Les réflexions qui suivent sont inspirées par le chapitre II du livre cinquième du célèbre roman hugolien. Victor Hugo (1802 – 1885) parsème son récit de quelques chapitres qui relèvent de la philosophie de l’Histoire, de la conception architecturale ou de la vision imaginaire du Paris médiéval (voir notamment le livre troisième). Car le roman se passe en 1482, date faisant partie intégrante du titre, millésime ravalé au rang de sous-titre ou carrément occulté au fil des innombrables éditions, adaptations cinématographiques ou conversions en comédies musicales.
Adrien Goetz, préfacier de l’édition 2009 chez Gallimard (coll. « Folio classique »), a le mérite de réhabiliter cette année 1482 sans insister sur sa proximité avec 1476 – 1477 : défaites de Charles le Téméraire à Grandson et Morat, sa mort à Nancy, extinction des derniers feux de ce que Julius Evola appelle « l’âme de la chevalerie », tandis que pointe comme une improbable aurore le pragmatisme calculateur de Louis XI. Nonobstant une importante réserve que je formulerai en conclusion, je trouve la préface d’Adrien Goetz remarquable et je m’incline devant l’étonnante érudition des 180 pages de notes de Benedikte Andersson.
Le volume contient aussi d’intéressantes annexes où l’on découvre sans surprise un Victor Hugo admirateur de Walter Scott, en face duquel Restif de la Bretonne fait piètre figure en apportant « sa hottée de plâtres » au grand édifice de la littérature européenne. Pourtant, Victor Hugo cite rarement ceux qu’il juge responsable du déclin des lettres françaises. Il ne fait qu’égratigner Voltaire, vitupère globalement les récits trop classiques dans des pages critiques où peuvent se reconnaître pour cibles l’Abbé Prévost, Madame de La Fayette, voire le Diderot de Jacques le Fataliste. Pour qui sait lire entre les lignes et connaît quelque peu la production littéraire du siècle des prétendues « Lumières », les considérations désabusées sur le roman épistolaire ne peuvent viser que Choderlos de Laclos et ses Liaisons dangereuses. Mais le chapitre II du livre cinquième vaut surtout par sa profondeur historique et une véritable théorie des trois âges de l’humanité que Victor Hugo nous invite à méditer avec une maîtrise stylistique et une organisation du savoir assez époustouflantes chez un jeune homme de 29 ans (Notre-Dame de Paris 1482 paraît en 1831).
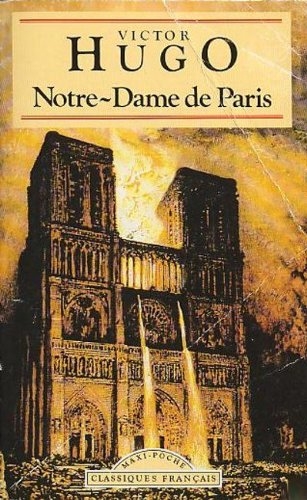 « Quand la mémoire des premières races se sentit surchargée, quand le bagage des souvenirs du genre humain devint si lourd et si confus que la parole, nue et volante, risqua d’en perdre en chemin, on les transcrivit sur le sol de la façon la plus visible, la plus durable et la plus naturelle à la fois. On scella chaque tradition sous un monument. » Ainsi Victor Hugo évoque-t-il le premier passage d’une ère d’oralité à un âge où l’architecture devient « le grand livre de l’humanité ». Souvenons-nous cependant de la parole biblique concernant la pierre que les bâtisseurs ont écartée et qui est justement la pierre d’angle. Le risque de « perdre en chemin » un élément essentiel deviendrait-il réalité dès que s’élèvent les premiers menhirs celtiques que l’on retrouve « dans la Sibérie d’Asie » ou « les pampas d’Amérique » ?
« Quand la mémoire des premières races se sentit surchargée, quand le bagage des souvenirs du genre humain devint si lourd et si confus que la parole, nue et volante, risqua d’en perdre en chemin, on les transcrivit sur le sol de la façon la plus visible, la plus durable et la plus naturelle à la fois. On scella chaque tradition sous un monument. » Ainsi Victor Hugo évoque-t-il le premier passage d’une ère d’oralité à un âge où l’architecture devient « le grand livre de l’humanité ». Souvenons-nous cependant de la parole biblique concernant la pierre que les bâtisseurs ont écartée et qui est justement la pierre d’angle. Le risque de « perdre en chemin » un élément essentiel deviendrait-il réalité dès que s’élèvent les premiers menhirs celtiques que l’on retrouve « dans la Sibérie d’Asie » ou « les pampas d’Amérique » ?
Toute tradition devant contenir une part de trahison (le latin tradition a donné le français traître), l’âge architectural serait alors le monde de la Tradition proprement dite, déjà synonyme de déclin par rapport aux temps originels et primordiaux, illuminés par la prodigieuse mémoire des « premières races ». Depuis « l’immense entassement de Karnac […] jusqu’au XVe siècle de l’ère chrétienne inclusivement », l’architecture est le mode d’expression dominant. Il ne faut pas pour autant tenir pour négligeable les autres fleurons artistiques et littéraires qui s’échelonnent tout au long de cette période plurimillénaire : les épopées et tragédies, l’Odyssée, l’Énéide et la Divine Comédie, dont on a pu écrire dans Éléments (n° 179, p. 68), qu’elles sont les trois piliers de la culture européenne. À plus forte raison, Victor Hugo mentionne les vénérables textes sacrés, et notamment le Mahabharata, dont l’auteur légendaire Vyasa « est touffu, étrange, impénétrable comme une pagode ».
Dans la Chrétienté médiévale, le style des édifices religieux romans est analogue à celui de l’architecture hindoue. La « mystérieuse architecture romane » est « sœur des maçonneries théocratiques de l’Égypte et de l’Inde », écrit Hugo. C’est une architecture de caste, où l’on ne voit que le détenteur de l’autorité sacerdotale. « On y sent partout l’autorité, l’unité, l’impénétrable, l’absolu, Grégoire VII; partout le prêtre, jamais l’homme; partout la caste, jamais le peuple. » « Qu’il s’appelle brahmane, mage ou pape, dans les maçonneries hindoue, égyptienne ou romane, on sent toujours le prêtre, rien que le prêtre. Il n’en est pas de même dans les architectures de peuple. »
Le style gothique est, selon Hugo, une « architecture de peuple ». Il assure la transition entre le Moyen Âge et les Temps modernes. Ceux-ci débutent avec l’invention de l’imprimerie. Avant de revenir en détail sur la vision hugolienne de la période gothique – passage du chapitre qui me semble le plus contestable -, brossons rapidement le tableau d’une modernité où la littérature devient l’art dominant, mais où les autres arts s’émancipent de la tutelle architecturale. « La sculpture devient statutaire, l’imagerie devient peinture, le canon devient musique. » L’architecture « se dessèche peu à peu, s’atrophie et se dénude ». Mais la littérature l’accompagne rapidement dans son déclin, hormis « la fête d’un grand siècle littéraire », qui est celui de Louis XIV et qui éclipse injustement Montaigne, Rabelais et la Pléiade.

L’objectif du romantisme est la résurrection simultanée de l’architecture et des lettres, ainsi qu’en témoigne l’engagement de Victor Hugo depuis la Bataille d’Hernani jusqu’à la mobilisation de son ami Viollet–le-Duc pour restaurer la cathédrale parisienne et l’Hôtel de Ville de Bruxelles. Achevé en 1445 sous le duc de Bourgogne Philippe le Bon, père de Charles le Téméraire, l’Hôtel de ville de Bruxelles est encore de style gothique et Victor Hugo saisit très bien le mouvement créatif qui s’étend de l’architecture religieuse à l’architecture civile en traversant les trois ordres dont Georges Duby démontre magistralement qu’ils constituent les fondements de l’imaginaire médiéval. « L’hiéroglyphe déserte la cathédrale et s’en va blasonner le donjon pour faire un prestige à la féodalité. » Mais il s’en va également orner les édifices qui font la fierté de la commune qui perce sous la seigneurie tout comme « la seigneurie perce sous le sacerdoce ».
Dans l’acception hugolienne du terme, le peuple apparaît comme l’opposition solidaire de toutes les couches sociales dominées contre la caste dominante, en l’occurrence le sacerdoce. Ce type d’antagonisme peut approximativement s’observer au cours de l’histoire des Pays-Bas espagnols. Plus encore que l’Église catholique, l’oppresseur est alors une forme de durcissement politico-religieux incarné par Philippe II et ses gouverneurs au premier rang desquels le sinistre duc d’Albe. La toile de Breughel intitulée Les Mendiants symbolise la solidarité de toutes les strates de la population des Pays-Bas contre la tyrannie hispano-chrétienne. Ce sont deux aristocrates, les comtes d’Egmont et de Hornes, qui prennent l’initiative de l’insurrection et qui sont décapités juste en face de l’Hôtel de Ville, devant le bâtiment qui abrite aujourd’hui le musée vestimentaire de Manneken-Pis !
Aux voyageurs désireux de découvrir ce patrimoine européen septentrional au rythme du flâneur dont Ghelderode fait l’éloge, et non dans la précipitation propre au tourisme de masse (voir l’éditorial d’Alain de Benoist dans la livraison d’Éléments déjà citée), je conseille de s’attarder au square du petit-Sablon, dont l’entrée est gardée par l’imposante statue d’Egmont et de Hornes, « populistes » ante litteram. Dans la lutte actuelle entre « populistes » et « mondialistes », les premiers peuvent-ils encore compter sur le Gotha et sur l’Église ? Car la caste dominante n’est plus le sacerdoce, mais une « hyper-classe mondialiste (Pierre Le Vigan) », une coterie de capitalistes revenus à leurs fondamentaux, à l’individualisme hors-sol et au déplacement massif de populations coupées de leurs origines, depuis la traite des Noirs jusqu’aux migrants d’aujourd’hui en passant par le regroupement familial des années 1970 transformant une immigration de travail en immigration de peuplement. Les déclarations pontificales et l’attitude des dernières monarchies européennes dévoilent plutôt une position favorable au mondialisme. Tout ceci ne nous éloigne de Victor Hugo qu’en apparence. Hugo est aussi « populiste » avant l’heure en attribuant au « peuple » une créativité, un peu comme Barrès l’accorde au « visiteur de la prairie », à la différence près que le rôle de la « Chapelle » barrésienne est d’orienter les élans et les rêves vers des fins spirituelles supérieures.
Chez Hugo, la créativité populaire, dont témoigne le foisonnement du style gothique, est magnifiée comme une sorte de préfiguration de la libre pensée. Hugo relève à juste titre que l’architecture gothique incorpore des éléments parfois « hostiles à l’Église ». Ce n’est pas à l’astrologie qu’il pense alors qu’il semble bien connaître la cathédrale de Strasbourg à laquelle on a consacré un livre entier décrivant ses innombrables figurations zodiacales.
L’hostilité à l’Église dans certains thèmes gothiques n’est pas une offensive anti-cléricale par le bas (catagogique, dirait Julius Evola), comparable à la critique pré-moderne qui va culminer chez un Voltaire dans ses imprécations contre « l’Infâme », mais l’affirmation d’un imperium supérieur à l’Église (dépassement anagogique, par le haut, de la théocratie pontificale). Julius Evola associe cette idée impériale gibeline au mystère du Graal dont Victor Hugo ne souffle mot et qui est pourtant contemporain de la naissance du style gothique. En effet, c’est entre le dernier quart du XIIe siècle et le premier quart du XIIIe siècle que prolifèrent les récits du cycle du Graal, comme s’ils obéissaient à une sorte de directive occulte, à un mot d’ordre destiné à la caste guerrière visant à la sublimer en une chevalerie en quête d’un élément essentiel perdu.
 Le thème du Graal est l’équivalent païen, au sens noble du terme, de la pierre d’angle biblique rejetée par les bâtisseurs. Énigmatique demeure à mes yeux cette phrase de René Guénon : « Le Graal ne peut être qu’un zodiaque. » Mais je suis convaincu que, pour déchirer le voile qui recouvre le mystère des origines, pour retrouver ce « grain d’or » dont parle l’astronome Kepler (1571 – 1630), il faut emprunter la voie de l’astrologie, domaine impensé de notre mouvance intellectuelle (du moins à ma connaissance), art antique vénérable raillé par La Fontaine et Voltaire, discipline dévoyée depuis quatre siècles, hormis quelques soubresauts : le marquis de Boulainvilliers (1658 – 1722), une école française aux alentours de 1900 (Caslant, Choisnard, Boudineau), une école belge (avec Gustave-Lambert Brahy comme figure de proue), les travaux plus récents de Gauquelin et Barbault (tous deux nés en 1920). Si le Graal est un vase, ce n’est pas exclusivement parce que Joseph d’Arimathie y a recueilli le sang de Jésus crucifié, mais c’est, par-delà sa dérivation chrétienne, par son identification plus générale à un récipient recueillant la pluie des influences cosmiques. Cet élargissement de la signification du Graal s’inscrit, soit dans la « Préhistoire partagée (Raphaël Nicolle) » des peuples indo-européens, soit dans une proto-histoire plus ample, ainsi qu’en témoigne le rapprochement d’Hugo entre les pierres levées d’Europe occidentale et celle de l’Asie sibérienne et de l’Argentine.
Le thème du Graal est l’équivalent païen, au sens noble du terme, de la pierre d’angle biblique rejetée par les bâtisseurs. Énigmatique demeure à mes yeux cette phrase de René Guénon : « Le Graal ne peut être qu’un zodiaque. » Mais je suis convaincu que, pour déchirer le voile qui recouvre le mystère des origines, pour retrouver ce « grain d’or » dont parle l’astronome Kepler (1571 – 1630), il faut emprunter la voie de l’astrologie, domaine impensé de notre mouvance intellectuelle (du moins à ma connaissance), art antique vénérable raillé par La Fontaine et Voltaire, discipline dévoyée depuis quatre siècles, hormis quelques soubresauts : le marquis de Boulainvilliers (1658 – 1722), une école française aux alentours de 1900 (Caslant, Choisnard, Boudineau), une école belge (avec Gustave-Lambert Brahy comme figure de proue), les travaux plus récents de Gauquelin et Barbault (tous deux nés en 1920). Si le Graal est un vase, ce n’est pas exclusivement parce que Joseph d’Arimathie y a recueilli le sang de Jésus crucifié, mais c’est, par-delà sa dérivation chrétienne, par son identification plus générale à un récipient recueillant la pluie des influences cosmiques. Cet élargissement de la signification du Graal s’inscrit, soit dans la « Préhistoire partagée (Raphaël Nicolle) » des peuples indo-européens, soit dans une proto-histoire plus ample, ainsi qu’en témoigne le rapprochement d’Hugo entre les pierres levées d’Europe occidentale et celle de l’Asie sibérienne et de l’Argentine.
Que Victor Hugo soit passé à côté de cette importante thématique note rien à la qualité de son chapitre que j’ai relu avec un intérêt admiratif et donc je vais conclure la recension en prenant mes distance par rapport à Adrien Goetz, excellent préfacier par ailleurs. Trois âges se succèdent donc dans la vision hugolienne du mouvement de l’Histoire. Le premier âge est celui de la transmission orale. Le deuxième est celui de la parole écrite et construite, où l’architecture est l’art dominant. Le troisième est celui de la parole imprimée, de la domination du livre, de la « galaxie Gutenberg » qui inspire en 1962 à McLuhan son ouvrage majeur.
Né à Besançon comme les frères Lumière, Victor Hugo assiste au balbutiement d’un quatrième âge que le préfacier Adrien Goetz nous convie à nomme l’âge des « révolutions médiologiques ». Cette nouvelle ère présente aujourd’hui le visage d’un « magma », le spectacle d’un « boueux flux d’images » avec pour fond sonore « le bruissement des images virtuelles et des communications immédiates ». Ses lucides observations n’empêchent pas le préfacier de rêver que « l’œuvre d’art total du XXIe siècle » puisse surgir bientôt de la toile d’araignée réticulaire en offrant aux générations futures un éblouissement comparable à celui que génère la lecture d’Hugo ou de Proust. Adrien Goetz va plus loin : « Les multimédias […] sont les nouvelles données de l’écriture peut-être, bientôt, de la pensée. » Il appelle de ses vœux « une sorte de cyberutopie ». Mais qu’elle soit « œuvre-réseau », livre imprimé, monument de pierre ou litanie psalmodiée des premiers temps d’avant l’écriture, l’utopie ne peut s’appuyer que sur les invariants anthropologiques qui, précisément, se désagrègent au fil de « la généralisation de la webcam ».
Ces invariants sont l’espérance d’un au-delà transfigurant, la certitude d’un en-deçà déterminant, la nécessité d’une Gemeinschaft hiérarchique ne faisant toutefois pas l’économie de la justice. Ils sont certes remis en question depuis plusieurs siècles, mais c’est l’individualisme post-moderne qui en constitue le contre-pied parfait. En même temps que les « liens hypertextes », qu’Adrien Goetz destine à une transmutation comparable à celle des alchimistes, s’affirme un type humain dominant dénué d’élan spirituel, oublieux de ses atavismes et fiévreusement lancé dans une course au plaisir qu’il s’imagine régie par l’« égalité des chances ».
Daniel Cologne



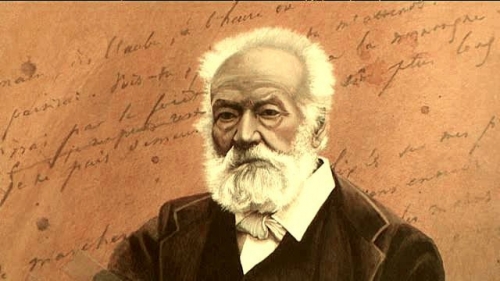

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
Les commentaires sont fermés.