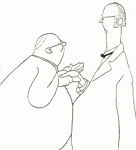Le retour de la «communauté» dans la pensée politique américaine par Robert STEUCKERS
(intervention lors du séminaire de l'association «Synergies européennes» à Roquefavour en Provence en janvier 1995, à l'Université d'été de la FACE en Provence en juillet 1995 et à la tribune du «Cercle Hermès» de Metz en Lorraine en février 1996)
analyse:
- Walter REESE-SCHÄFER, Was ist Kommunitarismus?, Campus, Frankfurt am Main, 1994, 191 p., DM 26, ISBN 3-593-35056-4.
- Martha NUSSBAUM, Gian Enrico RUSCONI, Maurizio VIROLI, Piccole Patrie, Grande Mondo, Reset/Donzelli editore, Milano, 1995, 64 p., Lire 8000, ISBN 88-7989-147-2.
- Charles TAYLOR, «Wieviel Gemeinschaft braucht die Demokratie?», Jerzy SZACKI, «Aus einem fernen Land. Kommentar zu Taylor», Otto KALLSCHEUER, «Individuum, Gemeinschaft und die Seele Amerikas», Bert van den BRINK, «Gerechtigkeit und Solidarität. Die Liberalismus/Kommunautarismus-Debatte», Susan M. OKIN, «Für einen humanistischen Liberalismus», in Transit/Europäische Revue, Nr. 5, Verlag Neue Kritik, Frankfurt am Main/Institut für die Wissenschaften vom Menschen (Spittelauer Lände 3, A-1090 Wien), Winter 1992/93, 190 p., DM 20, ISSN 0938-2062, ISBN 3-8015-0267-8. Notre projet, tant dans le cadre de cette initiative paneuropéenne qu'est «Synergies européennes» que dans celui de l'UFEC, embryon de parti politique que nous activerons quand les temps viendront, est un projet “euro-communautaire” dans le sens où il ne voit pas d'autre avenir pour l'Europe que dans une prise en compte et une organisation des communautés vivantes qui structurent effectivement, sur un mode complexe et varié, la vie des peuples sur notre continent et non pas dans la création d'un gigantesque moloch technocratique ou dans la répétition stérile des formes politico-administratives sclérosées, propres à l'Etat-Nation du XIXième siècle.
Pourquoi avoir choisi ce terme de «communauté», alors même que le sens de ce vocable de la science politique et/ou de la sociologie peut varier considérablement d'une langue à l'autre et d'un contexte politique à l'autre? «Communauté» peut désigner effectivement un groupe d'hommes de même origine, vivant sur un même territoire ou pratiquant des activités économiques en interaction constante. Mais «Communauté» peut désigner aussi la partie d'un Etat bénéficiant d'un degré d'autonomie plus ou moins grand, dont les ressortissants parlent tous une même langue, souvent minoritaire ou minorisée, partagent une culture identique ou une confession déterminée; c'est notamment cette notion-là de «Communauté» qu'utilise le droit constitutionnel espagnol actuel, quand il a instauré son «Etat asymétrique de communautés autonomes», où les communautés sont les entités basques ou catalanes, etc.; de même, le terme «communauté» désign(ai)ent aussi les instances européennes mises en place à Bruxelles, Luxembourg et Strasbourg, au début du processus d'unification européenne.
Nous avons choisi ce terme parce qu'il recèle d'emblée une connotation sympathique, demeurant malgré tout contestatrice du désordre établi, tant à gauche, où il évoque la solidarité dans le combat social, qu'à droite, où l'on garde la nostalgie des “holismes” traditionnels qui ont précédé la blessure moderne et industrielle. Qui dit «communauté», qui fait de la «communauté» l'unité de base de sa pensée politique, parie de fait pour les hommes réels, les hommes de chair et de sang, de labeur et de créativité, contre les visions abstraites de l'homme, où celui-ci n'est plus qu'une unité dissocié d'un tout préalable, jugé obsolète et combattu comme anachronisme, ou un rouage d'une mécanique débarrassée de toutes valeurs et de toute mémoire. Le message des “communautariens” est universel en tant qu'il implique la défense de toutes les communautés d'hommes réels dans le monde, et qu'il implique ou devrait impliquer la volonté de généraliser ce principe à l'échelle du continent européen et, par extension, du monde tout entier.
Pour bien cerner la signification du terme sociologique de «communauté», il convient au préalable de faire référence à des notions scientifiques bien précises, établies par quelques grandes figures de la sociologie moderne, voire de la philosophie:
1. Ferdinand TÖNNIES.
2. François PERROUX.
Tous deux nous ont livré la définition la plus scientifique et la plus précise du terme «communauté» dans le contexte européen. Malheureusement l'exploration et l'exploitation de leurs écrits s'avèrent de plus en plus problématiques et de moins en moins médiatisables, surtout dans l'espace linguistique francophone où le recul de la culture et l'effondrement de l'enseignement ne permettent plus d'aborder des corpus scientifiques complexes. Raison pour laquelle, dans le contexte actuel, il nous paraît urgent de faire systématiquement référence aux «communautariens» américains qui ont abordé les questions «communautaires» dans un langage plus plastique et plus accessible, surtout dans un pays comme les Etats-Unis où il n'y a plus, depuis longtemps, de corpus classique dans les établissements d'enseignement et où la philologie classique n'a même plus l'importance qu'elle a vaguement conservée dans nos “humanités”. La médiatisation outrancière a obligé les intellectuels américains à une sorte de concision didactique, que nous sommes, nous aussi, obligés d'utiliser désormais.
3. Le nouveau débat inauguré par les COMMUNAUTARIENS américains, où bon nombre d'aspects de la notion de «communauté» sont abordés sous des angles chaque fois différents.
4. Un parallèle devrait être tracé, nous semble-t-il, entre la définition sociologique de la «communauté» (chez Tönnies et Perroux) et la définition religieuse qu'en donnaient Hauer (Das Gemeinde) et Buber (la dialogique du «Je » et du «Tu»).
Ferdinand Tönnies (1855-1936)
En 1887, paraît l'ouvrage scientifique majeur de Ferdinand Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft, où il définit deux concepts fondamentaux de la sociologie moderne et les place en opposition:
a) La «communauté» (Gemeinschaft), regroupant des personnes de même origine, ayant entre elles des liens de sang ou des liens familiaux, partageant des sentiments communs et un destin commun, faisant appel à la mémoire. La «communauté» est en quelque sorte un élargissement du contexte familial et villageois traditionnel. Tönnies était en effet issu d'une communauté de paysans et de pêcheurs de la côte occidentale du Slesvig-Holstein qui n'a jamais connu le servage et a maintenu intacts les ressorts de la vieille communauté traditionnelle germanique. L'aliénation moderne et capitaliste n'avaient guère eu prise sur ces sociétés, elles recelaient en elles les ingrédients d'une résistance efficace aux processus d'aliénation, qui méritaient d'être maintenus et entretenus. La liberté collective implicite qu'elles incarnaient étaient un leg positif du passé, exemplaire pour tous ceux qui, au contraire, avaient été jetés dans les affres d'une forme moderne d'aliénation. Par ailleurs, l'excès de communauté conduit à la répétition du même, en dépit des mutations du contexte environnant, et à la stagnation.
b) La «société» (Gesellschaft) dont le mode de fonctionnement est mécanique et purement utilitaire. Les excès de société conduisent à l'anomie, au désordre social et à la domination de tous les héritages par des flux incontrôlables, urbains et lointains. Dans cette optique, l'hypertrophie de l'existence urbaine et commerçante détruit toutes les solidarités profondes et finit par ruiner la notion même de peuple.
Toute l'ambiguïté du socialisme organisé en parti se repère dans cette dichotomie mise en exergue par Tönnies: en effet, le socialisme veut la solidarité, qui est intacte dans la Gemeinschaft, mais il sacrifie au mythe moderniste qui détruit les vecteurs spontanés et irrationnels de cette solidarité, implicite dans la normalité communautaire.
Qu'est devenue la sociologie de Tönnies?
1. Elle a plu aux réactionnaires de droite, qui voulaient restaurer les holismes de l'ancien régime. Elle a plu aux pastoralistes de gauche, aux gauches utopiques, parce qu'elle semblait se démarquer des rigueurs et des horreurs de l'industrialisation (travail des enfants dans les mines, exploitation des femmes, absence d'hygiène de vie, etc.). Enfin, elle a plu aux mouvements de jeunes de droite comme de gauche, notamment le Wandervogel allemand et ses avatars ultérieurs, ainsi qu'à tous ceux qui oscillaient, indécis, entre la droite et la gauche.
2. Elle a déplu aux nationaux-socialistes, dont la propre notion de «communauté» différait considérablement de celle définie par Tönnies, dans le sens où elle désignait un ensemble beaucoup plus large, englobant tout le peuple allemand (voire tous les peuples germaniques), pourtant composé d'une multitude de communautés réelles, circonscrites dans des champs spatio-temporels ou socio-professionnels bien délimités. Cette hypertrophie de la «communauté» dans le contexte national-socialiste démontre le caractère non holiste de la définition nationale-socialiste de la «Volks-gemeinschaft», de même, elle révèle le projet fondamentalement moderniste dont cette pratique politique était porteuse, à la notable exception des associations paysannes, du moins jusqu'en 1942. L'utilisation d'une notion différente de la «communauté», le modernisme implicite du projet national-socialiste, et, face à cela, l'exception paysanne, font toute l'ambiguïté de ce régime en matière de praxis sociologique. Peu après la prise du pouvoir par Hitler, Tönnies, qui entend rester fidèle à son engagement social-démocrate, est privé de sa pension. Il meurt en 1936.
3. Elle a déplu aux marxistes, surtout aux intellectuels. Georges Lukacs condamne la sociologie de Tönnies comme “irrationnelle” et lui reproche d'avoir soutenu le “réformisme” au sein de la sociale-démocratie allemande, notamment le mouvement des “Genossenschaften” (des coopératives et des syndicats autonomes), car, affirme le théoricien hongrois du marxisme contemporain, ces “Genossenschaften” sont vectrices d'une re-communautarisation (re-holicisation) à l'intérieur même de la société capitaliste, alors qu'il faudrait une rupture totale et définitive, tant avec le capitalisme qu'avec les résidus de “féodalité” (ce dernier concept étant bien entendu flou et extensible). En fait, Lukacs reproche à Tönnies d'étendre les concepts jusqu'à les rendre “anti-historiques”, c'est-à-dire “romantiques” et “anti-scientifiques”. Lukacs prend là le relais de Marx et d'Engels quand ils condamnent les socialismes utopiques et quand ils s'opposent à Dühring qui avait cultivé, au sein du socialisme allemand, quand celui-ci n'était pas encore entièrement sous la coupe des marxistes, des notions vitalistes et non plus mécanicistes.
Que faut-il penser, ici, de ce concept d'“anti-historicisme” avancé comme une machine de guerre contre la sociologie de Tönnies, le mouvement des Genossenschaften et les syndicats autonomes (parfois héritiers de vieux réflexes corporatifs)? Que la vision marxiste demeure prisonnière de préjugés modernistes et bourgeois, dans le sens où la bourgeoisie entendait se libérer de toutes les formes de carcans institutionnels traditionnels, pour laisser place au libre jeu incessant et dissolvant de l'économie, c'est-à-dire de son économie de classe. L'histoire pour les modernistes, les libéraux et les marxistes, ce n'est pas de construire, de défaire et de recomposer des institutions au profit du Bien commun ou d'ériger des garde-fou institutionnels contre la fluidité absolue de l'argent-roi, mais de participer à tous les processus de dissolution, y compris, en un certain sens, ceux du capitalisme, pour que plus aucune barrière ne puisse se dresser contre le “fluidisme” planétaire de celui-ci, surtout dans sa variante spéculatrice, comme nous le constatons depuis deux décennies. Le “progrès”, ainsi défini, est essentiellement négatif.
Sur le plan purement politique, la «communauté», tant qu'elle reste intacte, reste en-deça, en marge du capitalisme réel qui, lui, va accoucher, par dialectique, du socialisme définitif, contre lequel plus aucune institution ne pourra se dresser, vu qu'elles auront toutes été dissoutes.
4. La sociologie de Tönnies revient au grand galop aujourd'hui dans la sociologie universitaire américaine, qui tire les leçons de l'effondrement social aux Etats-Unis et de l'anomie qui frappe cette société, dans des proportions inégalées dans l'histoire. L'analyse sociale au départ de la dichotomie Communauté/Société est revenue en Amérique quand des sociologues se sont repenchés sur les différences sociologiques entre villes et campagnes. Depuis, le regain d'intérêt pour la «communauté» n'a cessé de s'amplifier et d'aborder la question sous tous les angles.
Mais une compréhension globale du nouveau «communautarisme» américain ne pourrait être optimale, à nos yeux, que si on replace la problématique toute entière dans le contexte de l'œuvre de Tönnies.
1. Tout comme Tönnies (et Carl Schmitt), les communautariens américains amorcent leurs réflexions au départ d'une réception de l'œuvre de Hobbes et de sa théorie du contrat. Le contrat met un terme à l'“état de nature”, dit Hobbes, qui est un état de guerre de tous contre tous, où «l'homme est un loup pour l'homme», mais amorce par ailleurs —et quasi simultanément— une rationalisation outrancière des relations et des comportements sociaux et, en parfaite concomitance, une neutralisation de toutes les valeurs cimentantes de la société. Hobbes reste celui qui a le mieux pensé la toile de fond tragique qui se profile derrière toutes les quiétudes politiques à l'œuvre dans l'histoire et qui a élaboré théoriquement les mécanismes (quasi euclidiens) les plus efficaces pour contenir cette tragédie fondamentale hors de tout commonwealth humain; mais en dépit de ce mérite de Hobbes, il n'empêche que le contrat, —surtout tel qu'il sera repris et transformé par Locke et, à sa suite, les contractualistes anglo-saxons—, par la rationalisation pratique et la neutralisation axiologique qu'il implique, fait revenir, à l'avant-plan et au bout de processus plus ou moins longs, le tragique refoulé hors de la cité par le Léviathan, artifice voulu par le souverain et perçu au départ comme éminemment positif. A long terme, le contrat n'empêche pas —et même favorise— la généralisation de l'anomie qui, elle, restaure les horreurs de la guerre civile, non plus entre factions politiques bien profilées, mais entre individus ou bandes d'individus sans projets de société cohérents, mus par leur seul désir d'acquérir illégitimement les biens d'autrui ou d'obtenir frauduleusement des avantages personnels.
2. Dans la formulation de sa théorie, Tönnies dit être fortement redevable au politologue, sociologue et “organologue” Albert Schäffle, notamment à son livre Bau und Leben des sozialen Körpers. Schäffle raisonne en termes organiques et biologiques, ne transforme pas le fonctionnement de l'économie et de la société en un jeu de purs mécanismes. Tönnies reconnaît sa dette envers les conceptions juridiques de von Ihering et à la politologie romantique et conservatrice d'Adam Müller (Die Elemente der Staatskunst), au marxisme et à l'école historique des économistes allemands (Rodbertus et Adolf Wagner). Ensuite, dans la genèse de son œuvre, il revendique l'héritage des théories de Bachofen et de Morgan sur le matriarcat, puis des hypothèses de Hearn (The Aryan Houshold), de Fustel de Coulanges (La Cité antique) et du juriste allemand Leist sur les socialités primitives. La communauté, résume Tönnies, s'exprime par la famille, la vie villageoise morale et la vie urbaine religieuse. La société s'exprime par l'existence que mènent les hommes dans les mégapoles, existence fondée sur les conventions. Ensuite, par une vie nationale entièrement déterminée par la politique politicienne, puis, par une vie cosmopolite marquée par l'opinion publique, chapeautée par la “République des Intellectuels”.
La Communauté selon François Perroux
En 1942, François Perroux sort un opuscule définitionnel particulièrement bien charpenté, intitulé La communauté. Il précise la notion et complète de la sorte Tönnies. Perroux distingue:
1) La communauté amorphe, qui est une communauté résiduaire, survivant dans un monde entièrement dominé par le modèle sociétaire. Le risque de voir disparaître tout dynamisme dans ces communautés résiduaires n'avait pas été très bien perçu par Tönnies et ses vulgarisateurs.
2) La communauté structurée selon les legs de l'histoire présente des hiérarchies efficaces. Cette communauté est efficace si elle est simultanément organisée, si un appareil organisé lui confère des règles, des règles juridiques qui reflétent dans une formulation abstraite l'essence communautaire de ces structures.
Le problème, déjà perçu par Simmel, survient quand il y a divorce entre structure et organisation. François Perroux écrit (p. 69): «Le divorce entre l'organisation et les structures des communautés se déclare, ..., quand le législateur part d'un système idéologique, d'un ensemble d'idées préconçues pour énoncer les règles sociales, établir les découpages territoriaux et professionnels, construire les appareils de commandement et d'administration. Il n'épouse pas alors avec délicatesse et souplesse les contours du réel. Il prétend plier le réel à un moule idéologique et abstrait». En résumé, la société prend le pas sur la communauté et sur les structures communautaires quand l'organisation se détache de l'héritage communautaire. François Perroux démontre qu'il y a deux façons de s'en détacher: a) on passe à une organisation proprement sociétaire qui impose la contrainte (l'imperium), le commandement par l'injonction ou par la loi; b) on passe à une organisation associationniste, centrée sur le contrat entre des libres volontés qui s'entre-limitent et procèdent à des jeux détachés des flux réels et charnels de l'existence.
La revendication communautaire s'oppose à ces deux modèles, coercitif et cattalexique, en se fondant sur un consensus. Perroux explique (p. 70): «Une organisation est communautaire pleinement, une organisation exprime et valorise une communauté lorsqu'elle fait appel aux ressorts psychiques de cette communauté et en épouse autant qu'il est possible les structures spontanées. Il faut donc qu'elle ne contrarie pas, mais bien plutôt qu'elle favorise la fusion des activités et des consciences (...). Il faut aussi qu'elle ne mette pas en péril, soit en l'anéantissant, soit en la bureaucratisant, la hiérarchie des fonctions et des situations complémentaires de la communauté». Pourquoi Perroux valorise-t-il l'organisation communautaire? Parce que l'homme, dit-il, est homme s'il a un rôle historique, s'il est une personne, c'est-à-dire un acteur sur la scène de l'histoire [de sa Cité]. Cela implique: a) qu'il soit une partie consciente et active dans un ensemble; b) qu'il soit une force qui s'exerce durablement dans un sens déterminé au cours d'un drame (qui est l'histoire de sa communauté ou de son peuple). La personne humaine, dans la perspective communautaire selon Perroux, se définit dans le drame humain (dans l'histoire). L'individu qui ne suit que sa fantaisie, qui cède aux pressions de l'instinct ou aux calculs de l'égoïsme ne joue pas un rôle: il reste en marge du drame permanent qu'est sa communauté.
Deux conceptions du rôle historique de l'homme communautaire existent:
1. L'homme communautaire-historique adhère à des valeurs et veut les incarner dans l'histoire. Soit il réussit et modèle alors les communautés selon les canons des valeurs qu'il a choisies. Dans l'absolu, ces valeurs, avant d'être incarnées, sont en marge des communautés réelles. Mais les valeurs sont éternelles et si elles ne sont pas incarnées par l'élite de telle communauté, elles seront incarnées demain par celle d'une autre communauté. Pour Perroux, qui révèle là son héritage catholique, adhérer à des valeurs, ce n'est pas se soustraire au drame de l'histoire, mais au contraire se mouler dans ce drame et donner aux valeurs un ancrage spécifique, non interchangeable.
2. L'homme communautaire-historique choisit de jouer un rôle dans la pure immanence, soit dans la lutte des classes (communisme), soit dans la lutte des races (national-socialisme). Le risque, quand on s'enferme dans de telles luttes, c'est d'éteindre ou d'œuvrer à éteindre les dynamiques et les échanges qui demeurent même dans l'antagonisme; on se ferme à tout dialogue sur base de valeurs communes, existant de part et d'autre de la ligne de front, éventuellement sous d'autres modalités.
Le débat américain actuel sur le communautarisme
Le débat actuel aux Etats-Unis ramène sous les feux de la rampe la notion de communauté, refoulée depuis quelques décennies hors du champ de la sociologie universitaire.
Si le débat est actuel, la maturation de définitions nouvelles de la communauté, les approches conceptuelles innovantes en cette matière, sont à l'œuvre ou se forgent depuis assez longtemps: Michael Sandel a développé une critique de l'égoïté déliée, Charles Taylor une critique de l'individu atomisé, Alasdair MacIntyre a conceptualisé un système complexe faisant appel à l'esthétique, Robert Bellah revendique une logique du cœur, Ben Barber réhabilite la notion de commune, Martha Nussbaum a construit un “aristotélisme social-démocrate” et Michael Walzer a œuvré à revaloriser les “sphères de justice” subsistant dans nos sociétés.
Pourquoi ce renouveau?
1. Parce qu'il est devenu urgent de développer une critique générale devant les dégâts sociaux causés par l'atomisation outrancière de la société américaine actuelle: les hommes y ont perdu tous référents.
2. Cette perte de tous référents fait qu'il est impossible de maintenir une démocratie viable sans vertus civiques.
3. S'il n'y a plus de vertus civiques, si celles-ci ne peuvent plus s'exprimer, il n'y a plus de liens, donc plus de valeurs, dans la société. Liens et valeurs, constatent les communautariens, ne peuvent pas être générés par des codes moraux abstraits qui demeurent largement incompris et inaccessibles au commun des mortels. Restaurer les vertus civiques implique donc de refaire appel au vécu, aux valeurs réellement vécues, aux comportements traditionnels. Le philosophe ou le sociologue qui entend défendre sa Cité et/ou sa famille ne peut dès lors plus partir d'“idées générales” mais seulement de “cas concrets”.
Cet abandon nécessaire des idées générales postule une réorientation complète du débat et implique un dépassement de la dichotomie gauche/droite. En effet, dans leur souci de restaurer des valeurs civiques dans la société américaine, les communautariens ont été obligés de sortir des sentiers battus d'une sociologie qui n'avait exploré que des filons de gauche. La nécessité d'innover les oblige a procéder à une fertilisation croisée (cross-fertilization) des discours de la droite et de la gauche, dans le sens où celles-ci s'opposent toutes deux au libéralisme, idéologie dissolvante des liens unissant les hommes. Une nouvelle opposition se dessine à l'horizon: la gauche axiologique et la droite axiologique (Wertkonservativismus) s'opposent désormais de concert au libéralisme, idéologie dominante dans les sociétés occidentales qui a généré une permissivité incontrôlable.
La critique de Michael Sandel
Michael Sandel a commencé sa quête en voulant “remoraliser” la société sur base d'un ouvrage fondamental, qui fit beaucoup de bruit aux Etats-Unis il y a dix-sept ans, en 1979, A Theory of Justice de John Rawls. Cet ouvrage dès sa parution a connu un grand succès, hélas vite éclipsé. Il n'est revenu à l'avant-plan qu'après la parenthèse reaganienne et néo-libérale. Rawls, puis Sandel, sont partis d'une réévaluation de l'œuvre de Hobbes. La convivialité, le consensus ne sont plus menacés aujourd'hui par l'Etat de Nature mais par des conflits d'intérêts, qui ont pour objet la redistribution. Ces conflits permanents ruinent en bout de course les ressorts coopératifs de la société. Pour remettre en état ces ressorts coopératifs, il faut créer des normes pour aboutir à une justice fondée sur la fairness. Mais qui dit “normes”, dit retour à la philosophie normative, rejetée dans les pays anglo-saxons à la suite de l'empirisme logique et de “la philosophie du langage quotidien” d'Oxford. Dans cette optique, les jugements de valeur n'exprimeraient aucune réalité. Les valeurs sont donc évacuées. Elles découleraient d'anomalies et d'ambiguïtés de langage et, de ce fait, toute philosophie s'occupant de normes ou de valeurs serait considérée comme vide de sens. Rawls dénonce cette variante du libéralisme idéologique, plus en vogue chez les conservateurs que dans la gauche anglaise et américaine. Sa dénonciation a provoqué deux réactions:
1. Première réaction: la défense et l'illustration de normes rationnelles universellement valables, lesquelles seraient les valeurs intangibles et indépassables du libéralisme, idéologie dominante. Telle sera l'option de Nozick (Anarchy, State, Utopia, 1974) et de Buchanan. Nozick s'inscrit dans la tradition de Locke: il existe, affirme-t-il, des droits naturels donnés une fois pour toutes; seuls les Etats en conformité avec ces droits naturels sont légitimes. Ces Etats sont des agences protectrices de ces droits fondamentaux définis une fois pour toutes. Tel est le nouveau rôle dévolu à l'Etat minimal des libéraux. Toujours dans cette optique nozickienne, les modèles particuliers de redistribution sont illégitimes et doivent être combattus. La critique des communautairens à l'égard de cette réaction “fondamentaliste” occidentale s'articule autour de trois questions: a) Où est la justification ultime de ces droits fondamentaux? b) L'affirmation de l'illégitimité des modèles particuliers de redistribution ne conduit-elle pas à la destruction de toute sphère publique? c) La destruction de toute sphère publique ne conduit-elle pas à l'absoluisation du marché et à la mort du politique? Les communautariens, à la suite de Sandel, s'opposent ainsi à tout constructivisme méthodologique (ce qui pourrait être considéré comme une interprétation non libérale et non individualiste de Hayek) et s'opposent aussi à toute anthropologie qui manipule des modèles détachés de l'histoire ou de toute autre concrétude sociale.
MacIntyre et Taylor partagent cette critique de Sandel. Qui a imméditament eu des retombées militantes: elle a aidé les écologistes à formuler une éthique écologique; elle a permit de conceptualiser l'idée d'un contrat entre les générations; elle a consolidé le mouvement de “désobéissance civile”. Examinons cette critique de plus près. Sandel demande: où se trouve le fondement concret de cette option communautarienne pour la justice (Rawls) et la fairness? Il répond: dans la communauté des hommes et non pas dans un discours comme chez Nozick et Buchanan. Car ceux-ci procèdent à une réduction de la philosophie politique à un simple énoncé de normes et à une simple justification de ces normes énoncées. Et si l'on pose la question de Carl Schmitt aux partisans d'une philosophie politique similaire à celle de Nozick, quis judicabit? Qui juge? Ou, plus exactement: qui énonce les normes? Il n'est pas difficile de répondre à cette question dans le contexte actuel: les media. Mais ceux-ci n'ont aucune légitimité démocratique. Comme l'énoncé des normes sociales et politiques est laissé à quelques “prêtres” médiatiques et médiatisés, et non plus à la communauté des hommes réels de chair et de sang, imbriqués dans les flux réels de la vie et de l'économie, nous assistons à un appauvrissement graduel et à une hyper-moralisation de la pensée politique. Le risque est alors celui du solipsisme permanent, du détachement par rapport au drame concret.
La critique de Charles Taylor
La critique de Taylor est également, au départ, une critique des positions de Nozick, en qui il voit la quintessence de l'atomisme social. Taylor avance deux arguments majeurs: 1. Premier argument: aucune tradition philosophique classique ne pose l'homme comme un individu isolé. Pour Aristote, l'homme est par nature un zoon politikon, qui ne jouit pas d'une pleine indépendance, qui n'est pas totalement détaché des autres hommes et n'est jamais auto-suffisant. Taylor réclame là le retour à un filon fécond, celui qui part d'Aristote, passe par Thomas d'Aquin pour aboutir au Romantique Adam Müller et à Othmar Spann. Dénominateur commun de ce filon, mis en exergue par Spann en son temps: aucune sociologie n'est possible avec la méthodologie individualiste; l'universalisme (selon Spann et non pas selon les tenants de l'individualisme et du libéralismes absolus qui sévissent à Paris depuis une quinzaine d'années) insère l'individu dans un ordre supérieur, qui est l'ordre naturel. 2. Deuxième argument: l'individualisme absolu conduit au paradoxe; l'individu peut effectivement dire: “j'ai des droits: pour les faire valoir, je dénie à mes concitoyens, à mes prochains, et même à mes descendants le droit d'exercer leurs droits si ceux-ci me contrarient; cependant, pour faire valoir les leurs, ils peuvent me dénier le droit d'exercer les miens”. D'où droits et devoirs doivent être mis sur le même pied. On ne peut pas, sans verser dans le paradoxe, définir les droits de l'homme sans dresser simultanément le catalogue de ses devoirs vis-à-vis de la communauté.
Ces deux arguments de Taylor conduisent à formuler une question fondamental, surtout à l'ère d'anomie que nous vivons: de quel degré de “communauté” la démocratie a-t-elle besoin? Taylor dresse une typologie:
1. Dans la démocratie économique, telle que nous la connaissons en Occident et telle qu'elle apparaît dans sa forme la plus pure aux Etats-Unis, la forme politique de la société est un instrument pour les individus, pour qu'ils atteignent leurs objectifs individuels, et non pas un instrument pour les communautés, pour qu'elles atteignent une harmonie optimale et garantissent une continuité. Dans cette démocratie économique et individualiste, le militantisme politique des citoyens est un facteur de désordre parce qu'il crée des réflexes collectifs et communautaires non prévus par la rationalité libérale. Ensuite, la décision politique doit être entièrement abandonnée aux professionnels de la politique qui, eux, connaissent les règles et savent les appliquer en dépit des vicissitudes d'un réel auquel ils ne se frottent plus. Question de Taylor: où est le vertu liante (Montesquieu) dans cette démocratie économique? Poser cette question revient à envisager et à espérer l'avènement d'une démocratie avec vertu liante. Taylor l'appelle la “communauté démocratique”.
2. Reconstruire la “communauté démocratique” passe par la réactivation d'un sentiment de solidarité, par une participation effective aux décisions politiques, par le respect mutuel entre les membres de la communauté, par une économie fonctionnante, équilibrée entre l'entreprise privée de grandes dimensions et les propriétés collectives (ce qui nous apparaît flou). La “communauté démocratique” n'est rien d'autre que le retour de la societas civilis, c'est-à-dire la forme concrète d'une société civile garantissant liberté et dignité.
3. La critique de la démocratie économique, la volonté de restaurer la vertu liante et la “communauté démocratique” (alias la societas civilis) impliquent une critique de la liberté négative, cher aux maximalistes libéraux. Taylor fonde sa critique sur les définitions formulées par Sir Isaiah Berlin dans Two Concepts of Liberty. Pour Berlin, la liberté négative refuse tous les freins extérieurs à ma liberté; les institutions doivent veiller à éliminer le maximum de ces freins. La liberté positive est une liberté qui ne se considère possible que dans un cadre collectif; celui-ci doit être respecté, posé comme intangible, comme un bloc d'idées incontestables forgeant en ultime instance le consensus général. Cette liberté positive est celle de la vieille Rome républicaine, celle de Tocqueville, Jefferson et Machiavel (qui parlait de virtù dans un sens analogue à celui de “vertu liante”). Pour Berlin, la liberté positive est totalitaire. Seule la liberté négative est véritablement liberté. Taylor réfute cette option ultra-libérale, voire anarcho-libérale, d'Isaiah Berlin et travaille à revaloriser la liberté positive.
L'Irlandais Alasdair MacIntyre, qui enseigne aux Etats-Unis, estime, pour sa part, que la crise morale de notre temps a besoin d'un “remède aristotélicien”, c'est à dire à un retour à la notion non individualiste et purement politique de “zoon politikon”. MacIntyre distingue trois phases dans le déclin de la structure communautaire, trois phases de déperdition graduelle de la “vertu liante”: 1. On commence, par le truchement d'une sorte de “mauvaise conscience” qui émerge parce que le consensus s'étiole, par justifier les pratiques normatives de la société dans les contextes existentiels de la vie quotidienne et politique; Carl Schmitt estime qu'en cette phase, il n'y a pas encore détachement complet par rapport à la sphère vitale du peuple; 2. La phase d'Aufklärung proprement dite: le détachement d'avec la sphère vitale est consommé. Dans la civilisation occidentale, cette phase s'étend de Descartes à la Révolution Française; 3. Aujourd'hui nous vivons sous l'emprise d'un cynisme post-Lumières, à l'ère d'une raison purement instrumentale qui camoufle sa rationalité froide derrière un rideau d'“émotivisme”. MacIntyre plaide pour un retour à l'histoire, à la tradition, à un rattachement à la sphère vitale historico-traditionnelle. Sa maxime: pas de morale possible sans communauté.
Robert Bellah déploie une “logique du cœur”, ou plutôt une logique calquée sur les “habitudes du cœur”. Il propose, dans ce contexte, que les communautés encore existantes, ou les résidus de communauté appelés à les reconstituer éventuellement, soient protégées contre la “tyrannie du marché”. Cette proposition découle d'un constat: “L'idéologie économiciste, qui transforme les gens en facteurs de maximisation du marché, sape leur engagement [naturel et spontané] au sein de leur famille, de leur église, de leur communauté de voisinage, de leur école et même leur engagement envers les grandes sociétés et idées étatiques ou globales”. Aux Etats-Unis, la négligence des facteurs sociaux (communautaires et/ou collectifs) en faveur d'une maximisation du profit individuel a provoqué un effondrement très problématique de la socialité. La critique de Bellah prend en quelque sorte le relais de celle formulée dans les années 60 par David Riesman (La foule solitaire) et de celle formulée dans les années 80 par Christopher Lash (Le complexe de Narcisse) ou par Richard Sennett (The Fall of Public Man). Bellah lance un appel pour une nouvelle “religion civile”, difficile aux Etats-Unis.
Ben(jamin) Barber, dans le clan des communautariens, développe une conception plus activiste que contemplative héritée de son engagement dans les rangs de la “nouvelle gauche”. Le point fort de sa critique réside dans la distinction qu'il opère entre libéralisme et démocratie. Le libéralisme est à ses yeux anarchie, égoïsme et anomie. Il professe là le contraire de ce que professaient Nozick ou Berlin. La démocratie est d'autant plus forte qu'elle accroît la participation des citoyens à tous les niveaux de décision. Contre le libéralisme, il faut réactiver la citoyenneté. La dimension critique du travail de Barber consiste à dire que le libéralisme n'est qu'une “démocratie faible”, que le libéralisme est “newtonien” dans le sens où sa méthodologie sociale est celle du simplisme géométrique. Il reproche ensuite au libéralisme d'être “cartésien”, c'est-à-dire purement “déductif”, on est un citoyen exemplaire, un bon citoyen, un citoyen “politiquement correct” que si l'on adhère à quelques vérités abstraites, si l'on professe les “bonnes” idées. L'hyper-normativisme libéral révèle sa différence fondamentale d'avec le communautarisme, pour qui on est citoyen d'un Etat qui a une histoire particulière, complexe, non réduisible à quelques schémas simplistes, et qui a déployé dans le temps des valeurs spécifiques.
Le libéralisme postule un homme dépolitisé, ce qui est une aberration. Barber réclame donc le retour à la Polis antique. Car le libéralisme, “démocratie faible”, génère des pathologies telles l'atomisation des agrégats humains, le chaos et la dictature, la passivité des hommes contraints de subir. Mais à quoi ressemblerait une “démocratie forte”, selon Barber? Elle ne ressemblerait pas nécessairement à la démocratie représentative qui prétend être le seul modèle de démocratie acceptable. Pour Barber, la démocratie forte serait en quelque sorte une “assemblées de voisins” comprenant au total 5000 citoyens, liés entre eux par une “coopérative de communication”, rendue possible grâce aux progrès en matières de télécommunications. La décision populaire se ferait connaître par le biais de questionnaires à choix multiples et scrutins à deux tours. Barber préconise également le vote électronique, le tirage au sort comme dans la Rome antique et le service civil généralisé. Cette vision barbérienne de la “démocratie forte” nous semble fort constructiviste, typiquement américaine dans son novisme, sans trop de racines dans des modèles antiques.
Martha Nussbaum entend réintroduire les notions de citoyen, de Polis et de communauté, telles que les concevait Aristote, dans le discours des gauches, chez les démocrates américains, dans les sociales-démocraties européennes. Martha Nussbaum énumère les éléments de ce nouvel “aristotélisme social-démocrate”
- sur le plan anthropologique, les porteurs de cet aristotélisme social-démocrate doivent être conscients de la mort et de la finitude humaine, car c'est la condition essentiel pour tempérer les ardeurs des zélotes et des messianistes; - il faut opérer un retour à la corporéité, car le corps postule des limites; le rôle de la douleur est d'être une sorte de garde-fou contre des maximalismes ignorant les résistances de la matérialité ou de la physique; - il faut penser la politique toute en réfléchissant en permanence sur les capacités cognitives réelles de l'homme; - il faut mettre l'accent sur la raison pratique plutôt que sur la raison pure; - il fait avoir conscience de l'existence d'autres formes vivantes (animales et végétales) car la nature est notre cadre global, auquel on ne peut pas attenter sans risques; - il faut rendre à l'humour et au jeu toute leur place car ils sont des facteurs de revitalisation du discours politique.
Martha Nussbaum est indubitablement la sociologue “communautarienne” américaine qui a produit la réflexion la plus intense sur les implications de la conditio humana, de la finitude et de la déréliction. Elle nous enseigne une humilité, non pas une humilité masochiste mais une humilité faite d'émerveillement, non de haine de soi, c'est une humilité devant tout ce qui nous dépasse dans le temps et dans l'espace. Son idéal est de développer nos capacités à vivre en harmonie dans nos limites, notre cadre de vie qui implique forcément des contraintes. Martha Nussbaum n'est pas que sociologue, elle est aussi philologue classique et souhaite dès lors ramener la gauche américaine et européenne dans le giron intellectuel de la pensée classique, l'expurger de ses dérapages hyper-décontextualisants, hérités d'une proximité idéologique avec le libéralisme socialement atomisant.
Michael Walzer critique l'individualisme atomistique, propre de la société libérale, en tant que fruit de quatre formes de mobilité, ou de flux diraient Carl Schmitt ou Gilles Deleuze:
1. La mobilité géographique des citoyens: les déménagements fréquents (plus fréquents aux Etats-Unis qu'en Europe) engendrent un néo-nomadisme. 2. La mobilité sociale implique qu'il n'y a pas de transmission de savoir-faire entre les générations. 3. La mobilité matrimoniale est générée par le nombre impressionnant de divorces. 4. La mobilité politique implque qu'il est de plus en plus difficile de fixer dans la société des loyautés politiques.
Outre ce repérage des mobilités dissolvantes de nos sociétés, Michael Walzer théorise ce qu'il appelle l'“art des séparations”. La modernité rejette toutes les séparations au nom de la transparence, tout comme elle manifeste la volonté d'abolir les frontières, les cultures, les langues minoritaires. Certes, la civilisation occidentale est marquée par une “séparation” importante, la séparation entre l'Eglise et l'Etat. Mais outre cette grande séparation, la modernité tente de supprimer toutes les autres formes de séparation. Pourtant, constate Walzer, les murs sont utiles pour la socialité: c'est à l'abri de “murs” que l'on développe des libertés particulières, des libertés spécifiques, qui sont, en fin de compte, les seules libertés réelles et concrètes. Marx est un moderne qui a rejetté les “murs”, les séparations. Ce rejet des séparations est très net dans La question juive, où les Juifs sont sommés de se fondre dans les processus de transformation modernes sans plus revendiquer aucune identité. Pour Marx, l'unité/uniformité du monde capitaliste doit engendrer l'unité/uniformité du monde socialiste. L'unité/uniformité, phénomène d'arasement propre au monde capitaliste, n'est pas un scandale aux yeux de Marx, mais, au contraire, une condition première dans l'avènement d'une unité du monde post-capitaliste, c'est-à-dire, pour lui, du monde socialiste.
Pour Walzer, il s'agit de prendre sur cette question le contre-pied absolu de Marx: la liberté, dit-il au contraire de l'auteur de La question juive et du Capital, ne peut s'épanouir qu'à l'abri des “séparations”. Il faut de ce fait réapprendre à pratiquer l'“art des séparations” et permettre, de ce fait, à la liberté de s'épanouir de mille et une façons dans des espaces spatio-temporels limités et bien circonscrits. Mieux: c'est, derrière des murs érigés comme protections, que les peuples pourront faire éclore des “sphères de justice”, au sens où l'entendait aussi Rawls. Liberté et justice ne sont possibles qu'à l'abri de “séparations”.
Les thèses de Walzer, Nussbaum, Bellah, Sandel, Barber, MacIntyre, etc., constituent l'actuel débat américain sur le communautarisme. Ce débat répond à un besoin urgent de la société contemporaine. La nostalgie de la communauté n'est donc plus une nostalgie anachronique, une coquetterie pour archaïsants, une réminiscence de la “révolution conservatrice”, du Wandervogel ou des slavophiles. Mais peut-on, dans notre chef, clore ce débat sur la notion de communauté ou sur le néo-communautarisme américain, sans mentionner la discussion fructueuse patiemment construite avant-guerre par deux humanistes: Wilhelm Hauer et Martin Buber. S'il l'on médite intensément leurs conversations, il est impossible de répéter les manichéismes issus de la seconde guerre mondiale ou plutôt de faire sien les interprétation schématiques que l'on a élaboré à fins de propagande après 1945. Hauer était pasteur, indologue, missionnaire protestant, officier SS. Buber était un philosophe juif, un sioniste pacifique et communautarien. Hauer et Buber ont participé avant 1939 et après 1945, sans jamais rompre leur amitié en dépit de l'effondrement de la symbiose judéo-allemande, à des débats, des colloques, des discussions dont l'objet premier était Die Gemeinde, la communauté charnelle, religieuse et de prière, la communauté aussi au sens de paroisse et de commune, de village, de grande famille. Hauer et Buber voulaient tous deux préserver les communautés, en laissant à chaque personne (chaque personne qui joue un “rôle”) un espace de liberté pour dialoguer avec Dieu, pour philosopher, réfléchir ou méditer. Si ce travail de préservation ne peut plus être presté par une communauté charnelle, naturelle ou traditionnelle, il doit être l'œuvre du Bund (de la Ligue). C'est la raison pour laquelle, au sein du mouvement de jeunesse allemand des années 20, Hauer crée le Köngener Bund, initiative inscrite dans la tradition des Wandervögel, mais flanquée d'un cercle de prospective philosophique où des personnalités d'opinions différentes, voire en apparence hostiles, débattraient de cette question de la communauté. A la tribune du Köngener Bund se sont ainsi succédé communistes, nationaux-socialistes, juifs sionistes ou non, sociaux-démocrates et catholiques. Le Köngener Bund était une communauté allemande de combat philosophique, qui proposait aux gouvernants des solutions aux blessures de la modernité et à l'atomisation et l'anomie en progression constante. Le Köngener Bund était animé par une volonté didactique.
La tâche du Bund était de réceptionner les idées, de les synthétiser, de les rendre accessibles, de les diffuser au sein du peuple. A ce stade, il faut envisager, évidemment, de créer des institutions susceptibles de fonctionner correctement. Si elles fonctionnent bien, elles sont des exemples et, à ce titre, elles sont un don offert au monde entier, elles ont une valeur universelle, elles sont des modèles et, en tant que tels, adaptables à d'autres contextes humains. Les institutions optimales vont ensuite étendre leurs bienfaits à des fédérations de peuples, des empires (Reiche), des grands espaces, et, enfin, sans doute à très long terme, au monde. Dans le monde européen, le Bund doit nécessairement recourir aux religiosités pré-chrétiennes (Hauer, indologue, retrouve des traces de la “communauté” de type indo-européen dans tout le monde indo-européen).
Martin Buber dans son Principe dialogique (1962) émet quelques réflexions sur la “communauté” qu'il a certainement partagées avec Hauer. Dans la formulation de Buber, nous percevons une critique radicale du politisme qui se manifeste au sein des partis. Le parti politique est une machine de combat où le seul résidu de communauté toléré est la camaraderie. Mais souvent, en dehors du drill, de la parade, les partisans sont réduits au silence. Il n'y a pourtant communauté que là où l'on s'interroge fondamentalement sur le sens du monde et la vie. C'est justement là que le mouvement de jeunesse s'avère supérieur au parti politique, car on y perçoit une volonté constante d'incarner des valeurs dans le vécu. Le mouvement de jeunesse postule un engagement total et serein de la personne; dans le parti, qu'il soit totalitaire ou démocratique, on isole les partisans des non-partisans, on détache les hommes des flux réels et intimes de la vie, on se coupe de tout engagement réel et fondamental, on devient rouage d'une machine. On entre dans la monologique et non plus dans la dialogique. Buber nous dit: «Zwiegespräch und Selbstgespräch schweigen. Ohne Du, aber auch ohne Ich marschieren die Gebündelten, die von links, die das Gedächtnis abschaffen wollen, und die von rechts, die es regulieren wollen, feindlich getrennte Scharen, in den gemeinsamen Abgrund» (Dialogue et monologue intérieur disparaissent. Sans Tu, mais aussi sans Je, ils marchent au pas les enrégimentés, ceux de gauche, qui veulent abolir la mémoire, et ceux de droite, qui veulent la réguler; troupes opposées, ennemies, elles marchent vers l'abîme commun).
Tout mouvement cherchant réellement à révolutionner la modernité et à restaurer la communauté, abîmée ou éradiquée par l'anomie moderne, doit se doter d'un atelier de prospective philosophique, d'un espace de débat: telle est la leçon commune des deux amis Hauer et Buber. Nous l'avons retenue. Et nous tâcherons de marcher dans leurs pas.
Robert STEUCKERS.



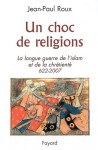

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg