 No próximo sábado, dia 27 de Junho, decorrerá em Lisboa a primeira Universidade de Verão da Associação Terra e Povo, que contará com a presença de vários oradores de diversos países. A recepção dos participantes será feita a partir das 10 horas e os trabalhos iniciar-se-ão às 10:30, prevendo-se que terminem às 17:30. As inscrições são limitadas e obrigatórias, devendo ser feitas por correio electrónico ou telefone. O preço é de € 30 e inclui almoço. Associados e estudantes beneficiam do preço reduzido de € 25.
No próximo sábado, dia 27 de Junho, decorrerá em Lisboa a primeira Universidade de Verão da Associação Terra e Povo, que contará com a presença de vários oradores de diversos países. A recepção dos participantes será feita a partir das 10 horas e os trabalhos iniciar-se-ão às 10:30, prevendo-se que terminem às 17:30. As inscrições são limitadas e obrigatórias, devendo ser feitas por correio electrónico ou telefone. O preço é de € 30 e inclui almoço. Associados e estudantes beneficiam do preço reduzido de € 25.
Organização: Associação Terra e Povo
lundi, 23 novembre 2009
Entretien de G. Faye avec le "Giornale d'Italia" (1998)
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Entretien de Guillaume Faye avec le «Giornale d'Italia» (24 juillet 1998)
Q.: Guillaume Faye, vous avez aujourd'hui 49 ans et pendant vingt ans vous avez été le véritable moteur intellectuel de la “nouvelle droite”. Est-ce un rôle que vous revendiquez sans polémique?
GF: Avec Giorgio Locchi, j'ai orienté la nouvelle droite française dans un sens anti-occidental et anti-américain, alors, qu'à l'instar des nombreuses droites européennes de l'après-guerre, cette nouvelle droite française était partie de positions conservatrices, philo-américaines et anti-communistes. Or le communisme était déjà mort dans les années 70. Nous devons créer de nouveaux concepts.
Q.: Est-ce un hasard si, après votre départ, la “nouvelle droite" semble avoir marqué un temps d'arrêt...
GF: En effet, l'aventure de la nouvelle droite s'est achevée, néanmoins, en France, c'est la première fois depuis l'Action Française qu'un courant de pensée de droite a pu atteindre le niveau intellectuel de l'extrême-gauche. Avec la nouvelle droite, nous avons eu affaire à un premier mouvement de droite que l'on ne considérait pas d'emblée comme complètement stupide. La nouvelle droite a modifié le paysage politique et culturel français parce qu'elle a été un mouvement de droite qui, après la seconde guerre mondiale, ne se présentait pas comme réactionnaire ou nostalgique. Toutes les manifestations de la nouvelle droite entre 1970 et 1985 faisaient parler d'elles dans les médias. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas car les médias se désintéressent du combat intellectuel.
Q.: Quelles sont les nouvelles lignes de combat culturel que vous proposez personnellement aujourd'hui?
GF: La nouvelle droite a développé après mon départ des axes de réflexion que je conteste et que je ne trouve pas pertinents comme l'alliance entre l'Europe et le tiers-monde, le communautarisme (ndlr: que “Synergies européennes” ne conteste pas à condition que la réflexion sur le communautarisme américain débouche sur des positions originales, en adéquation avec la pensée politique européenne; Faye critique ici la mauvaise interprétation néo-droitiste actuelle de ce communautarisme américain) et l'ethnopluralisme (ndlr: Faye critique ici le romantisme qui consiste à trouver formidable la juxtaposition en une harmonie idyllique des ethnies les plus dissemblables sur un même territoire européen, comme, par exemple, les banlieues françaises, modèle inacceptable et dépourvu de toute convivialité; de telles positions sont défendues aujourd'hui par de Benoist et Champetier) et, partiellement, le philo-islamisme (ndlr: Faye critique ici les positions des islamophiles naïfs, qui prennent pour argent comptant, sans le moindre esprit critique, les affirmations les plus contestables ou les plus boîteuses, pourvu qu'elles soient émises par des musulmans; la branche néo-traditionaliste de la ND parisienne, orchestrée par Arnaud Guyot-Jeannin, adopte de telles positions). Enfin, je critique aussi une sorte d'anti-christianisme caricatural, folklorique et mal compris. Aujourd'hui, à la fin des années 90, ces idées ont basculé dans l'utopie et ne sont plus défendables parce que le panorama politique global a changé et que nous subissons une colonisation de la part des ressortissants du tiers-monde, parce que l'Islam se renforce dans la mesure où il adopte des positions revanchistes et anti-colonialistes, alors que l'ère de la colonisation européenne est définitivement révolue et que nos générations n'en sont nullement responsables. Nous devons déterminer dans un avenir proche si les Américains sont pour nous des compétiteurs ou des ennemis, des hostes ou des inimici. Pour moi, ils ne sont pas inimici, soit des ennemis à écraser, mais des hostes, des compétiteurs, auxquels nons serons confrontés.
Q.: Adhérez-vous à l'idée d'«Union Européenne»?
GF: Les entités nationales sont appelées à disparaître au bénéfice d'une réalité fédérale, de macrorégions ou d'une Europe qui, après s'être dotée d'un drapeau et d'une monnaie, se donnera également une politique étrangère commune et de nouvelles institutions. Telles sont les batailles que nous allons devoir affronter contre l'atlantisme. L'élargissement de l'OTAN a pour objectif d'empêcher l'indépendance européenne et de placer la force nucléaire française, aujourd'hui indépendante, sous le commandement intégré.
Q.: Mais la nouvelle Europe accepte la notion de marché?
GF: Je garde mes idées de “troisième voie”, mais je veux une troisième voie qui permette d'entrer en compétition économique avec les Etats-Unis. Je suis en faveur d'un système de grande autarcie, dirigé contre le WTO, capable d'assumer le contrôle du politique sur l'économie mais sans fiscalisme ni archéo-socialisme. Je dis oui aux grands groupes industriels européens, à des opérations comme celle de l'Airbus.
Q.: Quels sont les alliés potentiels de l'Europe?
GF: On pourrait envisager des alliés provisoires et aléatoires comme la Chine et l'Inde. Aussi la Russie, mais elle s'est effondrée aujourd'hui et cet effondrement pose problème. La Russie cherche également l'alliance de la Chine et de l'Inde.
Q.: Pourra-t-on tenir tête aux Etats-Unis?
GF: Les Etats-Unis contrôlent pour le moment la situation mais ne semblent pas se rendre compte de ce qui arrivera avec l'euro et à la suite du processus d'unification européenne.
Q.: Et l'Islam?
GF: Les Etats-Unis ont intérêt à ce que l'Islam s'affirme en Europe parce qu'il constitue un facteur de ralentissement de l'unification européenne.
Q.: L'Europe se fera-t-elle?
GF: Nous avons perdu une bataille mais non pas la guerre. L'important, c'est que les élites européennes abandonnent le nationalisme archaïque et acquièrent la conscience d'appartenir à un peuple européen unique. Car il y a un ennemi extérieur commun. “Synergies européennes”, plus que le GRECE, va dans le sens de cette unification de l'Europe.
(Propos recueillis par Michele Fasolo pour Il Giornale d'Italia, 24 juillet 1998).
00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, europe, france, politique, idéologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 22 octobre 2009
R. Steuckers: entretien pour le journal Hrvatsko Slovo
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1998
Robert Steuckers :
Entretien pour le journal
Hrvatsko Slovo
Propos recueillis par Tomislav Sunic
1. Quelle est votre carte d'identité?
Je suis né en 1956 à Uccle près de Bruxelles. J'ai été à l'école de 1961 à 1974 et à l'Université et à l'école de traducteurs-interprètes de 1974 à 1980. Dans ma jeunesse, j'ai été fasciné par le roman historique anglais, par la dimension épique de l'Ivanhoe de Walter Scott, de la légende de Robin des Bois, par l'aventure de Quentin Durward, par les thématiques de la Table Ronde. Le cadre médiéval et la profondeur mythique ont très tôt constitué chez moi des référentiels importants, que j'ai complété avec notre propre héritage littéraire épique flamand, avec le Lion des Flandres de Hendrik Conscience, et par les thèmes bretons, découverts dans Le Loup Blanc de Paul Féval. Certes, j'ai lu à l'époque de nombreuses éditions vulgarisées, parfois imagées, de ces thématiques, mais elles n'ont cessé de me fasciner. Des films comme Excalibur ou Braveheart prouvent que ce filon reste malgré tout bien ancré dans l'imaginaire européen. En dépit des progrès techniques, du désenchantement comme résultat de plusieurs décennies de rationalisme bureaucratique, les peuples ont un besoin vital de cette veine épique, il est donc nécessaire que la trame de ces légendes ou que ces figures héroïsées demeurent des réferentiels impassables. Sur le plan philosophique, avant l'université, dans l'adolescence de 12 à 18 ans qui reste la période où s'acquièrent les bases éthiques et philosophiques essentielles du futur adulte, j'ai abordé Nietzsche, mais surtout Spengler parce qu'il met l'histoire en perspective. Pour un adolescent, Spengler est difficile à digérer, c'est évident et on n'en retient qu'une caricature quand on est un trop jeune lecteur de cet Allemand à la culture immense, qui nous a légué une vision synoptique de l'histoire mondiale. Toutefois, j'ai retenu de cette lecture, jusqu'à aujourd'hui, la volonté de mettre l'histoire en perspective, de ne jamais soustraire la pensée du drame planétaire qui se joue chaque jour et partout. Juste avant d'entrer à l'université, pendant la dernière année de l'école secondaire, j'ai découvert Toynbee, A Study of History, sa classification des civilisations, son étude des ressorts de celles-ci, sa dynamique de “challenge-and-response”; ensuite, pour la Noël 1973, il y avait pour moi dans la hotte des cadeaux Révolte contre le monde moderne de Julius Evola et une anthologie de textes de Gottfried Benn, où celui-ci insistait sur la notion de “forme”. J'avais également lu mes premiers ouvrages d'Ernst Jünger. A l'école, j'avais lu notamment le Testament espagnol de Koestler et La puissance et la gloire de Graham Greene, éveillant en moi un intérêt durable pour la littérature carcérale et surtout, avec le prêtre alcoolique admirablement mis en scène par Greene, les notions de péché, de perfectibilité, etc. que transcende malgré tout l'homme tel qu'il est, imparfait mais sublime en dépit de cette imperfection. Dès la première année à l'Université, je découvre la veine faustienne à partir de Goethe, les deux chefs-d'œuvre d'Orwell (La ferme des animaux et 1984), Darkness at Noon de Koestler (autre merveille de la littérature carcérale!). Immédiatement dans la foulée, je me suis plongé dans son ouvrage philosophique The Ghost in the Machine, qui m'a fait découvrir le combat philosophique, à mon avis central, contre le réductionnisme qui a ruiné le continent européen et la pensée occidentale en ce siècle et dont nous tentons péniblement de sortir aujourd'hui. Depuis ma sortie de l'université, j'ai évidemment travaillé comme traducteur, mais j'ai aussi fondé mes revues Orientations (1982-1992), Vouloir (depuis 1983), et co-édité avec mes amis suisses et français, le bulletin Nouvelles de Synergies Européennes (depuis 1994). Entre 1990 et 1992, j'ai travaillé avec le Prof. Jean-François Mattéi à l'Encyclopédie des Œuvres philosophiques des Presses Universitaires de France.
2. Dans les milieux politico-littéraires, on vous colle souvent l'étiquette de “droitier”. Etes-vous de droite ou de gauche. Qu'est-ce que cela signifie aujourd'hui?
Dans l'espace linguistique francophone, cela a été une véritable manie de coller à tout constestataire l'étiquette de “droite”, parce que la droite, depuis le libéralisme le plus modéré jusqu'à l'affirmation nationaliste la plus intransigeante, en passant par toutes les variantes non progressistes du catholicisme, ont été rejetées sans ménagement dans la géhenne des pensées interdites, considérées arbitrairement comme droitières voire comme crypto-fascistes ou carrément fascistes. Cette manie de juger toutes les pensées à l'aune d'un schéma binaire provient en droite ligne de la propagande communiste française, très puissante dans les médias et le monde des lettres à Paris, qui tentait d'assimiler tous les adversaires du PCF et de ses satellites au fascisme et à l'occupant allemand de 1940-44. Or, au-delà de cette polémique —que je ne reprendrai pas parce que je suis né après la guerre— je constate, comme doivent le constater tous les observateurs lucides, que les cultures dans le monde, que les filons culturels au sein de chaque culture, sont l'expression d'une pluralité inépuisable, où tout se compose, se décompose et se recompose à l'infini. Dans ce grouillement fécond, il est impossible d'opérer un tri au départ d'un schéma simplement binaire! La démarche binaire est toujours mutilante. Ceci dit, je vois essentiellement trois pistes pour échapper au schéma binaire gauche/droite.
- La première vient de la définition que donnait le grand économiste français François Perroux du rôle de l'homme dans l'histoire de l'humanité et dans l'histoire de la communauté où il est né par le hasard des circonstances. L'homme selon Perroux est une personne qui joue un rôle pour le bénéfice de sa communauté et non pas un individu qui s'isole du reste du monde et ne donne rien ni aux siens ni aux autres. En jouant ce rôle, l'homme tente au mieux d'incarner les valeurs impassables de sa communauté nationale ou religieuse. Cette définition a été classé à droite, précisément parce qu'elle insistait sur le caractère impassable des grandes valeurs traditionnelles, mais bon nombre d'hommes de gauche, qu'ils soient chrétiens, musulmans, agnostiques ou athées, en reconnaîtront la pertinence.
- La deuxième piste, très actuelle, est celle que nous indique le communautarisme américain, avec des auteurs comme Sandel, Taylor, McIntyre, Martha Nussbaum, Bellah, Barber,Walzer, etc. Au cours du XXième siècle, les grandes idéologies politiques dominantes ont tenté de mettre les valeurs entre parenthèses, de procéder à une neutralisation des valeurs, au bénéfice d'une approche purement technocratique des hommes et des choses. Dans les années 50 et 60, l'idéologie dominante de l'Occident, aux Etats-Unis et en Europe de l'Ouest, a été ce technocratisme, partagé par le libéralisme, la sociale-démocratie et un conservatisme qui se dégageait des valeurs traditionnelles du catholicisme ou du protestantisme (en Allemagne: de l'éthique prussienne du service à l'Etat). Les questions soulevées par les valeurs, dans l'optique d'une certaine philosophie empirique, néo-logique, étaient des questions vides de sens. Ce refus occidental des valeurs a généré un hyper-individualisme, une anomie générale qui se traduit par un incivisme global et une criminalité débridée en croissance continue. Le questionnement soulevé aujourd'hui par l'école communautarienne américaine est une réponse à l'anomie occidentale (dont on n'est pas toujours fort conscient dans les pays européens qui ont connu le communisme) et cette réponse transcende évidemment le clivage gauche/droite.
- La troisième piste est celle des populismes. Sous le titre significatif de Beyond Left and Right. Insurgency and the Establishment, une figure de proue de la gauche radicale américaine, David A. Horowitz, a publié récemment un ouvrage qui fait sensation aux Etats-Unis depuis quelques mois. Horowitz recence toutes les révoltes populaires américaines contre l'établissement au pouvoir à Washington, depuis 1880 à nos jours. Délibérément, Horowitz choisit à gauche comme à droite ses multiples exemples de révoltes du peuple contre ces oligarchies qui ne répondent plus aux nécessités cruelles qui frappent la population dans sa vie quotidienne. Horowitz brise un tabou tenace aux Etats-Unis, notamment en s'attaquant au caractère quelque peu coercitif des gauches, depuis le New Deal de Roosevelt jusqu'à nos jours. Une coercition subtile, bien camouflée derrière des paroles moralisantes... C'est à dessein que j'ai choisis ici des exemples américains, car les idéologèmes américains sont indépendants, finalement, des clivages européens nés de la seconde guerre mondiale. Même des propagandistes chevronnés ne pourront accuser de “fascisme” des filons idéologiques nés en plein centre ou en marge des traditions “républicaines” ou “démocrates”. Ce qui importe, c'est de défendre un continuum dans lequel on s'inscrit avec sa lignée.
3. Dans vos écrits sur la géopolitique, on perçoit une très nette influence des grands géopolitologues comme Kjellén, Mackinder, Haushofer et Jordis von Lohausen; vous semblez aussi vous intéresser aux travaux du Croate Radovan Pavic. De votre point de vue d'Européen du Nord-Ouest, comment percevez-vous la Mitteleuropa, plus particulièrement la Croatie?
C'est certain, j'ai été fasciné par les travaux des classiques de la géopolitique. J'ai rédigé des notes sur les géopolitologues dans l'Encyclopédie des Œuvres philosophiques, éditée par le Prof. Jean-François Mattéi (Paris, 1992). Le dernier numéro de ma revue Vouloir (n°9/1997) est consacré à ces pionniers de la pensée géopolitique. En ce qui concerne votre compatriote Pavic, c'est, avec le Français Michel Foucher (Lyon), le meilleur dessinateur de cartes expressives, parlantes, suggestives en Europe aujourd'hui. L'art de la géopolitique, c'est avant tout l'art de savoir dessiner des cartes qui résument à elles seules, en un seul coup d'oeil, toute une problématique historique et géographique complexe. Pavic et Klemencic (avec son atlas de l'Europe, paru cette année à Zagreb) perpétuent une méthode, lancée par la géopolitique allemande au début de ce siècle, mais dont les racines remontent à ce pionnier de la géographie et de la cartographie que fut Carl Ritter (1779-1859). Quant à ma vision de la Mitteleuropa, elle est quelque peu différente de celle qu'avait envisagée Friedrich Naumann en 1916. Au beau milieu de la première guerre mondiale, Naumann percevait sa Mitteleuropa comme l'alliance du Reich allemand avec l'Autriche-Hongrie, flanquée éventuellement d'une nouvelle confédération balkanique faisant fonction d'Ergänzungsraum pour la machine industrielle allemande, autrichienne et tchèque. Cette alliance articulée en trois volets aurait eu son prolongement semi-colonial dans l'empire ottoman, jusqu'aux côtes de la Mer Rouge, du Golfe Persique et de l'Océan Indien. Aujourd'hui, un élément nouveau s'est ajouté et son importance est capitale: le Rhin et le Main sont désormais reliés au Danube par un canal à gros gabarit, assurant un transit direct entre la Mer du Nord et l'espace pontique (Fleuves ukrainiens, Crimée, Mer Noire, Caucase, Anatolie, Caspienne). Cette liaison est un événment extraordinaire, une nouvelle donne importante dans l'Europe en voie de formation. La vision du géopolitologue Artur Dix, malheureusement tombé dans l'oubli aujourd'hui, peut se réaliser. Dix, dans son ouvrage principal (Politische Geographie. Weltpolitisches Handbuch, 1923), a publié une carte montrant quelles dynamiques seraient possibles dès le creusement définitif du canal Main/Danube, un projet qu'avait déjà envisagé Charlemagne, il y a plus de mille ans! Aujourd'hui le Rhin est lié à la Meuse et pourrait être lié au Rhône (si les gauches françaises et les nationalistes étriqués de ce pays ne faisaient pas le jeu des adversaires extra-européens de l'unité de l'Europe et du rayonnement de sa culture). Les trafics sur route sont saturés en Europe et le transport de marchandises par camions s'avèrent trop cher. L'avenir appartient aux péniches, aux barges et aux gros-pousseurs fluviaux. Ainsi qu'aux oléoducs transcaucasiens. Fin décembre 1997, l'armée belge en poste en Slavonie orientale a plié bagages et a acheminé tout son charroi et ses blindés par pousseurs jusqu'à Liège, prouvant de la sorte l'importance militaire et stratégique du système fluvial intérieur de la Mitteleuropa. La mise en valeur de ce réseau diminue ipso facto l'importance de la Méditerranée, contrôlée par les flottes américaine et britannique, appuyées par leur allié turc. Les Etats d'Europe centrale peuvent contrôler aisément, par leurs propres forces terrestres la principale voie de passage à travers le continent. La liaison Rotterdam/Constantza devient l'épine dorsale de l'Europe. Quant à la Croatie, elle est une pièce importante dans cette dynamique, puisqu'elle est à la fois riveraine du Danube en Slavonie et de l'Adriatique, partie de la Méditerranée qui s'enfonce le plus profondément à l'intérieur du continent européen et qui revêt dès lors une importance stratégique considérable. Au cours de l'histoire, quand la Croatie appartenait à la double monarchie austro-hongroise et était liée au Saint-Empire, dont le territoire belge d'aujourd'hui faisait partie intégrante, elle offrait à cet ensemble complexe mais mal unifié une façade méditerranéenne, que l'empire ottoman et la France ont toujours voulu confisquer à l'Autriche, l'Allemagne et la Hongrie pour les asphyxier, les enclaver, leur couper la route du large. Rappelons tout de même que la misère de l'Europe, que la ruine de la civilisation européenne en ce siècle, vient essentiellement de l'alliance perverse et pluriséculaire de la France monarchique et de la Turquie ottomane, où la France reniait la civilisation européenne, mobilisait ses forces pour la détruire. La Mitteleuropa a été prise en tenaille et ravagée par cette alliance: en 1526, le Roi de France François Ier marche sur Milan qu'il veut arracher au Saint-Empire; il est battu à Pavie et pris prisonnier. Ses alliés ottomans profitent de sa trahison et de sa diversion et s'emparent de votre pays pendant longtemps en le ravageant totalement. Au XVIIième siècle, la collusion franco-ottomane fonctionne à nouveau, le Saint-Empire est attaqué à l'Ouest, le Palatinat est ravagé, la Franche-Comté est annexée par la France, la Lorraine impériale est envahie, l'Alsace est elle aussi définitivement arrachée à l'Empire: cette guerre inique a été menée pour soulager les Turcs pendant la grande guerre de 1684 à 1699, où la Sainte-Alliance des puissances européennes (Autriche-Hongrie, Pologne, Russie) conjugue ses efforts pour libérer les Balkans. En 1695, Louis XIV ravage les Pays-Bas et incendie Bruxelles en inaugurant le bombardement de pure terreur, tandis que les Ottomans reprennent pied en Serbie et en Roumanie. En 1699, le Prince Eugène, adversaire tenace de Louis XIV et brillant serviteur de l'Empire, impose aux Turcs le Traité de Carlowitz: la Sublime Porte doit céder 400.000 km2 de territoires à la Sainte-Alliance, mais au prix de tous les glacis de l'Ouest (Lorraine, Alsace, Franche-Comté, Bresse). La République sera tout aussi rénégate à l'égard de l'Europe que la monarchie française, tout en introduisant le fanatisme idéologique dans les guerres entre Etats, ruinant ainsi les principes civilisateurs du jus publicum europæum: en 1791, alors qu'Autrichiens, Hongrois et Russes s'apprêtaient à lancer une offensive définitive dans les Balkans, la France, fidèle à son anti-européisme foncier, oblige les troupes impériales à se porter à l'Ouest car elle lance les hordes révolutionnaires, récrutées dans les bas-fonds de Paris, contre les Pays-Bas et la Lorraine. Le premier souci de Napoléon a été de fabriquer des “départements illyriens” pour couper la côte dalmate de son “hinterland mitteleuropäisch” et pour priver ce dernier de toute façade méditerranéenne. L'indépendance de la Croatie met un terme à cette logique de l'asphyxie, redonne à la Mitteleuropa une façade adriatique/méditerranéenne.
4. A votre avis, quelles seront les forces géopolitiques qui auront un impact sur le destin croate dans l'avenir?
Le destin croate est lié au processus d'unification européenne et à la rentabilisation du nouvel axe central de l'Europe, la liaison par fleuves et canaux entre la Mer du Nord et la Mer Noire. Mais il reste à savoir si la “diagonale verte”, le verrou d'Etats plus ou moins liés à la Turquie et s'étendant de l'Albanie à la Macédoine, prendra forme ou non, ou si une zone de turbulences durables y empêchera l'émergence de dynamiques fécondes. Ensuite, l'affrontement croato-serbe en Slavonie pour la maîtrise d'une fenêtre sur le Danube pose une question de principe à Belgrade: la Serbie se souvient-elle du temps de la Sainte-Alliance où Austro-Hongrois catholiques et Russes orthodoxes joignaient fraternellement leurs efforts pour libérer les Balkans? Se faire l'allié inconditionnel de la France, comme en 1914, n'est-ce pas jouer le rôle dévolu par la monarchie et la république françaises à l'Empire ottoman de 1526 à 1792? Ce rôle d'ersatz de l'empire ottoman moribond est-il compatible avec le rôle qu'entendent se donner certains nationalistes serbes: celui de bouclier européen contre tout nouveau déferlement turc? La nouvelle Serbie déyougoslavisée a intérêt à participer à la dynamique danubienne et à trouver une liaison fluviale avec la Russie. Toute autre politique serait de l'aberration. Et serait contraire au principe de la Sainte-Alliance de 1684-1699, qu'il s'agit de restaurer après la chute du Rideau de fer et des régimes communistes. Par ailleurs, l'intérêt de la France (ou du moins de la population française) serait de joindre à la dynamique Rhin/Danube le complexe fluvial Saône/Rhône débouchant sur le bassin occidental de la Méditerranée, zone hautement stratégique pour l'ensemble européen, dont Mackinder, dans son livre Democratic Ideals and Reality (1919), avait bien montré l'importance, de César aux Vandales et aux Byzantins, et de ceux-ci aux Sarrazins et à Nelson.
5. En vue de la proximité balkanique, quelles seront les synergies convergentes?
Favoriser le transit inter-continental Rotterdam/Mer Noire et faire de la région pontique le tremplin vers les matières premières caucasiennes, caspiennes et centre-asiatiques, est une nécessité économique vitale pour tous les riverains de ce grand axe fluvial et de cette mer intérieure. D'office, dans un tel contexte, une symphonie adviendra inéluctablement, si les peuples ont la force de se dégager des influences étrangères qui veulent freiner ce processus. Les adversaires d'un consensus harmonieux en Europe, de tout retour au jus publicum europæum (dont l'OSCE est un embryon), placent leurs espoirs dans la ligne de fracture qui sépare l'Europe catholique et protestante d'une part, de l'Europe orthodoxe-byzantine d'autre part. Ils spéculent sur la classification récente des civilisations du globe par l'Américain Samuel Huntington, où la sphère occidentale euro-américaine (“The West”) serait séparée de la sphère orthodoxe par un fossé trop profond, à hauteur de Belgrade ou de Vukovar, soit exactement au milieu de la ligne Rotterdam/Constantza. Cette césure rendrait inopérante la nouvelle dynamique potentielle, couperait l'Europe industrielle des pétroles et des gaz caucasiens et l'Europe orientale, plus rurale, des produits industriels allemands. De même, la coupure sur le Danube à Belgrade a son équivalent au Nord du Caucase, avec la coupure tchétchène sur le parcours de l'oléoduc transcaucasien, qui aboutit à Novorossisk en Russie, sur les rives de la Mer Noire. La guerre tchétchène profite aux oléoducs turcs qui aboutissent en Méditerranée orientale contrôlée par les Etats-Unis, tout comme le blocage du transit danubien profite aux armateurs qui assurent le transport transméditerranéen et non pas aux peuples européens qui ont intérêt à raccourcir les voies de communication et à les contrôler directement. La raison d'être du nouvel Etat croate, aux yeux des Européens du Nord-Ouest et des Allemands, du moins s'ils sont conscients du destin du continent, se lit spontanément sur la carte: la configuration géographique de la Croatie, en forme de fer à cheval, donne à l'Ouest et au Centre de l'Europe une fenêtre adriatique et une fenêtre danubienne. La fenêtre adriatique donne un accès direct à la Méditerranée orientale (comme jadis la République de Venise), à condition que l'Adriatique ne soit pas bloquée à hauteur de l'Albanie et de l'Epire par une éventuelle barrière d'Etats satellites de la Turquie, qui verrouilleraient le cas échéant le Détroit d'Otrante ou y géneraient le transit. La fenêtre danubienne donne accès à la Mer Noire et au Caucase, à condition qu'elle ne soit pas bloquée par une entité serbe ou néo-yougoslave qui jouerait le même rôle de verrou que l'Empire ottoman jadis et oublierait la Sainte-Alliance de 1684 à 1699, prélude d'une symphonie efficace des forces en présence dans les Balkans et en Mer Noire. L'Europe comme puissance ne peut naître que d'une telle symphonie où le nouvel Etat croate à un rôle-clé à jouer, notamment en reprenant partiellement à son compte les anciennes dynamiques déployées par la République de Venise, dont Raguse/Dubrovnik était un superbe fleuron.
6. Vous semblez être assez critique à l'égard de l'Etat pluri-ethnique belge? Quel sera son rôle?
L'Etat et le peuple belges sont des victimes de la logique partitocratique. Les peuples de l'Ostmitteleuropa savent ce qu'est une logique partisane absolue, parce qu'ils ont vécu le communisme. A l'Ouest la logique partisane existe également: certes, dans la sphère privée, on peut dire ou proclamer ce que l'on veut, mais dans un Etat comme la Belgique, où les postes sont répartis entre trois formations politiques au pro rata des voix obtenues, on est obligé de s'aligner sur la politique et sur l'idéologie étriquée de l'un de ces trois partis (démocrates-chrétiens, socialistes, libéraux), sinon on est marginalisé ou exclu: la libre parole dérange, la volonté d'aller de l'avant est considérée comme “impie”. On m'objectera que la démocratie de modèle occidental permet l'alternance politique par le jeu des élections: or cette possibilité d'alternance a été éliminée en Belgique par le prolongement et la succession ad infinitum de “grandes coalitions” entre démocrates-chrétiens et socialistes. A l'exception de quelques années dans les “Eighties”, où les libéraux ont participé aux affaires. Ce type de “grandes coalitions” ne porte au pouvoir que l'aile gauche de la démocratie-chrétienne, dont l'arme principale est une démagogie dangereuse sur le long terme et dont la caractéristique majeure est l'absence de principes politiques. Cette absence de principes conduit à des bricolages politiques abracadabrants que les Belges appellent ironiquement de la “plomberie”. L'aile plus conservatrice de cette démocratie-chrétienne a été progressivement marginalisée en Flandre, pour faire place à des politiciens prêts à toutes les combines pour gouverner avec les socialistes. Or, les socialistes sont relativement minoritaires en Flandre mais majoritaires en Wallonie. Dans cette partie du pays, qui est francophone, ils ont mis le patrimoine régional en coupe réglée et ils y règnent comme la mafia en Sicile, avec des méthodes et des pratiques qui rappellent les grands réseaux italiens de criminalité. Les scandales qui n'ont cessé d'émailler la chronique quotidienne en Belgique viennent essentiellement de ce parti socialiste wallon. La Belgique fonctionne donc avec l'alliance de socialistes wallons majoritaires dans leur région, de socialistes flamands minoritaires dans leur région, de démocrates-chrétiens wallons minoritaires et de démocrates-chrétiens flamands majoritaires, mais dont la majorité est aujourd'hui contestée par les libéraux néo-thatchériens et les ultra-nationalistes. Une très forte minorité flamande conservatrice (mais divisée en plusieurs pôles antagonistes) est hors jeu, de même que les classes moyennes et les entrepreneurs dynamiques en Wallonie, qui font face à un socialisme archaïque, vindicatif, corrompu et inefficace. La solution réside dans une fédéralisation toujours plus poussée, de façon à ce que les Flamands plus conservateurs n'aient pas à subir le mafia-socialisme wallon et les Wallons socialistes n'aient pas à abandonner leurs acquis sociaux sous la pression de néo-thatchériens flamands. Mais la pire tare de la Belgique actuelle reste la nomination politique des magistrats, également au pro rata des voix obtenues par les partis. Cette pratique scandaleuse élimine l'indépendance de la magistrature et ruine le principe de la séparation des pouvoirs, dont l'Occident est pourtant si fier. Ce principe est lettre morte en Belgique et la cassure entre la population et les institutions judiciaires est désormais préoccupant et gros de complications. L'avenir de la Belgique s'avère précaire dans de telles conditions, d'autant plus que la France essaie d'avancer ses pions partout dans l'économie du pays, de le coloniser financièrement, avec l'accord tacite de Kohl —il faut bien le dire— qui achète de la sorte l'acceptation par la France de la réunification allemande. Le pays implosera si son personnel politique continue à ne pas avoir de vision géopolitique cohérente, s'il ne reprend pas conscience de son destin et de sa mission mitteleuropäisch, qui le conduiront de surcroît à retrouver les intérêts considérables qu'il avait dans la Mer Noire avant 1914, surtout les entreprises wallonnes! Non seulement l'Etat belge implosera s'il ne retrouve pas une vision géopolitique cohérente, mais chacune de ses composantes imploseront à leur tour, entraînant une catastrophe sans précédent pour la population et créant un vide au Nord-Ouest de l'Europe, dans une région hautement stratégique: le delta du Rhin, de la Meuse et de l'Escaut, avec tous les canaux qui les relient (Canal Albert, Canal Juliana, Canal Wilhelmina, Willemsvaart, etc.).
7. Le peuple flamand en Belgique a joué un rôle non négligeable lors de la guerre en ex-Yougoslavie, en apportant son aide au peuple croate. Qu'est-ce qui les unit?
Les nationalistes flamands s'identifient toujours aux peuples qui veulent s'affranchir ou se détacher de structures étatiques jugées oppressantes ou obsolètes. En Flandre, il existe un véritable engouement pour les Basques, les Bretons et les Corses: c'est dû partiellement à un ressentiment atavique à l'égard de la France et de l'Espagne. La Croatie a bénéficié elle aussi de ce sentiment de solidarité pour les peuples concrets contre les Etats abstraits. Pour la Croatie, il y a encore d'autres motifs de sympathie: il y a au fond de la culture flamande des éléments baroques comme en Autriche et en Bavière, mais marqués d'une truculence et d'une jovialité que l'on retrouve surtout dans la peinture de Rubens et de Jordaens. Ensuite, il y a évidemment le catholicisme, partagé par les Flamands et les Croates, et un Kulturnationalismus hérité de Herder qui est commun aux revendications nationalistes de nos deux peuples. Mais ce Kulturnationalismus n'est pas pur repli sur soi: il est toujours accompagné du sentiment d'appartenir à une entité plus grande que l'Etat contesté —l'Etat belge ici, l'Etat yougoslave chez vous— et cette entité est l'Europe comme espace de civilisation ou la Mitteleuropa comme communauté de destin historique. Certes, dans la partie flamande de la Belgique, le souvenir de l'Autriche habsbourgeoise est plus ancien, plus diffus et plus estompé. Mais il n'a pas laissé de mauvais souvenirs et l'Impératrice Marie-Thérèse, par exemple, demeure une personnalité historique respectée.
00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, belgique, flandre, wallonie, mitteleuropa, europe centrale, europe, affaires européennes, croatie, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 06 octobre 2009
Gaps in Germany's New Right
GAPS IN GERMANY'S NEW RIGHT

REVIEW: GERMANY'S NEW RIGHT AS CULTURE AND POLITICS. Roger Woods (Palgrave, Basingstoke 2007)
In this clear and workmanlike report and assessment of the New Right in Germany, Roger Woods first of all examines the cultural background, then goes on to explore the problematic Conservative Revolutionary and National Socialist legacy, New Right values and programmes, before reaching a somewhat downbeat conclusion. “The New Right project of providing itself with a cultural dimension as a solid foundation for new political thinking has not gone according to plan” says Woods, early-on.
Woods outlines three phases of New Right development in Germany since 1968; firstly as a meta-political movement taking its lead from the French New Right interpretation of Gramsci and culture combined with 1970s ideology, then the period 1982-1989 when the New Right served as a right wing corrective to right wing German Federal and Land governments and also in the historians dispute, and finally from 1989, after the collapse of socialism, when issues of national identity came to the fore.
The most interesting parts of the book deal with the ambiguous inheritance of Conservative Revolutionary thinkers of the Weimar Republic and the background of cultural pessimism. Woods emphasizes the uncertainty many German New Right thinkers betray despite promoting traditional values such as the Church, Family, Nation/ State. The cultural pessimist insight is that all these ideas have been tried, and failed, and that modernity in all its aspects is irreversible. With the current ecological crisis of climate change and industrial pollution, as Botho Strauss points out, not even nature can be relied upon. The quest for institutions that can embody transcendental values is abandoned. It is this feeling of resignation that allows German New Right thinkers like Martin Schwarz to contemplate compromise with Islam: “In a speech to the right wing organization Synergon Deutschland Martin Schwarz declares that if Europeans were to adopt the principles of Islam their nations would flourish”. “We live in a time of chaos and disintegration. If we wish to survive we must not convince ourselves that our main aim is to confront those people who are being uprooted and tossed around as the old order disintegrates...There is no Islamic conspiracy to bring down the West!” - Martin Schwarz.
Opposed to this defeatism are a minority including Pierre Krebs of Thule Seminar: “In the land of Nietzsche and Wagner, Bach and Kant, Clausewitz and Thomas Münzer a single word could fan the red glow of history back to life, smash to pieces half a century of dictatorial 'reeducation' that thought it could displace this word from the mind of a whole people without encountering any resistance”.
From an English perspective, this cultural pessimism may seem a result of over-intellectualizing and the particular, awkward memory for Germans of the NSDAP. If, as it is commonly held, Europe is a Symphony of Nations, then we have already heard the majesty of Mussolini and the sombre, expressionist tones of German National Socialism; yet England, the Celtic lands, Scandinavia, central Europe and Russia have so far remained silent. Let Russia sing and England and France take up the reprise! (Britain's particular excuse for European dis-engagement has been its global empire, its invention of the modern world, and currently its maintenance through force, financial power and flim-flam of that same decaying world).
Unfortunately, there is a significant oversight of which this book is guilty. I would argue that the major fault with the German New Right, and Woods account of it, is a lack of awareness of our true, shared pre-Christian Aryan heritage. As for Christianity, there seems little point in falling back on the tradition of a religion if that religion is wrong; and not only wrong, but destructive. German religious traditionalists are still mainly Christian, thereby continuing the Semitic monotheist intrusion into Aryan spirituality. How can Germans “return” to a faith that caused them so much physical and mental harm, from encouraging Charlemagne to slaughter thousands of pagan Saxons in order to force conversion, or that wasted Germany for generations after the carnage of the Thirty Years War?
Neither Roger Woods nor the examples he cites have much time for the insights of European paganism and the apparent pre-Christian Aryan ideology uncovered by Indo-Europeanists like Georges Dumezil and Alby Stone. European pagan metaphysics in conjunction with the ideas of Western philosophers such as Nietzsche and Heidegger and the political outlook of Evola and Yockey can provide meaning, to resist the onslaught of nihilist modernism and the doubts and uncertainties expressed by New Right thinkers in Germany. This is where the German New Right, and the New Right across Europe, will find the “fixed points”, the traditions, the models for a functioning society, and the new elan – the new spirit of adventure, hope, and destiny – for which the German New Right, and many Europeans more generally, have been searching.
This new spirit must originate from and embody the European Faustean sensibility; it must embrace synthesis, science and technology: “The fascist is obsessed with an ideal of Modernity and youth: he wants to create a new man, a lover of sport and autosport, living in a new city which has been given new life by futuristic architecture. He is an admirer of Le Cobusier, Marinetti, Gropius. He loves motors, mechanical engineering and speed.” - Zeev Sternhell, quoted on p68.
I have just two caveats for a book that is otherwise fair as far as it goes:
- for a book published in mid-2007, the references don't extend beyond Summer 2004 at the latest, as far as I can see. I don't blame the author for this; publication schedules are often delayed.
- secondly, the front cover appears to be a (totally uncredited) photograph of the Holocaust memorial in Berlin. According to the text within, “For the New Right, however, the Holocaust memorial is 'the last testament of the generation of 68'. Before they retire they want to deal Germany a blow which will shake it to its core. Junge Freiheit quotes Rudolf Augustein's view that the memorial is aimed against the newly emerging Germany in Berlin and the sovereignty that Germany had taken so long to restore”. To choose this particular image to illustrate the cover of a book on Germany's New Right is singularly inappropriate, almost a calculated insult directed at the book's readers.
00:18 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, théorie politique, sciences politiques, allemagne, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 14 septembre 2009
L'influence de Henri Lefèbvre sur Guillaume Faye
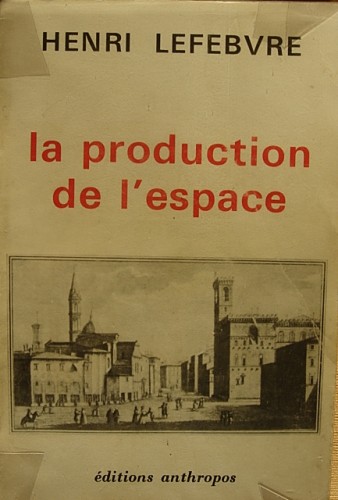
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
Robert Steuckers:
L'influence de Henri Lefèbvre sur Guillaume Faye
Indubitable et déterminante est l'influence de Henri Lefebvre sur l'évolution des idées de Guillaume Faye; Henri Lefebvre fut un des principaux théoriciens du PCF et l'auteur de nombreux textes fondamentaux à l'usage des militants de ce parti fortement structuré et combatif. J'ai eu personnellement le plaisir de rencontrer ce philosophe ex-communiste français à deux reprises en compagnie de Guillaume Faye dans la salle du célèbre restaurant parisien “La Closerie des Lilas” que Lefebvre aimait fréquenter parce qu'il avait été un haut lieu du surréalisme parisien du temps d'André Breton. Lefebvre aimait se rémémorer les homériques bagarres entre les surréalistes et leurs adversaires qui avaient égayé ce restaurant. Avant de passer au marxisme, Lefebvre avait été surréaliste. Les conversations que nous avons eues avec ce philosophe d'une distinction exceptionnelle, raffiné et très aristocratique dans ses paroles et ses manières, ont été fructueuses et ont contribué à enrichir notamment le numéro de Nouvelle école sur Heidegger que nous préparions à l'époque. Trois ouvrages plus récents de Lefebvre, postmarxistes, ont attiré notre attention: Position: contre les technocrates. En finir avec l'humanité-fiction (Gonthier, Paris, 1967); Le manifeste différentialiste (Gallimard, Paris, 1970); De L'Etat. 1. L'Etat dans le monde moderne, (UGE, Paris, 1976).
Dans Position (op. cit.), Lefebvre s'insurgeait contre les projets d'exploration spatiale et lunaire car ils divertissaient l'homme de “l'humble surface du globe”, leur faisaient perdre le sens de la Terre, cher à Nietzsche. C'était aussi le résultat, pour Lefebvre, d'une idéologie qui avait perdu toute potentialité pratique, toute faculté de forger un projet concret pour remédier aux problèmes qui affectent la vie réelle des hommes et des cités. Cette idéologie, qui est celle de l'“humanisme libéral bourgeois”, n'est plus qu'un “mélange de philanthropie, de culture et de citations”; la philosophie s'y ritualise, devient simple cérémonial, sanctionne un immense jeu de dupes. Pour Lefebvre, cet enlisement dans la pure phraséologie ne doit pas nous conduire à refuser l'homme, comme le font les structuralistes autour de Foucault, qui jettent un soupçon destructeur, “déconstructiviste” sur tous les projets et les volontés politiques (plus tard, Lefebvre sera moins sévère à l'égard de Foucault). Dans un tel contexte, plus aucun élan révolutionnaire ou autre n'est possible: mouvement, dialectique, dynamiques et devenir sont tout simplements niés. Le structuralisme anti-historiciste et foucaldien constitue l'apogée du rejet de ce formidable filon que nous a légué Héraclite et inaugure, dit Lefebvre, un nouvel “éléatisme”: l'ancien éléatisme contestait le mouvement sensible, le nouveau conteste le mouvement historique. Pour Lefebvre, la philosophie parménidienne est celle de l'immobilité. Pour Faye, le néo-parménidisme du système, libéral, bourgeois et ploutocratique, est la philosophie du discours libéralo-humaniste répété à l'infini comme un catéchisme sec, sans merveilleux. Pour Lefebvre, la philosophie héraclitéenne est la philosophie du mouvement. Pour Faye, —qui retrouve là quelques échos spenglériens propres à la récupération néo-droitiste (via Locchi et de Benoist) de la “Révolution Conservatrice” weimarienne— l'héraclitéisme contemporain doit être un culte joyeux de la mobilité innovante. Pour l'ex-marxiste et ex-surréaliste comme pour le néo-droitiste absolu que fut Faye, les êtres, les stabilités, les structures ne sont que les traces du trajet du Devenir. Il n'y a pas pour eux de structures fixes et définitives: le mouvement réel du monde et du politique est un mouvement sans bonne fin de structuration et de déstructuration. Le monde ne saurait être enfermé dans un système qui n'a d'autres préoccupations que de se préserver. A ce structuralisme qui peut justifier les systèmes car il exclut les “anthropes” de chair et de volonté, il faut opposer l'anti-système voire la Vie. Pour Lefebvre (comme pour Faye), ce recours à la Vie n'est pas passéisme ou archaïsme: le système ne se combat pas en agitant des images embellies d'un passé tout hypothétique mais en investissant massivement de la technique dans la quotidienneté et en finir avec toute philosophie purement spéculative, avec l'humanité-fiction. L'important chez l'homme, c'est l'œuvre, c'est d'œuvrer. L'homme n'est authentique que s'il est “œuvrant” et participe ainsi au devenir. Les “non-œuvrants”, sont ceux qui fuient la technique (seul levier disponible), qui refusent de marquer le quotidien du sceau de la technique, qui cherchent à s'échapper dans l'archaïque et le primitif, dans la marginalité (Marcuse!) ou dans les névroses (psychanalyse!). Apologie de la technique et refus des nostalgies archaïsantes sont bel et bien les deux marques du néo-droitisme authentique, c'est-à-dire du néo-droitisme fayen. Elles sortent tout droit d'une lecture attentive des travaux de Henri Lefebvre.
Dans Le manifeste différentialiste, nous trouvons d'autres parallèles entre le post-marxisme de Lefebvre et le néo-droitisme de Faye, le premier ayant indubitablement fécondé le second: la critique des processus d'homogénéisation et un plaidoyer en faveur des “puissances différentielles” (qui doivent quitter leurs positions défensives pour passer à l'offensive). L'homogénéisation “répressive-oppressive” est dominante, victorieuse, mais ne vient pas définitivement à bout des résistances particularistes: celles-ci imposent alors malgré tout une sorte de polycentrisme, induit par la “lutte planétaire pour différer” et qu'il s'agit de consolider. Si l'on met un terme à cette lutte, si le pouvoir répressif et oppresseur vainc définitivement, ce sera l'arrêt de l'analyse, l'échec de l'action, le fin de la découverte et de la création.
De sa lecture de L'Etat dans le monde moderne, Faye semble avoir retiré quelques autres idées-clefs, notamment celle de la “mystification totale” concomitante à l'homogénéisation planétaire, où tantôt l'on exalte l'Etat (de Hobbes au stalinisme), tantôt on le méconnaît (de Descartes aux illusions du “savoir pur”), où le sexe, l'individu, l'élite, la structure (des structuralistes figés), l'information surabondante servent tout à tour à mystifier le public; ensuite l'idée que l'Etat ne doit pas être conçu comme un “achèvement mortel”, comme une “fin”, mais bien plutôt comme un “théâtre et un champ de luttes”. L'Etat finira mais cela ne signifiera pas pour autant la fin (du politique). Enfin, dans cet ouvrage, Faye a retenu le plaidoyer de Lefebvre pour le “différentiel”, c'est-à-dire pour “ce qui échappe à l'identité répétitive”, pour “ce qui produit au lieu de reproduire”, pour “ce qui lutte contre l'entropie et l'espace de mort, pour la conquête d'une identité collective différentielle”.
Cette lecture et ces rencontres de Faye avec Henri Lefebvre sont intéressantes à plus d'un titre: nous pouvons dire rétrospectivement qu'un courant est indubitablement passé entre les deux hommes, certainement parce que Lefebvre était un ancien du surréalisme, capable de comprendre ce mélange instable, bouillonnant et turbulent qu'était Faye, où se mêlaient justement anarchisme critique dirigé contre l'Etat routinier et recours à l'autorité politique (charismatique) qui va briser par la vigueur de ses décisions la routine incapable de faire face à l'imprévu, à la guerre ou à la catastrophe. Si l'on qualifie la démarche de Faye d'“esthétisante” (ce qui est assurément un raccourci), son esthétique ne peut être que cette “esthétique de la terreur” définie par Karl Heinz Bohrer et où la fusion d'intuitionnisme (bergsonien chez Faye) et de décisionnisme (schmittien) fait apparaître la soudaineté, l'événement imprévu et impromptu, —ce que Faye appelait, à la suite d'une certaine école schmittienne, l'Ernstfall— comme une manifestation à la fois vitale et catastrophique, la vie et l'histoire étant un flux ininterrompu de catastrophes, excluant toute quiétude. La lutte permanente réclamée par Lefebvre, la revendication perpétuelle du “différentiel” pour qu'hommes et choses ne demeurent pas figés et “éléatiques”, le temps authentique mais bref de la soudaineté, le chaïros, l'imprévu ou l'insolite revendiqués par les surréalistes et leurs épigones, le choc de l'état d'urgence considéré par Schmitt et Freund comme essentiels, sont autant de concepts ou de visions qui confluent dans cette synthèse fayenne. Ils la rendent inséparable des corpus doctrinaux agités à Paris dans les années 60 et 70 et ne permettent pas de conclure à une sorte de consubstantialité avec le “fascisme” ou l'“extrême-droitisme” fantasmagoriques que l'on a prêtés à sa nouvelle droite, dès le moment où, effrayé par tant d'audaces philosophiques à “gauche”, à “droite” et “ailleurs et partout”, le système a commencé à exiger un retour en arrière, une réduction à un moralisme minimal, tâche infâmante à laquelle se sont attelés des Bernard-Henry Lévy, des Guy Konopnicki, des Luc Ferry et des Alain Renaut, préparant ainsi les platitudes de notre political correctness.
00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, guillaume faye, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, modernité, france, idéologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 septembre 2009
Terre et Peuple: TABLE RONDE 2009
08:53 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : identité, mouvement identitaire, actualité, europe, affaires européennes, colloque |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 05 septembre 2009
Pourquoi nous sommes Européennes et non pas Occidentaux

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Robert Steuckers:
Pourquoi nous sommes Européens et non pas Occidentaux
Les tenants des vieilles droites dans la partie ouest de notre continent s'engagent pour la «défense de l'Occident». La Nouvelle Droite, dans le sillage des critiques conservatrices-révolutionnaires et nationales-révolutionnaires allemandes, avec Alain de Benoist et Guillaume Faye, ont soumis la notion d'Occident à une critique serrée, au nom de l'Europe. Du coup, dans l'espace linguistique francophone, les droites sont désormais divisées en deux camps: celui des Occidentalistes et celui des Européens ou Néo-Européens (l'expression est de Faye, soucieux de donner une dimension projectuelle et «futuriste» à son engagement et de le détacher de tout ancrage passéiste et démobilisateur). Ce clivage oppose aussi souvent, à de très rares exceptions près, ceux qui s'accomodent du libéralisme et de l'américanisation des mœurs en gardant comme alibi ou comme colifichet un christianisme intégriste ou moderniste, d'une part, à ceux qui luttent pour un socialisme enraciné, contre le nivellement culturel venu d'outre-Atlantique, d'autre part, tout en refusant le discours manipulatoire des christianismes historiques et des sectes actuelles (Moon, scientologistes, etc.), lesquelles cherchent à recréer artificiellement des «suppléments d'âme», dans une société désertifiée par le matérialisme.
A l'Occident des premiers, les seconds opposent l'Europe, parce qu'ils sont conscients que notre continent ne pourra survivre que s'il demeure entier, s'il s'unit, s'il fait retour sur lui-même, s'il recentre ses énergies pour les mettre au service de tous. Or l'idée d'Occident ne séduit que les droites françaises, belges, espagnoles et britanniques, qui se posent comme héritières de l'Empire Romain d'Occident, issu de la scission de 395, et de l'Europe carolingienne, destructrice de l'autonomie économique des sociétés paysannes, notamment en Allemagne du Nord. Cet occidentalisme des droites, surtout lorsqu'il est vulgarisé outrancièrement, conduit implicitement à dévaloriser l'histoire des régions d'Europe situées en dehors des limites de l'Empire Romain d'Occident ou du vaste territoire jadis soumis à Charlemagne, à ignorer délibérément les productions culturelles des espaces germaniques, slaves, celtiques, scandinaves, grecs, magyars, roumains, finnois, etc. L'occidentalisme est une vision hémiplégique de l'Europe. Une réduction délétère. Et dangereuse car elle ne valorise qu'une frange atlantique de notre continent au détriment de son centre (la Mitteleuropa), de la synthèse balkanique et de l'immensité territoriale russo-sibérienne, marquée du génie slave. L'occidentalisme ne valorise donc qu'une petite portion d'Europe; pire: il valorise dans la foulée le greffon monstrueux que cette portion d'Europe a crée en Amérique du Nord, cette implosion culturelle, où toutes les énergies créatrices s'annullent lamentablement.
L'historiographie russe du XIXième siècle a réagi vertement contre cette réduction. Des historiens ou philosophes de l'histoire comme Danilevski ou Leontiev, un écrivain aussi important que Dostoïevski, ont dénoncé l'Occident comme le terreau où a germé la maladie libérale, où l'individualisme a brisé les réflexes communautaires, provoquant une irrémédiable décadence. Leurs arguments consistaient souvent en des laïcisations didactiques des reproches adressés par le christianisme orthodoxe/byzantin aux catholiques et aux protestants. Basée sur le «mir», c'est-à-dire la communauté paysanne et villageoise russe, l'orthodoxie slave dénonce l'autoritarisme catholique et l'individualisme protestant. En effet, l'église catholique nomme des prêtres étrangers aux paroisses, condamnés par dogme à ne pas avoir de descendance donc à être des individus nomadisés, qui appliquent le plus souvent des politiques allant dans le sens des intérêts de l'église et non dans celui de l'intérêt vital, biologique et immédiat du peuple. Le protestantisme, pour sa part, laisse la porte ouverte à tous les subjectivismes, donc favorise la dissolution des communautés. De plus, l'église catholique a progressé en Germanie grâce à son alliance avec l'appareil militaire carolingien, lequel délègue à ses officiers démobilisés des fiefs, privant de la sorte les élites enracinées, nées au sein du peuple lui-même, de leur rôle naturel de guide. L'église catholique enclenche ainsi un processus d'aliénation catastrophique, qui creusera, tout au long du Moyen Age, un fossé profond entre la culture des élites et la culture du peuple (cette distinction a été bien mise en lumière par Robert Muchembled, historien français). Qui plus est, l'officier carolingien démobilisé devient individuellement propriétaire du sol, jusqu'alors propriété collective d'une communauté villageoise et transmise telle quelle de génération en génération (lire à ce propos le splendide roman de Henri Béraud: «Le Bois du Templier pendu»). Le peuple devient économiquement dépendant du bon vouloir d'un officier allochtone.
Quand nous refusons l'occidentalisme aujourd'hui, nous ne rejettons pas simplement les enfantillages de l'American Way of Life, la fadeur de l'idéologie américaine, les horreurs de la décadence américaine par l'héroïne ou le crack, nous nous insurgeons avec une égale vigueur contre toutes les idéologies qui refusent de tenir compte de l'enracinement comme valeur primordiale. Nous sommes, pour reprendre le vocabulaire de Muchembled, du côté de la «culture du peuple» contre la «culture des élites» (nécessairement allochtones dans la définition de l'historien). Nous nions au christianisme manipulateur, à l'autoritarisme carolingien et catholique, au cléricalisme, au monarchisme coupé du peuple, toute valeur potentielle parce qu'ils nient et tuent la force jaillissante et vivifiante de l'enracinement. Les critiques protestantes, libérales, illuministes (l'idéologie des Lumières), marxistes, etc., n'ont pas constitué des révolutions (au sens étymologique de «retour sur soi») véritables; elles sont restées détachées des glèbes et des chairs; elles ont tiré des plans sur la comète sans retomber dans la lourde concrétude du sol et de l'histoire; elles sont restées des joujoux d'élites bourgeoises ou embourgeoisées vivant de leurs rentes ou aux crochets de leurs amis (Marx!). Elles sont des manifestations d'occidentalisme dans le sens où l'Occident est l'assemblage hétéroclite de toutes les pensées et pratiques détachées des glèbes et des chairs. Lorsque nous privilégions l'usage des termes «Europe» et «européen» pour désigner notre vision continentale des choses, nous opérons mentalement une révolution réelle, une révolution qui nous reconduit à l'essentiel immédiat et concret, que Barrès désignait par sa belle expression: «La Terre et les Morts».
De ce choix philosophique, découle évidemment la nécessité de lutter sans relâche contre toutes les idéologies de manipulation que je viens de citer, de réhabiliter les réflexes religieux spontanés de nos populations, de se pencher sur le passé, de soutenir dans la pratique les cercles d'archéologie locale, de créer et d'instituer des formes d'économie qui assurent à tous les membres de notre communauté de quoi vivre décemment et de fonder des familles, de privilégier les droits collectifs et enracinés des peuples plutôt que les droits bourgeois, déracinés et individualistes que l'on nomme fallacieusement «droits de l'homme», sans apercevoir que l'humanité ne peut survivre que si les hommes concrets tendent la main à d'autres hommes concrets, vivent dans des foyers avec des femmes et des enfants concrets, travaillent dans des ateliers ou des fermes avec d'autres hommes concrets, sans jamais être isolés comme Robinson sur son île. L'Occident a raisonné depuis mille ans en termes de salut individuel, lors de la phase religieuse de son développement, en termes de profit individuel, lors de sa phase bourgeoise et matérialiste, en termes de narcissisme hédoniste, dans la phase de déliquescence totale qu'il traverse aujourd'hui. Le centre et l'est de notre continent ont su mieux conserver l'idée de communauté charnelle. En Allemagne et en Scandinavie, les idéaux populistes de toutes sortes ont su donner une harmonie intérieure à la société depuis deux siècles, laquelle s'est traduite par des progrès considérables tant sur le plan intellectuel que sur le plan technique. L'Allemagne et la Suède enregistrent des succès industriels et sociaux considérables précisément parce que l'individualisme occidental les a moins marquées. Les peuples slaves et baltes ont traversé l'âge sombre de l'ère marxiste sans oublier leurs racines, comme le prouve quantité de faits divers de l'actualité récente, notamment en Estonie, en Moldavie, en Lithuanie et en Azerbaïdjan.
Dans cette optique, le recentrage de l'Europe sur elle-même ne peut se faire sur base des idéaux occidentaux et des pratiques sociales qu'ils ont générées. Le recentrage de l'Europe se fera sur base des idéaux fructueux que la philosophie de Herder a fait germer de Dunkerque au Détroit de Bering. Ces idéaux placent au sommet de la hiérarchie des valeurs le peuple comme porteur et vecteur d'une culture spécifique et inaliénable, hissent la solidarité communautaire au rang de principe social cardinal. Dans cette optique, l'autre est toujours un frère, non pas un gogo à berner, à qui soutirer du fric, un péquenaud que l'on administre à coups d'ukases, que l'on écrase d'impôts en lui contant qu'il jouit tout de même des «droits de l'homme» et qu'il n'a qu'à être bien content et s'esbaudir à la pensée que les p'tits chinois, eux, ils n'en bénéficient pas. Tous les défenseurs de beaux principes idéalistes sont des escobars, des escrocs, des distilleurs d'opium du peuple. L'Occident des réactionnaires et le One-World aseptisé des américanolâtres, libéraux ou ex-soixante-huitards, sont des principes de nature manipulatoire. Notre Europe, elle, n'est pas un principe, elle une terre, une terre-mère qui a enfanté dans la douleur quelques races d'hommes qui se sont entrecroisés (des Méditerranéens et des Nordiques, des Ostbaltiques et des Dinariques, etc.) puis ont produit des tas de choses magnifiques qui étaient déjà inscrites virtuellement dans les gènes de leurs plus lointains ancêtres. Il faut continuer l'aventure. Il faut faire passer toutes nos énergies du virtuel au réel.
Robert STEUCKERS.
00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : synergies européennes, europe, occident, philosophie, histoire, définition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 29 août 2009
Brief Guillaume Fayes an seine Freunde (1987)

Brief Guillaume Fayes an seine Freunde (1987)
Liebe Freunde,
Als Kadermitglied und Funktionär des GRECEs seit 17 Jahre, habe ich seine Entfaltung, seinen Höhepunkt (1978-1982) und seinen Untergang (1982-1987) miterlebt.
Lange habe ich seinen Zerfall nicht akzeptiert und habe geglaubt, daß die Ursachen dieses Zerfalles konjunkturbezogen waren. Aber in Wirklichkeit sind diese Ursachen eher strukturell und, letzterhand positiv: der GRECE hat seine historische Aufgabe verwirklicht. Heute ist diese Aufgabe beendet. Die Arbeit der GRECE-Bewegung war wirklich grundsätzlich und kann heute befrüchtet werden. Es war eine konstruktive Arbeit, genauer die Rekonstruktion einer Ideologie und einer Weltanschauung. Die Bewegung hat auch Leute ausgebildet, die heute überall in der Zivilgesellschaft aktiv sind.
Deshalb, der dumme Wille, den GRECE “regenerieren” zu wollen, seine Botschaft steril zu wiederkauen und sie ständig so wiederholen, wie sie einst war, scheint mir heute völlig utopisch, unnötig und unmöglich zu sein. Ein solches nostalgisches Verhalten wäre nur eine Rückwärtsbewegung. Der GRECE war ein Erfolg. Es künstlich im Leben zu halten wollen, würde notwendigerweise zu einem Fiasko führen. Der GRECE hat seine metapolitische und kulturelle Aufgabe optimal beendet. Mit den Meilsteinen, die er gelegt hat, können wir uns orientieren, um sein Werk in anderer Form zu vertiefen und für die Zukunft zu gestalten. Eine solche Transformation ist nicht nur notwendig, weil unsere Zeit es fordert, aber auch um die gestrige Arbeit des GRECEs effizient zu machen. Wir müssen diesen geistig-intellektuellen Korpus mehr Potenz und so denkend, ihm organisationell eine andere Gestalt geben.
Hauptaufgabe ist es, die ideologische Erbschaft fruchtbar zu machen. Wir müssen jetzt, ab sofort, zurück zur Wirklichkeit und deshalb eine moderne und interventiongerichtete Strategie entwickeln. Das ist der Grund, warum wir denken, daß das Werk des GRECEs jetzt abgeschlossen ist. Darum, höre ich heute auf, Mitglied des GRECEs zu sein. Und ich hoffe, daß die meisten von euch die gleiche Analyse wie ich machen werden. Obwohl ich nicht mehr Mitglied des GRECEs bin, bleibe ich trotzdem ein treuer Mitkämpfer unseres Kampfgemeinschaft.
Zwei Neuorientierungen scheinen mir interessant: ab 1992 wird Europa anfangen, als eine reale politische Wirklichkeit zu existieren. Die Grenzen werden sich tatsächlich öffnen. Bald wird eine gemeinsame Währung kommen, usw. Wir müssen notwendigerweise diese Möglichkeiten benutzen, die uns unsere Feinde geben. Diese bauen praktisch einen europäischen Großraum für uns und geben uns so die Möglichkeit, eine gesamteuropäische Kampforganisation zu schaffen, die der Kern einer künftigen gesamteuropäischen Gemeinschaft für unsere eigene Weltanschauung sein wird.
Die Ideologie, die wir seit vielen Jahren innerhalb der GRECE-Denkfabrik ausgearbeitet haben, war von einer spezifischen Kernidee im Leben gehalten und diese Idee war die Befreiung des gesamteuropäischen Kontinents, damit an die Schaffung einer gesamteuropäischen Reichsgemeinschaft gearbeitet werden könnte. Aber eine solche Idee hat nie in der Geschichte Wirklichkeit gefunden.
Die Amerikaner leben in einer antiquierten Welt, weil der amerikanische Traum schon da ist, und deshalb, weil er da ist, ist er unwiederruflich alt. Der amerikanische Traum ist eine alte Sache, ist schon volle Wirklichkeit geworden. Aber unser Traum ist hypermodern, weil er noch nicht da ist, liegt vor uns in einer noch relativ fernen Zukunft. Deshalb ist unser Traum jugendhaft.
In diesem Sinn und mit einem Optimismus, die wir von dem Bewußtsein unserer in den GRECE-Jahren erarbeiteten Tradition und unserer langen Gedächtnis geerbt haben, kann unser Projekt entstehen und sich entfalten: wir werden eine flexible Organisation stiften, die nicht nur Frankreich-zentriert sein wird, aber sich überall in allen Ländern des Kontinents entwickeln wird, wir werden in allen möglichen Schichten und Dimensionen der Gesellschaft intervenieren, aber immer mit dem Vorhaben, eine Reichsvision für das künftige Europa zu schmieden.
Die zweite Neuorientierung ist die folgende: die Ideen, die der GRECE verbreitet hat, eben unter den völlig inadequaten Namen der “Neuen Rechten”, leben und verbreiten sich sehr weit über die engen Grenzen aller möglichen rechtskonservativen Denkschulen. Deshalb sollte die post-GRECE-istischen Nachfolger-Bewegung total modernistisch sein, alles, was die soziologische Rechte darstellt, überwinden, sich an allen neuen Impulsen aus der Gesellschaft öffnen, und hauptsächlich die nostalgisch-folkloristische Rechte eine definitive Absage erklären. Diese neue Bewegung wird als Beruf haben, alle Leute aus allen möglichen Horizonten zu gruppieren, wenn sie grundsätzlich unser Programm zustimmen. Zusammen müssen wir entschieden alle Formen der Abhängigkeit und der Unterwerfung, irgendeiner Rechten oder Linken gegenüber, zurückwerfen.
Ziel ist es, die Grundlagen einer Bewegung zu erarbeiten:
- 1. die sich in allen Ländern des Kontinents verbreiten wird;
- 2. die alle alten Schablone und Spaltungen überwindet;
- 3. die die Erbschaft unserer Arbeit in den GRECE-Jahren fruchtbar macht;
- 4. die als Ziel haben wird, konkret eine neue politische und aktive Elite zu schmieden, um positiv in der Zivilgesellschaft intervenieren zu können.
Eine solche Arbeit wird lang, schwer und mühsam sein. Sie ist aber lebenswichtig und soll sofort von jetzt ab angefangen werden. Es wäre auch notwendig und logisch, daß die meisten Mitglieder und Sympathisanten des GRECEs sich in dieser neuen Bewegung einen, weil diese die allein mögliche historische Kontinuität darstellen wird. Natürlich neue Menschen, die aus allen Horizonten zu uns kommen werden, werden sich mit uns in diesem Kampf verbrüdern. Um der realen Welt die Stirn bieten zu können, um in dieser realen Welt Aktion führen zu können, werden wir dringend diese neuen Menschen brauchen.
Auf der juridischen Ebene, ist der Kern dieser neuen Bewegung (die weder eine Partei noch ein Apparat ist!), die dazu bestimmt ist, neue Energie in unserer Bewegung einzufliessen, ist schon gestiftet worden. Er hat die juridische Gestalt einer Stiftung und heißt: EUROPA.
Diese neue Bewegung steht noch in seiner Vorbereitungsphase und wird nur real und konkret auf europäischer Ebene am Anfang des nächsten Uni-Jahres, also im September 1987 existieren. Geburtsstunde wird die Sommeruni 1987 sein, die wir im Region Nivernais Ende August halten werden (wir können über unseren üblichen Versammlungsort in der Provence dieses Jahres nicht verfügen). Während dieser Sommeruniversität werden wir die Grundlagen unserer künftigen Arbeit festlegen.
Es ist notwendig, daß viele von euch sich sofort einschreiben.
Jetzt zur Arbeit, liebe Freunde!
Mit meinen freundlichsten Grüßen,
Ihr, Guillaume Faye, Mai 1987.
00:10 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, synergies européennes, métapolitique, guillaume faye, droite, conservatisme, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 28 août 2009
Les pistes manquées de la "Nouvelle Droite" - Pour une critique constructive

Archives de "SYNERGIES EUROPEENNES" - 1999
Les pistes manquées de la «nouvelle droite»
Pour une critique constructive
Robert STEUCKERS
En avril/mai 1987, Guillaume Faye claquait la porte du GRECE, principale officine du mouvement politico-intellectuel français que les journalistes avaient appelé la «nouvelle droite», histoire de lui donner un nom médiatisable. Faye y était resté pendant près de quinze ans, il avait porté le mouvement à bout de bras à ses heures de gloire. Il en ressortait dégoûté. Dans un texte récapitulatif qu'il a rédigé et qui est paru fin 1998 dans un livre intitulé L’archéofuturisme (éd. L’Æncre, Paris), il exprime clairement son désappointement ; il avait dégagé, dans un mémorandum dont il ne souhaite pas la publication mais qu’il nous avait soumis, les écrasantes responsabilités d'Alain de Benoist dans l'échec de ce mouvement de pensée, fort prometteur au départ, parce qu'il voulait réactiver ce que les idéologies dominantes avaient refoulé et ce que les multiples réductionnismes à l’œuvre dans la société excluaient ou refusaient de prendre en compte. Dans L’archéofuturisme, Faye, avec un langage plus feutré que dans son mémorandum, énonce les tares du mouvement, nous indique quelles ont été les impasses dans lesquelles celui-ci s'est fourvoyé et enlisé (paganisme folklorique, gauchisme révisé, fétichisme pour des mots creux, etc.) . Ensuite, il nous esquisse onze pistes pour relancer une dynamique, qui ne devra pas nécessairement s'appeler la “nouvelle droite”, le concept ayant fait faillite, désormais grevé de trop d'ambigüités.
Les options philosophiques de Faye mettent l'accent sur le futurisme, sur la prospective davantage que sur l'archéologie ou la mémoire, même s'il dit clairement que toute prospective futuriste doit avoir des assises historiques, des référentiels archétypaux. Néanmoins, la lecture de ses textes, l'audition de ses discours montrent que la fulgurante personnalité de Faye n'a nulle envie d'être trop embarrasée, trop incapacitée par le poids d'un héritage, quel qu'il soit. Puisqu'il nous enjoint de pratiquer et de propager un “archéo-futurisme”, sorte de mixte d'hellénité idéale et de fulgurances à la Marinetti —que Faye situe volontiers dans un environnement urbain et architectural mêlant Vitruve et Mies van der Rohe— dressons à notre tour un bilan et esquissons un projet, pour ce volume qui a pour objectif premier d'inaugurer l'ère de la “post-nouvelle-droite”. Notre approche sera peut-être moins “futuriste” que celle de Faye, elle privilégiera les continuités historiques, sans pour autant sombrer dans les archaïsmes qui condamnent à l'inaction et “muséifient” les discours.
Une terminologie ambiguë
Mais avant de passer au vif du sujet, rappelons que le terme de « nouvelle droite » est trop ambigu : le « new right » des pays anglo-saxons s’assimile à un curieux mixte de vieux conservatisme, de néo-puritanisme religieux et de néo-libéralisme offensif (lors de la montée de Reagan au pouvoir) ; la « Neue Rechte » allemande a un passé résolument national-révolutionnaire ; la nouvelle droite française est essentiellement portée par une association de combat métapolitique, le GRECE (Groupement de Recherches et d’Etudes sur la Civilisation Européenne). Nos critiques ne s’adressent pas à la « new right » anglo-saxonne, dont nous ne partageons pas les postulats et qui se déploie dans des aires politiques qui ne sont pas les nôtres, ni, a fortiori, à la « Neue Rechte » allemande dont nous nous sentons très proche, mais au GRECE (dont nous ne nions pas les acquis positifs) et à son « gourou », qui a toujours refusé toute direction collégiale, développé un culte puéril de sa personnalité, et s’est entouré d’hurluberlus dévots et sans culture, dont le cortège aurait inspiré Jérôme Bosch et fait la fortune du Dr. Freud. De club politico-culturel offensif et rupturaliste, le GRECE s’est transformé en une secte étriquée de copains plus ou moins farfelus, animée par un « Chancelier », sorte de gagman sexagénaire, grande gueule toujours occupée à monter des sketches au goût douteux, qui n’ont rien d’élitiste ni de philosophique ni de métapolitique. Triste épilogue…
Pourtant l’affaire GRECE n’avait pas commencé dans le gag (sauf si l’on se réfère à Roland Gaucher) (1). Le GRECE a constitué une réaction salubre contre la mainmise gauchiste-vulgaire sur les esprits dans les années 70. Cette réaction, cette volonté a permis de sortir du refoulement toute une panoplie de thématiques historiques ou organiques, d’introduire dans le débat les thématiques biologisantes ou les découvertes d’une psychologie différencialiste abordées aux Etats-Unis ou en Angleterre (Ardrey, Koestler, Eysenck, etc.). L’exploitation de l’œuvre de Konrad Lorenz et d’Irenäus Eibl-Eibesfeldt explique le franc succès du GRECE, explique aussi pourquoi nous avons été immanquablement attirés vers lui. Les numéros d’Eléments ou de Nouvelle école de 1975 à 1986 restent des sources de références incontournables. Malgré d’inévitables lacunes, dues à la faiblesse des moyens et des effectifs, le corpus prenait forme, lançait des débats, fécondait des esprits. Quelques adversaires de la ND ont reconnu l’importance de ses apports (Raymond Aron, par exemple).
Dans les années fortes de la ND, des dizaines de cadres ont été formés dans la discrétion, qui ont ensuite été injectés à divers niveaux de la vie politique ou culturelle de la France. A l’abri des regards, ces hommes et ces femmes continuent à faire du bon travail, dans des réseaux associatifs, dans des modules de recherches, chez des éditeurs... Mais ils ont abandonné la secte, ne la fréquentent plus, n’influencent malheureusement plus les jeunes qui y cherchent une voie et n’utilisent plus ce langage codé, repérable, stéréotypé, qui révèle une vulgate plutôt qu’une méthode.
La ND : un bon démarrage
Autre apport non négligeable de la ND : avoir contribué à « déculpabiliser » la culture dite de droite, diabolisée depuis 1945. C’est sans doute le principal motif de la haine que voue la gauche établie à la ND et à l’entreprise d’Alain de Benoist. Cette haine s’est déployée avec une férocité pathologique à partir de l’été 1979, quand la ND influençait fortement un hebdomadaire à très gros tirage, le Figaro-Magazine, dirigé par Louis Pauwels. Alain de Benoist y tenait la rubrique des « idées », poste d’avant-garde très efficace pour faire changer les mentalités, indiquer de nouvelles pistes à la culture française. L’idée d’une « école de pensée », formant des cadres en toute autonomie, la volonté de détruire les refoulements de la culture dominante et de proposer du neuf, sans jamais recourir à de vieilles lunes, ont contribué à forger le « mythe ND ». Très rapidement pourtant, l’offensive s’est soldé par un échec : l’idéologie dominante, les vigilants de la république, la gauche parisienne, les dévots d’un catholicisme progressiste ou intégriste se sont ligués contre la nouvelle venue et l’ont contrainte à la retraite. La ND a dû céder face au néo-libéralisme et au culte moralisant des droits de l’homme (couverture des pires dénis de droit que l’histoire ait jamais vécus). Dans les propres rangs de la ND, l’enthousiasme a fait place à l’aigreur. La lucidité a disparu au profit de la paranoïa. Au lieu d’admettre que la ND a battu en retraite, après un très beau combat, parce que les effectifs étaient trop réduits et encore insuffisamment formés, le microcosme néo-droitiste parisien a sombré dans les pleurs et les grincements de dents. Quinze ans après le ressac, malgré l’ouverture opportune de nouvelles pistes (écologie, communautarisme, etc.), aucune réflexion philosophique réelle et profonde n’est venue renforcer les options de départ. Vœux pieux et lamentations anti-technicistes ou anti-libérales ne peuvent tenir lieu de discours critique : nous aurions voulu une étude plus approfondie de Carl Schmitt, de Gramsci, de Hans Jonas, de Sombart, de De Man, etc. Et un plongeon dans le vaste océan de la postmodernité philosophique (Lyotard, Foucault, Deleuze, Guattari, etc.), ce qui aurait été tout naturel pour un mouvement d’origine française.
En juin 1989, lors d’une séance de formation au « Cercle Héraclite », ouvert aux cadres du mouvement, j’avais voulu marquer mon retour au GRECE, après un éclipse de près de six ans, en attirant l’attention des cadres (ou ce qu’il en restait…) sur l’ampleur et la pertinence de la critique contemporaine des philosophes français : je n’ai rencontré qu’indifférence, incompréhension et hostilité (pour lire le texte de cette intervention, cf. « La genèse de la postmodernité », in : Vouloir, n°54/55, 1989). « Je n’ai rien compris », m’a dit un cadre après mon exposé.
De même, les options biologisantes du GRECE avaient besoin —Alain de Benoist ne me contredira pas, même s’il est retourné récemment à sa manie comptable de calculer les quotients intellectuels— d’un solide ravalement. Il me paraissait nécessaire d’ouvrir les recherches de la ND aux théories de la cognition humaine, proposée par les disciples de Konrad Lorenz, encadrés par Riedl et Wuketits, de renouer avec la théorie des systèmes de Ludwig von Bertalanffy et avec son actualisation par le Japonais Maruyama, d’introduire dans les débats français les travaux de l’Allemand Friedrich Vester (cf : mon exposé au séminaire de mai 89 de l’équipe de Vouloir, tenu en Flandre, et visité par une équipe de cadres du GRECE dirigée par Charles Champetier : « Biologie et sociologie de l’“auto-organisation” », in Vouloir, n°56/58, 1989). « Je n’ai rien compris » fut une nouvelle fois la réaction d’un cadre (non, non, ce n’était pas Champetier : il était parti dans les campagnes flamandes à la recherche d’un magasin vendant des cigarettes. Ce toxicomane était en manque… faut comprendre… ).
En février 1991, à Pérouse en Ombrie, lors de mon exposé au colloque des ND française (A. de Benoist), italienne (M. Tarchi & A. Campi) et britannique (M. Walker), j’ai insisté sur une prise en compte de la méthode de Derrida pour éviter de développer une conception figée de l’identité, propre à certains partis nationalistes ou populistes, dont de Benoist lui-même soulignait les insuffisances. J’ai voulu étayer cette critique de de Benoist, en plaçant le débat à un niveau politologique et philosophique, en refusant de le laisser à celui des invectives stériles (cf. « Dévolution, Grand espace et régulation », in : Vouloir, n°73/75, 1991) (2). Cette critique de l’ « identitarisme figé » impliquait une réflexion sur les notions de différAnce et de différEnce chez Derrida. Pour tout commentaire, de Benoist, après mon exposé, m’a demandé pourquoi j’avais parlé de ce « con » de Derrida. Il semblait me prendre pour un fou.
Un refus d’abandonner ses insuffisances…
Ces trois incidents, un peu burlesques, montrent qu’il n’y avait pas, au sein de la ND, une volonté claire de se démarquer de certaines insuffisances ou de certains passéismes ni de consolider ses bonnes intuitions de départ. La ND ne voulait pas d’ouverture à la pensée française contemporaine, alors que tout le débat allemand et américain est profondément empreint des apports de Foucault, Deleuze, Lyotard, Derrida, etc. La ND ne voulait pas répondre sérieusement au reproche inlassablement ressassé de « biologisme » que lui adressaient ses adversaires. Elle aurait dû revendiquer son organicisme biologisant mais en l’étayant d’arguments scientifiques incontestables, au lieu d’être pétrifiée de frousse dès qu’un adversaire lui reprochait de faire de la « biopolitique ». La ND en est arrivée à démoniser elle-même tout discours biologisant-organicisant, avec des arguments boîteux, tirés de doctrines éthiques irréalistes ou d’une lecture un peu courte des critiques traditionalistes formulées à l’encontre du vitalisme. Enfin, les remarques méprisantes d’un Alain de Benoist sur la pensée de « Derridada » sont assez sidérantes, quand on sait que la ND est accusée, encore aujourd’hui, d’avoir fondé un « discours identitaire », repris par l’extrême-droite, accusée à son tour, de développer une vision étriquée et figée de l’identité. Malgré ses discours passionnels contre Le Pen (« le programme du FN me soulève le cœur », répondait-il aux journalistes d’une revue bourrée de fautes d’orthographes monstrueuses), de Benoist ne développe pas une théorie valable de l’identité, qui échappe tout à la fois au fixisme des vieilles droites et aux reproches des professionnels de l’anti-fascisme.
En ce début de l’année 1999, la ND vient de publier son premier manifeste (ouf, enfin, ça y est…). Si les pistes suggérées ou les constats qui y sont formulés rencontrent grosso modo mon approbation, j’estime toutefois que ce manifeste reste au niveau des vœux pieux ou de la protestation moralisante. Il lui manque précisément de bonnes références philosophiques.
Mon auto-critique
Enfin, mes critiques peuvent sembler oiseuses après tant d’années dans le sillage de la ND. En effet, le reproche pourrait aisément fuser : « Qu’as-tu f… là pendant si longtemps ? ». Pour ma défense, je dirais qu’il n’y avait rien d’autre en francophonie, et que mon intérêt pour le GRECE était parallèle à un intérêt pour les initiatives allemandes et italiennes de même nature. Je suis effectivement abonné à Criticón et à Junges Forum depuis 1978, bien avant mon passage au GRECE. Je lisais Linea de Pino Rauti et j’achetais en versions italiennes les livres d’Evola qui n’étaient pas traduits en français. Très tôt, j’ai pu comparer avantages et lacunes des uns et des autres. Ensuite, dès 1976, j’ai suivi de très près les initiatives de Georges Gondinet, à l’époque nullement assimilables à celles du GRECE. J’ai toujours, me semble-t-il, opté pour la pluralité des sources d’information contre le réductionnisme et l’assèchement sectaires. C’est une option qui me parait toujours valable : je demande donc à tout ceux qui s’intéressent à la ND parce qu’ils veulent sortir du ronron dominant de ne pas réduire leurs sources d’information à une et une seule officine, mais de chercher systématiquement la diversité. C’est par une pratique diversifiante et différAnciante (Derrida !) que les « refuzniks » que nous sommes finiront par appréhender et arraisonner le réel dans toutes ses facettes. Et ainsi gagner la bataille métapolitique, promise par de Benoist, avant qu’il n’opère ses replis frileux : peur de la politique, peur des populismes, peur des journalistes qui le critiquent, peur des langages francs et crus, peur de réaffirmer son biologisme, peur d’être traité de fasciste, peur de ne pas être reçu par une huile quelconque. Pas besoin d’être grand philosophe pour condamner et mépriser une telle attitude. Il suffit de se rappeler l’adage : la peur est mauvaise conseillère.
La «nouvelle droite» et l'histoire
Les regards que la «nouvelle droite» française a jetés sur l'histoire de l'Europe ont toujours été flous et ambigus. Quant à la «nouvelle droite» italienne, elle s'est fort préoccupée de redéfinir l'histoire du fascisme (alors que cette tâche était pleinement assumée par Renzo de Felice ou Zeev Sternhell). Redéfinir le fascisme était la tâche de son principal promoteur à l'université, était son boulot de chercheur, et nul parmi nous ne contestara évidemment cette fonction qui fut et reste la sienne.
A Paris, la vulgate ND —en disant « vulgate », je n’incrimine ni de Benoist ni d’autres exposants de la ND, mais une mouvance difficilement définissable que l’on a, à tort, assimilée à la ND et qui compénètre tout le champs des droites françaises— n’a pas développé une vision de l’histoire cohérente : tout au plus perçoit-on chez elle un vague mixte de vision décadentiste et de nordicisme (indo-européen), où les accents pessimistes de Gobineau (mal lu) et de Spengler (mal digéré) se mêlent aux accents « normandistes » et pessimistes du dernier Drieu. Chacun de ces auteurs est passionnant en soi. Chacun d’eux nous livre une œuvre aux strates multiples :
- Gobineau, notamment, outre son nordicisme (qui lui est vivement reproché) réhabilite le rôle de la Perse dans le rayonnement des peuples indo-européens et critique l’intellectualisme hellénistique (source de déclin) ; la Perse nous lègue notamment une éthique guerrière et chevaleresque, dont héritera, après bien des détours et à travers un filtre chrétien, les chevaliers médiévaux ; toute une historiographie et maints ragots colportés font de Gobineau l’inventeur d’un racisme hargneux devant à terme déboucher sur « l’impensable » ; en réalité Gobineau fut un grand voyageur ouvert à l’Islam iranien et à l’Orient, méprisant les « petits crevés » (comme il appelait les nullités des beaux quartiers de Paris) et ne prenant pas l’Europe pour « l’ombilic de l’univers l’univers » (cf. Jean Boissel, Gobineau (1816-1882). Un Don Quichotte tragique, Hachette, 1981 ; cf. également Alexis de Tocqueville, Œuvres Complètes, Tome IX, Correspondance d’A . de Tocqueville et d’A. de Gobineau, Gallimard, 1959). Gobineau est celui qui a ouvert la pensée française aux mystiques panthéistes de la Perse, qui a, bien avant Derrida, réclamé une ouverture de notre pensée à cet univers intellectuel.
- Spengler, avec sa notion de pseudo-morphose des civilisations, avec son mythe touranien, sa classification des cultures (faustienne, magique, etc.) ;
- Drieu, avec expérience de combattant de 1914, son passage à Dada (et sa participation à titre de témoin à décharge au « procès Barrès »), sa carrière d’écrivain parisien, ses tentations politiques (Doriot, etc.), ses réflexions sur les traditions, notamment sur Guénon, découvertes tardivement lors de la parution de son Journal.
Ces trois auteurs peuvent être interprétés de manières très diverses. Ils échappent ou devraient échapper à toute vulgate et à tout réductionnisme interprétatif.
Une pitoyable vulgate
Par ailleurs, une bonne part des militants de la mouvance de la “nouvelle droite” parisienne se percevaient comme les héritiers de ce complexe idéologique plus mystique que politique, plus idéaliste que concret, un complexe que l'on cultivait en ghetto à l'exclusion de tout autre et qui mêlait le “fascisme français” et les “écrivains maudits de la collaboration”. Ils mêlaient simultanément ce corpus complexe au filon nordiciste, issu d’une lecture très partielle de Gobineau voire de Vacher de Lapouge (3), où l'histoire était perçue comme l'amenuisement continu de l'influence physique et métaphysique des peuples germaniques en Europe, dont la France, leur pays, n'était que très partiellement l'héritière, une héritière, qui plus est, qui avait explicitement rejeté cet héritage depuis l'Abbé Siéyès.
Grosso modo, disons que, avant l'aggiornamento des années 90, dans les premières décennies de l'histoire de la ND, consciemment ou inconsciemment, l'accent était mis sur le filon Gobineau-Drieu la Rochelle, reprise des pamphlets anti-fascistes et anti-racistes, mais cette option, chez les camarades pseudo-nationalistes et néodroitistes, était revendiquée avec chromos brekeriens en prime; ce filon était détaché de tous contextes politiques réels puis simplifié en une vulgate assez étriquée, suscitant la commisération de tous ceux qui vivent quotidiennement les assauts du monde réel, sous quelque forme que ce soit. Dans les corridors et les coulisses de la ND parisienne, on avait l'impression d'errer dans une utopie irréelle, sous une bulle de verre où étaient voués aux gémonies tous les faits de vie réelle qui contrariaient l'image idéale du monde, des hommes et des Français, rêvée par ces petits étudiants ratés ou ces médiocres employés de banque subalternes, au profil psychologique instable et, qui, à cause de ce handicap, parce qu'ils ressentaient ces lacunes et ces tares en eux-mêmes, s'étaient recyclés, pour se donner une importance toute fictive, dans une “lutte métapolitique planétaire”.
Appuyés par tout un commerce de colifichets frappés du logo du GRECE, les tenants de la vulgate balbutiaient ou gribouillaient des fragments aussi oniriques que décousus de ce fatras nordico-fascisto-parisien; ces fragments, ils les faisaient dériver de ce filon pseudo-gobinien et les exprimaient en textes ou en images ou en discours avinés après le dessert, puis les ressassaient à l'infini, sans le moindre esprit critique en les mêlant à des interprétations naïves et juvéniles des mondes ouraniens-olympiens et des chevaleries idéales, décrits par Evola dans Révolte contre le monde moderne. Critiques du catholicisme populaire, volontiers blasphémateurs à l'égard des chromos, des crucifix, des vierges et des Saintes-Rita à la mode de Saint-Sulpice, les galopins du GRECE répétaient sous d'autres signes les mêmes travers que les chaisières et les bigotes des paroisses d'arrière-province.
L'anti-fasciste professionnel sans profession bien établie, l'ineffable “René Monzat”, a eu beau jeu de dénoncer cette bimbeloterie dans Le Monde, le 3 juillet 1993. Ce triste garçon, dont la jugeotte n'a certainement pas la fulgurance pour qualité principale, concluait au “nazisme fondamental” du GRECE, parce que de Benoist, qui n'est ni nazi ni rien d'autre que lui-même, rien d'autre que sa propre égoïté narcissique, s'était copieusement “sucré” en vendant des “tours de Yule” en terre cuite —modèle SS-himmlérien— à ses ouailles, en multipliant le prix de base de son grossiste allemand par dix!
Un scandinavisme irréel et onirique
Mais le nordicisme/germanisme de Gobineau s'inscrit dans une histoire plus complexe, dont la ND n'a jamais véritablement rendu compte: elle a contribué à pétrifier ce filon, surtout à le ridiculiser définitivement (Dumézil l'avait compris!), sans en avoir extrait les potentialités toujours vives, sans avoir dégagé, par exemple, l'apport géopolitique et géostratégique du monde nordico-scandinave dans l’histoire générale des peuples européens: ouverture des voies maritimes nord-atlantiques, exploitation de l'axe Baltique/Mer Noire, ouverture du commerce eurasien via le comptoir de Bulgar dans l'Oural, organisation du commerce fluvial sur le Dniepr, le Don et la Volga, ouverture de la Caspienne et accès du commerce européen à la Perse et à la Mésopotamie: autant de routes qui restent, aujourd'hui plus que jamais, d'une brûlante actualité. Non: pour la clique d'esprits bornés qui sautillaient et s'agitaient autour du gourou de Benoist (qui assurément ne partageait pas leurs simplismes), les Scandinaves du IXième au XIième siècles n'étaient ni des techniciens hors ligne de la navigation ni des commerçants audacieux qui ouvraient l'Europe au monde: ils étaient décrits comme des espèces de cannibales chevelus et moustachus qui pillaient les couvents ou, pire, comme des ruraux simplets, vivotant en dehors des tumultes du monde, confectionnant avec de la terre cuite des luminaires disgrâcieux (qui font rétrospectivement frémir Monzat et ses commanditaires du Monde) plutôt qu'étudiant la résistance des bois à la mer et au vent, la carte du ciel pour s'orienter en haute mer, l'aérodynamisme des coques de navires pour se lancer dans des expéditions hardies. Etre technicien ou commerçant, dans la vision du monde des débiles adeptes du grincheux gourou néo-droitiste, c'était déchoir dans la “troisième fonction”, c'est-à-dire la fonction du travail, de la production, jugée mineure par ces oisifs qui ne commandaient rien, qui ne produisaient rien, qui vivaient d'allocations ou de postes de fonctionnaire, mais qui croyaient, dur comme fer, qu'ils étaient potentiellement les souverains de la future “grande Europe”. Les Vikings imaginaires des milieux néo-droitistes n'étaient pas admirés pour ce qu'ils avaient été, des explorateurs, des marins et des négociants, mais parce qu'on leur prêtait des canons physiques stéréotypés: une blondeur et une vigueur qui étaient absentes, dans la plupart des cas, chez ces vikingomanes d'Auteuil-Neuilly-Passy. On sort ici de la politique, de la métapolitique, pour entrer de plein pied dans la psychopolitique voire la psychiatrie tout court.
Restaurer la « virtù » des Romains et des Germains
Revenons à l'histoire: le mythe nordiciste qui traverse l'historiographie européenne depuis les humanistes italiens du XVième siècle est surtout l'expression idéalisée de deux soucis récurrents dans la pensée politique de notre continent: la disparition de la virtù politique, de la force de façonner le politique pour le bien de la Cité, où la virtù était d'abord posée comme le propre du peuple et du Sénat de l'Urbs romana, puis par translatio imperii, comme le propre des peuples germaniques. Cette virtù est une idée républicaine au sens étymologique du terme, comme nous l'a explicité Machiavel dans son Prince. Elle s'oppose, en tant que telle, au césaro-papisme du Vatican qui, au XVième siècle, montre ses limites et s'enlise dans une impasse; elle s'oppose aussi aux tentatives de centraliser les Etats monarchiques au détriment des corps concrets qui composent la Cité. Dans ce sens, l'amenuisement de l'influence des peuples germaniques n'est rien d'autre que l'amenuisement de la virtù dans les corps politiques d'Europe et non pas la déperdition d'un quelconque système coercitif. L'assomption de la virtù équivaut à la perte d'autonomie des corps concrets de la Cité, à la dévitalisation des sociétés civiles. La vision de Gobineau n'est jamais qu'une manifestation tardive —à l'ère romantique qui est à l'évidence traversée par un spleen qui, risque, chez les esprits faibles, de s’avérer incapacitant— de ce souci récurrent de la virtù dans l'histoire des idées politiques en Europe; Gobineau n'a pas infléchi sa démarche dans un sens juridique et concret, alors même que le XIXième siècle s'interrogeait sur les sources du droit (Savigny, Ihering, de Laveleye, Wauters, etc.); il a, malgré lui et pour le malheur de sa propre postérité, jeté les bases d'un discours tissé de lamentations sur l'amenuisement du germanisme.
Dans la même veine pessimiste, Hippolyte Taine a été un penseur beaucoup plus concret et méthodique: la ND ne l'a jamais abordé. De même, rien n'a jamais été fait sur la problématique des races en France, qui a agité tout le débat du XIXième siècle, en opposant celtisants (Augustin et Amédée Thierry, H. Martin, Guérard, le “génie celtique de J. de Boisjoslin), germanisants (le mythe “franc” chez Chateaubriand, Guizot, Mignet, Gérard, Montalembert, de Leusse) et romanisants (Littré). Ce débat ne portait pas seulement sur la définition de la “race” et n'était nullement une anticipation des réductions caricaturales du national-socialisme, mais portait sur le droit, sur la manière de façonner la Cité, de répartir les tâches entre les classes. Taine parlait d'un “réalisme à connotation populaire et raciale”. Pour la ND, l'onirique a primé sur le réalisme que Taine appelait de ses vœux. Pourquoi ce refus ?
Drieu la Rochelle, écrivain dans le Paris décadent d'après 1918, après son comportement héroïque pendant la Grande Guerre et sa fréquentation des dadaïstes et des surréalistes, perçoit les enjeux du monde avec une remarquable lucidité, mais celle-ci est estompée par son pessimisme, par un décadentisme finalement assez pitoyable et par un spleen que révèlent pleinement les pages de son Journal (par ailleurs mine inépuisable de renseignements de toutes sortes). Après la défaite de l'Axe en 1945 et le suicide de Drieu, ce pessimisme et ce spleen sont d'autant plus incapacitants pour qui veut construire une véritable alternative philosophique, idéologique et politique. Plutôt qu’au Drieu triste, il faut retourner au Drieu visionnaire !
Echec de l’Axe, faillite de la « métaphysique occidentale »
Car 1945 n'est pas simplement l'échec de l'Axe: il est l'échec de toute la métaphysique et de la civilisation occidentales. Les Alliés ont gagné cette guerre sur le terrain, incontestablement, mais ils n'ont rien proposé d'autre que du “réchauffé”, comme le prouve, presque a contrario, le succès indéniable de la philosophie “déconstructiviste”, née en Amérique et chez Derrida dans le sillage de Heidegger. Ce dernier a perçu en germe de réelles potentialités dans la “révolution allemande” (en 1934 pendant la parenthèse de son “rectorat”), mais aussi de terribles impasses dans son volontarisme outrancier, où la volonté poussée à son paroxysme rompait les liens de l'homme avec les continuités qui le nourrissent spirituellement et politiquement et son constitutives de son identité profonde. Mais, en constatant les impasses du national-socialisme, Heidegger n'a pas davantage opté pour les visions américaniste et bolchéviste de la société et du monde. Face à cet éventail de faits et de pensées, face à ce triple rejet de la part de Heidegger, la ND aurait pu et dû:
- abandonner les pessimismes incapacitants;
- renouer au-delà de Gobineau avec le républicanisme de Machiavel, avec la notion de virtù, présente dans la Rome antique et, par translatio imperii, chez les peuples germaniques (comme l'avait bien vu la lignée des observateurs de Tacite aux humanistes italiens et de ceux-ci à Montesquieu, ce dernier étant une référence incontournable pour toute pensée démocratique sérieuse, c'est-à-dire pour toute pensée démocratique qui refuse d'accorder le label “démocratique” à tout ce qui se présente comme tel aujourd'hui en Europe occidentale).
- être attentive plus tôt, dès le départ, à la démarche de Heidegger; au lieu de lui avoir consacré une attention méritée dès le début de son itinéraire, la ND, vers la fin des années 60 et au début des années 70, mue par une sorte de paresse philosophique, a préféré parier pour une vulgate anti-philosophique tirée de la philosophie anglo-saxonne (une caricature malhabile de l'“empirisme logique”) pour qui les questions métaphysiques ou axiologiques, le langage métaphysique et l'énoncé de valeurs, sont vides de sens.
- dans la foulée d'une réception de Heidegger, la ND aurait pu embrayer sur le filon “déconstructiviste”, poursuivre une critique serrée de la “métaphysique occidentale” et ne pas laisser l'arme du déconstructivisme à ses adversaires! Cet abandon de l'arme du “déconstructivisme” condamne la ND à du sur-place, puis, inéluctablement, au déclin et au pourrissement. Sans une bonne utilisation de l’arme « déconstructiviste », la ND ne peut développer une critique crédible des institutions en place ou des fausses alternatives (gauchistes). Elle risque alors de passer pour un simple appendice intellectuel, un salon où l’on cause, un havre pour oisifs argentés, juste en marge du pouvoir.
Déconstructivisme et France rabelaisienne
Ensuite, la ND aurait pu faire advenir une pratique de la déconstruction permanente dans le champ de l'histoire. Je m'explique: surplombé par une métaphysique particulière (platonico-chrétienne), l'Occident a agi sur le terrain de l'histoire d'une certaine façon, c'est-à-dire d'une façon que déplorent les contestataires radicaux de cette métaphysique, de cet Occident et de cette histoire. La métaphysique occidentale, sur le terrain, a fait des dégâts, comme le constatait Heidegger. Ont été effacés de l'espace occidental, au nom d'une métaphysique particulière: les ressorts des communautés naturelles d'Europe, un processus qui est à l'œuvre, inexorablement, depuis la centralisation du Bas-Empire romain décadent jusqu'à une christianisation manu militari, en passant par la mise au pas des âmes par l'Inquisition, par la philosophie politique de Bodin qui ne laisse pas de place aux corps intermédaires de la société (c'est-à-dire aux corps concrets de la souveraineté populaire), par les déismes et les rationalismes hostiles à toutes originalités et tous mystères, par l'éradication des fêtes populaires, des fêtes de jeunesse, de l'espace de liberté des goliards et des vagantes, de l'univers dionysiaque-rabelaisien. Jamais la ND ne s'est branchée sur ces filons pluri-millénaires, jamais elle n'a utilisé ses atouts et ses entrées dans le monde journalistique français pour promouvoir les écrits de ceux qui faisaient le constat de cette éradication pluriséculaire, en dehors de tout encadrement politicien, idéologique ou “clubiste”. Si elle l'avait fait, jamais personne n'aurait pu lui reprocher de camoufler derrière un discours modernisé, une volonté de “réchauffer” la vieille soupe nationale-socialiste.
Parallèlement à cette négligence du filon rabelaisien, la ND n'a pas davantage revalorisé les luttes paysannes et populaires contre les Etats, expressions politiques de cette métaphysique occidentale. Elle a refusé cette démarche, malgré les appels incessants d'un Thierry Mudry notamment, parce qu'elle était prisonnière d'un seul mot: l'inégalitarisme. Alain de Benoist, soucieux de sa vocation pontificale au sein du microcosme néo-droitier, a développé pendant sa carrière dans la grande presse (Valeurs actuelles, Le Spectacle du Monde, Le Figaro-Magazine, partiellement, Magazine-Hebdo) tout un discours, somme toute assez boîteux, sur l'“inégalité”, avec des calculs de QI, des dérivées et des asymptotes comparant l'intelligence des Pygmées et des Suédois, des Mongols d'Oulan Bator et des Equatoriens de Quito, laissant entrevoir, peut-être même à son insu, un modèle pyramidal où il aurait trôné très haut, au sommet de la pyramide, avec le monde entier à ses pieds d’auguste membre de la MENSA (le club français qui recrute des gens dont le QI est supérieur à la moyenne, mais dont on ne jauge pas l'état psychologique avant de les admettre au bar select de l'association). Telle est sans doute la vision onirique qui traverse les rêves du Pape de la “nouvelle droite”. Tout cela est bien divertissant, mais où est l’intérêt (méta)politique d’une telle posture ?
Ignorance des révoltes populaires
L'option “inégalitaire” de la ND, illustrée avec une opiniâtreté quasi monomaniaque, interdisait de se pencher sur les luttes populaires, sous prétexte que Marx, Engels, Bloch, etc. s'étaient intéressés à la “Guerre des Paysans” du début du XVIième siècle et qu'un mouvement qui choisissait le label de “droite” ne pouvait évidemment frayer avec des “marxistes” (!!!!!!???), retentissante sottise qui a laissé ce terrain fécond des luttes et des révoltes populaires à des socialistes ou à des communistes qui, par ailleurs, étaient, eux aussi, prisonniers de la “métaphysique occidentale”, à cause de leur matérialisme figé (mécaniciste et physicaliste) et de leur rationalisme étriqué (acceptant les acquis de ce rationalisme more geometrico qui a commencé à mutiler les corps concrets de la souveraineté populaire dès la Renaissance). De même, les dimensions populaires des révoltes françaises du XVIIième siècle, des révoltes populaires et paysannes contre la monarchie et contre la république à la fin du XVIIIième, les petites jacqueries du XIXième (étudiées par l'historien Hervé Luxardo) (4), n'ont malheureusement pas eu de place dans les réflexions de la ND.
L'option anti-chrétienne, le rejet des structures dérivées de la “métaphysique occidentale” ne devrait pas déboucher sur le refus de s'identifier aux luttes des peuples réels contre les pays légaux, des concrétudes charnelles contre les abstractions juridiques et rationalistes, refus qui condamne la ND à n'être qu'un salon de précieux bavards aux ambitions limitées, sans connexions utiles avec le monde extérieur. Les professions de foi “organicistes” ne sont que purs discours si elles ne suggèrent pas une politique organique concrète. Les “intellectuels organiques” sont toujours à la tête du peuple réel ou, au moins, commandent un fragment du peuple réel, fût-il dispersé au travers de réseaux divers (professions, syndicats, partis, clubs, etc.). A terme, un club de pensée à vocation métapolitique et/ou politique doit rallier sous une seule bannière nouvelle des citoyens dispersés dans de multiples structures en voie d'obsolescence, car l’obsolescence est la loi de l'histoire pour les structures, quelles qu'elles soient. La ND ne peut plus parfaire un tel travail de rassemblement car les vieux droitismes figés qu'elle ne cesse de véhiculer (anti-égalitarisme rédhibitoire débouchant sur un anti-populisme incapacitant), malgré ses dénégations, l'empêchent paradoxalement de se brancher sur les quelques gauches organiques à vocation contextualiste (qui proclament et démontrent que le cadre, le contexte social, économique et politique doivent être respectés en tant que tels dans la théorie et dans la pratique, contrairement aux universalismes traditionnels des gauches; en France, une telle gauche est représentée par le MAUSS, c'est-à-dire le «Mouvement Anti-Utilitariste dans les Sciences Sociales», que de Benoist courtise en vain, à coup des viles flatteries, depuis tant d'années).
Un piètre personnel subalterne
Enfin, il y a une autre démarche de la ND qui est condamnée à l'impasse: par son parisianisme, par son repli frileux autour de son gourou, elle s'est révélée incapable de disperser les centres dynamiques du mouvement sur tout le territoire français; ensuite, elle a été handicapée par sa frilosité à sortir des frontières de l'Hexagone et, à cause de la piètre qualité intellectuelle de son personnel subalterne à penser véritablement l'Europe, à apprendre les dynamiques politiques, culturelles et sociales à l'œuvre en Italie, en Allemagne, en Espagne, dans le Bénélux, en Scandinavie, etc., et à agir efficacement dans un contexte européen (ce qui implique de maîtriser plusieurs langues, d'accepter que l'Autre parle la sienne et non pas le français exclusivement, d'écouter poliment un exposé en allemand, en italien ou en anglais sans éprouver le besoin pressant de sortir pour fumer un clope dans le patio ou pour descendre une pils au comptoir, etc.). Les tentatives plus récentes de la ND parisienne de sortir des frontières de France se heurtent au même ballast structurel: recrutement d'autodidactes spécialisés en bricolages idéologiques, de vieux copains sans qualifications précises, de marginaux sans originalité et bourrés de fantasmes, de caractériels repêchés dans les poubelles des partis identitaires qui les ont exclus pour incapacité sur tous plans pratiques.
Ensuite, la ND parisienne n'a cessé d'être obnubilée par les “débats” parisiens dont tout le monde se fout à 30 km de la capitale française, ce qui lui a interdit de susciter un nouveau mouvement de contestation global, organique, dans tout l'Hexagone. Certes, Alain de Benoist —rendons-lui justice— a eu la volonté de se brancher sur les débats philosophiques américains, allemands, italiens, mais il n'a pas enseigné à ses ouailles la façon de maîtriser les sources non françaises d'information et de documentation qui auraient permis de renforcer dans le discours quotidien de la ND ce “poumon extérieur”, apportant en permanence des bouffées d'arguments neufs et de les déployer avant ses adversaires. De plus, comme d'habitude, de Benoist a eu l'art de recruter des étudiants ratés, des jojos hauts en couleurs ou tristes comme des ados coincés, incapables de lui porter ombrage (pour lui, c'était l'essentiel...) mais tout aussi incapables de maîtriser ne fût-ce qu'un basic English. Ils se coupaient du même coup de toute une documentation utile pour la révolution culturelle à laquelle ils étaient censés participer, dans le laboratoire de pointe qu'of course le GRECE prétendait être! De Benoist a voulu s'ouvrir sur l'Allemagne, jamais il n'a péché dans le sens d'un nationalisme français fermé sur lui-même, hostile au monde entier, rejetant l'Europe en construction, peuplé de “rancuneux” (cette belle expression, que mentionne encore le Littré a été réintroduite dans le discours politique par Michel Winock). Cette attitude de bon Européen, chez de Benoist, a suscité mon respect et ma sympathie, du moins au départ. Mais tandis qu'il était européiste, sans arrière-pensée, il a laissé la bride sur le cou à des pseudo-théoriciens d'un nationalisme français irréaliste dans ses expressions héroïcisantes et naïves, que le lecteur pantois, habitué à des analyses plus fines, a trouvé dans éléments n°38 (intitulé: «Pourquoi la France?»). Ensuite, il n'a cessé de fréquenter un certain Philippe de Saint-Robert (la particule serait fictive!), apôtre d'un hexagonalisme de droite et d'un anti-européisme navrant, rêvant de reconstituer la France aux 130 départements de Napoléon (5). Ces démarches délirantes ont empêché la fusion du corpus néo-droitiste et des revendications régionales en France, fusion qui aurait permis une évolution graduelle vers une constitution fédérale de modèle allemand, espagnol ou helvétique. La ND aurait dû indiquer dans son programme l'objectif qu'elle s'assignait pour la France et pour le bien des peuples de l'Hexagone: faire advenir dans les esprits une constitution fédérale pour une VIième République française, rompant de la sorte avec l'étatisme fermé d'inspiration bodinienne que n'avaient jamais abandonné les factions nationalistes françaises de diverses moutures. Le travail de la ND aurait dû être de préparer l'avènement à terme de cette VIième République, de façon à ce que la France ait une constitution en harmonie avec les autres pays de l'Europe en voie d'unification, de façon à ce qu'il y ait homogénéité constitutionnelle dans tous les Etats de l'Union avant l'unification monétaire et avant la suppression des frontières. Aujourd'hui, nous avons presque l’une et l’autre, mais sans homogénéité constitutionnelle, ce qui est une hérésie et une aberration: la ND aurait pu prévoir cette imposture et suggérer une alternative crédible. En ne le faisant pas à temps, elle n'a pas assumé sa responsabilité historique. Elle n’a pas respecté sa promesse d’être une instance de « première fonction » (instance incarnant la souveraineté et le droit selon Dumézil). On peut se demander pourquoi…
Régionalisme et critique de l’Etat bodinien
Si elle avait forgé sur le terrain une alliance durable avec les mouvements régionaux sérieux, la ND aurait travaillé à l'élaboration concrète de cette constitution fédérale pour l'Hexagone, niant du même coup les formes étatiques de la “métaphysique occidentale” qui ont oblitéré les sociétés françaises de François Ier au jacobinisme. Pour parfaire cette alliance ND/régionalismes, le club métapolitique d'Alain de Benoist aurait dû développer une vision non-bodinienne de l'Etat, une conception symbiotique des corps intermédiaires (qui sont, ne cessons jamais de le rappeler, les véritables corps concrets de la souveraineté populaire), permettant de coupler régionalismes et revendications sociales et populaires concrètes, en nouant cette idée symbiotique aux combats syndicalistes, en se débarrassant de son discours néo-libéral (ante litteram) sur l'égalitarisme et l'inégalité, qui ont fait qu'elle a été accusée sans interruption de “social-darwinisme” (de Benoist a eu beau s'en défendre par la suite, ce stigmate lui est resté collé à la peau).
Enfin, un mouvement métapolitique comme le GRECE, qui prétend dans son sigle même, vouloir appréhender l'ensemble des dynamiques à l'œuvre dans la civilisation européenne, n'a jamais raisonné sur les grandes forces historiques et géopolitiques qui ont traversé les régions d'Europe. Comme beaucoup de visions non dynamiques de l'histoire, le GRECE semble avoir cultivé lui aussi une vision figée de l'histoire, où des figures hiératiques, fortement typées, répéteraient inlassablement le même drame, sans imprévus autres que ceux prévus par le scénariste, avec, pour toile de fond, une tragédie réitérée en boucle sous la détestable impulsion des mêmes tricksters. Le gourou du GRECE aimait à se dire “spenglérien”, mais aucun lecteur de Spengler ne se reconnaîtra dans sa “vision” (bigleuse et non plus faustienne) de l'histoire européenne.
Dans l'officine néo-droitiste parisienne, peu de choses ont finalement été dites sur les lignes de force de l'histoire suédoise, allemande, russe, balkanique, hispanique, sur les dynamiques géopolitiques effervescentes le long des grands axes fluviaux d'Europe, sur les enjeux territoriaux, comme si ces tumultes millénaires allaient tout d'un coup s'apaiser, dès que le gourou déciderait, du haut de sa magnificence, de prendre la parole. Sa germanolâtrie, qui n'est rien d'autre qu'une coquetterie parisienne, ne parvient pas à s'articuler en Allemagne, où les nouvelles droites (très diverses) sont bien en prise avec les problèmes d’histoire et d’actualité. Le gourou de la ND est balourd dans le débat allemand. Son Allemagne de fillettes à longues tresses nouées, de ruraux coiffés de petits chapeaux bavarois, de soldats altiers et perdus, n'est qu'une Allemagne de chromos: l'Allemagne réelle est une Allemagne d'ingénieurs méticuleux, de philosophes précis et rigoureux, de philologues pointilleux, d'industriels efficaces, de techniciens chevronnés, de négociants redoutables, de révolutionnaires radicaux, de moralistes jusqu'au-boutistes, de syndicalistes combatifs, de juristes tenaces. Mais de cette Allemagne-là, il n'en a pas parlé, sans doute auraient-elles effrayé ses ouailles, donné des cauchemars aux petits garçons fragiles qui l'admirent tant. Pensez-vous, ils auraient dû cesser de rêver, et commencer à travailler.
Refus de l’histoire réelle et images d’Epinal
Lors d'un face-à-face avec la presse russe, à Moscou le 31 mars 1992, où deux journalistes de la revue moscovite Nach Sovremenik me demandaient quelle était ma position dans la nouvelle crise balkanique et face à la Serbie de Milosevic, j'ai répondu en rappelant des événements importants de l'histoire européenne comme la Guerre de Crimée, le Traité de San Stefano (1878), l'aide apportée par les Russes à la Serbie, la Roumanie et la Bulgarie au XIXième siècle et leur désir de voir une paix s'instaurer entre Serbes et Bulgares, etc. Pendant que je répondais à cette question, importante pour les Russes qui ont la mémoire historique longue, au contraire des Occidentaux, en m'engageant sur un terrain qui n'intéressait pas de Benoist, le bougre m'enjoignait de me taire sans mettre de bémol à sa voix, tirait sur les pans de mon veston en cachant son bras derrière le large dos d'Alexandre Douguine, sans se rendre compte qu'il était tout à la fois grossier pour les journalistes qui me mettaient sur la sellette et ridicule en pleurnichant de la sorte parce qu'il n'était plus le seul à pouvoir parler (6). Outre le narcissisme époustouflant du gourou, cet incident burlesque montre bien le refus néo-droitiste de l'histoire réelle; lourde tare, car si l'on ne prend pas le pouls de l'histoire au-delà des clivages politiciens et au-delà du clivage binaire gauche/droite, si on ne lit pas l'histoire à travers les textes des traités qui l'ont jalonnée, on agit sous la dictée de “représentations platoniciennes”, autrement dit d'“images d'Epinal”, artificielles, arbitraires, déconnectées du réel. Or les “images d'Epinal” sont toujours classées quelque part, étant par définition figées, non mouvantes parce que non vivantes. En maniant ses fantasmes esthétiques et éthiques (son obsession à vouloir édicter une “morale”...), de Benoist a énoncé un discours en marge du fonctionnement réel des Etats de notre continent, il s'est soustrait au jeu dramatique de l'histoire, par désintérêt, délibérément ou par peur de l'engagement. Grave péché contre l'esprit. Pire, une telle démarche relève de la médiocrité et, en disant cela, je songe à une réplique dans le Malatesta de Montherlant: «En prison, en prison, monsieur. Pour médiocrité!».
L'incapacité de la “nouvelle droite” à énoncer un corpus de droit cohérent
D'emblée, le propos de la “nouvelle droite” n'est pas de discourir sur le droit (l’aventure de la petite revue Hapax, torpillée par de Benoist, a malheureusement été trop éphémère, pour qu’on l’analyse ici). Pourtant, question légitime, peut-on penser le destin d'une civilisation, peut-on s'engager pour la défense et l'illustration d'une culture sans jamais penser le droit qui doit la structurer? La ND a voulu faire remonter les racines de l'Europe à la matrice indo-européenne. Volonté légitime, exprimée notamment par Emile Benvéniste dans son Vocabulaire des institutions indo-européennes. Dans cet ouvrage fondamental, véritable exploration en profondeur du vocabulaire indo-européen, Emile Benvéniste jetait les bases d'une recherche fondamentale. En effet, le vocabulaire institutionnel indo-européen révèle l'origine de toutes nos pratiques juridiques; les racines linguistiques les plus anciennes se répercutent toujours dans notre vocabulaire juridique et institutionnel, tout en véhiculant un sens précis qui ne peut guère être effacé par des manipulations arbitraires ou être enfermé dans des concepts trop étroits. Une bonne connaissance de cette trajectoire et surtout de ces étymologies est impérative.
L'idéologie dominante en France a jeté un soupçon systématique sur ce type de recherches, sous prétexte qu'il entretient des liens inavoués et occultes avec le national-socialisme. La ND a été accusée de relancer la thématique nationale-socialiste des “aryens” en se référant aux recherches indo-européanisantes. D'où un ensemble de quiproquos navrants qui ont la vie dure et qui font les choux gras de quelques petits graphomanes “anti-fascistes”, dûment stipendiés par de mystérieuses officines ou carrément par l'argent du contribuable. Pourquoi une telle situation? Le droit positif actuel, avec ses référents mécanicistes issus de la pensée matérialiste du XVIIIième siècle et d'un jusnaturalisme moderne qui se voulait détaché de tout contexte historique, ne peut tolérer, sous peine d'accepter à terme sa propre disparition, une recherche féconde et profonde sur les archétypes du droit en Europe. Un retour systématique à ces archétypes ruinerait également les assises politiques de la France (et d'autres pays), qui sont de nature coercitive en dépit du discours “démocratique” qu'ils tiennent à titre de pure propagande.
Dans le contexte français, la ND, par les maladresses de de Benoist et par sa manie des iconographies d'inspiration nationale-socialiste dont il truffait ses journaux, a permis aux vigilants de l'ordre jacobin et républicain de continuer à jeter le soupçon sur toutes les recherches indo-européanisantes. Il leur suffisait de dire: “voyez cet éditeur de chromos nazis dans des revues intellectuelles qui ne cessent de parler des Indo-Européens, il n'y a tout de même pas de fumée sans feu...”. En effet, dans le contexte des années 70, la confluence possible de certains linéaments contestataires de la “pensée 68” (chez Deleuze et Foucault) et d'un recours aux archétypes du droit, aurait pu contribuer à fonder un droit de rupture, tout à la fois futuriste et archétypal, en dépit de l'anti-juridisme fondamental de Foucault. En ultime instance, cet anti-juridisme foucaldien n'est rien d'autre qu'un anti-positivisme dans la mesure où le positivisme s'était entièrement emparé du droit surtout en France mais aussi ailleurs en Europe. Le positivisme avait édulcoré et figé le droit, qui était ainsi devenu mécanique et légaliste, suscitait une inflation de lois et de règlements, n'acceptait plus de modifications souples et d'adaptations, sous prétexte que la “loi est la loi”. En jetant un discrédit total sur les études indo-européennes (parce qu'elles contenaient en germe une contestation de l'ordre juridique positiviste de la République), en posant systématiquement l'équation « études indo-européennes = nouvelle droite = néonazisme », les journalistes-laquais du régime bloquent à titre préventif toute contestation des structures archaïques de la France républicaine. L'histoire devra établir si de Benoist a oui ou non joué sciemment le rôle de la “tête de Turc”, pour permettre cet exorcisme permanent et donner du bois de rallonge à la vieille république...
Ignorance de l’héritage de Savigny
Carl Schmitt s'est insurgé contre le positivisme et le normativisme juridiques, contre leur rigidité et leur fermeture à toute rénovation: sa position se veut “existentialiste”. Ainsi le droit, l'Etat, une constitution, une institution sont autant de corps ou d'entités vivantes, animées de rythmes lents, qu'il s'agit de capter, d'accepter, de moduler et non d'oblitérer, de refuser et d'éradiquer. Ces rythmes dépendent du temps et de l'espace, de l'histoire et de la tradition. Schmitt s'inspire ici de Friedrich Carl von Savigny. Ce juriste allemand du début du XIXième siècle, spécialiste du droit romain, voyait dans le droit un continuum, légué par les ancêtres (mos majorum), sur lequel on ne pouvait intervenir au hasard et subjectivement sans provoquer de catastrophes. Savigny concevait le droit comme un héritage et rejetait les manies modernes à vouloir imposer un droit, des lois et des constitutions inventées ex nihilo, au départ d'a priori idéologiques, de préceptes moraux ou éthiques adoptés en dehors et en dépit de la continuité historique du peuple. Savigny s'est opposé au code napoléonien, d'essence révolutionnaire, et aux constitutions écrites qui figeaient le flux vivant du Volksgeist (cf. Friedrich Karl von Savigny. Antologia di scritti giuridici, a cura di Franca De Marini, Il Mulino, Bologna, 1980).
Savigny, ses maîtres Gustav Hugo et Philipp Weis, partaient du principe que toute codification constituait une fausse route, était susceptible de déboucher sur l'arbitraire et la tyrannie. Le droit vit de l'histoire et ne peut être créé arbitrairement par des législateurs-techniciens au gré des circonstances ni imposé de force au peuple. Le droit se forme par un long processus organique, propre à chaque peuple. Toute intervention arbitraire dans le continuum du droit interrompt le processus naturel de son développement; même dans une phase de déclin, quand le pouvoir est obligé de recourir à des décrets coercitifs, la codification est dangereuse car elle fige et stabilise un droit corrompu, désormais privé de force vitale. La fixation et la stabilisation du droit en phase de décadence perpétuent des régimes foireux voire iniques. Carl Schmitt écrit dans son célèbre texte qui rend hommage à Savigny et déclare que son œuvre est “paradigmatique”: «Le droit en tant qu'ordre concret ne peut être détaché de son histoire. Le véritable droit n'est pas posé (gesetzt) [comme une loi], mais émerge d'un développement non intentionnel (absichtslos) ... Le positivisme, venu ultérieurement, ne connaît plus ni origine ni patrie (Heimat). Il ne connaît plus que des causes ou des normes fondamentales posées comme si elles étaient des hypothèses. Il veut le contraire d'un droit dépourvu d'intentionnalité; son intention ultime est de dominer et d'obtenir en tout la “calculabilité”».
Pour Ulrich E. Zellenberg, qui s'inscrit aujourd'hui dans le sillage de Savigny et Schmitt, le droit «s'exprime dans les mœurs de la communauté, qui sont perçus comme corollaires de la volonté de Dieu. Le droit et la justice sont dès lors une seule et même chose. Il n'y a pas de différence entre le droit positif et le droit idéal. Comme le Prince et le juge ne sont pas appelés à créer un droit nouveau, mais à garantir le droit déjà existant, les revendications individuelles, les décisions à prendre dans les cas concrets et les innovations de fait se légitimisent comme des recours au droit ancien, ou comme le rétablissement de son sens propre» (cf. Ulrich E. Zellenberg, « Savigny », in : Caspar von Schrenck-Notzing, Lexikon des Konservativismus, Stocker, Graz, 1996).
Défense de la « societas civilis » et droit de résistance
Le droit historique, acquis à la suite d'une longue histoire et non fabriqué par des légistes professionnels, implique a) la défense de la societas civilis et b) le droit de résistance à l'arbitraire et à la tyrannie. La volonté du positivisme de légiférer à tout crin met le droit à la disponibilité des seuls légistes professionnels. Conséquence: le droit devient l'instrument d'une minorité cherchant à asseoir son pouvoir, par ingénierie sociale. Même les “institutions” comme la famille, le mariage, etc. sont à la merci des interventions arbitraires d'une caste isolée de la societas civilis. Pour Schmitt, les “ordres concrets”, les institutions anthropologiques (selon la définition qu'en donne Gehlen), sont des bastions de résistance contre la frénésie légiférante des législateurs positivistes; ces “ordres concrets” imposent des limites à l'ingénierie sociale et juridique, mettent un frein au flux normatif et obligent les légistes à accepter les règles des ordres concrets sous peine de les détruire. La rage légiférante des légistes positivistes (Schmitt: “les législateurs motorisés”) détruit la confiance des citoyens dans le droit, qui perd toute autorité et toute légitimité.
Sur le plan historique, la réaction de Savigny s'oppose tout à la fois à l'école philosophique de Christian Wolff (1679-1754), qui inspire l'absolutisme rationalisant, et aux partisans de l'adoption systématique du code napoléonien (Anton Thibaut, 1774-1840). Le droit germanique prévoit le droit de résistance à la tyrannie: au moyen-âge, ce droit s'inscrit dans les obligations réciproques du seigneur et du vassal, puis dans le droit des états de la société de s'opposer à la violence arbitraire du Prince. Avec Althusius, le droit de résistance est le droit de la societas civilis à s'opposer à l'absolutisme.
Cette brève esquisse des principes de droit de la pensée dite “conservatrice” montre que le discours de la ND aurait dû s'infléchir vers une défense tous azimuts de la liberté populaire contre les instances bodiniennes, coercitives et jacobines de la République française. Sur le plan culturel, cette démarche, renouant avec la défense conservatrice, anti-absolutiste et anti-révolutionnaire de la societas civilis, aurait dû recenser, commenter et glorifier toutes les étapes et les manifestations de révolte populaire en France contre l'arbitraire de l'Etat. De même, la ND aurait dû participer à la définition d'un droit ancré dans l'histoire, comme Savigny l'avait fait pour l'Allemagne. Pour un mouvement qui prétendait mettre la culture au-dessus de la routine politicienne, de l'économie ou même du social, il est tout de même étonnant de ne jamais avoir rien publié sur la notion de Kulturstaat chez Ernst Rudolf Huber, partiellement disciple de Schmitt car il était fasciné par la notion d'“ordre concret”. Le Kulturstaat de Huber est un Etat qui tire son éthique (sa Sittlichkeit) et ses normes d'une culture précise, héritage de toutes les générations précédentes. Cette culture est une matrice prolixe, ouverte, fructueuse: elle est une “source” organique inépuisable tant qu'on n'attente pas à son intégrité (Savigny et, à sa suite, Schmitt insistaient énormément sur cette notion de “source”/“Quelle”, sur l'image parlante de la “source” en tant que génératrice du droit). La notion de source chez Savigny et Schmitt, la notion de “culture” chez Huber interdisent de voir dans le droit et dans l'Etat de pures intances instrumentales. Le Kulturstaat n'est pas un Zweckstaat (un Etat utilitaire, sans continuité, sans ancrage territorial, sans passé, sans projet). Le rôle de l'Etat est de protéger l'intégrité de la “source”, donc de la culture populaire. Telle est la première de ses tâches. Par suite, la culture n'est pas quelque chose qui relève de l'“esprit de fabrication”, de la “faisabilité” comme on dit aujourd'hui, elle génère des valeurs intangibles, lesquelles à leur tour fondent l'idée de justice et justifient l'existence de secteurs non marchands, comme l'éducation (cf. Max-Emanuel Geis, Kulturstaat und kulturelle Freiheit. Eine Untersuchung des Kulturstaatskonzepts von Ernst Rudolf Huber aus verfassungsrechtlicher Sicht, Nomos-Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1990).
Sur base de cette approche du droit, que possèdent les écoles conservatrices allemande, autrichienne, italienne et espagnole, la ND aurait pu :
- développer une critique des instances révolutionnaires institutionalisées en France et dans les pays influencés et meurtris par le républicanisme révolutionnaire et l'impact du code napoléonien;
- aligner ce pays sur les préoccupations politiques de son environnement européen (car l'organicisme se répercute finalement sur l'ensemble des familles idéologiques, au-delà des clivages politiciens);
- préparer au niveau européen une contre-offensive organique bien étayée;
- élaborer des correctifs contre les miasmes de la centralisation, de l'utilitarisme anti-culturel, de la déconstruction des secteurs non-marchands au niveau eurocratique, etc.
Savigny, école historique, Bachofen
Schmitt, dans son plaidoyer pour un recours aux principales idées-forces de Savigny (cf. «Die Lage der europäischen Rechtswissenschaft», in: Verfassungsrechtliche Aufsätze, Berlin, 1973), fait explicitement le lien entre la démarche de Savigny dans le domaine du droit, d'une part, et celle de Gustav von Schmoller et de son “école historique” en économie, d'autre part. En outre, Schmitt annonce la nécessité de se replonger dans l'étude de la Tradition, en évoquant notamment Bachofen et l'approfondissement des études de philologie classique. Celles-ci nous donnent une image désormais très précise de la plus lointaine antiquité européenne. Les sources les plus antiques du droit nous apparaissent dans toute leur densité religieuse. Grâce aux efforts des philologues, les visions édulcorées de l'antiquité classique qu'un certain humanisme scolaire avait véhiculées, disparaissent dans les poubelles de l'histoire. Schmitt écrit: «Il ne s'agit nullement aujourd'hui de revenir en arrière à la façon des réactionnaires, mais de conquérir une immense richesse de connaissances nouvelles, qui pourront s'avérer fructueuses pour le présent dans le domaine des sciences du droit; nous devons nous emparer de ces richesses et les mettre en forme» (op. cit., p. 416). Dans cet appel de Schmitt, le lien entre les sciences juridiques et la nouvelle philologie classique, considérablement enrichie depuis Bachofen, est clairement établi. Schmitt légitimise dans le discours politologique le recours à la Tradition. L'héritage philologique est mobilisé dans le but de donner à la Cité un droit correspondant à son histoire et à ses origines, à ses sources. La ND a mal utilisé cet héritage philologique, surtout en répétant et en paraphrasant Dumézil, en le mêlant à certaines intuitions d'Evola, lui-même inspiré par Bachofen, mais sans jamais le mobiliser pour proposer un autre droit, pour opposer, au droit républicain et révolutionnaire institutionnalisé, un droit véritablement conforme aux sources européennes du droit. Alain de Benoist a raté le coche: il a fait de son pur discours culturel (cultureux!) un but en soi. Il a failli à sa mission. Il a trahi. Il a servi l'adversaire. Par ses maladresses et son absence de suite dans les idées, par sa négligence du message de Carl Schmitt, il a servi les ennemis de la population française, les ennemis de l'Europe, les ennemis des peuples européens.
Schmitt, en réclamant une recherche bi-disciplinaire, unissant le droit et la philologie d'après Bachofen, entendait donner un instrument à l'élite future de l'Europe: si le droit est demeuré coutumier en Angleterre mais reste aux mains des possédants de la société civile, si le droit est aux mains de fonctionnaires-légistes en France, auxquels fait face la société civile aidée de ses avocats trop souvent impuissants, l'Allemagne, dans l'esprit de Savigny, doit aligner une phalange de professeurs de droit et de philologues, capables de juger selon le sens du droit et non selon les formes et les règles abstraites. Cette phalange de juristes traditionnels et de philologues remplacerait l'ancienne “Chancellerie impériale”, chargée d'arbitrer les diversités du Saint-Empire. Schmitt appelait ainsi de ses vœux une “première fonction” souveraine, organisée selon le projet de Savigny. Cette “première fonction” utiliserait les méthodes organicistes et historiques. La ND, si elle avait été dirigée par des hommes compétents, aurait eu la chance de devenir une telle élite. Malheureusement, elle ne s'est pas concentrée sur les tâches que Schmitt assignait à celle-ci. Elle a pratiqué un occasionalisme systématique et ridicule, où toutes les occasions de “faire le malin” étaient bonnes, de briller dans les salons parisiens peuplés d'imbéciles aux cerveaux pourris par les folies révolutionnaires et jacobines, par l'“esprit de fabrication” (Joseph de Maistre !), par les slogans les plus absurdes, dont Bernard-Henri Lévy et toute la clique des vedettes médiatisées ont donné un bel exemple lors de la crise bosniaque. Tel était l’objectif prioritaire de de Benoist : réussir des coups médiatiques sans lendemain. Face à cette basse-cour parisienne, la ND n'a pas opposé un projet clair: au contraire, elle a présenté un véritable “mouvement brownien” de brics et de brocs d'idées diverses, sans liens apparents entre elles. Du coup, elle ne faisait pas le poids devant ceux qui avaient une longueur d'avance sur elle dans le monde “intellectuel” (?) parisien.
Un droit familial et collégial
Le recours aux études indo-européennes aurait également pu dépasser le clivage qui avait ruiné la postérité de Savigny en Allemagne: l'opposition stérile entre romanistes et germanistes, c'est-à-dire entre partisans du droit romain et partisans du droit germanique. Aujourd'hui, la philologie et les études indo-européennes indiquent au contraire une source commune, plus ancienne, propre à toutes les grandes traditions populaires européennes, et se situant au-delà de ce clivage artificiel romanité/germanité. Tel a été l'apport d'Emile Benveniste, du Géorgien Thomas V. Gamkrelidze, du Russe Vjaceslav V. Ivanov, de Dumézil et de Bernard Sergent. Dans tous ces travaux qui révèlent à nos contemporains les matrices culturelles du monde indo-européen, une part importante de ces volumes respectables traite des “institutions”. Gamkrelidze et Ivanov sont très précis pour tout ce qui concerne les liens sociaux, base du droit privé et du droit public, de l'antiquité à nos jours. Si la ND s'était référée à ces corpus, plutôt que de tirer de Dumézil une sorte de sous-mythologie guerrière, tout juste digne des jeux de rôle pour adolescents désorientés, elle n'aurait jamais essuyé le reproche de “national-socialisme”.
Avec un apport philologique solide, la ND aurait été mieux armée face à ses adversaires. Le droit primitif indo-européen est familial et collégial, il implique la liberté, le droit de résistance à la tyrannie, la délibération démocratique: la ND aurait eu beau jeu de ruiner les arguments de ses adversaires républicains en France. En critiquant tout apport philologique, ceux-ci se rangeaient automatiquement dans le camp des partisans de l'absolutisme, de la coercition, de la rupture entre société civile et appareil d'Etat. La ND aurait arraché leurs masques avec délectation: ces faux démocrates sont de vrais terroristes et le républicanisme institutionalisé n'est pas démocratique, il est même le pire des contraires de la démocratie. La ND aurait pu confisquer pour elle seule le label de “démocratie”. Schmitt conseillait même d'appeler Tocqueville à la rescousse... Effectivement, devant la phalange regroupant Savigny, Tocqueville, Schmoller, Schmitt et les philologues indo-européanisants, le discours républicain serait bien rapidement apparu pour ce qu'il est: un bricolage sans consistance.
Enfin, la notion de Volksgeist apparait certes comme typiquement allemande. Les savants allemands ont étudié en profondeur, de Herder aux frères Grimm, les tréfonds de l'âme populaire germanique. Mais, en dehors de la sphère culturelle et linguistique germanique, les philologues slaves ont pris le relais et ont exploré à fond les coins et les recoins de l'âme slave. Une telle demarche a été entreprise pour la France par quelques esprits aussi hardis que brillants (Van Gennep), mais cet acquis doit à son tour être politisé et instrumentalisé contre les partisans républicains de la “cité géométrique” (ce terme est de Georges Gusdorf, autre penseur capital qui a été totalement ignoré par de Benoist ; on peut légitimement se poser la question ; pourquoi cet ostracisme ?).
Entrelacs très dense de juridictions et de traditions
L'ancienne France n'avait peut-être pas de constitution, mais elle n'était pas un désert juridique. Au contraire: l'histoire des droits communaux ou municipaux, les structures juridiques des paroisses des provinces de France, les assemblées organisées ou non par des syndics permanents ou élus, la diversité des instances de justice, le régime de la milice populaire, l'assistance publique et l'organisation des hôpitaux et des maladreries, la fonction des prudhommes, les protections accordées à l'agriculture, sont autant de modèles, certes complexes, qui expriment la vitalité du petit peuple et sont les garants de ses droits fondamentaux face au pouvoir.
C'est dans ces entrelacs très denses de juridictions et de traditions juridiques que s'est épanouie la France rabelaisienne, la fameuse gaîté française (cf. Albert Babeau, Le village sous l'Ancien Régime, rééd., Genève, 1978, éd. or., Paris, 1878). Plutôt que d'encourager les fantasmes douteux et vikingo-germanolâtres de certains adolescents fragiles (ou de gâteux précoces...), la ND française aurait dû renouer avec cette France joyeuse des libertés villageoises, même si le type du gai Gaulois, païen, paillard et libertaire ne correspond pas au personnage sinistre, lugubre, grognon et tyrannique qui orchestre aujourd’hui cette ND moribonde, tenaillé par un ressentiment hargneux de vieille femme délaissée. Le recours à la vieille France rabelaisienne aurait été détonnant si la ND l'avait couplé à une exploitation idéologique efficace de cette distinction capitale qu'avait opérée l'ethnologue Robert Muchembled entre la “culture du peuple” et la “culture des élites”. La culture du peuple est fondamentalement païenne (c'est-à-dire paysanne et tournée vers les rythmes naturels auxquels nul ne peut échapper), elle est axée sur la diversité du réel et sur les innombrables différences qui l'animent. La culture des élites est étriquée, schématisée, géométrique avant la lettre, répressive, “surveillante et punissante” (pour reprendre les expressions favorites de Michel Foucault), en un mot, scolastique. Le pari pour la culture populaire rabelaisienne impliquait aussi de prendre parti
- pour les révoltes régionales contre la “cité géométrique” montée par Siéyes et les révolutionnaires ;
- pour la diversité des expressions populaires dans les anciennes provinces de France ;
- pour les révoltes populaires en général, que ces révoltes soient paysannes, régionalistes, syndicales ou ouvrières.
Cette triple prise de parti permettait de renouer avec la notion de “droit de résistance”.
Mais hélas: l'option droitière, le désir irrépressible (mais jamais réalisé!) de “manger à la table des puissants”, de servir de mercenaires aux droites du pouvoir, de débiter inlassablement des discours anticommunistes ineptes, de s'allier avec des politiciens droitiers véreux qui étalent leur prose dans la presse bourgeoise, de vouloir à tout prix collaborer à cette presse (parce qu'elle paie bien), empêchaient de jouer cette double carte de la défense et de l'illustration de la vieille France populaire et rabelaisienne, de revendiquer le droit de résistance de la societas civilis, de défendre le peuple réel contre ses oppresseurs, légistes ou militaires. Mais les puissants n'ont pas accepté le mercenariat proposé, le gourou de la ND a été remercié; c'est alors que l'on a assisté à un aggiornamento de la ND, à une tentative de s'ouvrir sur la gauche intellectuelle, ses cénacles, ses salons. Mais comment entrer dans ce monde-là, quand on revient piteusement d’en face, quand on a voulu se faire le gendarme intellectuel d'une fausse droite qui n'est jamais rien d'autre que la vraie gauche républicaine institutionnalisée?
Créer une « chancellerie impériale »
Schmitt, dans son projet de reconstituer une sorte de “chancellerie impériale” en créant son élite de juristes traditionnels et de philologues, gardiens du plus ancien passé de l'Europe, n'entendait pas jeter brutalement tout l'édifice juridique révolutionnaire-institutionalisé à terre. Il jetait un soupçon sur la validité et surtout sur la légitimité de cet édifice, il constatait que l'inflation de lois et de réglements, que la fixation sur les normes avaient conduit à un totalitarisme insidieux, à une tyrannie des normes, à l'émergence d'une cage d'acier institutionnelle rendant aléatoires les changements et les adaptations nécessaires. Or, en France, le gaullisme des années 60, pourtant héritier du républicanisme français, gère une constitution, celle de la Vième République, qui a reçu indirectement, via René Capitant, l'influence de Schmitt et de l'école décisionniste allemande. L'influence de Schmitt a parfois été considérée comme “étatiste”; on a dit qu'elle servait à soutenir les vieux Etats de modèle occidental et leurs appareils de contrôle et de répression. C'est là une interprétation schématisante de son œuvre. Nous l'avons vu en analysant son plaidoyer pour un retour à la démarche de Savigny. La societas civilis et ses ordres concrets sont, pour Schmitt, des instances et des valeurs d'ordre et de discipline, sont les réceptacles de vertus créatrices. Les constitutionnalistes de la Vième République, en suivant la logique de Schmitt, ont dû parvenir au même constat. Et admettre que le républicanisme français et ses imitateurs en Europe généraient une coupure problématique et perverse entre la societas civilis et les appareils d'Etat. Dans les années 60, les politologues gaulliens ont réfléchi à la question: le hiatus entre societas civilis et appareils d'Etat devait être surmonté par trois innovations réellement fécondes: a) la participation dans le domaine économico-industriel, b) la création d'un Sénat des professions, hissant l'élite de la societas civilis au plus haut niveau de l'Etat et de la représentation politique; c) la création d'un Sénat des régions, permettant de redonner à tous les territoires de l'Hexagone une représentation directe sur une base locale, contournant ce que Gusdorf avait appelé l'“ivresse géométrique de la France en carrés” (in La conscience révolutionnaire. Les idéologues, Paris, 1978).
Malgré ses dénégations, malgré ses déclarations réitérées de vouloir sortir du ghetto de l'extrême-droite, de Benoist n'a jamais cessé d'être accroché par toutes sortes de fils à la patte à ses petits copains de l'ex-OAS qui faisaient de l'anti-gaullisme un dogme et étaient tellement aveuglés par leurs ressentiments qu'ils ne constataient pas les mutations positives du gaullisme dans les années 60. Certes, de Benoist a un jour écrit un bon article dans le Figaro-Magazine, où il affirmait être gaullien plutôt que gaulliste. Mais la transition qu'il semblait annoncer par cet article en est restée là... Seul Europe, Tiers-Monde, même combat constitue une tentative d’Alain de Benoist de sortir concrètement du duopole de la Guerre Froide, mais, hélas, ce livre n’a pas eu de suite, n’a pas été remis à jour après 1989. Armin Mohler avait enjoint les Allemands à parier sur l’alliance française et l’appui aux « crazy states » hors d’Europe. Alain de Benoist lui a emboîté le pas. Mais où est la recette pour l’après-perestroïka ? Quelle théorie sur la Russie ? Alain de Benoist est fidèle à sa maladie : rien que les idées abstraites et les éthiques désincarnées, ses pièces de meccano. Pour le reste, fuite hors de l’histoire, fuite hors du monde.
Droit de résistance et citoyenneté active
Enfin, si la ND avait renoué avec la notion —pourtant éminemment conservatrice— de “droit de résistance”, elle n'aurait eu aucune peine à déployer un projet de citoyenneté active (et participative), et à défendre les secteurs non-marchands (éducation, secteur médical) battus en brèche par l'économicisme ambiant. Aujourd'hui, les quelques références à une citoyenneté active dans les textes de la nouvelle droite semblent tomber du ciel, semblent n'être qu'une manie et qu'un caprice passager, que les vrais partisans de la citoyenneté active ne prennent pas au sérieux. Mais nous, Sampieru, Mudry et moi-même, qui avions revendiqué très tôt cette orientation vers le peuple réel, étions traités par le gourou de “trotskistes” ou d'“écolos”, de lecteurs de la revue Wir Selbst, jugée à l'époque dangereusement “gauchiste”. Aujourd'hui, le gourou est lui-même devenu, paraît-il, un “trotskiste” et un “écolo”, il flatte bassement mais sans résultat le directeur de Wir Selbst, alors, pour dédouaner ses anciennes injures, il a fait écrire à l'un de ses serviteurs italiens une lettre insultante qui nous campait comme les “teste matte della Mitteleuropa” (les têtes brûlées de la Mitteleuropa). Vouloir la subsidiarité, le rétablissement du droit de résistance, vouloir un droit plongeant dans l'humus de l'histoire, être fidèles à Carl Schmitt, est-ce un programme capable de séduire des “têtes brûlées”? (7).
Lacunes économiques et géopolitiques
Enumérer les multiples errements de la ND française exigerait un livre entier. En guise de conclusion, signalons encore que l'économie a été une parente pauvre de la “révolution métapolitique” de la secte GRECE. Rien de sérieux n'a été entrepris pour faire connaître dans un public large les thèses des économistes hétérodoxes. En matière de géopolitique, on a vaguement évoqué un binôme franco-allemand (insuffisant dans l'Europe actuelle) et répété un anti-américanisme incantatoire, plus éthique que pratique. Alain de Benoist n'a jamais reproché aux Américains de fabriquer des “traités inégaux” avec toutes les autres puissances de la planète, n'a jamais analysé sérieusement le déploiement de la puissance américaine depuis l'indépendance des Etats-Unis: lors d'un colloque du GRECE, devant le public abasourdi, son argument principal ne fut-il pas de dire: “la sodomie entre époux est passible des tribunaux dans certains Etats de l'Union”. Et de Benoist, immédiatement après avoir prononcé cette phrase historique, regardait son public, semblait attendre une réaction. Les participants regardaient leurs chaussures d'un air géné. Et de Benoist a continué à parler, passant de la sodomie à autre chose, comme les polygraphes passent de la physique nucléaire à la bande dessinée. L'argument obsessionnel et pathologique de la sodomie épuise-t-il toute critique de l'américanisme?
Les litanies anti-américaines, justifiées par l'esthétisme, par l'éthique guerrière européenne, par l'hostilité au christianisme en général et au christianisme protestant américain en particulier, par la volonté obsessionnelle de défendre la liberté de se sodomiser en rond n'apportent rien de concret. Ligues de vertu puritaines et hystériques et cénacles pansexualistes et promiscuitaires ne servent jamais que de dérivatifs: pendant que les uns et les autres vocifèrent et s'agitent, ils ne se mêlent pas du fonctionnement de la Cité, au vif plaisir des dominants. La CIA peut dormir sur ses deux oreilles.
La CIA peut dormir sur ses deux oreilles…
La ND, qui se pose en théorie comme un mouvement pour la défense et la sauvegarde de l'Europe, n'a jamais formulé une géopolitique continentale d'un point de vue français. On connait les visions mitteleuropéennes de la géopolitique allemande, voire les projets de Kontinentalblock dérivés de la pensée de Haushofer. Jamais la ND française n'a vulgarisé les acquis de la géopolitique française contemporaine: aucun texte n'a été publié sur les ouvrages de Hervé Coutau-Bégarie, de Pascal Lorot, de François Thual, de Jacques Sironneau, d'Yves Lacoste (un “gauchiste”...), de Michel Foucher (un méchant qui a travaillé pour Globe...), de Zaki Laïdi (un “Arabe”...), de Michel Korinman, etc. alors que, dans toute l'Europe, ces travaux sont pionniers et inspirent les écoles géopolitiques en place. Pire, jamais la ND n'a emboîté le pas à Jordis von Lohausen qui demandait aux Français et aux Allemands de défendre l'Europe “dos à dos”, ce qui impliquait un engagement français sur l'Atlantique, une défense de la marine française, traditionnellement européiste et vaccinée contre les excès de germanophobie qui ont souvent agité les milieux militaires. La ND parisienne a-t-elle défendu les marins français et leurs projets, a-t-elle recommandé la lecture des écrits théoriques de l'amirauté? Non. La CIA peut dormir sur ses deux oreilles. La Navy League aussi. La germanophilie et l'européisme germanisant de la ND de de Benoist sont des leurres, des attrape-nigauds, des miroirs aux alouettes. Une politique germanophile et européiste en France est une politique de soutien à la marine du pays et implique un engagement civil et militaire dans l'Atlantique; l'Allemagne réorganise la continent avec la Russie; la France garde la façade atlantique. Dos à dos, disait Lohausen.
En philosophie, les carences de la ND sont effrayantes. Alors qu'en Allemagne, terre par excellence de la philosophie, tous recourent aux philosophes français contemporains pour court-circuiter les routines qui affligent la pensée allemande d'aujourd'hui, que des fanatiques tenaces cherchent à aligner sur les critères les plus étriqués de la “political correctness”, la ND parisienne a délibérément ignoré les grands philosophes français contemporains. J'ai même entendu dire et répéter dans les rangs de la ND qu'il n'y avait plus de “grands philosophes” aujourd'hui, mis à part de Benoist, bien sûr, le génie d'entre les génies! On ne saurait être plus à côté de la plaque!
Enfin, une stratégie métapolitique ne saurait être purement esthétique, ni virevolter au gré de tous les vents ni présenter ses arguments dans le désordre à la façon du “mouvement brownien” des particules. Une stratégie métapolitique ne peut se placer en-deçà de l'effervescence politicienne et partisane, que
- si elle se donne pour tâche de retrouver et de renouer des fils conducteurs,
- si elle capte et repère des forces dans le grouillement du réel ;
- si elle procède à un travail d'archéologie des institutions.
Les méthodes d'un tel travail, les philosophes français nous les ont léguées. Encore faut-il ne pas les avoir ignorés...
En bref, pour nous, entre autres textes de référence pour orienter notre travail, nous avons choisi celui de Schmitt, commenté dans cet exposé. Ensuite, nous posons des objectifs clairs, nous ne percevons pas le travail théorique comme un jeu de salon. Ces objectifs sont:
- restauration d'un droit européen basé sur ses racines et ses sources les plus anciennes (référence à Savigny).
- restauration des droits des communautés réelles qui font le tissu de l'Europe.
- restauration d'une “chancellerie impériale” capable d'harmoniser cette diversité juridique, corollaire de la diversité européenne (et cette chancellerie impériale doit compter des hommes et des femmes de toutes nationalités, capables de maîtriser plusieurs langues européennes).
- maintenir les systèmes de droit ouverts, afin d'éviter les fanatismes normativistes et toute forme de “political correctness”.
- prévoir une instance décisionnelle en cas de danger existentiel pour l'instance politique (nationale ou européenne).
- étude systématique des traditions d'Europe, comme Schmitt nous l'a demandé.
- coupler cette restauration juridique et cette méthode historique à un programme hétérodoxe en économie (la référence que fait Schmitt à l'école historique de Gustav von Schmoller).
Les remarques de Kowalski
Ce programme est vaste et interpelle quasiment toutes les disciples du savoir humain. Mais ce progamme ne saurait en aucun cas s'abstraire du mouvement de l'histoire. Et s'encombrer du ballast inutile des fantasmes, des images d'Epinal, des vanités personnelles... Pour terminer, signalons tout de même une hypothèse sur la ND, formulée par un politologue allemand, Wolfgang Kowalsky (in: Kulturrevolution? Die Neue Rchte im neuen Frankreich und ihre Vorläufer, Opladen, 1991). Kowalsky, après avoir analysé l'évolution des idéologies politisées en France, de mai 68 à l'avènement de Mitterrand, après avoir examiné le rôle de la ND dans cette longue effervescence, concluait en disant que la “métapolitique” de la ND, plus exactement son programme de “révolution culturelle”, était une arme contre la société civile (Kulturrevolution als Barriere gegen die Zivilgesellschaft). Certes, l'argumentation de Kowalsky est confuse, il confond allègrement ND et FN, croit en un “partage des tâches” entre ces deux formations (ce qui est une lubie des enquêteurs anti-fasciste professionnels sans profession définie). Néanmoins, la question de Kowalsky doit être posée, mais différemment: vu l'absence totale de consistance des discours de la ND sur le droit, l'économie, la géopolitique, les relations internationales, la staséologie (l'étude des mouvements sociaux; ce néologisme est de Jules Monnerot), l'histoire, l'organisation de la santé, les projets pratiques en écologie et en approvisionnement énergétique, etc., nous sommes bien obligés, à la suite de Kowalsky, de constater que la societas civilis, espace réel de la civilisation ou de la culture européenne, ne trouve dans la ND aucun argument pour assurer sa défense contre l'emprise croissante d'un monde politique totalement dévoyé, qui n'a plus d'autre projet que de se perpétuer, en s'auto-justifiant à l'aide d'arguments vieux de deux ou trois siècles, en pillant la societé civile par une fiscalité délirante, en la contrôlant par la presse et les médias stipendiés, en surveillant et en punissant ceux qui osent contester ce pouvoir inique (emprisonnement de fédéralistes français, poursuites judiciaires contre des indépendants contestant le système de sécurité sociale, contrôle de la fonction médicale, etc., toutes pratiques que l'on trouve évidemment dans d'autres pays). Kowalsky exagère sans nul doute en suggérant que de Benoist a construit pour toute la France une barrière contre la société civile, pour protéger et perpétuer le système bodinien, en place depuis Richelieu et les jacobins. Le rôle de de Benoist, s'il a vraiment été un dérivatif, a été plus modeste: empêcher que dans les milieux dits de “droite”, des argumentaires en faveur de la décentralisation, du fédéralisme, de la défense de la société civile, de la réforme juridique, judiciaire et constitutionnelle, qu'un retour aux projets gaulliens de participation et de sénat des professions et des régions (oubliés depuis le départ et la mort du Général), ne se cristallisent et ne se renforcent, afin de défier sérieusement le système en place et d'opter pour une révolution européenne armée d'un programme cohérent. La “métapolitique” selon de Benoist n'a été qu'un rideau de fumée, qu'un dérivatif, n'a servi qu'à désorienter de jeunes étudiants en ne les mobilisant pas pour un travail juridique, économique, sociologique et philosophique politiquement fécond à long terme. Pistes perdues... Rendez-vous manqués… Aveuglement ou sabotage ? L’Histoire nous l’apprendra…
Robert STEUCKERS,
Forest, février 1998.
(1) Roland Gaucher, qui reconnaît pleinement les mérites du GRECE, lui reprochant toutefois une méconnaissance de la stratégie de Gramsci, sait aussi croquer avec humour les travers que nous dénonçons par ailleurs : « Je me souviens ici d’une intervention d’Alain de Benoist, qui m’avait frappé lors d’un colloque organisé par l’Institut d’études occidentales. Quand vint son tour de parler, partant du fond de la salle, il s’avança, raide et gourmé, un rouleau de papier à la main. Ses partisans se levèrent pour l’acclamer — il n’était, à l’époque, guère connu mais il avait déjà su constituer sa clique et sa claque. Je n’ai pas retenu grand chose de son intervention, sinon l’expression d’un rejet radical de l’histoire de Job sur son fumier. Selon lui, elle ne nous touchait pas. Elle était radicalement étrangère à la cultue européenne » (Roland Gaucher, « Les Nationalistes en France, tome 1, La traversée du désert (1945-1983), p. 157). Plus loin, Gaucher se fait plus caustique encore : « J’en finirai sur cette aspect du GRECE avec une anecdote qui me fut un jour contée par le regretté Bonomo aujourd’hui décédé, excellent reporter, d’origine pied-noir. Bonomo, il y a une quinzaine d’années (peut-être à l’époque de la création du « Fig-Mag ») avait servi de pilote à Alain de Benoist et à un de ses amis pour un raid vers le Cap Nord. Bonomo conduisait la voiture, les deux autres étaient assis à l’arrière. Et au fur et à mesure que le temps passait, il était clair que se développait chez ces deux Nordiques un sérieux complexes de supériorité à l’égard de ce Méditerranéen, poisson de second choix. On parvint enfin au terme du voyage, en un point X… que la tradition nordico-païenne avait sans doute désigné : - Alors, raconte Bonomo, de benoist et son pote jaillissent de la voiture. Et, frappant de leurs petits poings leurs maigres bréchets ils avancent jusqu’au bord de la falaise et ils crient, extasiés, le visage levé vers le soleil pâle : « Père ! Père ! C’est nous ! Nous sommes revenus ! Nous t’adorons ! ». Bref, c’était gentil papa Soleil ! (op. cit., pp. 157-158).
(2) Près de Pérouse en février 91, Alain de Benoist était assis au fond de la salle de conférence, une salle magnifique de cet ancien couvent transformé en centre de séminaires, avec un parquet du XVIIIième parfaitement restauré. Il était interdit de fumer pour ne pas abîmer ce parquet. Alain de Benoist fumait, sale et dépenaillé, avec son costume fripé, sa chemise souillée et ses pompes qui n’avaient plus vu de cirage depuis des lunes. Une auréole de fumée s’élevait au-dessus de son crâne et de celui de sa maîtresse, vêtue d’un jeans troué et effiloché aux niveaux du genou et de la fesse gauche, curieux contraste avec toutes les dames italiennes présentes, dont l’élégance, ce jour-là, était véritablement époustouflante. Les copains parisiens ramenaient des bords de la Seine le look clodo. «Le style, c’est l’homme », disait Ernst Jünger et Alain de Benoist aimait à répéter cette phrase. Je l’ai aussi méditée, en le regardant, ce jour-là. Vers la moitié de mon exposé, il s’est levé pour aller fumer dehors, rappelé à l’ordre par le concierge. Il est revenu à l’entracte pour me dire : « Pourquoi t’as parlé de Derridada ?».
(3) Cette lecture partielle est une lecture anti-fasciste de Gobineau. Bon nombre d’hurluberlus de droite ont repris telles quelles les calomnies répandues sur Gobineau en France par les tenants d’un anti-racisme vulgaire, qui feraient bien mieux de s’inspirer des expériences de Gobineau en Orient pour développer un anti-racisme cohérent. Force est de constater que les vulgates anti-racistes et racistes partagent la même vision tronquée sur l’œuvre magistrale de l’orientaliste Gobineau.
(4) Cf. Hervé Luxardo, « Les paysans. Les républiques villageoises. 10ème-19ème siècle », Aubier, Paris, 1981 ; Hervé Luxardo, « Rase campagne. La fin des communautés paysannes », Aubier, Paris, 1984.
(5) et, du même coup, de refaire de Hambourg le chef-lieu du département des “Bouches-de-l'Elbe”. Fantasme qui avait déjà valu au bonhomme quelques ennuis, quand il était en poste à Bruxelles et rêvait de commencer sa marche vers l'Elbe, en conquérant la Wallonie et les Fourons.
(6) Il fallait le voir! Il aurait fait les délices d'un caricaturiste primesautier, avec ses sourcils tombant tristement, comme la chute des moustaches d'un Tarass Boulba de fête foraine, la bouche ouverte, la mâchoire pendouillant misérablement comme s'il venait d'essuyer un uppercut, les bajoues agitées de convulsions nerveuses, la lippe inférieure tremblotante, retenant à peine, grâce à la forte viscosité d'une salive nicotinée, son éternel bout de clope à moitié éteint et pestilentiel!
(7) Et que faut-il penser de la clique des vikingomanes de Paris et des environs, du fameux Chancelier du gourou, pied-noir et grande gueule, s'époumonant à hurler les pires inepties lors des universités d'été du GRECE, s'agitant à formuler un grossier paganisme de bazar oriental, et que faut-il penser de cette maîtresse vulgaire et illettrée qui faisait naguère, la clope au bec et l'invective sur la lippe, la pluie et le beau temps dans les bureaux du gourou, et que faut-il penser du Président actuel de la secte qui grenouillait dans les années 60 dans un groupe ultra-raciste (à faire pâlir Julius Streicher!) exclu avec fracas par Jean Thiriart de “Jeune Europe” à Bruxelles, d'un Président qui nous lance une fatwah du haut de sa tribune, lors du dernier colloque du GRECE, en prétendant que nous sommes de « dangereux extrémistes » ? Non, ceux-là ne sont pas des “teste matte”: c'est, paraît-il, l'avant-garde de l'élite européenne. Mais est-ce bien cette élite-là que Schmitt appelait de ses vœux? Je me permets d'en douter.
11:50 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : synergies européennes, droite, nouvelle droite, alain de benoist, politique, métapolitique, mouvements de pensée, france, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 28 juin 2009
Over boeken en schrijvers
OVER BOEKEN EN SCHRIJVERS
Ex: Nieuwsbrief / Deltastichting - nr. 26 - juni 2009
 De Normandische schrijver Jean Mabire zal wel niet zo vlug vergeten worden. Over heel Frankrijk, maar ook elders in Europa, telde hij vele vrienden en vooral vele lezers. Daarentegen mocht hij, als beginselvaste non-conformist, zelden of nooit genieten van officiële eerbewijzen of erkenningen. Het zal hem géén zorg geweest zijn.
De Normandische schrijver Jean Mabire zal wel niet zo vlug vergeten worden. Over heel Frankrijk, maar ook elders in Europa, telde hij vele vrienden en vooral vele lezers. Daarentegen mocht hij, als beginselvaste non-conformist, zelden of nooit genieten van officiële eerbewijzen of erkenningen. Het zal hem géén zorg geweest zijn.(Karel Van Vaernewyck)
(1) Adres van de Association des Amis de Jean Mabire, Route de Breuilles 15, F-17330 Bernay Saint Martin
(2) Editions d’Héligoland, 2008, ISBN 978 – 2 – 014874 – 39 – 7. F-27290 Pont-Anthouml.
00:24 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean mabire, livres, littérature, lettres, normandie, drieu la rochelle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 24 juin 2009
Universidade de Verao da Associaçao Terra e Povo
Universidade de Verão da Associação Terra e Povo
08:51 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : terre & peuple, université d'été, événements, nouvelle droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Discours pour l'Europe (novembre 1988)
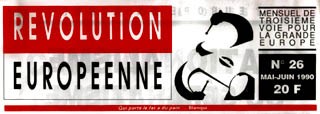

SYNERGIES EUROPÉENNES - NOVEMBRE 1988
Discours pour l'Europe
(Paris, 9 novembre 1988)
par Robert STEUCKERS
Mesdames, Messieurs,Chers amis et camarades,Chers partisans de la lucidité donc de la "troisième voie",
Les partis politiques du système veulent faire une Europe. Une Europe qu'ils annoncent pour 1992-93. Mais cette Europe n'est évidemment pas notre Europe. C'est une Europe qui traîne quelques soli-des boulets: notamment celui d'être la concrétisation d'un vieux projet américain. Professeur à Rome, Rosaria Quartararo a exploré les archives améri-cai-nes de Washington et d'ailleurs et elle y a découvert que la CEE, telle que nous la connaissons aujour-d'hui, avait déjà soigneusement été esquissée dans le fameux Plan Marshall et dans le cadre de la Eu-ro-pean Recovery Policy. Autrement dit, l'intégration envisagée s'est faite sous le signe de la vassalité à l'égard des Etats-Unis. Alors que les plans nés en Eu-rope, chez un Briand ou un Quisling, chez un Drieu La Rochelle ou chez un Henri De Man, pré-voyaient la liberté pour tous les peuples et le respect de toutes les identités, sans qu'il n'y ait de dépen-dance à l'endroit d'une puissance extra-continentale, les Etats-Unis, dont les stratégies diplomatiques et militaires ont toujours visé à deux choses:
- soit affaiblir notre continent en favorisant ses divisions internes;
- soit favoriser une intégration, de façon à faciliter la pénétration de nos marchés par les firmes et les ex-por-tateurs américains. De l'Allemagne de Weimar, li-vrée pieds et poings liés à la partitocratie des sous-capables, les circuits financiers américains disaient: It's a penetrated system, c'est un système "péné-tré". Cette qualité de "pénétré", eh bien, nous la re-fusons ici haut et fort.
En théorie, l'Europe intégrée est gérée par la Com-mission de Bruxelles. Mais en réalité, cet organe de dé-cision, qui devrait agir dans le sens de l'indépen-dance de notre continent, agit en fait pour favoriser et faciliter la "pénétration" de notre économie par les systèmes japonais et américains; la Commission se positionne ainsi comme un facteur de liquéfaction de notre tissu industriel, exactement comme HIV liqué-fie les stratégies du corps contre l'intrusion des virus de toutes sortes.
Par le fait que la Commission ne joue pas son rôle d'instance décisionnaire, les adversaires du Grand Es-pace européen obtiennent pleine satisfaction: celle d'avoir en face d'eux un processus d'intégration non dangereux, qui ne bénéficie qu'aux seules multina-tio-nales "pénétrantes", et d'avoir affaire à un organe soi-disant décisionnaire qui ne prend pas de vérita-bles décisions et qui se soumet aux parlements na-tionaux, dont l'horizon n'est pas européen mais é-troi-tement électoraliste, local, concussionnaire.
On en arrive au paradoxe suivant: les Européens sin-cères —et nous, nous voulons être de ceux-là— sont obligés de constater que l'Europe se défait par l'action délétère des institutions qui sont censées la ren-dre forte et que les seuls espaces de résistance aux pénétrations américaines et japonaises sont par-fois certains politiciens régionaux ou nationaux, qui ne sont pas encore trop gâtés par les turpitudes par-lementaires!
L'Europe des forces identitaires, que nous appelons de nos vœux, doit dès lors se donner pour mission de réduire cette logique perverse en miettes. Dans cette Europe-là, qui est nôtre, la Commission doit pou-voir décider et fortifier notre indépendance; elle doit suivre la logique impériale de l'auto-centrage,
- en refusant l'éparpillement tous azimuts des capi-taux;
- en favorisant les fusions économiques intra-euro-péennes et les investissements dans la modernisation de nos outils industriels;
- en dérivant les plus-values globales dans les cir-cuits de sécurité sociale et de politique familiale nataliste.
La Commission, dans son état actuel, a accru dange-reusement cette tare affligeante qu'est le nanisme po-li-tique volontaire; en suivant cette voie, elle a mené nos peuples dans une impasse: en effet, nos peuples sont des peuples de travailleurs, de créateurs, de pro-ducteurs et ont su faire de nos pays des géants éco-nomiques. Un géant économique ne peut jamais ê-tre un nain politique. Par conséquent, notre tâche est simple: c'est de combler rapidement le fossé qui sépare, d'un côté, la formidable et puissante réalité économique que nous représentons virtuellement dans le monde, et, d'un autre côté, notre marasme po-litique, notre indécision calamiteuse et notre éco-no-mie "pénétrée". D'ailleurs, soyons clairs et so-yons francs, une situation aussi paradoxale ne peut te-nir à long terme. A notre grandeur économique, doit correspondre une grandeur politique, garantie par une Commission décisionnaire qui obéit à d'au-tres logiques et d'autres principes que ceux de ce libéralisme qui véhicule la pénétration étrangère et dé-bilite notre corps politique.
Nous ne sommes donc pas hostiles à un chapeautage des gouvernements nationaux véreux, corrompus et anachroniques par une Commission qui serait ani-mée par la stratégie de l'auto-centrage et par l'idée de puissance. Par une Commission qui allierait l'idée d'Empire à celle du Zollverein (union douanière). Mais à la Commission libérale, molle, vassalisée et châ-trée par la valetaille partitocratique, nous préfé-re-rons toujours le gouvernement national dirigiste et so-cialiste, qui offrira un espace de résistance et sous-traiera ses administrés aux catastrophes provo-quées par le mondialisme des écervelés libéraux, com-me en Suède où le taux de chômage n'est que de 2,8%.
Evidemment, on pourrait nous poser une question em-barrassante: votre préférence —fort nuancée, nous en convenons— pour l'Etat national non mondialiste et non libéral ne vous aligne-t-elle pas d'em-blée sur les positions de Madame Thatcher qui vient de prononcer à Bruges un vibrant réquisitoire contre l'intégration européenne?
Notre réflexe identitaire est aux antipodes du réflexe insulaire de Madame Thatcher, tout comme notre va-lo-risation du rôle potentiel de la Commission est dia-métralement opposée au rôle réel qu'elle joue aujour-d'hui, dans une Europe qui se désindustrialise, se clo-chardise et se quart-mondise.
Margaret Thatcher a saboté l'autonomie alimentaire eu-ropéenne en torpillant la politique agricole com-mu-ne; par fétichisme idéologique, par son admiration fanatique pour les thèses fumeuses du néo-li-bé-ralisme, pour les grimoires de Hayek et de Milton Friedman, des anarcho-capitalistes et de la "Nou-vel-le Droite" américaine de la "majorité morale" (Moral Majority), par ses engouements idéologiques, Mar-ga-ret Thatcher a démantelé l'outil industriel britan-nique, déconstruit avec un acharnement déplorable les barrières protectionnistes existantes, tant en Grande-Bretagne qu'en Europe. Cette politique qu'elle veut imposer à la Commission, au détriment de bon nombre de secteurs industriels continentaux, français, belges, italiens ou allemands, favorise la concurrence américaine et japonaise et décourage les investissements auto-centrés; qui pis est, elle assas-sine le capital concret, ruine notre tissu industriel, déconsidère le fruit du Travail des producteurs au profit des magouilles des spéculateurs de tous poils; elle privilégie le capital vagabond et financier au dé-triment du capital créatif des machines et du capital humain des mains façonnantes de nos ouvriers et de la matière grise de nos chercheurs! Cette logique est une logique de l'artifice, de l'abstraction; elle est un défi aux forces de nos cerveaux, de nos mains, de notre sang!
En Ecosse, Madame Thatcher a confié des zones fran-ches à la firme Hitachi, abandonnant du même coup des lambeaux du sol et de la souveraineté britanniques à une instance privée étrangère. Dans ces zones franches, sacrifiées à l'anarchie capitaliste, son gouvernement promet de ne pas appliquer les lois de protection sociales: Hitachi pourra ainsi li-cencier des ouvriers écossais, embaucher de pauvres hères venus des quatre coins de la planète, ne devra payer aucune cotisation sociale, aucune indemnité de licenciement, aucune pension d'invalidité! Pour une Dame de Fer qui frappe du poing à Bruges, devant De-lors et Martens médusés, et réclame le droit à la souveraineté nationale, c'est un comble... Mais alors, au fait, qu'est-ce que la souveraineté nationale pour Madame Thatcher? Est-ce le droit de vendre des sujets britanniques comme esclaves à des né-griers japonais? Le droit de solder le territoire écos-sais à l'encan?
Chers camarades, en criant notre volonté politique, nous devons être vigilants et ne pas tomber dans les pièges du vocabulaire. Nous vivons en effet dans un monde orwellien, où chaque chose en est venue à si-gnifier son contraire:
- La Commission est, théoriquement, une instance dé-cisionnaire mais elle ne décide pas;
- Les Etats nationaux sont des anachronismes, après les charniers de Verdun, de la Somme, de Capo-ret-to, de Stalingrad ou de Poméranie, mais, ce sont parfois des leaders nationaux ou de vieux pays indé-pendants comme la Suisse ou la Suède qui créent et maintiennent de la souveraineté en notre continent;
Madame Thatcher hurle son nationalisme, mais ce na-tionalisme galvaude la souveraineté du pays et dé-pouille ses nationaux de tous droits, les mue en es-claves-numéros pour fabricants de gadgets japonais.
L'Europe des partisans de l'identité, notre Europe, sait au moins quelles sont les recettes de la souveraineté et de l'indépendance! Nous savons quelles doc-trines nous solliciterons: celles de List et de Schmol-ler, celles de Delaisi et de Perroux, celles de Zischka et de Messine. Nous savons quelles sont les grandes lignes qu'il faudra suivre pour bâtir un "grand espace protégé", pour assurer la liberté de tout un continent par un dirigisme économique sai-nement conçu!
Il est faux et trop facile de dire que nous n'avons pas de doctrine économique. Nous n'avons tout simple-ment pas eu les fonds nécessaires pour la diffuser, nous n'avons pas bénéficier de la complicité des mé-dias!
Et chez les autres, existe-t-il des doctrines écono-miques cohérentes? Que dire du RPR qui a fait cam-pagne pour un libéralisme reaganien, en même temps qu'il proclamait sa fidélité au gaullisme qui, lui, était pourtant dirigiste? Que dire de l'UDF qui se réclame de Keynes, sans vouloir se débarrasser du libre-échangisme libéral? Qui, avec Raymond Barre, se réclame de ce Keynes, lequel manifestait sa joie devant les réalisations économiques du IIIème Reich (j'oublie sans doute que Mr. Barre est un anti-facho officiel, comme mr. tout-le-monde...)? Que dire du PS qui se réclame de Schumpeter, pour qui les in-novations des inventeurs et des patrons sont les mo-teurs de l'économie et du progrès? Que dire donc de ce PS qui, malgré cet engouement pour Schumpeter, n'abandonne pas ses marottes égalitaristes? Que pen-ser ensuite des capitulations successives de la "IIème gauche", de la "IIIème gauche" et des sé-ductions du capitalisme libertaire, prôné par d'ex-PSU?
Face à l'incohérence et au désorientement, à l'échec patent et à l'enlisement tragi-comique des partis du système, nous sommes désormais en mesure de fai-re valoir notre droit à la parole et de propulser notre cohérence doctrinale sur la scène politique, de faire irruption dans le débat sans plus rougir de notre im-préparation. Je m'adresse surtout aux étudiants qui sont dans nos rangs: qu'ils se préparent pour ce que j'appelerais "la bataille de l'économie"; qu'ils étof-fent et fourbissent leurs argumentaires. Nos divers mouvements rénovateurs, qu'ils soient politiques ou métapolitiques, ont désormais l'impérieux devoir de se consacrer corps et âme aux doctrines écono-mi-ques, d'arraisonner enfin le social, même si cela im-plique le léger sacrifice d'être moins littéraires, voire moins nostalgiques.
Le modèle américain, reaganien, a fait faillite. Seul de-meure le modèle japonais. Le MITI nippon, c'est l'instance centrale qui régule (mot significatif!) l'é-conomie de l'Empire du Soleil Levant et c'est l'exem-ple que devrait suivre la Commission de Bru-xelles: les Japonais ont investi dans des machines-outils robotisées, en se passant allègrement d'im-mi-grés et en conservant ipso facto une homogénéité so-cio-culturelle. Ces deux options japonaises des an-nées cinquante portent aujourd'hui leurs fruits. Les "eurocrates" ont choisi la politique du chien crevé au fil de l'eau: ils n'ont pas investi à temps dans la ro-botisation et ils ont importé de la main-d'œuvre du Maghreb ou de la Turquie. Conséquence: nous a-vons un taux de chômage massif et nous ne sommes pas compétitifs.
Contrairement à ce qu'affirme une brochette de vilains petits cloportes, qui pissent leurs articulets mal torchés dans des revues soi-disant anti-fascistes, nous n'allons pas chercher nos modèles auprès des totalitarismes d'antan. Nous souhaitons plus simplement une synthèse efficace des stratégies suédoises ou japonaises et une application des théories véritablement socialistes que les sociaux-démocrates, pusillanimes et indécis, n'ont jamais osé s'approprier.
Mais il est temps de conclure:
Nous voulons des robots comme les Japonais, pas des esclaves immigrés;
Nous voulons des hommes et des peuples libres, pas des masses hallucinées par le déracinement;
Nous voulons le progrès technologique, pas l'avilis-sement des peuples nord-africains et sud-sahariens; parce que nous sommes de vrais humanistes —et non des humanistes de carnaval— parce que la di-gnité est un principe cardinal dans notre éthique, nous voulons des "potes" qui travaillent à reverdir le Sahara, nous voulons des "potes" qui travaillent dans les fermes modèles du désert de Libye; nous ne voulons pas des "potes" manipulés, devenus "schi-zo" dans de sordides HLM de banlieue;
Nous voulons le succès économique, pas le chôma-ge ni la désindustrialisation ni la quart-mondisation ou la tiers-mondisation de nos classes ouvrières;
Nous sommes des futuristes et des bâtisseurs, pas des collectionneurs de bric-à-brac.
Donc, il n'y a qu'un seul mot d'ordre qui tienne: au travail!
00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : europe, affaires européennes, économie, troisième voie, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 23 juin 2009
Il cantore del mito nuovo: Giorgio Locchi
Il cantore del mito nuovo: Giorgio Locchi
di Adriano Scianca (2005) - http://augustomovimento.blogspot.com/
E per ultima venne la “globalizzazione”. In duemila anni di pensiero unico egualitario ci siamo sorbiti: “l’inevitabile” venuta dei tempi messianici, “l’inevitabile” avanzata del progresso tecnico, economico e morale, “l’inevitabile” avvento della società senza classi, “l’inevitabile” trionfo del dominio americano, “l’inevitabile” instaurazione della società multirazziale. Ed ora, appunto, è la “globalizzazione” ad imporsi come “inevitabile”. Il cammino è già tracciato, nulla possiamo contro il Senso della Storia. Certo, l’ingresso trionfale nell’Eden finale va continuamente procrastinato, giacché sempre emergono popoli impertinenti che non apprezzano gli hegelismi in salsa yankee di cui sopra. Ma prima o poi – ce lo dice Bush, ce lo dicono i pacifisti, ce lo dicono gli scienziati, i filosofi e i preti – la storia finirà. È sicuro. Sicuro?
È vero: la storia può effettivamente finire. È del tutto plausibile che nel futuro che ci aspetta si possa assistere al triste spettacolo dell’“ultimo uomo” che saltella invitto e trionfante. Ma questo è solo uno dei possibili esiti del divenire storico. L’altro, anch’esso sempre possibile, va nella direzione opposta, verso una rigenerazione della storia attraverso un nuovo mito. Parola di Giorgio Locchi. Romano, laureato in giurisprudenza, corrispondente da Parigi de “Il Tempo” per più di trent’anni, animatore della prima e più geniale Nouvelle Droite, fine conoscitore della filosofia tedesca, della musica classica, della nuova fisica, Locchi ha rappresentato una delle menti più brillanti ed originali del pensiero anti-egualitario successivo alla sconfitta militare europea del ‘45.
 Molti giovani promesse del pensiero anticonformista degli anni ‘70 conservano ancora oggi il nitido ricordo delle visite da “Meister Locchi” presso la sua casa di Saint-Cloud, a Parigi, «casa dove molti giovani francesi, italiani e tedeschi si recavano più in pellegrinaggio che in visita; ma simulando indifferenza, nella speranza che Locchi […] fosse come Zarathustra dell’umore giusto per vaticinare anziché, come disgraziatamente faceva più spesso, parlare del tempo o del suo cane o di attualità irrilevanti»1. Le ragioni di una tale venerazione non possono sfuggire anche a chi l’autore romano lo abbia conosciuto solo tramite i suoi testi. Leggere Locchi, infatti, è un’“esperienza di verità”: aprendo il suo Wagner, Nietzsche e il mito sovrumanista – un «grande libro», «uno dei testi classici dell’ermeneutica wagneriana», come lo definisce Paolo Isotta sul… “Corriere della Sera”!2 – ci si trova di fronte al disvelamento (ἀλήθεια, a-letheia) di un sapere originale ed originario. Disvelamento che non può mai essere totale.
Molti giovani promesse del pensiero anticonformista degli anni ‘70 conservano ancora oggi il nitido ricordo delle visite da “Meister Locchi” presso la sua casa di Saint-Cloud, a Parigi, «casa dove molti giovani francesi, italiani e tedeschi si recavano più in pellegrinaggio che in visita; ma simulando indifferenza, nella speranza che Locchi […] fosse come Zarathustra dell’umore giusto per vaticinare anziché, come disgraziatamente faceva più spesso, parlare del tempo o del suo cane o di attualità irrilevanti»1. Le ragioni di una tale venerazione non possono sfuggire anche a chi l’autore romano lo abbia conosciuto solo tramite i suoi testi. Leggere Locchi, infatti, è un’“esperienza di verità”: aprendo il suo Wagner, Nietzsche e il mito sovrumanista – un «grande libro», «uno dei testi classici dell’ermeneutica wagneriana», come lo definisce Paolo Isotta sul… “Corriere della Sera”!2 – ci si trova di fronte al disvelamento (ἀλήθεια, a-letheia) di un sapere originale ed originario. Disvelamento che non può mai essere totale.L’aristocratica prosa locchiana è infatti ermetica ed allusiva. Il lettore ne è conquistato, nel tentativo di sbirciare tra le righe e cogliere un sapere ulteriore che, se ne è certi, l’autore già possiede ma dispensa con parsimonia3. Ad aumentare il fascino dell’opera di Locchi, poi, contribuisce anche la vastità dei riferimenti e la diversità degli ambiti toccati: dalle profonde dissertazioni filosofiche alle ampie parentesi musicologiche, dai riferimenti di storia delle religioni alle ardite digressioni sulla fisica e la biologia contemporanea. Chi è abituato alle atmosfere asfittiche di certo neofascismo onanistico o ai tic degli evolomani di stretta osservanza ne è subito rapito.
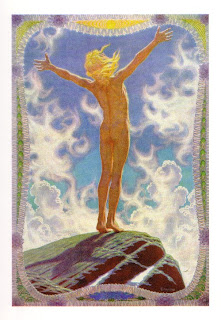 Il punto di partenza del pensiero locchiano è il rifiuto di ogni determinismo storico, ovvero l’idea che «la storia – il divenire storico dell’uomo – scaturisca dalla storicità stessa dell’uomo, cioè dalla libertà storica dell’uomo e dall’esercizio sempre rinnovato che di questa libertà storica, di generazione in generazione, fanno personalità umane differenti»4. È il rifiuto della “logica dell’inevitabile”. La storia è sempre aperta e determinabile dalla volontà umana. Due sono, a livello macro-storico, gli esiti possibili, i poli opposti verso cui indirizzare il divenire: la tendenza egualitarista e la tendenza sovrumanista, esemplificate da Nietzsche con i due mitemi del trionfo dell’ultimo uomo e dell’avvento del superuomo (o, se si preferisce, dell’“oltreuomo”, come è stato rinominato da Vattimo nell’intento illusorio di depotenziarne la carica rivoluzionaria). Il filosofo della volontà di potenza afferma la libertà storica dell’uomo tramite l’annuncio della morte di Dio: chi ha acquisito la consapevolezza che “Dio è morto” «non crede più di essere governato da una legge storica che lo trascende e lo conduce, con l’umanità intera, verso un fine – ed una fine – della storia predeterminato ab aeterno o a principio; bensì sa ormai che è l’uomo stesso, in ogni “presente” della storia, a stabilire conflittualmente la legge con cui determinare l’avvenire dell’umanità»5.
Il punto di partenza del pensiero locchiano è il rifiuto di ogni determinismo storico, ovvero l’idea che «la storia – il divenire storico dell’uomo – scaturisca dalla storicità stessa dell’uomo, cioè dalla libertà storica dell’uomo e dall’esercizio sempre rinnovato che di questa libertà storica, di generazione in generazione, fanno personalità umane differenti»4. È il rifiuto della “logica dell’inevitabile”. La storia è sempre aperta e determinabile dalla volontà umana. Due sono, a livello macro-storico, gli esiti possibili, i poli opposti verso cui indirizzare il divenire: la tendenza egualitarista e la tendenza sovrumanista, esemplificate da Nietzsche con i due mitemi del trionfo dell’ultimo uomo e dell’avvento del superuomo (o, se si preferisce, dell’“oltreuomo”, come è stato rinominato da Vattimo nell’intento illusorio di depotenziarne la carica rivoluzionaria). Il filosofo della volontà di potenza afferma la libertà storica dell’uomo tramite l’annuncio della morte di Dio: chi ha acquisito la consapevolezza che “Dio è morto” «non crede più di essere governato da una legge storica che lo trascende e lo conduce, con l’umanità intera, verso un fine – ed una fine – della storia predeterminato ab aeterno o a principio; bensì sa ormai che è l’uomo stesso, in ogni “presente” della storia, a stabilire conflittualmente la legge con cui determinare l’avvenire dell’umanità»5.Tutto ciò porta Locchi ad individuare una vera e propria “teoria aperta della storia”. Il futuro, in questa prospettiva, non è mai stabilito una volta per tutte, rimane costantemente da decidere. Non solo: anche il passato non è chiuso. Il passato, infatti, non è ciò che è avvenuto una volta per tutte, un mero dato inerte che l’uomo può studiare come fosse un puro oggetto. Esso, al contrario, è interpretazione eternamente cangiante. Il tempo storico, lo stiamo vedendo a poco a poco, assume un carattere tridimensionale, sferico, essendo caratterizzato da interpretazioni del passato, impegni nell’attualità e progetti per l’avvenire eternamente in movimento. L’origine mitica finisce per proiettarsi nel futuro, in funzione eversiva nei confronti dell’attualità. Le diverse prospettive che ne fuoriescono finiscono per scontrarsi dando vita al conflitto epocale.
 Il “conflitto epocale” è dato dallo scontro di due tendenze antagoniste. Si è già detto quale siano le tendenze della nostra epoca: egualitarismo e sovrumanismo. Ogni tendenza attraversa tre fasi: quella mitica (in cui sorge una nuova visione del mondo in modo ancora istintuale, come sentimento del mondo non razionalizzato e quindi come unità dei contrari), quella ideologica (in cui la tendenza, affermandosi storicamente, comincia a riflettere su se stessa e quindi si divide in differenti ideologie apparentemente contrapposte tra loro) e quella autocritica o sintetica (in cui la tendenza prende atto della sua divisione ideologica e cerca di ricreare artificialmente la propria unità originaria). E se l’egualitarismo (oggi in fase “sintetica”) è la tendenza storica dominante da duemila anni, la prima espressione “mitica” del sovrumanismo va ricercata nei movimenti fascisti europei.
Il “conflitto epocale” è dato dallo scontro di due tendenze antagoniste. Si è già detto quale siano le tendenze della nostra epoca: egualitarismo e sovrumanismo. Ogni tendenza attraversa tre fasi: quella mitica (in cui sorge una nuova visione del mondo in modo ancora istintuale, come sentimento del mondo non razionalizzato e quindi come unità dei contrari), quella ideologica (in cui la tendenza, affermandosi storicamente, comincia a riflettere su se stessa e quindi si divide in differenti ideologie apparentemente contrapposte tra loro) e quella autocritica o sintetica (in cui la tendenza prende atto della sua divisione ideologica e cerca di ricreare artificialmente la propria unità originaria). E se l’egualitarismo (oggi in fase “sintetica”) è la tendenza storica dominante da duemila anni, la prima espressione “mitica” del sovrumanismo va ricercata nei movimenti fascisti europei.Il fascismo, per Locchi, non può essere compreso che alla luce della “predicazione sovrumanista” di Nietzsche e Wagner6 e della “volgarizzazione” di tali tesi ad opera degli intellettuali della Rivoluzione Conservatrice (che, quindi, cessa di essere un’entità “innocente”, astrattamente separata dalle sue realizzazioni pratiche, come vorrebbe certo neodestrismo debole). Fascismo come espressione politica del Nuovo Mito comparso nell’ottocento da qualche parte tra Bayreuth e Sils Maria, quindi. Un qualcosa di nuovo, dunque. Ma, wagnerianamente, anche un qualcosa di antico.
Il fascismo, infatti, rappresenta anche la piena assunzione del “residuo” pagano che il cristianesimo non è riuscito a cancellare e che è sopravvissuto nell’inconscio collettivo europeo. Un fenomeno rivoluzionario, insomma, che si richiama ad un passato quanto più possibile ancestrale ed arcaico, proiettandolo nel futuro per sovvertire il presente. Lo scopo, nella lunga durata, è quello di far «regredire oltre la soglia memoriale» la Weltanschauung cristiana, versando significati nuovi nei significanti vecchi di matrice biblica, così come originariamente il cristianesimo “falsificò” i termini pagani per veicolare la propria visione del mondo in un linguaggio che non risultasse incomprensibile alle genti europee. È il progetto che il Parsifal wagneriano esprime con la formula «redimere il redentore»7.
 Ma il primo tentativo di agire concretamente nella storia da parte della tendenza sovrumanista, come sappiamo, è sfociato nella sconfitta militare europea del 1945. Una sconfitta che ha posto il vecchio continente tra le fauci della tenaglia costruita a Yalta. In quel periodo, è bene ricordarlo, troppi eredi del mondo uscito perdente dal secondo conflitto mondiale pensarono di rinverdire la loro militanza sostenendo uno dei due bracci della tenaglia a scapito dell’altro, vagheggiando di un Occidente “bianco” che altro non poteva essere se non la “terra della sera” (Abend-land) in cui veder tramontare ogni speranza di rinascita europea. Scelsero, quei “fascisti” vecchi o nuovi, la tattica del “male minore”. Che, notoriamente, non è altro che la tattica dell’“utile idiota” vista… dall’utile idiota.
Ma il primo tentativo di agire concretamente nella storia da parte della tendenza sovrumanista, come sappiamo, è sfociato nella sconfitta militare europea del 1945. Una sconfitta che ha posto il vecchio continente tra le fauci della tenaglia costruita a Yalta. In quel periodo, è bene ricordarlo, troppi eredi del mondo uscito perdente dal secondo conflitto mondiale pensarono di rinverdire la loro militanza sostenendo uno dei due bracci della tenaglia a scapito dell’altro, vagheggiando di un Occidente “bianco” che altro non poteva essere se non la “terra della sera” (Abend-land) in cui veder tramontare ogni speranza di rinascita europea. Scelsero, quei “fascisti” vecchi o nuovi, la tattica del “male minore”. Che, notoriamente, non è altro che la tattica dell’“utile idiota” vista… dall’utile idiota.In questo contesto, sarà proprio Locchi (non da solo, né per primo: si pensi solo a Jean Thiriart) a denunciare le insidie del “male americano”. E Il male americano è anche il titolo di un libro tratto da un articolo comparso su Nouvelle Ecole nel 1975 a firma Robert De Herte ed Hans-Jürgen Nigra, pseudonimi rispettivamente di Alain de Benoist e dello stesso Locchi. Tale testo contribuirà in maniera decisiva a depurare il corpus dottrinale della Nuova Destra di ogni suggestione occidentalista. Del resto, i due autori cortocircuiteranno la logica dei blocchi citando una frase di Jean Cau: «Nell’ordine dei colonialismi, è prima di tutto non essendo americani oggi che non saremo russi domani». C’è una grande saggezza in tutto ciò. Ne Il male americano l’America è descritta più nella sua ideologia implicita, nel suo way of life, che nella sua prassi criminale. Un’ideologia fatta di moralismo puritano, di disprezzo per ogni idea di politica, tradizione o autorità, di mentalità utilitarista, di conformismo e mancanza di stile, di odio freudiano contro l’Europa. Ciò che soprattutto interessa agli autori è l’influenza della Bibbia nella mentalità collettiva statunitense, senza la quale sarebbero inconcepibili i deliri neocons dell’attuale gestione. Ed inoltre – il ricordo del ‘68 è ancora caldo – non manca la ripetuta sottolineatura della sostanziale convergenza tra la contestazione sinistrorsa ed i miti di oltre-Atlantico. New York come capitale del neo-marxismo: ce n’è abbastanza per distinguere il testo di Locchi/De Benoist dalle denunce “progressiste” dei vari Noam Chomsky (che pure, beninteso, hanno anch’esse la loro funzione).
Ma “il male americano” è soprattutto un male dell’Europa. Oggi che la Guerra Fredda è finita e all’ordine di Yalta è subentrato il feroce solipsismo armato di uno pseudo-impero fanatico e usuraio, ce ne accorgiamo più che mai. L’Europa: il grande malato della storia contemporanea. Ma anche un’idea-forza, un mito, un ripiego sulle origini che è progetto d’avvenire, come vuole la logica del tempo sferico.

In questo senso, i riferimenti all’avventura indoeuropea o all’Imperium romano, alle poleis greche piuttosto che al medioevo ghibellino servono come materiale grezzo da cui forgiare qualcosa di nuovo, qualcosa che non si è mai visto. «Se si vuol parlare d’Europa, progettare una Europa, bisogna pensare all’Europa come a qualcosa che ancora non è mai stato, qualcosa il cui senso e la cui identità restano da inventare. L’Europa non è stata e non può essere una “patria”, una “terra dei padri”; essa soltanto può essere progettata, per dirla con Nietzsche, come “terra dei figli”»8. Se nostalgia dev’esserci, allora che sia “nostalgia dell’avvenire”, come nello (stranamente felice) slogan missino di qualche tempo fa. Questo mondo che crede nella fine della storia sta forse assistendo semplicemente alla fine della propria storia. Per il resto, nulla è scritto. Sprofonderemo anche noi fra le rovine putride di questa decadenza al neon? Oppure avremo la forza di forgiare il nostro destino attraverso l’istituzione di un “nuovo inizio”? A decidere sarà solo la saldezza della nostra fedeltà, la profondità della nostra azione, la tenacia della nostra volontà.
Note
(1) Stefano Vaj, Introduzione a Giorgio Locchi, Espressione e repressione del principio sovrumanista. Tra gli intellettuali influenzati da Locchi ricordiamo, oltre allo stesso Vaj, tutto il nucleo fondante della Novelle Droite anni ‘70/80, da De Benoist a Faye, Steukers, Vial, Krebs, ma anche Gennaro Malgieri ed Annalisa Terranova, oggi in AN. Spunti locchiani emergono anche in tempi recenti in Giovanni Damiano e Francesco Boco. Non possiamo non citare, inoltre, Paolo Isotta, critico musicale del “Corriere della Sera” (!), cui Maurizio Cabona riuscì a far redigere un entusiastico saggio introduttivo al libro su Nietzsche e Wagner e che anche ultimamente (vedi nota successiva) è tornato a citare Locchi proprio sulle colonne del maggiore quotidiano italiano.
(2) Paolo Isotta, “La Rivoluzione di Wagner”, ne “Il Corriere della Sera” del 04/04/2005.
(3) Va detto, inoltre, che tra le carte lasciate da Locchi si trova diverso materiale inedito, tra cui un saggio su Martin Heidegger probabilmente e sfortunatamente destinato a non vedere mai la luce.
(4) Da Wagner, Nietzsche e il mito sovrumanista.
(5) Ibidem.
(6) Grande merito di Locchi è del resto il fatto stesso di aver riscoperto le potenzialità rivoluzionarie dell’opera wagneriana in un ambiente che continuava a pensare al compositore tedesco nell’ottica della duplice “scomunica” nietzschana ed evoliana.
(7) Gli indoeuropei, la filosofia greca, Nietzsche, la Konservative Revolution, il fascismo, l’Europa: il lettore attento avrà già scorto, dietro a simili riferimenti, l’ombra possente di Adriano Romualdi. Eppure, incredibilmente, Locchi sviluppò il suo pensiero del tutto autonomamente da Romualdi. Anzi, sarà solo grazie ad alcuni giovani italiani recatisi da lui in visita a Parigi che il filosofo conoscerà l’opera del giovane pensatore morto prematuramente. Senza mancare di sottolineare l’oggettiva convergenza di vedute. Per gli amanti della rete (e i poliglotti), segnaliamo la presenza, in Internet, di un testo in spagnolo (La esencia del fascismo como fenómeno europeo. Conferencia-Homenaje a Adriano Romualdi) che riproduce un discorso di Locchi pronunciato proprio in onore del compianto autore di Julius Evola: l’uomo e l’opera. Ignoriamo le circostanze cui far risalire tale discorso.
(8) Da L’Europa: non è eredità ma missione futura.
00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, wagner, wagnerisme, philosophie, révolution conservatrice, histoire, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 février 2009
D. Venner : L'Europe et l'européanité
L'Europe et l'Européanité par Dominique Venner
 Qu'est-ce que l'Europe ? Qu'est-ce qu'un Européen ?
Qu'est-ce que l'Europe ? Qu'est-ce qu'un Européen ?D'un point de vue géopolitique et historique, l'Europe se définit d'abord par ses limites. Au centre, l'Europe noyau, formée par les nations qui ont vécu depuis le Haut Moyen Age une histoire solidaire bien que souvent conflictuelle. Pour l'essentiel, il s'agit des nations issues de l'Empire carolingien et de ses marges, celles qui constituèrent au traité de Rome (1957) l'Europe dite des Six. Au-delà, on voit se dessiner un deuxième cercle incluant les nations atlantiques et septentrionales, ainsi que celles de l'Europe orientale et balkanique. Enfin, un troisième cercle d'alliances privilégiées s'élargit jusqu'à la Russie. On ne plaide ici nullement pour un projet politique. C'est seulement l'historien qui parle et rappelle une série de réalités. On pourrait en invoquer d'autres. L'empire danubien des Habsbourg fut une réalité. L'Europe de la Baltique en fut une également, ce qui n'est plus vrai de la Méditerranée qui a cessé d'être un facteur d'unité à partir de la conquête arabo-musulmane du vue siècle. Mais l'Europe est bien autre chose que le cadre géographique de son existence.
La conscience d'une appartenance européenne, donc d'une européanité, est très antérieure au concept moderne d'Europe. Elle s'est manifestée sous les noms successifs de l'hellénisme, de la celtitude, de la romanité, de l'empire franc ou de la chrétienté. Conçue comme une tradition immémoriale, l'Europe est issue d'une communauté de culture multimillénaire tirant sa spécificité et son unicité de ses peuples constitutifs, d'un héritage spirituel qui trouve son expression primordiale dans les poèmes homériques.
Comme les autres grandes civilisations, Chine, Japon, Inde ou Orient sémitique, la nôtre plongeait loin dans la Préhistoire. Elle reposait sur une tradition spécifique qui traverse le temps sous des apparences changeantes. Elle était faite de valeurs spirituelles qui structurent nos comportements et nourrissent nos représentations même quand nous les avons oubliées. Si, par exemple, la simple sexualité est universelle au même titre que l'action de se nourrir, l'amour, lui, est différent dans chaque civilisation, comme est différente la représentation de la féminité, l'art pictural, la gastronomie ou la musique. Ce sont les reflets d'une certaine morphologie spirituelle, mystérieusement transmise par atavisme, structure du langage et mémoire diffuse de la communauté. Ces spécificités nous font ce que nous sommes, à nul autre pareils, même quand la conscience en a été perdue. Comprise dans ce sens, la tradition est ce qui façonne et prolonge l'individualité, fondant l'identité, donnant sa signification à la vie. Ce n'est pas une transcendance extérieure à soi. La tradition est un « moi » qui traverse le temps, une expression vivante du particulier au sein de l'universel.
Le nom d'Europe apparut voici 2 500 ans chez Hérodote et dans la Description de la terre d'Hécatée de Milet. Et ce n'est pas un hasard si ce géographe grec classait les Celtes et les Scythes parmi les peuples de l'Europe et non parmi les Barbares. Cette époque était celle d'une première conscience de soi, surgie de la menace des guerres médiques. C'est une constante historique : l'identité naît des menaces de l'altérité.
Une vingtaine de siècles après Salamine, la chute de Constantinople, le 29 mai 1453, fut ressentie comme un séisme pire encore. Tout le front oriental de l'Europe se trouvait offert à la conquête ottomane. L'Autriche des Habsbourg devenait l'ultime rempart. Cet instant critique favorisa l'éclosion d'une conscience européenne, au sens moderne du mot. En 1452, le philosophe Georges de Trébizonde avait déjà publié Pro defenda Europa, manifeste où le nom d'Europe remplaçait celui de Chrétienté. Après la chute de la capitale byzantine, la cardinal Piccolomini, futur pape Pie II, écrivit : "On arrache à l'Europe sa part orientale." Et pour faire sentir toute la portée de l'événement, il invoquait, non les pères de l'Église, mais, plus haut dans la mémoire européenne, les poètes et les tragiques de la Grèce antique. Cette catastrophe, disait-il, signifie « la seconde mort d'Homère, de Sophocle et d'Euripide ». Ce pape lucide mourut en 1464 dans le désespoir de n'avoir pu réunir une armée et une flotte pour délivrer Constantinople.
Que l'Europe fût une très ancienne communauté de civilisation, toute l'histoire en témoigne. Sans remonter aux peintures rupestres et à la culture mégalithique, il n'y a pas un seul grand phénomène historique vécu par l'un des pays de l'espace franc qui n'ait été commun à tous les autres. La chevalerie médiévale, la poésie épique, l'amour courtois, le monachisme, les libertés féodales, les croisades, l'émergence des villes, la révolution du gothique, la Renaissance, la Réforme et son contraire, l'expansion au-delà des mers, la naissance des Etats-nations, le baroque profane et religieux, la polyphonie musicale, les Lumières, le romantisme, l'univers prométhéen de la technique ou l'éveil des nationalités... Oui, tout cela est commun à l'Europe et à elle seule. Au cours de l'histoire, tout grand mouvement lié dans un pays d'Europe a trouvé immédiatement son équivalent chez les peuples frères et nulle part ailleurs. Quant à nos conflits qui ont longtemps contribué à notre dynamisme, ils furent dictés par la compétition des princes ou des États, nullement par des oppositions de culture et de civilisation.
Contrairement à d'autres peuples moins favorisés, les Européens avaient rarement eu à se poser la question de leur identité. Il leur suffisait d'exister, nombreux, forts et souvent conquérants. Voilà qui est fini. Le terrible « siècle de 1914 » a mis fin au règne des Européens que taraudent désormais tous les démons des interrogations sur eux-mêmes et de la culpabilité, tempérés il est vrai par une abondance matérielle provisoire. Les artisans de l'unification évacuent même avec effroi la question de l'identité. Celle-ci commande pourtant la nécessaire perception d'une communauté autant que la question vitale des frontières ethniques et territoriales.
Dominique Venner, Le Siècle de 1914, 2006.
A lire:
>>> Dominique Venner, Histoire et Tradition des Européens : 30000 ans d'identité, Ed. du Rocher, 2004.
00:25 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, identité, peuples européens, affaires européennes, identité européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 février 2009
El cantor del nuevo mito - Giorgio Locchi revisitado
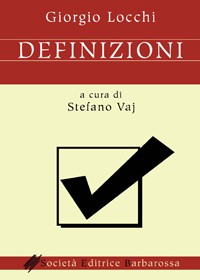
Adriano Scianca
“…sonaba, tan antiguo, y sin embargo era tan nuevo…”
Richard Wagner
Y por último llegó la “globalización”. En dos mil años de pensamiento único igualitario nos hemos tragado: la “inevitable” venida de los tiempos mesiánicos, el “inevitable” avance del progreso técnico, económico y moral, el “inevitable” advenimiento de la sociedad sin clases, el “inevitable” triunfo del dominio americano, la “inevitable” instauración de la sociedad multirracial. Y ahora, precisamente, es la globalización la que se impone como “inevitable”. El camino ya está trazado, nada podemos contra el Sentido de la Historia. Es cierto que la entrada triunfal en el Edén final es postergada de manera continua porque siempre surgen pueblos impertinentes que no aprecian los hegelianismos en salsa yanqui como los anteriormente citados. Pero, tarde o temprano- nos lo dice Bush, nos lo dicen los pacifistas, nos lo dicen los científicos, los filósofos y los curas- la historia llegará a su fin. Seguro. ¿Seguro?
¿El fin de la historia?
Es verdad: la historia, efectivamente, puede llegar a su fin. Es del todo plausible que en el futuro que nos espera se pueda asistir al triste espectáculo del “último hombre” que da saltitos invicto y triunfante. Pero este es sólo uno de los posibles resultados del devenir histórico. El otro, también este siempre posible, va en la dirección opuesta, hacia una regeneración de la historia a través de un nuevo mito. Palabra de Giorgio Locchi. Romano, licenciado en Derecho, corresponsal en París de “Il tempo” durante más de treinta años, animador de la primera y más genial Nouvelle Droite, fino conocedor de la filosofía alemana, de música clásica, de la nueva física, Locchi ha representado una de las mentes más brillantes y originales del pensamiento anti-igualitario posterior a la derrota militar europea del 45.
Muchas jóvenes promesas del pensamiento anticonformista de los años 70 conservan todavía hoy el nítido recuerdo de las visitas que hicieron a “Meister Locchi” en su casa de Saint-Cloud, en París, “casa a la que muchos jóvenes franceses, italianos y alemanes se dirigían más en peregrinaje que de visita; pero simulando indiferencia, con la esperanza de que Locchi (…) estuviese como Zarathustra con el humor adecuado para vaticinar y no, como desgraciadamente sucedía más a menudo, para que les hablase del tiempo o de su perro o de actualidades irrelevantes” (1). Las razones de tal veneración no pasan tampoco inadvertidas para quienes sólo hayan conocido al autor romano a través de sus textos. Leer a Locchi, de hecho, es una “experiencia de verdad”: tomemos su Wagner, Nietzsche e il mito sovrumanista – un “gran libro”, “unos de los textos clásicos de la hermenéutica wagneriana”, como lo define Paolo Isotta en el… ¡Corriere della Sera! (2)- uno se encuentra ante el desvelamiento (a-letheia) de un saber original y originario. Desvelamiento que no puede ser nunca total.
La aristocrática prosa de Locchi es, de hecho, hermética y alusiva. El lector es conquistado por ella, tratando de atisbar entre las líneas y de captar un saber ulterior que, estamos seguros de ello, el autor ya posee pero dispensa con parsimonia (3). A aumentar la fascinación de la obra de Locchi, además, contribuye también la vastedad de referencias y la diversidad de los ámbitos que toca: de las profundas disertaciones filosóficas a los amplios paréntesis musicológicos, pasando por las referencias a la historia de las religiones y por las audaces digresiones sobre la física y la biología contemporánea. Quien está acostumbrado a la atmósfera asfixiante de cierto neofascismo onanista o a los tics de los evolamaniacos de estricta observancia es raptado inmediatamente por todo ello.
La libertad histórica
El punto de partida del pensamiento locchiano es el rechazo de todo determinismo histórico, es decir, la idea de que “la historia- el devenir histórico del hombre- surge de la historicidad misma del hombre, es decir, de la libertad histórica del hombre y del ejercicio siempre renovado que de esta libertad histórica, de generación en generación, hacen personalidades humanas diferentes” (4). Es el rechazo de la “lógica de lo inevitable”. La historia está siempre abierta y es determinable por la voluntad humana. Dos son, a nivel macrohistórico, los resultados posibles, los polos opuestos hacia los que dirigir el porvenir: la tendencia igualitarista y la tendencia sobrehumanista, ejemplificadas por Nietzsche con los dos mitemas del triunfo del último hombre y del advenimiento del superhombre (o, si se prefiere, del “ultrahombre”, como ha sido rebautizado por Vattimo en el intento de despotenciar su carga revolucionaria). El filósofo de la voluntad de poder afirma la libertad histórica del hombre mediante el anuncio de la muerte de Dios: quien ha adquirido la conciencia de que “Dios ha muerto” “no cree ya que esté gobernado por una ley histórica que lo trasciende y lo conduce, con toda la humanidad, hacia una finalidad- y un fin- de la historia predeterminada ab aeterno o a principio; sino que sabe ya que es el hombre mismo, en todo “presente” de la historia, el que establece conflictivamente la ley con la que determinar el porvenir de la humanidad” (5).
Todo esto lleva a Locchi a identificar una auténtica “teoría abierta de la historia”. El futuro, desde esta perspectiva, no está nunca establecido de una vez por todas, ha de ser decidido constantemente. No sólo eso: tampoco el pasado está cerrado. El pasado, de hecho, no es lo que ha acaecido de una vez por todas, un mero dato inerte que el hombre puede estudiar como si fuese un puro objeto. Al contrario, es interpretación eternamente cambiante. El tiempo histórico, lo vamos viendo poco a poco, asume un carácter tridimensional, esférico, estando caracterizado por interpretaciones del pasado, compromisos en la actualidad y proyectos para el porvenir eternamente en movimiento. El origen mítico acaba proyectándose en el futuro, en función eversiva con respecto a la actualidad. Las distintas perspectivas que brotan de ello acaban chocando dando vida al conflicto epocal.
El conflicto epocal
El “conflicto epocal” se da por el choque de dos tendencias antagónicas. Ya se ha dicho cuales son las tendencias de nuestra época: igualitarismo y sobrehumanismo. Toda tendencia atraviesa tres fases: la mítica (en la que surge una nueva visión del mundo de manera todavía instintiva, como sentimiento del mundo no racionalizado y, por tanto, como unidad de los contrarios), la ideológica (en la que la tendencia, habiéndose afirmado históricamente, comienza a reflexionar sobre sí misma y, entonces, se divide en diferentes ideologías contrapuestas entre sí) y la autocrítica o sintética (en la que la tendencia toma nota de su división ideológica y trata de recrear artificialmente la propia unidad originaria). Y si el igualitarismo (hoy en fase “sintética”) es la tendencia histórica dominante desde hace dos mil años, la primera expresión “mítica” del sobrehumanismo ha de buscarse en los movimientos fascistas europeos.
El fascismo, para Locchi, no puede ser comprendido más que a la luz de la “predicación sobrehumanista” de Nietzsche y Wagner (6) y de la “vulgarización” que de tales tesis llevaron a cabo los intelectuales de la Revolución Conservadora (que, por tanto, deja de ser una entidad “inocente”, abstractamente separada de sus realizaciones prácticas, tal y como quisiera cierto neoderechismo débil). Por tanto, el fascismo como expresión política del Nuevo Mito que apareció en el siglo XIX en algún lugar entre Bayreuth y Sils Maria. Entonces, algo nuevo. Pero, wagnerianamente, algo antiguo también.
El fascismo, de hecho, representa también la plena asunción del “residuo” pagano que el cristianismo no logró borrar y que ha sobrevivido en el inconsciente colectivo europeo. Un fenómeno revolucionario, en definitiva, que se reconoce en un pasado lo más ancestral y arcaico posible, proyectándolo en el futuro para subvertir el presente. El objetivo, de larga duración, es hacer que la Weltanschauung cristiana “retroceda más allá del umbral de la memoria”, derramando significados nuevos en los significantes viejos de matriz bíblica, tal y como originariamente el cristianismo “falsificó” los términos paganos para canalizar la propia visión del mundo en un lenguaje que no resultase incomprensible a las gentes europeas. Es el proyecto que el Parsifal wagneriano expresa con la fórmula “redimir al redentor” (7).
El mal americano
Pero la primera tentativa de actuar concretamente en la historia por parte de la tendencia sobrehumanista, como sabemos, desembocó en la derrota militar europea de 1945. Una derrota que puso al viejo continente entre las fauces de la tenaza construida en Yalta. En aquel periodo, está bien recordarlo, demasiados herederos del mundo que salió derrotado de la segunda guerra mundial pensaron en renovar su militancia sosteniendo uno de los dos brazos de la tenaza a expensas del otro, anhelando un Occidente “blanco” que no podía ser otra cosa que la “tierra del anochecer” (Abend-land) en la que ver el crepúsculo de toda esperanza de renacimiento europeo. Eligieron, aquellos “fascistas” viejos o nuevos, la táctica del “mal menor”, que, como se sabe, no es otra que la táctica del “tonto útil” vista… por el tonto útil.
En este contexto, será precisamente Locchi (no sólo, ni el primero: sólo hay que pensar en Jean Thiriart) quien denuncie las insidias del “mal americano”. Y El mal americano (Il male americano) es también el título de un libro que salió de un artículo aparecido en Nouvelle Ecole en 1975 con la firma de Robert de Herte y Hans-Jürgen Negra, pseudónimos respectivamente de Alain de Benoist y del mismo Locchi. Tal texto contribuirá de manera decisiva a depurar el corpus doctrinal de la Nueva Derecha de toda sugestión occidentalista. Por lo demás, los dos autores provocarán un cortocircuito en la lógica de los bloques citando una frase de Jean Cau: “En el orden de los colonialismos, es ante todo no siendo americanos hoy, como no seremos rusos mañana”. Hay una gran sabiduría en todo esto. En Il male americano América es descrita más en su ideología implícita, en su way of life, que en su praxis criminal. Una ideología hecha de moralismo puritano, de desprecio por toda idea de política, tradición o autoridad, de mentalidad utilitarista, de conformismo y ausencia de estilo, de odio freudiano contra Europa. Lo que especialmente interesa a los autores es la influencia de la Biblia en la mentalidad colectiva estadounidense, sin la cual serían inconcebibles los delirios neocon de la actual administración. Y además – el recuerdo del 68 estaba todavía caliente- no falta el repetido énfasis de la sustancial convergencia entre la contestación izquierdista y los mitos del otro lado del Atlántico. Nueva York como capital del neo-marxismo: basta con esto para distinguir el texto del Locchi/ de Benoist de las denuncias “progresistas” de los varios Noam Chomsky (aunque, por supuesto, también estos tienen su función).
La tierra de los hijos
Pero “el mal americano” es sobre todo un mal de Europa. Hoy que la guerra fría ha terminado ya y al orden de Yalta le ha sucedido el feroz solipsismo armado de un pseudoimperio fanático y usurero, nos damos cuenta de ello más que nunca. Europa: el gran enfermo de la historia contemporánea. Pero también una idea-fuerza, un mito, un retorno a los orígenes que es proyecto de porvenir, como proclama la lógica del tiempo esférico.
En este sentido, las referencias a la aventura indoeuropea o al Imperium romano, a las polis griegas más que al medievo gibelino sirven como materia prima a partir de la cual forjar algo nuevo, algo que no se ha visto nunca. “Si se quiere hablar de Europa, proyectar una Europa, es preciso pensar en Europa como en algo que nunca ha sido, algo cuyo sentido y cuya identidad han de ser inventados. Europa no ha sido y no puede ser una ‘patria’, una ‘tierra de los padres`, ésta solamente puede ser proyectada, para decirlo como Nietzsche, como ‘tierra de los hijos’ (8). Si tiene que haber nostalgia, entonces que sea “nostalgia del porvenir”, como en el (extrañamente feliz) eslogan del MSI de hace ya años. Este mundo que cree en el fin de la historia quizás está asistiendo simplemente al fin de su propia historia. Después de todo, nada está escrito. ¿Nos hundiremos también nosotros en las pútridas ruinas de esta decadencia iluminada con luces de neón? ¿O tendremos la fuerza para forjar nuestro destino a través de la institución de un “nuevo inicio”? Lo decidirá tan sólo la solidez de nuestra fidelidad, la profundidad de nuestra acción, la tenacidad de nuestra voluntad.
Notas:
(1) Stefano Vaj, Introduzione a Girogio Locchi, Espressione e repressione del principio sovrumanista (La esencia del fascismo).Entre los intelectuales influenciados por Locchi recordamos, además del propio Vaj, todo el núcleo fundador de la Nouvelle Droite de los años 70/80, desde De Benoist a Faye, pasando por Steuckers, Vial, Krebs, pero también Gennaro Malgieri y Annalisa Terranova, hoy en AN. Ideas locchianas aparecen también en tiempos recientes en Giovanni Damiano y Francesco Boco. No podemos dejar de citar, además, a Paolo Isotta, crítico musical del Corriere della Sera (¡!), a quien Maurizio Carbona logró convencer para que redactara un entusiasta ensayo introductorio al libro sobre Nietzsche y Wagner y que últimamente (véase la siguiente nota) ha vuelto a citar a Locchi precisamente en las columnas del mayor diario italiano.
(2) Paolo Isotta, “La Rivoluzione di Wagner”, en Il Corriere della Sera del 4/4/05
(3) Hay que decir, además, que entre los papeles que Locchi dejó, se encuentra diverso material inédito, entre el cual está un ensayo sobre Martin Heidegger probable y desafortunadamente destinado a no ver nunca la luz.
(4) De Wagner, Nietzsche e il mito sovrumanista.
(5) Ibidem
(6) Por otra parte, gran mérito de Locchi es el hecho de haber redescubierto las potencialidades revolucionarias de la obra wagneriana en un ambiente que continuaba pensando en el compositor alemán desde la perspectiva de la doble “excomunión” nietzscheana y evoliana.
(7) Los Indoeuropeos, la filosofía griega, la Konservative Revolution, el fascismo, Europa: el lector atento habrá vislumbrado, detrás de referencias semejantes, la sombra pujante de Adriano Romualdi. Y sin embargo, increíblemente, Locchi desarrolló su pensamiento de manera completamente autónoma de Romualdi. Es más, será sólo gracias a algunos jóvenes italianos que fueron a visitarle a París como el filósofo conocerá la obra del joven pensador que murió prematuramente. Sin dejar de subrayar la objetiva convergencia de perspectivas. Al respecto, véase La esencia del fascismo como fenómeno europeo. Conferencia-Homenaje a Adriano Romualdi, que reproduce un discurso de Locchi pronunciado precisamente en honor del llorado autor de Julius Evola: el hombre y la obra.
(8) De L’Europa: non è eredità ma missione futura
00:15 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie de l'histoire, synergies européennes, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 18 janvier 2009
Por la autodefensa étnica integral: Reflexiones sobre "La colonizacion de Europa" de Guillaume Faye
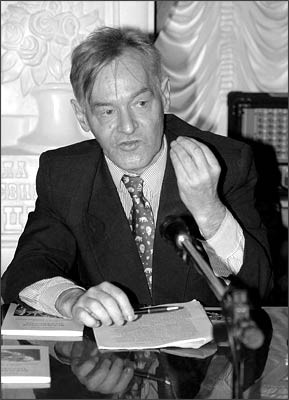
Por la autodefensa étnica integral: Reflexiones sobre "La colonización de Europa", de Guillaume Faye
Stefano Vaj
[Traducción de Santiago Rivas]
Conocí a Guillaume Faye en París en 1978, durante el undécimo congreso anual del GRECE (Groupement de Recherche et Etudes pour la Civilisation Européenne), en el momento álgido de una personal "crisis de identidad".
Aun siendo yo muy joven, llevaba cuatro o cinco años sumergido en un ambiente que creía hacer política prestando el empeño militante al sostenimiento del MSI, un partido sustancialmente empeñado en administrar los restos italianos de la derrota militar europea. Peor aún, la estrategia de aquella administración consistía en aguardar a la espera de ser finalmente reciclada, y en ofrecer sus servicios a las franjas más a la retaguardia de la "clase dirigente" vaticanista-capitalista-masónica –en una época un tanto preocupada por la atenuación de la guerra fría y por la garantía americana, así como por la concurrencia de los "compañeros de reparto" de observancia soviética.
Por lo demás, tal ambiente vivía en una absoluta esquizofrenia política, permaneciendo unido casi exclusivamente por el ansia de diferenciarse y por el rechazo respecto a la línea general biempensante, conservadora y ávida de respetabilidad, del partido; aquel mismo partido del cual continuaban frecuentando sus sedes, sosteniendo sus listas, suscribiendo sus manifiestos, etc. Los varios personajes que encontré no eran por lo demás ajenos a los miles de pequeños compromisarios, aunque llevasen cargos cuya denominación altisonante se correspondiese con una absoluta falta de poder real; además, pertenecían a connotaciones ideológicas tan variadas como carentes de correspondencia con mis propias ideas, o por mejor decir, a la sensibilidad que me había aproximado a un ambiente tal. Católicos integristas, anticomunistas genéricos, personajes convencidos de que la guerra mundial había sido combatida para hacer participar a cualquier representante sindical en las reuniones de los consejos de administración ("...como en Alemania Federal, como en Yugoslavia"), tradicionalistas y esoteristas al borde de la sesión espiritista, nihilistas, admiradores indiscriminados del militarismo chileno, israelita o francés, pseudoidealistas que nunca habían leído una línea de Spirito, Gentile o Fichte, vestales y adoradores de una crónica política pasada y mal comprendida; pero el empacho de la elección no era algo que me repugnase mayormente. Por muchos aspectos una corte de los milagros, en suma, cuyos miembros eran ciertamente "desviados" pero también en gran parte "recuperados" por el Sistema, presa de sugestiones ideológicas cuya gran variedad iba solamente a la par de la sustancial extrañeza de esos elementos con la "tendencia histórica" encarnada por las grandes revoluciones nacional-populares de la primera mitad del siglo, por Nietzsche, Wagner y Stefan George, Marinetti, D´Anunnzio y Drieu La Rochelle.
La imagen tan caricaturesca, demoníaca y en el fondo ridícula que de tal ambiente era ofrecida desde el exterior, con su intrigante perfume de azufre, era casi más atractiva que la mediocre realidad que yo experimentaba directamente cada día
El contacto con el ambiente francés, por entonces principalmente representado por el GRECE, "Groupement de Recherches et Etudes pour la Civilisation Européenne" (1), fue, por todo lo dicho, mucho más que una agradable sorpresa. No me había inventado una pertenencia literaria a una comunidad mítica irremediablemente extinta; aún existían personas que verdaderamente compartían aquellos valores que me habían atraído hacia un mundo italiano que teóricamente habría debido ser su heredero, pero que no usaba argumentos de acción histórica ni de "gran política".
Por lo demás, el movimiento francés, después de un decenio de duro trabajo, se encontraba visiblemente en la espera de un gran suceso, intentando agregar en torno suyo "compañeros de viaje" de notable renombre y, sobe todo, de suscitar un séquito, pequeño pero entusiasta, en numerosos países europeos, de Bélgica a Grecia, de Alemania a Inglaterra, de Suiza a la misma Italia. Un séquito que únicamente pedía ofrecer su propia contribución, creando comunidades locales o participando en el trabajo de difusión de ideas por medio de conferencias, publicaciones e infiltraciones en los medios de comunicación y de la universidad.
Pero alejemos las divagaciones. El congreso en cuestión trataba sobre "L´inégalité de l´homme", y venía a focalizar uno de aquellos temas que ya habían sido estabilizados como "leit-motivs" de la batalla cultural del movimiento, temática de identificación, de encuentro y alternativas de nuestra época, de antítesis frente a las ideologías de matriz judeo-cristiana, democrática, marxista, etc., y de visión del mundo antiigualitaria, aristocrática y sobrehumanista.
Entre los participantes se encontraban, naturalmente, Alain de Benoist el intelectual; Giorgio Locchi el filósofo –que habría de ser mi gurú y "maitre á penser" personal, si alguna vez tuve alguno, y cuya intervención en el congreso fue posteriormente publicada por "l´Uomo libero" n.6 con el título "Mito y Comunidad"–; y, sobre todo, Guillaume Faye el militante, el ponente que sin duda más me impactó.
Orador excepcional, hipnótico en su lectura de una relación escrita en la atenuada atmósfera de un convenio de estudios en un palacio de congresos, Guillaume Faye se asemejaba físicamente y en sus movimientos un poco al joven Feddersen interpelado por Gustav Froelich, el protagonista de "Metrópolis", de Fritz Lang; y era ya indiscutiblemente el astro en alza del movimiento. Especialmente para un dieciochioañero sediento de coherencia y pasión, pero también asaltado por la despreocupación, Faye daba la impresión de un "lúcido fanatismo" en donde de mezclaban reminiscencias del Che Guevara, D´Annunzio, Ignacio de Loyola y Goebbles, lejos, muy lejos de ese material humano sectario y arribista, conformista y reaccionario que dominaba en mi experiencia política de la Italia del momento. Las noches pasadas en discutir las cuestiones fundamentales de nuestra época y del futuro de Europa en la campiña provenzal de la Universidad de Verano del GRECE fueron, desde el principio, una bienvenida bocanada de oxígeno.
No sorprendía por ello que Faye fuese simplemente adorado por toda la base del movimiento, incluyendo los componentes internacionales, obviamente menos atraídos por otros exponentes condicionados por un residuo de "espíritu de salón parisino", o bien por una excesiva preocupación por la administración de las vicisitudes cotidianas y locales de la asociación. Y fue precisamente con Faye, Pierre Vial, Jason Hadgidinas y otros camaradas europeos de este ambiente con quienes nos reencontramos pocos años después en Grecia, en el santuario de Apolo en Delfos, al alba, para jurar en diez lenguas en una ceremonia privada nuestra fidelidad a Europa, a sus Dioses y al Sol (re)naciente de su cultura, tras el solsticio de invierno de nuestra época.
Ese rol especial de Guillaume Faye vino después a enfatizarse cuando, poco después, el movimiento, bautizado para la ocasión por los "media" como Nueva Derecha, tomó el control de la redacción de la revista "Figaro-Magazine", apareciendo en la primera página de los diarios de todo el mundo, ilusionándose por un instante de haber afirmado unas raíces inextirpables en la oficialidad. Excluyendo a unos pocos personajes dedicados a misiones meramente organizativas, Faye fue prácticamente el único que no jugó sus cartas en los medios tradicionales, en los círculos intelectuales acreditados y en la universidad, el único que permaneció empeñado únicamente en el movimiento, para el cual trabajaba a tiempo completo, en donde sus problemas de supervivencia eran de naturaleza puramente… económica. En semejante posición particular, Faye abrió algunos temas y frentes de lucha fundamentales que más tarde resonaron en toda Europa. En "El sistema contra los pueblos", traducido por mí mismo al italiano para "Edizioni dell´Uomo libero" y recientemente reeditado por "Societá Editrice Barbarossa" (2), constituyó el primer manifiesto contra la globalización publicado en nuestro continente, durante la época de los bloques y de las últimas etapas de la descolonización. La versión definitiva en la cual fue publicada el libro constituyó el fruto de una lucha épica, típica de Faye, contra los editores de "Copernic", por entonces la principal editorial del movimiento. Como es sabido, en el mundo francés y más aun en el anglosajón no son las editoriales (o publisher), sino los editores que jamás han publicado un renglón propio quienes pretenden enseñar a los escritores qué es escribir y cómo se escribe. En el caso, estas figuras no solamente discutían problemas de puntos y comas, de extensión de los capítulos o de "provocaciones" lo suficientemente atractivas para suscitar la atención de esos lectores que raramente superan las primeras páginas antes de regresar definitivamente sobre la cubierta, sino que también ejercieron una tentativa de atenuación y sustancial censura política de un mensaje considerado esta vez demasiado "paradójico", "visionario", "poco realista", "poco serio". El hecho de que el libro sea hoy una descripción fiel de cuanto positivamente ha sucedido y está sucediendo ante los ojos de todos, es el fruto y el testimonio del increíble entusiasmo y energía destinados a convencer, ilustrar, re-escribir la re-escritura de personajes más o menos ignotos, y al final… conseguirlo por cansancio.
Del mismo modo, Guillaume Faye fue quizá el primero en identificar en los Derechos Humanos la doctrina sincrética y final de la tendencia humanista, que el marxismo no ha sabido ser, y que representa el punto de convergencia final, post-ideológico, de todas las corrientes laicas y religiosas en las cuales tal tendencia se ha subdividido después de su afirmación en Europa con el edicto de Teodosio y la derrota de los sajones. El "especial" publicado al respecto por uno de los números de "Elèments" constituyó la inspiración para mi tesis de licenciatura, que después constituyó el núcleo de mi libro publicado con el título "Indagine sui Diritti dell´Uomo" (3) (L.Ed.E., Roma 1985), prologado por Julien Freund, y el cual dediqué al propio Faye. Otra piedra miliar en el recorrido de Faye es la representada por la publicación del "Nouveau Discours à la Nation Européenne" (4), incitación fichteana a la reivindicación de la propia identidad, al redescubrimiento de la fuerza de Europa y a la revuelta contra la dominación extranjera y mundialista de nuestro espacio vital; obra que el autor logró ver publicada por una editora "oficial" (Albatros), con introducción de Michel Jobert, exministro de De Gaulle.
Y aunque hoy pueda parecer banal, debemos a Faye la definitiva liquidación, en "L´Occident comme déclin" (5), de una confusión que hacía todavía a finales de los años setenta a los cantautores nacional-revolucionarios glorificar a la "civilización occidental", mientras algunos epígonos franceses de aquellos que habían combatido en Normandía contra los americanos aún denominaban "Occident" a uno de los pocos movimientos políticos con una cierta importancia. Igualmente, fue nuestro autor el primero en reproponer, en oposición tanto al progresismo ingenuo como al rechazo tradicionalista y neolúdico, la visión faústica de la técnica, relacionándola con la sensibilidad postmoderna que lucha por emerger en la cultura contemporánea ("Hermes, le retour du sacré". Ed. Le Labyrinthe). Siempre a Faye debemos, además, el clarividente análisis sociológico sobre "La Nueva Sociedad de Consumo", o el relanzamiento de modelos económicos alternativos basados en los grandes espacios continentales autocentrados y semiautárquicos (ver el artículo "Por la independencia económica", publicado en italiano por "l´Uomo libero" n. 13). Y podríamos continuar extendiéndonos, empezando por sus traducciones en esta misma revista que pueden consultarse en el sumario de números atrasados.
Por lo demás, frente a mi experiencia directa de la realidad italiana que se distinguía en asociar paradójicamente "fraccionismo" y conformismo, la acción de Faye en el ámbito de la Nueva Derecha conjugaba hasta el extremo disciplina y libertad de espíritu, por cuanto él mismo es uno de los pocos en recoger verdaderamente, junto a otras "piedras en el estaño", la invitación a intensificar el "debate interno" –concepto que ha preocupado durante un cierto periodo a los espontáneos del movimiento, obsesionados con la idea de devenir, o ser percibidos como, una "secta".
Entretanto, había llegado el tiempo de las intervenciones críticas sobre la cuestión religiosa y sobre la postura del GRECE en esta materia.
En efecto, la experiencia común mostraba que cuando en el neo-paganismo la partícula "neo" es gradualmente olvidada, fácilmente aparece la obsesión por la "positividad" y la "legitimación".
Después de todo, mientras es perfectamente posible ser el único, o el último, cristiano, musulmán o judío del mundo, la "religión", desde el punto de vista pagano, es aquello que "liga al conjunto" de un pueblo y a éste con sus orígenes. Pero, desde el momento en que el paganismo innegablemente no es una religión positiva, o bien se tiene el coraje trágico y zaratrustiano de intentar conscientemente la creación de formas originales y de nuevas "normas de valores", ciertamente inspiradas en el pasado que se reclama, pero precisamente por ello distintas, o bien es absolutamente central la búsqueda de una "legitimación" de cualquier tipo. Ésta, para los tradicionalistas evolianos o guenonianos termina regularmente por ser esotérica (los Sabios Ocultos, el Rey de la Montaña, la Tradición Oculta, etc.), cuando no termina por confluir en muchos casos en el Islam, en cualquier variante minoritaria del catolicismo católico u ortodoxo o, mucho peor aún, en los sincretismos vagamente masónicos o New Age.
Para el GRECE, sin embargo, como ya antes para el movimiento völkish de la Alemania de los años treinta, tal búsqueda de legitimación es, antes que metafísica, esencialmente sociológica, tendente a valorizar como "políticamente" importante cualquier fósil de creencia o hábito popular del cual se pueda hipotetizar un origen autóctono, precristiano o simplemente a-cristiano, desde la "fiesta del conejo" a las "estatuas de la felicidad" y otros folklores.
Respecto a todo ello, fue nuevamente Faye el reivindicador, mediante un famoso artículo en "Elements", de las razones de un paganismo laico, solar y postmoderno, abiertamente nietzscheano, distiguiéndose netamente de la obsesión de la "ninfa en su capullo" y de las manías de un "catolicismo a la inversa" de muchos conspicuos componentes de la Nueva Derecha, condicionada así por la rivalidad con las confesiones cristianas que a veces terminaban por remendar.
Artículo profético respecto a la más tardía "evolución" de un De Benoist, el cual, comenzando desde un interés hacia el empirocriticismo y la epistemología russelliana o popperiana, acabó paradójicamente, después de su libro "¿Cómo ser pagano?" (6) y tras un paréntesis heideggeriano, discutiendo con cristianos y judíos sobre metafísica y valores comunes de matriz sustancialmente neoplatónica o neognóstica, sobre cuya base poder atribuir la palma de la superioridad moral a Séneca o a Pablo de Tarso como oponentes de la secularización (ver, por ejemplo, su obra sobre "L´éclipse du sacré" ) (7). Si alguien desea ver los detalles del fin de un sueño no tiene más que leer las páginas de la nueva y extensa introducción de Robert Steuckers a "El sistema contra los pueblos", añadida a la mía en la última edición ya citada del libro de Faye.
A finales de 1986 la crisis anunciada por Giorgio Locchi ("todo lo que está de moda pasa de moda…") llegó a su maduración. Los animadores originales del GRECE, cuando no han sido simplemente recuperados por el Sistema, se encuentran reducidos por un lado a una dimensión de puro testimonio y, por el otro, son cada vez más marginalizados por la realidad de la vida cotidiana de la asociación, dedicada a burocráticos empeños de recolección de fondos para pagar al personal dedicado a recoger fondos… en una degeneración estilo Cienciología. Otros han decidido jugar la carta del Frente Nacional de Le Pen, en su tiempo duramente ridiculizado y ahora en posición de ridiculizar a su vez a la Nueva Derecha, que ya no es percibida como un sujeto dotado de un proyecto histórico o político y aparece reducida a un simple productor de conferencias y publicaciones con ambiciones limitadas.
Los temas de las publicaciones del área (en sustancia "Elèments", "Nouvelle Ecole" y su réplica de infeliz título "Krisis") cada vez son más refinados y literarios. El mismo Alain de Benoist, en una especie de regresión romántica, confiesa a Faye, a mitad de los años ochenta, estar cada vez más interesado en las "imágenes" antes que en las "ideas", hasta el punto de que éste último, en una conversación privada conmigo mismo durante el mismo periodo, describe la contraposición entonces presente en el ambiente como la de los "germanómanos no sobrehumanistas frente a los sobrehumanistas no germanómanos". Entre las consecuencias de tal deriva cabe destacar la extremización de las operaciones consistentes en el reclamo y valorización de los más estrafalarios componentes y sectores de la Revolución Conservadora alemana, por cuanto puedan alabar cualquier disidencia frente a los regímenes fascistas de los años treinta. Es más, era progresiva la concentración sobre temas de carácter sustancialmente histórico, literario y mítico, a despecho de las grandes argumentaciones de naturaleza sociológica, tecnocientífica, política, económica, sobre las cuales, en los años precedentes, el movimiento había tomado posiciones fuertemente originales e innovadoras.
Frente a la creciente presión de la censura y del "pensamiento único", el movimiento responde, por lo demás, con un creciente silencio sobre temas decisivos, paradójicamente acompañado de una constante irrigación de los temas secundarios y por "fugas hacia delante" difícilmente comprensibles para el público propio, como el guiño de ojos a un filosovietismo a lo Jean Cau, del todo onírico y prontamente liquidado por la evolución histórica. También por la incapacidad de no hacerse un hueco en las antítesis del debate político (nacionalismo-cosmopolitismo, liberalismo-socialismo, aborto sí aborto no, ecologismo-antiecologismo, feminismo-antifeminismo, imperialismo-anticolonialismo, comunismo-anticomunismo, etc.), por pretender imponer los propios, pero que se transformará o bien en una incapacidad de tomar posiciones sobre los problemas centrales de nuestro tiempo o bien en un gusto por la batuta brillante y por los eslóganes con fin en sí mismos.
Toparon después con el peine los nudos de los errores políticos y propagandísticos cometidos. El primero de todos: la obsesión con evitar ser presos de cualquier suerte de "internacional negra", y la falta de compresión del potencial de una dimensión verdaderamente internacional, más fácilmente accesible; por ejemplo en términos de capacidad de superar las crisis locales contingentes, de disminución de la vulnerabilidad a la represión y al "black-out" mediático, de movilización mítica de los militantes. Secundariamente, pesó muy negativamente el progresivo vacío de la función central del GRECE (presa del micro-leninismo de los funcionarios antes descritos, siempre más asfixiantes en su tentativa de sobrevivir a sí mismos en su improductividad metapolítica) a favor de una supuesta "corriente" y "comunidad", de cuyos confines e identidad, por cuanto indefinidos, se hipotetizaba que eran los mejores para mantener la riqueza, variedad u organicidad típicas de los grandes movimientos culturales, y sobre todo para evitar los golpes de la reacción, penetrar en los ganglios del poder cultural y evitar la temida "transformación en secta". En fin, al final terminó insostenible para muchos la ambigüedad respecto a los temas de la política real, cuyos contenidos eran justamente rechazados como inesenciales, pero que terminaron condicionando negativamente al movimiento como una suerte de "angelicalismo" y de "neutralidad" en toda materia, dada las posiciones públicas de Alain de Benoist, quien había rechazado en los años setenta, patrocinado por Maurizio Cabona, asumir la titularidad de una firma en el "Candido" de Giorgio Pisano, revista no precisamente arcádica.
Esta involución no pudo remediarla por si solo Guillaume Faye, con una incesante animación de iniciativas siempre más personales y "paralelas" –desde las transmisiones radiofónicas de temática postmoderna "Avant-Guerre", hasta la creación de siglas y actividades –como "l'Institut des Arts et des Lettres" (Instituto de las Artes y las Letras) o el "Collectif de Réflexion sur le Monde Contemporain" (Colectivo de Reflexión sobre el Mundo Contemporáneo)–, llevadas adelante sin un sueldo, un apoyo o un patrocinador, y contempladas con indiferencia, suficiencia y creciente hostilidad desde los vértices del movimiento, aparentemente cada vez más interesado, cuando no se ocupaba por la contabilidad, por las mistificaciones del arte moderno, la poética sobre los elfos en la Sajonia del siglo XV o los "decisivos" debates con Thomas Molnar sobre la cuestión de si lo divino se expresa "en" el mundo o "a través de" el mundo.
El abandono final de Faye devino así –junto con la muerte de Locchi, por lo demás ya aislado del movimiento muchos años antes, en el aparente ocaso de la Nueva Derecha– el símbolo de la conclusión de un ciclo, y el inicio de un periodo de relativa desmovilización en toda Europa, que vió a algunos refugiarse en la política tradicional, a otros en el ámbito de lo privado, y a muchos en confortables "capillas" locales con contactos externos cada vez más reducidos. Sin animar las escisiones, sin intentar apuntalar un flanco ni señalar una dirección, sin mucho menos "convertirse" a lo Marco Tarchi, Guillaume Faye se retira durante un decenio a la sombra, mientras el GRECE, naturalmente sin pagar derechos de autor, continúa utilizando sus escritos, no sin tolerar ciertos rumores según los cuales Faye estaba loco, tenía el cerebro embrutecido por la droga o había sido reclutado por la CIA.
En este escenario, su re-emersión, a finales de los "malditos" años noventa que vieron el derrumbe de tantas esperanzas y el triunfo del Sistema mundialista inútilmente denunciado y combatido con increíble clarividencia, no pudo sino representar para mí un presagio de buen augurio, y un estímulo para una re-movilización de cada uno, con el acostumbrado "pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad", que no es sino la lógica del que no puede hacer otra cosa y no puede sino encontrar una dimensión existencialmente atractiva en la sola propia vida cotidiana, profesional y familiar.
Que los diez años no habían pasado en vano está bien ilustrado por la aparición del ensayo sobre "El Arqueofuturismo" (París 1998, L'Aencre, 12 rue de la Sourdière) (8), que en trescientas páginas diseña un balance comprensivo de treinta años de debate político y cultural europeo, de la sociología de la concertación a la política y el significado cultural del deporte, del cine y la música a la genética y la homosexualidad, de la inmigración y la globalización a los modelos económicos, la religión y la ecología, para concluir con una "novela" arqueofuturista que constituye una sugestiva continuación al prólogo de "El Sistema contra los pueblos": si entonces se trataba de una figuración, durante una época considerada "paradójica", de cómo el mundo estaba en efecto a las puertas de su transformación con la victoria mundialista, ahora se trataba de la descripción de un mundo inversamente transformado en un escenario "arqueofuturista", en donde también tenía su pequeño puesto un… descendiente directo mío en la Milán del año 2073.
Como siempre, la mirada penetrante de Faye diseña nuevas pistas ya antes batidas, une lo impensable, despedaza los ídolos y los tópicos del pensamiento hegemónico, combate el conformismo… del pensamiento anticonformista, ayudando a cada uno de nosotros a pensar hasta el fondo todo aquello que ya piensa. La ruptura con la Nueva Derecha, de cuyas experiencias diseña un balance equilibrado y al margen de toda lógica de resentimiento personal que pudiera tener miles de justificaciones, hace ahora más libre el análisis tanto de las tendencias dominantes (respecto a las cuales destacan las cautelas del "political correctness" presentes en tantos escritos del movimiento) como de las carencias del mundo que ha buscado defenderse y afirmarse en oposición a ellas, desde el redescubrimiento de las identidades regionales a la defensa del cine nacional desde una oposición política militante.
"El Arqueofuturismo" fue continuado, por la misma editorial, por una reedición corregida y aumentada" del ya citado "Nouveau discours à la Nation Européenne", seguido a su vez por "La colonisation de l´Europa – Discours vrai sur la Colonisation et l´Islam" (9), que representa uno de los más interesantes estudios publicados en materia de política demográfica, inmigración y colonización de nuestro continente.
Decimos "estudio" para subrayar el grado de profundización, pero también insólito en cuanto al argumento y el trato. Aunque no será ciertamente una sorpresa para los lectores que conozcan al autor, es necesario precisar que las intenciones del libro no son precisamente "inocentes".
"Son muchos los que intentaron disuadirme de escribir este libro. Me avisaban con argumentos del tipo: No es necesario decir las cosas como son. Es peligroso, ¿Entiendes? Hubieras podido escribir un ensayo ilegible y pseudofilosófico, o vagamente sociológico, sobre las virtudes comparadas de la asimilación, la integración y el comunitarismo. Pero el intelectualismo burgués no me interesa (…) La apuesta de la disidencia es hoy la más fecunda. Ésta es la del pensamiento radical… Se trata de retornar –lejos de todo extremismo– a las raíces de las cosas, y atacar las cuestiones fundamentales de la época. No se debate del sexo de los ángeles cuando los bárbaros asedian Constantinopla. Ahora bien, la cuestión principal de la época es la más visible y a un tiempo la más clandestina, aquella de la que todos hablan pero que no es abordada sino con medias palabras y en voz baja, es decir la colonización demográfica que sufre Europa por parte de los pueblos magrebíes, africanos y asiáticos y se acompaña con una empresa de conquista del suelo europeo por parte del Islam. No es una curiosidad política, es un advenimiento histórico clamoroso, sin precedente alguno en la historia europea por mucho que queramos alargar la memoria. Se trata ante todo de tomar acto, de desvelar a las conciencias este hecho capital. No para admitirlo ni para mejor "convivir", sino para rechazarlo y abrir el debate sobre la manera de combatirlo e invertir su marcha (…) Es urgente. La casa está en llamas. No se trata de hacer folklore, ni de insultar, ni de profundizar en delirios odiosos, ni de un racismo de portería. Se trata de afirmar. De afirmarse con rigor y con determinación y defender el derecho imprescindible de los europeos a continuar siendo ellos mismos, un derecho que se les niega mientras le es reconocido a todos los otros pueblos del mundo… El tiempo de las prudencias metapolíticas ha terminado". Y el autor concluye: "En este libro preconizo la guerra civil étnica y apelo a la Reconquista".
Podemos continuar. El libro contiene gran cantidad de datos, anécdotas, análisis, refutaciones, puntos que desenmascaran la censura de desinformación del Sistema sobre el tema, que denuncian la gravedad calamitosa de las consecuencias socio-politicas y socio-económicas que se anuncian, poniendo en vereda las ilusiones de controlar el fenómeno y las "ilusiones" prefabricadas sobre las cuales debate la "política politicante".
Contiene también numerosas provocaciones, fecundas y desalentadoras también respecto a ideas o temas dados por descontado entre los opositores al mundialismo. Leemos, por ejemplo, respecto a los pueblos del Tercer Mundo: "No somos nosotros quienes han "destruido sus culturas", como pretenden los defensores –en el fondo rousseanianos y adeptos del mito del buen salvaje– del etnopluralismo, ya sean de derecha o de izquierda. ¿Después del paso de los europeos, las culturas árabe, índia, china, africana, etc., se han cancelado y desaparecido? Para nada. En realidad han quedado mucho más vivas y mucho menos occidentalizadas y americanizadas que las pobres culturas europeas". O aun más: "En general, el pauperismo de muchos países del sur del mundo no es la consecuencia del colonialismo o del neocolonialismo, sino de la incapacidad de hacerse cargo de sí mismos, aun cuando posean inmensos recursos naturales. También yo he pensado que el colonialismo europeo era cínicamente responsable, por gusto del beneficio, del pauperismo del Tercer Mundo. Es una visión intelectual que abandoné hace tiempo".
Otra tendencia de un cierto fenomeno en Italia, de la cual el libro hace sumariamente justicia, es aquella que Faye había liquidado junto a la Nueva Derecha de los inicios de los años ochenta, pero que ahora resurgía a caballo de su involución neotradicionalista. Hablamos de la tendencia a afirmar la existencia de una Tradición fundamentalmente unitaria, metacultural y metarracial por cuanto metafísica, de la cual Europa habría participado en el pasado, "paritariamente" (según el Evola de postguerra), o "parasitándola" del Oriente (como dice Guénon), y cuyos vestigios sobrevivieron eventualmente en otro lugar. Es obvio que el "antimodernismo" de tales corrientes no es en absoluto suficiente para fundar teóricamente una praxis política y metapolítica de oposición a la globalización. En conjunto, no representan sino una variante "invertida" del progresismo linealista, universalista y homologador del Sistema, en la común indiferencia a las tradiciones concretas y plurales y a la conservación y desarrollo de las identidades irreductibles de las cuales está compuesta la especie humana, indiferencia fundada sobre una supuesta "unidad trascendente de todas las religiones", así como de todas las razas y culturas (que representarían, a lo sumo, grados diversos en una jerarquía de valores comunes, o de decadencia irresistible).
Aún más. Faye es muy claro en reivindicar los límites de la tolerancia "politeísta" al Otro-en-sí, límites por lo demás bien presentes también en la reacción de la romanidad más conservadora y menos decadente, de Nerón a Celso y Juliano, contra la intolerancia y el sectarismo de importación medio-oriental que habia llegado para pervertir la identidad etno-cultural del Imperio. Sobre un plano más político, otro tema subyacente a todo el texto contenido en "La colonización de Europa" es la implícita visión identitaria que hace forzosamente diferentes las naturalezas de los movimientos migratorios internos, intraeuropeos, y la colonización por parte de las poblaciones foráneas.
Es este un aspecto que merece ser resaltado en nuestro país (Italia), donde los obispos predican la inmigración de asistentas y trabajadores filipinos, "bravos católicos", y donde todo transexual mulato brasileño encuentra trabajo rápidamente en las calles tras desembarcar con un visado de turista en cualquier aeropuerto nacional, mientras las raras "exhibiciones de fuerza" del régimen son reservadas a croatas, albaneses, búlgaros, yugoslavos, rechazados de cuando en cuando al mar con sus mujeres e hijos, concentrados a la Pinochet en los estadios por orden del ministro del interior, ¡mientras su gobierno discute la admisión en la Unión Europea de Israel y Turquía!
Los mismos procesos lingüísticos en uso tampoco son inocentes. La imposición por parte de los "media" y del lenguaje burocrático del término "extracomunitario" (término nunca aplicado a los suizos o americanos, y que en sustancia significa "de color") es absolutamente elocuente de la tentativa de acreditar una pretensión común de pertenencia económico-comunitaria y promover una "solidaridad" implícita, pongamos por caso, con un jamaicano de ciudadanía británica o con un nacional de religión judaica, en contraposición a la pretendida "extrañeidad" nacional de un húngaro o de un croata. También esto sirve para negar y dividir la identidad europea, facilitando su fagotización. Por lo demás, el libro de Faye es sobre todo una invitación a la reflexión, a la toma de posiciones y al debate. "Las tesis que sostengo no son dogmas. Llevar el debate hasta las cosas esenciales, electrizar las consciencias, éste es mi único objetivo. Soy un provocador. Informaos sobre la etimología latina de este término".
Por ello recojo la invitación del autor continuando un diálogo personal y a distancia que dura ya, al menos, veinte años, tomando posiciones sobre algunas de las cuestiones por él levantadas.
Un punto sobre el cual Faye, yo, y lo que resta de la Nueva Derecha estamos absolutamente de acuerdo es en la crítica y el rechazo del asimilacionismo, o del denominado "racismo integracionista". La procedencia francesa de la más fuerte denuncia de esta tendencia, sea en sus formas explícitas y conscientes como en sus formas latentes, es más que significativa. Francia es, en efecto (aunque en medida menor que los Estados Unidos) la patria de elección de la ideología integracionista más dura. Ideología abstracta, irrealista, que prolonga el monoteísmo político del jacobinismo y encuentra su mismo origen en la Francia de los Cuarenta Reyes, de la Revolución y del rechazo al modelo imperial, a favor tanto de la negación tanto de las realidades políticas, étnicas y culturales supraordenadas, como de las mismas nacionalidades diversas alojadas en el "Hexágono" francés, reprimidas y canceladas durante ochocientos años con una dureza y sobre todo con una tenacidad que ha tenido pocos iguales en Europa.
Tal tendencia se refleja inmutable en la política y la cultura colonial francesa, aunque otros colonialismos no han sido inmunes. Pero el italiano o el alemán, por ejemplo, estaban poseídos por la idea de expansión imperial, y el anglosajón era en el fondo la expresión de un instrumento mercantilista de una clase de aventureros que marchaban de sus comunidades locales para recrear caricaturas periféricas e impermeables de la sociedad inglesa en la jungla de Borneo o en la sabana africana. Francia, sin embargo, devino el escenario de los prefectos, de los burócratas y de los gendarmes encargados de la administración de los territorios y dominios de ultramar según el modelo centralista del Estado-nación, con su séquito de instructores que enseñaban a los pequeños senegaleses a repetir en coro: "Nuestros antepasados, los galos, eran altos y rubios" ("Ils étaient grands, ils étaient blonds, nos ancétres, les Gaulois"), y a apreciar las virtudes republicanas.
Esta tendencia, más difusa en su versión "humanitaria", "misionera" y "redentora", habita todavía profundamente, en su versión "dura", también en el espíritu de cierta derecha francesa, especialmente gaullista (por ejemplo, Charles Pascua o Alain Griotteray), gracias a una claramosa afirmación del principio sacrosanto según el cual un pueblo no es (sólo) una raza, sino sobre todo un proyecto común al que cualquiera -- independientemente de su origen étnico -- puede unirse. El "asimilacionismo forzado" no es tampoco extraño a ciertos ambientes italianos que se declaran de algún modo antiimigracionistas o, como mínimo, favorables a un control de la inmigración, particularmente a algunos componentes del ambiente legista.
La variante práctica y menos intelectualmente pulida de esta inclinación corresponde, por lo demás, a las versiones pequeño-burguesas y "de derechas" de la nostalgia de "un" proletariado, sea cual sea, del cual se siente evidentemente su ausencia. ¿Cuántas veces hemos oído decir: "El huésped debe respetar las reglas de la casa", o "No tengo nada contra los inmigrantes, siempre que respeten las leyes / hablen nuestra lengua / hagan un trabajo honesto / se comporten como los demás / no sean molestos / hagan la comunión todos los domingos / se vistan como nosotros / se comporten como "personas civilizadas", con segundas intenciones más o menos alucinatorias sobre la posibilidad, mejor dicho el derecho, de convertir al inmigrante extra-europeo en alguien "como nosotros", pero deseablemente más gentil y amable, dispuesto a trabajar en el mercado negro, a bajo coste y a tiempo indefinido, a prestarse para realizar "los trabajos que los europeos ya no quieren hacer"?
Al contrario, la realidad nos dice que el asimilacionismo solo puede funcionar al límite únicamente con minorías demográficamente insignificantes y étnicamente próximas. Pero en el resto de los casos no es sino una vía acelerada hacia el mestizaje cultural, también para los "asimiladores", y a la perdida brutal de la identidad de los inmigrados, de sus pertenencias y reglas comunitarias y, necesariamente, hacia una militarización creciente de la sociedad, ya que la integración forzada, cuando no es causa de una definitiva destrucción de la identidad de los ingredientes (de los alógenos y de los autóctonos), solamente puede ser mantenida por medio de una presión constante, sustancialmente policíaca.
Partiendo de los grupos espontáneos que se forman según el orígen en las aulas escolares hasta la composición del panorama urbano, los grupos etnoculturales tienden sin embargo a separarse como los componentes de una emulsión de agua y aceite, hasta el punto en que, cuando los "blancos" devienen ya irrelevantes, explota la rivalidad étnica, ahora con mayor intensidad, entre los etíopes y los egipcios, los nigerianos y los senegaleses, los cubanos y los puertorriqueños. Un famoso cómic de Lauzier muestra una mujer blanca de la periferia parisina, siendo entrevistada por un periodista de "Le Monde" sobre el racismo: "Ah, sí. Tenemos un grave problema en nuestro barrio con la intolerancia entre los bantúes y los mandingos… ¿Cómo dice? ¿Con los franceses?. No. Nadie nos hace caso, somos tan pocos…"
La misma particular crueldad de la guerra de Argelia refleja, por lo demás, la intolerancia y la incomprensión jacobina de los motivos por los cuales algunos "franceses" de ultramar pudieron, llegados a un cierto punto, tener ciertos motivos para rebelarse y traicionar a la "patria", puesto que la piel, la religión, usos, lengua y geografía no eran sino accidentes privados de peso en la visión idealista, abstracta y burocrática de la patria del gobierno francés de la epoca.
Un equivalente contemporáneo de la ideología colonialista de modelo "francés" es la idea, ya no inaudita en Italia, ya no sólo en los ambientes legistas, sino ahora también presente entre el electorado de "Alleanza Nazionale" (10) y de los partidos católicos del Polo, de acoplar un eventual y veleidoso "control" o "limitación" de la inmigración con la nacionalización forzada de los inmigrantes y de las poblaciones étnicamente extrañas que han adquirido ya la ciudadanía, a base de peticiones populares contra la edificación de mezquitas, del monolingüismo obligatorio o de la prohibición del uso del chador (hasta el punto de poner en cuestión la tolerancia de siempre hacia las monjas católicas). Actitudes que reproducen exactamente tanto la represión centralista tradicional contra las minorías autóctonas –especialmente en Francia (como bien saben corsos, vascos, bretones, normandos, occitanos…), pero también en nuestro propio país (caso del Tirol Sur)– como el tipo de ideología "colonialista" antes descrita, que en este caso sería aplicada a una especie de "re-colonización" puramente ideológica, prescindiendo del elemento etnodemográfico… del propio territorio nacional, y/o de la "mano de obra" cuya importación ha sido ya diseñada.
Así, al contrario que en la perspectiva "imperial" diferencialista, italo-alemana", en la perspectiva del "racismo asimilacionista" francés, la hibridación y el mestizaje no son solamente irrelevantes, sino incluso fenómenos positivos en cuanto conducen, en tal visión, a la "absorción" y a la "conversión", ayer del "colonizado", hoy del inmigrante, hasta transformarles en "ciudadanos" de la "república". Ahora bien, es fácil notar que tal punto de vista no es sino la versión "nacional", "politizada" y autoritaria de la globalización y homogeneización planetaria impuestas por el Sistema, tal y como la revolución francesa y Rousseau fueron las versiones locales de la revolución americana y de Locke, respectivamente.
Esta actitud es ciertamente "racista", en cuanto toma en cuenta la identidad cultural y étnica del Otro para abolirla e integrarla en un modelo propio, pero no tiene nada que ver con el pensamiento identitario europeo (ni africano, japonés, etc.). La demostración de la absoluta confusión mental que reina al respecto es la dada por las definiciones en términos de "limpieza étnica", con referencias más o menos explícitas al nacionalsocialismo (!) de la supuesta política de violaciones en masa desarrollada en Yugoslavia, cuyo resultado en términos procreativos, obviamente, no podía sino ser diametralmente opuesto a cualquier objetivo de defensa o "purificación" de la identidad étnica de los violadores. Aquí, ahora, nos encontramos entre grupos que, entre fuertes rivalidades históricas, y por ello entre una inevitable acentuación polémica de las diferencias existentes, viviendo en la misma región durante siglos, y presentando durante siglos un fuerte cruce de componentes políticas, lingüísticas, genéticas, religiosas, etcétera, que no tiene nada que ver con la hipotética convivencia, viviendo en los mismos barrios y en los mismos edificios comunales, con poblaciones provenientes de todos los posibles extremos del espectro ofrecido por la especie humana y por la geografía.
Así, el asimilacionismo "de derechas" aún piensa en celebrar sus propios complejos de superioridad en el intento de forzar a los inmigrantes (que creen poder importar "por encargo", según las necesidades coyunturales del momento) a convertirse en… caricaturas de los europeos, con la idea de tener una propia reserva de esclavos a su pronta disposición; exactamente como el asimilacionismo católico-comunista (11), en el fondo, contempla con buenos ojos la inmigración en su idea de convertir a los extraeuropeos a la democracia, al humanitarismo y a las religiones locales, con la idea de tener a su disposición una buena masa de desarrapados que puedan cambiar la vacilante fortuna de sus estructuras militantes.
Es casi inútil revelar cómo, en el mejor de los términos, los resultados son contrarios a los esperados por los mismos aprendices de brujo, puesto que el intento de asimilación forzada de importantes flujos migratorios fuertemente heterogéneos genera en realidad, aun más que la política "multicomunitarista" de la sociedad a manchas de leopardo sobre la cual hablaremos, costes sociales (y también, al final, costes económicos) espantosos, odios y enfrentamientos raciales, así como sociedades depauperadas, policíacas, asustadizas, híbridas, perdidas, confusas, violentas, en las cuales no tienen un gran peso los intereses de la burguesía blanca ni los valores "biempensantes", y en las cuales la política se transforma en una cuestión de simple pertenencia de tipo tribal.
La explosiva situación francesa de nuestros días reproduce por lo demás, "mutatis mutandis", el profundo cambio verificado en los últimos veinte años en el país que hizo del "melting pot" su mismo mito de fundación: los Estados Unidos de América, en donde las mismas "minorías", o menor los componentes étnicos menos favorecidos, tienden a re-ghettizarse, recreando comunidades homogéneas en difícil convivencia o en abierto conflicto con sus vecinos, dotadas con una vida social propia, civil y religiosa, con una propia economía local más o menos en los límites de la legalidad y la ilegalidad, con sus propios líderes, etc.; y en las cuales la "integración" tiende, cuando no al nivel del mero discurso teórico, a refugiarse en las provincias declaradas como "zona franca" y en las instituciones comunes, como las fuerzas armadas, los "show-business", el deporte profesional, etc., antes que permear la vida cotidiana de las masas de población.
Con algunas significativas diferencias, que Faye es el primero en recordar. Primera entre todas: que los Estados Unidos, a diferencia de los países europeos, se han dado forma a sí mismos a partir del rechazo colectivo de la identidad y de las pertenencias orgánicas (también aunque, como se ha dicho, reemergen constantemente), rechazo que constituye la misma razón de ser de un país que goza de recursos y espacios inmensos no sólo en sentido geográfico, espacios donde poder difuminar las comunidades étnicas, religiosas, etc., y donde pueden permitirse, al menos fuera de los grandes conglomerados urbanos, unas condiciones de relativa segregación; un país donde la naturaleza compuesta de su base social ya conoce una inmigración, legal o clandestina, fuertemente limitada y organizada sobre la base de un sistema de cuotas, y no una invasión salvaje de desesperados alógenos; un país, en fin, cuyo poder de "reducción" y de "control" de la identidad por parte del Sistema es el más eficaz del mundo, gracias en parte a los enormes medios que dispone el poder local, y gracias también a su dominio sobre el resto del mundo.
Por no mencionar el hecho de que la sociedad americana es mucho más brutal y pragmática (cosa por cierto normal para una sociedad de "pioneros", o cuando menos de sus herederos) frente a todo cuanto nos gusta pensar, o sea tolerar, en Europa. Con un sistema judicial ciertamente en mucho sentidos más "garantista" que el nuestro, el ciudadano americano convive perfectamente no tanto con una pena de muerte rara y tardíamente aplicada sobre todo por costosa (los gastos por los procedimientos relativos se cuantifican en varias decenas de miles de dólares por cada ejecución), sino mucho más concretamente con una población carcelaria en proporción diez veces superior a la italiana o la francesa, con un derecho penal basado en penas elevadísimas, y con métodos de control social –dada la inexistencia de una previsión digna de este nombre en lo relativo al comportamiento práctico sobre el territorio de los "vrai law enforcement officers"– cuando menos sospechosos para nuestros actuales "standards".
Igualmente es digna de mención la crítica radical de Guillaume Faye a las posiciones respecto a los problemas consecuentes de la colonización de Europa por la Nueva Derecha actual, cuyos exponentes, hoy, como alternativa a la entropía socio-cultural y a la desnaturalización de la civilización europea, proponen el fantasioso escenario de una sociedad multiétnica y comunidades diferenciadas, cada una de ellas enraizada en la propia identidad específica, ¡sobre… territorio europeo!
Así, la revista "Eléments" (n. 91, 1998) publicó un dossier titulado "El desafío multicultural", con una mujer magrebí velada en la portada gritando con megáfono frente a la sede de la CRS (policía francesa) en claro disturbio de orden público. Tal "dossier" está perfectamente citado en "La colonización de Europa", en donde las críticas van dirigidas sobre todo al título, pero no sólo.
Ya la palabra "desafío" dice el autor, sugiere que la inmigración en masa, la colonización demográfica que sufrimos, sea un desafío a aceptar, un dato al cual hacer frente para adaptarse. "Esto es fatalismo y etnomasoquismo. Es más, ¿por qué decir "multicultural" cuando el problema es multirracial y multiétnico? ¿Por qué cancelar esta dimensión antropo-biológica y religiosa de la inmigración, cuando nos encontramos frente al arribo masivo de poblaciones radicalmente alógenas y de un monoteísmo teocrático, el Islam, y no frente a la aportación "arriesgada" de "nuevas culturas", como infelizmente sugiere "Eléments"?
Esta actitud conduce objetivamente a travestir la realidad volviéndola neutra, "simpática", aceptable, a hacer pasar una colonización agresiva por una presencia pacífica y fraterna de "otras culturas". Se llega así a la afirmación del discurso de la izquierda y del episcopado francés: la inmigración sería una riqueza (cultural, etc.) para Europa. "Encuentro un pecado que los intelectuales de la Nueva Derecha actual hayan caído en semejante trampa. Como si el multiculturalismo no fuese ya una riqueza europea autóctona, como si tuviésemos necesidad imperiosa de afromagrebíes y musulmanes… para enriquecer nuestro natural pluralismo de identidades entre los europeos"
Según el editorial del número en cuestión de la revista, "como todo fenómeno postmoderno, el multiculturalismo… busca conciliar la memoria y el proyecto, la tradición y la novedad, lo local y lo global; representa una tentativa de sustraerse a la homogeneización institucional y humana" realizada por el Estado represivo y terapéutico. El multiculturalismo y el "comunitarismo" (en el sentido de promoción de la constitución y mantenimiento de comunidades diferenciadas por razones de pertenencia) podrían así "facilitar la comunicación dialogadora y por ello mismo fecunda entre grupos claramente situados los unos respecto de los otros", y ofrecerían "la posibilidad, para aquellos que lo auspician, de no deber pagar su integración social con el olvido de sus raíces". Ahora bien, se pregunta Faye: ¿pero porqué deben afirmar sus raíces aquí, entre nosotros?
Ante un relieve tan obvio, reforzado por la fácil constatación de que ningún país europeo, incluyendo a aquellos con fuerte emigración, sueña con consentir a otros pueblos, constituidos como tales, intentar nada semejante sobre el propio territorio, podemos añadir que tal visión, por mucho que pueda aparentar ser "moderna", "realista", "constructiva", "sin prejuicios", resulta en realidad fatalista, conservadora y, sobre todo, perfectamente irreal. A toda inmigración corresponde necesariamente una emigración, que empobrece, destruye y altera los equilibrios naturales y las tradiciones de la cultura de procedencia, tanto en el país abandonado como obviamente aun más en la población que se transfiere. Con toda la simpatía por los esfuerzos de los emigrantes italianos para conservar una identidad en los países de acogida, no creemos que nadie pueda probar nostalgia por los países vaciados y abandonados a los viejos, los criminales, los parásitos, o por las parodias de "sociedad italiana" recreadas en las varias "Little Italy" que viven entre la tentación de integrarse y la tenaz conservación de hábitos privados de un significado que no sea puramente folklórico.
Por no hablar de la estaticidad de una tal visión, que no toma en cuenta los flujos aun en acto y su potencial capacidad de expulsar de su territorio a las poblaciones autóctonas, desde el punto de vista físico, demográfico y político. Faye cita a este propósito el ejemplo de Kosovo, cuna de la nacionalidad serbia y convertido objetivamente en albanés a pesar de los esfuerzos del régimen de Belgrado; pero tal ejemplo no nos parece apropiado, pues se trata de fenómenos que permanecen en un lugar en cierto modo superficial, puramente político o, a lo más, lingüístico. Un ejemplo más adecuado de aquello que la "sociedad multicultural" puede aportar a Europa sea quizás el aportado por la "enriquecedora" inmigración extra-americana a los nativos de América del Norte. ¿Acaso los amerindios no gozan de una sociedad "multicultural"? Sí, pero solamente si por tal definición entendemos la supervivencia de cuatro alcohólicos fumando el calumet para gozo de los turistas de la reserva, cuyos hijos hablan exclusivamente inglés en un 95% y expresan su propia identidad mediante el deseo de ingresar, en la escuela, en una banda de pandilleros puertorriqueños o chinos. Esta perspectiva, que según "Eléments" conciliaría "la memoria y el proyecto", no ofrece ningún espacio ni a la primera ni al segundo.
Ciertamente, es más "trendy", y también demagógico (al menos entre los mismos inmigrantes y los intelectuales de la "political correctness"), "tomar nota" del pretendido carácter "irreversible" de la repoblación ya en marcha, y hasta del fenómeno migratorio todavía en curso, y estudiar "soluciones" a partir de este dato.
La solución propuesta por la Nueva Derecha es por otra parte, en sus últimas consecuencias, exactamente aquella antes combatida bajo los nombres de Sistema, americanización, mundialismo o globalización. El desarraigo territorial, la proletarización, el despedazamiento de todos los lazos comunitarios e identitarios en los aspectos que cuentan verdaderamente (el Estado-nación, el pueblo, la región) encuentra una compensación puramente virtual, consoladora y consumista a nivel de parroquias, "reservas", escuelas para extranjeros, ghettos para emigrantes de similar procedencia, etc. Todo esto no es ni siquiera el modelo americano, donde existen comunes valores federales, como no sea en negativo; es más bien el modelo del apartheid, del "desarrollo separado de las culturas" de la memoria sudafricana, que no resultó demasiado bien para ninguna de las culturas implicadas, salvo quizás para los intereses de los círculos especuladores anglo-hebreos; es el modelo que de seguro no goza de ninguna buena prensa en Europa y en el Tercer Mundo, si ésta fuese nuestra preocupación principal.
No se puede eludir esta realidad haciendo poesía. Leemos nuevamente en "Eléments": "En los últimos treinta años, el mundo ha entrado en una nueva era marcada por la diseminación y la reticulación: las pirámides ceden el puesto a los laberintos, las estructuras a las redes, lo vertical a lo horizontal, los territorios a los flujos". La inmigración no sería sino un fenómeno postmoderno, parte de un proceso mundial, aceptable e ineludible, al cual sería ilusorio y reaccionario oponerse. Pero, sorprende que los autores del dossier eludan que tales ideas resultan impregnadas de determinismo y de un fatalismo en verdad sorprendente en un movimiento intelectual fundado en torno al rechazo de las visiones lineales, deterministas, providencialistas o progresistas, de la historia.
Como apunta Faye, esta visión traduce por lo demás una falta de perspectiva geográfica e histórica (el fenómeno en cuestión, a diferencia de la "globalización", contra la cual sin embargo se continúa combatiendo, no afecta a una escala global; y la experiencia del pasado es rica en ejemplos de intensos cambios que han conducido a la destrucción de la identidad y del tejido social de los protagonistas relativos). Ahora bien, por "anticolonialismo", este aspecto caleidoscópico, esta naturaleza reticular del mundo contemporáneo, parece atribuir un derecho de repartición y colonización del territorio y de la sociedad exclusivamente a las poblaciones extraeuropeas empujadas a transferirse entre nosotros, lo cual cuando menos es difícil de justificar. En fin, después de tanto hablar de "comunidad y sociedad", este discurso comporta la renuncia a ver realizada en Europa y en los singulares países que la componen una verdadera estructura comunitaria y orgánica, en favor, mas bien, de la implantación sobre nuestro territorio de una "sociedad multirracial de comunidades" más o menos utópicamente confederadas por un contrato social basado sobre puros intereses comunes.
Este género de tesis nace en realidad de dos errores. La primera, una deriva y un equívoco de fondo de carácter ideológico. "Se comienza", comenta Faye, "por defender con justo derecho una concepción politeísta de la sociedad contra el universalismo asimilador, el centralismo jacobino, el republicanismo igualitario que niega la comunidad orgánica y las diferencias en beneficio de un individuo abstracto, simple consumidor desarraigado y "ciudadano" desencarnado. Esta visión se opone al modelo americano (y francés) de Estado, cuyo "crisol" pretende homogeneizar los pueblos en una masa nacional eventualmente animada por un patriotismo abstracto, y en la práctica por valores cosmopolitas". Esta visión, sin embargo, intentaba en sus inicios una defensa de la identidad de los pueblos europeos contra el centralismo de los estados-nación primero, y contra el universalismo mesiánico y tecnocrático del Sistema después, que intentan eliminar las diferencias y las pertenencias; es una visión, sí, "plural", pero étnica y arraigada. Más tarde se desvía: el principio del etnopluralismo es exagerado, pervertido. Se olvida la noción de proximidad étnica. Se ponen en un mismo plano las sacrosantas reivindicaciones autonomistas de los bretones, los tiroleses, los escoceses, los vascos, los corsos o… los italianos del norte –reivindicaciones centradas en gran parte sobre el mantenimiento del control económico y estructural del propio territorio contra la amenaza de colonización– y la creación, nada más y nada menos, de espacios de contrapoder de comunidades inmigrantes instaladas sobre nuestro territorio.
Llegamos así al punto en donde Charles Champetier, siempre en "Eléments", llega a escribir: "En una sociedad pluriétnica, las culturas no deben ser solamente toleradas en la esfera privada, sino reconocidas en la esfera pública, en particular bajo la forma de "derechos colectivos" específicos de las minorías." Buen cuadro, en verdad. Si la difusión de tales tesis se extendiese improbablemente tanto a los ambientes de la inmigración como a nosotros los europeos de origen, una vez convertidos en minoría podremos (quizás) continuar regulando nuestros asuntos internos. Eso o simplemente extinguirnos, después de haber debidamente colaborado, con nuestro ejemplo de borregos, a la occidentalización y al suicidio cultural de los mismos inmigrantes. Y no esperemos que la tolerancia, o incluso la promoción, del poder de la comunidad inmigrante sobre sus propios miembros tenga efectos limitados sobre los desvíos criminales de éstos últimos. Las experiencias históricas de "política de ghetto" demuestran que tales expectativas son completamente utópicas.
Igualmente, el reclamo hecho a propósito por la actual Nueva Derecha al modelo imperial, al politeísmo político y al "derecho a la diferencia" un poco incoherente. Se trata, muy al contrario, de rechazar con la inmigración la reducción forzada de las diferencias y de las pertenencias arraigadas y plurales, impuesta por un monoteísmo práctico (el universalismo de los Derechos Humanos y del indiferentismo trámite de la folklorización, que en parte camina también con las piernas de los monoteísmos religiosos, en particular de variante islámica), desnaturalización niveladora que representa exactamente la negación de tal "politeísmo".
Particularmente mal elegido resulta en particular el ejemplo del Imperio romano, cuando precisamente la Nueva Derecha ha subrayado tantas veces las consecuencias de su trágica inclinación, a pesar de los ocasionales sobresaltos de conciencia, al considerar superficialmente al dios judeocristiano "un dios como tantos otros" y al concederle apresuradamente la ciudadanía.
Una segunda componente, casi más psicológica que ideológica, de este tipo de posiciones es la desesperada convicción de que la presencia de comunidades organizadas, tradicionalistas y antioccidentalistas sobre nuestros territorios limita el mestizaje (una especie de "confianza en el racismo de los otros") y pueda por ello inducir a los europeos a redescubrir, por contraste y por imitación a un mismo tiempo, la propia identidad.
Tal convicción no tiene ningún fundamento real. Ante todo, una componente significativa de la inmigración mira decidida y espontáneamente hacia la integración, y los matrimonios mixtos, por lo demás de media poco estables, se intensifican inevitablemente, así como se pervierten las lenguas y se alteran las costumbres. El mismo improponible sistema indio de las castas, trágica tentativa de una ínfima minoría conquistadora de no ser reabsorbida por las poblaciones conquistadas, muestra el inevitable fracaso de las políticas de este género; pero además, aquí no estamos frente a una comunidad estable, sino ante un aluvión migratorio incontrolado, aun en acto heterogéneo incluso desde su propio interior y poseedor de una dinámica demográfica superior a la de las poblaciones autóctonas.
En cierto modo, esta posición se asemeja a la postura puramente defensiva del extremismo "blanco" y boer sudafricano, que al final del régimen no apoyó sin embargo al gobierno "nacional", alegando: estamos aquí desde ocho o diez generaciones, somos una minoría; ¿en qué somos diferentes de los zulúes? Hagamos como ellos y transformémonos en una tribu celosa y custodia de los propios intereses colectivos, en competición con las otras tribus, en lugar de hacernos cargo de todos los "problemas" y del gobierno de la sociedad. Un nivel de replegamiento que, en la Europa contemporánea, parece todavía francamente excesivo.
Por lo demás, los inmigrantes que rechazan la asimilación suelen ser radicalmente antieuropeos –y por ello reclaman polémica y propagandísticamente temas identitarios con fines de su propia afirmación como grupo en nuestra sociedad, sea de forma política, intelectual, mafiosa o pandillera de barrio– sin necesidad de ser por ello antioccidentales en sus comportamientos y en sus valores prácticos.
La cosa está más que demostrada por los poquísimos deseos que muestran de retornar a sus lugares de origen –cuyos estilos de vida y cuyas reglas, especialmente para las mujeres, los jóvenes y los intelectuales, les resultarían ya inaceptables– también una vez que eventualmente han "hecho fortuna", y es por ello que cesa la ayuda del "hambre" cantada por los inmigracionistas. La reivindicación de cuotas de reserva, reclamada a la administración pública especialmente por los musulmanes, no se acompaña sin embargo sino muy raramente por la aspiración de retornar a unos países donde la libertad de palabra es desconocida, el consumo de alcohol está prohibido, el clítoris es considerado un inútil ornamento del cual es preciso librarse, y el robo está castigado con la amputación al término de los procesos sumarios.
Además, el "hambre" en sentido literal es un factor del todo secundario en la nueva trata de esclavos suscitada por el sistema, como demuestra el hecho de que la inmigración procedente de los países cuyas condiciones de vida son objetivamente peores es más modesta respecto a aquellos relativamente acomodados, en donde el modelo consumista puede cómodamente agitarse bajo la nariz de las masas, y donde sin embargo pueden generarse más fácilmente conflictos sociales y culturales entre las rutilantes imágenes difundidas por los televisores vía satélite y una realidad local no sólo más austera, sino también bajo el fuerte control social de los modos de vida tradicionales.
Una variante aun más implícita, o quizás más inconsciente, de estas convicciones "multiculturalistas" es la tácita esperanza de que, en la instauración del caos étnico-religioso, en el fallecimiento del orden social, en la atribución de derechos colectivos a las "tribus" que compondrán la sociedad europea, podría existir una posibilidad para las minorías "incorrectas", por ejemplo antiigualitarias y "fascistas", de ser "dejadas en paz" o incluso autorizadas, en el cuadro del caleidoscópico "patchwork" multicultural, a autoconstituirse o autorregularse en alguna medida como "comunidad" a la par con las otras, e idealmente con la oportunidad de devenir en polo de atracción y/o encarnación residual de la "tribu europea".
Esta idea, naturalmente, representa la renuncia a todo sueño de "Grosse Politik" y la aceptación del modelo, no por casualidad estadounidense, de los amish, o de los mormones hasta los años cincuenta, contentos de vivir recluidos en un ambiente delimitado donde pueden de algún modo poner en práctica sus ideas –pero en este caso sin ninguna Utah deshabitada a donde emigrar para escapar a las "contaminaciones". Y en efecto, en la mejor (y más improbable) de las hipótesis, la realización de esta esperanza conduce derecha al "sueño americano", donde todo puede ser dicho y donde… nada de lo que se dice tiene la menor importancia, excepto para tu pequeño grupo de "desplazados".
Naturalmente, todos estos discursos, en nuestro continente, no son otra cosa que fantapolítica propia de un cómic. No solamente faltan los espacios y la "cultura" para implementar un modelo de este género, sino que en los mismos ambientes de la inmigración, más allá de reclamos identitarios que en Europa aparecen como puramente demagógicos y "cortijeros", son completamente recuperados e integrados a la ideología dominante. La eventual mala fe con la cual sacrifican cada día ante el altar de los Derechos Humanos, del poder de las organizaciones internacionales como la ONU, del ecumenismo religioso (naturalmente sólo entre religiones "del Libro"), no tiene la más mínima importancia, puesto que otra "mala fe" puede ser también hipotetizada en los centros del poder mundialista, sin que esto cambie mínimamente los valores que hoy informan nuestra sociedad. La intolerancia hacia los valores realmente alternativos crece, nunca disminuye, con la instauración del caos étnico en nuestra sociedad, en donde la "political correctness" termina así por ser el único criterio de ciudadanía.
Cuando veamos por vez primera a un exponente de la inmigración alzar la voz en defensa de un detenido político europeo antioccidental, o a favor de las minorías étnicas autóctonas del país huésped, nos replantearemos nuestras dudas.
Pero hay más. Como apunta Faye, el "asimilacionismo forzado" es hoy en día un blanco polémico antes que una praxis real y coherente de los gobiernos europeos, que permanecen en realidad, en su sustancial inmigracionismo, presos y en poder de un comportamiento esquizofrénico entre la asimilación y el "etnopluralismo" propuesto como la gran alternativa a la primera. Tras una campaña contra la ablación femenina (hipócrita, cuando la circuncisión neonatal masculina judía es en nuestros países un dato adquirido que nadie osa poner en discusión…) y una protesta "verde" contra las matanzas de corderos en cualquier festividad musulmana, siempre son cada vez más numerosas las voces favorables a la adopción de sistemas de cuotas y de "affirmative action", financiación de las actividades culturales y religiosas de los grupos alógenos, etc., medidas todas típicamente comunitaristas (si, por decreto, las razas y las religiones "no existen", no tienen importancia, obviamente no tendría sentido atribuirles porcentajes y puestos).
Escribe Faye: "Ser corso, alsaciano, vasco, flamenco o bretón ya es tener pocas posibilidades de obtener subvenciones para una asociación cultural, una escuela donde enseñar la propia lengua y cultura, iniciativas que enriquecen el patrimonio étnico europeo; pero ser chino, cingalés, nigeriano y –sobre todo– árabe-musulmán es tener siempre atenta a la administración ante todas las solicitudes de financiación, tanto en París como en Bruselas. En París, las fiestas rituales asiáticas y los diarios "comunitaristas" son en parte costeados por la administración pública. La asociación de los Arvernos de París (12), como otras de vascos o bretones, por su parte, sólo pueden contar con sus propios recursos. El señor Tiberi, que sin duda olvida ser corso antes que gaullista o ciudadano del mundo, se niega a conceder ayudas a las asociaciones de enseñanza de la lengua corsa. Sería subversivo, ¿capite bene…? En compensación, los centros de enseñanza del árabe han recibido en 1998 la suma de 123 millones de francos, con el fin de poder dispensar gratuitamente sus propios servicios. En París, aprender el árabe o el chino es gratis. Aprender el holandés, el italiano o el bretón cuesta dinero".
¡Y así también en Londres, Milán, Madrid o Viena! La tolerancia que es la oportunidad concretamente ofrecida a los inmigrantes para practicar un contrapoder territorial real, con suspensión del ordenamiento jurídico ordinario, y la creación de espacios donde es tolerada la violación de casi cualquier norma, desde la ablación y la bigamia hasta el ejercicio de la actividad comercial; constituye un ulterior ejemplo de discriminación antieuropea, frente a la obsesión del control de todo detalle mínimo de la vida social que aun denotan las políticas nacionales y de la CEE, más allá de la retórica de la desregularización, y que continúa ejerciéndose con mano dura sobre las poblaciones autóctonas y sobre territorios aún no bajo dominio extrauropeo.
Las ideas de "gobernar la transformación", de "colocarse a la cabeza de los procesos para mejor guiarlos", de "afrontar virilmente la realidad", de cortar gordianamente los nudos de cualquier dilema en una síntesis superior, son perfectamente legítimos en muchos casos.
Pero al así obrar, uno corre el riesgo de aceptar los falsos alivios de la desmovilización, y de tomar posiciones históricas perdidas y de hecho conservadoras. Desde el dirigente belga resignado a convivir con Hitler "por mil años" relatado por Degrelle, a los ambientes diplomáticos alemanes convencidos de que el comunismo y la partición de Alemania eran "realidades que siempre habría que tener en cuenta", a los nacionalistas irlandeses que acusaban a Michael Collins de "aventurero irresponsable", muchos, después de haber ridiculizado o criminalizado como "utópicos" a los propios políticos rivales, se encontraron a la vuelta ridiculizados por la historia, sea en la esperanza de "convivir" con la realidad de su época y "controlarla", sea en la miope convicción de que tal realidad era el reflejo de datos de naturaleza eterna.
Ahora bien, "La colonización de Europa" es bien clara al afirmar que, una vez que se rechaza el inmigracionismo salvaje, etnomasoquista y suicida de los circulos más ligados a la ideología y a los intereses del Sistema, la alternativa no está entre el "control" y la "integración forzada" de la inmigración por un lado y la sociedad neotribal por el otro. La alternativa está entre la rendición a este proceso o la autodefensa étnica integral. Autodefensa que se sustenta en todas aquellas medidas y reacciones inmunitarias que la combatan en todas las zonas del mundo eventualmente amenazadas de repoblación y de colonización demográfica y cultural del propio espacio histórico y geográfico.
Esta "utopía" es todavía la realidad cotidiana del Japón, el cual, a pesar de una derrota, una ocupación militar y un pesadísimo condicionamiento político, vemos aun acompañado por un (puro contraste) proceso de occidentalización de los valores y una admirable capacidad de mantener y desarrollar la propia homogeneidad racial, la propia dinámica demográfica, la propia identidad lingüística y modelos socio-económicos originales. Ejemplos similares pueden citarse de la praxis y la mentalidad, obviamente más contrastada, de los países islámicos antioccidentales, de las dos Chinas, de las dos Coreas, de la India y, en verdad, si incluimos el punto de vista jurídico, de la mayor parte de las naciones del mundo, comenzando por los Estados Unidos e Israel, que bien se guardan de hacer aceptaciones pasivas e indiferentes de los posibles flujos de emigrantes en amenaza de su composición étnica, lingüística y religiosa.
Es por lo demás "irreal" e imposible –si no en sentido lógico o físico, si en sentido humano y político– que la pequeña zona del planeta coincidente con una porción de la península euroasiática, con recursos naturales limitados y explotados al máximo durante siglos, contaminada, actualmente (a pesar del declive demográfico) relativamente superpoblada, con delicados equilibrios sociales, política y económicamente "fracturada" por la subordinación a mecanismos y centros de poder internacionales, pueda ser el receptáculo de masas de desocupados y prófugos, de colonia de criminales, de comunidades heterogéneas, de odre de esclavos rebeldes, por los demás destinados a urbanizarse súbitamente. El mismo improbable escenario en el cual "no sucede nada", y la evolución de la situación prosigue de modo lineal en la misma dirección sin crisis significativas, conduce sin remisión a una inmensa favela en donde las bandas étnicas de desesperados se mueven sobre un escenario dilapidado y "post-atómico", contentándose (y terminando por destruir) con los restos del pasado, tras pequeñas fortalezas privilegiadas completamente aisladas y fuertemente defendidas, desde la cuales se administrará el poder militar y cultural del sistema mediante tanques teleguiados y antenas de televisión, en un contexto mucho más similar al de "Mad Max" o "1997. Fuga de Nueva York" que al de "Metrópolis" o "1984".
Para apreciar toda la "magia" de esta perspectiva, vale la pena visitar, mucho antes que los ghettos de Los Angeles o el Bronx –que, después de todo, son lugares privilegiados por el hecho de encontrarse en los Estados Unidos– las periferias de México DF, de Río de Janeiro o de Johannesburgo, o incluso de eso en lo que se está convirtiendo el extrarradio parisino, para hacernos una idea precisa de lo que el Sistema reserva para Europa.
La autodefensa de la cual habla Faye no debería por lo demás reducirse a la esfera jurídico-administrativa. El problema no puede en modo alguno ser resuelto únicamente a nivel "policial", o de control de las fronteras, dada la inadecuación absoluta, en términos culturales y de recursos, de los aparatos estatales. Estos últimos están además fuertemente infiltrados, especialmente en los países donde, como en Francia y a diferencia de Italia o Alemania, rige el "jus soli" (es ciudadano aquel que ha nacido en el territorio) y no el "jus sanguinis" (es ciudadano el hijo de otro ciudadano), y en donde las minorías, en vías de convertirse en mayorías gracias a la "fuerza de las cunas", incluso sin continuos los refuerzos recibidos, están representadas por inmigrantes de segunda y tercera generación. El problema únicamente puede ser afrontado a nivel de conciencias y movilización social general: una movilización del mismo tipo a la que ha permitido a las minorías vasca en España o germanófona en Italia no ser sumergidas y canceladas, o al Tibet no transformarse aun en una provincia China.
Una tal movilización práctica y popular tiene además la ventaja de forzar mucho más fácilmente el cuadro jurídico impuesto por el Sistema y las ideologías dominantes, desgraciadamente hoy en día garantizadas a niveles internacionales. Aun siendo numerosísimas las posibles medidas útiles, formalmente respetuosas de tal cuadro, que podrían reingresar en los poderes ordinarios y en las políticas legítimas de los gobiernos no paralizados por el mito incapacitante de la "sociedad multiétnica inevitable", Faye no se hace ilusiones de que los procesos en curso puedan ser invertidos sin la adopción de medidas extraordinarias, más allá y fuera de la legitimidad burguesa y socialdemócrata; medidas que hoy en día solamente pueden ser impuestas desde lo bajo, y no ciertamente por administraciones impotentes, por un lado en cuanto sirven al Sistema y, por el otro, en cuanto están ellas mismas en vías de ser colonizadas, a partir del nivel local.
A la inversa, continuamos asistiendo en Italia al insólito espectáculo de una "Immigration Law" cada vez más esotérica e imposible para los abogados que tienen el problema de obtener un permiso para que un "manager" japonés o argentino pueda venir a dirigir una empresa italiana comprada por su casa madre, mientras traficantes, prostitutas, abusadores de todo género y simples desesperados tienen "de facto" libre acceso, y que a los pocos meses de desembarcar se comportan no como extranjeros, sino como verdaderos ocupantes.
Todo ello mientras, como subraya Faye, en la mayor parte de los países del mundo fuera de Europa los inmigrantes o los extranjeros presentes en su territorio son, en toda circunstancia, considerados no como colonos definitivos, ni como refugiados acogidos en nombre de la religión de los Derechos Humanos, sino como "visitantes" y "huéspedes", sin que nadie tenga en mente contestar las normas vigentes en materia de "preferencia nacional" o de expulsión de los clandestinos, como por ejemplo aquellas aplicadas por el benjamín islámico del Sistema, el gobierno de Arabia Saudita que, preocupado por la inmigración asiática, "ha reforzado la "saudización" de su mano de obra, con el consiguiente despido del 90% de los extranjeros y reemplazando a los mismos con súbditos saudíes. El sector privado también ha sido forzado a seguir tal política: los efectivos de todas las empresas deben comprender al menos un 80% de saudíes" (Al Quds Al-Arabi, 1 de enero 1999).
En fin, otro de los puntos tocados por Faye en la conclusión de su libro, quizás para poner el acento, es un punto que retoma el análisis actual de la Nueva Derecha para volcar voluntarísticamente las conclusiones. Hablamos de la novedad del escenario con el cual nos enfrentamos. Si la cosa no puede evidentemente devenir en una coartada para el suicidio histórico de Europa, es simplemente cierto que el mundo actual es diverso de aquel que lo ha precedido, y que está atravesando una crisis de pasaje epocal, respecto al cual las dos guerras mundiales, la revolución industrial, las revoluciones democráticas y comunistas no serían sino notas a pie de página de la historiografía futura. Una crisis cuyo orden de grandeza se asemeja al de la revolución neolítica.
La tecnología y la capacidad de gestión de la información y de las comunicaciones, el grado de influencia sobre el ambiente en el cual estamos inmersos, la anulación de las distancias, el control que el hombre está adquiriendo sobe su misma identidad biológica y de las especies animales y vegetales con las que convive, ciertamente, van mucho más allá de lo que representaron la máquina de vapor o la rotación de los cultivos.
Hoy, la atenuación de las tradicionales presiones selectivas por un lado y, por el otro, la disponibilidad de tecnologías como la diagnosis prenatal, la fecundación artificial, el chequeo genético, el implante de embriones y la gestación extrauterina, la clonación, la manipulación directa del genotipo y por ello de las líneas germinales, representan adquisiciones epocales que hacen a nuestra especie íntegramente responsable de la propia identidad biológica, por mucho que algunos de sus componentes decidan "removerlo" e ignorarlo. Es exactamente como el hecho de tener una pistola en la mano vuelve al poseedor el único responsable, para bien y para mal, de la elección de disparar o no disparar (indiferentemente del hecho de que obre para cometer un atraco, defender a un inerme o festejar el año nuevo), sin que pueda sustraerse de modo alguno a tal responsabilidad.
En efecto, también arrojar la pistola, o fingir que no existe como implícitamente propone la tendencia histórica judeocristiana y democrático-humanista, representa exactamente una de las elecciones posibles, que el desarmado no tiene necesidad de hacer. El desafío "postmoderno" representado por esta revolución ya ha sido repetidamente discutido tanto por Locchi como por Faye o por mí mismo, por ejemplo en el artículo "La técnica, l'uomo, il futuro" ("La técnica, el hombre, el futuro"), publicado en el ya citado n. 20 de "l´Uomo libero", donde apuntaba que las dos únicas respuestas posibles son la opción prometeica, "sobrehumanista", de quienes se hacen cargo de tal destino ("¿En qué quiero/queremos devenir?, ¿Qué gran proyecto celebra mejor mi libertad?"), o la negación freudiana y el pretendido rechazo del "dominio del hombre por el hombre" ("nadie podrá poseer esclavos, porque fuisteis creados mis esclavos", dice Yahvé), que conduce a la tiranía anónima, mecanicista, literalmente "insensata", representada por el Sistema.
En este cuadro, no puede ser ignorado el hecho de que las culturas y las razas nacen y se desarrollan por la identidad, fecundidad y creatividad de los relativos troncos a través de una separación ligada a factores naturales de los cuales no es hipotetizable la reproducción sino en improbables épocas neoprimitivas. Tales épocas pueden ciertamente ver la luz fuera de los estudios de Hollywood, pero serían necesarias catástrofes de tal magnitud que ya no sería puesta más en discusión, posiblemente, la supervivencia del ecosistema, o al menos de la especie humana, sino más bien la conservación de adquisiciones probablemente destinadas a permanecer con nosotros para siempre.
También en el campo étnico, racial y demográfico, la clave del análisis siempre nos remite al advenimiento del "tercer hombre". Así como el primer hombre estuvo inmerso en el reino animal y el segundo se hizo cargo, tras la revolución neolítica, del destino del mundo, el hombre es ahora llamado a asumir trágicamente el propio destino, incluida su identidad biológica.
Un hecho objetivo que hoy es del todo silenciado por intolerable, y que estaba perfectamente claro en los años treinta, y no sólo en Alemania sino también en los países escandinavos, en Francia y en los mismos Estados Unidos, cuando la ingeniería genética y las manipulaciones directas solamente eran posibles en los marcos de la ciencia-ficción y de la especulación pura, es que, en el futuro, la conservación de la evolución, o incluso el nacimiento, de razas, lenguas y culturas diversificadas solamente podrá ser el fruto de una elección deliberada en tal sentido, elección que podrá determinar los contenidos y las características, sobre la base de valoraciones de naturaleza esencialmente estética y afectiva.
En este sentido, no es casualidad que el alcance entrópico de la colonización poblacional de Europa represente a fin de cuentas un valor positivo desde el punto de vista del universalismo de la ideología del Sistema y del fin de la historia, sobre una escala mucho más amplia que el mero dato político inmediato, y precisamente como elemento de oposición respecto a la "tentación" identitaria y faústica; mientras un correspondiente disvalor viene ampliamente asignado por las mismas fuerzas al terrible poder de autodeterminación del cual el hombre ha sido llamado a hacerse cargo.
Por lo demás, estos elementos de fondo son también de alguna medida prometedores. Si la extinción de nuestra identidad étnica, amenaza que hoy pesa sobre nosotros, es ciertamente más definitiva que cualquier decadencia política, cultural o económica, en cuanto por definición irremediable. Existe ya una experiencia histórica, cuando el hombre operaba solamente con los instrumentos tradicionales de los procedimientos legislativos y administrativos, de la propaganda, de la medicina y de la educación colectiva, de cómo los "trends" demográficos y los procesos aparentemente consolidados pueden al día de hoy ser invertidos en el giro de una sola generación. En pocos decenios, las características y la identidad étnica y biológica de nuestras poblaciones serán íntegramente determinadas (o no determinadas, por pura elección, si prevalece la filosofía de la condena y de la degradación) por opciones individuales y colectivas. En cualquier caso, la responsabilidad relativa no será ya de la "naturaleza", ni de los procesos históricos "parabiológicos" que han gobernado hasta ahora las afirmaciones, la decadencia y el ascenso de las razas y de las civilizaciones. En todo caso, los cielos spenglerianos descritos en "La decadencia de Occidente" han llegado a su fin.
Si nuestras visiones de fondo continúan manifestando una absoluta consonancia con Faye, por otra parte emergen en las actuales posiciones "políticas" del mismo autor elementos menos convincentes. No trato aquí solamente de responder a la invitación al debate por él formulada en su libro, sino que también deseo resaltar cómo muchas de sus posiciones son debatidas actualmente en Italia.
La primera cuestión fundamental es la anunciada en el subtítulo mismo del libro, en la cual la colonización de Europa es tratada al modo de un "discurso verdadero" sobre la inmigración y el Islam.
En lo que respecta al último, la posición de Faye es cristalina. "En el curso de conferencias que he podido pronunciar, en el curso de las cuales he abordado incidentalmente la cuestión del Islam en Europa, jóvenes musulmanes me han acusado de "hostilidad visceral hacia el Islam" y de "complot contra el Islam". Mi respuesta siempre ha sido muy pacífica y determinada. Sí muestro una hostilidad visceral contra el Islam, tenéis razón. No, no fomento ningún complot contra el Islam, porque el "complot" hace referencia a una hostilidad disimulada, mientras que la mía es franca y abierta".
Al respecto, el autor tiene razón al subrayar cómo la "islamofilia" de muchos ambientes, paradójicamente con la primera línea ocupada por sectores del episcopado católico, progresistas, burgueses y extremistas de extracción varia, se funda sobre todo en la ignorancia: "Ninguno de ellos ha estudiado el Corán, ninguno habla el árabe, ninguno ha puesto nunca el pie en un país musulmán (salvo quizás en el enclave de algún "Club Med"), ninguno ha visitado una ciudad de mayoría musulmana. Para ellos, el Islam –y la inmigración– son hechos abstractos, lejanos, simpáticos".
Ahora bien, el que escribe no da pruebas de ninguna "ternura filosófica" por el Islam. "Religión del desierto" en mayor medida que las otras dos "del Libro", entristecida por la predestinación aun más que la confesión luterana, con la cual además no comparte el rigor alemán, más represiva e hipócrita que el catolicismo, más ritualista y justificacionista que el judaísmo, mercantil como el calvinismo, iconoclasta, universalista, levantina, completamente desprovista del concepto de honor en el sentido que ha sido entendido durante tres mil años en nuestro continente, no tiene necesidad de una ojeada particularmente profunda para evidenciar su profunda alteridad respecto a la sensibilidad y a los valores que me hacen sentir europeo".
La ceguera que ha conducido a autores y opositores al sistema como Claudio Mutti, o algunos militantes de la derecha radical francesa, a la conversión al Islam, siguiendo al "ilustre" precedente guenoniano, no es sino una variante de esa ceguera que ha conducido a otros muchos, especialmente el Italia, a refugiarse entre los brazos de la Santa Madre Iglesia, especialmente después de algún trauma histórico o personal, a la búsqueda de unas migajas de identidad europea, de la que abjuran, que hayan podido quedar atrapadas en el vestido a pesar de los enérgicos y continuos cepillados.
Es perfectamente cierto, por lo demás, que el cristianismo (y el mismo judaísmo) han participado de nuestra historia, y no por ello son, en muchos sentido, menos extraños que el Islam.
Esta consideración, por otra parte, puede ser exactamente contestada en la constatación de que el Islam es una religión árabe, de matriz árabe, afirmada en Arabia y en la inmediata esfera de expansión de tal mundo, y cuyo destino en parte conspicuo se asocia estrechamente al de la nación y la identidad de los árabes. En este modo, el Islam nos parece efectivamente acercarse mucho más, "mutatis mutandis", a una religión ancestral, "política" e identitaria en sentido europeo; particularmente en oposición al judaísmo, fundado sobre el rechazo de la validez religiosa de la comunidad política, por lo cual el mismo Israel sería la anti-nación; y también en relación al cristianismo, cuyas (pasadas) relaciones privilegiadas con Europa han sido fruto de una identificación contingente y por ello incompleta, y cuya vocación universalista es, por ello, tanto más explícita.
Símbolo de este último punto es la relación respectiva de las dos religiones por un lado con el latín, lengua no originaria que fue abandonada sin demasiados problemas en el curso de una generación, y por el otro con el árabe coránico, que es Palabra de Dios, desde el punto de vista musulmán también desde un punto de vista lingüístico, dada de una vez y para siempre en su perfecta e insuperable formulación (exactamente como el hebreo bíblico, lengua ya muerta en la época del Imperio romano y artificialmente resucitada por el sionismo, y por los siglos de los siglos la única lengua del Eretz-Israel). Y en cuanto a la pretendida "intolerancia" islámica, ¿se trata simplemente de la característica de un sistema religioso en una fase menos decadente y envejecida de las que estamos habituados?
La dulzura y mansedumbre cristianas se implantaron en Europa con el asesinato a traición de un emperador por haber rechazado la nueva fe, el genocidio de los sajones, la persecución de los "hombres libres" del norte arrinconados hasta Islandia; y la misma dulzura y mansedumbre, en el momento de su triunfo, "santificó" las ciudades con las campanas y las hogueras preparadas para las brujas y los herejes, la matanza fratricida de la noche de San Bartolomé, el regicidio, las guerras de religión sobre el suelo europeo, el genocidio de los indios que rechazaron la conversión, el terrorismo de las sectas subversivas y el simétrico terrorismo represivo de la inquisición, que por vez primera en Europa elevó la tortura, el lavado de cerebro y la perversión del proceso judicial, a una forma de arte.
Sobre el plano histórico y doctrinal, el escenario diseñado por ejemplo por "Las mil y una noches" (ver la historia de Hasan al-Basri, capítulos 778-831, o la del sastre, del jorobado, del hebreo del intendente y del cristiano, capítulos 25-34) representa una sociedad cruel y profundamente extraña a nosotros, pero en el fondo más pluralista, flexible y articulada también desde el punto de vista religioso que aquella alumbrada por las "Luces del Medievo" cruzado y, después, por los fastos de la Reforma y de la Contrarreforma. Una sociedad en la cual se mueven libremente no sólo cristianos y judíos reconocidos como tales, aunque sean ridiculizados y condenados, sino también los temidos "magos adoradores del fuego" –que no son otra cosa que los supervivientes (perseguidos al día de hoy en pleno Jomeinismo) del culto zoroastriano en la Persia islamizada–, ciertamente de cuando en cuando matados por el héroe de turno o por la autoridad, pero aparentemente más a sus anchas de lo que pudieron estar nuestras brujas en Toledo o las americanas, algunos años después, en Salem.
Por lo demás, como recuerda Faye una vez más en "La colonización de Europa", "si hoy la Iglesia católica no practica la intolerancia inquisitorial, no predica la conversión universal y la cristianización del mundo, sino que se repliega sobre el "ecumenismo" y sobre la "apertura al Otro", es simplemente porque se encuentra en decadencia, porque las relaciones de fuerza no juegan ya a su favor, de modo que la fe es cancelada por la caridad y ésta última es cada vez más secularizada hasta terminar confundiéndose con los Derechos Humanos.
El mismo libro de Faye abunda en concesiones relativas al hecho de que los musulmanes, desde su punto de vista, hacen bien en ser lo que son, y en el reconocimiento del hecho de que sus componentes emigrados permanecen más arraigados en su cultura que las mismas poblaciones en las cuales se insertan. Incluso llega a acreditarles méritos que quizás, como veremos, ni siquiera tienen, escribiendo: "Pero no es necesario negar al enemigo su nobleza, ni la humana justicia de su causa. Llena el suelo que tú abandonas. Preserva su territorio y su sangre, engrandece su territorio con el tuyo y reemplaza tu sangre por la suya. El enemigo que juega su papel es estimable. Y el traidor en no serlo en absoluto…" Y continúa: "El Islam nos considera como una civilización en un tiempo temible y hoy desvirilizada, decadente, afeminada, homofilizada. Nos ataca por ello. Y desde su punto de vista tiene buenas razones… Se pueden perfectamente compartir valores comunes con el enemigo que te invade… El Islam aparece como una "rebelión contra el mundo moderno" (13), y por ello seduce… Respeto, como enemigo digno de interés, al musulmán conquistador, al "Beur" (14) presa del odio y la venganza".
A la luz de tales relieves, no es posible comprender cómo Faye pueda individuar en sus conclusiones al Islam como el "enemigo principal", añadiendo, aunque sea en modo cualificado: "Los Estados Unidos son, como ya he explicado en otra obra, y más precisamente en "El Arqueofuturismo", un adversario, no un enemigo".
Ciertamente, Carl Schmitt, abundantemente citado en las obras de Faye, distingue entre "inimicus" (el oponente civil, el opuesto de un aliado y un compañero en el interior de la comunidad) y "hostis" (el enemigo externo, el extranjero hostil en guerra perenne, actual o potencial, con la comunidad). En este sentido, al menos etimológicamente, "inimicus" es un término que denota una alteridad más blanda y meramente "concurrente". También cuando el uso corriente de los términos "enemigo" y "adversario", en el francés, italiano o inglés contemporáneo, parecen indicar conceptos diversos especularmente inversos.
La cuestión, por terminológica que pueda ser, es grave, porque comúnmente, cuando se hace la relativa distinción, se atribuyen al "adversario" exactamente las posiciones antes descritas para el Islam, es decir una rivalidad y una concurrencia nutridas en sustancia por un mero conflicto de intereses y de voluntades de poder contrastadas, entre sujetos distintos entre sí, pero no "metafísicamente" opuestos, y en posiciones de algún modo simétricas y equivalentes en el ámbito respectivo, que pueden también encontrar ocasionalmente razones de alianza (por ejemplo contra un enemigo común) y de respeto recíproco.
El "enemigo" parece exactamente ser aquello que el Sistema representa para todas las culturas y las razas vitales, la misma negación radical de su legitimidad y posibilidad de existir. La afirmación de Faye suena así paradójica, similar a aquella de un pretendiente al trono de los zares que declarase que el "verdadero enemigo" es su rival en la sucesión, reconociendo a la inversa a los bolcheviques que están a las puertas del Palacio de Invierno como legítimos "adversarios", oponentes deportivamente respetuosos de las reglas y de los valores de la sociedad rusa tradicional. Pero el sentido común nos dice, por el contrario, que en el lenguaje corriente el verdadero "enemigo" de los muchachos de la calle Pala no es la banda que disputaba con ellos el uso del campo de juegos, sino la empresa que terminó desmantelándolo para construir allí un edificio, después de tantos sacrificios inútiles para defenderlo.
El vuelco de esta distinción parece confinar peligrosamente con una deriva en donde se termina por reconocer, en la más pura ideología de las burocracias de Estrasburgo y Bruselas, una común pertenencia "concurrencial" de los Estados Unidos y la Unión Europea al mismo "club occidental", contrapuesto en cuanto tal a todos los demás. Y por lo demás, dado que los "traidores" a quienes Faye reserva un peor juicio son exactamente los partidarios del Sistema y del poder internacional y fundamentalmente americano, parece extraño considerar digno de respeto al partido "enemigo", y de desprecio e ignominia al partido solamente "adversario".
La afirmación no parece fruto de un lapsus ocasional. Faye insiste repetidamente en su libro en su perdurable y absoluta oposición al poder americano en Europa (oposición que es, por lo demás, el tema central del "Nouveau discours à la Nation Européenne", también en su segunda edición), generando cierta notable perplejidad un par de puntos sobre la Guerra del Golfo. Leemos, por ejemplo, al autor escandalizarse en sustancia por los estados de ánimo perplejos de los pilotos ingleses musulmanes al bombardear Iraq. O bien, en otro punto, mencionar de paso la crisis iraquí como un caso en el cual los "europeos" (¿!) supieron "una vez más" comportarse como "predadores", término por cierto no particularmente insultante ni para Faye ni para su público.
Estas salidas son absolutamente sorprendentes tanto en líneas generales como desde el punto de vista del autor, desde el momento en que se refieren a un caso en el cual los europeos han ido a la zaga de los americanos y de Israel en la defensa de las fortalezas del tradicionalismo islámico más oscurantistas y feudales, aunque políticamente más sumiso del Sistema, contra un Estado ciertamente árabe y de mayoría musulmana, pero administrado por un gobierno laico dirigido por principio de socialismo nacional, al menos en la contingencia específica en posición anti-Sistema, y representado por un ministro de exteriores de fe cristiana.
Situación que Saddam Hussein no ha sabido utilizar propagandísticamente, por ejemplo transmitiendo por televisión las misas de Navidad en Bagdad, mientras los "cristianísimos" obispos católicos y adventistas americanos destinados en territorio saudita deben guardarse bien de turbar la sensibilidad religiosa de sus protectores musulmanes con "inoportunas" celebraciones.
Por otra parte, Faye cita ampliamente un libro de Alexandre Del Valle: "Islamisme et Etats-Unis, une alliance contre l'Europe" (Editions L'Age d'Homme) (15), para demostrar que, si los americanos y comúnmente el Sistema apoyan y promueven la inmigración, por ejemplo a través de la política de las organizaciones internacionales, el Islam sería a su vez el aliado objetivo de los EEUU en la destrucción del continente europeo, no sólo a través de la inmigración, sino por ejemplo a través de la política petrolífera, la crisis de Bosnia, etc., hasta el punto de ser muy creíble una sustitución del condominio americano-soviético por un condominio americano-islámico, con la potestad de los mismos EEUU para intervenir como "pacificadores" o "garantes de los Derechos Humanos" también en países de la Europa occidental donde el enfrentamiento étnico superase cierto umbral, provocando una situación similar a la de Bosnia. En realidad, el "anti-islamismo" y el "anti-arabismo" de Guillaume Faye parecen nutrirse de una perspectiva en este caso "francesa, demasiado francesa", un tanto paradójica en un autor generacional y etiológicamente extraño a la hipoteca "argelina" que tanto ha pesado desde la postguerra en los ambientes anticonformistas transalpinos.
Y es evidente en numerosas admisiones del autor una especie de identificación refleja entre "inmigrante" y "musulmán", entre musulmán y árabe e, incluso aunque menos posiblemente, entre árabe y magrebí. Como demuestran los ejemplos y las citas de los ambientes de la inmigración que abundan en su libro. Cuando Faye habla de inmigración y Tercer Mundo hace en toda evidencia referencia a una realidad en sustancia representada por argelinos y marroquíes, o comúnmente a árabes con un fuerte predominio norteafricano, a lo máximo con alguna franja subsahariana, cerrando sus conclusiones con alguna experiencia personal directa, adquiridas "in situ", de la realidad saudita.
Pero la realidad de los barrios periféricos de París o del mediodía francés, que Faye describe de modo apasionado pero objetivo, no es la fotocopia exacta de los problemas de todo el resto del continente, y aun menos su proyección cósmica en términos de definición de los escenarios del choque final. Según los datos publicados por "Il Giornale" del 13 de enero de 2001, diario no sospecho de filo-arabismo, los árabes musulmanes son, según el Ministerio del Interior (y son datos que podrían estar subestimados, existiendo otras áreas en donde la componente clandestina de la inmigración es más elevada) menos de un quinto de toda la realidad de la inmigración italiana, y esto solo gracias a una reciente contribución masiva de Marruecos. Egipto, por ejemplo, no representa más del tres por ciento; Túnez –a unos pocos cientos de kilómetros de nuestras costas– el cinco; y el porcentaje del resto de países árabes hace proverbial referencia directa a sus prefijos telefónicos (16), mientras las cristianísimas Filipinas aportan a la casa ocho puntos, y el Senegal y la China rondan el cuatro por ciento cada uno.
Y hablando de "trends" demográficos y de pesos respectivos, ésta última por sí sola tiene, además de una excepcional homogeneidad étnica dominada en un 95% por la raza jan, una población siete u ocho veces superior a todos los países árabes juntos (o quizás deberíamos decir árabo-bereber-fenicios, dadas las crecientes reivindicaciones de los tamazigh en el África noroccidental y la componente no árabe del Líbano). El editorialista de "Il Corriere della Sera" del 2 de febrero de 2001 recuerda las proféticas palabras recientemente pronunciadas al respecto por la actual élite china: "¿creen en verdad que trataremos de administrar un país en donde se concentra un cuarto de la humanidad según los principios de la legalidad burguesa occidental? ¿Creen poder afrontar un derrumbe del cual nacería un flujo migratorio sin precedentes en la historia?"
Ahora bien, Faye parece paradójicamente mucho menos preocupado por esta perspectiva, hasta el punto de oponer la "buena integración" o la aparente tranquilidad (organizada por los Tong, las Tríadas y los traficantes de carne humana y heroína) de las minorías asiáticas a las minorías árabe-musulmanes de los pandilleros que se hacen notar rompiendo escaparates y violentando a las mujeres blancas en el metro parisino.
Por lo demás, mientras la India superó hace ya tiempo los mil millones de habitantes, la misma África negra tiene una presión demográfica notablemente superior a la de los países árabes, a pesar de las continuas sequías y las carestías de todo género, y a pesar también de la perdurante mortalidad infantil y la difusión endémica del SIDA, problemas que implican en mucha menor medida a la población emigrada en Europa, donde pueden gozar de condiciones de vida, higiene y nutrición, similares a la población local. Y sus emigrantes son mucho menos "integrables" que los árabes, como las mismas comunidades negras americanas, hoy compuestas exclusivamente por mulatos de diferente gradación, demuestran.
Alemania, como indirectamente también recuerda "La colonización de Europa", sufre a su vez mucho menos de una inmigración árabe que turca, etnia a la que Faye dedica en algunos puntos singulares palabras de simpatía, con obvia función antiárabe. Pero, aunque los turcos ("mal islamizados", según Faye) hayan aplastado durante algunos siglos a los países árabes y norteafricanos bajo su dominio, por mucho que puedan haber sido aliados de los imperios centrales o haber refundado su propio estado en los años de entreguerras en imitación de los institutos y reformas introducidos por las revoluciones nacionales europeas, el verdadero "enemigo musulmán de Europa", despues de los "moros" de Carlos Martel, los enfrentamientos armados con los restos del Imperio bizantino y la Reconquista española, siempre ha estado representado sustancialmente por los turcos. Partiendo de las alucinantes vicisitudes que les vieron competir en humanidad y caballería con personajes como Vlad Tepes, alias Dracul, en los Balcanes, hasta llegar al asedio de Viena, pasando por la piratería mediterránea y las batallas de Creta, Malta y Lepanto. "Mamma, li Turchi!", se gritó en las costas italianas durante siglos a la llegada de los piratas, "Mamma, gli Arabi!" es una exclamación posible en nuestra lengua solamente… desde finales de los años noventa. Y aun hoy los turcos son la comunidad musulmana más numerosa en territorio europeo.
Mientras los árabes son acusados de esterilidad y parasitismo cultural, pues lo habrían tomado todo de los países conquistados (tesis que tiene indudables elementos de verdad), generalmente se escucha un clamoroso silencio frente a la "refinada" civilización otomana creada por predadores asiáticos y mercenarios rebelados contra sus señores araboegipcio-iraquíes para construir una parodia del Bajo Imperio, con tantos trazos discutibles y por lo demás con tantos éxitos a la hora de integrarse en la historia y en la identidad griega y balcánica. Y que hoy están dignamente prolongados por películas como "El expreso de media noche" y "Hamman". Un país en donde, para mostrar la propia desaprobación civil a las posiciones expresadas por un adversario político, no es el todo inaudito encontrarse al hijo crucificado en la puerta de casa con los ojos arrancados y los genitales en la boca, en donde corrupción, terrorismo y represión compiten en una carrera infinita y donde se consuma con toda tranquilidad el etnocidio de los kurdos y los armenios con la bendición del Sistema y de los aliados en la OTAN.
La misma realidad del Islam es una realidad compleja, que "La colonización de Europa" afronta certeramente sobre el plano cultural y teológico, desmintiendo con justicia muchos tópicos y mucha propaganda tranquilizadora al respecto, pero que merecen una mayor profundización también sobre el plano histórico-político.
Parece, por ejemplo, una consideración obvia que algunos de los principales Estados musulmanes, para bien y para mal, no son en absoluto árabes, ni étnica ni políticamente, ni siquiera –en parte– culturalmente: ver, más allá de la citada Turquía, el Irán, Afganistán y Paquistán. Además, el África del Norte es en varios aspectos una realidad bien distinta al Oriente Medio. Igualmente, la distinción entre sunnitas y chiítas reviste hoy en día un peso ciertamente superior al que divide, por ejemplo, a los cristianos ortodoxos de los católicos. Aun teniendo presente que, como dice Faye, "no se discute sobre el sexo de los ángeles cuando los bárbaros están a las puertas", y que no parece adecuado adentrarnos en minucias irrelevantes y desmovilizantes, para combatir a algo o a alguien, sea enemigo o adversario, es preciso conocerlo.
Aun más relevantes nos parecen otro tipo de distinciones, que ven hoy en día al "mundo islámico" subdividirse en algunas grandes componentes:
– las áreas fuertemente occidentalizadas, completamente integradas al sistema, como Túnez en primer lugar y en segundo Marruecos, a los que hay que añadir Turquía, Argelia y Egipto, a pesar de las fuertes oposiciones internas.
– los gobiernos del tradicionalismo y oscurantismo feudal musulmán, como Arabia Saudita, Kuwait, Qatar y, en parte, los Emiratos Árabes Unidos, todos de hecho protectorados americanos, aliados objetivos del sistema y traidores a los intereses del pueblo árabe.
– los países "laico-revolucionarios", "en los márgenes de la comunidad internacional", como Libia, Iraq (17) y, en posiciones más ambiguas, Siria y Paquistán.
– los países y movimientos del Islam militante, como el Irán, Afganistán, los libaneses de Hezbollah, Sudán, el denominado fundamentalismo islámico en Argelia, Egipto, Turquía y las repúblicas ex soviéticas, los componentes "extremistas" de la resistencia palestina, etc.
Ahora bien, los problemas para Europa, en materia de inmigración, provienen en sustancia del primer grupo. La alianza política objetiva con las fuerzas del Sistema denunciada por Faye no atañe sino al primer y al segundo grupo. Para el tercero y el cuarto, frente a la retórica sobre la agresividad del Islam, parecen ciertamente retorcidos los análisis que intentan demostrar la alianza "objetiva" entre Libia y los Estados Unidos, entre Nato e Intifada, entre la oposición argelina y los "sponsors" internacionales del gobierno que capturó el poder tras un golpe de Estado que canceló el respaldo electoral favorable a las fuerzas islámicas (¡!). Siguiendo ese hilo, podríamos concluir imaginando a los talibanes o a los imanes chiítas incitando a la propia juventud a desertar del propio país y de la propia comunidad militante para emigrar a los países donde el alcohol se consume en público, la mujer goza de una libertad sexual análoga a la del hombre y la blasfemia reina soberana, salvo quizás para pensar en salvar el alma con la firma de alguna petición para la construcción de alguna pequeña mezquita en nombre de los Derechos Humanos.
La verdad es que ningún italiano ha visto un libio de carne y hueso en la segunda mitad del siglo apenas concluso, a menos de haber sido llevado al lugar o a la embajada. Y se trata de un país que fue una de nuestras colonias por más de una generación, donde aún se habla la lengua italiana, y casi a tiro de artillería o de las lanchas neumáticas desde las costas de Pantelleria (¡!).
No por lo demás los ayatolás iraníes o el gobierno iraquí aparecen en primera fila incitando a la emigración, mientras los fundamentalistas egipcios manifiestan todo el propio deseo de mezclarse con los infieles organizando además atentados contra los turistas. Al contrario, es posible sostener que los únicos inmigrantes que originan los países no alineados con mayorías musulmanas son disidentes filo-occidentales o minorías étnicas –¡quizás católicos, como los armenios!
Si en Argelia no hubiese tenido lugar un golpe de Estado anti-islámico apoyado por Occidente, la misma Francia tendría quizás menos problemas de inmigración con su más discutida ex-colonia, exactamente como la inmigración de la Europa oriental no representó mayor problema hasta que los ciudadanos de tales Estados no precisaron solicitar un visado de salida. Y ello aunque el Adriático no se hubiese vuelto en ningún modo más estrecho, o los albaneses de algún modo mejor equipados en cuanto a embarcaciones o más emprendedores de lo que eran antes.
El Islam será seguramente siendo agresivo, y los países en donde viene siendo practicado no tienen ciertamente nada en contra para expandir con la mejor buena conciencia el propio territorio y esfera de influencia, pero si se le acredita representar un movimiento conquistador, identitario, patriarcal y autoritario, por cuanto gravado por la hipoteca universalista y monoteísta propia a todas las religiones del Libro, difícilmente se le puede imaginar dispuesto a promover la emigración hacia un país donde, como recuerda Faye, el 20% de los matrimonios de hoy en día son mixtos, estadísticamente destinados terminar en el divorcio y con la prole confiada a las mujeres infieles (¡!). Aquello que es directamente causante de la inmigración no es la pobreza, ni mucho menos la agresividad o rebeldía de los respectivos gobiernos. Es el dominio de los valores occidentales en su sociedad, y el grado de sometimiento político y económico de sus países al Sistema.
De Iraq solamente emigran los kurdos, a pesar de ser un país sometido a un terrible embargo internacional, con el 15% de los niños, según "Il Giornale" del 19 de febrero de 2001, afectados de desnutrición. No hay que olvidar que el primero de los Derechos Humanos, el primer elemento de desarticulación –¡también interna!– de los residuos de identidad común en las regiones aun no alienadas y occidentalizadas, es la libertad de andar y venir, el desarraigo de las raíces territoriales que vuelve a las poblaciones móviles, fungibles, proletarizadas, privadas de pertenencias (cuando no en el límite alienado e imaginario representado por los restaurantes y la parroquias, o por la afición futbolera), cuyo vértice es naturalmente la emigración.
Otra cosa es, naturalmente, el islamismo "literario" de los conversos europeos, o el imaginario y polémico de los negros extremistas estadounidenses, que se creen musulmanes como el barbudo americano de color protagonista del film "Ghost Dog" cree, leyendo el "Hagakure" de Yoko Yamoto, ser un samurai del medioevo japonés, ejemplos tan patéticos como la convicción de algunas "stars" occidentales del espectáculo de ser budistas. Y otra cosa es aun el islamismo minoritario y sedicioso, representado no sólo por la componente "radical" de los inmigrantes musulmanes en Europa, sino por ejemplo por una parte notable de la población india –contexto en el cual parece obvio el deber de tomar partido por un gran país cuya cultura y religiosidad profundizan en las más lejanas (y degeneradas) raíces indoeuropeas, contra la intolerancia facciosa de sectas fanáticas que han llevado la maldición de Abraham contra la sacralidad del mundo y de la comunidad política hasta la tierra de la literatura védica, de Indra, Mitra y Varuna.
Es pues el mismo Guillaume Faye quien, acusando a la Nueva Derecha de confundir la perspectiva de acuerdos geoestratégicos con el Islam (entendido como conjunto de entidades políticas y estatales) con la tolerancia hacia la inmigración o la islamofilia "filosófica", subraya indirectamente cómo las dos posiciones no tienen absolutamente ninguna relación necesaria. Cosa demostrada históricamente, por lo demás, por la política filo-árabe de los ingleses a principios del siglo XX (en función anti-turca) y de los alemanes de entreguerras y durante toda la Segunda Guerra Mundial (en función anti-occidental), ciertamente ni en el primero ni en el segundo caso por aspiraciones al mestizaje árabe-europeo, o a la conversión o a la creación de sociedades multirraciales en los propios países.
De nuevo es el mismo autor quien explícitamente hipotetiza posibles relaciones diversas, incluso alianzas, entre Europa y los países islámicos, enumerando como pre-condiciones: que no sea suscitada ni la interpenetración étnica ni el proselitismo religioso; que cese la política de alianza subterránea antieuropea con los Estados Unidos; que sea reconocida la soberanía europea sobre el territorio que abarca "desde Portugal hasta el estrecho de Behring, del Cáucaso al espacio siberiano". Pero, en el momento de exponerlas sobre el plano político concreto, apenas podemos imaginar la perplejidad de un dirigente político islámico frente a estas "condiciones" o "solicitudes" ante una mesa de negociaciones.
Veámoslo brevemente desde el punto de vista del imaginario dirigente:
1) El tráfico de mano de obra musulmana hacia las tierras infieles está organizado por el Sistema y por los gobiernos fantoches de los países filo-occidentales, aun cuando éstos no lo promuevan activamente, ni escondan su preferencia por algunos miles de dólares de más en "ayudas internacionales", empleados sobre el lugar por parte de las corruptas burocracias del poder, respecto a diez permisos de trabajo de otros tantos emigrantes cuyos (dudosos y eventuales) envíos de divisas a las familias de procedencia son ciertamente más difíciles de interceptar.
2) Mientras exista una obvia presión objetiva a la conversión en las zonas y en los barrios europeos de dominio musulmán, para un musulmán, como subraya Faye, el aspecto religioso permanece estrechamente conectado al aspecto político y étnico, así que el escenario de "misioneros del Islam" enviados a convertir a otras poblaciones según el modelo católico y protestante no tiene ninguna posible comparación histórica pasada o contemporánea. Para la mentalidad árabe, la única verdadera "conquista" es aún la tradicional adquisición de territorios a través de anexiones político-militares.
3) Ninguna de las naciones árabes tiene reivindicaciones territoriales o dominios sobre Europa; a lo más, es Turquía, a la que hemos visto gozar de la indulgencia cuando no de la simpatía de Faye, quien mantiene bajo el propio indiscutible dominio una ciudad particularmente importante en la historia europea bajo los nombres de Bizancio y Constantinopla, controlando además por cuenta de los americanos los estrechos y el acceso de las poblaciones eslavas del este al Mediterráneo.
4) La posición de la Europa actual no la de la oposición a la "alianza subterránea" reprochada por Faye a los árabes respecto a los EEUU –situación que por lo demás únicamente describe las posiciones de los gobiernos árabes filo-occidentales–, sino una subordinación del todo abierta y "oficial" a los mismos EEUU y a las organizaciones internacionales por ellos dominadas, que se manifiesta en particular con un apoyo incondicionado a los intereses americanos e israelitas en el Mediterráneo y en el Oriente Medio (¡!). No es difícil imaginar que si nuestro hipotético dirigente tiene algún conocimiento de la Biblia, además del Corán, la primera idea en venirle a la mente sea la parábola de la paja en el ojo ajeno y la viga en el propio.
Todo ello nos lleva a introducir un nuevo elemento crítico respecto al análisis contenido en "La colonización de Europa".
La utilización de términos como "conquista", "guerra", "colonización", es absolutamente legítima para evocar la situación de dramática emergencia en la cual nos encontramos, y tiene su eficacia y posibilidad en términos metafóricos. Pero tal utilización parece menos justificable, y comúnmente menos útil en términos estrictamente políticos, cuando es expresada en sentido literal y con vistas a acreditar la tesis de que exista un positivo y consciente "complot" por parte de las jerarquías religiosas, de los emigrantes y de los gobiernos de los países islámicos, todos indiferente y globalmente incluidos, con vistas a la realización de un diseño político unitario.
Hemos visto que el Islam, incluyendo la más reducida nación árabe, por desgracia o por fortuna, ni está unido ni es particularmente unitario. Mientras en cada uno de los países y componentes anidan algunos de los más resueltos opositores contemporáneos al sistema de poder internacional, otros no solamente están perfectamente alineados a éste último, sino que no constituyen más que irrelevantes fiduciarios locales de una colonización occidental que persiste en tales países de una forma nueva, hasta privarles de cualquier capacidad o poder de iniciativa que vaya más allá del hecho de negar la extradición de Craxi a los ministerios públicos de la República Italiana o de constituir útiles objetos y pretextos para las guerras occidentales contra otros musulmanes.
Ahora bien, las masas sociales de desadaptados, homologados neo-occidentales, criminales, jóvenes desarraigados y desesperados varios que hacen fila para entrar en Europa, vientre blando y puerta de servicio del "centro del Imperio", al mismo tiempo original en el pasado y copia bruta actual de la realidad transmitida por los televisores vía satélite, no son ciertamente las orgullosas tropas de asalto de una civilización conquistadora. Son mucho más similares a los rechazados de regiones y culturas que sufren a su vez de una fortísima incomodidad a una horda empujada sobre nuestras orillas por el atractivo de botines imaginarios, desplazados, "merci umane", por el sistema económico internacional según las propias exigencias. Representan las avanzadas de una "conquista" árabo-musulmana de Europa exactamente como los Padres Peregrinos representaron la conquista del continente americano por parte de la milenaria cultura europea o del Sacro Imperio Romano. Algo, seamos claros, que no impedirá a nuestros inmigrantes reducir a la ruina y a la extinción a nuestros pueblos, exactamente como las culturas de los pieles rojas fueron extirpadas por los emigrantes que partieron allí para así mejor renegar de la propia civilización, la propia raza y su comunidad. No es casualidad, por lo demás, que la norteamericana haya sido, como la que hoy nos amenaza, un colonia de población, como lo fueron en gran parte Australia o Sudáfrica, zonas ambas, por lo demás, a diferencia de Europa, con una bajísima densidad de población autóctona –en oposición a las colonias un tanto diversas como las de Indochina, Malasia, Tanzania, Etiopía o las Filipinas.
Cuando, como relata Faye, los imanes de la periferia de París predican: "Este continente se ofrece a nosotros, o mejor es Allah quien nos lo ofrece, como un fiero guerrero metamorfoseado en mujer sumisa" (de un boletín difundido por "Amicale des Musulmans de Créteil" en noviembre de 1999), se oyen resonar distintos ecos, muchos árabes, de desesperación depresiva y de una arrogancia compensatoria, incluso no sea una cita extraña a los lectores de "Las mil y una noches" (ver la historia entre el rey an-Un´man y sus descendientes contra el Imperio bizantino, capítulo 45). Por ello, las comparaciones históricas con Solimán el Magnífico, con Saladino el feroz o con el mismo imperialismo otomano aparecen sin duda sugestivas, potencialmente movilizadoras, pero sólo con la condición que tales referencias no vengan ofuscadas con la correcta comprensión de la realidad histórica y de las aclaraciones pertinentes.
Parece que este caso es el propio Faye quien concede un crédito excesivo a los gobiernos y a los países emigracionistas, en atribuirles planes orgánicos y coordinados de conquista, cuando su rol y peso actual parece más similar al de los jefes de tribu del África central y occidental que durante al menos cuatro siglos vendieron regularmente a sus propios súbditos a los traficantes de esclavos, primero para abastecer los mercados árabes y después los brasileños y los estadounidenses. ¿Aquel tráfico de esclavos puede ser considerado una "estrategia" para alterar la composición étnica del África sahariana o de los inmigrantes americanos "caucásicos", o para colonizar genética y culturalmente los relativos ámbitos?
Sería más que dudoso. Seguramente tal emigración ha mestizado más o menos consistentemente las zonas de destino, seguramente en los casos brasileño y estadounidense ha alterado irremediablemente las líneas culturales. Pero que todo ello correspondiese a una expansión deliberada, y al avance histórico, cultural y biológico de las poblaciones implicadas, es en verdad difícil de sostener. El autor parece aquí víctima de la propaganda identitaria de los mismos inmigrantes que, extraños en tierra extranjera, buscan en el peor de los casos recuperar y mantener una cohesión interna con valencia sustancialmente sindical y reivindicadora, compensatoria y consoladora de su "status" de desarraigados y renegados mestizos que, a pesar de todo, a diferencia de muchos europeos, americanos o brasileños, evidentemente aun no están enteramente habituados. También aquí habla en el fondo de Guillaume Faye la voz del ciudadano de un país antaño colonialista, que conoce desde hace pocos decenios la inmigración, pero que por emigración entiende aun hoy… ¡el éxodo hacia otras cortes europeas del residuo no guillotinado de la aristocracia francesa durante el periodo napoleónico y revolucionario! Concepto y experiencia cuando menos diferente de aquellos que el término "emigración" representa por ejemplo para la cultura italiana o irlandesa.
Si es cierto que el veinte por ciento de los matrimonios franceses son hoy en día matrimonios mixtos –incluso atribuyendo todo el peso del caso al hecho significativo de que se traten en la gran mayoría de los casos de matrimonios entre inmigrantes y mujeres autóctonas (y los jueces franceses contemporáneos asignan regularmente, en caso de separación, la prole a la madre, exactamente como los italianos)–, si es cierto que los inmigrantes no son (todavía) mayoría, y si finalmente es cierto que los inmigrantes no son ciertamente homogéneos entre sí, ¡no se diseña en el panorama un futuro de "limpieza étnica" para las comunidades extranjeras en el hexágono francés!
Por lo demás, al frente de las preocupaciones expresadas en "La colonización de Europa" a propósito del potencial condicionamiento de la libertad de la política exterior europea (¡!) por parte de los ambientes de la inmigración, en particular musulmana, es fácil constatar que la incidencia que la comunidad islámica puede ejercer al respecto es muy similar a aquella, en verdad mínima, de la comunidad italiana y alemana en América en las vigilias de la Segunda Guerra Mundial, y no por ejemplo a aquella de signo opuesto de la comunidad judía en nuestros países, o a aquella ejercida, por la vía del chantaje económico, la ocupación militar y el sometimiento político-cultural, por los Estados Unidos.
Estoy perfectamente de acuerdo con Faye al considerar hipócrita, jesuítico y perdedor el eslogan que invita a luchar "contra la inmigración, no contra los inmigrantes", muy parecido al anticomunismo clerical de los años cincuenta que quería "combatir al pecado, no a los pecadores". Los segundos caminan evidentemente con las piernas de la primera, y combatir la inmigración significa combatir la llegada, la instalación y la permanencia de los inmigrantes, por lo demás en nuestro país casi siempre ilegales en el sentido de la propia normativa vigente.
Pero considerar a los inmigrantes la consciente quinta columna de una guerra de conquista, cuando son a la inversa los gérmenes patógenos de un desarraigo universal que vacía y destruye las culturas y las economías de procedencia y saquea hasta reducirlas a ruinas las de destino (más allá de las momentáneas ventajas que aún están por demostrar), parece fruto de un "complotismo" que termina por revelarse políticamente funcional como discurso de legitimación para una "microguerra local de bandas", que es precisamente uno de los aspectos mas caracteristicos de la sociedad multirracial a la americana.
Evidentemente, también aquella de la "trata de esclavos" es una metáfora. Los inmigrantes, no sólo en Francia, apenas llegados se "empadronan" se benefician en la mayoría de los casos de un inmediato acceso a los bienes de consumo normalmente muy superior al que gozaban en los países de procedencia; se integran casi inmediatamente en la economía más o menos ilegal, cuando no criminal, de las respectivas comunidades; obtienen beneficios, ayudas y asistencia pública, con condiciones incluso discriminatorias para las poblaciones autóctonas. En una palabra, se "aburguesan". ¿Pero acaso es esto lo que entendemos por "victoria" y por "conquista"? Después de lamentar una tal suerte para las poblaciones europeas, ¿reconocemos en ella una "victoria histórica" de los inmigrantes? Del mismo modo se podría sostener que el proletariado o la Unión Soviética "han vencido", porque, hoy, con un poco de fortuna pueden comprar algún foulard de Hermes en las rebajas del supermercado occidental…
En "El Arqueofuturismo" Faye critica tal vez con exceso las que él mismo define como sus pasadas posiciones, y el proyecto político resumido en el título del libro "Europe-Tiers Monde, méme combat" de Alain de Benoist. Es absolutamente cierto que en Arabia Saudita un "pagano" o un "ateo", a diferencia de un cristiano o un judío, no tienen ningún derecho de entrada, y que los musulmanes desprecian a los europeos (por lo demás, como reconoce Faye, perfectamente con razón). Es cierto que son ilusorios "acuerdos" y "alianzas" entre mundos que en gran parte compiten para mejor comprometerse con el común enemigo americano. Pero no es en absoluto necesario que la detención del "ataque demográfico", o de una "colonización" que sólo es tal en el sentido zoológico del término, devenga objeto de un "acuerdo negociado" Europa-Tercer Mundo, según la hipótesis debenoistiana de la época (hoy desfasada en el "comunitarismo etnopluralista" de la Nueva Derecha ya tratado).
La verdad es que los países del Tercer Mundo que conservan algún residuo de independencia política o de cultura comunitaria e identitaria no han sido antes y no son ahora países de emigración, puesto que en ellos se entiende comúnmente que los recursos humanos pertenecen a la comunidad nacional, y pueden y deben ser empleados para resolver los posibles problemas comunes, e igualmente para compartir el destino común.
Y no es casualidad, exactamente como sucedió en Europa, que el enfriamiento y la inversión de los flujos migratorios siempre ha dependido constantemente del grado de sometimiento o independencia del país implicado (ver en nuestro continente como ejemplos a la Escocia después de la batalla de Culloden, la Irlanda dominada por los ingleses, la Alemania de los pequeños estados preguillerminos…). Exactamente como inversamente proporcional al grado de sometimiento político resulta la presión demográfica autóctona –lo que deja no sorprendentemente a Italia y Alemania en el fondo del mismo grupo europeo-occidental, ¡con la tasa de natalidad más baja de la historia de nuestro continente, como anota Faye, del tercer siglo después de Cristo!
Por lo demás, en términos ciertamente no de "cohabitación", sino más bien de "consistencia histórica posible, hemos ya apuntado que el cristianismo es intrínsecamente misionero y universalista (y aún lo es más en sus formas secularizadas), y por consiguiente inevitablemente llamado a "convertir" y adulterar con todos los medios las culturas ajenas; el judaísmo es fundamentalmente cosmopolita y por ello llamado a insertarse como cuerpo extraño etno-religioso en las otras culturas y comunidades y a minar y negar su cohesión interna; el Islam es hoy fundamentalmente el monoteísmo identitario de una comunidad etnocultural compuesta, ciertamente antifaústico y fundado sobre el rechazo de la visión europea de la historia, ciertamente imperialista e investido por una misión divina de autoafirmación, pero sobretodo, y, no sin razón, preocupado de no ser asimilado.
Tal diversificación tiene orígenes no solamente en diferencias teológicas, sino en experiencias históricas muy concretas que han envuelto a las tres religiones, llevándolas a ser lo que son, de tal modo que el Islam es el único en poder reivindicar con buen derecho una especie de "autoctonía" (que en el ámbito monoteísta sólo las corrientes sionistas del judaísmo buscan, no por casualidad, remedar con la constitución del Estado de Israel). En tal sentido, el expansionismo islámico, con la excepción quizás de la compleja vivencia de la primera islamización de Persia, parece ciertamente más cercano, a pesar de todo, a los modelos tradicionales de expansionismo político-culturales propios a todas las civilizaciones que al tipo de influencia etnocida ejercida en Occidente y en todo el mundo por el judeocristianismo, primero, y por sus variantes secularizadas que conocemos con el nombre de Sistema después; y por ello parece ciertamente menos inclinado a malgastar la propia voluntad de poder en la conversión y la adulteración forzada y/o en la dominación oculta.
Simétricamente, a diferencia de la mentalidad propia al judaísmo y al cristianismo, las poblaciones musulmanas derrotadas y sometidas, como reconoce Faye, siempre se encierran en el fatalismo y en la preservación de las propias tradiciones, sin representar ningún particular potencial de "envenenamiento" para aquellos que han llegado eventualmente a dominarles. Parece así difícilmente admisibles, y casi increíbles en boca del autor, algunas declaraciones en las que se deja arrastrar en su brillante discurso, como aquella (pág. 147) según la cual… "el pagano puede vivir sin conflictos con el cristiano o el judío, pero no con el musulmán" (¡!)
Del mismo modo, me parecen históricamente muy dudables, y políticamente desmovilizadoras, las opiniones según las cuales "es más fácil liberarse de unos "jeans" que de un chador, de un McDonald´s que de una mezquita". La historia está repleta de culturas que se imponen sobre otras culturas, para luego sufrir el desquite; las mezquitas fueron ya extirpadas sin mayores problemas de España, de Sicilia y de los Balcanes; la destrucción de todo testimonio cultural en el magma indiferenciado del Sistema, especialmente allí donde deviene completa, parece, según el actual estado de las experiencias, más irremediable.
Así, este tipo de afirmaciones, que sería erróneo extrapolar del contexto globalmente condivisible de la obra que comentamos, me parecen muy peligrosas bajo tres perfiles. El primero: la desenfatización de ese componente del aspecto propiamente racial y demográfico del problema, sobre el cual Faye ha insistido antes como una de las componentes trágicamente ignorados en las tendencias asimilacionistas o multiculturalistas por él criticadas. El segundo, estrechamente unido al primero: la objetiva continuidad que se genera con las posiciones del clero católico "combativo", que ya pagó el cambio con un lento declive de las vocaciones y del peso religioso contra el reconocimiento y el respeto social ahora unánimemente compartidos en exclusiva con los "hermanos mayores" de religión hebrea, y que hoy no tolera la improvista llegada de los "primos" mahometanos, convocando así a ciertos cruzados según quienes "nuestra cultura" será defendida solamente prohibiendo el culto islámico o expulsando al mar a los prófugos (europeos, a pesar de todo) de Bosnia, mientras serían bien recibidos los párrocos del Zaire, las criadas filipinas, los obreros andinos, las hermanas jamaicanas, los programadores israelíes…
Y, en tercer lugar, el hecho de que la pseudo-cultura de los McDonald´s y los jeans preparan y hacen posible exactamente el tipo de sociedad en donde conviven mil sectas entre sí, con el indiferentismo común y mayoritario, entre cientos de razas diversas sobre el mismo territorio. Todo el mundo es ciudadano, todos van y vienen, se entienden en inglés, no hay razón para no llevar a casa el propio pedacito de folklore o de creencia, o para no organizar la propia banda étnica en la cual encontrarse y encontrar un sucedáneo de política en el enfrentamiento tribal contra el barrio o el condominio confinante.
Retornando sobre un plano más filosófico y cosmo-histórico, uno de los eslóganes propuestos por "La colonización de Europa" es "Del etnopluralismo al etnocentrismo". Tales posiciones siguen los pasos de una ulterior crítica a la extremización (o mejor, en realidad, a la "externalización") de las posiciones antiuniversalistas de la Nueva Derecha.
También en este caso la Nueva Derecha ha partido de presupuestos correctos, y sobre todo capaces de derrotar políticamente al interlocutor "politically correct", precisamente por la constatación de la fundamental irreductibilidad de las civilizaciones y de las razas humanas, de modo que toda hipótesis de "igualdad humana" en sentido intercultural es en primer lugar ofensiva y lesiva para la identidad y el legítimo orgullo de pertenencia del "igualado". "Igualado" que es aburridamente asimilado, desde un punto de vista ideal antes que práctico, en una "humanidad" genérica definida sobre la base de parámetros occidentales, en donde como en Schelling "todas las vacas son grises", negando implícitamente el mismo derecho del Otro a la existencia –lo cual termina por reflejo negando implícitamente la existencia del Uno.
El subrayado de tal consecuencia "racista" inscrita en los postulados ideológicos del Sistema pertenece, por lo demás, a una estrategia más general del "déplacement" siempre aplicada en los ambientes de la Nueva Derecha, como ya hemos visto por ejemplo elevando a sistema el hecho de relanzar las tesis más inconvenientes a través de la sagacidad de citar entre comillas a personajes "santificados" por cualquier discrepancia con los regímenes fascistas históricos (quizás por repugnancia hacia un guardia urbano, o paradójicamente por… extremismo político mal conciliable con la "centralidad" mussoliniana o hitleriana), de la serie "he aquí, si queremos citar las ideas incómodas ya perseguidas también en los años treinta, etc."; y en este caso gritando a la inversa: "no respetan el derecho a las diferencias y las características concretas y específicas de las poblaciones extraeuropeas" (acusación que muchos toleran si se refiere a nuestra cultura y raza, pero que deja un fuerte sentido de incomodidad si se generaliza en una acusación de "injusticia" hacia los otros).
Al igual que en el ejemplo citado se termina en verdad por ser influenciado por todas las componentes más bizarras, lunáticas y marginales del mundo antiliberal de la primera mitad del siglo XX, también el discurso de la Nueva Derecha relaciona la cuestión de la originalidad e incompatibilidad de las culturas que termina siempre por desembocar en la idea perniciosa de una fundamental equivalencia entre la civilización y la raza, de una "par dignidad" acordada incondicional y automáticamente en toda dirección histórica y geográfica.
Desde aquí no hay mas que un paso para admitir incluso una inferioridad de la civilización europea, o al menos de la civilización europea históricamente existente, tesis que por lo demás ya había sido aceptada tanto en los ambientes tradicionalistas ("ex oriente luz", la "acción" como sierva de la "contemplación", la decadencia moderna y el reino de la cantidad respecto a la conservación a través de usos y costumbres más cercanos a una presunta Tradición ancestral común) como en los ecologistas y neoprimitivistas (con sus declaraciones en favor de sociedades históricamente extrañas, en supuesta armonía con la naturaleza, "no-agresivas" antifaústicas).
Tal conjunto de ideas es justamente rechazado por Faye como fruto y manifestación de un disolvente oscuro, de un etnomasoquismo enfermo que reniega de las propias raíces y no puede percibir intelectual ni afectivamente la absoluta peculiaridad de la propia identidad respecto a la identidad de los demás.
En oposición a ello, el autor retiene de nuevo la afirmación polémicamente opuesta de la superioridad de la cultura europea, que el libro "demuestra" con ejemplos y argumentos cuando menos convencionales y propios del siglo XIX, como la comparación entre Miguel Angel y la estatuaria precolombina, entre Mozart y la música ritual del Asia u Oceanía, enumerando además los legados de la cultura europea "en campos tan diversos como la arquitectura, la poesía, la literatura, las artes plásticas, la música, la astronomía, la física, las ciencias naturales, las matemáticas, la filosofía, la espiritualidad, la medicina, las técnicas aplicadas".
Ciertamente, cualquier tentativa de devolver a los europeos "conciencia de sí" es seguramente apreciable. Pero el discurso de "La colonización de Europa" deviene tan ambiguo y desviado como aquellos a los que se opone el autor cuando él mismo termina por escribir: "Existen criterios objetivos y universales de comparación entre las civilizaciones". O peor aún, en una caída absolutamente insólita de Faye en el tópico y en lo "políticamente correcto": "Hay religiones objetivamente superiores a otras porque sus obras espirituales son más elevadas (?) y porque no han dado lugar a masacres" (!).
Ahora bien, la idea de la "superioridad objetiva" es exactamente el punto de vista del extremismo "blanco" americano, del colonialismo franco-británico y tambien del reciente occidentalismo liberal (como por ejemplo, en Francis Fukuyama), y está tan viciada en sus presupuestos como es perjudicial en sus recetas prácticas. Por mucho que pueda aparentar ser "etnocentrista", comporta en realidad la admisión de una comparación universalista "entre naranjas y manzanas", como dicen los ingleses, algo extraño a la experiencia y al espíritu de las grandes civilizaciones históricas. Escribe Faye: "Los pueblos de larga duración, las civilizaciones vivaces siempre se han creído centrales y superiores", y cita como ejemplos a la China y al pueblo judío. Trasladando aquí las cuestiones más complejas y absolutamente peculiares que posee éste último, es perfectamente cierto que todas las grandes culturas y razas siempre se han considerado "superiores", pero en relación a los valores que ellas mismas se daban y expresaban, sin importarles mínimamente que en la base de tales reivindicaciones obvias (y contingencias) hubiese o no cualquier "verdad objetiva" de naturaleza universal, supercultural e interracial.
También me parece equívoco el criterio del "suceso histórico", porque tal "suceso" de la civilización europea es hoy peligrosamente puesto es discusión sobre el plano cultural y biológico, sin que ello deba mínimamente poner de nuevo en discusión la fidelidad que debo tributar a la misma civilización europea. Y secundariamente porque el mismo criterio está evidentemente influenciado por un punto de vista exactamente occidental-europeo, puesto que el "suceso" (versión pervertida de la idea de la "gloria inmortal" específica de la mentalidad indoeuropea, y por nada universal) es ya un sistema de medida culturalmente relativo, y como tal puede representar bien poco, o ser completamente incomprensible, en la perspectiva original, no occidentalizada, de la cultura malgache o de la tibetana.
Aún peor me parece el recurso a los "reconocimientos" que a la "superioridad" europea vemos tributar por otras culturas ("En el Japón, por ejemplo, la música europea es reconocida como más evolucionada que la música nacional"). Es fácil identificar en muchos de tales reconocimientos nada más que la manifestación del desarraigo impuesto por el colonialismo cultural del sistema occidental, o nada menos que la regresión a un estadio ulterior de degradación, un equivalente local del exotismo folklórico y de la xenofilia que Faye reprocha a los europeos (ver los coreanos que cenan en restaurantes con los camareros disfrazados de gondoleros o con traje tirolés). Pero en otras ocasiones, los mismos reconocimientos no son sino la manifestación de un fenómeno legítimo de (crítica y limitada) "cross-pollination" cultural, que siempre ha existido a nivel de las élites, y absolutamente funcional en el nacimiento, desarrollo y floración de las grandes culturas (que para ser sí mismas tienen necesidad de otro del cual distinguirse y con el cual relacionarse dialécticamente), al cual se opone Faye, declarándose provocadoramente partidario del "aislacionismo cultural".
El pensamiento identitario de matriz, decíamos, italogermano y centroeuropeo se funda sobre una afirmación voluntarista de valores, tradiciones y elementos culturales que son defendidos y propugnados simplemente porque son los reconocidos y reivindicados como propios. Y ello sin necesidad de recurrir a una dudable Razón Universal, como tal susceptible de ser desmentida (¿qué le importa a un indio boliviano que nunca ha tomado contacto con el Occidente el pensamiento de Heráclito, o sobre qué bases debería reconocerlo como "superior" y prescindir de la cultura irreduciblemente distinta en la cual vive él?).
La misma teoría nacionalsocialista de la "raza superior", correctamente entendida, retiene la afirmación de ciertos valores y elementos a un nivel completamente interno a una dialéctica alemana y europea, a un juicio aparentemente fundado sobre elecciones y pertenencias ya dadas por descontado, y a una voluntad de poder colectiva y autofundada. A ningún autor o dirigente de tal ambiente se le habría pasado por la mente la idea de que la civilización europea pudiera ser considerada "superior" desde el punto de vista de un judío, un africano o un japonés, así como estaba claro para todos que el juicio diverso sobre estas tres razas y tradiciones, por ejemplo, fuese el único juicio posible sobre ellas: era el juicio desde el punto de vista europeo, alemán y nacionalsocialista, y no el de un inexistente "observador desencarnado".
En el momento en que –después de haber reconocido (y luego inexplicablemente olvidado) que cada raza y cultura no puede sino considerarse superior desde su propia perspectiva– introducimos la idea según la cual existe una posible "discusión" al respecto fundada en referencias comunes y "objetivas", justificamos evidentemente la "conversión" a la "superior" civilización occidental, conversión que a su vez termina por justificar la "acogida" por parte de ésta última de elementos humanos y culturales extraños, así "convertidos" y mestizados, a lo más bajo una temporal "tutela" europea, pero al final, inevitablemente, inmersos en la entropía étnica total.
Estoy perfectamente de acuerdo con el hecho de que los europeos deben ante todo (pre)ocuparse de su identidad cultural y racial antes de angustiarse por la de los otros, que además corren menos riesgos. Pero también es cierto que todo ataque occidental a la identidad de los otros representa una llama que ataca por ambos lados, porque el mestizaje étnico y cultural anula cualquier especificidad de pertenencia.
Y estas especificidades son, como reconoce Faye, una riqueza que condiciona la misma capacidad de la especie humana en su complejo de conservar la propia peculiaridad respecto al resto de la biosfera, sobrevivir y realizar el propio destino. Las razas y culturas humanas no son solamente como las razas de los caballos o de los perros. Son también experimentos, a escala cósmica y macrocósmica, de una autocreación en la cual el hombre es trágicamente llamado para ser, o mejor devenir, aquello que es. Por ello, toda gran civilización ha necesitado de la existencia y de la resistencia de otras poblaciones distintas, en términos genéticos, espirituales, lingüísticos, para autodefinirse y adquirir, polémicamente, una consistencia de sí. Lo repetimos una vez más: quien afirma agresivamente la propia identidad es un rival contingente, que la niega y reniega ("te envenena también a ti") con éxitos potencialmente fatales para todos los pueblos.
Al contrario, Faye tiene perfectamente razón cuando subraya la absoluta prioridad, entre las varias cuestiones políticas actuales, de la cuestión relativa a la inmigración alógena, como amenaza a la supervivencia étnica, física y biológica de los pueblos europeos.
En este sentido toda otra cuestión es relativamente secundaria, en cuanto que ésta representa la amenaza última, la catástrofe irremediable que hoy nos amenaza.
Pero de nuevo a mi parecer hay que añadir un nuevo dato, a nivel político, sobre la inserción de tal fenómeno en un escenario migratorio, e "inmigratorio", más complejo, que en cierto sentido constituye también el cuadro que hace posible, facilita o acompaña, tal "inmigración de población" fundamentalmente etnocida.
Intento obviamente hacer referencia a la inmigración que, por ejemplo, recibe hoy en día Italia de la Europa suroriental (Albania, Rumanía, ex Yugoslavia en primera fila), por ser un veinte por ciento del total y que técnicamente puede ser considerado un flujo interno europeo, y que aun siendo la única reprimida por el poder constituido (aunque sea con resultados ridículos) comporta consecuencias sociales desastrosas en términos por ejemplo de criminalidad común y mafiosa, de orden público, de ilegalidad difusa, que a su vez afecta a la ya limitada capacidad de resistencia y conciencia identitaria de las poblaciones más directamente expuestas. Igualmente merece ser mencionada la migración interna del Sur al Norte presente en muchos países europeos, así como de la "periferia" al "centro", en la última fase de un proceso re-instalación y proletarización (o mejor, "movilización" a la americana) que aún no ha terminado de consumarse así como aún no ha terminado de consumarse la destrucción en curso de las identidades regionales bajo el ataque concentrado de la inmigración alógena y de la "naturalización" forzada centralista aún en acto.
Reconocer el "status" de europeos a los albaneses o a los rumanos, y subrayar la paradójica discriminación sustancial que éstos sufren respecto a los senegaleses, los chinos, los filipinos o los zulúes, no significa aprobar o tolerar el traspaso en masa de aquellos a nuestras ciudades, o la implantación masiva de comunidades extrañas –y además parasitarias, nómadas o criminales– sobre el territorio italiano.
Así como la pertenencia al mismo Estado-nación no puede representar una justificación para la perduración en vastas áreas europeas, concretamente en el sur de ciertos países, de círculos viciosos típicos de la emigración – subdesarrollo – asistencialismo – clientelismo – mafia - emigración, que generan presiones fiscales y distorsiones económico-políticas inaceptables en las regiones urbanas y en el norte, causa a su vez de disgregaciones sociales según el modelo mexicano-brasileño, y de sucesivas e irresponsables importaciones de mano de obra a bajo precio sobre todo el territorio (ver la actual situación de la agricultura en el valle del Po).
Estos fenómenos, lejos de ser irrelevantes, constituyen el marco en donde se inserta y prospera el etnocidio de las poblaciones europeas autóctonas, contribuyendo a desquiciar los "fundamentos" comunitarios de una posible resistencia, como parecen al menos haberse dado cuenta las áreas más conscientes del legismo italiano, del movimiento bretón o del nacionalismo galés.
En fin, hemos visto cómo Guillaume Faye profetiza la guerra civil étnica sobre el suelo europeo. Que será, como él mismo precisa, antes que una guerra civil del tipo clásico y fratricida, una guerra de liberación nacional, en sentido muy literal.
El autor manifiesta sin embargo, con razón, una desconfianza absoluta en la capacidad de nuestra sociedad para administrar el impacto del asentamiento masivo de poblaciones y culturas alógenas y hostiles (sea a través de la absorción forzada o a través de la implantación de un modelo social "multicultural" y neotribal) y en la posibilidad actual de contrastar el fenómeno en el ámbito de la pura política gubernamental o en el ámbito de la legalidad constitucional e internacional del Sistema, y es así que prevé el alcance en todo caso de un punto de ruptura que ponga en discusión los procesos denunciados. Y no sólo. Confía en que tal crisis se produzca, como elemento necesario para que pueda producirse un vuelco de la mentalidad presente y del escenario político contemporáneo, en un contexto sustancialmente insurreccional.
Ahora bien, que no existen soluciones prácticas en el interior del contexto político y cultural contemporáneo es perfectamente cierto, así como lo es el hecho de que se debe tener el coraje salir decisivamente de los parámetros mentales de la "political correctness" y de los regímenes democrático-liberales tradicionales. La "espera de la crisis" en el pensamiento de Faye, crisis étnica en "La colonización de Europa" como económica y ecológica en "El Arqueofuturismo", amenaza sin embargo de colorearse de aspectos mesiánicos, en el sentido en que la Revolución comunista era la espera de la extrema agravación de la explotación, de la concentración de la propiedad de los medios de producción y de la lucha de clases. Por lo demás puesto que tal crisis es tanto más probable cuanto más brutal, cuanto menos gradual es el fenómeno combatido, tal postura lleva a una valoración ambigua de su agravación, por sus auspiciadas potencialidades "catastróficas", en sentido etimológico; valoración que amenaza confinar, como en todos los "adventismos" religiosos y laicos, con una "lógica de lo peor", a nivel político fundamentalmente desmovilizante, en cuanto incoherente con los valores defendidos. Una lógica verdaderamente peligrosa, exactamente a la luz de la potencial irremediabilidad, sobre lo cual el mismo Faye insiste mucho, de procesos que inciden sobe la misma existencia física del sujeto histórico europeo, entendido como grupo etnocultural concreto. Soy, en efecto, en cierto modo más pesimista que el autor; y no se me escapa, bajo la falsilla de las reflexiones de Giorgio Locchi, que, si la historia es verdaderamente "abierta", el mismo fin de la historia es posible; que, a pesar de la resistencia siempre renaciente a la misma, la entropía cultural racial y lingüística encarnada por el Sistema puede perfectamente realizarse hasta el fondo, también a precios y con costos hoy impensables para sus actores. De la "crisis" profetizada no me parece en efecto cierto ni su verificación –especialmente allí donde y cuando la gradualidad, la aceleración de los fenómenos extiendan la toma de conciencia y de reacción colectiva–, ni sobre todo el éxito. Para que estalle la guerra de liberación, y sobre todo para que resultemos vencedores, debe haber alguien dispuesto a combatir. El etnocidio de por sí no genera revuelta, o al menos revuelta de relieve político, como la crisis económica y la explotación no generan por sí la revolución, o la difusión del pecado y los cataclismos simbolizadores del adviento del Anticristo generen de por sí las condiciones para la Segunda Venida.
Pero, mientras el mito solsticial ("la ocasión se manifiesta a quien la sabe atender", "donde el peligro es mayor, allí nace lo que salva", "tocar el fondo del cual ya no se puede salir", "nada hay más oscuro que la medianoche", etc.) representa una referencia espiritual ineludible para quienes hoy se baten por el renacimiento y la misma supervivencia de Europa, es útil reafirmar que no es la crisis la que provoca la "ruptura del tiempo de la historia" de la que representa a lo sumo la ocasión, sino que es la voluntad histórica del sujeto que en ella se esconde.
Y no sabremos cómo suscitar, mantener y cementar tal voluntad si no es a través de una acción y una praxis militante y coherente con los principios afirmados, que impongan hoy combatir la colonización y el etnocidio de Europa a todos los niveles y en todos los ámbitos posibles y concretamente en la elección política y personal cotidiana, ciertamente en la conciencia de su insuficiencia y en la determinación de aprovechar el cambio de las condiciones comúnmente destinadas a producirse, pero también en el apoyo constante a cualquier iniciativa de contraste y contención que se ofrezca concretamente.
Traducción de Santiago Rivas
Notas
(1) Grupo de Investigación y Estudios para la Cultura Europea. "Grece", en francés, significa "Grecia" [NdT]
(2) Con el título "Il sistema per uccidere i popoli" (El sistema para matar a los pueblos), Societá Editrice Barbarossa, Milano 1997.
(3) Indagaciones sobre los Derechos Humanos.
(4) Nuevos discursos a la Nación Europea.
(5) Occidente como decadencia.
(6) Ediciones Nueva República. Barcelona 2003.
(7) (El eclipse de lo sacro). Editions du Labyrinthe. París 1990.
(8) Traducido al español por Klaas Malan y disponible en red-vertice.com
(9) La Colonización de Europa. Edición particular. Madrid 2001
(10) El grupo dirigido por Gianfranco Fini, que aglutina a los denominados "postfascistas" procedentes del antiguo MSI:
(11) "Catto-comunista", expresión corriente en el lenguaje político italiano y de difícil traducción literal a otras lenguas. En sí, hace referencia a las corrientes de la Iglesia Católica permeables a las ideologías progresistas en general y no tanto marxistas en particular.
(12) Se trata de una famosa asociación cultural y folclórica celticista. Los Arvernos fueron una de las tribus de la antigua Galia.
(13) Referencia a la famosa obra de Julius Evola, "Rivolta contro il mondo moderno".
(14) Beur: joven árabe nacido en Francia de padres inmigrantes.
(15) "El Islam y los EEUU. Una alianza contra Europa". Inédito, no publicado. Madrid 2000.
(16) se trata de una broma: los prefijos telefónicos internacionales, desde Italia, comienzan todos 000.
(17) Obviamente escrito antes de la segunda Guerra del Golfo y la posterior ocupación americana.
[Extraído de la Revista L'Uomo Libero, número 51, Mayo de 2001]
00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, guillaume faye, identité, européisme, europe, affaires européennes, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 décembre 2008
Nationalisme, concert européen impérial, nouvelle droite et renouveau catholique
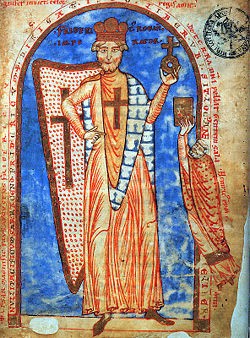
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1994
Nationalisme, concert européen impérial , nouvelle droite et renouveau catholique
Entretien avec Robeert STEUCKERS - Propos recueillis par Xavier Cheneseau
Animateur des revues «Vouloir» et «Orientations» (qui ont pris peu à peu la place d'«Eléments» dans le public de la «Nouvelle Droite», pouvez-vous nous dire comment vous percevez le retour des nationalismes en Europe?
Le terme «nationalisme» recouvre une quantité d’aspirations politiques, parfois divergentes. Alors, je commencerai par mettre les choses au point: pour moi, le «nationalisme», en tant qu’idéologie et pratique politiques, dérive tout naturellement du mot «nation»; au sens étymologique, c’est-à-dire au sens premier, le mot «nation» contient la même racine que «naître» (du latin «nascere»/«nasci», «natus»). La nation est donc la grande famille dans laquelle je nais, et aussi le sol où cette grande famille s’est épanouie. La nation est donc le peuple et le pays au sens charnel du terme. Toute autre définition de la nation est pour moi abusive, tronquée ou extrapolée. Donc fausse. Comme l’Europe est faite de multiples nations, voisines les unes des autres, le philosophe, l’historien ou le militant qui pensent en termes de nationalité déploient automatiquement une pensée qui accepte la variété, la diversité, la multiplicité, la pluralité et s’en réjouissent. Il veut un monde fait d’une infinité de coloris et non un monde de grisaille, comme nous en connaissons dans les banlieues de nos grandes villes. Cette définition de la nation postule que je dois admettre que l’autre veuille gérer son destin local à sa manière. Mais cette multiplicité est difficile à gérer à l’échelle de notre continent, surtout à l’heure où de vieux peuples réclament une structure étatique propre et une voix dans le concert européen. De cette revendication peut jaillir un nouveau désordre, si toutes ces entités politiques, les vieilles comme les nouvelles, se ferment sur elles-mêmes et se refont la guerre au nom de querelles anciennes. Mais si l’on se place directement au niveau européen, au niveau de notre civilisation, et que nous acceptons que cette civilisation s’exprime par une grande variété de modes et de façons, on s’efforcera automatiquement d’élaborer un droit des gens capable de gérer cette diversité sans heurts. Et ce droit des gens s’inspirera des techniques impériales (propres au Saint-Empire médiéval), des modalités fédéralistes de gestion de l’Etat (Suisse, RFA) et acceptera les clauses de la CSCE quant à la protection des minorités linguistiques. En effet, le retour des nationalismes n’est pas tant un retour à l’Etat fermé qu’une volonté de se débarrasser des centralismes trop contraignants et des modes de gestion propres au communisme marxiste-léniniste et au technocratisme libéral occidental. Aujourd’hui, grâce aux nouvelles technologies de communication, le centralisme rigide d’autrefois n’est plus de mise. L’homme du 21ième siècle devra faire face à cette triple nécessité: nécessité géopolitique de concevoir l’unité de l’Europe, nécessité éthique de respecter les diversités productrices de richesses et nécessité pratique de mettre les appareils politiques au diapason des nouvelles techniques de communications.
Ces nationalismes peuvent-ils déboucher sur l'émergence d'un Empire européen?
Il me semble qu’il est encore trop tôt pour parler d’«Empire européen». D’abord parce que la logique impériale, qui est fédérale, et fonctionne selon le principe de subsidiarité, n’est pas également répartie en Europe. Il subsiste des zones rétives à cette logique de pacification intérieure du continent. Je crois qu’il faut d’abord travailler au sein d’une structure qui existe et qui est la CSCE (qui regroupe tous les pays européens, Russie comprise, plus les Etats-Unis et le Canada). L’idéal, ce serait que la CSCE évolue vers un concert civilisationnel européen et euro-centré, que les Etats-Unis et le Canada s’en retirent pour concentrer leurs efforts sur l’ALENA (Association de Libre-Echange Nord-Américaine). Les Etats d’Amérique du Nord (USA, Canada et Mexique) auront une longueur d’avance: tous trois sont effectivement gérés par un système fédéral. Ce qui facilite les choses. La CEE, c’est-à-dire l’Europe de Maastricht est insuffisante. La fermer sur elle-même est une erreur géopolitique et une injustice sociale à l’égard des pays de l’Est. De plus, sur le plan stratégique et militaire, cette CEE n’est pas viable. La seule entité géostratégiquement viable à très long terme, c’est l’union stratégique des pays européens et asiatiques de la CSCE, reposant sur une interprétation du droit des gens qui accepte les différences culturelles, les gère et les cultive. L’erreur de la CEE a été de vouloir uniformiser l’économie avant d’arriver à un accord inter-européen sur les principes de droit (droit des gens et droit constitutionnel). Le travail de la CEE a été de déconstruire les barrières douanières en tous domaines. Il est évident que c’était peut-être nécessaire dans certaines grosses industries (le charbon et l’acier, d’où la CECA) mais nullement en agriculture. Résultat, nous avons partout en Europe des zones périphériques déshéritées, incapables de sortir de la mélasse puiqu’elles ne peuvent plus recourir à la technique des barrières douanières pour protéger l’emploi chez elles. De surcroît, globalement, l’Europe n’est pas indépendante sur le plan alimentaire, ce qui la met à la merci des puissances exportatrices de céréales (les Etats-Unis). La CSCE est intéressante parce qu’elle repose prioritairement sur le droit et non sur l’économie. Et ce droit règle notamment des problèmes de minorités, qui sont des entités collectives porteuses de culture. Si un «Empire européen» doit advenir —mais je préfère parler d’un concert européen intégré— il reposera sur la généralisation d’un droit constitutionnel de type fédéral, sur la défense de toutes les minorités linguistiques et culturelles et sur l’effort concret de parvenir à l’indépendance alimentaire.
Longtemps la «Nouvelle Droite» s'est présentée comme païenne, comment voyez-vous le renouveau du catholicisme en Europe et dans le monde?
Je tiens beaucoup à préciser que le paganisme, pour moi, dès le départ, n’a jamais été la volonté de forger un comportement religieux nouveau, mais essentiellement une défense des humanités gréco-latines et l’étude des racines culturelles de tous les autres grands goupes ethniques européens. Ces «humanités» nous dévoilaient une conception du droit et de l’Etat (des «res publicae», des choses publiques: notons le pluriel!) qui pourrait parfaitement nous inspirer encore aujourd’hui. Je rappelle aux zélotes d’une religion caricaturale et sulpicienne que les notions de droit, propres aux Romains, aux Grecs et aux Germains, sont plus anciennes que la religion chrétienne et que ce sont eux qui forment véritablement l’armature de la civilisation européenne. Bien sûr, j’ai toujours reproché aux cercles de la Nouvelle Droite de ne jamais avoir exploré cette veine-là et d’avoir voulu rétablir un culte païen, en ne tenant pas compte du fait que l’Europe pré-chrétienne était animée par une religion de la Cité, c’est-à-dire une religion éminemment politique et non prioritairement esthétique, morale ou éthique. En voulant théoriser une «éthique païenne» ou recréer ex nihilo une «esthétique païenne», avant de rétablir le droit romain ou germanique dans sa plénitude et dans son sens initial, les vedettes les plus bruyantes de la «Nouvelle Droite» ont fait du christianisme inversé, ont tout simplement joué, comme des adolescents irrévérencieux, à renverser les tabous de leur éducation catholique. C’était stupide et peu constructif. Quant au renouveau catholique, je suis sceptique. Evidemment, plusieurs revues italiennes, plus ou moins proche du Vatican (Il Sabato, 30 Giorni), publient des textes de grande valeur, qui renouent avec les grands principes généraux de la politique romaine et abandonnent les chimères de Vatican II ou de mai 68. Par ailleurs, la dépravation morale contemporaine, due aux excès de matérialisme socialiste ou capitaliste, rend attirantes la religion en général et l’idée de communauté fraternelle en particulier. Mais, je ne suis pas prêt à parier pour un catholicisme qui voudrait réduire à néant les acquis du protestantisme ou le caractère sublime de l’orthodoxie gréco-byzantine et russe ou reprendre une croisade contre l’Islam ou dénaturer le vieux fond gréco-celto-romano-germano-slave. Chez les catholiques, il faut retenir, à mon sens, mais en laïcisant ces intuitions et en les ramenant à leur matrice juridique romaine:
1) L’idée d’un œkumène européen, animé par une nouvelle synthèse spirituelle (ce qu’avait voulu réaliser le Tsar Alexandre Ier après la parenthèse napoléonienne).
2) La notion de forme politique basée sur la famille (mais non plus la famille nucléaire actuelle ou évangélique, mais la “gens” au sens romain ou la “Sippe” au sens germanique). Carl Schmitt est le penseur qui a théorisé la notion de «forme politique catholique (au sens d’universel)». Il faut le relire.
2) Reprendre, en les laïcisant, les linéaments du catholicisme social, tant dans sa variante corporatiste que dans sa variante sociologique (Othmar Spann).
3) En France, s’inspirer des études de Stéphane Rials et de Chantal Millon-Delsol, pour y généraliser un droit inspiré par la subsidiarité.
Le renouveau catholique ne saurait être, pour mes camarades et moi-même, le triste guignol intégriste avec ses monstrations esthétiques et ses vaines recherches d’une vérité éthique; ce qui fait urgence, c'est bien le retour à une forme romaine du politique, valable pour toute l’Europe. Un véritable renouveau catholique devrait abandonner la fibre religieuse évangélique, renoncer à toute forme de bigoterie, sphères où désormais les pires simagrées psycho-pathologiques sont possibles, où ont sévi les pires vecteurs de l’anti-politisme, pour redevenir purement et pleinement religiosité politique. Il ne faut retenir du message catholique que ce qui a amélioré et perfectionné le vieux fond politico-juridique romain (au sens pré-impérial, républicain, du terme). Méditons en ce sens Caton l’Ancien.
00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, politique, théorie politique, nationalisme, empire, renouveau catholique, catholicisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 02 novembre 2008
Misère des intellectuels de "droite"

ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
Misère des intellectuels de “droite”
L'option métapolitique de la “nouvelle droite” est, dans l'espace culturel germanique, une importation française. La ND, regroupée autour d'Alain de Benoist, a tenté d'adapter à la droite la théorie du communiste italien Antonio Gramsci, à un moment de l'évolution de cette droite, moment où elle se demandait quels étaient les véritables ressorts de la société. Point de départ de Gramsci: la société n'est mue que partiellement par les groupes politiques visibles, c'est-à-dire les partis. Plus essentielle est la superstructure idéelle de la société, où sont façonnées valeurs, morale et idées. La tâche des “intellectuels organiques” serait alors de mener un combat culturel au sein même de cette superstructure, combat dont le but ultime ne peut être que la révolution. D'après Gramsci, on ne peut donc révolutionner une société que si l'hégémonie culturelle qui la régente est brisée, c'est-à-dire quand les tenants de cette hégémonie ne croient plus en eux-mêmes. C'est alors que les valeurs révolutionnaires prennent le pas sur les valeurs dominantes fragilisées et deviennent graduellement hégémoniques. Le combat culturel mené par les intellectuels devient dans une telle optique la stratégie principale du “révolutionnement” politique de la société.
Dieter Stein, le directeur de l'hebdomadaire néo-conservateur berlinois Junge Freiheit, a analysé très justement cette vision gramscienne de la révolution, qui ne survient que par le biais de la culture; au bout de son analyse, il lance un avertissement: une telle vision de la révolution culturelle pourrait déboucher sur une “political correctness” de droite (cf. JF n°8/97). Si je trouve la critique de Stein pertinente, cela ne veut pas dire que je juge le point de vue de Gramsci incorrect. C'est aujourd'hui précisément que nous constatons que la “superstructure intellectuelle”, c'est-à-dire les médias, a acquis une puissance bien trop considérable, tant et si bien que les hommes politiques ne sont plus que des figurants pour les émissions d'actualité. La puissance qu'ont acquises les émissions de “talkshows” est emblématique et révèle un phénomène inhabituel, soit la “pluralisation totale” de la société mais avec pour corollaire paradoxal la réduction de tout aux idéaux du plus grand nombre, du “brave quidam”, du “Gutmensch” (ndt: ce terme est ironique; il a été forgé par les critiques allemands de la “PC”). C'est cette contradiction qui produit la “political correctness” (PC), qui, lorsqu'elle aura atteint son stade idéal, sera une censure bien installée dans l'intériorité même des citoyens. Cette nouvelle intériorité auto-contrôlée produit un discours mortifère, un discours assassin, qui frapperait abruptement toute personne qui, pour une raison ou une autre, serait déclarée non “politiquement correcte”. Tous ceux qui entendent ignorer les gestes symboliques et rituels de la PC, tous ceux qui ne se sentiraient pas “concernés” par ses gestes et ses agitations, tous ceux qui avanceraient un certain type d'arguments non conventionnels seraient purement et simplement “morts”, du moins au sens figuré.
Pourtant, à droite, beaucoup de militants souhaiteraient, eux aussi, l'avènement d'une telle “censure intérieure”. Mais qui serait tout simplement de signe opposé. Ceux qui ne détiennent aucune puissance politique développent souvent des fantasmes de toute-puissance, mais d'une toute-puissance basée sur d'autres critères que ceux maniés par la toute-puissance en place. Quoi d'étonnant, dès lors, que le concept narcotique d'“hégémomie culturelle” ait été importé de France en Allemagne par des groupuscules qui ont voulu, dans un premier temps, divulguer les aspects intéressants de la nouvelle droite française, mais se sont enlisés, finalement, dans la prédication d'une “stratégie rédemptrice” et, pire, ont fini par aller faire de la formation dans des groupuscules néo-nazis interdits.
La trajectoire du néo-droitisme gramscien est triste, mais cette tristesse provient de plusieurs causes:
1. Il n'existe pas de “nouvelle droite” unitaire.
2. Si, au départ, les intellectuels de droite se voulant gramsciens ont souhaité l'émergence d'un débat, ils se sont rapidement enlisés dans la recherche d'une “Weltanschauung” idéale.
3. La “Révolution conservatrice” n'est pas pour eux une mine de concepts intéressants pour affronter le monde actuel, mais, plus prosaïquement, l'occasion de répéter à satiété un discours invariable, fait d'invocations stériles.
4. Ces intellectuels de droite se sont créé un petit monde, hermétiquement protégé de l'effervescence du réel.
Il n'existe pas “UNE” nouvelle droite. C'est pourtant clair: il suffit de comptabiliser tout ce que l'on vend au public sous cette appelation. Dans ce bric-à-brac, il y a toujours quelque chose de “plus neuf”. Dans les années 60, on disait des nationaux-révolutionnaires allemands qu'ils étaient la “nouvelle droite”. Mais, il n'est pratiquement rien resté de cette école nationale-révolutionnaire. Son espace idéologique était à l'intersection de la gauche et de la droite. Les nationaux-révolutionnaires affirmaient qu'ils n'étaient ni de droite ni de gauche: ils n'ont pas survécu sur la scène politique. Hennig Eichberg, qui, à cette époque, était la tête pensante de cette “nouvelle droite”, se considère aujourd'hui comme un homme de gauche. Beaucoup de nationaux-révolutionnaires de ces années 60 se retrouvent aujourd'hui chez les Republikaner.
Quant à la “nouvelle droite” la plus récente, elle a fini par démontrer qu'elle était au fond “conservatrice”, mais elle s'adresse à de plus larges catégories sociales que ses ancêtres de la nouvelle droite de 1968 qui tentaient d'apporter une réponse aux intellectuels de gauche et à la sottise de la vieille droite. Plus typés étaient les néo-droitistes —quelques personnes et quelques journaux— qui voulaient et veulent faire de leur nouvelle droite un projet de modernisation de l'extrême-droite. Cette catégorie de “néo-droitistes” reste la plus problématique, car, au fond, elle se borne à sortir de la naphtaline la “pensée anti-démocratique” de l'époque de Weimar (telle que l'a définie Kurt Sontheimer). Par cet exercice, elle veut hisser la pensée de l'extrême-droite à l'excellent niveau et à la belle forme, acquis par la “révolution conservatrice” sous Weimar.
A côté de ces “requinqueurs” de vieux corpus, s'est regroupée une autre “nouvelle droite”, composée pour l'essentiel de conservateurs (en Allemagne) ou de nationaux-libéraux et de conservateurs (en Allemagne et en Autriche). Ils ont abordé sans complexe la pensée moderne, ils ont, en ce sens, été conséquents, ont modulé leur action sur ce choix et ont investi les territoires politiques assignés par convention sociale à ces idéologies bourgeoises, bien ancrées et établies. Ces entristes, qui ont pénétré dans les rouages de la CDU, de la CSU ou de l'ÖVP, voire de la FDP ou de la FPÖ, sont de braves citoyens, ils sont tout simplement un petit peu à droite que les autres.
Si l'on mélange ces deux courants sous l'appelation commune de “nouvelle droite”, on débouche évidemment dans un beau désordre, sinon dans une aporie intellectuelle. Les “nouvelles droites” ancrées dans les diverses formes d'extrémismes droitiers confondent la volonté de débattre intellectuellement avec la proclamation impavide d'une Weltanschaunng ancienne, dont elles ont la nostalgie. Pour sortir de cette impasse, on recourt généralement à deux stratagèmes, dont on use et on abuse:
- soit on recommence à se référer directement aux racines théologiques du politique, en tentant de formuler un nouveau projet de “théologie politique”, dans le sens où l'entendait Carl Schmitt,
- soit on s'efforce de séculariser ce besoin d'absolu.
Dans ce cas, on se tourne vers d'autres certitudes, des certitudes immanentes, comme le “peuple” (Volk), des certitudes idéalistes, comme cette “science des citoyens d'Empire” de facture hégélienne, plus exactement mi-hégélienne-de-gauche, mi-hégélienne-de-droite, à l'usage de citoyens qui ne vivent plus dans un Reich et ne souhaitent certainement pas y revivre, les plages de Torremolinos ou des Baléares ayant pour eux plus d'attraits... Les multiples expressions de ces exercices para-théologiques ou “hégélisants” varient considérablement: les plus “sortables” ne sont “que” autoritaires, mais, dans la plupart des cas, le mode totalitaire est bien vite accepté, illustré et défendu...
C'est dans ces recherches et ces tâtonnements qu'il faut replacer l'engouement pour la “révolution conservatrice” de l'entre-deux-guerres. Soyons clairs et honnêtes: cette “révolution conservatrice” est une mine d'or, elle ne cesse de susciter les intérêts des philosophes et des politologues, à juste titre; il est intéressant d'en étudier tous les aspects si l'on veut connaître l'archéologie de certaines pensées aujourd'hui classées à “droite”, si l'on veut se plonger dans des corpus entièrement différents de l'idéologie dominante actuelle, si l'on veut lire de “mauvais livres” au regard des catégories politiques contemporaines. En pratiquant ainsi une forme de transversalité, indubitablement, on se forme l'esprit, on acquiert un sens critique, on aiguise ses intuitions. La “révolution conservatrice” nous apprend que les hommes de droite n'ont pas toujours été bêtes. Mais, en réceptionnant la “révolution conservatrice” de cette sorte, on ne doit pas non plus oublier qu'elle fut un échec. Ni oublier qu'elle fut, en bon nombre de ses aspects, antidémocratique et partiellement extrémiste. Aujourd'hui, notre regard doit se porter sur elle avec le même sens critique que sur les corpus de gauche de la même époque. Malheureusement, pour beaucoup d'hommes de droite actuels, de militants, cette “révolution conservatrice”, dans ses innombrables variantes, n'est que prétexte à répétitions, à dévotions naïves et bigotes, répétitions et dévotions qui remplacent toute intellectualité autonome ou permettent des exercices pénibles comme réitérer une attitude antidémocratique classique en citant des extraits d'auteurs “révolutionnaires-conservateurs”, pour faire intelligent ou pour donner le change.
Le résultat de tout cela est lamentable, car une telle nouvelle droite paraît toujours bien vieille, elle parait truffée de science, elle se gargarise de sa belle Weltanschauung prête-à-porter, mais elle n'est quasi pas branchée sur la réalité. Car la belle Weltanschauung néo-droitiste n'est qu'une construction intellectuelle consolatrice pour tous ceux qui sont laissés-pour-compte dans la société réellement existante. Les plus lucides d'entre eux savent certes que le “peuple” (Volk) de leur idéologie n'est pas le peuple réel qui circule dans les rues d'Allemagne. Mais ce sont les “autres” qui sont coupables de cette inadéquation. Le peuple devrait correspondre à leur image du peuple: nous n'avons plus affaire là à de la nostalgie, à la nostalgie d'une “hégémonie culturelle” de droite, conservatrice, mais la rage de voir partout l'inadéquation génère subtilement une sorte de totalitarisme, camouflé derrière un verbiage conservateur, qui se veut apaisant, moral et “traditionnel”.
Au bout du compte, nos intellectuels de la “nouvelle droite” sont soit des modernisateurs de l'extrémisme, soit des bourgeois à un âge où il n'y a plus de bourgeois classiques, cultivés et conventionnels. Cette alternative, dont les deux termes sont également figés, est le résultat de la ghettoïsation des droites. Elles marinent dans leur jus. Alors que reste-t-il de la “nouvelle droite”?
Il reste sans doute quelques intellectuels de droite, qui se posent en anarchistes pour ne pas sombrer dans le dogmatisme, pour ne pas se laisser aveugler par les illusions. La réalité prosaïque, c'est qu'il n'y a dans le monde ni consolation ni rédemption. Mais, justement, ce n'est pas la tâche des intellectuels de droite de proposer de la consolation et d'annoncer une rédemption: au contraire, ils devraient se donner pour seule mission de déconstruire systématiquement toute idéologie de la consolation et de la rédemption. Travail difficile: en effet, c'est la meilleure façon de se faire mal aimer de tous; les uns détestent le “déconstructiviste” parce qu'il ne partage par leur illusion et n'apporte donc pas de quoi l'alimenter, de quoi entretenir la consolation; les autres le détestent tout autant parce qu'ils sont de gauche ou libéraux, qu'ils appartiennent à des espaces politico-philosophiques dans lesquels, forcément, le déconstructiviste n'aimera pas aller mariner: au contraire, il aimera les détricoter avec une égale délectation. Le véritable intellectuel de la nouvelle droite devrait être celui qui d'emblée se définit comme l'homme sans aucune illusion.
Nos sociétés souffrent d'une absence de créneau critique. Pourtant, aujourd'hui plus qu'auparavant, le terme “critique” est le vocable le plus prisé des hommes de gauche, au point qu'ils identifient les mots “gauche” et “critique”. L'école de Francfort, réservoir idéologique de la gauche, s'est effectivement auto-dénommée “critique”. Mais la gauche ne critique plus, elle accepte le statu quo et gère la crise. Automatiquement, dans un tel contexte, la pratique de la critique incombe alors à la droite. Pire, si un homme de gauche pratique encore la critique, il sera désormais traité de “fasciste” ou de “crypto-fasciste” par ses coreligionnaires (Botho Strauss, même Peter Handke, le cinéaste Fassbinder, le dramaturge Heiner Müller, héritier du théâtre de Brecht).
Pour nous, la démarche “critique”, c'est d'affronter les aléas du réel sans s'embarresser de tabous. L'actuelle “political correctness” instaure de nouveaux tabous et aboie son hostilité à l'égard de tout discours, de tout débat, et justifie ces tabous et ces aboiements au nom d'idées de gauche. Forcément, l'homme de droite sera celui qui s'opposera avec énergie à ces tabous et à ces aboiements: il se dira de droite parce que ces tabous et ces aboiements se disent de gauche. Il rejettera la “political correctness” parce qu'elle refuse tout discours et tout débat. Il restaurera le débat par le simple fait de prendre la parole de force, en avançant des arguments de signes nouveaux ou de signes contraires. Cet acte de prise de parole constitue une pluralisation volontaire du discours et place l'homme de droite —nouveau contestataire radical— au centre même de la vie sociale en danger de rigidification définitive. Il reconnaît alors que la confrontation des idées n'est possible que dans une société marquée du sceau du pluriel. L'intellectuel de droite prend dès lors position pour un ordre social où règne la liberté et où s'épanouit la diversité. Il défend cette liberté précisément parce que ses idées sont bannies et ostracisées dans une société qui devient de moins en moins plurielle et différenciée. Sa tâche consiste à réfléchir et à chercher. Car celui qui connaît les réponses avant de formuler ses questions, tombe dans le piège du totalitarisme.
Que reste-t-il de la “nouvelle droite”? Sans doute un homme de droite qui n'est plus un homme de droite au sens conventionnel du terme. Un homme qui part à l'aventure dans la vie ou dans les épaisses forêts de la pensée, car il sait que rien n'est définitivement sûr, que ce savoir de l'incertitude universelle fait de lui le meilleur critique des conventions figées de la société, mais d'une société dont il connaît les ressorts (organiques), parce qu'il en est issu.
Jürgen HATZENBICHLER.
(Correspondant de “Synergies Européennes” en Carinthie, responsable de la chronique politique de Junge Freiheit/Autriche; article paru dans Junge Freiheit, n°16/97; traduction et adaptation françaises de Robert Steuckers).
00:10 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, conservatisme, critique, philosophie, théorie politique, politique, gauche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 21 septembre 2008
G. Faye: le choc des conceptions du monde

Le choc des conceptions du monde
par Guillaume FAYE
La pensée métaphysique, issue du monothéisme et qui s'achève dans l'humanisme, a voulu définitivement nommer l'être, le «connaître», et, par là fixer les valeurs. La métaphysique, rompant avec la philosophie grecque pré-socratique, a pensé l'être-du-monde comme un acquis, comme une valeur suprême. Elle a envisagé l'être comme Sein (Etre-en soi) et non comme Wesen (Etre-Devenir). Le mot français «être», ne rend pas ce double sens. Rechercher —et prétendre trouver— l'être comme Sein (einai en grec), c'est le dévaluer, c'est commencer une "-«longue marche vers le nihilisme». La philosophie de l'Esprit (Geist; le noús platonicien) prend le pas sur la philosophie de la vie et de l'action, sur la «création», la poiésis. Toute une anthropologie en découle: pour la conception-du-monde de la tradition métaphysique et humaniste, l'humain est un être achevé puisqu'il participe de valeurs suprêmes (Dieu, notamment, ou des «lois», des «grands principes moraux») elles-mêmes achevées, connaissables, stables, universelles. «Il n'y a plus de mystère dans l'être» dit alors Heidegger. Enfermé dans les essences et les principes, l'humain perd son mystère: c'est l'humanisme précisément. Toute possibilité de dépassement de l'humain par l'homme doit être abandonnée. Les «valeurs» humaines, prononcées une fois pour toutes, courent alors le risque de la sclérose ou du tabou.
D'où la séparation, qui s'est toujours remarquée dans l'histoire, entre les valeurs proclamées avec emphase par les philosophies monothéistes et humanistes, et les comportements auxquels elles donnaient lieu. Sur le plan religieux, l'enfermement de l'action humaine dans des «lois», et le caractère infini mais fini à la fois du Dieu suprême, que l'on sait être définitivement omnipotent, tend a transformer le lien religieux en relation intellectuelle, en logos, compromettant à la longue la force des mythes. Spinoza, Leibniz, Pascal et Descartes offrent des exemples de cette transformation de la métaphysique religieuse en logique; il faut se souvenir de l'amor intellectualis dei de Spinoza, de la déduction des attributs de Dieu chez Leibniz, de l'intelligibilité de Dieu pour toute raison, affirmée par Descartes, ou, allant encore un peu plus avant dans le nihilisme religieux, du paradigme marchand du pari sur le divin de Pascal. Bernard-Henri Lévy avait parfaitement raison, en proclamant conjointement son biblisme et son athéisme, dans Le Testament de Dieu, de se dire fidèle à la religion métaphysique hébraïque, creuset des autres monothéismes, la première à avoir formulé la préférence du logos sur le muthos.
Perpétuel interrogateur
Au rebours, la tradition grecque qui commence avec Anaximandre de Samos et Héraclite, et qui serpentera, en tant que conception-du-monde implicite dans toute l'histoire européenne jusqu'à Nietzsche, se refuse à nommer l'être. Celui-ci est pensé comme Wesen (être-en-devenir) comme gignesthai (devenir transformant), mais n'est jamais défini. Le mot grec pour «vérité», nous explique Heidegger, est alèthéia, ce qui signifie «dévoilement inachevé». La vérité n'y est point celle du Yahvé biblique, «Je suis l'Un, je suis la Vérité». Est vérité ce qui est éclairé par la volonté humaine, cette volonté qui soulève le voile du monde sans jamais faire advenir au jour la même réalité.
Dans la philosophie grecque, comme chez Heidegger, des mots innombrables sont utilisés pour «penser l'être». On ne pourra jamais répondre à la question de l'être, comme on ne pourra jamais connaître 1'«essence du fleuve», perpétuellement changeant, qui coule sous le pont. Le monde, dans son être-devenir, reste alors toujours l'«Obscur», et l'homme, un perpétuel interrogateur, un animal en quête constante de l'«éclairement». L'hominité, nous dit Heidegger, est caractérisée par le deinotaton, l'«inquiétance»: inquiéter le monde, c'est le questionner éternellement, le faire sortir et se faire sortir soi-même de la quiétude, cette illusion de savoir où l'on est et où l'on va.
Cette conception-du-monde se représente l'humain, perpétuel donneur de sens, en duel avec le monde, qui se dérobe à ses assauts, et qui demande, pour se laisser partiellement arraisonner, toujours de nouvelles formes d'action humaine, de nouveaux sens, de nouvelles valeurs, qui seront à leur tour transgressées.
Sacré et ouverture-au-monde
La mythologie grecque qui nous offre le spectacle de combats entre des dieux inconstants et des guerriers humains jamais découragés, toujours ardents dans leur passion de violer les lois divines pour préserver leur vie ou les lois de leur communauté, constitue l'aurore de cette conception européenne du monde. Une fin de l'histoire, par la réconciliation avec le divin métaphysique, enfin connu, lui est profondément étrangère. Cette conception-du-monde est la seule qui autorise à envisager la fondation d'un surhumanisme: l'humain, passant de cycles historiques de valeurs en cycles historiques de valeurs, transforme à chaque étape épochale la nature de sa Volonté-de-Puissance selon le processus de l'Eternel Retour de l'Identique. Le cosmos reste un mystère, il est 1'«obscur en perpétuel devoilement», comme, de manière singulièrement actuelle, l'envisage aussi la physique moderne. Le mythe reste présent au cœur du monde; cette impossibilité voulue et acceptée de connaître et de nommer l'être du monde, confère à celui-ci un caractère aventureux et risqué, et à l'action humaine la dimension tragique et solitaire d'un combat éternellement inachevé. Le sacré, au sens le plus fort, peut alors surgir dans le monde: il réside dans cette distance entre la volonté humaine et la «dérobade» du monde, bien visible d'ailleurs dans les entreprises scientifiques et techniques modernes. Le sacré n'est pas réservé à un principe (moral ou divin) ou à un attribut substantiel de l'être (un dieu), mais il habite par le fait de l'homme, le monde. Le sacré s'apparente à un sens donné par l'humain à son entour: le monde, nous dit Hölderlin, est vécu alors comme «nuit sacrée». Il n'y a plus lieu de se rassurer en recherchant 1'«essence de l'être», prélude à la fin de l'histoire, puisque l'homme de cette conception grecque du monde désire l'inquiétude. Il s'assume ainsi comme pleinement humain, c'est-à-dire toujours en marche vers le sur-humain, puisqu'il se conforme à son ouverture-au-monde ( la Weltoffenheit dont parlait Gehlen) inscrite dans sa physiologie et éprouvée par la biologie moderne.
La recherche de l'être comme Sein, quête de l'absolu métaphysique et moral, peut s'envisager alors comme une entreprise in-humaine, et l'humanisme qui en découle philosophiquement comme une idéologie proprement non-humaine, plus exactement maladive. C'est dans l'historicité (Geschichtlichkeit) et la mondanité (Weltlichkeit), ce que les grecs appelaient le to on (l'étant) et les latins l'existentia, que réside le chemin que nous pouvons choisir de suivre ou de ne pas suivre.
Le suivre, s'enfoncer dans le Holzweg, la sente de bûcheron qui ne mène «nulle part» sinon «au cœur de la forêt sacrée», dont nous parle mystérieusement Heidegger, voilà ce qui est renouer avec l'aurore de la Grèce: reprendre le fil coupé par le christianisme et «la sortir de l'oubli». La sente ne mène pas vers un bourg, celui où les marchands se reposent, mais, inquiétante, elle s'enfonce vers l'aventure. L'«aventure», c'est-à-dire l'advenir, ce qui, au détour du chemin «surgit du futur»: l'histoire.
Voici donc le sens fondamental de l'entreprise de Nietzsche, puis de Heidegger, et après lui sans doute de bien d'autres: réinstaller, en Europe, à l'époque technique, cette conception-du-monde incomplètement formulée, inachevée par certains grecs, mais le faire sous une forme différente, auto-consciente en quelque sorte, en sachant que même ce travail sera à recommencer. Nous, hommes du soir, de l'Hespérie (Abend-land), (par rapport à cette Grèce des pré-socratiques qui a voulu être l'Aurore d'une conception du monde) un travail nous attend, qui n'a rien de philosophique, au sens intellectuel du terme: rendre auto-consciente, au sein de l'Europe de la civilisation technique, une forme transfigurée de cette conception-du-monde, ou de cette religion-du-monde de l'aube grecque, tirée de l'oubli par Nietzsche et Heidegger.
Guillaume FAYE.
00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : guillaume faye, nouvelle droite, philosophie, polémologie, métaphysique, europe, européisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 03 septembre 2008
R. Steuckers: entretien à "Militant" (1992)

ARCHIVES: Un entretien de 1992, pour tous ceux qu'intéressent à l'histoire du mouvement identitaire et "néo-droitiste" (en dépit des variétés que cette appelation peut recouvrir). A noter, cet entretien a été accordé à Xavier Cheneseau quelques semaines avant la rupture définitive avec le "canal historique" (et hystérique) de la nouvelle droite centrée autour d'Alain de Benoist et au moment des accords de Maastricht. La donne internationale a considérablement changé depuis. Prière aux lecteurs de 2008 d'en tenir compte!
Entretien de Robert Steuckers à la revue «Militant»
I - Animateur de la «Nouvelle Droite», pensez-vous que votre mouvance a contribué à préparer le terrain pour le Front National, par exemple?
Je voudrais d'abord apporter une petite précision: je ne me sens ni ne me considère comme étant de «droite», même si j'ai souscrit à bon nombre d'analyses posées par le mouvement d'Alain de Benoist, abusivement baptisé «Nouvelle Droite» par les milieux du journalisme parisien. Dans cette mouvance, c'est essentiellement la «nouveauté» qui m'a séduit. Je ne crois pas que la «Nouvelle Droite» d'Alain de Benoist et de Guillaume Faye ait préparé le terrain pour le Front National. Celui-ci a été porté par une dynamique qui lui est propre. Si le Front National s'était laissé inspirer par les thèses de la ND, il aurait choisi une orientation moins occidentaliste et repris à son compte l'anti-américanisme gaullien; son programme économique n'aurait pas été directement calqué sur Reagan et Thatcher, mais aurait opté pour un dirigisme à la française (Déat, le néo-socialisme, le gaullisme) ou pour un auto-centrage tel que l'a préconisé le grand économiste français François Perroux. Enfin, le poids de l'intégrisme catholique aurait été moins net dans la presse du FN, si le souffle du «paganisme néo-droitiste» l'avait touchée, paganisme qui, en dernière instance, est une religion de la Cité et un refus tranché de toute forme de cosmopolitisme.
2 - Ne pensez-vous pas que le succès relatif du lepénisme peut apparaître comme un démenti cinglant à la stratégie métapolitique?
Le succès électoral du FN, drôlement étrillé à cause des manipulations de la loi électorale, est une chose. La stratégie métapolitique en est une autre. Celle-ci n'a nullement perdu de sa validité, quand le FN a commencé son ascension. Par stratégie métapolitique, il faut entendre une volonté de réactiver des idées, des pratiques, des programmes, des faits d'histoire, qui ont été refoulés par les idéologies dominantes. Devant les effets du déclin, que nous constatons tous, cette stratégie métapolitique possède des vertus réparatrices: elle permet, sur base d'une documentation, d'une incessante combinaison de thèmes politiques et historiques, de critiquer les idéologies dominantes, d'en montrer les tares et les insuffisances qui conduisent à des faillites retentissantes, ce que prouvent des faits comme la désindustrialisation de l'Europe, le chômage de masse, le déclin démographique, l'incapacité de construire une défense européenne cohérente et de fédérer les atouts industriels de notre continent, et, enfin, le laisser-aller généralisé, que les sociologues contemporains ont appelé l'«ère du vide» de la «bof-generation». Le FN a obéi à une toute autre logique que celle de la «métapolitique» d'Alain de Benoist: il a réactivé les clivages de la IVème République, renonçant ainsi à prendre acte des potentialités de l'ère gaullienne: organisation de la société française selon les critères de la «participation», orientations diplomatiques de Troisième Voie (dialogue euro-arabe, relations avec l'Amérique Latine, avec la Chine, l'URSS, l'Inde, etc.), indépendance militaire et nucléaire, centrage de l'économie (Elf-Aquitaine), grands projets technologiques (Concorde), etc. La ND, quant à elle, n'a peut-être pas assez insisté sur ces réalités, bien que les livres de Faye constituent un bon tremplin didactique pour les réinjecter dans le débat.
3 - Partisan d'une Europe indépendante, vous préconisez une économie auto-centrée. Pouvez-vous dire pourquoi et comment vous comptez y arriver?
L'idée d'un auto-centrage de notre continent est assez ancienne et, dans la littérature économique, elle est récurrente. Je songe aux projets de Friedrich List (1789-1846), qui fut l'artisan du Zollverein allemand et des politiques protectionnistes américaines, à l'œuvre d'Anton Zischka, qui traverse le siècle, et aux théories de François Perroux, qui a démontré les atouts du centrage des économies et la nécessité, pour le bon fonctionnement de celles-ci, d'une homogénéité culturelle. C'est dans cette tradition multicéphale, refoulée, radicalement différente de celles des idéologies dominantes, que je m'inscrit. Ce qu'il faut faire, sur base de ces théories? D'abord militer pour la diffusion de ces alternatives cohérentes, non utopiques et, abandonner l'a priori anti-économie des «droites», qui rend leurs programmes totalement inopérants à long terme. Ensuite, quand ces idées pratiques auront acquis une certaine notoriété, travailler à infléchir la logique actuelle qui est mondialiste, qui disperse les capitaux tous azimuts et délaisse l'investissement dans nos pays. A l'échelon européen, nous nous ferons les défenseurs des fusions industrielles internes à notre continent. En clair, nous applaudirons à des fusions comme Matra-Ericsson (le cas du contrat de la CGCT), comme Volvo-Daf, comme Peugeot-Mercedes et nous lutterons contre les fusions qui impliquent des partenaires non européens, japonais ou américains. Cette idée, nous la partageons avec beaucoup d'Européens engagés dans d'autres circuits politiques et idéologiques que le nôtre. Nous espérons que se réalisera un jour la fusion de ces bonnes volontés, en dépit des étiquettes actuelles.
4 - La politique euro-arabe préconisée par Benoist-Méchin vous paraît-elle toujours applicable?
Le monde arabe est pluriel, malgré la force unificatrice de l'Islam ou les nostalgies nasseriennes. Le rôle de l'Europe est de jouer la conciliation entre les parties, sans imposer quelque politique que ce soit. Les Arabes sont nos voisins et, si nous sommes réalistes, nous devons bien admettre qu'il faut s'entendre avec eux pour éliminer, chez nous, les effets négatifs de Yalta. La logique des relations euro-arabes futures ne saurait plus être de type colonialiste, puisque les Arabes disposent désormais de solides atouts dans leur jeu: pétrole, démographie en hausse, identité politique, grands espaces. L'Europe, malgré son déclin démographique préoccupant, possède encore et toujours les cerveaux techniciens et une infrastructure industrielle remarquable, qui a besoin de débouchés. Les Arabes ont intérêt à s'entendre avec les Européens plutôt qu'avec les Américains qui financent une tête de pont dans leur espace, Israël, qui bafoue leur dignité et ne serait pas viable sans cette aide. Des opérations comme l'organisation de la téléphonie saoudienne par les Suédois d'Ericsson, la vente d'appareils militaires français, la reconquête des zones désertifiées en Algérie par une équipe du Baden-Wurtemberg, les pourparlers (torpillés) entre Belges et Libyens ou entre Français et Irakiens en matières nucléaires, les bonnes relations commerciales que continue à entretenir la RFA avec l'Iran, sont autant d'opportunités qui s'offrent à nos pays de sortir de la logique binaire de Yalta, de s'affranchir des dépendances économiques imposées par les réseaux transnationaux téléguidés depuis Washington et d'accroître leurs potentiels industriels. A la logique de Benoist-Méchin, qui, malgré son passé collaborationiste, a infléchi la politique de la Vème République dans un sens arabophile, doit s'ajouter la logique de Zischka, qui en 1952 avait ébauché un plan de reconquête et de rentabilisation du Sahara, plan que les politiciens médiocres de notre après-guerre n'ont pas retenu (cf. Anton Zischka, Afrique, complément de l'Europe, Laffont, 1952). L'industrialisation et la refertilisation des zones sahariennes exigeront beaucoup de main-d'œuvre et les immigrés maghrébins d'Europe pourraient y pourvoir. L'immigration, qui crée un antagonisme euro-arabe compréhensible, est un fruit du libéralisme économique: cette idéologie a toujours rejeté les planifications audacieuses, comme celles de Zischka, parce que, par idéalisme irréaliste, elle ne reconnaît pas le primat du politique. Le retour à un planisme grandiose permettrait de règler la question de l'immigration dans un sens positif. Le pétrole des Libyens et des Saoudiens pourrait largement financer des projets agricoles et industriels de ce type. Les fermes libyennes, irriguées selon des procédés modernes, sont d'ores et déjà des modèles du genre.
Autre écueil à éviter: prendre parti pour une et une seule idéologie arabe, au détriment de toutes les autres. Les Européens, dans leur politique arabe, ne doivent privilégier aucun interlocuteur: ni les nassériens, ni les intégristes, ni les baathistes, ni les frères musulmans, ni les Libyens, ni les Irakiens mais viser la conciliation de tous sans s'immiscer dans les affaires intérieures des pays arabes.
5 - La Turquie, Israël, les pays d'Afrique du Nord ont demandé à rejoindre la CEE. Que vous inspirent ces demandes?
On ne crée pas un espace économique auto-centré sans homogénéité culturelle. Les différences entre le Nord et le Sud de l'Europe, entre les pôles latin et germanique, entre les Britanniques et les Continentaux, etc. rendent le fonctionnement de l'Europe des 12 déjà fort problématique. Si l'on y adjoint le Maghreb et la Turquie, le chaos sera à son comble. Tout centrage économique sans homogénéité culturelle conduit à une logique implosive, à un dérèglement généralisé. Au nom des impératifs géopolitiques, la Turquie et les pays du Maghreb doivent devenir des alliés de l'Europe, dans des sphères voisines, intégrées selon les mêmes règles de l'auto-centrage. La Turquie, dont l'opposition politique à Türgüt Özal ne veut pas de la CEE, a intérêt à rejouer un rôle «ottoman» au Proche-Orient et à renouer avec la Syrie, l'Irak et l'Iran, en dépit des conflits récents. Tout axe diplomatique optimal pour la Turquie s'oriente vers le Golfe Persique, alors que l'axe occidental, choisi par Özal, conduirait Ankara à n'être qu'un appendice mineur de la CEE, mal industrialisé et incapable de tenir devant les concurrences ouest-européennes. Les Nord-Africains, eux, doivent jouer la carte du Grand Maghreb et refuser que leurs ressortissants ne deviennent les nouveaux esclaves de l'Europe industrialisée. L'Europe doit, pour sa part, tolérer l'expansion des Etats nord-africains vers le sud et, en tant que non français, je déplore l'action retardatrice que joue sur ce plan l'armée française au Tchad, faisant ainsi le jeu des Américains, ennemis de toute forme de rassemblements continentaux ou sub-continentaux. Quant à Israël, un seul choix s'offre à lui, qui s'articule comme suit: renoncer à son rôle de tête de pont de l'impérialisme américain en Méditerranée orientale, s'entendre avec les Palestiniens comme le préconisent les diplomates européens et l'Internationale Socialiste (cf. la récente visite d'Arafat à Strasbourg), dialoguer avec les Turcs soucieux d'orienter leur diplomatie dans un sens ottoman. L'option CEE n'est pas un remède pour Israël: en effet, comment pourrait-il y vendre ses fruits devant la concurrence espagnole? De plus, il serait excentré et détaché artificiellement de son voisinage. La faiblesse géographique de l'Etat hébreux le rend inviable à long terme, a fortiori quand la démographie palestinienne minorise déjà le peuplement juif. Les élites israëliennes, comme les chrétiens du Liban, ont intérêt à réviser leur sionisme ou leur particularisme dans la perspective d'un néo-ottomanisme: c'est pour eux une question de vie ou de mort politiques.
6 - L'Acte Unique européen vous paraît-il une bonne base de départ pour l'Empire européen à construire?
Votre question n'autorise pas de réponse tranchée. L'Acte Unique aura pour conséquence d'éliminer des secteurs viables sur le plan national mais aussi des tares locales anachroniques. L'Acte Unique favorisera les grandes entreprises capitalistes au détriment des PME mais créera simultanément des institutions permettant une plus grande mobilité d'action pour tous. Nous restons conscients du fait que la CEE a été créée jadis pour faciliter la pénétration en Europe des capitaux du Plan Marshall mais que l'idée d'une unité continentale et d'une intégration économique est plus ancienne et ne provient pas des Etats-Unis. Le défi à affronter, complexe et à facettes multiples, est donc le suivant: choisir une politique d'auto-centrage mais ne pas confisquer à certains Européens les relations privilégiées qu'ils entretiennent avec des Etats européens non membres de la CEE. Le «grand espace» de 1992 ne sera pas d'emblée un paradis, un bijou politique. Le risque d'un gigantisme stérilisant demeure, donc cette Europe en gestation ne doit pas se considérer comme achevée; elle doit être ouverte à toutes les candidatures européennes, fermée aux candidatures non européennes. Prenons quelques exemples: la Suède et la Norvège comptent des industries de pointe remarquables, avec lesquelles les grands consortiums européens ont intérêt à s'entendre plutôt qu'avec des équivalents japonais ou américains. La RDA est membre du COMECON mais, par le biais des relations inter-allemandes, elle constitue aussi, officieusement, le treizième Etat de la CEE; la RFA, à partir de 1992, ne devra pas renoncer à ses liens spéciaux avec la RDA ni avec les autres pays de l'Est européen, car cette situation est l'amorce d'un élargissement généralisé à toute l'Europe. La Grèce souhaite, pour sa part, une accentuation des relations inter-balkaniques. Toutes ces dynamiques et ces synergies, dont l'impact dépasse le cadre territorial de la CEE, ne seront possibles que quand disparaîtra l'OTAN et l'inféodation à Washington, car sinon jamais les Suédois, les Suises, les Autrichiens et les Yougoslaves, qui détiennent des zones cruciales en Europe, ne pourront participer à la construction de notre continent. Mes amis et moi-même, qui constituons une forme de pôle germano-belge de la ND européenne, avons souvent été accusés de pro-soviétisme par des camarades français. Nous constatons, en revanche, que ces accusateurs sont frappés d'une étrange myopie historique et réduisent l'Europe au territoire de la CEE ou à celui de l'OTAN. A l'heure où la perestroïka de Gorbatchev est avant toute chose un aveu d'impuissance économique, le danger ne vient plus prioritairement de l'Est. Il vient des concurrences capitalistes extra-continentales. Le danger soviétique ne redeviendra primordial que si l'Europe actuelle, celle des libéraux et des marchands, reste sur ses positions et refuse les dynamiques que je viens d'évoquer. Les Russes n'auront plus qu'une solution: reconduire leur vieille alliance avec l'Amérique. Car il faut savoir que la Russie ne pactice qu'avec le plus fort: avec l'Amérique comme pendant la Guerre de Sécession —ce qu'avait prévu Tocqueville en 1834— ou sous Roosevelt (de 1941 à 1945) et Khroutchev (de 1959 à 1962); avec l'Allemagne (de 1939 à 1941) ou l'Europe unie quand celles-ci sont puissantes et fermes.
En conclusion, l'Acte Unique peut être le meilleur ou le pire: espérons au moins qu'il balaiera les anachronismes nationaux, portés par des politiciens sans envergure, sans mémoire historique et, surtout, sans vision d'avenir grandiose.
00:05 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nouvelle droite, europe, affaires européennes, front national, politique, monde arabe, méditerranée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 juin 2008
G. FAye: Preparing for WW3

Dear Friends, here a US-American analysis of Faye’s last book.
Beste vrienden, hier een Amerikaanse analyse van het laatste boek van Faye.
Liebe Freunde, Hier eine US-amerikanische Analyse von Fayes letztes Buch.
Chers amis, voici une analyse américaine du dernier livre de Faye.
Preparing for World War III
ex: http://theoccidentalquarterly.com/vol3no2/mo-worldwara.html
Avant-Guerre: Chronique d’un cataclysme annoncé
(Pre-War: Account of an Impending Cataclysm)Guillaume Faye, Paris: L’ Æncre, 2002, 24 Euros, 382 pp.
Reviewed by Michael O’Meara
Readers of The Occidental Quarterly are probably unfamiliar with the work of Guillaume Faye, but his ideas are increasingly those of Europe’s nationalist vanguard.
An early associate of Alain de Benoist and one of the architects of the European New Right, the young Faye left politics in the late 1980s to pursue a career in media. In 1998 he returned, instantly re-establishing himself as the intellectual force on the nationalist right.
He has since published five books, each of which has had a major impact on the struggle against multiculturalism, Third World immigration, and globalization.1 Unlike Benoist and other New Right theoreticians, whose defense of the European ethnos is waged almost exclusively on the cultural terrain, and unlike Le Pen's National Front, which favors the assimilation rather than the forced repatriation of non-Europeans, Faye claims that race is not only primary to cultural identity, but that race and culture are, at root, inseparable. For this reason he argues that the struggle to preserve Europe's cultural patrimony is no less a struggle to defend its genetic heritage and the ethnic integrity of its Lebensraum.(2)
His latest work—Avant-Guerre: Chronique d’un cataclysme annoncé (Pre-War: Account of an Impending Cataclysm)—is reminiscent of Spengler’s Hour of Decision. Like Spengler, Faye looks at the storm clouds on the horizon and predicts that within ten years a coming era of world-altering tempests will descend on the white race, determining if it is to have a future or not.
In his view, these cataclysms will be neither ideological nor economic in character, but (à la Huntington) racial and civilizational, involving clashing continental blocs and warring ethno-racial groups. They are thus likely to engender unprecedented violence and destruction, forcibly shaking white people from the stupor that is leading them toward extinction. Although presently unprepared to fight such wars and alienated from all that is distinct to their race and heritage, the struggles of the twenty-first century, he believes, will give Europeans on both sides of the Atlantic a final chance to throw off the forces that have denatured and debilitated then over the last half century.
Europe and America
Like most "nationalists" who fight in Europe’s name, Faye is extremely critical of the American government and the role it has played in repressing the worldwide forces of white solidarity. But unlike many on the anti-American right, Faye does not believe the U.S. is Europe’s principal enemy, even if its Judeo-liberal New Class has been responsible for eroding European autonomy and demonizing its culture. An enemy, he contends, does more than corrupt and intimidate, it threatens one’s biological existence. Taking his cue from Carl Schmidt, he thinks it is more accurate to characterize the U.S. as Europe’s "adversary"—an adversary that needs to be opposed if Europeans are ever to re-assert the Faustian project distinct to their ethos—but nevertheless one with whom a life-and-death struggle is not at all inevitable.
The real enemy threatening the white homelands comes, he claims, from the Third World. Accordingly, the terror attack of "9/11" suggests one form his predicted cataclysm will take. But while Islam is Europe’s principal enemy, it is not, paradoxically, America’s. Based on the work of General Gallois, Alexandre Del Valle, and a new generation of European geopoliticists, Faye argues that Islam has long served the U.S. in furthering the hegemonic ambitions of its global village, specifically in dividing Europe and weakening Russia. That its recruitment and arming of Islamic fanatics to fight in Afghanistan and Chechnya and in Bosnia and Kosovo at last boomeranged ought not to detract from the fact that for a quarter century the U.S. systematically incited Islamic insurgencies for the sake of its strategic aims.
In Faye’s view, America’s principal Third World enemy, and thus the power it will face in World War III, comes not from the Middle East (even if militant Islam continues to target it), but from a rapidly developing and technologically armed China bent on contesting its dominance in the Pacific. In this potential Sino-American conflict, Faye believes the future lies entirely on the Chinese side. Unlike the Middle Kingdom, the U.S.’s disparate mix of race and cultures has left it without a coherent heritage and thus a destining project worth dying for. This makes it not a nation in the European sense, but simply une symbiose étatico-entrepreneuriale. Because such an entity is likely to fly apart if challenged by a determined enemy, in the great cataclysms to come it will be Europe (and Russia), not the U.S., that will stand at the center of the struggle to defend the white West from a hostile non-white world.
Islam
While America’s future holds out the prospect of an interstate war with China, Faye believes Europe faces an intrastate war with the forces of an insurgent Islam—a war, to repeat, that will resemble 9/11 more than the conventional military engagement the U.S. can expect in the Pacific.
In the four decades since 1962, when Africa broached Europe’s southern frontier, the continent, especially France and Belgium, has been inundated by successive waves of Third World immigrants. The amplitude of this immigration, involving masses not individuals, is such that not a few demographers contend that it is more accuratelydescribed as "colonization." Due to disproportional birthrates, the unrelenting influx of non-white, unassimilable, and largely Muslim immigrants has already begun to "de-Europeanize" Europe. For example, virtually everywhere they have settled in France they have succeeded in "ethnically cleansing" former neighborhoods, establishing not ghettos, but conquered territories, from which future conquests are being prepared. With their seven to eight million inhabitants, these territories have become, in effect, hostile African/Middle Eastern encampments within an increasingly besieged France.3
This immigration is creating an extremely volatile situation, for Europe lacks the massive police apparatus and vast geographical expanses that have kept ethnoracial tensions ‘manageable’ in the U.S. Typically, in urban areas where neighborhoods have been lost to Islamic civilization, Europeans have come to experience not only escalating levels of violence and insecurity, but the loss of their laws and institutions. There are now more than 1400 zones de non-droit in France (including eleven towns), and in nearly a hundred of these, republican jurisdiction has been supplanted by the shari`a (Islamic law).4
Within such zones, whose deteriorating conditions politically correct public officials persist in describing in socioeconomic rather than biocultural terms, it is nearly impossible for a Frenchman to reside in the public housing estates (HLM) built for the French working class, to find a café serving wine or ham, or for his wife to dress or behave in public as do European women. In contrast to the Little Italies and Germantowns arising in many American cities in the last century, these non-European enclaves have not the slightest intention of assimilating into the dar-al-Harb (the "impious" non-Islamic world, which Muslims view as the "world of war"), and have, in fact, begun to assert their autonomy vis-à-vis it. In recent years, hardly a week passes without a newspaper report of a riotor bloody incident provoked by clashes between police and Muslim gangs.
Since 1990, urban violence has grown five percent annually—since 2000, by ten percent—as the anomie, violence, and disintegration associated with America’s inner cities becomes an increasingly familiar European reality. In fact, in 2000, for the first time in history, French criminality, whose ethnoracial character is overwhelmingly non-European, surpassed that of the U.S. crime rate; and Paris, once the City of Lights, became the least safe of the major European cities.
In the face of these threats to the continent’s demographic, cultural, and institutional foundations, the media, the academy, and the established "anti-racist" organizations (mostly controlled by Zionists) attempt to silence whoever criticizes such changes, all the while making the term "multiculturalism" emblematic of the mobile postmodern society of optional values and fashionable identities that comes with globalization. Instead, then, of mobilizing the Christian West against such threats, these New Class forces preach cowardice, resignation, escapism, and a self-destructive humanitarianism.
An ethno-masochistic response of this kind has naturally emboldened the more militant members of France’s Muslim community, who now call for jihad against the "white cheese." Public authorities, though, persist in distinguishing between violent fundamentalists (who number perhaps 40,000) and the "peace-loving" Muslim community, unable or unwilling to acknowledge Islam’s inherent hostility to Europe’s secular society. Between orthodox and fundamentalist Islam, Faye, though, claims there is solely a difference in temperament. And even this is increasingly compromised by fundamentalist aggressions. Years before the 9-11 attack on the symbols of U.S. hegemony, this "monstrous offshoot of Judaism" had already begun its third great offensive against the dar-al-Harb, targeting Europe as a future Muslim homeland.5
Buoyed up by U.S.-protected strongholds in Southeast Europe (Albania, Bosnia, Kosovo), U.S. pressure to admit Muslim Turkey to the EU, and large stockpiles of sophisticated arms, Islamists have already begun organizing for a new conquest.
It is not surprising, then, that Faye interprets the growth of European Islam as the opening salvo in a larger struggle for the continent’s future.6 Faye’s militant opposition to Islam does not, however, bear a resemblance to that of President Bush’s handlers. The struggle against Islam, he insists, is a struggle to free Europe from a dire threat to existence—not a justification for further Zionist aggression.
What War Will Bring
In the coming cataclysms—likely to involve street battles between rival racial communities, guerrilla skirmishes, mega-terrorism, perhaps even small-scale nuclear exchanges with "dirty bombs," along with conventional-style invasions from neighboring Islamic armies—Faye believes Europe will either perish or experience a rebirth. In any case, the confrontations ahead will create a situation in which the present politically correct delusions are impossible to sustain.
For like every great struggle affecting human’s natural selection, war privileges the elemental and the vital. With it, the subtleties and distractions that sophists and simulators have used to misdirect Europeans cannot but cease to count, as will those minor differences that have historically divided them. Then, as "money and pleasure" cede to the imperatives of "blood and soil," only the traditions, the way of life, and the genetic principles defining them as a people will matter.
The situation the white race finds itself in today may therefore be unconditionally bleak, but in that hour when everything risks being lost, Faye believes a final opportunity for renaissance will present itself.
In this vein, he predicts that the dominant musical theme of the twenty-first century will be neither an orchestral ode to joy nor the doggerel of an urban savage, but rather a solemn military march based on ancient hymns. Europeans on both sides of the Atlantic, he advises, would do well to keep step with its strong, marked rhythm.
Michael O’Meara is a scholar who resides and teaches on the West Coast of the United States. He is the author of numerous articles and book reviews.
1. L’archéofuturisme (1998); Nouveau discours à la nation européenne, 2nd ed. (1999); La colonisation de l’Europe (2000); Pourquoi nous combattons (2001). All these works have been published by L’Æncre and can be purchased at the Librairie Nationale, 12 rue de la Sourdière, 75001 Paris, or on the Internet at www.librairienationale.com/.
2. See Michael Torigian, New Right, New Culture: Anti-Liberalism in Postmodern Europe (Lanham, MD: University Press of America, 2003).
3. The number of non-Europeans in France is not officially known. The cited figure is the estimate of one of the country’s leading demographers. See “L’avenir démographique: Entretien avec Jacques Dupâquier,” in Krisis 20-21 (November 1997). Another academic (J. P. Gourevich) claims it is closer to 9 million. Some put the figure as high as 14 million, while the media usually refer to 4, 5, or 6 million. But more alarming than these figures is the fact that one-third of the population under 30 is now of non-European origins and has a birth rate four or five times higher than the European one.
4. Jeremy Rennher, “L’Occident ligoté par l’imposture antiraciste,” in Écrit de Paris 640 (February 2002). Even the politically correct editor of Violences en France (Paris: Seuil, 1999), Michael Wieviorka, acknowledges that the explosion of violence and criminality since 1990 is an outgrowth of Islamic power. Because the French government keeps most data on immigrant crime and racial terror securely under wraps, the little that is known has been surreptiously leaked by frustrated officials. The publication with the best access to these leaks is the monthly J’ai tout compris! Lettre de désintoxification, edited, not coincidentally, by Guillaume Faye.
5. The first, Arab wave of the seventh century brought the Muslims to Poitiers, and the second, Turkish wave of the twelth through the seventeenth centuries led to the destruction of Christian Byzantium and the seige of Vienna. The third wave, in the form of the present colonization, is stealthy in character, but potentially even more catastrophic.
6. Accordingly, the more militant Europeanists now invoke the need for a new reconquista. This is especially evident in Philippe Randa’s novel Poitiers demain (Paris: Denoël, 2000) and the album Reconquista by the group Fraction (Heretik Records).
------------------------------------------------------------------------
00:11 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : socilogie, conflits, guillaume faye, polémologie, polémique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 16 mai 2008
G. Faye: La dictature du bien-être

Guillaume FAYE,
La dictature du bien-être, mars 1979.
Aldous Huxley pensait avoir fait œuvre de fiction en situant son Brave new world au 3e millénaire. Il est mort en constatant que la société sans souffrances et sans besoins insatisfaits était en passe de devenir la triste réalité de notre temps et que, comme dans son Brave new world, tout individu libre ou faisant preuve de quelque pensée originale était déjà considéré comme malfaisant par des masses conditionnées par ce que le socio-anthropologue Arnold Gehlen a appelé la dictature du bien-être. Car la religion du bien-être est bel et bien devenue dictature.
Cette volonté, partout affirmée, de satisfaire les désirs matériels et la soif de consommation des hommes de notre temps n’est du reste pas choquante en soi : elle est intrinsèquement liée à l’existence même de la fonction de production telle que la connaissent les sociétés d’origine indo-européenne. Mais dans le système de tripartition du monde indo-européen, tel que l’a dégagé Georges Dumézil, la fonction de production demeure impérativement subordonnée à la fonction guerrière et, surtout, à la fonction de souveraineté. Or le drame est que nous assistons à une inversion de ce rapport de subordination, que la société entière se trouve dominée par ces exigences consuméristes, et que l’économie s’est investie du pouvoir de résoudre tous les problèmes humains.
En réduisant tous les facteurs sociaux à l’économie, la société marchande fait de celle-ci l’instrument d’un développement global, motivé par une fausse conception du bonheur, mélange illusoire d’abondance matérielle et de loisirs plus ou moins organisés. Ce qui laisse croire qu’il n’existe que des besoins et des désirs matériels, que ceux-ci ne sont qu’individuels, toujours quantitatifs et toujours susceptibles d’être comblés. Certains patrons n’hésitent d’ailleurs pas affirmer que "l’entreprise fait le monde". Pour Entreprise et progrès, qui se veut le "poil à gratter" du CNPF [NB : ancêtre du MEDEF], les mutations de l’entreprise déterminent les mutations sociales, l’entreprise est le phénomène directeur de la société, phénomène auquel les Français auraient toutefois quelque peine à s’adapter en raison de leurs "tares culturelles" (sic).
Le pire est sans doute que la plupart des gens se laissent prendre à l’apparente générosité de ce totalitarisme économique. Les arguments de bon sens ne manquent pas. Valéry Giscard d’Estaing écrit : "Seules les économies de marché sont réellement au service du consommateur. Si on laisse de côté les idéologies pour ne considérer que les faits, force est de constater celui-ci : les systèmes économiques dont la régulation est assurée par une planification centrale offrent aux consommateurs des satisfactions incomparablement moins grandes en quantité et en qualité que ceux qui reposent sur le libre jeu du marché". Mais au nom de la liberté individuelle d’accéder à la consommation de masse, ce totalitarisme diffuse un individualisme forcené - l’hypersubjectivisme dont parle Arnold Gehlen - qui décompose les groupes humains en détruisant les liens sociaux et organiques de leurs membres, en interdisant tout projet collectif, historique ou national.
Pourtant, à force de promettre le bonheur pour tous et tout de suite, le libéralisme marchand finit par engendrer des espoirs déçus et une ambiance d’insatisfaction collective. Le mythe égalitaire du bonheur obligatoire s’est ici couplé avec celui de la progression indéfinie du niveau de vie individuel, quelle que soit la prospérité des circuits économiques. Paradoxalement, chaque accroissement quantitatif de ce niveau de vie renforce l’insatisfaction psychologique qu’il était censé éliminer, provoquant dans le corps social une dépendance quasi physiologique à l’égard des désirs économiques, avec les multiples conséquences pathologiques qui en découlent. "La fausse libération du bien-être, écrit Pasolini, a créé une situation tout aussi folle et peut-être davantage que celle du temps de la pauvreté" (Écrits corsaires).
L’attente d’un progrès automatique et mécaniquement acquis rend les hommes esclaves du système et les dispense de faire preuve d’imagination et de volonté. La dictature du bien-être use les sensations et finit par user l’homme. Konrad Lorenz écrit : "Dans un passé lointain, les sages de l’humanité avaient déjà reconnu fort justement qu’il n’était pas bon pour l’homme de parvenir trop bien à son aspiration instinctive à atteindre au plaisir et à se soustraire à la peine". Émoussé par l’habitude, le plaisir exige alors une surenchère permanente et entraîne à la perversion. Les consommateurs modernes veulent impatiemment avoir tout et tout de suite, mais cette hypersensibilité à la privation les rend en réalité incapables de goûter les joies de l’acquisition. Konrad Lorenz précise encore : "Le plaisir n’est que l’acte du consommateur. La joie est le plaisir de l’acte créateur".
Arnold Gehlen a nommé pléonexie cette aliénation psychologique par laquelle la satisfaction d’une revendication égalitaire provoque un surcroît de désir égalitaire. Et il a nommé néophilie cette incapacité profonde des mentalités soumises à l’esprit marchand à se satisfaire d’une situation acquise. Ce qui conduit le système à entretenir un état de rebellion permanent, d’autant plus vif que cette insatisfaction paraît toujours plus insupportable. C’est une spirale sans fin. La hausse indéfinie du niveau de vie, promise et revendiquée dans n’importe quelle conjoncture, est un facteur de crise, tant et si bien qu’à la limite, cette dictature du bien-être menace le système même qui l’a engendrée tout en aliénant toujours plus profondément ses sujets.
Asservis au mythe égalitaire du bien-être, les consommateurs sont en effet en voie de domestication rapide. L’éthologie nous a enseigné l’histoire du Sacculina carcini, ce crabe d’apparence normale qui, dès qu’il se fixe en parasite sur un autre crabe, perd ses yeux, ses pattes et ses articulations pour devenir une créature en forme de sac - ou de champignon - dont les tentacules souples plongent dans le corps de l’animal parasité. "Horrible dégénérescence", s’écrit Konrad Lorenz qui ne peut s’empêcher d’observer déjà des "phénomènes de domestication corporelle chez l’homme". Ainsi l’humanité s’est-elle engagée dans une voie qui la laisse survivre mais qui la prive de sensibilité, vers une sorte de Brave new world peuplé de parasites "vulgarisés"...
Cet asservissement mental aux bienfaits illusoires du progrès continu fabrique, selon Raymond Ruyer, des peuples courts-vivants. Repliés dans leur cocon douillet et préservés du monde extérieur, ces peuples s’accrochent à des valeurs à court terme et se contentent d’actes aux conséquences immédiatement et directement mesurables ou quantifiables, exprimées en valeurs économiques convenues. Ce qui conduit nos hommes d’État à se définir comme "de bons gestionnaires de l’affaire France", assimilant ainsi le pays à une sorte de "société anonyme par actions-bulletins de vote".
L’individu court-vivant n’envisage plus son héritage et son après-mort : sa descendance et sa lignée deviennent pour lui des concepts incompréhensibles. Il gère au jour le jour son destin étroit et limité, se contentant de rendre des comptes sur ses activités aux gestionnaires placés plus haut que lui. Il navigue à vue, calculant même - grâce aux nouveaux économistes à qui rien n’est impossible - le prix de son enfant jusqu’à sa majorité. L’affection, non mesurable, est ainsi remplacée par des liens contractuels.
Dans le Manifeste du Parti Communiste (1848), Karl Marx écrit : "La bourgeoisie a noyé les frissons sacrés de l’extase religieuse, de l’enthousiasme chevaleresque, de la sentimentalité à quatre sous dans les eaux glacées du calcul égoïste. Elle a fait de la dignité personnelle une simple valeur d’échange et, à la place des libertés si chèrement acquises, elle a substitué l’unique et impitoyable liberté du commerce (...) Elle force toutes les nations à adopter le style de production de la bourgeoisie, même si elles ne veulent pas y venir. Elle les force à introduire chez elles la prétendue civilisation, c’est-à-dire à devenir bourgeoises. En un mot, elle forme le monde à son image".
Comment mieux décrire les effets destructeurs, pour les cultures, de l’esprit marchand propagé par la bourgeoisie ? Ces cultures se trouvent ainsi réduites à de simples comportements de consommation et le seul langage admis est celui du pouvoir d’achat, potentiellement égal chez tous les peuples et sur toute la Terre. Cette volonté de diffusion d’un seul mode de vie menace à terme la richesse culturelle de l’humanité. De même que pour les marchands classiques, les frontières et les mœurs variées constituaient des obstacles intolérables, pour la société marchande, les différences ethniques, culturelles, nationales, sociales et même personnelles, doivent être inexorablement résolues. Le rêve universaliste d’un vaste et homogène marché mondial de la consommation annonce l’avènement de l'homo œconomicus.
Dépassant ainsi largement sa fonction de satisfaction des besoins matériels essentiels, l’économie est devenue le fondement même de la nouvelle "culture" universelle. Cette mutation a réduit l’homme à n’être plus que ce qu’il achète : pour employer un mot à la mode, il s’est réifié. Et Valéry Giscard d’Estaing de définir en ces termes son projet politique : "Promouvoir une immense classe moyenne de consommateurs". Dictature du bien-être ? Dès 1927, Drieu La Rochelle nous mettait en garde : "L’étouffement des désirs par la satisfaction des besoins, telle est l’économie sordide, découlant des facilités dont nous accablent les machines, qui viendra à bout de nos races. L’abondance de l’épicerie tue les passions. Bourrée de conserves, il se fait dans la bouche de l’homme une mauvaise chimie qui corrompt les vocables. Plus de religions, plus d’arts, plus de langages. Assommé, l’homme n’exprime plus rien" (Le Jeune Européen).
00:52 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, conditionnement |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 janvier 2008
De ondraaglijke lichtheid van het zgn. antifascistisch discours

DE ONDRAAGLIJKE LICHTHEID VAN HET ZGN. ANTIFASCISTISCH DISCOURS
door Peter LOGGHE
Voor De Standaard der Letteren van 7 augustus 2003 vat G. Van den Berghe het boek van Peter Godman over de katholieke inquisitie samen, en heeft het daarin in volgende bewoordingen over de heren inquisitoren : “Daaruit blijkt dat in zijn ogen de wereld werd beheerst door de strijd tussen goed en kwaad, en dat de Kerk en haar vertegenwoordigers die twee polen feilloos van elkaar konden onderscheiden. De kerkelijke elite voelde zich hoog verheven boven de “eenvoudigen en ongeletterden” (simplices et idiotae), die ze moesten leiden, onderrichten en behoeden voor foute interpretaties van de bijbel”. En verder : “(Ze) zagen het katholicisme als een belegerde vesting die ze uit alle macht moesten verdedigen. De waarheid was één en ondeelbaar, en werd vastgelegd door de Kerk. Alles wat daarvan afweek was ketterij, verraad aan God, majesteitsschennis”. En tenslotte : “De congregatie werkte ongecoördineerd en chaotisch. Het ene lid verbood wat het andere gedoogde. Enkelen bezaten de geestelijke souplesse en intellectuele scherpte om subtiele overwegingen te maken maar de meesten konden alleen de hakbijl hanteren”.
Godman, die Van den Berghe bespreekt, heeft het, zoals gezegd, over de inquisitie. Nu is het allang bon ton om in de katholieke pers de katholieke inquisitie te veroordelen, enige moed is hiertoe niet meer vereist, onze kranten lopen daarmee geen enkel risico, integendeel, vanuit bepaalde vrijzinnige hoek kunnen ze zelfs handgeklap en schouderklopjes ontvangen. Maar het vergt véél meer moed om dezelfde toon aan te slaan tegen de zgn. antifascistische inquisitie. Want, geachte lezers, vervangt u de woorden “God” door “Marx”, “Kerk” door “het stalinistisch communisme”, “ketters” door “fascisten”, en “(ze)” en “kerkelijke elite” door de “antifascisten” en u leest deze tekst als een treffende beschrijving van het zgn. antifascistisch kamp. In België, in Nederland, Duitsland, Frankrijk, in gans Europa.
De tactiek van het zgn. antifascistisch kamp is heel duidelijk : alles wat afwijkt van het dogmatisch marxisme wordt – in een geleidelijk proces weliswaar – gelijkgeschakeld met het verfoeilijke “fascisme”, te beginnen met wat men gespierd rechts zou kunnen noemen en eindigend bij allerlei rechtsliberale en conservatief-christelijke groepjes en clubjes. Althans, voor zover men hen hun gangen laat gaan. . De methoden zijn gekend : criminalisering, stigmatisering van andersdenkenden. Niet alleen de politieke en culturele uitingen van “andersdenken” moeten worden verboden, maar zelfs de gedachten, zelfs het politiek denken moet worden gestroomlijnd, zodat afwijkingen van de zuivere leer zelfs niet meer kunnen worden gedacht. Hier is al een tijdje aan de gang, wat ook in Duitsland – en dan vooral in het Bundesland Nordrhein-Westpfalen – met het begrip “nieuw rechts” aan de gang is. “Fascisme, zoals nieuw rechts, schrijft Dieter Stein in de uitgave 30 (van 3 tot 18 juli) van 2003 van het conservatieve weekblad Junge Freiheit, is een kauwgom, waar letterlijk alles kan worden ondergebracht, wat ook maar enigszins bedreigend voor de ingenomen machtspositie kan zijn”. Hij denkt dan aan “de inzichten van Amerikaanse communautaristen over sociale verbanden, de ideeën van de Britse adel over de Franse revolutie, Franse Gaullisten die nadenken over soevereiniteit en Deense rechtse liberalen over het migratieprobleem”. Wij kunnen hieraan toevoegen : De inzichten van Vlaams-nationalisten over Vlaamse onafhankelijkheid en hoe die te behalen op korte of middellange termijn. Dit alles vatten de heren zgn. antifascisten allemaal onder de hoed “rechts-extreem”, dus fascistisch en moet bestreden of verboden worden. De bedoeling is voor hoofdredacteur Stein duidelijk : rechtsintellectuele en conservatieve stromingen het etiket “rechts-extreem” opkleven, zodat men de gedachten kan verbieden, zonder de feitelijke discussie te moeten aangaan. Een zeer comfortabele positie : zo kunnen ze elk debat weigeren, want het gaat toch maar om “fascisten”.
Mark Grammens schrijft in Journaal nr. 341 van 17 mei 2001 kort, bondig maar daarom niet minder correct : “Men kan in een democratie geen mensen diskwalificeren omdat ze andere ideeën aanhangen”. Het gedachtemisdrijf is in wezen een kenmerk van totalitaire regimes, en hoort dus niet thuis in een echte democratie. Maar wat is er aan democratie overgebleven als bepaalde prominente leden van de zgn. progressieve pers – let wel : zonder dat ze hierop door andere weldenkenden worden aangesproken – kunnen schrijven : “De kiezer heeft altijd gelijk, luidt een mooi democratisch axioma, ik ben het daar niet langer mee eens” (Yves Desmet in De Morgen van 14 oktober 2000) ? Dit lijkt toch wel op een eerste aardige paradox in het zgn. antifascistisch discours : het aanwenden van fascistische methoden om een zgn. antifascistisch, maar in wezen totalitair regime te vestigen. De kaste van hogepriesters is al gewijd, nu alleen nog het volk vinden om de kerk te vullen. En dan is de vergelijking tussen zgn. antifascisten en de inquisitie toch al zo moeilijk niet meer, of vergis ik mij ?
Waar komt dit antifascisme vandaan ? Als je onderzoekt wie allemaal met dit scheldwoord wordt belaagd, Britse conservatieven, Vlaamse separatisten, Deense antifiscalisten, dan kan je niet om deze tweede paradox van het zgn. antifascistisch discours heen : het is een inhoudsloos woord geworden. En de geschiedenis van het zgn. antifascisme schetst dezelfde, gewaardeerde Mark Grammens in zijn Journaal als volgt in (pag. 2779) :
“Ervan uitgaande dat het fascisme van alle Europese diktaturen uit de eerste helft van de 20e eeuw waarschijnlijk de zachtaardigste was – en zelfs, samen met de diktatuur van Franco in Spanje, niet eens racistisch – vanwaar komt dan de omzetting van het begrip “fascisme” in een scheldwoord ? Dit is het gevolg van weer zo’n taboe in onze geschiedschrijving, namelijk het door Stalin via de Komintern aan zijn volgelingen in de wereld in de dertiger jaren gegeven bevel om hun pijlen niet te richten op het nationaal-socialisme, maar wel het “fascisme” tot enige en absolute vijand te maken. Was de reden hiervoor dat Stalin reeds met de gedachte van een bondgenootschap met het nationaal-socialisme speelde (het Ribbentrop-Molotov pakt van 1939) ? Neen, volgens de beschikbare gegevens was het alleen maar zijn vermoedelijk wel terechte vrees dat “nationaal-socialisme” door de opinie beschouwd kon worden als “socialisme” en dat aanvallen op dat regime dus onrechtstreeks en wellicht ten dele onbewust zijn socialisme konden benadelen. “Fascisme”, hoewel eveneens voortgekomen uit het socialisme, bevatte voor het dom gehouden volk die samenhang niet. Wie dus vandaag zijn tegenstander “fascist” noemt, terwijl die tegenstander geen Italiaan is, geen voorstander van een “corporatistische” staat, en geen andere specifieke denkbeelden van het fascisme aanhangt, - misschien zelfs, in tegenstelling tot de echte fascisten, racistisch is – is in wezen een stalinist : hij voert postuum de bevelen van Stalin uit.”
Natuurlijk moet men ook de slotformulering van Mark Grammens die het gebruik van het scheldwoord “fascisme” in de Vlaams-Belgische politiek een absurditeit noemt, volledig onderschrijven. Vermeende racisten als “fascisten” uitspuwen is stupied, lachwekkend wordt het als men Vlaamse separatisten eveneens met het scheldwoord “fascisten” bedenkt. Vlaamse separatisten streven naar het uiteenvallen van België, en Italiaanse fascisten streefden juist het tegenovergestelde na. In dit verband kan men het scheldwoord “fascisme” het best toepassen op de Groenen van Agalev en Ecolo en op de gehele Belgische intelligentsia die de lof en grootheid van het Belgische vaderland bezingt.
U heeft het al begrepen, lezer, fascisme is een scheldwoord geworden. In België dient dit scheldwoord als cement, als bindmiddel in een toch wel zeer vreemde coalitie van zeer tegenstrijdige krachten, maar die één zaak gemeen hebben : het heropleven en het voortbestaan van het Nederlands volksdeel, dat men Vlaanderen heet, bestrijden. Dit andere Vlaanderen bezit een oud vrijbuitersmentaliteit, is koppig en wil niet weten van allerlei opgelegde dogma’s. Des te erger voor dit Vlaanderen !
Maar we moeten onze blik niet eens verengen tot Vlaanderen om dezelfde strategie, dezelfde tactiek waar te nemen om elke conservatief, elke identitaire stroming te criminaliseren en te stigmatiseren. Dit is een Europese strategie. En dan is het verdraaid nuttig naar Europese figuren te kunnen verwijzen, die het voorgekauwde dogmatisch-marxistisch schema door elkaar hebben gehaald. Ik roep graag enkele getuigen à décharge op, figuren van Europees niveau. Zij hebben het zgn. antifascistisch spelletje grondig dooreen gehaald, en het past daarom even bij hen stil te staan.
EERSTE GETUIGE à décharge : Armin Mohler, de puzzellegger, de regenfluiter
Armin Mohler, ver buiten de Duitse staatsgrenzen bekend als auteur van het standaardwerk over de conservatieve revolutie (Die konservative Revolution in Deutschland 1918-1932 – Ein Handbuch) stierf op 4 juli 2003. Geboren in Basel (Zwitserland) in 1920 was hij in zijn jeugd duidelijk links georiënteerd. Hij onderging ook invloeden van Spengler, Nietzsche, Jünger. Even papte hij aan met het nationaal-socialisme en ging zelfs clandestien de grens over om in de Waffen-SS dienst te nemen, plan dat echter niet doorging. Ook werd hem heel snel de tegenstelling duidelijk tussen het nationaal-socialistisch apparaat en zijn conservatief-revolutionaire idealistische voorstellingen. Dan maar van het ongemak een deugd gemaakt : hij studeerde uiteindelijk af bij de professoren Karl Jaspers en Herman Schumacher over de conservatieve revolutie.
Eigenlijk moeten wij Armin Mohler enorm erkentelijk zijn : het begrip conservatieve revolutie werd door hem succesvol gelanceerd en blijft als begrip tot op vandaag overeind. Volgens Stephan Breuer is Mohler op die manier verantwoordelijk voor dit succesvolle begrip dat het ook in wetenschappelijke kringen heeft gemaakt. Het is ironisch dat deze term, die nu vaak door de hogepriesters van het zgn. antifascistisch geloof wordt verbonden aan het fascisme, juist door Armin Mohler werd geponeerd om duidelijk te maken dat er duidelijke verschillen bestonden tussen de conservatief-rechtse en/of jong-nationalistische krachten in het tussenoorlogse Duitsland en het aanstormende nationaal-socialisme en dat, als er van overlappingen tussen beide “kampen” kan worden gesproken, deze verbindingen zeker en misschien uitgebreider bestonden tussen andere politieke krachten (sociaal-democraten, liberalen, etc.) en het nationaal-socialisme.
Mohler omschreef het heterogene gezelschap van jongconservatieven, Völkischen, nationaal-revolutionairen, Bündischen en Landvolkbewegung als Konservative Revolution en zag hun eenheid in de strijd tegen de liberale decadentie en de universalistische tendensen van het moderne. Karl Heinz Weissmann herhaalt Armin Mohler in Junge Freiheit als hij schrijft : “Voor de Achsenzeit was het conservatief streven gericht op het verleden, daarna op de toekomst. Voordien is het erop geconcentreerd het overgeleverde te bewaren, of zelfs de verloren gegane toestand te herstellen. De Achsenzeit is voor de conservatief een tijd van ontnuchtering. Hij ziet dat bepaalde groepen een status quo hebben geschapen, die voor hen niet acceptabel is, en dat vroegere toestanden niet meer herstelbaar zijn. Zijn blik wendt zich voorwaarts”.
Onder invloed van de historicus Zeev Sternhell zou Armin Mohler iets later tot het besluit komen dat niet de Eerste Wereldoorlog of de bolsjewistische revolutie het echte lontmoment geweest waren voor de conservatieve revolutie, maar wel het feit dat het wegvallen van de toepasbaarheid van de termen “links” en “rechts” bij veel mensen voor reacties had gezorgd, en zij hierna stellingen begonnen te nemen die nu eens “links” en dan weer “rechts” waren. Men kan het ook anders omschrijven : ontgoochelden van links en rechts vonden zich in nieuwe positioneringen, die Zeev Sternhell als “fascisme” omschreef en Mohler juister als “konservatieve revolutie” bepaalt. Mohler doorstak het ballonnetje van rechts = conservatief = fascisme.
Laten wij Mohler echter niet de geschiedenis ingaan als alleen maar de auteur van een razend interessant handboek. Hij was secretaris van Ernst Jünger tot 1953 en als journalist voor enkele Zwitserse en Duitse dagbladen actief in Parijs. In 1961 leidde hij de Carl Friedrich von Siemensstiftung (tot 1981), een culturele kring met enorme uitstraling. Uit zijn Franse tijd hield hij een oprechte bewondering over voor het Gaullisme en hij probeerde vruchteloos de waarde van dit buitenlandse voorbeeld in de Duitse pers te brengen. Hij ging zwaar te keer tegen de Vergangenheitsbewältigung in Duitsland en stelde de onbehoorlijke vraag waartoe ze moest dienen. (Was die Deutschen fürchten en Der Nasenring behandelen dit thema uitvoerig). Mohler wees met scherpe pen op het soevereiniteitsdeficit en schaamde zich er niet voor uit te halen naar de VSA, zijn voornaamste vijand. Hij was niet in de eerste plaats anticommunist, wat hem onderscheidde van zovele (bange) Duitse conservatieven. Vijandschappen legde hij slechts na lang wikken en wegen vast, als we Karl Heinz Weissmann mogen geloven. Links viel hij aan niet omwille van haar neomarxisme, maar “wel omwille van haar steriliteit, haar neiging om de heropvoeding (van de Duitsers, red.) verder te zetten en haar hedonisme die elke cultuurscheppende ascese kapot maakt”.
Armin Mohler hield niet erg van het woord conservatief, omdat iedereen wel iets wil behouden of bewaren. Hij vond meer inhoud in rechts : rechts wil niet conserveren, het gaat er in werkelijkheid om toestanden te creëren, nieuw te creëren, waarvan het loont ze te bewaren.
Zijn laatste grote omslag kwam er met de Franse Nouvelle Droite (en hier kan misschien ook even opgemerkt dat Armin Mohler de Deltastichting en TekoS heeft gekend – ik verwijs naar het afscheidsartikel van Luc Pauwels in het ledenblad van de Delta-Stichting). Eén van de zaken die hem op filosofisch vlak verbond met de (toen) jonge Fransman Alain de Benoist was het nominalisme, waarover in TEKOS nummer 109 in vertaling een bijdrage werd afgedrukt. Nominalisme, een begrip en een inhoud die zoveel conservatieven irriteerden – zoals Mohler ook op andere manieren op conservatieven kon inhakken en hen irriteren : het onburgerlijke, ja zelfs het antiburgerlijke bij Mohler, zijn vitaliteit, zijn capaciteit om te begeesteren, zijn scherp oordeel en soms té scherp woord. Links of rechts : het kon Mohler eigenlijk niet veel schelen, als ze hun ding maar goed verdedigden.
Mohler heeft zijn droom, een professoraat politieke wetenschappen opnemen, nooit kunnen waarmaken. Veel uitgeverijen sloten voor hem hun deuren. In 1967 werd hem de Adenauerprijs toegekend en ontketende een bepaalde pers een heksenjacht tegen hem
Is hij mislukt in zijn leven ? Mohler, zo besluit Weissmann zijn artikel in Junge Freiheit, wees graag op auteurs die onduidelijke maar aanwijsbare invloeden op het leven hebben. “Regenfluiters” worden ze genoemd, maar het zijn eigenlijk vogels die met hun gefluit een storm aankondigen. Armin Mohler behoort tot het gild van de regenfluiters. Zo zei Mohler zelf : “Ze waarschuwen voor de komende vernietiging, maar ze wensen op geen enkele manier een terugkeer naar de goede oude tijd. Hun doel is niet het bewaren van hetgeen reeds land over zijn tijd heen is, maar het vasthouden aan het wezenlijke”. Mohler wees op het wezenlijke, wees op Europa, op onze cultuur, en dat had niets met “fascisme” te doen. De getuigenis van Armin Mohler zal van wezenlijk belang blijven in onze strijd .
TWEEDE GETUIGE à décharge : Ernst Niekisch, de taboebreker
Het complexe en niet alledaagse leven van Ernst Niekisch, zijn ideeën en de evolutie van zijn ideeën vormen één groot démenti van de ondraaglijke lichtheid van het zgn. antifascistisch discours : conservatief = rechtse zak = antisociaal = fascisme. Het blijft daarom boeiend enkele facetten en feiten aan het papier toe te vertrouwen en wij baseren ons hiervoor op de inleiding van Alain de Benoist van de Franse vertaling van Ernst Niekisch, Adolf Hitler – une fatalité allemande, Pardès, Puiseaux, 1991, ISBN 2 – 86714-093-5.
Niekisch gaat door voor één van de heftigste tegenstanders van het nationaal-socialisme en is een epigoon van wat men het nationaalbolsjewisme heeft genoemd. Hij werd geboren in Silezië in 1889 en zal in Berlijn sterven in 1967. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is hij instructeur van jonge rekruten en Feldwebel in een gevangenenkamp in München. Hij leest er Marx en sluit zich aan bij de sociaal-democraten. Op 18 november 1918 verneemt hij dat de republiek in München door Kurt Eisner is uitgeroepen, dat soldaten in Augsburg hun raden zouden willen aanduiden. De sociaal-democraten aarzelen en besluiten dan Niekisch naar de kazerne te sturen. Uren later is hij de voorzitter van de soldaten- en arbeidersraad, zit in het centraal comité van Beieren en zal zelfs afgevaardigde worden in het nationaal congres in Berlijn. Na de moord op Eisner, op 21 februari 1919, zal hij de beweging even leiden, en heeft hij oa. gesprekken met Rathenau, in de hoop de beweging nog te kunnen redden. Hij zal zich verzetten tegen de pogingen van de anarchisten Landauer en Mühsam om een tweede, communistische revolutie uit te lokken, want hij vindt het sovjetsysteem voor Beieren niet geschikt – een ruraal gebied. De witte terreur zal ook Niekisch niet sparen en hij wordt tot 2 jaar opsluiting veroordeeld Hij ontdekt er Spengler en leert er het primaat van de buitenlandse politiek erkennen, hij deduceert er dat een sociale revolutie eerst een nationale revolutie onderstelt. En bij Pruisische auteurs snuift hij de Pruisische geest op.
In 1922 ontmoeten wij Niekisch in Berlijn, de stad waar hij steeds naartoe wilde. Hij is er secretaris van de jeugdafdeling van de Duitse Textielvakvereniging (met 70 000 leden) en gaat er vrij snel de strijd aan met de reformistische vleugel van de partij. Hij wil een nieuwe intellectuele lijn voor de partij en pleit voor een verregaande identificatie van de arbeidersklasse met de staat en tegen de capitulatie t.o.v. Frankrijk en het Dawesplan, dat zal leiden tot een grote inmenging van het Amerikaanse bankwezen in Duitsland. De Duitse sociaal-democratische partij moet “de weerstand van het Duitse volk groeperen tegen het Westers imperialisme”. Hij poneert de quasi-identiteit van volks en staat. Staat en volk zijn één, een eenheid die boven de veranderingen van tijden staat, ook omdat zij niet één generatie vertegenwoordigt, maar alle. Dit is iets wat het uitsluitend politieke karakter van het liberalisme niet kan begrijpen, noteert Niekisch.
In Grundfragen deutscher Aussenpolitik (1925) verdedigt Ernst Niekisch de idee van klassentegenstellingen, maar onderstreept hij terzelfdertijd het primaat van de buitenlandse politiek, waar de klassentegenstellingen slechts secundair zijn. Als men de Russische revolutie slechts ziet als een sociaal revolutionaire gebeurtenis, dan merkt men het essentiële niet op. Men kan haar slechts begrijpen vanuit het licht van de buitenlandse politiek. En Niekisch hamert hier reeds op een nagel, die hij later nog herhaaldelijk zal beslaan : hij roept Duitsland op om weerstand te bieden tegen de “gerichtheid op het Westen”, gerichtheid die tegengesteld is aan de echte Duitse belangen. En door haar oriëntatie op het Westen versterkt de SPD (sociaal-democraten) het kapitalisme. Met deze stellingen heeft hij succes bij de Hofgeismarkreis, een kring van SPD’ers die proberen de nationale idee en het socialisme te verzoenen, en het is met deze kring dat hij het tijdschrift zal starten, Widerstand (vanaf 1926) dat hem befaamd zal maken. Met de medewerking van August Winnig krijgt het blad een nationaal-revolutionair karakter, Winnig riep de arbeiders op om deel te nemen aan de nationale opstand en stelde dat de vijand niet de patroon of de werkgever was, maar het internationaal financieel kapitaal. Jongconservatieven, neo-nationalisten, paramilitaire groepen met als voornaamste Oberland, Bündische groepen zullen de ideeën van Niekisch nu leren kennen, en uit bvb. de Bündische groepen, met hun ideeën over “Bündisch socialisme” zullen heel wat latere nationaal-bolsjewisten komen.
Belangrijk voor Niekisch is ook zijn ontmoeting met Ernst Jünger, die voor Widerstand enkele belangrijke bijdragen zal schrijven, maar die zich toch nooit nationaal-bolsjewist zal noemen. Hij heeft wel invloed op het blad en zal het in de richting duwen van een “nieuw aristocratisme”, geïnspireerd door een “heroïsch realisme”.
1928-1930 : De Widerstandskringen nemen uitbreiding, zowel op het vlak van medewerkers als op het vlak van invloed onderaan. A. Paul Weber, van wie we hier enkele tekeningen afdrukken, verleent zijn medewerking en de filosoof Hugo Fischer zet zijn schouders mee onder de onderneming. In 1928 wordt een uitgeverij opgericht, de Widerstandsverlag.
Het valt niet te ontkennen dat dit nationaalbolsjewisme tevens een hernieuwing betekent van de aloude “Ostorientierung”, maar nu tevens verbonden met een nieuwe ideologie in het Oosten, het bolsjewisme. Nationaalbolsjewisten wilden een gerichtheid op het Oosten, eerder dan op de Rijnlandse gebieden. En : voor hen is het Verdrag van Versailles een instrument van de liberaalkapitalistische bourgeois om de oorlog tegen Duitsland verder te zetten en haar op een blijvende manier te knechten. Het kapitalisme is het systeem van de onderdrukker en toevallig ook het economisch stelsel van het Westen. Duitsland moet dus een Schicksalsgemeinschaft vormen met Rusland.
Binnen de totaliteit van de Konservative Revolution zorgde dit wel voor moeilijkheden : hoe een natuurlijke “Ostorientierung” verzoenen met een noodzakelijke kritiek op het marxisme ? Twee sleutelideeën zullen hierbij helpen :
1. De overtuiging dat er heel wat gemeenschappelijke punten bestaan tussen bolsjewisme en Pruisische stijl – een sterke staat, gehiërarchiseerd, de wil om het burgerlijke parasietendom te vernietigen.
2. En de idee dat het bolsjewisme vooral een Russische beweging is, waarvan het internationaal marxisme maar een façade is.
Maar er bleef toch steeds een ambiguïteit bestaan binnen de conservatieve beweging : voor de enen was de bolsjewistische revolutie niets anders dan de radicale vorm van kosmopolitisme, anderen zagen 1917 dan weer als een elektrische schok, noodzakelijk om de Russen opnieuw een gevoel van eigenwaarde te geven. “Elk volk heeft zijn eigen socialisme” zou Moeller van den Bruck schrijven, met als onderliggende idee dat elk volk zijn eigen revolutie heeft, en dat elke revolutie ook door het volk wordt gekleurd. Nog anderen zien in het marxisme een soort nageboorte van het kapitalisme en achtten het dus niet in staat om dit kapitalisme afdoende te bestrijden. Vele nationaalrevolutionairen echter blijven de affiniteiten onderstrepen : het bolsjewisme is een idealistische beweging, gericht op een ethiek, een ethiek van de arbeid, het offer, het primaat van de collectiviteit op de enkeling. Vanaf 1927 wordt in deze kringen de Russische revolutie dan ook als een mogelijk voorbeeld van nationale en sociale herstructurering beschouwd. Widerstand zal in 1928 Stalin zelfs gelukwensen met de dood van Trotsky en zijn pogingen om de nationale orde en eenheid in Rusland te versterken. Niet alle nationaalrevolutionairen gaan even ver, en sommigen gaan nog verder. Karl O. Paetel, die in 1941 asiel zoekt in New York, en in 1963 een anthologie over de Beat generation zal schrijven, staat volledig achter de klassenstrijd.
In 1929 schrijft Niekisch met Jünger een artikel waarin zij pleiten voor een samenwerking met de communisten, op voorwaarde dat het marxisme zich zou keren tegen de gevestigde Weimarorde. Het wordt een dovemansgesprek, want voor de nationalisten zijn de marxisten nog maar halverwege, en voor de marxisten is het al even duidelijk : als de nationalisten werkelijk zo begaan zijn met het lot van de arbeiders, moeten ze maar gewoon marxisten worden.
In 1930 werkt Niekisch opnieuw hard in de richting van een nieuwe “Ostorientierung” : hij maakt duidelijk dat de Duitser geen slaaf of Rus moet worden, maar dat het gaat om een noodzakelijke coalitie. Rusland, voegt hij er aan toe, is niet liberaal, is niet parlementair en is niet democratisch. Zijn ideeën slaan vooral aan in Bündische kringen en bij het Oberlandkorps (vrijkorps). Niekisch mag regelmatig op bijeenkomsten het woord voeren, maar zijn minder gemakkelijk karakter veroorzaakt scheuren, en hij besluit zijn eigen kringen op te richten – wat daadwerkelijk gebeurt vanaf 1930-31, de zgn. Widerstandskringen. Het totaal aan effectieven schat Uwe Sauermann (een na-oorlogs publicist) op 5000, maar de invloed is vele malen groter. Louis Dupeux schat het totaal aan nationaalbolsjewisten op ongeveer 25 000. De invloed van Niekisch is vooral aantoonbaar bij jongeren, die worden aangesproken door zijn radicalisme, zijn scherpe formuleringen. Anderen verwijten hem dan weer zijn gebrek aan soepelheid, zijn moeilijk karakter. Hij was m.a.w. geen practisch politicus. Hij trok begeesterde leerlingen aan, maar kon nooit massa’s volgelingen verzamelen.
Nog een woord over de verhouding van Ernst Niekisch en het nationaal-socialisme. Hij was ongetwijfeld een van de eersten om te waarschuwen voor het nationaal-socialisme, reeds in 1927. Niet alleen omwille van haar jodenpolitiek, maar ook omdat het nationaal-socialisme vastzit in een fanatiek anticommunisme en haar “Ostorientierung” niets anders is dan expansionisme en imperialisme. Een politieke leer, die het ras als het beslissende element van haar politiek beleid maakt, beschouwt Niekisch niet als Duits, maar als Beiers, zuiders en katholiek. Begin 1932 brengt hij zijn brochure Hitler – ein deutsches Verhängnis op de markt, waarin hij zijn waarschuwingen nog eens herhaalt. Het boekje haalt een oplage van 40 000 exemplaren. Sebastian Haffner ziet Niekisch en Hitler als twee volmaakte antipoden, die maar één gemeenschappelijk punt hadden : hun haat voor de Weimarrepubliek.
In de lente van 1932 neemt Niekisch nog deel aan een studiereis naar de Sovjet-Unie op uitnodiging van een arbeidsgroep voor de studie van planeconomie (Arplan), hij heeft er contact met Karl Radek, en schrijft bij thuiskomst nog een lovend artikel over de Sovjet-Unie, waarin hij pleit voor de collectivisatie als een mogelijke sociale organisatievorm die “de moordende effecten van de techniek het best kan beheersen”.
Niekisch wordt – zoals iedereen – in snelheid gepakt door de machtsgreep van Hitler, “een persoonlijk succes voor de man, een mislukking voor het nationaal-socialisme” vindt hij. Hij noemt hem ook “der Talentlose”. Op 20 december 1934 wordt Widerstand verboden, en Niekisch wordt de verklaarde vijand van de NSDAP. Ondanks politiecontrole slaagt hij er nog in enkele binnen- en buitenlandse reizen te maken. Hij blaast de rijksgedachte nieuw leven in als laatste poging om het racisme van het nationaal-socialisme een alternatief te bieden. Zijn laatste brochure Die dritte Imperiale Figur en Im Dickicht der Pakte worden door de Gestapo opgespoord. Op 22 maart 1937 wordt hij, samen met een zeventigtal van zijn medestanders, aangehouden en op 10 januari 1939 volgt het oordeel : hij wordt veroordeeld wegens hoogverraad, zijn bezittingen worden aangeslagen en hij verliest zijn burgerrechten. In 1945 wordt hij door de Amerikanen bevrijd, hij wordt lid van de (West-Duitse) KPD en hij wordt professor aan de Humboldt-universiteit in het oostelijke deel van Berlijn. Hij noemt zich voortaan democraat en progressief, hij valt opnieuw de westelijke orientering aan van de BRD en staat op een strikt neutralisme, maar hij blijft streven naar een herenigd Duitsland.
Niekisch een fascist ? Voor Sebastian Haffner is hij een revolutionair socialist, Armin Mohler beschrijft hem als de meest radicale nationalist. Alain de Benoist sluit zijn inleiding als volgt af : Niekisch werd gevangengezet onder Weimar, onder Hitler, uitgespuwd door de overheden van de BRD en veracht door de DDR. Zijn fundamentele idee blijft dat nationale bevrijding en socialistische revolutie samengaan. De paradox is dat Niekisch de URSS bewonderde door juist die redenen, waarvoor ze werd verafschuwd door haar tegenstanders, en voor de omgekeerde redenen, waarvoor ze werd bejubeld door haar bewonderaars. Natuurlijk heeft Niekisch zich veel illusies gemaakt over de Sovjet-Unie, maar hij heeft het toch op enkele punten bij het rechte eind : is het vanop afstand bekeken niet zo dat het Stalinistische Rusland eerder moet worden gekwalificeerd als een nationaal-bolsjewistische staat ? En opent een nieuwe Duits-Russische samenwerking geen perspectieven voor morgen ?
CONCLUSIE
Er is geen fascistische dreiging in Vlaanderen, in Nederland, in Europa. Een logische vraag blijft dus gesteld : waarom is er dan een zgn. antifascisme ? De twee getuigen à décharge moeten de druk op dit zgn. antifascistisch kamp verhogen om eindelijk eens hierover de discussie aan te gaan.
00:35 Publié dans Définitions, Manipulations médiatiques, Nouvelle Droite, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 19 janvier 2008
Pour une volonté impériale !

Marcello DE ANGELIS :
Pour une volonté impériale !
Etre ou ne pas être : le dilemme d’Hamlet se pose à la jeunesse d’Europe
Quand Samuel Huntington, professeur à Harvard, a publié son célèbre livre, The Clash of Civilizations, aujourd’hui cité jusqu’à la nausée, il augurait l’avènement d’une nouvelle dimension conflictuelle dans le monde, suscitée cette fois par les origines culturelles, rassemblées dans des espaces organiques autocentrés de dimensions continentales, espaces opposés les uns aux autres ; dans cet affrontement planétaire à acteurs multiples, il réservait à l’Europe un rôle pour le moins ambigu. Il désignait notre continent comme la matrice de la « civilisation occidentale », admettait qu’il allait devenir une superpuissance économique et militaire. Mais au fil de son exposé, il finissait par répéter l’hypothèse que, dans le futur, l’Europe continuerait son petit bonhomme de chemin comme dans les années 50, au sein de ce que l’on appelle depuis lors le « monde occidental ». Il n’y aura pas, selon Huntington, deux agrégats indépendants et autonomes respectivement sur le continent nord-américain et en Europe. Cette thèse n’a guère préoccupé les esprits, elle est passée quasi inaperçue, la plupart des observateurs ont considéré que ce vice d’analyse dérive d’un effet d’inertie, propre de la culture américaine, qui s’est répercuté sur le cerveau de l’honorable professeur, par ailleurs excellent pour tous les brillants raisonnements qu’il produit.
Huntington mérite aussi nos éloges pour avoir eu tant d’intuitions, pour avoir prospecté l’histoire européenne , en feignant un à-peu-près qui découvre par « accident » les rythmes réels du monde, qui lui permettait de prédire que le destin de notre Europe n’était pas prévisible comme l’était celui des autres parties du monde. Certes, l’Europe pourra soit se muer en un bloc autocentré soit garder le corps de ce côté de l’Atlantique et le cerveau de l’autre. La question reste sans solution. Et si le livre de Huntington —comme le soulignent quelques esprits plus fins— n’était pas un simple essai académique mais plutôt un scénario à l’usage de l’établissement américain… Quoi qu’il en soit, l’établissement a très bien retenu la leçon de Huntington et a vite mis tout en œuvre pour agencer le monde selon ses intérêts économiques et géopolitiques.
Les deux concurrents les plus sérieux des Etats-Unis à l’échelle de la planète, selon la logique d’affrontement décrite par Huntington, devraient être l’Empire européen et un Califat islamique rené de ses cendres. L’Empire européen (potentiel), fort d’une culture spécifique et pluri-millénaire, humus indestructible d’une formidable mentalité, capable de disposer d’une technologie militaire de pointe, bénéficiant d’un marché intérieur supérieur à celui des Etats-Unis, aurait facilement marginalisé le colosse américain grâce à un partenariat quasiment obligatoire avec les pays limitrophes de l’Europe de l’Est et à un développement harmonieux des pays de la rive sud de la Méditerranée. De son côté, le monde islamique, qui peut plus difficilement engager un dialogue avec la civilisation américaine, décrite par quelques scolastiques musulmans comme le pire mal qui ait jamais frappé la planète et le contraire absolu de tout ce qui est « halal » (pur) ou « muslim » (obéissant à la loi de Dieu). Ce monde musulman connaît une formidable expansion démographique et détient la majorité des gisements de pétrole. Si l’Empire européen voit le jour, se consolide et s’affirme, il est fort probable que ce monde musulman change de partenaires commerciaux et abandonne les sociétés américaines. Le monde orthodoxe-slave-byzantin, handicapé par la totale dépendance de la Russie vis-à-vis de la Banque mondiale, connaît actuellement une terrible phase de recul.
Actuellement, les mages de la stratégie globale américaine semblent avoir trouvé une solution à tous les maux. D’un côté, ils favorisent la constitution d’un front islamique hétérogène, avec la Turquie pour fer de lance et l’Arabie Saoudite pour banque. Ce front en forme de « croissant » ( !) aura l’une de ses pointes au Kosovo, c’est-à-dire au cœur de l’Europe byzantine, et l’autre dans la république la plus orientale de l’Asie Centrale ex-soviétique : ainsi, toute éventuelle renaissance du pôle orthodoxe ou panslave sera prise dans un étau et le monde islamique sera coupé en deux. Pire, en ayant impliqué l’Union Européenne dans l’attaque contre la Serbie, les stratèges américains ont empoisonné tout dialogue futur en vue de créer une zone d’échange préférentiel entre cette Union Européenne et le grand marché oriental slave et orthodoxe. Or, ce marché est l’unique espoir de voir advenir un développement européen et de sortir l’Europe ex-soviétique du marasme actuel ; le passage de l’aide américaine à l’aide européenne aurait permis un saut qualitatif exceptionnel.
L’Europe se trouve donc dans l’impasse. Comment faire pour en sortir ? Mystère ! Une Europe forte économiquement, même bien armée, s’avère inutile si elle n’est pas libre et indépendante ; tout au plus peut-elle être le complément subsidiaire préféré d’une autre puissance. Toute Europe autonome et puissante est obligatoirement le principal concurrent des Etats-Unis tant sur le plan économique et commercial que sur le plan politique et diplomatique. Notre continent devra donc opérer ce choix crucial et historique : ou bien il restera ce volet oriental du Gros-Occident, niant de ce fait sa propre spécificité, diluant progressivement sa propre identité dans une sur-modernité qui la condamnera à demeurer terre de conflits et zone frontalière, limes face à l’Est et face à l’Islam pour protéger les intérêts et la survie d’une puissance impériale d’au-delà de l’océan ; ou, alors, l’Europe se réveillera et retrouvera une nouvelle dimension, qui est tout à la fois sa dimension la plus ancienne ; elle ramènera son cerveau en son centre et en son cœur, elle rompra les liens de subordination qui l’entravent et partira de l’avant, redevenant ainsi maîtresse de son destin.
Ce réveil est le juste choix. Mais est-il possible ? On ne peut malheureusement rien prédire aujourd’hui. Quoi qu’il en soit, il reste en Europe une certaine volonté d’agir dans la liberté et l’indépendance.
Marcello de ANGELIS.
(article paru dans Area, juin 1999).
00:10 Publié dans Affaires européennes, Nouvelle Droite, Politique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 janvier 2008
P. Maugué: questions à la ND

Un texte du regretté Pierre Maugué, décédé prématurément, sur la ND, rédigé dans le feu de la polémique qui avait opposé ses différentes fractions en l'an 2000. Texte toujours instructif, à lire avec le recul qu'impose le temps écoulé...
Pierre MAUGUE :
Questions à la "Nouvelle Droite"
La ND française à la croisée des chemins
La Nouvelle droite française se trouve à la croisée des chemins. Elle n’embraye plus, comme jadis, sur les réalités politiques, économiques, sociales et sociétales de notre époque. Si elle parvient encore à identifier la plupart des problèmes majeurs auxquels nous sommes confrontés[1],elle les analyse de plus en plus du point de vue de Sirius, sans indiquer, sinon des solutions, du moins des voies qui pourraient être sérieusement explorées pour sortir de l’impasse. Elle emploie de plus en plus le langage descriptif et explicatif de l’historien ou du sociologue pour dessiner le monde qui est en train de se construire (ou de se détruire), renonçant à essayer de le changer, et tournant résolument le dos à toute possibilité d’action.
Déconnectant la théorie de la praxis (alors que d’autres déconnectent la praxis de la théorie), elle paraît plus avide d’être reconnue par l’intelligentsia en place que de peser sur le cours de l’histoire, avec tous les risques que cela comporte. Elle oublie que si Marx a eu une influence majeure sur l’histoire politique du dernier siècle, et non pas seulement sur l’histoire des idées, ce n’est pas en raison de son œuvre majeure, Das Kapital, destinée à un cénacle de spécialistes et que pratiquement personne (même parmi les grands leaders et intellectuels marxistes) n’est parvenu à lire en entier, mais par Le Manifeste communiste, fresque grandiose propre à enflammer les imaginations, et traduite dans pratiquement toutes les langues. C’est enfin par la création et l’animation de sections nationales de l’Internationale socialiste que les idées de Marx ont commencé à influer sur l’histoire du monde qui était en train de se faire.
La Nouvelle droite française et ses dirigeants paraissent, quant à eux, affligés du même défaut que la vieille droite d’Action française. En effet, si Charles Maurras fut un penseur qui ne manqua pas de lucidité, il eut une absence quasi totale de stratégie politique, et n’influa jamais réellement sur le cours des évènements.
Cette déconnexion entre théorie et praxis (Nouvelle droite) et entre praxis et théorie (droite populiste), est un écueil majeur, qui se retrouve, à des degré divers, dans toute l’Europe, mais qui semble atteindre son paroxysme en France.
Une série de questions mériteraient d’être débattues. Sans avoir la prétention d’être exhaustif, nous soumettons la liste suivante :
SUR LA FORME
1 - Peut-on prétendre défendre les traditions indo-européennes de l’Europe dans le cadre d’un mouvement dirigé d’une manière autocratique, contraire au principe de gouvernement des communauté d’hommes libres que l’on retrouve de la Grèce ancienne à la Scandinavie?
2 - Dans une société qui est rien moins que respectable, un souci constant de respectabilité ( qui n’est le plus souvent qu’un alignement sur la politique du politiquement correct) est-il justifié pour la Nouvelle droite ? Reflet d’une mentalité petite-bourgeoise chez ceux-là mêmes qui prêchent une morale aristocratique, est-il compatible avec la conquête de nouveaux territoires idéologiques ?
3 - La polémique ( forme ritualisée du duel) est-elle une arme qui peut être utilisée contre nos adversaires, sans compromettre le sérieux de notre discours ?[3] Faut-il réintroduire l’ironie et l’insolence dans le combat des idées et reprendre, à cet égard, la tradition d’Erasme et de Fischart ?
4 - Peut-on, par crainte d’être accusé de populisme, déconnecter la théorie de la praxis, et prétendre avoir une action sur l’évolution du monde uniquement par l’écrit et la parole ? L’action métapolitique ne comporte-t-elle pas le risque de devenir une justification de l’impuissance ?
SUR LE FOND
5 - Peut-on prétendre défendre la culture millénaire de l’Europe sans défendre prioritairement, avec la plus grande vigueur, toute atteinte portée au socle ethnique de cette culture ?
6 - La question de l’immigration peut-elle être considérée comme transcendant le traditionnel clivage gauche/droite ? Si tel est le cas, doit-on défendre l’idée que le peuple puisse s’exprimer par voie référendaire[4] sur la politique d’immigration et que, si nécessaire, la constitution de l’Etat soit modifiée à cet effet ?
7 - Indépendamment des positions idéologiques de chacun, peut-on, dans une Europe en plein déclin démographique, être en faveur d’une libéralisation excessive de l’avortement, voire même, promouvoir l’avortement ?
8 - La géopolitique est-elle un élément essentiel de toute réflexion politique, et peut-elle être crédible si elle ne s’appuie pas sur les données démographiques propres à l’époque envisagée ?
9 - Même si le fédéralisme ethnique peut apparaître comme le meilleur moyen de protéger la diversité ethno-culturelle de l’Europe, n’y a-t-il pas cependant un risque d’émiettement de souveraineté propre à affaiblir l’Europe, si ce principe est appliqué inconsidérément? Le danger existe-t-il que les Etats-Unis, ou d’autres ennemis de l’Europe, attisent les différences ethniques entre peuples européens pour en faire des facteurs de déstabilisation et les utiliser à leur profit (Diviser pour régner) ?
10- Toutes les religions monothéistes doivent-elles être considérées comme présentant un danger d’égale nature et de même ampleur dans l’optique d’une défense de la composante païenne de l’identité européenne ?
SUR LA STRATÉGIE
11 - Les idées de la Nouvelle droite peuvent-elles être efficacement défendues en Europe par des mouvements qui continuent (même s’ils restent en contact) à marcher en ordre dispersé, alors que l’orientation politique de l’Europe socialo-libérale est de plus en plus déterminée par des institutions communes, à Bruxelles, Strasbourg ou Luxembourg. ? Serait-il opportun de créer une structure de type fédératif pour harmoniser la doctrine et l’action des divers mouvements nationaux ?
12 - Des actions communes, à l’échelle européenne, pourraient-elles être envisagées sur des questions précises ? Par exemple, orchestration d’une campagne demandant que la procédure du référendum d’initiative populaire soit introduite dans tous les pays européens, afin que le peuple lui-même puisse se prononcer sur la politique d’immigration ?
Pierre MAUGUÉ.
00:50 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 janvier 2008
Du dextrisme

Un texte de la polémique interne aux "Nouvelles Droites", qui fit rage en 2000. Elle mérite une lecture attentive, mais avec le recul voulu...
Patrick CANAVAN :
Du Dextrisme
Dans le cadre du débat qui agite la nouvelle droite française, Patrick Canavan, collaborateur de Vouloir et de Nouvelles de Synergies Européennes, présente sa propre définition du "dextrisme", néologisme qui doit désigner, selon lui, le microcosme néo-droitier. Il est clair que Canavan prend parti pour l'orientation Faye/Vial, tout en restant critique.
"Soyons des donneurs de sens" (Pierre Vial).
" Notre terre, c’est l’Eurosibérie, l’Empire du Soleil, le domaine d’Apollon et de Dionysos, de l’Atlantique au Pacifique, immense espace sur le quel le soleil ne se couche jamais " (Guillaume Faye).
Parallèlement au numéro 11 de Vouloir, dossier important consacré aux nouvelles droites, il a paru bon d’évoquer les récentes publications issues de cette mouvance dextriste pour apprécier comment sont analysés les principaux enjeux idéologiques de l’an 2000. Par Nouvelle Droite, on entend généralement le GRECE groupé autour du seul Alain de Benoist. Parler de nouvelles droites, au pluriel et sans majuscule paraît plus fidèle à la réalité. Le terme "dextrisme" pourrait définir un état d’esprit, une vision de l’homme et du monde dont nul n’a le monopole et ignorant l’orthodoxie.
Pierre Vial, professeur d’histoire médiévale à Lyon III, fondateur du GRECE (en mai 68!) et animateur de Terre et Peuple s’est plié au jeu de l’entretien avec O. Chalmel qui dirige la revue de cette association pour une culture enracinée (1). Le résultat est excellent: l’entretien est vivant, libre et nous apprend énormément sur le personnage, nettement plus complexe que l’image du militant national-populiste habituellement colportée. Guillaume Faye paie sa dette intellectuelle et spirituelle à son vieil ami dans une belle préface: Vial fut, avec G. Locchi, J. Mabire, D. Venner, l’un des maîtres du jeune Faye, qui s’imposa vite comme l’un des principaux esprits, sans doute le plus novateur, du GRECE, dès 1973. Faye définit bien Vial comme une sorte de moine-soldat, perdu dans ce stupide XXème siècle... Pour le XXIème, je n’en dirais pas autant puisqu’il verra se réincarner - comme Faye l’a bien montré dans son Archéofuturisme - des figures plus qu’anciennes. Vial est de celles-ci. On pense aussi au sanglier, qui "n’attaque que pour se défendre", mais alors quelle charge! Et c’est vrai que la prose de Vial dégage un fumet de gibier, de fortes odeurs forestières qui peuvent heurter les narines de certains, plus habitués à la nouvelle cuisine.
Faye définit aussi l’association Terre et Peuple - allusion claire au sang et au sol, ce qui se transmet de générations en générations - comme " la principale force de combat et d’action métapolitique et culturelle pour l’idée européenne ". Il rappelle aussi que la métapolitique bien comprise n’est jamais entièrement coupée du politique, sous peine de neutralisation. On ne demande certes pas aux théoriciens de coller des affiches ni d’abdiquer leur esprit critique, mais de ne pas démobiliser ceux qui se sentent faits pour le combat au quotidien, les militants.
La lourde hérédité de Pierre Vial
Celui qui s’est imposé comme l’un des spécialistes de l’Ordre du Temple, est manifestement fier de ses ascendances lyonnaises et mal-pensantes: un ancêtre blanquiste, un autre poilu de la Grande Guerre, on voit que l’hérédité du Professeur est lourde. A lire ses évocations du Lyon de sa jeunesse, de son père bonapartiste, on comprend mieux l’organicisme quasi obsessionnel de P. Vial, cette conception très charnelle de l’héritage. D’avoir vu son père pleurer le jour de la chute de Diên Biên Phu a marqué cet adolescent à jamais, l’entraînant sur des chemins périlleux dont il n’a pas dévié d’un pouce. Itinéraire impeccable, via recta qui forcent le respect, même si l’on nuancera tel ou tel point. Mais l’essentiel est là, dans l’attitude. Or comme disait Drieu: " on est plus fidèle à une attitude qu’à des idées ". Sur ce plan-là, Vial se qualifie benoîtement de " nationaliste révolutionnaire ", de " gibelin " et même, horresco referens, de paganus, ce qui, pour un élève des Pères n’est pas gentil. Mais voilà, Vial est l’un de ces Gentils (en grec: ethnikoi) qui regrettent l’absence toute provisoire des Druides. Ceci ne fait pas de lui un rêveur inoffensif.
Après ses premières armes au sein de groupes subversifs (notamment Jeune Nation avec D. Venner), il est l’un des fondateurs du GRECE, et l’une de ses chevilles ouvrières jusqu’en 1987, date de son passage au FN. Son témoignage sur ces vingt ans de combat culturel est du plus haut intérêt puisqu’il couvre la grande époque de la nouvelle droite originelle aujourd’hui éclatée. Elle innove et suscite alors de grands débats: les Indo-Européens, l’inné et l’acquis, les races, l’égalitarisme, l’eschatologie judéo-chrétienne, le paganisme, l’éthologie, Schmitt et Gehlen, etc. Un feu d’artifice. Mais comme le montre bien Vial, qui connaît ce mouvement de l’intérieur (et y a gardé quelques amis), le GRECE subit l’usure, ignore pour des raisons obscures de grands problèmes, tel que l’immigration non européenne. Surtout, son chef prend systématiquement ses distances avec ce qui pourrait ressembler à une application concrète des grands principes. Le réel semble lui soulever le coeur. Vial est sévère, comme tous les amis déçus: le GRECE, à la fin des années 80, " se mord la queue ", perd toute prise sur une réalité de plus en plus dramatique.
Naguère A. Imatz, dans son excellente synthèse Par delà droite et gauche (Ed. G. de Bouillon, Paris 1996, recensé à l’époque dans Vouloir) avait déjà fait le même diagnostic en parlant de stagnation. Et si cette association avait été la principale victime du succès de Le Pen? La hantise d’être amalgamé au clan populiste (aux insuffisances bien réelles !) n’a-t-elle pas poussé certains à se distancier au point de perdre le contact, ou à renoncer à dire le fond de leur pensée?
Refuser l'académisme pour prôner le rêve et l'action
Le médiéviste nous livre des réflexions profondes sur l’essence du pouvoir. Servi par une culture historique sans rien de sec, Vial a médité, malgré son activisme débordant, sur le Politique; il est manifestement un disciple de Julien Freund. Le pédagogue a aussi planché sur l’indispensable formation des militants, auxquels il voue un amour sincère (toujours ce côté charnel, boy-scout diront les malicieux): Vial sait que l’idée doit toujours s’incarner et que sans soldats prêts à les défendre, elles ne sont que prétexte à notes en bas de page. Plaisant paradoxe que cet universitaire qui, n’ayant rien à prouver dans le domaine de l’érudition alimentaire, refuse l’académisme démobilisateur pour prôner et le rêve et l’action!
Nuançons tout de suite le propos et ne soyons pas hagiographes: du reste ce drôle de moine ne doit pas apprécier les Vies de saints, ou alors pour y retrouver les traces de l’ancienne religion! Terre et peuple, sang et sol, en bref l’héritage. Fort bien. Et l’Esprit? N’y a-t-il pas risque de matérialisme grossier, voire de malentendu. Blut und Boden et exaltation de la horde: tout ceci est connu, diabolisable à l’infini, et, surtout, a montré ses limites. Le piège serait le mimétisme, le jeu de rôle (tribalisme virtuel et saine barbarie), l’ambiguïté, postures toutes les trois impolitiques et irréalistes. Or Aristote le disait fort bien: la Politique est l’art du possible. Hors de ce constat, point de salut.
A propos de l’inévitable accusation de racisme , Vial rappelle que l’identité compte trois composantes: la race (" qui conditionne beaucoup de caractères " remarquons qu’il ne dit pas " tous les caractères "), la culture (et l’éducation comme dressage) et la volonté (facteur aujourd’hui déterminant car indispensable pour refuser le métissage). Voilà des idées à développer, ainsi que celle de différence et de (légitime) préférence. Tout un travail d’encyclopédiste à effectuer sur le vocabulaire. Naguère, Faye et Steuckers avaient publié un exemplaire lexique du partisan européen, qu’il conviendrait de refondre avec l’aide d’une équipe dextriste mêlant les sensibilités et les générations: de Mabire à Racouchot par exemple.
Une géopolitique aux intuitions justes
Comme son ami Faye, comme Steuckers, autre gibelin, Vial se révèle géopoliticien aux intuitions justes: " Il faut penser à l’Eurosibérie, à l’espace eurosibérien, au grand empire que peut être un jour l’Europe et son prolongement en direction de l’Asie. Là il y a des éléments de motivation, de mobilisation psychique et d’enthousiasme capables de parler à l’imaginaire des gens qui ont vingt ans ". Un livre sur la nécessaire confédération impériale est d’ailleurs en chantier dans les scriptoria de Terre et Peuple. Lors du colloque de mai 2000, qui fut un franc succès (350 personnes enthousiastes, dont une majorité de jeunes) un appel appuyé à l’Eurosibérie ethnocentrée (et même au Sacrum Imperium) a été lancé par les divers orateurs, comme en témoigne le compte-rendu assez objectif publié par Le Monde (30 mai 2000).
On trouvera dans ce livre qui fera date des textes plus anciens de Vial publiés dans Eléments, Identité, Questions de, etc. et traitant des marottes du Professeur: la guerre et le sacré, la forêt, Merlin, Vincenot. Ce florilège se termine par une belle exhortation au mouvement identitaire grand-continental, nécessairement multipolaire, ce Mouvement Social d’Empire dont l’Eurosibérie a besoin.
Une condamnation de l'ethno-masochisme
Après le Nouveau discours à la nation européenne et l’Archéofuturisme, G. Faye revient avec un livre explosif tout simplement intitulé La colonisation de l’Europe. Discours vrai sur l’immigration et l’Islam. Pour en parler, la prudence s’impose, vu que la République, dans son infinie bonté, s’est dotée de lois liberticides restreignant le débat sur cette question essentielle: le devenir anthropologique de l’Europe. L’essai (350 pages) est torrentiel, comporte parfois des redites, des approximations (des chiffres cités seraient inexacts), mais quelle rupture avec l ’idéologie dominante! (2) Quelle condamnation de l’ethnomasochisme occidental dans ce cri d’alarme face à la submersion de notre continent par des masses souvent musulmanes parties à la recherche de l’Eldorado, tels les miséreux du roman déjà ancien de J. Raspail: Le camp des saints. Refusant à la fois la naïveté prométhéenne et le caritarisme chrétien, Faye nous met en garde contre les utopies assimilationnistes et communautariennes. Il rappelle que le conflit, le rapport de force, même codifiés, demeurent les fondements de la vie sociale. Or aujourd’hui, le risque de fracture ethnique, de partition du territoire européen existe bel et bien. Pour lui, le socle bio-anthropologique de notre civilisation est en passe d’être profondément modifié. De façon très lucide, Faye met en lumière des phénomènes soigneusement cachés par les élites au pouvoir: la dévirilisation des Européens et la bestialisation des Africains (dans la publicité par exemple), l’ethnomasochisme des Blancs (haine de soi et mixomanie), la montée d’une guérilla raciale, la constitution comme aux Etats-Unis de tribus hostiles pratiquant la razzia et l’économie parallèle, etc.
Le GRECE hors du réel
Suivant les thèses développées par le politologue Alexandre del Valle dans ses deux livres déjà classiques sur l’instrumentalisation de l’Islam combattant par Washington pour diviser le continent (Golfe-Balkans-Tchétchénie), de l’immigration incontrôlée pour le saper de l’intérieur, Faye évoque la thèse d’une alliance (temporaire) entre thalassocrates et islamistes. Il critique aussi le risque de démobilisation de la mouvance identitaire par certains théoriciens de l’actuel GRECE qui tiennent des propos franchement irréalistes sur l’immigration, aux lisières du politiquement correct, et surtout en rupture complète avec la simple observation du réel. Des rumeurs d’éventuel procès contre G. Faye ayant filtré en mai 2000, nous conseillons à nos lecteurs de se procurer sans tarder ce livre authentiquement subversif et idéologiquement délinquant qui place son auteur parmi la cohorte des déviants, pourchassés par les inquisiteurs et respectés par les hérétiques du moment. Une critique, justement signalée par divers lecteurs (R. Steuckers dans ses passionnantes lettres électroniques – robert.steuckers@skynet.be ainsi qu’un mystérieux Cercle Gibelin cerclegibelin@hotmail.com) : l’allusion récurrente à la guerre ethnique peut être dangereuse auprès de jeunes esprits non encadrés car comprise de travers comme un appel à la guerre civile, distorsion que les adversaires ne manqueront pas d’exploiter.
Après ces deux livres remplis de sève, volcaniques et radicaux, abordons maintenant deux titres qui illustrent la démarche de l’actuel GRECE.
A l’occasion du colloque de janvier 2000 sur la désinformation, l’association publie un Manifeste pour une renaissance européenne, rédigé par Alain de Benoist et Charles Champetier, les idéologues de cette mouvance (3). Malgré des aspects intéressants (le monde comme pluriversum, le cosmos comme continuum), le texte en est décevant: ton compassé, langue de bois, ambiguïtés et insuffisances sur des sujets graves. En voici un exemple, à propos de l’immigration: "ni apartheid ni melting pot: acceptation de l’autre en tant qu’autre dans une perspective dialogique d’enrichissement mutuel". Que signifie ce charabia "dialogique" qui fait penser aux brochures en faveur de "l’ouverture à l’Autre" (la majuscule aurait été préférable). Tout ceci serait comique si le sujet n’interdisait la légèreté: c’est de l’avenir de notre communauté dont nous parlons. Plus loin, les mêmes prônent une véritable reconnaissance dans la sphère publique des "différentes communautés qui vivent en France" (admirez l’euphémisme), bref, en clair, l’acceptation d’un droit islamique, et à terme, de la partition du territoire car on ne voit pas ce qui ferait reculer les élus musulmans et leurs institutions (nous parlons bien de "reconnaissance dans la sphère publique ") de réclamer leur territoire. Cela s’est vu et traduit par des millions de personnes tuées ou expulsées de force au Pakistan, au Bengladesh, au Kosovo. Est-ce cela le modèle proposé par le GRECE ? Qui mobilisera-t-il ?
Toujours au sujet de cette mouvance, signalons le recueil de textes Aux sources de la droite, publié par A. Guyot-Jeannin, journaliste du GRECE, qui avait déjà édité un décevant dossier Evola (4). Il récidive aujourd’hui avec ce livre où divers acteurs de la scène dextriste interviennent sur des sujets tels que l’Europe (J. Mabire), la résistance (P. Conrad), la Tradition (JP Lippi), les Lettres (d’Algange), les régions (JJ Mourreau), etc. Les textes cités ici, malgré leur taille réduite, sont parmi les plus intéressants de ce recueil assez inégal, où manquent les signatures d’un Venner, d’un Vial, et de G. Faye bien sûr. Ils semblent avoir été jugés indignes de figurer au sommaire du recueil, qui n’aborde pas les questions telles que la droite et l’ordre, la géopolitique, l’art, le temps, le paganisme (pour la religion, seul le catholique C. Rousseau a droit à la parole), etc. De même, appel n’a pas été fait à des écrivains : Raspail, Déon, Mourlet, de jeunes auteurs auraient pu ajouter leur grain de sel. On est surpris de ne lire aucun acteur politique : un Mégret, un Le Gallou, une I. Pivetti, voire un Bossi auraient pu être interrogés. Et Haider : n’était-ce pas le moment de voir ce qu’il pense ?
Guyot-Jeannin: travail incomplet et bâclé
Autre reproche : n’avoir interrogé que des Français alors que c’est en Italie, en Grande-Bretagne et pourquoi pas aux Etats-Unis que le courant néo-conservateur effectue un travail novateur. Rien sur la droite en Europe centrale et orientale, rien sur la Russie. Travail incomplet et bâclé dont l’objectif visible est davantage d’occuper le terrain que de tracer des pistes. Parisianisme et copinage, bref rien de fondateur. L’introduction de Guyot-Jeannin est du charabia d’inspiration pseudo-légitimiste (Pierre Boutang doit hurler là-haut !), la bibliographie fort pauvre quand on la compare à l’essai excellent d’Imatz cité plus haut. Plus grave, les sophismes abondent tel que celui-ci, dû à A. Guyot-Jeannin, qui fait ici preuve de sa clairvoyance habituelle: "Ce n’est pas parce que certains immigrés posent problème (sic) que les Français vivent dans la décadence, mais bien parce que les Français vivent dans la décadence que certains immigrés posent problème". Bel exemple d’ethnomasochisme et de mépris pour son peuple, le type même du discours aussi déconnecté que prétentieux. Pourquoi tenter de (maladroitement) culpabiliser ses compatriotes? Qu’y peuvent ces millions de Français sans fortune (qui n’ont pas le privilège de vivre à Neuilly-sur-Seine comme l’éditeur du recueil) forcés de cohabiter avec des allogènes de plus en plus nombreux, souvent hostiles? Se moquer des petites gens, les insulter n’a rien d’aristocratique mais relève du bourgeoisisme le plus puant. Comme si, en plus, l’immigration ne concernait que la France, la seule France ! Comme si la question était le " problème " posé par " certains " immigrés ! Accepte-t-il donc le principe même de l’immigration massive ? On reste confondu devant pareil aveuglement, exprimé avec tant de prétention. Si c’est cela la " droite essentielle ...
«La gauche réactionnaire» de Marc Crapez
Cette synthèse sur la droite souffre d’une autre lacune grave: les travaux novateurs de M. Crapez sur la naissance de la gauche réactionnaire et de la droite égalitaire (La gauche réactionnaire. Mythes de la plèbe et de la race, Berg 1997, préface de P.A.Taguieff et Naissance de la gauche, Michalon, 1999) ne sont pas utilisés. Or Crapez renouvelle l’analyse de la droite en affinant la vieille distinction, classique, due à R. Rémond, entre droites contre-révolutionnaire, bonapartiste et orléaniste. Son livre sur la gauche réactionnaire est du plus haut intérêt pour qui s’interroge sur les racines des nouvelles droites (voir " Vieilles gauches et nouvelles droites", pages 275-318). Crapez n’a pas été utilisé par les nouvelles droites comme il le mérite. Il distingue ainsi trois gauches (égalitaire, fraternitaire et libérale) et trois droites : la libérale (modérée ou libertarienne), conservatrice (libérale ou impériale), réactionnaire (traditionaliste ou populiste). Crapez souligne les contacts: le bonapartisme résulterait des noces d’une droite conservatrice impériale et d’une gauche égalitaire autoritaire. L’utilisation de ces concepts aurait permis une analyse autrement plus novatrice... et utile pour critiquer la gauche idéologique, que Crapez définit comme une extrême droite retournée (Le Figaro du 3 avril 1999): elle pratique un terrorisme intellectuel fort efficace, justifiant la fusion des peuples européens dans le grand métissage, préalable à leur neutralisation définitive en tant que porteurs de civilisation. La gauche idéologique est devenue le chien de garde de la Nouvelle Classe, bourgeoisie humaniste, universaliste et multiraciale. Au lieu de cela, Guyot-Jeannin inflige à ses lecteurs un ennuyeux prêt-à-penser.
Pour terminer, je citerai le livre de l’Allemand P. Krebs, Docteur ès Lettres, qui anime le Thule-Seminar. Lui aussi a fréquenté le GRECE : sa synthèse, Europe contre Occident (5), est un parfait manuel de résistance aux idéologies mortifères, dénuée quant à elle de toute concession à l’imposture, dans la veine de Faye et du jeune Alain de Benoist. Lisez Krebs avec les livres de Vial et de Faye : vous y retrouverez le même souffle, la même voix, celle des dissidents. La voix des Impériaux.
Patrick CANAVAN.
(1) P. Vial, Une terre, un peuple, Ed. Terre et Peuple, Paris 2000, 130FF. BP 1095, F-69612 Villeurbanne cedex,
www.geocities.com/Athens/Agora/3973/
(2) G. Faye, La colonisation de l’Europe. Discours vrai sur l’immigration et l’Islam, Aencre, Paris 2000, 145FF. 12 rue de la Sourdière, F-75001 Paris.
(3) A. de Benoist & C. Champetier, Manifeste pour une renaissance européenne, GRECE, Paris 2000, 50FF. 99-103 rue de Sèvres, F-75006 Paris, http://grece.hypermart.net Signalons aussi d’A; de Benoist, L’écume et les galets, Labyrinthe 2000, 280F. Recueil des chroniques anonymes publiées dans La Lettre de Magazine-Hebdo, revue de la droite radicale publiée par J.C. Valla et aujourd’hui disparue. A. de B. s’y révèle bon chroniqueur de l’actualité, et l’anonymat lui donne un punch souvent réjouissant.
(4) A. Guyot-Jeannin (éd.), Aux sources de la droite, Age d’Homme, Lausanne 2000, 130FF.
(5) P. Krebs, Europe contre Occident, Ed. Héritage européen, Overijse 1997 (voir à la Librairie nationale).
00:40 Publié dans Nouvelle Droite, Synergies européennes, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook





