Pour [lui], la globalisation et l’effacement de l’Etat ont favorisé l’émergence d’un pillage sans précédent au coeur du système financier, organisé dans l’opacité et en toute impunité. Interview.
L’éclatement des bulles, technologiques ou financières, révèle nombre de scandales et de malversations, telles les affaires Enron ou Madoff. La financiarisation de l’économie s’accompagnerait-elle d’une nouvelle criminalité ? Pis, nous dit le magistrat, auteur de « L’Arnaque » (Gallimard), cette criminalité est partie prenante du système économique, dont elle est devenue « la variable d’ajustement et de régulation ». De quoi s’inquiéter !
Qu’est-ce qui vous permet de dire qu’une nouvelle criminalité, différente des mafias, a pénétré les circuits économiques ?
J’hésite à parler de délinquance ou de criminalité, car cela obscurcit le débat. Je préfère parler de fraude, de pillage ou de prédation.
La globalisation économique et financière a fait évoluer les frontières de la criminalité : à l’ancienne, de forte intensité et de haute fréquence, s’est superposée une fraude de plus faible intensité et de basse fréquence qui est facilement ignorée dans les analyses officielles.
Les techniques frauduleuses sont devenues des variables d’ajustement de l’économie globalisée, et même des modes de gestion de celle-ci, et pas seulement des malversations marginales.
Il ne s’agit pas du gangstérisme en col blanc des mafias ou des escrocs, mais d’un pillage de l’économie à travers le système financier. Cette prédation est, de la part des acteurs, un acte rationnel, même si elle aboutit à l’irrationalité quand le système s’effondre, comme dans la crise des subprimes.
Ces techniques sont donc frauduleuses sans être toujours délictueuses ?
Oui, parce que les réglementations étatiques se sont restreintes au profit de l’autorégulation des marchés, censés faire leur propre loi. Les Etats ont accepté que cette dernière se substitue à la leur, et ils ont perdu le contrôle des régulations.
Les acteurs de ces marchés peuvent violer – en général impunément – ce qu’il reste de lois étatiques quand elles les gênent. Les Etats sont dépassés par leur puissance et par leur inventivité. Souvent, les acteurs de ces marchés n’ont même plus de comptes à rendre et peuvent faire ce qu’ils veulent allégrement, dans une opacité totale, y compris en violant les principes selon lesquels ils prétendent fonctionner.
En quoi le scandale des savings and loans, aux Etats-Unis, a-t-il « introduit la criminalité comme mode de gestion » ?
Au début des années 80, on assiste aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne à la mise en place des premiers mécanismes de financiarisation de l’économie.
A l’époque, les savings and loans, des caisses d’épargne mutualistes qui permettaient l’accession à la propriété des classes populaires et moyennes, deviennent financièrement incorrectes, puisqu’elles sont hors du marché concurrentiel.
La remontée des taux, pour contrer l’inflation, et les mesures ultralibérales prises par Ronald Reagan vont placer les caisses d’épargne en faillite virtuelle. Or, ce système mutualiste était un moteur de l’économie américaine, puisqu’il soutenait le secteur de la construction : s’il s’écroulait, l’économie était menacée.
Le pouvoir politique va donc laisser les savings and loans devenir la proie des affairistes, des mafias, des escrocs et des politiques corrompus. Tout ce beau monde fait tourner l’argent et crée une bulle immobilière qui cache l’ampleur de la faillite frauduleuse.
Spéculations, escroqueries, banqueroutes, blanchiment, se mêlent à un rythme effréné, sous l’oeil indifférent des pouvoirs publics. Des experts ont estimé que 60 à 80 % des faillites des caisses étaient dues à des dérives criminelles.
Ce scandale a introduit la criminalité comme mode de gestion des crises. Il a été une sorte de transition entre un gangstérisme traditionnel et une criminalité financière intégrant la fraude comme élément de régulation au coeur des mécanismes économiques et financiers. L’Etat s’interdit d’intervenir, puisque c’est contraire à sa doctrine néolibérale, encourageant implicitement les pratiques frauduleuses.
Est-ce à dire que vous pensez que toute l’économie est « criminalisée » ?
Pas du tout. Je ne dis pas que l’économie est devenue entièrement frauduleuse, mais simplement que si on ne voit pas la fraude on ne comprend rien à ce qui se passe. Si quelqu’un a besoin de frauder, il fraude. S’il peut faire autrement que frauder, évidemment il ne fraude pas. Conclusion : la fraude est un acte de gestion comme un autre, ni plus ni moins.
On a beaucoup parlé du rôle de la banque américaine Goldman Sachs…
Elle a en effet d’abord joué le rôle de chef de file des manipulations du marché ayant favorisé la bulle Internet, qui succède à la crise des savings and loans. Elle s’est distinguée par exemple, à la fin des années 90, par une technique d’introduction en Bourse frauduleuse dite de l’ »échelonnement », qui lui vaudra une amende de 40 millions de dollars en 2005.
Mais elle n’est pas la seule. L’éclatement de la bulle Internet et le scandale Enron révèlent le rôle de JP Morgan, qui avait créé des sociétés offshore afin de faciliter les opérations illicites du spécialiste de courtage d’énergie. Elle devra payer une amende de 135 millions de dollars.
Loin d’être un scandale isolé, Enron est symptomatique des nouvelles pratiques, qu’illustreront encore les affaires WorldCom, Adelphia, Qwest ou Vivendi. Donner des informations erronées ou trompeuses sur la réalité de l’entreprise, avec la complicité des auditeurs, des comptables, des commissaires aux comptes, des agences de notation, grâce à la passivité des autorités de contrôle, est devenu pratique courante.
Warren Buffett en viendra, dès 1998, à déplorer que « beaucoup de PDG considèrent ces manipulations non seulement comme convenables, mais comme un devoir ». L’aspect structurel de la fraude lui ôte, aux yeux de ceux qui la pratiquent, toute connotation morale susceptible de les retenir peu ou prou.
En quoi ont-ils tous besoin de ces pratiques ?
Ils n’ont pas forcément besoin de pratiques frauduleuses, mais au moins de ne plus avoir de limites. Mettre des limites fait partie des fonctions des Etats, qui, malgré leur affaiblissement, veulent sauver les apparences.
On le voit avec le « cinéma » qui est fait autour des bonus des traders ou des paradis fiscaux. En réalité, la fiscalisation des bonus est facile à contourner, et la finance, contrairement aux fraudeurs fiscaux ou aux mafias, n’a pas besoin de paradis fiscaux ou judiciaires pour se dissimuler. Ce qui l’intéresse avant tout, c’est la protection réglementaire des places financières internationales où les régulations et les contrôles sont allégés, voire inexistants, sans qu’elle ait à se cacher.
Les Etats peuvent obliger les banques à augmenter leurs fonds propres, mais il suffit à celles-ci de domicilier leurs hedge funds dans les paradis réglementaires, où elles peuvent, en toute transparence, oublier ces contraintes. Ainsi, les Suisses, qui savent qu’à terme ils seront obligés de coopérer pour ce qui concerne la fraude fiscale et le blanchiment d’argent sale, continueront de proposer à la grande finance leur savoir-faire en matière de laxisme réglementaire.
Vous qualifiez le système financier mondial de « finance Ponzi », le modèle d’escroquerie sur lequel s’est organisé le fonds Madoff. N’est-ce pas un peu exagéré ?
Je ne suis pas le seul à parler de la finance Ponzi, qui est devenue le modèle du système financier. Les subprimes sont un schéma de Ponzi à grande échelle : les banques ont fait entrer les emprunteurs dans le cycle de la spéculation immobilière en leur promettant qu’ils en profiteraient.
On leur a dit : « Achetez une maison à 100, elle vaudra 120 dans deux ans. Si vous n’avez pas assez d’argent pour rembourser, on vous fera un nouveau prêt en réévaluant votre hypothèque. » Cela marchait tant que la bulle grossissait. Qui s’est enrichi ? Pas les emprunteurs, expulsés de chez eux. Mais les agents immobiliers et les financiers, qui faisaient croître la bulle financière en titrisant leurs créances.
Les profits des banquiers alimentent la bulle financière, qui, en retour, vient gonfler la bulle immobilière. Cette finance ne repose que sur elle-même, sur le crédit qu’elle octroie. Il n’y a aucune création de valeur. Le coup de génie, c’est que l’emprunteur entre dans une mécanique où il est à lui-même son propre escroc.
L’explosion des revenus des hauts dirigeants des entreprises et des banques a-t-elle quelque chose à voir avec cet envahissement de la fraude ? Peut-on parler de corruption ?
Les bonus sont parfaitement légaux, même s’ils participent au fonctionnement de la finance Ponzi, qui nous a fait basculer dans un univers de l’au-delà de la loi. La loi, c’est bon pour les citoyens ordinaires, rarement pour les acteurs de la finance.
Dans ces transgressions, le droit n’a plus guère de prise. Quand on a besoin de frauder, on fraude, et l’on n’a même pas mauvaise conscience, puisque le gain est devenu la seule mesure de l’utilité sociale. Que disent les banquiers ? « Nous avons gagné cet argent, nous pouvons donc en faire ce que nous voulons ! » Plus personne n’a de responsabilité. Si on fraude et qu’on se fait prendre, on paie une petite amende, et c’est reparti.
Jusqu’où peut se développer cette croissance par la fraude ?
L’affaire Enron et la crise des subprimes montrent que la finance Ponzi dispose de trois ressorts qui peuvent se combiner différemment : d’abord, des actifs insuffisamment valorisés, ou qui ne peuvent être rentabilisés par la seule application des lois du marché ; ensuite, des techniques de manipulation, de dissimulation comptable et de transgression des lois qui s’apparentent à de la fraude ; enfin, l’inventivité et la prolifération financières.
Ces trois ressorts de la finance Ponzi sont de nouveau à l’oeuvre dans la pseudo-reprise actuelle. L’immobilier n’offre plus d’actifs valorisables par des bulles. La finance s’est donc tournée vers les marchés d’actions et leurs dérivés, les matières premières, l’or, la dette des Etats, etc.
Comme la titrisation – cette invention géniale de la finance Ponzi – est en panne, ce sont les Etats qui alimentent directement, à fonds perdus, la nouvelle spéculation, de plus en plus opaque. Le secteur financier s’est concentré autour d’une poignée de mégabanques qui font la pluie et le beau temps face à des Etats démunis.
Croyez-vous vraiment que les Bourses mondiales sont euphoriques parce que l’économie se redresse ? Cherchez plutôt du côté des dark pools et des crossing networks, des flash orders ou du trading haute fréquence, qui sont entre les mains d’un tout petit nombre d’opérateurs, et vous découvrirez pourquoi Martin Bouygues ne comprend plus rien au cours de ses actions. C’est qu’il n’y a rien à comprendre : les cours sont manipulés dans l’obscurité la plus complète.
La finance mondiale me fait penser au ver-coquin, ce parasite qui se nourrit du cerveau des bovidés et meurt avec son hôte. Le système financier sera emporté avec l’ensemble de l’économie. A moins qu’il ne trouve une autre manière de s’alimenter, par exemple un conflit mondial, comme cela s’est produit après la crise de 1929. En vrai, a-t-on jamais vu mourir la finance ?




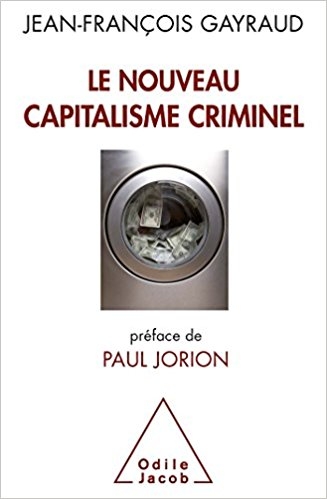

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg

 Jean de Maillard, 58 ans, vice-président au tribunal de grande instance d’Orléans, s’intéresse aux mutations économiques, financières et sociales nées de la mondialisation. Dans « Le Rapport censuré » (Flammarion), publié en 2004, il a repris un travail « trappé » sur les menaces engendrées par les circuits de l’argent sale, réalisé pour le ministère des Affaires étrangères.
Jean de Maillard, 58 ans, vice-président au tribunal de grande instance d’Orléans, s’intéresse aux mutations économiques, financières et sociales nées de la mondialisation. Dans « Le Rapport censuré » (Flammarion), publié en 2004, il a repris un travail « trappé » sur les menaces engendrées par les circuits de l’argent sale, réalisé pour le ministère des Affaires étrangères.