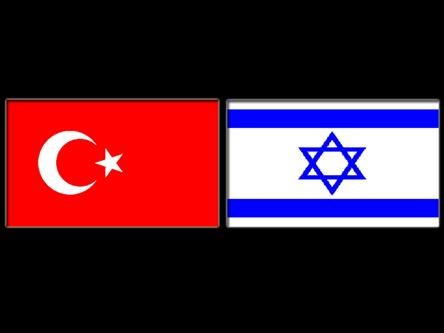mercredi, 30 décembre 2009
Turquia-Israel: una "alianza estrategica"
Turquía-Israel: una “alianza estratégica”
Turquía fue el primer país musulmán que reconoció al Estado de Israel y el primero también en establecer relaciones diplomáticas con él. Sin embargo, más acusadamente tras el bombardeo de Gaza, dichas relaciones se encuentran deterioradas por una escalada de gestos ofensivos que las han tensado. ¿Significa esto el fin de una de las relaciones diplomáticas más estables, con altibajos, de Oriente Próximo?
La “alianza periférica”
El régimen republicano turco reconoció al Estado de Israel en 1949 y estableció relaciones diplomáticas con él en 1952. De ese modo, Turquía escenificaba su opción prioritaria por Occidente, al tiempo que daba la espalda a la antigua porción árabe del Imperio otomano, corroborando la ruptura con el pasado imperial que había comenzado con el triunfo de Atatürk. Por otra parte, las relaciones entre el sionismo y el Imperio en la época en que Palestina formaba parte de éste nunca habían sido malas, y de algún modo los otomanos habían mantenido como mínimo una neutralidad benévola durante las dos primeras aliyot [olas de inmigración judía a Israel].
Para Israel, estas relaciones tenían un interés fundamental, pues suponían una ruptura del cerco árabe. Ben Gurion, el fundador del Estado, ya había desarrollado la teoría de la “periferia estratégica”, que suponía anudar relaciones con entidades no árabes de Oriente Próximo (Turquía, Irán, maronitas libaneses, kurdos de Irak…) Uno de sus frutos fue un pacto secreto (“pacto periférico”) de 1958 entre ambos Estados. Sus términos no se conocen exactamente (incluso los signatarios niegan su existencia), pero se supone que su núcleo era el intercambio de información de seguridad y militar, así como el compromiso por parte turca de actuar de portavoz de Israel ante Estados Unidos y la OTAN.
Este pacto tuvo escasa duración, pues en torno a 1960 Ankara inició un acercamiento a la Unión Soviética y los países árabes de Oriente Próximo, hacia los que Turquía mantuvo una posición de apoyo, no muy enérgico, en su conflicto con Israel, tanto con ocasión de la nacionalización del canal de Suez y la guerra de los Seis Días como recibiendo a Yasir Arafat y autorizando la apertura de una oficina de la OLP en Ankara (1979). De hecho, desde la proclamación de la capitalidad de Jerusalén, Turquía disminuyó la actividad de su representación diplomática con Israel (1980-1985).
Con todo, no cesó la cooperación militar, sobre todo desde el golpe de Estado de 1980. Es preciso tener en cuenta que los militares turcos, que se consideran depositarios del legado de Atatürk, son los principales valedores de las relaciones con Israel, sea por razones ideológicas –Israel está firmemente anclado en Occidente– como prácticas: el israelí es el primer Ejército de la región en los planos armamentístico, de cualificación profesional y de servicios de inteligencia.
La “alianza estratégica”
Esta relación se profundizó y adquirió nuevas dimensiones a partir del colapso de la Unión Soviética (1990). Para Turquía supuso un cambio de paradigma, pues si por una parte su posición estratégica como defensora del flanco sur de la OTAN había perdido buena parte de su valor, la disolución de la URSS abría nuevos terrenos a su actuación política y económica en dirección a las repúblicas ex soviéticas de los Balcanes y, sobre todo, las turcófonas de Asia Central. Ello significaba asimismo mejorar su capacidad militar para cubrir sus propios flancos: con Grecia, con la que mantenía un antiguo contencioso aún latente a pesar de los acuerdos de buena vecindad; con Chipre, con la presencia militar en la República Turca del Norte; y con Siria, que mantenía una política de apoyo al PKK kurdo.
Parcialmente liberada de las servidumbres de la guerra fría, Turquía estaba en condiciones de ejercer de potencia regional. Israel, por su parte, tenía mucho que ganar en su alianza con Turquía: la profundidad estratégica que le daba contar con el espacio aéreo turco para entrenamiento de su aviación y como corredor hacia Siria, Irán e Irak, un excelente mercado, especialmente para su industria militar, y un proveedor de materias primas.
El instrumento de esta nueva situación fue la elevación al rango de embajadas de las representaciones diplomáticas en 1991. De ese modo, a partir de 1992 se prodigaron las visitas bilaterales de alto nivel: las de los presidentes israelíes Herzog (1992) y Weizmann (1994, 1996) y las del turco Demirel (1996, 1999), así como las de los primeros ministros Tansu Çiller (1994) y Barak (1999).
Estas visitas hablan de unas relaciones de particular densidad, que quedaron plasmadas en una catarata de acuerdos, iniciados en 1992 con un protocolo de cooperación de defensa, precedente del Acuerdo Secreto de Seguridad de 1994, y de los más amplios y decisivos Acuerdos de Cooperación y Capacitación Militares de febrero de 1996 y Acuerdo de Cooperación de Industria Militar de agosto, así como un acuerdo de libre comercio a finales del mismo año, ratificado en los primeros meses de 1997. El seguimiento de estos instrumentos se realiza a través de encuentros bimestrales.
Estos acuerdos, que contaron con el beneplácito de Estados Unidos y con la crítica de los países árabes de la región e Irán, dieron lugar a una relación de interdependencia asimétrica que colocaba a Israel en mejores condiciones, como proveedor de tecnología militar para la modernización de las fuerzas armadas turcas (1) y de seguridad avanzada para la lucha contra el PKK (es sabido que agentes del Mossad actúan en el Kurdistán), con capacidad de entrenar en el uso de ambas y con la fuerza que le da su íntima alianza con Estados Unidos, que a través de Israel ha hecho llegar armamento moderno a Turquía, superando de ese modo las limitaciones parlamentarias debidas a la mala situación de los derechos humanos en el país euroasiático.
En este sentido, son ilustrativas las declaraciones de un portavoz del Departamento de Estado de EE UU en mayo de 1997, de que era un “objetivo estratégico” de Estados Unidos que Turquía e Israel ampliaran sus relaciones políticas y su cooperación militar.
Aun siendo las más relevantes, la cooperación militar no es la única: a ella debe unirse la política, que implica un apoyo mutuo. En ese sentido, Israel y el lobby judío de Estados Unidos, por ejemplo, impidieron en todos los foros posibles una condena de Turquía por el genocidio armenio, y Turquía ha actuado de interlocutor para Israel en distintas instancias internacionales, comenzando por la OTAN y haciendo un hueco al Estado sionista en la política regional a través de la Iniciativa de Cooperación de Estambul, promovida por la OTAN para mejorar el diálogo mediterráneo, especialmente en materia de seguridad.
En el aspecto económico ha habido logros significativos: las transacciones comerciales entre ambos países han pasado de 2.000 millones de dólares en 2000 a 3.300 en 2008, el volumen más elevado de la región. Por otra parte, el capital israelí ha encontrado en Turquía una nueva tierra de promisión y, asociado al capital local, se ha embarcado en un ambicioso programa de conquista de los mercados centroasiáticos, con especial hincapié en el campo de la energía. Turquía es asimismo el destino predilecto del turismo israelí, con 700.000 visitas anuales.
Dos aspectos de esta colaboración destacan nítidamente: la busca por Israel de nuevas fuentes de energía exteriores. El petróleo y el gas encontrarían un vehículo idóneo en los dos oleoductos, procedentes del Caspio y de Asia Central, que se dirigen al puerto turco de Cehyan y que podrían tener un ramal que llegara hasta Ashkelon (sur de Israel). La otra es el agua, bien escaso y controvertido en Israel (buena parte de los acuíferos se encuentran en los territorios ocupados). En 2004 se firmó un acuerdo por el que Turquía aportaría 50 millones de metros cúbicos de agua anuales durante veinte años.
Síntomas de desapego
A partir de fines de 2000, coincidiendo con la segunda Intifada, esta luna de miel en cierto modo contra natura empezó a mostrar síntomas de agotamiento: incluso los mismos militares comenzaron a mostrar su preocupación por el hecho de que el alto nivel de intercambio pudiera debilitar a Turquía en una situación de cambio de alianzas, por ejemplo, un acuerdo entre Israel y Siria. Este cambio, que ya detectó Arabic News, órgano de la Liga Árabe, en marzo de 2001, se plasma en la suspensión del acuerdo de modernización de los carros de combate turcos por parte de Israel, en visitas y maniobras conjuntas, así como en el aumento del tono de la prensa turca respecto a la violación por parte de Israel de los derechos humanos en Gaza y Cisjordania. Para los militares turcos, no se trataba tanto de una ruptura como de una “congelación” de las relaciones estratégicas entre ambos países. Lo cierto es que, según los politólogos Kessler y Kochlender, «el sector industrial militar israelí reconoce que las exportaciones a Turquía disminuyen… reemplazadas por otras de Estados Unidos y de Europa, especialmente italianas».
Las contradicciones se agudizaron a partir de la subida al poder del AKP postislamista. El AKP mantenía desde hacía tiempo buenas relaciones con Hamas, organización a la que defendió en instancias internacionales con el argumento nada complicado –para alguien que no sea un político occidental– de que Hamas era indispensable para avanzar en la paz en Oriente Próximo. Con todo, la política de Tayyip Erdogan no está pensada tanto “contra” Israel como a favor de estrechar los lazos con los árabes, lo que, no cabe duda, conlleva un alejamiento, siquiera retórico, de un Israel excesivamente prepotente. Este juego se manifestó en 2004: mientras se firmaba el acuerdo sobre el agua citado anteriormente, el Gobierno turco protestaba airadamente por el asesinato “selectivo” del dirigente de Hamas Ahmed Yasin en Gaza.
Con todo, no debe dejar de señalarse que durante estos años se produjo un acercamiento entre Turquía y diversos países árabes, como Siria, una vez resuelta la discrepancia sobre el PKK y encarrilado el asunto de los recursos hídricos; Egipto, con el que se ha firmado un acuerdo de libre cambio, y Arabia Saudí. Actualmente los hombres de negocios turcos están presentes en todas las áreas de las economías de la región, incluida Palestina: en 2005 se constituyó el llamado Foro de Ankara, que reúne a hombres de negocios turcos, israelíes y palestinos con el propósito de canalizar inversiones hacia zonas industriales instaladas en Gaza y Cisjordania.
Esta proyección regional permitió a Turquía proponerse como mediadora entre Israel y Siria, una iniciativa que el Estado sionista aceptó de mala gana a pesar de su plausibilidad.
El invierno de Gaza: ¿un punto de inflexión?
El 17 de noviembre de 2008 se celebró la séptima reunión del Foro de Ankara en la capital turca. La ocasión estuvo revestida de particular solemnidad, pues el presidente israelí, Shimon Peretz, se dirigió al Parlamento turco; era el primer mandatario de ese país que lo hacía. En diciembre, el primer ministro israelí, Ehud Olmert, era recibido calurosamemnte en Ankara.
Pocos días más tarde de esta última visita, Israel lanzó sobre Gaza la operación Plomo Fundido, una invasión de la franja precedida de una meticulosa destrucción, no ya de la estructura militar, sino de todo el país. La brutalidad y el desprecio a las leyes de la guerra e incluso a la más elemental humanidad levantó un clamor universal de repulsa. Estas manifestaciones fueron particularmente masivas en Turquía, donde a la presencia en las calles se unieron tomas públicas de posición, ciberataques e incluso suspensiones de partidos de baloncesto.
La diplomacia turca se mostró muy activa en la búsqueda del fin de la agresión: se destacó a un alto funcionario en Israel mientras se multiplicaban los contactos con Egipto, Damasco e incluso la Conferencia Islámica, así como las presiones en las Naciones Unidas. Como primera medida, Ankara canceló su mediación con Damasco.
El 29 de enero de 2009 se reunía el Foro de Davos. Durante él se produjo un violento choque dialéctico entre Shimon Peretz y Tayyip Erdogan, que abandonó la reunión.
En la reacción de Erdogan se reflejan distintas circunstancias: el sincero horror ante lo que él mismo había calificado de «crimen contra la humanidad» y «salvajada», más cuando afectaba a una organización de algún modo «hermana»; el rechazo a una actitud discriminatoria hacia él por parte del moderador del encuentro, David Ignatius; la sensibilidad hacia la opinión pública de su país, y sobre todo la sensación de que los israelíes –hacía poco que se había celebrado la séptima sesión del Foro de Ankara y que Olmert había sido recibido con solemnidad en la capital turca– habían actuado sin prevenirlos de sus proyectos, menospreciando a los turcos y dando al traste con sus esfuerzos mediadores.
A partir de entonces se han producido una escalada de declaraciones y gestos que no han hecho sino enrarecer el ambiente, cuyo mejor exponente ha sido la suspensión por parte de Turquía de las maniobras Águila Anatolia, por la presencia, junto a Italia y Estados Unidos, de la aviación israelí, que debían celebrarse en septiembre de 2008.
Por parte israelí se multiplicaron las declaraciones hostiles: cancelación de viajes turísticos a Turquía con ocasión de las vacaciones del Pésaj (segunda pascua), protestas oficiales por la proyección en Turquía de un filme en el que se veía a soldados israelíes matando a un niño palestino («se pretende dar la impresión de que los soldados israelíes asesinan a niños», afirmó hipócritamente el portavoz israelí). La situación llegó al extremo de que el Ministerio de Exteriores turco se vio obligado a pedir a los funcionarios israelíes que «actuaran con sentido común en sus declaraciones y actitudes».
Lampedusa en el Levante
Esta escalada, aún fundamentalmente verbal, ¿significa el preludio de un cambio en las relaciones entre Ankara y Tel Aviv? Sí y no: sí en cuanto que ha roto la unidad de acción entre ambas capitales de forma definitiva («Turquía [no] se privará de hablar duramente de los errores cuando se cometan», en palabras de Abdullah Gül, presidente de Turquía), hasta el punto de que el ministro turco de Exteriores, Ahmet Davutoglu, afirmó que las relaciones entre ambos países dependían del «cese de la tragedia humanitaria» en Gaza. Las recientes visitas de Erdogan a Irak, y sobre todo a Irán –donde llegó a acusar a Israel de querer «devastar» el país y afirmó que Ahmadineyah era un «pacifista»–, así como la normalización de las relaciones con Armenia, parecen sugerir una mayor autonomía en las opciones diplomáticas.
Por parte israelí, la nueva actitud de Turquía, más que producir una autocrítica por los errores propios, ha servido para definir una nueva actitud de Ankara. Así, el Jerusalem Post afirmaba el 14 de agosto: «Como Rusia con Putin, Turquía… ha escondido su rápida transformación desde una democracia imperfecta pero prooccidental bajo los anteriores Gobiernos hacia un régimen antioccidental y, en el caso de Turquía, islamista».
Esta idea de un cambio en la política exterior turca aparece también en un reciente artículo del prestigioso ex director de Le Monde Jean-Marie Colombani, en el que habla de «deriva» para definirla. El diplomático Shlomo Ben-Ami sugiere en un artículo en El País (septiembre de 2008) que los «serios dilemas de identidad» de Turquía suponen para Israel que «su futuro en Oriente Medio no reside en alianzas estratégicas con las potencias no árabes de la región, sino en la reconciliación con el mundo árabe».
Sin embargo, a pesar de ello y de la torpeza diplomática israelí (2), no han faltado por ambas partes las declaraciones apaciguadoras, que, en última instancia, reflejan los límites del enfrentamiento: Israel sabe que no puede ir más lejos («Turquía es muy importante para el entrenamiento de nuestra aviación en espacios abiertos», según el ex comandante de la fuera aérea israelí Ben Eliyahu); en ese sentido, Ehud Barak, ministro de Defensa del anterior Gobierno de Tel Aviv, afirmó: «A pesar de los altibajos, Turquía sigue siendo un elemento central en nuestra región. No podemos dejarnos llevar por declaraciones encendidas». Y el influyente ministro de Industria, Ben Eliécer, aseguró: «Tenemos un conjunto de intereses estratégicos comunes de gran importancia. Debemos actuar con gran sensibilidad para que no se materialicen los pronósticos más sombríos».
Ankara, en cambio, ha optado por un tono más firme, lo que pone de manifiesto un mayor equilibrio en la relación de fuerzas entre ambos: «Turquía es el único país amigo de Israel en la región… Por ello se debe dar mucha importancia a que el Estado judío busque el apoyo de Ankara para sus políticas regionales» (el politólogo Erçan Citioglu en declaraciones a al-Yazira). Según el ministro de Exteriores, Davotuglu, «tenemos la esperanza de que mejore la situación en Gaza y que eso cree un nuevo ambiente para las relaciones turco-israelíes» (Hurriyet, 13 de octubre de 2008).
Conclusión: entre el republicanismo y el neootomanismo
Muchos observadores de la política exterior turca han hablado de una supuesta tensión en las relaciones exteriores turcas entre el republicanismo –anclaje firme en Occidente, desdén por la política regional– y el neootomanismo, o tendencia a convertirse en protagonista de la política próximo oriental, como había sucedido en el pasado. Los garantes de la primera opción serían los militares y el aparato del Estado; los de la segunda, los islamistas –tanto en la etapa de Erbakan, bruscamente interrumpida por los militares, como en la del AKP– y los proislamistas de Gobiernos anteriores.
Desde mi punto de vista, se trata de un falso debate: ni los militares han dejado de apoyar una menor interdependencia con Israel, por ejemplo, ni los islamistas han abandonado el eje fundamental de su política exterior: el ingreso en la Unión Europea y la OTAN; de algún modo, la nueva política exterior en relación con Oriente Próximo es una forma de hacer valer su nuevo papel estratégico ante sus aliados occidentales; los islamistas, por otra parte, son lo suficientemente conscientes de la profundidad de las relaciones turco-israelíes como para causarles un daño irreparable. Además, una excesiva dureza con Israel pondría en cuestión su papel mediador, por mucho que le mereciera simpatías entre la opinión árabe.
El nuevo Gobierno israelí ¿puede ahondar las actuales diferencias? No es fácil saberlo, teniendo en cuenta la escasa sutileza de su diplomacia. Sin embargo, es de suponer que terminará imponiéndose la cordura: en estos momentos, Israel es importante para Turquía. Pero sin duda Turquía lo es mucho más para Israel.
Alfonso Bolado
Notas:
(1) Turquía gastará 150.000 millones de dólares hasta 2020 en la modernización de su Ejército. Una parte importante de este dinero está destinada a Israel: modernización de los aviones F-4, F-5 y F-16, así como de los carros M-60; producción conjunta de misiles de medio alcance (Arrow y Delilah) y compra de otros (Popeye I), adquisición de 150 helicópteros estadounidenses (que se llevaría a cabo por intermediación israelí).
(2) La rudeza de la diplomacia israelí, consecuencia en parte de su carácter militante, en parte del complejo de superioridad moral característico del sionismo, es proverbial. El episodio turco no es único: los desplantes a políticos extranjeros que no son de su agrado –como sucedió con el enviado de la Unión Europea, Miguel Ángel Moratinos–; la sistemática denuncia de cualquier actitud, real o supuesta, de antisemitismo; la altanería con la que se dirige a las autoridades de los países huéspedes en estos casos (el Gobierno español y el catalán la han padecido con ocasión de los bombardeos de Gaza); la agresividad de las comunicaciones con la prensa internacional… la hacen antipática. Sorprende por ello la debilidad de las respuestas, que no hace sino retroalimentar esos comportamientos.
Extraído de CSCA.
00:25 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, turquie, israël, méditerranée, proche orient, moyent orient, diplomatie, politique internationale, politique, alliance stratégique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 décembre 2009
Droht ein Krieg zwischen Iran und dem US-Irak?
Droht ein Krieg zwischen Iran und dem US-Irak?
Eine Auseinandersetzung um eine kleine Ölquelle im Grenzgebiet zwischen dem Irak und dem Iran kann der Anlass für einen größeren Konflikt werden, bei dem die USA sich »legitim« ihres Erzfeindes Iran entledigen könnten.
Von den westlichen Mainstream-Medien weitgehend ignoriert, braut sich in Persien ein Gewitter zusammen, das sich zu einem handfesten Konflikt zwischen dem Iran und dem US-Irak ausweiten könnte.
Bereits von 1980 bis 1988 führten der Iran und der Irak einen brutalen Krieg, der Hunderttausende das Leben kostete. Zwar verkündete der damalige irakische Präsident den Sieg, aber in Wirklichkeit handelte es sich um eine Patt-Situation.
Seit dem 18. Dezember halten nun iranische Soldaten ein umstrittenes Ölfeld auf irakischem Staatsgebiet besetzt. Das Öl-Feld Fakka liegt etwa 300 Kilometer südöstlich von Bagdad.
Einem Mitarbeiter des Betreibers Maysan Oil Company zufolge werden in Fakka gegenwärtig rund 10.000 Barrel Öl pro Tag gefördert.
Vize-Innenminister Ahmed Ali al-Chafadschi sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, elf Soldaten hätten die Grenze überquert, die iranische Flagge gehisst und hielten einen Ölturm besetzt. Auch in der Vergangenheit hätte Iran versucht, irakische Techniker durch Schüsse an der Arbeit an dem Bohrturm zu hindern. Der Irak habe bislang nicht militärisch reagiert und strebe eine diplomatische Lösung an, sagte al-Chafadschi weiter. »Der Bohrturm liegt auf irakischem Gebiet, 300 Meter von der Grenze entfernt.«
Dem widersprach Teheran und erklärte, die Ölquelle befinde sich auf iranischem Gebiet.
Jetzt mischte sich erstmals auch ein hochrangiger US-Militär ein: US-Generalstabschef Michael Mullen sagte, nach seinem Verständnis stehe das Gebiet unter irakischer Souveränität.
Interessant bei dieser Aussage dürfte sein, dass er nicht behauptet, dass die Ölquelle auf irakischem Gebiet liegt, sondern unter irakischer Souveränität steht.
Für die USA wäre dieser Vorfall wohl eine Möglichkeit, den internationalen Druck auf den Erzfeind Iran weiter zu verstärken. Er könnte sogar Anlass dafür sein, einen Konflikt zu schüren, bei dem die Amerikaner den Irakern »schützend« beistehen und so ein für alle Mal das Problem »Iran« aus der Welt schaffen. Die jüdisch-israelisch-amerikanische Lobby wartet schon lange darauf.
Die Nachricht über die Besetzung der Ölquelle stärkte an den internationalen Finanzmärkten den Dollar, der einen Teil seiner Verluste zum Euro wieder wettmachte. Auch der Ölpreis legte nach den ersten Berichten leicht zu, gab später jedoch wieder nach.
Dienstag, 22.12.2009
© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.
00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : moyent orient, irak, iran, pétrole, hydrocarbures |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 30 mai 2009
L'histoire vraie de Lawrence d'Arabie
L'histoire vraie de Lawrence d'Arabie
23/04/2009 | http://www.lefigaro.fr/
T. E. Lawrence - On a retrouvé la version intégrale des «Sept Piliers de la sagesse», la fameuse saga autobiographique de l'agent britannique.
Quand éclate la Grande Guerre, Hussein, le chérif de La Mecque, et ses fils en profitent pour se révolter contre l'occupation turque, vieille de cinq cents ans ! Les Turcs étant alliés aux Allemands, les Arabes sont solidaires des forces françaises et britanniques. Lawrence est un familier du Moyen-Orient où il a mené des missions archéologiques. Il parle l'arabe et se fait recruter comme officier de renseignement. Il est bientôt chargé de rencontrer le chérif Fayçal, fils d'Hussein, retranché au cœur des montagnes dans l'arrière-pays de Médine.
Ainsi commence la gigantesque saga, avec le portrait majestueux de Fayçal, le prophète, l'icône de la rébellion. C'est lui qui va réunir les tribus, les réconcilier, les rallier contre les Turcs. C'est le frère loyal de Lawrence. Tel est le couple rayonnant de cette longue pérégrination guerrière à travers ce que Lawrence appelle le Hedjaz, c'est-à-dire l'Arabie des villes saintes, et plus largement un pays qui s'étend de La Mecque à Damas.
La légende de Lawrence est telle que le lecteur, gavé de gloses et de clichés, s'attend à un mélange inextricable de combats et de méditations dostoïevskiennes. Tant le personnage est réputé complexe, déchiré, masochiste. Mais les pages où il confie ses dilemmes et ses vertiges sont finalement limitées par rapport à l'insatiable tableau des courses, des escarmouches, des bivouacs virils, des sabotages à la dynamite de voies ferrées et de ponts.
La cavalcade épique occupe la presque totalité du livre, à part un préambule caustique et une parenthèse au bout de huit cents pages où Lawrence prend du recul et révèle soudain un tout autre portrait de lui-même, sous le masque du guerrier et du militant de la cause arabe. Il se qualifie « d'escroc à succès » et « d'imposteur impie ». C'est un précipice qui s'ouvre au cœur du héros et de son épopée pour les scinder en deux parts irréconciliables. Un divorce entre l'action et la pensée.
On tue, on fouette, on torture à tout-va !
Le mythe de Lawrence va prospérer au tranchant de cette faille. Lawrence opère cette volte-face vertigineuse qui retourne le colonel efficace et fervent en traître attifé en Bédouin, en sceptique très occidental, persuadé de son échec, de son égotisme, Zarathoustra raté, miné par la culpabilité et l'autoflagellation. Car, dès le départ, Lawrence a deviné que les Britanniques veulent canaliser et contrôler le désir d'indépendance des Arabes, il ne croit donc au succès de sa mission que dans la brûlure de l'action.
Pourtant, c'est un combattant clairvoyant, entouré de cheikhs tribaux truculents et divisés, plus amateurs de razzias que du fantasme de l'unité arabe. Certaines tribus partent pour la bataille avec leurs esclaves armés de dagues, en croupe des méharis. Lawrence admire leurs cuisses noires et musclées. D'autres se dénudent carrément dans l'assaut pour que leurs vêtements souillés n'infectent pas leurs blessures. Et Lawrence de savourer le spectacle des volées de jambes athlétiques et brunes. Son homosexualité n'est jamais avouée directement. Mais il chouchoute un couple de serviteurs juvéniles, amants l'un de l'autre, facétieux et transgressifs à souhait. Leurs foucades garçonnières agrémentent la ritournelle des tueries. Car on tue, on fouette, on torture à tout-va ! Lawrence, lui-même, exécute de trois balles un soldat fautif. Il en fait une description détaillée. Le fameux sadomasochisme du personnage n'est jamais revendiqué, il se déduit de la somme des souffrances infligées et endurées dans les déserts torrides parcourus par des méharistes coriaces et cruels.
L'originalité du livre tient à la multitude d'actes bruts commis dans des paysages décrits avec une exactitude de géologue et de géographe. Ce qui prime est la souplesse, la précision, la prégnance, la frontalité du récit. C'est le roman physique des granits dressés en embuscade, des grès, des laves, des dunes diamantines, des silex coupants, des puits antiques, des dromadaires omniprésents, de leurs selles somptueuses, des oueds, des gorges piranésiennes et des vallées parfumées. La chimère de Lawrence va échouer en 1920, puisque les Britanniques ne vont pas honorer leurs promesses faites aux Arabes.
Depuis Œdipe, pas de mythe sans Sphinx, sans duplicité, sans échec, sans dérapage pervers. Jamais un aventurier n'a été capable d'être à la fois aussi clair et concret dans l'action et aussi abstrait dans la méditation amère qui la récuse. Cette monstruosité, ces deux bords d'une blessure qui ne peut cicatriser, voilà la chair béante du mythe qu'un accident de moto viendra nimber de mort absurde.
Les Sept Piliers de la sagesse de Thomas Edward Lawrence traduit de l'anglais par Éric Chédaille Phébus, 1 072 p., 25 €.
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : arabie, arabie saoudite, première guerre mondiale, moyent orient, proche orient, islam, grande-bretagne, angleterre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 mai 2009
Encerclement de l'Iran (3/6)

L’encerclement de l’Iran à la lumière de l’histoire du “Grand Moyen-Orient” (3/6)
par Robert STEUCKERS
L’oeuvre stratégique de Trajan
 De la mort de César en –44 à +138, les Perses se maintiennent à l’ouest dans la région d’Edesse, empêchant les Romains d’exercer un contrôle réel et définitif sur le Proche-Orient et leur barrant l’accès à la Mésopotamie et au Golfe Persique. Avec l’empereur Trajan [photo], la grande stratégie envisagée par César, à la veille de son assassinat, se concrétise: avec dix légions, Trajan s’empare du pays des Daces, dont il fait la seule province romaine au nord du Danube en +105. Comme la maîtrise du cours inférieur du Danube implique la maîtrise totale de l’Anatolie et de la Mer Noire et, qu’à son tour, cette maîtrise permet de contrôler les bassins du Tigre et de l’Euphrate, Trajan, bien conscient de ces réalités géopolitiques, poursuit son grand dessein: il transforme le pays des Nabatéens en une province d’Arabie, se dotant de la sorte d’une base arrière, pour réduire le saillant perse d’Edesse, s’emparer des hautes terres arméniennes et, dans la foulée, de débouler avec ses légions en Mésopotamie. Finalement, les Romains arrivent à Charax, sur les rives du Golfe Persique. Plus jamais une Europe impériale et unie n’y reviendra! Son successeur Hadrien estime, sans nul doute à juste titre car la puissance parthe n’est pas négligeable et le front est désormais trop long, qu’il est trop risqué de poursuivre l’aventure et de mettre ses pas dans ceux d’Alexandre. Il retire les légions de Mésopotamie, rend à l’Arménie son statut de royaume client, non inclus dans l’orbe romaine. Il affronte une révolte juive, celle de Simon-Bar-Kochba (+132 à +135), qui sème le trouble sur ses arrières et rompt les liaisons entre la Méditerranée et la Mésopotamie. Cette révolte coûte à Rome les effectifs d’une légion entière. Neuf légions sur un total de vingt-huit sont stationnées de la Mer Noire à l’Egypte face aux Parthes. Dix sont stationnées entre l’Autriche et l’embouchure du Danube, région où elles font face aux peuples cavaliers (indo-européens) des Roxolans et des Iazyges (qui formeront bientôt le noyau de la cavalerie romaine, modifiant ipso facto le caractère majoritairement fantassin de l’armée). Hadrien n’avait pas eu tort: sa politique purement défensive apporte à l’empire romain une paix de près de deux siècles, qu’on peut considérer comme son âge d’or.
De la mort de César en –44 à +138, les Perses se maintiennent à l’ouest dans la région d’Edesse, empêchant les Romains d’exercer un contrôle réel et définitif sur le Proche-Orient et leur barrant l’accès à la Mésopotamie et au Golfe Persique. Avec l’empereur Trajan [photo], la grande stratégie envisagée par César, à la veille de son assassinat, se concrétise: avec dix légions, Trajan s’empare du pays des Daces, dont il fait la seule province romaine au nord du Danube en +105. Comme la maîtrise du cours inférieur du Danube implique la maîtrise totale de l’Anatolie et de la Mer Noire et, qu’à son tour, cette maîtrise permet de contrôler les bassins du Tigre et de l’Euphrate, Trajan, bien conscient de ces réalités géopolitiques, poursuit son grand dessein: il transforme le pays des Nabatéens en une province d’Arabie, se dotant de la sorte d’une base arrière, pour réduire le saillant perse d’Edesse, s’emparer des hautes terres arméniennes et, dans la foulée, de débouler avec ses légions en Mésopotamie. Finalement, les Romains arrivent à Charax, sur les rives du Golfe Persique. Plus jamais une Europe impériale et unie n’y reviendra! Son successeur Hadrien estime, sans nul doute à juste titre car la puissance parthe n’est pas négligeable et le front est désormais trop long, qu’il est trop risqué de poursuivre l’aventure et de mettre ses pas dans ceux d’Alexandre. Il retire les légions de Mésopotamie, rend à l’Arménie son statut de royaume client, non inclus dans l’orbe romaine. Il affronte une révolte juive, celle de Simon-Bar-Kochba (+132 à +135), qui sème le trouble sur ses arrières et rompt les liaisons entre la Méditerranée et la Mésopotamie. Cette révolte coûte à Rome les effectifs d’une légion entière. Neuf légions sur un total de vingt-huit sont stationnées de la Mer Noire à l’Egypte face aux Parthes. Dix sont stationnées entre l’Autriche et l’embouchure du Danube, région où elles font face aux peuples cavaliers (indo-européens) des Roxolans et des Iazyges (qui formeront bientôt le noyau de la cavalerie romaine, modifiant ipso facto le caractère majoritairement fantassin de l’armée). Hadrien n’avait pas eu tort: sa politique purement défensive apporte à l’empire romain une paix de près de deux siècles, qu’on peut considérer comme son âge d’or.
Les Parthes ne profitent pas du départ des Romains pour reprendre l’Arménie et le saillant d’Edesse: à l’Est se forme un autre empire indo-européen et cavalier, celui des Kouchans, qui s’étend sur le Pakistan actuel, mais aussi sur l’arrière-pays de réserve des empires perses précédents: la Bactrie et la Transoxiane. Privé de cet espace de réserve, l’empire parthe entre en déclin, ce qui amène à nouveau les Perses du Roi Ardashir au pouvoir. L’empire cesse donc d’être parthe, pour redevenir perse, comme du temps des Achéménides. Dans ce contexte de transition du pouvoir, la donne géopolitique est la suivante: Ardashir contrôle certes le noyau antique de l’Empire perse, soit l’Iran actuel, mais les Rois d’Arménie sont de sang parthe et s’allient aux Romains contre le nouveau pouvoir. Cette décision barre la route à Ardashir, qui ne peut reprendre pied sur les hautes terres d’Arménie. Il tourne alors ses forces vers l’est, contre l’Empire kouchan. C’est un succès: les Perses contrôlent tous les territoires du Golfe à l’Indus, y compris la Bactrie et la Transoxiane, espaces de réserve indispensables à assurer la puissance perse sur ses arrières. Mieux: Ardashir traverse le Golfe et place Bahrein sous suzeraineté perse. Deux options géostratégiques de l’ “iranité éternelle” venaient de se traduire dans le réel: le contrôle de l’arrière-pays steppique et la rive opposée du Golfe.
La poussée germanique vers le Danube
Au nord du Danube, les Goths, partis de Suède, ont conquis le bassin de la Vistule, traversé les marais du Pripet et se massent dans la vallée du Dniestr, en Moldavie et en Ukraine actuelles. Ils sont désormais sur la Mer Noire, à hauteur d’Odessa. Ils repoussent les Roxolans vers le Dniepr et le Don. D’autres Germains, les Vandales, partis de Silésie, poussent à travers la Bohème, arrivent dans le nord de la Hongrie actuelle et coincent les Iazyges cavaliers dans la vallée de la Tisza (Theiss). Les Germains de l’Est sont plus menaçants pour Rome que ne l’avaient jamais été les Roxolans et les Iazyges, avec lesquels ils avaient composé. Cette première poussée germanique, bien organisée, oblige les Romains à abandonner deux positions stratégiques importantes: les Champs Décumates entre le Rhin et le Danube, laissés aux Alamans, et la Dacie, si chèrement acquise sous Trajan, aux Gépides, Vandales Asding et Wisigoths. Mais sur le front perse, Rome se maintient, grâce aux légions de Galérien. L’Arménie est toujours cliente de Rome, le saillant d’Edesse sous le contrôle des légions, de même que la moitié nord de la Mésopotamie. Quant aux Perses, ils sont maîtres de tout l’Iran actuel, plus de l’Azerbaïdjan, des régions steppiques au Nord de l’Iran, zone de rassemblement depuis la proto-histoire des peuples cavaliers indo-européens —qui, toujours, fonderont ou redonneront vigueur à l’impérialité perse-parthe,— et de la moitié occidentale du Pakistan actuel, dont la quasi totalité du Béloutchistan.
Les deux empires semblent immuables, résister à leurs périphéries, moyennant des affrontements mineurs. Cependant, à la fin du règne de Julien, qui part contre les Perses avec ses légions gauloises et germaniques, les Huns, partis des flancs de l’Altaï en Sibérie centrale, ont avancé leurs hordes et leurs troupeaux vers la Mer d’Aral: à l’ouest, ils avancent vers la Volga qu’ils atteignent vers +350; à l’Est, ils conquièrent la Bactrie et la Transoxiane, mettant définitivement fin à l’indo-européanité centre-asiatique; depuis lors en effet, cette Asie centrale, indo-européenne depuis la culture proto-historique de Jamnaïa, est devenue turco-mongole, hunnique; elle ne sera jamais plus un espace de réserve pour les empires sédentaires du “rimland”, tous issus de peuples guides indo-européens. Toutes les potentialités démographiques indo-européennes d’Asie centrale altaïque sont, à un moment ou à un autre de la proto-histoire ou de l’histoire antique, rentrés dans l’espace iranien pour y consolider un ordre impérial; désormais, ces potentialités n’existent plus.
La fin lamentable de l’Empire romain d’Occident
Sur l’embouchure de la Volga dans la Caspienne, les Huns font face à un peuple cavalier indo-européen, les Alains, et, à hauteur de la boucle du Don, à proximité de la Volga, ils sont les voisins des Ostrogoths germaniques, dirigés par leur roi Ermanarich, qui s’est rendu maître de la Crimée (les descendants des Ostrogoths s’y maintiendront jusqu’au 17ième siècle!). Les Ostrogoths sont les premiers, avant les Romains et les Perses, à percevoir le danger hunnique: en +372, ils avancent leur cavalerie en direction de la Volga pour affronter la présence étrangère hunnique, mais ils sont écrasés par la tactique avérée des Huns: volées de flèches, décrochages rapides, retour des archers montés, nouvelle volée de flèches, nouveau décrochage, jusqu’à l’épuisement de l’adversaire. Boucliers de l’Europe lors de ce premier assaut hunnique, les Goths, bousculés et vaincus, en seront aussi les premiers martyrs. Leur défaite scelle le sort de l’Europe: les Huns, que plus aucune force militaire digne de ce nom ne peut arrêter, poussent jusqu’à la puszta hongroise, idéale pour l’élevage de leurs chevaux. Ils colonisent cette plaine en soumettant les Gépides. Les peuples germaniques sont repoussés, chassés des rives de la Mer Noire et des terres noires d’Ukraine: ils entrent dans l’Empire romain et finissent par en prendre le contrôle, d’autant plus que le meilleur général romain de l’époque, Stilicon, est un Vandale qui sait composer avec ses compatriotes. En 408, l’empereur Honorius, méfiant, le fait assassiner: mauvais calcul, absence de clairvoyance, mesquinerie de dégénéré, car plus aucun militaire de valeur n’est à même de défendre l’Italie. Alaric, chef des Wisigoths, va venger Stilicon et piller Rome. Honorius se replie à Ravenne et assiste, indifférent, au spectacle. Athaulf, successeur d’Alaric, souhaite une paix définitive avec Rome, mais l’empereur, décadent, irresponsable, incapable de défendre les citoyens de Rome, refuse tout compromis. S’il avait accepté les propositions honnêtes d’Athaulf, l’Empire d’Occident aurait été aussitôt restauré, sous l’impulsion des Wisigoths, pour faire face au second assaut des Huns.
Attila, les Turcs et les Avars
Après le choc entre Goths et Romains, les Huns de Hongrie se donnent pour roi Attila, qui conserve ses puissants alliés germaniques, les Ostrogoths et les Gépides. Attila avance ses troupes jusqu’à Orléans, le point le plus à l’Ouest qu’aient jamais atteint des conquérants venus de l’Altaï. Aetius, dernier général romain de l’Ouest, perdu au milieu des nouveaux royaumes germaniques constitués sur l’ancien Empire romain, parvient à s’allier aux Wisigoths, qui formeront le gros des troupes, aux Burgondes et aux Francs pour faire face à la menace: Attila est battu aux Champs catalauniques en +451 et reflue en Hongrie. Il y meurt l’année suivante. Son empire est partagé entre ses fils, très nombreux. Face à l’anarchie qui s’ensuit, les Germains se révoltent et écrasent les Huns en +454 en Hongrie (Bataille de Nedao, site inconnu). L’Empire romain sort exsangue et démembré de l’aventure, tandis que l’Empire perse, maître des zones les plus importantes de la Transoxiane et de la Bactrie, était parvenu à résister. Mais, le danger ne disparaît pas pour autant: il se transpose à l’est, où les Huns Blancs, qui n’osent affronter les Perses, annihilent l’empire kouchan vers +440, portant l’ennemi potentiel sur l’ensemble de la frontière orientale de l’orbe perse. En +484, l’empereur perse est tué à la tête de son armée, mais les Huns Blancs préfèrent jeter leur dévolu sur l’Inde. La situation changera au siècle suivant: les premiers Turcs à arriver aux portes des empires du “rimland” battent préalablement les Mongols jouan-jouan en +552, qui se réfugient chez les Huns Blancs en Transoxiane. Les Turcs battent les Huns Blancs en +557. Les Perses profitent de l’occasion pour réoccuper la Transoxiane, et se redonner ainsi le territoire qui a toujours été leur habituelle “bouffée d’oxygène”. Après cela, les Turcs restent cois. Mais les débris des Huns Blancs et des Jouan-Jouans se portent vers l’Ukraine et, de là, vers la Hongrie, où nos ancêtres les connaîtront sous le nom d’Avars. Ils affronteront les Francs en Thuringe (+562), qui leur barreront la route de l’ouest. Mais les Avars reproduisent la stratégie des raids tous azimuts d’Attila, frappant au hasard, où on les attend le moins. Les Byzantins les utiliseront, comme mercenaires ou comme alliés de revers, pour mater les Slaves, mais devront leur payer un tribut énorme, empêchant la Rome d’Orient, par la suite, de mobiliser les moyens financiers nécessaires pour battre définitivement les Perses d’abord, pour faire face ensuite aux Arabes, successeurs de Mahomet.
Des Samanides à Mahmoud de Ghazni
La Perse, après les Sassanides, servira de lieu de passage, d’espace de transit pour les tribus turques et hunniques en marche vers le Sud et l’Ouest. Elle n’a plus une réserve indo-européenne semi-nomade et semi-sédentaire, cavalière et guerrière, au-delà de la Transoxiane et de la Bactrie. Les vagues migrantes qui arrivent n’apportent pas un renouveau de souche européenne, mais de la nouveauté non persane, non assimilable à la persité antique. Toutefois, cette spécificité perse ne disparaît pas pour autant: malgré les coups durs encaissés, c’est une dynastie iranienne du Khorassan, les Samanides, qui règne de 819 à 1005. Une autre domine à l’Ouest de l’Iran actuel, les Bouyyides, de 934 à 1055. Les Samanides s’affirment dans la région au sud de la Mer d’Aral, dans le triangle formé par trois villes prestigieuses: Samarkand, Boukhara et Merv. Descendants d’un ancêtre appelé Saman Khudat, les représentants de cette famille islamisée ne sont que vice-rois des califes dans la région: ils se débarrassent, de manière subtile, de leurs maîtres arabes pour établir une culture propre, certes musulmane mais persane et non arabe. Au cours des premiers siècles de la domination arabe, le rejet de l’arabité par les Iraniens sera constant: d’abord, les conversions ont été lentes (il a fallu plus de quatre siècles!), ensuite, la base zoroastrienne de leur religion les induit à choisir généralement des voies chiites, contestatrices des pouvoirs dominants sunnites chez les Arabes, tout simplement parce que le zoroastrisme, puis les doctrines de Mani et de Mazdak, s’opposent aux pouvoirs sclérosés et aux répétitions rituelles stériles.
Les trois villes, qui forment les piliers du pouvoir samanide, sont des centres caravaniers, des foyers de commerce et de culture. Boukhara comptait près de 300.000 habitants. Dans la bibliothèque royale s’accumulaient 45.000 volumes. Un syncrétisme religieux et philosophique y émergeait, favorisé par les contacts entre Arabes et Persans, entre Européens du Nord et marchands chinois, entre Musulmans, Nestoriens et Bouddhistes. Les Samanides, sous la pression des Bouyyides, finissent par perdre le contrôle des mines d’argent de la région, source matérielle de leur pouvoir. Les tribus turques d’Asie centrale lorgnent sur les richesses des villes samanides, qui tombent en déliquescence et ne possèdent plus leur puissance d’antan. Après d’innombrables péripéties, changements d’alliances, trahisons et querelles intestines, les Turcs entrent dans Boukhara le 23 octobre 999.
Une date clef : la chute de Boukhara
Pour l’historien britannique John Man, “la chute de Boukhara en 999 doit être considérée comme le premier épisode d’une crise générale”, qui amènera les Turcs en Anatolie, déclenchera les croisades européennes un siècle plus tard, débouchera sur la prise de Constantinople en 1453 et générera, après les innombrables avatars de l’histoire, le problème des Balkans, toujours irrésolu. Pour éviter un raz-de-marée turc sur le reste de l’Iran, Mahmoud de Ghazni, un Perse, se soumet formellement au calife de Bagdad. Les Turcs n’occupent encore que l’espace clef d’Asie centrale, le triangle urbain de Boukhara, Samarkand et Merv. Mahmoud de Ghazni, fort de l’alliance qui le lie au calife, veut recréer, manu militari, l’empire d’Alexandre et celui des gupta, sous sa rude férule. Il envahit l’Inde, réussit un exploit militaire extraordinaire pour l’époque: la traversée du désert de Thar pour prendre la ville de Somath sur les rives de l’Océan Indien. L’objectif géopolitique de Mahmoud de Ghazni était de créer un barrage d’empires islamisés, de la Méditerranée à l’Inde, pour barrer la route aux Turcs d’Asie centrale, non encore convertis. Mais le pillage systématique des villes indiennes et des lieux de culte hindous, qu’il a pratiqué pour obtenir des fonds, le rendra odieux aux Indiens, qui le considèrent comme le premier envahisseur musulman décidé à détruire les bases de l’hindouisme. Sa rudesse est bel et bien à l’origine du conflit indo-musulman actuel. A sa mort en 1030, son empire, dirigé par ses héritiers, s’étend provisoirement jusqu’à Bénarès (prise en 1033), puis s’écroule. Les Turcs écrasent l’armée de son fils et amorcent, vers 1037, leur longue marche vers l’ouest, qui conduira à la bataille de Manzikert en 1071, contre les Byzantins, puis aux Croisades. A l’Est, ils prendront l’Inde en 1206, sous la conduite d’Aîbek.
Les Séfévides, alliés de revers du Saint-Empire et de l’Espagne
L’Iran ne retrouvera une identité politique propre qu’avec l’avènement des Séfévides en 1501. De 1037 à 1500, effectivement, l’Iran est sous la coupe de chefs turcs ou mongols. Au 15ième siècle toutefois, le déclin mongol permet le réveil de trois puissances: la Lithuanie, la Moscovie et l’ordre religieux soufi des Séfévides. Les Lithuaniens repoussent les Mongols et arrivent sur la Mer Noire. La Moscovie se structure au nord et passera à l’attaque au siècle suivant. Sur les marches turcomanes de l’Iran, un ordre soufi se crée sous la houlette du Cheikh Safi’uddin Ardébili en 1301. Celui-ci adhèrera pleinement à ce complexe religieux soufi-chiite au cours du 14ième siècle. En 1447, six ans avant la chute de Constantinople, le Cheikh Junayd et son fils Heydar imposent une réforme à l’ordre: celui-ci prend un aspect militaire et vise le pouvoir politique. Les tribus turcomanes de la région sont organisées selon de telles règles mystiques et militaires. On les appelle les “Qizilbash” ou “chapeaux rouges”: ils seront entièrement dévoués aux Séfévides.
En 1487, Shah Ismaël succède à son père Heydar, qui avait épousé Marie, la petite-fille d’Alexius IV, empereur de Byzance. L’origine de son épouse lui dicte une hostilité aux Ottomans. Du coup, les puissances européennes traditionnelles cherchent à faire de lui l’allié de revers contre les Ottomans, comme François I était l’allié de revers des Ottomans contre le Saint-Empire et l’Espagne. Shah Ismaël s’assure dans un premier temps la bienveillance, voire l’alliance, des tribus turcomanes de la périphérie septentrionale de l’Iran (sauf les Ouzbeks), conquiert ensuite Diyarbakir en 1508, puis envahit la Mésopotamie. La défaite des Ouzbeks au nord ne lui permet cependant pas de conserver l’espace de la Transoxiane dans la sphère d’influence iranienne, ce qui constitue, comme toujours, un sérieux handicap sur le long terme. Les Ouzbeks sont de fait les alliés de revers des Ottomans. La situation stratégique du début du 16ième siècle est donc la suivante: Espagne, Saint-Empire, Iran contre France, Ottomans et Ouzbeks. L’alliance franco-ottomane ne se fera que dans les années 20 du 16ième siècle, mais, de fait, la volonté de Louis XII, puis de François I, de sortir du cadre légitime de la Francie occidentale (selon le Traité de Verdun de 843) qui s’était déjà emparé antérieurement de la Burgondie rhodanienne, de se rendre maître de la plaine padane pour débouler dans l’Adriatique, sont autant de démarches trahissant une foncière inimitié à l’endroit de l’Espagne et de l’Empire, qui sont, à l’époque, sous la souveraineté commune du jeune Charles-Quint.
Heurs et malheurs des Séfévides
Les Ottomans ripostent et envahissent l’Iran en 1514. L’armée de Shah Ismaël est écrasée. L’expansion ottomane au Proche et au Moyen-Orient commence: Soliman le Magnifique s’empare de Bagdad en 1534. L’Iran séfévide perd définitivement l’Irak. Il faudra attendre l’avènement du Shah Abbas I (1588-1629) pour stabiliser à nouveau l’Iran séfévide, en faire un bloc inexpugnable, regroupant le Caucase, l’Iran et une bonne partie de l’Afghanistan actuel. Abbas I a réussi à consolider ses frontières occidentales, mais sans récupérer la Mésopotamie et le Kurdistan actuel. En 1639, les hostilités entre Ottomans sunnites et Perses chiites cessent durablement: la frontière occidentale de l’Iran restera, grosso modo, la même que celle que nous connaissons aujourd’hui. Au 18ième siècle, Nader Shah Afshar (1729-1747) tenta une nouvelle fois, sans succès, de reconquérir la Mésopotamie, soulageant par ses efforts les Européens, qui purent ainsi consolider les conquêtes d’Eugène de Savoie dans les Balkans et celles de Catherine II sur le pourtour de la Mer Noire. Nader Shah Afshar s’opposa toutefois victorieusement à la Russie dans le Caucase. Il réussit à envahir l’Afghanistan et l’Inde, à prendre Dehli, capitale des Moghols. Ses efforts en Transoxiane furent vains, ce qui n’est pas sans conséquences: l’histoire nous enseigne qu’un Iran qui ne domine pas la Transoxiane demeure faible et menacé. L’épopée guerrière de Nader Shah Afshar se fit au détriment de l’organisation intérieure de l’Empire, comme du temps de Mahmoud de Ghazni: ses conquêtes furent perdues après sa mort. Plus tard, Karim Khan Zand prend Bassorah aux Ottomans, ce qui permet à la Perse de développer son commerce avec l’Inde. Cette victoire montre l’importance stratégique primordiale de ce port au sud de la Mésopotamie.
Au 19ième siècle, la dynastie des Qadjars, turcomane d’origine, affronte la Russie qui, forte de ses victoires contre les Ottomans, a progressé dans le Caucase et commence à grignoter les territoires iraniens. La Russie est désormais maîtresse de la Caspienne. L’Iran, sous la conduite de Fath’Ali Shah, tente de reprendre pied en Afghanistan en conquérant Hérat en 1837: les Anglais font alors pression sur le Shah pour qu’il retire ses troupes. Au même moment, comme par hasard, une révolte religieuse, celle des Bâbis, plonge l’Iran dans une guerre civile. Les Babistes luttaient contre le clergé chiite, jugé trop rétrograde, et militaient pour un assouplissement général des règles islamiques de la vie quotidienne. Réprimé durement, le mouvement continue toutefois à agir dans la clandestinité et travaillera à la chute des Qadjars, en soutenant le mouvement constitutionaliste de la première décennie du 20ième siècle, qui a reçu un certain soutien britannique, retiré prestement, dès que les nécessités stratégiques de l’Entente avec la France et la Russie obligeaient Londres à ménager Pétersbourg pour concentrer tous les efforts contre l’adversaire allemand. La Russie s’opposait au constitutionalisme, craignant la contagion, et préférait soutenir le Shah et le clergé hostile à toute réforme socio-religieuse. En 1857, immédiatement après la Guerre de Crimée, le Shah Nasser ed-Din tente une nouvelle fois de reprendre Hérat; les Anglais, qui n’acceptent pas et n’accepteront jamais cette expansion iranienne vers l’est, débarquent dans le Sud. Russes et Anglais finissent par se partager des zones d’influence dans le pays, le réduisant, non pas au statut d’une colonie, mais d’une zone sans indépendance réelle. Le pouvoir des Qadjars au 19ième siècle est l’histoire d’un lent déclin de la Perse.
00:14 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, géopolitique, iran, perse, grand moyen orient, moyent orient, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook