lundi, 20 avril 2015
Camus on Ideology vs. Blood

Camus on Ideology vs. Blood
By Kevin Donoghue
Ex: http://www.counter-currents.com
It is December 10, 1957, and a cold, dark day in Stockholm, Sweden. Inside the hall, however, it is bright and warm, with many of the world’s leading men assembled for the chance to hear directly from the bright young man about to be honored. His voice has rung out as a sign of hope and a challenge to tyrants and dictators, his work acclaimed and already achieving a place of honor in the curricula of the world’s universities.
The author has just turned 44 years of age, yet he has the ear of the world’s great and good, as well as the ears of many a common man. His life’s work as an author has led to today’s event, the awarding of the Nobel Prize, but he is more than that: a famous newspaper editor, a philosopher, a public intellectual, a dramatist, a playwright, a playboy whose Hollywood good-looks and fame ensure a dizzying succession of women. For a time, he was the voice of the French Resistance inside France itself—indeed, from the very heart of immortal Paris—both during and immediately after the war.
Yet, on this day, many find themselves wondering what this famous man will say. He has been uncommonly quiet for months now, a matter that has incited not a small amount of public comment. The author did rouse himself during the Hungarian Uprising of 1956 and helped rally world opinion in favor of that noble but doomed effort to remove the ancient and Christian nation of Hungary from under Soviet domination. Yet, he has remained silent in the face of a national crisis gripping his own homeland.
In Algeria, French troops are fighting a no-holds-barred war against Muslim forces seeking to evict France and all Frenchmen and Christians. In Paris, all men with an interest in public affairs have staked a position on what would eventually be known as the Algerian War, a matter so dire, so central to French life as to eventually cause not just the downfall of a government but the demise of the Fourth Republic itself.
And, so, the men in Stockholm that day were more than usually interested when the honored man, Albert Camus, took to the podium to give a short lecture. And so he began:
In receiving the distinction with which your free Academy has so generously honored me, my gratitude has been profound, particularly when I consider the extent to which this recompense has surpassed my personal merits. Every man, and for stronger reasons, every artist, wants to be recognized. So do I. But I have not been able to learn of your decision without comparing its repercussions to what I really am. A man almost young, rich only in his doubts and with his work still in progress, accustomed to living in the solitude of work or in the retreats of friendship: how would he not feel a kind of panic at hearing the decree that transports him all of a sudden, alone and reduced to himself, to the center of a glaring light? And with what feelings could he accept this honor at a time when other writers in Europe, among them the very greatest, are condemned to silence, and even at a time when the country of his birth is going through unending misery? (http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1957/camus-speech.html [2])
The lecture matched the man: short yet grand, concise yet breath-taking in scope.
However, fate would have it that Camus’ speech would not be the most famous, or the most important, words he would utter that day. For a controversy dogged his every step in Sweden. A French Algerian writer, a celebrated man of the French Left, could not be allowed to say nothing about what his comrades considered a war of national liberation that demanded their full support. So after Camus’ remarks, an Algerian student rose and asked the newly-crowned laureate, how he could remain silent in the face of his people’s struggle for justice.
And, so, Camus responded. His response confounded his comrades and revealed the extent to which Camus prized the reality of our organic connections to family and community over mere political theory and rhetoric.
People are now planting bombs on the tramway of Algiers. My mother might be on one of those tramways. If that is justice, then I prefer my mother.
That simple remark turned a simmering controversy into a firestorm of condemnation, a condemnation so furious as to—temporarily, at least—besmirch his reputation and cause the removal of his works from mandatory reading lists well into the 1980s.

Camus and Michel
Gallimard from 1958
Those of us on the Right who are seeking both to describe the terminal problem of liberalism and to set forth a humane solution would do well to remember Camus’ point.
To be effective, to signal clearly that we are not haters and harmers, but people offering a just and humane solution to a very real, very human problem, we must remember that abstract political theories are outside of our political tradition. (They are not outside of France’s, hence, Camus’ heresy.) We must remain grounded. We must recognize why the Left writ large continues to attract souls like Camus, and we must offer an equally attractive alternative vision.
In short, let us appeal to family, not theory.
Article printed from Counter-Currents Publishing: http://www.counter-currents.com
URL to article: http://www.counter-currents.com/2015/04/camus-on-ideology-vs-blood/
URLs in this post:
[1] Image: https://secure.counter-currents.com/wp-content/uploads/2014/06/camus.jpg
[2] http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1957/camus-speech.html: http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1957/camus-speech.html
[3] Image: http://www.counter-currents.com/wp-content/uploads/2015/04/messud_1_110713-e1429032863954.jpg
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albert camus, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L'Iran, un clou dans la chaussure d'Obama?

L'Iran, un clou dans la chaussure d'Obama?
par Jean Paul Baquiast
Ex: http://www.europesolidaire.eu
Malheureusement pour Obama, les choses ne se présentent pas aussi favorablement, concernant l'accord sur le nucléaire. D'abord ledit accord, ou plus exactement le pré-accord dit de Lausanne, est considéré par le fidèle allié Israël comme une défaite majeur infligée par l'ami américain. Benjamin Netanyahu, après l'avoir exposé devant un Congrès américain compréhensif, ne cesse de le répéter. Ce message est relayé aux Etats-Unis comme dans le reste du monde par les différents lobbys juifs, dont l'AIPAC en Amérique. Ils considèrent, à tort ou à raison que l'Iran n'a pas renoncé à la promesse faite il y a quelques années, de « rayer Israël de la carte ». On pourrait cependant penser que l'Etat juif dispose de suffisamment de moyens militaires et de renseignement pour tuer dans l'oeuf un tel projet, si Téhéran faisait la folie d'essayer de le réaliser.
Cependant, en dehors des Israéliens et de leurs amis à Washington, il apparaît qu'une très grande majorité de parlementaires américains, à la Chambre comme au Sénat, se propose de ne pas ratifier le traité avec l'Iran. Leur principal motif n'est pas la sécurité d'Israël, mais le désir de torpiller Obama, qu'ils présentent comme le plus mauvais des présidents américains. Iront-ils jusqu'à refuser le traité, ce qui serait immédiatement considéré comme une sorte de déclaration de guerre par l'Iran? La chose est fort possible. Iront-ils ensuite à pousser le Pentagone à des frappes directes contre les sites nucléaires iraniens, ou plus vraisemblablement inciter Israël à le faire? On en parle, et pas seulement à Téhéran ou Tel-Aviv.
Par précaution, le ministre iranien de la défense envisagerait en conséquence ces temps-ci un possible accord militaire entre l'Iran, la Chine et la Russie, destiné dans un premier temps à contrer le réseau antimissile de l'Otan, mis en place en Europe sous le nom de BMDE, que nous avions abondamment commenté sur ce site. L'Inde pourrait éventuellement s'y joindre ultérieurement Le BMDE est officiellement présenté comme destiné à décourager des frappes balistiques iraniennes, totalement imaginaires à ce jour. En fait, il est destiné à rendre inopérantes, comme nul ne l'ignore, des frappes russes en retour d'une attaque de l'Otan dirigée contre la Russie. Or, en cas de conflit américano-iranien, le BMDE pourrait servir à réaliser des frappes, éventuellement nucléaires, contre l'Iran. Il était donc naturel que l'Iran se tourne vers la Russie pour acquérir des batteries anti-missiles dites S.300. Au delà de cette première défense, il est également naturel que l'Iran cherche à promouvoir une alliance militaire avec la Russie et la Chine, en vue de se défendre contre toute attaque américaine, aujourd'hui ou plus tard.
Il n'est pas possible aujourd'hui de pronostiquer les chances de réalisation d'un tel accord. Mais d'ores et delà, la perspective de celui-ci renforce considérablement le poids de l'Iran, comme grande puissance régionale au Moyen-Orient. Elle pourra ainsi faire avorter les intentions des puissances sunnites alliées des Etats-Unis, dont l'Arabie Saoudite est la plus irresponsable, visant à mener des guerres au Yémen contre les Houthis, alliés de principe de l'Iran, ou contre la Syrie de Bashar al Assad, allié aussi bien de l'Iran que de la Russie.
Concernant la Chine, elle ne pourra que s'intéresser à une alliance stratégique avec l'Iran, incluant la Russie. Ainsi se constituerait un axe favorisant ses grands projets économiques et politiques, par l'intermédiaire d' un pays aux ressources considérables et qui, en tant qu'héritier du grand Empire Perse, ne s'estime pas nécessairement devoir représenter les intérêts des monarchies pétrolières.
L'Iran, nous demandions-nous, est-elle donc en passe de devenir un clou dans la chaussure d'Obama? C'est à lui en premier lieu qu'il faudrait poser la question.
00:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, iran, obama, états-unis, moyen orient |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Debord, réac ou révolutionnaire?...

Debord, réac ou révolutionnaire?...
par Galaad Wilgos
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Nous reproduisons ci-dessous un point de vue de Galaad Wilgos, cueilli sur le site Le Comptoir et consacré à la position de Guy Debord par rapport à la question du progrès...
« Quand être “absolument moderne” est devenu une loi spéciale proclamée par le tyran, ce que l’honnête esclave craint plus que tout, c’est que l’on puisse le soupçonner d’être passéiste. » — Guy Debord.
Le titre peut paraître improbable aux yeux des pythies progressistes. Debord, dont on honorait le vingtenaire de la mort il y a peu, idole devenue consensuelle, dont l’ouvrage – ou devrait-on dire le titre – a enfanté quantité de lieux communs, semble faire partie du milieu. À l’instar d’un Camus, devenu social-démocrate progressiste, Debord l’irréductible s’est transformé, avec l’âge et la mort, en gentil critique des médias. On a détourné Debord.
Pourtant, un certain Debord demeure ignoré du grand public. Et pour cause, l’homme qui refusait d’apparaître dans les médias, le contempteur du travail, le premier critique de son public, a développé une œuvre dotée en germes de fortes doses d’explosif. Debord, dynamite conceptuelle. Si on le connaît plus pour sa pulvérisation de la « société du spectacle » ainsi que ses remarques sur l’urbanisme, peu de gens connaissent l’auteur de ces lignes : « La décadence générale est un moyen au service de l’empire de la servitude ; et c’est seulement en tant qu’elle est ce moyen qu’il lui est permis de se faire appeler progrès. » (Panégyrique, in Œuvres, p.1684)
Car en effet, Debord n’était pas un anticapitaliste typique. Malgré une conversion pleine et entière au marxisme, sa radicalité ainsi que son adhésion au conseillisme l’avaient amené à mener de front un combat radical contre la société moderne. Faisant constamment référence au passé afin d’y tirer des exemples, il détestait de nombreux phénomènes liés à la société moderne, fustigeait les travers moraux de ses contemporains [i] et émettait des critiques qui pourraient le faire passer aux yeux de certains de nos contemporains pour un « réac’ ». Ainsi, à propos des problèmes de banlieue, Debord disait :
« Je pense que tu as noté un fait qui a été cité très vite, peu de jours après l’affrontement du pont de l’Alma. Les pompiers appelés à Montfermeil sous le prétexte d’un faux incendie sont en fait tombés dans un guet-apens, où on les attendait avec des pavés et des barres de fer. Nos vieilles chansons témoignent qu’il est après tout normal, quand on est trop dans le besoin, de “crever la panse et la sacoche” d’un contrôleur des omnibus. Mais attaquer des pompiers, cela ne s’est jamais fait quand Paris existait ; et je ne sais même pas si cela se fait à Washington ou à Moscou. C’est l’expression achevée, et pratique, de la dissolution de tous les liens sociaux. » (Jean-François Martos, Correspondance avec Guy Debord, 1998, p.137).
Debord romantique révolutionnaire
Pour comprendre cela, il faut revenir sur un concept analysé par Michael Löwy et Robert Sayre : le romantisme révolutionnaire. On ne peut pas comprendre ses critiques acerbes de la modernité sans voir qu’elles s’enracinent dans toute une tradition de pensée critique, élaborée en réaction à l’avènement du capitalisme industriel. Entendons-nous bien, il ne s’agit pas de faire de Debord un disciple de Hugo ou de Nerval – bien qu’il aimait tout particulièrement des gens comme Novalis, Coleridge ou Musset [ii]. Il s’agit en revanche de l’attacher à ce « grand courant de protestation contre la civilisation capitaliste/industrielle moderne, au nom de valeurs du passé, qui commence au milieu du XVIIIe siècle, avec Jean-Jacques Rousseau et qui persiste, en passant par la Frühromantik allemande, le symbolisme et le surréalisme, jusqu’à nos jours ». Il se caractérise ainsi par plusieurs traits spécifiques, qui le distinguent d’une critique rationnelle et « froide » du capitalisme : « Déchiré entre nostalgie du passé et rêve d’avenir, il dénonce les désolations de la modernité bourgeoise : désenchantement du monde, mécanisation, réification, quantification, dissolution de la communauté humaine. Malgré la référence permanente à un âge d’or perdu, le romantisme n’est pas nécessairement rétrograde : au cours de sa longue histoire, il a connu aussi bien des formes réactionnaires que révolutionnaires. » [iii]
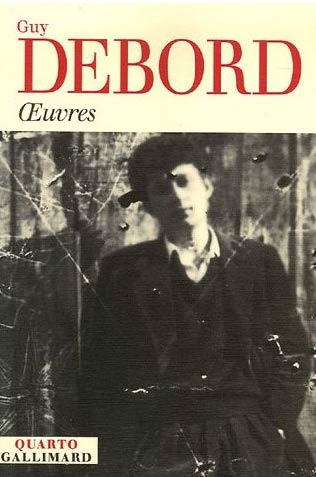 Le concept de romantisme révolutionnaire avait déjà été mis en débat dans les années 1950, lorsqu’Henri Lefebvre se rapprocha de l’Internationale situationniste. C’était notamment autour de ce concept que les deux entamèrent un dialogue plus ou moins fécond. Et de prime abord, Debord n’y semblait pas favorable. Les situationnistes refusaient en effet la conception de l’art de Lefebvre, qui distinguait encore les genres et parlait d’« œuvre » (en opposition, du reste, avec la conception de l’ancien romantisme, qui mettait du flou dans ces délimitations), alors que les situs, changeant ainsi le terrain même de la discussion, ne considéraient plus que l’existence même comme œuvre véritable, désirant ainsi dépasser l’art et sa conception moderne en faisant de la vie elle-même une œuvre d’art. Par ailleurs, leur refus du monde ne pouvait être à leurs yeux romantique que dans la mesure où l’entreprise situationniste demeurait finalement un échec – incapable de porter un coup radical à la société capitaliste –, quand bien même ce refus était inconsciemment romantique. Les situationnistes semblent cependant admettre la qualification de romantique vers le début des années 1960, au moment même où Debord et Lefebvre rompirent leur relation amicale. [iv]
Le concept de romantisme révolutionnaire avait déjà été mis en débat dans les années 1950, lorsqu’Henri Lefebvre se rapprocha de l’Internationale situationniste. C’était notamment autour de ce concept que les deux entamèrent un dialogue plus ou moins fécond. Et de prime abord, Debord n’y semblait pas favorable. Les situationnistes refusaient en effet la conception de l’art de Lefebvre, qui distinguait encore les genres et parlait d’« œuvre » (en opposition, du reste, avec la conception de l’ancien romantisme, qui mettait du flou dans ces délimitations), alors que les situs, changeant ainsi le terrain même de la discussion, ne considéraient plus que l’existence même comme œuvre véritable, désirant ainsi dépasser l’art et sa conception moderne en faisant de la vie elle-même une œuvre d’art. Par ailleurs, leur refus du monde ne pouvait être à leurs yeux romantique que dans la mesure où l’entreprise situationniste demeurait finalement un échec – incapable de porter un coup radical à la société capitaliste –, quand bien même ce refus était inconsciemment romantique. Les situationnistes semblent cependant admettre la qualification de romantique vers le début des années 1960, au moment même où Debord et Lefebvre rompirent leur relation amicale. [iv]
La relation au passé de Debord est ainsi de tout intérêt. Comme Lefebvre, il n’acceptait pas l’idée d’un retour vers le passé comme solution au capitalisme. Romantique et antimoderne, oui, mais certainement pas réactionnaire. Alors que le situationnisme, avant-garde artistique, ne devait pas a priori s’opposer à une vision focalisée sur l’avenir, l’histoire et l’évolution de Debord ont été de magnifiques contradictions par rapport à ces visions avant-gardistes des origines. Passionné d’histoire, il puisait de nombreuses références dans le passé, afin d’en tirer des germes de négation de l’ordre capitaliste. Grand admirateur des époques et des auteurs anciens, il pouvait mentionner en des termes élogieux l’Athènes antique, la Florence de la Renaissance [v], mais aussi l’époque médiévale, avec ses récits du Saint-Graal et sa chevalerie, voire les communautés étrangères au capitalisme :
« Ce qui intéressait les situationnistes dans ces communautés était leur existence indépendante de l’État et de l’accumulation capitaliste, soit parce qu’elles leur étaient antérieures, comme les sociétés archaïques ou la chevalerie médiévale, soit parce qu’elles échappaient à leur emprise, comme les Gitans. Il ne s’agissait pas, bien sûr, de reproduire tel quel, dans une société communiste, le mode de vie des chevaliers, des nomades ou des Amérindiens, mais de s’appuyer sur leur exemple pour concevoir de nouvelles formes de vie désaliénée. » [vi]
Les situationnistes et le progrès
Peu de place pour un progrès dogmatique, donc. Cette chimère sortie toute ailée des cerveaux aériens de l’aristocratie décadente et de la bourgeoisie montante postulait l’amélioration continue de la civilisation avec le temps. L’accumulation des enseignements, les découvertes scientifiques, la pensée rationnelle seraient autant de preuves de la supériorité des Modernes sur les Anciens. Le XVIIIe siècle et ses Lumières – Rousseau excepté – en furent les parangons, le XIXe siècle et sa révolution industrielle lui donnèrent une assise matérielle, sociale. La bourgeoisie, auréolée de ses victoires révolutionnaires et en bonne place sur le trône du monde, pouvait désormais rebaptiser l’optimisme qui en découlait du doux nom de Progrès, devenant ainsi un qualificatif mélioratif, là où il désignait autrefois un simple mouvement. L’idéologie du Progrès, avec son eschatologie, son sens de l’Histoire dirigé inéluctablement vers l’Éden – des droits de l’homme et du marché pour les libéraux, de la Révolution et de la fin du capitalisme pour les marxistes – put régner en maître par l’intermédiaire des maîtres du monde – et de nombre de leurs adversaires. Face à ce nouveau dogme moderne, le romantisme s’érigea aussi en réaction aux « illusions du progrès » (Sorel), à commencer par Rousseau, critique interne aux Lumières.
Les situationnistes étaient ambigus par rapport à la question du progrès, plus particulièrement du progrès technique. L’urbanisme en est une preuve flagrante : la New Babylon élaborée par Constant Anton Nieuwenhuys était un bijou de technophilie. Reposant sur une automatisation totale du travail – abolissant dès lors, selon Constant, le travail – elle fonctionnait à l’aide des technologies les plus avancées et des matériaux les plus « modernes » pour son temps (aluminium, nylon,…). Tout y était artificiel, des bruits d’ambiance aux changements météorologiques programmés. C’était une « expression typique de la phase de modernisation que traversent les sociétés occidentales dans l’après-guerre » [vii], avec son cortège joyeux et extatique d’enthousiastes du progrès techno-scientifique. Ouvrage de science-fiction qui allait engendrer de nombreux monstres – émules d’un Constant, lui-même déconcerté (tant il n’adhérait pas non plus à une négation totale du passé) –, New Babylon assortie des productions artistiques du « peintre industriel » situationniste Giuseppe Pinot Gallizio et des affinités futuristes du mouvement, étaient de grandiloquentes proclamations technophiles.
Cependant, ce serait oublier que le mouvement s’était aussi érigé contre une certaine modernisation devenue folle. À l’instar de Rousseau, les situs critiquaient la modernité au sein de la modernité. Les rêves de récupération des développements techniques créés par le capitalisme à des fins socialistes étaient toujours présents, marxisme et imaginaire moderniste obligent, mais en dépit de cela, le projet radical de critique s’insurgeait contre les dégâts provenant de cette société. La « dérive » [viii] est un exemple notable : il s’agit d’une nouvelle forme d’activité, une forme de vie novatrice à la fois poétique et subversive, qui se construit en partie par opposition à la ville moderne. Alors que celle-ci dispose des destinations comme autant de points abstraits, séparés les uns des autres et reliés par des trajectoires généralement rectilignes – en raison d’une rationalisation instrumentale et d’un utilitarisme capitaliste – la dérive ne suit aucun schéma et préfère les chemins spontanés, les ambiances.
Celui qui dérive s’oppose à la vision purement utilitaire du déplacement urbain, avec son cortège de « non-lieux » (ces lieux de passage qui relient les points de départ et d’arrivée d’un même ensemble géographique), de sas, d’écrans, d’accélérateurs de déplacements (ascenseurs, routes, etc.) et de contraintes policières (le situ Abdelhafid Khatib ayant été incarcéré à deux reprises en cherchant à définir l’ambiance des Halles la nuit, en raison de son origine nord-africaine). La dérive était généralement effectuée ivre. « Le sens de la dérive réside bien dans son opposition à ce conditionnement, au cloisonnement de la ville, à la canalisation des trajets, à la déqualification des lieux. Il est dans la guérilla que mènent les marcheurs libres contre le quadrillage et la gestion de l’espace rendus nécessaires par une société fondée sur la division du travail et la lutte des classes. “On nous impose où il faut aller, par où il faut marcher. Et la dérive, c’est le contraire. […] On découvre des parcours inapparents dans les villes, dans les cités, dans les rues” déclarera le situationniste Ralph Rumney. » [ix] Anecdote intéressante et témoignage dramatique des ravages de la modernisation, quand Raoul Vaneigem et Debord cherchèrent à faire une dérive dans les Sarcelles, ils durent renoncer bien vite et retourner à leurs lieux habituels… Le lieu ne se prêtait en rien à la recherche d’une atmosphère et aux déplacements incongrus des situs. Il faut bien le dire, les endroits préférés des situs demeuraient les endroits historiques et préservés, des villes telles que Venise ou Amsterdam, où toute une ambiance et une géographie persistaient dans leur être, contre la modernisation galopante des villes. Ces nomades n’avaient, en réalité, jamais assez de railleries et de vitupérations contre les immondes amas de béton que sont les HLM, ou contre les buildings titanesques des grandes métropoles.
Debord écolo, anti-industriel et anti-moderne
Mais au-delà de ses ambigüités, c’est la trajectoire particulière de Guy Debord qui est la plus intéressante. Ce dernier n’a pas été épargné par les paradoxes du mouvement auquel il a appartenu, mais à l’inverse de plusieurs de ses membres, ainsi que de nombreux héritiers proclamés du situationnisme, Debord a effectué une mue en vieillissant – et notamment au contact d’intellectuels comme Jacques Ellul et Cornélius Castoriadis – vers un positionnement franchement anti-industriel, anti-moderne et écologiste. Au cours des années 1950, déjà, il commençait à lancer quelques foudres affirmées contre le modernisme échevelé. En 1957, contre l’appréciation du futurisme de certains de ses camarades, Debord dénonçait « la puérilité de [son] optimisme technique » (Rapport sur la construction des situations). Des années plus tard, son célèbre ouvrage La société du spectacle fustigera le « système économique fondé sur l’isolement [qui] est une production circulaire de l’isolement. L’isolement fonde la technique, et le processus technique isole en retour. De l’automobile à la télévision, tous les biens sélectionnés par le système spectaculaire sont aussi ses armes pour le renforcement constant des conditions d’isolement des “foules solitaires”. » (§28). La note 45 démolit le secteur tertiaire des services, qu’il décrit comme étant l’ « immense étirement des lignes d’étapes de l’armée de la distribution et de l’éloge des marchandises actuelles », dont le développement rencontrait à ce moment-là la demande d’emploi liée à l’automatisation du travail – anticipant par là les « jobs à la con » de David Graeber. Dans la note 192, Debord déplore la dissolution de la communication, du langage, et donc de la communauté, et il n’hésite pas, dans la note 115, à se revendiquer du « général Ludd », figure mythique du mouvement de bris des machines anglais !
En 1971, après de nombreuses évolutions personnelles, il rédigea un texte alors inédit, au titre qui donnait d’emblée le ton : « La planète malade ». Singulière proclamation techno-critique et écologiste (bien qu’ambiguë par moments), il y aborde la question de la pollution. L’article fait office de critique exhaustive des dégâts industriels, et notamment de la production de pollution : « augmentation rapide de la pollution chimique de l’atmosphère respirable ; de l’eau des rivières, des lacs, des lacs et déjà des océans, et l’augmentation irréversible de la radioactivité accumulée par le développement pacifique de l’énergie nucléaire ; des effets du bruit ; de l’envahissement de l’espace par des produits en matières plastiques qui peuvent prétendre à une éternité de dépotoir universel ; de la natalité folle ; de la falsification insensée des aliments ; de la lèpre urbanistique qui s’étale toujours plus à la place de ce que furent la ville et la campagne ; ainsi que des maladies mentales […] ».
Avec prescience, il y détecte déjà les récupérations de l’écologie par la société du spectacle : « la soi-disant “lutte contre la pollution”, par son côté étatique et réglementaire, va d’abord créer de nouvelles spécialisations, des services ministériels, des jobs, de l’avancement bureaucratique ». Et il conclut par un vibrant plaidoyer pour la démocratie des soviets, dite « démocratie totale », ainsi que pour la révolution : « Ce printemps [de mai 68] obtint aussi, sans précisément y monter à l’assaut, un beau ciel, parce que quelques voitures avaient brûlé et que toutes les autres manquaient d’essence pour polluer. Quand il pleut, quand il y a de faux nuages sur Paris, n’oubliez jamais que c’est la faute du gouvernement. La production industrielle aliénée fait la pluie. La révolution fait le beau temps. »
Sans concession avec une société moderne produisant tant de nuisances, il approfondit certaines critiques émises à l’encontre de la nourriture moderne dans un autre texte, peu connu, nommé « Abat-faim » et publié en 1985 dans la fameuse Encyclopédie des Nuisances (tome I, fascicule 5). On sait que Debord et ses amis situs adoraient la bonne gastronomie, mais aussi les bons breuvages. Le palais est un palais, le bon goût ne touche pas uniquement l’art mais aussi la victuaille et la boisson. Si dans le texte précédent, Debord affirmait que « pour la pensée bourgeoise, méthodologiquement, seul le quantitatif est le sérieux, le mesurable, l’effectif ; et le qualitatif n’est que l’incertaine décoration subjective ou artistique du vrai réel estimé à son vrai poids », ce texte sera pour lui l’occasion d’approfondir ceci en décortiquant les dégâts industriels sur l’évolution du goût des aliments… et donc des hommes. Pour Debord en effet, avec le progrès de la technique, nous ne mangerions plus que des abats-faims, soit « une pièce de résistance qu’on sert d’abord pour apaiser, abattre la première faim des convives » (Larousse).

Bien avant les scandales de Findus, il y dénonce déjà les colossales malversations liées à l’industrie agro-alimentaire et à ses aliments « dont l’apparence colorée n’y garantit pas la saveur, ni la fadeur l’innocuité ». La chimie fait des ravages, couplée avec la mondialisation et la logique marchande elle permet des horreurs : viandes composées à plus de 30% de matières végétales fabriquées en laboratoire, bières infectes, voire bières concentrées (permettant le remplacement des brasseurs par de vulgaires embouteilleurs chargés de réunir les éléments séparés – le tout au profit des grandes industries brassicoles, détruisant les brasseries locales et donc du même coup tout un savoir-faire ancestral), pains composé d’ingrédients imbitables (farines non-panifiables, levures chimiques, fours électriques), fruits gardés au froid afin de résister à toutes les saisons (perdant au passage, selon un journaliste enthousiaste du Cosmopolitan, beaucoup de leur saveur naturelle), etc. Constat presque prophétique : aujourd’hui, on sait désormais scientifiquement que les fruits ne sont plus que des succédanés des fruits d’antan, une pomme des années 1950 en valant 100 des années 2000…
La nourriture est un sujet peu abordé par les révolutionnaires – si ce n’est par l’angle quantitatif. Or, c’est un enjeu tout aussi important, sinon majeur, et Debord l’avait bien compris. La logique du capitalisme tend à tout réduire à des abstractions et à nuire à l’authenticité des productions humaines. Elle crée des ersatz, et ce au profit des personnes qui possèdent le capital, seules aptes à payer des laboratoires pour toujours progresser dans la réduction des coûts, et les machines permettant de recomposer les aliments séparés. Cette réduction des coûts (et du temps), on le sait désormais, passera bientôt par la disparition des animaux, bien trop coûteux pour ceux qui ne veulent plus avoir à faire à de la chair vivante. Au nom du quantitatif, on détruit le qualitatif. Raisonnements d’esthètes ? Les premiers perdants de ces avancées sont en réalité les classes populaires. Des petites entreprises familiales en Occident transmettant un legs gastronomique séculier jusqu’aux agriculteurs vivriers qui en Afrique sont incapables de rivaliser avec la production à bas coûts (et à bas goûts) des grandes fermes industrielles occidentales, tous y perdent, et tout s’y perd : les traditions alimentaires, l’autonomie alimentaire, tout ce qui a pu se faire grâce à une production spontanée du peuple et une longue formation historique.

Mais comment a-t-on pu en arriver là ? Debord, en antimoderne, ne peut que constater la lente déliquescence des mœurs. Il fut un temps où l’on pouvait « pendre à la lanterne » les falsificateurs de nourriture, alors que la falsification demeurait artisanale ; elle est aujourd’hui d’autant plus endémique qu’elle est acceptée passivement. « Autre temps, autres mœurs ». Le goût des hommes s’est perdu avec l’homogénéisation capitaliste. « Toute tradition historique doit disparaître, et l’abstraction devra régner dans l’absence générale de la qualité (voir l’article Abstraction). Tous les pays n’avaient évidemment pas les mêmes caractéristiques (géographiques et culturelles) dans l’alimentation. Pour s’en tenir à l’Europe, la France avait de la mauvaise bière (sauf en Alsace), du très mauvais café, etc. Mais l’Allemagne buvait de la bonne bière, l’Espagne buvait du bon chocolat et du bon vin, l’Italie du bon café et du bon vin. La France avait du bon pain, de bons vins, de nombreux fromages, beaucoup de volaille et de bœuf. Tout doit se réduire, dans le cadre du Marché Commun, à une égalité de la marchandise polluée. »
Une mise en garde d’autant plus salutaire que la question du goût n’est pas anodine. Au contraire, elle est le corollaire de celle de l’intelligence, dans tout ce que ce concept embrasse. Une vision bien trop cartésienne de l’être humain a tendu à séparer le corps et l’esprit, dans une dichotomie qui oppose finalement un matérialisme vulgaire à un idéalisme désincarné. Caricature radicale, car comme le rappelait Charles Péguy, « le spirituel couche dans le lit de camp du temporel ». L’éveil à la curiosité sous toutes ses formes est toujours passé par une forme quelconque de passion et de sensualité. Goût des mathématiques, goût de la politique, tout passe par un enracinement des activités dans les désirs et plaisirs charnels des uns et des autres – le corps, réceptacle et formateur des idées. Et les Athéniens de l’Antiquité le savaient, eux qui voyaient notamment dans la tragédie une fonction éminemment critique et démocratique : la leçon de la tragédie passait par les passions qu’elle véhiculait, transmises à l’audience. Plus on ressentait les choses, mieux c’était ; l’apathie – étymologiquement « absence de passion » – était radicalement méprisée chez les Grecs, particulièrement en politique. Plus tard, de nombreuses formes de socialisme tenteront de revaloriser le désir et la libido (parfois jusqu’à l’outrance, ce que récupèrera le capitalisme consumériste), car l’accomplissement de soi passe aussi par une adéquation entre travail, désir et plaisir.
Si Castoriadis pouvait affirmer qu’il fallait remplacer « la passion pour les objets de consommation » par « la passion pour les affaires communes » (Une société à la dérive), c’est bien parce qu’il savait qu’on ne pratiquait pas quelque chose sans que cette chose soit valorisée socialement et apprécié individuellement. La fadeur morne de la politique et des luttes sociales contemporaines est ainsi, désormais, compensée par le Spectacle et ses nuisances. Les valeurs se perdent dès lors par recul de la sensualité, qui est tout à la fois moteur d’ouverture spirituelle et médiatrice des passions.
La perte de sensualité, le mépris des sens, est finalement l’ami pervers d’un capitalisme voué à tout rationaliser, à assécher un monde où l’austérité forcée traverse le monde de la production – et la désinhibition par l’overdose de stimuli celui de la consommation. « La répétitivité et l’affadissement des discours sur la sensualité ont également à voir avec une prise de distance généralisée vis-à-vis du monde sensuel. La pacification politique, le primat de la sécurité, la défiance à l’égard des passions ont des effets anesthésiants. Sans cesse stimulées par des signaux audio et vidéo, la vue et l’ouïe – les deux sens les moins charnels – ont pris l’ascendant sur le goût, et surtout sur l’odorat et le toucher. Les corps, soumis à une infinité de stimulations externes (consommer, embellir, faire du sport, etc.) sont dépossédés d’eux-mêmes. Car l’injonction contemporaine à jouir de la vie selon des principes bien davantage hédonistes et consuméristes que sensuels est le plus souvent un moyen de canaliser les désirs et les énergies, avec une visée normalisatrice. Chacun doit être capable de rendre compte de ses manières d’accéder à des plaisirs qui ne dépassent pas les limites de ce qui est décrété acceptable ; l’éthique de la transparence, aujourd’hui triomphante, repose sur une limitation des libertés communes et sur un autocontrôle des individus. » (Thomas Bouchet, Les fruits défendus. Socialisme et sensualité du XIXe siècle à nos jours.)
Réac ou révolutionnaire ?
Alors, Guy Debord était-il réactionnaire ? Ou révolutionnaire ? La question est importante, car elle dépasse la personne, elle-même significative, de Guy Debord pour toucher les mouvements radicaux et révolutionnaires en général. L’on sait trop bien désormais le lien néfaste entre tout un pan de la tradition révolutionnaire et les idéologies du Progrès. La « table rase » du passé a justifié la diabolisation de ce dernier, et il est, encore aujourd’hui, difficile de tenir une position de valorisation du passé sans passer pour un odieux nostalgique des vieilles dominations. L’eschatologie révolutionnaire n’a pourtant pas toujours été accolée à la Révolution, qui elle-même, étymologiquement, signifie un retour au point originel.
Régis Debray le rappelle régulièrement : « C’est le présentisme qui est effrayant. La perte des anachronismes. L’instant qui scintille, sans recul pour s’en démarquer, sans l’aune pour le juger. Si maintenant tout est maintenant, disons adieu aux rébellions de demain, que le jeunisme tuera dans l’œuf. Pas de révolution sans l’insistance, l’assistance du révolu. […] Tous les révolutionnaires que j’ai rencontrés avaient un temps de retard sur le leur : le Che voulait refaire San Martín, Marcos, Zapata, Chávez, Bolívar. Comme nos jacobins en 1789, lecteurs de Plutarque et de Tite-Live, les Gracques ; et Lénine, la Commune de Paris. Les réfractaires ont la manie d’antidater, en faisant d’un anachronisme leur agenda » (Dégagements). Et comme une preuve par l’histoire, la défunte revue libertaire Offensive avait publié un dossier entier sur ces révolutions ayant précédé la Révolution française. Ces dernières se caractérisaient par un conservatisme populaire qui visait à garder ce qu’il y avait de mieux dans la société tout en restaurant les dégâts commis par les dominants. « Que la révolution soit aussi une restauration, cela devait donc être entendu au sens le plus exact de ce terme : restaurer, c’est bien remettre à neuf une bâtisse, une statue ou un meuble anciens qui ont été abîmés, pour leur permettre de se conserver dans le temps. Révolutionner, ce n’était pas “faire table rase”, cela signifiait au contraire conserver autant que possible un certain état de la société, qui n’avait pu être troublé que par la soif de richesse et de puissance des gouvernants. Par conséquent, loin de se concevoir comme des “bousculeurs”, les révolutionnaires de jadis se voulaient des mainteneurs. » (Patrick Marcolini, « Révolte et conservatisme », Offensive).
 L’un des apports intéressants de Guy Debord réside dans son évolution, qui a été aussi une évolution contre cette conception progressiste, modernisatrice de la Révolution. Comme la majeure partie des authentiques radicaux du XXe siècle, sa volonté d’aller à la racine du capitalisme le conduisit à prendre des positions de plus en plus opposées à la vision linaire, déterministe de l’Histoire. Il adhérait ainsi au célèbre passage du Manifeste du Parti communiste disant que « la bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c’est-à-dire l’ensemble des rapports sociaux. […] Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d’idées antiques et vénérables, se dissolvent; ceux qui les remplacent vieillissent avant d’avoir pu s’ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s’en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés enfin d’envisager leurs conditions d’existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés ». Cela s’accompagnait d’une remise en cause toute aussi radicale des normes véhiculées par le clivage gauche-droite. Considéré comme un auteur de gauche, certaines de ses positions semblaient pourtant déroutantes, désignant le problème de l’immigration comme significatif de l’évolution du monde occidental américanisé, les délinquants de banlieue comme les symptômes d’une dissolution radicale des liens sociaux, et les thèmes sociétaux comme les nouveaux cadres de la pensée bourgeoise. Cela le conduisait même à dire que « les catholiques extrémistes sont les seuls qui me paraissent sympathiques, Léon Bloy notamment. ».
L’un des apports intéressants de Guy Debord réside dans son évolution, qui a été aussi une évolution contre cette conception progressiste, modernisatrice de la Révolution. Comme la majeure partie des authentiques radicaux du XXe siècle, sa volonté d’aller à la racine du capitalisme le conduisit à prendre des positions de plus en plus opposées à la vision linaire, déterministe de l’Histoire. Il adhérait ainsi au célèbre passage du Manifeste du Parti communiste disant que « la bourgeoisie ne peut exister sans révolutionner constamment les instruments de production, ce qui veut dire les rapports de production, c’est-à-dire l’ensemble des rapports sociaux. […] Ce bouleversement continuel de la production, ce constant ébranlement de tout le système social, cette agitation et cette insécurité perpétuelles distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes. Tous les rapports sociaux, figés et couverts de rouille, avec leur cortège de conceptions et d’idées antiques et vénérables, se dissolvent; ceux qui les remplacent vieillissent avant d’avoir pu s’ossifier. Tout ce qui avait solidité et permanence s’en va en fumée, tout ce qui était sacré est profané, et les hommes sont forcés enfin d’envisager leurs conditions d’existence et leurs rapports réciproques avec des yeux désabusés ». Cela s’accompagnait d’une remise en cause toute aussi radicale des normes véhiculées par le clivage gauche-droite. Considéré comme un auteur de gauche, certaines de ses positions semblaient pourtant déroutantes, désignant le problème de l’immigration comme significatif de l’évolution du monde occidental américanisé, les délinquants de banlieue comme les symptômes d’une dissolution radicale des liens sociaux, et les thèmes sociétaux comme les nouveaux cadres de la pensée bourgeoise. Cela le conduisait même à dire que « les catholiques extrémistes sont les seuls qui me paraissent sympathiques, Léon Bloy notamment. ».
Alors, Debord, réac’ ou révolutionnaire ? Gageons qu’il aurait réfuté cette opposition stupide, en montrant que la Révolution a besoin de conservation et donc du passé. Le capitalisme n’ayant plus besoin de la bourgeoisie conservatrice, il a continué sa mutation, chamboulant jusqu’aux mœurs sexuelles afin de conserver sa domination. Désormais, toute opposition authentique ne pourra se revendiquer du Progrès ou de la modernité, moteurs des changements perpétuels nécessaires au renouvellement du capitalisme. Il s’agit dès lors de puiser consciemment dans la mémoire collective pour trouver matière à créer un avenir. Des germes afin que poussent de nouvelles fleurs révolutionnaires. Guy Debord n’était pas réactionnaire, c’était un révolutionnaire sans le Progrès.
Galaad Wilgos (Le Comptoir, 23 mars 2015)
Notes :
[i] « Le fait de n’avoir jamais accordé que très peu d’attention aux questions d’argent, et absolument aucune place à l’ambition d’occuper quelque brillante fonction dans la société, est un trait si rare parmi contemporains qu’il sera sans doute parfois considéré comme incroyable, même dans mon cas. » (Panégyrique, p.1662).
[ii] « Géographie littéraire », in Œuvres, Paris, Gallimard, 2006, pp.1290-1291.
[iii] « Consumé par le feu de la nuit – le romantisme noir de Guy Debord »
[iv] http://noesis.revues.org/723#tocto1n2
[v] « Il est juste de reconnaître la difficulté et l’immensité des tâches de la révolution qui veut établir et maintenir une société sans classes. Elle peut assez aisément commencer partout où des assemblées prolétariennes autonomes, ne reconnaissant en dehors d’elles aucune autorité ou propriété de quiconque, plaçant leur volonté au-dessus de toutes les lois et de toutes les spécialisations, aboliront la séparation des individus, l’économie marchande, l’État. Mais elle ne triomphera qu’en s’imposant universellement, sans laisser une parcelle de territoire à aucune forme subsistante de société aliénée. Là, on reverra une Athènes ou une Florence dont personne ne sera rejeté, étendue jusqu’aux extrémités du monde ; et qui, ayant abattu tous ses ennemis, pourra enfin se livrer joyeusement aux véritables divisions et aux affrontements sans fin de la vie historique. » (Guy Debord, Préface à la quatrième édition italienne de La Société du spectacle)
[vi] http://noesis.revues.org/723#tocto1n2
[vii] Le mouvement situationniste. Une histoire intellectuelle, p.173
[viii] « Mode de comportement expérimental lié aux conditions de la société urbaine : technique du passage hâtif à travers des ambiances variées. Se dit aussi, plus particulièrement, pour désigner la durée d’un exercice continu de cette expérience. », « Définitions », IS, n°1, juin 1958, p.13.
[ix] Le mouvement situationniste, p.93
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, situationnisme, guy debord |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Michéa: «On ne peut être politiquement orthodoxe»...

Jean-Claude Michéa: «On ne peut être politiquement orthodoxe»...
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Jean-Claude Michéa à la revue anarcho-libertaire Ballast. Il revient, notamment, sur la « nouvelle stratégie Godwin (ou de reductio ad hitlerum) » de la gauche libérale qui vise à faire taire toute pensée critique...
Jean-Claude Michéa, dont l'essentiel de l’œuvre est désormais disponible dans la collection de poche Champs, des éditions Flammarion, a récemment publié chez cet éditeur La gauche et le peuple, un livre de débat avec Jacques Julliard
Vous venez du PCF et possédez, à la base, une formation marxiste. Comment en êtes-vous venu à vous intéresser à ces « frères ennemis », pour reprendre la formule de Guérin, que sont Bakounine, Proudhon, Rocker, Camus, Durruti, Voline, Goodman, Louise Michel, Albert Thierry, Chomsky, Landauer, James C. Scott ou Graeber, que vous ne cessez de citer au fil de vos textes ?
Bien des problèmes rencontrés par le mouvement anticapitaliste moderne tiennent au fait que le terme de « socialisme » recouvre, depuis l’origine, deux choses qu’il serait temps de réapprendre à distinguer. Il s’applique aussi bien, en effet, à la critique radicale du nouvel ordre capitaliste issu des effets croisés de la révolution industrielle et du libéralisme des Lumières qu’aux innombrables descriptions positives de la société sans classe qui était censée succéder à cet ordre, qu’il s’agisse du Voyage en Icarie de Cabet, du nouveau monde sociétaire de Charles Fourier ou de la Critique du programme de Gotha de Karl Marx. Or il s’agit là de deux moments philosophiquement distincts. On peut très bien, par exemple, accepter l’essentiel de la critique marxiste de la dynamique du capital (la loi de la valeur, le fétichisme de la marchandise, la baisse tendancielle du taux de profit, le développement du capital fictif etc.) sans pour autant souscrire – à l’instar d’un Lénine ou d’un Kautsky – à l’idéal d’une société reposant sur le seul principe de la grande industrie « socialisée » et, par conséquent, sur l’appel au développement illimité des « forces productives » et à la gestion centralisée de la vie collective (pour ne rien dire des différentes mythologies de l’« homme nouveau » – ou artificiellement reconstruit – qu’appelle logiquement cette vision « progressiste »). C’est donc l’échec, rétrospectivement inévitable, du modèle « soviétique » (modèle qui supposait de surcroît – comme l’école de la Wertkritik l’a bien montré – l’occultation systématique de certains des aspects les plus radicaux de la critique de Marx) qui m’a graduellement conduit à redécouvrir les textes de l’autre tradition du mouvement socialiste originel, disons celle du socialisme coopératif et antiautoritaire, tradition que l’hégémonie intellectuelle du léninisme avait longtemps contribué à discréditer comme « petite-bourgeoise » et « réactionnaire ».
J’ajoute que dans mon cas personnel, c’est avant tout la lecture - au début des années 1970 - des écrits de Guy Debord et de l’Internationale situationniste (suivie, un peu plus tard, de celle de George Orwell, de Christopher Lasch et d’Ivan Illich) qui m’a progressivement rendue possible cette sortie philosophique du modèle léniniste. Les analyses de l’I.S. permettaient à la fois, en effet, de penser le capitalisme moderne comme un « fait social total » (tel est bien le sens du concept de « société du Spectacle » comme forme accomplie de la logique marchande) et d’en fonder la critique sur ce principe d’autonomie individuelle et collective qui était au cœur du socialisme coopératif et de l’« anarcho-syndicalisme ». Et cela, au moment même où la plupart des intellectuels déçus par le stalinisme et le maoïsme amorçaient leur repli stratégique sur cet individualisme libéral du XVIIIe siècle – la synthèse de l’économie de marché et des « droits de l’homme » – dont le socialisme originel s’était précisément donné pour but de dénoncer l’abstraction constitutive et les implications désocialisantes.
Mais, au fond, on sent que la tradition libertaire est chez vous une profonde assise morale et philosophique bien plus qu’un programme politique (pourtant présent, aujourd’hui encore, dans tous les mouvements anarchistes constitués de par le monde). Quelles sont les limites théoriques et pratiques que vous lui trouvez et qui vous empêchent de vous en revendiquer pleinement ?
C’est une question assurément très complexe. Il est clair, en effet, que la plupart des anarchistes du XIXe siècle se considéraient comme une partie intégrante du mouvement socialiste originel (il suffit de se référer aux débats de la première internationale). Mais alors qu’il n’y aurait guère de sens à parler de « socialisme » avant la révolution industrielle (selon la formule d’un historien des années cinquante, le « pauvre » de Babeuf n’était pas encore le « prolétaire » de Sismondi), il y en a clairement un, en revanche, à poser l’existence d’une sensibilité « anarchiste » dès la plus haute Antiquité (et peut-être même, si l’on suit Pierre Clastres, dans le cas de certaines sociétés dites « primitives »). C’est ce qui avait, par exemple, conduit Jaime Semprun et l’Encyclopédie des nuisances à voir dans l’œuvre de Pao King-yen et de Hsi K’ang - deux penseurs chinois du troisième siècle – un véritable « éloge de l’anarchie » (Éloge de l’anarchie par deux excentriques chinois, paru en 2004).
Cela s’explique avant tout par le fait que la question du pouvoir est aussi ancienne que l’humanité – contrairement aux formes de domination capitalistes qui ne devraient constituer, du moins faut-il l’espérer, qu’une simple parenthèse dans l’histoire de cette dernière. Il s’est toujours trouvé, en effet, des peuples, ou des individus, si farouchement attachés à leur autonomie qu’ils mettaient systématiquement leur point d’honneur à refuser toute forme de servitude, que celle-ci leur soit imposée du dehors ou, ce qui est évidemment encore plus aliénant, qu’elle finisse, comme dans le capitalisme de consommation moderne, par devenir « volontaire ». En ce sens, il existe incontestablement une tradition « anarchiste » (ou « libertaire ») dont les principes débordent largement les conditions spécifiques de la modernité libérale (songeons, par exemple, à l’œuvre de La Boétie ou à celle des cyniques grecs) et dont l’assise principale – je reprends votre formule – est effectivement beaucoup plus « morale et philosophique » (j’ajouterais même « psychologique ») que politique, au sens étroit du terme.
C’est évidemment la persistance historique de cette sensibilité morale et philosophique (l’idée, en somme, que toute acceptation de la servitude est forcément déshonorante pour un être humain digne de ce nom) qui explique le développement, au sein du mouvement socialiste originel - et notamment parmi ces artisans et ces ouvriers de métier que leur savoir-faire protégeait encore d’une dépendance totale envers la logique du salariat - d’un puissant courant libertaire, allergique, par nature, à tout « socialisme d’Etat », à tout « gouvernement des savants » (Bakounine) et à toute discipline de parti calquée, en dernière instance, sur les seules formes hiérarchiques de l’usine bourgeoise. Le problème c’est qu’au fur et à mesure que la dynamique de l’accumulation du capital conduisait inexorablement à remplacer la logique du métier par celle de l’emploi (dans une société fondée sur le primat de la valeur d’usage et du travail concret, une telle logique devra forcément être inversée), le socialisme libertaire allait progressivement voir une grande partie de sa base populaire initiale fondre comme neige au soleil. Avec le risque, devenu patent aujourd’hui, que la critique anarchiste originelle – celle qui se fondait d’abord sur une « assise morale et philosophique » – laisse peu à peu la place à un simple mouvement d’extrême gauche parmi d’autres, ou même, dans les cas les plus extrêmes, à une posture purement œdipienne (c’est ainsi que dans un entretien récent avec Raoul Vaneigem, Mustapha Khayati rappelait qu’une partie des querelles internes de l’I.S. pouvaient s’expliquer par le fait qu’« un certain nombre d’entre nous, autour de Debord, avait un problème à régler, un problème avec le père »).
La multiplication des conflits de pouvoir au sein de nombreuses organisations dites « libertaires » – conflits dont les scissions répétitives et la violence des polémiques ou des excommunications sont un symptôme particulièrement navrant – illustre malheureusement de façon très claire cette lente dégradation idéologique d’une partie du mouvement anarchiste moderne : celle dont les capacités de résistance morale et intellectuelle au maelstrom libéral sont, par définition, les plus faibles – comme c’est très souvent le cas, par exemple, chez les enfants perdus des nouvelles classes moyennes métropolitaines (le microcosme parisien constituant, de ce point de vue, un véritable cas d’école ). De là, effectivement, mes réticences à me situer aujourd’hui par rapport au seul mouvement anarchiste orthodoxe et, surtout, mon insistance continuelle (dans le sillage, entre autres, d’Albert Camus et d’André Prudhommeaux) à défendre cette idée de « décence commune » dont l’oubli, ou le refus de principe, conduit presque toujours un mouvement révolutionnaire à céder, tôt ou tard, à la fascination du pouvoir et à se couper ainsi des classes populaires réellement existantes.
On a du mal à savoir ce que vous pensez précisément de l'État – une problématique pourtant chère aux marxistes comme aux anarchistes...
Je n’ai effectivement pas écrit grand-chose sur cette question (sauf, un peu, dans la Double pensée et dans mon entretien avec le Mauss), tant elle me semble polluée par les querelles terminologiques. Ce que marxistes et anarchistes, en effet, critiquaient sous le nom d’État au XIXe siècle ne correspond plus entièrement à ce qu’on range aujourd’hui sous ce nom (pour ne rien dire de la critique libérale de l’État qui relève d’une autre logique, malheureusement trop facilement acceptée par certains « anarchistes » parisiens tendance Largo Winch). Le mieux est donc de rappeler ici quelques principes de bon sens élémentaire. Ce qui commande une critique socialiste/anarchiste de l’État, c’est avant tout la défense de l’autonomie populaire sous toutes ses formes (cela suppose naturellement une confiance de principe dans la capacité des gens ordinaires à s’autogouverner dans toute une série de domaines essentiels de leur vie).
Autonomie dont le point d’ancrage premier est forcément toujours local (la « commune » pris au sens large du mot – cf. Marx –, c’est-à-dire là où un certain degré de face-à-face, donc de démocratie directe – est en droit encore possible). Cela implique donc :
a) la critique de tout pouvoir bureaucratique séparé et qui entendrait organiser d’en haut la totalité de la vie commune.
b) la critique de la mythologie républicaine de « l’Universel » dont l’État serait le fonctionnaire, du moins si par « universel » on entend l’universel abstrait, pensé comme séparé du particulier et opposé à lui. L’idée en somme que les communautés de base devraient renoncer à tout ce qui les particularise pour pouvoir entrer dans la grande famille uniformisée de la Nation ou du genre humain. En bon hégélien, je pense au contraire que l’universel concret est toujours un résultat – par définition provisoire – et qu’il intègre la particularité à titre de moment essentiel (c’est-à-dire non pas comme « moindre mal », mais comme condition sine qua non de son effectivité réelle). C’est pourquoi – mais on l’a déjà dit mille fois – l’État et l’Individu modernes (autrement dit, l’État « universaliste » et l’individu « séparé de l’homme et de la communauté », Marx) définissent depuis le début une opposition en trompe l’œil (c’est Hobbes qui a génialement démontré, le premier, que l’individu absolu – celui que vante le « rebelle » libertarien – ne pouvait trouver sa vérité que dans l’État absolu [et réciproquement]).
L’individu hors-sol et intégralement déraciné (le « self made man » des libéraux) n’est, en réalité, que le complément logique du Marché uniformisateur et de l’État « citoyen » et abstrait (tout cela était déjà admirablement décrit par Marx dans la question juive). La base de toute société socialiste sera donc, à l’inverse, l’homme comme « animal social » (Marx) et capable, à ce titre, de convivialité (le contraire, en somme de l’individu stirnero-hobbesien). Le dernier livre de David Graeber sur la dette (qui prolonge les travaux du Mauss), contient, du reste, des passages remarquables sur ce point (c’est même la réfutation la plus cruelle qui soit du néo-utilitarisme de Lordon et des bourdivins). C’est pourquoi une critique socialiste/anarchiste de l’État n’a de sens que si elle inclut une critique parallèle de l’individualisme absolu. On ne peut pas dire que ce lien soit toujours bien compris de nos jours !
Pour autant, et à moins de rêver d’une fédération mondiale de communes autarciques dont le mode de vie serait nécessairement paléolithique, il est clair qu’une société socialiste développée et étendue à l’ensemble de la planète suppose une organisation beaucoup plus complexe à la fois pour rendre possible la coopération amicale entre les communautés et les peuples à tous les niveaux et pour donner tout son sens au principe de subsidiarité (on ne délègue au niveau supérieur que les tâches qui ne peuvent pas être réalisé au niveau inférieur [ce qui est exactement le contraire de la façon de procéder liée à l’Europe libérale]). C’est évidemment ici que doit se situer la réflexion – compliquée – sur le statut, le rôle et les limites des services publics, de la monnaie, du crédit public, de la planification, de l’enseignement, des biens communs etc.
Tout comme Chomsky, je ne suis donc pas trop gêné – surtout en ces temps libéraux – par l’emploi du mot « étatique » s’il ne s’agit que de désigner par là ces structures de coordination de l’action commune (avec, bien entendu, les effets d’autorité et de discipline qu’elles incluent) qu’une société complexe appelle nécessairement (que ce soit au niveau régional, national ou mondial). L’important devient alors de s’assurer du plus grand contrôle démocratique possible de ces structures par les collectivités de base (principe de rotation des fonctions, tirages au sort, interdiction d’exercer plus d’un mandat, contrôle des experts, référendums d’initiatives populaires, reddition des comptes, etc., etc.). Dans l’idéal, la contradiction dialectique entre la base et le « sommet » (et le mouvement perpétuel de va-et-vient entre les deux) pourrait alors cesser d’être « antagoniste ». Mais, vous le voyez, je n’ai improvisé là que quelques banalités de base.
Comme vous le savez, le terme « libertaire » a été inventé par Déjacque en opposition au terme « libéral », lors d’une querelle avec Proudhon. Vous n’avez pas de mots assez durs contre les « libéraux-libertaires » chers, si l’on peut dire, à Clouscard. Comment expliquez-vous cette alliance a priori incongrue ?
On aura une idée supplémentaire de toutes ces difficultés sémantiques si l’on ajoute que la traduction américaine du mot « libertaire » (le journal de Joseph Déjacque était certes publié à New-York, mais uniquement en français) est libertarian. Or ce dernier terme (qu’on a curieusement retraduit par « libertarien ») en est peu à peu venu à désigner, aux États-Unis, la forme la plus radicale du libéralisme économique, politique et culturel – celle qu’incarnent notamment Murray Rothbard et David Friedman – au point d’être parfois considéré aujourd’hui comme un simple équivalent de celui d’« anarcho-capitaliste » ! Pour dissiper ce nuage d’encre, il est donc temps d’en revenir aux fondements mêmes de la critique socialiste originelle de l’anthropologie libérale. On sait, en effet, que pour les libéraux – il suffit de lire John Rawls – l’homme doit toujours être considéré comme un être « indépendant par nature » et qui ne peut donc chercher à nouer des liens avec ses semblables (ne serait-ce – écrit ironiquement David Graeber – que pour pouvoir « échanger des peaux de castor ») que dans la stricte mesure où ce type d’engagement contractuel lui paraît « juste », c’est-à-dire, en dernière instance, conforme à son « intérêt bien compris ».
Dans cette perspective à la Robinson Crusoé (Marx voyait significativement dans le cash nexus des économistes libéraux – terme qu’il avait emprunté au « réactionnaire » Carlyle – une pure et simple « robinsonnade »), il va de soi qu’aucune norme morale, philosophique ou religieuse ne saurait venir limiter du dehors le droit « naturel » de tout individu à vivre en fonction de son seul intérêt égoïste (y compris dans sa vie familiale et affective), si ce n’est, bien entendu, la liberté équivalente dont sont supposés disposer symétriquement les autres membres d’une société libérale (les interventions de l'État « minimal » n’ayant alors plus d’autre prétexte officiel que la nécessité permanente de protéger ces libertés individuelles, que ce soit sur le plan politique et culturel – la défense des « droits de l’homme », y compris en Irak, au Mali ou en Afghanistan – ou économique – la défense de la libre concurrence et de la liberté intégrale d’entreprendre, de vendre et d’acheter). Or si la plupart des fondateurs du socialisme partageaient effectivement l’idéal émancipateur des Lumières et leur défense de l’esprit critique (ils étaient évidemment tout aussi hostiles que les libéraux aux sociétés oppressives et inégalitaires d’ancien régime), ils n’en dénonçaient pas moins l’anthropologie individualiste et abstraite sur laquelle cet idéal était structurellement fondé. À leurs yeux il allait de soi, en effet, que l’homme était d’abord un être social, dont la prétendue « indépendance naturelle » (déjà contredite par la moindre observation ethnologique) impliquait – comme Marx l’écrivait en 1857 – une « chose aussi absurde que le serait le développement du langage sans la présence d’individus vivant et parlant ensemble ».
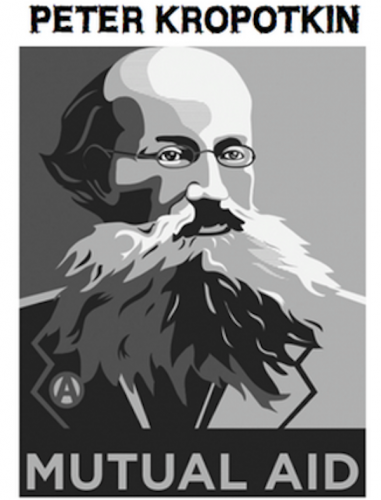
De là, naturellement, le rôle philosophique absolument central que ces premiers socialistes accordaient aux concepts d’entraide et de « communauté » (on a presque fini par oublier que le terme de « socialisme » s’opposait, à l’origine, à celui d’« individualisme ») et leur critique corrélative du dogme libéral selon lequel l’émancipation intégrale des individus ne pourrait trouver ses ultimes conditions que dans la transformation correspondante de la société – pour reprendre une formule de l’école saint-simonienne – en une simple « agrégation d’individus sans liens, sans relations, et n’ayant pour mobile que l’impulsion de l’égoïsme » (la coexistence « pacifique » des individus ainsi atomisés devant alors être assurée par les seuls mécanismes anonymes et impersonnels du Droit et du Marché, eux-mêmes placés sous l’égide métaphysique du Progrès continuel de la Science et des « nouvelles technologies »). Il suffit, dès lors, de réactiver ce clivage originel (ce qui suppose, vous vous en doutez bien, une rupture radicale avec tous les postulats idéologiques de la gauche et de l’extrême gauche contemporaines) pour redécouvrir aussitôt ce qui sépare fondamentalement un authentique libertaire – celui dont la volonté d’émancipation personnelle, à l’image de celle d’un Kropotkine, d’un Gustav Landauer, ou d’un Nestor Makhno, s’inscrit nécessairement dans un horizon collectif et prend toujours appui sur les « liens qui libèrent » (comme, par exemple, l’amour, l’amitié ou l’esprit d’entraide) – d’un « libertaire » libéral (ou « anarcho-capitaliste ») aux yeux duquel un tel travail d’émancipation personnelle ne saurait être l'œuvre que d’un sujet « séparé de l’homme et de la communauté » (Marx), c’est-à-dire, en définitive, essentiellement narcissique (Lasch) et replié sur ses caprices individuels et son « intérêt bien compris » (quand ce n’est pas sur sa seule volonté de puissance, comme c’était par exemple le cas chez le Marquis de Sade).
C’est d’ailleurs cette triste perversion libérale de l’esprit « libertaire » que Proudhon avait su décrire, dès 1858, comme le règne de « l’absolutisme individuel multiplié par le nombre de coquilles d’huîtres qui l’expriment ». Description, hélas, rétrospectivement bien prophétique et qui explique, pour une grande part, le désastreux naufrage intellectuel de la gauche occidentale moderne et, notamment, son incapacité croissante à admettre que la liberté d’expression c’est d’abord et toujours, selon la formule de Rosa Luxemburg, la liberté de celui qui pense autrement.
L'an passé, Le Monde libertaire vous a consacré quelques pages. S’il louait un certain nombre de vos analyses, il vous reprochait votre usage du terme « matriarcat », votre conception de l’internationalisme et de l'immigration, et, surtout, ce qu’il percevait comme une complaisance à l’endroit des penseurs et des formations nationalistes ou néofascistes – au prétexte qu’ils seraient antilibéraux et que cela constituerait votre clivage essentiel, quitte à fouler aux pieds tout ce qui, dans ces traditions, s’oppose brutalement à l’émancipation de chacune des composantes du corps social. Comprenez-vous que vous puissiez créer ce « malaise », pour reprendre leur terme, au sein de tendances (socialistes, libertaires, communistes, révolutionnaires, etc.) dont vous vous revendiquez pourtant ?
 Passons d’abord sur l’idée grotesque – et visiblement inspirée par le courant féministe dit « matérialiste » – selon laquelle l’accumulation mondialisée du capital (dont David Harvey rappelait encore récemment qu’elle constituait la dynamique de base à partir de laquelle notre vie était quotidiennement façonnée) trouverait sa condition anthropologique première dans le développement du « patriarcat » – lui-même allègrement confondu avec cette domination masculine qui peut très bien prospérer, à l’occasion, à l’abri du matriarcat psychologique. Une telle idée incite évidemment à oublier – comme le soulignait déjà Marx – que le processus d’atomisation marchande de la vie collective conduit, au contraire, « à fouler aux pieds toutes les relations patriarcales » et, d’une manière générale, à noyer toutes les relations humaines « dans les eaux glacées du calcul égoïste ».
Passons d’abord sur l’idée grotesque – et visiblement inspirée par le courant féministe dit « matérialiste » – selon laquelle l’accumulation mondialisée du capital (dont David Harvey rappelait encore récemment qu’elle constituait la dynamique de base à partir de laquelle notre vie était quotidiennement façonnée) trouverait sa condition anthropologique première dans le développement du « patriarcat » – lui-même allègrement confondu avec cette domination masculine qui peut très bien prospérer, à l’occasion, à l’abri du matriarcat psychologique. Une telle idée incite évidemment à oublier – comme le soulignait déjà Marx – que le processus d’atomisation marchande de la vie collective conduit, au contraire, « à fouler aux pieds toutes les relations patriarcales » et, d’une manière générale, à noyer toutes les relations humaines « dans les eaux glacées du calcul égoïste ».
Passons également sur cette assimilation pour le moins hâtive (et que l’extrême gauche post-mitterrandienne ne songe même plus à interroger) de l’internationalisme du mouvement ouvrier originel à cette nouvelle idéologie « mobilitaire » (dont la libre circulation mondiale de la force de travail et le tourisme de masse ne représentent, du reste, qu’un aspect secondaire) qui constitue désormais – comme le rappelait Kristin Ross – « le premier impératif catégorique de l’ordre économique » libéral. Mes critiques semblent avoir oublié, là encore, que l’une des raisons d’être premières de l’association internationale des travailleurs, au XIXe siècle, était précisément la nécessité de coordonner le combat des différentes classes ouvrières nationales contre ce recours massif à la main d’œuvre étrangère qui apparaissait déjà, à l’époque, comme l’une des armes économiques les plus efficaces de la grande bourgeoisie industrielle. Comme le soulignaient, par exemple, les représentants du mouvement ouvrier anglais (dans un célèbre appel de novembre 1863 adressé au prolétariat français), « la fraternité des peuples est extrêmement nécessaire dans l’intérêt des ouvriers. Car chaque fois que nous essayons d’améliorer notre condition sociale au moyen de la réduction de la journée de travail ou de l’augmentation des salaires, on nous menace toujours de faire venir des Français, des Allemands, des Belges qui travaillent à meilleur compte ».
Naturellement, les syndicalistes anglais – étrangers, par principe, à toute xénophobie – s’empressaient aussitôt d’ajouter que la « faute n’en est certes pas aux frères du continent, mais exclusivement à l’absence de liaison systématique entre les classes industrielles des différents pays. Nous espérons que de tels rapports s’établiront bientôt [de fait, l’association internationale des travailleurs sera fondée l’année suivante] et auront pour résultat d’élever les gages trop bas au niveau de ceux qui sont mieux partagés, d’empêcher les maîtres de nous mettre dans une concurrence qui nous rabaisse à l’état le plus déplorable qui convient à leur misérable avarice » (notons qu’on trouvait déjà une analyse semblable des effets négatifs de la politique libérale d’immigration dans l’ouvrage d’Engels sur la situation de la classe laborieuse en Angleterre). Comme on le voit, la conception de la solidarité internationale défendue par les fondateurs du mouvement ouvrier était donc un peu plus complexe (et surtout impossible à confondre avec ce culte de la « mobilité » et de la « flexibilité » qui est au cœur de l’idéologie capitaliste moderne) que celle du brave Olivier Besancenot ou de n’importe quel autre représentant de cette nouvelle extrême gauche qui apparaît désormais – pour reprendre une expression de Marx – « au-dessous de toute critique ».
Quant à l’idée selon laquelle ma critique du capitalisme entretiendrait un rapport ambigu, certains disent même structurel, avec le « néofascisme » – idée notamment propagée par Philippe Corcuff, Luc Boltanski et Jean-Loup Amselle –, elle me semble pour le moins difficile à concilier avec cet autre reproche (que m’adressent paradoxalement les mêmes auteurs) selon lequel j’accorderais trop d’importance à cette notion de common decency qui constituait aux yeux d’Orwell le seul fondement moral possible de tout antifascisme véritable. Il est vrai que les incohérences inhérentes à ce type de croisade (dont le signal de départ avait été donné, en 2002, par la très libérale Fondation Saint-Simon, avec la publication du pamphlet de Daniel Lindenberg sur les « nouveaux réactionnaires ») perdent une grande partie de leur mystère une fois que l’on a compris que l’objectif premier des nouveaux évangélistes libéraux était de rendre progressivement impossible toute analyse sérieuse (ou même tout souvenir concret) de l’histoire véritable des « années trente » et du fascisme réellement existant.
Et cela, bien sûr, afin de faire place nette – ce qui n’offre plus aucune difficulté majeure dans le monde de Youtube et des « réseaux sociaux » – à cet « antifascisme » abstrait et purement instrumental sous lequel, depuis 1984, la gauche moderne ne cesse de dissimuler sa conversion définitive au libéralisme. Bernard-Henri Lévy l’avait d’ailleurs reconnu lui-même lorsqu’il écrivait, à l’époque, que « le seul débat de notre temps [autrement dit, le seul qui puisse être encore médiatiquement autorisé] doit être celui du fascisme et l’antifascisme ». Or on ne peut rien comprendre à l’écho que le fascisme a pu rencontrer, tout au long du XXe siècle, dans de vastes secteurs des classes populaires, et des classes moyennes, si l’on ne commence pas – à la suite d’Orwell – par prendre acte du fait qu’il constituait d’abord, du moins dans sa rhétorique officielle, une forme pervertie, dégradée, voire parodique du projet socialiste originel (« tout ce qu’il y a de bon dans le fascisme – n’hésitait pas à écrire Orwell – est aussi implicitement contenu dans le socialisme »). Ce qui veut tout simplement dire que cette idéologie ontologiquement criminelle (analyse qui vaudrait également pour les autres formes de totalitarisme, y compris celles qui s’abritent aujourd’hui sous l’étendard de la religion) trouvait, au même titre que le socialisme, son point de départ moral et psychologique privilégié dans le désespoir et l’exaspération croissante d’une partie des classes populaires devant cette progressive « dissolution de tous les liens sociaux » (Debord) que le principe de neutralité axiologique libéral engendre inexorablement (processus qu’Engels décrivait, pour sa part, comme la « désagrégation de l’humanité en monades dont chacune à un principe de vie particulier et une fin particulière »).
Naturellement, la fétichisation du concept d’unité nationale (qui ne peut qu’entretenir l’illusion d’une collaboration « équitable » entre le travail et le capital) et sa nostalgie romantique des anciennes aristocraties guerrières (avec son culte du paganisme, de la hiérarchie et de la force brutale) interdisaient par définition au fascisme de désigner de façon cohérente les causes réelles du désarroi ressenti par les classes populaires, tout comme la véritable logique de l’exploitation à laquelle elles se trouvaient quotidiennement soumises. De là, entre autres, cet « antisémitisme structurel » (Robert Kurz) qui « ne fait que renforcer le préjugé populaire du "capital accapareur" rendu responsable de tous les maux de la société et qui, depuis deux cents ans, est associé aux juifs » (Robert Kurz ne manquait d’ailleurs pas de souligner, après Moishe Postone, que cet antisémitisme continuait d’irriguer, « de façon consciente ou inconsciente » – et, le plus souvent, sous le masque d’une prétendue solidarité avec le peuple palestinien – une grande partie des discours de l’extrême gauche contemporaine). Il n’en reste pas moins que l’idéologie fasciste – comme c’était d’ailleurs déjà le cas, au XIXe siècle, de celle d’une partie de la droite monarchiste et catholique (on se souvient, par exemple, du tollé provoqué sur les bancs de la gauche par Paul Lafargue – en décembre 1891 – lorsqu’il avait osé saluer dans une intervention du député catholique Albert de Mun « l’un des meilleurs discours socialistes qui aient été prononcés ici ») – incorpore, tout en les dénaturant, un certain nombre d’éléments qui appartiennent de plein droit à la tradition socialiste originelle.
Tel est bien le cas, entre autres, de la critique de l’atomisation marchande du monde, de l’idée que l’égalité essentiellement abstraite des « citoyens » masque toujours le pouvoir réel de minorités qui contrôlent la richesse et l’information, ou encore de la thèse selon laquelle aucun monde véritablement commun ne saurait s’édifier sur l’exigence libérale de « neutralité axiologique » (d’ailleurs généralement confondue, de nos jours, avec le principe de « laïcité ») ni, par conséquent, sur ce relativisme moral et culturel « postmoderne » qui en est l’expression philosophique achevée (à l’inverse, on aurait effectivement le plus grand mal à trouver, dans toute l’œuvre d’Eric Fassin, une seule page qui puisse réellement inciter les gens ordinaires à remettre en question la dynamique aveugle du capital ou l’imaginaire de la croissance et de la consommation). C’est naturellement l’existence de ces points d’intersection entre la critique fasciste de la modernité libérale (ou, d’une manière générale, sa critique « réactionnaire ») et celle qui était originellement portée par le mouvement ouvrier socialiste, qui allait donc permettre aux think tanks libéraux (Fondation Saint-Simon, Institut Montaigne, Terra Nova, etc.) de mettre très vite au point – au lendemain de la chute de l’empire soviétique – cette nouvelle stratégie Godwin (ou de reductio ad hitlerum) qui en est progressivement venue à prendre la place de l’ancienne rhétorique maccarthyste. Stratégie particulièrement économe en matière grise – d’où le succès qu’elle rencontre chez beaucoup d’intellectuels de gauche – puisqu’il suffira désormais aux innombrables spin doctors du libéralisme de dénoncer rituellement comme « fasciste » (ou, à tout le moins, de nature à engendrer un regrettable « brouillage idéologique ») toute cette partie de l’héritage socialiste dont une droite antilibérale se montre toujours capable, par définition, de revendiquer certains aspects – moyennant, bien sûr, les inévitables ajustements que son logiciel inégalitaire et nationaliste lui impose par ailleurs.
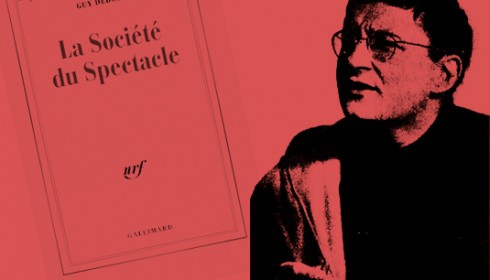
À tel point que les représentants les plus intelligents de cette droite antilibérale ont eux-mêmes fini par comprendre, en bons lecteurs de Gramsci, tout le bénéfice qu’il leur était à présent possible de tirer de leurs hommages sans cesse plus appuyés – et sans doute parfois sincères – à l’œuvre de Marx, de Debord ou de Castoriadis. Un tel type de récupération est, du reste, d’autant plus inévitable que le disque dur métaphysique de la gauche moderne – à présent « prisonnière de l’ontologie capitaliste » (Kurz) – ne lui permet plus, désormais, de regarder en face la moindre réalité sociologique concrète (comme dans le célèbre conte d’Andersen sur les Habits neufs de l’Empereur) et, par conséquent, de percevoir dans la détresse et l’exaspération grandissantes des classes populaires (qu’elle interprète nécessairement comme un signe de leur incapacité frileuse à s’adapter « aux exigences du monde moderne ») tout ce qui relève, au contraire, d’une protestation légitime (je renvoie ici au remarquable essai de Stephen Marglin sur The Dismal science) contre le démantèlement continuel de leurs identités et de leurs conditions matérielles de vie par la dynamique transgressive du marché mondialisé et de sa culture « postmoderne » (« cette agitation et cette insécurité perpétuelles » – écrivait déjà Marx – « qui distinguent l’époque bourgeoise de toutes les précédentes »).
De là, bien entendu, l’étonnante facilité avec laquelle il est devenu aujourd’hui possible de discréditer a priori toutes ces mises en question de la logique marchande et de la société du Spectacle qui, il y a quelques décennies encore, étaient clairement le signe d’une pensée radicale – qu’il s’agisse de l’École de Francfort, de l’Internationale situationniste ou des écrits d’Ivan Illich. Si, par exemple, le Front National – tournant le dos à la rhétorique reaganienne de son fondateur – en vient, de nos jours, à soutenir l’idée que les politiques libérales mises en œuvre par la Commission européenne, et le déchaînement correspondant de la spéculation financière internationale, sont l’une des causes majeures du chômage de masse (tout en prenant évidemment bien soin de dissocier ce processus de financiarisation « néolibéral » des contradictions systémiques que la mise en valeur du capital productif rencontre depuis le début des années soixante-dix), on devra donc désormais y voir la preuve irréfutable que toute critique de l’euro et des politiques menées depuis trente ans par l’oligarchie bruxelloise ne peut être que le fait d’un esprit « populiste », « europhobe » ou même « rouge-brun » (et peu importe, au passage, que le terme d’« europhobie » ait lui-même été forgé par la propagande hitlérienne, au cours de la Seconde Guerre mondiale, dans le but de stigmatiser la résistance héroïque des peuples anglais et serbe à l’avènement d’une Europe nouvelle !).
En ce sens, la nouvelle stratégie Godwin apparaît bien comme l’héritière directe de la « Nouvelle Philosophie » de la fin des années soixante-dix. À ceci près, que là où un Glucksmann ou un BHL se contentaient d’affirmer que toute contestation radicale du capitalisme conduisait nécessairement au Goulag, la grande innovation théorique des Godwiniens aura été de remplacer la Kolyma et les îles Solovski par Auschwitz, Sobibor et Treblinka. De ce point de vue, Jean-Loup Amselle – avec son récent pamphlet sur les « nouveaux Rouges-Bruns » et le « racisme qui vient » – est incontestablement celui qui a su conférer à ces nouveaux « éléments de langage » libéraux une sorte de perfection platonicienne. Au terme d’une analyse fondée sur le postulat selon lequel « la culture n’existe pas, il n’y a que des individus » (hommage à peine voilé à la célèbre formule de Margaret Thatcher), il réussit, en effet, le tour de force de dénoncer dans le projet d’une « organisation sociale et économique reposant sur les principes d’échange non marchand, de don, de réciprocité et de redistribution » – autrement dit dans le projet socialiste traditionnel – l’une des incarnations les plus insidieuses, du fait de son supposé « primitivisme », de cette « posture rouge-brune qui fait le lit du Front national et de Riposte laïque » (il est vrai qu’aux yeux de cet étrange anthropologue de gauche, les partisans de la décroissance, les écologistes et les « anarchistes de tout poil » avaient déjà, depuis longtemps, largement contribué à cette lente fascisation des esprits). Le fait qu’une pensée aussi délirante ait pu rencontrer un écho favorable auprès de tant d’« antifascistes » auto-proclamés (pour ne rien dire des éloges dithyrambiques d’un Laurent Joffrin) nous en apprend donc énormément sur l’ampleur du confusionnisme qui règne aujourd’hui dans les rangs de la gauche et de l’extrême gauche post-mitterrandiennes – mouvement anarchiste compris.
Et, comme par hasard, c’est précisément dans un tel contexte idéologique – contexte dans lequel tous les dés ont ainsi été pipés d’avance – que tous ceux qui tiennent la critique socialiste de Marx, d’Orwell ou de Guy Debord pour plus actuelle que jamais et contestent donc encore, avec un minimum de cohérence, le « monde unifié du capital » (Robert Kurz), se retrouvent désormais sommés par les plus enragés des « moutons de l’intelligentsia » (Debord) de s’expliquer en permanence sur la « complaisance » que cette critique entretiendrait nécessairement avec les idéologies les plus noires du XXe siècle. Avec à la clé – j’imagine – l’espoir des évangélistes libéraux d’amener ainsi tous ces mauvais esprits à mettre, à la longue, un peu d’eau dans leur vin, de peur de passer pour « passéistes » ou « réactionnaires ». Tout comme, sous le précédent règne du maccarthysme, c’était, à l’opposé, la peur d’être assimilés à des « agents de Moscou » qui était censée paralyser les esprits les plus critiques. Il se trouve hélas (et j’en suis sincèrement désolé pour tous ces braves policiers de la pensée qui ne font, après tout, que le travail pour lequel l’Université les paye) qu’il y a déjà bien longtemps que j’ai perdu l’habitude de me découvrir – dans la crainte et le tremblement – devant chaque nouvelle procession du clergé « progressiste » (ou, si l’on préfère, devant chaque nouvelle étape du développement capitaliste). Mais n’est-ce pas George Orwell lui-même qui nous rappelait qu’« il faut penser sans peur » et que « si l’on pense sans peur, on ne peut être politiquement orthodoxe » ?
Jean-Claude Michéa (Ballast, 9 février 2015)
00:05 Publié dans Actualité, Entretiens, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, philosophie, sociologie, jean claude michéa, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


