“Le Complexe de Narcisse”, recension de l’ouvrage de C. Lasch
par Guillaume FAYE
Ex: http://vouloir.hautetfort.com/
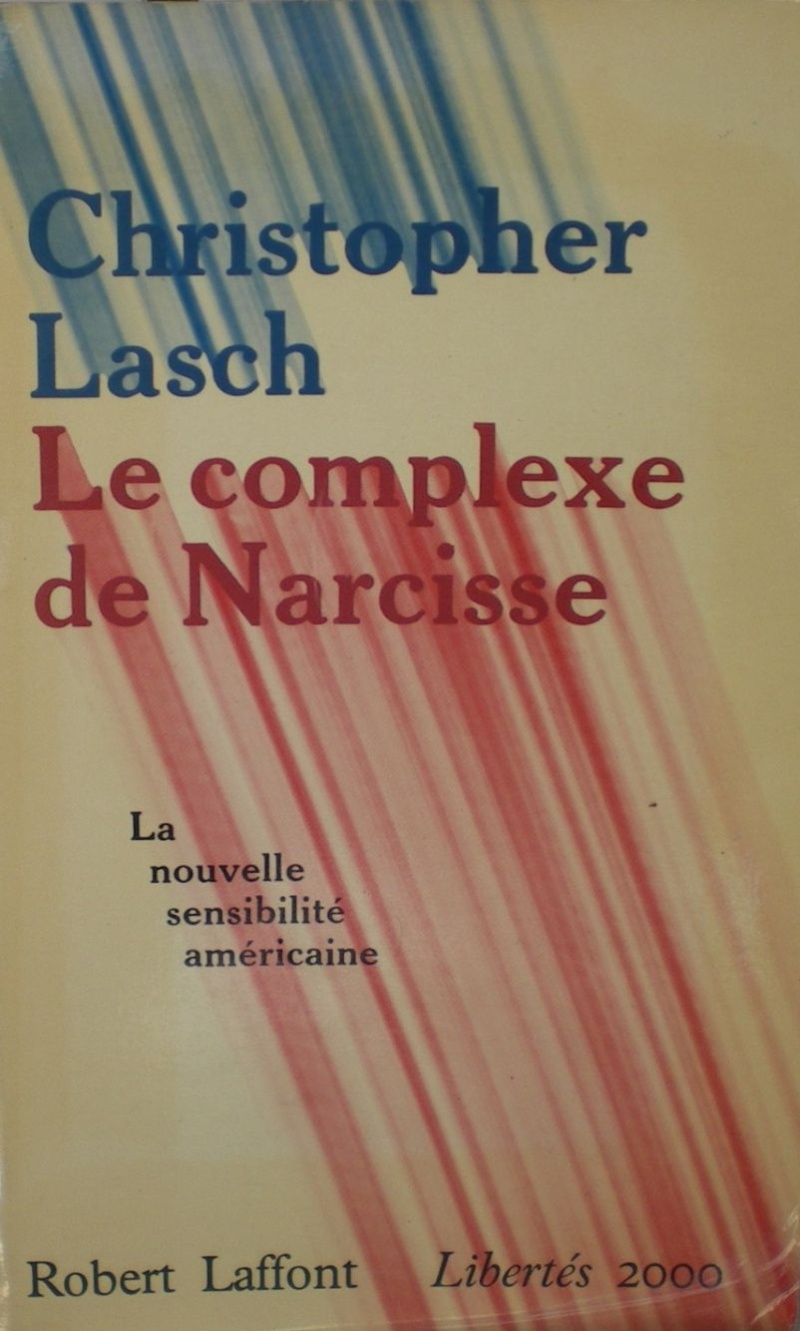 « Partout, la société bourgeoise semble avoir épuisé sa réserve d’idées créatrices (…) La crise politique du capitalisme reflète une crise générale de la culture occidentale. Le libéralisme (…) a perdu la capacité d’expliquer les événements dans un monde où règnent l’État-Providence et les sociétés multinationales et rien ne l’a remplacé. En faillite sur le plan politique, le libéralisme l’est tout autant sur le plan intellectuel ».
« Partout, la société bourgeoise semble avoir épuisé sa réserve d’idées créatrices (…) La crise politique du capitalisme reflète une crise générale de la culture occidentale. Le libéralisme (…) a perdu la capacité d’expliquer les événements dans un monde où règnent l’État-Providence et les sociétés multinationales et rien ne l’a remplacé. En faillite sur le plan politique, le libéralisme l’est tout autant sur le plan intellectuel ».
Ce diagnostic porté par Christopher Lasch, l’un des observateurs les plus lucides de l’actuelle société américaine, donne le ton du réquisitoire qu’il a fait paraitre contre la mentalité et l’idéologie décadente des sociétés bourgeoises, sous le titre de The Culture of Narcissism (en traduction française, Le complexe de Narcisse). Dans cet essai, Lasch s’efforce de donner une description aussi précise que possible d’une « nouvelle sensibilité américaine » que l’on retrouve aujourd’hui, plus ou moins atténuée ou déformée, dans la plupart des pays industriels. Conclusion générale de son analyse l’individualisme traditionnel propre à l’idéologie libérale ne se traduit plus aujourd’hui, contrairement à ce qui se passait encore dans les années 60, par une politisation de l’opinion ou une radicalisation de la recherche du bien-être économique, mais par un repli radical sur le “moi” individuel. Ce repli correspond à la poursuite effrénée du “bonheur intérieur”. L’homme contemporain part à la recherche de lui-même, sans illusions politiques, mû par une angoisse qu’il tente d’apaiser par un recours systématique à toutes les formes de sécurité. C’est le triomphe de Narcisse.
Passant en revue l’évolution de la littérature, du système d’éducation, des médias de masse et du discours politique, C. Lasch dresse ainsi la “géographie” d’un narcissisme contemporain dans lequel il n’est pas éloigné de voir, à juste titre, le stade ultime du déclin d’une civilisation.
L’« invasion de la société par le moi » produit, dit-il, une course sans limites vers la « sécurité physique et psychique ». Équivalant à une existence menée dans un perpétuel présent, elle interdit « tout sens de la continuité historique ». Les modes “psy”, les obsessions sexuelles étalées dans le discours public, la frénésie des “expérimentations personnelles”, le désintérêt pour le travail, “l’égotisme” d’une famille nucléaire essentiellement consommatrice, la “théâtralisation de l’existence”, le mimétisme vis-à-vis des “vedettes” de la scène ou de la chanson, sont autant de traits caractéristiques du narcissisme.
« Cette concentration sur soi définit (…) le mouvement de la nouvelle conscience », note Lasch, qui ajoute : « La recherche de son propre accomplissement a remplacé la conquête de la nature et de nouvelles frontières ». Sur le plan politique, un tel comportement s’observe à gauche aussi bien qu’à droite. La gauche était d’ailleurs, depuis longtemps, acquise à une idéologie de refus de la vie-comme-combat. La droite, elle, a peu à peu été gagnée aux valeurs de la pensée rationnelle, calculatrice et bourgeoise. La fuite devant la lutte aboutit ainsi à un psychisme « misérabiliste », que Lasch décrit en ces termes : l’homme « est hanté, non par la culpabilité, mais par l’anxiété (…) Il se sent en compétition avec tout le monde pour l’obtention des faveurs que dispense l’État paternaliste. Sur le plan de la sexualité (…) son émancipation des anciens tabous ne lui apporte pas la paix (…) Il répudie les idéologies fondées sur la rivalité, en honneur à un stade antérieur du développement capitaliste. Il exige une gratification immédiate et vit dans un état de désir inquiet et perpétuellement inassouvi ».
L’origine de ce « complexe de Narcisse », état psychologique ultime de la mentalité individualiste, est à rechercher dans la décomposition d’une société qui, fondée sur l’égalité et l’autonomie individuelle, s’est peu à peu transformée en jungle sociale. « La culture de l’individualisme compétitif est une manière de vivre qui est en train de mourir — note à ce propos C. Lasch. Celle-ci, dans sa décadence, a poussé la logique de l’individualisme jusqu’à l’extrême de la guerre de tous contre tous, et la poursuite du bonheur jusqu’à l’impasse d’une obsession narcissique de l’individu pour lui-même. La stratégie de la survie narcissique (…) donne naissance à une « révolution culturelle qui reproduit les pires traits de cette même civilisation croulante qu’elle prétend critiquer (…) La personnalité autoritaire n’est plus le prototype de l’homme économique. Ce dernier a cédé la place à l’homme psychologique de notre temps — dernier avatar de l’individualisme bourgeois ».
Soumis aux “experts” et dominé par les psychiatres, l’homme contemporain s’est donc anxieusement lancé à la poursuite de son “moi”. Démobilisé dans ses instances profondes, imperméable à toute visée politique de longue durée, inapte à la compréhension d’un destin collectif, indifférent à l’histoire, il planifie, comme un comptable, l’obtention de son bonheur intime. Ce dernier, jusqu’à la fin des années 60, se confondait avec la réussite matérielle et le bien-être du confort domestique. C’était l’époque de la deuxième “révolution industrielle”, animée par une idéologie de la compétition individuelle et caractérisée par l’accession massive des classes moyennes au standing de la bourgeoisie aisée. Mais aujourd’hui, l’idée de bonheur a pris une autre résonance. Elle a dépassé sa connotation purement matérielle pour se doter d’une portée “psychologique”. Il s’agit maintenant de sécuriser son “moi”, de “partir à la recherche de soi-même”, sur la base d’une introspection presque pathologique. À la quête du bonheur économique, dont les limites apparaissent désormais clairement, s’ajoute la recherche du “bonheur intérieur”. L’idéal mercantile du bien-être petit-bourgeois conserve sa vigueur, mais il ne suffit plus à étancher la soif de l’homme contemporain. Celui-ci veut accéder à la “félicité psychique”. Il se tourne vers une série d’utopies nouvelles. L’État-Providence est là pour lui promettre la “bonne vie” sans le stress, le maximum de droits avec le minimum de devoirs, le confort à peu de frais, la prospérité matérielle dans la quiétude du “moi”.
Toutefois, les gourous du mieux-vivre, s’ils ont rejeté les valeurs de compétition et de risque, n’ont pas abandonné pour autant les aspirations matérialistes de la bourgeoisie traditionnelle. Narcisse, obsédé par son désir d’apaiser ses “tensions” psychologiques, de réaliser ses “pulsions” libidinales, n’entame pas une critique sur le fond de la société de consommation. Il veut l’abondance, mais sans avoir à se battre pour l’obtenir ; la richesse, mais sans effort, et, en plus, la plénitude sexuelle et l’apaisement de ses conflits quotidiens.
L’impossibilité évidente de satisfaire en même temps ces exigences contradictoires donne à la mentalité narcissique une conscience à la fois infantile et douloureuse. Plus l’individu se replie sur lui-même, plus il se découvre des “problèmes” nouveaux et insolubles. La recherche du bonheur débouche sur une angoisse qui n’est plus regardée comme un défi, mais comme une menace. La nouvelle bourgeoisie narcissique est une classe fragile, inquiète, hypersensible, superficielle, instable.
Une autre cause du narcissisme contemporain, qui « recroqueville le moi vers un état primaire et passif dans lequel le monde n’est ni crée ni formé », réside dans la permissivité sociale et la bureaucratisation. La permissivité détruit les normes de conduite collectives. Loin de libérer, elle isole. Elle fait exploser le sens. Privé du cadre éducatif et des institutions hérités, l’individu ne sait plus comment se comporter. Il s’en remet alors ans injonctions éphémères que lui distillent les médias, la publicité, les “manuels” d’éducation sexuelle, etc. Les conseils (intéressés) des magazines ou de la télévision se substituent à l’expérience intériorisée de la tradition familiale ou communautaire. Les règles de vie ne sont plus trouvées que par fragments ou par accident, dans le champ anonyme et frustrant du “discours public”. Le “surmoi” social s’est effondré. Les normes de comportement, auxquelles nulle société n’échappent, ne proviennent plus que des structures dominantes, économiques et techniques, de la société, Privé d’autodiscipline, puisqu’il n’intériorise pas les règles sociales, l’individu se heurte brutalement aux interdits socio-économiques qu’il découvre en arrivant à l’âge adulte : règles bureaucratiques, pratiques bancaires, impératifs commerciaux, etc. Élevé dans le mythe d’une “liberté” formelle, il supporte de moins en moins bien ces contraintes et réagit en se renfermant d’autant plus sur lui-même.
La bureaucratisation des activités sociales accentue la tendance. Déchargeant les hommes des soucis de la lutte quotidienne, elle donne aux hommes l’illusion de l’irresponsabilité. L’individu se découvre étranger à ceux qui l’entourent, à ceux qui partagent son existence quotidienne et à qui, désormais, plus rien ne le lie. La mentalité d’assistance, le recours perpétuel à des “droits” que rien ne vient plus fonder, la sécurisation de la vie privée par la bureaucratisation de l’État-Providence décharge l’individu de son rôle actif. Que lui reste-t-il à faire alors, puisque rien ne l’attache plus aux autres, sinon à se passionner pour lui-même ?
Le déclin des idéaux révolutionnaires et du marxisme orthodoxe a fait perdre l’espoir d’une transformation radicale de la société. L‘idéologie égalitaire a reporté ses visées dans le domaine des contre-pouvoirs insignifiants et des micro-aménagements quotidiens. L’égalitarisme ne laisse plus entrevoir de “paradis social”, mais seulement des “paradis individuels”. L’utopie du bonheur s’affaiblit sur le plan collectif et se rétracte au niveau intime et personnel. Nous en sommes à l’ère, prévue (et voulue) par l’École de Francfort, des “révolutions minuscules”.
La “fin de l’histoire”, elle aussi, est recherchée sur le plan individuel après l’avoir usé sur le plan social et collectif, Même la société “bonheurisée” et privée de véritable histoire politique que nous connaissons actuellement apparaît comme trop astreignante. Elle ne constitue pas encore un refuge suffisamment sécurisant contre le stress. Elle n’endort pas encore assez. L’individu, en se repliant sur sa sphère psychique, prend mentalement sa retraite dès l’âge de 20 ans. La société n’entend plus sortir directement de l’histoire ; c’est l’individu qui se retire de la société.
Oublieuse de toute notion de continuité historique, de toute perception dense des liens sociaux, la société narcissique incite à vivre pour soi-même et à n’exister que dans l’instant. Tel est d’ailleurs le sens de la plupart des messages publicitaires. Tel est aussi le “discours” distillé à longueur de temps par des magazines, de plus en plus nombreux, qui se spécialisent dans la résolution “catégorielle” des problèmes individuels (parents, enfants, jeunes femmes, amateurs de vidéo, etc.) et l’étude “micro-dimensionnelle” de la vie quotidienne. Dans cette recherche, nulle place n’est laissée à l’accomplissement personnel dans le sens d’un style aristocratique ou d’un dépassement de soi. On en reste aux fantasmes stéréotypes, à la planification “micro-procédurière”, à l’introspection complaisante d’un “moi” de plus en plus étiolé. « La survie individuelle est maintenant le seul bien », observe C. Lasch. Le XXIe siècle, à ce rythme, ne sera pas un siècle religieux, mais un siècle thérapeutique.
Dans cette perspective, le culte de la fausse intimité, l’intensification artificiel le des rapports subjectifs, la simplification primitiviste des “rituels” de séduction et d’approche, constituent des formes maladroites de compensation par rapport au cynisme social et à l’absence de valeurs partagées. L’existence de liens entre l’individu et des valeurs de type communautaire reste en effet une nécessité inéluctable dans toute société, quand bien même la conscience individuelle les refuse. Les liens affectifs individuels demeurent insuffisants pour donner aux individus un sens à leur existence. Ainsi, paradoxalement, la vague actuelle de “sentimentalité” qui tend à isoler l’individu à l’intérieur du couple, et le couple à l’intérieur de l’ensemble de la société, débouche sur la mort de toute affection authentique et sur la fragilisation des rapports d’union. L’amour comme l’amitié, pour être durables, doivent s’insérer dans un cadre plus large que celui défini par leurs protagonistes immédiats. Or, c’est cette dimension communautaire que le “narcissisme” attaque dans ses racines. Lorsque l’individu ne peut plus ni percevoir ni “idéaliser” le groupe, la cité, la communauté à laquelle il appartient, il est obligatoirement conduit à intensifier ses rapports infimes de façon si hypertrophique qu’il finit en fait par les détruire. C’est ainsi, par ex., que la vague récente de “néoromantisme”, évoquée par Edouard Shorter (Naissance de la famille moderne, Seuil, 1979), ne débouche pas sur l’amour, mais sur l’égotisme et sur l’obsession de soi.
De même, les fausses expérimentations vitales, qui ne reposent sur aucune habitude culturelle, sur aucun besoin intériorisé, dépersonnalisent l’individu au lieu de le recentrer, le “débranchent” en quelque sorte du monde vécu sans lui fournir “l’autre dimension” souhaitée. N’ayant pas trouvé le bonheur dans la consommation matérielle et le confort économique, la nouvelle bourgeoisie “narcissique” tente de l’atteindre dans une consommation de “produits spirituels”, dont la qualité laisse, évidemment, fort à désirer. Les États-Unis, et plus spécialement la sphère “californienne”, sont particulièrement en pointe dans ce style d’entreprises, dont certains essaient de nous persuader qu’elles constituent la naissance d’une nouvelle culture ou la source possible d’un renouveau de la spiritualité.
La description que donne C. Lasch est convaincante de bout en bout. Pourtant, Lasch semble ne pas tirer toutes les conclusions de son propos, probablement parce qu’il se trouve lui-même immergé dans une société américaine dont il n’ose pas remettre en cause les idéaux fondateurs (dont le “narcissisme” est pourtant l’aboutissement). C’est pourquoi il propose, de façon assez peu crédible un retour à des valeurs anciennes auxquels il n’envisage à aucun moment de donner un nouveau fondement. (Certains pourront voir là un essai de réactivation du puritanisme américain traditionnel).
Ce n’est pourtant pas, à notre avis, dans un quelconque “ordre moral” que réside la solution au “mal de vivre” de Narcisse. La solution ne peut procéder d’une manipulation sociale, d’une transformation des institutions, d’une évolution mécanique des codes sociaux ou d’un discours purement moral, Pour en finir avec “l’idéologie de la compassion” et la mentalité de “l’avoir-droit narcissique”, toute attitude répressive ou, au contraire, de simple lamentation, ne peut que se révéler sans effet. Seuls peuvent mobiliser les individus en tant que parties intégrantes d’un peuple, des projets d’essence politique et culturelle, fondés sur des valeurs (et des contre-valeurs) entièrement opposées à celles qui ont présidé à la naissance de la “république universelle” des États-Unis d’Amérique. Ce n’est pas, bien entendu, d’outre-Atlantique, que l’on peut les attendre.
◘ Le complexe de Narcisse : La nouvelle sensibilité américaine, traduit par Michel Landa, Robert Laffont, coll. Libertés 2000, 1981. [Version remaniée : La Culture du narcissisme, Champs-Flam, 2006]
► Guillaume Faye, Nouvelle École n°37, 1982.
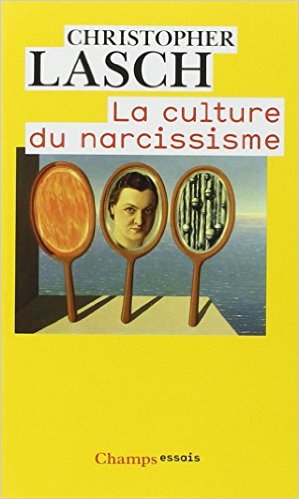 On le pressent, une fois ce diagnostic établi, la solution proposée par Lasch n’a rien de bien « transgressif », en apparence du moins. Lasch propose simplement de retrouver le sens des limites. Sur ce point, il convient cependant de ne pas se méprendre. Que l’individu doive retrouver le sens des limites n’a jamais signifié pour Lasch l’impératif de rétablir par la force l’autorité qui châtie et punit aveuglément. C’est ici que des « conservateurs droitiers » tels qu’Alain Finkielkraut ou Pascal Bruckner cessent de de pouvoir se référer sans mauvaise foi à Lasch. La permissivité et la peur du conflit d’une part, l’autorité qui ne sait qu’interdire d’autre part, forment pour Lasch deux faces d’une même médaille. A moins que les normes éthiques, suggère-t-il dans Le Moi assiégé, ne s’enracinent dans une identification émotionnelle avec les autorités qui les font respecter, elles n’inspireront rien de plus qu’une obéissance servile.
On le pressent, une fois ce diagnostic établi, la solution proposée par Lasch n’a rien de bien « transgressif », en apparence du moins. Lasch propose simplement de retrouver le sens des limites. Sur ce point, il convient cependant de ne pas se méprendre. Que l’individu doive retrouver le sens des limites n’a jamais signifié pour Lasch l’impératif de rétablir par la force l’autorité qui châtie et punit aveuglément. C’est ici que des « conservateurs droitiers » tels qu’Alain Finkielkraut ou Pascal Bruckner cessent de de pouvoir se référer sans mauvaise foi à Lasch. La permissivité et la peur du conflit d’une part, l’autorité qui ne sait qu’interdire d’autre part, forment pour Lasch deux faces d’une même médaille. A moins que les normes éthiques, suggère-t-il dans Le Moi assiégé, ne s’enracinent dans une identification émotionnelle avec les autorités qui les font respecter, elles n’inspireront rien de plus qu’une obéissance servile.  Dans une enquête de grande ampleur, qui évoque notamment le radicalisme chrétien d’Orestes Brownson (1803-1876), le transcendantalisme de Ralph Waldo Emerson (1803-1882), le mouvement de résistance non violente de Martin Luther King (1929-1968), en passant par le socialisme de guilde de George Douglas Howard Cole (1889-1959), Lasch met en évidence tout un gisement de valeurs relatives à l’humanisme civique, dont les Etats-Unis et plus largement le monde anglo-saxon ont été porteurs en résistance à l’idéologie libérale du progrès. Il retrouve, par-delà les divergences entre ces œuvres, certains constances : l’habitude de la responsabilité associée à la possession de la propriété ; l’oubli volontaire de soi dans un travail astreignant ; l’idéal de la vie bonne, enracinée dans une communauté d’appartenance, face à la promesse de l’abondance matérielle ; l’idée que le bonheur réside avant tout dans la reconnaissance que les hommes ne sont pas faits pour le bonheur. Le regard historique de Lasch, en revenant vers cette tradition, n’incite pas à la nostalgie passéiste pour un temps révolu. A la nostalgie, Lasch va ainsi opposer la mémoire. La nostalgie n’est que l’autre face de l’idéologie progressiste, vers laquelle on se tourne lorsque cette dernière n’assure plus ses promesses. La mémoire quant à elle vivifie le lien entre le passé et le présent en préparant à faire face avec courage à ce qui arrive. Au terme du parcours qu’il raconte dans Le Seul et Vrai Paradis, le lecteur garde donc en mémoire le fait historique suivant : il a existé un courant radical très fortement opposé à l’aliénation capitaliste, au délabrement des conditions de travail, ainsi qu’à l’idée selon laquelle la productivité doit augmenter à la mesure des désirs potentiellement illimités de la nature humaine, mais pourtant tout aussi méfiant à l’égard de la conception marxiste du progrès historique. Volontiers raillée par la doxa marxiste pour sa défense « petite bourgeoise » de la petite propriété, tenue pour un bastion de l’indépendance et du contrôle sur le travail et les conditions de vie, la pensée populiste visait surtout l’idole commune des libéraux et des marxistes, révélant par là même l’obsolescence du clivage droite/gauche : le progrès technique et économique, ainsi que l’optimisme historique qu’il recommande. Selon Lasch qui, dans le débat entre Marx et Proudhon, opte pour les analyses du second, l’éthique populiste des petits producteurs était « anticapitaliste, mais ni socialiste, ni social-démocrate, à la fois radicale, révolutionnaire même, et profondément conservatrice ».
Dans une enquête de grande ampleur, qui évoque notamment le radicalisme chrétien d’Orestes Brownson (1803-1876), le transcendantalisme de Ralph Waldo Emerson (1803-1882), le mouvement de résistance non violente de Martin Luther King (1929-1968), en passant par le socialisme de guilde de George Douglas Howard Cole (1889-1959), Lasch met en évidence tout un gisement de valeurs relatives à l’humanisme civique, dont les Etats-Unis et plus largement le monde anglo-saxon ont été porteurs en résistance à l’idéologie libérale du progrès. Il retrouve, par-delà les divergences entre ces œuvres, certains constances : l’habitude de la responsabilité associée à la possession de la propriété ; l’oubli volontaire de soi dans un travail astreignant ; l’idéal de la vie bonne, enracinée dans une communauté d’appartenance, face à la promesse de l’abondance matérielle ; l’idée que le bonheur réside avant tout dans la reconnaissance que les hommes ne sont pas faits pour le bonheur. Le regard historique de Lasch, en revenant vers cette tradition, n’incite pas à la nostalgie passéiste pour un temps révolu. A la nostalgie, Lasch va ainsi opposer la mémoire. La nostalgie n’est que l’autre face de l’idéologie progressiste, vers laquelle on se tourne lorsque cette dernière n’assure plus ses promesses. La mémoire quant à elle vivifie le lien entre le passé et le présent en préparant à faire face avec courage à ce qui arrive. Au terme du parcours qu’il raconte dans Le Seul et Vrai Paradis, le lecteur garde donc en mémoire le fait historique suivant : il a existé un courant radical très fortement opposé à l’aliénation capitaliste, au délabrement des conditions de travail, ainsi qu’à l’idée selon laquelle la productivité doit augmenter à la mesure des désirs potentiellement illimités de la nature humaine, mais pourtant tout aussi méfiant à l’égard de la conception marxiste du progrès historique. Volontiers raillée par la doxa marxiste pour sa défense « petite bourgeoise » de la petite propriété, tenue pour un bastion de l’indépendance et du contrôle sur le travail et les conditions de vie, la pensée populiste visait surtout l’idole commune des libéraux et des marxistes, révélant par là même l’obsolescence du clivage droite/gauche : le progrès technique et économique, ainsi que l’optimisme historique qu’il recommande. Selon Lasch qui, dans le débat entre Marx et Proudhon, opte pour les analyses du second, l’éthique populiste des petits producteurs était « anticapitaliste, mais ni socialiste, ni social-démocrate, à la fois radicale, révolutionnaire même, et profondément conservatrice ». 



 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
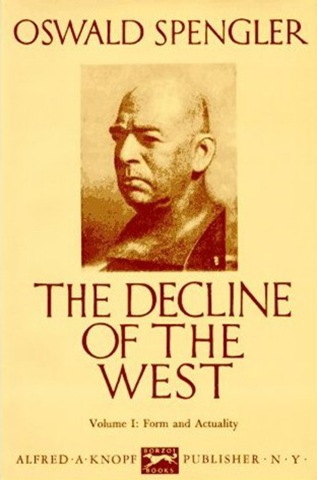 Nous avons
Nous avons 
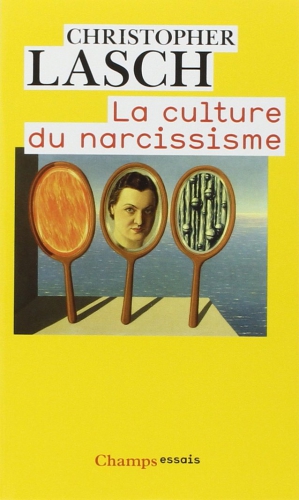 Similairement, la théorie d’Oswald Spengler, annonçant le déclin inévitable de l’Occident, se raccroche à une détermination cyclique d’un sens de l’histoire qu’il estime être en mesure de saisir. Selon lui, le déclin de la culture occidentale s’amorce dans les civilisations qui elles-mêmes représentent le dernier souffle d’une culture, « son achèvement et sa fin » ou encore « un pas de géant vers l’anorganique ». « Un siècle d’activité extensive pure, excluant la haute production artistique et métaphysique – disons franchement une époque irreligieuse, ce qui traduit tout à fait le concept de ville mondiale – est une époque de décadence ». Cette anthropologie pessimiste du déclin indexée sur un mouvement historique erratique se retrouve dans l‘Homme et la technique. Pour Spengler l’homme se distingue de l’animal par sa supériorité technique qui lui confère une force de domination inédite. Technique de forme « générique », c’est-à-dire « invariable » et « impersonnelle » – « la caractéristique exclusive de la technique humaine (…) est qu’elle est indépendante de la vie de l’espèce humaine » – au contraire, bien entendu, des animaux pour qui la « cogitation » se veut « strictement tributaire du « ici et maintenant » immédiat, et ne tenant compte ni du passé ni de l’avenir, elle ne connaît pas non plus l’expérience ou l’angoisse ». Ainsi, « l’homme est devenu créateur de sa tactique vitale (…) et la forme intime de sa créativité est appelée culture ». L’histoire de la technique n’est rien d’autre que l’histoire de la culture et de la civilisation, c’est-à-dire l’histoire d’une activité créatrice décorrélée de la « tactique de la vie ». Considérant la nature « comme du matériau et des moyens à son service », l’homme prométhéen s’éloigne toujours plus de celle-ci en y substituant, de son emprunte drue, l’artifice (l’art au sens de technique) afin de se « construire sois-même un monde, être soi-même Dieu (…) » : « c’est bien cela le rêve du chercheur Faustien ». Cette prétention génère un déphasage tragique entre l’homme et la nature puisque, en dernière analyse, « l’homme ne cesse pas d’en dépendre (…) elle continue à l’englober elle-même, lui comme tout le reste, en dépit de tout ce qu’il peut faire ». « Toute haute culture est une tragédie ». La notion de chute est ici toujours présente ainsi que l’idée d’une nature humaine désorganisée par la technique.
Similairement, la théorie d’Oswald Spengler, annonçant le déclin inévitable de l’Occident, se raccroche à une détermination cyclique d’un sens de l’histoire qu’il estime être en mesure de saisir. Selon lui, le déclin de la culture occidentale s’amorce dans les civilisations qui elles-mêmes représentent le dernier souffle d’une culture, « son achèvement et sa fin » ou encore « un pas de géant vers l’anorganique ». « Un siècle d’activité extensive pure, excluant la haute production artistique et métaphysique – disons franchement une époque irreligieuse, ce qui traduit tout à fait le concept de ville mondiale – est une époque de décadence ». Cette anthropologie pessimiste du déclin indexée sur un mouvement historique erratique se retrouve dans l‘Homme et la technique. Pour Spengler l’homme se distingue de l’animal par sa supériorité technique qui lui confère une force de domination inédite. Technique de forme « générique », c’est-à-dire « invariable » et « impersonnelle » – « la caractéristique exclusive de la technique humaine (…) est qu’elle est indépendante de la vie de l’espèce humaine » – au contraire, bien entendu, des animaux pour qui la « cogitation » se veut « strictement tributaire du « ici et maintenant » immédiat, et ne tenant compte ni du passé ni de l’avenir, elle ne connaît pas non plus l’expérience ou l’angoisse ». Ainsi, « l’homme est devenu créateur de sa tactique vitale (…) et la forme intime de sa créativité est appelée culture ». L’histoire de la technique n’est rien d’autre que l’histoire de la culture et de la civilisation, c’est-à-dire l’histoire d’une activité créatrice décorrélée de la « tactique de la vie ». Considérant la nature « comme du matériau et des moyens à son service », l’homme prométhéen s’éloigne toujours plus de celle-ci en y substituant, de son emprunte drue, l’artifice (l’art au sens de technique) afin de se « construire sois-même un monde, être soi-même Dieu (…) » : « c’est bien cela le rêve du chercheur Faustien ». Cette prétention génère un déphasage tragique entre l’homme et la nature puisque, en dernière analyse, « l’homme ne cesse pas d’en dépendre (…) elle continue à l’englober elle-même, lui comme tout le reste, en dépit de tout ce qu’il peut faire ». « Toute haute culture est une tragédie ». La notion de chute est ici toujours présente ainsi que l’idée d’une nature humaine désorganisée par la technique. Autre variation sous la plume de Désiré Nisard puisée dans son Études de mœurs et de critique sur les poètes latins de la décadence. Nisard fustige sous le nom de littérature décadente deux traits principaux : l’engouement pervers de la description ainsi qu’une érudition déplacée. Deux symboles d’un manque d’imagination sur le plan artistique. Cependant, il n’y pas de littérature décadente sans une décadence générale des mœurs. Alors que la description homérique se fixe sur l’humanité dans ce qu’elle possède de générique – la description brosse alors un monde commun, un homme commun, une spiritualité commune sous une multitudes de visages -, à l’inverse, la littérature décadente (notamment celle de Lucain) s’appesantit sur l’homme du divers : on passe d’une description de l’humanité à celle de l’individu. L’érudition irrigue la description et lui donne une coloration passéiste : il s’agit d’un « besoin de chercher dans les souvenirs du passé des détails que l’inspiration ne fournit pas » et non de cette érudition critique, parfaitement louable, qui consiste à amasser des faits sur une époque pour ensuite les comparer et les juger. Une fois de plus l’auteur mélange les deux fondamentaux inhérents aux discours de la décadence : la déchéance d’un passé en décomposition exprimée dans un ordre moral dévoyé. Ceux qu’il nomme « les versificateurs érudits » se rattachent à une littérature de seconde classe, une littérature dans laquelle s’épuise la grandeur des époques primitives. Alors que l’érudition de type décadente se perd dans les détails et dans la répétition d’un passé ou d’une nature révolue (on pourrait ici relever l’analogie avec le décadentisme ; notamment chez Huysmans pour qui le goût de l’érudition confine à l’exaltation de l’artifice, à l’art pour l’art – c’est-à-dire précisément ce que Nisard reproche aux versificateurs érudits – : « à coup sûr, on peut le dire : l’homme a fait dans son genre, aussi bien que le Dieu auquel il croit » nous dit des Esseintes) en s’attachant de trop près aux beautés purement descriptives (contingentes, relatives, casuels), les chef-d’œuvres primitifs (La Bible, les épopées d’Homère et de Dante, etc…) cultivent les beautés d’un ordre moral (soit des vérités éternelles valables pour toutes les époques et toutes les nations, soit ces vérités nécessaires qui fleurissent aux époques de grandeurs mais demeurent liées à une certaine culture). Chez les versificateurs érudits nous avons une simple « sensation de curiosité passagère qui résulte d’une heureuse combinaison de mots, d’une chute, d’une pointe » ; la littérature de l’âge d’or s’applique, quant à elle, à « conserver dans les formes pures et sacrées la somme des vérités pratiques nécessaires à la conservation et à l’amélioration de l’homme, dans quelque temps qu’il vive, et malgré toute ces variétés de mœurs, de société, de coutume, qui modifient son état, mais ne changent pas sa nature ».
Autre variation sous la plume de Désiré Nisard puisée dans son Études de mœurs et de critique sur les poètes latins de la décadence. Nisard fustige sous le nom de littérature décadente deux traits principaux : l’engouement pervers de la description ainsi qu’une érudition déplacée. Deux symboles d’un manque d’imagination sur le plan artistique. Cependant, il n’y pas de littérature décadente sans une décadence générale des mœurs. Alors que la description homérique se fixe sur l’humanité dans ce qu’elle possède de générique – la description brosse alors un monde commun, un homme commun, une spiritualité commune sous une multitudes de visages -, à l’inverse, la littérature décadente (notamment celle de Lucain) s’appesantit sur l’homme du divers : on passe d’une description de l’humanité à celle de l’individu. L’érudition irrigue la description et lui donne une coloration passéiste : il s’agit d’un « besoin de chercher dans les souvenirs du passé des détails que l’inspiration ne fournit pas » et non de cette érudition critique, parfaitement louable, qui consiste à amasser des faits sur une époque pour ensuite les comparer et les juger. Une fois de plus l’auteur mélange les deux fondamentaux inhérents aux discours de la décadence : la déchéance d’un passé en décomposition exprimée dans un ordre moral dévoyé. Ceux qu’il nomme « les versificateurs érudits » se rattachent à une littérature de seconde classe, une littérature dans laquelle s’épuise la grandeur des époques primitives. Alors que l’érudition de type décadente se perd dans les détails et dans la répétition d’un passé ou d’une nature révolue (on pourrait ici relever l’analogie avec le décadentisme ; notamment chez Huysmans pour qui le goût de l’érudition confine à l’exaltation de l’artifice, à l’art pour l’art – c’est-à-dire précisément ce que Nisard reproche aux versificateurs érudits – : « à coup sûr, on peut le dire : l’homme a fait dans son genre, aussi bien que le Dieu auquel il croit » nous dit des Esseintes) en s’attachant de trop près aux beautés purement descriptives (contingentes, relatives, casuels), les chef-d’œuvres primitifs (La Bible, les épopées d’Homère et de Dante, etc…) cultivent les beautés d’un ordre moral (soit des vérités éternelles valables pour toutes les époques et toutes les nations, soit ces vérités nécessaires qui fleurissent aux époques de grandeurs mais demeurent liées à une certaine culture). Chez les versificateurs érudits nous avons une simple « sensation de curiosité passagère qui résulte d’une heureuse combinaison de mots, d’une chute, d’une pointe » ; la littérature de l’âge d’or s’applique, quant à elle, à « conserver dans les formes pures et sacrées la somme des vérités pratiques nécessaires à la conservation et à l’amélioration de l’homme, dans quelque temps qu’il vive, et malgré toute ces variétés de mœurs, de société, de coutume, qui modifient son état, mais ne changent pas sa nature ».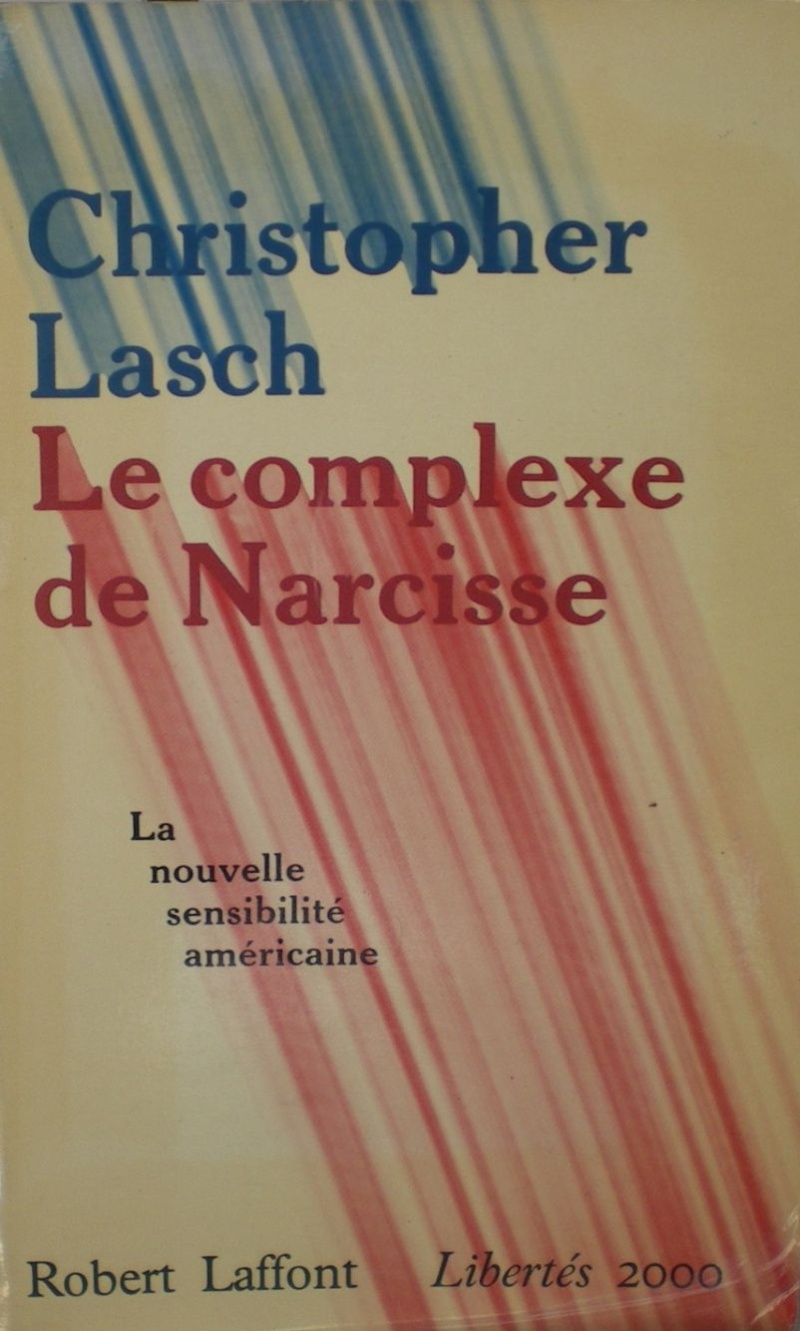

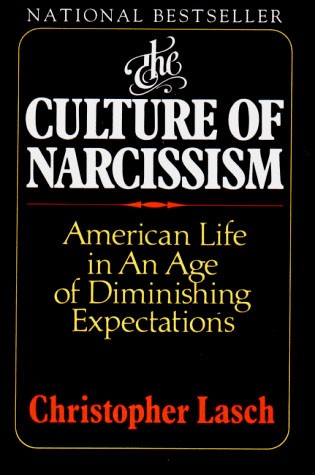 Deux volets paraissent se succéder dans ce petit livre, à première vue dissemblables, en tout cas appartenant à des sphères différentes : celui consacré à la culture, en l’occurrence celle que l’on destine, ou que l’on prête aux masses; et celui des médias, de la communication. Mais Christopher Lasch démontre que ces deux vecteurs de la société contemporaine, non seulement détiennent une importance capitale pour le projet qu’entretiennent les élites de contrôler efficacement le corps social, prévenant ainsi la guerre civile, comme l’indique pertinemment Régis Debray, dont le théoricien américain s’inspire parfois, mais aussi sont intimement imbriqués, tant la « culture » est devenue une affaire médiatique, fondée sur la publicité, la posture, l’esbroufe et le vide. Lasch montre même que le combat politique a pris le ton de cette culture de masse, faite d’annonces, de chocs, d’effets de miroirs, de clowneries (il cite Mark Rudd, Jerry Rubin et Abbie Hoffman, mais nous pourrions tout aussi bien invoquer les noms illustres de la carnavalesque « révolution » de 68, dont certains leaders ont bien fait leurs affaires), et que ce « style » fondé sur la fugacité de l’image et du son s’aligne intégralement sur la vérité marchande du capitalisme contemporain, fait de flux, de conditionnement, de légèreté idiote, et surtout de choix fallacieux, car puérils et grossiers.
Deux volets paraissent se succéder dans ce petit livre, à première vue dissemblables, en tout cas appartenant à des sphères différentes : celui consacré à la culture, en l’occurrence celle que l’on destine, ou que l’on prête aux masses; et celui des médias, de la communication. Mais Christopher Lasch démontre que ces deux vecteurs de la société contemporaine, non seulement détiennent une importance capitale pour le projet qu’entretiennent les élites de contrôler efficacement le corps social, prévenant ainsi la guerre civile, comme l’indique pertinemment Régis Debray, dont le théoricien américain s’inspire parfois, mais aussi sont intimement imbriqués, tant la « culture » est devenue une affaire médiatique, fondée sur la publicité, la posture, l’esbroufe et le vide. Lasch montre même que le combat politique a pris le ton de cette culture de masse, faite d’annonces, de chocs, d’effets de miroirs, de clowneries (il cite Mark Rudd, Jerry Rubin et Abbie Hoffman, mais nous pourrions tout aussi bien invoquer les noms illustres de la carnavalesque « révolution » de 68, dont certains leaders ont bien fait leurs affaires), et que ce « style » fondé sur la fugacité de l’image et du son s’aligne intégralement sur la vérité marchande du capitalisme contemporain, fait de flux, de conditionnement, de légèreté idiote, et surtout de choix fallacieux, car puérils et grossiers.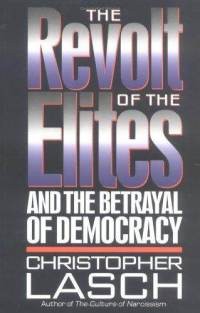 Le point crucial de sa réflexion, et son originalité, tiennent à l’analyse de la modernité comme arrachement des racines, des modes d’existence qui étaient liées à une mémoire, un groupe, une classe, et qui se prévalaient d’habitudes, de pensées, d’arts qui devaient autant aux familles qu’aux métiers, dont beaucoup étaient artisanaux, qu’à toutes espèces d’appartenances, celle des amis, des terroirs, des activités de tous ordres, et, plus généralement, aux traits caractéristiques des ensembles dans lesquels la personne se coulait sans s’anéantir. C’est justement ce vivier, cette incalculable, incomparable expérience populaire, cette richesse multiséculaire, qui ont été arasés par la gestion bureaucratique et marchande des égos et des pulsions, par une éducation sans caractère, universaliste et mièvre, un traitement technique des besoins et souffrances humains. Les familles éclatent, les générations ne se transmettent plus rien, le nomadisme, vanté par l’hyper-classe, est méthodiquement imposé, les lavages de cerveau sont menés par la télé et des films idiots, la société de consommation abaisse et uniformise les goûts, instaure un totalitarisme d’autant plus efficace qu’il sollicite un hédonisme de bas étage. Ces danses, ces chants, cette poésie authentiques des anciennes sociétés rendaient plus libres, plus autonomes et fiers de soi que cette production « artistique » qui ressemble tant aux produits de la publicité, lesquels visent à rendre les cerveaux malléables et les cœurs mélancoliques. Le temps où une véritable création populaire irriguait celle des élites, à charge de revanche, comme on le voit par exemple dans les œuvres de Jean-Sébastien Bach, et précisément dans les grands chefs d’œuvres, semble révolu, détruit complètement par la barbarie marchande.
Le point crucial de sa réflexion, et son originalité, tiennent à l’analyse de la modernité comme arrachement des racines, des modes d’existence qui étaient liées à une mémoire, un groupe, une classe, et qui se prévalaient d’habitudes, de pensées, d’arts qui devaient autant aux familles qu’aux métiers, dont beaucoup étaient artisanaux, qu’à toutes espèces d’appartenances, celle des amis, des terroirs, des activités de tous ordres, et, plus généralement, aux traits caractéristiques des ensembles dans lesquels la personne se coulait sans s’anéantir. C’est justement ce vivier, cette incalculable, incomparable expérience populaire, cette richesse multiséculaire, qui ont été arasés par la gestion bureaucratique et marchande des égos et des pulsions, par une éducation sans caractère, universaliste et mièvre, un traitement technique des besoins et souffrances humains. Les familles éclatent, les générations ne se transmettent plus rien, le nomadisme, vanté par l’hyper-classe, est méthodiquement imposé, les lavages de cerveau sont menés par la télé et des films idiots, la société de consommation abaisse et uniformise les goûts, instaure un totalitarisme d’autant plus efficace qu’il sollicite un hédonisme de bas étage. Ces danses, ces chants, cette poésie authentiques des anciennes sociétés rendaient plus libres, plus autonomes et fiers de soi que cette production « artistique » qui ressemble tant aux produits de la publicité, lesquels visent à rendre les cerveaux malléables et les cœurs mélancoliques. Le temps où une véritable création populaire irriguait celle des élites, à charge de revanche, comme on le voit par exemple dans les œuvres de Jean-Sébastien Bach, et précisément dans les grands chefs d’œuvres, semble révolu, détruit complètement par la barbarie marchande.