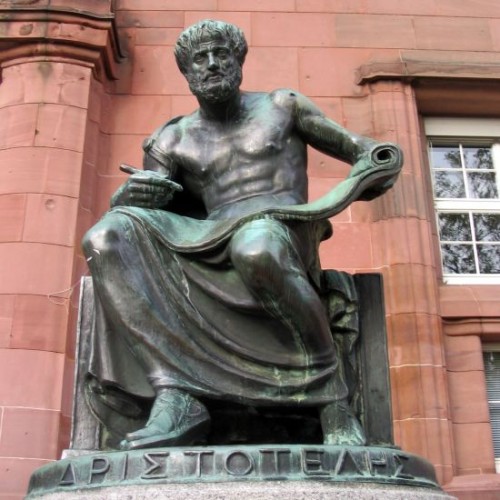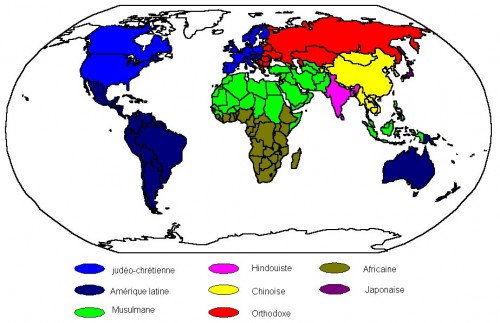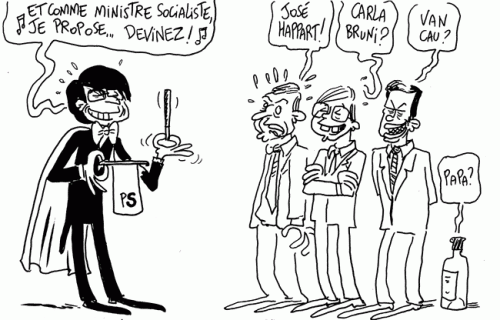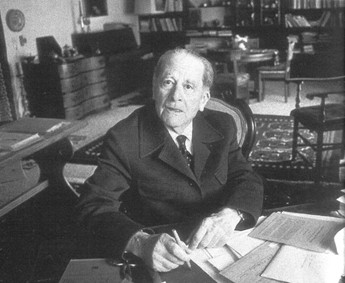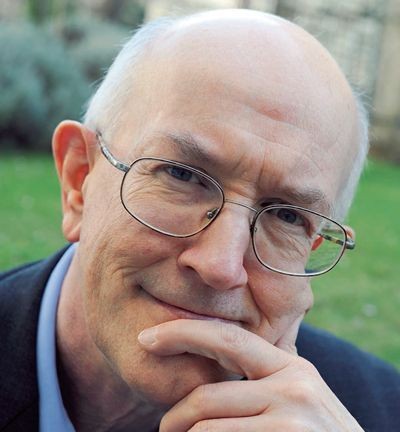dimanche, 04 octobre 2009
Le paradoxe del 'Etat libéral
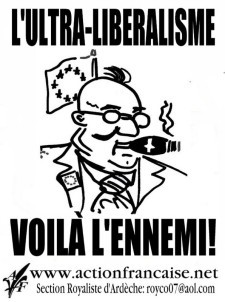 Le paradoxe de l'Etat libéral |
| « De nombreuses guerres et divers massacres de masse ont ensanglanté le XXe siècle. Les libéraux ont beau jeu d’accuser les monarchies finissantes ou les régimes totalitaires d’avoir causé ces horreurs pour imposer le bonheur collectif d’un empire, d’une race ou de l’humanité. C’est oublier que ces idéologies prétendaient résister au processus de décomposition initié par le libéralisme, dont la logique de l’illimité commençait à produire ses conséquences, sans que ses penseurs, Adam Smith, John Locke ou Montesquieu, personnes fort raisonnables, l’aient vraiment prévu. […] Comme le libéralisme ignore par principe la notion de bien commun et que la liberté consiste pour lui dans la simple liquidation des tabous et des frontières, les désirs individuels ne trouvent plus aucun frein. Chacun est absolument libre de faire ce qu’il veut du moment qu’il ne nuit pas à autrui. Mais que veut dire "ne pas nuire à autrui" ? Comment définir la "non-nuisance" puisqu’aucune conception du bien ne vaut plus qu’une autre ? Comment les tribunaux dans lesquels les libéraux placent leur confiance trancheront-ils ? Dans le doute, s’alignant sur ce que le lobby le plus puissant du moment aura fait passer pour l’"évolution naturelle des mœurs", ils donneront raison au plus fort, jusqu’à ce que, sous la pression d’un autre lobby plus efficace, les lois aient changé. […] La loi du plus fort chassée par la porte revient par la fenêtre. Les comportements chicaniers et procéduriers pullulent. Les diverses "communautés" au sens moderne du mot, alliances provisoires d’individus vaguement semblables, se déchirent devant les tribunaux afin de faire valoir leurs droits et d’exhiber leur "fierté" à la face du monde. La nécessité de satisfaire ses désirs et d’établir une concurrence "libre et non faussée" pour assurer la croissance oblige le libéralisme à dissoudre les communautés intermédiaires réputées conservatrices, parce qu’elles empêchent le mouvement perpétuel. L’Etat libéral, par un incroyable paradoxe, se renforce sans cesse au détriment des familles, des communes et du sentiment national. Il s’efforce de rendre les personnes conformes à l’idéologie en les transformant en consommateurs avides ou en producteurs sans cesse aiguillonnés par la concurrence. Les individus n’ont qu’un seul obstacle sur leur route : la liberté d’autrui. Cela signifie que les droits d’un homme quelconque s’étendent dans la mesure où la puissance qu’il amasse lui permet de l’emporter sur autrui. Le déploiement des libertés aboutit à la lutte de tous contre tous. Toute stabilité disparaît ; ce qu’il y a de plus sacré menace sans cesse de s’effondrer sous les coups de tel ou tel groupe de pression. »
Jacques Perrin, La Nation, 11 septembre 2009 |
00:30 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, sciences politiques, politologie, économie, théorie économique, crise, libéralisme, etat |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 14 septembre 2009
Pouvoirs oligarchiques et démocratie de façade
Pouvoirs oligarchiques et démocratie de façade
L’Intitut Néo-Socratique nous prie d’annoncer son cycle de conférences qui se déroulera au cours de l’année à venir sur le thème général :
Le Système oligarchique ;
comment il nous domine et comment s’en libérer !
La première conférence, prononcée par Yvan Blot, Président de l’Institut, se tiendra
Le lundi 14 septembre 2009 à 19H 30
A l’Hôtel Néva (rez-de-chaussée)
14 rue Brey – 75017 PARIS (près de l’étoile)
avec pour titre :
Notre démocratie de façade cache une oligarchie ;
Origine historique de cette situation
En avant propos de cette conférence, Polémia en présente la thématique qui sera abordée.
Pouvoirs oligarchiques et démocratie de façade
L’histoire de l’humanité est en grande partie l’histoire de ses classes dirigeantes. Dans toutes les sociétés sauf les sociétés très primitives, des classes dirigeantes sont apparues (Spencer) et ont cherché à justifier leur domination, en général avec succès. Ce succès reposait principalement sur leurs prestations, protéger la société du désordre intérieur et des ennemis extérieurs, notamment.
Très tôt, les anciens philosophes grecs perçurent que les dirigeants pouvaient rechercher leur intérêt propre et trahir le bien commun. La classification classique des régimes politiques d’Aristote vient de là : la monarchie vise le bien commun à l’inverse de la tyrannie. L’aristocratie vise le bien commun à l’inverse de l’oligarchie. Dans le langage actuel, la démocratie (Aristote disait : politeia que l’on traduit par république) vise le bien commun, ce qui n’est pas le cas du gouvernement démagogique.
Elites dévouées au bien commun ou élites courtermistes
Plusieurs critères permettent de distinguer les élites dévouées au bien commun et celles qui ne le sont pas :
Les propriétaires, rois ou aristocrates, ont une vision à long terme de la gestion de leurs biens, ce qui est beaucoup moins le cas des gérants salariés nommés pour une période courte. A l’heure actuelle, ce sont les gérants salariés, les « managers » qui gouvernent non seulement l’Etat mais aussi la plupart des grandes entreprises et les médias. C’est le règne de l’intérêt à court terme.
Un deuxième critère peut être le caractère plus ou moins « héroïque » des gouvernants, c'est-à-dire leur capacité à se sacrifier eux-mêmes pour autrui. Cette capacité est plus grande, par vocation même, chez les religieux ou les militaires, ou encore chez les savants ou professeurs amoureux de la vérité ou les juges et policiers amoureux de la justice.
Autrefois, l’aristocratie occupait les postes supérieurs de l’Etat. Elle n’avait pas que des mérites mais elle avait celui d’être d’essence militaire : le soldat est prêt à mourir, à donner sa vie pour son roi ou son pays. L’éthique du sacrifice ne lui était pas étrangère. Les gouvernants actuels ont une éthique de carrière bien différente.
« Les démocraties représentatives » ne sont que des oligarchies
Au vingtième siècle, on peut dire que les aristocraties ont été remplacées par des oligarchies. Ce n’est pas la version de l’histoire officielle car les oligarchies ont prétendu se battre pour la démocratie. On fait croire aux foules occidentales qu’elles vivent en démocratie, laquelle aurait remplacé les monarchies d’autrefois et leurs aristocraties nobiliaires. En réalité, nous vivons en oligarchies sous le nom de démocraties dites « représentatives ».
Essayez donc d’être candidat à une élection sans être membre d’un parti politique puissant : votre chance de vous faire élire est nulle ! Essayez donc de proposer une loi sur un sujet qui vous est cher. Il n’y a aucune procédure pour cela sauf dans les rares pays qui pratiquent la démocratie directe : la Suisse et l’Italie, au niveau national et local, l’Allemagne et l’ouest des Etats-Unis, au niveau local seulement.
Les vraies démocraties sont aujourd’hui celles qui combinent démocratie directe et démocratie représentative.
Seule la démocratie directe permet de contrôler les « gérants »
Pour les démocraties purement représentatives, le bilan n’est pas bon. Des études économiques très poussées, notamment du professeur suisse Kirchgässner, ont montré que les pays à démocratie directe ont des impôts 30% plus faibles, des dépenses publiques 30% plus réduites et une dette publique 50% plus faibles que les démocraties représentatives. Le PNB est plus élevé en moyenne.
De plus, du point de vue politique, les démocraties directes satisfont leurs citoyens (80% des Suisses sont satisfaits de leurs institutions. Dans les démocraties purement représentatives comme la France, les citoyens n’ont absolument pas le sentiment d’avoir une influence sur la politique de leur pays. Ils ne peuvent pas initier de référendums. Ils peuvent élire les députés présentés et sélectionnés par les grands partis politiques et c’est tout. Les programmes des partis se ressemblent de plus en plus. Le citoyen n’a plus guère de choix. D’après une enquête lourde menée par les politologues Bréchon et Tchernia, 40% des Français font encore confiance au parlement, autant pour les syndicats et 18% seulement font confiance aux partis politiques. Les Français n’ont pas l’impression que l’on gouverne en fonction des préoccupations et des intérêts du peuple.
Pour redonner du sens à la démocratie, il faut prendre conscience du caractère oligarchique du pouvoir actuel, qui est le pouvoir de gérants à court terme (rien à voir avec la gestion de vrais propriétaires). Il faut contrôler ces gérants : une seule voie pour cela : la démocratie directe.
Yvan BLOT
24/08/2009
Correspondance Polémia
11/08/2009
13:53 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, pensée politique, théorie politique, sciences politiques, antiquité grecque, grece antique, oligarchie, démocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 09 août 2009
Entretien avec G. Maschke: le mensonge de la guerre permanente pour la paix perpétuelle
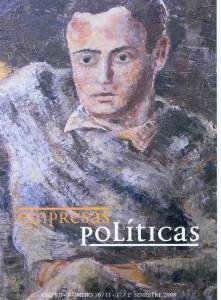
Entretien avec Günter Maschke:
Le mensonge de la guerre permanente pour la paix perpétuelle
Propos recueillis par Sven Beier
Q.: Monsieur Maschke,vous venez de publier récemment un vaste recueil d’écrits de Carl Schmitt sur le droit des gens, sous un titre apparemment paradoxal: “Frieden oder Pazifismus?” (= “La paix ou le pacifisme?”). Les pacifistes seraient-ils des acteurs politiques qui ne veulent pas la paix?
GM: Aucune des variantes du pacifisme n’aspire à la paix en tant que non recours à la guerre, aucune d’entre elles n’aspire à une paix qui serait conclue après une guerre menée contre un ennemi que l’on reconnaîtra comme tel; les pacifistes dans toutes leurs variantes veulent abolir la guerre, dans la mesure où ils nient son droit à exister. Ils considèrent que la guerre est un crime et entendent l’interdire par le droit; le pacifisme armé, qui détermine le droit des gens depuis le Diktat de Versailles de 1919, rend possibles les sanctions, les mesures de maintien de la paix, les occupations pacifiques, les mandats solidement étayés, les interventions humanitaires, ce qui équivaut, quels que soient les concepts camouflants utilisés, à des actions militaires contre tous ceux qui “brisent la paix”, contre les “agresseurs”. Par conséquent, tous les acteurs de l’échiquier doivent veiller à ne pas passer pour “agresseurs”. L’agresseur apparent doit pouvoir être montré comme tel, être littéralement construit de toutes pièces, ce qui signifie qu’il faudra provoquer l’ennemi pour qu’il commette des actes d’agression. De ce fait, le véritable agresseur est celui qui, en vertu de sa force et de sa position géographique, est en mesure de provoquer l’acte d’agression. “L’agresseur est celui qui force son adversaire à recourir aux armes”, disait déjà Frédéric le Grand. Celui qui se laisse provoquer se laissera passer un corde autour du cou, une corde qui n’est pas seulement d’ordre juridique, car il devra inévitablement songer aux conséquences de sa défaite éventuelle (c’est-à-dire celle qu’il devra accepter après une “capitulation sans condition”) et, subséquemment, luttera jusqu’à ce qu’il sera saigné à blanc. Ensuite, comme autre conséquence de ce pacifisme, nous repérons la tendance à éliminer toutes les règles du droit de la guerre; contre celui qui a eu recours à la guerre, tout sera dès lors permis. Quant aux autres, les crimes qu’ils auront commis n’entreront pas en ligne de compte. Le chemin qui mène du pacifisme, en tant que négation du droit à faire la guerre, à la guerre “totale” et “juste” est très court: “perpetual war for perpetual peace” (“guerre permanente pour la paix perpétuelle”). Or les notions de guerre et de paix sont en corrélation; le concept de paix présuppose toujours qu’il y a eu des hostilités préalables. Mais ceux qui pensent que ces hostilités sont par définition d’ordre criminel et que tout ennemi est, par voie de conséquence, un criminel, ne peuvent jamais faire de paix véritable. Car, justement, opérer une telle discrimination à l’encontre de la guerre et de l’ennemi, revient à ôter l’un des deux piliers qui soutiennent le droit des gens, en l’occurrence le pilier de la guerre, pour ne laisser que le pilier de la paix, ce qui ne permet évidemment aucune stabilité, donc aucune paix véritable. On ne peut faire la paix qu’avec un ennemi que l’on reconnaît(ra). La paix est un “état de droit”, une “situation de droit” et, en tant que telle, ne peut être obtenue que si la guerre, à son tour, possède un statut juridique. Le pacifisme s’avère ainsi un obstacle à la paix, tandis qu’un monde sans guerre ne serait pas pour autant un monde de paix, mais aurait besoin de s’auto-décrire à l’aide de tout nouveaux concepts.
Q.: Affirmeriez-vous que Carl Schmitt est un théoricien mobilisable aujourd’hui pour expliciter le droit des gens actuellement en vigueur ainsi que la situation internationale?
GM: Le droit des gens moderne ferait bien mieux de se préoccuper de savoir s’il doit ou non se mettre à la remorque de Carl Schmitt et non le contraire, chercher à mettre Carl Schmitt à la remorque du monde actuel. Ce droit des gens n’est pas innocent dans tous les désastres qui se sont succédé depuis 1919. Après chaque catastrophe, les doctrinaires du droit des gens moderne ont accentué encore plus la discrimination qui frappe la guerre et octroyé à la politique de puissance en vigueur —et toujours en place— la possibilité de déployer des manoeuvres de diversion et des “voilements”, des occultations, de plus en plus subtils; il suffit de songer aux innombrables possibilités qui existent d’interpréter le Pacte Kellogg de 1928 et la Doctrine Stimson de 1932. La belligérance proprement dite est dès lors devenue de plus en plus brutale, surtout parce qu’une défaite finale s’avèrerait encore plus terrible qu’auparavant. Entre 1919 et 1939, on a cherché à pallier l’interdiction de faire la guerre car on craignait les sanctions; on a dès lors procédé à des “occupations pacifiques”, à des “représailles”, etc. Typique de cette façon de procéder: le conflit sino-japonais. L’abolition du concept de “guerre” et son remplacement par celui de “conflit armé”, suivi de l’interdiction générale de tout recours à la violence, n’ont rien amélioré; on a simplement utilisé à profusion et à satiété le concept d’“auto-défense”. Les Etats-Unis prétendent “se défendre” en Irak, laquelle petite puissance les aurait menacé de manière décisive. L’impuissance possible du droit des gens face à certaines réalités est une chose; accorder à ces réalités l’apparence du droit ou célébrer des massacres par le truchement de la haute technologie comme des “mesures préventives” ou comme des “préludes” à l’avènement d’un droit civil universel (comme le veut le grand prêtre de l’humanisme actuel, Jürgen Habermas) en est une autre.
Q.: Dans quelle mesure est-ce réaliste de parler d’un rapport direct entre espace (Raum) et droit (Recht), comme le fait Carl Schmitt, de façon à ce que la guerre et la paix soient des réalités qui visent la réalisation d’un “ordre naturel”? A notre époque de flux migratoires et de flux de marchandises, où la population est devenue “multiculturelle”, on ne peut pas faire grand chose sur base de ce rapport espace/droit, pour régler la coexistence entre de telles “populations”, du moins si cette coexistence est encore organisée par un Etat?
GM: Les flux migratoires et les flux de marchandises se portent vers des espaces précis, organisés politiquement; ils ne s’écoulent pas au petit bonheur la chance sur une Terre qui ne serait pas subdivisée en entités étatiques. Dans certains cas jugés urgents, on va même jusqu’à construire des barrières, que ce soit sur la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique ou sur celle qui sépare les zones de peuplement juif des zones administrées par l’autorité palestinienne. C’est justement à cause de ces flux que le contrôle politique et militaire d’espaces s’avère aujourd’hui plus important qu’hier. D’autres facteurs le prouvent également: la lutte de plus en plus âpre pour l’accès aux matières premières, la militarisation de l’espace circumterrestre, les tentatives d’encercler la Russie ou de fractionner certains Etats en en détachant des composantes par le truchement de l’idéologie des droits de l’homme. Il y a déjà longtemps que l’on parle du “retour de l’espace” et les jours de la géographie politique et de la gépolitique ne sont pas encore comptés, loin de là! Même si les cercles les plus conventionnels et les plus conformistes de l’université allemande le souhaiteraient!
Q.: Le modèle d’ordre, que préconise Schmitt dans sa vision du droit des gens, avec sa fixation sur la notion de sol et sur l’idéal d’un peuple homogène, qui s’est approprié ce sol et l’a rentabilisé, n’est-il pas désormais archaïque parce que “folciste” (= “völkisch”), comme on l’a souvent reproché à Schmitt; “folciste” et donc aujourd’hui obsolète?
GM: Le droit des gens selon Schmitt a essuyé pas mal de critiques sous le national-socialisme, justement parce qu’il présentait, disaient ses adversaires partisans du régime, un déficit de “folcicité”. Par ailleurs, l’idée de “folcicité” ne me paraît pas obsolète aujourd’hui, vu l’agressivité de la globalisation: elle devient au contraire de plus en plus importante. J’en veux pour preuve la tendance actuelle à constituer de plus en plus souvent des Etats nouveaux et petits, n’englobant, si possible, qu’une seule ethnie. On évite bien entendu d’utiliser les termes “folciste” ou “ethnique”, voire “racial”, parce qu’ils sont chargés de connotations historiques, mais cela n’empêche pas que l’on lutte plus âprement aujourd’hui qu’hier pour faire triompher l’idéal “folciste”. Schmitt, lui, ne se préoccupait pas de la question “folciste” mais visait la constitution de “grands espaces” (Grossräume) contre la notion de “One World”, qui est issue de l’idéalisme désincarné et ne cherche pas à faire advenir un monde où les sujets du droit des gens seraient mis sur pied d’égalité mais, au contraire, seraient tous soumis à une et une seule superpuissance impérialiste. Le droit des gens de Carl Schmitt, que l’on accuse à tort d’être un “étatiste”, se place résolument au-delà de tout étatisme et repose surtout sur l’observation attentive d’un fait bien patent, que Washington veut ignorer: que le monde sera toujours plus grand que les Etats-Unis et ne pourra pas sempiternellement être taillé à la mesure des idées et des conceptions bizarres qui sont nées dans des cerveaux américains.
Q.: L’idéal schmittien du droit des gens semble avoir été plus ou moins réalisé dans le petit univers des Etats européens entre la Paix de Westphalie et la première guerre mondiale, avec des Etats souverains, délimités chacun par des frontières, se livrant quelques fois des “guerres de forme”, sorte de duels guerriers qui se terminaient par des traités de paix aux effets finalement restreints. N’a-t-on pas affaire, ici, à un mythe personnel cultivé par Schmitt, avec lequel il est parti en guerre contre la guerre totale qui sévissait au 20ème siècle? En partant du principe que les guerres-duels ont réellement existé, Schmitt n’a tout de même pas imaginé sérieusement qu’on pouvait y retourner? Et vous-même, y voyez-vous davantage qu’une réminiscence historique, une simple alternative à la tentative de fonder une paix sur les valeurs de l’universalisme de la “révolution mondiale démocratique”, à laquelle appelait George W. Bush en novembre 2003?
GM: La guerre limitée, ou “guerre des formes”, a bel et bien existé: elle repose sur la distinction claire entre guerre et paix, entre intérieur et extérieur, entre combattant et non combattant, etc. Même si l’on ne peut plus revenir à de telles distinctions, peut-on pour autant soutenir la notion de “guerre totale” ou l’état de “perpetual war for perpetual peace”, en propageant le mensonge d’une “paix indivisible” et en affirmant tout de go que toute guerre particulière concerne le monde tout entier, c’est-à-dire cette “communauté des peuples” (Völkergemeinschaft), qui existe soi disant réellement mais qui est, dans les faits, une “société d’Etats” (Staatengesellschaft)? En raisonnant de la sorte, peut-on contribuer à préparer pour l’avenir une sorte de “soft law” pour faciliter et légitimer l’interventionnisme impérialiste? Quand un sot prononce une phrase stupide, dans le genre “la liberté allemande (sur l’essence ou sur la réalité présente de laquelle, je refuse de m’exprimer ici pour demeurer poli) se défend aussi dans l’Hindou Kouch”, ou quand un autre handicapé de la dure-mère nous déclare que les Etats-Unis seraient davantage “sécurisés”, si l’Irak était sauvé tout en étant détruit, je constate que de telles assertions sont possibles uniquement parce que l’on croit aux principes du droit des gens tel qu’il s’applique depuis 1919. Et pire: même ceux qui critiquent les deux types d’assertion que je viens d’énoncer, pour m’en moquer, croient à ces principes de 1919! Ces gens peuvent, par exemple, critiquer le Traité de Versailles, mettre en doute la validité du Tribunal de Nuremberg, condamner les motivations qui ont conduit à la guerre du Vietnam, tout en célébrant l’avènement des droits de l’homme ou la défense préventive des “valeurs occidentales” ou toute autre sublime philosophade de cet acabit! Beaucoup de ceux qui s’insurgent contre les entorses faites au droit des gens par le gouvernement des Etats-Unis, oublient simultanément que ces entorses ne sont que la conséquence logique de l’évolution même de la pensée juridique aux Etats-Unis, une évolution qui a commencé plus ou moins vers 1880 et qui a donné pour résultat, in fine, le droit des gens de 1919. Mais cela donnerait quoi, cette “démocratie mondiale” ou ce qui en tient lieu? Une “démocratie” est par définition le “kratos”, le pouvoir, détenu par un “demos”, par un peuple particulier, et ne peut donc pas s’étendre au “monde” ou à l’humanité. Ensuite, la démocratie n’est qu’une méthode pour produire le droit et, en tant que méthode, ne présuppose aucun contenu; tout contenu éventuel, qui viendrait l’étoffer, s’ajouterait ultérieurement. L’Occident parle sans cesse de “démocratie”, mais ôte à cette même “démocratie” toute valeur quand les résultats d’une consultation démocratique lui déplaisent; dans cette optique, songeons simplement à la victoire électorale du “Front Islamique du Salut” en Algérie en décembre 1991; l’Occident a constaté, avec une joie à peine dissimulée, qu’un putsch a mis un terme à l’ascension du FIS. Songeons aussi aux élections iraniennes de 2005. La “révolution démocratique mondiale” est-elle une révolution fabriquée et imposée de force par les dirigeants des lobbies pétroliers qui lisent Leo Strauss pendant leurs temps de loisir? Mais qui agissent selon la devise de Schumpeter: “La démocratie, c’est le pouvoir par le mensonge”?
Q.: Vu les efforts que déploie la dernière superpuissance en piste, les Etats-Unis, pour faire advenir le “One World”, ne peut-on pas dire que le “nomos de la Terre”, espéré par Carl Schmitt, avec son pluriversum de “grands espaces” (Grossräume), est à reléguer au département des antiquités?
GM: Les Etats-Unis peuvent briguer l’avènement d’un “One World” mais, à l’évidence, on sait depuis longtemps qu’ils ne réussiront pas l’opération. Les tentatives de construire réellement de “grands espaces” sont patentes aujourd’hui, notamment en Amérique latine. Les pertes enregistrées par les Etats-Unis dans les secteurs de la production et de la finance sont incontestables. A cela s’ajoute, l’endettement pharamineux (et absurde) des Etats-Unis vis-à-vis de l’étranger et les risques que comporte cet endettement. Sur le plan militaire, les Etats-Unis se heurtent rapidement à leurs limites: ils ne disposent pas de troupes étrangères en suffisance, qui, elles, seraient prêtes à mourir pour une cause. On pourrait approcher l’idéal d’une paix mondiale, si les Etats-Unis devenaient à leur tour l’objet d’un “containment”, d’un endiguement, et si la volonté unie de tous les autres mettait un terme à leurs tentatives de contrôler l’espace arabe (et, par là même, une bonne part des sources d’approvisionnement de l’Europe), de pénétrer la “Terre du Milieu” ou l’espace centre-asiatique et d’encercler la Russie. Cet endiguement des Etats-Unis et l’union des volontés alternatives n’est pas un projet sans perspective...
Q.: La tentative d’empêcher par tous les moyens l’avènement de cet “Etat mondial” n’est-elle pas un combat à la Don Quichotte, contre des moulins à vent, vu la dynamique à l’oeuvre aujourd’hui et que l’on appelle la “globalisation”, laquelle procède par la constitution de plus en plus dense de réseaux économiques et communicationnels? Et cette lutte inutile à la Don Quichotte n’était-elle pas déjà obsolète du temps de Carl Schmitt lui-même?
GM: Un “Etat mondial”? Cela ne peut aboutir. Tout au plus arrivera-t-on à une “Fédération mondiale” fonctionnant selon le principe de subsidiarité, mais c’est assez utopique. Si l’on aboutit un jour à une “unité du monde”, sous quelle que forme que ce soit, alors nous aurions sûrement un résultat d’ores et déjà prévisible: les guerres, ou les “conflits armés”, continueront à exister mais sous la forme de guerres civiles. On peut déjà clairement entrevoir ce que cela signifie, en observant les simulations actuelle d’une “unité mondiale”, où les Etats-Unis jouent un rôle qu’on ne leur a pas demandé de tenir: celui de “policier global”. L’augmentation ininterrompue de la mise en réseau de l’économie ne constitue pas une garantie de paix; souvenons-nous que l’intégration économique de l’Europe était bien plus avancée en 1914 qu’aujourd’hui! L’intégration croissante de l’économie et du droit ne génère pas d’ordre politique. Si l’Etat perd de la légitimité, alors, simultanément, l’intégration économique et l’interdépendance croissante ont des effets déstabilisants voire bellogènes. On peut affirmer que le droit international actuel est l’enfant morbide d’une alliance fatidique: celle qui unit les idéaux de la révolution française aux conceptions anglaises du droit maritime. Et qui donne les maux suivants: impérialisme des droits de l’homme et rééducation d’une part, pan-interventionnisme couplé aux propagandes haineuses, étranglement de l’économie de l’adversaire et estompement de la distinction entre guerre et paix, d’autre part. On croit donc aujourd’hui, sur la planète entière, que par l’application des principes de la révolution française et de ceux du thalassocratisme anglais, qui ont pourtant eu pour résultat de déstabiliser le monde, on finira par faire éclore la stabilité de demain. Vous allez me dire que je simplifie à outrance! Et vos questions alors, ne procèdent-elles pas de simplifications pires encore?
Q.: Joschka Fischer, qui exerce encore actuellement les fonctions de ministre des affaires étrangères en Allemagne, a récemment osé un pronostic sur le développement du nouvel ordre mondial: ou bien les Etats-Unis réussissent, dans le cadre de l’ONU, à créer une “république mondiale” dominée par eux-mêmes et par l’UE, leur partenaire; ou bien, ils entreront dans une concurrence accrue avec la Chine, ce qui n’exclut pas, à terme, une confrontation sino-américaine future pour l’hégémonie globale. Pour éviter cela, l’avènement d’un “One World” sous domination américaine n’est-il pas la voie vers un avenir de paix?
GM: Les Etats-Unis n’entendent pas agir dans le cadre de l’ONU, comme on le sait. Quant à l’Europe qu’ils contrôlent et qui est divisée, ce n’est pas pour eux un partenaire mais un idiot utile. La concurrence avec la Chine sera de plus en plus aigüe, c’est inévitable. Une “république mondiale” par la grâce des Etats-Unis? Que cela signifierait-il? Poursuivre des actions criminelles comme l’agression américaine contre l’Irak et les soutenir? Participer à des guerres de prédation, pardon, à des guerres privatisées? Soutenir des Etats si proches des “valeurs occidentales” comme l’Egypte, le Pakistan ou l’Arabie Saoudite, voire la Colombie, ou aller y jouer un rôle médiateur pour faire croire urbi et orbi qu’on y respecte les droits de l’homme? Rendre plausible le projet de premières frappes nucléaires “préventives”?
Q.: Mais l’esprit du temps, le “Zeitgeist”, n’est-il pas un allié puissant de tous les projets qui promettent une “paix mondiale”, esprit du temps que l’on retrouve in nuce dans les esquisses d’un “Etat mondial” proposées par David Held ou Otfried Höffe? Toute critique basée sur Carl Schmitt ne s’avère-t-elle pas impuissante, si elle se borne à dénoncer de telles promesses de paix comme de simples travestissements juridiques, humanitaires et idéologiques d’un interventionnisme impérialiste?
GM: Kierkegaard aimait à dire: “Celui qui épouse le Zeitgeist deviendra vite veuf”. La “paix mondiale”, l’ “Etat mondial”, la “Fédération mondiale” (avec subsidiarité), ou quelle que soit la dénomination dont peuvent se parer ces rêves, qui ne sont pas si beaux (laissons de côté ici les distinguos), ne sont que des impossibilités, qui, de plus, sont incongrus sur le plan éthique. “Le futur, c’est le massacre”, et le massacre n’est pas anobli parce qu’il est “high tech” ou perpétré au nom de la “démocratie”. En politique, il faut s’en tenir aux probabilités et non aux voeux pieux. Première probabilité: après le 20ème siècle, nous en aurons encore pour notre argent! Au lieu de fantasmer sur un “Etat mondial”, ou sur quelque dérivation vermoulue du même genre, nous devrions, nous les Allemands, nous rappeler qu’après 1991, nous avons payé 13 milliards de DM pour que 150.000 Irakiens soient tués et que 300.000 enfants d’Irak meurent de faim ou de privations à cause de l’embargo imposé à leur pays, alors que l’Irak ne nous a jamais menacés, ni nous ni l’Occident. Evidemment, nous les Allemands, nous nous y connaissons en matière de refoulement... Le tableau de désolation que nous offre l’Irak aurait tout de même dû nous faire réfléchir aux conséquences de nos alliances, nous indiqué une nouvelle manière d’agir. Il est bien possible qu’une critique basée sur l’oeuvre de Schmitt s’avère impuissante face à certaines réalités actuelles, mais elle demeure néanmoins percutante contre l’idéologie qui les recouvre. Et j’ajouterais ceci: la destruction d’une réalité commence toujours par une attaque contre sa superstructure! Par vos questions, vous suggérez que rien ne peut s’opposer à un impérialisme interventionniste. Comment en arrivez-vous à une telle conclusion? Pour mourir, on a toujours bien le temps, mais certaines formes de “sacrificio dell’intellettto” (de sacrifice de l’intelligence) sont incurables!
(entretien paru dans “Junge Freiheit”, n°38/2005; traduction française: Robert Steuckers; avec l’aimable autorisation de G. Maschke)
A lire:
Günter MASCHKE (Hrsg.), “Carl Schmitt. Frieden oder Pazifismus? Arbeiten zum Völkerrecht und zur internationalen Politik 1924-1978”, mit einem Vorwort und mit Anmerkungen versehen. Duncker u. Humblot, Berlin, 2005, XXX u. 1010 seiten, gebunden, 98 euro.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droit, politologie, carl schmitt, sciences politiques, théorie politique, philosophie, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 02 août 2009
Protestantisme, capitalisme et américanisme
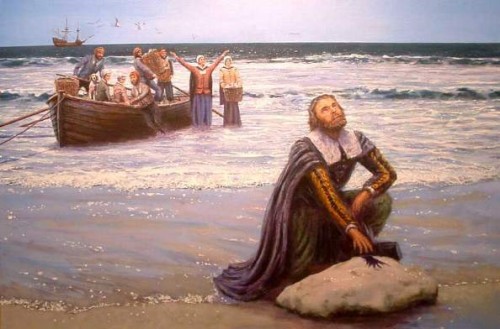
Nous avons aimé ce texte d'Edourd Rix:
Protestantisme, capitalisme et américanisme
On trouve chez de nombreux auteurs la distinction entre, d'une part, le catholicisme, christianisme négatif incarné par Rome, qui serait un instrument anti-germanique, et d'autre part, le protestantisme, christianisme positif émancipé de la papauté romaine, qui assumerait les valeurs traditionnelles germaniques. Dans cette perspective, Martin Luther serait un libérateur de l'âme allemande du carcan méditerranéen et despotique de la Rome papale, sa grande réussite étant la germanisation du christianisme. Les Protestants s'inscriraient donc dans la lignée des Cathares et des Vaudois, autant de représentants de l'esprit germanique en rupture avec Rome. Mais en réalité, Luther est celui qui a fomenté le premier en Europe la révolte individualiste et antihiérarchique, laquelle devait se traduire, sur le plan religieux, par le rejet du contenu «traditionnel» du catholicisme, sur le plan politique par l'émancipation des Princes allemands de l'Empereur, sur le plan du sacré par la négation du principe d'autorité et de hiérarchie, et donner une justification religieuse au développement de la mentalité marchande.
Sur le plan religieux, les théologiens réformés oeuvrent pour un retour aux sources, au christianisme des Ecritures, sans addition et sans corruption, c'est à-dire aux textes de la tradition orientale. Si Luther se rebelle contre «la papauté instituée par le diable à Rome», c'est uniquement parce-qu'il refuse l'aspect positif de Rome, la composante traditionnelle, hiérarchique et rituelle subsistant dans le catholicisme, l'Eglise marquée par l'ordre et le droit romain, par la pensée et la philosophie grecques, en particulier celle d'Aristote. D'ailleurs, ses paroles fustigeant Rome comme «Regnum Babylonis», comme cité obstinément païenne, ne sont pas sans rappeler celles employées par L’Apocalypse hébraïque et les premiers chrétiens contre la ville impériale.
Le bilan est tout aussi négatif sur le plan politique. Luther, qui se présentait comme «un prophète du peuple allemand», favorisa la révolte des Princes germaniques contre le principe universel de l'Empire, et par conséquent, leur émancipation de tout lien hiérarchique supranational. En effet, par sa doctrine qui admet le droit de résister à un empereur tyrannique, il légitimait au nom de l'Evangile, la rébellion contre l'autorité impériale. Au lieu de reprendre l'héritage de Frédéric II, qui avait affirmé l'idée supérieure du Sacrum Imperium, les Princes allemands, en soutenant la Réforme, passèrent dans le camp anti-impérial, n'ambitionnant plus que d'être des souverains «libres».
De même, la Réforme se caractérise, sur le plan du sacré, par la négation du principe d'autorité et de hiérarchie, les théologiens Protestants n'acceptant aucun pouvoir spirituel supérieur à celui des Ecritures. Effectivement, aucune Eglise ni aucun Pontifex n'ayant recu du Christ le privilège de l'infaillibilité en matière de doctrine sacrée, chaque chrétien est apte à juger de lui-même, par un libre examen individuel, en dehors de toute autorité spirituelle et de toute tradition dogmatique, la Parole de Dieu. Outre l'individualisme, cette théorie protestante du libre examen n'est pas sans lien avec un autre aspect de la Modernité, le rationalisme, l'individu qui a rejeté tout contrôle et toute tradition se fiant à ce qui, en lui, est la base de tout jugement, la raison, qui devient alors la mesure de toute vérité. Ce rationalisme, bien plus virulent que celui existant dans la Grèce antique et au Moyen-Age, donnera naissance à la philosophie des Lumières.
A partir du XVIè siècle, la doctrine protestante fournira une justification éthique et religieuse à l'ascension de la bourgeoisie en Europe, comme le démontre le sociologue Max Weber dans L'Ethique protestante et l'Esprit du Capitalisme, étude sur les origines du capitalisme. D'après lui, pendant les phases initiales du développement capitaliste, la tendance à maximiser le profit est le résultat d'une tendance, historiquement unique, à l'accumulation bien au-delà des biens de consommation personnelle. Weber trouve l'origine de ce comportement dans «l'ascétisme» des Protestants marqué par deux impératifs, le travail méthodique comme tâche principale dans la vie et la jouissance limitée de ses fruits. La conséquence non intentionnelle de cette éthique, qui était imposée aux croyants par les pressions sociales et psychologiques pour prouver son salut, fut l'accumulation de richesse pour l'investissement. Il montre également que le capitalisme n'est qu'une expression du rationalisme occidental moderne, phénomène étroitement lié à la Réforme. De même, l'économiste Werner Sombart dénoncera la Handlermentalitat (mentalité marchande) anglosaxonne, conférant au Catholicisme un rôle non négligeable de barrage contre la progression de l'esprit marchand en Europe occidentale.
Libéré de tout principe métaphysique, des dogmes, des symboles, des rites et des sacrements, le Protestantisme devait finir par se détacher de toute transcendance et mener à une sécularisation de toute aspiration supérieure, au moralisme et au puritanisme. C'est ainsi que dans les pays anglosaxons puritains, particulièrement en Amérique, l'idée religieuse en vient à sanctifier toute réalisation temporelle, la réussite matérielle, la richesse, la prospérité étant même considérées comme un signe d'élection divine. Dans son ouvrage Les Etats-Unis aujourd'hui, publié en 1928, André Siegfried, après avoir souligné que «la seule vraie religion américaine est le calvinisme’, écrivait déjà : «Il devient difficile de distinguer entre aspiration religieuse et poursuite de la richesse (...). On admet ainsi comme moral et désirable que l'esprit religieux devienne un facteur de progrès social et de développement économique». L'Amérique du Nord figure, selon la formule de Robert Steuckers «l'alliance de l'Ingénieur et du Prédicateur», c'est-à-dire l'alliance de Prométhée et de Jean Calvin ou encore de la technique ravie à l'Europe et du messianisme puritain issu du monothéisme judéochrétien. Transposant en termes profanes et matérialistes le projet universaliste de la chrétienté, elle entend supprimer les frontières, les cultures, les différences afin de transformer les peuples vivants de la Terre en des sociétés identiques, régies par la nouvelle Sainte-trinité de la libre entreprise, du libre échange mondial et de la démocratie libérale. Indéniablement, Martin Luther, et, plus encore, Jean Calvin, sont les pères spirituels de l'Oncle Sam...
Quant à nous, jeunes Européens, nous rejetons viscéralement cet Occident individualiste, rationaliste et matérialiste, héritier de la Réforme, de la pseudo Renaissance et de la Révolution française, autant de manifestations de la décadence européenne. Nous préférons toujours Faust à Prométhée, le Guerrier au Prédicateur, Nietzsche et Evola à Luther et Calvin.
Edouard Rix est un des animateurs de la revue Le Lansquenet (disponible sur www.librad.com).
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : protestantisme, capitalisme, américanisme, etats-unis, amérique, théorie politique, sciences politiques, politologie, religion, philosophie, 17ème siècle, puritanisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 09 juillet 2009
Down with the therapeutic left and the managerial right! (Part I)
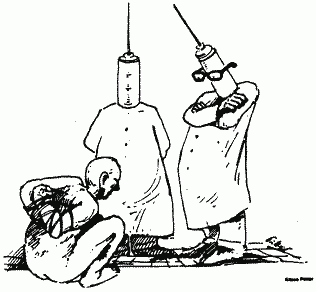
Down with the therapeutic left and the managerial right!
(Part One)
By Mark Wegierski
Ex: http://www.enterstageright.com/
The Next City was in the mid- to late-1990s, a prominent Toronto-based Canadian magazine (which is now no longer being published), although the website archive may still be extant. In his editorial commentary in the Spring 1997 issue, "Down with left and right", Lawrence (Larry) Solomon, the editor-in-chief of the magazine, suggested that those terms had definitively outworn their usefulness. Among the responses published in The Next City (Fall 1997), Michael Taube, then publisher of a small conservative zine From The Right (which in the end lasted only three issues) had argued that those terms continued to mean something significant. Nick Ternette, editor of The Left Fax (another small zine) had claimed that "the left as defined by socialists, Marxists, and greens does not believe in more government intervention, but less -- it believes as some of the new right does that people should do things for themselves instead of relying on government, and it sees an alternative to free markets...and...government interventionism, namely communalization." [emphasis in the original].
Mr. Solomon's response (Fall 1997) can be summarized as a reiteration of the call made in the initial piece, for paying less attention to outward ideology. The implicit hope expressed was that there would be more of the practical working-out of difficult modern-day problems and dilemmas by persons of good will regardless of ideology. Although this is certainly a fine sentiment, one finds that in practice there will often be some kind of partisanship.
Nick Ternette's statement is indeed curious, in that it can be read in a very traditionalist way. Is this in fact “socialism” -- or some kind of “anarcho-communitarianism”? Could this be seen as a call for the abolition of the managerial-therapeutic state, on the understanding that persons should depend on their own resources (or rather perhaps those of their immediate locality)? Is this an advocacy of the devolution of power to smaller municipalities and rural areas, as against the big cities? Should neither provinces nor the federal government in Canada set any general standards for health, education, welfare, human rights laws, etc? Should only local taxes be collected, and should any resources collected stay within the locality? Should one only be bound by the rules, laws, and customs of one's locality?
Nick Ternette was probably thinking mostly of clusters of left-wing activists in large and multicultural urban centers when he made his argument. But it could be argued that most of the communities of the country are in fact not the various components of the urban-based “rainbow coalition” continually trumpeted in the media, but rather smaller municipalities and rural areas typically despised and marginalized by left-liberalism today. One could conjecture that in a situation where local authority became paramount, left-liberal influence in Canada would be confined to a few large cities (or perhaps just a few trendy and/or grungy neighbourhoods in the largest cities) – rather than being projected upon the country as a whole (through mass-media, mass-education, and consumerism) as it is today.
The possible ultra-traditionalist take on Mr. Ternette's writing may strongly suggest the obsolescence of the Left-Right dichotomy. According to many theorists, the prevalent current-day political reality is the "managerial-therapeutic regime". That term is carefully chosen, for it could be argued that there is a "managerial Right" and a "therapeutic Left" which -- although in apparent conflict -- in fact represent little more than a debate as to the most effective application of consumerist desires and/or “market discipline” and/or mandatory sensitivity-training to keep the “subject-citizens” in line. The "managerial Right" represents the consumerist, business, economic side of the system, whereas the "therapeutic Left" represents redistribution of resources along politically-correct lines, and ongoing "sensitization" for recalcitrants.
The Left is also identified today with the pop-culture, which, in a somewhat different way from the therapeutic, seeks to reduce to non-existence traditional social norms of nation, family, and religion. While ferociously struggling for its vision of social justice and equality, much of the Left before the 1960s felt that many such notions were simply a natural, pre-political part of social existence, which it had no desire to challenge. The profit motive of the corporations, and the rebelliousness of the cultural Left and of late modern culture in general, feed off of each other, as Daniel Bell has argued in The Cultural Contradictions of Capitalism. North American pop-culture (which most definitely includes very reckless and irresponsible academic and art trends), and the consumer-culture, are tightly intertwined. What is fundamentally missing is the sense of an integrated self and society, where a more meaningful kind of identity can be held by persons, and in which real public and political discourse can take place.
It could be argued that the real division of late modernity is between supporters and critics of the managerial-therapeutic regime. The latter include genuine traditionalists, as well as various eclectic center and left persons. It may be noted, for example, that Christopher Lasch, one of the most profound critics of late modernity, continued to identify himself as a social democrat to the very end of his life.
This kind of coalition is prefigured in the words of the nineteenth-century aesthetic and cultural critic John Ruskin, who, in an age of a pre-totalitarian and pre-politically-correct Left, could say with some confidence, "I am a Tory of the sternest sort, a socialist, a communist."
To be continued. ![]()
Mark Wegierski is a Canadian writer and historical researcher.
00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, gauche, droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 02 juillet 2009
Necesidad de un Pensamiento Revolucionario
Necesidad de un Pensamiento Revolucionario
Por Guillermo Faye
Ex: http://elfretenegro.blogspot.com/
Ex: http://elfretenegro.blogspot.com/
El sistema está globalmente en estado de disfuncionamiento. Ninguna mejora es posible, porque la ideología hegemónica –y no la opinión común- la rechaza; una incompatibilidad de humor se ha instalado entre esta ideología y las soluciones prácticas que sería necesario aplicar para salvaguardar lo esencial de esta civilización. Hoy, ninguna reforma parcial es ya suficiente: se debe cambiar de sistema, como un antiguo motor cuyas piezas ya no pueden ser reparadas, sino que deben ser remplazadas.
Un partido político cuyo objetivo no sea el arribismo de sus cuadros sino la salvación de su nación, ya no debe de pensar en términos reformistas, sino revolucionarios. La mentalidad revolucionaria puede definirse como un estado de guerra permanente. Una oposición "clásica" piensa en el poder que quiere tomar como en un adversario cuyos cuerpos constituidos están compuestos de colegas políticos; una oposición revolucionaria piensa en el poder y en sus miembros como en enemigos.
Sin embargo, hay dos concepciones del pensamiento revolucionario, que Maquiavelo y Lenin habían entendido perfectamente. La primera es defensiva y conduce al fracaso. Es la estrategia del león que siempre muere, a menudo con valentía, bajo de las picas de las lanzas. Esta estrategia rechaza toda alianza táctica, todo compromiso provisional, en nombre de una pureza doctrinal mal comprendida. Es una estrategia sin espíritu de ataque. Se carga con el pantalón rojo, bigote al viento, antes morir bajo las balas de las metralletas enemigas.
La segunda concepción es asaltante. Subordina los medios al fin. Es la estrategia del zorro, la raposa que siempre devasta, de noche, los gallineros. Sabe contratar alianzas con los tontos útiles y los oportunistas, los chaqueteros que saben disimular la espada bajo la toga para así golpear más fuerte, que conocen el arte de la máscara. Saben proceder con paciencia y constancia: el mantenimiento secreto de sus objetivos radicales. Saben hacer concesiones, provisionalmente, sin perder de vista la integridad de sus objetivos, apoyados en una voluntad de hierro. Practican el arte de la mentira, alabado por Nietzsche. Como buenos marineros, saben bordear y utilizar la potencia de los vientos contrarios, sin olvidar nunca el puerto final, el objetivo final.
La primera concepción es romántica; sus raíces mentales son germánicas y célticas. La segunda concepción es clásica. Sus raíces mentales son helénicas y romanas. La primera concepción es inepta para tomar el poder, pero después de la toma del poder, puede ser muy eficiente.
Un partido político cuyo objetivo no sea el arribismo de sus cuadros sino la salvación de su nación, ya no debe de pensar en términos reformistas, sino revolucionarios. La mentalidad revolucionaria puede definirse como un estado de guerra permanente. Una oposición "clásica" piensa en el poder que quiere tomar como en un adversario cuyos cuerpos constituidos están compuestos de colegas políticos; una oposición revolucionaria piensa en el poder y en sus miembros como en enemigos.
Sin embargo, hay dos concepciones del pensamiento revolucionario, que Maquiavelo y Lenin habían entendido perfectamente. La primera es defensiva y conduce al fracaso. Es la estrategia del león que siempre muere, a menudo con valentía, bajo de las picas de las lanzas. Esta estrategia rechaza toda alianza táctica, todo compromiso provisional, en nombre de una pureza doctrinal mal comprendida. Es una estrategia sin espíritu de ataque. Se carga con el pantalón rojo, bigote al viento, antes morir bajo las balas de las metralletas enemigas.
La segunda concepción es asaltante. Subordina los medios al fin. Es la estrategia del zorro, la raposa que siempre devasta, de noche, los gallineros. Sabe contratar alianzas con los tontos útiles y los oportunistas, los chaqueteros que saben disimular la espada bajo la toga para así golpear más fuerte, que conocen el arte de la máscara. Saben proceder con paciencia y constancia: el mantenimiento secreto de sus objetivos radicales. Saben hacer concesiones, provisionalmente, sin perder de vista la integridad de sus objetivos, apoyados en una voluntad de hierro. Practican el arte de la mentira, alabado por Nietzsche. Como buenos marineros, saben bordear y utilizar la potencia de los vientos contrarios, sin olvidar nunca el puerto final, el objetivo final.
La primera concepción es romántica; sus raíces mentales son germánicas y célticas. La segunda concepción es clásica. Sus raíces mentales son helénicas y romanas. La primera concepción es inepta para tomar el poder, pero después de la toma del poder, puede ser muy eficiente.
00:13 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, révolution, nouvelle droite, nationalisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 29 juin 2009
"Le choc des civilisations" de Samuel Huntington
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 2003
"Le choc des civilisations" de Samuel Huntington
Conférence de Metz
Samedi 27.09.03
Présentation d’un ouvrage de géopolitique : HUNTINGTON (Samuel P.), Le Choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 1997.
Introduction.
Identification de l’auteur : Samuel P. Huntington est professeur à l’Université de Harvard. Il dirige le John M. Olin Institute for Strategic Studies. Il a été expert auprès du Conseil national américain de sécurité (N.S.C.) sous l’administration Carter (1977-1981). Par ailleurs, il est le fondateur et l’un des directeurs de la revue Foreign Policy. Il s’agit donc d’un personnage important au sein de l’ « école de géopolitique » américaine. Et il n’est pas négligeable de signaler que son livre a été salué par deux autres théoriciens américains de renom :
- Zbigniew Brzezinski, lui-même conseiller du président des Etats-Unis de 1977 à 1981, expert au Center for Strategic and International Studies, professeur à l’université Johns Hopkins de Baltimore et auteur notamment du Grand Echiquier paru en 1997.
- Henry Kissinger, conseiller en matière de sécurité nationale et ministre-secrétaire d’Etat (à partir de 1973) sous les présidents R. Nixon (1969-1974) et G. Ford (1974-1977). Henry Kissinger a publié récemment La Nouvelle Puissance Américaine.
Avant de rentrer dans une explication plus approfondie des grands thèmes développés par Huntington dans chacun des chapitres de son ouvrage, il est nécessaire de retracer brièvement sa genèse et les objectifs poursuivis par son auteur.
Le livre est issu d’une réflexion amorcée par Huntington dans un article publié durant l’été 1993 dans la revue Foreign Affairs. Cet article s’intitulait The Clash of Civilizations ? et était rédigé sous forme d’hypothèse : Les conflits entre groupes issus de différentes civilisations sont-ils en passe de devenir la donnée de base de la politique globale ? Selon les éditeurs de la revue, cet article a suscité des réactions et des commentaires en provenance de tous les continents. A tel point que Huntington, afin de répondre à ses laudateurs comme à ses détracteurs, a approfondi sa réflexion et a couché sous forme de thèse cette fois-ci, une nouvelle grille de lecture des relations internationales dans le livre constituant l’objet de notre conférence. Il a été publié pour la première fois en 1996 par Simon et Schuster sous le titre : The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order. Il a été traduit en français dès 1997 chez Odile Jacob. Cette œuvre est plus intéressante que celle publiée par Brzezinski car elle témoigne d’une véritable recherche et n’hésite pas à se référer à des auteurs importants comme Toynbee- Spengler - Braudel - De Maistre. En substance, le professeur Huntington y affirme :
« Le monde d’après la guerre froide comporte sept ou huit grandes civilisations. Les affinités et les différences culturelles déterminent les intérêts, les antagonismes et les associations entre Etats. Les pays les plus importants dans le monde sont surtout issus de civilisations différentes. Les conflits locaux qui ont le plus de chance de provoquer des guerres élargies ont lieu entre groupes et Etats issus de différentes civilisations. La forme fondamentale que prend le développement économique et politique diffère dans chaque civilisation. Les problèmes internationaux les plus importants tiennent aux différences entre civilisations. L’Occident n’est plus désormais le seul à être puissant. La politique internationale est devenue multipolaire et multicivilisationnelle. »[1]
L’objectif poursuivi par Samuel Huntington est avant tout de donner aux dirigeants politiques américains et pourquoi pas européens une nouvelle grille de lecture des relations internationales. Certains ont accusé Huntington de théoriser et de justifier dans son ouvrage la confrontation entre les Etats-Unis et le reste du monde, bref d’adopter une logique ouvertement belliciste. Nous pensons que cet avis est erroné si nous nous en tenons au texte réel d’Huntington. La réflexion de Huntington n’est pas le fruit de son imagination, elle s’appuie sur des faits concrets. Huntington constate ainsi le déclin de l’Occident et l’émergence de nouveaux pôles de puissance aux intérêts divergents. Sa logique n’est donc pas offensive mais plutôt défensive. Ce livre résonne comme un signal d’alarme à l’adresse de la classe dirigeante occidentale : si vous ne tenez pas compte de cette nouvelle réalité qu’est l’émergence des autres civilisations, le triomphe de notre civilisation risque bientôt de n’être plus qu’un souvenir d’ici quelques dizaines d’années. N’en doutons pas, la thèse de Huntington est destinée à constituer un paradigme, un modèle permettant de décrypter la réalité confuse en matière de politique internationale. Son livre est à ce titre truffé de concepts opératifs réutilisables dans l’interprétation de nombreux événements politiques, concepts que je tenterai de dégager au cours de cette conférence. A la doctrine Truman qui a dominé toute la période de la guerre froide, doit succéder la doctrine Huntington. Huntington précise toutefois que, comme toute théorie des relations internationales, sa doctrine n’est pas infaillible. Elle ne saurait rendre compte de tous les événements politiques d’importance survenus après la guerre froide. Toutefois, elle permet d’en expliquer une majorité et c’est en cela qu’il estime sa théorie plus valide que les autres.
Chapitre premier : Le nouvel âge de la politique globale.
Dans son chapitre premier, Huntington passe en revue toutes les théories survenues après la guerre froide afin de donner de nouveaux repères aux géopolitologues. Il analyse leurs qualités et leurs défauts à la lumière d’une règle simple mais efficace. En géopolitique, une théorie est semblable à une carte topographique. Plus une carte est détaillée, plus elle reflète la réalité mais l’abondance d’informations représentées la rend d’autant plus compliquée à lire. Au contraire, une carte simplifiée n’indiquant que les axes principaux de communication se lit plus aisément à l’instar d’une théorie plus englobante des faits politiques permettant d’apporter une réflexion d’ensemble sur la réalité internationale. Toutefois, si elle est trop simplifiée, la carte risque de perdre le voyageur tout comme une théorie trop abstraite qui contribuerait moins à interpréter les faits qu’à enfermer l’analyste dans une logique trop réductrice. L’auteur ne veut donc pêcher ni par excès de détails, ni par simplification outrancière des événements internationaux.
A la lumière de ces critères de qualité, il n’est pas inutile de développer brièvement les quelques théories qu’Huntington entend dépasser.
Un seul et même monde : euphorie et harmonie : La fin de la guerre froide a pu sembler signifier la fin des conflits importants et l’émergence d’un monde relativement harmonieux. La formulation de ce modèle la plus connue est celle de Francis Fukuyama, qui a avancé la thèse de « la fin de l’histoire ». Selon Fukuyama, nous pourrions la définir en ces termes : « Nous avons atteint le terme de l’évolution idéologique de l’humanité et de l’universalisation de la démocratie libérale occidentale en tant que forme définitive de gouvernement. » L’avenir ne sera pas fait de grands combats exaltés au nom d’idées ; il sera plutôt consacré à la résolution de problèmes techniques et économiques concrets. Au vu et au su du nombre de conflits qui ont éclaté après la fin de la guerre froide, Huntington déclare que la réalité jure trop avec cette théorie pour qu’elle puisse nous servir de repère.
Deux mondes : « eux » et « nous » : Quoi de plus facile au sortir de la guerre froide que de diviser le monde en deux entités bien distinctes ! Division qui se prête admirablement bien à tous les manichéismes. Ainsi certains ont eu coutume de diviser le monde entre le Nord et le Sud, c’est-à-dire, entre les pays modernes, développés et les pays traditionnels, sous-développés ou en voie de développement. D’autres préfèrent à cette séparation matérielle, une séparation culturelle entre l’Occident et l’Orient. Huntington réfute la validité tout comme l’utilité de cette division en terme géopolitique. Il est effectivement improbable que l’on vit un jour apparaître une coalition des pays sous-développés désireuse de faire la guerre aux « capitalistes du Nord ». De même la division culturelle entre Occident et Orient relève plus de nos propres fantasmes que d’une réalité bien établie. Autant l’unicité de l’Occident peut-elle être partiellement prouvée en matière économique, politique et culturelle [même s’il est douloureux pour nous Européens de le reconnaître]. A ce sujet, nous renvoyons nos auditeurs à l’ouvrage d’Alexandre Zinoviev : L’Occidentisme[2]. Autant la réalité orientale est multiple. Quoi de plus différentes entre elles constate Huntington que les sociétés hindoues, musulmanes ou encore chinoises. Cette théorie est donc caduque car elle caricature trop la réalité.
Cent quatre-vingt-quatre Etats environ : D’après la théorie « réaliste » des relations internationales, les Etats sont les acteurs majeurs, et même les seuls importants dans les affaires mondiales. Pour assurer leur survie et leur sécurité, les Etats s’efforcent immanquablement de maximiser leur puissance. Si un Etat constate qu’un autre est en train d’accroître sa puissance et peut donc devenir une menace potentielle, il s’efforce de protéger sa sécurité en accroissant sa propre puissance et/ou en s’alliant à d’autres Etats. Ces hypothèses permettent de prédire les intérêts et les actions des cent quatre-vingts quatre Etats environ qui existent dans le monde d’après la guerre froide. Ce paradigme étatique donne une image bien plus réaliste et opératoire de la politique globale que les paradigmes unitaire et binaire. Pour autant, ses limites sont importantes. Il suppose en effet que tous les Etats perçoivent de la même façon leurs intérêts et agissent de la même façon. Cette théorie ne saurait donc expliquer pourquoi le Canada ne s’arme pas afin de résister à une invasion potentielle des Etats-Unis. Elle ne saurait non plus expliquer pourquoi les pays européens ont décidé de se réunir en une entité politique plus large. Huntington constate que les valeurs, la culture et les institutions influencent grandement la façon dont les Etats définissent leurs intérêts. Des Etats qui ont une culture et des institutions similaires ont des intérêts communs. Des Etats démocratiques ont des points communs avec d’autres Etats démocratiques.
Un pur chaos : L’affaiblissement des Etats et, dans certains cas, leur échec accréditent une quatrième image, celle d’un monde réduit à l’anarchie. Ce paradigme s’appuie « sur le déclin de l’autorité gouvernementale, l’explosion de certains Etats, l’intensification des conflits tribaux, ethniques et religieux, l’émergence de mafias criminelles internationales, le fait que les réfugiés se comptent par dizaines de millions, la prolifération des armes de destruction massive, nucléaires ou autres, l’expansion du terrorisme, la persistance des massacres et des nettoyages ethniques. »[3] Comme le paradigme étatique, le paradigme chaotique est proche de la réalité. Il donne une vision imagée et précise d’une bonne partie de ce qui se produit effectivement dans le monde. Cependant, ce paradigme n’est pas opératoire ; on ne saurait effectivement prendre de décision politique rationnelle si l’on considère que le monde fonctionne comme un pur chaos. Le monde s’il devient de plus en plus chaotique, ne va pas sans un certain ordre, celui des civilisations !
Chapitre II : Les civilisations hier et aujourd’hui.
Encore faut-il s’entendre sur la définition d’une civilisation. Aux XVIIIe et XIXe siècles, le concept de « civilisation » servait à désigner toute société évoluée, notamment en terme matériel et institutionnel par opposition aux sociétés dites « barbares ». Ce n’est évidemment pas le sens que prend le terme « civilisation » dans l’ouvrage d’Huntington. Il n’étudie pas « la civilisation » comprise dans un sens universaliste. Il critique même cette conception purement occidentale à certains passages du livre. Au contraire, il étudie « les civilisations » caractérisées selon lui par divers éléments :
- Premièrement, une civilisation est une entité culturelle. Parmi les éléments culturels clés qui définissent une civilisation, Huntington dénombre le sang, la langue, la religion, la manière de vivre. Il constate que de tous les éléments objectifs qui définissent une civilisation, le plus important est en général la religion. Beaucoup de civilisations se sont identifiées au cours de l’histoire avec les grandes religions du monde. Au contraire, des populations faisant partie de la même ethnie et ayant la même langue, mais pas la même religion, peuvent s’opposer, comme c’est le cas au Liban, en ex-Yougoslavie et dans le subcontinent indien.
- Deuxièmement, les civilisations sont englobantes, c’est-à-dire qu’aucune de leurs composantes ne peut être comprise sans référence à la civilisation qui les embrasse. Pour reprendre les termes de Toynbee, « les civilisations englobent sans être englobées par les autres ». Une civilisation est ainsi le mode le plus élevé de regroupement et le niveau le plus haut d’identité culturelle dont les humains ont besoin pour se distinguer des autres espèces. Les civilisations sont les plus gros « nous » et elles s’opposent à tous les autres « eux ».
- Troisièmement, Huntington constate que les civilisations sont mortelles mais qu’elles sont des réalités d’une extrême longue durée. Les Empires naissent et meurent, les gouvernements vont et viennent, les civilisations restent et survivent aux aléas politiques, sociaux, économiques et même idéologiques.
- Enfin, puisqu’une civilisation est une entité culturelle, elle ne revêt pas de fonctions politiques telles que maintenir l’ordre, dire le droit, collecter les impôts, mener des guerres, négocier des traités, etc. Seul le Japon est à la fois une civilisation et un Etat tandis que la Chine est une civilisation qui se veut être un Etat. Nous rajouterons que dans les cercles de Synergies Européennes, nous affirmons que l’Eurosibérie est une civilisation qui doit être un Etat !
Enfin, après avoir donné sa définition de ce qu’est une civilisation, Huntington dénombre sept grandes civilisations contemporaines (ou plutôt six et demi) :
- La civilisation chinoise qui daterait au moins de 1500 av. J.-C., voire de mille ans plus tôt.
- La civilisation japonaise, dérivée de la civilisation chinoise et apparue entre 100 et 400 ap. J.C.
- La civilisation hindoue depuis 1500 av. J.C.
- La civilisation musulmane, née dans la péninsule arabique au VIIe siècle ap. J.C., elle s’est étendue en Afrique du Nord, en Espagne, et à l’est, en Asie centrale, dans le sous-continent indien et en Asie du Sud-Est. En conséquence de quoi, on distingue au sein de l’Islam plusieurs cultures ou sous-civilisations : l’arabe, la turque, la perse et la malaisienne.
- La civilisation occidentale dont Huntington date l’apparition à 700-800 ap. J.C. L’Occident regroupe l’Europe, l’Amérique du Nord et les autres pays peuplés d’Européens, comme l’Australie et la Nouvelle-Zélande.
- L’Amérique latine qui possède des caractéristiques propres suite à une évolution différente. Huntington parle d’une culture corporatiste et autoritaire différente de la démocratie occidentale. L’Europe et l’Amérique du Nord ont subi les effets de la Réforme et ont combiné culture catholique et culture protestante. Historiquement, l’Amérique latine a seulement été catholique. Enfin, la civilisation d’Amérique latine inclut des cultures indigènes, lesquelles n’existaient pas en Europe et ont été éliminées en Amérique du Nord.
- La civilisation africaine, si possible. Huntington émet l’hypothèse que l’Afrique subsaharienne pourrait s’assembler pour former une civilisation distincte dont le centre de gravité serait l’Etat d’Afrique du Sud.
En analysant la figure n°1 (= carte 1.3 [4]) fournie par Huntington, on remarque que le géopolitologue laisse la place à deux autres entités qu’il classe également sous le titre de civilisation : l’espace orthodoxe et l’espace bouddhiste. Toutefois, il considère que le Bouddhisme et l’Orthodoxie bien que ce soient deux grandes religions, n’ont pas été à la base de grandes civilisations. Remarquons également que dans son analyse, Huntington opère une distinction très nette entre l’Europe et la Russie orthodoxe (cf. figure n°3 = carte de ligne de partage entre l’Europe et le monde orthodoxe[5]) Certes, la Russie se différencie du reste de la population européenne par son origine slave et sa religion orthodoxe mais les peuples slaves sont majoritairement chrétiens, ils sont indo-européens, blancs et leur histoire est étroitement liée depuis plusieurs siècles déjà à l’histoire européenne. La distinction religieuse est d’ailleurs plutôt simpliste pour ne pas dire fausse quand on sait qu’aux yeux de la religion catholique, les protestants sont considérés comme hérétiques alors que les orthodoxes sont simplement schismatiques. Comment ne pas voir dans cette séparation une habile manœuvre politique destinée à théoriser auprès de nos « élites » européennes, une frontière culturelle qui est loin d’être évidente. Comment ne pas y voir la peur sous-jacente d’une alliance euro-russe, peur déjà bien présente à l’esprit des Américains en 1939 lors du Pacte Molotov-Ribbentrop. Comment ne pas y voir un voile discret jeté sur l’idée d’une alliance continentale que tous les stratèges britanniques ou américains ont cherché à combattre depuis Mackinder en passant par Mahan, Spykman, Brzezinski et plus récemment Kissinger. Il suffit de lire leurs ouvrages pour comprendre que le cauchemar américain est effectivement la réalisation d’un bloc politique eurasiatique s’étendant de Reykjavik à Vladivostok tel que l’ont théorisé Thiriard ou Guillaume Faye. Nous aurons l’occasion de revenir dans notre conclusion sur cet élément important.
Après avoir dénombré les différentes civilisations contemporaines, Huntington souligne un détail essentiel. En quoi la situation a-t-elle changé par rapport au passé ? Les civilisations existent depuis longtemps. Pourquoi tout d’un coup pointer du doigt le risque d’un choc des civilisations alors que certaines d’entre elles sont plusieurs fois millénaires ? Tout simplement parce qu’aux rencontres limitées entre civilisations a succédé une période d’intenses interactions. Au XVe siècle l’influence puissante et unidirectionnelle de l’Occident sur les autres civilisations a commencé à se manifester. Pendant quatre cents ans, les relations intercivilisationnelles se sont résumées à la subordination par l’Occident des autres civilisations. « L’expansion de l’Occident a été facilitée par la supériorité de son organisation, de sa discipline, de l’entraînement de ses troupes, de ses armes, de ses moyens de transport, de sa logistique, de ses soins médicaux, tout cela étant la résultante de son leadership dans la révolution industrielle. L’Occident a vaincu le monde non parce que ses idées, ses valeurs, sa religion étaient supérieures mais plutôt par sa supériorité à utiliser la violence organisée. Les Occidentaux l’oublient souvent, mais les non-Occidentaux jamais. »[6] Cependant cette supériorité a commencé à s’estomper à partir de la Première guerre mondiale. Au XXe siècle, les relations entre civilisations sont passées d’une période dominée par l’influence unidirectionnelle d’une civilisation en particulier sur les autres à une phase d’intenses interactions multidirectionnelles entre toutes les civilisations. L’expansion de l’Occident s’est arrêtée tandis que la révolte contre celui-ci a commencé. Par à coups, la puissance de l’Occident a décliné relativement à celle des autres civilisations. Cette situation laisse donc la place à l’émergence des sociétés non occidentales qui redeviennent les actrices de leur propre histoire, surtout depuis la fin des conflits idéologiques. Dans ce contexte et vu les échanges de plus en plus soutenus entre les différentes civilisations à l’échelle mondiale, un choc entre civilisations a beaucoup plus de chance de se produire que par le passé ! Les Etats-Unis tentent de se substituer au rôle de gendarme du monde autrefois tenu par l’Europe mais ils ne cessent de s’attirer la haine des peuples. Une haine lourde de conflits à venir.
Chapitre III : Existe-t-il une civilisation universelle ? Modernisation et occidentalisation.
La civilisation universelle ?
Samuel P. Huntington est très critique vis-à-vis du concept de civilisation universelle que l’on apparente souvent à la culture de Davos. Sont convertis à cette culture nombre de nos hommes politiques, dirigeants d’entreprise, banquiers, hauts fonctionnaires, intellectuels et journalistes. « Ils partagent tous la même foi dans les vertus de l’individualisme, de l’économie de marché et de la démocratie politique. »[7] Cette culture est extrêmement importante parce que les personnes qui la partagent possèdent des responsabilités dans presque toutes les institutions internationales, dans plusieurs gouvernements, dans l’économie mondiale, dans la défense et dans les universités. Cependant, souligne Huntington, que représentent ces convertis à l’échelle mondiale ? Il est probable qu’en dehors de l’Occident, ils ne sont qu’une petite poignée (1% [peut-être moins] de la population) à partager ses valeurs et ils ne sont pas forcément en position de force au sein de leur propre société. Il suffit pour cela de prendre comme exemple la Jordanie durant la dernière guerre du Golfe pour se rendre compte que seuls les dirigeants soutenaient l’effort américain dans la région tandis que la population jordanienne y était largement hostile. Cette culture de Davos est donc loin de former une culture universelle.
De même, Huntington critique l’idée selon laquelle la diffusion des structures de consommation et de la culture populaire occidentale à travers le monde crée une civilisation universelle. Entendez l’idée selon laquelle, puisqu’un hindou boit du coca-cola et porte des blue-jeans, il est forcément converti aux valeurs consuméristes de la société américaine. En effet, nous sommes assez d’accord avec Huntington lorsqu’il affirme que nous ne pouvons identifier les simples aspects matériels d’une culture avec ses valeurs et ses idéaux profonds. « Seule l’arrogance, dit-il, incite les Occidentaux à considérer que les non-Occidentaux « s’occidentaliseront » en consommant plus de produits occidentaux. Le fait que les Occidentaux identifient leur culture à des liquides vaisselle, des pantalons décolorés et des aliments trop riches, voilà qui est révélateur de l’Occident. »[8] Cependant nous rajouterons qu’il ne faut pas sous-estimer, sur certains esprits plus faibles, le pouvoir attractif de toutes nos cochonneries. La colonisation massive de peuples allochtones que l’Europe connaît à l’heure actuelle n’est hélas pas là pour le démentir. Quoique, la capacité d’intégration de la société occidentale tende à diminuer à mesure que le nombre d’étrangers y est plus important. Le regroupement communautaire massif de ces populations favorise en effet la conservation des pratiques culturelles issues du pays d’origine. Face à un peuple s’identifiant aux marques de shampoing et aux voitures de luxe, il est normal que des cultures plus fortes comme la culture arabe prennent progressivement le dessus à l’extérieur, comme à l’intérieur de nos frontières !
Enfin Huntington bat également en brèche la thèse selon laquelle un surcroît d’interactions (commerces, investissements, tourisme, médias, communication électronique) engendrerait une culture mondiale. Et dans la mesure où ce sont de grands groupes américains et européens qui dominent la diffusion de l’information à l’échelle planétaire, cette culture mondiale serait forcément occidentale. Premier argument critique avancé par Huntington : les populations du monde ne perçoivent pas les informations avec les mêmes schèmes de pensée. Chaque culture possède sa grille de lecture. Les Chinois ne regardent pas Dallas de la même manière que les Américains ! Deuxième argument, à notre sens le plus important, sous forme de question critique : en quoi les interactions de plus en plus nombreuses entre les peuples seraient synonymes de paix et de solidarité ? On avait déjà argué par le passé que si l’on augmentait les rapports commerciaux entre les nations, la probabilité qu’une guerre éclate entre elles diminuerait. Cette affirmation est évidemment totalement fausse et tout le monde connaît à l’heure actuelle l’expression « guerre commerciale » qui n’a pas besoin d’être commentée tant elle est lourde de sens. De même, la sociologie a abondamment prouvé cette règle très simple que beaucoup de nos « penseurs » contemporains s’évertuent pourtant à oblitérer. : « On se définit par ce qu’on n’est pas ». En psychologie sociale, la théorie de la distinction montre que les personnes se définissent par leurs différences dans un certain contexte. Autrement dit, comme les communications, le commerce et les voyages multiplient les interactions entre civilisations ; on accorde en général de plus en plus d’attention à son identité civilisationnelle. « Deux Européens, un Allemand et un Français, qui interagissent ensemble s’identifieront comme allemand et français. Mais deux Européens, un Allemand et un Français, interagissant avec deux Arabes, un Saoudien et un Egyptien, se définiront les uns comme Européens et les autres comme Arabes. »[9]
Huntington appuie sa critique du concept de civilisation universelle en constatant un renouveau des langues nationales au détriment des langues coloniales. En Inde par exemple, il est plus facile pour un voyageur qui traverse le pays de communiquer en hindi qu’en anglais. De même il constate une « indigénisation » de langues comme le français ou l’anglais, deux langues qui ont pourtant des prétentions universalistes. En effet, l’anglais parlé au Cachemire ou le français de Côte d’Ivoire sont loin d’avoir gardé les accents de leur métropole d’origine. Le renouveau religieux notamment dans les pays musulmans est un autre signe manifeste d’une plus grande conscience identitaire des anciens pays colonisés.
Les réactions à l’Occident et à la modernisation.
Un autre versant intéressant de la réflexion du stratège américain réside dans sa conceptualisation des réactions des peuples traditionnels face à l’Occident et la modernisation. Il en comptabilise trois :
- Le rejet total de l’Occident, c’est-à-dire le rejet par de petites communautés traditionnelles non seulement des valeurs de l’Occident mais également des artifices de la modernisation. Huntington affirme que ce rejet est quasi insoutenable dans le monde « hyperglobalisé » dans lequel nous vivons. Une société traditionnelle ne peut lutter avec des arcs à flèches contre des chars !
- Le kémalisme consiste à adhérer à la fois à la modernisation et à l’occidentalisation. Il est fondé sur l’idée que la modernisation est désirable et nécessaire, que la culture indigène est incompatible avec la modernisation et doit être abandonnée ou abolie et que la société doit être entièrement occidentalisée afin de se moderniser convenablement. L’exemple le plus frappant est celui de la Turquie de Mustafa Kemal. Le problème des pays choisissant cette voie réside évidemment dans la déchirure profonde et douloureuse entre les valeurs ancestrales et la société moderne.
- Le réformisme tente de combiner la modernisation avec la préservation des valeurs, des pratiques et des institutions fondamentales de la culture propre à la société concernée. C’est la voie qu’ont choisie au XIXe siècle des pays comme la Chine ou le Japon : « éducation chinoise pour les principes fondamentaux, éducation occidentale pour la pratique. » - « esprit japonais, technique occidentale. »[10]
Comme vous pouvez le constater, l’ouvrage de Huntington est intéressant car il contient une foule de concepts permettant d’abstraire et ainsi de comprendre la réalité. A partir de ces concepts, l’esprit peut explorer de nouvelles voies. Huntington constate par exemple que beaucoup de pays traditionnels ont évolué du kémalisme vers le réformisme. En effet, durant les premières phases du changement, l’occidentalisation favorise la modernisation. Pendant les phases suivantes, la modernisation favorise la désoccidentalisation et la résurgence de la culture indigène de deux manières. « A l’échelon sociétal, la modernisation renforce le pouvoir économique, militaire et politique de la société dans son ensemble et encourage la population à avoir confiance dans sa culture et à s’affirmer dans son identité culturelle. A l’échelon individuel, la modernisation engendre des sentiments d’aliénation et d’anomie à mesure que les liens et les relations sociales traditionnelles se brisent, ce qui conduit à des crises d’identité auxquelles la religion apporte une réponse. »[11]
La religion comme moteur civilisationnel.
La place que Huntington confère à la religion est importante. Il est évident que pour nombre de personnes désorientées, surtout dans des sociétés vides de sens, la religion peut constituer un refuge, voire une façon plus solide d’appréhender la vie dans son ensemble. La religion rend aux gens la fierté qu’ils avaient perdue, elle leur donne un passé, un présent, un futur, une structure mentale et sociologique ainsi que des aspirations communes. C’est ce qui fait la force des sociétés culturellement homogènes et la faiblesse des Etats multiethniques et multiculturels. Les pays à majorité musulmane sont un bon exemple de ce phénomène. Les organisations islamiques y sont de plus en plus présentes sur le terrain. Elles ont compris que pour prendre le pouvoir, il fallait être les premières à agir en cas de problème et s’imposer comme la seule alternative possible face au gouvernement en place. Lors des tremblements de terre en 1992, au Caire, ces dernières étaient souvent les premières à soigner les blessés tandis que les secours gouvernementaux tardaient. Huntington note qu’en 1995, tous les pays majoritairement musulmans, sauf l’Iran, étaient culturellement, socialement et politiquement plus islamiques et islamistes que quinze ans auparavant. L’exemple irakien est encore plus criant. Dans la détresse la plus totale, le peuple irakien se retourne inexorablement vers ses racines sunnites ou chiites. Les hôpitaux musulmans ne désemplissent pas car ils sont les seuls à offrir un service de soins efficaces et gratuits ! La suppression du régime laïc de Saddam a ouvert une voie royale à une réislamisation du pays, la présence américaine ne faisant qu’exacerber davantage la conscience identitaire de la population. Huntington assimile donc la religion à un véritable moteur civilisationnel, source de dynamisme. C’est une interprétation techniciste et bien américaine d’un phénomène à notre sens plus profond. Cependant, ignorer superbement cette donnée essentielle en politique internationale serait une erreur. Elle a déjà coûté cher à l’Occident et risque encore de lui poser des problèmes dans un proche avenir.
Chapitre IV : L’effacement de l’Occident : puissance, culture et indigénisation.
Si Huntington constate un déclin de l’Occident, il est néanmoins d’accord pour dire qu’à l’heure actuelle, après sa victoire contre le communisme, la société occidentale profite toujours de sa position d’hyper puissance avec à sa tête un leader américain incontesté. Ouvrons une parenthèse pour remarquer au passage que Huntington prend bien soin de définir le communisme vaincu comme un phénomène extra-occidental. Dans son obsession de séparer la Russie de l’Europe, Huntington commet là une faute grave. Considérer le communisme indépendamment de ses racines occidentales est un non-sens historique. En effet, quoi de plus « occidental » au sens traditionnel, que le progressisme et le matérialisme historique qui caractérisent la société communiste ?
Vu sa position de leader, les sociétés appartenant à d’autres civilisations ont toujours besoin de l’Occident aujourd’hui pour parvenir à leurs fins et protéger leurs intérêts car les nations occidentales :
- possèdent et animent le système bancaire international ;
- contrôlent les monnaies fortes ;
- représentent les principaux pays consommateurs ;
- produisent la majorité des produits finis ;
- dominent les marchés internationaux de capitaux ;
- exercent une autorité morale considérable sur de nombreuses sociétés ;
- contrôlent les voies maritimes ;
- mènent les recherches techniques les plus avancées ;
- contrôlent la transmission du savoir technique de pointe ;
- dominent l’accès à l’espace ;
- dominent l’industrie aéronautique ;
- dominent les communications internationales ;
- dominent le secteur des armements sophistiqués.[12]
Mais qu’adviendra-t-il demain de la société occidentale. Huntington inventorie aussi les signes manifestes de notre déclin :
- faible croissance économique ;
- stagnation démographique ; (cf. figure n°2 = figure 5.2[13])
- chômage ;
- déficit budgétaire ;
- corruption dans les affaires ;
- faible taux d’épargne ;
- déclin moral…[14]
Parmi les plus évidentes manifestations du déclin moral, Huntington cite avec une très grande lucidité :
- Le développement de comportements antisociaux, tel que le crime, la drogue, et plus généralement la violence.
- Le déclin de la famille, se traduisant par l’augmentation du taux des divorces, les naissances illégitimes, les grossesses d’adolescentes et les familles monoparentales.
- Le déclin du « capital social », tout du moins aux Etats-Unis, c’est-à-dire la participation plus faible à des associations bénévoles et, de fait, le relâchement des relations de confiance qui s’y nouent.
- La faiblesse générale de « l’éthique » et la priorité accordée à la complaisance.
- La désaffection pour le savoir et l’activité intellectuelle, qui se manifeste aux Etats-Unis [comme en Europe] par la baisse du niveau scolaire.[15]
Il s’ensuit une certaine érosion de la culture occidentale, tandis que les mœurs, les langues, les croyances et les institutions indigènes, enracinées dans l’histoire, sont réaffirmées. La puissance accrue des sociétés non occidentales sous l’effet de la modernisation engendre le renouveau des cultures non occidentales dans le monde entier. « Le lien entre puissance et culture a presque toujours été négligé par ceux qui pensent qu’apparaît et doit apparaître une civilisation universelle comme par ceux pour qui l’occidentalisation est une condition nécessaire de la modernisation. Ils refusent de reconnaître que la logique de ces raisonnements les incline à soutenir l’expansion et la consolidation de la domination de l’Occident sur le monde et que si les autres sociétés étaient libres de façonner leur propre destin, elles revigoreraient leurs croyances, leurs habitudes et leurs pratiques, ce qui, selon les universalistes, est contraire au progrès. »[16] Et pourtant, désormais, les Extrêmes-Orientaux attribuent leur réussite économique non aux emprunts à la culture occidentale mais à leur adhésion à leur propre culture. Ils réussissent, pensent-ils, parce qu’ils sont différents des Occidentaux. Cette résurgence des cultures non occidentales, Huntington la désigne au moyen du concept d’ « indigénisation ». Cette indigénisation s’accompagne d’un renouveau religieux favorisé notamment par la chute du communisme. Les civilisations voient le communisme comme le dernier dieu laïc à avoir échoué. La religion prend la place de l’idéologie, et le nationalisme religieux remplace le nationalisme laïc. Nous sommes habitués dans nos pays d’Europe occidentale à associer la pratique religieuse à la vieille génération. Force est de constater que dans les pays musulmans ou encore en Inde, ce sont les jeunes de la classe moyenne qui sont à la tête de ce mouvement religieux qu’Huntington appelle aussi « la revanche de Dieu. » Face à cette déferlante jeune et dynamique, à forte conscience identitaire, Huntington n’a-t-il pas raison de lancer un cri d’alarme, n’en déplaise à ses détracteurs ?
Chapitre V : Economie et démographie dans les civilisations montantes.
Ce chapitre n’est pas essentiel. Il ne fait qu’appuyer, colonnes de chiffres à l’appui que l’économie et la démographie occidentale régressent alors que plusieurs autres civilisations émergent dans les deux domaines. Huntington écrit un peu avant la crise financière asiatique et n’en parle donc pas.
Chapitre VI : La recomposition culturelle de la politique globale.
Une autre conséquence de la fin de la guerre froide est la suivante. Alors qu’avant il était loisible à un peuple de se définir comme non aligné, c’est-à-dire comme n’appartenant ni à l’une ni à l’autre idéologie, il devient de plus en plus difficile à l’heure actuelle d’échapper à cette question : « Qui êtes-vous ? » Selon Huntington, tous les Etats doivent pouvoir répondre à cette question au risque de ne pas trouver leur place dans le concert des nations. Ce problème d’identité est évidemment d’autant plus intense dans les pays où vivent d’importants groupes de population appartenant à différentes civilisations. C’est un élément crucial en effet. Lorsque l’Inde entre en conflit avec son voisin pakistanais, les combats n’embrasent pas seulement les frontières mais également les centres urbains où cohabitent hindous et musulmans. Huntington a très bien compris le danger que pouvaient représenter la cohabitation au sein d’une même entité politique de plusieurs communautés d’origine différentes. La moindre étincelle est susceptible de mettre le feu aux poudres. Nous croyons d’ailleurs que les dirigeants européens commencent tout doucement à comprendre le phénomène : leur refus de prendre part à la dernière guerre du Golfe n’était sans doute pas seulement motivé par le respect des institutions internationales.
Si le livre d’Huntington a suscité tant de cris de chattes effarouchées de la part de nos intellectuels européens « immigrophiles », c’est sans doute parce qu’il est bâti sur un principe très simple, tellement simple mais aussi tellement dérangeant que la propagande émolliente caractérisant nos médias tente chaque jour de nous le faire oublier : les affinités culturelles facilitent la coopération et la cohésion, tandis que les différences culturelles attisent les clivages et les conflits. C’est pourquoi, pour répondre à ses détracteurs, Huntington dresse dans son chapitre six, un argumentaire en six points appuyant ce principe :
- Dans un monde globalisé, les entités culturelles les plus larges sont les civilisations. Il est donc logique que les conflits entre groupes appartenant à différentes civilisations soient centraux dans la politique globale.
- Dans la mesure où l’Occident ne se contente pas d’appliquer la doctrine Monroe à seule sphère civilisationnelle mais cherche à l’étendre au monde entier, il est logique que par réaction, les cultures se radicalisent et adoptent une position défensive sinon de combat.
- L’identité se définit toujours par rapport à l’autre. Si tout le monde était blanc, il serait stupide de nous définir comme étant de race blanche, c’est parce qu’il existe d’autres types de population que cette distinction devient effective. Les exemples historiques ne manquent pas pour prouver que l’attitude des peuples a toujours été modelée selon ce principe. Dans la haute Antiquité, les Grecs se distinguaient des barbares, au Moyen Age et durant les Temps modernes, les règles régissant les relations entre nations chrétiennes étaient différentes de celles dictant l’attitude vis-à-vis des Turcs et des autres « infidèles ». Enfin le Coran distingue clairement le Dar al-Islam et le Dar-al-Harb (c’est-à-dire la zone des convertis et la zone à convertir) et la guerre sainte ne sera jamais totalement terminée tant que l’Islam ne se sera pas imposé à l’ensemble de la planète.
- Les différents culturels sont difficiles à résoudre car les valeurs et les principes d’une culture ne sont pas négociables. Il en va ainsi des problèmes territoriaux très aigus qui opposent musulmans d’Albanie et orthodoxes serbes à propos du Kosovo ou bien des Juifs et des Arabes à propos de Jérusalem, puisque ces lieux ont pour chaque camp une signification historique, culturelle et affective profonde. La question du foulard qui secoue la politique française actuellement et qui pose également des problèmes en Belgique, relève du même type de conflit. De tels problèmes culturels appellent des réponses par oui ou par non, non des demi-mesures.
- Les conflits ont existé, existent et continueront à exister. La guerre est une dimension ontologiquement humaine même si elle est à déplorer. Tout au plus l’homme peut-il diminuer la probabilité qu’elle survienne.
- Huntington reprend enfin l’idée force de Karl Schmitt : l’essence de la politique est de définir qui sont nos amis et qui sont nos ennemis. Une entité politique qui n’a que des amis est une utopie.
La structure des civilisations.
Parmi les concepts opératifs majeurs présents dans son ouvrage, les plus importants à notre sens sont relatifs à la structure des civilisations. Huntington propose de classer les pays selon différentes catégories :
- Etats phares : Une civilisation possède en général un lieu au moins qui est considéré par ses membres comme la source principale de sa culture. Ce lieu est souvent constitué d’un Etat ou de plusieurs Etats. Huntington parle dans ce cas d’Etat phare. L’Etat phare possède un rôle important dans la sphère civilisationelle puisque c’est généralement lui qui fédère les autres Etats autour de lui. Dans la civilisation orthodoxe, c’est la Russie qui joue ce rôle. La civilisation chinoise porte chez Huntington le nom de son Etat phare, la Chine. Nous avons déjà mentionné précédemment que la Chine avait des prétentions à réunir dans un même Etat l’ensemble de ce qu’elle considère comme la civilisation chinoise. L’axe franco-allemand et les Etats-Unis constituent les Etats phares de la civilisation occidentale. Par contre, le problème de la civilisation musulmane, note Huntington, est qu’elle ne possède pas d’Etat phare.
- Pays isolés : Un pays isolé n’a pas d’affinités culturelles avec d’autres sociétés. L’Ethiopie par exemple, est isolée culturellement par sa langue dominante, l’araméen, écrit en caractères éthiopiens, par sa religion dominante, l’orthodoxie copte, par son passé impérial, par ses différences religieuses vis-à-vis de ses voisins en majorité musulmans. Le plus important pays isolé est le Japon. Aucun autre pays n’a la même culture, et les émigrés japonais sont peu nombreux dans les autres pays et guère assimilés culturellement.
- Pays divisés : Ce sont des pays dont le territoire est traversé par une frontière entre civilisations. Ces pays sont confrontés à des problèmes aigus pour préserver leur unité. De nombreux pays africains sont minés par des guerres civiles interminables entre chrétiens et musulmans : Soudan, Nigeria, Tanzanie, Ethiopie… Avec la chute du communisme, la culture a bien souvent remplacé l’idéologie comme facteur d’attraction et de répulsion. « L’effet de division a été particulièrement visible dans les pays divisés dont la cohérence, à l’époque de la guerre froide, était assurée par des régimes communistes légitimés par l’idéologie marxiste-léniniste. La Yougoslavie et l’Union soviétique ont éclaté et se sont divisées en entités nouvelles regroupées sur des bases civilisationnelles : les républiques baltes (protestantes et catholiques) [qui vont d’ailleurs bientôt rejoindre l’Europe], les républiques orthodoxes et musulmanes de l’ex-Union soviétique ; la Slovénie et la Croatie catholiques ; la Bosnie-Herzégovine partiellement musulmane ; la Serbie-Monténégro et la Macédoine orthodoxes en ex-Yougoslavie. Là où ces entités nouvelles rassemblent encore des groupes appartenant à plusieurs civilisations, des divisions de second ordre apparaissent. »[17] Rappelons que le livre d’Huntington a été publié en 1996 et que la guerre du Kosovo n’avait pas encore eu lieu ; pourtant l’auteur écrit déjà à l’époque : « Le Kosovo, peuplé d’Albanais musulmans, restera-t-il paisible au sein de la Serbie orthodoxe slave ? On ne le sait pas. De même, des tensions apparaissent entre la minorité musulmane albanaise et la majorité orthodoxe slave en Macédoine. »[18]
- Pays déchirés : Dans un pays divisé, des forces répulsives éloignent les groupes culturellement différents les uns des autres. Un pays déchiré, par contraste, a une seule culture dominante qui détermine son appartenance à une civilisation, mais ses dirigeants veulent le faire passer à une autre civilisation. La Turquie est le pays déchiré type depuis que, dans les années vingt, elle a tenté de se moderniser, de s’occidentaliser et de s’intégrer à l’Occident.
Chapitre VII : Etats phares, cercles concentriques et ordre des civilisations.
Les rôles assumés par l’Etat phare d’une civilisation sont multiples. Il est à la fois un leader, un protecteur, un gendarme, un modèle et un centre autour duquel gravitent les autres Etats. La création d’un bloc civilisationnel uni politiquement autour de son Etat phare n’est pas si saugrenue que certains voudraient le penser. Elle génère en effet dynamisme et ordre au sein d’un vaste espace géographique et évite souvent nombre de guerres intestines au sein d’une même civilisation. Dans la même logique, l’absence d’Etat phare à l’intérieur d’une civilisation condamne celle-ci à la stagnation et à la faiblesse face aux autres réellement cohérentes.
Un cas particulier, le monde arabe.
A la lumière de cette règle on comprend mieux le manque d’unité du monde arabe. En effet, en Occident, le parangon de la loyauté est depuis le XVIIe siècle l’Etat-nation. Les groupes qui transcendent les Etats-nations - communautés religieuses, linguistiques ou civilisations - requièrent une loyauté et un engagement moins intense. Dans le monde islamique, au contraire, les deux structures fondamentales, originales et durables sont d’une part la famille, le clan, la tribu et d’autre part la Religion et l’Empire à plus grande échelle. Les tribus ont été centrales dans la vie politique des Etats arabes, tandis que les gens se sentaient unis par de-là les différences tribales dans une même communauté de langue, de culture, de style de vie et surtout de religion, la communauté des croyants, la Oumma, transcendant les particularismes.
Cependant, l’Islam est divisé en plusieurs centres de pouvoirs concurrents, chacun tentant de capitaliser à son profit l’identification des musulmans avec la Oumma afin de réaliser la cohésion islamique sous son égide. Le concept de Oumma présuppose que l’Etat-nation n’est pas légitime, et pourtant la Oumma ne peut être unifiée que sous l’action d’au moins un Etat phare fort qui fait actuellement défaut. Pour que l’Islam comme communauté religieuse se matérialise, il faudrait que les suprématies religieuse et politique (califat et sultanat) soient combinées en une seule entité gouvernementale. Ce manque d’unité a été savamment entretenu tout au long de l’histoire coloniale, d’abord par les Britanniques puis après la Deuxième guerre mondiale par les Etats-Unis et leur allié israélien. On sait maintenant que, dans la guerre fratricide qui a opposé l’Iran et l’Irak durant de nombreuses années, la politique des Etats-Unis ne consistait pas à s’engager pour un camp ou pour l’autre mais à en entretenir le conflit afin d’éviter l’émergence de tout Etat phare dans la région.
Il est devenu banal d’affirmer que les Etats-Unis sont partis en guerre contre l’Irak pour s’accaparer les ressources pétrolières du pays. Il l’est peut-être moins d’affirmer que les stratèges américains éliminaient de surcroît un pion gênant sur l’échiquier proche-oriental, cet Irak à l’idéologie ouvertement panarabe et où les discours présidentiels surfaient de plus en plus sur la vague du renouveau islamique. Lorsque les dirigeants européens accusaient l’Amérique de ne pas ramener la paix dans la région mais de semer un trouble encore plus grand, sans doute ne se doutaient-ils pas qu’ils étaient fort proches de la vérité. En prétendant devant les caméras du monde entier, vouloir ramener la paix et la sécurité au Proche-Orient, les Etats-Unis poursuivaient sur le terrain l’objectif inverse : diviser pour régner. Parmi les Etats susceptibles de jouer le rôle de centre au sein de la civilisation islamique, Huntington cite l’Indonésie, l’Egypte, l’Iran, le Pakistan, l’Arabie Saoudite et la Turquie. Il prend bien soin de ne pas mentionner l’Irak ! Notons que les groupes islamistes transnationaux tels les moudjahidin participant au djihad partout où leur foi leur dicte de combattre, ont bien compris la politique du « Grand Satan » et tentent aujourd’hui de fédérer la communauté des croyants par de-là les frontières.
Chapitre VIII : L’Occident et le reste du monde : problèmes intercivilisationnels.
Huntington précise sa théorie du choc des civilisations en hiérarchisant les relations entre les grands blocs civilisationnels. Les aspirations universelles de la civilisation occidentale, la puissance relative déclinante de l’Occident et l’affirmation culturelle de plus en plus forte des autres civilisations suscitent des relations généralement difficiles entre l’Occident et le reste du monde. Cependant leur nature et leur degré d’antagonisme varient considérablement et se décomposent en trois catégories (cf. figure n°4 = figure 9.1. [19]). Avec ses civilisations rivales, l’Islam et la Chine, l’Occident risque d’entretenir des rapports très tendus et même souvent très conflictuels. Ses relations avec l’Amérique latine et l’Afrique, civilisations plus faibles et dans une certaine mesure dépendantes vis-à-vis de lui, impliqueront des conflits moins forts, en particulier avec l’Amérique latine. Les relations de la Russie, du Japon et de l’Inde avec l’Occident risquent, quant à elles, de se situer entre ces deux autres groupes. Ce sont des civilisations qui hésitent entre l’Occident, d’un côté, et les civilisations islamique et chinoise, de l’autre.[20]
Huntington dénoue en les explicitant plusieurs nœuds de problèmes attisant les conflits entre l’Occident et le reste du monde.
La prolifération des armements.
Vu l’avance technologique acquise par les Etats-Unis dans le domaine de l’armement, il existe peu de moyens d’empêcher sa domination. Un bon raccourci pour les Etats consiste à acquérir des armes de destruction massive (bombe nucléaire) avec les moyens de les utiliser (vecteurs tels les missiles). Celles-ci leur permettent tout d’abord d’établir leur domination sur les autres Etats de leur civilisation et de leur région, et, ensuite, elles leur donnent les moyens d’empêcher une invasion de leur civilisation ou de leur région par les Etats-Unis ou d’autres puissances extérieures. Huntington avoue que si l’Irak avait attendu deux ou trois ans pour envahir le Koweit, le temps de posséder des armes nucléaires, il en aurait très probablement pris possession et se serait peut-être même emparé des champs de pétrole saoudiens. Ainsi, le résultat de la Guerre du Golfe n’est pas la réduction de la prolifération des armements mais l’inverse puisque les Etats non occidentaux ont tiré les leçons du conflit. Désormais, des pays comme la Corée du Nord ou l’Inde savent qu’il ne faut pas se battre avec les Etats-Unis à moins d’avoir des armes nucléaires. « Cette leçon, déclare Huntington, a été apprise par cœur par les dirigeants politiques et les généraux dans tout le monde non occidental, avec son corollaire : « Si vous avez des armes nucléaires, alors les Etats-Unis ne se battront pas avec vous. » »[21] Nous le rappelons, ce livre a été écrit en 1996. Peu de temps après se déroulaient effectivement les premiers essais nucléaires indiens. Et dernièrement, la Corée du Nord a relancé son programme nucléaire ! Autre conséquence évidente de ce principe. Alors que son armée est en pleine déliquescence, la Russie compte toujours parmi les grandes puissances parce qu’elle a réussi à maintenir un arsenal nucléaire suffisant en état de marche. Paradoxalement, la possession de quelques armes nucléaires devient l’arme des faibles. Le terrorisme constitue également une arme privilégiée des faibles ; la plupart des Etats étant démunis quant à la réponse à apporter à ce type d’agression. L’Etat ne peut réagir en attaquant un autre Etat comme dans une guerre classique : le conflit possède désormais un caractère asymétrique !
Ce type de conflit est d’ailleurs tellement embarrassant pour les Etats modernes qu’il est souvent dénoncé comme « injuste ». Les Américains parlent souvent, à propos de l’usage des armes de destruction massive ou d’attentats terroristes, d’attaques « non conventionnelles », « lâches », « contraires aux lois de la guerre » parce qu’elles s’en prennent à des civils. Cette technique de propagande n’est pas neuve et il ne faut pas se laisser prendre à ce genre de jeu sémantique sur le caractère « juste » ou « injuste » des armes employées. Peut-être faudrait-il d’ailleurs rappeler aux Etats-Unis que ces attaques « non conventionnelles » étaient considérées il n’y a pas si longtemps par leur Etat-Major comme tout à fait conventionnelles, notamment dans le cadre de leur opération « Little Boy » à Nagasaki et Hiroshima. Ces attaques « non conventionnelles » sont en réalité la conséquence logique de l’hyper puissance américaine puisqu’elles sont à ce jour les seuls moyens de résistance réellement efficaces des peuples qui ont choisi de résister au diktat U.S. Toutefois, Huntington met en garde l’Occident : « Isolément, le terrorisme et les armements nucléaires sont l’arme des faibles hors d’Occident. S’ils les combinent, les faibles non occidentaux deviendront forts. »[22]
Les Etats-Unis ont toujours soutenu, depuis qu’ils maîtrisent l’atome, une politique de non-prolifération des armes nucléaires tant à l’extérieur de l’Alliance Atlantique qu’en son sein. Seuls les Britanniques ont pu bénéficier de cette technologie qu’ils ont toutefois dû développer en partenariat avec leurs cousins d’outre-Atlantique. La fronde française, face à cet état de fait, a permis à un autre pays membre de l’OTAN de développer son propre arsenal. Selon Huntington, à cette politique de non-prolifération doit logiquement succéder une politique de « prolifération négociée ». C’est ce qu’il appelle « la diffusion lente et inéluctable de la puissance dans un monde multicivilisationnel. »[23] De plus, le politologue américain souligne que les Etats-Unis pourraient profiter de ce changement en stimulant la prolifération dans l’intérêt des Etats-Unis et de l’Occident. En d’autres mots, certains Etats alliés recevraient l’autorisation de développer un arsenal nucléaire. Huntington pense notamment au Japon qui pourrait ainsi contrecarrer la puissance nucléaire chinoise, permettant ainsi de sanctuariser leur propre pays et de placer en première ligne leurs alliés dans le cadre d’une guerre nucléaire. Un exemple contemporain de l’efficacité de la prolifération négociée est l’arsenal nucléaire israélien permettant de contrebalancer toute volonté de puissance arabe au Proche-Orient.
Les droits de l’homme et la démocratie.
L’auteur reconnaît honnêtement que les droits de l’homme et la démocratie ne sont pas des valeurs partagées par l’ensemble des peuples de la planète et qu’il devient illusoire, voire même dangereux, vu la puissance déclinante de l’Occident, de vouloir absolument imposer ces valeurs. Non seulement cette influence diminue, mais le paradoxe de la démocratie atténue aussi la volonté occidentale de défendre la démocratie dans le monde d’après la guerre froide. « Le présupposé occidental selon lequel des gouvernements élus démocratiquement seront coopératifs et pro-occidentaux pourrait bien se révéler faux dans les sociétés non occidentales où la compétition électorale peut porter au pouvoir des nationalistes et des fondamentalistes anti-occidentaux. » C’est sans doute la raison pour laquelle les Etats-Unis ne mettent pas trop d’ardeur à l’heure actuelle pour transmettre le pouvoir à un gouvernement de transition élu démocratiquement par l’ensemble du peuple irakien. S’ils sont allés au feu, ils entendent bien préserver quelques avantages sur le terrain ![24]
L’immigration.
Lorsqu’il lit le chapitre d’Huntington consacré à l’immigration, le lecteur se rend vite compte qu’il n’a pas affaire à un auteur de gauche. Un auteur belge ou français s’autorisant de telles assertions aurait tôt fait d’être taxé de raciste et de fasciste, voire d’être traduit devant un tribunal pour incitation à la xénophobie. Huntington ne fait pourtant que constater des évidences.
- « Si la démographie dicte le destin de l’histoire, les mouvements de population en sont le moteur. (…) S’il y a une « loi » de l’immigration, soutient Myron Weiner, elle stipule que le flux migratoire, une fois qu’il a commencé à couler, induit son propre flux. Les émigrés permettent à leurs frères et à leurs proches restés au pays d’émigrer en leur donnant des informations sur la façon de s’y prendre, en leur fournissant des moyens pour se déplacer et de l’aide pour trouver un travail et un logement. » Il en résulte selon ses propres termes, une « crise migratoire globale ». »[25]
Les citations ci-après prouvent également que Huntington est particulièrement bien renseigné sur la situation européenne :
- « Au début des années quatre-vingt-dix, les deux tiers des immigrés en Europe étaient musulmans. La préoccupation des Européens en la matière concernait par-dessus tout l’immigration musulmane. Le défi est démographique – les immigrés représentent 10 % des naissances en Europe occidentale et les Arabes 50 % de celles-ci à Bruxelles – et culturel. Les communautés musulmanes, turque en Allemagne ou algérienne en France, n’étaient pas intégrées dans leur culture d’accueil et, au grand dam des Européens, ne semblaient pas devoir l’être. »[26]
- « Vis-à-vis des immigrés, l’hostilité européenne est étrangement sélective. Peu de gens en France s’inquiètent d’un afflux de ressortissants de l’Est – les Polonais, après tout, sont européens et catholiques. Les immigrés africains qui ne sont pas arabes ne sont pour la plupart ni redoutés ni méprisés. Le mot « immigré » est potentiellement synonyme de musulman, l’Islam étant aujourd’hui la deuxième religion en France (…). »[27]
- « L’opposition publique à l’égard de l’immigration et l’hostilité vis-à-vis des immigrés se manifestent dans des cas extrêmes par des violences perpétrées contre des communautés musulmanes et des personnes. Ce fut en particulier un problème en Allemagne au début des années quatre-vingt-dix. Plus significative est l’augmentation des suffrages ralliés par les partis d’extrême droite, nationalistes et anti-immigrés. En France, le Front national, négligeable en 1981, est monté à 9,6 % en 1988 et s’est ensuite stabilisé entre 12 et 15 % aux élections régionales et législatives. En 1995, les deux candidats nationalistes à la présidence de la République ont rassemblé 19,9 % des voix (…). En Belgique, le Bloc flamand et le Front national ont progressé de 9 % aux élections locales de 1994, le Bloc obtenant 28 % à Anvers. (…) Ces partis européens hostiles à l’immigration étaient pour une bonne part l’image en miroir des partis islamistes dans les pays musulmans. C’étaient des outsiders dénonçant un establishment social et politique corrompu. »[28]
- « L’Europe ou bien les Etats-Unis peuvent-ils inverser la tendance ? En France, le pessimisme démographique est de mise, depuis le roman de Jean Raspail[29] dans les années soixante-dix jusqu’aux analyses académiques de Jean-Claude Chesnais[30] dans les années quatre-vingt-dix. Pierre Lellouche l’a bien résumé en 1991 : « L’histoire, la géographie et la pauvreté montrent que la France et l’Europe sont destinées à être noyés par la population des pays à problèmes du Sud. L’Europe était blanche et judéo-chrétienne dans le passé ; elle ne le sera plus à l’avenir. »[31] »[32]
- « Les sociétés européennes ne veulent en général pas assimiler les immigrés ou bien elles éprouvent de grandes difficultés à le faire. Les immigrés musulmans et leurs enfants sont également ambigus quant à leur désir d’assimilation[33]. Une immigration importante ne peut donc que produire des pays divisés entre chrétiens et musulmans. Ce phénomène pourrait être évité si les gouvernements et les électeurs européens étaient prêts à payer le prix de mesures restrictives (…). »[34]
Chapitre IX : La politique globale des civilisations.
Etats phares et conflits frontaliers.
Dans un monde reposant sur l’ordre des civilisations, les relations entre entités appartenant à différentes civilisations seront souvent conflictuelles, prophétise Huntington. La paix froide, la guerre froide, la guerre commerciale, la quasi-guerre, la drôle de paix, les relations agitées, la rivalité intense, la coexistence dans la concurrence, la course aux armements seront autant d’expression caractérisant les relations intercivilisationnelles. La confiance et l’amitié seront rares. Huntington prévoit deux grands types de conflit :
- Au niveau local, les conflits civilisationnels surviendront entre Etats voisins appartenant à différentes civilisations comme dans l’ex-Union soviétique et l’ex-Yougoslavie.
- Au niveau global, les conflits entre Etats phares auront lieu entre les grands Etats appartenant à différentes civilisations. Les conflits surviendront par exemple lorsqu’un Etat phare d’une civilisation donnée montera en puissance et mettra ainsi en péril la position d’Etats phares appartenant à d’autres civilisations.
L’Islam et l’Occident.
Huntington développe à propos de l’Islam, et de sa relation avec l’Occident, toute une série d’idées assez sulfureuses. Le fait que le politologue attribue à cette relation un caractère problématique est une des raisons majeures expliquant l’ire que son ouvrage a suscitée dans les milieux bien pensant européens. Toutefois, vous allez pouvoir constater que ces idées ne sont pas totalement dénuées de sens. « Certains Occidentaux, déclare-t-il, comme le président Bill Clinton, soutiennent que l’Occident n’a pas de problèmes avec l’Islam, mais seulement avec les extrémistes violents. Quatorze cents ans d’histoire démontrent le contraire. Les relations entre l’Islam et le Christianisme, orthodoxe comme occidental, ont toujours été agitées. Chacun a été l’autre de l’autre. (…) C’est la seule civilisation qui a mis en danger l’existence même de l’Occident, et ce à deux reprises.[35] »[36]
Les causes de cet affrontement pluriséculaire et irréductible ne sont pas contingentes mais résident dans la nature même des deux religions, déclare Huntington : « Tous deux sont universalistes et prétendent incarner la vraie foi, à laquelle tous les humains doivent adhérer. Tous deux sont des religions missionnaires dont les membres ont l’obligation de convertir les non-croyants. Depuis ses origines, l’Islam s’est étendu par la conquête et, le cas échéant, le Christianisme aussi. Les concepts parallèles de « Jihad » et de « Croisade » se ressemblent beaucoup et distinguent ces deux fois des autres grandes religions du monde. »[37]
A l’heure actuelle, le conflit a toutefois changé de visage. En effet, c’est moins contre l’Occident chrétien que les musulmans se battent aujourd’hui que contre l’Occident athée, ayant élevé le matérialisme au rang de religion universelle. Auparavant, l’ennemi des musulmans était le matérialisme dialectique en provenance des pays communistes. Désormais, l’ennemi principal des musulmans est le matérialisme marchand.
Dernier élément sur lequel Huntington insiste dans la relation Islam/Occident : à mesure que l’influence de l’Occident s’efface des anciennes colonies du Proche-Orient, l’émergence d’Etats phares capables d’unir le monde arabe se fait plus pressante, elle est aussi plus probable. On considère trop souvent que les musulmans engagés dans la guerre contre l’Occident ne représentent que la minorité. Les scènes de liesse dans les rues de nombreux pays à majorité musulmane où dans certains faubourgs musulmans de nos villes européennes le 11 septembre 2001 laissent présumer le contraire ! Soutenir et applaudir, fussent-ils des actes passifs, constituent les premières étapes de la résistance… et de la résistance à la lutte, le pas est vite franchi.
L’Asie, la Chine et l’Amérique.
Pour Huntington, l’Asie, particulièrement l’Extrême-Orient, constitue le théâtre le plus probable des conflits entre civilisations. Il donne d’ailleurs à cette région le nom de « chaudron des civilisations ». En effet, « rien qu’en Extrême-Orient, on trouve des sociétés qui appartiennent à six civilisations – japonaise, chinoise, orthodoxe, bouddhiste, musulmane et occidentale -, plus l’Hindouisme en Asie du Sud. Les Etats phares de quatre civilisations, le Japon, la Chine, la Russie et les Etats-Unis, sont des acteurs de poids en Extrême-Orient ; l’Inde joue également un rôle majeur en Asie du Sud, tandis que l’Indonésie, pays musulman, monte de plus en plus en puissance. »[38]
Le risque de conflit généralisé dans la région est encore aggravé par les interactions de plus en plus nombreuses entres les sociétés asiatiques et les Etats-Unis. Or, constate Huntington, il existe des différences fondamentales de valeur entre les civilisations asiatiques et la civilisation américaine : « L’ethos confucéen dominant dans de nombreuses sociétés asiatiques valorise l’autorité, la hiérarchie, la subordination des droits et des intérêts individuels, l’importance du consensus, le refus du conflit, la crainte de « perdre la face » et, de façon générale, la suprématie de l’Etat sur la société et de la société sur l’individu. En outre, les Asiatiques ont tendance à penser l’évolution de leur société en siècles et en millénaires, et à donner la priorité aux gains à long terme. Ces attitudes contrastent avec la primauté, dans les convictions américaines, accordée à la liberté, à l’égalité, à la démocratie et à l’individualisme, ainsi qu’avec la propension américaine à se méfier du gouvernement, à s’opposer à l’autorité, à favoriser les contrôles et les équilibres, à encourager la compétition, à sanctifier les droits de l’homme, à oublier le passé, à ignorer l’avenir et à se concentrer sur les gains immédiats. »[39]
Enfin, comme nous l’avons théorisé ici plus haut, les Etats-Unis ne peuvent supporter l’émergence de la Chine comme puissance régionale en Extrême-Orient car elle est contraire selon Huntington, aux intérêts vitaux américains. Notons au passage que le gros problème de la politique américaine est le suivant : ils adoptent la doctrine Monroe à l’échelle de leur continent mais ils ne supportent pas que les Etats phares des autres civilisations fassent de même avec leur propre sphère de rayonnement ! Précisons toutefois qu’une Chine trop dynamique au point de vue démographique, serait contraire également à nos propres intérêts. En effet, la Chine risque à terme de déverser son trop plein de population en Europe ou dans les vastes espaces de la Sibérie, riches en matière première. A l’inverse des Etats-Unis, nous ne sommes pas opposés au rayonnement de la Chine en Extrême-Orient, du moment que cette expansion ne déborde pas sur notre propre sphère civilisationnelle qui comprendra nécessairement la Sibérie.
Face à cette montée en puissance de la Chine, les Américains espèrent jouer la carte du Japon, Etat traditionnellement « suiviste » de la puissance U.S. depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale. Le « suivisme » est un des autres concepts développés par Huntington. Selon lui, les Etats peuvent réagir de deux manières à la montée d’une puissance nouvelle. « Seuls ou alliés à d’autres, ils peuvent s’efforcer d’assurer leur sécurité en recherchant l’équilibre avec la puissance émergeante, la refouler ou, si nécessaire, entrer en guerre avec elle pour la vaincre. Au contraire, ils peuvent se rallier à elle, se mettre d’accord avec elle et adopter une position secondaire ou subordonnée vis-à-vis d’elle dans l’espoir de voir leurs intérêts clés protégés. »[40] Une solution médiane constituerait à alterner recherche de l’équilibre et « suivisme » mais elle risquerait à terme de vexer à la fois la puissance émergeante et les alliés alternatifs. On comprendra aisément, suite à cette définition du « suivisme », que la solution japonaise n’est pas idéale pour les Etats-Unis puisque la particularité d’un Etat « suiviste » est d’abandonner la puissance dominante, une fois qu’une autre puissance émerge. Effectivement, suite au déclin de l’Occident, le Japon restera-t-il fidèle à son allié américain ? Choisira-t-il l’orbite chinoise ? Nous ne pouvons qu’espérer l’émergence d’une nouvelle puissance dans la région : l’Empire eurosibérien qui saura séduire et rallier la civilisation japonaise et son porte-avions insummersible.
Chapitre X : Des guerres de transition aux guerres civilisationnelles.
Caractéristiques des guerres civilisationnelles.
Elles ont tendance à être très violentes et sanglantes parce qu’elles mettent en jeu des questions fondamentales d’identité. En outre, elles traînent souvent en longueur ; il arrive qu’elles soient entrecoupées de trêves ou d’ententes, mais en général ces dernières ne durent pas, et les combats reprennent. « D’autre part, en cas de victoire militaire décisive de l’un des deux camps, les risques de génocide sont plus élevés lorsqu’il s’agit d’une guerre civile identitaire. (…) Les conflits civilisationnels sont parfois des luttes pour le contrôle des populations. Mais, le plus souvent, c’est le contrôle du sol qui est en jeu. Le but de l’un des participants au moins est de conquérir un territoire et d’en éliminer les autres peuples par l’expulsion, l’assassinat ou les deux à la fois, c’est-à-dire par la purification ethnique. »[41] Les exemples du Ruanda ou encore du Kosovo sont éloquents à cet égard ! Retenons en tout cas ces deux caractéristiques fondamentales :
- Comme elles mettent en jeu des questions fondamentales d’identité et de pouvoir, on a du mal à les résoudre par des négociations ou des compromis. Un armistice obtenu ne signifie d’ailleurs jamais la fin d’un conflit qui, tel un feu de forêt maîtrisé, peut reprendre avec violence à tout instant.
- Les guerres civilisationnelles éclatent entre groupes qui font respectivement partie d’ensembles culturels plus larges. Les risques d’extension de la guerre sont donc énormes, surtout dans le monde « connecté » et « internationalisé » qui est le nôtre. « Les migrations ont donné naissance à des diasporas dans des tierces civilisations. Les communications permettent plus facilement aux parties en présence d’appeler à l’aide, et à leurs « proches parents » d’apprendre immédiatement ce qui arrive à leurs alliés. Le rétrécissement permet ainsi aux « groupes apparentés » de fournir un soutien moral, diplomatique, financier et matériel aux parties en présence. (…) A son tour, le soutien apporte un renfort aux parties en présence et prolonge le conflit. »[42]
Chapitre XI : La dynamique des guerres civilisationnelles.
Les guerres civilisationnelles sont particulièrement intenses, non seulement sur le terrain mais également psychologiquement, puisqu’elles mobilisent tout autant l’énergie des combattants que leur conscience identitaire. De par ce caractère identitaire, elles ont des retombées néfastes sur l’ensemble des habitants des civilisations concernées. Une menace localisée est naturellement magnifiée et généralisée à l’échelle de la civilisation. Au début des années quatre-vingt-dix, les Russes ont ainsi défini les guerres entre clans et régions du Tadjikistan, ou la guerre en Tchétchénie, comme des épisodes d’un affrontement plus large, pluriséculaire, entre l’Orthodoxie et l’Islam, tandis que les opposants musulmans étaient engagés dans un djihad, soutenus par des groupes islamistes radicaux exploitant la conscience identitaire des révoltés. De même une défaite locale d’un pays face à un pays appartenant à une autre civilisation, peut résonner comme un échec cuisant à l’échelle civilisationnelle. On comprend dès lors l’acharnement que certains Etats phares mettent pour soutenir des Etats secondaires dans des conflits locaux. La « théorie des dominos » en vogue durant la guerre froide est remise à l’honneur : une défaite dans un conflit local peut provoquer des pertes de plus en plus lourdes et conduire ainsi au désastre à l’échelle de la civilisation.[43] Huntington note également que les processus de « diabolisation » sont particulièrement intenses dans les affrontements de civilisations : les opposants sont souvent dépeints comme des sous-hommes, ce qui donne le droit de les tuer. De même, leur culture est vouée aux gémonies : tous les symboles, tous les objets culturels de l’adversaire deviennent des cibles. On se rappellera au Kosovo des mosquées détruites par les forces serbes mais aussi des monastères orthodoxes saccagés par les Albanais. « Dans les guerres entre culture, la culture est toujours perdante. »[44]
Les ralliements de civilisation : pays apparentés et diasporas.
A la différence de la guerre froide, les conflits de civilisation ne s’écoulent pas du haut vers le bas. Ils bouillonnent à partir du bas. Les Etats et les groupes ont différents niveaux d’engagement dans une guerre de ce genre (cf. figure n°5 = figure 11.1.[45]) :
- Niveau primaire : les parties belligérantes qui s’entre-tuent. Ce sont parfois des Etats, parfois des Etats embryonnaires comme en Bosnie ou au Nagorny-Karabakh ou des groupes locaux.
- Second niveau : Ce sont généralement des Etats directement apparentés aux belligérants de base. Par exemple l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le Caucase. La Serbie et la Croatie en ex-Yougoslavie.
- Troisième niveau : Ce sont des Etats éloignés du théâtre des affrontements mais qui ont des liens de civilisation avec les belligérants, tels l’Allemagne, la Russie et les Etats islamiques dans le conflit yougoslave ou tels la Russie, l’Iran et la Turquie dans le cas du différend arméno-azéri.
Dans le cadre d’un conflit régional entre des factions appartenant à deux civilisations différentes, les intérêts des gouvernements de deuxième et troisième échelon sont plus compliqués que ceux des belligérants de base. Ils apportent généralement leur soutien aux combattants élémentaires et même s’ils ne le font pas, dit Huntington, ils sont soupçonnés de le faire par les pays ennemis. Toutefois, ces gouvernements ont souvent intérêt à contenir les tensions de la base, afin de ne pas être entraînés dans un conflit civilisationnel plus large et plus destructeur. De ce constat très ingénieux, Huntington élabore une méthodologie de résolution des conflits.
Arrêter les guerres civilisationnelles.
Les parties de la base ont souvent beaucoup de mal à s’asseoir à la même table des négociations. Les enjeux et les haines sont trop aiguës pour espérer par ce biais une résolution pacifique du conflit. Les guerres entre pays d’une même civilisation ont l’avantage de pouvoir parfois être résolues par la médiation d’une tierce partie désintéressée, ayant une légitimité auprès des pays belligérants. Souvent l’Etat phare joue un rôle d’arbitre au sein de la civilisation et limite les tensions entre les communautés. Par contre, il est difficile dans un conflit civilisationnel de trouver une tierce partie qui ait la confiance des deux protagonistes. C’est pourquoi « les guerres civilisationnelles ne sont pas interrompues par des individus, groupes ou organisations désintéressés, mais par des parties intéressées de deuxième et troisième échelon, parties qui se sont attiré le soutien de leur parentèle et qui ont la capacité de négocier des accords avec leurs homologues, d’une part, et de convaincre leur parenté d’accepter ces accords, d’autre part. »[46] C’est également la raison pour laquelle, « les guerres sans parties de deuxième et de troisième échelon ont moins tendance à s’étendre que les autres guerres, mais elles sont aussi plus difficiles à arrêter, tout comme les guerres entre groupes appartenant à des civilisations sans Etat central. »[47]
Huntigton, grâce aux outils de pensée qu’il a façonnés, modélise ainsi l’arrêt des combats complet dans un conflit civilisationnel. Cet arrêt suppose :
- « l’implication active des parties de deuxième et troisième échelon,
- des négociations entre parties de troisième échelon sur les termes généraux d’un arrêt des combats,
- l’utilisation par ces parties de troisième échelon de la carotte et du bâton pour obtenir que les parties de deuxième échelon acceptent ces termes et fassent pression dans le même sens sur les parties de premier échelon,
- le retrait du soutien venant du deuxième échelon et, en fait, la trahison du premier échelon par les parties du deuxième échelon,
- et, résultat de ces pressions, l’acceptation des termes par les parties du premier échelon qui, bien entendu, les subvertiront quand elles considéreront que c’est là leur intérêt. »[48]
Chapitre XII : L’Occident, les civilisations et la civilisation.
Dans son dernier chapitre, Huntington développe sa réflexion sur le déclin de l’Occident. Autant dire qu’il n’y va pas avec le dos de la cuillère. Nous avons déjà évoqué plus haut les caractéristiques du déclin de l’Occident et de l’Europe. Celui-ci touche les domaines moraux, démographiques, culturels et partiellement militaires. Nous n’y reviendrons pas davantage. Huntington insiste cependant sur le fait que « du déclin naît le risque d’invasion « quand la civilisation n’est plus capable de se défendre elle-même parce qu’elle n’a plus la volonté de le faire, elle s’ouvre aux envahisseurs barbares » qui viennent souvent « d’une autre civilisation plus jeune et plus puissante. »[49] »[50] Néanmoins « tout est possible, mais rien n’est inévitable : tel est l’enseignement primordial qui ressort de l’histoire des civilisations. Les civilisations peuvent, et ont pu, se réformer, se renouveler. Le problème majeur pour l’Occident est le suivant : indépendamment de tout défi extérieur, est-il capable d’arrêter le processus de déclin interne et d’inverser la tendance. »[51]
L’un des grands périls qui guette notre civilisation d’après le politologue américain, c’est la modification du substrat ethnique européen avec comme conséquence l’émergence d’une société prétendument multiculturelle. Dans le cas de l’Europe, la forte minorité arabo-islamique en pleine progression, ne manifestant désormais plus aucun désir de s’intégrer culturellement, devient un foyer de contestation et même de rejet des valeurs européennes en terre européenne ! Aux Etats-Unis comme en Europe, une coalition de politiciens irénistes et de gauchistes utopistes prétendent y voir un enrichissement et les prémisses d’une société multiethnique et multiculturelle harmonieuse. Face à ces délires, le jugement d’Huntington est sans appel : « L’histoire nous apprend qu’aucun Etat ainsi constitué n’a jamais perduré en tant que société cohérente. (…) L’avenir des Etats-Unis et celui de l’Occident dépend de la foi renouvelée des Américains en faveur de la civilisation occidentale. Cela nécessite de faire taire les appels au multiculturalisme, à l’intérieur de leurs frontières. (…) Les Américains font partie de la famille culturelle occidentale ; les partisans du multiculturalisme peuvent entamer, voire détruire cette relation, ils ne peuvent lui en substituer une autre. Quand les Américains cherchent leurs racines culturelles, ils les trouvent en Europe. »[52]
Huntington préconise aussi une nouvelle construction géopolitique autour d’une zone de libre-échange transatlantique, suivie d’une véritable intégration politique, capable de donner les moyens d’un redressement civilisationnel et de redonner à l’Occident son statut de puissance hégémonique. C’est ici que l’on voit tout l’intérêt que les Américains ont d’empêcher la création d’un bloc impérial eurosibérien car selon lui : « le rejet des principes fondamentaux et de la civilisation occidentale signifie la fin des Etats-Unis d’Amérique tels que nous les avons connus. Cela signifie également la fin de la civilisation occidentale. Si les Etats-Unis se désoccidentalisent, l’Ouest se réduira à l’Europe et à quelques zones d’implantation européenne, faiblement peuplées. Sans les Etats-Unis, l’Occident ne représente plus qu’une fraction minuscule et déclinante de la population mondiale, abandonnée sur une petite péninsule à l’extrémité de la masse eurasienne. »[53]
Clefs pour l’avenir.
L’auteur, après avoir dressé un tableau de l’état déplorable de la civilisation occidentale, préconise toute une série de solutions mais il insiste surtout sur le fait que l’Occident doit renoncer à « sa prétention à l’universalité, [qui] tient pour évident que les peuples du monde entier devraient adhérer aux valeurs, aux institutions et à la culture occidentale parce qu’elles constituent le mode de pensée le plus élaboré, le plus lumineux, le plus libéral, le plus rationnel, le plus moderne. Dans un monde traversé par les conflits ethniques et les chocs entre civilisations, la croyance occidentale dans la vocation universelle de sa culture a trois défauts majeurs : elle est fausse, elle est immorale et elle est dangereuse. (…) L’impérialisme est la conséquence logique de la prétention à l’universalité. »[54] Il constate que les prétentions dans ce domaine pourraient mener à des conflits graves avec les autres civilisations et conduire éventuellement à la défaite de l’Occident. « En résumé, pour éviter une guerre majeure entre civilisations, il est nécessaire que les Etats phares s’abstiennent d’intervenir dans les conflits survenant dans des civilisations autres que la leur. C’est une évidence que certains Etats, particulièrement les Etats-Unis, vont avoir, sans aucun doute, du mal à admettre. »[55] C’est la règle de l’abstention. Cette règle préconise aussi que les Etats phares s’entendent pour contrôler et réduire les conflits frontaliers entre leur civilisation respective.
Huntington propose aussi que les institutions internationales soient profondément remaniées afin que le Conseil de Sécurité de l’ONU cesse d’être le club des vainqueurs de la Seconde guerre mondiale et qu’il accueille la nation phare de chaque grande civilisation, créant ainsi un forum permanent de dialogue intercivilisationnel.
Analyse : Ce que nous retenons, ce que nous critiquons.
Ce que nous retenons.
Nous considérons cet ouvrage comme fondamental et très stimulant pour une pensée prospective dans les relations internationales et civilisationnelles. Les nombreux concepts opératifs contenus dans son livre se révèlent précieux et peuvent être repris dans nos propres analyses et nos propres théories. Le caractère essentiel du livre n’a pas échappé à la critique universitaire et médiatique qui comme à son habitude, incapable qu’elle est de répondre à une pensée bien construite, s’est contentée de falsifier et de diffamer l’auteur et sa thèse afin de le discréditer.
Si Huntington ne cite pas des géopoliticiens comme Carl Schmitt ou Karl Haushofer, il nous a semblé que le concept de « civilisation » qu’il développe n’est pas sans lien avec celui de Großräume (Grand Espace) présent dans l’œuvre des deux théoriciens allemands. « Il [Carl Schmitt] souhaite surtout que différents grands espaces se constituent entre lesquels un nouveau nomos [en grec : la Loi, le Principe ordonnateur] devrait voir le jour. (…) La rivalité de ces grands espaces au sein d’un droit international reconnu[56] assurerait la présence d’amis et d’ennemis et maintiendrait l’histoire en mouvement. »[57] Contre la vision économico-matérialiste des libéraux, Carl Schmitt rejoint le schéma huntingtonien d’une unité politique basée sur une culture civilisationnelle : « Mais si l’idée de Großräume, de « Grand Espace », est née de la conviction que les Etats étaient devenus trop petits au regard du développement de la technique et de l’économie, les théoriciens de ce « Grand Espace » ont également dit que celui-ci ne pouvait être ni bâti ni organisé en priorité sur l’économie. La conservation de la multiplicité des cultures est désormais un acte politique. »[58] Cependant Carl Schmitt va plus loin que la conception immanente d’Huntington car il insuffle à sa théorie une dimension transcendantale : « L’Etat universel technicisé et normalisé lui semble l’œuvre de l’Antéchrist : contre cette possibilité, il entend mobiliser la puissance « catéchontique » d’un nouvel ordre juridique liant entre eux les grands espaces. »[59] De même il semble qu’on puisse rapprocher le concept huntingtonien d’ « Etat phare » avec le concept schmittien d’ « Hegemon » qui doivent tous deux être le moteur de la création d’un « Grand Espace » (ou Etat civilisationnel) : « (…) L’idée d’unir plusieurs Etats sans qu’il n’y ait de puissance hégémonique est une impossibilité sociologique. Aucune véritable fédération, au sens propre du terme, ne peut voir le jour sans hegemon. »[60] Toute cette analyse mériterait cependant une recherche plus approfondie, nous nous bornons ici à tracer des pistes.
Huntington fait une analyse très intéressante de la méthode par laquelle les élites islamiques ont entrepris la reconquête de leur sphère civilisationnelle. Alors que les milieux néo-droitistes nous ont gavé de théories sur la prise de contrôle du pouvoir culturel, sans grande réussite effective d’ailleurs, les Islamistes, eux, nous donnent l’exemple d’une réussite indéniable dans le domaine. Tout comme les Musulmans, nous devons faire de la métapolitique (gramscisme) efficace en investissant non seulement la sphère politique mais surtout la sphère sociale et culturelle. L’idéologie révolutionnaire ne doit pas seulement s’exprimer dans le domaine intellectuel para-universitaire mais doit répondre aussi aux questions et aux problèmes concrets des gens. Elle doit ensuite montrer sur le terrain que ses idées sont efficaces au contraire de celle du pouvoir, raison majeure pour laquelle la population doit la soutenir. Prendre le pouvoir, c’est s’imposer comme la seule alternative possible, y compris en cassant les autres mouvements contestataires. D’ailleurs, selon le mot d’ordre de Guy Debord dans ses Commentaires sur la société du spectacle : « Le premier mérite d’une théorie critique exacte est de faire instantanément paraître ridicule toutes les autres. » « Mais il faut aussi qu’elle soit une théorie parfaitement inadmissible [par le système et son discours]. Il faut qu’elle puisse déclarer mauvais, à la stupéfaction indignée de tous ceux qui le trouvent bon, le centre même du monde existant, en en ayant découvert la nature exacte. »
Ce que nous critiquons.
La question russe.
Dans son livre, Huntington pose la question suivante : « La Russie doit-elle adopter les valeurs, les institutions et les pratiques occidentales, et tenter de s’intégrer à l’Occident ? Ou bien incarne-t-elle une civilisation orthodoxe et eurasiatique différente de l’Occident et dont le destin serait de relier l’Europe et l’Asie ? Les élites intellectuelles et politiques et l’opinion sont divisées sur ces questions. D’un côté, on trouve les partisans de l’occidentalisation, les « cosmopolites », les « atlantistes », et de l’autre, les successeurs des slavophiles, qualifiés diversement de « nationalistes », d’ « eurasianistes » ou de « derzhavniki » (Etatistes). »[61] Huntington répond clairement à cette question dans sa conclusion. Il faut selon lui intégrer à l’Union européenne et à l’OTAN les Etats occidentaux de l’Europe centrale, c’est-à-dire les Etats du sommet de Visegrad[62], les Républiques baltes, la Slovénie et la Croatie. Il faut considérer la Russie comme l’Etat phare du monde orthodoxe et comme une puissance régionale essentielle, ayant de légitimes intérêts dans la sécurité de ses frontières sud. Les intérêts des Etats-Unis seront mieux défendus s’ils évitent de prendre des positions extrêmes en cherchant par exemple à intervenir dans les affaires des autres civilisations et s’ils adoptent une politique atlantiste de coopération étroite avec leurs partenaires européens, afin de sauvegarder et d’affirmer les valeurs de leur civilisation commune.[63] Nous ne sommes pas d’accord avec Huntington pour deux raisons :
- Premièrement la Russie fait partie intégrante de l’Europe. Huntington considère qu’il existe une séparation entre ce qu’il appelle l’Europe occidentale et le monde orthodoxe. Or nous ne voyons pas pourquoi la séparation entre peuples latins catholiques et germaniques protestants d’une part et peuples slaves orthodoxes d’autre part serait plus grave et plus fondamentale que la séparation entre peuples latins et germaniques. Au contraire, puisque Huntington affirme dans son ouvrage que la religion est un élément primordial pour définir la culture d’une civilisation, nous pourrions arguer que le catholicisme considère les orthodoxes comme simplement schismatiques alors qu’il qualifie les protestants d’hérétiques. L’histoire européenne elle-même vient infirmer les thèses du politologue américain. En effet, la Russie n’a-t-elle pas été au cours des derniers siècles un protagoniste majeur dans les relations entre pays européens ?
- Deuxièmement, l’Europe ne fait pas partie de l’Occident. Comme l’avait déjà démontré dans les années quatre-vingt Guillaume Faye, il n’y a pas identité entre Occident et Europe. Les deux termes sont même antagonistes. Osons l’affirmer, l’Occident tel que défini par Huntington, moderne, héritier de l’Antiquité classique remise à l’honneur par la Renaissance et les Lumières, caractérisé par l’Etat de droit, le pluralisme social et l’individualisme, et spirituellement ancré dans le catholicisme de Vatican II lié au protestantisme, cet Occident là est une couverture répugnante qui étouffe le vieux brasier européen sommeillant au plus profond de nous, un feu qui couve et qui ne demande qu’à renaître. Nos cousins d’outre-Atlantique ne possèdent pour culture que cette couverture odieuse, émergence cancéreuse de nos racines profondes et saines. Marc Rousset, dans son livre sur les Euro-ricains, dresse à la fin de celui-ci le portrait de l’authentique Européen. En voici un petit florilège :
- « Gouverner [pour un Européen], c’est croire dans le politique, au sens noble et gaullien du terme (…). Gouverner, ce n’est pas flatter l’opinion, mais faire les choix qui s’imposent dans l’intérêt du pays ! »
- « Etre Européen, c’est croire en des valeurs culturelles, nationales, familiales, religieuses ou mythiques pour s’opposer à l’envahissement de l’argent. »
- « Etre Européen, c’est refuser la société multi-ethnique. »
- « Etre Européen, c’est refuser l’économie hédoniste, unidimensionnelle et futile des biens de consommation. »
- « Etre Européen, c’est croire en des valeurs au lieu d’amasser et de consommer. »
- « Etre Européen, c’est accorder de l’importance à la mentalité héroïque : tâche, désintéressement, abnégation, sacrifice, fidélité, candeur, vénération, bravoure, remplir ses devoirs. C’est accorder moins d’importance à la mentalité mercantile : utilitarisme, hédonisme, droit au bonheur par l’argent, réclamer ses droits. »
- « Etre Européen selon Nietzsche ce n’est pas être une brute blonde ou un être avide de gains mais un individu avide de connaissances qui se dépasse sans cesse. Le salut de l’homme [est] (…) de se détacher du troupeau pour rejoindre Zarathoustra. »
- « Etre Européen, c’est avoir le sens du beau. »[64]
Outre les propositions détachées par Marc Rousset, nous rajoutons : ETRE EUROPEEN c’est :
- Avoir le sens de l’honneur, de la parole donnée et de la loyauté.
- Avoir le sens de la honte (de déroger à ses propres yeux et aux yeux de Dieu).
- Savoir qu’avec les Musulmans, les Chinois, les Hindous, les Japonais… nous partageons bien des valeurs communes mais pas celles du genre des droits de l’homme !!!
- Faire de sa vie (et de celle des autres) sa propre œuvre d’art.
- Aimer le raffinement et le luxe sans jamais tomber dans le snobisme et la préciosité.
- Pouvoir vivre avec un esprit égal, dans un palais ou dans un bivouac.
- Aimer les femmes et les hommes, pas les PLAYBOY bellâtres « homomorphes » ou les collectionneuses vulgaires et superficielles.
- Vouloir des hommes toujours plus hommes et des femmes toujours plus femmes.
Donc vous l’aurez compris, à l’inverse de Huntington, nous plaçons la séparation dans le monde blanc, non sur la frontière superficielle entre le monde orthodoxe et le monde catholique mais plutôt au niveau de l’Atlantique entre d’une part la « Vieille Europe » et d’autre part le « Nouveau Monde ». Les motivations réelles qui se cachent derrière cette séparation artificielle sont clairement exprimées par Huntington lui-même à deux endroits de son livre :
« Depuis plus de deux cent ans, les Etats-Unis s’efforcent d’empêcher qu’émerge une puissance dominante en Europe. Depuis presque cent ans, avec la politique de « la porte ouverte » vis-à-vis de la Chine, ils procèdent de même en Extrême-Orient. Pour ce faire, ils se sont battus dans deux guerres mondiales et dans une guerre froide avec l’Allemagne impériale, l’Allemagne nazie, le Japon impérial, l’Union soviétique et la Chine communiste. »[65]
« Cela serait conforme à la tradition, l’Amérique s’étant toujours souciée d’empêcher que l’Europe et l’Asie soient dominées par une seule puissance. Ce n’est plus d’actualité en Europe, mais en Asie, cet objectif reste valide. En Europe occidentale, une fédération relativement lâche [ndlr. dans les deux sens du terme], liée intimement aux Etats-Unis d’un point de vue culturel, politique et économique ne menacerait pas la sécurité américaine. »[66]
D’un point de vue européaniste, nous devons bien évidemment nous atteler à réaliser cet empire eurosibérien que les Américains redoutent tant. Mais dès lors, une question se pose :
Une entité politique voulant correspondre avec une réalité civilisationnelle peut-elle contenir des minorités n’appartenant pas à la civilisation dominante ? A notre sens, un empire eurosibérien majoritairement européen peut, dans un cadre institutionnel impérial, englober des territoires ne faisant pas partie de sa civilisation mais liés à lui historiquement et géopolitiquement, telles les républiques musulmanes d’Asie centrale. A l’inverse la présence massive d’une immigration bariolée dans nos ensembles urbains ne peut être intégrée à un système fédéral basé sur les peuples et les ethnies. Nous devons privilégier au sein de l’Empire européen l’ancrage des peuples sur leur terre d’origine. Le concept de civilisation n’est donc pas réducteur ! D’aucuns voudraient nous faire croire qu’il enferme la diversité des communautés sous un même vocable et finit par tuer cette diversité. Le fait qu’un Empire s’identifie à une civilisation (Chine, projet de Synergie Européenne) ne veut pas dire pour autant que les minorités y seront automatiquement brimées. C’est la politique adoptée par les dirigeants qui conditionne la bonne cohabitation des différentes communautés. La Chine est certes un mauvais exemple qu’on nous ressert d’ailleurs un peu trop souvent pour nous convaincre que toute volonté de politique civilisationnelle rime automatiquement avec impérialisme et disparition à long terme des minorités culturelles tel le peuple tibétain au sein de la sphère chinoise. Pourtant la Russie impériale (sauf durant la courte période de russification intensive pratiquée au XIXe siècle sous l’influence du nationalisme occidental) et surtout l’Empire austro-hongrois ne sont-ils pas des beaux exemples de cohabitation réussie de différentes communautés sous une seule et même autorité politique ? Et au contraire, ne sont-ce pas justement le métissage, le multiculturalisme, le « mélange » des civilisations bref la grande soupe des peuples que nos « élites » politiques, culturelles et médiatiques nous préparent en chantant un hymne à la tolérance, ne sont-ce pas tous ces termes prononcés sur un ton solennel pour leur donner le relief qu’ils ne possèdent pas, tous ces mots creux et vides de sens qui seront dans le futur les véritables fossoyeurs des cultures ?
Les mouvements entre civilisations sont comparables à la tectonique des plaques : Sur les pourtours des sphères civilisationnelles se développent des zones de trouble comparables aux failles volcaniques. Le fait de construire la civilisation européenne n’impliquera pourtant pas automatiquement l’absence de conflits également intracivilisationnels mais ces conflits ne seront pas insurmontables dans la mesure ou deux régions d’une même civilisation qui s’opposent doivent pouvoir s’entendre au nom d’intérêts civilisationnels communs. Sauf si une civilisation ennemie vient bien entendu exciter les antagonismes. Il faut faire la promotion d’une généralisation de la doctrine Monroe au niveau civilisationnel. L’Amérique aux Américains, l’Asie aux Asiatiques, la Oumma islamique aux Musulmans et bien entendu l’Europe aux Européens !
Index des concepts clefs.
- Abstention (Règle de l’…, p.24)
- Chaudron des civilisations (p.19)
- Civilisation comme entité culturelle (p.4)
- Civilisation comme entité « englobante » (p.4)
- Civilisation universelle (critique) (p.6-7-8)
- Déclin moral (p.10)
- Diffusion de la puissance (p.16)
- Dominos (théorie des …, p.21)
- Etat phare (p.12)
- Fin de l’histoire (p.2)
- Guerres civilisationnelles (p.20-23)
- Indigénisation (p.10)
- Kémalisme (p.8)
- Niveaux d’engagement dans une guerre civilisationnelle (p.21-22)
- Pays déchiré (p.13)
- Pays divisé (p.13)
- Pays isolé (p.12-13)
- Prolifération négociée (p.16)
- Réformisme (p.8)
- Rejet (p.8)
- Religion comme moteur civilisationnel (p.9)
- Suivisme (p.20)
[1] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.25.
[2] ZINOVIEV (Alexandre), L’Occidentisme. Essai sur le triomphe d’une idéologie. (traduction française)- Saint-Amand-Montrond, Plon, 1995
[3] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.35.
[4] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.22.
[5] Idem, p.231.
[6] Idem, p.61.
[7] Idem, p.71
[8] Idem, p.72-73.
[9] Idem, p.86.
[10] Idem, p.97.
[11] Idem, p.99.
[12] Idem, p.107-108. D’après BARNETT (Jeffery R.), Exclusion as National Security Policy dans Parameters, 24, printemps 1994, p.54.
[13] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.127.
[14] Idem, p.108.
[15] Idem, p.458.
[16] Idem, p.125-126.
[17] Idem, p.197. Si on possède l’honnêteté intellectuelle suffisante pour admettre que les pays divisés sont continuellement minés par des guerres civiles larvées, il devient très facile d’appliquer cette règle simple à nos propres pays. L’arrivée massive de populations d’origine étrangère ne saurait effectivement qu’y multiplier la probabilité de conflits futurs entre les communautés de culture différente.
[18] Ibidem.
[19] Idem, p.364.
[20] Si nous parvenons à rétablir la Tradition en Europe, l’Inde pourrait devenir un allié important, d’autant plus que nous possédons des racines indo-européennes communes avec la civilisation hindoue.
[21] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.271.
[22] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.272-273. Pensons notamment à l’usage de valises nucléaires mises au point par les Russes pendant la guerre froide. Ces armes combinent habilement le facteur nucléaire avec la stratégie terroriste.
[23] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.280.
[24] Les Etats-Unis et l’Europe, « champions toute catégorie de la démocratie », poursuivent dans ce domaine une politique particulièrement hypocrite, condamnant les élections truquées ou annulées par des juntes militaires opposées à leurs intérêts mais fermant discrètement les yeux là où, comme en Algérie, l’armée annule le résultat d’élections légitimant l’arrivée au pouvoir de partis religieux tels le FIS algérien.
[25] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.289-290.
[26] Idem, p.292.
[27] Idem, p.292-293. D’après ROBERSON (B.A.), Islam and Europe : An Enigma or a Myth ?, dans Middle East Journal, 48, printemps 1994, p.302
[28] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.293-294.
[29] RASPAIL (Jean), Le Camp des saints, Paris, Robert Laffont, 1973.
[30] CHESNAIS (Jean-Claude), Le Crépuscule de l’Occident : démographie et politique, Paris, Robert Laffont, 1995.
[31] LELLOUCHE (Pierre), cité dans MILLER, Strangers at the Gate, p.80.
[32] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.298.
[33] Notons que l’essor des moyens de communication n’a pas favorisé l’intégration des communautés étrangères. Cablées sur les chaînes de leur pays respectif et retournant au pays chaque fois qu’elles en ont l’occasion, comment les familles musulmanes pourraient-elles réellement se sentir européennes ?
[34] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.298-299.
[35] Au VIIIe siècle, l’invasion arabe n’ayant pu être stoppée que par Charles Martel à Poitiers en 732 et au XVIe siècle, le siège de Vienne en 1529 marquant un terme à l’avancée arabe.
[36] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.306-307.
[37] Idem, p.309.
[38] Idem, p.322.
[39] Idem, p.331-332.
[40] Idem, p.342.
[41] Idem, p.376-377.
[42] Idem, p.379-380.
[43] Idem, p.406-407.
[44] Idem, p.408.
[45] Idem, p.411.
[46] Idem, p.442.
[47] Ibidem.
[48] Idem, p.445.
[49] QUIGLEY, Evolution of Civilizations, p.138-139 et p.158-160.
[50] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.456.
[51] Ibidem.
[52] Idem, p.461- 462.
[53] Ibidem.
[54] Idem, p.467- 468.
[55] Idem, p.478. Les missions de sécurité et de défense définies par les membres de l’UE sont également complètement opposées à cette règle puisqu’elles prévoient de s’immiscer dans des conflits étrangers où les droits de l’homme sont bafoués.
[56] Et non imposé comme l’actuel droit international d’obédience anglo-saxonne.
[57] WEYEMBERGH (Maurice), Carl Schmitt et le problème de la technique, dans CHABOT (Pascal) et HOTTOIS (Gilbert), Les philosophes et la technique.- Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2003, p. 161.
[58] MASCHKE (Günther), Unité du monde et Grand Espace européen, dans Vouloir n°1 (nouvelle série), avril-juin 1994, p.42.
[59] WEYEMBERGH (Maurice), Carl Schmitt et le problème de la technique, dans CHABOT (Pascal) et HOTTOIS (Gilbert), Les philosophes et la technique.- Paris, Librairie philosophique J. Vrin, 2003, p. 161.
[60] MASCHKE (Günther), Unité du monde et Grand Espace européen, dans Vouloir n°1 (nouvelle série), avril-juin 1994, p.43.
[61] Idem, p.205.
[62] Hongrie, Pologne, République tchèque, Slovaquie.
[63] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.470-471.
[64] ROUSSET (Marc), Les Euros-Ricains.- Paris, Ed. Godefroid de Bouillon, 200, p.469-484.
[65] HUNTINGTON (Samuel P.), Le choc des civilisations.- Paris, Odile Jacob, 2000, p.338.
[66] Idem, p.344.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : civilisations, théorie politique, sciences politiques, choc des civilisations, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 27 juin 2009
Citation de Chantal Delsol

Citation de Chantal Delsol:
Trouvé sur: http://forumsoral.com/
Comme je suis anti-républicain, et donc plutôt fédéraliste, au même titre que Robert Steuckers ou l'Action Française fidèle à Charles Maurras, je vous laisse un morceau qui résume bien ce que j'ai envie de dire à Soral et de la république :
Chantal Delsol écrit : « La république n'accepte donc le débat démocratique qu'à l'intérieur des présupposés qui sont les siens. Et parce que ces présupposés sont assez précis et dessinent une figure du bien commun clairement déterminée, le champ du débat demeure toujours limité, voire exigu, en tout cas par rapport aux démocraties occidentales voisines. Dans la république française, la démocratie ne peut fonctionner seulement tant que les différents courants de pensée acceptent les présupposés républicains, et par là elle ne fonctionne jamais que sous une forme atténuée, puisque l'éventail des figures permises du bien commun est restreint. Si, pour des raisons diverses, un nombre significatif de citoyens récusent certains présupposés républicains et veulent exprimer cette récusation au nom de la démocratie, alors la république se trouve déstabilisée et sommée de donner une réponse à cette contradiction. Soit il lui faudra remettre en cause ses propres principes au nom de la démocratie, ce qui lui paraît impensable parce que ses valeurs sont sacralisées ; soit elle cherchera les moyens d'empêcher ces courants de s'exprimer, au nom de ses principes. La difficulté, dans ce deuxième cas, est qu'elle ne peut pas condamner ouvertement la démocratie pluraliste, faute de se voir rejetée dans le camp des ennemis de la liberté. La réponse à ce dilemme s'annonce tortueuse ».
http://www.polemia.com/article.php?id=109
_________________
Ne serait-ce pas l'instinct de la crainte qui nous incite à connaître ? La jubilation de celui qui acquiert une connaissance ne serait-elle pas la jubilation même du sentiment de sentiment recouvré ? Friedrich Wilhelm Nietzsche
00:20 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, philosophie, sciences politiques, fédéralisme, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 26 juin 2009
Volksgemeenschap en persoon: niet tegengesteld maar aanvullend!
Volksgemeenschap en persoon: niet tegengesteld maar aanvullend!
Men mag de volksgemeenschap niet voorstellen als een amalgaam van los en onafhankelijk staande leden, die hun individuele vrijheden en voorrechten willen vrijwaren door aaneen te sluiten en elkaar te beschermen. De volksgemeenschap is een natuurlijk verbond, gegrond op eenzelfde complex van aanleg en daarom gericht op eenzelfde goed. Zij is een hogere streefeenheid, waarin de door bloed en karakter gelijkgeschakelde individuen organisch zijn ingeschakeld om, in de mate van hun persoonlijk vermogen, het algemene goed, dat ook het goed is van iedereen, te beveiligen en te doen aangroeien. Deze nieuw-solidaristische opvatting van de volksgemeenschap legt de nadruk op de collectieve streefeenheid naar het nationale goed gericht, maar laat voldoende ruimte aan de ingeschakelde individuele persoonlijkheid.
De gemeenschap bestaat niet om zichzelf, als een godheid die, zoals het communisme het voorhoudt, het individu naar willekeur mag knevelen en opslorpen, een Moloch waaraan tenslotte alle persoonlijkheid en ieder persoonlijk levensbelang onmeedogend worden opgeofferd. Politiek links heeft het in naam van het egalitarisme, nog steeds uiterst moeilijk met de natuurlijke ongelijkheid tussen personen. Evenmin dient de gemeenschap louter en alleen om, volgens de liberale opvatting, de individuele rechten, voorrechten en vrijheden te beschermen, zonder medelijden met de nood van de zwakkere, zonder kommer om het volksbelang, zonder plichten tegenover de gemeenschap. Een opvatting die nog steeds zeer populair is ter rechtse politieke zijde, en waaraan nep-solidaristen maar al te graag hand- en spandiensten aan leveren. Noch het liberalisme, met zijn individualisme, noch het communisme, met zijn verwoesting door opslorping van de persoonlijkheid, kunnen het vraagstuk dat zich stelt oplossen. De oplossing dient gezocht te worden in een wisselwerking tussen de enkeling en de gemeenschap. Een ware Derde Weg dus!
De gemeenschap is gegroeid uit de menselijke behoefte aan ruimere, bestendige steun in een georganiseerde collectiviteit, om door middel van gebundelde krachten de individuele ontplooiing mogelijk te maken. De gemeenschap bestaat omwille van de persoon. Anderzijds kan de individuele persoon zijn levensdoel niet bereiken zonder voortdurende en aanvullende hulp van de gemeenschap. Beide zijn volkomen met elkaar verbonden : de gemeenschap leeft voor de enkeling en deze voedt zich aan de gemeenschap. Hier raken we aan de personalistische basis die ontegensprekelijk in het nieuw-solidarisme aanwezig is. Niettemin heeft dit personalisme het ideale alibi verschaft aan nep-solidaristen (voornamelijk ter christen-democratische en rechts-nationale zijde) om zich in te nestelen in het naoorlogse neocorporatistische systeem en uiteindelijk zelfs de (neo)liberale kritieken erop te gaan ondersteunen! Wat de personalisten betreft, heeft een persoon er dus alle belang bij dat de gemeenschap wordt uitgebouwd en gevrijwaard blijft van verval en vernietiging. Als de enkeling de gemeenschap nodig heeft, dan begrijpt hij dat het eigenbelang hem dwingt tot dienstbaarheid tegenover een organisme waarvan zijn individuele volmaking afhankelijk is. En zo komen sommige sujetten die zichzelf rechtse “solidaristen” noemen in het vaarwater van het ‘welbegrepen eigenbelang’ op het einde van Guy Verhofstadts tweede brief aan de andersglobalisten (november 2003).
Uit dit besef wordt bij de enkeling het gemeenschapsgevoel geboren, een gevoel van samenhorigheid en dienstwillige erkentelijkheid ten overstaan van de hogere eenheden waartoe hij behoort, namelijk de gezinsgemeenschap, de beroepseenheid, de bedrijfsgemeenschap en de volksgemeenschap. Het individuele persoon kan z’n levensopgang slechts maken met de hulp van de gemeenschap. Het gezond individualisme (dat in schril contrast staat met het door liberale krachten gepropageerde individualisme), als begin van alle activiteit, wordt tegelijk aan het welzijn van enkeling en collectiviteit dienstbaar gemaakt. Het nieuw-solidarisme pleit dus hoegenaamd niet voor een totalitaire Staat waar dwang, terreur en bureaucratische starheid de persoon in de pas dwingen. Integendeel, het is het nieuw-solidarisme erom te doen een maatschappij na te streven waarin een voluntaristisch klimaat heerst waarbij de individuele persoon zelf aan de slag gaat om de nieuwe maatschappij en de nieuwe ordening tegemoet te werken. Geen passieve afwachtende houding dus, maar een plicht tot initiatief en vernieuwing in de geest van het nieuw-solidarisme, vrij en losgekomen van de oude gedachten en vormen, waaronder de “oud-solidaristische”!
00:30 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, politologie, sciences politiques, sociologie, philosophie, communauté, communautarisme, personne, personalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pour une typologie opératoire des nationalismes

Archives de Synergies Européennes - 1990
Pour une typologie opératoire des nationalismes
par Robert STEUCKERS
Le mot «nationalisme» recouvre plusieurs acceptions. Dans ce vocable, les langages politique et politologique ont fourré une pluralité de contenus. Par ailleurs, le nationalisme, quand il agit dans l'arène politique, peut promouvoir des valeurs très différentes selon les circonstances. Par exemple, le nationalisme peut être un programme de libération nationale et sociale. Il se situe alors à «gauche» de l'échiquier politique, si toutefois on accepte cette dichotomie conventionnelle, et désormais dépassée, qui, dans le langage politique, distingue fort abruptement entre une «droite» et une «gauche». Les gauches conventionnelles, en général, avaient accepté comme «progressistes», il y a une ou deux décennies, les nationalismes de libération vietnamien, algérien ou nicaraguéen car ils se dressaient contre une forme d'oppression à la fois colonialiste et capitaliste. Mais le nationalisme n'est pas toujours de libération: il peut également servir à asseoir un programme de soumission, d'impérialisme. Un certain nationalisme français, dans les années 50 et 60, voulait ainsi oblitérer les nationalismes vietnamien et algérien de valeurs jacobines, décrétées quintessence du «nationalisme français» même dans les rangs des droites, pourtant traditionnellement hostiles à la veine idéologique jacobine. Nous constatons donc, au regard de ces exemples historiques récents, que nous nageons en pleine confusion, à moins que nous ayons affaire à une coïncidentia oppositorum...
Pour clarifier le débat, il importe de se poser une première question: depuis quand peut-on parler de «nationalisme»? Les historiens ne sont pas d'accord entre eux pour dire à quelle époque, les hommes se sont vraiment mis à parler de nationalisme et à raisonner en termes de nationalisme. Avant le XVIIIième siècle, on peut repérer le messianisme national des Juifs, la notion d'appartenance culturelle commune chez les Grecs de l'Antiquité, la notion d'imperium chez les Romains. Au Moyen Age, les nations connaissent leurs différences mais les assument dans l'œkumène chrétien, qui reste, en ultime instance, le seul véritable référent. A la Renaissance, en Italie, en France et en Allemagne, la notion de «nation», comme référent politique important, est réservée à quelques humanistes comme Machiavel ou Ulrich von Hutten. En Bohème, la tragique aventure hussite du XVième siècle a marqué la mémoire tchèque, contribuant fortement à l'éclosion d'un particularisme très typé. Au XVIIième siècle, l'Angleterre connaît une forme de nationalisme en instaurant son Eglise nationale, indépendante de Rome, mais celle-ci est défiée par les non-conformistes religieux qui se réclament de la lettre de la Bible.
Avec la Révolution Française, le sentiment national s'émancipe de toutes les formes religieuses traditionnelles. Il se laïcise, se mue en un nationalisme purement séculier, en un instrument pour la mobilisation des masses, appelées pour la première fois aux armées dans l'histoire européenne. Le nationalisme moderne survient donc quand s'effondre l'universalisme chrétien. Il est donc un ersatz de religion, basé sur des éléments épars de l'idéologie des Lumières. Il naît en tant qu'idéologie du tiers-état, auparavant exclus du pouvoir. Celui-ci, à cause précisément de cette exclusion, en vient à s'identifier à LA Nation, l'aristocratie et le clergé étant jugés comme des corps étrangers de souche franque-germanique et non gallo-romane (cf. Siéyès). Ce tiers-état bourgeois accède seul aux affaires, barrant en même temps la route du pouvoir au quatrième état qu'est de fait la paysannerie, et au quint-état que sont les ouvriers des manufactures, encore très minoritaires à l'époque (1). Le nationalisme moderne, illuministe, de facture jacobine, est donc l'idéologie d'une partie du peuple seulement, en l'occurrence la bourgeoisie qui s'est émancipée en instrumentalisant, en France, l'appareil critique que sont les Lumières ou les modes anglicisantes du XVIIIième siècle. Après la parenthèse révolutionnaire effervescente, cette bourgeoisie se militarise sous Bonaparte et impose à une bonne partie de l'Europe son code juridique. La Restauration d'après Waterloo conserve cet appareil juridique et n'ouvre pas le chemin du pouvoir, ne fût-ce qu'à l'échelon communal/municipal, aux éléments avancés des quart-état et quint-état (celui en croissance rapide), créant ainsi les conditions de la guerre sociale. En Allemagne, les observateurs, d'abord enthousiastes, de la Révolution, ont bien vite vu que les acteurs français, surtout parisiens à la suite de l'élimination de toutes les factions fédéralistes (Lyon, Marseille), ne cherchaient qu'à hisser au pouvoir une petite «élite» clubiste, coupée du gros de la population. Ces observateurs développeront, à la suite de cette observation, un «nationalisme» au-delà de la bourgeoisie, capable d'organiser les éléments du tiers-état non encore politisés, c'est-à-dire les paysans et les ouvriers (que l'on pourrait appeler quart-état ou quint-état). Ernst-Moritz Arndt prend pour modèles les constitutions suédoises des XVIIième et XVIIIième siècles, où le paysannat, fait unique en Europe, était représenté au Parlement en tant que «quart-état», aux côtés de la noblesse, du clergé et de la bourgeoisie marchande et industrielle (2). Le Baron von Stein, juriste inspiré par la praxis prussienne de l'époque frédéricienne, par les théories de Herder et de Justus Möser, par les leçons de l'ère révolutionnaire et bonapartiste, élabore une nouvelle politique agraire, prévoyant l'émancipation paysanne en Prusse, projette de réorganiser la bureaucratie d'Etat et d'instaurer l'autonomie administrative à tous les niveaux, depuis la commune jusqu'aux instances suprêmes du Reich. Les desiderata d'Arndt et du Baron von Stein ne seront pas traduits dans la réalité, à cause de la «trahison des princes allemands», de l'«obstination têtue des principules et ducaillons», préférant l'expédiant d'une restauration absolutiste pure et simple.
Comment le nationalisme va-t-il évoluer, à la suite de cette naissance tumultueuse dans les soubresauts de la Révolution ou du soulèvement allemand de 1813? Il évoluera dans le plus parfait désordre: la bourgeoisie invoquera le nationalisme dans l'esprit de 1789 ou de la Convention, les socialistes dans la perspective fédéraliste ou dans l'espoir de voir la communauté populaire politisée s'étendre à tous les états de la société, les Burschenschaften allemandes contre les Princes et l'ordre imposé par Metternich à Vienne en 1815, les narodniki russes dans la perspective d'une émancipation paysanne généralisée, etc. Le mot «nationalisme» en vient à désigner des contenus très divers, à recouvrir des acceptions très hétérogènes. En Hongrie, avec Petöfi, le nationalisme est un nationalisme ethnique de libération comme chez Arndt et Jahn. En Pologne, l'ethnisme slavisant se mêle, chez Mickiewicz, d'un messianisme catholique anti-russe et anti-prussien, donc anti-orthodoxe et anti-protestant. En Italie, avec Mazzini, il est libéral et illuministe. En Allemagne avec Jahn et au Danemark, avec Grundtvig, il est nationalisme de libération, ethniste, ruraliste, racialisant et s'oppose au droit romain (non celui de la vieille Rome républicaine mais celui de la Rome décadente et orientalisée, réinjecté en Europe centrale entre le XIIIième et le XVIième siècles), c'est-à-dire à la généralisation d'un droit où l'individu reçoit préséance, au détriment des communautés ou de la nation.
Dans l'Allemagne nationale-libérale de Bismarck, le tiers-état allemand accède au pouvoir tout en concédant une bonne législation sociale au quint-état ouvrier. La France de la IIIième République consolide le pouvoir bourgeois mis en selle lors de la Convention. Entre 1914 et 1918, le monde assiste à la conflagration généralisée des nationalismes tiers-étatistes. En 1919, à Versailles, l'Ouest impose le principe de l'auto-détermination dans la Zwischeneuropa, l'Europe sise entre l'Allemagne et la Russie. La France va ainsi accorder aux Polonais et aux Tchèques ce qu'elle refusera toujours aux Bretons, aux Alsaciens, aux Corses et aux Flamands. Mais cette auto-détermination n'est pas accordée directement aux peuples pris dans leur globalité, mais aux militaires polonais ou roumains, aux clubs tchèques (Masaryk), etc. Ces strates dirigeantes, exploitant à fond les idéologèmes nationalistes, ont affaibli leurs peuples en imposant des budgets militaires colossaux, notamment en Pologne et en Roumanie. Dans ce dernier pays, ce n'est pas un hasard non plus si la contestation néo-nationaliste, hostile au nationalisme de la monarchie et des militaires, se soit basée sur les idéologies agrariennes (poporanisme) ou les ait faits dévier dans une sorte de millénarisme paysan, comparable, écrit Nolte (3), aux millénarismes de la fin du Moyen Age ouest-européen (Légion de l'Archange Michel, Garde de Fer).
Devant ce désordre événémentiel, la pensée européenne n'a pas été capable d'énoncer tout de suite une théorie scientifique, assortie d'une classification claire des différentes manifestations de l'idéologie nationaliste. Avec un tel désordre de faits, une typologie est nécessaire, vu qu'il y a pluralité d'acceptions. Les linéaments de nationalisme se sont de surcroît mêlés à divers résidus, plus ou moins fortement ancrés, d'idéologies non nationales, non limitées à un espace ou à un temps précis. La première classification opératoire n'a finalement été suggérée qu'en 1931 par l'Américain Carlton J.H. Hayes (4). Celui-ci distinguait:
1) Un nationalisme humanitaire, faisant appel à des valeurs intériorisées et critique vis-à-vis du système en place. L'idéologie humanitaire pouvant reposer tantôt sur la morale tantôt sur la culture;
2) Un nationalisme jacobin, réclamant une adhésion formelle, donc extérieure, et s'instaurant comme système de gouvernement;
3) Un nationalisme traditionaliste, autoritaire et contre-révolutionnaire, explorant peu les ressorts de l'intériorité humaine, et s'opposant au système en place au nom d'une tradition, posée comme pure, comme réceptacle exclusif de la vérité;
4) Un nationalisme libéral, se réclamant du droit ou des droits, généralement hostile au système en place, car celui-ci n'accorde aucun droit à certaines catégories de la population ou n'en accorde pas assez au gré des protagonistes du nationalisme;
5) Un nationalisme intégral, opérant une synthèse de différents éléments idéologiques pour les fusionner en un nationalisme opératoire. Maurras est le théoricien par excellence de ce type de nationalisme de synthèse, hostile, lui aussi, au régime en place.
Le découpage que nous suggère Carlton J.H. Hayes est intéressant mais l'expérience historique nous prouve que les nationalismes qui ont fait irruption sur la scène politique européenne ont souvent été des mixtes plus complexes, vu les affinités qui pouvait exister entre ces différents nationalismes, comme par exemple entre le nationalisme humanitaire et le nationalisme libéral, entre le libéralisme et le jacobinisme, entre les traditionalistes et les nationalistes intégraux, etc.
Hans Kohn (5), disciple de Meinecke, réduira conceptuellement la pluralité des nationalismes à deux types de base: 1) les nationalismes émanant de la Nation-Etat, d'essence subjective et politique, où l'on adhère à une nation comme à un parti. C'est une conception occidentale, d'après Kohn;
2) les nationalismes émanant de la Nation-Culture, d'essence objective et culturelle, déterminée par une appartenance ethnique dont on ne peut se débarrasser aisément. C'est une conception orientale, slave et germanique, d'après Kohn.
L'Occident, selon sa classification, développerait donc une idée de la nation comme communauté volontaire, comme un «plébiscite de tous les jours» (Renan). Jordis von Lohausen, géopoliticien autrichien contemporain, disait dans ce sens que l'on pouvait devenir français ou américain comme l'on devient musulman: par simple décision personnelle et par acceptation de valeurs universelles non liées à du réel concret, à un lieu précis et objectif.
L'Est européen développe une approche contraire des faits nationaux. Cette approche, dit Kohn, est déterministe: on appartient à une nation comme on appartient à une famille, pour le meilleur et pour le pire.
Kohn en déduit que les approches occidentales sont libérales, démocratiques, rationnelles et progressistes. Les approches orientales, quant à elles, sont irrationnelles, anti-individualistes, passéistes, voire «fascistes» et «racistes».
Cette dichotomie, un peu simple, mérite une critique; en effet, les nationalismes jacobins, occidentaux, de facture libérale et démocratique, se sont montrés agressifs dans l'histoire, bellogènes, incapables de créer des consensus réels et d'organiser les peuples (de faire des peuples des organismes harmonisés). Quant aux nationalismes dits orientaux, ils reposent sur un humanisme culturel, dérivé de Herder, qu'il serait difficile de qualifier de «fasciste», à moins de condamner comme telle toute investigation d'ordre culturel ou littéraire dans un humus précis. Par ailleurs, l'Irlande qui est située à l'Ouest du continent européen, n'est ni slave ni germanique mais celtique, déploye un nationalisme objectif, ethnique, culturel, littéraire qui n'a jamais basculé dans le fascisme. De même pour l'Ecosse, le Pays de Galles, la Flandre, la Catalogne, le Pays Basque. La Pologne, située à l'Est, assimile de force les Ruthènes, les Kachoubes, les Lithuaniens, les Ukrainiens, les Allemands et les Tchèques qui tombent sous sa juridiction non pas au nom d'un nationalisme ethnique polonais mais au nom d'une idéologie universaliste messianisée, le catholicisme. Si bien que tous les Slaves catholiques sont considérés comme Polonais, en dépit de leur nationalité propre. Dans la Russie du XIXième siècle, le nationalisme est un mixte qui n'a rien de la netteté dichotomique de Kohn: l'étatisme anti-volontariste, mi-occidental mi-oriental, se conjugue au panslavisme culturel, «oriental» et non humaniste, et au narodnikisme, «oriental» et humaniste.
Theodor Schieder (6) critique les classifications de Hayes et de Kohn, parce qu'il les juge trop figées et parce qu'elles ne tiennent pas compte du facteur temps. La formation des nationalismes européens s'est déroulée en plusieurs étapes, dans trois zones différentes. La première étape s'est déroulée en Europe occidentale; la seconde étape, en Europe centrale; la troisième étape, en Europe orientale. En Europe occidentale, c'est-à-dire en France et en Angleterre, le cadre territorial national était déjà là; il n'y a donc pas eu besoin de l'affirmer. Le tiers-état s'émancipe dans ce cadre et conserve les éléments d'universalisme propre au Lumières parce que le romantisme attentif aux spécificités ethno-culturelles ne s'est pas encore développé. La culture est toujours au stade du subjectif-universaliste et non encore au stade de l'objectif-particulariste. Ce qui explique qu'en Angleterre, le terme «nationalisme» sert à désigner des mouvements de mécontents sociaux en Irlande, en Ecosse, au Pays de Galles. Cette acception, à l'origine typiquement britannique, du terme nationalisme est passée aux Etats-Unis: on y parle du «nationalisme noir» pour désigner le mécontentement des descendants des esclaves africains importés en Amérique, jadis, dans les conditions que l'on sait. Aux Etats-Unis comme en France, le nationalisme ne peut être ni objectif ni linguistique ni ethnique mais doit être subjectif et politique parce ces pays sont pluri-ethniques et, au départ, peu peuplés, donc contraints de faire appel à l'immigration. Tout recours à l'objectivité ethno-linguistique y briserait la cohésion artificielle, obtenue à coup de propagande idéologique.
En Europe centrale, il a fallu d'abord que les nationalismes créent le cadre territorial sur le modèle des cadres occidentaux. C'est ainsi que l'on a pu observer, dans la première moitié du XIXième siècle, les lents processus des unifications allemande et italienne. Il a fallu aussi chasser les puissances tutrices (la France en Allemagne; l'Autriche en Italie). L'obsession de se débarrasser des armées napoléoniennes et de l'administration française ainsi que de ses reliquats juridiques est bien présente dans les écrits des ténors du nationalisme allemand du début du XIXième: chez Arndt, chez Jahn et chez Kleist. Dans cette première phase, le nationalisme émergeant révèle une xénophobie, qui unit le peuple en vue d'un objectif précis, la libération du territoire national, et qui, sur le plan théorique, cherche à démontrer une homogénéité somatique de tout le corps social et populaire. Ensuite, la démarche unificatrice passe par l'élaboration d'un droit alternatif, devant nécessairement accorder un plus en matière de représentation que le droit ancien, imposé par une puissance extérieure. D'où, en Allemagne, la recherche constante d'une alternative au droit romain et la volonté d'un retour au droit coutumier germanique, laissant plus de place aux dimensions communautaires, territoriales ou professionnelles (cf. Otto von Gierke), ce qui permet de répondre aux aspirations concrètes d'autonomie communale et aux volontés d'organisation syndicale, exprimées dans la population.
En Europe orientale, les processus nationalitaires se heurtent à une difficulté de taille: créer un cadre est excessivement compliqué, vu la mosaïque ethnique, à enclaves innombrables, qu'est la partie d'Europe sise entre l'Allemagne et la Russie. Cette difficulté explique la neutralisation de cette zone bigarrée au sein d'empires pluri-nationaux. La raison d'être de la monarchie austro-hongroise était précisément due à l'impossibilité d'un découpage territorial cohérent sur base nationale dans cette région, ce qui l'aurait affaiblie face à la menace ottomane. Pendant la guerre 14-18, Allemands et Autrichiens renoncent, sur le plan théorique, à l'idéologie nationale, tandis que l'Entente et les Etats-Unis, malgré leurs idéologies dominantes cosmopolites, instrumentalisent, contre la logique fédérative autrichienne, le fameux principe wilsonien de l'«auto-détermination nationale» (7). Quand, à Versailles, sous l'impulsion de Wilson et de Clémenceau, on accorde à l'Europe orientale l'auto-détermination, on le fait par placage irréfléchi du modèle jacobin, subjectivo-politique, sur la mosaïque ethnique, objectivo-culturelle. Le mélange du nationalisme subjectif et des faits objectifs d'ordre ethnique et culturel a provoqué l'explosion d'irrédentismes délétères.
Le nationalisme des «petits peuples» dans les travaux de Miroslav Hroch
Miroslav Hroch (8), de nationalité tchèque, analyse le nationalisme des «petits peuples», soit les nationalismes norvégien, finlandais, flamand, baltes et tchèque. Ces nationalismes, tous culturels à la base, ont également évolué en trois étapes. La première de ces étapes est la phase intellectuelle, «philologique», où des érudits redécouvrent le Kalevala en Finlande ou exhument de vieilles poésies ou épopées ou, encore, créent des romans historiques comme Conscience en Flandre. L'archéologie, la littérature et la linguistique sont mobilisées pour une «prise de conscience». Vient ensuite la seconde phase, celle du réveil, où cette nouvelle culture encore marginale passe des érudits aux intellectuels et aux étudiants. Le Tchèque Palacky (9) a été, par exemple, l'initiateur d'un tel passage dans la société tchèque du début du XIXième. La troisième phase est celle où le nationalisme, au préalable engouement d'érudits et d'intellectuels, devient «mouvement populaire», atteint les masses qui passent, ainsi, à une «conscience historique». C'est la littérature, dans tous ces cas, qui est le moteur d'un mouvement social. Au XIXième, dans le sillage du romantisme, c'est le roman qui a joué le rôle de diffuseur. Aujourd'hui, ce pourrait être le cinéma ou la bande dessinée.
Qui porte cette évolution? Ce n'est pas, comme dans les cas des nationalismes tiers-étatistes, la bourgeoisie industrielle ou marchande. Celle-ci ne montre aucun intérêt pour la philologie, la poésie ou le roman historique. Sur le plan culturel, elle est strictement analphabète (Kulturanalphabet, dirait-on en allemand). Le nationalisme des «petits peuples» émane au contraire de personnalités cultivées, issues de classes diverses, mais toutes hostiles à la caste marchande inculte (les «Philistins», disait l'humaniste anglais Matthew Arnold). Schumpeter, en économie, Veblen, en sociologie, ont montré combien puissante était cette hostilité du peuple, des clergés et des aristocrates à l'encontre des riches sans passé, porteurs de la civilisation capitaliste. Constatant que cette haine allait croissante, Schumpeter prévoyait la fin du capitalisme. Cette haine est donc partagée entre d'une part, les nationalismes culturels et, d'autres part, les gauchismes de toutes moutures, qui, quand ils conjuguent leurs efforts et abandonnent le faux clivage gauche/droite en induisant un nouveau clivage, cette fois entre cultivés et non-cultivés, font sauter la domination des castes marchandes, spéculatrices et incultes («middelmatiques» disait le socialiste belge Edmond Picard).
Des intellectuels
issus des milieux paysans
Les intellectuels qui initient ces nationalismes de culture sont souvent issus de milieux populaires paysans, ruraux, ou sont de petits hobereaux cultivés, dépositaires d'une «longue mémoire». Miroslav Hroch pose, après ce constat sur l'origine sociale de ce type d'intellectuels, une question cruciale: sont-ils des «modernisateurs» (progressistes) ou des «traditionalistes» (réactionnaires et passatistes)? Dans sa réponse, Hroch reconnaît que ces intellectuels sont plutôt des «modernisateurs», vu qu'ils cherchent à redonner un bel éclat à leur patrie et à souder leur peuple, de façon à ce qu'il échappe au déracinement de la révolution industrielle. Les nationalismes de culture sont tous nés dans des régions d'Europe développées, au passé riche. La Flandre a été une zone urbanisée depuis le Moyen Age. Le Pays Basque est la zone la plus évoluée d'Espagne, qui, après une brève éclipse au XIXième siècle sur fond de pronunciamentos castillans, a connu un nouvel essor au XXième. Même chose pour la Catalogne. La Finlande dispose d'une bonne industrie et présente un bon alliage politique fait de ruralité et de modernité. La Norvège a toujours eu d'excellents chantiers navals et dispose, aujourd'hui, d'une industrie électronique de premier plan, capable de fabriquer des missiles modernes. La Bohème-Moravie a été, après l'Allemagne, la principale zone industrielle d'Europe centrale et Prague a une université pluri-séculaire. Au vu de ces faits, le reproche de passéisme qu'adressait Kohn aux nationalismes de culture ne tient pas. Notre conclusion: le nationalisme est difficilement acceptable quand il émane du tiers-état, parce qu'il véhicule alors l'égoïsme de classe et l'impolitisme délétère à long terme du libéralisme; il est acceptable quand il émane d'une sorte de «première fonction» reconstituée dans le fond-de-peuple enraciné et encore doté de sa «longue mémoire».
E.H. Carr et le reflet des périodes de l'histoire européenne dans la définition des nationalismes
Pour l'historien britannique E.H. Carr, les nationalismes, aux divers moments de leur évolution, sont des reflets de l'idéologie politique et économique dominante de leur époque. Ainsi, avant 1789, le nationalisme —ou ce qui en tenait lieu avant que le vocable ne se soit imposé dans le vocabulaire politique— dans les Etats au cadre territorial formé, comme la France ou l'Angleterre, est régalien; il est le corollaire du pouvoir royal et inclut dans ses corpus doctrinaux l'idéal mécaniciste et absolutiste en vigueur chez les théoriciens du politique au XVIIIième siècle. De 1789 à 1870, le nationalisme est démocratique; la révolution de 1789 est démocratique et libérale, bourgeoise et tiers-étatiste. En 1813, en Allemagne, avec Arndt et Jahn, elle s'adresse à l'ensemble du peuple, paysannerie comprise. En 1848, elle est démocratique au sens le plus utopique du terme, tant à Paris qu'à Francfort. De 1870 à 1939, quand on abandonne petit à petit les principes libéraux et l'économie du «laisser-faire», le nationalisme devient socialiste car il faut impérativement organiser l'industrie et les masses ouvrières, ce que l'utopisme libéral n'avait pas prévu, aveuglé qu'il était par le mythe de la «main invisible» que Hayek nommera, quelques décennies plus tard, la «catallaxie». Bismarck accorde aux ouvriers une protection sociale. Les idéologies planistes (De Man, Freyer), le stalinisme, le fascisme (sur-tout dans sa dimension futuriste et in-dustrialiste), le New Deal de Roosevelt et le national-socialisme hitlérien (avec ses constructions d'autoroutes et son Front du Travail) visent à faire accèder leur nation à la puissance et y parviennent en appliquant de nouvelles méthodes, chaque fois différentes mais radicalement autres que celles appliquées aux époques antérieures. La France et l'Angleterre, véhiculant des nationalismes anciens, de type régalien, et appliquant en économie les théorèmes du libéralisme, intègrent mal leurs classes ouvrières et ne parviennent pas à asseoir en elles une lo-yauté optimale.
L'Allemagne bismarckienne, en effet, a été un modèle d'intégration social à son époque. Appliquant les théories de l'économiste List sur les tarifs douaniers protecteurs de toute industrie naissante, le gouvernement impérial impose les Schutzzölle en 1879 qui protègent non seulement le capital national mais aussi le travail national, ce qui lui vaut la reconnaissance de la social-démocratie dirigée à l'époque par Ferdinand Lassalle. Dès que le capital et le travail sont protégés, il faut les organiser, c'est-à-dire les rendre ou les re-rendre «organiques». Pour ce faire, il a fallu injecter de la protection sociale et légiférer dans le sens d'une sécurité sociale. La nation, dans cette optique, était le système qui «organisait» et octroyait de la protection. Nation et système social se voyaient désormais confondus dans la classe ouvrière: le patriotisme du «prolétariat» allemand en 1870 et en 1914 venait du simple fait que ces masses ne souhaitaient ni le knout russe archaïsant ni l'arbitraire libéral français ou anglais. En août 1914, les travailleurs allemands couraient aux armes pour que Russes et Français ne viennent pas réduire à néant la sécurité sociale construite depuis Bismarck et non pas pour la gloire du Kaiser ou de la Sainte-Allemagne des réactionnaires et des romantiques médiévisants.
Pour E.H. Carr, la phase 1 du nationalisme est régalienne et portée par les cours et l'aristocratie; la phase 2 est politique et démocratique; sa classe porteuse est la bourgeoisie; la phase 3 est économique et portée par les masses. Les nations à nationalisme de phases 1 et 2 ont opté pour un colonialisme, où les territoires d'outre-mer devaient servir de débouchés à l'industrie métropolitaine que, du coup, on ne modernisait plus. Les nationalismes de phase 3 préfèrent la «colonisation intérieure», c'est-à-dire la rentabilisation maximale des terres en friches de la métropole, des énergies nationales, des ressources du territoire. Cette «colonisation intérieure» a pour corollaire un système d'éducation très solide et très complexe. En bout de course, ce sont les nations qui ont renoncé au libéralisme stricto sensu et au colonialisme qui sortent victorieuses de la course économique: le Japon et l'Allemagne.
Le nationalisme contre les établissements?
Donc tout nationalisme efficace doit être une idéologie contestatrice; il doit toujours vouloir miner les établissements qui s'endorment sur leurs lauriers ou veulent bétonner des injustices. Il doit vouloir l'émancipation des masses et des catégories sociales dont l'établissement refuse l'envol et vouloir aussi leur intégration optimale dans un cadre solide, épuré de toutes formes de dysfonctionnements. Il n'y a aucun vrai natio-nalisme possible dans une société qui dysfonctionne à cause de sa maladie libérale. Les discours nationalistes dans les sociétés libérales sont des hochets, des joujoux, de la propagande, de la poudre aux yeux. Dans les sociétés protégées, appliquant intelligemment et souplement les principes du protectionnisme, qui permet l'éclosion d'un capitalisme national, d'un socialisme national, d'une pédagogie nationale, le nationalisme devient automatiquement l'idéologie de ceux que favorise le protectionnisme, contre le cosmopolitisme libéral et l'internationalisme prolétarien qui sont des fois sans ancrage social réel et conduisent les sociétés à la ruine ou à la déliquescence. Aujourd'hui, comme il n'y a plus de volonté protectionniste, ni à l'échelon étatique ni à l'échelon continental, il n'y a plus de nationalisme, si ce n'est des contre-façons grotesques, à verbosité militariste, qui servent de véhicule à d'autres utopies internationalistes, comme, par exemple, les intégrismes religieux ou les stratégies néo-spiritualistes qui nous viennent des Etats-Unis ou de Corée.
Les nouveaux fronts
Chaque étape du développement de la pensée nationale crée de nouveaux fronts politiques, que le manichéisme de la pensée d'aujourd'hui refuse de percevoir. Avant 1789, le morcellement territorial des Etats et les douanes intérieures constituaient des freins à l'expansion du libéralisme et de l'industrie. La nécessité de les éliminer a généré une idéologie à la fois nationale (parce que la nation était le cadre élargi nécessaire à la promotion des industries et manufactures) et libérale (l'accession du tiers-état marchand à la gestion des affaires). Cette idéologie mettait un terme aux dimensions rigidifiantes et fossilisantes de l'Ancien Régime. Mais quand le libéralisme a atteint ses limites et montré qu'il pouvait dissoudre mais non organiser, l'idéologie idéale à appliquer dans le cadre concret de la nation est devenue le protectionnisme. Par la création de zones autarciques à dimensions territoriales précises —la nation, l'Etat— le pouvoir mettait un frein aux velléités cosmopolites donc dissolutives du libéralisme. L'Angleterre, ayant une longueur d'avance dans la course à l'industrialisation, exploitait à fond la pratique du libre-échange pour inonder de ses produits les pays d'Europe non encore industrialisés ou moins industrialisés, empêchant du même coup le développement d'un tissu industriel autochtone et privant la population d'opportunités multiples. Le cosmopolitisme est précisément l'idéologie qui, sous prétexte d'élargir les horizons à l'infini, refuse de tourner son regard vers la concrétude ambiante et condamne du même coup la population fixée dans et sur la concrétude ambiante à demeurer dans ses chaînes. L'idéologie cosmopolite des Lumières servait l'Angleterre au XIXième siècle comme elle sert les Etats-Unis aujourd'hui.
De cet état de choses découlent précisément les nouveaux fronts. Le regalien, qui est politique pur, et le protectionnisme, qui veut intégrer les masses ouvrières et fortifier l'économie, s'opposent avec une égale vigueur au libéralisme cosmopolite. Le monarchisme, le socialisme et le syndicalisme (ersatz à l'ère industirelle des associations professionnelles d'ancien régime) s'oppose tantôt dans le désordre tantôt dans l'ordre au libéralisme. Les idéologues libéraux comme Hayek et von Mises ou, dans une moindre mesure, Myrdal, décrivent le socialisme et le syndicalisme comme «réactionnaires» parce qu'ils s'opposent à l'expansion illimitée du capitalisme. Cette attitude procède d'un refus des léviathans équilibrants, d'un refus de mettre un frein aux désirs utopiques et subjectifs, irréalisables parce que trop prétentieux. Le politique étant précisément la création de tels «léviathans équilibrants», on peut déduire que le libéralisme, fruit de l'idéologie des Lumières, est anti-politique, cherche à briser le travail éminemment humain —l'homme étant zoon politikon— du politique. Le retour de Hayek et de von Mises dans un certain discours conservateur, aux Etats-Unis, en Angleterre et en France et d'une vulgate idéologique insipide ayant pour thème les «droits de l'homme», de même que la destruction de l'Irak baasiste et de l'institutionalisation, amorcée par Kouchner, du droit d'ingérence dans les affaires intérieures de pays tiers, avec la triste affaire des Kurdes, participe d'une totalitarisation du libéralisme qui, par la force militaire les trois puissances où le conservatisme se réclame de Hayek et les gauches du discours «droits-de-l'hommard», cherche à homogénéiser la planète en brisant par déchaînement de violence outrancière (la destruction des colonnes irakiennes en retraite par bombes à neutrons et à effet de souffle) les petits léviathans locaux, ancrés régionalement. Comme par hasard, les trois puissances qui amorcent cette apocalypse sont celles dites de l'«Ouest» dans le discours anti-impérialiste de l'école nationale-bolchévique (Niekisch, Paetel)...
Le commun dénominateur politisant du conservatisme monarchiste, créateur de léviathans non socialisés, et du syndicalisme, organisateur du tissu social, explique le rapprochement entre l'AF et les syndicalistes soréliens au sein du Cercle Proudhon en 1911-12, le rapprochement entre De Man et Léopold III en Belgique, le rapprochement —hélas marginalisé— entre le CERES de Chevénement et la NAR monarchiste...
L'exemple latino-américain
En 1945, le monde assiste à l'achèvement de la dynamique enclenchée par les nationalismes européens. Ce ne sont plus désormais des nations qui s'affrontent mais des blocs idéologiques transnationaux à vocation globale. Une sorte de nouvelle guerre de religion commence, réclamant, surtout chez les communistes, une forte dose de foi, qu'un Sartre contribuera notamment à injecter. Le nationalisme glisse alors vers le tiers-monde, comme l'avait prévu le géopoliticien allemand Karl Haushofer. En effet, en 1949, la Chine de Mao proclame son autarcie par rapport aux grands flux financiers internationaux, vecteurs du processus de dénationalisation. Malgré le discours communiste-internationaliste, la Chine se replie sur elle-même, redevient nationale-chinoise, repli qui sera encore accentué par la «révolution culturelle» des années 60. En 1954, l'Egypte de Nasser, à son tour, tente de se déconnecter des grands circuits occidentaux. Les nationalismes du tiers-monde visent donc l'indépendance, essayent la non-intégration dans la sphère américaine, que Roosevelt et Truman voulaient étendre au monde entier (d'où l'expression «mondialisme»). Le modèle dans le tiers-monde est, tacitement, celui de l'Allemagne nationale-socialiste, et, plus officiellement, celui de la Russie de Staline. Mais le tiers-monde n'est pas homogène: l'Amérique latine, par exemple, était déjà, par l'action des bourgeoisies «monroeïstes», dans l'orbite américaine avant-guerre comme nous le sommes aujourd'hui. C'est pourquoi, les Latino-Américains ont pensé un nationalisme de libération continental qui peut nous servir d'exemple, à condition que nous ne le concevions plus sur le mode trop romantique du guévarisme d'exportation qui avait, jadis, séduit la génération de ceux qui ont aujourd'hui entre 40 et 50 ans. Mis à part ce nationalisme de libération, l'Amérique latine présente:
1) Un nationalisme d'intégration pour populations hétérogènes (Mexique-Brésil).
2) Un nationalisme hostile aux investisseurs étrangers à l'espace latino-américain. Ce nationalisme continentaliste avait été surtout développé au Chili (avant Pinochet) et en Bolivie.
3) Un nationalisme qui est recours au passé pré-colonial. Ce nationalisme a surtout été théorisé par le Péruvien Mariategui. Il s'apparente du point de vue des principes aux nationalismes de culture européens, comme le nationalisme finlandais qui exhume le Kalevala ou le nationalisme irlandais qui exhume balades celtiques et épopée de Cuchulain, etc. Ou qui recourt au passé pré-chrétien de l'Europe.
4) Un nationalisme dérivé du populisme urbain, dont l'expression archétypique demeure le péronisme argentin.
Ces quatre piliers théoriques du nationalisme continentaliste latino-américain réduisent à néant les clivages gauche/ droite conventionnels; en effet, on a vu alternativement groupes de «gauche» et groupes de «droite» se revendiquer tour à tour de l'un ou l'autre de ces piliers théoriques.
En quoi ces piliers théoriques peuvent-ils servir de modèles pour l'Europe?
A. Quand le nationalisme de la gauche chilienne exprime son agressivité tranchée à l'égard des exploiteurs étrangers, il a le mérite de la clarté dans la définition et la désignation de l'ennemi, acte politique par excellence, comme nous l'ont enseigné Carl Schmitt et Julien Freund.
Quant au nationalisme péruvien, théorisé par Mariategui, il constitue un mixte de dialectique indigéniste et de dialectique économiste. La lutte contre l'exploitation économique passe par une prise de conscience indigéniste, dans le sens où le retour aux racines indigènes implique automatiquement une négation du système économique colonial. L'anti-impérialisme, dans la perspective péruvienne-indigéniste, consiste à recourir aux racines naturelles, non aliénées, du peuple. Cet indigénisme est hostile aux nationalismes des «bourgeoisies monroeistes», d'origine coloniale et alignées généralement sur les Etats-Unis avec, comme seul supplément d'âme, un esthétisme européisant, tantôt hispanophile, tantôt francophile ou anglophile.
Les mythes castriste, guévariste, sandiniste, chilien ont eu du succès en Europe parce qu'inconsciemment, ils correspondaient à des désirs que les Européens n'exprimaient plus en leur langage propre, qu'ils avaient refoulés. Lorsque l'on analyse des textes cubains officiels, parus dans la célèbre revue Politica Internacional (La Havane) (10), on découvre une analyse pertinente de l'offensive culturelle américaine en Amérique latine. Par l'action dissolvante de l'américanisme, la culture cesse d'être conscience historique et politique et se mue en instrument de dépolitisation, d'aliénation, par surenchère de fiction, de psychologisme, etc. Nous pourrions comparer cette analyse, très courante et généralisée dans le continent latino-américain, à celle qu'un Steding (11) avait fait du neutralisme culturel dépolitisé en Hollande, en Suisse et en Scandinavie ou à celle que Gobard avait fait de l'aliénation culturelle et linguistique en France (12).
Indigénisme, populisme ou nationalisme?
En conclusion, toute idéologie et toute pratique politique qui veulent prendre en compte les racines du peuple, ses productions culturelles doivent: 1) tenir compte des lieux et du destin qu'ils imposent, ce qui implique une politique régionaliste fédérante à tous les échelons; c'est là une logique fédérante 2) opérer un retour aux racines, par un travail archéologique et généalogique constant, de façon à pouvoir repérer les moments où ont été imposées des structures aliénantes, à comprendre les circonstances de cette anomalie et à en combattre les résidus; c'est là une logique indigéniste; 3) déconstruire les mécanismes aliénants introduits dans nos tissus sociaux au moment de la révolution industrielle (une relecture de Carlyle s'impose à ce niveau) et organiser les nouvelles jungles urbaines, ce qui signifie ré-enraciner les populations agglutinées dans les grandes métropoles; c'est là une logique justicialiste et populiste; 4) rassembler les peuples et les entités politiques de dimensions réduites au sein de grands espaces économiques semi-autarciques, dépassant l'étroitesse de l'Etat-Nation; c'est une logique continentaliste ou «regnique» (reichisch); 5) rompre avec les nationalismes séculiers et laïques classiques, nés à l'époque des Lumières et véhiculant sa logique d'homogénéisation, éliminatrice de nombreux possibles (l'omologazzione de Pier Paolo Pasolini); rompre également avec les nationalismes qui se sont rebiffés contre les Lumières pour retomber dans le fantasme de la conversion forcée, dans un culturalisme passéiste conservateur et déréalisé.
Une idéologie politique est acceptable —qu'elle se donne ou non l'étiquette de «nationaliste»— si et seulement si 1) elle se fonde sur une «culture» enracinée, impliquant une conscience historique et portée par une sorte de nouvelle «première fonction» (au sens dumézilien du terme); 2) si cette nouvelle «première fonction» est issue du fond-du-peuple (principe d'indigénat); 3) si elle donne accès à une représentation juste et complète à toutes les strates sociales; 4) si elle organise une sécurité sociale et prévoit une allocation fixe garantie à chaque citoyen, ce qui n'est possible que si l'on limite sévèrement l'accès à la citoyenneté, laquelle doit désormais comprendre le droit à un pécule mensuel garanti, permettant une relative indépendance de tous (diminution de la dépendance du salariat, égalité des chances, accès possible au recylage professionnel ou à de nouvelles études, garantie de survie et d'indépendance de la mère au foyer, meilleures chances pour les enfants des familles nombreuses); comme la richesse nationale ou régionale n'est pas extensible à l'infini, les droits inhérents à la citoyenneté doivent rester limités à l'«indigénat» (selon certains principes institués en Suisse); 5) si elle organise l'affectation des richesses financières nées des prestations de l'indigénat dans le cadre de son «espace vital», de façon à renoncer à toutes formes de colonialisme ou de néo-colonialisme financier aliénant et à n'accepter, en matières de colonisation, que les «colonisations intérieures» (ère agronomique en France au XIXième, assèchement des Polders aux Pays-Bas ou des marais pontins en Italie, colonisation des terres en friche du Brandebourg ou de Transylvanie par des communautés paysannes autonomes, mobilisation de toutes les énergies de la population sans recours à l'immigration comme au Japon); 6) si elle traque toutes les traces d'universalisme militant et homogénéisant, toujours susceptible de faire basculer les communautés humaines concrètes dans l'aliénation par irréalisme têtu: cette traque, objet d'une vigilance constante, permet l'envol d'une appréhension du monde réellement universelle, qui accepte le monde tel qu'il est: soit bigarré et kaléidoscopique.
Enfin, toute idéologie acceptable doit affronter et résoudre les grands problèmes de l'heure; ce serait notamment aujourd'hui l'écologie. Le nationalisme classique, ou celui qui resurgit aujourd'hui, n'insiste pas assez sur les dimensions indigénistes, populistes-justicialistes et continentalistes. Il est dans ce sens anachronique et incapacitant. Il reste tiers-étatiste dans le sens où il n'est plus universel comme l'était la pensée de la caste souveraine des sociétés traditionnelles, ce qui explique qu'il est incapable de penser la dimension continentale ou l'idée de Regnum (Reich) et qu'il refuse de prendre en compte le fait du fond-du-peuple, propre des quart-état et quint-état. Le nationalisme risque d'occulter deux dimensions: l'ouverture au monde et le charnel populaire. Il reste à mi-chemin entre les deux sans pouvoir les englober dans une pensée qui va au-delà du simple positivisme.
Robert STEUCKERS.
1) Olof Petersson, Die politischen Systeme Nordeuropas. Eine Einführung, Nomos, Baden-Baden, 1989.
(2) Olof Petersson, op. cit.
(3) Ernst Nolte, Die faschistischen Bewegungen, dtv 4004, München, 1966-71, pp. 212-226.
(4) C.J.H. Hayes, Essays on Nationalism, New York, 1966; The Historical Evolution of Modern Nationalism, New York, 1968 (3ième éd.); Nationalism: A Religion, New York, 1960.
(5) H. Kohn, The Age of Nationalism. The First Era of Global History, New York, 1962; The Idea of Nationalism. A Study in its Origin and Background, New York, 1948 (4ième éd.); Prophets and Peoples: Studies in 19th Century Nationalism, New York, 1952.
(6) Th. Schieder, «Typologie und Erscheinungsformen des Nationalstaats in Europa», in Historische Zeitschrift, 202, 1966, pp. 58-81 (repris in: Heinrich August Winkler, Nationalismus, Athenäum/Hain, Königstein/Ts, 1978, pp. 119-137); Der Nationalstaat in Europa als historisches Phänomen, Köln, 1964.
(7) Rudolf Kjellen, Die politischen Probleme des Weltkrieges, 1916.
(8) Miroslav Hroch, Die Vorkämpfer der nationalen Bewegung bei den kleinen Völkern Europas, Prag, 1968; «Das Erwachen kleiner Nationen als Problem der komparativen Forschung», in H.A. Winkler, Nationalismus, op. cit., pp. 155-172.
(9) Joseph F. Zacek, Palacky. The Historian as Scholar and Nationalist, Mouton, Den Haag/Paris, 1970.
(10) Pedro Simón Martínez, «Penetración y explotación del imperialismo en la Cultura Latinoamericana», in Politica Internacional, Instituto de politica internacional, La Habana/Cuba, 19, 1967, pp. 252-255.
(11) Christoph Steding, Das Reich und die Krankheit der europäischen Kultur, 1942 (3ième éd.).
(12) Henri Gobard, L'aliénation linguistique. Analyse tétraglossique, Flammarion, Paris, 1976; La guerre culturelle. Logique du désastre, Copernic, Paris, 1979.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, sciences politiques, théorie politique, nationalisme, histoire, identité, identité nationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 25 juin 2009
R. Badinand: Requiem pour la contre-révolution

Daniel Cologne - http://www.alexipharmaque.net/
Rodolphe Badinand:
Requiem pour la Contre-Révolution
Ainsi s’achève Requiem pour la Contre-Révolution, dont l’auteur Rodolphe Badinand me fait l’honneur d’être le co-dédicataire. Il ne m’en voudra donc pas si j’inverse l’adjectif indéfini et l’adjectif démonstratif. L’appel clôturant ce remarquable recueil d’ ‘’essais impérieux’’ est en réalité rédigé comme suit :
‘’Pour le Système et ses sbires, nous incarnons le plus grand des périls parce que nous croyons en nos rêves’’. Rodolphe Badinand cite alors Thomas Edgar Lawrence : ‘’Les rêveurs de jour sont des hommes dangereux, car ils peuvent jouer leur rêve les yeux ouverts et le rendre possible’’. L’auteur conclut : ‘’Soyons ces rêveurs éveillés…’’ (p.163).
Qui sommes nous donc et quel est ce ‘’Système’’ que Rodolphe Badinand nous invite à faire trembler ? Disons d’abord ce que nous ne sommes pas. Nous ne sommes pas des ‘’anti-Lumières’’, comme nous désignent nos ennemis. Nous ne sommes pas les nostalgiques d’un temps révolu, les passéistes assoupis dans la langueur des regrets éternels. Nous coupons le cordon ombilical avec la Contre-Révolution, dont nous saluons néanmoins le double mérite : son courage d’être entré en résistance contre des ‘’valeurs mortifères’’, et notamment les ‘’idéologies égalitaires’’, mais aussi la ‘’valeur didactique’’ de ‘’son échec’’ (p.42).
Nous sommes les partisans d’une recomposition du monde fondée, non sur l’abstraction droit-de-l’hommiste, mais sur le socle concret du ‘’droit des hommes (c’est moi qui souligne) à s’enraciner dans leur terroir et leurs communautés d’appartenance multiples et variées’’ (p.163).
Cette refondation planétaire postule une reconstruction de l’Europe selon un ‘’principe fédérateur d’essence supérieure’’ (p.162), dont l’absence pertinemment épinglée par un monarque polynésien fut le cause de la Première Guerre Mondiale. En citant Tupon IV, roi des Tonga, Rodolphe Badinand témoigne de ce qu’est la véritable ouverture à l’Autre, la capacité d’être authentiquement à l’écoute de la sagesse, d’où qu’elle vienne : tout le contraire de la mensongère ‘’tolérance’’ du Système, où l’égalitarisme de façade masque l’impitoyable volonté d’épuiser les hommes et les peuples dans une course infernale le long de ‘’la ligne droite individu-Etat jacobin-Etat mondial-humanité’’ (p.163).
Un exemple de ‘’principe fédérateur’’ est l’idée impériale telle que la concrétise l’institution pluriséculaire du Saint Empire romain germanique. ‘’Au Moyen Age, l’empire sacré et sanctifié ne pouvait que promouvoir l’idéal chrétien. Il aurait été inconcevable qu’il s’édifiât contre la majorité religieuse du moment’’ (p.119). A notre époque de déchristianisation, il ne faut évidemment pas aspirer à reproduire la structure médiévale, mais il convient de lui substituer un symbolisme cosmique où l’Empire serait une image du Soleil central autour duquel tourneraient, à des vitesses différentes, comme les planètes du système solaire astronomique, les nations (patries historiques) et les régions (patries charnelles). Ainsi l’Europe pourrait-elle revendiquer le titre de ‘’patrie idéale’’, répondre à l’exigence d’universalité inscrite au cœur de toute pensée métapolitique.
Rodolphe Badinand distingue judicieusement l’impérialité et les impérialismes. ‘’Contrairement au Saint Empire, les Premier et Second Empires français n’ont reposé que sur les épaules d’une personnalité charismatique’’ (p.116). Son procès des bonapartistes n’a d’égal que son rejet de l’hitlérisme, ‘’version teutonne du jacobinisme français’’ (p.121).
Dans la ligne d’Alain de Benoist, Rodophe Badinand considère aussi comme de ‘’faux empires’’ les empires coloniaux anglais, français, hollandais, portugais ou espagnol. Il tient ‘’le mal colonial’’ (p.127) pour une des étapes importantes de la ‘’décomposition de la France’’ (p.125).
Erudit français, Rodophe Badinand consacre tout naturellement de nombreuses pages à l’histoire de son pays. Recensant l’ouvrage d’un historien de l’Université de Jérusalem, il rappelle ‘’les prétentions capétiennes à la Couronne du Saint Empire romain germanique’’ (p.95), qui aurait pu devenir, entre les règnes de François Ier et Louis XIV, un ‘’Saint Empire romain de la Nation Française’’ (p.96). C’est l’un des textes courts du recueil, qui alternent avec des essais plus longs, de même que se succèdent, dans un ensemble ipso facto de lecture agréable, de brefs comptes-rendus de livres, de vigoureuses interventions conférencières et de profonds essais où la réflexion toujours nuancée se déploie dans un style souvent chatoyant.
La coutume gastronomique encadre le plat de résistance de hors-d’œuvre et de desserts. Ici, l’essai le plus consistant, qui donne d’ailleurs son titre au florilège, est opportunément placé en tête. Une quarantaine de pages d’une rare densité intellectuelle nous convie ainsi à réfléchir sur la Contre-Révolution ‘’impasse intellectuelle majeure’’ (p.13).
L’Eglise catholique fut la première à s’opposer à la révolution de 1789 et elle le fit avec d’autant plus de force qu’un an à peine après la prise de la Bastille, fut votée la Constitution civile du clergé (1790), la ‘’plus grave erreur’’ (p.19) de la révolution suivant l’auteur.
Celui-ci examine, tout au long des deux siècles écoulés, la ‘’lente translation vers la Modernité’’(p.24) qui affecte la catholicisme et dont Jacques Maritain (1882-1973) offre un exemple symbolique.
Le royalisme également a succombé, au fil des décennies, à la contagion de l’esprit moderniste. Ce dernier ‘’contamina les doctrines monarchiques avec la même vigueur qu’il se développait au sein du catholicisme’’ (p.28). Des mouvements royalistes de gauche naquirent ainsi dans toute l’Europe méridionale : le Parti populaire monarchique portugais, le carlisme espagnol qui ‘’se transforma en un mouvement socialiste autogestionnaire’’ (p.30), et en France les ‘’’maurrassiens’’ de la Nouvelle Action Française de Bertrand Renouvin.
‘’Avec ces trois exemples’’, écrit Rodolphe Badinand, ’’nous devons nous interroger si la Contre-Révolution et la Révolution ne seraient pas l’avers et le revers d’une même médaille appelée la Modernité’’ (Ibid).
Avant de revenir sur cette importante citation, où l’on voit émerger sous la plume de l’auteur le questionnement fondamental, épinglons encore cette vision non conformiste des régimes de Salazar, Franco et Pétain, où Rodolphe Badinand voit les germes de l’élan économique-industriel d’après-guerre, via l’arrivée au pouvoir des technocrates. Le phénomène lui semble particulièrement sensible dans la France de Vichy, après ‘’la nomination de l’amiral Darlan à la vice-présidence du Conseil des ministres’’ (p.31).
Y aurait-il eu donc un ‘’apport contre-révolutionnaire au libéralisme’’ (p.32) ? Oui, répond sans hésitation l’auteur qui va jusqu’à établir un parallélisme entre la ’’main invisible’’ du marché et les ’’voies insondables’’ de la Providence. Les fondements chrétiens de la Contre-Révolution sont ici mis en cause et il en découle que la dérive potentielle des contre-révolutionnaires était prévisible dès la fin du XVIIIème siècle.
Rodolphe Badinand rappelle opportunément que ’’les trois futures sommités de la contre-révolution intellectuelle étaient vus par leurs contemporains comme des libéraux : Edmund Burke était un parlementaire whig, défenseur des droits du Parlement anglais et de la Révolution américaine ; Joseph de Maistre était, à la cour de Savoie, jugé comme un franc-maçon francophile et Louis de Bonald fut, en 1789-1790, le maire libéral de Millau’’ (p.41).
Quant à la Révolution conservatrice, que ses adversaires ont baptisée ’’Nouvelle Droite’’, elle intègre certes un héritage contre-révolutionnaire, mais elle se réfère aussi au socialisme proudhonien, aux non-conformistes des années trente si bien étudiés par Pierre Loubet del Bayle, et au situationnisme de Guy Debord dénonçant ’’la société du spectacle’’. Rodophe Badinand conclut son analyse de ce courant par cette hypothèse de recherche que les historiens des idées politiques devraient creuser ; ’’Ce syncrétisme semblerait marquer la fin historique de la Contre-Révolution en tant que mouvement de pensée’’ (p.36).
Rodolphe Badinand s’interroge de manière inattendue : ‘’L’écologie : le dernier surgeon contre-révolutionnaire ?’’ (p.38). L’auteur fait un rapprochement insoupçonné entre, d’une part les écrits d’un Edouard Goldsmith ou d’un Bernard Charbonneau, et d’autre part, le roman balzacien Le Médecin de Campagne, sorte d’Arcadie où «’’chacun mène une existence équilibrée’’ et où ‘’la nature maîtrisée, mais non agressée par le machinisme, donne des fruits à tous les villageois’’ (p.39). Au même titre que la Nouvelle Droite et la Révolution Conservatrice, l’écologie dépasse ‘’les vieux clivages, devenus obsolètes’’ (voir le slogan ‘’Ni Droite ni Gauche’ d’Antoine Waechter) et ne se laisse pas enfermer dans le binôme Révolution - Contre Révolution. Sa vision du monde dynamique rompt avec le passéisme ruraliste exaltant une société champêtre ‘’stable, immuable et édénique’’ (Ibid)
Partageant avec les écologistes certaines légitimes préoccupations environnementales, Rodolphe Badinand avertit : ‘’Si le réchauffement planétaire se poursuit et s’accentue, dans quelques centaines d’années, la banquise aura peut-être disparu, faisant de l’océan polaire un domaine
maritime de première importance’’ (p.123). La maîtrise de l’Arctique s’impose à l’auteur comme une des plus impérieuses nécessités pour le futur Empire européen. Cet enjeu tant stratégique que symbolique est d’autant moins négligeable que les anciennes mythologies indo-européennes, y compris celle de l’Hellade méditerranéenne et celle de l’Inde védique, mentionnent le Septentrion comme l’origine, sinon de l’humanité, du moins d’une de ses plus importants rameaux. L’Europe se devra donc d’être présente sur tout le pourtour de l’Océan Arctique comportant aussi des rivages asiatiques et nord-américains.
‘’Face à la marée montante des peuples du Sud, le regroupement intercontinental des descendants de Boréens ne se justifie que par le désir de survivre au XXIème siècle. Cela mérite au moins un débat que seul l’avenir tranchera’’ (p.73).
Rodolphe Badinand nous convie à effectuer deux démarches simultanées : retrouver le chemin de notre ‘’plus longue mémoire’’ et imaginer notre futur lointain.
‘’Les contre-révolutionnaires souhaitaient conserver intact le passé. Leur démarche les obligea souvent à faire de l’avenir table rase. Entre la négation du passé, propagée par la Modernité, et le refus du futur, pratiqué par la Contre-Révolution, existe une troisième voie : l’archéo-futurisme’’ (p.44). L’auteur se réfère à Guillaume Faye, qui a longtemps partagé avec Alain de Benoist, quoique dans un autre registre, le magistère intellectuel de notre famille de pensée. Né vers 1972, issu de la génération suivante, Rodolphe Badinand peut prétendre à la succession de ces deux maîtres à penser, selon l’expression consacrée et en l’occurrence toute relative si l’on pense à ces figures hors normes que sont René Guénon (1886-1951) et Julius Evola (1898-1974).
A propos de ces deux immenses éveilleurs, il est temps de se demander dans quelle mesure ils ont été piégés par le binôme Révolution-Contre Révolution. C’est à force de critiquer le progressisme moderne rectilinéaire que l’on dérive peu à peu, au départ d’une conception cyclique de l’histoire, vers un décadentisme ‘’traditionnel’’ tout aussi rectilinéaire.
Progressisme et décadentisme apparaissent alors comme les deux faces de la même médaille, de même que s’impose la nécessité, pour la Nouvelle Droite et la Révolution Conservatrice, de faire venir leurs adversaires sur leur terrain (c’est Rodolphe Badinand qui souligne). ‘’Qu’elles cessent donc de débattre des idées adverses pour imposer la discussion sur leurs idées’’ (p.43). Qu’elles arrêtent de disserter sur les inconvénients du progressisme et sur l’absurdité d’un ‘’sens de l’Histoire’’, et qu’elles valorisent les avantages et la solidité de leur conception cyclique du devenir humain, qui est une respiration à plusieurs vitesses, et qui ne peut en aucun cas dégénérer en un décadentisme vertigineux.
Osons nous dresser avec Rodolphe Badinand contre l’exorbitante prétention de la démocratie moderne à être le point oméga de l’aventure humaine. Adoptée le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen comporte en son Article XI une restriction à la liberté d’expression que l’auteur reprend in extenso : ‘’sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ‘’ (p.18).Rodolphe Badinand commente : il s’agit d’ ‘’une phrase si vague qu’elle permet toutes les interprétations possibles et justifie toutes les polices de la pensée. Or le totalitarisme commence quand on empêche certaines opinions de s’exprimer sur la place publique…(Ibid.). La Modernité est donc bien la ‘’matrice des totalitarismes » ». Sous le couvert de la démocratie et du ‘’droit-de-l’hommisme’’ sévit un terrorisme intellectuel s’appuyant sur des lois liberticides et rétablissant le délit d’opinion, dont sont passibles tous ceux qui contestent les fondements du Système. Un de ces fondements concerne les origines de l’espèce humaine. C’est la thèse africano-centriste selon laquelle l’Afrique serait l’unique berceau de l’humanité, le seul foyer primordial à partir duquel le primate se serait transformé en homo sapiens.
En optant pour une vision ‘’boréocentrique’’ de l’histoire, Rodolphe Badinand ne craint pas de s’exposer à la vindicte de la ‘’bien-pensance’’ qui pourrait lui faire grief ‘’d’une supercherie scientifique à relent raciste’’ (p.69).
Pourtant, ses ‘’Notes dissidentes sur la nation de tradition Primordiale’’, autre chapitre très fouillé et hyper-documenté, révèle une approche pluraliste du problème. Logique et conséquent, Rodolphe Badinand se refuse à trancher la question de l’antériorité en faveur de l’un ou l’autre ‘’ensemble ethnique’’. ‘’N’y aurait-il pas finalement une succession aléatoire de Traditions primordiales pour chaque entité ethnique matricielle ? Et si c’était le cas, qui bénéficierait de l’antériorité ? On le voit : ce type de questionnement débouche sur une absence de réponse d’ordre humain. Cependant, s’interroger sans cesse est le meilleur moyen de maintenir son esprit libre et éveillé. L’interrogation permanente produit des antidotes aux toxines du conformisme médiatique’’ (p.71).
Nous voici aux antipodes du dogmatisme des traditionalistes qui, même lorsqu’ils se définissent comme ‘’intégraux’’ et se réclament d’Evola ou de Guénon, demeurent fréquemment incapables d’auto-critique, inaptes à soulever eux-mêmes des objections à leur discours, fascinés par ‘’le pessimisme foncier de la doctrine des âges, souvent porteur de désespoir ou d’inaction totale’’ (p.59).
Rodolphe Badinand est un authentique ‘’penseur libre’’ aussi éloigné de la fallacieuse ‘’libre-pensée’’ que de son primaire retournement traditionaliste, aussi étranger à la linéarité évolutive qu’à la descente sans frein de l’âge d’or à l’âge de fer. La ‘’spiritualité primordiale’’ ne serait-elle pas plutôt d’inspiration astrologique, c’est-à-dire fondée sur l’alternance de courbes ascendantes et descendantes, tributaires des angles tantôt harmonieux tantôt dissonants formés entre eux par les astres ?
Diverses formes d’astrologie caractérisent en tout cas les aires culturelles où Rodolphe Badinand discerne, en s’appuyant sur de récentes recherches anthropologiques, paléontologiques et archéologiques, l’empreinte des Boréens, ancêtres des Indo-Européens, grand peuple migrateur de la plus haute préhistoire ‘’ne rechignant jamais les rencontres avec les tribus indigènes’’ (p.68).
Celles-ci possèdent peut-être leur propre foyer d’irradiation culturelle, leur ‘’tradition primordiale’’ indissociable de leur ‘’’spécificités ethno-spirituelles » » (p.71). Dans la Grèce antique, parallèlement à l’exaltation mythologique du ‘’séjour des dieux’’ localisé au Nord et gardé à l’Occident par les Hespérides, à l’entrée du fameux jardin aux ‘’pommes d’or’’ que cueillit Héraklès et qui subjuguèrent la farouche Atalante, le scrupuleux Hérodote évoquait la possibilité de l’existence d’Hypernotiens, équivalents de nos Hyperboréens, matrice des peuple du Sud avec lesquelles nous sommes appelés à fonder une ‘’fraternité qualitative’’ (p.60).
En effet, ‘’la tradition risque d’avoir sa signification détournée et de devenir à son corps défendant un auxiliaire du fraternitarisme mondial’’ (c’est Rodolphe Badinand qui souligne) assimilable à ‘’un oecuménisme pervers ‘’ (Ibid). Sous le couvert de celui-ci peut de développer une forme spirituelle d’impérialisme et de domination mondiale à laquelle les Boréens étaient totalement réfractaires lorsqu’ils quittèrent leurs terres arctiques d’origine pour essaimer sur d’autres continents et fonder peut-être les cultures méso-américaines, l’Egypte pharaonique, la Chine du Céleste Empire.
Les historiens de notre famille de pensée saluent en Dominique Venner un guide incontournable dont Rodolphe Badinand se solidarise dans la critique de ‘’la conception guénonienne d’une seule tradition hermétique et universelle, qui serait commune à tous les peuples et à tous les temps, ayant pour origine une révélation provenant d’un ‘’ultramonde’’ non identifié’’ (p.60). A la suite du directeur de la Nouvelle Revue d’Histoire, l’auteur subodore dans le ‘’traditionalisme intégral’’ un ‘’syncrétisme équivoque’’ et une critique de la modernité ne débouchant ‘’que sur un constat d’impuissance’’ (Ibid.), ‘’l’attente millénariste de la catastrophe’’ (p.61).
Par delà les fausses alternatives Tradition-Modernité et Révolution-Contre-Révolution, la brillante anthologie de Rodophe Badinand, compilant des textes écrits ces dix dernières années dans L’Atre, Cartouches, Roquefavour, Eléments et L’Esprit européen, suggère de remonter aux sources vives de cet ‘’esprit européen’’ et de réfléchir à son adaptation au monde de demain et d’après-demain. ‘’Il y a du travail pour cent ans’’, écrivit un jour Robert Steuckers. Rodolphe Badinand est un des pionniers de ce siècle de renouveau de l’intelligence européenne, de cette ère de rayonnement retrouvé et de renaissance métapolitique, de cette nouvelle étape de l’aventure humaine où les Européens et fiers de l’être sauront être à l’écoute des sagesses fleuries sous d’autres latitudes, pour construire enfin une Terre harmonieuse et pacifiée.
Le Coin Littéraire - (novembre 2008) - Ex: http://www.alexipharmaque.nat/
00:15 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences politiques, politologie, contre-révolution, théorie politique, conservatisme, droites, droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 23 juin 2009
L'alternationalisme comme troisième voie économique
L’alternationalisme comme troisième voie économique
Ex: http://frontalternationaliste.hautetfort.com/
Si nous voulons comprendre le sens économique de l’idée alternationale, il nous faut nous en éloigner quelque peu. La raison est que l’alternationalisme a une vision extérieure et intérieure de l’économie qui est un peu différente l'une de l'autre, de par son différentialisme inhérent. D’abord, le principe de base des néonationalistes1 est que tout est fonction de l’intérêt de la communauté nationale (autrement dit, le peuple), mais celle-ci se doit d’être conséquente de ce droit pour ce qui est des autres peuples. Alors si une certaine nation choisit un système économique plutôt qu’un autre, le principe alternationaliste veut qu’il y ait respect pourvu que le sien soit respecté. En somme, il ne s’agit que du bon vieux principe de « notre liberté s’arrête là où celle des l’autre commence ». Donc, nous n’imposerons pas un modèle économique précis à l’ensemble du monde, mais un respect défensif de notre principe. Donc pas d’hégémonie économique avec nous.
Pour ce qui est de l’idée économique intérieur, notre vision de l’alternationalisme est directement liée au concept de troisième voie, qui est en autre une alternative au libéralisme ainsi qu’au communisme. Pour être claire, la liberté d’entreprendre continuera à exister, mais contrairement aux libéraux, nous considérons la primauté de l’intérêt national sur l’individuel. Il s’agit finalement d’une économie réglementée en fonction du bien commun, faisant la promotion d’une économie enracinée et selon les besoins réels du la population. Un exemple assez concret serait de mettre en place des moyens de contrôle sur les compagnies de services étrangères (comme Walmart ou Mc Donald, pour ne nommer que les plus connus) dans le but d’éviter qu’elles ne détruisent les commerces locaux. Cette volonté est basée sur le principe d’intérêt général, car si les gens vont dans ce genre de commerce, c’est bien évidemment pour payer moins cher (intérêt individuel libéral), mais si cela tue l’économie locale, au final cela rendra la collectivité plus pauvre et du coup tout le monde3. Cela est sans compter l’emprise politique que ceux-ci s’accapareront4. En promouvant le commerce local, les gens payeront peut-être plus cher sur le coup, mais de cette manière tout le monde s’enrichit (intérêt général). En somme, il s’agit d’un capitalisme réglementé en fonction de la situation du pays, il n’est donc aucunement exclu de faire du commerce avec d’autres pays pourvu qu’il soit équitable et démocratiquement décidé.
Comme vous avez pu le constater, l’économie proposée s’oppose au libre-échange, car nous considérons que l’économie du monde ne doit pas être réduite à une grande économie de colonie (tout est exporté et importé). Nous considérons que chaque peuple doit s’auto-suffire le plus possible pour conserver leur autonomie politique et ainsi faire leurs propres choix. Ceci est primordial pour que le pouvoir reste aux mains du peuple5 et non pas dans celles de la ploutocratie financière, comme c’est le cas en ce moment.
Ce type d’économie est directement lié à une vision sociale de la société, car nous considérons que la souveraineté nationale est la condition primordiale du socialisme parce que s’il n’y a plus de contrôle sur l’économie, le principe de concurrence détruira inévitablement les mesures de justices sociales pour des raisons de compétitivités et donc de survies économiques. L’explication est que le capitalisme a une tendance naturelle à vouloir accroître son marché. Quand les compagnies deviennent mondiales, ils deviennent des multinationales, pour qui le salaire est une dépense totalement brute contrairement aux compagnies nationales, qui elles doivent entretenir leur marcher6 (ce qui n’est pas le cas pour les multinationales qui pillent un endroit pour être compétitif dans un autre). Au final, dans une économie néolibérale la planète s’appauvrit partout7 et le système finit par s’effondrer comme c’est le cas en ce moment8. Voilà pourquoi nous sommes favorables à une limitation territoriale du marché. Il est aussi non négligeable de souligner que ce type d’économie est la seule à être adaptée au concept d’éco économie9, contrairement au néolibéralisme qui est une fuite en avant sans réflexion sur l'avenir des ressources planétaire.
Je conclurais en signifiant que l’économie néonationaliste est tout simplement une économie au service de l’homme parce que réglementé selon des principes humains et non administré par des principes mathématiques d’offre, de demande et d’intérêt individuel. Même si cette vision n’est que l’idée générale que l’on se fait du bon sens, elle reste une idée révolutionnaire10 au même titre que le marxisme, mais dans une optique de respect envers la nature humaine.
Vortigern
- Dans notre contexte, alternationalisme et néonationalisme seront considérés comme des synonymes, ce qui n’est pas toujours le cas.
- Comme des tarifs douaniers qui viendraient baisser les avantages des multinationales (car profitant du salariat du tiers monde et du portefeuille des pays riches), ce qui rendra les entreprises locales compétitives.
- Les grandes surfaces, en plus de l’évasion fiscale, de faire baisser les salaires, de s’opposer au syndicalisme et de ne retourne de l’argent que chez les grossistes, appauvrisse la population ce qui grossit leur marcher. Donc, la stratégie est poly machiavélique.
- Grosse compagnie = beaucoup d’emplois = gros lobbies = contrôle politique assuré.
- Si la nation est le lieu de la démocratie, donc tout pouvoir au-delà devient antidémocratique.
- En donnant de bons salaires, les employés peuvent acheter ce que la compagnie vend, et de cette manière ils soutiennent (ou améliorent) leurs ventes. Il s’agit, en fait, du principe du citoyen corporatif responsable.
- Au niveau global, si toutes les compagnies (même celles dans des pays où il y a consommation) voient le salaire comme une dépense brute, cette pression à la baisse finit par toucher la moyenne des salaires en pays industrialisés, ce qui fait baisser les ventes et ruine l’économie (surtout s’il elle est basé sur le secteur des services et de la vente, comme ces le cas en occident).
- Les subprimes ne sont pas la cause fondamentale de la crise économique, car ce qui a poussé les prêteurs à faire des crédits à risque c’est le besoin de soutenir la consommation, malgré la baisse générale de revenu aux U.S. engendrée par la disparition de la production réelle (délocalisations) au profit de la finance et des services.
- L’éco économie est un équilibre entre production économique et équilibre écologique, unique salut pour l’homme du futur.
- Comme le pouvoir est aux mains du capital, la révolution est inévitable pour reprendre ce pouvoir.
00:27 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, alternationalisme, troisième voie, économie, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 juin 2009
Democracy, Revolution & Rejection

DEMOCRACY, REVOLUTION & REJECTION:
Why We Should Reject Rather Than Revolt
From: http://freiekreis.wordpress.com/
The political soldier identifies himself, as he develops his ideology, with a given political institute, whether it be a party, a think group, an ideology, a book, a writer, a set of writers, or solely with himself. Either way, he will come to the conclusion that his ideas find or did not find fertile ground within the social reality he lives and functions in. Even the individualist anarchist is confronted with other people and their convictions and has to learn to communicate and function within these social relationships in order to exchange information, satisfy wants and needs of both himself and significant others. In this sense, F.A. Harper’s “hermit” is the only person that is truly free. For him, there is no social reality because he has excluded himself from any social relationship and any significant other, in order to be able to answer to his desire to reject a social reality. It must be said, a political or ideological idea or sentiment is not necessary for human interaction or a market situation. However it does define the perception of the (significant) other within his or her social and circumstantial context. It is even possible for an individual to reject any “idea” behind his actions, which of course puts human action back in its original sense of methodological individual choice as a result of a (semi-)rational cost-benefit analysis. On a general basis, it would not be wrong to state the overall ‘spine’ of our choices is intertwined with our image of ourselves, the other, society, metaphysical (non-)realities etc.
Even though there is no absolute reality and our definitions of any given word or subject (be it abstract or not) are never equal to the definitions of the (significant) others, we compare ourselves with those significant others and merely perceive that our social and personal views are similar or different. We compare and we match up with those that have similar views and use similar arguments to get to those similar views. Now we are divided in a number of fractions. Some fractions consisting of only one person, some of a great number of people, and some ideas we might imagine ourselves, are not represented at all within our social reality at the time. Yet, even those who are the sole representatives of an opinion and therefore have an opinion monopoly, still have to interact with others in order to function, assuming he does not choose the path of the hermit and withdraws himself from the social reality, which is physically impossible under the present spatial conditions.
In order to plan their society, these commons find themselves on an idea market. Whether this society is a democracy or a dictatorship or anything in between is irrelevant, because nor the king nor the democratically elected representative is able to tell what the citizen or constituent or voter should think and steer your mind. And whether we like it or not, in the end the ideas that are ‘bought’ by a majority of social subjects mostly form and manage society. Not only is the king who suppresses his citizen majority with an oligarchic court and a rigid police force illegitimate, his regime has a very low stamina and the risk of failure is high. His means to maintain power (police, propaganda, repression, redistribution of wealth, etc.) are costly and its efficiency will remain low. However keeping these truths and historic facts in mind, over a large time span we can legitimately state that the opinions and ideas that have found fertile ground within the mind of the majority of a developed society will determine the course of that society. This only would work under two important premises: one, the opinions and ideas are effective and at least those who support these views (the majority) benefit from it more than they would benefit under another idea; and two, the majority stays a majority. If people lose interest or ‘external elements’ are added to the society which results in a decreasing number of supporters, the idea would implode and disappear or would at least be marginalised.
In this postmodern age of intellectual denomination and the (state-ignited) ideological supermarket and cultural/philosophical relativism that sprout from that, the inflation of ideas, views and ideological prostitution (democratization) has drastically devaluated the absolute value of the single view. The liberal media and political spectre have forced political soldiers to mellow out and incorporate “compromise” within their beliefs in order to disable dissidence and guarantee obedience. These truly are challenging times for the “real” political soldiers, who do not choose the path of the democratic farce and the party-political poker game. He who chooses the path of compromise is not a political soldier, but a diplomat. The political soldier will win or loose, live or die. His ideological flag is clear and unspoiled and shoots straight arguments at his enemies and wears a thick armour that is his credo. He is a noble warrior and should be a dignified victor or a worthy loser. Either way, the political soldier has a clear conscience, fighting for what he believes is right. The political diplomat on the other hand might have an idea as fierce and outspoken as the soldier, but will meet with his opponents in dark alleyways and negotiate. He will mellow his conviction out and therefore betray it. He waives the white flag of surrender, while it is truly the flag of defeat.
Doubting victory is admitting defeat. As is embracing compromise.
Whether these partycrats call themselves progressive or conservative is totally irrelevant. First of all do they embrace the party-political “game” and therefore can never be considered “progressive” or “reform-minded”, because they choose a system that promises victory, but at the same time guarantees defeat. Second, those who find themselves in or choose to be a part of the majority (the ideological majority and partial majority) can also be named nothing but conservative. He who is in power does not want to ‘change’ the scenery, for he is on the throne, and knows he gained power from the citizens under the present conditions. Even the so-called minority is truly conservative. It can only wait for the majority to make mistakes, and sell that to their electorate, under the present conditions. They are but grey vultures in a farce that is democracy. They can speak of change, but they never will, nor would they want it if they could. Even the libertarians and individual anarchists who choose the way of the party and embrace democracy are not in the clear. Even though their collaboration with the democratic majority spoils their whole mission. And power corrupts. It is unfortunately not certain that, if the libertarians would be on the political throne, they would truly diminish the state. For they are in charge and therefore have power. Power to steer. Power to influence. Power to “reign” in the libertarian ways.
Now, those in the political margins of society, who do not embrace the democratic dance of lies and deceit mostly are revolutionaries. They wish to ‘smash’ the system that defines these margins as margins and defines themselves as ‘norm’. But most of these barbarian smashers have an urge to rebuild. To swap roles. To change the rifle from one shoulder to the other. It is the dogma of most of the revolutionaries, especially the egalitarian leftist revolutionaries (the communists, national socialists, national Bolsheviks etc.), because they still do embrace the root of the democratic farce, namely the power of the majority. Whether it be the working class or the ‘elements of racial purity’, their revolution would succeed or fail depending on nothing but numbers. Their ideology is totally subjected to the numbers of its support. Which makes them nothing but democrats themselves. In a time of developed property rights and a strong sense of ownership in the minds of ourselves and others, thinking a revolutionary spirit is slumbering in the minds of the silent majority, is unwise. They are not silent from slumber, but hang on to what they have and what they know. The egalitarian “democratic” revolutionary will time and time again be disappointed by his supporters and therefore by his own ideas. The Russian Revolution failed eventually. Lenin thrived on social injustice and a pandemic identity crisis after a terrible defeat in a terrible war. He did not convince people of the socialist ideal, but convinced people to do away with the tsarist regime and the “old” institutions that clearly failed. If the Russians would truly be communists in their hearts, the Russian state wouldn’t have been smothered by party propaganda, the Polit Bureau and its statist bullying. The Bolshevik revolutionaries failed and will continue to fail, as long as they believe in the greater power of numbers, rather than the power of great ideas.
The elitist revolutionary does have a certain sense of intellectual honesty. He is honest enough to acknowledge that embracing the weapon of numbers is embracing democracy and therefore selling out your revolutionary principles. He is mature enough to see that an increase of support, what I call “supportive inflation”, implies a mellowing-out of basic principles in order to keep and keep receiving the new supporters, what I call “ideological devaluation”. He acknowledges that the self is the only one that will fully support and subscribe his own views and that the views of the significant other will always vary. He even admits that the larger the group he identifies himself with, the more his idea would have to devaluate in order to be able to make those connections with others. He therefore chooses to keep his ideological core group small. His basic premise is that this small fraction should gain power, “smash” the system and create an order to their liking, for the simple reason that they know how the system should be and function, and that the majority does not. So in a sense, the only way the differ from an everyday democrat is that the do not embrace the rules of majority versus minority. Whether they would imply an internal democracy or not is again irrelevant. The egalitarian revolutionary plays the game foul, but doesn’t cheat. The elitist revolutionary plays the game foul as well, but cheats in the process. In this sense, the egalitarian revolts in a more honest way, because he still applies the tit for tat strategy within the rules of his game. The elitist is a cheater. He first of all has to get some sort of a numeral advantage to “gain” power. However, he cheats the basic idea of the game theory by not participating in the tit for that. It is a sneaky and ineffective way to revolt. Changing the rules, winning and claiming you beat your opponent fair and square is cheating and this is bound to come back at you. It must not be stipulated any further that the elitist revolutionary needs a costly and effective institute to prevent a bottom-up revolution against their top-down elitism. Both by democratic and egalitarian revolution elements. A fine example of elitist revolutionaries were the Shogun dynasties in 18th and 19th century Japan, who managed to bring down the imperial Japanese state with a very modest number of supporters and warriors. They remained in power for a long time and had an effective government and did not participate nor cause many a conflict during their reign. But then again, they did “create” a system of their own, and for the ‘majority’ of Japanese citizens, the change of power did not matter a great deal for them and did not mess up their way of life or social reality drastically. Also the Roman civil war can be brought down to the elitist war between Marius and Sulla, the populares clan and the optimates clan. However, as understanding I am towards elitist revolution and how I tend to favour its ways over those of the of the egalitarian ‘democratic’ revolutionaries, I cannot support them fully. Never ever. They still believe in the power of successive systems as an answer to society’s problems and needs. They still believe in the power of overthrowing and rebuilding. In fact, their perception that they answer to society’s problems and needs is an illusion. Rousseau’s volonté general is an absolute illusion. There is but the aggregate of wants and needs from society’s subjects, but not a general interest that overrules the wants and needs of the civil subjects. It is their perception, their wants and needs projected with false argumentation to be “in the interest of society”. There can never be accurate ‘social’ planning, mere personal conviction and individual planning. A government, not even another person can “know” what is best for me, only perceive in his own imperfect perception what would be best for me, with the premise that HE would be ME in the given situation. Not that the Ego always knows what is best for himself, the empathy of the other is formed around his ability to put his in your place, not think in your place. Empathy remains an externality of egoism, as stated by Ayn Rand. Altruism is but the institutionalised version of empathy.
The fallacy of the elitist remains however the same. His sense of paternalistic empathy is charming, but wrong. The ruler thinks to rule in the way he THINKS is the best, and is therefore determined by his imperfect perception and entire imperfect human nature. Therefore his analysis of the world and even the perception of its problems are distorted. And as we all know, the first perfect human will be God. Even the leader who claims to act out the word of God will not act legitimately. For his perception of something that is claimed to be perfect will, yet again, be distorted through his imperfect persona. The elitist creates the majority in his own mind and acts as he pleases. In that way he is wrong, being blind towards his own perception and conditions of his nature. He might not think he is God, but his alleged divinity does prove him wrong.
What remains of ideas on this good earth, but those of the hermit, the democrat, the elitist and the egalitarian revolutionary? Is there another alternative? In a strict sense there isn’t. In order to manage a society these are the only ones you have. The hermit turns his back on society to live a truly free life. He quits the game, walks away and does not even consider whether he lost or won it. He has no need to play. Therefore no need to win.
The democrats play the game amongst each other in a civilized tit for that game. The winner can be king until he messes up and is defeated by the other democrat. The game does not change and the rules also stay the same. The democrats perform a civilized dance. It doesn’t get them anywhere, but it makes them feel good and safe.
The egalitarian revolutionaries also play along. They accept the rules (which does make them democrats) and when they see their chance, cheat. They play to win and when they seize control over the game, change the rules in their advantage. The egalitarian revolutionaries are cunning, but play at high stake, compromising their power with their numbers and their devaluated ideology. Their revolution is bound to end and bound to be succeeded by another revolution. This, of course, creates an incentive to have a “perpetual” revolution. In order to distract the supporting majority from puppeteering themselves, the puppeteer will constantly chance his mask and tell the spectators that the puppeteer is constantly changing. This is of course a lie, but a cunning way to reduce the chances of a counter-revolution that will sweep the egalitarian revolution away.
The elitist revolutionary does play along, but cheats from the beginning. It requires him, when not yet in power, to be already a part of an elite in order to gain power. The fact that there are consequences in order to be an elitist revolutionary, undermines his whole goal. His strategy is determined by his starting grid. An effective elitist putsch needs help in the right places. And how it will, once succeeded, maintain his power and sell it to the silent “ruled” majority, is unknown. The cost of keeping everyone satisfied and quiet will be very high.
Yet, there is another option. Nor is it democratic, nor is it revolutionary, nor is it the way of the hermit. The hermit doesn’t want to play the game. The democrat plays the game according to the rules. The egalitarian revolutionary plays the game according to the rules and changes both game and rules when he wins. And the elitist cheats. Both his counter players, the game and even himself.
Yet, there is the political soldier that turns his back from the battle and builds himself a castle. Like Harper’s hermit, he turns his back on the game and refuses to play. But unlike the hermit, he does not withdraw himself from his social reality in order to be truly free. This political soldier withdraws him solely from the game, but remains wandering across the battlefield, across the game table. He is the rejecter. He does not want to play the game, for he knows he already won. In his castle he is king, and outside he is not.
The revolutionaries believe in the power of successive systems. One changing the other and changing the other, time and time again. They do not see that the problems does not lie in the system, but is the system and is any system.
The democrats feel safe within their game but are hypocritical stagnant dancers. The egalitarian revolutionary just changes systems. He just puts on another record and performs another dance. Yet his dance is as stagnant and slow as the democrats’ dance, for he beliefs in the power of great numbers, not in the power of great ideas.
The petty elitist lives but in the greatness of his own mind and is drunk with interventionist compulsion. He has a great idea, but does not seem to see that it is but projected on himself and not on his people. Therefore he identifies others with himself, which makes him an egalitarian after all and which makes him the saddest revolutionary of them all.
Now the rejecter is noble and truthful. He is in his castle, minding his own business. Does not care about the thoughts of others but those of himself. He does not care whether his views are shared by others or not. He has no desire to play the game, only desire to interact when he has a need or a want. The rejecter looks solely for satisfaction of himself and of those he loves. He does not seek power. In fact, he rejects even the existence of the game. He is the only one who sees that power over oneself is already a difficult and precise science. He has no wish to have institutionalised power over another, let alone their minds or the entire society.
For the rejecter truly is the noblest of political soldiers. By not being one. He rejects the polis. He himself is a polis. He keeps his ruling to himself. The rejecter is a truly great person. And for all I know, I’m the only rejecter I’ve ever met.
00:25 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : théorie politique, politologie, philosophie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La grande escroquerie qu'est le socialisme libéral
La grande escroquerie qu’est le socialisme libéral
Ex: http://frontalternationaliste.hautetfort.com/
Notre époque vit, depuis la chute du mur de Berlin, le libéralisme comme idéologie profondément dominante. Une idéologie libérale qui exalte le droit individuel au point même de ne pas excuser certaines nuisances qu’elle suscite à l’ensemble des groupes communautaires et sociaux que forme la société. Sans aller plus loin sur les nuisances identitaires que cause le libéralisme, je voudrais mettre l’accent sur les notions de justice sociale dans le cadre du libéralisme (souvent appelé social-démocratie) pour en démontrer les contradictions et l’escroquerie.
Le protectionnisme et la xénophobie
D’abord, nous remarquons communément l’aigreur qu’ont nos clercs néolibéraux quand ils entendent le simple mot de protectionnisme. Ces messieurs, dirait-on, y voient une espèce d’hérésie dans le simple fait de le prononcer, comme s’il était scientifiquement prouvé que le concept est faux, comme le créationnisme ou autres aberrations du genre. D'ailleurs, on croirait parfois que ces gens voient l’économie comme un phénomène naturel, comme la météorologie ou la cosmologie. Il est important de souligner qu’une pratique économique ne peut pas être fausse tout simplement parce qu’une autre ne peut pas être vraie, car il s’agit de techniques et non de faits absolus, mais ceci est un autre débat. Ce qui est le plus troublant aujourd’hui, c’est l’absence de débat sérieux sur la question du libre-échange[1] et le fait que celui-ci soit présenté comme l’avenir indépassable de notre temps, un dogme ou même pire, la fin de l’histoire. On nous parlera du protectionnisme comme d’une idéologie rétrograde, voir réactionnaire et l’on n’hésitera pas à utiliser des mots à fortes connotations symboliques (comme replie sur sois, peur de l’autre et j’en passe c’est les meilleurs) pour la discréditer. Ce qui ne marche pas avec cette rhétorique ridicule, c’est que ce sont des notions, certes bien belles à dire, mais n’ayant strictement aucuns rapports avec l’économie. Ces notions s’appliquant beaucoup plus au niveau des comportements individuels qu’aux choix économiques, mais sont d’excellents moyens d’éviter le débat. Ensuite, après nous avoir traités réactionnaires, on nous lapidera d’arguments qui n’ont encore une fois rien avoir avec l’économie et qui sont supposés nous convaincre que le libre-échange c’est l’ouverture à l’autre, c’est l’échange des cultures, du savoir-faire, etc. Les néolibéraux sont assez forts là-dessus et savent utiliser la psychologie symbolique de l'ouverture et de la fermeture pour justifier des mesures liberticides et antisociales avec des notions qui n'ont rien à voir avec l'économie. Par ce terrorisme intellectuel, ils réussiront à convaincre que leurs mesures sont progressistes et seront donc acclamées par les sociaux-démocrates (aussi complice de cette dégradation) comme avancée inconditionnelle du droit individuel dans ce monde qu'ils veulent postmoderne.
La social-démocratie et le libéralisme
Dans l’échiquier politique de l’Amérique du Nord, les sociaux-démocrates sont considérés comme étant la gauche et les conservateurs comme étant la droite (les néolibéraux se considèrent généralement comme de droite, mais peu ou pas du tout conservateur). Sur cette échelle, nous remarquons tout d’abord que l’ensemble est complètement libéral, mais ce qui est plus étrange encore que le fait qu’il n’y est aucunes alternatives à cela, c’est que le concept de libéralisme est en opposition avec ce que l’on pourrait appeler la doctrine conservatrice ainsi que celle appelée socialiste. La contradiction majeure pour le camp des libéraux conservateurs est que pour conserver et vouloir conserver, il faut imposer des principes moraux à tous. Ce principe, croyez-le ou non, est en contradiction directe avec le principe fondamental du libéralisme qui est la sainte liberté individuelle de choisir ce qui est bien et ce qui est mal. Alors pas de bol les libéraux réacs, vous vous faites arnaquer. Ensuite, avec les sociaux-démocrates (qui sont l’objet de ce texte) il y a aussi contradiction, car le même droit individuel (toujours plus important que le droit communautaire, selon la doctrine libérale) empêche la mise en place de mesures sociales, car contraignantes pour l’individu[2] roi. Évidemment, et c’est bien ce qui leur est reproché par les libéraux purs et durs, c’est de ne pas respecter fondamentalement les principes libéraux en imposant de lourdes taxes, d’ingérer la vie des gens, ainsi que de mettre en place certaines lois de préservations culturelles (mais quand même très minimales). Mais là où ils respectent très bien ce principe, c’est dans la notion de libre-échange, où ils n’auront pas l’audace d’empêcher la libre circulation des biens, des capitaux et des hommes, notion cher au libéralisme pour que nous puissions jouir de l’ouverture sur le monde, cette belle allégorie qui n’est rien d’autre que du terrorisme intellectuel… car aucuns gauchistes sociaux-démocrates ne voudraient, même pour le salut du monde, être associé à un ignoble réac de droite (équivalent contemporain du suppôt de Satan). Encore une fois, la psychologie est l’arme parfaite qui tue les penseurs les plus éclairés, car il y a évidemment des convergences de principe entre réacs et gauchos, même s’ils ne peuvent faire autrement que de les refouler pour mieux se combattre et ainsi faire rire les néolibéraux.
Mais dans le fond, c’est quoi le problème entre libre-échange et protections sociale ? Bien, c’est une simple question de logique. Comme les frontières sont ouvertes et que ces pays étaient jadis des espaces économiques différents et avec des potentiels différents (dû a des choix économiques tout aussi différents), les entreprises suivent la logique de l’optimisation en produisant sur les espaces où c’est pas cher et vendent sur les espaces où il y a du fric, étant donné qu’il n’y a plus rien n’a respecter. Bien sûr, en délocalisant massivement, ils détruisent leur marché (où il y a du $), mais comme leur logique est : après moi le déluge… et bien ils s’en fichent (à l’instar de l’environnement dois-je ajouter). Pour mettre cette notion en images concrètes, je la comparerais aux ti-vieux Québécois qui passent leur retraite aux U.S. parce que ça ne coûte pas cher de taxes et d’impôts[3]. Mais évidemment, ceux-ci retourneront au Québec quand ils seront malades pour se faire soigner gratuitement. En somme, ils veulent le beurre et l’argent du beurre comme le dit le proverbe et cela est logique, ils ne suivent que leurs intérêts individuels, comme les grandes compagnies le font. Cette logique engendre un déséquilibre qui aboutit à la ruine de l’économie là où il y a des mesures sociales et avantage là où il n’y en a pas. En fait, un équilibre vers le bas se crée mécaniquement entre les états et justifie la volonté de gouvernance mondiale que nous connaissons aujourd’hui. Pour cette raison un système social se doit de cloisonner minimalement ses contributeurs pour des raisons d’intérêt général et en cela cette mesure est parfaitement antilibérale. Donc, c’est pour protéger leur marché qu’il faut empêcher les entreprises de délocaliser, car eux ne sont pas dans une logique morale ni même sur le long terme, mais dans une logique marchande et immédiate. Donc, ce qui est mauvais dans la social-démocratie ce n’est pas sa volonté d’aider les pauvres par la redistribution, mais son entêtement à ne pas régler le problème à la source, car si l’on n’empêche pas les entreprises de délocaliser nous ne produiront bientôt plus rien et à part le secteur tertiaire (et encore…), il n’y aura pas de travail, donc plus de pauvreté, donc plus de demandes sociales et d’assistanat, donc plus d’impôts et de taxes, donc plus de délocalisation et plus de ti-vieux en Floride, et ainsi de suite. En somme, les protections sociales ne peuvent avoir d’avenir pour ces raisons et que, telle l’eau sur le roc, le libéralisme dissoudra toutes mesures sociales pour finalement ne garder que le bon vieux droit individuel qui, ne l’oublions pas, ne veux rien dire quand on a pas le minimum pour survivre.
Le vrai socialisme est antilibéral
Comme je l’ai expliqué dans mon article précédent[4], si nous voulons sortir du capitalisme sauvage (obligatoire avenir de toutes théories libérales) sans tomber dans l’opposé tout aussi grotesque qu’est le communisme, nous devons définir un espace économique et le réglementer par un pouvoir moral. Selon moi cela pourrait être la nation, car déjà existante et régie moralement par le suffrage universel (du moins, elle devrait l’être), mais cela pourrait tout de même être autre chose, malgré tout là n’est pas la question. L’intérêt de cette idée est qu’elle a le potentiel de stopper la logique de l’intérêt individuel qui, autant chez les gens que chez les entreprises, nous dirige vers un monde complètement totalitaire où les gros peuvent asservir les petits par le jeu du droit négatif[5] (ou contrainte par le manque), car le droit négatif nous rends peut-être libre de faire ce que l’on veut, mais ne nous nourrit pas pour autant. Pour terminer, il ne faut pas oublier que si la social-démocratie est tolérée par les clercs néolibéraux, contrairement aux vrais socialistes qui eux sont diabolisés, c’est tout simplement parce que leur système se détruit par lui même et qu’il dévie du coup les vrais débats concernant les inquiétudes légitimes des citoyens sur leur avenir.
Vortigern Zifendel
[1] Fondamentalement le débat est entre alter mondialiste et mondialiste qui sont tout deux libre échangiste
[2] Le débat sur le droit d’allez ou non dans des cliniques privées au Québec en est un bon exemple.
[3] Au U.S. il n’y a pas de protections sociales, donc il y a moins de taxes et d’impôts
[4] L’alternationalisme comme troisième voie économique
[5] Le droit négatif est le droit de ne pas être empêché de faire ce que l’on veut, alors que le droit positif est le droit d’avoir quelque chose comme de la nourriture ou un logement par exemple.
00:25 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences politiques, politologie, théorie politique, libéralisme, socialisme, socialisme libéral, actualité, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le problème du totalitarisme chez Domenico Fisichella

SYNERGIES EUROPÉENNES - MAI 1988
Le problème du totalitarisme chez Domenico Fisichella
par Marco Tarchi
On a beaucoup parlé du totalitarisme, on a beaucoup écrit à son sujet depuis une quarantaine d'années, et pas souvent à bon escient. La résonance "sinistre" de ce vocable a servi à canaliser le jugement de l'opi-nion publique contre l'option dangereuse qu'il représentait, à susciter d'incessantes polémiques journa-lis-tiques et à soulever des vagues d'indignations et d'é-motions chez les intellectuels. Après les péri-pé-ties de la guerre froide, pendant laquelle le terme fut brandi comme une épithète infâmante dans la lutte qui opposait l'Occident à l'URSS de Staline, l'alliée ré-pudié des USA, que l'on comparait allègrement à l'Allemagne hitlérienne, l'ennemie sans cesse exé-crée, l'expression "totalitarisme" est ressortie de temps à autre pour désigner le danger que repré-sen-tent les régimes éloignés de l'idéologie et de la pra-xis libérales. D'aucuns, comme le célèbre économis-te Friedrich von Hayek, l'ont utilisée pour disquali-fier en bloc toute forme d'expérience socialiste.
Né des passions politiques —les premiers à l'utili-ser furent Amendola et Basso pour fustiger le régime de Mussolini qui, aussitôt, s'en est emparé à son pro-fit, pour en inverser la charge négative— le mot est rapidement entré dans le vocabulaire de la polito-lo-gie, non sans réserves et précautions. D'une part, l'adjectif "totalitaire" a servi pour identifier et dési-gner des formes de gouvernement que l'on ne pou-vait pas faire entrer dans les catégories classiques d'analyse, forgées par Aristote. D'autre part, on ne pouvait pas ne pas relever le fait que ce terme syn-thétique permettait de mettre en lumière des affinités évidentes entre des régimes inspirés d'idéologies op-po-sées, tout en occultant simultanément les diffé-ren-ces substantielles qui pouvaient exister entre ces ré-gimes.
Le "totalitarisme": deux générations de politologues se chamaillent à son propos
Deux générations de sociologues, de politologues et de philosophes de la politique se sont chamaillés à propos de ce terme tabou, sans parvenir à trouver un accord. Les principaux de ces théoriciens ont repéré qu'au 19ème siècle ont émergé divers systèmes pour-vus simultanément 1) des caractéristiques typi-ques des autocraties et des dictatures (une aversion à l'égard du pluralisme politique et de tout contrôle du pouvoir souverain venu "du bas", hypertrophie des pré--rogatives du Chef,...) et 2) de caractéristiques is-sues des modèles démocratiques (légitimation popu-laire, degré élevé de participation des citoyens à la vie publique). Pour ces théoriciens, il est impossible de comprendre et d'étudier la nouveauté et l'origi-na-lité de telles expériences sans créer un critère de clas-sification adéquat, une dénomination ad hoc. La ré-pli-que de leurs adversaires, c'est de dire qu'il y a soit une ambigüité structurelle au sein même de la notion soit que l'application de cette même notion entraîne des distorsions dues à son instrumen-tali-sation. Sartori, Barber, Spiro sont des auteurs qui se sont prononcés dans le sens de ce soupçon. La pal-me du refus revient indubitablement à Georges Mos-se, devenu célèbre pour ses études sur le national-so-cialisme. Son jugement, il l'a exprimé dans Intervista sul nazismo (1) (= Entrevue sur le nazis-me), accordée à Michael Ledeen; ce jugement est sans appel: le totalitarisme "est un slogan typique de la guerre froide. Il surgit dans les années où il s'avè-re nécessaire de stigmatiser d'un seul coup tous les adversaires des démocraties parlementaires. C'est de ce fait une généralisation fausse; ou, pour dire mieux, c'est, de façon typique, une généralisation qui découle d'un point de vue libéral [...]. Entre Lé-nine, Staline et Hitler, les différences sont grandes et, de plus, les différences entre fascisme et bolché-visme sont énormes. Le concept de totalitarisme voile ces différences, parce qu'en l'utilisant, on en arrive à regarder le monde exclusivement du point de vue du libéral".
Le concept "totalitarisme" n'est pas infécond
En entendant ce réquisitoire, on serait tenté de croire que le terme "totalitarisme" est scientifiquement in-fé-cond. Domenico Fisichella, professeur ordinaire de sciences politiques à l'Université de Rome, ne le pense pas. Depuis dix ans, il s'applique à soustraire le mot "totalitarisme" à l'hégémonie de la sous-cul-ture journalistique, avec pour but de le restituer à la science. Il a commencé à le faire dans une série d'es-sais publiés dans Intervento et Diritto e società, puis dans un livre devenu célèbre, Analisi del tota-li-ta-rismo, qui a rapidement connu deux éditions chez l'éditeur D'Anna (en 1976 et en 1978). Aujourd'hui paraît une version mise à jour, remaniée et étoffée, Totalitarismo. Un regime del nostro tempo, livre ri-goureux dans la méthode et remarquable quant à son épaisseur théorique. C'est une étude vivante et docu-mentée, qui, de ce fait, se prête tant à une introduction exhaustive à l'argumentation qu'à une amorce de discussion.
Le pivot central de l'analyse de Fisichella, c'est la con-viction de l'utilité de la notion de "totalitarisme". Celle-ci peut, d'une part, être définie de manière co-hérente, afin d'éviter des tiraillements d'ordre instru-mental ou des usages hors de propos, et, d'autre part, être appliquée à toute une série de cas concrets. Ainsi, le concept peut être conservé car il possède une "capacité prédictive": si l'on est en mesure d'en reconnaître la nouveauté, cette nouveauté qui "obéit au conditionnement d'une société technologiquement avancée", on pourra finalement lancer l'hypothèse que "tous les totalitarismes qui se sont succédé jus-que aujourd'hui constituent à peine les premières épreu-ves, les premiers essais, d'un spectacle qui con-naîtra des suites de grande ampleur et de grande fréquence".
Le totalitarisme: une réponse à la fragmentation de nos sociétés industrielles avancées
Première donnée factuelle que nous pouvons retirer de la recherche de Fisichella: le totalitarisme appar-tient de plein titre à notre époque. C'est une réponse à la fragmentation culturelle et sociale qui est typique des sociétés industrielles urbaines. C'est une formu-le qui se destine à éviter la multiplication des conflits locaux et à imposer une sorte de mystique collective aux effets mobilisateurs. C'est une expérience qui n'en-tre pas forcément en contradiction avec la démo-cratie mais s'enchevêtre dans le réseau même de cel-le-ci, comme l'avait déjà bien deviné Jacob Talmon qui, dans Les origines de la démocratie totalitaire (2), analysait les applications qu'avaient déduites les Jacobins de la pensée de Rousseau.
Pour comprendre le sens de ce concept, il faut donc l'im-merger dans son temps propre, le délimiter tem-porellement, comme c'est la règle dans toutes les sciences sociales, et il faut éviter les transpositions ha-sardeuses, telles celles qu'ont essayés des auteurs comme Barrington Moore (3) qui émettait l'hy-po-thè-se que des totalitarismes avaient déjà existé dans la Chine antique, dans le Japon féodal ou dans la Ro-me de Caton. Dès que cette immersion a été opérée, la "nouveauté" totalitaire émerge clairement: les formes politiques qui l'incarnent ont toutes comme pré-mis-ses l'aliénation et l'homologation des citoyens, ce qui est typique pour les pays où l'accélération du développement technologique a fracassé les modes de vie basés sur les groupes primaires (la famille, la communauté villageoise). Le caractère démocratique du totalitarisme repose en fait sur la légitimation de la part des masses; jouissant d'une telle légitimation, le totalitarisme exprime dès lors un consensus basé sur le grand nombre, sur les agrégats générés par l'urbanisation et le déracinement.
Domenico Fisichella, un disciple de Hannah Arendt
A partir d'une telle prémisse —c'est-à-dire l'iden-ti-fication de la "société de masse" à un lieu où les to-ta-litarismes connaissent une incubation— s'arti-cu-le toute la construction théorique de l'essai de Fisichel-la: c'est en elle que nous pouvons découvrir l'élé-ment du livre le plus stimulant, le plus producteur de discussions fructueuses. La source principale d'ins-pi-ration du politologue romain, c'est Hannah Arendt, ce qu'elle a dit du totalitarisme et ses obser-va-tions critiques consignées dans Les origines du tota-litarisme. Bien sûr, dans son introduction et dans le corps de son texte, Fisichella corrige ou atténue quel--ques-uns des aspects les plus tranchés de l'ou-vra-ge-clef de la politologue et philosophe germano-américaine. Le raisonnement de Fisichella, sur ces points, se fait complexe; et pour pouvoir accéder au moins aux traits les plus saillants de ce raisonnement, il me paraît opportun de donner un ordre ana-lytique à la matière, avant de signaler les caracté-ris-tiques du totalitarisme selon Fisichella et, enfin, de lui adresser quelques objections.
Le totalitarisme a connu le succès, écrit Fisichella, dans les pays où il s'est imposé (les deux cas qui guident la démonstration de Fisichella sont l'Alle-magne nationale-socialiste et la Russie soviétique), parce qu'il a proposé une réponse à la crise de l'Etat, tant de l'Etat démocratique parlementaire que de l'E-tat encore lié à la formule autocratique. Cette crise, amorcée par la multiplication des acteurs politiques et sociaux de masse, déséquilibre en conséquence les systèmes de représentation, et ne peut être perçue comme un résultat du totalitarisme mais comme une donnée continue. A la perte des capacités identifica-trices des institutions étatiques, Lénine et Hitler ne ré--pondent pas, en fait, par une action coercitive restauratrice —comme dans la tradition des golpe auto-ritaires— mais par la consécration d'un nouveau su-jet, le parti, qui monopolise le pouvoir. Le mouve-ment de crise se projette du coup au-delà de l'Etat et le parti reproduit celui-ci, opère une duplication, et en amplifie les fonctions, créant simultanément une situation inédite, dans laquelle les compétences et les attributions d'autorité sont réparties selon des nor-mes non écrites et variables, selon les convenances du moment.
Le totalitarisme: un régime de révolution permanente
Le totalitarisme est de ce fait, d'après Fisichella, le ré-gime des révolutions permanentes, du nihilisme au pouvoir, de l'incertitude et du mouvement. Dans le to-talitarisme, on ne parvient jamais trop à savoir où se situe le véritable centre de la légitimité ou de l'au-to-rité: chez le Chef? Au parti? Au gouvernement? Dans la bureaucratie? A l'armée? La réponse varie se-lon les époques et aussi selon la position de l'ob-servateur.
Parce qu'il naît en réponse à un processus de mas-si-fication —c'est-à-dire de "dissolution des libres as-sociations et des groupes naturels, d'applatissement des pyramides sociales, de liquéfaction des diffé-rences individuelles et des innombrables agrégations de la communauté vivante en une masse grise"— le to-talitarisme émerge seulement de "situations de catastrophe, ou précipite celles-ci"; il révèle "comme symptôme initial de la "réaction de désastre" un "dé-sorientement total"". Dans un tel désarroi généralisé, face au "caractère plastique et dépourvu de forme de la personnalité des masses", face à l'"homme-mas-se" qui est "sembable à un récipient, toujours prêt à être rempli", le pouvoir totalitaire, qui considère que la révolution est un "office constant", met en acte un projet original de construction de l'homme nouveau, destructeur du vieil ordre démocratico-libéral et fon-dateur d'une ère nouvelle.
Le totalitarisme: expression politique du "mouvement" du monde
Les intuitions de Hannah Arendt sur le caractère "de mouvement" que détiennent toutes les expériences to-talitaires, Fisichella les développe et les remodèle sys-tématiquement. Le cadre qui ressort de ce travail de remodelage permet de définir le totalitarisme com-me un régime politique situé au-delà de la loi, qui est dans la perpétuelle impossibilité de se stabiliser, qui, pour éviter toute mise en sourdine, laisse toujours pla--ner une certaine incertitude quant à ses mouve-ments prochains et qui demeure imprévisible quant à ses choix stratégico-politiques et aux sanctions qu'il serait amener à prendre.
Si l'on garde à l'esprit qu'au fond de toute solution totalitaire, il y a une espérance de type millénariste, un espoir de voir surgir définitivement un "ordre nouveau" qui ferait table rase de la mentalité bour-geoise et de tout ce que celle-ci a produit antérieu-rement, on comprend pourquoi les régimes sovié-tique et nazi ont tenu à maintenir un haut degré de mobilisation populaire, afin d'étouffer le domaine du "privé", par le biais d'une expansion paroxystique de la vie et des devoirs publics. Tel est le premier stra-tagème destiné à bloquer la formation de cette mul-tiplicité de goûts, de styles, d'aspirations et de tendances qui agissent en substrat dans les sociétés pluralistes. Et parce que cette mobilisation "sans par-ticipation" (car, dans le langage de l'auteur, elle est "hétérodirecte", stimulée d'en haut) est constante, le régime impose une guerre civile institutio-nalisée, qui désigne toujours de nouveaux ennemis contre lesquels il s'agit de lutter, et installe l'"uni-vers concentrationnaire" et la terreur en guise de structures politiques afin de détacher les individus hostiles du tissu social.
Le totalitarisme a besoin d'ennemis
La propagande et la mobilisation nationales-socia-lis-tes et bolchéviques, souligne Fisichella, sont de type "guerrières et révolutionnaires" et insistent forcé-ment sur les embûches que dressent sournoisement l'"ennemi". Le totalitarisme a donc nécessairement be-soin d'une pluralité d'ennemis pour faire miroiter aux masses qu'il reste un objectif à atteindre. L'in-ven-tion technique du totalitarisme, son coup de gé-nie stratégique, c'est d'indiquer un ennemi objectif qui est tel par configuration métaphysique (c'est le juif ou le "contre-révolutionnaire" potentiel) et, étant de nature métaphysique, il est inépuisable. Avec un éventail de stéréotypes martellé dans les crânes à qui mieux-mieux, doublé d'une théorie conspirative de l'histoire, rendue élémentaire et suggestive, Lénine et Hitler —mais aussi leurs émules, fidèles, colla-bo-rateurs et successeurs— finiront en effet par con-vaincre les masses que la révolution et l'ordre nou-veau sont constamment menacés et que dès lors, il n'est pas licite de "baisser la garde".
Schématiquement, on peut dire que Fisichella met bien en évidence l'essence authentique du totalita-ris-me en signalant sa vocation anti-pluraliste et massi-fiante et en décrit toutes les conséquences pratiques ul-té-rieures (subordination radicale de l'économie à la politique, fin de l'homo oeconomicus, a-classisme, pré-disposition des masses au sacrifice par défaut d'un cadre stable et reconnaissable d'intérêts, etc.). Fi-sichella en arrive ensuite à sa conclusion provo-catrice et, partant, intéressante; il dit qu'étant radi-calement révolutionnaires, tous les phénomènes tota-litaires sont de gauche (le national-socialisme com-pris, dont le caractère anti-bourgeois est répété et attesté). Le livre de Fisichella affronte, chapitre après chapitre, les nœuds principaux de cette ques-tion, dont le problème de la "nouveauté" du totalita-risme, le système de terreur, la révolution permanente, la transformation de la société, le consensus. De plus, ce livre passe en revue deux autres régimes que l'on pourrait encore qualifier de "totalitaires" et introduire dans la catégorie des totalitarismes: 1) le fascisme italien que Fisichella, documents à l'appui, exclut du domaine totalitaire, le considérant au con-traire comme un exemple d'"Etat total" ou "to-ta-liste" et 2) la Chine maoïste qu'il inclut dans sa catégorie du totalitarisme.
Une nouvelle typologie qui distingue "totalitarisme" et "autoritarisme"
Dès que l'on referme cet ouvrage, les stimuli de ré-flexion et de discussion apparaissent trop nombreux, trop importants, pour pouvoir être tous consignés dans une simple recension. Certes, plusieurs affir-mations de fond posées par Fisichella ne peuvent qu'ê-tre retenues et, tout d'abord, la rigoureuse distinc-tion qu'il opère entre les régimes totalitaires et les régimes autoritaires. Cette distinction permet d'affir-mer l'utilité du concept de "totalitarisme" (ce que nous avions déjà exprimé dans notre livre Partito unico e dinamica autoritaria (4), qui aborde le pro-blème de la place structurelle et fonctionnelle du parti dans les systèmes non compétitifs).
Il reste à voir a) si cette typologie n'a pas besoin de spé-cifications ultérieures; b) quand et à quelle réalité elle peut s'appliquer; c) si sont fondés les arguments des théoriciens de la "société de masse", sur laquelle repose la lecture du totalitarisme comme régime de mo-bilisation permanente.
Sur le premier point, il me semble que sont per-tinentes les observations de Juan Linz dans son essai si souvent cité: Totalitarian and Authoritarian Regimes. La catégorie linzienne du "régime auto-ri-taire de mobilisation" permet en effet de mieux ren-dre compte des analogies indéniables, d'ordre idéo-lo-gique et pratique, que néglige la dichotomie habi-tuelle entre autoritarisme et totalitarisme. Dans cette perspective, la lecture que donne Linz des fascismes (national-socialisme inclus) s'avère particulièrement efficace: l'identification des sous-types au sein du ge-nus commun autoritaire permet une modulation plus efficiente, finalement, du spectre des différentia-tions.
Y a-t-il encore du "totalitarisme" dans le monde?
Un autre problème sérieux, mais ultérieur, est celui qui peut être réduit à deux questions: quels sont les régimes qui peuvent se dire "totalitaires"? Et s'ils ne le sont pas entièrement, à quel moment le sont-ils? Dans les pages du livre de Fisichella, émergent quel-ques doutes: l'auteur se dit sceptique quant à la pos-sibilité de considérer comme achevée la transition du totalitarisme à l'autoritarisme dans les régimes com-mu-nistes d'Europe de l'Est. Comment est-il possible de repérer les caractères centraux de la définition fi-sichellienne du totalitarisme dans des pays comme la Pologne actuelle, la Hongrie ou la RDA? Et l'"u-ni-vers concentrationnaire" est-il bel et bien existant en Tchécoslovaquie ou en URSS? Et la tendance domi-nante de ces systèmes, tend-elle vers la massi-fica-tion, vers l'anti-pluralisme, vers le contrôle rigide du secteur public sur l'économie? Il nous semble que l'on ne puisse pas du tout l'affirmer péremptoi-re-ment. Et c'est là précisément que surgit le problème que suscite toute lecture arendtienne du totalitarisme: si on l'adopte de façon a-critique, et si l'on partage avec Fisichella l'idée d'une actualité persistante du modèle totalitaire, on finira par ne plus réussir à trou-ver une réalité qui l'incarne. Certes, il y a l'Al-ba-nie. Ou la Roumanie. Sans doute l'Iran (mais que dire du rôle du parti?). Et que penser de Cuba, ou du Vietnam? Et ensuite?
Corriger le jugement de Hannah Arendt et de ses disciples sur le nazisme
Le punctum dolens de ce discours, en général, c'est le problème de la "société de masse" et de ses con-sé-quences. La thèse des Arendt, Kornhauser, Sig-mund Neumann, Lederer, etc. a connu pendant quel-ques décennies une vaste popularité et a con-tri-bué a forger le concept de totalitarisme tel que l'ont accepté les sciences sociales. Aujourd'hui, ce con-cept vacille sous les coups de la critique empirique qui en dévoile le substrat philosophique et les préju-gés de valeur. Bernt Hagtvet a très bien démontré, dans son brillant essai intitulé The Theory of Mass Society and the Collapse of the Weimar Republic: A Re-Examination (5), que la société de Weimar, dont est issu le national-socialisme, était tout autre chose qu'un agrégat social informel et atomisé, dépourvu de toute agrégation d'intérêts reconnaissables et légi-timés: cette République de Weimar était au contraire un réseau dense de réalités associatives des genres les plus divers, réseau que la NSDAP a pu conquérir de l'intérieur dans la plupart des cas, grâce à une capacité d'identification multiforme et élastique. Ri-chard Hamilton (in: Who voted for Hitler?) et Thomas Childers (in: The Nazi Voter) ont pu dé-montrer, dans leurs études remarquables quant aux élections, que le degré maximal de consensus en fa-veur du nazisme en marche ne provenait pas des périphéries des métropoles, habitées par des déra-cinés, mais des petits centres agricoles et commer-ciaux. D'autre part, il est vrai que les strates sociales à l'identité la plus solide, comme les catholiques et les ouvriers socialistes, sont celles qui résistèrent le mieux à l'avance hitlérienne. Il n'empêche que ce qui a attiré les individus les moins imbriqués, les moins dotés d'identité sociale, ce fut la promesse de "démobiliser de manière coercitive les conflits", pro-messe qu'incarnaient les nationaux-socialistes, et non le projet de "révolution permanente".
L'effet de "rassurance"
Fisichella a néanmoins raison quand il affirme que le totalitarisme "inclut dans son utopie, en tant que dé-passement des frustrations et des insécurités déri-vées d'un état historique dense de tensions, la fin ra-dicale et définitive du conflit, lequel est dissous fina-le-ment dans la "communauté du peuple" et dans la so-ciété sans classes". Mais Fisichella nous convainc moins quand il ajoute que, par un contraste para-doxal, le totalitarisme "s'auto-attribue (et se destine à) une vocation radicale et permanente au conflit et à la guerre". Il nous apparaît toutefois que le citoyen qui obéit à un gouvernement totalitaire n'obéit pas à une angoisse d'insécurité (chose qui est réservée au dissident, à l'opposant) mais à un effet de "rassu-rance", qui non seulement demeure mais se renforce au cours du passage du mouvement totalitaire à la "pillarisation" du régime. De nombreux historiens l'ont démontré: le citoyen de l'Allemagne nazie ou de la Russie stalinienne a largement ignoré les er-reurs et les horreurs: les déportations, les purges, les camps d'extermination. Ce citoyen s'est rassuré sans cesse, s'est senti apaisé en constatant la dis-pari-tion des conflits sociaux que les régimes pré-tota-li-taires n'avaient su ni prévenir ni endiguer.
Adepte du totalitarisme est donc celui qui ne sup-porte pas le fardeau que constitue la complexité des so-ciétés modernes, celui qui esquive les conflits tu-mul-tueux qui accompagnent la fragmentation so-ciale, celui qui spécule sur les bénéfices qu'il espère tirer d'un horizon nouveau de pacification mais impo-sé de force. En ce sens, la leçon des totalitarismes est toujours d'actualité et la menace persiste d'un écroulement des situations actuelles où règne un plu-ralisme querelleur et désagrégateur. Les politologues et les opérateurs de la politique en prendront-ils cons-cience rapidement et arracheront-ils le totalita-risme à ses formes trop idéalisées pour le restituer à son authentique banalité, la banalité des solutions qui demeurent toujours à portée de main, la banalité des raccourcis accidentés qu'empruntent ceux qui ne peuvent supporter l'excès d'inquiétude auquel notre temps semble les avoir condamnés.
Marco TARCHI.
Domenico FISICHELLA, Totalitarismo. Un regime del nostro tempo, La Nuova Italia Scientifica, Roma, 1987, p. 195, lire 25.000. Trad. franç.: Robert Steuckers.
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences politiques, totalitarisme, politologie, théorie politique, philosophie, italie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 juin 2009
America's Left-Conservative Heritage
America’s Left-Conservative Heritage
Recent dialogue between Kevin R.C. Gutzman, Christian Kopff and Tom Piatak concerning the tension between classical liberal-libertarians and traditionalist conservatives reminded me of an observation from my Portuguese “national-anarchist” colleague Flavio Goncalves concerning the clarion call issued by Chuck Norris a while back: “Seems like the US Right is as revolutionary as the South American Left? Your country confuses me.”
It does indeed seem that most of the serious dissidents in America are on the Right nowadays, and I think this can be understood in terms of America’s unique political heritage. American rightists typically regard themselves as upholders and defenders of American traditions, while American liberals tend to admire the socialism and cultural leftism of the European elites. However, the republican political philosophy derived from the thought of Locke, Montesquieu and Jefferson that found its expression in such definitive American documents as the Declaration of Independence and the Constitution, and of which modern neo-classical liberalism and libertarianism are outgrowths, is historically located to the left of European socialism.
A variety of thinkers from all over the spectrum have recognized this. For instance, Russell Kirk somewhat famously remarked that conservatives and socialists had more in common with one another that either had with libertarians. Murray Rothbard observed that “conservatism was the polar opposite of liberty; and socialism, while to the “left” of conservatism, was essentially a confused, middle-of-the-road movement. It was, and still is, middle-of-the-road because it tries to achieve liberal ends by the use of conservative means.” Seymour Martin Lipset affirmed Rothbard’s thesis:
Given that the national conservative tradition in many other countries was statist, the socialists arose within this value system and were much more legitimate than they could be in America…Until the depression of the 1930s and the introduction of welfare objectives by President Roosevelt and the New Deal, the AFL was against minimum wage legislation and old age pensions. The position taken by (Samuel) Gompers and others was, what the state gives, the state can take away; the workers can depend only on themselves and their own institutions…Hence, the socialists in America were operating against the fact that there was no legitimate tradition of state intervention, of welfarism. In Europe, there was a legitimate conservative tradition of statism and welfarism. I would suggest that the appropriate American radicalism, therefore, is much more anarchist than socialist.
Back in 1912, when the German Social Democrats won 112 seats in the Reichstag and one-third of the vote, Kaiser Wilhelm II wrote a letter to a friend in which he said that he really welcomed the rise of the socialists because their statist positions were much to be preferred to the liberal bourgeoisie, whose antistatism he did not like. The Kaiser went on to say that, if the socialists would only drop antipatriotism and antimilitarism, he could be one of them. The socialists wanted a strong Prussian-German state which was welfare oriented, and the Kaiser also wanted a strong state. It was the pacifism and the internationalism of the socialists that bothered him, not their socialism. In the American context, the “conservative” in recent decades has come to connote an extreme form of liberalism; that is, antistatism. In its purest forms, I think of Robert Nozick philosophically, of Milton Friedman economically, and of Ronald Reagan and Barry Goldwater politically.
Thomas Sowell has provided some interesting insights into what separates the Left and Right in contemporary American discourse. Both Left and Right are derivatives of eighteenth century radicalism, with the Left being a descendent of the French Revolution and the Right being a descendent of the American Revolution. What separates the legacies of these two revolutions is not their radicalism or departure from throne-and-altar traditionalism, but their differing views on human nature, the nature of human society, and the nature of politics. Both revolutions did much to undermine traditional systems of privileged hierarchy. After all, how “traditional” were the American revolutionaries who abolished the monarchy, disestablished the Church, constitutionally prohibited the issuance of titles of nobility, constitutionally required a republican form of government for the individual states and added a bill of rights as a postscript to the nation’s charter document? One can point to the Protestant influences on the American founding that coincide with the Enlightenment influences, but how “traditional” is Protestantism itself? Is not Protestantism the product of a rebellion against established religious authorities that serves as a kind of prelude to a latter rebellion to established political authorities?
I would maintain that what separates the modern Right and Left is not traditionalism versus radicalism, but meritocracy versus egalitarianism. For the modern Left, equality is considered to be a value in its own right, irrespective of merit, whether individual or collective in nature. The radical provisions of the U.S. Constitution, for instance, aimed at eliminating systems of artificial privilege. No longer would heads of state, clerics, or aristocrats receive their position simply by virtue of inheritance, patronage or nepotism, but by virtue of individual ability and achievement. No longer would an institution such as the Church sustain itself through political privilege, but through the soundness of its own internal dynamics. To be sure, these ideals have been applied inconsistently throughout American history, and all societies are a synthesis of varying cultural and ideological currents. For instance, it is clear that nepotism remains to some degree. How else could the likes of George W. Bush ever become head of state?
Yet, for the Left, equality overrides merit. With regards to race, gender or social relations, for example, it is not sufficient to simply remove barriers designed to keep ethnic minorities, women or homosexuals down regardless of their individual abilities or potential contributions to society. Instead, equality must be granted regardless of any previous individual or collective achievement to the point of lowering academic or professional standards for the sake of achieving such equality. This kind of egalitarian absolutism is also apparent with regards to issues like the use of women in military combat or the adoption of children by same-sex couples. The Left often frames these issues not in terms of whether the use of female soldiers is best in terms of military standards (perhaps it is) or what is best for the children involved or whether the parenting skills of same-sex couples is on par with those of heterosexual couples (perhaps they are), but in terms of whether women should simply have the “right” to a military career or whether same-sex couples should simply have “equal rights” to adopt children, apparently with such concerns as military efficiency, child welfare and parental competence being dismissed as irrelevant.
To frame the debate in terms of tradition versus radicalism would seem to be setting up a false dichotomy. Edmund Burke, the fierce critic of the French Revolution considered by many to be the godfather of modern conservatism, was actually on the left-wing of the British politics of his time. For instance, he favored the independence of Ireland and the American colonies and even defended India against imperial interests. A deep dig into Burke’s writings reveals him to have been something of a philosophical anarchist. His opposition to the French Revolution was not simply because it was a revolution or because it was radical, but because of the specific content of the ideology of the revolutionaries who aimed to level and reconstruct French society along prescriptive lines. The American Revolution was carried out by those with an appreciation for the limits of politics and the limitations imposed by human nature, while the French Revolution was the prototype for the modern totalitarian revolutions carried out by the Bolsheviks, Nazis (whom Alain De Benoist has characterized as “Brown Jacobins”), Maoists , Kim Il-Sung and the Khmer Rouge.
One can certainly reject the hyper-egalitarianism championed by the Left and still favor far-reaching political or social change. It would be hard to mistake Ernst Junger for an egalitarian, yet he was contemptuous of the Wilhelmine German military’s practice of selecting officers on the basis of their class position, family status or political patronage rather than on their combat experience. He preferred a military hierarchy ordered on the basis of merit rather than ascribed status. Junger’s Weimar-era writings are filled with a loathing for the social democratic regime, yet he called for an elitist worker-soldier “conservative revolution” rather than a return to the monarchy.
Nor does political radicalism imply the abandonment of historic traditions. I, for one, advocate many things that are quite radical by conventional standards. Yet I am extremely uncomfortable with left-wing pet projects such as the elimination of “offensive” symbols like the Confederate flag; the alteration of the calendar along PC lines (C.E. and B.C.E instead of A.D. and B.C); the attacks on traditional holidays like Christmas or Columbus Day; a rigidly secular interpretation of the First Amendment (and I’m an atheist!); and the attempted reconstruction of language along egalitarian lines (making words like “crippled” or “retarded” into swear words or the mandatory gender neutralization of pronouns). All of these things seem like a rookie league version of Rosseauan/Jacobin/Pol Potian “year zero” cultural destructionism. Nor do I wish to do away with baseball, Fourth of July fireworks displays, Civil War re-enactors or the works of Edgar Allan Poe. I am also somewhat appalled that one can receive a high school diploma or even a university degree without ever having taken a single course on the history of Western philosophy. It is not uncommon to find undergraduates who have never heard of Aristotle. If they have, they are most likely to simply dismiss him as a sexist and defender of slavery. I’ve met graduate level sociology students who can tell you all about “the social construction of gender” but have no idea who Pareto was.
The principal evil of the Cultural Marxism of present day liberalism is its fanatical egalitarianism. Unlike historic Marxists, who simply sought equality of wealth, cultural Marxists seek equality of everything, including not only class, race, or gender, but sexuality, age, looks, weight, ability, intelligence, handicap, competence, health, behavior or even species. I’ve heard leftists engage in serious discussion about the evils of “accentism.” Such equality does not exist in nature. It can only be imposed artificially, which in turn requires tyranny of the most extreme sort. The end result can only be universal enslavement in the name of universal equality. For this reason, the egalitarian Left is a profoundly reactionary outlook, as it seeks a de facto return to the societies organized on the basis of static caste systems and ascribed status that existed prior to the meritocratic revolution initiated by the Anglo-American Enlightenment.
Perhaps just as dreadful is the anti-intellectualism of Political Correctness. In many liberal and no-so-liberal circles, the mere pointing out of facts like, for instance, the extraordinarily high numbers of homicides perpetrated by African-Americans is considered a moral and ideological offense. If one of the most eminent scientists of our time, Dr. James Watson, is not immune from the sanctions imposed by the arbiters of political correctness, then who would be? Are such things not a grotesque betrayal of the intellectual, scientific and political revolution manifested in Jeffersonian ideals? Is not Political Correctness simply an effort to bring back heresy trials and inquisitors under the guise of a secularized, egalitarian, fake humanitarian ideology? The American radical tradition represents a vital “left-conservative” heritage that elevates meritocracy over both an emphasis on ascribed status from the traditional Right and egalitarianism from the Left. It is a tradition worth defending.
00:35 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, etats-unis, politologie, sciences politiques, idéologies, conservatisme, gauches, droites |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 juin 2009
Sobre a Autoridade
Sobre a Autoridade

Um dos pontos débeis do pensamento politicamente correcto é esquecer, ignorar ou não considerar certos temas de todos os dias como a dor, o envelhecimento, a morte, a hierarquia, a ordem, a autoridade.
A respeito deste último tema, sabemos que desde o iluminismo (século XVIII) até ao progressismo dos nossos dias deu-se a negação sistemática da autoridade para substitui-la por critérios meramente racionalistas. Sem notar que não pode existir nenhum conhecimento livre da autoridade, pois ela é um seu elemento constitutivo. Ainda que a autoridade não possa substituir o juízo próprio, ele não exclui que a autoridade seja fonte de verdade.
Por outro lado, nenhum homem pode pensar a partir “somente da sua razão”, mas antes começa a pensar no seio de uma determinada tradição de pensamento ou cultura. Todo o homem nasce dentro de grandes ecúmenos culturais que condicionam o seu sentido de ser no mundo.
Qualquer um que oiça a palavra autoridade associa-a imediatamente com a figura do que manda sendo o seu correlativo aquele que obedece. A relação mando-obediência impõe-se de início como a dupla a partir da qual começamos a entender aquilo que enforma o conceito de autoridade. Esta última podemos caracterizá-la, numa primeira definição, como a imposição da vontade de um homem sobre outro.
Mas assim que nos detemos sobre ela vemos que esta definição não é de todo suficiente porque nos fala mais sobre a consequência do exercício da autoridade do que da autoridade propriamente dita. E as definições para serem completas e acabadas têm de apanhar a essência do que pretendem definir e não somente a sua finalidade.
A versão autoritária da autoridade vincula-a com a obediência, à priori, cega ou mecânica. De facto, esta concepção da autoridade esteve ligada às ordens militares ou religiosas, sobretudo no período de formação dos seus membros. Autoritário é aquele que exerce o seu poder para obter a obediência de outro.
Mas, como dizíamos, a natureza da autoridade não se esgota na obediência mas antes há que encontrá-la a partir do acto de reconhecimento de um saber superior, em qualquer aspecto da vida, que um homem constata noutro. A superioridade do saber do outro sobre o nosso é a origem da autoridade.
A autoridade não se recebe mas antes é concedida por um homem a outro. É concedida por aquele que reconhece no outro um saber ou conhecimento superior ao que ele possui na matéria ou tema de que se trate. Ninguém é autoridade em tudo, é-se sempre autoridade nalguma ordem de coisas, domínios ou disciplinas, ainda que nenhum de nós esteja livre dos “tudólogos”, os que “tudo-sabem”. A única “tudologia” aceitável é aquela dos pais sobre os filhos, e só até aos seis ou sete anos de idade.
A autoridade funda-se sobre o saber reconhecido de alguém e na necessidade que esse conhecimento gera. O centenário filósofo Hans Gadamer (1900-2002) escreveu: a autoridade correctamente entendida tem a ver, não com a obediência, mas com o conhecimento.
O homem, a partir do momento em que reconhece outro como autoridade, confia no que este diz como sendo verdade. É por isso que a autoridade pressupõe o conhecimento ou o saber daquele que a exerce, enquanto a obediência revela o poder, indica-nos o exercício concreto de autoridade de quem a exerce.
Assim, a autoridade, que como exercício se manifesta no campo político-social pôde ser definida, muito acertadamente, pelo filósofo céptico Giuseppe Rensi (1871-1941), na sua obra Filosofia da Autoridade (1920) como:”o acto que determina o que de facto vale como justiça e moral…entre opostas verdades teóricas racionalmente possíveis é a autoridade que decide o que de facto deve valer como se fosse a justiça, o bem, a verdade”
A objecção que nasce da politologia e da sociologia ao observar que nas nossas sociedade nem todas as autoridades dizem a verdade, pois existem autoridades que infundem conhecimentos falsos para manipular as pessoas, objecção que também pode aplicar-se à manipulação de grupos sociais menores, é difícil de contestar. Há que fazer a distinção entre “potestas” e “auctoritas”. A autoridade entendida como poder pode mentir, e de facto mente, para alcançar a obediência, mas a autoridade enquanto “auctoritas”, ou seja, em si mesma, funda-se sobre a verdade. Pois o conhecimento é sempre verdadeiro, um falso conhecimento é um desconhecimento.
Ainda que a autoridade gere obediência, ela não é obediência, essa é a consequência do exercício da autoridade. Mas, a autoridade tem como finalidade somente alcançar a obediência ou procura, e pode, aspirar a algo mais?
Uma vez mais temos que aplicar o velho princípio metodológico da filosofia clássica “distinguere ut iungere” (distinguir para unir) e assim discriminar entre bens externos e bens internos. A autoridade, no campo dos bens externos, pode, numa prática mal feita (uma pseudo-investigação) lograr prestígio, fama e dinheiro. Há tansíssimos académicos de pacotilha hoje em dia. Mas, pelo contrário, a autoridade, nos bens intrínsecos, só se pode afirmar realizando bem a prática em questão. Os bens internos a determinada prática só se podem obter realizando bem essa prática.
Assim, pôde afirmar o grande filósofo escocês Alasdair MacIntyre (1929- ) que a virtude (analogicamente a autoridade) só pode ser definida em relação com as práticas e com os seus bens internos.
E estes bens internos não são só para quem os realiza mas são bens para toda a comunidade. Uma autoridade, mesmo a mais isolada, é sempre uma autoridade socialmente reconhecida.
Assim, o pseudo-investigador do exemplo, esses especialistas das Comissões e das Academias, usurpadores de bolsas, prestígios e cânones, poderão ter um currículo alargado e ganhar bom dinheiro, mas o que nunca terão é a satisfação de ter podido ampliar os conhecimentos das suas disciplinas, metodologicamente garantidos pela prática de investigar e a autoridade que os guia.
Vemos, então, como a natureza ou essência da autoridade se revela de duas formas: por um lado no reconhecimento do superior por parte do inferior, e por outro no serviço do superior ao inferior por meio de uma boa prática. A finalidade última da autoridade é o progresso existencial dos que a acatam. Dá-se, assim, por cumprido, o último sentido etimológico de “auctoritas”, que os romanos entendiam como reconhecimento, respeito e aceitação, que deriva do substantivo “auctor” = criador, autor, instigador, por sua vez derivado do verbo “augere”, que significa aumentar, fazer progredir.
Alberto Buela, Arbil nº118
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : théorie politique, philosophie, politologie, sciences politiques, autorité, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 17 juin 2009
Sobre a Igualdade
Sobre a Igualdade
Robert Steuckers, numa entrevista de Maio de 1998, sobre o igualitarismo e a posição da Nova Direita francesa face ao tema
Que diferença entre Nietzsche e Marx quando nos colocamos no ponto de vista do igualitarismo moderno? Para Marx a injustiça provoca a desigualdade, para Alain de Benoist, neste sentido pós-nietzschiano, a injustiça instaura-se precisamente porque vivemos numa era igualitária.
(Robert Steuckers) – A sua questão inscreve-se numa problemática de ordem semântica. Você procura ver clareza na manipulação em todos os sentidos das “grandes palavras” do debate político-social: justiça, liberdade, igualdade, etc., todas estão desvalorizadas pelos “discursos gastos” da política politiqueira. Tentemos clarificar esse debate.
1)Para Marx, efectivamente, a injustiça social, a não redistribuição harmoniosa dos rendimentos sociais, a concentração de capitais em muito poucas mãos provocam uma desigualdade entre os homens. É preciso, portanto, redistribuir justamente, para que os homens sejam iguais. Serão iguais quando não mais forem vítimas de qualquer injustiça de ordem material (baixos salários, exploração do trabalho humano, incluindo crianças, etc.).
2)Para a tradição dita “inigualitária” da qual se afirmou Benoist no início da sua carreira “metapolítica”, a injustiça é que os indivíduos excepcionais ou sobredotados não recebam tudo o que lhes é devido numa sociedade que visa a igualdade. Neste sentido, “igualdade” significa “indiferenciação”. Esta equação é sem dúvida plausível na maioria dos casos, mas não o é sempre. Alain de Benoist teme sobretudo o nivelamento (por baixo).
Estas opiniões desenvolvem-se ao nível da vulgata, da doxografia militante. Para aprofundar o debate é preciso recapitular todo o pensamento de Rosseau, o seu impacto sobre o socialismo nascente, sobre o marxismo e sobre as múltiplas manifestações da esquerda contestatária.
De qualquer modo, no debate actual, convém sublinhar o que se segue:
a)Uma sociedade equilibrada, consensual, harmoniosa, conforme a uma tradição, cria a partir dela mesma a justiça social, gera-a espontaneamente, ela é atravessada por uma lógica de partilha (dos riscos e dos bens) e, parcialmente, de doação. Ela evita as clivagens geradoras de guerras civis, e portanto as desigualdades demasiado gritantes em matérias económicas. A Roma antiga dá-nos bons exemplos na matéria, e não somente no caso das reformas dos Gracos (às quais se referem os marxistas). Os excessos de riqueza, as acumulações muito flagrantes, as especulações mais escandalosas, a usura, eram reprimidas por multas consideráveis e reinvestidas nas festividades da cidade. As pessoas divertiam-se à posteriori com o dinheiro injustamente ou exageradamente acumulado. As multas, aplicadas pelos edis curuis, taxavam aqueles que transgrediam contra a frugalidade paradigmática dos romanos e beneficiavam o povo. A acumulação exagerada de terras aráveis ou de pasto eram igualmente objecto de multa (multo ou mulcto).
b)A prática da justiça está, portanto, ligada à estrutura gentílica e/ou comunitária de uma sociedade.
c)Uma estrutura comunitária admite as diferenças entre os seus cidadãos mas condena os excessos (hybris, arrogância, avarice). Esta condenação é sobretudo moral mas pode revestir-se de um carácter repressivo e coercivo através das autoridades públicas (a multa reclamada pelos edis da Roma antiga).
d)Numa estrutura comunitária há uma espécie de igualdade entre os pares. Mesmo se certos pares têm direitos particulares ou complementares ligados à função que ocupam momentaneamente. É a função que dá direitos complementares. Não há traço de inigualdade ontológica. Ao invés, há inigualdade das funções sociais.
e)Uma estrutura comunitária desenvolve simultaneamente uma igualdade e inigualdades naturais (espontâneas) mas não procura criar uma igualdade artificial.
f)A questão da justiça regressou à discussão no pensamento político americano e ocidental com o livro de John Rawls (A Theory of Justice, 1979). O liberalismo ideológico e económico gerou no pensamento e na prática social ocidental um relativismo cultural e uma anomia. Com este relativismo e esta anomia os valores que cimentam a sociedade desaparecem. Sem estes valores, deixa de haver justiça social, já que o outro deixa de ser considerado como portador de valores que também partilho ou outros valores que considero eminentemente respeitáveis, ou deixa de haver valores credíveis que me constrinjam a respeitar a dignidade de outrem. Mas no contexto de uma tal perda de valores deixa também de haver comunidade coerente. A esquerda americana, que se entusiasmou com o livro de Rawls, quis, numa segunda vaga, restaurar a justiça reconstituindo os valores que cimentam as comunidades naturais que compõem os Estados e as sociedades políticas. Reconstituir estes valores implica forçosamente uma guinada à “direita”, não uma direita militar ou autoritária, mas uma direita conservadora dos modelos tradicionais, orgânicos e simbióticos da vida-em-comum (a “merry old England”, a alegria francesa, a liberdade germânica nos cantões suíços, etc.)
g)A contradição maior da Nova Direita francesa é a seguinte: ter sobrevalorizado as inigualdades sem sonhar em analisar seriamente o modelo romano (matriz de muitos delineamentos do nosso pensamento político), ter sobrevalorizado as diferenças até ao ponto de, por vezes, aceitar a hybris, ter simultaneamente cantando as virtudes da comunidade (no sentido definido por Tönnies) ao mesmo tempo que continuava a desenvolver um discurso inigualitário e falsamente elitista, não ter compreendido que estas comunidades postulavam uma igualdade de pares, ter confundido, ou não ter distinguido correctamente, essa igualdade de pares e a igualdade-niveladora, ter desenvolvido teses críticas sobre a igualdade sem ter levado em conta a “fraternidade”, etc. Daí a oscilação de De Benoist relativamente ao pensamento de Rousseau, rejeição completa no início da sua carreira, adesão entusiasta a partir dos anos 80 (cf. intervenção no colóquio do G.R.E.C.E. de 1988). Com a abertura do pensamento comunitário americano (cf. Vouloir n°7/NS e Krisis n°16), que se refere à noção de justiça teorizada por Rawls, a primeira teoria neo-direitista sobre a igualdade despedaça-se e é abandonada pela nova geração do G.R.E.C.E.
h)A igualdade militante, leitmotiv que estruturou o passo de todos os pensamentos políticos dominantes na França (NdT: e na Europa), é uma igualdade que visa o nivelamento, o controlo das mentalidades e dos corpos (Foucault: “vigiar e punir”), a redefinição do território, que se desenrola de forma sistemática para transformar a diversidade fervilhante da sociedade civil numa “cidade geométrica” (Gusdorf). Numa acção dessas as comunidades e as personalidades são disciplinadas, são-lhes impostas interdições de exprimirem a sua espontaneidade, a sua especificidade, o seu génio criativo. A vontade de restaurar essa espontaneidade, essa especificidade e esse génio criativo passa por uma recusa dos métodos de nivelamento igualitarista sem, contudo, impedir que se pense a igualdade em termos da igualdade de pares e de “phratries” comunitárias, bem como de pensar a “fraternidade” em sentido geral (terceiro termo da tríade revolucionária francesa, mas abandonado em quase todas as práticas políticas pós-revolucionárias). A Nova Direita francesa (contrariamente às suas congéneres alemã e italiana) geriu mal esta contradição entre a primeira fase da sua mensagem (obsessivamente anti-igualitarista) e a segunda fase (neo-rousseauniana, pela democracia orgânica, comunitária, interessada pela teroria da justiça em Rawls). O resultado é que continua a ser sempre vista como obsessivamente anti-igualitarista nas fontes historiográficas mais correntes, quando na realidade desenvolve um discurso muito diferente desde há cerca de uma dúzia de anos, pela voz do próprio De Benoist e Charles Champetier.
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, nouvelle droite, politologie, sciences politiques, théorie politique, égalité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 juin 2009
Reinterpretar la revolucion socialista
Reinterpretar la revolución socialista
 ex: htpp://labanderanegra.wordpress.com/
ex: htpp://labanderanegra.wordpress.com/
Reinterpretar el concepto que se tiene comúnmente de la revolución socialista -en momentos en los cuales los diversos acontecimientos políticos, sociales, económicos, culturales y militares suscitados a finales del siglo XX han trastocado la noción de certidumbre a que estaba habituada la humanidad, aún con el riesgo de una hecatombe termonuclear durante la Guerra Fría- implica adoptar un distanciamiento y un cuestionamiento generalizado respecto al modelo de sociedad actual, de manera que la revolución como tal adquiera una dimensión realmente revolucionaria y, por ende, socialista, evitando convertirse, como lo indicara el Che Guevara, en simple caricatura.
Esto pasa por determinar si el discurso y las mismas actitudes personales corresponden a la realidad que se busca trascender y transformar, en lugar de disfrazarla con los ribetes del reformismo, al igual que ocurre con las acciones gubernamentales aparentemente socialistas en algunos de nuestros países.
Pero, esto no será nunca suficiente si no determinamos, a su vez, los objetivos que se persiguen y no contentarse nada más con traspasar los límites individuales en que nos hallemos, en tanto el grueso de los sectores populares se mantiene luchando sin esperanza inmediata por un mundo mejor. Al hacerlo así, estaríamos reivindicando los valores mezquinos inculcados por el capitalismo; razón por la cual se impone someter a tal cuestionamiento los diversos paradigmas que han definido la sociedad humana hasta el presente. Sin ello, se hará sumamente dificultoso sostener una lucha radical hacia el socialismo.
Es fundamental -por tanto- comprender e interpretar que la sociedad siempre ha sido vista y aceptada como una totalidad de relaciones sociales y no la suma de elementos separados, por lo que el socialismo supone una profunda y completa transformación del sistema económico capitalista, en un primer lugar, y de todas sus derivaciones en los demás ordenes; transformación ésta que debe abarcar lo concerniente a las relaciones de producción, así como aquellas que legitiman la propiedad privada de los medios de producción, como su rasgo esencial. Tendría que originarse, en consecuencia, una rebelión integral y permanente contra las estructuras sobre las cuales se levanta el orden establecido. En el caso de nuestra América, tal rebelión debe expresarse en el rescate de la memoria histórica de sus luchas populares -sin ese sesgo positivista y eurocentrista impuesto por la historia oficial- formando un lazo con esa búsqueda de emancipación constante protagonizada por los hombres y las mujeres del pasado que les garantizara a nuestros pueblos su derecho inalienable a la autodeterminación, la democracia, la libertad, la justicia y la igualdad. De ahí que no sea revolucionario y, menos, socialista levantar diques que represen la iniciativa de las bases populares para profundizar las conquistas democráticas y así destruir el viejo orden imperante porque ello sería transitar una vía que nos conducirá, a la larga, al reformismo, haciendo del socialismo una mera aspiración.
Como lo escribiera Wim Dierckxsens en su obra “La transición hacia el postcapitalismo: el socialismo del siglo XXI”: “la sociedad que se proyecta construir, se caracteriza no por el poder de definición del bien común desde arriba, sino por una interpelación ciudadana que opera desde lo local hacia lo global y de lo particular a lo general. La democracia puede llegar a adquirir contenido y forma plenos, cuando la economía se oriente en función de la plenitud de la vida misma. Ello implica una participación más directa de la ciudadanía en todos los ámbitos de la vida”. Por ello, en términos generales, ninguna revolución que se precie de socialista podría contradecir, a riesgo de negarse, tales objetivos, sobre todo, al persistir en el marco de referencia dominante del capitalismo, ya que todo el esfuerzo realizado para lograr una ruptura institucional para acceder al socialismo quedaría en el vacío, frustrándose las expectativas populares.
Homar Garcés
Extraído de Argenpress.
00:25 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, sciences politiques, politologie, socialisme, socialisme européen, socialisme hétérodoxe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Quand les libéraux se déchirent...

Quand les libéraux se déchirent |
| Mardi, 02 Juin 2009 - http://unitepopulaire.org | |
| « Des analystes réputés pour défendre habituellement des politiques économiques libérales, de même que des commentateurs du Wall Street Journal et d'autres journaux prestigieux, semblent renier leurs positions traditionnelles ces derniers temps. Ils se sont prononcés en faveur d'injections massives de liquidités dans les marchés par les banques centrales, de la prise de contrôle par le gouvernement américain d'institutions financières géantes. A première vue, quiconque comprend le fonctionnement d'une économie de marché peut facilement voir que quelque chose ne tourne pas rond dans ces positions. […] Il s'agit d'une taxe invisible qui redistribue les ressources à ceux qui ont accumulé des dettes et qui ont fait de mauvais placements. La justification pour intervenir semble toujours s'appuyer sur la peur de revivre la Grande Dépression. Si nous laissons trop d'institutions s'effondrer pour cause d'insolvabilité, nous dit-on, il y a risque d'un effondrement généralisé des marchés financiers, ce qui entraînerait un assèchement complet des flux de crédit et des effets catastrophiques sur tous les secteurs de la production. […] Que doit-on faire lorsque ce château de cartes commence à s'effondrer ? Il est évident que le crédit va s'amenuiser. Les prix doivent retomber à des niveaux plus réalistes; et les ressources engagées dans des projets improductifs doivent être libérées et transférées à des secteurs où il existe une demande réelle. Ce n'est qu'à ce moment que les capitaux redeviendront de nouveau disponibles pour des investissements profitables. […] La confusion entourant les questions monétaires dans les théories de l'école de Chicago est telle qu'elle pousse aujourd'hui ses partisans à appuyer la plus gigantesque appropriation de capitaux privés par un gouvernement dans l'histoire du monde. »
Martin Masse, chercheur associé à l’Institut économique Molinari, "Ces libéraux qui oublient les principes du marché", 8 octobre 2008 |
00:20 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libéralisme, libéraux, théorie politique, politique, économie, idéologie, idéologie économique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
The Political Theory Carl Schmitt
The Political Theory of Carl Schmitt
By Keith Preston - http://attackthesystem.com/
Discussion:
Carl Schmitt
The Crisis of Parliamentary Liberalism
The Concept of the Political
The Weimar Republic Sourcebook (p. 331, 334-337, 342-345)
The editors of The Weimar Republic Sourcebook attempt to summarize the political thought of Carl Schmitt and interpret his writings on political and legal theory on the basis of his later association with Nazism between 1933 and 1936. Schmitt is described as having “attempted to drive a wedge between liberalism and democracy and undercut the assumption that rational discourse and legal formalism could be the basis of political legitimacy.”(Sourcebook, p. 331) His contributions to political theory are characterized as advancing the view that “genuine politics was irreducible to socio-economic conflicts and unconstrained by normative considerations”. The essence of politics is a battle to the death “between friend and foe.” The editors recognize distinctions between the thought of Schmitt and that of right-wing revolutionaries of Weimar, but assert that his ideas “certainly provided no obstacle to Schmitt’s opportunistic embrace of Nazism.”
As ostensible support for this interpretation of Schmitt, the editors provide excerpts from two of Schmitt’s works. The first excerpt is from the preface to the second edition of Schmitt’s The Crisis of Parliamentary Democracy, a work first published in 1923 with the preface having been written for the 1926 edition. In this excerpt, Schmitt describes the dysfunctional workings of the Weimar parliamentary system. He regards this dysfunction as symptomatic of the inadequacies of the classical liberal theory of government. According to this theory as Schmitt interprets it, the affairs of states are to be conducted on the basis of open discussion between proponents of competing ideas as a kind of empirical process. Schmitt contrasts this idealized view of parliamentarianism with the realities of its actual practice, such as cynical appeals by politicians to narrow self-interests on the part of constituents, bickering among narrow partisan forces, the use of propaganda and symbolism rather than rational discourse as a means of influencing public opinion, the binding of parliamentarians by party discipline, decisions made by means of backroom deals, rule by committee and so forth.
Schmitt recognizes a fundamental distinction between liberalism, or “parliamentarism”, and democracy. Liberal theory advances the concept of a state where all retain equal political rights. Schmitt contrasts this with actual democratic practice as it has existed historically. Historic democracy rests on an “equality of equals”, for instance, those holding a particular social position (as in ancient Greece), subscribing to particular religious beliefs or belonging to a specific national entity. Schmitt observes that democratic states have traditionally included a great deal of political and social inequality, from slavery to religious exclusionism to a stratified class hierarchy. Even modern democracies ostensibly organized on the principle of universal suffrage do not extend such democratic rights to residents of their colonial possessions. Beyond this level, states, even officially “democratic” ones, distinguish between their own citizens and those of other states. At a fundamental level, there is an innate tension between liberalism and democracy. Liberalism is individualistic, whereas democracy sanctions the “general will” as the principle of political legitimacy. However, a consistent or coherent “general will” necessitates a level of homogeneity that by its very nature goes against the individualistic ethos of liberalism. This is the source of the “crisis of parliamentarism” that Schmitt suggests. According to the democratic theory rooted in the ideas of Jean Jacques Rosseau, a legitimate state must reflect the “general will”, but no general will can be discerned in a regime that simultaneously espouses liberalism. Lacking the homogeneity necessary for a democratic “general will”, the state becomes fragmented into competing interests. Indeed, a liberal parliamentary state can actually act against the “peoples’ will” and become undemocratic. By this same principle, anti-liberal states such as those organized according to the principles of fascism or bolshevism can be democratic in so far as they reflect the “general will.”
The second excerpt included by the editors is drawn from Schmitt’s The Concept of the Political, published in 1927. According to Schmitt, the irreducible minimum on which human political life is based is the friend/enemy distinction. This friend/enemy distinction is to politics what the good/evil dichotomy is to morality, beautiful/ugly to aesthetics, profitable/unprofitable to economics, and so forth. These categories need not be inclusive of one another. For instance, a political enemy need not be morally evil or aesthetically ugly. What is significant is that the enemy is the “other” and therefore a source of possible conflict. The friend/enemy distinction is not dependent on the specific nature of the “enemy”. It is merely enough that the enemy is a threat. The political enemy is also distinctive from personal enemies. Whatever one’s personal thoughts about the political enemy, it remains true that the enemy is hostile to the collective to which one belongs. The first purpose of the state is to maintain its own existence as an organized collective prepared if necessary to do battle to the death with other organized collectives that pose an existential threat. This is the essential core of what is meant by the “political”. Organized collectives within a particular state can also engage in such conflicts (i.e., civil war). Internal conflicts within a collective can threaten the survival of the collective as a whole. As long as existential threats to a collective remain, the friend/enemy concept that Schmitt considers to be the heart of politics will remain valid.
An implicit view of the ideas of Carl Schmitt can be distinguished from the editors’ introductory comments and selective quotations from these two works. Is Schmitt attempting to “drive a wedge” between liberalism and democracy thereby undermining the Weimar regime’s claims to legitimacy and pave the way for a more overtly authoritarian system? Is Schmitt arguing for a more exclusionary form of the state, for instance one that might practice exclusivity on ethnic or national grounds? Is Schmitt attempting to sanction the use of war as a mere political instrument, independent of any normative considerations, perhaps even as an ideal unto itself? If the answer to any of these questions is an affirmative one, then one might be able to plausibly argue that Schmitt is indeed creating a kind of intellectual framework that could later be used to justify at least some of the ideas of Nazism and even lead to an embrace of Nazism by Schmitt himself.
It would appear that the expression “context is everything” becomes a quite relevant when examining the work of Carl Schmitt. It is clear enough that the excerpts from Schmitt included in the The Weimar Republic Sourcebook have been chosen rather selectively. As a glaring example, this important passage from second edition’s preface from The Crisis of Parliamentary Democracy has been deleted:
“That the parliamentary enterprise today is the lesser evil, that it will continue to be preferable to Bolshevism and dictatorship, that it would have unforseeable consequences were it to be discarded, that it is ’socially and technically’ a very practical thing-all these are interesting and in part also correct observations. But they do not constitute the intellectual foundations of a specifically intended institution. Parliamentarism exists today as a method of government and a political system. Just as everything else that exists and functions tolerably, it is useful-no more and no less. It counts for a great deal that even today it functions better than other untried methods, and that a minimum of order that is today actually at hand would be endangered by frivolous experiments. Every reasonable person would concede such arguments. But they do not carry weight in an argument about principles. Certainly no one would be so un-demanding that he regarded an intellectual foundation or a moral truth as proven by the question, What else?” (Schmitt, Crisis, pp. 2-3)
This passage, conspicuously absent from the Sourcebook excerpt, indicates that Schmitt is in fact wary of the idea of undermining the authority of the Republic for it’s own sake or for the sake of implementing a revolutionary regime. Schmitt is clearly a “conservative” in the tradition of Hobbes, one who values order and stability above all else, and also Burke, expressing a preference for the established, the familiar, the traditional, and the practical, and an aversion to extremism, fanaticism, utopianism, and upheaval for the sake of exotic ideological inclinations. Clearly, it would be rather difficult to reconcile such an outlook with the political millenarianism of either Marxism or National Socialism. The “crisis of parliamentary democracy” that Schmitt is addressing is a crisis of legitimacy. On what political or ethical principles does a liberal democratic state of the type Weimar purports to be claim and establish its own legitimacy? This is an immensely important question, given the gulf between liberal theory and parliamentary democracy as it is actually being practiced in Weimar, the conflicts between liberal practice and democratic theories of legitimacy as they have previously been laid out by Rosseau and others and, perhaps most importantly, the challenges to liberalism and claims to “democratic” legitimacy being made by proponents of totalitarian ideologies from both the Left and Right.
The introduction to the first edition and first chapter of Crisis contain a frank discussion of both the intellectual as well as practical problems associated with the practice of “democracy”. Schmitt observes how democracy, broadly defined, has triumphed over older systems, such as monarchy, aristocracy or theocracy in favor of the principle of “popular sovereignty”. However, the advent of democracy has also undermined older theories on the foundations of political legitimacy, such as those rooted in religion (”divine right of kings”), dynastic lineages or mere appeals to tradition. Further, the triumphs of both liberalism and democracy have brought into fuller view the innate conflicts between the two. There is also the additional matter of the gap between the practice of politics (such as parliamentary procedures) and the ends of politics (such as the “will of the people”). Schmitt observes how parliamentarism as a procedural methodology has a wide assortment of critics, including those representing the forces of reaction (royalists and clerics, for instance) and radicalism (from Marxists to anarchists). Schmitt also points out that he is by no means the first thinker to point out these issues, citing Mosca, Jacob Burckhardt, Belloc, Chesterton, and Michels, among others.
A fundamental question that concerns Schmitt is the matter of what the democratic “will of the people” actually means, observing that an ostensibly democratic state could adopt virtually any set of policy positions, “whether militarist or pacifist, absolutist or liberal, centralized or decentralized, progressive or reactionary, and again at different times without ceasing to be a democracy.” (Schmitt, Crisis, p. 25) He also raises the question of the fate of democracy in a society where “the people” cease to favor democracy. Can democracy be formally renounced in the name of democracy? For instance, can “the people” embrace Bolshevism or a fascist dictatorship as an expression of their democratic “general will”? The flip side of this question asks whether a political class committed in theory to democracy can act undemocratically (against “the will of the people”) if the people display an insufficient level of education in the ways of democracy. How is the will of the people to be identified in the first place? Is it not possible for rulers to construct a “will of the people” of their own through the use of propaganda? For Schmitt, these questions are not simply a matter of intellectual hair-splitting but are of vital importance in a weak, politically paralyzed democratic state where the committment of significant sectors of both the political class and the public at large to the preservation of democracy is questionable, and where the overthrow of democracy by proponents of other ideologies is a very real possibility.
Schmitt examines the claims of parliamentarism to democratic legitimacy. He describes the liberal ideology that underlies parliamentarism as follows:
“It is essential that liberalism be understood as a consistent, comprehensive metaphysical system. Normally one only discusses the economic line of reasoning that social harmony and the maximization of wealth follow from the free economic competition of individuals…But all this is only an application of a general liberal principle…: That truth can be found through an unrestrained clash of opinion and that competition will produce harmony.” (Schmitt, Crisis, p. 35)
For Schmitt, this view reduces truth to “a mere function of the eternal competition of opinions.” After pointing out the startling contrast between the theory and practice of liberalism, Schmitt suggests that liberal parliamentarian claims to legitimacy are rather weak and examines the claims of rival ideologies. Marxism replaces the liberal emphasis on the competition between opinions with a focus on competition between economic classes and, more generally, differing modes of production that rise and fall as history unfolds. Marxism is the inverse of liberalism, in that it replaces the intellectual with the material. The competition of economic classes is also much more intensified than the competition between opinions and commercial interests under liberalism. The Marxist class struggle is violent and bloody. Belief in parliamentary debate is replaced with belief in “direct action”. Drawing from the same rationalist intellectual tradition as the radical democrats, Marxism rejects parliamentarism as sham covering the dictatorship of a particular class, i.e., the bourgeoise. True democracy is achieved through the reversal of class relations under a proletarian state that rules in the interest of the laboring majority. Such a state need not utilize formal democratic procedures, but may exist as an “educational dictatorship” that functions to enlighten the proletariat regarding its true class interests. Schmitt then contrasts the rationalism of both liberalism and Marxism with irrationalism. Central to irrationalism is the idea of a political myth, comparable to the religious mythology of previous belief systems, and originally developed by the radical left-wing but having since been appropriated by revolutionary nationalists. It is myth that motivates people to action, whether individually or collectively. It matters less whether a particular myth is true than if people are inspired by it.
It is clear enough that Schmitt’s criticisms of liberalism are intended not so much as an effort to undermine democratic legitimacy as much as an effort to confront the weaknesses of the intellectual foundations of liberal democracy with candor and intellectual rigor, not necessarily to undermine liberal democracy, but out of recognition of the need for strong and decisive political authority capable of acting in the interests of the nation during perilous times. Schmitt remarks:
“If democratic identity is taken seriously, then in an emergency no other constitutional institution can withstand the sole criterion of the peoples’ will, however it is expressed.” (Sourcebook, p.337)
In other words, the state must first act to preserve itself and the general welfare and well-being of the people at large. If necessary, the state may override narrow partisan interests, parliamentary procedure or, presumably, routine electoral processes. Such actions by political leadership may be illiberal, but not necessarily undemocratic, as the democratic general will does not include national suicide. Schmitt outlines this theory of the survival of the state as the first priority of politics in The Concept of the Political. The essence of the “political” is the existence of organized collectives prepared to meet existential threats to themselves with lethal force if necessary. The “political” is different from the moral, the aesthetic, the economic or the religious as it involves first and foremost the possibility of groups of human beings killing other human beings. This does not mean that war is necessarily “good” or something to be desired or agitated for. Indeed, it may sometimes be in the political interests of a state to avoid war. However, any state that wishes to survive must be prepared to meet challenges to its existence, whether from conquest or domination by external forces or revolution and chaos from internal forces. Additionally, a state must be capable of recognizing its own interests and assume sole responsibility for doing so. A state that cannot identify its enemies and counter enemy forces effectively is threatened existentially.
Schmitt’s political ideas are more easily understood in the context of Weimar’s political situation. He is considering the position of a defeated and demoralized Germany, unable to defend itself against external threats, and threatened internally by weak, chaotic and unpopular political leadership, economic hardship, political and ideological polarization and growing revolutionary movements, sometimes exhibiting terrorist or fanatical characteristics. Schmitt regards Germany as desperately in need of some sort of foundation for the establishment of a recognized, legitimate political authority capable of upholding the interests and advancing the well-being of the nation in the face of foreign enemies and above domestic factional interests. This view is far removed from the Nazi ideas of revolution, crude racial determinism, the cult of the leader and war as a value unto itself. Schmitt is clearly a much different thinker than the adherents of the quasi-mystical nationalism common to the radical right-wing of the era. Weimar’s failure was due in part to the failure of political leadership to effectively address the questions raised by Schmitt.
00:17 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, révolution conservatrice, allemagne, weimar, droit, droit constitutionnel, politique, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 juin 2009
Wenn Geschichte gemacht wird

Dossier "Günter Maschke"
Günther Maschke: Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973-1993
Wenn Geschichte gemacht wird
von Werner Olles - Ex: http://www.jungefreiheit.de/
Während das Auge der wissenschaftlichen Theorie immer noch ungebrochen nach links blickt, führt die Neue Rechte ihre Kulturkämpfe aus der Defensive und ist auch noch stolz darauf. Die Botschaft, daß aus Leid Erkenntnis und aus Bösem Gutes wachsen kann, paßt bis heute nicht zur deutschen Verdrängungsmentalität. Günter Maschke, der "einzige Renegat der 68er Generation" (Jürgen Habermas), zieht es dagegen vor, dort zu sein, wo Geschichte gemacht wird. Nicht ohne Anmaßung – aber mit einer erstaunlichen Enthaltsamkeit, was wohlfeiles Pathos und erhobene Zeigefinger betrifft – empfahl er bereits vor zehn Jahren den Konservativen, "sich zu opfern, um als Nationalrevolutionäre wieder aufzuerstehen". Daß diese ihm nicht gefolgt sind, hat auch etwas damit zu tun, daß der Mangel an nachgetragener Moral, der sich wie ein roter Faden durch sein Werk zieht, von den Angesprochenen als persönliches Desaster interpretiert wird. Nicht nur hierin liegen die Konservativen allerdings völlig falsch. Maschkes schöpferische Energie wurzelt ja gerade darin, daß er den anti-liberalen Motiven seiner kommunistischen Jugend die Treue gehalten hat.
Die zehn Aufsätze, die "Das bewaffnete Wort" versammelt, wurden zwischen 1973 und 1993 geschrieben. "Politik und Guerilla in der cubanischen Revolution" stammt aus "Kritik des Guerillero – Zur Theorie des Volkskrieges" (1973) und beschreibt die Genesis von Castros Aufstand, der eigentlich schon 1952 mit dem Militärputsch des Generals Fulgencio Batista gegen die Regierung Prio Socarrás begann. Ein Jahr später überfiel der in einem Jesuitenkloster erzogene Sohn eines Großgrundbesitzers Fidel Castro mit 150 Getreuen die Moncada-Kaserne.
Der Aufsatz über den faschistischen Décadent Drieu la Rochelle "Die schöne Geste des Untergangs" erschien 1980 in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Drieu – Kollaborateur, Ästhet, Zyniker, Romancier und Essayist, gleichzeitig geängstigt und angezogen von der Energie Deutschlands – sah den Sinn des Faschismus in der Zusammenführung der "Jugend von rechts" mit der "Jugend von links". Zunächst von Hitler fasziniert – den Reichsparteitag im September 1935 beschreibt er als "artistische Emotion, berauschend und schrecklich" – treten die Differenzen zwischen Drieus Linksfaschismus und dem Nationalsozialismus, dem er seine "sterile Okkupationspolitik" und sein "Paktieren mit den alten Eliten" zum Vorwurf macht, bald immer klarer hervor. Wie Ernst Jünger, der sich während seiner Pariser Jahre im gleichen Milieu wie Drieu bewegte, wertet auch Maschke Drieus Freitod als bewußte und programmierte Annäherung an die Transzendenz.
Die tragische Geschichte Lateinamerkas untersucht Maschke am Beispiel Perus in dem Aufsatz "Das bewaffnete Wort – Mythos der Erziehung und revolutionäre Gewalt: Der ‘Leuchtende Pfad’ in Peru", 1993 erschienen in "Politische Lageanalyse. Festschrift für Hans-Joachim Arndt zum 70. Geburtstag" und ein Jahr später in der Kulturzeitschrift "Behemoth". Die weltweit wohl am härtesten und blutigsten agierende "Befreiungsbewegung", angesiedelt am äußersten häretischen Rand des Maoismus, schildert der Autor als ein Kind der in den fünfziger Jahren einsetzenden Bildungsexplosion. Ihre Kader sind in der Regel keineswegs die Ärmsten der Armen, die Indios des Hochlandes und des Amazonasgebietes, sondern in erster Linie Schüler und Studenten, Lehrer und Universitätsdozenten, Intellektuelle und Künstler. Drastisch schildert Maschke den Terror des "Sendero Luminoso" im peruanischen Bürgerkrieg mit bisher fast 40.000 Opfern. Die quasireligiösen Antriebe des Sendero putschen dessen Krieger zu unbeschreiblichen Grausamkeiten auf. Getötet werden die Feinde "durch Kreuzigungen, nach vorheriger Kastration, durch Steinigung, durch das-zu-Tode-Prügeln mit den eigenen, zuvor abgeschnittenen Armen, durch das lebend-Begrabenwerden". Führer des Sendero ist der inzwischen festgenommene Philosoph Abimail Guzmán Reynoso, um dessen Person sich ein Kult entwickelte, der in zahllosen Liedern und Gedichten den großen Führer, Lehrer und "Presidente" verherrlicht. 1980 begannen die fanatischen Banden des Sendero mit dem Versuch, "die bestehende ungerechte Ordnung in einem Ozean aus Blut zu ertränken, um sich der ‘Großen Harmonie’ zu nähern, jener ‘neuen Gesellschaft’ ohne Ausbeuter und Ausgebeutete, ohne Unterdrücker und Unterdrückte, ohne Klassen und Parteien, ohne Demokratie, ohne Waffen, ohne Kriege …" Maschke versagt dieser religiösen, mystischen und spirituellen Kraft des Sendero, der – wie es in einer seiner Losungen heißt – "um den großen subjektiven Mythos zu erreichen, die totale Hingabe an das reinigende Feuer des bewaffneten Kampfes" sucht, nicht seinen Respekt. Der Gastprofessor an der Hochschule der Kriegsmarine in La Punta versteht die Bedeutung des Mythos als Stabilisierung des Willens zum Kampf, eine Interpretation, die um so evidenter ist, wenn der Feind diesen Willen nicht mehr hat, weil ihm der Mythos längst abhanden gekommen ist.
Zwei der besten Aufsätze Günter Maschkes entstanden 1985 und 1987. "Die Verschwörung der Flakhelfer", dem Sammelband "Inferiorität als Staatsräson" entnommen, 1986 nachgedruckt in Jean Baudrillards "Die göttliche Linke" und in der Zeitschrift Criticón, ist wohl die intelligenteste Reflexion über das nationale Bewußtsein der Deutschen und ihrer politischen Eliten. Mit spitzer Feder stößt der Autor mitten hinein in ein Drama gewaltigen Ausmaßes, dessen Logik stringent ist. Weil nur das Nationalbewußtsein in der Lage ist, das Verhältnis zu den "anderen", zu den Fremden und Feinden zu klären, konnte die Geschichte der BRD nur "eine Geschichte der schiefen Ebene sein". Dieses Land ohne Souveränität war von Anfang an eine einzige ununterbrochene Veranstaltung gegen die Einheit der Nation. Nach der ersten Staatszerstörung durch den Nationalsozialismus nach 1933 folgte 1945 in Nürnberg die zweite durch den "Internationalen Gerichtshof" der Siegermächte. 1968 schließlich kapitulierten die Flakhelfer endgültig vor der "kritischen" Jugend, einer Bewegung, "die nach Autorität lechzte, einem Aufstand der Söhne gegen die Väter mithilfe der Großväter (Ernst Bloch, Herbert Marcuse), einer dem Personenkult sich weihenden Bewegung". Das folgende Wüten führte zu einem psychischen Genocid, der die Deutschen ihrer Kultur, ihrer Würde und ihres Gedächtnisses beraubte. Das liberale Syndrom, welches die Flakhelfer an die Macht brachte, "machte den Weg frei für den Marsch durch die Institutionen derer, die Fleisch von seinem Fleische waren, die im gleichen Wust normativer und moralisierender Vorstellungen aufgewachsen waren und an der gleichen Begehrlichkeit und Harmlosigkeit litten …"
"Sterbender Konservatismus und Wiedergeburt der Nation" erschien 1987 erstmals im Jahrbuch Der Pfahl. Den Verfall des konservativen Gedankens bestimmt Maschke hier an drei großen politischen Daten: der Reichsgründung, der Endphase der Weimarer Republik und dem Aufbau der Bundesrepublik. Das NS-Regime definiert er klar als "durch und durch revolutionäre und antikonservative Kraft". Den heutigen Konservativen rät der Autor, "die Programmatik der Konservativen Revolution präziser, konkreter und radikaler zu erneuern", denn – so Maschke – "zu halten, zu verteidigen, zu bewahren, gibt es hier (sonst) nichts mehr!" Abseits des von Günter Maschke ausgemachten Armageddons sind die Theorien längst funktionslos geworden, auch hier blieb nicht viel mehr als Ästhetik, Pointen und Bonmots, gepflegte Inszenierungen eines Lebensstils der Eitelkeiten und Spiele: Die Lage ist hoffnungslos, aber nicht ernst. Das stimmt zum Teil, aber sie könnte – folgen wir Maschke – vielleicht noch ernst werden: "Am Beginn einer Nationwerdung steht häufig der Bürgerkrieg; wenig spricht dafür, daß am Beginn ihrer Wiedergewinnung etwas anderes stehen könnte, da der größte Feind der Nation ein Teil ihrer selbst ist." Zumindest – da ist ihm uneingeschränkt zuzustimmen – "ist die Zeit für klare Feinderklärungen innerhalb dieses Volkes da!" Werner Olles
Günter Maschke: Das bewaffnete Wort. Aufsätze aus den Jahren 1973–1993, Karolinger Verlag, Wien und Leipzig 1997, 196 Seiten, geb., 42 Mark
00:34 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politologie, sciences politiques, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 02 juin 2009
G. Maschke: "Der subventionierte Amoklauf"
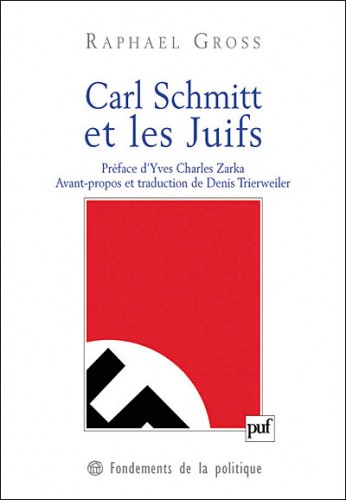
Dossier "Günter Maschke"
Der subventionierte Amoklauf
Raphael Gross: Carl Schmitt und die Juden
Günter Maschke - http://www.jungefreiheit.de/
Nullus est liber tam malus, ut non aliqua parte prosit – Kein Buch ist so schlecht, daß es nicht in irgendeiner Beziehung nütze, pflegte Plinius d. Ä. (23–79) seinem Neffen und Adoptivsohn, dem jüngeren Plinius (61–113) tröstend zu sagen. Doch dank der nie genug zu preisenden Gnade unser aller Sterblichkeit ward es dem rastlos lesenden Gelehrten nicht vergönnt, Raphael Gross‘ "Carl Schmitt und die Juden" aufzuschlagen, und blieb es dem Admiral der Römischen Flotte versagt, vor den Untiefen dieser nicht auszulotenden Seichtigkeit zu erschaudern.
Wir sind einiges gewohnt und wissen, daß, wer sich die Füße an Carl Schmitt abstreift, gute Gesinnung beweist und es deshalb auf Kenntnisse und Genauigkeit nicht ankommt, handelt es sich doch um "ein politisch-moralisches Integrationsritual". Dem Pingeligen wird an dieser treffenden Bemerkung Vilmos Holczhausers das Wort "Ritual" stören. Denn so einig sich die zahllosen Schmitt-Verfolger waren, sind und sein werden – bisher streifte ein jeder seine Füße auf die eigene, gar zu individuelle Manier ab. Ein mächtig-weiser Ordner mußte kommen, auf daß sich das üppig geförderte, volkspädagogisch so erfreuliche Gewusel in ein wirkliches Ritual verwandele, auf daß aus dem Chaos Schöpfung werde. Nun ist er da, der große Liturgiker, der in genialer Einfachheit, mit einer einzigen Position und keinem Begriff, die Wirrnis beendet und gelassen sein Fiat lux spricht: überlebensgroß Herr Gross.
Herr Gross weiß etwas, das alle wissen, doch bringt er‘s nicht übers Herz, diese seine Sonderstellung zu verschweigen: Carl Schmitt war Antisemit. Das war er tatsächlich, wenn es auch für geraume Zeit (oder für immer) unklar bleiben wird, wie sein Antisemitismus funktionierte bzw. wie er sich zusammensetzte. Vor 1933 lassen sich keine antisemitischen Bemerkungen Schmitts finden, sieht man von dem harmlosen Spott auf Walther Rathenau in den "Schattenrissen" (1913) ab, der gleichwohl Gross erzürnt. Gross aber schließt aus dem Fehlen antisemitischer Bemerkungen auf deren "stillschweigende Allgegenwart" (so Thomas Wirtz in einer glänzenden Kritik in der FAZ vom 31.7., die ihren Gegenstand zu ernst nimmt). Sei vor 1933 ein antisemitisches Bekenntnis "einfach unklug" gewesen, so habe sich 1933 der wahre Schmitt entpuppt. Dessen Antisemitismus aber könne nicht reduziert werden auf einen mit nationalsozialistischen Girlanden umdekorierten, christlichen Anti-Judaismus. Doch gab es genug Professoren, auch Juristen, wie etwa Axel Freiherr von Freytagh-Loringhoven, die vor 1933 aus ihrem Antisemitismus keinen Hehl machten, ab 1933 es jedoch vorzogen, zu schweigen (der Vergleich fällt hier nicht zugunsten Schmitts aus). Wie es aber um Schmitts Antisemitismus auch stand, wie sehr man von Schmitts "Glossarium" aus den Jahren 1947/51 auch schockiert sein mag: die entsprechenden Textstellen und Fakten lassen sich auf wenigen Seiten ausbreiten. Wir kennen auch längere Aufsätze über die von Schmitt geleitete "Judentagung" (3. bis 4. Oktober 1936 in Berlin) und es sind auch ausführliche Studien, etwa über die Hintergründe dieser Tagung, denkbar.
Doch eine solche Arbeit leistet Gross nicht. Er will statt dessen das gesamte Werk Schmitts, das 1910 mit "Über Schuld und Schuldarten" einsetzt und erst 1983 mit dem Interview des italienischen Juristen Fulco Lanchester, "Un giurista d‘avanti a se stesso" (Quaderni costituzionali, 1/1938, Seite 5–34), endet, als bloßen Ausfluß, als getarnte Anwendung, als fachwissenschaftlich nur verbrämte Polemik wider den /die Juden verstehen. Gross möchte uns weismachen, er verfüge über den Universalschlüssel zu einem Haus, dessen Türen er noch nicht einmal von weitem gesehen hat. Denn Schmitts Werk ist in erster Linie Staatstheorie, Völkerrecht und Politikwissenschaft, es ist eng verbunden mit damaligen konkreten Problemen, und es bleibt verbunden mit weiter andauernden Fragen; was Schmitt von den Juden dachte, ist für ein Verständnis seiner Schriften nicht einmal von tertiärer Bedeutung. Selbst die beliebt gewordene Debatte um seine "Politische Theologie" führt zu nichts, verkennt man, daß sie im bloß Metaphorischen verharrt, – sie wird nur für soo wichtig erachtet, weil sie zu Spekulationen reizt, die sich inzwischen als Karikaturen fort und fort reproduzieren. Achselzuckend bemerkt Thomas Wirtz: "Der Jude als Artfremder (ist) der einzylindrige Motor, der Schmitts Werk über mehr als sechs Jahrzehnte am Laufen gehalten habe; ihn zu vernichten sei der Antrieb seiner langen und weit gestreuten Produktion gewesen." Weshalb ist noch niemand auf die Idee gekommen, das Werk Jean Bodins als eine Camouflage seines Hasses auf die Hexen und seiner Forderung, diese zu foltern und zu töten, zu deuten?
Solche Methode ist wissenschaftlich unsinnig (eigentlich sollte hier stehen "irrsinnig", aber was tue ich nicht alles für meinen Redakteur?) und nicht unverwandt der Verfahrensweise des Herrn Omnes, Napoleon aus seiner Körpergröße zu erklären. Für Gross sind alle Begriffe Schmitts, auch die so typischen Gegensatzpaare Nomos–Gesetz, Legalität–Legitimität, Land–Meer, Norm –Befehl, Macht–Recht, aber auch Beschleunigung, Katechon, Antichrist substantiell antisemitische Begriffe, die stets den Feind Schmitts, die Juden, im Visier haben. (Wie steht es mit "Verfassung-Verfassungsgesetz" oder mit "institutioneller Garantie"?). Wer der Moderne ablehnend oder auch nur skeptisch gegenübersteht (die bei Gross wenig mehr ist als die jüdische Emanzipation, ansonsten aber als schnurstrackser Weg zum Heil erscheint), der sollte sich vorsehen. Denn wenn es stimmt, daß die Juden besonders begabte Agenten der Moderne sind, sprich der Beschleunigung, Abstrahierung, Quantifizierung, Entortung, dann hat man auf derlei Hirnwebereien gefälligst zu verzichten. Da die jüdischen Juristen besonderem Wert auf die "formale" Legalität legen, ist schon jede Kritik an deren Alleinherrschaftsanspruch und jede Suche nach einer tragfähigen Legitimität verdächtig und gehört in den Orkus. Da die Vorstellungen vom Kommen des Antichrist antisemitisch getönt sein können, ist jedes Erschrecken vor dem Pax et securitas, mit dem der Mensch dem Menschen ausgeliefert wird, ist jedes Entsetzen vor einer rein quantitativen, nihilistischen Ordnung würgender Immanenz "böse" und "gefährlich".
"Gefährlich" ist übrigens ein Lieblingswort Gross‘, der sich hier gänzlich dem gouvernantenhaften Wissenschaftsbetrieb der BRD eingliedert. Und da der Nomos auch die Kritik des jüdischen Gesetzes beinhaltet (und weil es ihm um die Erhaltung der konkreten Völker als "Gedanken Gottes" zu tun ist?), ist er letztlich nichts als eine aufgetakelte antisemitische Spekulation. Wie fruchtbar und aufschließend ein Gedanke auch sei, – wenn er zu einer antisemitischen Conclusio führen kann, hat man sich seiner zu entschlagen. Am grauenvollsten ist für Gross natürlich das "Feinddenken", die Unterscheidung von Freund und Feind. Diese banalité supérieure impliziert jedoch auch zwingend, daß man nur mit einem Feind Frieden schließen kann, – solch simple Einsicht Schmitts, die auch das Urteil spricht über eine Welt, in der es keine Feinde mehr geben soll und die gleichzeitig vom Frieden schwätzt, entgeht Gross wie so vielen anderen. Über die Struktur, die Entwicklung, die lignes de force von Schmitts Werk, über deren Zusammenhang mit den Fragen, die die Menschen des 20. Jahrhunderts quälen und ängstigen (und die die des 21. Jahrhunderts noch ganz anders quälen und ängstigen werden!), erfährt man selbst bei Jürgen Fijalkowski, Mathias Schmitz oder Graf Krockow mehr.
Gross verplempert statt dessen seine Seiten mit schülerhaften Nacherzählungen, sei es der Deutung des Erbsündendogmas, einiger Thesen Kelsens, der Vorstellungen vom Nomos bei Albert Erich Günther und Wilhelm Stapel (die flugs mit denen Schmitts ineinsgesetzt werden), der Überlegungen de Maistres und Donoso Cortés‘ usw. Schwupp sind wieder 20–30 Seiten geschrieben, die das Herz des linksliberalen Bildungsspießers erfreuen (weil dieser meint, sich der Lektüre der betreffenden Autoren entschlagen zu können, da er wähnt, Gross habe diese wirklich sorgfältig gelesen: "Echo kommt vor jedem Wort"). Dieses hilflose Proseminaristen-Verfahren verwehrt es Gross, Schmitt dort zu kritisieren, wo es angebracht ist. Weil Schmitt sich lobend über de Maistres angebliche Thesen zur "Souveränität" und zur "Entscheidung" äußert, entgeht es Gross, daß der Savoyarde stets an "Wahrheit" interessiert war, daß für ihn die "Entscheidung" nur effektiv war im Dienste dieser einen, zwar bedrohten, jedoch unbezweifelbaren Wahrheit: Wichtig war, wie entschieden wurde, nicht, wie Schmitt gerne schrieb, daß. De Maistre war weder ein "Dezisionist", noch glaubte er, daß es nur auf eine "Entscheidung" ankomme, gleichgültig, wie diese beschaffen sei. (Ob mit letzterem Schmitt während seiner dezisionistischen Phase wirklich erfaßt ist, muß hier auf sich beruhen). Ähnliches gilt für Schmitts Deutung von Donoso, der nicht, wie Schmitt erklärte, die Diktatur forderte, weil er die Legitimität für erledigt hielt, sondern nur die Diktatur im Namen der Legitimität bejahte. Schmitt hat sich diese (und andere!) Autoren aufs Bedenklichste zurechtgeschnitzelt und sie gewaltsam zu seinen Vorläufern ernannt; dies zu demonstrieren (was freilich schon geschah), wäre ein sinnvolles Unterfangen gewesen.
Gross‘ in der Regel unholde Unwissenheit verrät sich auch, weist er dem Katechon eine zentrale Bedeutung für die katholische Theologie zu, – als wäre dieser in den Dogmatiken und Handbüchern nicht beinahe inexistent und als hätte nicht der schärfste katholische Kritiker Schmitts, Alvaro d‘Ors, die Entbehrlichkeit dieses Begriffes für ein christliches Geschichtsbild dargelegt: der Christ muß wollen, daß Sein Reich komme und darf gar nicht um Aufschub bitten. Gross hat keine Ahnung von Katholizismus, weiß aber, daß Schmitt "eigentlich" kein Katholik war.
Besonderes Augenmerk widmet Gross Hans Kelsen. Die Kontrapunktik Kelsen–Schmitt ist in der Sekundärliteratur beliebt und gibt ja tatsächlich einiges her. Sieht man jedoch von Schmitts "Politischer Theologie" (1922) und von Kelsens Polemik "Wer soll der Hüter der Verfassung sein?" (Die Justiz, 1930/31, Seite 576–628) gegen Schmitts "Der Hüter der Verfassung" (als Aufsatz zuerst 1929) ab, so bezieht sich Schmitt sehr selten auf Kelsen, Kelsen auf Schmitt so gut wie nie. Was Schmitt angeht, so ist die Ursache bekannt: er hielt Kelsens Werk schlicht für langweilig und banal und sprach allenfalls abfällig von den "ewigen Trivialitäten Kelsens".Laut Gross aber hat Schmitt Kelsen fanatisch verfolgt. Beklagte sich dieser 1934, im Vorwort zur "Reinen Rechtslehre", über die "schon an Haß grenzende Opposition gegen die ‚Reine Rechtslehre‘, so fingiert Gross, daß sich dies auf Schmitt beziehe, von dem in Kelsens Schrift nirgendwo die Rede ist.
Gross sieht nur Antisemiten und Antisemitisches
Viel schärfer als von Schmitt wurde Kelsen von dem Wiener Völkerrechtler Hold v. Ferneck oder von dem protestantischen Antinazi Rudolf Smend attackiert, geradezu brutal aber von Hermann Heller (vgl. dessen "Die Souveränität", 1927), der nota bene Jude, Sozialist und Emigrant war. Über diese und andere Kritiker Kelsens schweigt Gross. Jeder Zweifel jedoch, der gegenüber der "Reinen Rechtslehre" geäußert wird, die für Gross eine potenzierte Heilige Schrift ist, verrät schurkischen Antisemitismus, so daß – folgt man der Logik Gross‘ – der Jude Heller ein weitaus bösartigerer Antisemit sein muß als Schmitt. Kurz darauf erfahren wir, daß Kelsen "sich der Gefahr bewußt (war), die seiner relativistischen Weltanschauung von seiten der politisch-religiösen Theorie Schmitts" drohe und werden auf Kelsens "Staatsform und Weltanschauung" (1933, S. 29 f.) verwiesen, wo es jedoch um Jesus und Barabas geht und die "Volksabstimmung" (sich äußernd in der Forderung des jüdischen Pöbels, daß Pilatus Jesus kreuzigen lassen solle und nicht den Barabas) Kelsen nur dann als "ein gewaltiges Argument gegen die Demokratie" erscheint, "wenn die politischen Gläubigen (...) ihrer Wahrheit so gewiß sind wie der Sohn Gottes"; von Schmitt ist auch hier nirgendwo die Rede. Gross verfährt noch einmal so und macht den Leser glauben, daß Kelsen mit einer Passage aus "Der soziologische und der juristische Staatsbegriff" (Ausgabe 1928) auf eine Kritik Schmitts antworte, – doch gibt es weder diese Kritik noch einen von Kelsen auch nur erwähnten Carl Schmitt.
Eine weitere, noch üblere Methode Gross‘ darf man "assoziatives glissando" nennen: Wenn "selbst ein liberaler Theologe, wie Adolf v. Harnack" den Alten Bund mit dem Neuen für unvereinbar hält (als wenn vom Christentum aus etwas anderes möglich sei, Dialog hin, Hans Küng her!), so ist dies für Gross die Vorstufe zu Ernst Jüngers und Carl Schmitts Sorge, daß "durch die Exterminierung der Juden deren Moral nun frei und virulent" geworden sei. Von Sympathie für die Juden zeugen derlei Aussagen nicht, aber sie stehen in einem strikten Gegensatz zur Forderung, daß man sie ausrotte – Gross aber rückt sie in die Nähe dieser Forderung. Aufweis der Unvereinbarkeit von Altem und Neuem Bund und Ablehnung des Allgemeinwerdens der jüdischen Moral ist für ihn gleichbedeutend mit klammheimlicher Bejahung des Massenmordes!
So wie Antisemiten einer bestimmten Spezies nur Juden und Jüdisches sehen, so sieht Gross nur Antisemiten und Antisemitistisches. Wo Gross auch hintapert: Der Antisemitismus war schon da und hat die Landschaft vermint. Wenn aber dem der Grosschen Prosekution Unterworfenen gerade mal keine antisemitischen Gedankengänge nachzuweisen sind, so hat er sich ihnen doch hingegeben, "trotzdem" und "eigentlich": Hoch leben die Moskauer Trotzkistenprozesse! Gleichwohl schimpft Gross auf "Verschwörungsphantasien" und "-theorien" und vergißt, daß ohne Verschwörungen, die weder in Biarritzer Hotels noch auf Prager Friedhöfen stattfinden müssen, das Politische und die Politik gar nicht denkbar sind und daß "Verschwörung" seit Jahrzehnten ein seriöses Thema der Geschichtsschreibung und politischen Wissenschaft (nicht nur) in den romanischen Ländern ist.
Man mag erwarten, daß Gross etwas über die Ursachen des Antisemitismus sagt, d. h. über die Realitäten, die ihn provozierten; daß diese Realitäten verzerrt wahrgenommen werden können, kann nur bewiesen werden, wenn man sie untersucht. Doch Gross sieht nur jahrtausendealtes Vorurteil, ewigen Wahn, ein permanentes Kopfkino, eine geheimnisvolle, sich unaufhörlich aus dem Nichts erneuernde Urzeugung. Die ausgedehnte, jüdische Selbstkritik nicht nur vor und nach 1933, der Kampf der assimilierten deutschen Juden gegen die einströmenden Ostjuden zwecks Eindämmung des Antisemitismus u. a. m., – dies alles gibt es für Gross nicht. Bei Theodor Herzl lesen wir: "In den Bevölkerungen wächst der Antisemitismus täglich, stündlich und muß weiter wachsen, weil die Ursachen fortbestehen und nicht behoben werden können. – Die causa remota ist der im Mittelalter eingetretene Verlust unserer Assimilierbarkeit, die causa proxima die Überproduktion an mittleren Intelligenzen, die keinen Abfluß nach unten haben und keinen Aufstieg – nämlich keinen gesunden Abfluß und keinen gesunden Aufstieg. Wir werden nach unten hin zu Umstürzlern proletarisiert, bilden die Unteroffiziere aller revolutionären Parteien und gleichzeitig wächst nach oben unsere furchtbare Geldmacht". (Herzl, "Gesammelte zionistische Werke", Band I, 1923, Seite 39 und 41) Ein Vertreter dieser furchtbaren Macht bemerkt derweil zu einem anderen: "Was die antisemitischen Sympathien betrifft, so sind die Juden selbst hieran schuld und haben die Aufregung ihrem Dünkel, ihrer Überhebung und namenlosen Frechheit zuzuschreiben". (Meyer Carl Rothschild an Gerson von Bleichröder, 16. September 1875, zitiert nach: Fritz Stern, Kulturpessimismus als politische Gefahr, 1963, Seite 92). Friedrich Meinecke kam 1946 in "Die deutsche Katastrophe", gedruckt mit Erlaubnis der US-Besatzer, zu dem Ergebnis: "Zu denen, die den Becher der ihnen zugefallenen Macht gar zu rasch und gierig an den Mund führten, gehörten auch viele Juden. – Die Juden, die dazu neigen, eine ihnen einmal lächelnde Gunst der Konjunktur unbedacht zu genießen, hatten mancherlei Anstoß erregt seit ihrer vollen Emanzipation. Sie haben viel beigetragen zu jener allmählichen Entwertung und Diskreditierung der liberalen Gedankenwelt, die seit dem Ausgange des 19. Jahrhhunderts eingetreten ist" (Seite 53 und 29). Wer nicht von den Ursachen des Antisemitismus reden will, sollte auch von diesem schweigen, und schweigen sollte auch der, der sich weigert, dessen Realitätskern zu untersuchen, weil wahnhafte Reaktionen möglich sind. La verdad es siempre deliciosa.
Daß gerade "der assimilierte Jude der wahre Feind" sei, diese Wendung Peter F. Druckers aus seinem Buche "The end of economic man" (New York 1939) schreibt Gross Schmitt zu: Dieser hatte in seinem "Glossarium" (Seite 17/18) den Satz Druckers nicht klar genug als Zitat gekennzeichnet. Das Motiv für seinen Amoklauf findet Gross also in der sachlichen Feststellung eines jüdischen Intellektuellen! Schmitts oft verblüffende Nachlässigkeit im Umgang mit Zitaten, auch mit historischen Herleitungen, biographischen Behauptungen oder angeblichen Nachzeichnungen der Ideen anderer, die in Wirklichkeit Verzeichnungen sind, – hier wird sie rüde abgestraft, wobei sich der Abstrafer freilich selbst disqualifiziert: Gross warf keinen einzigen Blick in das von Schmitt immerhin deutlich genannte Buch Druckers.
Zweifel am Zustand der akademischen Welt
Die groben Schnitzer, die oft kleinen, dann aber Gross‘ Ignoranz und stultitia offenbarenden Irrtümer, die Nichtkenntnis selbst der Literatur, die ihm bei seinem Feldzug zupaß käme, – man findet kein Ende. Schreibt Schmitt etwa über Hitler: "Er wollte sich mit Gewalt in die weltbeherrschende Schicht und in ihr Arcanum eindrängen; er wollte es ihnen nicht entreißen, sondern nur daran beteiligt werden; er wollte aufgenommen werden in den feinen Club, endlich einmal ein ganz großer Herr sein, ein Lord. Jenes Arcanum aber lag tatsächlich in der Idee der Rasse" (Glossarium, Seite 157; bei Gross, Seite 358), so "beschrieb Schmitt sich damit selbst als einen Verführten des nationalsozialistischen Arcanums"! Gross kennt gar einen Bruder Schmitts namens "Georg", von dem selbst das schlaue Carlchen nichts wußte. Einen Aufsatz jedoch, dessen Autor Gross‘ Bösartigkeiten nicht erreicht, ihn aber wegen seiner Konfusion anregen könnte, straft er mit Nichtachtung: Jean-Luc Evrard, Les juifs de Carl Schmitt, in: Les Temps Modernes, November/Dezember 1997, Seite 53–100.
Der Text hat Gross "viele Jahre beschäftigt", – die tropisch wuchernde Fülle an Fehlern, Verschleifungen, Insinuationen, ganz zu schweigen von der grundsätzlichen Unergiebigkeit des Themas, lassen sich vielleicht auch damit erklären. Doch der Skandal liegt nicht darin, daß wieder einmal ein miserables Buch über Schmitt geschrieben wurde (unter den ca. 200 Monographien liegt die Gross‘ wohl im untersten Vierzigstel), sondern daß Gross eine ganze Heerschar von Beratern, Hinweisgebern, Helfern zur Seite stand, ganze 45, so ich richtig zählte. Hier finden sich bedeutende Gelehrte, wie Reinhart Koselleck, leidliche Kenner wie Dirk van Laak, ein Anti-Schmitt-Maniaque wie Bernd Rüthers. Einige dieser 45 Leute aus Deutschland, Österreich, Israel, Frankreich, den USA sollen sogar das Manuskript gelesen haben. Man muß also einmal mehr am intellektuellen wie am moralischen Zustand der akademischen Welt verzweifeln.
Gross wurde auch über Jahre hinweg von mehreren Stiftungen gefördert. In den deutschsprachigen Ländern fließen für jüdische Stipendiaten keineswegs Milch und Honig – sie stürzen vielmehr kataraktartig auf die Antragsteller herab. Jacob Taubes‘ Diktum, daß die jüdische Intelligenz in der BRD sich in einer Situation befinde, in der sie bis auf die Knochen korrumpiert werde, bewahrheitet sich ein weiteres Mal. Na also! Etwas kann man immer lernen, hätte der ältere Plinius gejauchzt. Ein jiddisches Sprichwort weiß es noch: Gott bewahre uns vor jüdischer Chuzpe, jüdischen Mäulern und jüdischem Köpfchen.
Raphael Gross: Carl Schmitt und die Juden. Suhrkamp Verlag, Frankfurt/M. 2000, 441 Seiten, geb., 54 Mark
00:20 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, sciences politiques, politologie, carl schmitt, révolution conservatrice, antisémitisme, judaica, judaïsme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 29 mai 2009
M. Gauchet: "La démocratie du privé perturbe le collectif"
«La démocratie du privé perturbe le collectif»
Interview - Ex: http://www.liberation.fr/
Invité de «Libération», Marcel Gauchet dresse le bilan de deux années de sarkozysme. Et réagit à l’actualité tout au long de ce numéro spécial.
Théoricien de la crise de la démocratie et directeur de recherches à l’Ecole des hautes études en sciences sociales (EHESS), Marcel Gauchet, 63 ans, répond aux questions de Libération.
Quel bilan politique dressez-vous des deux premières années de Nicolas Sarkozy à l’Elysée ?
Le sarkozysme est difficile à analyser, car il est caméléonesque. Il manie la contradiction sans complexe. En jouant sur tous les tableaux, il se rend insaisissable, ce qui explique que les protestations de la gauche le laissent indemne. Néanmoins, si on doit faire un bilan, on peut dire que le sarkozysme a probablement épuisé son capital initial et que s’il continue de faire illusion, c’est paradoxalement grâce à la crise, qui le prend à contre-pied, mais justifie, pour quelque temps encore, son activisme. L’essence du sarkozysme, c’est, sous le titre de la «réforme», l’idée que le moment est venu de banaliser la France, en économie, en diplomatie, dans l’éducation… C’est un programme de pasteurisation européo-libérale du pays, dont les deux armes principales sont d’une part la communication, que Nicolas Sarkozy manie en virtuose, et d’autre part la vitesse et l’emballement du rythme : réformes annoncées à jet continu pour déstabiliser les opposants, qui n’ont pas le temps de se mobiliser qu’on en est déjà à la réforme suivante ; multiplication des fronts pour brouiller les cartes, etc.
Cette formule serait en train de toucher à ses limites ?
J’en ai l’impression. D’une part, une bonne partie des prétendues réformes sont pour la galerie. Sarkozy sait marier comme personne l’intransigeance verbale et une gestion très chiraquienne des compromis. C’est un bonapartisme pour la télévision, où l’affichage de la volonté l’emporte sur la réalité. Ca ne marche qu’un temps et les limites de l’entreprise commencent à se voir. Ensuite, l’effet de surprise ne joue plus. La démarche se heurte à la résistance de l’exception française. Or celle-ci est solide. Elle repose sur une culture politique républicaine ancrée dans une vision très forte de l’histoire du pays. Sarkozy a eu tort de croire qu’il pouvait se contenter de concessions rhétoriques à ce noyau dur, avec les discours de Guaino. Il a sous-estimé la vitalité de ce cadre historique et mental. Aussi son action s’enlise-t-elle. Nous sommes en train de passer de la guerre de mouvement à la guerre de tranchées. La crise lui offre un répit qu’il a saisi avec son intelligence et sa souplesse habituelles. Elle fragilise son discours sur le fond, mais elle met en valeur son pragmatisme et son volontarisme, qui sont bien adaptés à la situation.
Les Français ne l’ont-ils pas élu justement pour ce programme de réformes ?
Les Français sont ambigus et contradictoires. Ils aspirent au changement car ils ont les réflexes d’une ancienne grande puissance qui ne veut pas abdiquer. Ils entendent rester dans le peloton de tête - de ce point de vue, le discours de Sarkozy a rencontré un écho profond dans la société. Mais ils veulent aussi rester ce qu’ils sont. Voilà pourquoi ils sont si réactifs dès qu’ils ont l’impression que l’on risque de toucher à ce qui constitue le cœur de l’expérience politique française. Dans le discours, Sarkozy a essayé de jouer sur les deux tableaux, en annonçant le changement tout en invoquant la France éternelle, de Jeanne d’Arc à Guy Môquet. Mais dans la pratique, ce grand écart s’est révélé intenable. L’histoire a disparu en route, au profit d’un changement souvent très ignorant des réalités françaises.
Le sarkozysme incarne-t-il une étape de la crise de la démocratie telle que vous l’analysez dans vos essais ?
Ce serait lui faire beaucoup d’honneur que d’y voir un phénomène historique significatif en lui-même. Le sarkozysme n’est qu’une conjoncture française, mais qui met néanmoins en lumière un élément sous-jacent de la crise de la démocratie : une volonté de pouvoir dont l’effet est une dévitalisation du pouvoir. Typique, par exemple, est la place démesurée donnée par le chef de l’Etat à la communication, comme si agir sur les images était transformer la réalité. Caractéristique, également, son impossibilité de faire le départ entre l’homme privé et sa fonction publique. Or une telle distinction, c’est l’âme même de la démocratie, où le pouvoir est dans les institutions, non dans les personnes. Chez Nicolas Sarkozy, la dimension institutionnelle est absente. L’autorité qui compte, à ses yeux, c’est la sienne, pas celle de l’Etat, dont il n’a pas le souci. Par ce trait, il incarne à merveille ce que j’appelle «la démocratie du privé», qui est un processus de désarticulation de la démocratie sous l’effet de l’individualisation et de la privatisation du monde.
L’idée que nous sommes passés d’une «démocratie du public» à une «démocratie du privé» est au cœur de votre réflexion actuelle. Qu’entendez-vous par là ?
Pour le dire abruptement, la question est de savoir si le collectif jouit d’une existence indépendante de celle des êtres qui le composent. Si oui, on peut lui donner une expression institutionnelle, une expression publique, distincte de l’expression privée des individus, qui ont par ailleurs voix au chapitre. Historiquement, c’est cette idée qui a longtemps prévalu. Elle a eu de beaux jours politiques, spécialement en France, où elle a constitué l’âme de l’Etat républicain. Dans ce cadre, les libertés individuelles sont supposées s’accomplir par la participation à la chose publique. Parallèlement, il est vrai, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis avaient développé des modèles plaçant l’accent davantage sur les libertés individuelles que sur la chose publique, sans ignorer le rôle de celle-ci. Mais depuis une trentaine d’années, cette tradition anglo-américaine s’est radicalisée et diffusée partout. La pente du monde est de remettre en question toutes les formes de collectivisation de l’existence politique, au nom de l’idée qu’il n’existe que les individus réels et leurs intérêts particuliers, et que c’est de leur interaction que doivent surgir les compromis acceptables pour tout le monde. C’est ce qu’on appelle le néolibéralisme. La chose publique, dans ce cadre, n’a plus de consistance par elle-même, elle n’est plus que l’instrument des demandes émanées de la sphère privée. Les institutions collectives sont discréditées, parce qu’elles sont toujours suspectes de ne pas prendre en compte les personnes concrètes. Sous couvert des mêmes règles, l’esprit du fonctionnement de la démocratie a complètement changé.
Néanmoins, la démocratie américaine se caractérise par des valeurs collectives très fortes : patriotisme et religion.
En effet. C’est, pour le coup, l’exception américaine : les Etats-Unis sont dotés d’une identité politique très forte et le pays où les libertés privées ont le plus de place. C’est fonction de la foi dans la «destinée manifeste» de l’Amérique et dans son rôle de puissance à l’échelle du monde. L’Etat-nation américain est projeté vers l’extérieur ; il n’organise pas la société à l’intérieur. C’est ce qui fait que la démocratie du privé coexiste avec une dimension publique axée sur le rayonnement des Etats-Unis. Les Européens, au contraire, ont abandonné toute politique de puissance et, dans leur démocratie sociale, le poids des institutions publiques est grand. Aussi chez eux l’irruption de la démocratie du privé est-elle très perturbatrice pour l’identité collective. Ils ne savent plus très bien où ils en sont. Autant, pour les Américains, la démocratie du privé se complète par un Etat tourné vers le dehors, autant, pour les Européens et en particulier pour les Français, elle se solde par l’incapacité d’assumer un héritage historique dont ils ne savent plus trop que faire, tout en y restant attachés.
La «démocratie du privé» s’accompagne d’une «oligarchisation» de la société, dites-vous, mais aussi d’une montée en puissance de la protestation. N’est-ce pas contradictoire ?
La démocratie du privé, ce n’est pas du tout le repli des gens dans leur foyer, le cocooning, la passivité : c’est l’alignement de chacun sur son intérêt d’individu et la légitimation absolue de celui-ci, donc de sa défense inconditionnelle. C’est dire que l’effervescence protestataire, la revendication et le contentieux sont garantis d’avance. Mais ces revendications campent sur leur particularité, en se plaçant à l’extérieur du politique. La protestation s’en remet en fait aux responsables et leur dit : «Voilà ce que nous voulons, débrouillez-vous pour trouver les moyens». Le mot-clé est résister. Mais si vous ne formulez pas de propositions, si vous ne prenez pas en charge le point de vue de l’ensemble où votre réclamation doit s’inscrire, ce sont les gouvernants qui le font pour vous. Le problème de cette formule, c’est qu’elle ne permet pas de remonter au collectif. Elle exige, mais délègue aux hommes politiques le soin de décider : ainsi, la protestation secrète naturellement l’oligarchisation. Du reste, le personnel politique s’accommode de la situation. Il a compris que si elle est parfois inconfortable, elle lui laisse les cartes bien en main. Le divorce entre le haut et le bas se creuse. Car les citoyens continuent dans le même temps d’aspirer à une grande politique. On a vu à l’occasion de la dernière élection présidentielle que leur attente était intacte. Les électeurs aspirent à une puissance du politique que toute leur pratique au quotidien a pour effet de rendre impossible. D’où le sentiment général d’une dépossession incompréhensible.
Comment s’en sort-on ?
D’une part, il ne faut pas sous-estimer la prise de conscience par les individus des contradictions et de l’impasse dans laquelle ils sont. Les gens ne sont pas stupides, ils voient bien que quelque chose coince. Car cette équation impossible, on la trouve à tous les niveaux : dans la famille, à l’école, dans l’entreprise. L’évolution du syndicalisme, par exemple, est significative. Mais ce mouvement des mentalités ne suffit pas à faire bouger les choses à lui seul. C’est la rencontre avec les circonstances historiques qui précipite le changement, dans les moments de choix qui font apparaître la nécessité de reprendre en compte le collectif. En la matière, nous avons tout ce qu’il nous faut sous la main : la crise financière, le défi écologique, le blocage européen, le déséquilibre des systèmes sociaux. L’art du politique, c’est de conjuguer ces deux forces.
La crise financière est-elle un autre symptôme de la «démocratie du privé» ?
Elle est le symptôme économique de la dérive politique entraînée par la confiance illusoire dans l’autorégulation des intérêts individuels. Elle fait apparaître la vacuité de ce rêve d’agrégation automatique. La vérité est qu’un monde mondialisé a plus besoin que tout autre d’une organisation. Savoir laquelle va nécessiter du temps, mais tel est le but qu’il faut se fixer et c’est dans une telle optique qu’on peut par exemple parler de protection économique.
Est-ce le nouveau rôle historique de la gauche ?
Autant je ne vois pas de raison de désespérer à long terme, autant je suis obligé de constater, en ce qui concerne la France actuelle, que nous sommes au plus bas. Nous payons le prix du mitterrandisme, qui a été le visage sous lequel la France a défini pour longtemps son attitude face à ce changement de cap du monde. Elle a commencé par le refuser, sous Giscard. Puis, dans les années 80, tandis que le Royaume-Uni avait élu Thatcher et les Etats-Unis Reagan, est arrivé Mitterrand, qui a installé une culture de la dénégation, consistant à s’adapter à la nouvelle donne, mais sans le dire. Les socialistes français en sont toujours là : ils ont la particularité d’être à la fois très rigides doctrinalement et très cyniques en pratique. A leur décharge, il faut dire que Mitterrand avait cru trouver une échappatoire en jouant l’Europe : puisque le modèle français était condamné, il a voulu construire à un échelon européen une nouvelle synthèse du libéralisme et de l’Etat fort. Faire une Europe française, en somme. Dans les années 80, le projet européen a été le grand espoir de la société française. Mais il se trouve que le projet a échoué : l’Europe telle qu’elle s’est développée n’est pas française, on peut même dire qu’elle est anti-française, tout simplement parce qu’elle reflète la réalité d’un monde qui va spontanément à rebours de notre héritage historique. Le désenchantement qui s’en est suivi vis-à-vis de l’Europe a été spectaculaire. Depuis, personne n’a fait l’effort de reprendre le problème à la racine. Jospin, qui semblait l’avoir compris, n’a pas osé. Ségolène Royal est passée à côté. La panne est complète.
Les deux grands courants concurrents du PS - le pôle écologiste et libertaire et la gauche radicale - vous semblent-ils porteurs de promesses ?
Non, pas la moindre, hélas ! La gauche radicale est une rémanence de notre histoire. C’est la Révolution française qui revient, par-delà le communisme. Besancenot nous propose un néo-hébertisme et Badiou nous réinvente Babeuf et sa Conjuration des Egaux. Tout cela bouillonne, exprime des choses profondes, mais n’offre guère de perspectives opératoires. Quant à la liste commune Cohn-Bendit-José Bové, la contradiction de la nouvelle démocratie individualiste du privé y atteint son sommet. Il n’y a vraiment que sur le papier que le souci écologique et la radicalisation des droits personnels collent ensemble !
Critiquer les droits de l’homme, n’est-ce pas encourager des formes politiques autoritaires ?
Je ne critique pas les droits de l’homme, je critique l’usage qu’on en fait, ce qui est fort différent. Ils sont indiscutables dans leur ordre, mais ne fournissent en rien une réponse générale, immédiate et totale aux questions qui nous sont posées. Ils établissent la base de légitimité du pouvoir dans nos sociétés ; ils énoncent ce qu’on ne doit en aucun cas violer et ce vers quoi nos sociétés doivent tendre, en tant que sociétés d’individus. Mais en aucun cas ils ne définissent le système politique ou l’organisation sociale qui permettront d’assurer leur développement. Les droits de l’homme sont le fondement et le but, pas le moyen. Ils ne nous dispensent pas, comme l’illusion du moment le fait croire, de réfléchir sur l’ordre politique et sur le fonctionnement de la société en tant que tels. Si l’idée de socialisme doit retrouver un sens vivant, c’est du côté de cette conjonction qu’il faut le chercher.
Recueilli par ÉRIC AESCHIMANN et LAURENT JOFFRIN
00:30 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sciences politiques, politologie, théorie politique, sociologie, philosophie, démocratie, droits de l'homme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
G. Maschke: Der Engel der Vernichtung

Dossier "Günter Maschke"
Der Engel der Vernichtung
Angriff gegen den aufklärerischen Optimismus, verdunkelt von Kraftworten: Zum 250. Geburtstag von Joseph de Maistre
Ex: http://www.jungefreiheit.de/
Günter Maschke
La neve sulla tosta, ma il fuoco nella bocca!", rief ein begeisterter Italiener aus, der das einzige überlieferte Portrait Joseph de Maistres betrachtete, das kurz vor dessen Tode entstand. Das Haupt weiß, wie von Schnee bedeckt und aus dem Munde strömt Feuer: De Maistre gehört zu den wenigen Autoren, die mit zunehmenden Jahren stets nur radikaler und schroffer wurden und sich der sanft korrumpierenden Weisheit des Alters entschlungen, gemäß der man versöhnlicher zu werden habe und endlich um die Reputation bemüht sein müsse. Fors do l'honneur nul souci, außer der Ehre keine Sorge, war der Wahlspruch des Savoyarden, und zu seiner Ehre gehörte es, immer unvermittelter, schonungsloser und verblüffender das Seine zu sagen.
Der Ruhm de Maistres verdankt sich seinen Kraftworten, mit denen er den ewigen Gutmenschen aufschreckt, der sich's inmitten von Kannibalenhumanität und Zigeunerliberalismus bequem macht. "Der Mensch ist nicht gut genug, um frei zu sein", ist wohl noch das harmloseste seiner Aperçus, das freilich, wie alles Offenkundige, aufs Äußerste beleidigt. Beharrliche Agnostiker und schlaue Indifferenzler entdecken plötzlich ihre Liebe zur Wahrheit und erregen sich über den kaltblütigen Funktionalismus de Maistres, schreibt dieser: "Für die Praxis ist es gleichgültig, ob man dem Irrtum nicht unterworfen ist oder ob man seiner nicht angeklagt werden darf. Auch wenn man damit einverstanden ist, daß dem Papste keine göttliche Verheißung gegeben wurde, so wird er dennoch, als letztes Tribunal, nicht minder unfehlbar sein oder als unfehlbar angesehen werden: Jedes Urteil, an das man nicht appellieren kann, muß, unter allen nur denkbaren Regierungsformen, in der menschlichen Gesellschaft als gerecht angesehen werden. Jeder wirkliche Staatsmann wird mich wohl verstehen, wenn ich sage, daß es sich nicht bloß darum handelt, zu wissen, ob der Papst unfehlbar ist, sondern ob er es sein müßte. Wer das Recht hätte, dem Papste zu sagen, daß er sich geirrt habe, hätte aus dem gleichen Grunde auch das Recht, ihm den Gehorsam zu verweigern."
Der Feind jeder klaren und moralisch verpflichtenden Entscheidung erschauert vor solchen ganz unromantischen Forderungen nach einer letzten, alle Diskussionen beendenden Instanz und angesichts der Subsumierung des Lehramtes unter die Jurisdiktionsgewalt erklärt er die Liebe und das Zeugnisablegen zur eigentlichen Substanz des christlichen Glaubens, den er doch sonst verfolgt und haßt, weiß er doch, daß diesem die Liebe zu Gott wichtiger ist als die Liebe zum Menschen, dessen Seele "eine Kloake" (de Maistre) ist.
Keine Grenzen mehr aber kennt die Empörung, wenn de Maistre, mit der für ihn kennzeichnenden Wollust an der Provokation, den Henker verherrlicht, der, zusammen mit dem (damals) besser beleumundeten Soldaten, das große Gesetz des monde spirituel vollzieht und der Erde, die ausschließlich von Schuldigen bevölkert ist, den erforderlichen Blutzoll entrichtet. Zum Lobpreis des Scharfrichters, der für de Maistre ein unentbehrliches Werkzeug jedweder stabilen gesellschaftlichen Ordnung ist, gesellt sich der Hymnus auf den Krieg und auf die universale, ununterbrochene tobende Gewalt und Vernichtung: "Auf dem weiten Felde der Natur herrscht eine manifeste Gewalt, eine Art von verordneter Wut, die alle Wesen zu ihrem gemeinsamen Untergang rüstet: Wenn man das Reich der unbelebten Natur verläßt, stößt man bereits an den Grenzen zum Leben auf das Dekret des gewaltsamen Todes. Schon im Pflanzenbereich beginnt man das Gesetz zu spüren: Von dem riesigen Trompetenbaum bis zum bescheidensten Gras - wie viele Pflanzen sterben, wie viele werden getötet!"
Weiter heißt es in seiner Schrift "Les Soirées de Saint Pétersbourg" (1821): "Doch sobald man das Tierreich betritt, gewinnt das Gesetz plötzlich eine furchterregende Evidenz. Eine verborgene und zugleich handgreifliche Kraft hat in jeder Klasse eine bestimmte Anzahl von Tieren dazu bestimmt, die anderen zu verschlingen: Es gibt räuberische Insekten und räuberische Reptilien, Raumvögel, Raubfische und vierbeinige Raubtiere. Kein Augenblick vergeht, in dem nicht ein Lebewesen von einem anderen verschlungen würde.
Über alle diese zahllosen Tierrassen ist der Mensch gesetzt, dessen zerstörerische Hand verschont nichts von dem was lebt. Er tötet, um sich zu nähren, er tötet, um sich zu belehren, er tötet, um sich zu unterhalten, er tötet, um zu töten: Dieser stolze, grausame König hat Verlangen nach allem und nichts widersteht ihm. Dem Lamme reißt er die Gedärme heraus, um seine Harfe zum Klingen zu bringen, dem Wolf entreißt er seinen tödlichsten Zahn, um seine gefälligen Kunstwerke zu polieren, dem Elefanten die Stoßzähne, um ein Kinderspielzeug daraus zu schnitzen, seine Tafel ist mit Leichen bedeckt. Und welches Wesen löscht in diesem allgemeinen Schlachten ihn aus, der alle anderen auslöscht? Es ist er selbst. Dem Menschen selbst obliegt es, den Menschen zu erwürgen. Hört ihr nicht, wie die Erde schreit nach Blut? Das Blut der Tiere genügt ihr nicht, auch nicht das der Schuldigen, die durch das Schwert des Gesetzes fallen. So wird das große Gesetz der gewaltsamen Vernichtung aller Lebewesen erfüllt. Die gesamte Erde, die fortwährend mit Blut getränkt wird, ist nichts als ein riesiger Altar, auf dem alles, was lebt, ohne Ziel, ohne Haß, ohne Unterlaß geopfert werden muß, bis zum Ende aller Dinge, bis zur Ausrottung des Bösen, bis zum Tod des Todes."
Im Grunde ist dies nichts als eine, wenn auch mit rhetorischem Aplomb vorgetragene banalité supérieure, eine Zustandsbeschreibung, die keiner Aufregung wert ist. So wie es ist, ist es. Doch die Kindlein, sich auch noch die Reste der Skepsis entschlagend, die der frühen Aufklärung immerhin noch anhafteten, die dem Flittergold der humanitären Deklaration zugetan sind (auch, weil dieses sogar echtes Gold zu hecken vermag), die Kindlein, sie hörten es nicht gerne.
Der gläubige de Maistre, der trotz all seines oft zynisch wirkenden Dezisionismus unentwegt darauf beharrte, daß jede grenzenlose irdische Macht illegitim, ja widergöttlich sei und der zwar die Funktionalisierung des Glaubens betrieb, aber auch erklärte, daß deren Gelingen von der Triftigkeit des Glaubens abhing - er wurde flugs von einem bekannten Essayisten (Isaiah Berlin) zum natürlich 'paranoiden' Urahnen des Faschismus ernannt, während der ridiküle Sohn eines großen Ökonomen in ihm den verrucht-verrückten Organisator eines anti-weiblichen Blut- und Abwehrzaubers sah, einen grotesken Medizinmann der Gegenaufklärung. Zwischen sich und der Evidenz hat der Mensch eine unübersteigbare Mauer errichtet; da ist des Scharfsinns kein Ende.
Der hier und in ungezählten anderen Schriften sich äußernde Haß auf den am 1. April 1753 in Chanbéry/Savoyen geborenen Joseph de Maistre ist die Antwort auf dessen erst in seinem Spätwerk fulminant werdenden Haß auf die Aufklärung und die Revolution. Savoyen gehörte damals dem Königreich Sardinien an und der Sohn eines im Dienste der sardischen Krone stehenden Juristen wäre wohl das ehrbare Mitglied des Beamtenadels in einer schläfrigen Kleinstadt geblieben, ohne intellektuellen Ehrgeiz und allenfalls begabt mit einer außergewöhnlichen Liebenswürdigkeit und Höflichkeit in persönlich-privaten Dingen, die die "eigentliche Heimat aller liberalen Qualitäten" (Carl Schmitt) sind.
Der junge Jurist gehörte gar einer Freimaurer-Loge an, die sich aber immerhin kirchlichen Reunionsbestrebungen widmet; der spätere, unnachgiebige Kritiker des Gallikanismus akzeptiert diesen als selbstverständlich; gelegentlich entwickelte de Maistre sogar ein wenn auch temperiertes Verständnis für die Republik und die Revolution. Der Schritt vom aufklärerischen Scheinwesen zur Wirklichkeit gelang de Maistre erst als Vierzigjährigem: Als diese in Gestalt der französischen Revolutionstruppen einbrach, die 1792 Savoyen annektierten. De Maistre mußte in die Schweiz fliehen und verlor sein gesamtes Vermögen.
Erst dort gelang ihm seine erste, ernsthafte Schrift, die "Considérations sur la France" (Betrachtungen über Frankreich), die 1796 erschien und sofort in ganz Europa Furore machte: Die Restauration hatte ihr Brevier gefunden und hörte bis 1811 nicht auf, darin mehr zu blättern als zu lesen. Das Erstaunliche und viele Irritierende des Buches ist, daß de Maistre hier keinen Groll gegen die Revolution hegt, ja, ihr beinahe dankbar ist, weil sie seinen Glauben wieder erweckte. Zwar lag in ihr, wie er feststellte, "etwas Teuflisches", später hieß es sogar, sie sei satanique dans sons essence. Doch weil dies so war, hielt sich de Maistres Erschrecken in Grenzen. Denn wie das Böse, so existiert auch der Teufel nicht auf substantielle Weise, ist, wie seine Werke, bloße Negation, Mangel an Gutem, privatio boni. Deshalb wurde die Revolution auch nicht von großen Tätern vorangetrieben, sondern von Somnambulen und Automaten: "Je näher man sich ihre scheinbar führenden Männer ansieht, desto mehr findet man an ihnen etwas Passives oder Mechanisches. Nicht die Menschen machen die Revolution, sondern die Revolution benutzt die Menschen."
Das bedeutete aber auch, daß Gott sich in ihr offenbarte. Die Vorsehung, die providence, leitete die Geschehnisse und die Revolution war nur die Züchtigung des von kollektiver Schuld befleckten Frankreich. Die Furchtbarkeit der Strafe aber bewies Frankreichs Auserwähltheit. Die "Vernunft" hatte das Christentum in dessen Hochburg angegriffen, und solchem Sturz konnte nur die Erhöhung folgen. Die Restauration der christlichen Monarchie würde kampflos vonstatten gehen; die durch ihre Gewaltsamkeit verdeckte Passivität der Gegenrevolution, bei der die Menschen nicht minder bloßes Werkzeug sein würden. Ohne Rache, ohne Vergeltung, ohne neuen Terror würde sich die Gegenrevolution, genauer, "das Gegenteil einer Revolution", etablieren; sie käme wie ein sich sanftmütig Schenkender.
Die konkrete politische Analyse aussparen und direkt an den Himmel appellieren, wirkte das Buch als tröstende Stärkung. De Maistre mußte freilich erfahren, daß die Revolution sich festigte, daß sie sich ihre Institution schuf, daß sie schließlich, im Thermidor und durch Bonaparte, ihr kleinbürgerlich-granitenes Fundament fand.
Von 1803 bis 1817 amtierte de Maistre als ärmlicher, stets auf sein Gehalt wartender Gesandter des Königs von Sardinien, der von den spärlichen Subsidien des Zaren in Petersburg lebt - bis er aufgrund seiner lebhaften katholischen Propaganda im russischen Hochadel ausgewiesen wird. Hier entstehen, nach langen Vorstudien etwa ab 1809, seine Hauptwerke: "Du Pape" (Vom Papste), publiziert 1819 in Lyon, und "Les Soirées de Saint Pétersbourg" (Abendgespräche zu Saint Petersburg), postum 1821.
Die Unanfechtbarkeit des Papstes, von der damaligen Theologie kaum noch verfochten, liegt für de Maistre in der Natur der Dinge selbst und bedarf nur am Rande der Theologie. Denn die Notwendigkeit der Unfehlbarkeit erklärt sich, wie die anderer Dogmen auch, aus allgemeinen soziologischen Gesetzen: Nur von ihrem Haupte aus empfangen gesellschaftliche Vereinigungen dauerhafte Existenz, erst vom erhabenen Throne ihre Festigkeit und Würde, während die gelegentlich notwendigen politischen Interventionen des Papstes nur den einzelnen Souverän treffen, die Souveränität aber stärken. Ein unter dem Zepter des Papstes lebender europäischer Staatenbund - das ist de Maistres Utopie angesichts eines auch religiös zerspaltenen Europa. Da die Päpste die weltliche Souveränität geheiligt haben, weil sie sie als Ausströmungen der göttlichen Macht ansahen, hat die Abkehr der Fürsten vom Papst diese zu verletzlichen Menschen degradiert.
Diese für viele Betrachter phantastisch anmutende Apologie des Papsttums, dessen Stellung durch die Revolution stark erschüttert war, führte, gegen immense Widerstände des sich formierenden liberalen Katholizismus, immerhin zur Proklamation der päpstlichen Unfehlbarkeit durch Pius IX. auf dem 1869 einberufenen Vaticanum, mit dem der Ultramontanismus der modernen, säkularisierten Welt einen heftigen, bald aber vergeblichen Kampf ansagte.
Die "Soirées", das Wesen der providence, die Folgen der Erbsünde und die Ursachen des menschlichen Leidens erörternd, sind der vielleicht schärfste, bis ins Satirische umschlagende Angriff gegen den aufklärerischen Optimismus. Hier finden sich in tropischer Fülle jene Kraftworte de Maistres, die, gerade weil sie übergrelle Blitze sind, die Komplexität seines Werkes verdunkeln und es als bloßes reaktionäres Florilegium erscheinen lassen.
De Maistre, der die Leiden der "Unschuldigen" ebenso pries wie die der Schuldigen, weil sie nach einem geheimnisvollen Gesetz der Reversibilität den Pardon für die Schuldigen herbeiführen, der die Ausgeliefertheit des Menschen an die Erbsünde in wohl noch schwärzeren Farben malte als Augustinus oder der Augustinermönch Luther und damit sich beträchtlich vom katholischen Dogma entfernte, der nicht müde wurde, die Vergeblichkeit und Eitelkeit alles menschlichen Planens und Machens zu verspottern, - er mutete und mutet vielen als ein Monstrum an, als ein Prediger eines terroristischen und molochitischen Christentum.
Doch dieser Don Quijote der Laientheologie - doch nur die Laien erneuerten im 19. Jahrhundert die Kirche, deren Klerus schon damals antiklerikal war! -, der sich tatsächlich vor nichts fürchtete, außer vor Gott, stimmt manchen Betrachter eher traurig. Weil er, wie Don Quijote, zumindest meistens recht hatte. Sein bis ins Fanatische und Extatische gehender Kampf gegen den Lauf der Zeit ist ja nur Gradmesser für den tiefen Sturz, den Europa seit dem 13. Jahrhundert erlitt, als der katholische Geist seine großen Monumente erschuf: Die "Göttliche Komödie" Dantes, die "Siete Partidas" Alfons' des Weisen, die "Summa" des heiligen Thomas von Aquin und den Kölner Dom.
Diesem höchsten Punkt der geistigen Einheit und Ordnung Europas folgte die sich stetig intensivierende Entropie, die, nach einer Prognose eines sanft gestimmten Geistesverwandten, des Nordamerikaners Henry Adams (1838-1918), im zwanzigsten und einundzwanzigsten Jahrhundert zur völligen spirituellen, aber auch politischen und sittlichen Anomie führen würde.
Der exaltierte Privatgelehrte, der in St. Petersburg aufgrund seiner unbedeutenden Tätigkeit genug Muße fand, sagte als erster eine radikale, blutige Revolution in Rußland voraus, geleitet von einem "Pugatschev der Universität", was wohl eine glückliche Definition Lenins ist. Die Prophezeiung wurde verlacht, war Rußland doch für alle ein Bollwerk gegen die Revolution. Er entdeckte, neben Louis Vicomte de Bonald (1754-1840), die Gesetze politisch-sozialer Stabilität, die Notwendigkeit eines bloc des idées incontestables, Gesetze, deren Wahrheit sich gerade angesichts der Krise und des sozialen Atomismus erwies: Ohne Bonald und de Maistre kein August Comte und damit auch keine Soziologie, deren Geschichte hier ein zu weites Feld wäre. De Maistre, Clausewitz vorwegnehmend und Tolstois und Stendhals Schilderung befruchtend, erkannte als erster die Struktur der kriegerischen Schlacht und begriff, daß an dem großen Phänomen des Krieges jedweder Rationalismus scheitert; der Krieg war ihm freilich göttlich, nicht wie den meist atheistischen Pazifisten ein Teufelswerk; auch ihn durchwaltete die providence.
Endlich fand de Maistre den Mut zu einer realistischen Anthropologie, die Motive Nietzsches vorwegnahm und die der dem Humanitarismus sich ausliefernden Kirche nicht geheuer war: Der Mensch ist beherrscht vom Willen zur Macht. Vom Willen zur Erhaltung der Macht, vom Willen zur Vergrößerung der Macht, von Gier nach dem Prestige der Macht. Diese Folge der Erbsünde bringt es mit sich, daß, so wie die Sonne die Erde umläuft, der "Engel der Vernichtung" über der Menschheit kreist - bis zum Tod des Todes.
Am 25. Februar 1821 starb Joseph de Maistre in Turin. "Meine Herren, die Erde bebt, und Sie wollen bauen!" - so lauteten seine letzten Worte zu den Illusionen seiner konservativen Freunde. Das war doch etwas anderes als - Don Quijote.
Günter Maschke lebt als Privatgelehrter und Publizist in Frankfurt am Main. Zusammen mit Jean-Jacques Langendorf ist er Hausgeber der "Bibliothek der Reaktion" im Karolinger Verlag, Wien. Von Joseph de Maistre sind dort die Bücher "Betrachtungen über Frankreich", "Die Spanische Inquisition" und "Über das Opfer" erschienen.
00:20 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politologie, réaction, sciences politiques, théorie politique, france, révolution française, contre-révolution, conservatisme, catholicisme, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook