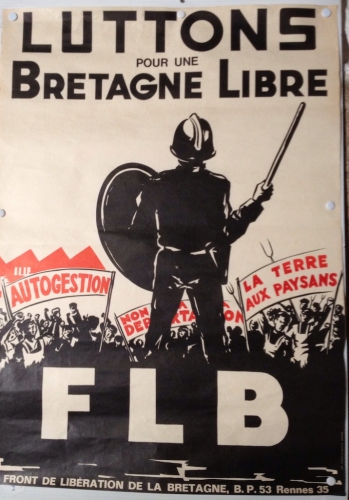dimanche, 23 mars 2025
Parution du numéro 72 de War Raok
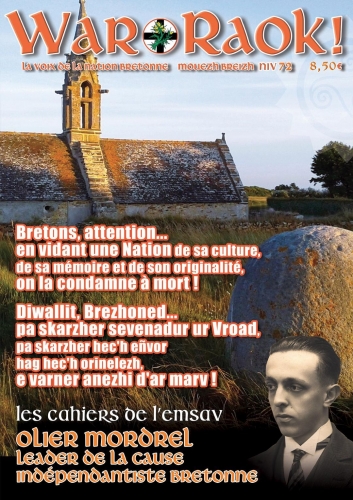
Parution du numéro 72 de War Raok
EDITORIAL
Le vrai redressement
Devons-nous rendre à la nation bretonne un rôle actif, rôle qui suppose une prise de risques ? Pouvons-nous courir le danger de nous replier sur un culte exclusif du passé, sur le refus d’une histoire qui, de toute façon, se ferait sans nous, c’est-à-dire contre nous ? De toute évidence un repliement sur des complexes culturels figés signerait la baisse de vitalité de notre peuple. Nous devons vouloir la modernité, à condition de donner à ce terme le sens d’une réactualisation de notre héritage.
Maintenir une tradition figée, ou ses restes, ne suffit pas, il faut en faire un instrument de conquête et de prospection. La reconquête de notre personnalité est un signe parmi d’autres de cette attitude. Il n’est surtout pas question de renier le legs des ancêtres, mais gardons-nous du passéisme, d’une utopie régressive.
La nation bretonne suppose une juvénilité persistante de ses membres, non la relégation dans l’image faussée d’un passé désamorcé. La réactualisation des héritages, l’implantation volontaire de nouvelles traditions conformes à l’esprit communautaire, la revalorisation de notre histoire nationale, autant d’axes pour ce qui est véritablement une politique culturelle de recréation du peuple.
Cette entreprise n’est pas essentiellement de nature politique, on peut diffuser dans la mentalité collective et dans la société civile des valeurs, des idées, des images, des mythes selon des visées qui dépassent de loin le champ du politique et recherchent le plus vaste impact historique. Le but : la prise du « pouvoir culturel », indispensable à tout changement dans l’ordre du politique. Cet impact historique, c’est l’histoire de Bretagne véritable conscience du destin d’un peuple dans le temps et l’espace. Notre histoire est sans fin et au système dominant qui tente aujourd’hui de figer toute histoire dans une culture planétaire inerte, nous y opposons une philosophie dynamique et devons nous réapproprier notre passé et le mobiliser pour un projet de reconquête et de remodelage du présent. Nous atteindrons ainsi la part d’éternité qui est en nous. L’histoire est donc ce qui doit être conservé et régénéré pour que notre peuple échappe à la disparition qui le menace.
Habitués malheureusement à une représentation segmentaire du devenir historique, nous n’avons que trop sacrifié au dogme d’un progrès à sens unique. Or, le passé chronologique n’est pas le révolu. C’est tout naturellement que les générations d’autrefois se prolongent dans celles d’aujourd’hui et prennent part à notre vie présente. Nous refusons de les oublier à jamais au profit d’une quelconque fin de l’histoire.
C’est pourquoi un retour aux sources signifie une recréation volontaire des formes sociales, linguistiques, culturelles, qui devraient nous être propres et la remise en pratique des principes qui les entretiennent. C’est donc, avant tout, une réforme de l’ordre intérieur et une régénération de la conscience.
Le peuple breton doit rester fidèle à ses attaches et à ses héritages culturels et historiques. A une époque où domine un système planétaire, l’enracinement constitue une réponse globale aux pathologies d’une civilisation mondiale paralysée et cancérisée.
Enfin, donnons au peuple breton une forme qui empêche sa disparition et permette son retour à la dynamique de l’histoire. Notre perspective est alors politique et en ce sens nous entendons l’aider à devenir une véritable communauté solidaire et renforcer sa conscience nationale. Notre volonté d’histoire et d’enracinement n’est pas un enfermement, elle s’ouvre sur la reconquête d’un espace culturel global, exigence de la géopolitique la plus réaliste. Découvrons l’authenticité d’une vue-du-monde qui rompe avec les schémas universalistes. Loin de marquer un repliement, cette attitude devrait se généraliser aux peuples-de-culture des cinq continents, victimes du même ennemi idéologique.
Padrig MONTAUZIER.
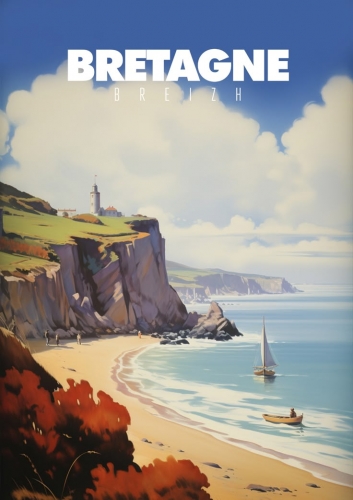
SOMMAIRE de WAR RAOK n° 72
Editorial, page 3
Buan ha Buan, page 4
Société
Pourquoi s’attaquer à nos pierres sacrées ?, page 8
Environnement
La non-durabilité des énergies renouvelables, page 10

Traditions
Le Barroù Mae, une tradition du mois de mai en Bretagne, page 12
Politique
À propos du Mémoricide, page 14
Enseignement
L’esclavage numérique et la fin de l’enseignement, page 17

Billet d’humeur
Pour que la Bretagne reste la Bretagne… et l’Europe…, page 18
Europa
Les socialistes arrivent au pouvoir en Catalogne…, page 19
Hent an Dazont
Votre cahier de 2 pages en breton, page 20


LES CAHIERS DE L’EMSAV
Olier Mordrel : un sanglier de combat !, Page 23
Un sacrifice volontaire, page 24


Histoire de Bretagne
Sébastien Le Balp, leader des Bonnets rouges, page 31
Nature
La loutre d’Europe en Bretagne, page 35
Lip-e-bav
Le parmentier de chou-fleur aux moules, page 37
Keleier ar Vro
Le patrimoine breton, en danger, en déshérence !, page 38

Bretagne sacrée
Le temple de Lanleff un temple énigmatique, page 39.
* * *

War Raok fête ses 25 années de combat pour la Bretagne !
Avec le numéro 72, la revue War Raok fête ses 25 années d’existence.
25 années de combat politique, combat pour les libertés bretonnes et l’émancipation du peuple breton, combat pour la civilisation, la pérennité de nos ethnies, de nos peuples...
Finis les projets utopiques, les sursauts libérateurs jaillis d’un autre printemps… Finis les doux rêves d’un romantique mouvement breton. L’émancipation du peuple breton, la vraie, celle qui dans un même mouvement change l’homme breton et la société, ne peut germer que dans une société nouvelle où les préoccupations matérielles n’accaparent pas totalement les esprits. Malheureusement aujourd’hui, le contexte politique enferme la plupart des Bretons dans l’individualisme, dans l’égoïsme matérialiste ou dans le désespoir.
Le nationalisme breton que l’on retrouve exprimé dans War Raok est en fait un espoir de liberté par delà des siècles de servage, un besoin d’identité qui n’a jamais été aussi fort. Vouloir être Breton aujourd’hui, c’est vouloir retrouver le sens de la communauté fraternelle, c’est vouloir maîtriser son destin, c’est vouloir exprimer sa dignité dans sa propre culture, c’est vouloir vivre ses traditions… en un mot c’est vouloir être un Breton libre, un Breton de ce temps.
L’esprit de la revue War Raok est simple : il faut dépouiller de ses dernières guenilles passéistes le combat breton. Ce dernier doit impérativement devenir authentique et indubitable ! Aussi, la revue s’inscrit dans une démarche souverainiste bretonne, un souverainisme breton qui doit demeurer frontal.
La muraille du mépris édifiée par les divers gouvernements français depuis des siècles se lézarde sérieusement. C’est l’occasion de réaffirmer nos revendications de justice, de liberté et sortir définitivement des abysses dans lesquels l’État français nous entraîne.
Pour la rédaction de War Raok,
Padrig Montauzier, directeur de publication.
19:36 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, nationalisme breton, pays celtiques, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 septembre 2024
Parution du numéro 70 de War Raok
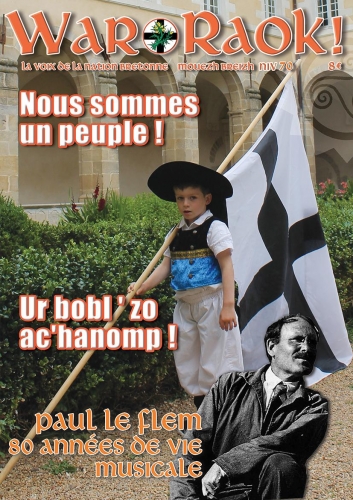
Parution du numéro 70 de War Raok
EDITORIAL:
Exposer notre théorie, c’est refuser de tricher avec notre peuple
L’élaboration de principes accordés à la défense des peuples colonisés répond à des nécessités. Il faut lui assurer les fondements solides d’une réflexion cohérente, d’une justification convaincante et d’un discours fondateur susceptibles de lui donner sa pleine dimension historique. Il y a urgence parce que la crise aiguë qui secoue nos peuples, aggravée par l’état de déliquescence de la société occidentale, risque d’atteindre un point de non-retour.
Il s’agit de poser des principes clairs car une action mal perçue est vouée à l’échec ou, ce qui est pire, à la perversion, au détournement vers des fins étrangères à son but. Réduite au niveau du spectacle, la revendication nationaliste, à contenu ethniste, ne servira que de faire-valoir à nos adversaires et sera réduite au rôle d’utilité d’une vie politique préfabriquée. Un peuple qui ne parvient pas à faire entendre sa voix ou qui le fait en usant de références qui lui sont données par l’extérieur (idées à la mode, slogans vides de sens...), est voué à être récupéré par le système qui l’aliène. Dans le même ordre d’idées, on sait comment le système colonial laisse filtrer, quand cela lui est utile, une « extrême-gauche » ou une « extrême-droite » qui lui servent de repoussoir et qui sont en fait des produits fabriqués de toute pièce. Pour éviter cette récupération dans un système qui veut la disparition des peuples, nous devons imposer nos propres références historiques, ne pas laisser les autres les définir par rapport à des concepts étrangers, à un vocabulaire exogène... C’est ainsi que nous nous poserons en acteurs historiques, non en figurants marginaux d’une société artificielle.
Sur le plan de la pratique, la cohérence doctrinale est le seul moyen d’éviter les manipulations de tous ordres. On connaît bien l’accusation d’un autonomisme ou d’un indépendantisme qui aurait sa source « à l’étranger ». On connaît aussi l’assimilation de l’ethnisme au « racisme » ou à la « xénophobie ». La déformation par adaptation à l’idéologie en cours est une arme coutumière de ceux qui luttent contre la liberté et l’émancipation des peuples. Nous la détournerons en montrant que nous portons en nous-mêmes les motivations et les justifications de nos actes et de nos idéaux.
Notre engagement pour le peuple breton résulte d’une prise de conscience et d’une décision spécifique. Nous sommes mus par une nécessité interne et non par la pression ou l’influence d’une société qui nous est étrangère, et dont nous refusons les rôles qu’elle veut nous faire jouer. Laisser à d’autres le soin de se définir c’est être agis par eux, c’est être sujets de l’histoire. Or nous voulons faire notre histoire, c’est-à-dire faire rentrer notre peuple dans l’histoire en lui rendant la possibilité d’agir pour lui-même et d’être l’acteur de son devenir.
Alors, nous devons nous situer et prendre du champ par rapport à l’instant, distinguer tactique et stratégie, refuser l’enfermement dans l’actualité, où les plus impatients risquent de perdre le sens de la durée qui caractérise les grandes actions menées au service d’un peuple. Une réflexion théorique est donc à la fois une auto-construction et une maîtrise de l’événement. Il entre enfin dans notre projet un élément d’éthique. Nous vivons en un temps qui favorise le trouble des esprits et provoque indirectement les situations ambiguës. La claire expression de nos idées et de nos buts est l’un des moyens par lesquels nous nous démarquons des velléitaires ou des profiteurs.
Si la conscience de nos buts doit nous inviter à plus d’exigence envers nous-mêmes, elle nous permet aussi de refuser l’aventurisme, l’excès d’actes et de paroles, l’immaturité politique ou le confusionnisme intellectuel qui sont les agents de toutes les provocations... tout comme la complaisance quasi pathologique dans des attitudes outrées.
Nous devons nous donner les moyens de dépasser l’événementiel pour mieux nous construire comme agents de l’histoire, acteurs de notre libération nationale.
Padrig Montauzier

Sommaire War Raok n°70
Buhezegezh vreizh, page 2
Editorial, page 3
Buan ha Buan, page 4
Politique
Histoire du fascisme, page 8
Environnement
Pseudo-écologistes et hypocrisie des pays occidentaux, page 11
Tribune libre
Migration et culpabilité impériale, page 14
Société
Sur le phénomène Woke, page 16
Billet d’humeur
L’homme politique en tant que menteur pathologique, page 18
Hent an Dazont
Votre cahier de 4 pages en breton, page 21

Mythologie celtique
Le monde des abeilles chez les Celtes, page 23
Tradition
Culture traditionnelle et populaire de Kosovo Polje, page 26

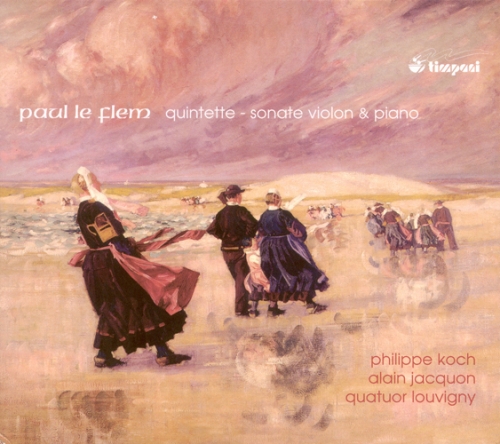
Grandes figures
Paul Le Flem, 80 années de vie musicale, page 28
Histoire de Bretagne
La bataille de Trans-la-forêt, page 31

Nature
Le geai des chênes aux ailes marbrées bleues électriques, page 34

Lip-e-bav
Irish stew, stobhach Gaelach, page 36
Keleier ar Vro
Les châteaux et l’histoire de Bretagne, page 37

Bretagne sacrée
L’abbaye Sainte-Croix de Quimperlé, page 39.
* * *

Qui veut faire taire la revue War Raok?
Piv en deus c'hoant da lakaat ar gelaouenn War Raok da devel?
Chère lectrice, cher lecteur, chers abonnés, chers démocrates et défenseurs des libertés bretonnes,
En presque 25 années d’existence, c’est la toute première fois que la revue War Raok sonne l’alarme et sans un soutien de votre part, la revue, votre revue peut disparaître.
De nombreux médias de presse écrite connaissent un effondrement du nombre de leurs abonnés ces dernières années. War Raok est parvenu à limiter cette tendance à une lente érosion. Outre la baisse du nombre des abonnements, citons la hausse vertigineuse du prix du papier, le coût de la distribution… et malgré toutes ces difficultés, nous nous sommes engagés à ne quasiment pas augmenter le prix des abonnements.
Mais c’est pour un tout autre problème que nous tenons à vous informer, une autre menace qui, aujourd’hui, pèse sur la presse libre. En plus de 24 années de publication, War Raok n’a jamais eu la moindre menace de procès ! Et pour cause, l’équipe rédactionnelle et moi-même avons été toujours très rigoureux, très vigilants dans tous les articles publiés. Malgré cela, 4 procédures viennent d’être lancées contre la revue, procédures liées aux droits sur l’image.
Sur plus de 24 années, sur le site internet de War Raok, 11 malheureuses images réduites et miniaturisées au format de 2 centimètres par 2 centimètres servant d’illustrations à certains articles… constituent l’infraction et des facturations amendes de près de 3500 € pour les agences : AFP, Reuters, Associated Press, PA images.
Ne pensez-vous pas qu’un simple courrier nous signifiant l’infraction et nous recommandant par la suite d’être plus vigilants aurait été amplement suffisant ? Nous n’avons jamais voulu enfreindre la loi, ni porter préjudice aux agences de presse concernées… Les images incriminées ont été reprises sur divers sites d’informations et divers journaux, où bien souvent ne figurent pas les droits et le nom de l’agence propriétaire. Notre bonne foi est réelle et ne peut être mise en doute.
Face aux sommes réclamées, totalement disproportionnées, nous sommes toutefois optimistes, convaincus que vous allez être nombreux à nous aider, conscients que War Raok est plus que jamais nécessaire en tant que revue libre et indépendante bretonne, et ainsi faire face aux menaces qui pèsent aujourd’hui sur le pluralisme de la presse.
Pas question à ce stade d’envisager un échec, nous parions résolument sur la réussite de cette mobilisation ! Nous comptons sur vous et chaque don de votre part participera à la survie de la revue, la voix de la nation bretonne… la voix de la Résistance bretonne !
Merci d’avance chers amis, pour la Bretagne, son peuple et les libertés bretonnes toujours aussi menacées.
Padrig Montauzier.
L’équipe rédactionnelle de War Raok.
Trugarez vras deoc’h-holl evit ho skoazell.
Skipailh War Raok/Mouezh Breizh.
Vos dons :
- Chèques bancaires à l’ordre de War Raok
Adresse : 50 B avenue du Maréchal Leclerc, Appt 203, 35310 Mordelles (Breizh).
- Virement bancaire :
IBAN. FR76 1558 9351 3104 9873 3504 155
BIC. CMBRFR2BARK
11:58 Publié dans Actualité, Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, war raok, revue, terres d'europe, pays celtiques, nationalisme breton |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 15 mars 2023
Parution du numéro 66 de la revue War Raok
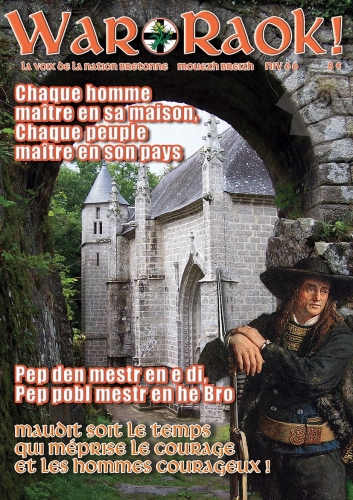
Parution du numéro 66 de la revue War Raok
EDITORIAL
Il faut oser affronter l’État français et son ministère de l’Éducation coloniale
De plus en plus de voix s’élèvent pour que soit enseigné, de façon officielle, l’Histoire de la Bretagne aux jeunes élèves bretons. Un enseignement obligatoire et non pas une certaine « liberté pédagogique » des enseignants qui consiste à enseigner l’Histoire de France à travers des exemples locaux afin d’agrémenter et embellir le programme ! Voilà le subterfuge, l’échappatoire du ministère français de l’Éducation nationale pour ne pas intégrer officiellement l’Histoire de la Bretagne dans tous les programmes scolaires. Une fidélité aux règles intangibles imposées par les Grands Maîtres de l' Éducation nationale depuis le 19ème siècle.
La République française a choisi de laisser les enfants bretons dans l’ignorance de leur Histoire
Cette Histoire de la nation bretonne, véritable roman national au cœur de notre identité, serait-elle si sulfureuse pour que lʼÉtat français et sa belle République souhaitent la passer sous silence ? Une connaissance parfaite susciterait-elle une prise de conscience et éveillerait-elle soudain un désir d’émancipation au sein du peuple breton ?
Les motifs du refus d’enseigner cette grande Histoire du peuple breton se trouvent en fait dans ces deux interrogations ! Nos braves « Hussards noirs de la République française » ont bien flairé le danger et lorsqu’ils daignent évoquer notre Histoire, ils la falsifient et osent les pires contrefaçons. On va même user des pires arguments fallacieux et s’adjoindre la collaboration de piètres historiens nourris par des visions idéologiques peu recommandables.
Ainsi, on apprend que les Bretons tireraient leur origine des tribus gauloises qui occupaient l’Armorique avant notre ère. Que la langue bretonne serait un miraculeux échantillon conservé de la langue que l’on parlait dans toute la Gaule… et donc que les Bretons seraient ainsi deux fois Français, puisque descendants directs des grands guerriers blonds aux yeux bleus, que la mythologie officielle assigne pour aïeux lointains à l’ensemble des hommes qui habitent entre l’Atlantique, le Rhin et les Alpes.
La vérité est toute autre messieurs. Le berceau historique de notre ethnie est l’Île de Bretagne, où vivaient entre autres peuples, des hommes qui parlaient une langue apparentée à celle des Celtes continentaux et qui possédaient un type physique assez différent.
Peu à peu refoulés vers l’Ouest suite aux diverses invasions, ils ne parvinrent à se maintenir que dans les deux péninsules occidentales de l’Île : le Pays de Galles et la Cornouailles où leurs fils habitent encore. Étaient-ils trop nombreux pour ces territoires ? Toujours est-il qu’ils se mirent à émigrer vers l’Armorique toute proche. L’Armorique ainsi repeuplée devint la Bretagne.
On voit déjà combien, par cette brève première partie de notre Histoire, les débuts de la Bretagne la font différente de la France et l’erreur que l’on commettrait en l’assimilant à une quelconque et vulgaire province française.
La suite de son histoire ne fit que creuser le fossé qui séparait la Bretagne, dès l’origine, de ses voisins de l’Est ! A peine établis en Armorique, les Bretons durent lutter contre les assauts successifs des Francs et repousser les multiples tentatives d’invasion pour sauvegarder leur liberté. Du point de vue historique, une chose est certaine, et personne ne le niera, la Bretagne vécu indépendante pendant de très longs et heureux siècles. Je ne vous ferai pas l’histoire de cette glorieuse période où les souverains bretons donnèrent au pays une prospérité remarquable et où les autres nations regardaient avec envie ce petit peuple européen actif et entreprenant.
L’État français et sa République n’ont eu de cesse de répéter aux Bretons qu’ils n’avaient pas d’Histoire ! Il nous faut maintenant mettre un terme à cette politique bornée où se mêlent peur et méfiance, mais aussi totalitarisme et négationnisme culturel piliers jacobins de l’Éducation nationale française.
Il faut abattre cette féodalité.
Padrig MONTAUZIER.

Sommaire War Raok n°66
Buhezegezh vreizh page 2
Editorial page 3 (Padrig Montauzier)
Buan ha Buan page 4 (Julien Dir, Yann Vallérie)

Europe
Réflexion sur l’identité européenne page 10 (Enric Ravello)
Tribune libre
L’Occident a tendu un piège perfide aux Russes ? Page 12 (Peter G. Feher)
Histoire
Deux peuples, deux destins page 14 (Fulup Perc’hirin)
Politique
Immigration : la prochaine étape du libéralisme page 17 (Enric Ravello Barber)
Hent an Dazont
Votre cahier de 2 pages en breton page 18 (Tepod Mab Kerlevenez/Eostig Pont-Eon)
Solidairté Kosovo
Le convoi de Noël, contre vents et marées page 23 (Goulc’hen Danio de Rosquelfen)

Plantes et santé
L’herboristerie… et le pouvoir des plantes page 25 (Jérôme Marchin)
Civilisation celtique
Littératures écrites et orales des civilisations celtiques page 27 (Fulup Perc’hirin)
Nature
Le ver de terre page 31 (Per Manac’h)
Lip-e-bav
Soupe de poisson à la bretonne page 33 (Youenn ar C’heginer)
Keleier ar Vro
Le Gwenn ha Du de l’Hôtel de ville de Saint-Nazaire page 34 (Meriadeg de Keranflec’h)
Bretagne sacrée
Le dolmen de la Roche-aux-fées page 35 (Per Manac’h)
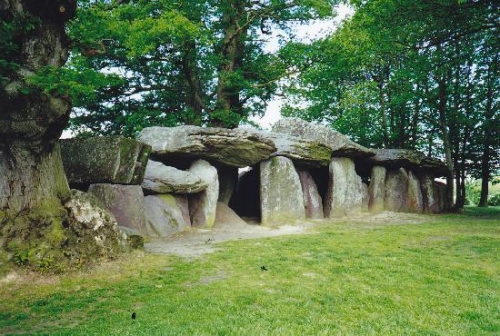
21:28 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : terres d'europe, terroirs, racines, bretagne, nationalisme breton, revue, pays celtiques, celtisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 15 décembre 2022
Parution du numéro 65 de la revue War Raok

Parution du numéro 65 de la revue War Raok
EDITO
Transformer le crépuscule présent en une nouvelle aurore
En ces temps perturbés et dans un contexte particulièrement trouble, face à l’arrogance et à l’indécence de certains grands prêtres, grands guides ou nouveaux ayatollahs de la terre brûlée plaidant en faveur de cette funeste et aberrante religion révolutionnaire qui consiste à faire du « passé table rase », nous devons plus que jamais affirmer notre attachement aux traditions et aux valeurs, fondements de nos sociétés bretonnes et européennes.
Si la tradition est un ensemble de représentations et de pratiques considérées comme indiscutablement vraies par le peuple qui s’y réfère, elle est également un trait culturel spécifique particulièrement chargé de valeurs. La tradition est intemporelle, incarnée et réalisée puisque, comme l’indique son nom, elle est transmission de principes. Un autre nom de la tradition est mémoire, à condition de ne pas entendre par là une fabrication imposée : un peuple sans mémoire, et plus encore un peuple sans souvenir, est un peuple sans âme.
Elle ne s’oppose pas au « futur », au « progrès » ou au « moderne », elle les fonde. Les projets et les visées d’avenir sont des mises en perspective de traditions. La tradition touche aussi bien les attitudes mentales que les rites qui doivent demeurer immuables. Nos rites populaires sont un ensemble de coutumes dictées par notre tradition. Ils sont aujourd’hui soit réduits, par déculturation, soit neutralisés par muséification dans un ridicule folklore-spectacle pour touristes. Mais les traditions peuvent être régénérées ou réinventées même après une période d’apparente interruption. En fait, rien ne disparaît jamais, tout est soumis à la loi du changement et demeure susceptible de revenir. Une tradition peut être occultée, nous pouvons la manifester de nouveau. La tradition est un perpétuel recours.
Il nous faut donc refuser tout système de pensée que nous imposent les fanatiques idéologues nourris de la philosophie des « Lumières » : leur but est l’homogénéisation générale des peuples et par conséquent la destruction de tous référents communautaires. Nous refusons de voir l’âme du peuple breton remplacée par l’absence d’âme de ses plus mortels ennemis.
On ne peut pas évoquer la tradition sans y associer le concept de valeurs qui font qu’il n’y a pas de vie possible pour un peuple sans la reconnaissance et l’adoption d’un certain nombre de valeurs fondatrices. Elles ne s’appréhendent pas rationnellement mais dans le vécu d’une communauté ethnique. Des valeurs, qui ne se confondent pas avec des dogmes moraux imposés, mais sont essentiellement une attitude de vie. Il faut savoir lire, à travers la crise qui affecte notre Europe aujourd’hui, le déclin de cadres idéologiques déliquescents et la naissance de nouvelles valeurs, encore indistinctes, mais que nous devons formaliser selon les données immémoriales de nos héritages propres. Les peuples ont besoin d’un système de valeurs renouvelé, réinventé, qui puisse transformer le crépuscule présent en une nouvelle aurore.
Chaque peuple peut placer au-dessus de tout ses propres valeurs, tout en les considérant comme relatives, comme son bien propre et non comme celui de l’humanité tout entière.
Enfin, toute tentative de promouvoir des valeurs universelles est en fait un instrument du déracinement idéologique pour vider de leur substance les morales concrètes des peuples authentiques.
Nous pouvons être guidés dans ce choix de valeurs réelles par notre propre tradition culturelle.
Nous ne voulons pas être tenus pour responsables de la mort du peuple breton et de notre Bretagne. Aussi, nous devons avoir le courage de la résistance et de l’abnégation et convaincre autrui de la portée civilisationnelle de notre combat politique qui occupera obligatoirement l’ensemble des prochaines années à venir.
D’an holl ac’hanoc’h e hetan un Nedeleg laouen hag ur Bloavezh mat 2023.
Padrig MONTAUZIER.

Sommaire War Raok n° 65
Buhezegezh vreizh page 2
Editorial page 3
Buan ha Buan page 4
Peuples d’Europe
Les Hellènes oubliés page 8
Billet d’humeur
Le nouvel opium du peuple page 9
Europe
La Suède détruit le cauchemar social-démocrate page 10
Environnement
De la mondialisation à la civilisation page 12
Tribune libre
Le destin français de l’Alsace, une tragédie page 14
Hent an Dazont
Votre cahier de 4 pages en breton page 19
Politique
Faut-il affirmer une dimension européenne ? Page 23
Histoire de Bretagne
Un point de vue politique (2ème partie) page 26

Religion
Le sanctuaire de Sainte-Anne-d'Auray page 30
Histoire de Celtie
Les Culdee, Lug et Merlin page 31
Tradition
La San Esteban, la Catalogne et l’axe carolingien page 32
Civilisation celtique
Littératures écrites et orales des civilisations celtiques page 33
Nature
La lamproie page 36
Lip-e-bav
Filet mignon de porc au cidre et son confit page 37
Keleier ar Vro
La statue de Louis XIV dévoilée page 38
Bretagne sacrée
La chapelle Sainte-Barbe page 39
21:09 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, celtisme, pays celtiques, terres d'europe, armorique, nationalisme breton |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 24 juillet 2022
Parution du n°63 de War Raok
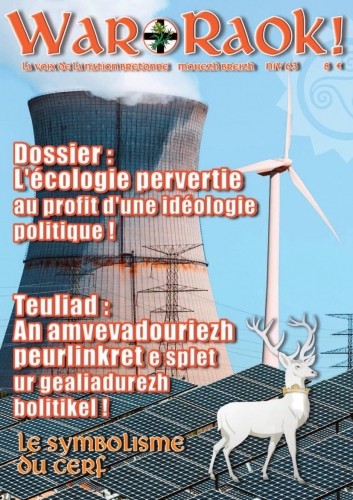
Parution du n°63 de War Raok
EDITORIAL
Nous n’avons jamais tant envie de sortir d’une maison que lorsque l’on y est enfermé de force !
Le jacobinisme, fruit de la Révolution française, sévit impitoyablement sur ce pauvre Hexagone. D’autant plus dangereux qu’il se pare de toutes les qualités et vertus, et apparaît encore pour la grande majorité des hommes politiques français comme une nécessité ! Il est un des pires fléaux auquel il faut ajouter ce colonialisme exercé par l’État français, depuis l’avènement de sa belle Révolution, à l’encontre des peuples ethniques comme le peuple breton. Est-il utile de rappeler que cette Révolution française prétendant libérer le peuple du pouvoir absolu du Roi en rétablissait un autre encore plus absolu avec son système totalitaire.
La Bretagne qui, depuis la perte de son indépendance, jouissait d’une large autonomie, a vu, par un tour de passe-passe, ses libertés purement et simplement supprimées car assimilées à des privilèges. Dorénavant, il faut une Bretagne incolore, docile, soumise qui ne soit plus qu’une banale province française, que le reflet de cette France issue des Lumières.
On cherche ainsi à rendre les Bretons amnésiques et à effacer toute trace de souvenirs historiques ! Dans quelques temps plus tard on commettra sans vergogne, au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité, les pires excès, les pires crimes. La France s’est faite par le fer, le feu et le sang reconnaissent volontiers les jacobins et c’est pourquoi ils pensent qu’elle ne peut se maintenir que par la contrainte et la coercition. Ils n’ont pas compris que la contrainte engendre obligatoirement des réactions, légitimes et parfois violentes, et que l’on a jamais tant envie de sortir d’une maison que lorsque l’on y est enfermé de force. Ils ne se demandent jamais comment on peut être ou devenir autonomiste, souverainiste ou indépendantiste Breton, Corse, Flamand, Catalan, Basque...etc. Ils jugent et condamnent sans chercher à comprendre. Leurs actions néfastes n’ont que trop duré.
La France reste aujourd’hui le pays le moins évolué de toute l’Europe occidentale
Depuis qu’ils sont au pouvoir, nos braves et indécrottables jacobins, épris de liberté, pratiquent en fait le centralisme démocratique. Sûrs d’eux, insensibles au temps qui passe, aux évolutions géopolitiques, ils demeurent immuables dans leurs convictions. Par leur aplomb, leur suffisance, ils donnent à leur République une renommée usurpée. L’ « Une et Indivisible » commence sérieusement à se fissurer, l’Europe des peuples sans État est en marche ! On entend des craquements dans la charpente vermoulue et fatiguée de l’édifice France aux fondations instables et mal assurées.
Jacobins, fanatiques « nationalistes » (les guillemets s’imposent car la France n’est pas une nation mais un État composé de nations) n’ont pas compris qu’en favorisant le nivellement, ils sont en train de creuser eux-mêmes leur propre tombe. Une véritable nation, un véritable peuple ne peuvent être qu’une communauté ethnique.
En fait les tenants de l’indivisibilité de la République française ne font-ils pas tout pour détruire leur République ? Ils se plaignent aujourd’hui ! Ils gémissent et pleurent même… Par leurs conceptions irréalistes et universalistes ils ont amené leur France à ce degré de dissolution et d’inconsistance que l’on connaît aujourd’hui.
Pour le peuple breton et les autres peuples embastillés dans la forteresse France, une émancipation s’impose et si l’ennemi reste encore aujourd’hui la République française, qui s’essouffle et qui n’engendre guère plus aucun enthousiasme, un nouvel ennemi menace et met en danger notre civilisation européenne et l’ensemble de nos peuples européens... Et contre cet ennemi-là nous devrons opposer un front résolu et sans faille.
Padrig MONTAUZIER
SOMMAIRE N° 63
Buhezegezh vreizh
Editorial
Buan ha Buan
Dossier Environnement
- L’écologie pervertie au profit d’une idéologie politique
- Les prédicateurs de la mondialisation
- Génération Greta. Comment la peur de l’effondrement mobilise toute une société et ses médias
- Éclairer la Bretagne. Sans indépendance énergétique pas d’autonomie économique !
- En conclusion du dossier
Hent an Dazont
Votre cahier de 4 pages en breton
Politique
Quand les petits remplacements mènent au Grand Remplacement
Tribune libre
Nations et nationalismes : la grande confusion
Santé
De pauvres fruits et légumes

Tradition
Le symbolisme du cerf
Civilisation celtique
Littératures écrites et orales des civilisations celtiques
Nature
Petit musicien de nos foyers : le grillon

Lip-e-bav
Andouille de Guéméné poêlée et lapin au cidre
Keleier ar Vro
La longue affaire du Bugaled Breizh
Bretagne sacrée
Les cimetières marins
14:58 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, bretagne, nationalisme breton, celtisme, pays celtiques, terroirs, racines, terres d'europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 27 décembre 2021
Parution du n°62 de War Raok

Parution du n°62 de War Raok
EDITORIAL
Les effets de l’acculturation en Bretagne
Le destin de la Bretagne est fondé sur son identité, sa culture, son histoire!
La culture est l’ensemble des valeurs, des traditions et coutumes d’un peuple. Elle reflète le mode de vie et la vision du monde d’une communauté donnée. C’est toute l’identité d’un peuple. La culture est aussi le reflet de l’histoire, c’est-à-dire le vécu d’un peuple dès son origine et à travers les âges. L’acculturation est le rejet de ses valeurs, ses coutumes et traditions pour s’approprier des valeurs culturelles d’un autre groupe humain, en cherchant à s’identifier à ces mœurs et coutumes. Cette domination culturelle est une nouvelle forme de colonisation dont les médias aux ordres constituent les véritables instruments d’acculturation et en sont les principaux organes de promotion. Nous ne sommes pas sans savoir que tout changement de comportement, des coutumes et traditions, reflets du passé d’un peuple, conduisent à la disparition de ce peuple, de son identité et de sa culture.
La culture est l’âme vivante d’une nation et c’est ce qui fait qu’une nation est différente d’une autre. Selon un principe anthropologique, toutes les cultures se valent, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de culture qui soit supérieure à d’autre, puisque chaque culture a ses particularités et reflète un passé différent et unique d’un peuple. Et, c’est à travers les spécificités culturelles qu’on distingue les peuples, à savoir leur mode de vie, leur vision du monde, leur croyance.
Dans le cas de la Bretagne, si la politique de l’État français a été de tout temps de s’attaquer particulièrement à la langue bretonne, l’enseignement de l’histoire de la Bretagne n’a pas été épargné pour autant. Il est vrai que si les Bretons avaient eu une parfaite connaissance de leur histoire, nous ne serions très certainement pas dans cette situation actuelle de sujétion, dans cet état de dépendance et aurions recouvré depuis fort longtemps nos libertés perdues. La dimension celtique de l’histoire et de la culture bretonnes est en fait une manière de la singulariser par rapport au modèle culturel français, héritier de la tradition gréco-latine. Ainsi, on comprend mieux la méfiance, l’acharnement et l’opposition du « pays des droits de l’homme » à dispenser un enseignement généralisé de l’histoire millénaire du peuple breton à la jeunesse bretonne. Méfiance toutefois ! L’enseignement que nous voulons est celui d’une histoire de Bretagne authentique écrite par des historiens honnêtes et intègres et non par ce que pourrait proposer l’État français, par le biais de son Éducation nationale, un programme d’enseignement revu et corrigé, une histoire à sa convenance, une histoire falsifiée fleurant bon le négationnisme, une histoire convenable écrite par des idéologues manipulateurs !
Langue, histoire, coutumes, traditions… un rejet de ces valeurs peut inéluctablement conduire à une disparition de la culture bretonne en tant que telle si rien n’est fait. Dans ce constat de déperdition, quelle est donc la place d’une politique culturelle devant mettre en évidence les valeurs culturelles de la Bretagne au passé mémorable dans l’histoire de l’Europe ? Nous sommes à l’heure où la tendance fait croire que tout ce qui est étranger est bon et tout ce qui est local est mauvais. La Bretagne est reconnue comme un pays riche culturellement d’après son histoire, ses origines et l’ensemble des valeurs et traditions qui lui sont propres, cependant, elle n’est pas épargnée d’être un jour dans la liste des anciennes sociétés. En somme, le combat contre l’acculturation est avant tout une responsabilité de tous les Bretons, mais il incombe aux responsables politiques en Bretagne, en particulier au « croupion » Conseil Régional, de faire la promotion de la culture bretonne par tous les moyens. C’est une affaire politique qui nécessite l’apport de tous les secteurs concernés.
L’hostilité de la république française à l’égard de la Bretagne est toujours d’actualité. Avons-nous alors encore quelque chose à partager avec elle, qui bafoue notre identité et nous dénie toute autonomie, jusqu’à l’enseignement aux enfants de Bretagne de leur langue et de l’Histoire de leur pays ? Les Bretons doivent reprendre en mains l’enseignement de leur langue, mais également de leur histoire refusant ainsi les hérésies qui, par lavage des cerveaux, ont été introduites dans leurs esprits. Seul, un authentique pouvoir breton sera à même de défendre et de promouvoir cette culture bretonne à la fois héritière du passé de nos aïeux et tournée vers la créativité du futur.
Padrig MONTAUZIER

Sommaire War Raok n° 62
Buhezegezh vreizh page 2
Editorial page 3 (Padrig Montauzier)
Buan ha Buan page 4
Société
La cancel culture et la délégitimation de la mémoire page 9 (Giulio Battioni)
Politique
L’Alliance souverainiste bretonne,
un élan majeur pour la Bretagne page 11 (Meriadeg de Keranflec’h)
Tradition
Le symbolisme du cheval page 15 (Per Manac’h)
Hent an Dazont
Votre cahier de 4 pages en breton page 19 (Donwal Gwenvenez/Yann Mikael)
Histoire de Celtie
Importance du celtisme dans les Asturies page 23 (Carlos X. Blanco)
Tribune libre
Sur les prénoms non-français, objection M. Zemmour ! Page 25 (Youenn Caouissin)
Histoire de Bretagne
Le faux traité de 1532 page 26 (Docteur Louis Melennec)
Politique
La mosquée de Cologne, la charia en marche page 30 (Erwan Houardon)
Civilisation celtique
Littératures écrites et orales des civilisations celtiques page 32 (Fulup Perc’hirin)
Nature
L’écureuil, petit rouquin de nos forêts page 36 (Youenn Caouissin)
Lip-e-bav
Gratin du pêcheur aux herbes page 37 (Youenn ar C’heginer)
Keleier ar Vro
Un statut de résident pour la Bretagne page 38 (Meriadeg de Keranflec’h)
Bretagne sacrée
Les lavoirs page 39 (Per Manac’h)
14:29 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, bretagne, celtisme, pays celtiques, nationalisme breton |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 07 mai 2021
Histoire et perspective du nationalisme breton - Entretien avec Padrig Montauzier
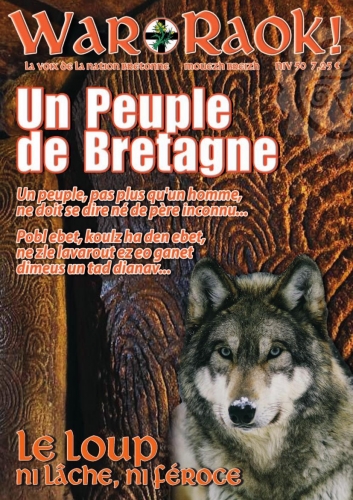
Histoire et perspective du nationalisme breton
Entretien avec Padrig Montauzier
Propos recueillis par Enric Ravello Barber
Ex: https://www.enricravellobarber.eu/2021/05/
Breizhiz, preizh oc'h deut da vezañ da lezennoù didruez ur reizhiad bedelour ha bedvroelour ha da veañs ar re zo ouzh e ren. Bazhyevet oc'h dindan lezennoù estren Bro-C'hall hag a zo bet a-viskoazh o klask hoc'h enteuziñ hag a zistruj kement tra a c'hallfe ho tieubiñ. Ar falsprofeded-se o deus troet ac'hanoc'h en atomoù denel, e Frañsizien vat reizh ha sentus. Ar pezh a anvont demokratelezh hiziv n'eo nemet maskl ar servelezh ekonomikel hag an displedoni vezhus.
Hiziv, pobl Vreizh, n'ac'h eus ket a vammvro anavezet ez-ofisiel ken. Arc'hoazh n'az-po mui na familh, na hevelebiezh : n'az po nemet mistri. Klaoustre, siwazh, en em laki da garout ar sujidigezh-se en ur grediñ e waranto dit bevañ ez aes.
Traduction française :
Bretons, vous êtes livrés aux lois impitoyables d’un système mondialiste et cosmopolite et à l'égoïsme de ceux qui le dirigent. Vous êtes soumis aux lois étrangères de la France qui se livre depuis toujours à une politique d’assimilation forcée, et détruit tout ce qui peut vous libérer. Ces mauvais prophètes vous ont transformé en atomes humains, en bons Français dociles et disciplinés. Ce qu'ils nomment aujourd'hui démocratie n'est que le masque de l'esclavage politique, du servage économique et de l'abjection morale.
Aujourd’hui, peuple breton tu n’as plus de patrie reconnue officiellement. Demain tu n’auras ni famille, ni identité : tu n’auras que des maîtres. Mais malheureusement tu risqueras d’aimer encore cette servitude croyant qu'elle te garantira l'aisance matérielle.

IDENTITÉ
La Bretagne est une nation avec une personnalité forte et profondément enracinée, pour commencer l'interview, j'aimerais que vous nous expliquiez la genèse de la nation bretonne.Beaucoup de gens pensent que les Bretons sont les restes des Celtes gaulois qui ont survécu à la romanisation, mais en réalité c'était l'Armorique et c'était totalement romanisé, vous, les Bretons, vous vous appelez ainsi précisément parce que vous venez de Grande-Bretagne et êtes les descendants deles Celtes ont émigré en Armorique à la suite de l'invasion anglo-saxonne de l'île.Pouvez-vous expliquer brièvement cela? L'arrivée des Bretons était-elle dans une certaine mesure une « re-celtisation » de l'Armorique?
Padrig Montauzier : La presqu’île habitée aujourd’hui par les Bretons et située à l’extrémité de l’Europe occidentale était connue dans le passé sous le nom d’Armorique, « le pays du bord de la mer ». Les premières manifestations de la vie humaine en Armorique datent de l’époque paléolithique avec notamment les fouilles du Mont Dol en Ille et Vilaine. Les hommes qui ont dressé les mégalithes vivaient aux environs de l’an 2000 avant Jésus-Christ, possédaient des armes de bronze et imposèrent alors leur domination sur tout l’Occident, jusqu’au jour où les Celtes qui occupaient l’Europe centrale partirent à la conquête des terres avoisinant la Baltique, la mer du Nord, la Grande Bretagne et l’Irlande.
Au premier siècle avant Jésus-Christ, plusieurs tribus celtes occupent le massif Armoricain. Elles appartiennent au rameau « celto-belge » qui peuple une partie des îles Britanniques. Cinq peuples se partagent le territoire appelé actuellement la Bretagne : Les Redones, les Namnètes, les Vénètes, les Ossismes et les Curiosolites.

L’île de Bretagne, c’est-à-dire la Grande Bretagne actuelle, était habitée par des populations de race ligure puis ensuite envahie par les Celtes, les Goidels dans un premier temps puis par les Bretons. L’invasion saxonne commence vers 449 et se poursuit jusqu’à la fin du VIème siècle. Les succès des troupes saxonnes forcent les Bretons à se réfugier dans l’Ouest du pays en formant ainsi trois groupes : au Sud, les Bretons de Cornouailles (Cornwall), au Nord, les Bretons de Cumbrie et entre les deux, les Bretons de Cambrie ou Pays de Galles. D’autres Bretons, pour échapper à la fureur des Saxons, traversent l’océan et abordent par exemple les côtes de Galice… les autres, beaucoup plus nombreux arrivent en Armorique et fondent la nation bretonne qui occupe aujourd’hui notre péninsule.
A la suite des persécutions exercées par les Anglo-Saxons contre les Bretons, l’émigration en Armorique prend des proportions considérables. Cette émigration de Grande Bretagne en Armorique se fait sans doute par tribus, une flottille part sous la direction d’un tiern (chef) ou encore d’un moine et débarque dans la péninsule. Les exilés se groupent autour d’un chef puissant et c’est ainsi l’origine des principautés créées par les Bretons sur le sol de leur nouvelle patrie. Ces principautés sont au nombre de trois : la Domnonée, la Cornouaille, et le Bro-Warroch ou Bro-Erec. La re-celtisation de l’Armorique se fait sur deux zones distinctes. A l’Ouest l’élément celtique domine complètement car cette région est en partie très dépeuplée. A l’Est par contre où la population armoricaine est plus dense, il se forme ce que l’on appelle aujourd’hui la Haute Bretagne ou pays gallo, une zone mixte à la fois bretonne et armoricaine. Sans l’émigration bretonne, la péninsule armoricaine aurait été un pays de langue latine, simple province du royaume des Francks, languissante et inculte… Cette émigration bretonne lui a donné un peuple nouveau de race et de langue celtiques, un peuple fier, indépendant… en un mot qui en a fait la Bretagne. Voilà ce que les émigrés ont apporté en ce pays, voilà ce que ce pays leur doit. Lorsque les Bretons quittèrent la Cambrie ou le Cornwall pour l’Armorique, ils ne partaient pas pour une terre totalement inconnue. Ils avaient le souvenir des nombreuses relations commerciales entretenues jadis au temps de la Celtique indépendante avec les tribus armoricaines et les paysages de cette nouvelle Bretagne leur rappelaient ceux de la patrie perdue.

Vous êtes donc frères des Gallois - et des Cornouaillais - certains nationalistes bretons pensent que Galles et la Grande-Bretagne sont la même nation divisée en deux, "deux tranchants de la même épée" m'a dit un jour un bon nationaliste breton;en fait l'hymne de Galles et celui de la Bretagne, qu'en pensez-vous ?
Padrig Montauzier : Effectivement nous sommes frères, frères celtes et unis par une même culture. Il est vrai que le Pays de Galles et la Bretagne ont toujours été, sur le plan culturel, très proches principalement au niveau de la langue, Comme vous le mentionnez, nous avons un hymne identique ce qui démontre bien une très grande proximité culturelle. Une différence toutefois, nos frères gallois, comme pour les autres nations celtes, bénéficient de pouvoirs réels et d’une reconnaissance par la couronne anglaise, ce qui n’est pas le cas du peuple breton sous tutelle coloniale française et privé de ses droits nationaux.
A la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, on assiste à un renouveau du celtisme, proposant même une unité pan-celtique, dont chacune des nations celtiques serait une province (Écosse, Irlande, Pays de Galles, Cornouailles, Ile de Man, Grande-Bretagne).Êtes-vous favorable à cette idée ?
Padrig Montauzier : Cette idée évidemment j’y suis favorable et l’on voit bien qu’elle est profondément ancrée chez les Bretons. Regardez par exemple le succès du festival inter-celtique de Lorient qui rassemble depuis de nombreuses années des milliers de spectateurs venant du monde entier. Toutefois, si après la seconde guerre mondiale nos frères irlandais et gallois se sont mobilisés pour aider les militants nationalistes bretons persécutés par le gouvernement gaulliste/communiste français, il ne faudrait pas oublier que dans l’ensemble tous nos frères celtes restent relativement très francophiles. Personnellement, sur le plan politique, je regarde plus vers l’Est pour un soutien à notre cause de libération nationale. C’est là que l’on voit qu’il existe parfois un « fossé » entre le culturel et le politique, alors que les deux sont étroitement liés !
Le Gwenn ha Du (blanc et noir) est le nom donné au drapeau breton que nous connaissons tous, mais la Bretagne a eu de plus en plus de drapeaux plus anciens, comme celui avec la croix noire sur fond blanc, lequel d'entre eux représente le mieux l'histoire et l'identité bretonne, quelle est la différence entre eux ?
Padrig Montauzier : Faisons abstraction des drapeaux représentant les pays (Broioù) de Bretagne et intéressons-nous aux trois drapeaux symbolisant la Nation bretonne. Les drapeaux basés sur une croix de couleurs découlent en fait de l’époque des croisades. Lors des deux premières croisades, les différentes nations y participant arboraient toutes la croix rouge sur fond blanc. C'est seulement lors de la troisième croisade, en 1188, que chaque nation put avec l'accord du pape disposer de sa propre couleur de croix afin de se distinguer des autres nations. Avec l'approbation du pape Gregoire IX, les Bretons auraient reçu la couleur noire pour leur croix. Les différentes traces historiques ont le plus souvent montré la croix noire sous forme d'écu, de bannière, ou encore associée à des hermines. Le Kroaz Du (croix noire en breton) devient l'emblème de l’État breton jusqu'à l'annexion par la France. Le Kroaz Du évoluera à cette date et sera utilisé par la marine bretonne qui lui rajoute des mouchetures d'hermine. Lors de l'annexion définitive en 1532, il disparaîtra alors au profit de l'hermine plain, les différents rois de France successifs estimant que la croix noire rappelait trop la monarchie et l’indépendance bretonne, et risquait de remettre en cause la légitimité du rattachement du duché de Bretagne à la France. Le Kroaz Du a été remis en lumière à partir de l’année 2000 sous l’impulsion du parti de droite nationaliste ADSAV.

Appelé Bannière d'hermine ou drapeau hermine plain, ce drapeau historique de Bretagne voit le jour en 1316 sous le règne du duc de Bretagne Jean III qui décide de changer d'armoiries et opte pour le semé de mouchetures d'hermine, que l'on appelle en héraldique « hermine plain ». Aujourd'hui encore, le drapeau d'hermine est utilisé lors certaines manifestations historiques, politiques et fêtes religieuses, par certains bagadoù et mairies de Bretagne et flotte sur des bateaux de plaisance, châteaux et églises de Bretagne.
Enfin le Gwenn ha Du (blanc et noir en breton). Au XIXème siècle, un réveil celtique, partie prenante du romantisme et du principe des nationalités, gagne toute l’Europe, d’Ouest en Est, et les hermines du Gwenn-ha-Du en frémirent dans le vent. C’est en 1925 que Morvan Marchal, militant nationaliste breton et co-fondateur de Breiz Atao, ce laboratoire expérimental des partis bretons de l’avenir, créé le drapeau breton à bandes. Il fallait inventer un drapeau breton d’esprit moderne tout en conservant au maximum les couleurs et les hermines primitives. Au point gauche du drapeau neuf bandes égales alternativement noires et blanches, couleur traditionnelle, lesquelles bandes représentent, les blanches les pays bretonnants : Léon, Trégor, Cornouaille, Vannetais, les noires, les pays gallos : Rennais, Nantais, Dolois, Malouin, Penthièvre.
Ce drapeau n’a jamais voulu être un drapeau politique mais un emblème moderne de la Bretagne et il constitue une synthèse parfaitement acceptable de la tradition du drapeau d’hermine et d’une figuration de la diversité bretonne. Dès 1937, il est reconnu par le gouvernement français à l’Exposition Internationale où il flotte sur l’Esplanade des Invalides à égalité avec les autres drapeaux du monde entier.
Ainsi, arboré à ses débuts par le seul Parti National Breton, il fut rapidement adopté par d’autres fractions militantes aussi différentes qu’Ar Falz et le Bleun-Brug. Il guidera les militants sur les lieux historiques et flottera au cours de leurs manifestations et congrès. Avant, pendant et après la seconde guerre mondiale des centaines de Bretons iront en prison, se battront et mourront pour ce drapeau parce qu’il symbolise leur personnalité d’homme libre dans la réalité toujours enchaînée.
Le Gwenn ha Du est donc aujourd’hui le drapeau national officiel de la nation bretonne.

On parle de la possibilité de réintégrer la capitale historique de la Bretagne, Nantes, en Bretagne, dont elle a été retirée en 1941 pour créer le département artificiel de la Loire-Atlantique.Cette réunification de la Grande-Bretagne est un jalon pour le nationalisme breton ?
Padrig Montauzier : Le décret signé sous le régime français du Maréchal Pétain retirant la Loire Atlantique du reste de la nation bretonne est en fait un vieux projet décidé par les radicaux socialistes français afin d’affaiblir la Bretagne de la réduire sur le plan européen car l’État français n’a jamais perdu en mémoire le fait séparatiste breton. Tous les gouvernements français ont fidèlement suivi et appliqué ce décret et cette horrible amputation de notre nation. Cette partition de notre Bretagne ne repose que sur des volontés politiques françaises dont les conséquences continuent de peser lourdement sur notre nation : économiquement, nous sommes affaiblis ; et outre le déni évident de démocratie, le temps poursuit l’érosion de notre identité et amenuise cette force qu’elle constitue, ce levier dont tous devrions tirer profit. La question de la réunification de la Bretagne est plus que jamais d’actualité, mais, nous nationalistes et indépendantistes bretons, restons opposés à la tenue d’un référendum pour de multiples raisons. La première est d’une évidence toute simple : l’État français, en organisant la partition, en amputant la nation bretonne d’une partie de son territoire national, a-t-il demandé son avis au peuple breton ? Non bien évidemment ! Alors pourquoi tant de gymnastique ? Pourquoi demander, je dirais quémander, un référendum ?
La voie du référendum est un véritable piège sur cette question fondamentale qu’est le retour de la Loire Atlantique en Bretagne. Un leurre, un appeau comme disent les chasseurs, un référendum bien pensé, cadenassé, ambigu quant à la définition, au périmètre ou encore à la formulation et aux libellés des questions posées… Un référendum sujet à toutes les manipulations de la part des ennemis jurés de la réunification et ils sont nombreux à être aux aguets, sans oublier des politiques en bout de course qui aujourd’hui reviennent sur le devant de la scène et qui dans le passé ont trahi.
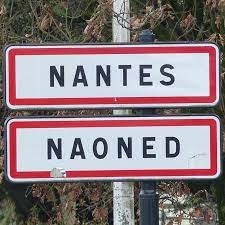 Il existe pourtant un mode législatif tout simple pour régler le problème: le décret. Il suffirait en effet d’un simple décret, répondant à celui du gouvernement français en 1941, pour réintégrer la Loire Atlantique en Bretagne, clore ainsi définitivement cette abomination et rendre enfin justice au peuple breton. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ! Alors faut-il que la réunification de la Bretagne pose problème et inquiète à ce point pour devoir choisir la voie la plus tortueuse pour résoudre une fois pour toute l’éternelle revendication du peuple breton qui, dans son immense majorité et principalement les habitants de la Loire Atlantique, demande la fin de cette partition ? Il est vrai qu’une Bretagne, son intégrité territoriale retrouvée, deviendrait une nation européenne conséquente, d’où l’origine de son amputation, sans sous-estimer les craintes toujours actuelles d’un État français, enfermé dans un colonialisme d’un autre âge, redoutant quelques velléités séparatistes de la part d’une Bretagne toujours réputée rebelle.
Il existe pourtant un mode législatif tout simple pour régler le problème: le décret. Il suffirait en effet d’un simple décret, répondant à celui du gouvernement français en 1941, pour réintégrer la Loire Atlantique en Bretagne, clore ainsi définitivement cette abomination et rendre enfin justice au peuple breton. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ! Alors faut-il que la réunification de la Bretagne pose problème et inquiète à ce point pour devoir choisir la voie la plus tortueuse pour résoudre une fois pour toute l’éternelle revendication du peuple breton qui, dans son immense majorité et principalement les habitants de la Loire Atlantique, demande la fin de cette partition ? Il est vrai qu’une Bretagne, son intégrité territoriale retrouvée, deviendrait une nation européenne conséquente, d’où l’origine de son amputation, sans sous-estimer les craintes toujours actuelles d’un État français, enfermé dans un colonialisme d’un autre âge, redoutant quelques velléités séparatistes de la part d’une Bretagne toujours réputée rebelle.
Refusons catégoriquement cette solution référendaire qui pourrait se retourner contre nous et signifier la fin de notre rêve d’unité.
NATIONALISME
Vous avez été condamné à 15 ans de prison pour votre participation à l'attentat du Château de Versailles (une attaque sans victimes qui ne cherchait que des dommages matériels et symboliques) en tant que membre du FLB / ARB, vous êtes donc l'une des plus grandes références du nationalisme Breton, pouvez-vous nous résumer brièvement votre vie de militant ?
Padrig Montauzier : Mon parcours politique pourrait être assez classique s’il n’y avait pas eu la période « clandestine », les condamnations puis les prisons françaises.
Comme je l’ai maintes fois mentionné, j’ai très jeune été baigné dans un environnement politique, un environnement familial puisque mon père était militant et dirigeant syndicaliste ouvrier. C’est ainsi que tout gamin j’ai participé à certaines grandes manifestations organisées par le parti communiste français et mes souvenirs restent encore, à ce jour, intacts, comme ces « premier mai » au parc du Thabor à Rennes.

La suite est logique, la route est toute tracée. Adhésion aux Jeunesses communistes quelques années avant les fameux évènements de mai 68 et c’est à partir de cette date que tout va basculer. Un mouvement clandestin FLB (Front de Libération de la Bretagne) se manifeste bruyamment en Bretagne en faisant exploser des bâtiments administratifs symboles de la présence française en Bretagne. Une revendication claire : l’indépendance de la Bretagne… Évidemment ce n’était pas du goût d’un PCF jacobin et ennemi juré de tout ce qui pouvait être assimilé au mouvement breton. Vient également s’ajouter à cette première dissension, le mouvement de révolte de mai 68 et le regard d’un jeune lycéen de 18 ans, un regard en totale opposition avec les positions communistes (PCF) et celles de la centrale ouvrière affiliée à ce parti.
C’est la rupture totale et mon intérêt soudain pour tout ce qui concerne la Bretagne et le mouvement breton, tant culturel que politique. Un premier déclic : apparition à la télévision régionale d’un homme s’exprimant en langue bretonne ! Cet homme, vous l’avez reconnu, c’était Charlez ar Gall. Seconde chose qui déclenche mon intérêt pour la cause bretonne c’est une lecture de l’Histoire de la Bretagne de l’abbé Poisson et là l’affaire était conclue. S’ensuivent les lectures de nombreux journaux politiques de l’époque dont l’Avenir de la Bretagne dirigée par Yann Fouéré, et le Peuple breton l’organe de l’UDB. Le choix a été rapide, et l’homme de gauche que j’étais encore resté, opte pour les idées exprimées dans un journal classé « à droite », le journal de Yann Fouéré et à cette époque organe de SAV (Strollad Ar Vro, parti de la patrie en français.
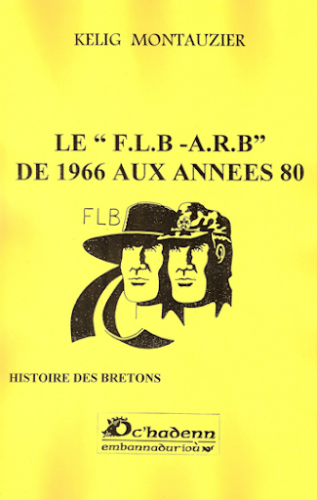 Début des années 70, adhésion au parti SAV et quelques temps plus tard je prends la fonction de secrétaire fédéral pour le pays de Rennes.
Début des années 70, adhésion au parti SAV et quelques temps plus tard je prends la fonction de secrétaire fédéral pour le pays de Rennes.
Entre temps les attentats du FLB (Front de libération de la Bretagne) s’intensifient, ainsi que les arrestations, les condamnations… L’État français, fidèle à lui-même, reste totalement sourd malgré la multiplication des « nuits bleues » et les scores très honorables du mouvement politique breton légal aux diverses élections.
Alors encore une suite logique… Pourquoi poursuivre dans la voie légale qui semble être une impasse ? Quelques mois plus tard le pas est franchi. C’est mon engagement dans le mouvement clandestin. Responsable de Kevrennoù sur plusieurs départements, membre du Kuzul Meur (Grand conseil), attentats en série... puis arrestation et jugement devant une juridiction spéciale française : la Cour de Sûreté de l’État. Une première condamnation à 15 années de réclusion criminelle, puis quelques mois plus tard, seconde condamnation (pour une trentaine d’attentats) à 15 autres années d’emprisonnement dans les geôles françaises. A noter que lors du premier procès, j’ai refusé d’y participer au motif que je ne reconnaissais pas cette juridiction française et demandais à être jugé en Bretagne par un juridiction bretonne. Dans le box des accusés, je me suis limité à lire une longue déclaration de plusieurs heures après 20 jours de grève de la faim, et demandé à mes avocats de se retirer afin de laisser, entre elle, la justice française délibérée en son âme et conscience ! (Petit rappel, la peine de mort avait été envisagée).
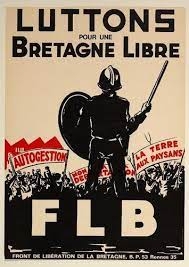 1981, élection de Mitterrand, amnistie… et 3 ans et demi passés dans les cachots du pays qui nous occupe toujours. A peine libéré, création avec Yann Fouéré et une poignée de militants nationalistes du POBL (Parti pour l’Organisation de la Bretagne Libre). A l’issue d’une première assemblée générale je suis nommé secrétaire national, puis quelques années plus tard je deviens un des présidents jusqu’à la création d’ADSAV (la relève ou la renaissance) en français, parti de la droite nationaliste bretonne. A l’initiative de ce nouveau parti, j’en prends la direction pendant de nombreuses avant de laisser la place à une équipe plus jeune et me consacrer uniquement à la revue War Raok/La voix de la nation bretonne qu’il faut impérativement moderniser et développer… un outil indispensable pour faire avancer, voire triompher, la cause indépendantiste bretonne.
1981, élection de Mitterrand, amnistie… et 3 ans et demi passés dans les cachots du pays qui nous occupe toujours. A peine libéré, création avec Yann Fouéré et une poignée de militants nationalistes du POBL (Parti pour l’Organisation de la Bretagne Libre). A l’issue d’une première assemblée générale je suis nommé secrétaire national, puis quelques années plus tard je deviens un des présidents jusqu’à la création d’ADSAV (la relève ou la renaissance) en français, parti de la droite nationaliste bretonne. A l’initiative de ce nouveau parti, j’en prends la direction pendant de nombreuses avant de laisser la place à une équipe plus jeune et me consacrer uniquement à la revue War Raok/La voix de la nation bretonne qu’il faut impérativement moderniser et développer… un outil indispensable pour faire avancer, voire triompher, la cause indépendantiste bretonne.
La Première Guerre mondiale du fait de son impact démographique et de son acculturation française, après la Seconde on fut considérée « tout le breton » comme un soupçon de «collaborationnisme», comment ces deux conflits affectèrent-ils réellement la Bretagne ?
Padrig Montauzier: La première guerre mondiale a été une véritable catastrophe pour la Bretagne. 240.000 Bretons sont morts dans une guerre où la Bretagne n’était en rien concernée, mais cette guerre correspond surtout à la fin d’un mode de vie traditionnelle, à la régression de la langue bretonne… et à la montée d’un fanatisme républicain français culpabilisant les Bretons d’appartenir à un peuple fier et distinct.
La seconde guerre mondiale a été également un conflit qui a affecté durement notre patrie. Toutefois il faut noter que si durant le premier conflit le mouvement breton était peu existant sur le plan politique, il n’en est pas de même lors de cette seconde guerre mondiale. L’EMSAV est organisé, relativement influent avec plusieurs partis politiques mais également bien représenté dans le domaine culturel. On conteste ouvertement la présence française en Bretagne, le journal Breiz Atao, le Parti National Breton ouvrent la voie et parlent d’indépendance… le groupe clandestin Gwenn ha Du fait parler la poudre, le journal La Bretagne, plus modéré, demande un statut d’autonomie… Il y a donc une véritable « contestation » nationaliste bretonne et l’État français en alerte met en route son appareil répressif. Premières arrestations de leaders politiques, premiers emprisonnements.
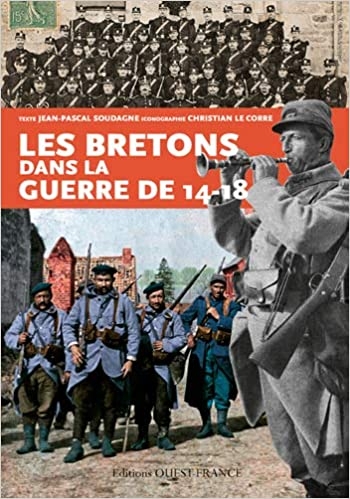 Je vous donne deux citations de chefs et militants nationalistes bretons à cette période :
Je vous donne deux citations de chefs et militants nationalistes bretons à cette période :
« Quelques centaines de Bretons résolus peuvent, à l’occasion du prochain confit, faire de la Bretagne une seconde Irlande ». Frañsez Debauvais.
Ou encore :
« Dans un délai prévisible il n’y aura plus de France, nous devons être sur les rangs pour prendre notre part des dépouilles de la bête ». Célestin Lainé.
Pendant ces années du conflit, deux camps s’affrontent : les Bretons qui se rangent du côté de la France en résistance contre l’occupation allemande, et les nationalistes bretons qui ne veulent pas entrer dans ce jeu guerrier où la Bretagne n’est nullement en conflit avec l’Allemagne. On retrouve cette même situation en Irlande avec le mouvement républicain et notamment avec l’attitude de l’IRA. Profitant de cette situation particulière en Bretagne et sous l’influence de plusieurs responsables allemands très celtisants, le IIIème Reich accorde quelques largeurs aux milieux nationalistes sur le plan culturel, notamment la diffusion de la langue bretonne sur les ondes. Quant à son engagement, en cas de victoire, d’accorder à la Bretagne une réelle indépendance, cela reste assez floue et pour ce qui me concerne reste au stade d’une vague promesse.
Ce qu’il faut surtout retenir de ce second conflit et de son incidence en Bretagne, c’est le comportement de ceux, qui au nom d’une résistance à l’occupant allemand, commettent les pires crimes, les plus odieux assassinats de militants bretons. C’est ainsi, après le lâche assassinat de l’abbé Yann-Vari Perrot par les communistes, que des militants nationalistes créent la formation Perrot (Bezen Perrot) et s’engagent, en tant que Bretons, au côté des forces allemandes et traquent alors les réseaux de résistants afin de préserver la vie des militants bretons. Ces hommes, ne se reconnaissant pas français, n’ont donc pas collaboré, c’est une différence avec les millions de Français qui, eux, ont joué la carte allemande contre leur propre pays.
Enfin, après la guerre, la France gaulliste et communiste a traduit et fait condamner un nombre considérable de militants bretons tant politiques que culturels, et malheureusement certains ont été passés par les armes. Rappelons, que lorsqu’ils étaient condamnés à mort face au peloton d’exécution, ils ne criaient pas «Heil Hitler» mais «Breizh Atao». Et si l’histoire avait été autre ? Nos militants seraient aujourd’hui des héros, des rues, des places porteraient leurs noms…
En tant que nationaliste breton et indépendantiste, je me suis toujours refusé à condamner ces camarades. J’ai le plus grand mépris pour ceux qui le font et qui sont tous, vous devez vous en douter marxistes et communistes, éternels ennemis d’une Bretagne libre.
La France n’est pas à une honte près... Cette période a laissé des traces, et malgré les tombereaux de mensonges déversés constamment par la bonne presse régionale, entretenant cet esprit de vengeance, le mouvement breton a néanmoins su relever la tête et reprendre le combat contre cet État français englué dans un colonialisme et un impérialisme d’un autre âge.
 Olier Mordrel est-il la référence maximale de la pensée nationaliste bretonne ?
Olier Mordrel est-il la référence maximale de la pensée nationaliste bretonne ?
Padrig Montauzier : Même si nous ne partageons pas toutes les positions d’Olier Mordrel, il nous faut reconnaître qu’il compte parmi le grand penseur et acteur du nationalisme breton. Ce grand homme a eu cette chance d’être présent et de militer pendant le second conflit mondial, puis après un exil forcé, de continuer à militer et à promouvoir les idées nationalistes bretonnes. Un autre grand homme, que j’ai bien connu et milité avec lui de très nombreuses années, c’est Yann Fouéré. Autre personnage, bien différent d’Olier Mordrel, pas tant sur les idées, mais sur l’approche et sur la façon de les présenter et de les promouvoir. N’oublions pas que Yann Fouéré fut un ancien haut fonctionnaire, ancien sous-Préfet de Morlaix dans le Finistère et donc habitué à une certaine diplomatie… ce que fait de lui un redoutable homme politique. En fait, ces deux hommes se complètent admirablement. Maintenant, d’autres ont écrit, peu il est vrai, mais de grande valeur également. Un grand regret, suite à la mort prématurée, du fait d’une longue maladie, pendant la seconde guerre mondiale de celui que je considère comme le grand artisan du mouvement nationaliste breton et fidèle équipier d’Olier Mordrel, je veux parler de Frañsez Debauvais. Très peu d’écrits malheureusement de sa part et je pense que s’il avait survécu nous aurions eu très certainement une autre version, ou plutôt, une approche différente du nationalisme breton qui aurait été un véritable outil, une véritable arme, pour notre combat de libération nationale.
Malheureusement, dans les années 60-70, le nationalisme breton a été pénétré par le gauchisme, des magazines comme War Raok, que vous dirigez, ou des partis comme ADSAV, dont vous êtes co-fondateur, sont-ils la possibilité de retrouver le véritable sens identitaire du nationalisme breton ?
Padrig Montauzier : Les années 60-70 sont en fait les années du fameux Mai 68 avec ses dérives qui ont gangrené non seulement les milieux politiques mais également toute la société en Bretagne. Le mouvement breton n’a pas échappé au virus gauchiste et a encore, aujourd’hui, bien du mal à en guérir. Cette véritable maladie mentale nous a fait perdre un nombre considérable d’années dans notre combat pour l’émancipation de notre peuple. Notre objectif de militant breton nationaliste est de permettre à la Bretagne de renaître et ce simple objectif dépasse le clivage gauche/droite, clivage que nous revivrons lorsque nous aurons recouvré notre liberté ! Aujourd’hui notre peuple breton est menacé dans son existence même. L’Europe est en proie à une grave crise d’identité, l’image même des peuples est brouillée, le mot nation ne dit plus rien et son sens premier s’efface. Le sentiment d’appartenance n’existe plus que dans la réalité des nations charnelles et dans les aires de vieille culture… Aujourd’hui, la nation s’appelle Bretagne, Flandre, Écosse, Catalogne, Corse, Pays de Galles, Euskadi…

C’est l’orientation choisie par la revue War Raok, orientation qui refuse tout sectarisme idéologique véritable frein dans notre lutte de libération. Le peuple breton a besoin de propositions qui s’inscrivent dans une démarche de renouveau, de propositions porteuses d’idées fortes mais simples qui permettront demain à notre nation de prendre un nouvel essor dans une Europe nouvelle. Comme dit précédemment, on doit s’écarter et se dégager de tout dogme idéologique, de tout impératif de conformisme et de bienséance politiques qui l’emportent sur les intérêts du peuple breton. Notre démarche résulte d’une prise de conscience nationaliste, de décisions qui nous sont propres car nous ne laisserons jamais à d’autres le soin de nous définir. Nous voulons tout simplement faire entrer notre peuple dans l’histoire en lui rendant la possibilité d’agir pour lui-même et d’être l’acteur de son devenir. Ce qui caractérise notre nationalisme, ce qui nous caractérise c’est que nous envisageons notre lutte pour l’indépendance de la Bretagne comme un appel à certaines attitudes morales, sociales et politiques en rupture totale avec le système colonial qui nous opprime.
IMMIGRATION
La Bretagne est en train de devenir un lieu d'arrivée massive d'immigrants ces dernières années, avec l'augmentation conséquente de l'insécurité, pensez-vous que le gouvernement parisien utilise consciemment l'immigration pour « dé-bretoniser » la Bretagne ? Que pensez-vous de ces psycho-nationalistes bretons en faveur du «papal pour tous» ?
Padrig Montauzier : Excellente question qui ne s’applique malheureusement pas uniquement à la Bretagne. L’État français utilise bien sûr ce phénomène migratoire, avec le déplacement de ces populations étrangères et extra-européennes, et déstabilise ainsi l’homogénéité ethnique des peuples. Il le fait régulièrement en Bretagne et dans certaines grandes villes bretonnes aujourd’hui on ne sait plus très bien dans quelle partie du monde nous nous trouvons ! Autrefois on déplaçait les populations (régimes communistes), aujourd’hui la façon de faire est différente, plus anodine, mais toute aussi efficace. Mais comme vous le dites dans votre question, certains militants « bretons » acceptent ce procédé mortifère qui menace l’existence même du peuple breton, peuple dont ils se réfèrent et prétendent défendre l’identité !

De tout temps les déplacements de population ont marqué l’histoire, mais accomplis à l’intérieur d’un vaste ensemble ethno-culturel relativement homogène, ils n’ont jamais affecté la cohésion, ni mis en péril les caractères communs des peuples. La présence de plus en plus massive, en Europe, de populations immigrées extra-européennes est en fait le produit d’un certain système idéologique négateur des spécificités. Il faut également remarquer qu’une immigration massive, comme nous le constatons actuellement, devient obligatoirement une colonisation !
Il nous appartient donc, nous défenseurs des peuples, de refuser ce qui devient une invasion démographique. Les problèmes liés à cette immigration extra-européenne en Europe appellent une solution idéologique favorable à la cause des peuples. Les irresponsables qui prônent la fusion des peuples par idéologie mondialiste font le jeu des puissances d’argent et de la haute finance cosmopolite. Leur ardeur humanitaire masque en fait leurs véritables motivations.
Au même titre que nous, nationalistes et indépendantistes bretons, refusons l’exode des Bretons, nous refusons l’exode immigrationniste dans le reste du monde.
EUROPE DES PEUPLES
Yann Fouéré, un nationaliste breton, a écrit le célèbre livre Pour l'Europe des cent drapeaux qui proposait une Europe fédérale basée sur les patries charnelles.Quelle est votre proposition pour la construction de cette "Europe aux cent drapeaux" ?
Padrig Montauzier : Tout d’abord je voudrais préciser que l’on peut difficilement séparer le combat qui se mène aujourd’hui en Bretagne (ou en Catalogne, en Flandre, en Corse, au Pays Basque, en Écosse...) et le destin de l’Europe. L’Europe que nous voulons bâtir est l’Europe des peuples, l’Europe aux cent drapeaux, aux cent nations... l’Europe ethnique. Dois-je rappeler que la Bretagne est une des plus anciennes nations européennes. L’Europe fait donc partie de notre combat et d’un bout à l’autre de cette Europe des peuples luttent pour leur émancipation et leur libération nationale. De l’un à l’autre, les buts et les moyens varient, mais l’impulsion initiale est la même.
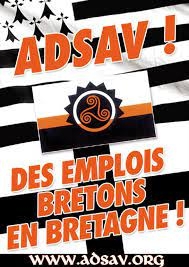 Cette lutte des peuples, concerne ou concernera tous les peuples européens. Mais comme je le précisais précédemment, cette Europe devra se construire sur des bases ethniques, des peuples-patries… Une Europe européenne. Dois-je vous énumérer les dangers actuels qui risquent de conduire l’Europe à sa perte : l’immigration extra-européenne, l’islam religion guerrière, la menace de certains pays émergents… etc. La situation est aujourd’hui critique car nous sommes plus qu’hier devant un grave danger d’assimilation. Je suis un défenseur et du côté des peuples de culture contre les systèmes massifiants, les complices et les agents du déracinement. A nous d’organiser la résistance, peuples européens. A nous Bretons de participer activement à la construction de cette Europe des peuples qui est en marche. Ce qu’il faut à cette Europe c’est d’abord une vision, un idéal, un souffle nouveau. Cette Europe nouvelle doit bien sûr échapper à toutes tentations impérialistes, centralistes, à tout système unitaire. Elle sera une fédération dont chaque nation sera membre. Ces membres, eux-mêmes États, se gouvernant, s’administrant en toute souveraineté selon leurs propres lois. La Bretagne adhérera librement à ce pacte fédéral et ne déléguera uniquement que ce qu’elle ne pourra gérer seule. A tout moment cependant, elle sera libre de suspendre telle compétence à l’Europe, voire, si la situation l’exige, de se retirer totalement du pacte.
Cette lutte des peuples, concerne ou concernera tous les peuples européens. Mais comme je le précisais précédemment, cette Europe devra se construire sur des bases ethniques, des peuples-patries… Une Europe européenne. Dois-je vous énumérer les dangers actuels qui risquent de conduire l’Europe à sa perte : l’immigration extra-européenne, l’islam religion guerrière, la menace de certains pays émergents… etc. La situation est aujourd’hui critique car nous sommes plus qu’hier devant un grave danger d’assimilation. Je suis un défenseur et du côté des peuples de culture contre les systèmes massifiants, les complices et les agents du déracinement. A nous d’organiser la résistance, peuples européens. A nous Bretons de participer activement à la construction de cette Europe des peuples qui est en marche. Ce qu’il faut à cette Europe c’est d’abord une vision, un idéal, un souffle nouveau. Cette Europe nouvelle doit bien sûr échapper à toutes tentations impérialistes, centralistes, à tout système unitaire. Elle sera une fédération dont chaque nation sera membre. Ces membres, eux-mêmes États, se gouvernant, s’administrant en toute souveraineté selon leurs propres lois. La Bretagne adhérera librement à ce pacte fédéral et ne déléguera uniquement que ce qu’elle ne pourra gérer seule. A tout moment cependant, elle sera libre de suspendre telle compétence à l’Europe, voire, si la situation l’exige, de se retirer totalement du pacte.
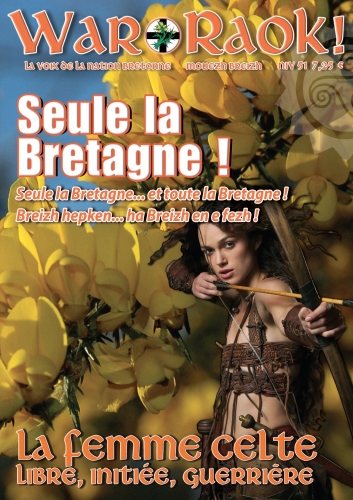
Enfin, quels sont vos projets culturels et politiques actuels ?
Padrig Montauzier : Actuellement je projet qui me tient à cœur c’est de faire en sorte qu’une revue comme War Raok perdure et devienne un véritable outil pour la cause qui m’anime et qui anime tous les défenseurs des libertés bretonnes. La revue que je dirige doit devenir une référence dans cette résistance de notre peuple face à un État français colonialiste et impérialiste. War Raok, avec plus de 20 années d’existence, œuvre concrètement pour une réelle renaissance bretonne, refuse par les articles traités que le peuple breton se laisse contaminer par des émotions étrangères, émotions préfabriquées, afin de mieux se réapproprier ses propres émotions… celles liées à sa terre, à sa culture, à son histoire, à sa langue, à sa religion et à ses traditions.
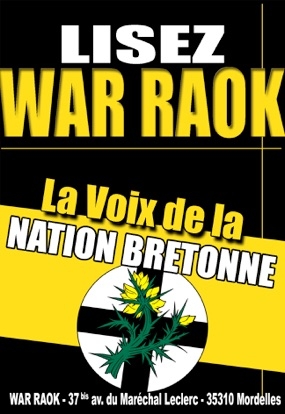 Il faut que War Raok continue à diffuser les idées généreuses de liberté, sans complaisance mais avec objectivité et rigueur. Si certains ont peur de leur ombre, se passent eux-mêmes la camisole intellectuelle, nous préférons à War Raok agir pour une véritable renaissance bretonne en évitant surtout de ne pas tomber dans le piège d’une revue contestataire, irresponsable ou extrémiste.
Il faut que War Raok continue à diffuser les idées généreuses de liberté, sans complaisance mais avec objectivité et rigueur. Si certains ont peur de leur ombre, se passent eux-mêmes la camisole intellectuelle, nous préférons à War Raok agir pour une véritable renaissance bretonne en évitant surtout de ne pas tomber dans le piège d’une revue contestataire, irresponsable ou extrémiste.
Voilà mon cher Enric.
A galon vat Enric, Bennozh Doue deoc’h kamaladed, ha bevet dieubidigezh Vreizh ha Bro Gatalonia.
08:29 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Entretiens, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, padrig montauzier, bretagne, nationalisme breton, pays celtiques, celtisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 mars 2021
Parution du numéro 60 de la revue War Raok
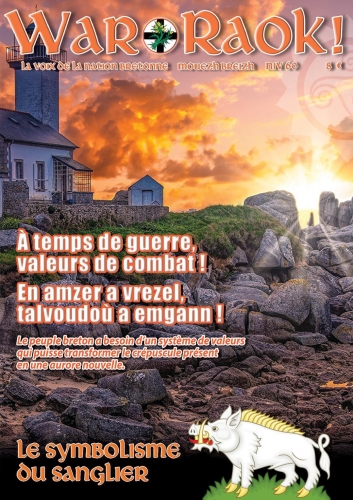
Parution du numéro 60 de la revue War Raok
EDITORIAL
Les voies du salut
Toute nation qui ne s’administre pas elle-même connaît inéluctablement une rapide décadence.
Il est vain pour un peuple de lutter si l’on a pas d’abord pris conscience des données fondamentales qui déterminent son aliénation. Nous voulons donner au peuple breton une forme qui empêche sa disparition et permettre son retour à la dynamique de l’histoire. Notre volonté d’émancipation n’est pas un enfermement : elle s’ouvre sur la reconquête d’un espace global, exigence de la géopolitique la plus réaliste. Gardons-nous d’un exclusivisme ethnique mal compris. La légitime préservation de nos caractères ethniques ne doit pas être un repli sur soi-même, même si nous pouvons être séduits par l’expression : « patriotisme ethnique » qui fixe des critères généraux et permet de parler de communauté nationale.
Dans l’Europe actuelle, Europe en pleine mutation, ce sont les nations sans État, les peuples aux droits bafoués, qui sont une nouvelle fois au premier rang des revendications. La rumeur vient d’Écosse, de Catalogne, du Pays Basque, de Flandre, de Corse ou de Bretagne, comme naguère des Pays Baltes ou d’Irlande… Partout renaissent des tensions légitimes qu’on aurait cru éteintes, et la marée des peuples opprimés bat aux portes du vieux continent.
La Bretagne depuis le traité d’union en 1532 (en fait il ne s’agit nullement d’un traité mais d’un simple acte interne à la France n’ayant aucun effet juridique en Bretagne), et plus encore depuis l’annexion de 1790, en donne un frappant exemple. De par sa position excentrée, la Bretagne n’a jamais offert pour l’État français qui en dispose aujourd’hui, que l’intérêt que l’on accorde à une zone stratégique ou à une colonie.
La nouvelle république française ne s’est jamais préoccupée de favoriser le développement industriel et commercial de ce petit peuple dont elle a rayé le nom de la carte et dont elle affecte d’ignorer l’existence. Son organisation d’essence révolutionnaire, centraliste et unitaire lui interdit de tenir aucun compte des spécificités et des intérêts particuliers de la Bretagne et son statut d’autonomie est de fait aboli unilatéralement par la force et sans le consentement et la participation des Bretons. C’est ainsi qu’un pays jadis des plus riches, à l’époque de sa souveraineté, devient une nation léthargique restée en marge de tout développement et progrès, qu’ont pu atteindre, parce ce que restées maîtresses de leurs destinées, d’autres petites nations comme la Norvège, le Danemark ou encore l’Islande.
Nous sommes en 2021. Les choses ont-elles évolué ? Je vous répondrai, oui et non.
Non du fait de la France qui poursuit inexorablement sa politique coloniale, qui persiste à enfermer le peuple breton dans une caserne administrative, dans une camisole centraliste, impérialiste et continue à vivre à l’heure napoléonienne.
Oui, parce que les Bretons se sont tournés, non vers le passé, mais vers l’avenir et, depuis maintenant de nombreuses années, ils ont su relever maints défis. La Bretagne peut ainsi s’honorer d’être devenue très compétitive dans de nombreux secteurs d’activités, tant au niveau européen qu’international.
La jeune Bretagne a renoué avec ses racines et est à ce jour fière de son identité. Elle refuse la politique d’assimilation et d’uniformisation de l’État français.
La Jeune Bretagne relève la tête et nombreux sont ceux qui rêvent de République bretonne ! La guérison serait-elle au bout du chemin ?
Voilà, succinctement énoncé, ce que nous, patriotes bretons, voulons, ce que notre peuple est en droit d’exiger pour sa prospérité matérielle, pour son épanouissement intellectuel et moral, au nom de la sagesse politique dont il a toujours fait preuve dans le passé, au cours de mille années d’indépendance et de trois cents ans d’autonomie.
A la France de dire si elle est disposée à donner satisfaction aux aspirations légitimes du peuple breton, ou si elle fait litière de ses beaux principes de liberté qu’elle-même continue à répandre dans le monde...
A la France de dire si nous devons encore avoir le moindre espoir ? La moindre confiance en ce pays qui nous a coûté trop de sang et de larmes.
Nos chers voisins sont-ils enfin disposés à s’incliner devant nos droits ou, si pour demeurer et rester Bretons, seul le divorce reste la solution ? Une chose est certaine, l’Europe des peuples est en marche. Les communautés ethniques relèvent fièrement la tête et amorcent un début de souveraineté.
Da c’hortoz donedigezh ur wir Republik vrezhon…
Padrig MONTAUZIER

SOMMAIRE N°60
Buhezegezh vreizh page 2
Editorial page 3 (Padrig Montauzier).
Buan ha Buan page 4
Politique :
Faut-il recommencer les Croisades ? Page 11 (Erwan Houardon).
Billet d’humeur :
Sommes-nous obligés de les croire ? Page 14 (Riec Cado).

Tradition :
Le symbolisme du sanglier page 16 (Gérard Thiemmonge).
Hent an Dazont :
Votre cahier de 4 pages en breton page 19 (Tepod Mab Kerlevenez hag An Deureugenn).
Tribune libre :
Pour une écologie cohérente et intégrale page 23 (Dominique Baettig).
Histoire de Bretagne :
Les Amazones de la Chouannerie page 25 (Youenn Caouissin).
Environnement :
Agriculture et écologie : cap vers la réconciliation ! Page 28 (Mael Le Cosquer).
Civilisation bretonne :
Le principe féminin, origine primordiale page 31 (Fulup Perc’hirin).

Nature :
Le héron cendré, le monsieur échasses de nos étangs page 35 (Youenn Caouissin).
Lip-e-bav :
Le gâteau nantais et gâteau à la peau de lait page 37 (Youenn ar C’heginer).
Keleier ar Vro :
Na stok ket ouzh ma c’hroaz page 38 (Meriadeg de Keranflec’h).
Bretagne sacrée :
Les Roches du Diable page 39 ( Per Manac’h).
00:15 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, war raok, bretagne, nationalisme breton, pays celtiques, peuples celtiques, celtes, celtisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 décembre 2020
WAR RAOK n°59
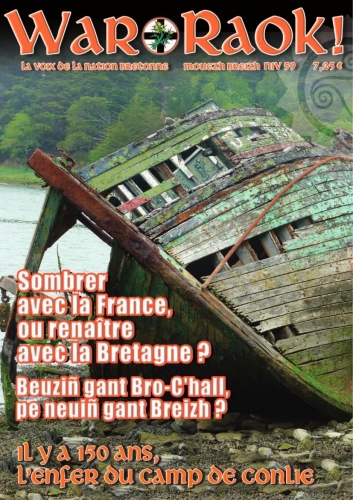
WAR RAOK n°59
Sommaire:
Buhezegezh vreizh page 2 (Michel Lugaid).
Editorial page 3 (Padrig Montauzier).
Buan ha Buan page 4 (Tepod Mab Kerlevenez, Meriadeg de Keranflec’h).
Politique
La barbarie n’épargne jamais rien... page 8 (Erwan Houardon).
Billet d’humeur
La République française : arme de destruction massive page 11 (Riec Cado).
Écologie
La protection de notre littoral page 14 (Mael Le Cosquer).
Tradition
Le corbeau dans les traditions indo-européennes page 17 (Alberto Lombardo).
Hent an Dazont
Votre cahier de 4 pages en breton page 19 (Donwal Genvenez).
Tribune libre
L’ineffable beauté de notre combat page 23 (Valérien Cantelmo).
Histoire de Bretagne
Il y a 150 ans, l’enfer du Camp de Conlie page 25 (Camille Le Mercier d’Erm).
Environnement
Entre spoliation et artificialisation des terres bretonnes page 28 (Erwan Houardon).
Civilisation bretonne
Rapports entre principes féminin et masculin page 31 (Fulup Perc’hirin).
Nature
“Courte queue”, le chat sauvage page 35 (Youenn Caouissin).
Lip-e-bav
Raie rôtie au lard page 37 (Youenn ar C’heginer).
Keleier ar Vro
Réunification de la Bretagne page 38 (Meriadeg de Keranflec’h).
Bretagne sacrée
Le Mont-Dol, un mont de légendes page 39 (Per Manac’h).

EDITORIAL
Le nationalisme : exaltation du sentiment national mais également volonté d’émancipation d’un peuple, son droit à disposer de lui-même
Dans un de mes anciens articles je ne boudais pas mon plaisir à mentionner cette petite phrase : « faisons lever une moisson d’espérance aux couleurs du nationalisme breton ».
Il n’est pas dans mon intention de donner ici un cours de philosophie politique, je n’en ai pas les compétences mais surtout j’ai toujours eu une autre préférence : l’action. Toutefois, la jeune génération de militants bretons a besoin de solides repères, de jalons afin de ne pas céder aux chants des sirènes et ainsi de ne pas déserter le terrain idéologique émasculé par des idéologies du déclin.
Comprendre le monde, réfléchir, élaborer des solutions requière de connaître le sens des mots. Le terme nationaliste, si décrié, si galvaudé, est pour nous Bretons un ingrédient nécessaire à la libération de notre peuple privé de ses droits nationaux.
Mais d’où vient cette opposition entre patriotisme et nationalisme ? Qui a intérêt à entretenir cet antagonisme qui naît en réalité des usages successifs qui ont été faits de ces termes tout au long de l’histoire ? Opposer patriotisme et nationalisme est un lieu commun du discours politique. Le patriotisme, notion méliorative et affective, serait l’amour de son pays, une conception ouverte de sa patrie, la volonté désintéressée de la servir et de la promouvoir. Le patriotisme serait ouvert et inclusif. A contrario, le nationalisme, notion péjorative, serait une doctrine agressive, un amour exalté de la patrie qui dégénérerait en impérialisme... Le nationalisme serait par définition fermé et exclusif.
Les oligarques qui œuvrent, depuis des dizaines d'années, à diaboliser le concept même de nationalisme, au motif spécieux que ceux qui se déclareraient nationalistes seraient prétendument des nostalgiques du fascisme ou du IIIème Reich, développent avec habileté un sophisme de culpabilité par association, technique fallacieuse qui consiste à tenter de décrédibiliser l'adversaire en prétendant qu'il serait semblable à quelqu'un, ou à quelque chose, de détestable sous le prétexte qu'il en partagerait une caractéristique. Il est remarquable que ces mêmes oligarques n'ont aucunement cherché à diaboliser de la même façon le concept de communisme.
« En situation de crise, la première chose à faire est de redonner aux mots leur véritable sens »
(Confucius)
Balayons d’un revers de main et jetons aux oubliettes la stupide et ridicule phrase imputée par erreur à un célèbre général français et dont l’auteur est en fait le romancier Romain Gary : « Le patriotisme c’est l’amour des siens…. le nationalisme, c’est la haine des autres ». Un autre imbécile s’était quant à lui autorisé à déclarer devant le parlement européen : « Le nationalisme, c’est la guerre ». (François Mitterrand 17 janvier 1995).
Pour nous militants bretons, le nationalisme, c’est avant tout la volonté du peuple breton à disposer d’un État souverain. La souveraineté étant de fait consubstantielle à l’État, être souverain signifie donc être maître chez soi, mais être maître chez soi nécessite d’avoir un chez soi, cela semblerait être une lapalissade mais il est, pour nous Bretons, impératif de le souligner.
Notre nationalisme, c'est la volonté politique de pouvoir vivre dans sa patrie, autrement dit dans sa nation, d'y être maître, ce qui implique de ne pas être sous la tutelle d’un pouvoir politique dirigé par un État étranger, en l’occurrence l’État français, sans sous-estimer la politique néfaste de l’Union européenne, véritable courroie de transmission des nouvelles oligarchies.
Les Bretons, depuis la perte de l’indépendance de leur patrie, cherchent à être les sujets, les maîtres de leur destin. Ils choisissent de mettre en avant telle ou telle facette de leur identité, cette identité bretonne forte et ancrée, pourtant persécutée et stigmatisée, qui a dû répondre à de si nombreuses attaques de la France ne désirant que l’effacer, la nier, et qui pourtant revient toujours comme le mouvement incessant des vagues s’étalant sur les plages bretonnes. Et étant donné qu'une identité forte est une condition nécessaire à la souveraineté d'une nation, le nationalisme s’impose naturellement comme la défense simultanée de la souveraineté et de l'identité. Ainsi, pour nous Bretons, patriotisme et nationalisme doivent inévitablement marcher main dans la main.
Je vous souhaite à tous un joyeux Noël et une bonne année 2021.
D’an holl ac’hanoc’h e hetan un Nedeleg laouen hag ur Bloavezh mat 2021.
Padrig MONTAUZIER
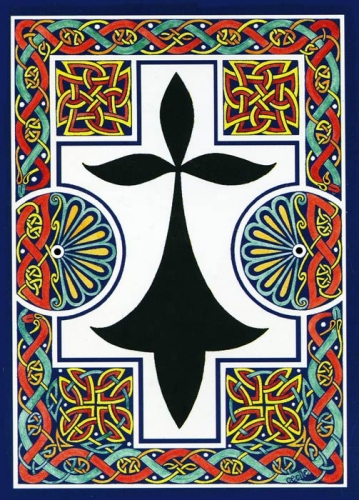
00:32 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, war raok, bretagne, nationalisme breton, padraig montauzier, celtisme, pays celtiques, terres d'europe, armorique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 26 août 2020
War Raok n° 58
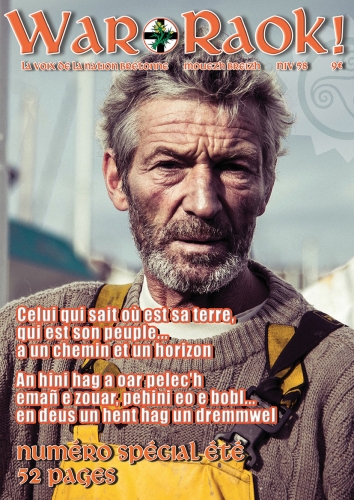
EDITORIAL:
La victoire de l’audace !
« La passion doit céder parfois à la raison, lorsque l’on veut réellement atteindre le but que l’on s’est assigné... ».
Cela ne signifie nullement l’abandon de nos idées, de nos convictions, mais la situation en Bretagne est arrivée à un tel degré qu’il nous faut envisager une stratégie nouvelle, une stratégie d’alliance et d’union avec l’ensemble du mouvement national breton.
Certains, idéologues sectaires, considèrent que l’union nationale est un classique de la rhétorique politique, une expression magique qui, à chaque crise grave, revient comme une arlésienne. C’est, chaque fois, la même musique... Ils font fausse route et négligent que dans le cadre de la Bretagne il ne s’agit pas d’une simple crise, il s’agit d’une lutte de libération nationale, d’une lutte pour l’émancipation d’un peuple… Cette notion unanimiste consiste à considérer que, pour un temps, ce qui nous rassemble est au-dessus de ce qui nous divise et doit requérir deux principales conditions : qu’il existe un ennemi bien identifié et qu’elle s’inscrive dans un horizon temporel bien défini.
Alors oui cette union est plus nécessaire que jamais, mais il n’y a d’union réellement féconde que sur des principes et fondements certains. Il n’y a d’union digne d’être recherchée et voulue que celle qui ne se fait pas pour un jour, mais pour toujours. De même, il ne peut y avoir unité sans action ou alors elle n’est qu’une banale farce ou duperie et nous n’avons aucun goût pour participer à un rassemblement de pure forme.
Les enthousiasmes les plus ardents, les meilleures volontés ont beau s’unir, s’il ne s’agit que de doctrines, d’idéologies, de plans douteux… les plus belles flammes s’éteignent et ne laissent subsister qu’un peu de cendre froide. La plupart des militants nationalistes bretons sont animés d’un enthousiasme à la fois passionné, exalté et d’une volonté sincère de réaliser le bonheur du peuple breton. La plupart de ces hommes et femmes sont également des militants de valeur et tous ou au moins presque tous ont de toute évidence l’esprit et le cœur frappés comme d’une espèce d’illumination par le terrible sort fait au peuple breton par une république française s’arc-boutant sur un colonialisme d’un autre âge.
L’union nationale, le rassemblement de bonnes volontés, qui ne sont pas seulement valables par ce qu’ils sont, mais aussi par ce qu’ils représentent de possibilités pour la nation bretonne, doivent être une chose vraie. Une union nationale, qui associerait pour un temps les bonnes volontés et laisserait de côté les intérêts partisans au profit de l’intérêt général, doit être une véritable arme que nous devons brandir plus hardiment que jamais. La tâche qui reste à accomplir n’est pas insurmontable. Les militants bretons ont assez de caractère, de détermination en eux-mêmes et s’il leur en manquait, ils les puiseraient dans le souvenir de leurs héros, pour ainsi faire face aux dangers des nombreux ennemis de l’émancipation de notre peuple et aux bassesses mesquines de l’État français.
Pobl vreizh n’eo ket marv koulskoude c’hoazh, met war-nes mervel emañ*
La mise sur pied d’une authentique union nationale doit, pour tous les défenseurs des libertés bretonnes, être salutaire et c’est pourquoi, plus résolu que jamais à l’union dans le combat et pour une action précise, tout patriote breton doit prendre conscience que la libération de la Bretagne dépend du succès d’une telle expérience. Nos amis Corses ont bien compris la nécessité de s’unir malgré leurs divisions.
Cette tâche, ce véritable espoir pour la Bretagne et pour son peuple, doit être la plus belle mais aussi la plus efficace de toutes celles qui nous sont imparties. Nous devons la mener à bien et assurer sa pleine réussite. De sa réalisation dépend pour la plus grande part l’avenir de la nation bretonne et du peuple breton.
Peut-être est-il temps de changer d’état d’esprit ?
Padrig MONTAUZIER
* Le peuple breton n’est pas encore mort, mais il est sur le point de mourir.
Sommaire War Raok n° 58
Buhezegezh vreizh page 2
Editorial page 3
Buan ha Buan page 4
Terre d’Europe
Les coutumes des peuples de Russie page 12
Politique
Covid-19, muezzin et Le Camp des Saints page 14
Histoire de Celtie
La bataille de Culloden page 18
Billet d’humeur
Et si l’on arrêtait de stigmatiser les extraterrestres ! Page 20
Tribune libre
La guerre sociale qui vient page 22
Identité bretonne
Bretagne : la vie des paysans jadis page 24
Hent an Dazont
Votre cahier de 4 pages en breton page 25
Europe
Pourquoi nous combattons page 33
Écologie
L’écologie vue de droite page 35
Géopolitique
La Russie de Poutine page 37
Histoire de Bretagne
Cadoudal : l’attentat de la rue Saint-Nicaise page 39
Environnement
Un environnement sain : un atout majeur pour la Bretagne page 43
Civilisation bretonne
Rapports entre principes féminin et masculin page 45
Nature
Les pics, des percussionnistes agréables à entendre page 47
Lip-e-bav
Potée bretonne version quimperoise page 49
Keleier ar Vro
Pardons bretons et troménies, patrimoine culturel page 50
Bretagne sacrée
Le château de Trécesson page 51
10:13 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, revue, war raok, pays celtiques, celtisme, nationalisme breton, terroirs, terres d'europe, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 25 avril 2020
War Raok fête ses 20 ans !
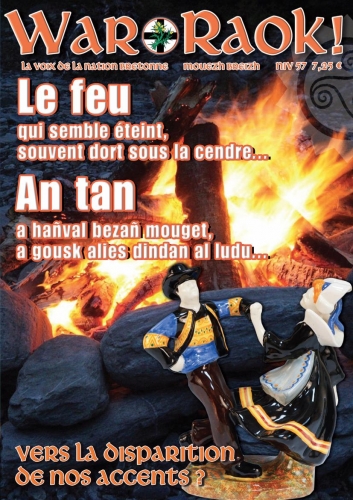
EDITORIAL
Ugentvet bloavezh, deiz ha bloaz laouen War Raok !
War Raok fête ses 20 ans !
Dans un paysage médiatique contemporain largement dominé par un journalisme de révérence, mou et fade, discipliné, docile et bienveillant, il est toujours utile de rappeler qu’un autre rapport à la presse existe. Si cette dernière est très massivement diffusée et subventionnée, une réappropriation de la parole s’impose et ne doit pas rester uniquement le fait de quelques locomotives isolées.
De plus en plus des voix s’élèvent pour dénoncer les dérives et les perversions de cette presse gangrenée, ces médias et leur collusion, souvent trouble, avec le pouvoir en place, sans oublier la main mise des puissances d’argent, ou encore la connivence de nombreux journalistes avec les milieux politiques. De toute évidence ces journalistes ne sont pas prêts à faire leur mue ! La presse mainstream à l’impartialité plus que douteuse, aux manipulations multiples et constantes, manipulations proportionnelles à l’importance des enjeux politiques, aux faits inexacts, aux analyses sans grande pertinence… ne remplit plus sa mission d’intérêt général. Elle peut toutefois exprimer sa subjectivité, mais celle-ci ne doit en aucun cas prendre le pas sur la justesse de l’information ni s’exercer au détriment des lecteurs.
Sans langue de bois… ni de velours !
A l’heure où les convergences économiques des titres se traduisent en convergence idéologique, le fameux positionnement consensuel du plus petit dénominateur commun permettant de ne pas heurter la sensibilité politique des lecteurs, War Raok fait, sans aucun doute, figure d’exception. Dans un paysage médiatique en voie d’unification accélérée, nous nous permettons le luxe d’une voix dissonante, dissidente et d’une liberté de ton devenues rares. Depuis 20 ans, la revue War Raok s’efforce de développer une communication différente de celle produite par les médias institutionnels en Bretagne, différente du fait d’analyses spécifiques sciemment occultées par les médias aux ordres, qui enrichissent nos réflexions sur de très nombreuses thématiques.
Aujourd’hui, il serait absurde d’estimer que les médias ne jouent aucun rôle dans la formation des opinions. Dès lors que les informations sont orientées, que les idées ne sont plus diffusées que de manière confidentielle, elles deviennent naturellement moins légitimes. War Raok n’est pas uniquement une revue d’opposition même si elle dénonce l’attitude scandaleusement partisane des médias officiels. Elle est principalement porteuse d'un projet pour la Bretagne, d'une finalité sociale, politique, culturelle et économique. Soucieuse d’informer dans les meilleures conditions ses lecteurs, War Raok a pour essentiel but de permettre aux Bretons, à ce petit peuple celte, de sortir de l'état passif dans lequel le confinent les médias de masse en Bretagne. Elle instille un bol d’air frais, un parfum parfois irritant ou suave selon certains, elle secoue la « pâte molle et insipide » du paysage médiatique dans lequel la presse libre n’existe plus guère.
La survie de publications dissidentes, qui refusent d’être soumises à la dictature du politiquement correct, n’est possible que grâce à la fidélité des abonnés, des lecteurs et au travail souvent bénévole d’une équipe fiable et déterminée.
Soutenir War Raok, c’est soutenir une revue bretonne indépendante et libre, c’est défendre une certaine conception de l’information, de la liberté d’opinion pilier de toutes les libertés. Mais soutenir War Raok c’est peut-être surtout renforcer le pluralisme des médias en Bretagne et donc, in fine, le pluralisme politique et la démocratie avec cette précision fondamentale que la démocratie, ce n’est pas obligatoirement le nombre, mais plutôt l’originalité.
Nous avons besoin de vous pour continuer à exercer ce regard critique et objectif qui, loin d’être un obstacle à la démocratie, ne peut que la stimuler. Merci de votre soutien !
Trugarez deoc’h en araok.
Padrig MONTAUZIER directeur de publication
et toute l’équipe de War Raok.

SOMMAIRE WAR RAOK N° 57
Buhezegezh vreizh page 2
Editorial page 3
Buan ha Buan page 4
Politique
Actualités de cendres et de haines... page 12
Europe
Migrants en Allemagne : la situation est-elle maîtrisable ? Page 15
Billet d’humeur
Mieux se nourrir page 17
Hent an Dazont
Votre cahier de 4 pages en breton page 19
Tribune libre
Le conservatisme, une vision politique à reconquérir page 23
Identité bretonne
La fin des accents ? Page 25
Histoire de Bretagne
La très ancienne coutume de Bretagne page 27
Environnement
Les zones humides capitales pour la biodiversité page 29
Civilisation bretonne
Rapports entre principes féminin et masculin page 32
Nature
Mais faites donc taire tout cela ! Page 35
Lip-e-bav
Coq au cidre et aux pommes page 37
Keleier ar Vro
Dalc’homp soñj Markiz Pontkallek page 38
Bretagne sacrée
La chapelle de Languidou page 39.

09:00 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, revue, war raok, celtisme, nationalisme breton, pays celtiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 17 avril 2020
War Raok n°55 & 56

War Raok n°55 & 56
EDITORIAL War Raok n° 55
La fidélité à notre Terre et à notre peuple
Le nationalisme breton, si présent et offensif il y a encore peu et plutôt timide en ces temps de grande perturbation, doit reprendre toute sa place, s’affirmer et ainsi combattre les tentacules de cette République française jacobine et coloniale. Il doit également s’opposer de façon drastique aux partisans et aux adeptes de l’uniformisation de l’Europe et de la dissolution des spécificités ethniques dans un horrible mélange artificiel universaliste.
Il faut renverser cette utopie destructrice des peuples et des communautés ethniques ainsi que cet ordre marchand qui menace nos cultures et combat nos aspirations à une vie nationale propre. Le peuple breton, mon peuple, deviendrait-il un peuple sans fierté, un peuple timoré et soudainement frileux qui a honte de sa langue, de sa culture, de son identité… qui n’a pas le courage d’affirmer sa propre souveraineté et d’édifier enfin son propre État, sa propre République ?
Est-il nécessaire de rappeler, encore une fois, que nos droits de peuple sont bafoués mais également que notre propre culture, notre propre identité sont menacées. Cette culture bretonne et celtique, riche et unique, est notre meilleur rempart contre ceux qui souhaitent la dissoudre et créer ainsi une uniformisation criminelle. C’est, pour nous, militants et patriotes bretons, une véritable barricade contre une éventuelle mort culturelle.
Aucune nation ne naît multiculturelle. Le multiculturalisme est une situation artificielle autant que malsaine qui ne peut affecter que les sociétés en déclin général. Une société multiculturelle porte au plus profond d’elle les germes d’une future destruction nationale.
Le mouvement national breton qui lutte contre la politique coloniale de l’État français ne doit pas ignorer que d’autres maux, tout aussi mortifères, menacent l’existence même du peuple breton. Les méthodes sont multiples : violentes, brutales avec déplacement de populations, mais aussi plus fourbes et perfides qui consistent tout simplement à remplacer un peuple progressivement par l’arrivée massive de populations étrangères. Aujourd’hui la méthode préférée et choisie est celle du métissage, ce métissage que certains, (à gauche principalement, mais à droite également sans oublier les traîtres en soutane et les déclarations répétées du Vatican en faveur des migrants), considèrent comme une réalité indéniable et une véritable réponse à la crise démographique des nations occidentales... Pire, les irresponsables qui prônent la promotion de la mobilité universelle et du multiculturalisme et déclarent ouvertement qu’à l’heure de la mondialisation les migrations sont des facteurs de prospérité, d’innovation et de développement durable, ne sont pas uniquement des irresponsables mais des criminels en puissance. Pitoyable cette vision surréaliste vantant un enrichissement humain et culturel ! Cette “culture de rencontre”, cette perception du monde où l’invasion migratoire actuelle constitue l’horizon vital de l’humanité, non seulement nous la réfutons mais nous la rejetons catégoriquement.
Notre rôle de militant politique breton est de donner un éclairage indispensable pour dissiper la pénombre qui rend aveugle notre peuple atteint malheureusement de cécité du fait des mensonges diffusés, répandus et imposés par la bonne presse et sa propagande immonde, par les petits “flics” de la pensée unique, par une oligarchie décadente, sans omettre les manipulations de cet État français, notre geôlier, aux funestes projets de destruction des peuples qu’il embastille. Il nous appartient de résister à cet avenir crépusculaire, de combattre pour un destin nouveau et la sauvegarde de notre Bretagne. Les Bretons ont le devoir sacré de conserver leurs racines, leurs traditions, leur civilisation… leur identité et de transmettre à leurs enfants le magnifique héritage reçu de leurs ancêtres. Pour conclure, je reprendrai cette célèbre phrase de Friedrich Hegel : “L’erreur la plus fatale pour un peuple est d’abandonner ses caractères biologiques”. Aussi complétons sans condescendance l’intitulé de cet éditorial : “Notre foi : la fidélité à notre terre, à notre peuple... à notre sang”.
Padrig MONTAUZIER
SOMMAIRE N° 55
Buhezegezh vreizh
Editorial
Buan ha Buan
Société
Greta Thunberg, nouveau conte pour Occidentaux invertébrés – page 11
Religion
Quand un cardinal africain défend l’identité de l’Europe – page12
Musique
Da Anaon eo aet Yann-Fañch Kemener – page 16
Billet d’humeur
Non à l’idéologie du métissage généralisé – page 18
Hent an Dazont
Votre cahier de 4 pages en breton – page 19
Histoire de Celtie
Mort Ghlinne Comhann / Massacre de Glencoe – page 24
Histoire de Bretagne
Institutions bretonnes et classes sociales au XVe siècle – page 25
Environnement
Les effets de la pollution environnementale – page 28
Civilisation bretonne
Rapports entre principes féminin et masculin – page 32
Nature
Nous avions un ami, pourtant, ce n’était qu’un petit chien... – page 35
Lip-e-bav
Queue de lotte à l’armoricaine – page 37
Keleier ar Vro
Prezegenn Loig Kervoas e Koad-Kew 2019 – page 38
Bretagne sacrée
L’art breton à la fin du Moyen Âge – page 39
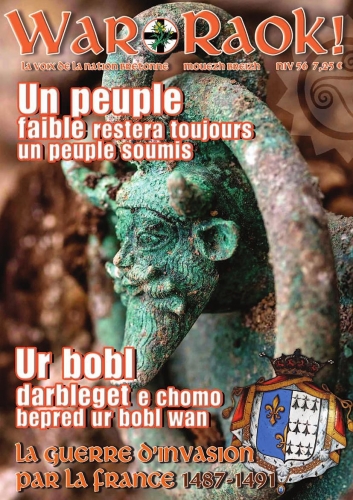
EDITORIAL War Raok N° 56
Un peuple faible est un peuple soumis !
L’année 2019 va s’achever dans quelques jours dans un désordre général qui ronge depuis maintenant tant et tant d’années notre vieille Europe. Pourquoi les peuples européens sombrent-ils de plus en plus dans une dégénérescence, une déchéance voire un déclin qui semblent inéluctables ?
Le mal s’est tellement immiscé dans l’ensemble de nos sociétés qu’il semble qu’il n’y ait plus aucun recours pour un véritable redressement. Personnellement je ne peux pas et ne veux pas céder au pessimisme ambiant et je pense que nous devons avoir la profonde certitude d’un relèvement, d’un sursaut de nos peuples et pour ce qui me concerne, de mon peuple… le peuple breton.
Depuis tant d’années, tant de siècles, les Bretons, privés de leur liberté, doivent sans cesse lutter pour continuer d’exister en tant que peuple, en tant qu’ethnie. Je suis donc optimiste quant à l’avenir des peuples européens, de nos patries charnelles, mais je m’autorise néanmoins d’être critique vis à vis de mon propre peuple et pour ce dernier éditorial de l’année 2019, il m’a semblé judicieux de vous livrer quelques réflexions de notre barde national, Glenmor, qui, avec son talent, sa verve bien connue, n’hésite pas à déranger quand il le faut les bonnes consciences. Il a parfaitement étudié et analysé les comportements d’un peuple qui lui était cher, un peuple dont il était issu, un peuple souvent en errance, dépossédé des ses droits mais toujours debout et déterminé, un peuple viscéralement attaché à ses traditions, un peuple fier de son identité… un peuple bien vivant car on ne meurt que de ses propres faiblesses.
Il faut savoir parfois être sévère envers son propre peuple, et notre barde a su, avec une grande sagesse, dans un de ses nombreux recueils et en quelques phrases nous brosser un tableau fidèle de la situation d’une nation et d’un peuple aux valeurs importées, un peuple certes conquis mais jamais soumis, un peuple qui en fait a besoin d’une lutte à mener pour se sentir exister.
… « Pour réussir la catastrophe actuelle, la France a depuis des siècles inventé la kermesse en invitant les Bretons à la foire. A toute bonne table, il faut un chien. Nous fûmes la guenille des kermesses que l’Histoire appelle des guerres, le paltoquet que l’économie nomme chantier. L’ennemi, le nôtre, nous a servi des œuvres d’art que l’on appelle monuments aux morts…
Mobiliser la conscience nationale d’un peuple n’est certes pas chose aisée tant il est vrai que celle-ci est diluée dans un fatras de bonnes ou mauvaises volontés… A chaque velléité jacobine, la Bretagne répond par un sourire ou une colère. Le mouvement breton s’embarrasse le plus souvent de détail que d’essentiel. Tel est le sort de toute Nation-colonie.
Il n’y a pas de politique bretonne sans nationalisme, c’est à ce niveau surtout que l’éparpillement est catastrophique. Le phénomène est directement lié au fait que le « politicien » breton a adopté le vocabulaire français. Le concept gallican, sa définition ont fortement marqué nos dernières générations. Nous assistons à la prolifération de partis relevant du gauchisme en Bretagne, les uns aussi sectaires et tout aussi ambigus que les mêmes bourgeonnements de Paris. Tout se passe comme si la Bretagne ne pouvait se définir une ligne politique propre au réel breton, au tempérament de l’homme breton ! Le réel breton débouche sur le nationalisme qui, en somme, n’est qu’une prise de conscience de celui-ci. Gérer ses propres affaires est liberté à tous les niveaux, à plus forte raison au niveau de l’ethnie et du peuple.
Dans le cadre français, d’autrefois et d’aujourd’hui, il n’a été et ne sera jamais possible de réaliser ce nationalisme d’avenir... ».
Extraits du recueil « Le sang nomade » 1975.
Alors devons-nous, comme Glenmor, hurler dans la nuit pour réveiller les Bretons qui refusent obstinément d’ouvrir les yeux ? Oui sans aucun doute en espérant que ce hurlement perce la brume dans laquelle trop de nos compatriotes se bercent.
Si nous combattons pour un idéal, pour une vision de la vie, nous combattons avant tout pour la survie du peuple breton, de notre ethnie spécifique, de notre identité bretonne, celtique et européenne.
Nedeleg laouen ha d’an holl ac’hanoc’h e hetan ur Bloavezh mat 2020.
Joyeux Noël et meilleurs vœux à vous tous pour 2020.
Padrig MONTAUZIER
SOMMAIRE N° 56
Buhezegezh vreizh — page 2
Editorial — page 3
Buan ha Buan — page 4
Politique :
Le temps des assassins — page 11
Société Bretagne 2050 :
Grands scénarios très politiquement corrects — page 13
Tribune libre :
Éclairer l’Europe — page 15
Europe
Pologne : Large victoire des nationalistes — page 16
Billet d’humeur :
Pour certains Bretons, la France est un pays étranger — page 18
Hent an Dazont :
Votre cahier de 4 pages en breton — page 19
Culture bretonne :
Les Beaux-Arts bretons — page 23
Histoire de Bretagne :
La guerre d’invasion de la Bretagne par la France — page 26
Environnement :
Écologisme et nationalisme, un combat indivisible — page 30
Civilisation bretonne :
Rapports entre principes féminin et masculin — page 32
Nature :
La nature au pillage — page 35
Lip-e-bav :
Tripes bretonnes au cidre et aux pruneaux — page 37
Keleier ar Vro :
Retour sur l’incendie de la chapelle de Koad-Keo — page 38
Bretagne sacrée :
Notre-Dame de Bon-Repos — page 39.

00:29 Publié dans Revue, Terres d'Europe, Terroirs et racines, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, war raok, bretagne, nationalisme breton, pays celtiques, celtisme, culture celtique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 20 mars 2020
Esquisse d'une biographie d'Olier Mordrel
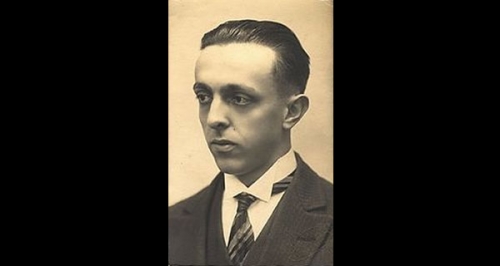
Esquisse d'une biographie d'Olier Mordrel
Olier Mordrel, (né à Paris le 29 avril 1901, mort le 25 octobre 1985 à Léchiagat), de son vrai nom Olivier Mordrelle, fut un militant nationaliste breton engagé dans la collaboration avec l'Allemagne nazie. Il était favorable à l'autonomie de la Bretagne comme nation associée à la France. Il est aussi connu sous les pseudonymes de Jean de La Bénelais, Er Gédour, Calvez et Olivier Launay, noms avec lesquels il a signé ses nombreux ouvrages et articles.
Il est le fils d'une corse mariée avec le général Joseph Mordrelle (décédé en 1942), originaire de la région malouine et qui a accompli la plus grande partie de sa carrière dans les troupes coloniales. Il est né à Paris où il a passé le plus clair de son enfance. Paradoxalement il a appris le breton à Paris. Après des études aux Beaux-Arts, il exerce pendant dix ans la profession d'architecte à Quimper.
Olier Mordrel est l'idéologue majeur du nationalisme breton et son influence marque encore aujourd'hui la frange la plus nationaliste de l'Emsav. Son fils est Tristan Mordrelle. En 1919, il adhère au groupe régionaliste Breiz Atao (Bretagne toujours). En 1922, il devint président de l'Unvaniez Yaouankiz Breiz (Union de la jeunesse de Bretagne). En 1925, alors qu'il s'était installé à Quimper comme architecte, il cosigne, avec Roparz Hemon, le manifeste de Gwalarn, dans le numéro de Breiz Atao (n° 74, février 1925) où apparait la swastika, symbole choisi pour son aspect païen et pré chrétien, en en-tête de la rubrique sur la vie du parti. C'est aussi le premier congrès interceltique à Dublin où la délégation bretonne se compose de François Jaffrennou (le barde Taldir), Olier Mordrel, Morvan Marchal et Youen Drezen. En 1927, il devient co-président du Parti autonomiste breton (PAB), puis son secrétaire à la propagande.
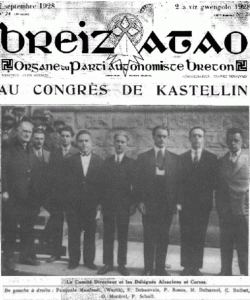 Il anime dans les années trente, un courant de jeunes architectes d’esprit nationaliste (il possède le magasin art déco Ty Kodaks de Quimper) et tente de créer un style breton moderne. En 1932, François Debauvais et Olier Mordrel fondent le PNB 2 (Parti national breton), lequel sera dissous sous le gouvernement Daladier (octobre 1939) en raison de son engagement séparatiste et de ses amitiés avec de hauts dignitaires allemands prompts à affaiblir par tout moyen la France. Olier Mordrel est un des deux dirigeants majeurs de la mouvance autonomiste, mais si François Debauvais s'attache plus à l'organisation, lui accorde plus de temps aux spéculations idéologiques et aux prises de positions politiques notamment par l'intermédiaire du journal autonomiste puis nationaliste "Breiz Atao". Sa sensibilité radicale voire extrémiste qui le pousse vers un romantisme néo-païen et une fascination pour le fascisme reste cependant toujours relativement marginale et il devra créer sa propre revue afin d'exprimer un ensemble d'opinions que "Breiz Atao" ne peut formuler sans risquer de heurter d'autres sensibilités, notamment catholiques.
Il anime dans les années trente, un courant de jeunes architectes d’esprit nationaliste (il possède le magasin art déco Ty Kodaks de Quimper) et tente de créer un style breton moderne. En 1932, François Debauvais et Olier Mordrel fondent le PNB 2 (Parti national breton), lequel sera dissous sous le gouvernement Daladier (octobre 1939) en raison de son engagement séparatiste et de ses amitiés avec de hauts dignitaires allemands prompts à affaiblir par tout moyen la France. Olier Mordrel est un des deux dirigeants majeurs de la mouvance autonomiste, mais si François Debauvais s'attache plus à l'organisation, lui accorde plus de temps aux spéculations idéologiques et aux prises de positions politiques notamment par l'intermédiaire du journal autonomiste puis nationaliste "Breiz Atao". Sa sensibilité radicale voire extrémiste qui le pousse vers un romantisme néo-païen et une fascination pour le fascisme reste cependant toujours relativement marginale et il devra créer sa propre revue afin d'exprimer un ensemble d'opinions que "Breiz Atao" ne peut formuler sans risquer de heurter d'autres sensibilités, notamment catholiques.
Il publie dans Breiz Atao, en 1933, le programme de gouvernement SAGA (Parti des Celtes Releves), sous le pseudonyme de A. Calvez. Il déclare à ce sujet (Stur, n° 1-2, juin 1942, p 5) : en 1933, (…) nous avons déclenché, dans notre vieux “ Breiz Atao ”, la campagne SAGA, en faveur d’un national-socialisme breton. En 1934, il fonde la revue Stur (Le Gouvernail), qui arbore le swastika. Il reprend, dans ce journal, des opinions du domaine de la pensée fasciste[réf. nécessaire] en développant un nationalisme celte. Il y publie en 1938 une lettre de Vision d’avenir (Stur n°12, 01-03/1938, p. 25-26) défendant la brutalité nécessaire des peuples maîtres – disons si vous voulez, les Nordiques –, et concluant : Ah ! Ceux d’entre nous qui ont mal au ventre à voir égorger un poulet, feraient bien d’aller s’endurcir un peu les nerfs tous les matins à l’abattoir municipal : conseil d’ami….
En 1936, il fonde le Bulletin des minorités nationales de France, ultérieurement dénommé Peuples et Frontières, où sont présentées des revendications au nom de la Bretagne et des principales minorités nationales européennes. L'autonomiste alsacien Hermann Bickler est chargé de la rubrique sur l’Alsace. Il se trouve être aussi sensible que Mordrel à l'idéologie nationale socialiste. Yann Fouéré lui succèdera. Ce journal s'attache à défendre le point de vue des autonomistes des minorités ethniques, notamment corse, flamande et bretonne. Parmi les rédacteurs se trouve pour la Flandre, l'abbé Jean-Marie Gantois et pour la Corse, Petru Rocca. On trouve parfois sous sa plume des écrits à caractère antisémite. Dans le premier numéro de Peuples et Frontières (1er janvier 1937, p. 14-16), dans Une lettre à propos de La Kermesse Héroïque, le Flamand J. Demeerseman attaque l’organe juif Marianne, en déclarant Il ne suffira pas d’alléguer comme excuse que, peut-être en Allemagne, l’industrie du cinéma n’est pas encore totalement libérée de l’emprise juive.
 Dans Breiz Atao (n° 164, 11 décembre 1932) il déclare, signant de son pseudonyme J. La B / Jean La Bénelais : Jacobin rime avec Youppin. (...) " Notre Juif " à nous, en Bretagne, c’est donc surtout le théoricien de l’Une et Indivisible, avant que Breiz Atao ne reprenne la swastika, symbole utilisé également par les nazis, le 29 janvier 1933. Le 14 décembre 1938, Mordrel est condamné, avec François Debauvais, à un an de prison avec sursis pour « atteinte à l'unité de la nation ». De juillet 1938 à juillet 1939, il est secrétaire général et rédacteur de Breiz Atao. Avant la déclaration de la guerre entre la France et l'Allemagne, et afin s'échapper à une arrestation imminente, il part en Allemagne nazie avec sa femme, François Debauvais et Anna Debauvais qui décrit leur voyage (Mémoires du chef breton : Fransez Debauvais, tome 3, p. 29-38). Depuis la Belgique, il rejoint Berlin. Publiés depuis Amsterdam, Mordrel et Debauvais adressent un manifeste aux Bretons, condamnant la guerre entreprise par la France le 25 octobre 1939.
Dans Breiz Atao (n° 164, 11 décembre 1932) il déclare, signant de son pseudonyme J. La B / Jean La Bénelais : Jacobin rime avec Youppin. (...) " Notre Juif " à nous, en Bretagne, c’est donc surtout le théoricien de l’Une et Indivisible, avant que Breiz Atao ne reprenne la swastika, symbole utilisé également par les nazis, le 29 janvier 1933. Le 14 décembre 1938, Mordrel est condamné, avec François Debauvais, à un an de prison avec sursis pour « atteinte à l'unité de la nation ». De juillet 1938 à juillet 1939, il est secrétaire général et rédacteur de Breiz Atao. Avant la déclaration de la guerre entre la France et l'Allemagne, et afin s'échapper à une arrestation imminente, il part en Allemagne nazie avec sa femme, François Debauvais et Anna Debauvais qui décrit leur voyage (Mémoires du chef breton : Fransez Debauvais, tome 3, p. 29-38). Depuis la Belgique, il rejoint Berlin. Publiés depuis Amsterdam, Mordrel et Debauvais adressent un manifeste aux Bretons, condamnant la guerre entreprise par la France le 25 octobre 1939.
En janvier 1940, les deux fondateurs du PNB adressent de l'étranger une "Lettre de Guerre" (Lizer Brezel) à leurs militants en rappelant qu'"un vrai breton n'a pas le droit de mourir pour la France". Ils ajoutent : "Nos ennemis depuis toujours et ceux de maintenant sont les Français, ce sont eux qui n'ont cessé de causer du tort à la Bretagne". Il est à Berlin « pour tenter d'y jouer la carte de l'indépendance bretonne dans l'éventualité probable d'une défaite de la France ». En mai 1940, François Debauvais et lui sont jugés par contumace par le tribunal militaire de Rennes pour « atteinte à la sécurité extérieure de l'État et à l'intégrité du territoire, maintien ou recrutement d'un groupe dissous, provocation de militaires à la désertion et à la trahison ». Ils sont dégradés militairement et condamnés à mort. Début mai 1940, il y dirige un prétendu « gouvernement breton en exil » (Bretonische Regierung).
Il ne fait pas pourtant avec François Debauvais figure de chefs alliés en exil. Leur présence correspond à une des politiques possibles en cas d’invasion réussie par le Reich. Ils peuvent circuler grâce aux agents du service secret qui gèrent l’option de l'indépendance bretonne, et leur ont fait délivrer des passeports de "Statenlos", réservés aux apatrides. Le 1er juillet 1940, il revient en Bretagne, suite à l'invasion allemande. Il devient alors directeur du Parti national breton et de son journal, L'Heure bretonne. Au même moment, au « Congrès » de Pontivy, Debeauvais et Mordrel créent le Comité National Breton. Il décide aussi l’édition d’un nouveau journal l’Heure Bretonne (son premier rédacteur sera Morvan Lebesque). Le 20 octobre 1940, le PNB est placé sous sa direction, et mène régulièrement campagne contre le gouvernement de Vichy et ses représentants régionaux, avec l’accord de l’occupant pour sa politique de pression sur Vichy. Les liens avec Célestin Lainé se tendent encore plus (après l'opposition au Comité National Breton), suite à l'action de son service Spécial à Gouezec en octobre 1940.
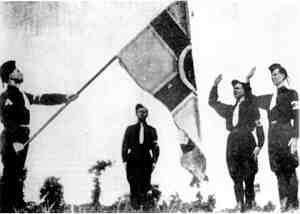 Sa ligne politique irrite Vichy et ne correspond plus aux besoins de Berlin, qui s’appuie désormais sur Vichy et constate l’isolement relatif du PNB dans la population; cet état de fait sera à l'origine de "la révolution de palais" du parti de décembre 1940. Qui plus est, Raymond Delaporte appuyé de Célestin Lainé, lequel ambitionne depuis longtemps de remplacer Olier Mordrel, profite du désir allemand d'étouffer l'autonomisme breton rendu inutile pour l'écarter de la direction alors qu'il lance une réorganisation du parti visant à le rendre totalement indépendant des Allemands et hostile à Vichy. La doctrine du PNB perdra en rigueur et en ardeur pour nourrir un séparatisme convenu. En novembre 1940, il affirme : "Notre force est en nous. elle n'est ni dans les autres ni dans les circonstances. ce n'est ni Vichy ni Berlin qui rendront au peuple breton la force de caractère nécessaire pour s'affranchir, se regrouper et se frayer une route. Notre sort se joue dans nos fibres... N'attendons rien que de nous. Alors, nous passerons au travers du gros temps, si gros temps il y a, comme une bonne étrave, et nos enfants seront Bretons".
Sa ligne politique irrite Vichy et ne correspond plus aux besoins de Berlin, qui s’appuie désormais sur Vichy et constate l’isolement relatif du PNB dans la population; cet état de fait sera à l'origine de "la révolution de palais" du parti de décembre 1940. Qui plus est, Raymond Delaporte appuyé de Célestin Lainé, lequel ambitionne depuis longtemps de remplacer Olier Mordrel, profite du désir allemand d'étouffer l'autonomisme breton rendu inutile pour l'écarter de la direction alors qu'il lance une réorganisation du parti visant à le rendre totalement indépendant des Allemands et hostile à Vichy. La doctrine du PNB perdra en rigueur et en ardeur pour nourrir un séparatisme convenu. En novembre 1940, il affirme : "Notre force est en nous. elle n'est ni dans les autres ni dans les circonstances. ce n'est ni Vichy ni Berlin qui rendront au peuple breton la force de caractère nécessaire pour s'affranchir, se regrouper et se frayer une route. Notre sort se joue dans nos fibres... N'attendons rien que de nous. Alors, nous passerons au travers du gros temps, si gros temps il y a, comme une bonne étrave, et nos enfants seront Bretons".
Il remet sa démission, contraint et forcé, ainsi que celle de directeur de l'Heure Bretonne le 2 décembre 1940. Il est remplacé au PNB le 8 décembre 1940 par Raymond Delaporte. Cette "révolution de palais" aurait été soutenue par les services allemands, désireux de mettre en avant un autre dispositif. (Il faut néanmoins noter que la nouvelle ligne politique du PNB mené par Delaporte est beaucoup moins collaborationniste que la précédente.) Quant à O. Mordrel, il est assigné à résidence en Allemagne. Il fut assigné à résidence en Allemagne de la fin décembre 1940 à mai 1941. D'abord à Stuttgart, il rejoint Berlin au milieu de janvier 1941. Le professeur Leo Weisgerber lui propose le poste de lecteur de celtique à l'Université de Bonn. Ce dernier organise le retour à Paris de Mordrel le 6 mai 1941. Mordrel obtient des accords pour séjourner en Mayenne. A cette occasion, quelques-uns de ses amis comme Jean Merrien, Raffig Tullou, Jean Trécan et René-Yves Creston lui rendent visite et prennent son avis sur un certain nombre de problèmes culturels et politiques. Il revient par la suite à Rennes le 16 septembre 1941, avec l'autorisation des Allemands, après 10 mois de mise à l’écart, il est présenté comme "indésirable" par les dirigeants du P.N.B., exécré par Vichy, et gardé en réserve par les autorités allemandes. Il est autorisé et encouragé à faire reparaître sa revue Stur en 1942. En 1943, il rencontre régulièrement à Rennes Louis-Ferdinand Céline. Il fait partie de Radio Paris, la radio de propagande nazie. Le 13 août 1944, à l'arrivée des Alliés, il se réfugie en Allemagne. Le 16 février 1945, des négociations s'engagent entre Jacques Doriot et Mordrel au sujet de la reconnaissance d'une indépendance bretonne au sein d'une fédération « de type suisse » . C'est le Comité de libération française de Jacques Doriot. Il s'enfuit ensuite à la chute de l' Allemagne.
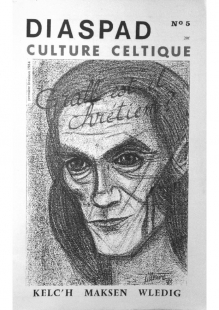 Il part d'abord pour le Brésil, puis l'Argentine, avant de trouver refuge en Espagne. Il est condamné à mort par contumace à la Libération, en juin 1946. Il écrit dans la revue Ar Vro, sous le pseudonyme de Brython. Il revient en France, en 1972, collabore à La Bretagne réelle, sous le pseudonyme d'Otto Mohr (son pseudonyme de 1940) et édite divers livres, dont Waffen SS d'Occident. Il a co-fondé dans les années 1980 un cercle nationaliste, le Kelc'h Maksen Wledig (Du nom de l'Empereur Maxime, "descendu" de Bretagne insulaire en compagnie de Conan Meriadec, le premier roi de Bretagne ), avec, entre autres, Yann-Ber Tillenon, et qui se place dans la continuité de l'extrême-droite bretonne ; et Georges Pinault, alias Goulven Pennaod. En 1981, il soutient François Mitterrand, tout en étant attentif aux travaux du GRECE, cercle de réflexion animé par Alain de Benoist, considéré comme proche de l'extrême-droite. Il meurt en 1985. (Voir Camus et Monzat, Les Droites nationales et radicales en France, Presses universitaires de Lyon, 1992).
Il part d'abord pour le Brésil, puis l'Argentine, avant de trouver refuge en Espagne. Il est condamné à mort par contumace à la Libération, en juin 1946. Il écrit dans la revue Ar Vro, sous le pseudonyme de Brython. Il revient en France, en 1972, collabore à La Bretagne réelle, sous le pseudonyme d'Otto Mohr (son pseudonyme de 1940) et édite divers livres, dont Waffen SS d'Occident. Il a co-fondé dans les années 1980 un cercle nationaliste, le Kelc'h Maksen Wledig (Du nom de l'Empereur Maxime, "descendu" de Bretagne insulaire en compagnie de Conan Meriadec, le premier roi de Bretagne ), avec, entre autres, Yann-Ber Tillenon, et qui se place dans la continuité de l'extrême-droite bretonne ; et Georges Pinault, alias Goulven Pennaod. En 1981, il soutient François Mitterrand, tout en étant attentif aux travaux du GRECE, cercle de réflexion animé par Alain de Benoist, considéré comme proche de l'extrême-droite. Il meurt en 1985. (Voir Camus et Monzat, Les Droites nationales et radicales en France, Presses universitaires de Lyon, 1992).
Indépendamment de ses engagements politiques, Olier Mordrel est considéré comme un écrivain doté d'un talent de plume certain, tant en langue bretonne qu'en langue française. Dès les années 20, il commence à formuler une vision de la Bretagne propre, reposant sur une recherche de la pérennité d'une certaine sensibilité celtique. C'est avec "L'essence de la Bretagne" que débute son œuvre littéraire. Il y aborde l'effondrement de la société traditionnelle, la perte des repères, la quête à mener pour revivifier la Bretagne et son être. Après son retour d'exil, Olier Mordrel s'attache à produire une œuvre complète qui traite à la fois de son engagement passé, de doctrine politique nationaliste, de poésie celtique et d'histoire de l'art. Dans son livre majeur "Breiz Atao", Olier Mordrel fait le bilan de 25 ans de militantisme, non sans écarter les critiques que lui adressent dans leurs propres ouvrages des militants nationalistes, dont Anna Youennou, épouse de François Debauvais, dans son œuvre en 6 volumes "Breiz Atao et les siens, mémoire du chef breton". L'auteur présente Olier Mordrel comme volontiers hautain, autoritaire, méprisant et opportuniste.
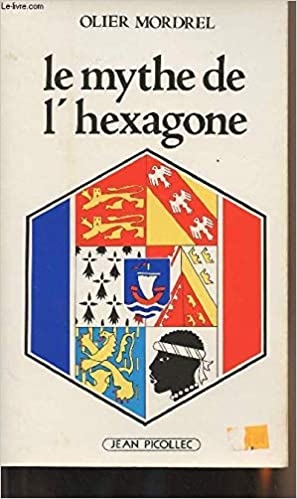 Le portrait des relations entre Mordrel et Debeauvais laissant entrevoir des rapports de plus en plus exécrables à mesure que la possibilité de réaliser l'indépendance avec l'aide allemande se concrétise. Reste que Olier Mordrel explique dans le détail son parcours et fournit son propre point de vue sur son engagement. Olier Mordrel cependant se garde d'expliquer les raisons plus intimes de ses sympathies pour l'idéologie nationale socialiste. Il avance au demeurant des motivations comme l'opportunisme, les circonstances exceptionnelles, une certaine communauté d'esprit. Il prend soin de démarquer la démarche du PNB de celle des fascismes par une sensibilité bretonne originale éloignée des stato-nationalismes allemand et italien et rejette l'idée d'une "copie bretonne" de modèles étrangers.
Le portrait des relations entre Mordrel et Debeauvais laissant entrevoir des rapports de plus en plus exécrables à mesure que la possibilité de réaliser l'indépendance avec l'aide allemande se concrétise. Reste que Olier Mordrel explique dans le détail son parcours et fournit son propre point de vue sur son engagement. Olier Mordrel cependant se garde d'expliquer les raisons plus intimes de ses sympathies pour l'idéologie nationale socialiste. Il avance au demeurant des motivations comme l'opportunisme, les circonstances exceptionnelles, une certaine communauté d'esprit. Il prend soin de démarquer la démarche du PNB de celle des fascismes par une sensibilité bretonne originale éloignée des stato-nationalismes allemand et italien et rejette l'idée d'une "copie bretonne" de modèles étrangers.
Il continuera à participer de loin à la vie de l'Emsav en adressant via des essais des conseils à la jeune génération. Il délivre notamment des propositions d'ordre politique, comme dans la "Voie Bretonne" ou il dénonce les incohérences idéologiques de la "gauche bretonne". Il approfondit en outre la doctrine nationaliste née dans les années 20 avec "Breiz Atao" avec "Le Mythe de l'Hexagone" et "L'idée bretonne". Son amour certain de la langue bretonne et de la littérature le pousse à rédiger des poèmes, des traductions mais aussi à saisir et comprendre cette "âme bretonne" qui l'intrigue depuis tant d'années en cherchant chez les écrivains bretons l'expression de cette sensibilité celtique qu'il essaie de cerner et décrire. Ce seront les ouvrages "La littérature en Bretagne" et "Les hommes dieux". Il réalise un atlas de la Bretagne où il livre son propre regard sur la péninsule tant d'un point de vue humain que géographique et dont le titre est "La Bretagne".
L'héritage d'Olier Mordrel a été longtemps ignoré ou rejeté depuis la fin de la guerre en raison de son parcours clairement marqué par une tentative de conciliation du fascisme, du national-socialisme et du celtisme breton avant et durant le conflit. Ses ouvrages d'après guerre, qui n'abordent pas ces thématiques, sont cependant des références du nationalisme breton d'un point de vue intellectuel, qu'on y adhère ou non. Avec l'apparition d'Adsav en 2000, Olier Mordrel et son héritage ont été réhabilités et parfois glorifiés. Une rupture après 55 ans de dénonciations des nationalistes bretons durant la guerre.
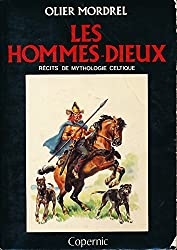 En 2005, Adsav organisera une cérémonie sur la tombe de Mordrel pour les 20 ans de sa disparition. Plus généralement on peut dire qu'avec Adsav, les conceptions mordrelliennes du nationalisme breton que l'on trouvait déjà dans Breiz Atao à l'état embryonnaire, sont devenues les éléments constitutifs d'un nouveau courant à part entière de l'Emsav. Un courant d'extrême droite ou très proche de l'extrême droite mais doté d'une perspective propre et différente de l'extrême droite française. Une réalité qu'a dénoncé Mona Bras, porte parole de l'UDB suite à une interview du président d'Adsav ou ce dernier souligne les apports d'Olier Mordrel au nationalisme breton. La porte parole y dénonçait la dérive "mordrellienne" d'une frange de l'Emsav.
En 2005, Adsav organisera une cérémonie sur la tombe de Mordrel pour les 20 ans de sa disparition. Plus généralement on peut dire qu'avec Adsav, les conceptions mordrelliennes du nationalisme breton que l'on trouvait déjà dans Breiz Atao à l'état embryonnaire, sont devenues les éléments constitutifs d'un nouveau courant à part entière de l'Emsav. Un courant d'extrême droite ou très proche de l'extrême droite mais doté d'une perspective propre et différente de l'extrême droite française. Une réalité qu'a dénoncé Mona Bras, porte parole de l'UDB suite à une interview du président d'Adsav ou ce dernier souligne les apports d'Olier Mordrel au nationalisme breton. La porte parole y dénonçait la dérive "mordrellienne" d'une frange de l'Emsav.
Direction des Renseignements Généraux - Audition du 23/12/1946 d'Helmut Knochen, 36 ans, ex-chef de la Police de Sûreté et du SD en France
Autonomistes bretons - Mordrel : Les autonomistes bretons étaient, avant guerre, financés par l'Abwehr. Pendant l'occupation , un certain nombre d'entre eux ont travaillé sous les ordres du Kommandeur de Rennes, pour la lutte contre le maquis et ont fait du renseignement pour l'Abwehr ainsi que pour nous.
Mordrel, leur chef, était en rapports dès 1940 avec le Général Best de l'administration militaire du Militarbefehlshaber et c'est lui que j'ai rencontré. Best s'intéressait tout particulièrement aux problèmes bretons.
00:57 Publié dans Biographie, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : olier mordrel, bretagne, combat breton, nationalisme breton, pays celtiques, celtisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 17 décembre 2015
Sept films à voir ou à revoir sur les Nations sans Etat

Sept films à voir ou à revoir sur les Nations sans Etat
Ex: http://cerclenonconforme.hautetfort.com
Depuis la fin de la période de décolonisation amorcée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale jusqu'au milieu des années 1970, les notions d'éternité et d'intangibilité des frontières nationales sont durablement inscrites dans la représentation mentale collective. Or, ces derniers mois, les aspirations à l'indépendance de l'Ecosse et de la Catalogne bouleversent ces certitudes qui n'avaient pas été aussi ébranlées, au sein des Etats piliers de l'Union européenne, depuis de nombreuses décennies. De nombreux Etats européens ne masquent pas leurs craintes que ces exemples ne créent un lourd précédent. En réalité, qu'est-ce qu'une frontière continentale si ce n'est une limite issue d'un traité de guerre ou d'une union par mariage ? Ainsi, les luttes indépendantistes constituent-elles un légitime moteur de l'Histoire. Depuis la dissolution de l'ancien bloc soviétique au début de la décennie 1990, qui a favorisé l'accession ou la ré-accession à l'indépendance de nombre d'anciennes républiques soviétiques, ce ne sont pas moins de six pays qui sont parvenus à l'indépendance ces vingt dernières années : de l'Erythrée en 1993 au Soudan du Sud en 2011, en passant par le micro-Etat du Pacifique des Palaos, le Timor Oriental et le Monténégro. Il nous sera permis d'être plus circonspect concernant le sixième cas. Car si de nombreux Etats européens ne masquent pas leurs craintes de voir leurs frontières remises en cause, ces Etats-dit-Nations, si prompts à se crisper sur leur intégrité territoriale avaient su se montrer plus favorables, en 2008, à soutenir l'indépendance de l'Etat-mafieux islamiste du Kosovo-et-Métochie, au détriment du caractère de berceau originel que représente le Kosovo pour une Nation serbe qui n'avait pas voulu se plier aux injonctions du Nouvel Ordre mondial... Mauvais apprentis sorciers, les arroseurs sont aujourd'hui les arrosés. "Aujourd'hui la Serbie, demain la Seine-Saint-Denis, un drapeau frappé d'un croissant flottera sur Paris".... La chanson prophétique Paris-Belgrade du groupe de rock In Memoriam fait dramatiquement écho aux récents événements survenus dans la très jacobine Nation française.

LA BATAILLE DE CULLODEN
Titre original : The Battle of Culloden
Film anglais de Peter Watkins (1964)
16 avril 1746, à Culloden, des membres des différents clans rebelles écossais des Highlands, menés par le Prince Charles Edouard Stuart, font face aux troupes anglaises du Roi George II de Grande-Bretagne, que commande le Duc de Cumberland. Il ne faut pas plus d'une heure pour que le destin de la bataille soit scellé. Les Ecossais, mal organisés, sont mis en pièce par l'armée royale mieux équipée. Le combat terminé, la pacification du gouvernement britannique est d'une férocité sans nom. L'objectif avoué est de totalement annihiler le système clanique et, ainsi, de prévenir toute nouvelle rébellion dans les Hautes terres. Ils seront plus de deux mille Ecossais à périr dans la lande marécageuse ce jour-là...
Watkins a curieusement opté pour un montage singulier. Aussi, le film se présente-t-il comme un documentaire d'actualités tourné caméra à l'épaule. Le réalisateur se balade donc sur le champ de bataille et interviewe les combattants çà-et-là sans manquer pas de commenter le déroulé de la bataille en voix off. Choix risqué mais, ô combien, magistralement réussi ! Tourné avec des comédiens amateurs et un maigre budget, on est loin de la grande production peu avare en mélodrame. Et voilà tout le charme de Watkins, le drame brut l'emporte sur le pathos, finalement assez anachronique. Culloden, c'est un peu un Braveheart réussi ! Un chef-d'œuvre !

BRAVEHEART
Film américain de Mel Gibson (1995)
En cette fin de treizième siècle, l'Ecosse est occupée par les troupes d'Edouard 1er d'Angleterre. Rien ne distingue un certain William Wallace de ses frères de clan lorsque son père et son frère meurent opprimés. Bien au contraire, Wallace souhaite avoir le moins d'ennuis possibles avec la soldatesque anglaise et s'imagine parfaitement en modeste paysan et époux de son amie d'enfance, Murron MacClannough. C'est en secret que les amoureux se marient afin d'épargner à la belle de subir le droit de cuissage édicté par la couronne anglaise. Mais Murron est bientôt violentée par un soldat anglais, provoquant la fureur de Wallace. La jeune femme est étranglée devant ses yeux. Wallace ne pense plus qu'à se venger. La garnison britannique du village est massacrée, première bataille d'une longue série de reconquête des clans écossais à l'assaut des Highlands...
Oui, Braveheart est un beau film ! Oui, les scènes de bataille sont fabuleuses ! Oui, le personnage de Wallace, imaginé et interprété par Gibson, ferait se soulever n'importe quel militant et s'enhardir du courage nécessaire lorsqu'il n'y a plus d'autre solution que le combat. Oui, Wallace est un héros nationaliste qui ne laisse pas indifférent. Oui, Gibson maîtrise toutes les ficelles du Septième art dès son deuxième long métrage. Oui, il est normal que vous ayez irrésistiblement eu une furieuse envie de casser la figure de Darren, brave étudiant londonien en Erasmus, qui vous tient lieu de pourtant si amical voisin. Oui, oui, oui et pourtant... Braveheart ne parvient pas au niveau de la réalisation de Watkins. La faute à un pathos romantique trop exacerbé et une idylle absolument mal venue avec Isabelle de France, bru du Roi Edouard 1er. Il est néanmoins impensable de ne pas le voir et l'apprécier.
FLB
Documentaire français de Hubert Béasse (2013)
En quatorze années d'existence, de 1966 à 1980, le Front de Libération de la Bretagne a commis pas moins de deux centaines d'attentats. Par tous les moyens, les F.L.B. entreprennent de défaire l'annexion de la Bretagne à la France, héritée du mariage de la Duchesse Anne, alors seulement âgée de douze ans, et du Roi de France Charles VIII. Les nombreux attentats visent l'ensemble des pouvoirs régaliens et symboliques de la France. Le plasticage de l'antenne de retransmission télévisée de Roc'h Trédudon, privant la Bretagne de télévision pendant plus d'un mois, et le dynamitage de la Galerie des glaces du château de Versailles comptent parmi les actions les plus spectaculaires menées par les mouvements indépendantistes en France. Evidemment, la répression ne tarde pas à frapper l'Emsav...
Divisé en deux parties, Les Années De Gaulle et Les Années Giscard, le remarquable documentaire de Béasse donne la parole à nombre d'anciens F.L.B., dont le témoignage est assorti de nombreux documents inédits. Provenant d'horizons politiques, parfois les plus opposés, l'extension du F.L.B. ne pouvait que rimer avec scission. S'ouvrant aux thèses socio-économiques anticapitalistes, l'Armée Révolutionnaire Bretonne entend marier ses initiales au sigle F.L.B. et lutter pour une Bretagne plus progressiste. Béasse, par bonheur, entend tendre le micro à toutes les tendances des F.L.B., et ce, avec une objectivité appréciable dans le traitement des témoignages. Les pendules sont remises à l'heure pour ceux qui ont la mémoire courte ou la dent dure sur la réalité du mouvement breton. Parfaitement intéressantes que ces deux heures documentaires.

GENERATION FLNC
Documentaire français de Samuel Lajus (2004)
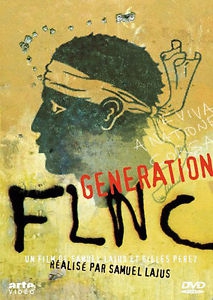
Il est dit que l'omerta règne en Corse. Pas dans ce passionnant et poignant documentaire en tout cas. De nombreuses images d'archives enrichissent les témoignages d'une trentaine d'ex-militants quinquagénaires du Front, de représentants du nationalisme corse mais également de hautes personnalités, tel le commissaire Robert Broussard, Jean-Louis Debré ou Charles Pasqua. La langue de bois n'est ainsi pas de mise, y compris sur les sujets les plus sensibles, des règlements de compte entre partisans de la même cause aux négociations secrètes entre les clandestins et l'Etat, mais aussi sur la dérive mafieuse de certaines factions. Finalement, ce sont les représentants de l'Etat qui en disent le moins ; tant il est vrai qu'ils n'ont pas les fesses complètement propres sur ces sujets. Deux années de tournage pour achever ce document, extraordinaire de décorticage d'un sentiment identitaire. Indispensable pour qui s'intéresse au sujet.
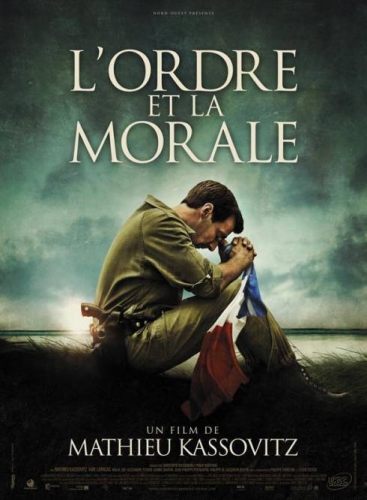
L'ORDRE ET LA MORALE
Film français de Mathieu Kassovitz (2011)
1988, loin de l'hexagone, sur l'île kanake d'Ouvéa, quatre gendarmes sont abattus dans l'assaut de leur caserne et vingt-sept autres retenus par des membres du mouvement indépendantiste du Front de Libération National Kanak et Socialiste. La situation se dégradait depuis de nombreux mois. Trois cents militaires sont dépêchés sur l'île calédonienne pour libérer les otages. Philippe Legorjus, patron de l'élite des gendarmes d'intervention, et Alphonse Dianou, leader des preneurs d'otages, partagent bien des valeurs communes, l'honneur surtout. Legorjus sent qu'il peut maîtriser la situation sans effusion de sang mais la France est alors à deux jours du premier tour des élections présidentielles. Dans le combat qui opposera Jacques Chirac et François Mitterrand en pleine cohabitation, la morale ne semble pas être la première préoccupation des deux candidats.
Tiré de l'ouvrage La Morale et l'action de Legorjus, le film ne manqua pas de faire scandale. Film militant pro-indépendantiste selon les partisans de la vérité d'Etat, film inutile pour de nombreux Kanaks estimant la réouverture des cicatrices inutile. C'est certainement Legorjus qui constitue la source la plus fiable pour expliquer ce bain de sang. Manipulation des faits pour de basses considérations électives, réalité d'un néo-colonialisme français, fortes rivalités entre de hauts gradés, la prise d'otages de la grotte ne pouvait connaître d'issue sereine. Les exécutions sommaires de militants indépendantistes fait prisonniers sont là pour le rappeler. Parfois manichéen dans sa caricature des militaires français, le film de Kassovitz demeure néanmoins extrêmement convaincant. A voir absolument !

15 FEVRIER 1839
Film québécois de Pierre Falardeau (2001)
14 février 1839, sous le régne de la Reine Victoria, deux héros québécois de la lutte pour l'indépendance, Marie-Thomas Chevalier de Lorimier et Charles Hindelang, apprennent que la sentence de mort par pendaison sera appliquée le lendemain. Voilà deux années que ces hommes comptent parmi huit cents détenus emprisonnés à Montréal dans des conditions dégradantes après l'échec de l'insurrection de 1837, dont une centaine a été condamnée à mort par les autorités colonialistes anglaises. Entourés de leurs compagnons d'infortune, vingt-quatre heures les séparent de leur funèbre destin. De vagues sursauts d'espoir affrontent la peur et le doute. Une seule chose est sûre, affronter la mort sera leur dernier combat. Et ils ne regrettent rien...
Malgré une parenté historique et linguistique évidentes, que connaît-on aujourd'hui du Québec en France et de son aspiration à la liberté ? Inspiré de faits réels, Falardeau rompt avec sa filmographie satirique et a à cœur de rendre hommage aux luttes indépendantistes qui ont enflammé le pays québécois au 19ème siècle. Le réalisateur livre un huis-clos sombre de toute beauté. D'un parti pris indépendantiste évident, le film a légitimement été fortement égratigné par la critique anglophone dénonçant un déferlement de haine antibritannique. Quelques approximations historiques ne nuisent pas à un ensemble prodigieux.
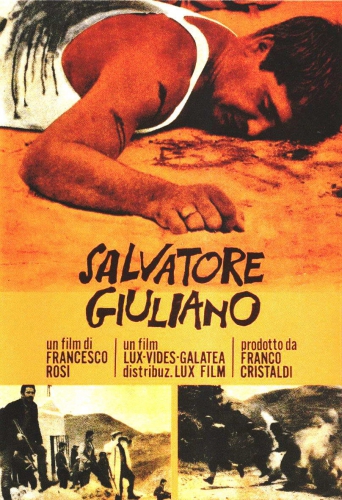
SALVATORE GIULIANO
Film italien de Francesco Rosi (1961)
5 Juillet 1950, le corps criblé de balles du bandit indépendantiste sicilien Salvatore Giuliano est découvert dans la cour d'une maison du village de Castelvetrano. Si l'homme était traqué par la police et l'armée italiennes, il semblerait qu'il ait été retrouvé avant eux. Le constat du décès est dressé par un commissaire tandis que les journalistes sont à l'affût du moindre renseignement. La mort achève une existence intrépide commencée en 1945 lorsque Giuliano s'engage dans la lutte violente, avec l'appui de la Mafia, pour l'indépendance de son île. Le 1er mai 1947, il avait été notamment impliqué dans l'assassinat de militants socialistes. Son corps est bientôt exposé dans sa commune natale de Montelepre, où sa mère et les habitants viennent se recueillir avec une dévotion non simulée. Tous les regards convergent alors vers Gaspare Pisciotta, lieutenant de Giuliano, que tous soupçonnent de l'avoir trahi et assassiné...
Film subversif et engagé à plus d'un titre ! Rosi utilise un curieux procédé scénographique pour évoquer la vie de ce curieux personnage historique sicilien, moitié bandit indépendantiste, moitié Robin des Bois dont le souhait était de voler les riches pour donner aux pauvres et arracher l'île à la domination italienne pour en faire le quarante-neuvième Etat d'Amérique. Ainsi, le récit anarchique de Rosi parvient-il à ne pas être brouillon sans aucun ordre chronologique. Autre point fort, Rosi est l'un des premiers à dénoncer les rapports étroits de la Cosa nostra avec le pouvoir politique sicilien. Enfin, le réalisateur n'a pas hésité à faire appel à des acteurs non-professionnels, renforçant le caractère authentique de l'œuvre. Un grand film politique par l'un des maîtres du cinéma italien.
Virgile / C.N.C.
Note du C.N.C.: Toute reproduction éventuelle de ce contenu doit mentionner la source.
00:05 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, 7ème art, peuples sans état, écosse, nationalisme écossais, indépendantisme écossais, bretagne, nationalisme breton, corse, indépendantisme corse, québec |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 26 février 2012
En souvenir d’Olier Mordrel
00:09 Publié dans Hommages, Terres d'Europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, olier mordrel, bretagne, nationalisme breton, pays celtiques, armorique, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 01 mars 2011
Frakass - La Blanche Hermine
Frakass - La Blanche Hermine
00:05 Publié dans Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, pays celtiques, nationalisme breton |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 février 2011
Breizh Atao !
Breizh Atao !
00:10 Publié dans Histoire, Terres d'Europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, pays celtiques, nationalisme breton, histoire, autonomisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 14 juin 2010
France et Bretagne en 1532
France et Bretagne en 1532
Ex: http://propos.sturiens.over-blog.com/
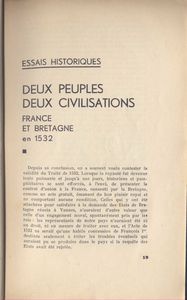 Depuis sa conclusion, on a souvent voulu contester la validité du Traité de 1532. Lorsque la royauté fut devenue toute puissante et jusqu'à nos jours, historiens et pamphlétaires se sont efforcés, à l'envi, de présenter le contrat d'union à la France, consenti par la Bretagne, comme un acte gratuit, émanant du bon plaisir royal et ne comportant aucune condition. Celles qui y ont été attachées pour satisfaire à la demande des Etats de Bretagne réunis à Vannes, n'auraient d'autre valeur que celle d'un engagement moral, spontanément pris par les rois : les représentants de notre pays n'auraient été ni en droit, ni en mesure de traiter avec eux, et l'Acte de 1532 ne serait qu'une habile concession de François Ier, destinée seulement à éviter les troubles éventuels qui auraient pu se produire dans le pays si la requête des Etats avait été rejetée. D'autres historiens ont, en leur temps, fait justice de ces assertions, et il ne nous appartient pas d'y revenir. L'examen du droit public breton peut, à lui seul, nous convaincre de l'entière validité du contrat. Ce qui apparaît comme contestable à la lumière du seul droit public français, devient une vérité d'évidence si l'on fait appel à la notion bretonne de ce même droit.
Depuis sa conclusion, on a souvent voulu contester la validité du Traité de 1532. Lorsque la royauté fut devenue toute puissante et jusqu'à nos jours, historiens et pamphlétaires se sont efforcés, à l'envi, de présenter le contrat d'union à la France, consenti par la Bretagne, comme un acte gratuit, émanant du bon plaisir royal et ne comportant aucune condition. Celles qui y ont été attachées pour satisfaire à la demande des Etats de Bretagne réunis à Vannes, n'auraient d'autre valeur que celle d'un engagement moral, spontanément pris par les rois : les représentants de notre pays n'auraient été ni en droit, ni en mesure de traiter avec eux, et l'Acte de 1532 ne serait qu'une habile concession de François Ier, destinée seulement à éviter les troubles éventuels qui auraient pu se produire dans le pays si la requête des Etats avait été rejetée. D'autres historiens ont, en leur temps, fait justice de ces assertions, et il ne nous appartient pas d'y revenir. L'examen du droit public breton peut, à lui seul, nous convaincre de l'entière validité du contrat. Ce qui apparaît comme contestable à la lumière du seul droit public français, devient une vérité d'évidence si l'on fait appel à la notion bretonne de ce même droit.
Alors que le droit public du royaume de France confondait à cette époque, quant au roi, souveraineté et propriété, en Bretagne les deux notions étaient déjà distinctes. Pour les Bretons, le « dominium » et l'« imperium » du prince n'étaient pas confondus. Le pouvoir du duc n'était pas considéré comme absolu, et le duché n'était pas considéré comme sa chose propre. A chaque acte du pouvoir central devait correspondre la sanction populaire. Les Etats de Bretagne étaient un véritable Parlement, dont le caractère politique était très accentué, et dont on retrouve l'intervention depuis l'origine la plus reculée, dans tous les actes politiques intéressant le duché. Un acte aussi grave que celui de la réunion du duché à la couronne, s'il avait été consommé sans leur intervention, ne pouvait être que frappé de nullité absolue.
La forme du gouvernement breton était un produit spontané de la nature et de l'histoire, particulièrement bien adapté aux besoins de la Bretagne et à la mentalité de son peuple. Une conception particulière du droit, conception proprement celtique et spiritualiste, animait tous les rouages de l'administration de la justice et de l'organisation politique. On y trouve la raison de la longue et héroïque lutte de la Bretagne contre les rois de France, dont l'erreur fut, après la réunion, de considérer le peuple breton comme le reste de leur peuple, et de vouloir lui appliquer les mêmes méthodes et les mêmes lois.
L'examen de l'état politique, administratif et social de la Bretagne, au jour de la réunion, fait ressortir très vivement les différences profondes qui existaient alors entre la France et la Bretagne ; ainsi s'expliquent également les précautions multiples prises dans le traité de 1532 contre les empiétements du pouvoir royal et l'obstination avec laquelle les Bretons s'efforcèrent de sauvegarder l'intégrité de leur constitution nationale, gage de leur autonomie.
*
**
En Bretagne, les rapports du peuple et du souverain, aussi bien que ceux des diverses classes sociales entre elles, étaient régis par des principes étonnamment modernes et libéraux. Aucune charte particulière, aucune constitution écrite ne les réglaient ; mais ils prenaient appui sur les principes fondamentaux du droit public breton de formation traditionnelle. La Très Ancienne Coutume de Bretagne proclamait que la législation bretonne devait être toute entière de raison.
En réalité, la confiance mutuelle qui unissait le souverain et ses sujets était le produit d'une lente évolution qui, au cours des siècles, maintint en le transformant et en l'adaptant chaque fois à des besoins plus actuels, le principe de gouvernement très libéral en vigueur dans les confédérations celtiques de l'époque préchrétienne. A l'origine, comme dans toute l'antiquité nordique, le chef suprême était élu, et les comtes ou seigneurs bretons devaient se rallier autour de lui pour combattre l'ennemi commun. Mais le roi ne pouvait lever aucun impôt, prendre aucune mesure générale sans l'assentiment des chefs réunis, le pays étant toujours plus puissant que le monarque. Lorsque les rois de Bretagne devinrent héréditaires, ce principe libéral continuera à s'appliquer, et il dominera toute la constitution bretonne jusqu'en 1532 et même jusqu'en 1789. Le roi ou le duc ne pouvait toucher à aucun intérêt public sans l'avis et le consentement des seigneurs du pays dont l'assemblée, en se transformant, devint peu à peu les Etats de Bretagne. Le roi Salomon III, aux environs de l'an 1000, fut empêché de quitter le pays par une défense formelle des seigneurs assemblés. Plus tard, le duc Jean IV fut exilé, puis rappelé par les Etats.
L'histoire bretonne est pleine de faits semblables : « Le droit fondamental du pays, dit M. de Carné, de l'aveu du prince et de ses sujets, frappait de nullité tout acte politique non ratifié par l'assentiment formellement exprimé des Etats ». Depuis le XIIe siècle, on peut suivre sans la perdre jamais de vue, la trace de l'action exercée par l'Assemblée bretonne sur tous les événements de quelque importance et sur l'orientation même de la politique du duc. Les rares conquérants de la Bretagne, ou plutôt les princes victorieux qui avaient battu ses armées, se soumettaient eux-mêmes à cette inévitable coutume des assemblées. Aussi La Borderie a-t-il pu écrire que le gouvernement breton « prend la forme de la monarchie représentative dont jouissait dès lors aussi l'Angleterre, et qui était le gouvernement le plus modéré, le plus régulier, le plus libéral sous lequel put vivre, au XVe siècle, une nation chrétienne ».
C'est dans l'attachement que portaient à leur gouvernement les différentes classes de la société bretonne que se rencontre l'explication de la longue lutte soutenue par la Bretagne contre le pouvoir central. L'élément féodal qui dans notre pays s'était développé dans sa plénitude, n'y avait pas été vicié dans son essence. La conquête n'avait pas été à l'origine des pouvoirs des seigneurs, et les « antipathies héréditaires » qu'elle avait ailleurs suscitées n'y existaient guère. Le servage, sous sa forme la plus dure et la plus cruelle, ne s'y retrouve jamais : on n'en aperçoit de traces que dans une petite partie de la Haute-Bretagne, région la plus soumise aux influences du dehors, et dans le Léon, où « l'usement de motte », dernier vestige du servage, fut aboli par François II en 1486. Dès le XIe et le XIIe siècle, les paysans pouvaient quitter la terre, la vendre à leur gré, la transmettre à leurs héritiers, se marier à leur guise, plaider librement, parfois même contre leur seigneur.
Augustin Thierry avait été frappé de ce fait lorsqu'il écrivit : « Les gens du peuple en Basse-Bretagne n'ont jamais cessé de reconnaître dans les nobles de leur pays les enfants de la terre natale ; ils ne les ont jamais haï de cette haine violente que l'on portait ailleurs aux seigneurs de race étrangère et, sous les titres féodaux de barons et de chevaliers, le paysan breton retrouvait encore les tierns et les mac-tierns des premiers temps de son indépendance ». La plupart des nobles de Bretagne, en effet, très nombreux et très pauvres, se confondaient dans leurs derniers rangs avec la population rurale. Ils en partageaient les deuils et les plaisirs, et recevaient, en nature, de leurs colons, la plupart des choses fongibles. Les colons eux-mêmes participaient à la possession du sol, puisqu'ils l'occupaient en grande partie alors à titre de « domaine congéable ». Un parfait accord attesté par les traditions, l'histoire et les chants populaires, semblait régner entre les paysans et les nobles, rapprochés par la communauté des habitudes et la simplicité de la vie. Aussi, du commencement du XIe siècle au début du XVIe siècle, ne voit-on pas en Bretagne se produire les jacqueries qui se retrouvent périodiquement en France à cette époque.
*
**
Les mêmes règles familiales, le même libéralisme se retrouvait dans l'administration du pays. Une décentralisation intelligemment comprise avait donné aux cités et aux paroisses des pouvoirs très étendus d'administration. Dès la plus haute antiquité, s'affirment les libertés des communes bretonnes, et leurs franchises étaient, au XVIe siècle, inviolables. Loin de reposer sur des chartes octroyées par le bon plaisir, ou arrachées par la violence, elles dérivaient d'une évolution traditionnelle qui avait peu à peu adapté le mécanisme des antiques institutions à des nécessités plus modernes.
La coutume de Bretagne qui condense le droit public et privé du pays, est inspirée par une moralité très haute et par un idéalisme élevé. Les idées religieuses, la famille, la charité, la tolérance y tiennent une grande place. « Son caractère le plus remarquable, dit Planiol, est l'esprit de solidarité qui l'anime. On chercherait vainement ailleurs, non pas le droit, mais le même accent d'honnêteté, de bonté, le même souci non seulement de justice, mais de charité. Cette tournure d'esprit est propre à la Bretagne ». Or, ce sont également de ces principes que s'inspirait le gouvernement ducal.
La centralisation du pouvoir politique aux mains des ducs s'était opérée peu à peu ; mais l'évolution qui accroissait les droits du souverain tempérait également la puissance que les événements tendaient à lui donner, en développant les institutions politiques et administratives du peuple breton. Si dans la plupart des pays féodaux, la reconstitution de la souveraineté est passée par les mêmes phases, il est rare de voir s'accomplir ce qui s'est passé en Bretagne : un développement parallèle et harmonieux des pouvoirs du duc comme des droits de ses sujets. L'évolution a tendu dans les pays centralisateurs, en France en particulier, à faire disparaître entièrement les franchises féodales et les libertés qu'elles garantissaient aux seigneurs comme à leurs vassaux, aux bourgeois comme aux artisans : en Bretagne, au contraire, l'évolution n'a dépouillé ces franchises et ces libertés que de ce qu'il y avait en elles d'anarchique et d'inconciliable avec un gouvernement qui devait obéir à des nécessités plus modernes. Elle en a conservé le meilleur : l'esprit de ces antiques institutions nordiques qui fut toujours le frein le plus efficace à l'établissement du despotisme et de la servilité. Le résultat fut un remarquable développement de l'esprit public dans toutes les classes de la nation. Les admirables résultats pratiques que donnaient les méthodes administratives si humaines du gouvernement breton venaient encore consolider l'inébranlable attachement du peuple à sa constitution politique et à sa liberté.
La prospérité du pays, favorisée par la modération des charges publiques s'était affirmée particulièrement sous le règne du duc Jean V, administrateur éclairé, qui a laissé une œuvre législative considérable. Essentiellement décentralisateur, le gouvernement breton favorisait l'accomplissement de grands travaux publics, mais il laissait à la ville ou à la région intéressée toute liberté d'action. Loin d'entraver l'initiative privée, il la favorisait de tout son pouvoir, subventionnant même les entreprises qui présentaient le caractère d'entreprises nationales. Mais si l'Etat Breton se renfermait dans son rôle de défenseur des intérêts publics, et répudiait tout monopole, il ne laissait pas agir sans contrôle les fermiers des impôts et les grandes entreprises. Il estimait que son premier devoir était de surveiller toutes les branches de l'activité nationale et de réprimer les abus : ce fut le principe administratif de tous les souverains bretons. Jean V, en particulier, intervint fréquemment pour réprimer les exactions et faire rendre à ses sujets une bienveillante justice. Déjà le duc Pierre II avait organisé l'assistance judiciaire gratuite. Pour statuer sur les réclamations auxquelles donnait lieu l'impôt des fouages, Jean V envoyait sur place un de ses agents avec cette mission : « Faites ainsi que vous verrez qu'il sera à faire de raison, en forme que pour le temps à venir elle se puisse perpétuer au mieux pour le profit de nos sujets ». Les litiges étaient ainsi réglés sur place, selon une situation de fait précis, et non selon des textes, démontrant une fois de plus la supériorité de la coutume sur la règle latine du droit écrit.
Les ordonnances de Jean V dénotent souvent aussi des conceptions économiques et sociales très audacieuses pour l'époque. Parmi celles-ci, l'ordonnance de 1425, sur l'administration générale du pays, discutée et approuvée par les Etats à Vannes, fut le point de départ d'une véritable révolution économique, qui donna à la Bretagne une longue avance sur toutes les autres nations. Elle réservait pour l'industrie et la consommation locale certains produits de première nécessité, établissait un service de répression des fraudes, instituait l'unité de poids et mesures, fixait le minimum de salaire pour les ouvriers de l'industrie.
Toutes ces mesures adaptées aux besoins du pays déterminèrent une ère de prospérité incomparable. Aussi le bon chroniqueur Alain Bouchard, sans exagérer beaucoup, pouvait-il écrire au moment de la réunion à la France, que la Bretagne « florissait en toutes prospérités, qu'il n'était de petit village où l'on ne put trouver de la vaisselle d'argent » ; que la Bretagne « est un véritable paradis terrestre, alors que le royaume de France est en telle misère que l'on n'y peut trouver refuge de sûreté ».
*
**
Fière de sa liberté, calme et forte, la Bretagne portait donc à ses antiques institutions un attachement profond et légitime. Aussi, nous dit l'aumônier de la reine Anne : « Quand les Bretons connurent que le roy de France les voulait de fait appliquer à lui et les régir selon ses lois, lesquelles ne s'accordaient pas aux leurs, parce qu'ils avaient toujours été en liberté sous leurs princes, et ils veoient les Français comme serfs chargés de maints subsides, ne voulant obtempérer à l'intention du roy, commencèrent à faire monopolle et eurent conseil ensemble de se défendre ».
Ce passage résume admirablement les raisons de la répugnance de toute la Bretagne pour l'union définitive avec le royaume de France. Le fait de la réunion n'était rien : la cause française avait de nombreuses sympathies dans le peuple comme à la cour. Mais les Bretons, comme jadis, craignaient les lois du roi de France et tenaient à conserver les leurs.
L'opposition dernière qui se manifesta aux Etats de 1532 ne se basait pas sur d'autres arguments. Aussi l'Acte d Union fut-il, en plus d'une nécessité constitutionnelle, acte de grande sagesse politique de la part du roi de France. Le souverain français paraissait aussi rester un duc de Bretagne en même temps qu'un roi de France. Si la souveraineté extérieure de la nation bretonne disparaissait, la Bretagne n'en paraissait pas moins garder sa liberté intérieure, son régime politique et administratif, ses coutumes particulières. Et pour les Bretons, particulièrement respectueux de la parole donnée et très sensibles au sentiment de l'honneur, la violation du serment solennel prêté par une personne royale à chaque début de règne, de respecter les institutions et les lois de la province n'était pas concevable.
Mais l'acte d'Union de 1532, ainsi conçu, malgré les nombreuses précautions qu'il prenait, devait-il conserver intégralement à la Bretagne les favorables institutions qui la régissaient ? La France, d'ailleurs, pouvait-elle lui sauvegarder, avec l'esprit libéral qui animait leur gouvernement, les résultats particulièrement heureux de la politique des ducs ?
En fait, le traité de 1532 conserva à la Bretagne, jusqu'en 1789, l'essentiel des libertés qui lui étaient si chères. Mais ce ne fut que grâce à l'exceptionnelle opiniâtreté de son peuple, dont l'esprit de résistance au pouvoir central se manifesta constamment, et parfois de façon violente, au cours des XVIIe et XVIIIe siècles. Les luttes que la Bretagne eut à soutenir étaient la conséquence des frictions inévitables qui devaient se produire entre deux peuples de régime et de tempérament différents, entre deux nations dont l'évolution politique s'était faite selon des principes opposés.
Les institutions de la Bretagne, la forme constitutionnelle et parlementaire de son gouvernement, l'accord harmonieux qui continuait d'y régner généralement entre les classes sociales, montrent que dans ce pays les transformations du droit public s'étaient faites pour le peuple, sinon pour et par lui. Le duc ne peut d'abord rien sans l'approbation des seigneurs, puis ensuite sans l'approbation des Etats, dont l'organisation progressive tend à donner une image de plus en plus fidèle de la nation.
Ce fut de très bonne heure au contraire que ces principes disparurent en France. La politique de la puissante maison capétienne a toujours été de faire de la France une monarchie absolue, qui deviendrait le centre de l'Europe, la plus forte nation d'occident. Pour réaliser ce projet, que nous appellerions aujourd'hui impérialiste, poursuivi par les rois de France, de règne en règne avec une remarquable et surprenante opiniâtreté, il fallait de toute nécessité abattre ce vieil esprit d'indépendance et de liberté, héritage celtique, qui se traduisit à l'époque médiévale par le régime féodal. Philippe Auguste, en attaquant les bases de ce régime, Philippe le Bel en livrant les coutumes nationales à la merci de ses légistes, furent les véritables fondateurs de l'absolutisme royal en France. Dès ce jour les juristes, épris de droit romain, vont s'efforcer non seulement de justifier les actes de la royauté, mais aussi de leur donner toute apparence de légitimité et de justice.
Et le picard Beaumanoir proclame : « Le roi est souverain par-dessus tout et a, de son droit, le général garde du royaume, pourquoi il peut faire tel établissement comme il lui plaît, pour le commun profit et chi il établit, i doit être tenu ». Alors qu'en Bretagne l'évolution politique continua d'obéir à cette maxime : « Lex fit consensu populi et constitutione regis », en France elle se fît sur ces paroles qui « faisaient bouillir le sang breton de notre illustre d'Argentré » : « Le roi ne tient fors de Dieu et de son épée, ce qui li plest à fère doit estre tenu par loi ». Cette phrase fut, depuis Philippe le Bel, l'évangile de tous les « politiques » du royaume de France.
*
**
Ce système, érigé en raison d'Etat, réclamait l'asservissement du peuple et la disparition de toutes les existences particulières. Bientôt la domination temporelle ne suffit plus. L'unification politique, presque complètement achevée lors de la réunion de la Bretagne à la France, ne faisait que précéder l'unification administrative. La difficulté de gouverner un royaume aussi étendu et aussi varié, dans ses institutions et dans ses lois, les nécessités nouvelles nées des guerres continuelles entreprises pour obéir à l'ambitieuse pensée des rois, obligeait le pouvoir central à une sévérité et à un despotisme accru vis-à-vis des collectivités comme des individus. Ainsi disparurent une à une les libertés coutumières, nées spontanément au cours des siècles, témoignages de l'effort collectif des générations, et fruits de leurs longues aspirations vers le bien du peuple et le libre gouvernement de la cité. Corporations, provinces, ordres, classes et toutes institutions particulières, furent transformés en organismes administratifs froids et rigides, d'où toute évolution était désormais exclue.
Les princes et leurs conseillers, préfaçant les initiatives révolutionnaires, en diffamant le passé, s'efforcèrent d'éteindre parmi leurs peuples tous les souvenirs d'indépendance légués par leurs ancêtres. Tout ce qui ne tenait pas à l'Etat fut calomnié, insulté, déshonoré par les historiographes et les légistes de cour. Tout ce qui était antérieur au grand roi passa pour entaché de barbarie et les dernières paroles de Louis XIV consacrèrent l'ultime et ambitieuse pensée qui, malgré tout, devait créer la France. « Les peuples sont nés pour obéir sans discernement, et les rois pour posséder tout et commander à tout ».
En face de cette conception, la lutte acharnée que soutint la Bretagne contre les exigences des rois les plus absolus, personnifia la résistance du vieil esprit celtique, avide d'indépendance et de liberté qui s'était conservé chez les Bretons. C'était l'esprit d'une civilisation particulière, une conception morale et philosophique du droit qu'il fallait défendre, d'un droit qui plaçait le bien du peuple au-dessus de tout, et pour qui la justice n'était pas suffisante car il fallait encore faire une place à la bienveillance et à la charité. Aussi, en face de conceptions inverses et du dogme de l'Etat-Dieu qui commençait à naître et dont nous souffrons aujourd'hui plus que jamais, des luttes parlementaires violentes et parfois des révoltes sanglantes opposèrent jusqu'à la Révolution la nation bretonne à la royauté française.
C'est ce divorce de conceptions, d'idées et de tempéraments entre les deux races, qui entretint pendant près de trois siècles entre la Bretagne et la France cette mésintelligence marquée par de terribles conflits. De nos jours encore, sous des manifestations et des modalités diverses, et à une époque où l'on parle depuis longtemps déjà du droit des peuples, la même lutte se perpétue. Mais c'est aussi dans ces mêmes dissemblances entre l'esprit français et l'esprit breton que l'on peut trouver la raison de cette incompréhension et parfois de cette hostilité sourde que l'on rencontre souvent encore dans tous les milieux, vis-à-vis de la Bretagne.
Yann Kerberio.
STUR n° 9 Avril 1937
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, france, bretagne, celtisme, celtitude, pays celtiques, armorique, celtes, nationalisme breton |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 11 novembre 2008
Qui était Morvan Marchal?

Qui était Morvan Marchal ?
Après la Première Guerre mondiale, ancien élève du lycée Saint-Martin de Rennes, Marchal est élève architecte à l'École des Beaux-Arts de Rennes. Il fonde, en 1918 le Groupe régionaliste breton, dont la revue est Breiz Atao (Bretagne Toujours). En janvier 1919, paraît le premier numéro de cette revue dont le but initial était essentiellement culturel. Il en assure la direction ainsi que celle de la Yaouankiz Vreiz (Jeunesse Bretonne) jusqu'en 1928.
Il conçoit le drapeau Gwenn ha Du en 1923. Artiste, poète et illustrateur, il apporte sa collaboration à de nombreuses publications bretonnes, aussi bien politiques que philosophiques. Il fait partie du groupe d'artistes bretons "Les Seiz Breur".
Il participe à la création du Parti autonomiste breton au premier congrès de Breiz Atao en septembre 1927 à Rosporden. On le retrouve dans le comité directeur du parti. En rivalité constante avec Olier Mordrel, il rompt souvent avec le mouvement Breiz Atao. Ayant quitté le PAB, il aurait adhéré un temps au Parti radical, dont il aurait été exclu pour ses prises d'opinion sur la Bretagne.
Lors de son congrès du 11 avril 1931, le PAB explose sous les divergences. Marchal adhère alors à la Ligue fédéraliste de Bretagne, dont il crée en 1932 la revue La Bretagne fédérale, déclinaison de gauche de la politique de Breiz Atao. En 1934, à la fin de la ligue, il rejoint le Mouvement fédéraliste breton, avec Gestalen, Francis Bayer du Kern, Goulven Mazéas et Rafig Tullou.
Il signe en 1938 Le manifeste des Bretons fédéralistes avec Y. Gestalen, Ronan Klec'h, Francis Bayer du Kern, Raphaël Tullou et Per Goulven contre la guerre à venir. Ce manifeste affirme :
« […] l'impérieux devoir de regrouper ceux de nos compatriotes qui ne veulent pas confondre Bretagne et Église, Bretagne et réaction, Bretagne et parti-pris puéril anti-français, Bretagne et capital, et encore moins Bretagne et racisme. » (p. 14)
Il se tourne vers les études philosophiques et occultistes et vers des études druidiques et symbolistes et fonde avec Francis Bayer du Kern et Rafig Tullou, Kredenn Geltiek (croyance celtique) et la revue Nemeton (La Clairière). Il est le néo-druide Maen Nevez ou Artonovios.
Il est condamné à la Libération à une peine d'indignité nationale. Il s'expatrier alors dans la banlieue parisienne et devient employé du gaz. Il laisse quelques contributions à des revues, dont Le Symbolisme de Marius Lepage, par ailleurs membre de la loge Volney du Grand Orient à Laval. Lui-même y aurait fait son entrée le 1er mai 1938[2].
Il meurt dans des conditions misérables, en 1963 dans la salle commune de l'hôpital Lariboisière.
Une rue du quartier de la Poultière au nord-est de Vitré porte son nom.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : bretagne, régions d'europe, nationalisme breton, armorique, celtisme, celtitude, celtes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook