
Parution du n°448 du Bulletin Célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Gianni Celati nous a quittés
Entretien avec Jean Guenot (II)
Un professeur suisse nous fait relire Bagatelles
Oscar Rosembly (1909-1990)
Rosembly dans Gringoire
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Parution du n°448 du Bulletin Célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Gianni Celati nous a quittés
Entretien avec Jean Guenot (II)
Un professeur suisse nous fait relire Bagatelles
Oscar Rosembly (1909-1990)
Rosembly dans Gringoire
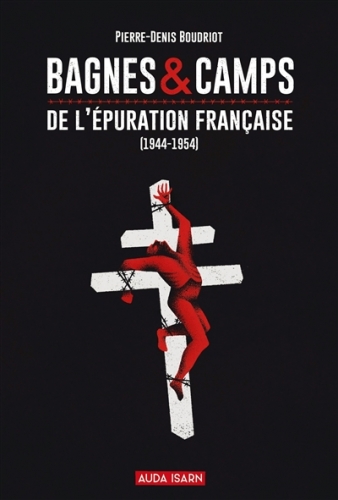
Mais c’est aux prisons françaises de l’épuration qu’un historien, Pierre-Denis Boudriot, vient de consacrer un livre d’autant plus passionnant que le sujet n’a jamais été traité auparavant. Cette plongée dans le monde carcéral de l’immédiate après-guerre est basée sur les nombreux témoignages de condamnés politiques. Aussi retrouve-t-on dans ce livre des personnages connus tels ceux déjà cités mais aussi Ralph Soupault, Lucien Combelle, Claude Jamet et d’autres qui payèrent parfois très cher leur engagement. L’auteur s’est également appuyé, ce qui est plus rare, sur les nombreuses notes et circulaires de l’administration pénitentiaire relatives aux maisons centrales et à leurs prisonniers. L’exceptionnelle richesse documentaire de ce fonds donne à cet ouvrage tout son prix. La confrontation de ces deux sources a permis de confirmer la véracité des écrits des épurés, souvent jugés tendancieux car pétris de ressentiment. De manière exhaustive, l’auteur analyse tout ce qui constitue la vie carcérale : le personnel pénitentiaire, la discipline, l’alimentation, le travail, la correspondance et le parloir, les lectures (autorisées), puis l’amnistie et les libérations conditionnelles ou anticipées. Et enfin, sous le titre « Une vie à recommencer », le retour au foyer. Ce sujet a concerné pas moins de 10.000 hommes et 4.000 femmes de toutes conditions sociales, connus ou pas. Un ouvrage dont le réalisme suscite une certaine compassion rétrospective tant les conditions de détention étaient dures à cette époque.
• Pierre-Denis BOUDRIOT, Bagnes & camps de l’épuration française (1944-1954), Auda Isarn [BP 80432, 31004 Toulouse cedex 6], 2021, 239 p., bibliographie et index (20 € franco)
09:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, revue, livre, épuration, univers carcéral, prison, années 40 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Michael WIESBERG :
Réflexions sur Le Zéro et l’Infini d’Arthur Koestler
 La vie d’Arthur Koestler fut loin d’être paisible et monotone. Après avoir abandonné ses études d’ingénieur à la « Haute Ecole Technique » de Vienne, il a émigré vers la Palestine où il a vécu de petits boulots occasionnels. Après ses mésaventures palestiniennes, les éditions Ullstein de Berlin lui offrent un poste de correspondant au Proche Orient, à Paris, puis un poste de journaliste scientifique à Berlin même. Cela durera de 1926 à 1931. Cette période est caractérisée par l’engagement passionné de Koestler pour la cause sioniste. En 1931, il change d’option : il s’engage dans le parti communiste allemand. Pendant la guerre civile espagnole, il écope d’une condamnation à mort et échappe de peu à l’exécution. Pendant la seconde guerre mondiale, il sert brièvement dans les armées française et britannique. Il finit par s’établir à Londres, où il écrira des ouvrages de vulgarisation scientifique. Le 3 mars 1983, il se suicide.
La vie d’Arthur Koestler fut loin d’être paisible et monotone. Après avoir abandonné ses études d’ingénieur à la « Haute Ecole Technique » de Vienne, il a émigré vers la Palestine où il a vécu de petits boulots occasionnels. Après ses mésaventures palestiniennes, les éditions Ullstein de Berlin lui offrent un poste de correspondant au Proche Orient, à Paris, puis un poste de journaliste scientifique à Berlin même. Cela durera de 1926 à 1931. Cette période est caractérisée par l’engagement passionné de Koestler pour la cause sioniste. En 1931, il change d’option : il s’engage dans le parti communiste allemand. Pendant la guerre civile espagnole, il écope d’une condamnation à mort et échappe de peu à l’exécution. Pendant la seconde guerre mondiale, il sert brièvement dans les armées française et britannique. Il finit par s’établir à Londres, où il écrira des ouvrages de vulgarisation scientifique. Le 3 mars 1983, il se suicide.
Le roman Le Zéro et l’Infini de Koestler paraît d’abord à Londres en 1940. La figure centrale et fictive de ce roman est un bolchevique de la vieille garde, ancien commissaire du peuple : Roubachov. Il est accusé de « menées contre-révolutionnaires », après que les services secrets soviétiques, les sbires du NKVD, l’aient arrêté et placé en détention. D’après Koestler lui-même, cette figure de fiction est inspirée par les dirigeants bolcheviques réels, et de premier plan, que furent Karl Radek, Nicolas Boukharine et Léon Trotski, qui, tous, en ultime instance, devinrent des victimes des purges staliniennes de la seconde moitié des années 30. En créant le personnage de Roubachov, Koestler a essayé de montrer, de manière exemplative, ce qui se passait dans les prisons du NKVD et d’expliquer comment ce noyau dur des anciens révolutionnaires d’octobre 1917 a pu être liquidé. Roubachov est confronté à deux autres personnages, ses adversaires tout au long de l’intrigue : Ivanov et Gletkine. Ils représentent deux générations de bolcheviques. Ivanov, le plus âgé, reçoit l’ordre de convaincre Roubachov de la nécessité de faire des aveux. Bien sûr, Ivanov sait que les crimes imputés à Roubachov sont purement fictifs. Et, malgré cela, il tente de convaincre celui-ci qu’il serait insensé de jouer les martyrs. On ne doit pas transformer le monde en un « bordel sentimental et métaphysique ». La pitié, la conscience, le remord et le doute doivent demeurer des « dérapages répréhensibles ». On ne doit pas abjurer la violence tant qu’il y a du chaos dans le monde. Tout compromis avec sa propre conscience, explique Ivanov au prisonnier, équivaut à de la désertion. Comme l’histoire est a priori immorale, toute attitude qui reposerait sur des décisions morales dictées par la conscience d’un individu, équivaudrait à faire de la politique en s’inspirant des bonnes paroles d’un prêche dominical. Pour cette raison, explique Ivanov, les blessures que ressent Roubachov dans sa propre conscience, au vu des hommes sacrifiés au nom de la « raison de parti », ne sont jamais que des « fictions grammaticales ».
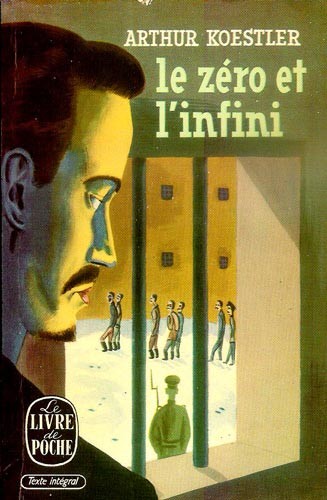 Pour Koestler, cette notion de « fiction grammaticale » doit nous expliquer cette part du moi que l’on ne définit pas comme « logique » mais comme « personnelle ». Or comme ce moi est inexistant pour le parti, mais que la grammaire réclame un substantif pour cette chose, Ivanov nomme cet aspect du « moi » celui de la « fiction grammaticale ». Roubachov, dans cette phase-là de sa détention, est tourmenté par des scrupules moraux, à cause de ses propres manières d’agir d’antan : celles-ci étaient déterminées exclusivement par un schéma de pensée rationnelle et acceptaient en toute conscience les pertes humaines qu’imposait cette rationalité. Ivanov réussit finalement à convaincre Roubachov que les idées, que celui-ci cultive et rumine, relèvent d’une « sentimentalité bourgeoise ». « On n’entendra aucun coq chanter », dit Ivanov, « si, objectivement parlant, des individus nuisibles sont liquidés ».
Pour Koestler, cette notion de « fiction grammaticale » doit nous expliquer cette part du moi que l’on ne définit pas comme « logique » mais comme « personnelle ». Or comme ce moi est inexistant pour le parti, mais que la grammaire réclame un substantif pour cette chose, Ivanov nomme cet aspect du « moi » celui de la « fiction grammaticale ». Roubachov, dans cette phase-là de sa détention, est tourmenté par des scrupules moraux, à cause de ses propres manières d’agir d’antan : celles-ci étaient déterminées exclusivement par un schéma de pensée rationnelle et acceptaient en toute conscience les pertes humaines qu’imposait cette rationalité. Ivanov réussit finalement à convaincre Roubachov que les idées, que celui-ci cultive et rumine, relèvent d’une « sentimentalité bourgeoise ». « On n’entendra aucun coq chanter », dit Ivanov, « si, objectivement parlant, des individus nuisibles sont liquidés ».
Ivanov conjure alors Roubachov de tirer les « conséquences logiques » de leurs conversations, et obtient du prisonnier que celui-ci se déclare prêt à signer un aveu qui va dans le sens de l’accusation. A partir de ce moment-là du récit, le roman prend une tournure dramatique. Ivanov, qui, lui aussi, est une figure controversée, est accusé d’avoir mené l’enquête sur Roubachov de manière trop négligente : il est alors remplacé par un représentant de la jeune génération de bolcheviques, qui ne connaît pas les compromis. Ivanov est ensuite liquidé.
Gletkine, qui prend la place d’Ivanov, représente, dans Le Zéro et l’Infini, une génération qui agit toujours sans réticence aucune selon la ligne fixée par le parti et qui ne connaît plus personnellement les circonstances vécues par les premiers bolcheviques dans la Russie des Tsars. La liste des crimes supposés que Gletkine présente à Roubachov, est en fait un ramassis d’accusations fantaisistes, dont, en tête, celle d’avoir fomenté un attentat contre le « numéro un », Staline. La volonté de résister, chez Roubachov, est ensuite annihilée par l’application d’une procédure d’audition véritablement éreintante. Au cours de cette longue audition, on apprend pour quels motifs Roubachov doit être sacrifié. « L’expérience nous apprend », explique Gletkine, « que l’on doit donner aux masses des explications simples et compréhensibles pour les processus difficiles et compliqués ». Si l’on disait aux paysans que malgré « les acquis de la révolution », ils sont restés fainéants et arriérés, on n’obtiendra rien. Mais si on leur explique qu’ils sont des « héros du travail » et que l’on attribue les maux qui les frappent encore à des saboteurs, alors on obtiendra quelque chose. Gletkine explique alors de manière fort plausible que le parti est régi par le principe que « la fin justifie les moyens ». Le parti attend donc des « vieux bolcheviques » qu’ils se sacrifient. La raison de cette exigence réside dans le fait que la guerre menace l’Union Soviétique. En cas de guerre, s’il y a des mouvements d’opposition, cela peut conduire à la catastrophe. Gletkine déclare alors à Roubachov qu’on lui reproche d’avoir, en liaison avec d’autres opposants, tenté de provoquer une scission au sein du parti. Si son repentir est « vrai », alors Roubachov doit aider le parti à éliminer cette scission. Il s’agit de montrer aux masses que tout opposant est un « criminel ». Après la victoire finale du socialisme, explique Gletkine, la vérité reviendra sans doute à la surface. A ce moment-là, Roubachov et les autres recevront la gratitude qui leur revient. Complètement brisé, Roubachov accepte pour finir de signer des aveux de culpabilité. Deux balles dans la nuque mettent fin à son existence.
Si l’on cherche à évaluer les conséquences des « grandes purges » pour l’Union Soviétique, l’attention se focalise immanquablement sur les successeurs des « vieux bolcheviques ». La nouvelle génération fut celle qui se soumit de manière inconditionnelle au parti. A la fin de la « tchistka » (de la « purge »), se dresse la pâle figure de l’apparatchik, caractérisée par une « non-identité ». Staline a créé les conditions préalables d’un système de parasites et de pleutres qui n’ânonnaient rien d’autre que les slogans doctrinaires du parti. Sous Staline, le matérialisme cru du marxisme-léninisme est entré dans un processus de perversion, dont l’apogée la plus emblématique fut l’émergence d’une pensée purement immanentiste, érigée au rang de dogme. C’est ainsi, in fine, que Staline a introduit les conditions initiales de l’effondrement final des systèmes sociaux du « socialisme réel » ou, plutôt, de l’égalitarisme radical. L’idée d’un ordre socialiste juste est resté une chimère en Europe orientale, pour laquelle des millions d’hommes ont dû sacrifier leur vie.
L’histoire ne se répète pas. Une tyrannie à la Hitler ou à la Staline ne se présentera plus. Mais il est certainement une chose que le livre de Koestler nous enseigne, et qui reste valable aujourd’hui : il nous montre où nous mène un monde régi par la pleutrerie et la pensée conformiste. Une république qui se vante d’incarner la liberté et la démocratie n’est pas pour autant immunisée contre les tumeurs totalitaires. Il faut donc toujours, dans tous les cas de figure, apprendre à se défendre contre la pleutrerie et le conformisme dès qu’ils se pointent à l’horizon.
Michael WIESBERG.
(article paru dans « Junge Freiheit », Berlin, n°11/1996, dans la série « Mein Lieblingsbuch / Folge 6 : « Sonnenfinsternis » von Arthur Koestler – Chronik der stalinistischen Säuberung » / « Mon livre favori / 6°partie : « Le Zéro et l’Infini » d’Arthur Koestler – Chronique des purges staliniennes » - Trad. franç. : octobre 2010).
00:10 Publié dans Littérature, Livre | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : littérature, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, communisme, arthur koestler, anticommunisme, années 30, purges staliniennes, stalinisme, épuration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
 Les résultats de la libération et de l'épuration en Belgique
Les résultats de la libération et de l'épuration en Belgique
Archives du "CRAPOUILLOT" - 1995
Sans nul doute, la collaboration a connu une plus grande ampleur en Belgique qu'en France. En mai 1940, les services de la Sûreté belge et les autorités françaises commettent une maladresse de taille en arrêtant tous les partisans de la paix ou de la neutralité qui «ne voulaient pas mourir pour Dantzig»: les communistes, juifs de nationalité allemande, italiens anti-fascistes, nationalistes flamands, rexistes et partisans de Joris Van Severen, le «national-solidariste thiois», chef d'un «ordre militant», purement idéaliste, sublime et patriotique. Les policiers belges livrent leurs co-nationaux aux Français qui les traînent de Dunkerque au pied des Pyrénées en leur faisant subir les pires sévices: Léon Degrelle et René Lagrou (nationaliste flamand), qui ont survécu de justesse à ce calvaire nous ont laissé des témoignages poignants: Ma guerre en prison (éd. Ignis, Bruxelles, 1941) et Wij Verdachten (= “Nous, les suspects”, Steenlandt, Bruxelles, 1941). Joris Van Severen et son adjoint Jan Ryckoort sont abattus, avec une vingtaine d'innocents, à la sortie du kiosque d'Abbeville, où on les avait enfermés. Après la capitulation de l'armée belge et du roi Léopold III, Paul Reynaud fustige le souverain en usant d'un vocabulaire particulièrement maladroit et, du coup, les réfugiés flamands et wallons sont mal accueillis en France, ce qui ruine trente ans d'amitié franco-belge.
Les prisonniers politiques de mai 1940 reviennent au pays animés par un ressentiment dont on ne mesure plus guère l'ampleur (1). L'ancienne solidarité franco-belge, sévèrement critiquée par le mouvement flamand pendant l'entre-deux-guerres, fait place à une germanophilie qui conduit une frange de l'opinion, favorable aux personnalités arrêtées et déportées dans les camps pyrénéens, à réclamer aux Allemands le retour des deux départements (Nord, Pas-de-Calais), enlevés aux Pays-Bas par Louis XIV et considérés comme d'anciennes «terres impériales». Ces départements sont effectivement placés sous l'égide du gouverneur militaire allemand de Bruxelles, mesure ambigüe destinée à calmer les esprits, sans offenser Vichy. Un an plus tard, la «croisade anti-bolchévique», avec le départ de la «Légion Wallonie» de Degrelle pour le front russe, va éclipser cette pré-collaboration francophobe et inaugurer un «européisme» national-socialiste, qui reprend à son compte certains accents de l'internationale socialiste. Une bonne part de la collaboration nouvelle ne repose plus sur des réminiscences historiques ou des ressentiments personnels, mais sur une admiration du système social allemand, basé sur la notion de Volksgemeinschaft, de «communauté populaire». Les groupes collaborateurs les plus extrémistes sont d'ailleurs issus de la gauche et de l'extrême-gauche, où les réflexes patriotiques classiques ne jouaient plus beaucoup: pour ces militants, l'allégeance allait au pays qui avait le système social le plus avantageux pour la classe ouvrière, en l'occurrence, l'Allemagne, mère-patrie de la social-démocratie. Et quand Degrelle proclame que les «Wallons sont des Germains de langue romane», ce n'est pas qu'une vile flatterie à l'égard du vainqueur, mais une volonté tactique 1) de participer à un ensemble politique «impérial», où les «Pays-Bas autrichiens», qui allaient devenir la Belgique en 1830, avaient joué un rôle important, notamment sur le plan militaire, et 2) de ne pas être exclus, en tant que Wallons, d'un «ordre social» qui séduisait les masses ouvrières du «Pays Noir», dont l'idéologie était «sociale-démocrate» à la mode allemande et dont le type de vie était très proche de ceux de la Ruhr ou de la Sarre. Mines et sidérurgie forgent une solidarité implicite qui va au-delà de tous les autres clivages.
Ces quelques faits montrent que la collaboration n'allait pas se limiter aux seuls mouvements nationalistes, mais se capillariser dangereusement dans tout le corps social. Le gouvernement Spaak-Pierlot —ou du moins ses vestiges d'après la tourmente— qui s'était transplanté à Londres, percevait le danger du clivage insurmontable qui se dessinait en Belgique: deux camps antagonistes se faisaient face, les partisans de l'ordre ancien (toutes oppositions sociales sublimées) et les partisans de l'«Ordre Nouveau». Entre les deux, un établissement fidèle au Roi qui tente d'imposer une voie médiane, de sauver l'indépendance du pays, d'avancer quelques-uns de ses pions dans une certaine collaboration «nationaliste de droite». Mais cet établissement demeure hostile à la IIIième République, au gouvernement de Londres, aux communistes et, au sein de la collaboration, aux nationalistes flamands indépendantistes et «républicains». Il se méfie bien sûr des autorités proprement nationales-socialistes et table sur les éléments traditionnels et conservateurs de la diplomatie et de l'Etat allemands.
Dans la rue et les campagnes, surtout à partir de 1943, règne une atmosphère de guerre civile: rexistes et nationalistes flamands, ainsi que les membres de leurs familles, sont abattus sans autre forme de procès, sans distinction d'âge ou de sexe. En 1944, les collaborateurs passent à la contre-offensive qui, à son tour, entraîne de nouvelles représailles: la spirale atteint son horreur maximale à Courcelles en août 1944, quand la «Brigade Z» du parti rexiste venge cruellement la mort des siens, notamment l'assassinat du maire de Charleroi et de sa famille, en exécutant sommairement 27 personnes (2).
Ce formidable imbroglio aurait dû, après la victoire des armes anglaises et américaines, être démêlé par une justice sereine, patiente, douée de beaucoup de tact. Il n'en fut rien. Personne n'a mieux stigmatisé cette «justice de roi nègre» que le Professeur Raymond Derine, un éminent juriste de l'Université Catholique de Louvain (3). La justice militaire de l'épuration est une honte pour la Belgique, explique ce juriste, pour quatre faisceaux de raisons:
1) Le gouvernement de Londres prépare dès 1942 une épuration sévère, sans plus avoir le moindre contact physique avec la Belgique occupée et sans comprendre les motivations réelles, et si complexes, des futurs réprouvés. Paul Struye, Président du Sénat et résistant, écrira dans ses mémoires: “les 20.000 héros revenant de Londres et découvrant en Belgique 8.000.000 de suspects dont 4.000.000 au moins de coupables” (4). La collaboration fonctionnera dès lors à coup de lois rétroactives, hérésie juridique dans tout Etat de droit.
2) Les juridictions d'exception sont essentiellement militaires: elles ont donc tendance à réclamer des peines maximales. Dans ces excès, le ressentiment des vaincus de 1940 et des pensionnaires des Oflag, appelés à prononcer les peines, a joué un rôle prépondérant. Ces militaires n'avaient pas eu de contact avec la Belgique réelle et n'avaient vécu la guerre qu'au travers de fantasmes répétés à satiété pendant de longues années d'inactivité forcée.
3) La nomination de substituts très jeunes et inexpérimentés, tentés de faire du zèle en matière de répression.
4) Enfin, en Flandre, les magistrats civils et militaires appelés à juger les faits de collaboration sont majoritairement issus de la bourgeoisie francisée, procédurière, marchande, généralement inculte, confinée dans l'étroitesse d'esprit de son pauvre unilinguisme et hostile à toute intellectualité; ces hommes vont tout naturellement être tentés d'éradiquer définitivement une idéologie populaire, intellectuelle, polyglotte, donc ouverte au monde, et plus honnête dans ses pratiques: le nationalisme de libération flamand, opiniâtre et infatigable, qui contestait leur pouvoir à la racine. Avec un tel ressentiment, ces individus ne pouvaient évidemment prononcer une justice sereine. Mais la répression frappera plus durement les intellectuels francophones que leurs homologues flamands. Pour plusieurs raisons: le vivier intellectuel flamand était presque entièrement “contaminé” par des éléments idéologiques que l'établissement considérait “subversifs” par définition tel le populisme romantique qui mettait le peuple au-dessus de toutes les instances étatiques et générait ainsi une contestation permanente de l'Etat belge calqué à l'époque sur le modèle centraliste jacobin. La répression a certes frappé les intellectuels flamands, plus nombreux que leurs collègues wallons, mais les condamnations à mort ont été rares et aucune n'a été suivie d'exécution. Le poète Wies Moens, le poète et humoriste Bert Peleman, le prêtre, théologien, philosophe et historien de l'art Cyriel Verschaeve ont été condamnés à mort: Peleman a été grâcié, Moens a fui en Hollande (les autorités néerlandaises ont refusé de l'extrader), Verschaeve s'est réfugié dans un couvent tyrolien (des militants flamands ramèneront sa dépouille dans son village en 1975). Beaucoup d'écrivains ont été arbitrairement arrêtés, emprisonnés voire maltraités, dans les premières semaines de la libération, mais n'ont été ni jugés ni poursuivis ni condamnés. Ils ont toutefois gardé une ineffaçable rancune contre l'Etat et se sont juré de lui faire payer les avanies subies, même les pécadilles: l'Etat belge n'a plus reçu l'aval de l'intelligentsia dans son ensemble, qui n'a plus cessé de le dénigrer, de répandre un “mauvais esprit” et d'en saper les assises. En revanche, les responsables politiques flamands, grands idéalistes, payent le prix du sang; le martyrologue est aussi long qu'épouvantable, surtout quand on connaît la probité morale des condamnés: Leo Vindevogel, Theo Brouns, Lode Huyghen, Marcel Engelen, Karel De Feyter, Lode Sleurs, August Borms...
La répression contre les intellectuels, surtout en Wallonie, prendra, dans ce contexte, une tournure dramatique et particulièrement cruelle, comme si le pouvoir, détenu par des classes en déclin, voulait éliminer par tous les moyens ceux qui, par leurs efforts, étaient la preuve vivante de son infériorité culturelle, c'est-à-dire de son infériorité absolue. Paul Colin, le brillant critique d'art qui introduisit l'expressionnisme allemand à Bruxelles et à Paris, le plus talentueux journaliste du pays à qui l'on doit une merveilleuse histoire des Ducs de Bourgogne, est abattu comme un chien dans son bureau à Bruxelles en 1943, son remplaçant Paul Herten sera fusillé en octobre 1944, dans des conditions abominables, qu'a dénoncées l'ancien résistant Louis De Lentdecker, écœuré par l'hystérie de cette époque (5). Le philosophe José Streel, qui avait pourtant abandonné la collaboration en 1943, est fusillé en 1946 (6) , de même que les journalistes Victor Meulenyser et Jules Lhoste. Pierre Daye, correspondant de Je suis partout, parvient à fuir en Argentine. Raymond de Becker, correspondant avant-guerre de la revue Esprit, écope de vingt ans de bagne, de même que Henri De Man, un des plus grands théoriciens socialistes du siècle. Robert Poulet est condamné à mort et attendra sa grâce pendant 1056 jours d'isolement, pour ensuite émigrer à Paris et offrir son grand talent à la presse non-conformiste de France. Parmi les écrivains «prolétariens», d'origine communiste ou socialiste, Pierre Hubermont, animateur des “Cercles Culturels Wallons”, est condamné à vingt ans de travaux forcés et sa carrière est définitivement brisée; son jeune disciple Charles Nisolles est fusillé en 1947. René Baert est abattu par des militaires belges en Allemagne en 1945. Son ami le peintre surréaliste Marc Eemans, qui n'a écrit que des articles sur les arts, le tourisme et les traditions populaires, est condamné à huit ans de prison (il en fera quatre). Le brillant germaniste Paul Lespagnard est également fusillé. Le sublime Michel de Ghelderode est insulté, humilié publiquement et chassé de son modeste emploi de fonctionnaire municipal à Schaerbeek. Félicien Marceau se réfugie à Paris, où il deviendra académicien. Simenon, le père du fameux Maigret, se replie à Genève. Hergé, le créateur de Tintin, est importuné à plusieurs reprises (7) et devra aller vivre sur les rives helvétiques du Lac Léman pendant quelque temps; son collègue, l'inimitable caricaturiste Paul Jamin (alias “Jam” puis “Alidor”) est condamné à mort mais heureusement ne sera pas exécuté: octogénaire avancé aujourd'hui, sa verve et son coup de crayon rehaussent toujours les pages de l'hebdomadaire satirique bruxellois Père Ubu. L'intelligentsia francophone non-conformiste fut littéralement décapitée à la suite de la répression, qui réussit là un coup de maître: plus personne ne peut se faire l'avocat des réprouvés en dehors des frontières, en usant d'une langue très répandue sur la planète.
 Les personnalités qui ont émis des critiques sévères à l'encontre de la justice répressive belge, ne nient pas pour autant la nécessité de punitions justes et appropriées, surtout pour trois motifs: 1) Le soutien apporté aux manœuvres arbitraires de l'ennemi, qui ont causé des dommages à la population ou lui ont apporté des souffrances inutiles; en clair, cela signifie réclamer des peines exemplaires pour les auxiliaires de la police allemande, surtout ceux qui ont agi pour des mobiles vénaux; 2) Le soutien apporté à l'armée ennemie après la libération du territoire en septembre 1944 (notamment au cours de l'offensive von Rundstedt dans les Ardennes); 3) Les actions qui ne sont pas moralement avalisables (dénonciations vénales, etc.). Ces trois faisceaux de motifs qu'avançait l'Action Catholique auraient permis une répression modérée, qui n'aurait pas laissé de séquelles psychologiques graves dans la population ni induit une frange de l'intelligentsia dans un négativisme permanent et systématique. Malheureusement ces suggestions humanistes restèrent lettre morte.
Les personnalités qui ont émis des critiques sévères à l'encontre de la justice répressive belge, ne nient pas pour autant la nécessité de punitions justes et appropriées, surtout pour trois motifs: 1) Le soutien apporté aux manœuvres arbitraires de l'ennemi, qui ont causé des dommages à la population ou lui ont apporté des souffrances inutiles; en clair, cela signifie réclamer des peines exemplaires pour les auxiliaires de la police allemande, surtout ceux qui ont agi pour des mobiles vénaux; 2) Le soutien apporté à l'armée ennemie après la libération du territoire en septembre 1944 (notamment au cours de l'offensive von Rundstedt dans les Ardennes); 3) Les actions qui ne sont pas moralement avalisables (dénonciations vénales, etc.). Ces trois faisceaux de motifs qu'avançait l'Action Catholique auraient permis une répression modérée, qui n'aurait pas laissé de séquelles psychologiques graves dans la population ni induit une frange de l'intelligentsia dans un négativisme permanent et systématique. Malheureusement ces suggestions humanistes restèrent lettre morte.
A partir de septembre 1943, la terreur prend une ampleur considérable; en 1944, elle fera 740 victimes politiques (principalement des collaborateurs). Le nombre d'actes de pur banditisme atteint des proportions jamais vues depuis l'âge sinistre des guerres de religion. Paul Struye était attéré: «Le respect de la vie humaine a disparu. On tue pour un rien. Il arrive qu'un homme soit abattu comme un chien sans qu'on sache s'il est victime de justiciers patriotes, de rexistes ou nationalistes flamands, de vulgaires gangsters, d'une vengeance individuelle ou simplement d'une erreur sur la personne. Des gens armés et masqués (...) terrorisent certaines régions, y introduisant des procédés de ku-klux-klan qu'on n'y avait jamais connus ou cru possibles» (8).
Après la conquête-éclair du territoire belge par les armées britanniques à l'Ouest et américaines à l'Est, des individus mus par une «colère populaire spontanée», surtout orchestrée par les communistes, procèdent à des arrestations en masse, non seulement de collaborateurs, mais de membres innocents de leurs familles ou de simples patriotes dont les opinions de droite étaient connues. Les hommes politiques modérés des partis traditionnels (libéraux, socialistes, catholiques) sont scandalisés et multiplient les protestations, parfois véhémentes sans rien pouvoir changer à la situation; le catholique Verbist s'écrie à la Chambre, fustigeant la “résistance” de l'après-occupation: «Les bourreaux nazis ont fait école» (9). Ces arrestations étaient perpétrées par des personnes privées ou des organismes partisans qui n'avaient aucun pouvoir de justice et n'agissaient que de leur propre chef. 50.000 à 100.000 personnes s'entassaient dans les prisons, dans des camps de concentration improvisés, dans les cages du jardin zoologique d'Anvers, dans les écoles réquisitionnées, etc., alors que les principaux collaborateurs s'étaient repliés en Allemagne, continuaient le combat sur le front de l'Est ou travaillaient dans les usines du Reich! Jamais les auteurs de ces actes de terrorisme n'ont été jugés pour leurs crimes et pour s'être arbitrairement substitué à l'Etat ou à ses services de police.
Le 17 décembre 1942, le gouvernement de Londres, agissant sans l'assentiment d'un Parlement élu (!), modifie les articles de loi réprimant l'intelligence avec l'ennemi, en réintroduisant la peine de mort et surtout en remplaçant les termes anciens (“a favorisé les desseins de l'ennemi dans une intention méchante”) par un terme nouveau, plus vague et permettant toutes les interprétations (“sciemment”). Les prévenus seront donc jugés sur des lois rétroactives non sanctionnées par un Parlement. En mai 1944, les “Londoniens” décident de nouveaux renforcements qui ne seront publiés que le 2 septembre, un jour avant l'arrivée des chars de Montgomery à Bruxelles: les condamnés perdront leurs droits civiques pour au moins dix ans, ne pourront plus devenir fonctionnaires, être jurés, experts ou témoins, faire partie d'un conseil de famille, etc. ni exercer les métiers d'enseignant, de journaliste (presse écrite et radiodiffusée), d'acteur de théâtre ou de cinéma ni occuper des postes de direction dans une entreprise commerciale, une banque, une association professionnelle, une association sans but lucratif (équivalent de l'assoc. loi 1901 en France) de caractère culturel, sportif ou philanthropique. Plus tard, les restrictions seront encore plus drastiques, prenant même une tournure ridicule par leur mesquinerie: suppression des indemnités pour les invalides de 1914-18 condamnés pour collaboration, interdiction de s'inscrire dans une université, de recevoir des allocations familiales, d'avoir un compte-chèque postal (!) ou un raccord téléphonique et... de posséder des pigeons voyageurs (!!). 300.000 personnes, plus de 10% du corps électoral de l'époque sont frappées de mesures de ce type (10). En comptant leurs familles, cela fait plus d'un million de personnes jetées dans la précarité et livrées à l'arbitraire.
Pourtant, à Londres en 1942, le socialiste Louis De Brouckère ne réclamait que 700 à 900 arrestations, son collègue Balthazar, 1500! Le ministre de la justice Delfosse, qui arrive en 1942 à Londres et connaît l'ampleur de la collaboration, réclame 70.000 à 90.000 incarcérations. De Brouckère, rapportent les témoins (11), l'a regardé ahuri et lui a lancé: cela «nous paraît dangereux, sinon impossible». Du camp de concentration d'Oranienburg-Sachsenhausen, l'ancien ministre libéral Vanderpoorten, avant de mourir, donne des instructions humaines, témoignant de sa grandeur d'âme: «pas d'exécutions, envoyer les chefs, les meurtriers et les dénonciateurs dans un camp au Congo et laisser les autres tels qu'ils sont». Finalement, 405.067 dossiers s'accumuleront sur les bureaux des «auditeurs militaires», après la libération des innocents internés arbitrairement, mais toujours inscrits sur l'une ou l'autre liste noire et privés de leurs droits! Il était bien sûr impossible de traiter une telle masse de dossiers, ni de gérer le système pénitentiaire quand les cellules individuelles abritaient de quatre à huit pensionnaires: de cette masse de dossiers, on en a extrait 58.784, on a poursuivi 57.052 personnes dont 53.005 seront condamnées. Parmi celles-ci, 2940 condamnations à mort, suivies de 242 exécutions; 2340 peines à perpétuité. 43.093 personnes non condamnées restaient sur la liste noire, ce qui les excluait de l'administration ou de l'enseignement.
Dans son ouvrage sobre et serein, qui est le plus redoutable réquisitoire jamais posé sur la justice belge du temps de l'épuration, le Prof. Derine a énuméré les vices de forme et les aberrations juridiques qui ont entaché cet épisode sombre de l'histoire de Belgique. Son mérite est d'avoir ressorti toutes les critiques rédhibitoires formulées à l'époque par J. Pholien, futur premier ministre du royaume. Ces critiques portent essentiellement sur la rétroactivité des lois (une loi pénale ne vaut que pour l'avenir, toute autre disposition en ce domaine étant aberrante), sur le fait qu'elles ont été imposées par l'exécutif seul, sans sanction du pouvoir législatif et sur le caractère largement “interprétatif” du terme “sciemment” (remplaçant “avec une intention méchante”, cf. supra). Ensuite, le juriste H. De Page remarquait qu'une loi, pour être valable, devait, selon la tradition juridique belge, bénéficier «d'une publicité effective». Or une loi votée en mai 44 qui ne paraît au Journal Officiel que le 2 septembre et est applicable dès le 3, ne bénéficie pas d'une telle publicité. «Il n'est pas admissible d'astreindre tyranniquement, en vertu d'une présomption reconnue matériellement impossible, les citoyens au respect de règles qu'ils ignorent certainement» (12). Le recrutement de très jeunes juristes inexpérimentés, pour faire fonction de magistrat dans les tribunaux spéciaux et auxquels on attribuait des pouvoirs exorbitants, quasi illimités, ne pouvait conduire qu'à cette «justice de rois nègres», dénoncée par Pholien (13). Ensuite, le fameux article 123sexies, qui interdisait aux “inciviques” l'exercice de quantité de professions, réintroduisait subrepticement la «mort civile», et le montant énorme de certaines amendes exigées équivalait à la confiscation générale des biens et, parfois, à leur mise sous séquestre, toutes mesures abrogées par la Constitution. Autre artifice douteux: le prolongement fictif de l'état de guerre jusqu'au 15 juin 1949, ce qui permettait de maintenir en place les juridictions d'exception et de considérer les conseils de guerre comme étant “en campagne”, de façon à ce que leurs compétences territoriales demeurent illimitées (notamment sur le territoire allemand). Cet artifice permettait de procéder à des exécutions, contrairement aux dispositions qui supprimaient celles-ci en dehors des périodes de belligérance effective. Parmi les incongruités, rappellons que l'Union Soviétique n'était pas alliée à la Belgique qui n'entretenait pas avec elle de relations diplomatiques. Les volontaires des diverses unités allemandes luttant contre les armées soviétiques n'auraient normalement pas dû être inquiétés, du moins s'ils n'avaient pas agi sur le territoire belge contre des citoyens belges: pour pouvoir les punir, on a stipulé, dans la loi du 17 décembre 1942, «qu'est allié de la Belgique tout Etat qui, même en l'absence d'un traité d'alliance, poursuit la guerre contre un Etat avec lequel la Belgique elle-même est en guerre». L'Union Soviétique était donc l'allié d'un allié, en l'occurrence la Grande-Bretagne. Or celle-ci, tout comme la France, n'était pas un allié de la Belgique, mais un simple garant tout comme l'Allemagne, puisque la Belgique était neutre. De surcroît, elle n'était plus tout-à-fait belligérante depuis la capitulation du 28 mai 1940.
Une loi du 10 novembre 1945 introduit le système dit «des transactions»: l'accusé accepte sa faute et négocie avec l'«auditeur militaire» le montant de sa peine; s'il accepte la suggestion de l'auditeur, il est condamné à cette peine; s'il refuse, il reçoit une peine plus lourde! Porte ouverte aux pires maquignonnages, qui n'ont pas grand chose à voir avec le droit... Une loi de 1888 prévoyait la libération anticipée d'un détenu qui avait déjà purgé le tiers de sa peine (ou dix ans en cas de perpétuité). Cette procédure, courante pour les condamnés de droit commun, n'a pas été retenue par l'«Auditorat militaire» pour les condamnés politiques, ce qui induisait une discrimination notable en défaveur de ces derniers.
La législation arbitraire de l'épuration belge a conduit le pays dans une situation étonnante pour les critères occidentaux, dénoncée par le doyen de la faculté de droit de l'Université Catholique de Louvain (francophone), le Prof. P. de Visscher: «La législation sur l'épuration civique (...) a (...) donné naissance à une masse considérable de citoyens de seconde zone qui se trouvent dans l'impossibilité pratique de se réadapter à la vie sociale. La notion même des droits de l'homme, jadis considérés comme intangibles par cela même qu'ils tiennent à la qualité d'homme, s'en trouve dangereusement ébranlée de même que le principe fondamental suivant lequel aucune peine ne peut être prononcée sinon par les tribunaux de l'ordre judiciaire» (14).
Le Prix Nobel de médecine flamand, le Prof. C. Heymans a rappelé fort opportunément que l'Occident s'insurgeait à juste titre contre le sort fait à Monseigneur Mindzenty en Hongrie et au Cardinal croate Stepinac en Yougoslavie titiste mais ne soufflait mot sur le fait que Monseigneur van Assche avait été arrêté arbitrairement en Belgique et torturé jusqu'à ce que mort s'ensuive.
Tous ces vices de formes, ces anomalies juridiques, ces entorses aux droits de l'homme, constatés par les plus éminents juristes du royaume, flamands et francophones confondus, devait tout naturellement amener une fraction de l'opinion à réclamer l'amnistie pure et simple, voire la révision de certains procès ou des réhabilitations. Derine remarque que l'établissement belge et, pourrions-nous ajouter, ses auxiliaires communistes ou gauchistes (à qui on avait confié le «sale travail» des arrestations arbitraires en leur garantissant l'impunité), n'a cessé de réclamer l'amnistie en Espagne franquiste, au Chili ou en Afrique du Sud (Mandela) pour mieux cacher derrière un écran de fumée idéologique et médiatique la cruelle réalité belge en ce domaine. Avocat d'une amnistie sereine, dégagée de tout carcan idéologique collaborationniste, Derine rappelle que la France a résolu le problème de l'amnistie par un train de lois (1951, 1953, 1959) et que l'Union Soviétique a procédé de même dès le 18 septembre 1955 (y compris pour les soldats de l'armée Vlassov et pour les auxiliaires de la police allemande, pour autant qu'il n'y ait pas eu assassinat ou torture). Les termes du décret soviétique étaient les suivants: «Afin d'offrir à ces citoyens la possibilité de retrouver une existence et du travail convenables et de redevenir des membres utiles à la communauté populaire».
Aujourd'hui, en 1994, la Belgique, contrairement à l'URSS d'avant la perestroïka, n'a toujours pas accordé l'amnistie et certains citoyens subissent encore les séquelles de la répression. Le vaste mouvement en faveur de l'amnistie a touché toute l'opinion flamande, tous partis confondus. Mais cette mobilisation n'a servi à rien. En 1976, le juriste A. Bourgeois constatait que 770 dossiers de séquestre (théoriquement anti-constitutionnels!) n'avaient pas encore été refermés, 3500 à 4000 citoyens étaient encore privés de certains de leurs droits, 10.000 citoyens environ n'avaient pas récupéré leurs droits politiques et un nombre incalculable d'anciens fonctionnaires et enseignants n'avaient jamais pu réintégrer leur fonction et avaient dû choisir une autre carrière. Des milliers d'autres étaient toujours privés de certains droits concrets comme le remboursement de dommages de guerre, des limitations dans le montant de leur retraite, etc. (15).
Le combat en faveur de l'amnistie revêt surtout une dimension morale: si la Belgique avait agi humainement comme le Soviet Suprême en septembre 1955, elle aurait cessé d'être une démocratie fictive, aurait aligné son comportement politique sur les principes généraux inscrits dans la Charte des droits de l'homme et du citoyen et prouvé à l'ensemble de ses citoyens et au monde qu'elle est en mesure de garantir leurs droits comme n'importe quel pays civilisé. En proclamant l'amnistie, elle aurait abjuré la phase la plus noire de son passé et démontré aux prophètes de la haine, qui sont si tenaces, que toute entorse au droit doit nécessairement, un jour, être effacée et que l'obstination dans la rancune est la pire des vanités humaines.
Elsa Van Brusseghem-Loorne.
Notes:
Les lecteurs français liront avec profit les pages que Paul Sérant consacre à la répression belge dans Les vaincus de la libération, R. Laffont, Paris, 1964.
(1) Maurice De Wilde, De Kollaboratie, deel 1, DNB, Anvers/Amsterdam, 1985. L'histoire de ce livre est intéressante à plus d'un titre; son auteur, présentateur de la télévision d'Etat néerlandophone en Belgique, dont la sensibilité est nettement de gauche, a animé une série télévisée sur la collaboration qui l'a améné progressivement à réviser ses jugements et à rendre justice aux idéalistes. Dans ce premier tome de sa fresque, il démontre avec brio que si Belges, Français et, dans une moindre mesure, Britanniques n'avaient pas procédé à des arrestations arbitraires en mai 1940, et si Joris Van Severen n'avait pas été assassiné, la collaboration n'aurait pas connu une telle ampleur. Maurice De Wilde réouvre là le dossier d'un contentieux franco-belge qui n'a jamais été réglé.
(2) Alfred Lemaire, Le crime du 18 août ou les journées sanglantes des 17 et 18 août 1944 dans la région de Charleroi, Imprimerie/Maison d'éd. S.C., Couillet, 1947.
(3) Prof. Raymond Derine, Repressie zonder maat of einde?, Davidsfonds, Louvain, 1978.
(4) Paul Struye, Justice! Que faut-il penser de la répression?, texte d'une conférence prononcée à Bruxelles le 24 décembre 1944 avec le futur ministre catholique A. Verbist.
(5) Louis De Lentdecker, Tussen twee vuren, Davidsfonds, Louvain, 1985.
(6) Jean-Marie Delaunois, De l'Action Catholique à la collaboration, Ed. Legrain/Bourtembourg, Courcelles/Bruxelles, 1993. Biographie de José Streel, version grand public d'un mémoire défendu à l'Université Catholique de Louvain, ayant obtenu la plus grande distinction. Capital pour comprendre le rexisme. Pour saisir l'ampleur de la collaboration intellectuelle en Flandre, se référer à l'ouvrage de Herman Van de Vijver, Het cultureel leven tijdens de bezetting, DNB/Pelckmans, Kapellen, 1990.
(7) Thierry Smolderen & Pierre Sterckx, Hergé, portrait biographique, Casterman, Tournai, 1988.
(8) Paul Struye, L'évolution du sentiment public en Belgique sous l'occupation allemande, Bruxelles, 1945.
(9) Conférence prononcée à Bruxelles le 24 décembre 1944, aux côtés de Paul Struye, cf. note (4).
(10) A. Bourgeois, «Over Amnestie», in Kultuurleven, août-sept. 1976; «Balans van de repressie en epuratie», ibid.; «Opruiming van de gevolgen der repressie», ibid.
(11) Témoignage du Ministre des Colonies du gouvernement de Londres; A. de Vleeschauwer, le 29 mars 1949.
(12) H. de Page, Traité élémentaire de droit civil belge, tome 1, 1962, 3ième éd.
(13) Actes du Parlement, Sénat, 16 décembre 1948, p. 235.
(14) P. de Visscher, «Les nouvelles tendances du droit public belge», in La Revue Nouvelle, 1951, p. 125.
(15) A. Bourgeois, cf. articles cités en note (10).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : histoire, deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, belgique, flandre, wallonie, années 40, libération, épuration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
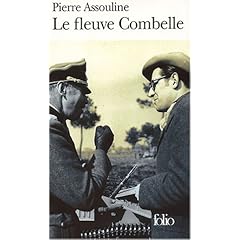
Lucien Combelle
...Voici bientôt quinze ans qu’il nous a quittés. Je n’ai dû le rencontrer qu’une ou deux fois, rue Monge où il habitait alors. C’était en compagnie de Laurence Granet qui avait soutenu, quelques années auparavant, une thèse de doctorat sur « L’idéologie fasciste dans les œuvres de Brasillach, Drieu La Rochelle, Rebatet ». Le souvenir de ces conversations s’est effacé. Je me souviens seulement du jour où, en public, il évoqua, au risque de lui nuire, son « éditeur fasciste » [sic] qui publia au début des années quatre-vingts ses souvenirs de prison. Cette sortie ne fut pas sans choquer un ami célinien qui fit cette réflexion : « Tout de même, il exagère, c’est lui qui a été fasciste ! ». Longtemps, j’ai cru que, dans son journal Révolution nationale, il s’était montré partisan d’un fascisme « libéral », je veux dire moins radical que celui prôné par ses confrères de la presse parisienne. Jusqu’à cet été 1988 où, pour annoter la correspondance que lui adressa Céline sous l’Occupation, je dépouillai, à la Bibliothèque Royale (de Belgique), la collection complète de cet hebdomadaire. Comme l’a également montré Jeannine Verdès-Leroux, qui s’est livrée au même exercice, Lucien Combelle était, bien au contraire, partisan d’un collaborationnisme sans concessions. C’est dire si Vichy n’était pas ménagé, surtout quand le régime prenait l’initiative, approuvé en cela par l’Église, de censurer en zone non occupée des écrivains jugés délétères : « Valéry, Fargue interdits. Demain Gide et Proust. Et Céline et Marcel Aymé. Et Montherlant. La France officielle semble vouloir retrouver sa beauté en avalant la jouvence de l’abbé Soury, et soigner ses blessures avec de l’eau bénite »¹. On n’est donc pas étonné de le voir dénoncer ensuite l’une des plus hautes autorités du clergé français, « Mgr Gerlier, primat des Gaules – quelle fâcheuse consonance ! – qui se permet de jouer au conseiller d’État et se mêler aux affaires de César. Monseigneur n’aime point l’antisémitisme. Monseigneur n’est pas révolutionnaire. (…) Il est démocrate et pluraliste, comme on dit. Bref, Monseigneur est, à sa manière, un dissident » ². Fustigeant le chef de l’Action française, Combelle n’y allait pas davantage de main morte : « M. Maurras a été antisémite et antidémocrate pour son bonheur et pour le nôtre. Mais, pour son malheur et pour celui de la France, M. Maurras reste germanophobe. La France, pour lui, c’est le félibrige » ³. « Révolution » est sans doute le mot qui revient alors le plus souvent sous sa plume : « Nous sommes, ou les acteurs, ou les témoins, selon une bonne ou une mauvaise fortune, d’une révolution mondiale, d’une révolution qui est née très exactement sur notre continent, dans cette Europe qui, pour notre orgueil, continue à étonner le monde » 4. « Grand garçon, intelligent, très cultivé, avec l’esprit caustique, bon avec les copains, plutôt désagréable avec ceux qui lui avaient fait dans les bottes, Combelle cultivait une pointe de cynisme » 5 : c’est ainsi que le décrit Henry Charbonneau, venu, comme lui, de l’Action française.
Après la guerre, Lucien Combelle présentera naturellement un profil nettement moins tranché. Ainsi, lors de l’émission « Apostrophes » (1978), il évoqua le « jeune fasciste sincère, de bonne foi et naïf » qu’il fut. C’est seulement chez le juge d’instruction, ajouta-t-il, qu’il découvrit ce qu’est la responsabilité des intellectuels. Philippe Alméras, qui l’avait rencontré, lui aussi, dans les années quatre-vingts, garde le souvenir de sa grande prudence : « Comme tous les ébouillantés de la Libération, il craignait l’eau froide 6 ». Céline entretint avec lui une relation du même type (un peu paternelle) que celle qu’il noua avec Henri Poulain, le secrétaire de rédaction de Je suis partout. D’une vingtaine d’années leur aîné, il ne craignait pas de les morigéner dès que paraissait dans leur journal respectif un article qu’il désapprouvait. Ainsi, à propos de cet éditorial sur (ou plutôt contre) Maurras : « Combelle fait l’enfant. Il sait aussi bien que moi l’origine de l’horreur de Maurras pour l’Allemagne – le Racisme 7. » Ou à propos d’un compte rendu du livre, Pétition pour l’histoire, d’Anatole de Monzie : « Tu dédouanes Monzie à présent et son histoire ? La merde est à ton goût ! Rien de plus pourri que ce vieux pitre – membre de la Ligue des Droits de l’Homme – membre de la Lica – grand ami de Lecache et Jean Zay ! » 8. Les exemples sont nombreux… Contrairement à Poulain, exilé en Suisse, Combelle reverra Céline. C’est seulement à la parution d’Un château l’autre qu’il reprit contact. « Tout ceci ne nous rajeunit pas ! » 9, lui répond Céline, une dizaine d’années après la tourmente qui les vit embastillés l’un à Copenhague, l’autre à Fresnes.
Marc LAUDELOUT
Notes
1. Lucien Combelle, « Avec ou sans prières », Révolution nationale, 22 août 1942.
2. Id., « Où en sommes-nous ? », Révolution nationale, 26 septembre 1942.
3. Id., « La France de M. Maurras », Révolution nationale, 31 mai 1942.
4. Id., « Ceci commande cela », Révolution nationale, 8 mai 1943.
5. Henry Charbonneau, Les mémoires de Porthos, La Librairie française, 1981 (rééd.).
6. Philippe Alméras, « Lucien Combelle relaps », Le Bulletin célinien, janvier 2006.
7. Lettre du 31 mai 1942 in L’Année Céline 1995, Du Lérot-Imec Éditions, 1996, p. 122.
8. Lettre du 21 août 1942, Ibidem, p. 127.
9. Lettre du 12 août 1957, Ibid., p. 154.
Bibliographie
Lucien Combelle est l’auteur de six livres : Je dois à André Gide (Frédéric Chambriand, 1951) ; Chansons du Mirador (Frédéric Chambriand, 1951) ; Prisons de l’espérance (ETL, 1952) ; Louis Renault ou un demi-siècle d’automobile française (La Table ronde, 1954) [signé d’un pseudonyme : Lucien Dauvergne] ; Péché d’orgueil (Olivier Orban, 1978) et Liberté à huis clos (La Butte aux cailles, 1983). Sous le titre « Céline, le pérégrin », il a préfacé un recueil de textes de Céline (Le style contre les idées, Complexe, 1987). Il a également écrit le scénario d’une bande dessinée de José Fernandez Bielsa, Quand les héros étaient des dieux (Dargaud, 1969). Au début des années 80, il avait l’intention d’écrire, en collaboration avec Laurence Granet, un Panorama des écrivains de l’Occupation ; le projet n’a pas abouti. En 1997, Pierre Assouline lui a consacré un livre, Le fleuve Combelle (Calmann-Lévy). L’année suivante, Lucien Combelle lui accorda une série de cinq entretiens dans le cadre de l’émission À voix nue sur les ondes de France-Culture (25-29 juillet 1998). Le 1er décembre 1978, à l’occasion de la parution de son livre de souvenirs, Péché d’orgueil, il participa – aux côtés de Henri Amouroux, Raymond Bruckberger, Jean-Luc Maxence et Dominique Desanti – à l’émission Apostrophes de Bernard Pivot sur le thème « Les intellectuels et la collaboration ». Il donna également son témoignage dans le film documentaire d’Alain de Sédouy et Guy Seligmann, Paris l’outragée (Antenne 2, 1989). On trouvera dans L’Année Céline 1995 (Du Lérot, 1996) la correspondance que lui adressa Céline, présentée et annotée par Éric Mazet. Plusieurs ouvrages retracent brièvement son itinéraire : Dictionnaire Céline de Philippe Alméras (Plon, 2004), Dictionnaire commenté de la Collaboration française de Philippe Randa (Jean Picollec, 1997) et Histoire de la Collaboration de Dominique Venner (Pygmalion, 2000). Sur son activité sous l’Occupation, on lira le livre de Jeannine Verdès-Leroux, Refus et violences. Politique et littérature à l’extrême droite des années trente aux retombées de la Libération (Gallimard, 1996), qui s’appuie sur une lecture de ses articles de l’Occupation.
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, littérature française, lettres françaises, france, années 30, années 40, épuration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
| L’Age de Caïn  L’AGE DE CAÏN Premier témoignage sur les dessous UN AUTRE SON DE CLOCHE. Oui, c’est un autre son de cloche que nous vous proposons avec cet ouvrage, un autre son de cloche sur « la libération » qui a suivi la seconde guerre mondiale, et toutes les festivités et les joyeusetés qui l’accompagnèrent. Car il paraît que le peuple de France ne peut s’émouvoir et ne célébrer dans son histoire – d’après ceux qui la rédigent et qui l’imposent aujourd’hui – que les grands massacres, les grands massacres fondés sur la haine de quelque chose qu’il faut faire disparaître pour pouvoir exister. Mais si les tueries de la « révolution » sont encore chantées, celles qui ont accompagné et suivi « la libération » sont savamment occultées – n’ont pas que l’on en ait honte, mais plutôt que l’on ait honte qu’il y eut de tels Français qu’il fallut éliminer, la bonne excuse. Précieux témoignage que cet ouvrage, donc. Il faut signaler qu’il n’a jamais été contesté, et que les noms et les événements qui y sont décrits le sont d’une manière très précise qui ne prête pas à confusion. Signalons toutefois que l’encyclopédie trotskyste en ligne « wikipedia » se permet d’informer ceux qui la consultent de la façon suivante : En 1948, Abel rédige le récit de sa détention (L'Âge de Caïn) où il critique sévèrement les méthodes employées par la les forces de la libération envers les détenus. Il s'attaque à ce qu'il juge être de l'épuration "sauvage". Cet ouvrage est toutefois suspect de révisionnisme et compte parmi le répertoire des textes dont se revendiquent aujourd'hui les négationnistes La belle affaire ! Car ce sont bien des dizaines de milliers de Français qui, à travers la France, furent sommairement exécutés, la plupart parfaitement innocents de ce qu’on leur reprochait, ou, plus directement, victimes de règlements de compte ; sans parler de tous ceux qui furent plus simplement incarcérés et torturés (…, car le ministère de l'intérieur, officieusement, donne des chiffres qui varient entre 80.000 et 100.000 exécutions sommaires. Citation d’une note de l’ouvrage). Quant à l’auteur de l’ouvrage, qui est-il ? Le livre est signé Jean-Pierre Abel, mais ce n’est là qu’un pseudonyme qui fait référence au titre L’âge de Caïn. Lisons à son sujet ce qu’en dit le site internet de bibliothèque en ligne « Aaargh » : Quelques précisions : Jean-Pierre Abel est en fait René Château. Elève d'Alain, Proche de Gaston Bergery, radical-socialiste et fondateur de la Ligue de la Pensée Française en 1940, directeur jusqu'en 1943 de La France Socialiste, quotidien de Déat. Il a été arrêté le 30 août 1944 comme collaborateur notoire et détenu à l'Institut d'hygiène dentaire et de stomatologie 158, avenue de la Choisy, pendant soixante seize jours. Cet immeuble fut réquisitionné dès la libération et transformé en centre de détention de collaborateurs par des FFI qui s'étaient arrogé le droit de rendre leur propre justice. Robert Aron, dans son Histoire de l'épuration, raconte que cent cinquante personnes, environ, y ont été emprisonnées (dont l'ancien député socialiste L'Hévéder dont il est question dans le texte) en dehors de toute légalité. Certaines furent fusillées dans l'enceinte de l'institut, d'autres furent repêchées dans la Seine. La Préfecture de police, avertie de ces faits, tenta d'y pénétrer mais accueillis à coups de mitraillette, les policiers reculèrent pour éviter un massacre. Le préfet de police Charles Luizet chargea le colonel FFI Aron-Brunetière, chef du 2ème bureau, de faire procéder à la fermeture de l'institut et des autres centres de détention (le lycée Janson de Sailly, la caserne de Reuilly, la mairie du 18ème arrondissement, l'hôtel du Dôme rue Léopold Robert ...). Les détenus, au nombre de 1500 environ, furent transférés à la prison de Fresnes où après un premier interrogatoire, 800 d'entre eux furent immédiatement libérés.
|
| 26 euros + 5 euros de port. |
00:13 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : deuxième guerre mondiale, seconde guerre mondiale, épuration, france, paris |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook