samedi, 30 août 2025
Petra Steger: «Le contrôle prévu des chats par l'UE est une attaque générale contre les droits fondamentaux et les libertés de la population européenne!»

Petra Steger: «Le contrôle prévu des chats par l'UE est une attaque générale contre les droits fondamentaux et les libertés de la population européenne!»
Le gouvernement fédéral autrichien est appelé à voter fermement contre les projets de surveillance numérique de Bruxelles au Conseil de l'UE !
Par Petra Steger
Source: https://www.fpoe.eu/steger-geplante-eu-chatkontrolle-ist-generalangriff-auf-grund-und-freiheitsrechte-der-europaeischen-bevoelkerung/
« La Commission européenne et la présidence danoise du Conseil ne lâchent pas prise : l'adoption prévue du règlement CSA au Conseil de l'Union européenne constitue une atteinte sans précédent aux droits fondamentaux et aux libertés des citoyens européens. Sous le couvert de la lutte contre la pédocriminalité, on crée un système qui prévoit essentiellement une surveillance de masse généralisée et l'affaiblissement du chiffrement de bout en bout », dit et met en garde Petra Steger, députée européenne (FPÖ), après que la présidence danoise du Conseil a fait du contrôle des chats l'une de ses priorités.
« La surveillance généralisée des chats privés constitue une violation flagrante des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux et de l'article 8 de la CEDH. Même le service juridique du Conseil de l'UE met en garde, dans un avis officiel, contre l'affaiblissement du chiffrement de bout en bout, qui constitue une atteinte massive à la vie privée des citoyens et une violation des droits de l'homme. Des défenseurs indépendants de la protection des données et le Parlement européen se sont également clairement prononcés contre les analyses de masse et l'érosion de la sécurité des communications. Seules la Commission von der Leyen et la présidence danoise du Conseil, qui agit désormais sous son égide, font avancer ce projet de surveillance avec toute leur énergie », poursuit Mme Steger.
Il est particulièrement préoccupant que la présidence danoise du Conseil veuille imposer un accord au Conseil dès septembre: « Le gouvernement fédéral autrichien est clairement appelé à voter contre la proposition danoise de contrôle des chats et à ne pas s'engager définitivement dans la voie anticonstitutionnelle de la censure et du contrôle numériques. Il ne faut en aucun cas accepter que les libertés fondamentales des citoyens soient sacrifiées au profit d'un régime de surveillance centralisé à Bruxelles. »
« La FPÖ opposera donc une résistance farouche au Parlement européen comme au niveau national. La population européenne a un droit inaliénable à la vie privée, à la confidentialité des communications et à la protection contre les fantasmes de toute-puissance de l'État. Nous défendrons ces droits fondamentaux par tous les moyens – contre le contrôle des chats, contre la censure et contre la frénésie de surveillance de Bruxelles. Notre engagement est en accord avec la grande protestation citoyenne et les milliers d'e-mails de protestation que nous avons reçus ces dernières semaines », a conclu la députée européenne du FPÖ, Petra Steger.

Petra Steger
Membre de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (LIBE) | Membre suppléante de la commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (ITRE) | Membre suppléante de la commission de la sécurité et de la défense (SEDE)
19:38 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : censure, surveillance, petra steger, fpö, autriche, europe, affaires européennes, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni poussent à une nouvelle guerre contre l'Iran

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni poussent à une nouvelle guerre contre l'Iran
par Davide Malacaria
Source: https://www.piccolenote.it/mondo/francia-germania-e-regno...
La réunion à Genève entre les délégations de la France, de l'Allemagne, du Royaume-Uni (les pays dits « E-3 ») et de l'Iran, visant à déterminer l'avenir de l'accord sur le nucléaire de Téhéran (JPCOA), suspendu après la guerre entre l'Iran et le duo Israël-États-Unis, a été un désastre. Le fait que Téhéran se préparait à accueillir une délégation de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) pour surveiller ses sites n'a servi à rien. Ce geste de bonne volonté a été ignoré.
Les trois pays européens – garants de l'accord avec la Russie et la Chine (les États-Unis s'en sont retirés) – ont décidé que l'Iran ne respectait pas les obligations qui lui incombaient en vertu de cet accord et ont donc décidé de dénoncer cette situation aux Nations unies, déclenchant ainsi le snapback, un processus qui devrait durer 30 jours, à l'issue duquel l'ONU pourrait réintroduire les sanctions contre la nation considérée comme réprouvée (levées à l'époque grâce au JPCOA).
Il semble que la bombe australienne, c'est-à-dire l'expulsion du pays des kangourous de la délégation diplomatique iranienne pour la responsabilité présumée de Téhéran dans deux attentats terroristes contre des cibles juives – qui a éclaté la veille du sommet en question – ait fait plus de dégâts que prévu.
Bien que l'issue du sommet ait déjà été prédéterminée, l'initiative australienne, qui n'était certainement pas fortuite dans ses modalités spectaculaires et son timing, a donné l'impulsion finale. Nous avons consacré une note à l'affaire australienne, en rappelant d'ailleurs le rôle du Mossad dans l'enquête qui a conduit Sydney à prendre cette mesure.
Dans cette note, nous mentionnions que le sommet de Genève avait probablement abouti à un résultat provisoire, interprétation optimiste découlant de l'absence immédiate de rapports et de l'annonce simultanée de l'arrivée des inspecteurs de l'AIEA à Téhéran. Malheureusement, cela ne s'est pas passé ainsi.

Trita Parsi (photo) écrit à ce sujet dans Responsible Statecraft, observant que la décision de l'E-3 rend plus probable une nouvelle guerre contre l'Iran. Commentaire véridique, même si nous ne partageons pas son affirmation selon laquelle le snapback rétablit automatiquement les sanctions de l'ONU.
De nombreuses variables entrent en jeu, notamment les options dont disposent la Chine et la Russie, pays alliés de l'Iran et, surtout, peu enclins à se plier aux diktats des faucons anglo-américains, d'où la possibilité que cette pression soit réduite à néant.
Il y a ensuite la possibilité d'un retour au dialogue : malgré la décision regrettable de l'E-3, Téhéran a tout de même accueilli les inspecteurs de l'AIEA, une ouverture qui pourrait ne pas être ignorée par l'administration Trump, malgré son manque d'autonomie lorsque les intérêts israéliens sont en jeu.
En annonçant son intention de recourir au snapback, l'E-3 a expliqué que cette décision visait à inciter l'Iran à reprendre le dialogue interrompu. Le commentaire de Parsi est lucide : « Loin de faire progresser la diplomatie, cette décision risque d'accélérer l'escalade. Alors qu'Israël n'a certainement pas besoin d'un prétexte pour attaquer à nouveau l'Iran [...], le snapback pourrait fournir une couverture politique utile – une fine couche de légitimité – pour de nouvelles attaques américaines ».
« L'E3 – poursuit Parsi – soutient que le snapback est nécessaire pour faire pression sur l'Iran afin qu'il reprenne les pourparlers avec les États-Unis et accorde à l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) l'accès à ses installations nucléaires, y compris la surveillance des stocks d'uranium enrichi à 60 % ». [La visite actuelle des inspecteurs de l'AIEA, a annoncé Téhéran, ne concerne que la centrale nucléaire de Busheir, ndlr].
« À première vue, ces demandes peuvent sembler raisonnables. Mais Téhéran nourrit des réserves légitimes. Les responsables iraniens soupçonnent l'AIEA d'avoir divulgué des informations sensibles qui ont permis la campagne d'assassinats ciblés du Mossad contre leurs scientifiques nucléaires et craignent que la divulgation de l'emplacement des stocks ne déclenche une nouvelle série d'attaques aériennes américaines ».
De plus, l'Iran était à la table des négociations lorsque Israël et les États-Unis ont commencé à bombarder. L'E-3 insiste désormais pour que Téhéran revienne à la table des négociations, mais ne demande pas en parallèle à Washington de s'abstenir de bombarder à nouveau.
« Le plus important est peut-être que, compte tenu du fossé infranchissable sur la question de l'enrichissement, de la patience limitée de Trump pour la diplomatie et de la pression israélienne pour reprendre les hostilités, la reprise de pourparlers qui seraient presque certainement voués à l'échec – à moins que les deux parties ne fassent preuve d'une plus grande flexibilité – ne ferait qu'augmenter la probabilité que la guerre éclate tôt ou tard.
« Mais c'est peut-être là le cœur du problème. L'E-3 d'aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir avec celui d'il y a vingt ans. Lorsqu'il a été créé en 2003, son objectif était d'empêcher l'administration Bush – qui venait de mener une invasion désastreuse et illégale en Irak – de lancer une nouvelle guerre, cette fois contre l'Iran. »
« Aujourd'hui, le contexte géopolitique a changé. L'alignement de l'Iran sur la Russie en Ukraine l'a conduit à être identifié comme une menace directe pour l'Europe. En outre, l'UE est beaucoup plus dépendante des relations transatlantiques qu'il y a 20 ans, tandis que les cycles successifs de sanctions ont fait de l'Iran un partenaire économique négligeable pour elle. »
« L'escalade avec l'Iran par le biais du snapback sert deux objectifs de l'UE : punir Téhéran pour son soutien à la Russie en Ukraine et aligner l'Europe sur les faucons de l'administration Trump [et d'Israël, ndlr], un alignement jugé nécessaire pour apaiser les tensions créées dans d'autres domaines d'une relation transatlantique qui subit une pression sans précédent ».
« En ce sens, la constellation E3, conçue en 2003 pour prévenir la guerre, pourrait, en 2025, nous en rapprocher. Mais ne vous fiez pas uniquement à ce que j'écris. Rappelez-vous comment le chancelier allemand a ouvertement admis qu'Israël « a fait le sale boulot pour le compte de l'Europe » en bombardant l'Iran en juin dernier ».
Un nouveau foyer d'incendie s'ajoute donc aux autres qui font rage au Moyen-Orient, avec Israël qui, en plus de se livrer au génocide de Gaza et de harceler de plus en plus la Cisjordanie, attaque la Syrie et le Yémen et fait pression, en collaboration avec les États-Unis, pour le désarmement du Hezbollah, une pression aussi brutale qu'injustifiée qui risque de déclencher une guerre civile au pays des cèdres. Une attaque contre l'Iran, mieux préparée et plus massive, s'inscrit dans cette logique expansionniste soutenue par les États-Unis et l'Union européenne.
18:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, europe, affaires européennes, iran |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La fin de la métaphysique rend-elle l’action impossible ?
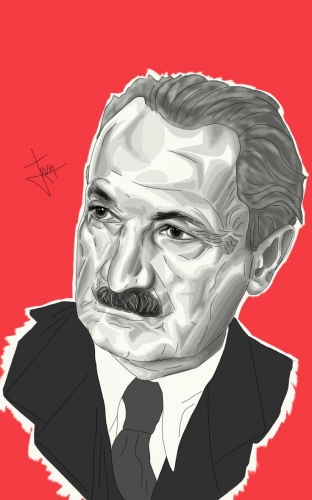
La fin de la métaphysique rend-elle l’action impossible?
Claude Bourrinet
J’ai synthétisé un artiche de Reiner Schürmann, dans le numéro des Cahiers de L’Herne, de 1983, consacré à Heidegger. Lorsque j’ai cité, j’ai placé des guillemets.
LA FIN DES PHILOSOPHIES PREMIÈRES
Lorsqu’on parle d’« action », on évoque en général la politique (au sens très large, et à partir d’une éthique), et parfois la guerre qui, comme on le sait, en est le prolongement. Précisons tout de suite que l’« impossibilité » de l’action n’implique pas que les hommes cessent d’« agir », ni, sur un autre plan, que la « Mort de Dieu » empêche de croire, ou de se rendre au culte. La question se pose plus globalement, non au niveau de la subjectivité (les hommes font quelque chose, souvent autre chose que ce qu’ils pensaient faire), ni de l’individu, ou du groupe, mais sur le plan historial. Au demeurant, « agir » présuppose qu’in fine existent des conséquences à l’action, et qu’il ne s’agit pas, comme l’on dit trivialement, de « coups d’épée dans l’eau », hypothèse pourtant qui risque bien de correspondre à quelque vérité.

Reiner Schürmann (1941-1993)
Il est absolument nécessaire de rappeler cette dimension constitutive de la condition humaine, ce rideau imaginaire, qui, comme une scène théâtrale, persuade le spectateur qu’il se passe quelque chose. L’homme est un être d’imagination, et, comme L’Ecclésiaste qui s’aperçoit, à la fin de sa vie, que tout est vanité, il arrive souvent que, du point de vue du Divin, ou, si l’on veut, de Sirius, toute l’agitation humaine, depuis un certain moment historique, s’est avéré être souffle de vent, et peut-être pire. Car il arrive que l’on fabrique sa propre désert, en croyant élever des tours jusqu’au Ciel.
La question essentielle est celle de la « présence », de ce qu’est un « monde », ou, comme Heidegger dit, de l’« évènement ». Bien sûr, d’« être » aussi, mais ce terme est quelque peu usé.
Comment concevoir une « philosophie pratique » (un engagement) à partir d’une « philosophie de l’être », qui semble bien abstraite ?
Depuis Socrate, on ne cesse de répéter que « vertu est savoir ». Agir positivement repose sur la raison, la theoria, la plus noble de nos facultés susceptible de nous mener dans les voies de la praxis. Agere sequitur esse. L’agir suit l’être, et l’être serait la raison.
Admettons que l’être et l’agir ne soient pas dissociables. Parler de la présence, c’est aussi parler de l’agir.
Concrètement, dans le domaine politique (et éthique), la question de l’agir est: « Quel est le meilleur système politique ? ».
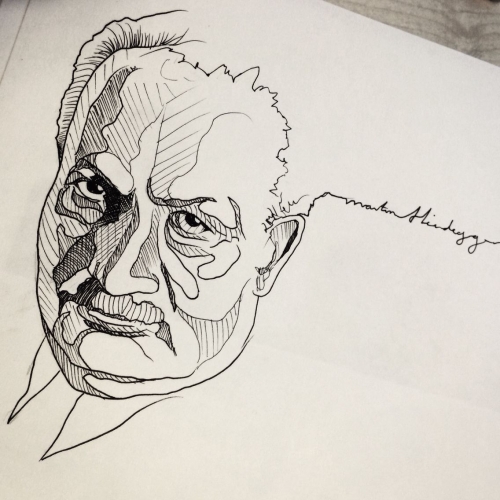
Heidegger affirme que, désormais, cette question est vide, que les représentations successives d’un fundamentum inconcussum, principe certain de toute certitude sur lequel peut et même doit reposer tout l’édifice du savoir — aussi bien les vérités théoriques de la science que les vérités pratiques de la morale —, mieux proposition de fond — Grundsatz, par exemple le Cogito ero sum, de Descartes, qui fonde la possibilité d’une mathesis universalis, de la connaissance du monde, de sa domination par le sujet, de la maîtrise de l’organisation de la Cité. Or, Heidegger objecte que la fin de la métaphysique, donc du sujet, aboutit à « fonder » dans un lieu déserté.
Le constat nihiliste interdit-il de rien « faire » ?
Qu’est-ce que la « loi », que sont les « règles pratiques »? Le nomos est la loi, une injonction décrétée – un « décret » - par la nature de l’être. Cette loi insère l’homme dans l’être. Elle le porte et le lie. Le nom ne peut être un artefact de la raison humaine. Le nomos doit conduire à la vérité de ce qu’est l’homme, afin d’y demeurer. Il dépend des « constellations historiques » de la présence.
Pour saisir ce dont il serait question pour nous, qui sommes conscients, depuis plus d’un siècle, de la Mort de Dieu, il faut partir de la notion de déconstruction (1927) (Abbau) de l’ontologie (de l’étude de l’être).
Les nomes sont donc déterminées par des « décrets ». Autrement dit les mises en place dans l’arrangement de la présence-absence. Les normes naissent des crises dans l’histoire, et font époque.
Du fait de la loi, qu’est-ce qui la rend possible ? Quelles en sont les conditions ? Il faut les chercher ailleurs que dans le sujet.
« Les conditions de l’agir sont fournies par les modalités selon lesquelles, à un moment donné de l’histoire, les phénomènes présents entrent en rapport les uns avec les autres. »
Par « loi », il faut entendre loi positive, mais aussi loi naturelle et divine.
Cette constellation d’interaction phénoménale fait notre « demeure » relative à une époque donnée, le nomos oikou, l’éco-nomie de la présence. Obéir à cette économie époquale conduit à l’aletheia, la « Vérité », qui est dévoilement de l’être (aletheia signifie négation de l’oubli).
Le nomos « rationnel » découle de ce nomos attaché à la Vérité.
La loi comme artefact de la raison autonome, universelle et intemporelle découle de la conception kantienne, qui part du sujet, de la loi morale que la raison pratique se donne à elle-même.
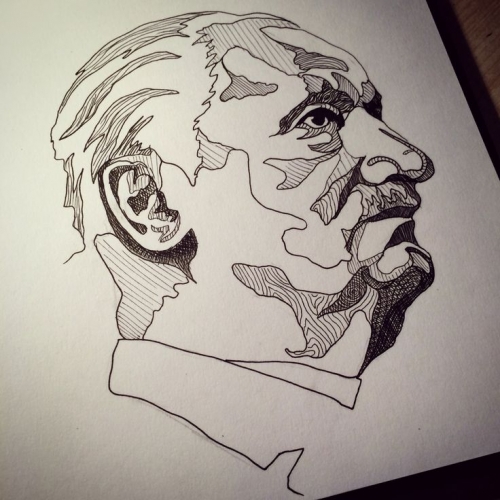
En fait, la recherche kantienne d’universalité et de nécessité en morale dépend d’une époque dans l’histoire de la présence.
La naïveté de la conception kantienne tient à l’illusion que tout être rationnel est capable de discerner ce qui est à faire et à ne pas faire. Mais cette « confiance » est datée, elle est une façon de répondre à « l’injonction contenue dans le décret de l’être ».
Donc, la question de la liaison de la théorie et de la pratique doit tenir compte des décrets de l’être engendrés par notre époque, qui est celle de la déconstruction du sujet.
Il faut « penser » notre situation, et s’interroger sur l’unité entre penser et agir.
Mais « penser » « ne signifie plus : s’assurer un fondement rationnel sur lequel poser l’ensemble du savoir et du pouvoir ». « Agir » « ne signifie plus: conformer ses entreprises quotidiennes, privées et publiques, au fondement ainsi établi ».
La déconstruction initiée par Heidegger dès 1927 est la « pulvérisation d’un […] socle spéculatif où la vie trouverait son assise, sa légitimité, sa paix ». « Déconstruire la métaphysique revient à interrompre […] le passage spéculatif du théorique au pratique ».

Ce passage, pour les Anciens relevait d’une dérivation éthique et politique de la philosophie première. Pour les modernes, une application de la métaphysique générale, dans les métaphysiques spéciales. Le discours sur l’être était fondateur.
Dans les réponses concernant la question de l’agir, les philosophes anciens et modernes ont pu s’appuyer sur quelque Premier nouménal (la chose « en soi », au-delà de la perception sensible et rationnelle), dont la fonction fondatrice était assurée par une doctrine des fins dernières. Les Grecs demandaient : « Quelle est la meilleure vie ? », les médiévaux : « Quels sont les actes naturellement humains ? », les modernes : « Que dois-je faire ? ». Les réponses provenaient de leurs sciences référentielles.Or, ce qui était tenu comme fondement nouménal est situé historiquement. Sa déconstruction clôt l’ère des philosophies pratiques, dérivées d’une philosophie première, aussi bien que l’ère métaphysique.
Cette déconstruction prive le discours sur l’action des schémas qui appartenaient aux thèses sur la substance, sensible ou divine, sur le sujet, sur l’esprit, ou sur l’« être ». Par conséquent, l’agir perd son fondement, ou son archè.

La question est donc : Que faire à la fin de la métaphysique ?
"C'est pour moi aujourd'hui une question décisive de savoir comment on peut coordonner en général un système politique à l'ère technique et quel système ce pourrait être. A cette question je ne sais pas de réponse. Je ne suis pas convaincu que ce soit la démocratie."
Martin Heidegger; "Nur noch ein Gott Kann uns retten" (Seul un Dieu peut encore nous sauver); Der Spiegel, 31 mai 1976
Constat d’ignorance, donc. « Je ne sais pas ».
L’ignorance semble prédominer aux moments de transition entre époques. Cela n’a rien à voir avec « les opinions et convictions d’un individu, avec son sens des responsabilités politiques, ou avec la perspicacité de ses analyses du pouvoir ».
Cette ignorance est inhérente aux écrits de Heidegger. Elle fait texte. A partir de ce « texte », il faut définir une « pensée ». Prendre un chemin.
Elle part du constat que l’ère métaphysique est clos, et avec elle la hiérarchie des vertus, la hiérarchie des lois – divines, naturelles, humaines – la hiérarchie des impératifs, la hiérarchie des intérêts discursifs : intérêt cognitif ou intérêt émancipatoire. Cette période avait en vue un modèle, un canon, un principium pour agir.
Il s’agit d’une double clôture : systématique (les normes procèdent de philosophies premières), historique (le discours déconstructeur (Nietzsche) se situe à sa limite chronologique.
Le problème survient dès qu’on prend conscience que l’exclusion de l’ère de la métaphysique est aussi celle de la présence (historique) comme fondement, comme identité.
Radicalité de la démarche : « l’agir dépourvu d’archè n’est pensable qu’au moment où la problématique de l’« être » - héritée du champ clos de la métaphysique mais soumise, sur le seuil de celui-ci, à une transmutation, à un passage – émerge des ontologies et les congédie ».
LE CONCEPT D’ANARCHIE
Il ne s’agit nullement ici des doctrines de Proudhon, de Bakounine, qui se réfèrent à un pouvoir rationnel.
Anarchie veut dire : 1. Le schéma que la philosophie pratique a emprunté à la philosophie première, c’est la référence à une archè, qu’elle s’articule selon la relation attributive, pros hen, ou participative, aph’ henos [expression aristotéliciennes, qui ont influencé la théologie chrétienne. La relation attributive : pros hen signifie, en grec, « par rapport à une chose » ou « vers une chose ». Aristote l’utilise pour décrire une relation entre plusieurs choses qui partagent une référence commune à une réalité première, sans pour autant être identiques à elle. Relation participative: aph’ henos signifie « à partir de l’un ». L’expression met l’accent sur la dépendance ontologique ou causale des réalités secondaires vis-à-vis d’une réalité première].

Les théories de l’agir, à chaque époque, décalquent, du savoir ultime, comme d’un patron, le schéma attributif-participatif. Elles cherchent dans les philosophies premières le dessein de chercher une origine à l’agir. Cela se traduit par un déplacement de mire qui ne cesse de se déplacer historiquement : cité parfaite, royaume céleste, volonté du plus grand nombre, liberté nouménale et législatrice, « consensus pragmatique transcendantal », etc.
Toujours existe l’archè, qui imprime sens et telos (fin, finalité). Pour l’époque de la clôture, le schéma de référence à une archè est le produit d’un certain type de penser, qui a connu une genèse, une période de gloire, et un déclin. Il y eut de nombreux « premiers » au cours des siècles. Ces « principes «époquaux », avec la clôture de l’ère métaphysique, dépérissent.
L’anarchie devient alors concevable.
Les philosophies premières fournissaient au pouvoir des structures formelles. La « métaphysique » désigne ce dispositif où l’agir requiert un principe auquel puisse se rapporter les mots, les choses et les actions. Désormais, l’agir est sans principe. La présence devient une différence irréductible.
La question d’un « système politique coordonné à l’ère technique » relève des constructions principielles, et s’avère donc intempestive.
L’anarchie désigne le dépérissement de la règle du scire per causas (« connaître par les causes »), de l’établissement des « principes », le relâchement de leur emprise.
Son concept situe l’entreprise heidegérienne, le lieu où elle est sise : implantée dans la problématique du ti to on (« Qu’est-ce que l’être? ») mais arrachant celle-ci au schéma du pros hen. Retenir la présence, mais la désencadrer du schéma attributif.
La référence principielle est travaillée , dans son histoire et dans son essence, par une force de dislocation, de plurification. Nous sommes dans une période de transition où l’on perçoit le logos référentiel comme architecture. C’est cela, la déconstruction.
Le concept d’anarchie survient au moment où « cèdent les assises et où l’on s’aperçoit que le principe de cohésion, qu’il soit autoritaire ou rationnel, n’est plus qu’un espace blanc sans pouvoir législateur sur la vie ».
Inutile donc de peser les avantages et les inconvénients des différents systèmes.
L’ère de la technique est celle du savoir. Or, penser et connaître sont contradictoires. « Les sciences ne pensent pas ». Cette opposition est héritée de Kant. Existent alors « deux territoires, deux continents entre lesquels il n’y a ni analogie, ni ressemblance ». « Il n’y a pas de pont qui conduise des sciences vers la pensée. » On « pense » l’être, et ses époques, mais on « connaît » les étants, et leurs aspects.

Heidegger invoque l’ignorance, qui est sans doute nécessaire à la pensée. Il s’agit de répéter la présence, de « regagner les expériences de l’être qui sont à l’origine de la métaphysique, grâce à une déconstruction des représentations devenues courantes et vides ». Le nomos de notre oikos produit de moins en moins de certitudes. Toute systématicité dans l’usage des mots, des choses et des actions, est impossible.
L’aveu d’ignorance est en vérité une feinte stratégique. Elle répond seulement à des questions creuses, sur les préférences politiques etc.
Elle a un autre sens, et se réfère à la « vie sans pourquoi ». « Au fond le plus caché de son être l’homme n’est véritablement que quand, à sa manière, il est comme la rose – sans pourquoi. » (L’expression vient de Maître Eckhart, et a été reprise par Silesius). Cela veut dire une vie sans but, sans telos. Mais sans telos, l’agir n’est plus l’agir.
Il s’agit d’arracher l’agir à la domination de l’idée de finalité, à la téléocratie où il a été tenu depuis Aristote. L’Abbau (la déconstruction) n’appartient pas à la « région » d’une science déterminée, ou d’une discipline. L’agir n’est pas déconstruit isolément. Il est nécessaire d’abord de comprendre les époques où le monde des principes époquaux, pour constater qu’ils « perdent leur force constructrice et deviennent néant ». Exercice ascétique.
L’« ignorance » est l’innocence rendue à la pluralité. Selon Heidegger existent quatre domaines où cette plurification devient pensable.
1) Les cloisons entre les différentes disciplines scientifiques doivent sauter.
2) La pensée doit être multiple, car la présence est multiple. « Tout se fait jeu. » Heidegger prône un langage héraclitéen (« l’enfant qui joue ») et nietzschéen : la présence comme « transmutation à jamais sans repos ». Penser, c’est répondre et correspondre aux constellations de présence telles qu’elles se font et se défont.
3) La grammaire. L’opération héno-logique se rapporte à la structure prédicat et sujet. D’où la métaphysique. « « L’être » est quelque chose. » Il s’agit de la désapprendre. Il faut un changement dans le langage. Tout au plus pouvons-nous le préparer. Il s’agit de libérer le potentiel d’un parler multiple (contre l’uniformisation du langage et de la technologie). La question reste posée.
4) L’éthique. Contre L’Ethique à Nicomaque, d’Aristote, qui commence ainsi : « Tout art et toute investigation, et pareillement toute action et tout choix tendent vers quelque bien. »
En revanche, Heidegger expérimente avec des mots toujours nouveaux pour disjoindre l’agir et la représentation de la fin. Il parle de Holzwege, de « chemins qui ne mènent nulle part ».

L’expression « sans pourquoi » éclaire la métaphore des Holzwege : de ces sentiers qu’utilisent les bûcherons, « chacun suit son propre tracé, mais dans la même forêt. Souvent il semble que l’un est pareil à l’autre. Mais ce n’est qu’une apparence ». De même la praxis. Libéré des représentations d’archè et de telos, l’agir ne se laisse plus décrire par un propos tenu d’avance. L’agir suit la façon multiple dont, à chaque moment, la présence s’ordonne autour de nous. Il suit la venue à la présence comme phyein (phyein (φύειν) – « croître », « faire croître »).
« Ainsi que l’ont compris les Grecs préclassiques – au « premier commencement » - l’agir peut être kata physin (« selon la nature » ou « conformément à la nature »). Au-delà de la clôture métaphysique, à l’« autre commencement », la mesure de toutes actions ne peut être ni un hen nouménal ni la simple pression des faits empiriques. Ce qui donne la mesure, c’est la modalité sans cesse changeante selon laquelle les choses émergent et se montrent : « Toute poiesis dépend toujours de la physis… A celle-ci, qui éclôt d’avance et qui advient à l’homme, se tient la production humaine. Le poiein prend la physis comme mesure, il est kata physin. Il est selon la physis, et en suit le potentiel… Est un homme averti celui qui pro-duit ayant égard à ce qui éclôt de lui-même, c’est-à-dire à ce qui se dévoile. »
« « Le concept courant de chose », dans sa captation ne saisit pas la chose telle qu’elle déploie son essence ; il l’assaille. – Pareil assaut peut-il être évité, et comment ? Nous n’y arriverons qu’en laissant en quelque sorte le champ libre aux choses. Toute conception et tout énoncé qui font écran entre la chose et nous doivent d’abord être écartées. » »
Un agir, donc, qui ne fait qu’un avec « l’autre pensée » et « l’autre destin » (ceux d’après l’ère métaphysique).
« L’assaut est une modalité de la présence, celle qui prédomine à l’ère technique. » Résultat extrême des décisions et orientations prises depuis la Grèce classique. Renforcées au fil des siècles, et maintenant violence généralisée, plus destructrice que les guerres.
Heidegger n’appelle pas à une contre-violence. Il ne cherche pas la confrontation : il n’en attend rien. « La confrontation ne saurait que renforcer la violence qui est au cœur de notre époque historique fondamentale. » « Je n’ai jamais parlé contre la technique », dit Heidegger. Il n’incite pas non plus à abandonner le domaine public.
La violence extrême de la technique clôt la métaphysique. « Non que la violence provoque sa propre négation. » Seulement une double face. Nous sommes limitrophes.
« La transition hors des époques ne peut s’obtenir par une contraction de la volonté. » Une seule attitude est à notre portée : « Le délaissement n’entre pas dans le domaine de la volonté. » Il est le jeu préparatoire d’une économie kata physis. Il prélude à la transgression des économies principielles. De la non-violence de la pensée provient le « pouvoir non-violent ». Faire ce que fait la présence : « laisser être. Heidegger oppose le lassen, « laisser », au überfallen, « assaillir ». Le délaissement, la Gelassenheit, n’est pas une attitude bénigne, ni un réconfort spirituel. « Laisser être » est la seule issue viable hors du champ d’attaque aménagé par la raison calculatrice.
Laisser le champ libre aux choses. Aucun Grand Refus. Philosopher contre la technique équivaudrait à « une simple ré-action contre elle, c’est-à-dire à la même chose. »
S’interroger plutôt sur l’essence de la technique, son appartenance à la métaphysique. Il ne s’agit pas de chercher des alternatives à la standardisation et à la mécanisation. Heidegger n’est pas « écologiste ». Ce qui lui importe, ce ce qui apparaît comme « laissant le champ libre aux choses « , c’est-à-dire comment les rendre présentes.
C’est l’événement d’appropriation qui laisse ainsi venir les choses à notre rencontre (begegnenlassen). « Il s’ensuit que l’a priori pratique qui subvertit la violence consistera à « nous abandonner (überlassen) à la présence sans qu’elle soit occluse ». Il consistera à laisser les choses se mettre en présence, dans des constellations essentiellement rebelles à l’ordonnancement. L’agir multiple, au gré de l’événement fini : voilà la praxis qui « laisse le champ libre aux choses ». »
Si la pensée n’est ni le renfort, ni la négation de la technique, elle n’a pas de but. « Elle n’est pas dominée par la recherche d’une conformité entre énoncé et objet. »
Sa tâche est somme toute modeste et insignifiante, par rapport à la technique. Elle nous instruit sur une origine sans telos. Une origine toujours neuve, comme l’aube, « sur laquelle on ne peut compter, et qui par là défie le complexe technico-scientifique ».
Existe donc un impératif : « les « choses » en leur venue au « monde » se distinguent des produits en ce que ces derniers servent à un emploi. » Désimpliquer les choses, là est le principe.
Notre existence doit être près de l’origine. Être près de l’origine – près de l’événement qu’est le phyein – ce sera suivre dans la pensée et dans l’agir l’émergence du « sans pourquoi » des phénomènes.
« La pensée et la poésie entament la téléocratie comme la rouille entame le fer. Maître Eckhart : « Le juste ne cherche rien dans ses œuvres. Ce sont des serfs et des mercenaires, ceux qui cherchent quelque chose dans leurs œuvres et qui agissent en vue de quelque « pourquoi ». »
Ainsi la contingence radicale est-elle restaurée. Les choses émergent avec précarité, fragilité, dans un monde précaire. C’est l’innocence du multiple retrouvée. L’oeuvre d’art appartient à ce monde : elle produit une vérité comme une sphère contingente d’interdépendance, en instituant un réseau de références autour d’elle. Elle « vient au monde ». Le monde vient à la chose. Et nous sommes nous-mêmes dans ce monde de la contingence innocente, de l’émergence kata physis. Toute fissuration de la structure métaphysique téléologique ouvre à la clarté de l’agir sans fond (abgründig). Abgründig pointe vers l'idée que l'être n'a pas de fondement ultime ou de cause première absolue dans le sens traditionnel (par exemple, une divinité ou une substance métaphysique). L'être est « sans fond » (Abgrund), c'est-à-dire qu'il échappe à une explication définitive ou à une réduction à une cause stable.
16:23 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, martin heidegger, reiner schürmann |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Religion climatique et lutte culturelle – Comment l'agenda écosocialiste désindustrialise l'Allemagne

Religion climatique et lutte culturelle – Comment l'agenda écosocialiste désindustrialise l'Allemagne
Pour Frank-Christian Hansel, l'agenda climatique allemand n'est pas un projet de réforme technique, mais une lutte culturelle idéologique aux conséquences considérables pour l'économie et la société.
Frank-Christian Hansel
Source: https://www.freilich-magazin.com/politik/klimareligion-un...
Depuis plus d'une décennie et demie, de Merkel à Habeck, de la CDU aux Verts, une doctrine climatique s'est établie en Allemagne qui doit être comprise moins comme une politique environnementale axée sur les faits que comme une lutte culturelle délibérément menée par la gauche. Sous le couvert de la « protection du climat » et de la « décarbonisation », une grande offensive idéologique a été lancée, qui non seulement restreint les décisions techniques et économiques, mais recode également l'ensemble du système de valeurs sociales – vers une vision écosocialiste du monde et de l'humanité.
Cet agenda n'est pas un domaine politique fortuit, mais le levier central pour transformer l'économie, la société et la culture. L'orthodoxie climatique rouge-verte, activement promue par Angela Merkel et ses successeurs, a mis en place un système dogmatique dans lequel la légitimité politique ne découle plus d'une négociation démocratique, mais d'un chantage moral : quiconque s'oppose à la « religion climatique » est considéré comme un ennemi de l'avenir, comme un hérétique s'opposant au grand récit moral.
Les trois piliers fondamentaux de l'idéologie climatique
- 1) La prétention à l'absolu de la religion climatique – Le « sauvetage de la planète » est placé au-dessus de toute raison économique en tant qu'objectif métaphysique ultime.
- 2) Logique de redistribution écosocialiste – Les moyens de production, les systèmes énergétiques et les structures de consommation doivent être réorientés politiquement afin d'imposer un système prétendument « équitable » à zéro émission.
- 3) Hégémonie culturelle – Les médias, l'éducation, les ONG et les réseaux internationaux créent une autorité interprétative qui discrédite moralement toute critique avant même qu'elle puisse être discutée objectivement.

L'industrie automobile – en première ligne et victime de la guerre culturelle
Si vous considérez encore que cet agenda climatique, en tant que combat culturel, est une exagération théorique, il vous suffit de regarder l'industrie automobile allemande, le cœur industriel de notre pays, symbole et moteur de notre prospérité. C'est là que la logique idéologique coercitive et la réalité s'affrontent de plein fouet.
- Volkswagen : fermetures d'usines, délocalisations, fortes réductions de production
- Porsche : suppression d'environ 1900 emplois d'ici 2029 à Zuffenhausen et Weissach
- Bosch : 1100 emplois supprimés à Reutlingen
- Daimler Truck : 5000 emplois menacés en Allemagne
- Continental : 3000 emplois supprimés dans le monde, dont une grande partie en Allemagne
Les conséquences de la transition accélérée vers les voitures électriques
Le Center Automotive Research (CAR) estime à environ 15.000 le nombre d'emplois qui pourraient être supprimés dans le secteur en raison de la transition accélérée vers les voitures électriques, qui s'accompagne de la destruction de chaînes de valeur sophistiquées mises en place au fil des décennies. Des régions entières, en Bavière, dans le Bade-Wurtemberg et en Basse-Saxe, sont confrontées à une rupture structurelle qui est dévastatrice non seulement sur le plan économique, mais aussi sur le plan social.

Cette évolution n'est pas un accident industriel résultant d'une politique mal équilibrée. Elle est la conséquence logique d'une stratégie culturelle et idéologique dans laquelle toute affirmation industrielle est considérée comme nuisible au climat, voire comme moralement illégitime. L'abandon politiquement imposé des technologies à combustion, accompagné de directives européennes, d'interdictions nationales et de subventions unilatérales, est un exemple typique de la manière dont une idéologie abstraite se traduit par une destruction industrielle concrète.
Celui qui ne reconnaît pas les faits perd
La « protection du climat » n'est qu'une façade pour un processus de pouvoir plus profond: la transformation du pays qui, d'une société industrielle orientée vers l'économie de marché, doit devenir une économie de pénurie réglementée et dirigée par l'État. La lutte culturelle de gauche pour le climat est l'arme stratégique à long terme visant à détruire le système politique et économique et à le remplacer par un système idéologique.
Ceux qui ne comprennent pas cet état de choses ne pourront jamais provoquer un véritable changement politique.
La question centrale est donc la suivante: la CDU a-t-elle reconnu ce conflit pour ce qu'il est, à savoir une lutte culturelle et idéologique pour déterminer l'ordre fondamental de notre société ? Si oui, il faut se demander pourquoi elle ne mène pas la lutte contre ce projet. Par crainte de perdre ses dernières options de pouvoir ? Par commodité, parce qu'elle s'est installée dans l'ombre de l'hégémonie verte-gauche?
Ma propre conviction, que l'Union démocrate-chrétienne pourrait encore être un partenaire dans cette lutte, est proche de zéro. Trop souvent, elle s'est révélée être la co-administratrice et le précurseur de cet idéologie, celle de la sortie du nucléaire de Merkel à la mise en œuvre anticipée des objectifs climatiques verts. Dernier exemple en date: peu avant la fin de la majorité rouge-verte, Friedrich Merz a inscrit la « neutralité climatique » dans la Constitution, renforçant ainsi l'idéologie et non le réel.
Ce qui est nécessaire aujourd'hui
Il est essentiel que les électeurs comprennent que le changement politique doit se faire précisément à ce niveau, celui du débat idéologique fondamental. Le moyen le plus efficace d'y parvenir est de mettre en avant les conséquences réelles et accablantes: suppressions d'emplois, explosion des prix de l'électricité, désindustrialisation. Ce n'est que lorsqu'il sera clair que ces pertes sont la conséquence directe d'une idéologie climatique que la pression politique nécessaire pour imposer un changement pourra voir le jour.

Pour mettre fin à cette aberration, il faut donc:
- Dénoncer la doctrine coercitive de la politique climatique comme un projet de domination écosocialiste.
- Déconstruire publiquement la logique de chantage moral de la religion climatique.
- Révéler sans pitié le bilan réel de la transition énergétique et de la décarbonisation : pertes d'emplois, destruction de la prospérité, désindustrialisation.
- Établir une contre-culture d'ouverture technologique, d'autodétermination économique et de politique énergétique libérale.
Ce n'est qu'en démystifiant le fondement idéologique que l'on pourra inverser le cours politique. Cela exige le courage d'une critique fondamentale, non seulement à l'égard des Verts, mais aussi à l'égard des complices démo-chrétiens et socialistes qui ont élevé cette lutte culturelle écosocialiste au rang de doctrine d'État.

À propos de l'auteur
Frank-Christian Hansel
Frank-Christian Hansel, né en 1964, est membre de la Chambre des députés de Berlin pour l'AfD depuis 2016. Originaire de Hesse, il a étudié les sciences politiques, la philosophie et a suivi les cours d'études latino-américaines.
14:03 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Ecologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : religion climatique, climatisme, allemagne, europe, affaires européennes, afd, hans-christian hansel |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


