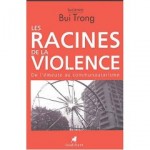jeudi, 24 mars 2011
Urheimat: alle origini del Popolo Europeo
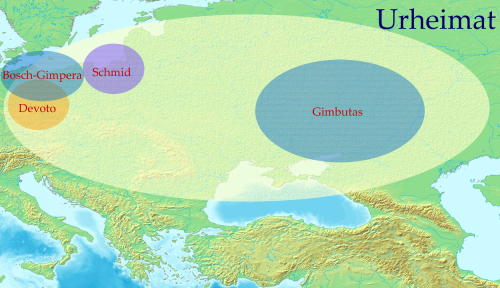
Urheimat: alle origini del Popolo Europeo
Molteplici le teorie sulle origini etniche, addirittura c’è chi sostiene che gli Ittiti provengano dal popolo dei Chatti, stanziati in Europa tra Reno e Weser
Gianluca Padovan
Ex: http://rinascita.eu/
L’improbabile origine asiatica
La questione più dibattuta tra archeologi e linguisti è la sede originaria (dal tedesco Urheimat) dei cosiddetti “Indoeuropei”, popolo che tra il IV millennio a. e il I millennio a. sembra comparire, oltre che in Europa, anche in Asia e in Africa. Ma, inizialmente, si pensa che tale popolazione provenga dall’India e approdi in Europa foriera di cultura e tradizione: cosa mai avvenuta. Così pure si desidera vedere la provenienza di genti, che fanno fiorire culture sul suolo europeo, dalle steppe e dalle tundre dell’est e dai deserti di sudest, basandosi più che altro sui testi biblici e sulla propria religione. A mio avviso il concetto espresso nella frase “ex Oriente lux” è da riconsiderare e soprattutto da evitarne la pedissequa e acritica applicazione.
Alcuni ritengono che la patria originaria sia da ricercarsi nell’Asia Centrale, in un territorio compreso tra il Turkestan e il Pamir, altri nella cosiddetta Russia Europea, ovvero ad ovest degli Urali. Ma vi è chi ritiene che l’ “Urheimat” sia l’Europa del Nord. Oggi i più tendono a considerare che essa sia da collocarsi tra la Germania del Nord e l’Elba e la Vistola, fino alle steppe che vanno dal Danubio agli Urali, quasi in una sorta di compromesso. In buona sostanza la provenienza della luce culturale e sociale è ancora da definirsi e, sostanzialmente, le idee al proposito rimangono varie anche e soprattutto in campo accademico.
Ad esempio, uno dei luoghi comuni dell’Antropologia è l’origine asiatica degli “Indoeuropei”. E a sostegno della tesi della provenienza asiatica vi è la questione del cavallo. Si afferma che esso è addomesticato e allevato nelle grandi pianure dell’est e del sudest asiatico e da qui introdotto in Europa. In realtà il cavallo è già noto almeno fino dal paleolitico superiore, con attestazioni, ad esempio, in Scania (Svezia meridionale). Ma sulla questione si potrebbero leggere fiumi di parole sia pro che contro.
Calvert Watkins scrive: “Molti studiosi ritengono che la zona della steppa siberiana a nord e a est del Mar Nero sia stata, se non la ‘culla’ originaria degli Indoeuropei, almeno un’importante area di sosta negli spostamenti verso ovest nei Balcani e oltre, verso l’Anatolia e verso il sud e poi verso l’est nell’Iran e in India, a cominciare dalla metà del quinto millennio a.C. Questa è quella che viene chiamata dagli archeologi cultura Kurgan, dalla parola russa per i suoi caratteristici monumenti o tumuli sepolcrali” (Watkins C., Il proto-indoeuropeo, in Campanile E., Comrie B., Watkins C., Introduzione alla lingua e alla cultura degli Indoeuropei, Il Mulino, Bologna 2005, p. 49). Tali teorie sono basate anche sugli scritti dell’archeologa americana di origini lituane Marija Gimbutas.
Innanzitutto è probabilmente da ricercare in Europa il fenomeno del megalitismo, che ha lasciato sul territorio monumenti a tumulo che si perpetuano nel tempo e anche all’esterno dei confini continentali. L’argomento è più che noto ed è superfluo riprenderlo, ma un passo è doveroso riportarlo: “L’architettura territoriale neolitica realizza i suoi capolavori nelle regioni europee che costeggiano l’Atlantico e il Mare del Nord - la facciata atlantica europea - dal Portogallo alla Svezia. Gordon Childe ha avuto l’intuizione di rilevare che in Europa i grandi centri dell’architettura megalitica corrispondono alle regioni in cui le sopravvivenze paleolitiche sono più numerose e meglio attestate. Perciò c’è forse un rapporto, sconosciuto e mediato dal tempo, di educazione, atteggiamento e cultura tra i pittori delle caverne paleolitiche e i costruttori di monumenti megalitici. È significativo ricordare il profondo cambiamento di opinione, nella comunità archeologica, sulle origini delle culture megalitiche europee. In passato si pensava che derivassero dalle grandi civiltà urbane del Vicino Oriente. Attraverso i sistemi moderni di datazione al radiocarbonio Colin Renfrew ha potuto dimostrare che i manufatti europei risalgono a prima del 4000 a.C. e sono “creazioni autonome, uniche nel loro genere: i più antichi monumenti di pietra eretti al mondo”. Molte costruzioni furono cominciate nel V millennio a.C. e modificate fino al I millennio a.C.” (Benevolo L., Albrecht B., Le origini dell’architettura, Editori Laterza, Bari 2002, p. 97).
La forza culturale Europea
Così ricorda Romualdi: “L’espansione della cultura nordica nella Russia centrale e meridionale si lascia seguire attraverso la cultura megalitica di Volinia, quella del medio Dnepr e quella di Fatyanovo: tutte queste culture sono caratterizzate da ceramica globulare o cordata e da asce da battaglia. Esse invadono il territorio dei cacciatori ugro-finnici della ceramica a pettine, e premono su quello degli agricoltori della ceramica dipinta di Tripolje. Queste invasioni sono state appassionatamente negate dalla scuola archeologica sovietica di Marr e compagni, pei quali l’esistenza di una Urheimat indoeuropea era “un pregiudizio borghese, esattamente come la fede nell’esistenza di Dio” e per i quali le invasioni indoeuropee facevan parte della mitologia capitalistica” (Romualdi A., Gli Indoeuropei, Edizioni di Ar, Padova 1978, p. 29).
E ancora Romualdi sottolinea l’improbabilità di forti migrazioni da est verso ovest, apportatrici di caratteri culturali: “Ci si trova sempre di fronte alla vaga suggestione delle ‘orde indoeuropee irrompenti nelle steppe euroasiatiche’, contro la quale già Hermann Hirt aveva obiettato che a nessun popolo delle steppe è mai riuscito di diffondere lingue in Europa” (Ivi).
Herman Hirt, nel suo Die Indogermanen, afferma: “L’agricoltura può nutrire su uno stesso territorio assai più uomini dei nomadi delle steppe. È in grado di produrre forze sempre nuove che rafforzano e vivificano la prima corrente. L’assalto dei popoli delle steppe può abbattersi straordinariamente violento, può distruggere come una fiumana di lava ma, poiché non ha nulla dietro di sé, si riassorbe ben presto nella sabbia” (Hirt H., Die Indogermanen I, S. 190; in Romualdi A., op. cit., p. 70). Se qualcuno nutre dei dubbi, guardi che cos’hanno lasciato, ad esempio, gli Unni in Europa: solo un ricordo e per giunta negativo.
Fin dagli albori della storia in Asia e nell’Africa del Nord si incontrano Europei in quanto minoranze che riescono a imprimere una propria impronta alla storia locale. La lingua che diffondono è quella di una aristocrazia conquistatrice, probabilmente poco rispecchiante i multiformi aspetti della vita quotidiana, ma in grado di perdurare nel tempo.
Ittiti, Hittiti, Hatti o Chatti
Rimanendo cauti su traduzioni, trascrizioni, vocalizzazioni più o meno azzeccate, e interpretazioni, parrebbe che la terra di Hatti o di Chatti sia quella occupata dagli Ittiti, che verrebbero così scritti: Hittites, Héthéens, Hetiter, etc. Il territorio, o patria di origine o di semplice sviluppo, è stato localizzato nella penisola anatolica, ad est dell’attuale città di Ankara, antica Angora, capitale della Turchia, ed è la regione detta Hatti. La città principale è Hattusa, o Chattusa, vecchia Boğhazköy (“villaggio nella gola”), odierna Boğazkale. Ma la domanda canonica rimane comunque la seguente: da dove provengono gli Ittiti? Anche qui le ipotesi, ognuna con i suoi bravi dati a sostegno, sono varie. All’occhio di un profano come me sono tutte ugualmente interessanti e valide. Ma una mi ha colpito per la sua originalità e, senza che la si prenda troppo sul serio, la riporto semplicemente perché mi piace, invitando le persone competenti a rifletterci sopra. C’è chi sostiene che gli Ittiti provengano dal popolo dei Chatti, stanziati in Europa tra Reno e Weser. Alcuni linguisti sostengono che varie parole ittite derivino da una forma di linguaggio “antico-alto-tedesco” (Lehman J., Gli Ittiti, Garzanti, Milano 1997, p. 61). Fermo restando che la lingua ittita appartiene alla “famiglia indoeuropea” (meglio identificabile come Famiglia Europea), non basta l’assonanza dei nomi a fornire dati probanti: “Tuttavia non ci basiamo solo su questo. Theodor Bossert, una delle autorità dell’ittitologia, ha pubblicato nel suo Alt-Anatolien (Anatolia antica) una mappa in cui sono registrate tutte le località archeologiche dove sono state rinvenute divinità raffigurate su un toro o nell’atto di cavalcarlo. È una traccia lineare che dalla Siria, oltrepassando Boğhazköy, corre lungo il Danubio fino al Reno, piegando per una sua parte anche verso l’Italia. Un bellissimo esemplare di epoca romana, raffigurante questa divinità ittita con tutti i suoi attributi (fascio di saette e doppia ascia) a cavallo del toro, è stato trovato all’inizio del secolo a Heddernheim, che oggi è un quartiere di Francoforte sul Meno. Werner Speiser forse esagera, quando nel suo Vorderasiatische Kunst (Arte dell’Asia Anteriore) del 1952 sostiene che gli ittiti, con le loro teste e i lunghi nasi vigorosi, avevano un aspetto addirittura “falico” (cioè vestfalico); ma se si accetta la tesi di fondo c’è da riflettere. In definitiva anche i Galati dell’Asia Minore, cui scriveva l’apostolo Paolo, sono parenti dei celti nordeuropei” (Ibidem, pp. 74-75).
Caratteri distintivi
Leggendo nei vari testi e osservando le testimonianze della loro cultura possiamo vedere che gli Ittiti hanno la fronte alta e arrotondata, il naso dritto è senza l’angolo di attaccatura e i capelli sono tendenzialmente sciolti, lunghi e diritti. Possiamo ravvisarvi dei connotati “greci” come per esempio il naso? Attenzione: riferendosi agli Ittiti le iscrizioni egizie li descrivono aventi capelli chiari o probabilmente castano-chiari; inoltre c’è chi ha la barba, tagliata in varie fogge, verosimilmente a seconda della moda del momento. Per curiosità andiamo a vedere che cosa ci dice Tacito a proposito dei germanici Chatti, i quali sono stanziati a nordest del fiume Reno: “abitano il territorio che comincia dalla selva Ercinia, in luoghi non così pianeggianti e palustri come le altre regioni nelle quali si estende la Germania; infatti vi continuano i colli, che a poco a poco si fanno più rari, e la selva Ercinia continua insieme ai suoi Chatti e alla fine li mette al sicuro. La conformazione fisica è più resistente, solide le membra, truce l’aspetto, maggiore la forza d’animo. Possiedono - per essere dei Germani - molto raziocinio e abilità: mettono a capo delle truppe condottieri scelti, ubbidiscono ai comandanti, mantengono il loro posto nelle file dell’esercito; sanno riconoscere l’opportunità favorevole, ritardare gli attacchi, distribuire opportunamente le occupazioni della giornata e fortificarsi di notte; ascrivono la fortuna alle cose dubbie, e invece il valore alle cose sicure, e, cosa ben rara e concessa soltanto alla disciplina romana, ripongono maggior fiducia nel comandante che nell’esercito. La loro forza militare risiede interamente nella fanteria, che oltre alle armi caricano anche di arnesi da lavoro e vettovaglie: gli altri li vedi andare in battaglia, i Chatti in campagna militare. Rare presso di loro le scorrerie e scaramucce. Ottenere rapidamente la vittoria e altrettanto rapidamente ritirarsi è tipico del combattimento a cavallo: la velocità è connessa al timore, la ponderatezza invece alla costanza” (Tacito C., Germania, Risari E. (a cura di), Mondadori Editore, Milano 1991, 30, 1-3).
Tacito sottolinea quindi la capacità dei Chatti di possedere due cose non comuni tra Germani e Celti, che sono la ponderatezza, la costanza, la disciplina e la logistica. Inoltre spiega che dalla tribù dei Chatti, nel 38 a., si staccano i Batavi per andarsi a stabilire alla sinistra orografica del fiume Reno, quindi nel territorio occupato dai Romani, ma da questi “non subiscono l’umiliazione di pagare tributi, né sono oppressi dagli esattori; sono esenti da oneri di imposte e da contribuzioni straordinarie e tenuti in serbo soltanto per il combattimento; li si destina alla guerra come fossero armi da offesa e da difesa” (Ibidem, 29, 1).
Arii o Ariani.
Con il nome di Arii o di Ariani si designano comunemente le genti di lingua “indoeuropea” che dilagarono nelle attuali regioni dell’Iran e dell’India del nord. Taluni hanno sostenuto che si tratta di genti provenienti da nord o da est del Mar Nero, altri da settori ad ovest che oggi portano il nome di Romania e Ucraina. Nel corso del XIX sec. altri studiosi indicano invece come ariani i popoli di lingua europea, di razza bianca e in particolare quelli provenienti dalle regioni del Nord Europa.
Ad ogni buon conto non si è stabilita, o non si è voluta stabilire, con esattezza la loro terra d’origine, andando a negare l’esistenza di una cosiddetta “razza ariana”. Dagli Anni Trenta in avanti, e soprattutto a conclusione della Seconda guerra mondiale, si tende ad assimilare il termine di ariano con le teorizzazioni sulla razza e le formulazioni e le applicazioni delle cosiddette “leggi razziali”. Pertanto l’argomento viene accantonato come scomodo e inopportuno.
Ecco un’altra curiosità che ci viene dal passato tramite Tacito e ancora sui Germani: “Io, personalmente, condivido l’opinione di chi ritiene che le popolazioni della Germania non si siano mescolate con altre genti tramite matrimoni, e che quindi siano una stirpe a sé stante e pura, con una conformazione fisica propria. Da ciò deriva un aspetto simile in tutti, nonostante il gran numero di individui: occhi azzurri e torvi, capelli biondo-rossastri, corpi saldi e robusti, in grado però di costituire una massa d’urto: la loro capacità di sopportare prestazioni faticose è di gran lunga inferiore, e non sono avvezzi a tollerare la sete e il caldo; il clima e la configurazione del territorio li abituano infatti ad adattarsi al freddo e alla fame” (Ibidem, 4, 3).
In particolare, Tacito parla della numerosa tribù dei Suebi, costituita da più tribù: “Attraversa e divide il paese dei Suebi una catena continua di montagne, al di là della quale abitano numerose genti; tra di esse è ampiamente diffuso il nome di Lugi, applicato a molte tribù. Basterà qui ricordare le più forti: Harii, Helveconi, Manimi, Helisi, Nahanarvali” (Ibidem, 43, 2). Stando ad alcuni studiosi la catena montuosa è stata individuata nei Carpazi occidentali e i territori nelle odierne Slesia e Polonia, dalla Vistola all’Oder; inoltre si esprime perplessità sul fatto che fossero della tribù dei Suebi, propendendo per quella degli Slavi.
Vediamo ora cosa ci dice Tacito di una tribù in particolare, quella degli Harii: “Per tornare agli Harii, alla forza per la quale superano le popolazioni sopra elencate aggiungono un’aria truce, e accrescono l’innata ferocia con artifici e con la scelta del momento opportuno: neri gli scudi, tinti di scuro i corpi, scelgono per l’attacco le notti più buie: un esercito di spettri che incute terrore col suo aspetto tenebroso. Non c’è nemico in grado di fronteggiare quella vista tremenda e quasi infernale. Infatti in qualsiasi combattimento i primi a essere sconfitti sono gli occhi” (Ibidem, 43, 4).
Gli studi delle nostre origini e quindi delle popolazioni che abitarono il continente europeo servono allo sviluppo delle conoscenze, nel senso più ampio del termine. Questo porrà probabilmente dei limiti a quello che fu propugnato fin dall’Ottocento come “pangermanesimo”, a cui Stalin oppose, nella prima metà del secolo successivo, il suo ideale di “panslavismo”, dimenticando come gli Slavi siano gente di stirpe europea e non già asiatica. È auspicabile che tutto ciò ponga fine all’equivoco ottocentesco e novecentesco di credere che da altrove sia pervenuta la nostra cultura, definendola “indoeuropea”. Sarebbe un po’ come dire (mi si conceda il paragone) a persone che vivono onestamente del proprio lavoro che gli asini volano ed è bello vederli volare: a furia di ripeterlo, decennio dopo decennio, qualcuno per creduloneria, qualcuno per problemi psichici, altri per piaggeria, affermeranno di vedere gli asini volare.
Noi siamo Europei e la nostra cultura è a tutti gli effetti europea. Non ci credete? La storia si ripete sempre e non sono certo io a dirlo: basti pensare, ad esempio, al filosofo napoletano Giambattista Vico e alla sua teoria riguardo corsi e ricorsi storici. Quindi è necessario e bastante vedere cos’hanno fatto, nel bene e nel male, le genti europee in questi ultimi duemilacinquecento anni e da dove sono partite, dove sono giunte, cos’hanno fondato, cos’hanno costruito, quale sia il contributo sociale, nazionale e culturale che hanno ovunque lasciato. Reimpariamo a pensare con la nostra testa... da veri Europei.
11 Marzo 2011 12:00:00 - http://rinascita.eu/index.php?action=news&id=7010
00:05 Publié dans anthropologie, archéologie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthropologie, ethnologie, europe, histoire, préhistoire, protohistoire, indo-européens, urheimat, archéologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 26 octobre 2010
La psico-antropologia de L. F. Clauss
LA PSICO-ANTROPOLOGÍA DE L.F. CLAUSS:
00:05 Publié dans anthropologie, Philosophie, Psychologie/psychanalyse, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthropologie, psychologie, révolution conservatrice, allemagne, raciologie, races, weimar |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 15 octobre 2010
Noi, Celti e Longobardi
Noi, Celti e Longobardi
 Nel 1997 Gualtiero Ciola pubblicava un’opera, poi ristampata, che costituiva un originale punto di riferimento per un’adeguata considerazione delle origini etniche dei popoli italiani. Nel suo corposo studio Noi, Celti e Longobardi, Ciola analizza le testimonianze archeologiche e linguistiche che hanno segnato il territorio della penisola italica, fornendo utili indicazioni per seguire nuovi percorsi di ricerca.
Nel 1997 Gualtiero Ciola pubblicava un’opera, poi ristampata, che costituiva un originale punto di riferimento per un’adeguata considerazione delle origini etniche dei popoli italiani. Nel suo corposo studio Noi, Celti e Longobardi, Ciola analizza le testimonianze archeologiche e linguistiche che hanno segnato il territorio della penisola italica, fornendo utili indicazioni per seguire nuovi percorsi di ricerca.
Il libro di Ciola è un’opera dal carattere decisamente militante che vuole mostrare le tracce lasciate, soprattutto nei territori settentrionali della penisola, da popolazioni di origine celtica e germanica. Si tratta quindi di un testo particolarmente importante per favorire la ricostituzione di una coscienza identitaria dei popoli padani. Infatti la classe dirigente italiana, soprattutto nell’ultimo mezzo secolo, ha utilizzato massicci flussi migratori di meridionali e di extracomunitari con l’intento di sottoporre la Padania a un processo di denordizzazione che rischia di cancellarne per sempre l’identità etnica.
In una vera e propria controstoria dell’Italia etnica, Ciola col suo libro indica la via della liberazione dai tabù e dai pregiudizi che vengono inculcati dalla cultura di regime, particolarmente insistente nel contesto del mondialismo.
A partire dal secondo millennio a.C. si verifica l’irruzione nella penisola italica di genti ariane che segneranno in modo indelebile le culture del territorio, sebbene a macchia di leopardo, come Ciola mostra nel suo libro. La differenza più evidente fra i nuovi venuti e le popolazioni preesistenti è nel fatto che gli Indoeuropei si caratterizzavano per i culti solari e patriarcali, mentre gli autoctoni celebravano culti matriarcali riferiti alla Madre Terra. Gli Etruschi sono probabilmente gli eredi dei culti matriarcali, anche se la civiltà etrusca fu di gran lunga la più avanzata fra quelle italiche delle origini, e assorbì elementi culturali di civiltà indoeuropee, soprattutto di quella greca.
L’espansione etrusca nella pianura padana venne subito fermata dai Celti che si affermarono in tutta la zona lasciando un vasto patrimonio di toponimi nonché di parole che sono arrivate fino all’italiano moderno. Ciola elenca in tavole apposite una lunga serie di lemmi di origine celtica, di cui i dialetti padani sono letteralmente infarciti. Proprio per cancellare queste tracce di cultura nordica la classe dirigente italiana ha sempre cercato di oscurare le culture dialettali, soprattutto settentrionali, sia col regime liberale, sia con quello fascista, soprattutto con quello democristiano, e ancora di più con l’attuale sistema mondialista. Assai più ampia tolleranza, invece, è stata mostrata verso i dialetti meridionali…
La parte nord-orientale della penisola era abitata dai Veneti, popolazione di origine indoeuropea che l’autore ritiene ascrivibile anch’essa all’ethnos celtico. Si tratta di una questione storiografica ancora dibattuta, sulla quale Ciola propone numerosi spunti di approfondimento.
Molte feste popolari sono chiaramente ispirate alle feste solstiziali celebrate dai Celti, e talune sono state cristianizzate, come la festa della Candelora, che originariamente era la festa della dea celtica Brigit.
Purtroppo in Italia è sempre esistito un malanimo anticeltico che risale ai tempi dei Romani e che si è perpetuato nel Risorgimento e nel fascismo, che hanno cercato di inculcare l’idea di un’Italia “schiava di Roma”: un dogma che ancora oggi viene propagandato dai governi italiani, con l’aggravante del mondialismo, di cui la classe politica è totalmente succube.
Un altro momento importante per la formazione delle identità etniche italiane è l’arrivo dei Germani col crollo dell’Impero Romano. L’invasione dei “Barbari” rappresenta un significativo apporto di sangue nordico nella penisola: i Germani si caratterizzavano per un solido senso della stirpe e per una più accentuata divisione in caste della società. Tuttavia nessuna tribù germanica riuscì a dare un assetto stabile al territorio, aprendo la strada alla riconquista bizantina e alla formazione del territorio pontificio.
L’invasione longobarda fu l’ultima occasione di instaurare un regno “nordico” in Italia. La questione, com’è noto, fu ampiamente dibattuta al tempo del Risorgimento, suscitando l’interesse anche di personalità importanti come Alessandro Manzoni. Sta di fatto che la strenua resistenza bizantina, la diplomazia papale e l’intromissione dei Franchi resero impossibile ai Longobardi la conquista dell’Italia.
Tuttavia l’apporto culturale longobardo ha lasciato tracce significative in numerosi vocaboli, nei toponimi, nonché nelle caratteristiche razziali soprattutto nel Nord Italia e in Toscana.
La diffusione dei Longobardi in Toscana ha dato origine anche a particolari teorie sul Rinascimento. Lo studioso tedesco Ludwig Woltmann sosteneva che il Rinascimento, che ebbe in Toscana la sua sede privilegiata, era un fenomeno essenzialmente nordico: un’aspirazione alla libertà e alla curiosità intellettuale che è molto meno sentita nelle culture mediterranee. In effetti l’arte toscana di quell’epoca presenta caratteri assai poco meridionali: simbolo del Rinascimento fiorentino sono le Grazie e la Venere del Botticelli, che hanno un aspetto decisamente ariano!
L’ultima parte del libro passa in rassegna tutte le regioni italiane delineandone la composizione etnica che è chiaramente celtico-germanica al Nord, con un consistente apporto celtico nelle Marche e con influenze umbre che, secondo Ciola, sono da far risalire a elementi proto-celtici. L’elemento etrusco è diffuso al Centro, ma in Toscana è frammisto a una consistente presenza longobarda. Nel Sud, invece, nonostante alcuni insediamenti longobardi e normanni, durarono a lungo le occupazioni musulmane, e ancor oggi prevalgono elementi di origine meridionale e levantina che determinano le tipiche caratteristiche psicorazziali della popolazione locale.
Il saggio di Ciola è opera di notevole erudizione, ricca di indicazioni che possono essere utili anche in ambito accademico, ma soprattutto è un invito a non dimenticare i valori delle culture nordiche che hanno segnato per tanti secoli la nostra civiltà: la sete di libertà, l’aspirazione alla giustizia, la fedeltà alla parola data, il coraggio, il senso dell’onore…
Si tratta di espressioni che rischiano di scomparire dal vocabolario, in un contesto come quello del mondialismo, dove dominano la menzogna, l’inganno, la truffa, il doppio gioco: gli ingredienti della società multicriminale.
Noi, Celti e Longobardi è un libro che ha il sapore di una boccata di aria fresca nell’ambiente asfittico della cultura ufficiale, e ha potenzialità dirompenti per la mentalità dominante, bigotta e conformista al di là di ogni ragionevole immaginazione.
* * *
Gualtiero Ciola, Noi, Celti e Longobardi, Edizioni Helvetia, Spinea (VE) 2008, pp.416, € 27,00.
00:05 Publié dans anthropologie, archéologie, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : celtes, celticité, celtitude, lombards, germains, italie, padanie, pô, alpes, alpes italiennes, anthropologie, ethnologie, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 14 octobre 2010
Ludwig Woltmann: la obsesion por la hegemonia germanica
00:05 Publié dans anthropologie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : anthropologie, ethnologie, monde germanique, allemagne, france, 19ème siècle, ludwig woltmann, raciologie, races |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 10 octobre 2010
Por la creacion de un Romanestan - Los Gitanos, ?Un problema Hindu-Europeo?
Sebastian J. Lorenz
[Publicado en "ElManifiesto.com"]
00:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes, anthropologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, europe, affaires européennes, anthropologie, ethnologie, gitans, roms, romanichels, tziganes, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 03 octobre 2010
"De l'inégalité parmi les sociétés" de Jared Diamond
« DE L'INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS » de Jared DIAMOND
par Pierre MARCOWICH
ex: http://www.oswald-spengler-le-retour.net/
 Dans son ouvrage, « DE L’INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS », Jared DIAMOND se donne pour ambition de nous faire découvrir les facteurs permanents qui auraient, selon lui, déterminé, comme une loi d’airain, l’évolution des sociétés humaines depuis la fin de la dernière glaciation jusqu’à nos jours, ce qui représente une période de 13.000 ans. (1)
Dans son ouvrage, « DE L’INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS », Jared DIAMOND se donne pour ambition de nous faire découvrir les facteurs permanents qui auraient, selon lui, déterminé, comme une loi d’airain, l’évolution des sociétés humaines depuis la fin de la dernière glaciation jusqu’à nos jours, ce qui représente une période de 13.000 ans. (1)
Je précise tout d’abord qu’en utilisant l’expression de « loi d’airain » qui aurait pesé sur l’évolution des sociétés humaines depuis la Néolithique, je suis fidèle à l’esprit de l’auteur qui a d’ailleurs voulu affirmer sa thèse dans le titre même de son ouvrage.
En effet, le titre de l’ouvrage en anglais est nettement plus explicite que celui en français : « GUNS, GERMS, AND STEEL, THE FATES OF HUMANS SOCIETIES », titre qui se traduit en français de la façon suivante :
Canons, microbes, et acier, les Parques des Sociétés humaines. Selon le WEBSTER’S DICTIONARY, le mot "The Fates", repris du latin, signifie en anglais "Les Parques", divinités romaines qui décident de manière inflexible et impitoyable le destin de chaque homme. (2)
L'analogie est évidente, puisque l'auteur évoque trois phénomènes bruts désignés par l'auteur comme agents implacables du destin des sociétés depuis 13.000 ans.
C’est un titre à la Jean-Jacques ROUSSEAU avec son "Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes" (1755) que le traducteur (ou l’éditeur) a préféré octroyer à l’ouvrage de Jared DIAMOND dont le titre est devenu « De l’inégalité des sociétés », Est-ce dans le but d’atteindre, avec le maximum d’efficacité, un public portée sur les questions philosophiques ?
Comme il le confie lui-même, dans son ouvrage, Jared DIAMOND, docteur en physiologie, est un spécialiste de l’évolution biologiques des oiseaux qu’il a étudiés en Papouasie-Nouvelle-Guinée, en Australie et en Amérique du sud. Dans le même temps, ses séjours lui permirent de se familiariser avec « maintes sociétés humaines technologiquement primitives » (page 34).
La problématique telle que la pose Jared DIAMOND
Jared DIAMOND formule la problématique de l’évolution historique des sociétés humaines depuis la fin du dernier âge glaciaire, il y a 13.000 ans, par l’énonciation suivante :
« Certaines parties du monde ont créé des sociétés développées fondées sur l’alphabétisation et l’usage d’outil métalliques, d’autres ont formé des sociétés uniquement agricoles et non alphabétisées, et d’autres encore sont restées des sociétés de chasseurs et de cueilleurs avec des outils de pierre. » (page 11)
De cette situation, affirme Jared DIAMOND, découle, depuis 13.000 ans, une inégalité entre les sociétés humaines, qui fait que les premières ont conquis ou exterminés les deux autres.
Il convient de remarquer qu’il ressort de l’énoncé de Jared DIAMOND, que, selon lui, ce ne sont pas les hommes qui « créent » les « sociétés », mais certaines « parties du monde », c’est à dire des zones géographiques, autrement dit la nature (la terre, l’eau, le climat, les montagnes, la mer). Il découle de l’énoncé de Jared DIAMOND que la nature aurait la « volonté » de prendre la décision de créer les sociétés. On croit lire l’entrée en matière d’une sorte de nouvelle Génèse, matérialiste, où la nature remplacerait le Dieu de l’ancienne Bible.
Bien sûr, le lecteur comprend ce que, malgré la faiblesse de son expression, Jared DIAMOND veut dire : selon lui, la matière, comprise uniquement comme phénomène concret, palpable, visible, se trouve être à l’origine de toute formation sociale.
De plus, prétendre que d’autres parties du monde ont formé « des sociétés uniquement agricoles » est tout aussi aberrant, car toutes les « sociétés développées » sont passées, elles aussi, par le stade agricole pour s’urbaniser par la suite, outre qu’il paraît hasardeux de qualifier de « société » un clan de la préhistoire (biologiquement homogène) vivant de chasse et de cueillette.
Ce manque de rigueur est frappant chez une personne qui se présente comme un scientifique de haut niveau.
Quant à la prétendue « alphabétisation » des sociétés développées, ce n’est qu’un phénomène relativement récent dans les sociétés développées. Je préfère y voir une erreur du traducteur qui a confondu alphabétisme (système d’écriture composé de lettres) avec alphabétisation (enseigner la lecture et l’écriture aux analphabètes).
En réalité, la vraie question que se pose Jared DIAMOND tout au long de son ouvrage, de la première page jusqu’à la dernière page, est celle-ci :
« Pourquoi, (..), ce sont les sociétés européennes, plutôt que celle du Croissant fertile, de la Chine qui ont colonisé l’Amérique et l’Australie ? ». (page 614)
Car, la situation de domination sur le monde exercée par l’Europe, depuis le 15ème siècle, semble beaucoup chagriner Jared DIAMOND.
Jared DIAMOND ne veut voir dans cette domination que l’effet du hasard, provoqué par des phénomènes uniquement matériels, d’ailleurs venus de l’Asie du Sud-Est, de sorte que, selon lui, les Européens n’ont aucun mérite d’avoir créé des sociétés développées. Briser la superbe de cette Europe (État-Unis compris, où il vit), tel est l’objectif de son livre. Par quel moyen ? Pour Jared DIAMOND, l’Histoire doit devenir une science, s’inspirant de sciences comme « la génétique, la biologie moléculaire et la biogéographie appliquée aux cultures* et à leurs ancêtres sauvages* » (page 32). [Attention, il s’agit ici des cultures céréalières ou légumières et de leurs ancêtres sauvages]
La thèse de Jared DIAMOND
Pour Jared DIAMOND, les sociétés qui bénéficient des milieux les plus favorables pour son alimentation seront à même de supplanter et d’exterminer les autres moins favorisées vivant sur des terres plus ingrates.Selon Jared DIAMOND, tout, à la base, est une question d’alimentation.
Ainsi, pour qu’une société soit « supérieure » à d'autres sociétés, il est nécessaire qu’elle dispose :
- d’une installation sur des terres où la nature se montrerait prolifique et généreuse en céréales sauvages ;
- de la meilleures combinaison d’un certain nombre de cultures agricoles : céréales et de plantes légumières à forte concentration de protéines qui auront, au préalable, été domestiquées ;
- du plus grand nombre d’animaux domesticables de toute taille pour son alimentation, dont pourtant certains doivent être assez robustes et d’une taille assez importante pour qu’ils soient capables de transporter la production agricole, et bien sûr, aussi le matériel de guerre et les troupes ;
- d’une localisation géographique parfaite permettant à la société de bénéficier par simple diffusion des innovations culturelles (écriture), culturales (agricultures) et technologiques réalisées par d’autres sociétés ;
La meilleure alimentation et la réception rapide de ces innovations venues de l’extérieur permettra à la société de passer rapidement du stade de l’âge de pierre à l’âge de bronze puis à celui du fer, qui seront d’une grande utilité non seulement pour la production agricole, mais aussi et surtout pour la fabrication des armes de guerres (fusils, canons, épées, etc.).
En outre, l’élevage du bétail provoquera de graves maladies dans la population qui le pratique. Mais, au cours des siècles, cette population en sera finalement immunisée par l’habitude. Par contre, lorsque cette société envahira d’autres sociétés pratiquant moins ou pas tout l’élevage du bétail, ces maladies provoqueront des hécatombes dans les sociétés envahies. Par conséquent, nous dit Jared DIAMOND, l’élevage du bétail, ou du moins les microbes qui en sont la conséquences, constitue une arme de guerre. Je rappelle le titre originel anglais de l’ouvrage « canon, microbes et acier, les Parques, etc.).
Si elle est en possession de ces atouts, ladite société est, selon Jared DIAMOND, mécaniquement assurés du succès, à savoir conquérir d’autres sociétés. C’est le miracle de la méthode d’analyse causale, d’après laquelle chaque phénomène est obligatoirement l’effet du phénomène précédent et la cause du phénomène suivant.
Jared DIAMOND constate que, sur ce plan, c’est l’Asie qui a été privilégiée, en particulier, le Croissant fertile (Proche-Orient) où sont d’ailleurs nées les premières civilisations (Chine, Summer, Égypte, Arabe). Ce sont, selon Jared DIAMOND, les sociétés préhistoriques de cette régions qui vont conquérir les autres sociétés. Remarquons, au passage, qu’il oublie l’Inde.
Autre objection : chacun sait que c’est l’Europe qui, dans la période historique, va conquérir l’Afrique, l’Australie, l’Océanie, l’Amérique du Nord et du Sud, l’Antartique, etc. Jared DIAMOND est conscient de cette contradiction : sa théorie ne colle pas avec les faits historiques. Qu’à cela ne tienne, il « invente » un nouvelle aire géographique, homogène selon lui, l’Eurasie, englobant à la fois l’Europe et l’Asie. Dans cette Eurasie, la région Europe aurait pratiquement tout reçu de l’Asie, en cultures céréalières, en animaux domestiques, en métaux, poudre à canon, de telle sorte que, quels que soient par la suite les progrès techniques, intellectuelles qu'elle réalisera, l'Europe n’en aurait, selon l'auteur, aucun mérite. C’est ainsi que Jared DIAMOND arrive à écrire cette véritable loufoquerie à la logique incohérente :
« Les colons européens n’ont pas crée en Australie une démocratie industrielle, productrice de vivres et alphabétisée. Tous ces éléments, ils les ont importés de l’extérieur : le cheptel, toutes les cultures (sauf les noix de macadamia), les techniques métallurgiques, les machines à vapeur, les fusils, l’alphabet, les institutions politiques et même les germes. Il s’agissait à chaque fois de produits finis, fruits de 10 000 ans de développement dans les milieux eurasiens. Par un accident de la géographie, les colons qui débarquèrent à Sydney en 1788 avaient hérité de ces éléments (sic) » (pages 482 et 483). Bien sûr, Sydney n’existait pas en 1788. Ainsi, pour Jared DIAMOND, la démocratie, l’industrie et l’alphabétisation sont des inventions chinoise, arabe ou égyptienne. Pourquoi pas les cathédrales gothiques, l’industrie nucléaire et les vaccinations antirabiques et antivarioliques qui ont sauvé tant de peuples conquis par l’Europe ?
Jared DIAMOND prétend que la diffusion des innovations de Chine jusqu’en Europe du Nord, dans ce qu’il appelle, pour les besoins de sa cause, l’Eurasie, était facile sur l’axe Est-Ouest. C’est oublier les Chaînes de montagnes et le désert à traverser entre la Chine et l’Iran.
Par contre, Jared DIAMOND prétend que l’axe Nord-Sud du continent américain était plus accidenté au niveau de l’Amérique centrale outre, les ’immenses forêts, de sorte que la diffusion des innovations entre le Nord et le Sud était fortement ralentie, la voie marine étant impossible à utiliser à cause de la présence d’un désert au Texas. C’est ici aussi oublier que les îles Caraïbes ont été colonisées par les Indiens du même nom. Il est d’ailleurs curieux que Jared DIAMOND n’indique pas sur la carte géographique qu'il produit les mouvements d’émigration des populations des peuples Caraïbes vers les îles Caraïbes, alors que sur la même carte il indique en détail les mouvements migratoires vers les îles polynésiennes. Pourquoi cette pudeur pour les Îles caraïbes. Est-ce pour ne pas gêner sa théorie ?
L’exemple le plus important de cette curieuse méthodologie est celui du passage des hommes préhistoriques de la Sibérie en Amérique du Nord. Les préhistoriens situent cet événement en –20.000 avant J.C., en raison de la possibilité de passage à pied sec. Jared DIAMOND le situe beaucoup plus tard vers –13.000 avant J.C., tout simplement parce qu’aucune découverte archéologique n’a été faite datant de –20.000 à –13.000 sur ce passage. Il faut dire que cela arrange sa théorie, à savoir que les Indiens n’ont pas bénéficié du temps nécessaire pour se développer autant qu’ils l’auraient pu si leurs ancêtres avaient traversé le détroit de Behring en -20.000 avant notre ère.
Au regard du simpliste et grossier matérialisme, sur lequel Jared DIAMOND base sa thèse, Karl MARX, avec son matérialisme historique, fondé sur les contradictions naissant des rapports sociaux de production (la matière, l’infrastructure), mais qui tient compte de l’influence majeure des superstructures (l’idéologie, le psychisme) dans le cours de l’histoire, pourrait passer pour un adepte de la métaphysique platonicienne, rêvant du monde des Idées.
Il est vrai qu’il s’agit d’un ouvrage de de compilation et de vulgarisation qui ne nécessite aucune connaissance précise en histoire, en philosophie, en sciences écrit en langage simple et même familier. Il comporte 694 pages présentant en détail les migrations préhistoriques, la domestication des légumes, des céréales et de certains animaux sauvages. Il ne nécessite un effort de réflexion de la part du lecteur moyen. En effet, les notions de société, d’histoire, de culture, de civilisation, d'Etat, employés indifféremment pour toutes les époques préhistoriques et historique, ne sont jamais définis, car toujours règne l’évidence. C’est donc un ouvrage qui fait appel au « bon sens populaire ».
Je ne veux pas dire qu’il faille écarter d’un revers de main les données brutes relatives au climat, à la végétation, aux cultures de céréales, aux légumes cultivés et à l’élevage du bétail selon les régions géographiques que Jared DIAMOND expose dans son ouvrage.
En effet, dès 1920, Oswald SPENGLER considérait que, pour comprendre l’histoire des cultures, il était nécessaire de prendre en compte l’histoire de l’économie, du droit, mais aussi l’histoire du paysage. Or, à propos du paysage, voici ce qu’il écrivait :
« Il nous manque également une histoire du paysage (donc du sol, donc de la végétation et du climat) sur lequel s’est déroulé l’histoire humaine depuis 5.000 ans. Or, l’histoire humaine est si difficile à séparer de l’histoire du paysage, elle reste si profondément liée à elle par des milliers de racines, qu’il est tout à fait impossible, sans elle de comprendre la vie, l’âme et la pensée.
En ce qui concerne le paysage sud-européen, depuis la fin de l’ère glaciaire une invincible surabondance de végétation cède peu à peu sa place à l’indigence du sol.
À la suite des cultures égyptienne, antique, arabe, occidentale, s’est accomplie autour de la Méditerranée une transformation du climat selon laquelle le paysan devait abandonner la lutte contre le monde végétal et l’entreprendre pour ce même monde, s’imposant ainsi d’abord contre la forêt vierge, puis contre le désert.
Au temps d’Hannibal, le Sahara était loin au sud de Carthage, aujourd’hui, il menace déjà l’Espagne du Nord et l’Italie ; où était-il au temps des constructeurs de pyramides portant en relief des tableaux de forêts et de chasse ?
Après que les Espagnols eurent chassés les maures, le caractère sylvestre et agricoles du pays qui ne pouvait être maintenu qu’artificiellement, s’effaça. Les villes devinrent des oasis dans le désert. Au temps des Romains, cette conséquence ne se serait pas produite. » (3)
Oswald SPENGLER est bien conscient que sa vision de l’histoire ne peut pas prendre en compte l’histoire du paysage (sol, végétation, climat), en raison de l’inexistence à son époque de telles études. Cependant, malgré le manque de données à sa disposition, Oswald SPENGLER entreprend, en une dizaine de lignes, une analyse synthétique sur un problème bien connu depuis longtemps : l’avancée du désert autour de la Méditerranée. Cependant, tout en constatant la grande importance de cet aspect physique dans l’évolution des civilisations méditerranéennes, Oswald SPENGLER introduit en même temps le facteur culturel : « Les villes devinrent des oasis dans le désert. Au temps des Romains, cette conséquence ne se serait pas produite. »
Tout laisse penser qu’après l’expulsion sur les Maures, les Espagnols de cette époque, les dizaines de milliers d’Espagnols venus du Nord qui s’étaient installés dans le Sud après la Reconquête, n’étaient pas du tout intéressés à continuer l’œuvre routinière du système d’irrigation laissé par les Arabes, en raison de son caractère administratif, collectiviste et coercitif poussé à l’extrême. C’était l’époque des chevaliers errants, de l’aventure. Les Espagnols de l’époque, en Occidentaux qu’ils étaient, tournés vers le lointain, individualistes forcenés, préférèrent partir à l’aventure au pays de l’Eldorado, en Amérique du Sud, pour y gagner richesses et liberté. Dans le sud de l’Espagne, les villes devinrent donc des oasis au milieu du désert.
Oswald SPENGLER ajoute qu’avec les Romains, une telle désertification ne se serait pas produite. En effet, quand ils conquéraient un pays, leur culture étant tournée vers l’aspect administratif et juridique des choses, les Romains construisaient des aqueducs, des routes, etc. pour contrôler le pays et ses populations avec leurs armées, de sorte que ces ouvrages d’art auraient permis d’arrêter l’avancée du désert, si, par hypothèse virtuelle, ils avaient hérité du système d’irrigation construit par les Arabes en Espagne.
La méthode historique selon Oswald SPENGLER, allie donc les facteurs géographiques aux facteurs culturels, exerçant selon lui un rôle prédominant. L’histoire devient, dès lors, plus compréhensible.
Jared DIAMOND, quant à lui, pour « expliquer » l’histoire humaine, ignore totalement le facteur culturel, c’est à dire la vision du monde, l’interprétation que les hommes se font de la vie : leurs mythes, leurs croyances, leurs conceptions artistiques et « scientifiques », la spécificité de leur organisation politique.
C’est ainsi que Jared DIAMOND nous parle souvent de « ses amis » Papous (ou Néo-Guinéens), mais jamais il ne nous expose ni leur culture, ni leur leur vision du monde, etc. Il affirme que lui et ses amis néo-Guinéens se posent mutuellement « mille questions », mais nous ne saurons jamais le contenu de ces questions.
Dans le tableau intitulé « Facteurs sous-jacents de l’Histoire » depuis la fin de l’époque glaciaire (page 122), Jared DIAMOND nous « explique » les « chaînes de causalité menant des facteurs lointains (orientations des axes continentaux) aux facteurs proches (fusils, chevaux, maladies, etc.) permettant à certains peuples d’en conquérir d’autres ». C’est une conception totalement zoologique de l’homme.
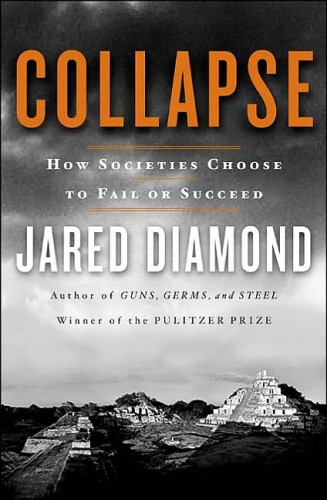 L’homme peut très bien se nourrir convenablement et ne pas avoir la force (psychique) de conquérir d’autres peuples. Par exemple, les Romains du 4ème siècle après J.C., c’est à dire ceux qui vivaient dans le Bas-Empire décadent, étaient mieux nourris que les Barbares Germains, et pourtant ce sont ces Barbares qui ont détruit l’Empire romain en 476. Aujourd’hui, les Européens, dont les ancêtres ont conquis l’Amérique du Nord et du Sud, il y a 500 ans, sans trop de problèmes, sont mieux nourris que les Afghans. Pourtant, ils seraient bien incapables (psychiquement) d’envoyer une véritable Armée conquérir l’Afghanistan. Leur pacifisme affiché n’a pour objet que de voiler leur incapacité psychique. On pourrait multiplier les exemples.
L’homme peut très bien se nourrir convenablement et ne pas avoir la force (psychique) de conquérir d’autres peuples. Par exemple, les Romains du 4ème siècle après J.C., c’est à dire ceux qui vivaient dans le Bas-Empire décadent, étaient mieux nourris que les Barbares Germains, et pourtant ce sont ces Barbares qui ont détruit l’Empire romain en 476. Aujourd’hui, les Européens, dont les ancêtres ont conquis l’Amérique du Nord et du Sud, il y a 500 ans, sans trop de problèmes, sont mieux nourris que les Afghans. Pourtant, ils seraient bien incapables (psychiquement) d’envoyer une véritable Armée conquérir l’Afghanistan. Leur pacifisme affiché n’a pour objet que de voiler leur incapacité psychique. On pourrait multiplier les exemples.
Pour comprendre pourquoi, à un moment donné de l’histoire, certaines sociétés ont conquis d’autres sociétés, il s’avère nécessaire de prendre en compte leur histoire et kleur culture.
Mais, ne prenant jamais en compte ni l'histoire ni la culture des sociétés qu’il évoque, Jared DIAMOND a une conception totalement a-historique de l’évolution des sociétés humaines.
C'est pourquoi, Jared DIAMOND, qui se veut historien, ne se pose jamais la question de la signification d’un événement au regard de l'histoire.
Pour qu’un évènement soit considéré comme historique, il faut qu’il ait une signification pour les hommes d’aujourd’hui, sinon, il se perd dans la masse des faites bruts.
Or, Jared DIAMOND fonde sa théorie de l’histoire humaine sur le principe de l’alimentation la meilleure en protéines et l’élevage de bétail comme « moteur » de l’histoire, en soulignant sur de nombreuses pages les multiples conquêtes qu’ont réalisées les hommes de la préhistoire.
Jared DIAMOND expose longuement les invasions préhistoriques des Chinois du Nord vers le Sud, faisant disparaître un certain nombre de peuples ou les chassant, tandis que ceux chassés de la Chine du Sud envahissaient la péninsule indochinoise et les îles polynésiennes, exterminant au passage les peuples déjà installés. Jared DIAMOND décrit les mêmes mouvements d’extermination et de conquête en Afrique, entre tribus africaines.
Mais les ayant signalés, il les oublie tout aussitôt. Et il a raison. Car tous ces mouvements guerriers de la Préhistoire n’ont aucune signification aujourd’hui.
En effet, les luttes entre deux tribus d’une société primitive, en Afrique ou en Europe, n’ont aucune espèce d’importance pour nous aujourd’hui, Elles n’ont aucune signification pour la compréhension du monde actuels.
Par contre, la victoire de la tribu barbare germanique des Chérusques sur les Romains en l’an 9, ou des Aztèques sur les Tlascanes au Mexique, s’appelle de l’histoire. Car ici, le "quand ?" a son importance.
La défaite des Romains en l'an 9, cette défaite eut pour conséquence pour les Romains de ne plus tenter de s’aventurer en Germanie, ce qui évita ainsi la romanisation. Nous aurions alors eu une Europe Gallo-romaine. Cet événement marque donc encore le monde moderne.
Par contre, Jared DIAMOND s’appesantit, pour les stigmatiser, lourdement sur les conquêtes européennes et les massacres qu’elle provoqua Comme je viens de le dire, il a parfaitement raison de faire ressortir l’action de l’Europe, même s’il n’est pas conscient du motif réel et se limite à la stigmatisation.
En effet, en partant à la conquête du Monde à partir du 15ème siècle, l’Europe a forcé, au besoin par les armes, et parfois de façon cruelle, de nombreux peuples qui vivaient repliés sur eux-mêmes à entrer dans l’Histoire, dans la « modernité » telle que la conçoit l’Occident. Elle a contraint les peuples repliés sur eux-mêmes à se découvrir entre eux. Elle a également contraint d’autres peuples qui, dans les siècles passés avaient joué un grand rôle comme puissances mondiales (Chine, Inde, monde arabe) à revenir sur la scène historique. En même temps, elle leur a fait découvrir, avec les progrès technologiques et sanitaires, ses notions de Liberté, de démocratie, d’État-Nation, etc, que, d’ailleurs, ces peuples retourneront plus tard contre elle.
Contrairement à d’innombrables conquêtes et exterminations réalisées par d'autres peuples, la conquête européenne de plusieurs continents est un exemple de fait historique ; elle fait histoire, car il a encore aujourd’hui une signification.
Autrement dit, en soulignant avec force la conquête de l’Amérique, de l’Afrique, de l’Australie tout en minimisant l’intérêt des conquêtes d’autres peuples, Jared DIAMOND constate un véritable fait historique, mais sans en saisir la signification profonde.
Ce faisant, il détruit l’intérêt de sa propre théorie comme explication exhaustive et définitive de l’histoire depuis la fin de l’époque glaciaire, car il est évident que les Européens n’ont pas conquis tous les continents de la planète parce qu’ils avaient, il y a 13.000 ans, une alimentation basée sur tels ou tels légumes ou céréales.
Les Européens ont réalisé ces conquêtes parce que leur culture, c’est-à -ire leur vision du monde, les portait à regarder vers le lointain beaucoup plus que la culture arabe, pourtant conquérante, et la culture chinoise, elle aussi conquérante, tandis que l’indienne ni l’antique n'’avait pas du tout cette attirance vers ce qui est étranger et loitnain.
Cet attrait vers le lointain était déjà présent vers l’an 1000 avec les Croisades, tandis que, dès le 13ème siècle, Marco Polo partait, avec sa famille, à l’aventure jusqu’en Chine pendant près de 17 années. Un Chinois, est-il venu en Europe à cette époque ?
Puis, au 15ème siècle, ce fut cet attrait vers l’Océan qui semblait constituer la voie la plus courte pour aller jusqu’en Chine et Japon où l’on trouvait, croyait-on à cette époque, de l’or à foison. Les meilleurs esprits scientifiques, en même temps théologiens et philosophes, tiraient des plans permettant de partir. Et finalement, arriva ce qui devait arriver. Un roi se laissa convaincre. On partit alors avec beaucoup d’impatience, en toute hâte, comme une pulsion puissante qui explose enfin en jaillissant du plus profond des instincts, sur de frêles embarcations vers l’inconnu, vers l’Ouest.
Mais Jared DIAMOND, qui ignore tout de la notion d’histoire, ne pense pas à se poser la question du « Quand ? ». . « Car ici, le quand a son importance », nous dit Oswald SPENGLER. Or, à cette époque, l’Europe était encore une culture jeune, en pleine maturité, qui avait une force psychique que nous, Européens civilisés, avons du mal à imaginer et même à comprendre.
En face, qu’y avait-il ?
Des peuples dont certains étaient à peine sortis du néolithique, des empires découpés en lambeaux, des civilisations endormies ou tombées dans la barbarie (Chine, Inde, Monde islamo-arabe) aux populations psychiquement prostrées, acceptant n’importe quel conquérant, occupése seulement à se reproduire et à travailler, n’éprouvant aucun intérêtsaux luttes féroces pour le pouvoir qui se déroulaient au-dessus d'elles et dont elles n’attendaient rien.
L’empire Aztèques était en réalité l’héritier de la vieille civilisation maya, essoufflée, malgré l’apparence barbare des Aztèques qui en avaient pris le commandement par la force. Quant à l’empire Inca, à peine né, sans écriture, il était déjà profondément divisé en raison de son système politique de transmission du pouvoir.
L’Europe ne pouvait que sortir victorieuse de toute ces confrontations et amener ces peuples sur la scène de l’Histoire. Désormais, ce qui se passe au Darfour, au Rwanda, au Tibet, en Colombie, en Australie, en Iran, etc., dans la moindre contrée, intéresse chaque habitant de la planète. C’est l’œuvre historique de l’Europe.
Jared DIAMOND veut « expliquer » l’Histoire, comme s’il s’agissait d’expliquer un comportement de molécules ou d’une masse musculaire stimulée en laboratoire. En le lisant, on a l’impression que l’homme est surtout un estomac.
Jared DIAMOND n’est pas parvenu à comprendre l’histoire, car il ignore totalement l’aspect psychique à la base des comportements et des actes des êtres humains. Cet aspect psychique apparaît dans ce qu’on appelle la culture (vision du monde, actuel, passé et à venir), mythes, croyances, morale, art.
Par exemple, les Aborigènes d'Australie ont une culture centrée sur ce qu’ils appellent « le temps du rêve », ou simplement « le rêve » (cela rappelle le culture indoue),
Le « temps du rêve » explique les origines de leur monde, de l’Australie et de ses habitants. Selon leur tradition, des créatures géantes, comme le Serpent arc-en-ciel, sont sorties de la terre, de la mer ou du ciel et ont créé la vie et les paysages australiens. Leurs corps géants ont créé des fleuves et des chaînes de montagne mais leur esprit est resté dans la terre, rendant la terre elle-même sacrée aux peuples indigènes. Le rêve, la terre sacrée, autant de mythe qui ont incité les aborigènes d’Australie à ne pas quitter leurs régions pour partir à la découverte d’autres peuples et profiter des innovations des peuples voisins. Jared DIAMOND, qui se prétend leur « ami », ne dit pas un mot sur leur culture, leurs mythes, leur vision du monde, leur religion, qui pourraient expliquer bien des choses. À mon avis, la thèse de la prépondérance de l’esprit, de la culture, sur le comportement humain permet de mieux comprendre l’histoire.
Jared DIAMOND ne se pose pas non plus la question de comprendre pourquoi après 40.000 ans d’occupation de l’Australie, on ne dénombre, à l’arrivée des premiers Européens en 1788, que 250.000 aborigènes, alors que les Indiens sont plusieurs millions après 15.000 ans d’occupation de l’Amérique, au 15ème siècle, à l’arrivée des Espagnols. Que s’est-il passé ? Quels Empires se sont effondrés ? que signifie réellement ou symboliquement ces figures de géants gravés sur les rochers il y a 10.000 ou 30.000 ans ? Mais Jared DIAMOND ne s’intéresse qu’aux estomacs.
Pour ce qui concerne les Papous de Papouasie-Nouvelle-Guinée, que Jared DIAMOND présente aussi comme « ses amis », on ne saura rien de leur culture à la fin des 694 pages, malgré tout un chapitre intitulé « Le peuple de Yali », dans lequel Jared DIAMOND se borne à récapituler toutes les cultures légumières, les élevages du cochon et les migrations depuis la Préhistoire. Pourtant, Jared DIAMOND aurait pu exposer au lecteur le fondement de la culture papoue centrée sur le prestige et la beauté du guerrier. Quelle signification symbolique pouvait avoir leur comportement nécrophage et anthropophages. Sur tout cela, Jared DIAMOND reste muet, arc-bouté sur sa thèse sur l’influence du seul milieu géographique sur l’histoire humaine.
Mais passé « l’effet-céréales-légumes-bétail » qui, selon Jared DIAMOND, aurait expliqué à lui seul la prédominance du Croissant fertile et de la Chine sur le monde depuis la préhistoire, comment expliquer que ces deux régions ont perdu leur puissance mondiale, leur capacité d’expansion et d'innovation, de sorte que ce ne sont pas elles qui ont découvert et conquis l’Amérique, mais l’Europe ?
Fidèle à lui-même, sans même dire un seul mot des facteurs culturels., Jared DIAMOND ne voit qu’une explication matérialiste et mécaniste à la sortie de l’Histoire de ces deux régions.
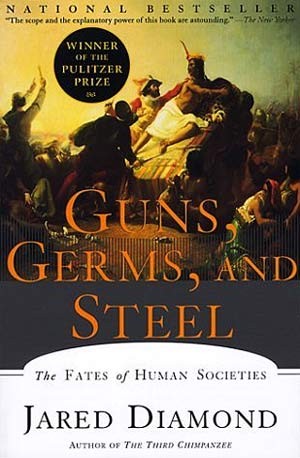 Pour ce qui concerne le Croissant fertile, Jared DIAMOND prétend que la cause du déclin se trouverait, selon lui, simplement dans la désertification, tout en « oubliant » de citer la culture arabo-islamique, pour les besoins de sa cause. Car la civilisation arabo-islamique, bien qu’issue du désert, parvient naturellement à surmonter la désertification au moyen de son esprit conquérant, de sorte qu’elle fut à deux doigts de surpasser l’Occident naissant pour la domination du monde, outre que son rayonnement a duré tout de même 5 siècles au minimum. Mais Jared DIAMOND se garde d’en parler, car ce fait historique contredit sa thèse.
Pour ce qui concerne le Croissant fertile, Jared DIAMOND prétend que la cause du déclin se trouverait, selon lui, simplement dans la désertification, tout en « oubliant » de citer la culture arabo-islamique, pour les besoins de sa cause. Car la civilisation arabo-islamique, bien qu’issue du désert, parvient naturellement à surmonter la désertification au moyen de son esprit conquérant, de sorte qu’elle fut à deux doigts de surpasser l’Occident naissant pour la domination du monde, outre que son rayonnement a duré tout de même 5 siècles au minimum. Mais Jared DIAMOND se garde d’en parler, car ce fait historique contredit sa thèse.
Et si aujourd’hui, malgré la chance que l’Histoire leur a de nouveau donné avec le pétrole, les pays arabo-musulmans n’ont pas réussi à sortir de l’ornière, avec encore 40 % d’analphabètes, et un taux d’innovations technologiques et spirituelles parmi les plus bas du monde, cela est surtout dû (comme au 14ème siècle) à leur culture qui les tourne entièrement vers un passé mythifié et les empêche de profiter du potentiel créatif de 50 % de leurs population (les femmes).
Aussi superficielle apparaît la raison que donne Jared DIAMOND pour « expliquer » pourquoi ce n’est pas la Chine qui a découvert et conquis l’Amérique ou l’Afrique. Car il faut savoir que, dès 1400, près de 90 ans avant l’aventure de Christophe Colomb, tout était prêt pour partir vers l’Afrique : bateaux de très gros tonnages, équipages, matériels, etc. Mais soudain, l’empereur ordonna d’arrêter tout et de brûler la flotte. Et on n’en parla plus. Jared DIAMOND y voit simplement l’effet du hasard : il y eut un coup d’État fomenté par les eunuques dont le bénéficiaire interdit toute expédition au-delà des mers ! Il ne voit pas là non plus que cette interdiction vient de la profondeur de l’âme chinoise seulement intéressée par ce qui est chinois. Même avec l’Inde, les relations étaient insignifiantes. La Chine n’a jamais rêvé d’aller en Europe. Alors pourquoi aurait-elle rêvé de l’Amérique, de l’Afrique ? Ce n’est pas un hasard non plus si elle a entouré son espace vital d’une grande muraille.
Par contre, en Occident, si Christophe Colomb était mort sans avoir réalisé son projet, d’autres « rêveurs », des savants, des aventuriers, dont l’Europe abondait alors, se seraient levés pour partir vers ce qu’ils affirmaient être la voie la plus courte pour aller en Chine, et finalement l’un d’entre eux auraient réussi. Simplement, au lieu d’être espagnole, l’Amérique du Sud aurait peut-être été française.
Sur le racisme biologique
En même temps qu’il prétend démontrer que la diversité de l’histoire humaine est simplement le résultat des différences de milieux géographiques, climatiques et végétaux, Jared DIAMOND imagine prouver l’inanité du racisme biologique : « L’histoire a suivi des cours différents pour les différents peuples en raison de différences de milieux, non pas de différences biologiques » (page 31).
Jared DIAMOND s’est choisi un adversaire, le racisme biologique, déjà définitivement terrassé politiquement et militairement depuis 65 ans, et, sur les plans scientifique et philosophique, depuis le XXème siècle. C’est donc sans crainte d’être démenti que, à chaque fin de chapitre de son ouvrage, Jared DIAMOND stigmatise, comme une justification de sa thèse sur l’histoire, le racisme biologique dont il fait surtout grief aux Européens et aux Américains.
Son anti-racisme est d’ailleurs assez étonnant, car en réaction aux supposés racistes biologiques blancs qui pensent être plus intelligents que les gens d’une autre couleur, les Papous de Nouvelle-Guinée, en l’espèce, Jared DIAMOND prétend que ce sont les Papous de Nouvelle-Guinée, qui seraient plus intelligents que les blancs Européens : « Pourquoi, malgré leur intelligence que je crois supérieure, les Guinéens ont-ils finalement une technique primitive ».
Remarquons que Jared DIAMOND « croit » à la supériorité intellectuelle des Papous, sans estimer nécessaire de le démontrer. Il ne s’aperçoit pas qu’il fait alors du racisme biologique anti-blanc. Il tombe dans la même aberration qu’il prétend combattre. Sans s’en être conscient, il adopte une position raciste. Il est vrai que la thèse du racisme biologique est une thèse matérialiste, comme celle que défend Jared DIAMOND consistant à faire de l’estomac le moteur de l’histoire humaine. Les deux thèses en présence paraissent s’opposer, mais elles finissent par se rejoindre dans le fond, parce qu'elles sont toutes deux matérialistes.
Les Blancs et les Papous étant des homo sapiens, ils ont en moyenne le même niveau d’intelligence, au contraire de ce que pense Jared DIAMOND. Leurs différences de comportement est, pour l’essentiel, d’origine psychique, donc culturelle, et n’a rien à voir avec l’intelligence.
Le conquérant et bâtisseur du Maroc moderne, le Maréchal LIAUTEY, l’avait déjà compris en 1910, lorsqu’ils disaient à ses soldats : « Les peuples coloniaux ne nous sont pas inférieurs ; ils sont autres ».
Au surplus, le racisme d’aujourd’hui est un phénomène psychique. Par conséquent, il ne peut pas efficacement se combattre avec des arguments scientifiques. Il se combat avec des moyens psychiques : proposer un même destin à des personnes d’origines raciales différentes.
Des hommes aux dinosaures en passant par les oiseaux
Poussant jusqu’au bout l’assimilation de la méthode historique à la méthode des sciences physiques et biologiques, Jared DIAMOND termine son livre dans une sorte d’apothéose, nous faisant entrevoir une perspective quasi-« grandiose », et peut-être même gigantesque :
« J’ai donc bon espoir que l’étude historique des sociétés humaines puisse se poursuivre aussi scientifiquement que l’étude des dinosaures – et pour le plus grand profit de notre société (…) ». (pages 640 et 641).
Ainsi, Jared DIAMOND abaisse l’être humain, l’homo sapiens, au même niveau que le dinosaure.
Certains y verront, de la part de Jared DIAMOND, l’expression d’une sorte de nihilisme absolu, conséquence de son matérialisme forcené : la négation de toutes les valeurs (spirituelles, morales, sociales, intellectuelles) et de leur hiérarchie.
Mais, après tout, les dinosaures ne sont-ils pas considérés comme les ancêtres des oiseaux ? Une façon pour Jared DIAMOND, conscient peut-être des limites de sa thèse, d’exprimer, sur un mode « inintentionnel », sa nostalgie du temps où il ne s’occupait que d’ornithologie, objet d’études moins complexe que l’histoire humaine.
Pierre Marcowich
(1) Jared DIAMOND, DE L’INÉGALITÉ PARMI LES SOCIÉTÉS, Éditions Gallimard, 2000, pour l’édition française, impression de février 2009, Traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Pierre-Emmanuel Dauzat, 694 pages ;
(2) WEBSTER’S NEW TWENTIETH CENTURY DICTIONARY – unabriged –Second edition – Deluxe color, World publishing Company, 1977, (2.128 pages) : Article Fate (pages 666-667) : « The Fates : in Greek and Roman mythology, the three goddesses who control human destiny and life. »
(3) Oswald SPENGLER, LE DÉCLIN DE L’OCCIDENT ; Éditions Gallimard, 1948, renouvelé en 1976, Tome II, Chap. I, Origine et paysage, page 42, note de bas-de-page ;
00:10 Publié dans anthropologie, Ethnologie, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthropologie, ethnologie, sociologie, philosophie, sociétés, déclin, décadence, jared diamond |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 16 septembre 2010
Konrad Lorenz, uno scienziato antimoderno

di Stefano Di Ludovico I pregiudizi scientisti e progressisti di cui è impregnata la nostra cultura ci portano spesso a vedere in ogni visione alternativa rispetto al mondo moderno il portato di mentalità antiscientifiche ed arcaiche, sogno di visionari metafisici che ignorano i fondamenti e le regole più elementari del sapere positivo. Sembra quasi che la critica al mondo moderno sia prerogativa di culture inevitabilmente “altre” rispetto a quel sapere che di tale mondo si reputa a fondamento, e che la scienza sia necessariamente al servizio della modernità e della società a cui essa ha dato origine. La figura e l’opera di Konrad Lorenz smentiscono clamorosamente tali pregiudizi: universalmente considerato uno dei maggiori “scienziati” del XX secolo, padre dell’etologia moderna e Nobel per la fisiologia e la medicina nel 1973, è stato al tempo stesso uno dei più lucidi e feroci critici della modernità e dei suoi miti, anticipatore di molte di quelle tematiche oggi fatte proprie dai movimenti e dalle culture ambientaliste e no-global.
Fonte: Centro Studi Opifice [scheda fonte]
A rileggere la sua opera, sviluppatasi lungo l’arco di un quarantennio, dal dopoguerra agli anni Ottanta del secolo appena trascorso, ci ritroviamo al cospetto di un vero e proprio “profeta” dei mali che affliggono il nostro mondo e dei problemi che la nostra generazione è chiamata ad affrontare. E tutto ciò da una prospettiva che pur rimanendo fedele ai fondamenti positivisti ed evoluzionisti della sua visione di fondo, ha saputo essere al tempo stesso radicalmente anticonformista ed “inattuale” rispetto ai valori ed alle tesi di cui quella visione si è fatta spesso portatrice. Ci sembra essere proprio questa, alla fine, la cifra del pensiero di Konrad Lorenz, uno scienziato “antimoderno”. A diciotto anni dalla sua morte - avvenuta nel 1989 - proprio oggi che molte delle sue analisi si sono rivelate profetiche e che l’eco delle polemiche, anche accese, che hanno accompagnato la sua vicenda culturale ed umana si va ormai spegnendo, è possibile, e al tempo stesso doveroso, guardare alla sua opera con maggiore interesse, curiosità ed obiettività, attribuendole la valenza e la riconoscenza che meritano.
Konrad Lorenz nasce a Vienna nel 1903. Studia medicina a New York e a Vienna, laureandosi nel 1928. Nel 1933 consegue anche la laurea in zoologia, assecondando i suoi veri interessi che si stavano orientando sempre più verso il mondo animale e l’ornitologia in particolare. Nel 1937 diventa docente di psicologia animale e anatomia comparata presso l’Università di Vienna e, a partire dal 1940, di psicologia all’Università di Königsberg. Scoppiata la guerra, combatte nell’esercito tedesco. Durante il conflitto viene fatto prigioniero dai russi; così dal 1944 al 1948 è trattenuto in un campo di detenzione sovietico fino alla fine delle ostilità. Nel 1949 viene pubblicato L’anello di Re Salomone, destinato a rimanere la sua opera più celebre, dove Lorenz rivela quelle doti di abile ed affascinante divulgatore che resero i suoi testi famosi nel mondo, avvicinando alle tematiche etologiche e naturalistiche un vasto pubblico di non addetti ai lavori; doti confermate nel successivo E l’uomo incontrò il cane, del 1950. Nel 1961 diviene Direttore dell’Istituto Max Plank per la fisiologia del comportamento di Starnberg, in Baviera, carica che manterrà fino al 1973. E’ proprio a partire da tali anni che, accanto a testi a contenuto prettamente scientifico, Lorenz inizia ad estendere i suoi interessi alla sfera sociale e culturale, per arrivare ad affrontare le tematiche dell’attualità del suo tempo, lette all’interno di un’ottica che faceva tesoro di quanto via via egli stava maturando e scoprendo in ambito naturalistico. Dall’etologia animale si passa così all’etologia umana. Tali nuovi interessi iniziano per la verità a fare capolino già nelle opere a carattere scientifico, rivelando la vastità degli orizzonti e delle prospettive che fin dagli inizi hanno accompagnato la sua ricerca.
L’opera Il cosiddetto male, del 1963, che affronta il tema dell’aggressività intraspecifica, è un tipico esempio di tale prospettiva. In questo scritto Lorenz sostiene che l’aggressività, al pari di diversi altri istinti quali la sessualità o la territorialità, sia un comportamento innato, come tale insopprimibile e spontaneo, impossibile da far derivare dai soli stimoli ambientali. Essendo un istinto innato, l’aggressività è in quanto tale “al di là del bene e del male” (di qui anche il carattere ironico e polemico del titolo del libro; modificato, in alcune delle edizioni successive, nel più neutro L’aggressività), componente strutturale di ogni essere vivente e svolgente un ruolo fondamentale nell’ambito dei processi evolutivi e quindi della sopravvivenza della specie. Basti pensare al ruolo che la conflittualità intraspecifica gioca nell’ambito della delimitazione del territorio, della scelta del partner nella riproduzione, dell’instaurazione delle gerarchie all’interno del gruppo. Lorenz sostiene altresì che gli stessi istinti “buoni”, ovvero quelli gregari e amorosi, derivino evoluzionisticamente dalla stessa aggressività, essendo modificazioni selettive di questa indirizzati a finalità differenti, tanto che sopprimere l’aggressività significherebbe sopprimere la vita stessa. Il libro suscitò polemiche violentissime, dato che Lorenz non limitò le sue riflessioni all’ambito animale, ma le estese anche a quello umano e storico-sociale. Le accuse si sprecarono e la polemica, dal terreno scientifico su cui Lorenz intendeva mantenerla, scivolò, com’era prevedibile, su quello politico ed ideologico: gli diedero del razzista e del guerrafondaio. In realtà il proposito del testo era quello di criticare le correnti comportamentiste e behavioriste, allora molto in voga, secondo cui tutti i comportamenti derivano in ultima analisi dalle influenze e dagli stimoli ambientali, modificati i quali sarebbe possibile modificare gli stessi comportamenti, aggressività inclusa. Per i comportamentisti, quindi, non vi sarebbe nulla di innato. Lorenz, al contrario, considera l’istinto un dato originario, geneticamente condizionato: in quanto tale, esso vive di vita autonoma, non vincolandosi necessariamente all’azione di quelle influenze ambientali aventi la funzione di stimoli scatenanti. Anzi, secondo Lorenz più un istinto non trova occasione di scatenamento, più aumenta la possibilità che esso si scarichi prima o poi in maniera ancor più dirompente, anche in assenza degli stimoli corrispondenti. Se così non fosse, per Lorenz sarebbero difficilmente spiegabili i fenomeni di aggressività cosiddetta “gratuita”, così diffusi sia nel mondo animale che tra gli uomini. Lungi dal costituire un’apologia della violenza e della guerra, l’opera di Lorenz intendeva innanzi tutto mettere in guardia da ogni posizione utopica circa la convivenza umana e la risoluzione dei conflitti, risoluzione che, per essere realistica e antropologicamente fondata, non poteva prescindere da dati e analisi che egli riteneva incontrovertibili. Al contrario, proprio la mancata conoscenza del funzionamento dei comportamenti innati poteva portare a risultati opposti a quelli auspicati, finendo per favorire proprio l’innesco di comportamenti deleteri per la pacifica convivenza. Sostenendo l’impermeabilità di fondo ai condizionamenti ambientali degli istinti basilari dell’uomo come di tutte le specie animali, Lorenz vuole evidenziare così le illusioni insite nella convinzione secondo cui l’educazione e la trasformazione dell’assetto politico-sociale sarebbero di per sé sufficienti a modificare e plasmare i comportamenti umani. E questo non perché egli negasse ogni valore alla cultura o alla dimensione spirituale dell’uomo, quasi a volerlo ridurre a un animale tra i tanti e per ciò vincolato esclusivamente ai suoi istinti. Alieno da ogni visione irenistica e bucolica dell’uomo così come della natura in genere, critico di ogni antropologia che risentisse del mito rousseauiano del “buon selvaggio”, egli sottolineò piuttosto come la “pseudospeciazione culturale” tipica della specie umana ha portato i gruppi umani – siano essi i clan, le tribù, le etnie o le moderne nazioni - una volta raggiunto un determinato grado di differenziazione reciproca, a relazionarsi in modo molto simile a quello delle specie animali più evolute, specie tra le quali, come accennato sopra, la conflittualità intraspecifica gioca un ruolo fondamentale all’interno dei processi adattativi. Lorenz evidenzia come diversi comportamenti risalenti a fattori culturali rivelino una fenomenologia sorprendentemente simile a quelli di origine genetica, facendo risaltare così una certa convergenza tra le dinamiche animali e quelle umane, convergenza che in fenomeni come non solo l’aggressività, ma anche ad esempio la territorialità, l’imprinting, il gioco ed i riti risalta con chiarezza.
E’ soprattutto però con opere quali Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, del 1973 e Il declino dell’uomo, del 1983, che le problematiche del proprio tempo e la critica alle convinzioni ed alle ideologie dominanti diventano i temi centrali della sua ricerca; temi che, comunque, continuano a trovare ampio spazio anche nelle opere a contenuto scientifico di questo periodo. Tra queste ricordiamo L’altra faccia dello specchio, del 1973, dedicata alla disamina dei processi conoscitivi della specie umana da un punto di vista storico-evoluzionistico, Natura e destino, del 1978, dove viene ripreso il confronto tra innatismo e ambientalismo, e Lorenz allo specchio, scritto autobiografico del 1975. Nel 1973, intanto, tra le ennesime e strumentali polemiche scatenate in particolare dagli ambienti culturali di sinistra, viene insignito, come accennato, del Premio Nobel per la fisiologia e la medicina, unitamente ad altri due etologi, Nikolaas Tinbergen e Karl Ritter von Frisch. Pur di infangare la sua figura, non bastando le meschine accuse già rivoltegli in occasione de Il cosiddetto male, per l’occasione vennero tirati in ballo presunti atteggiamenti di condiscendenza verso il regime nazista, strumentalizzando ad arte tesi espresse a suo tempo in merito all’eugenetica. In realtà, ciò che non gli veniva perdonato erano le posizioni controcorrente verso i miti progressisti-rivoluzionari così prepotentemente in voga nel clima caldo degli anni settanta, così come il temperamento libero e non curante verso il “politicamente corretto”, che lo portavano a confrontarsi senza pregiudizi con gli ambienti intellettuali più disparati, come dimostra l’attenzione mostrata verso il GRECE, il “Gruppo di ricerca e studio per la civilizzazione europea”, fondato in Francia da Alain De Benoist, dalla cui collaborazione nacque anche un libro-intervista pubblicato nel 1979 con il titolo Intervista sull’etologia. Sempre nel 1973 si stabilì ad Altenberg, in Austria, assumendo la direzione del Dipartimento di sociologia animale dell’Accademia Austriaca delle Scienze. Tra le altre più significative opere ricordiamo L’etologia (1978), vasta sintesi del suo pensiero etologico, e i due libri-intervista Salvate la speranza (1988) e Il futuro è aperto (postumo del 1996, in collaborazione con il filosofo Karl Popper), in cui torna ad affrontare anche tematiche più specificatamente filosofico-sociali.
Gli otto peccati capitali della nostra civiltà, destinata a diventare una delle sue opere più note, vuole essere un’analisi delle cause della decadenza della civiltà e dei pericoli che incombono sull’umanità. Come il successivo Il declino dell’uomo, è un’opera intrisa di un cupo pessimismo, a volte radicale, pessimismo che in seguito lo stesso Lorenz avrebbe ritenuto esagerato. Gli otto “peccati capitali” della civiltà sarebbero a suo dire i seguenti: l’abnorme aumento della popolazione mondiale; la devastazione dell’ambiente; la smisurata competizione economica tra gli individui; l’affievolirsi dei sentimenti; il deterioramento del patrimonio genetico; l’oblio della tradizione; l’omologazione culturale; la proliferazione nucleare. Come vediamo, si tratta di “peccati” ancor oggi all’ordine del giorno e con i quali l’attuale umanità continua a fare i conti, ma che al tempo di Lorenz ancora non venivano individuati e denunciati come tali in tutta la loro gravità. Addirittura tali “peccati” rischiano per Lorenz di portare l’umanità verso l’estinzione. Questa visione apocalittica gli è suggerita, secondo un’ottica seguita un po’ in tutte le sue opere, dal parallelo che egli istituisce con il mondo dell’evoluzione animale e naturale in genere. Più che eventi causati da specifici accadimenti storico-sociali, essi vengono letti infatti quali veri e propri fenomeni degenerativi dell’evoluzione umana: come avviene per molte specie viventi che, ad un certo punto della propria storia evolutiva, imboccano un vicolo cieco avviandosi verso l’estinzione, lo stesso sembra stia accadendo per la specie umana. “Quale scopo – si chiede Lorenz – possono avere per l’umanità il suo smisurato moltiplicarsi, l’ansia competitiva che rasenta la follia, la corsa agli armamenti sempre più micidiali, il progressivo rammollimento dell’uomo inurbato? A un esame più attento, quasi tutti questi fatti negativi si rivelano però essere disfunzioni di meccanismi comportamentali ben determinati che in origine esercitavano probabilmente un’azione utile ai fini della conservazione della specie. In altre parole, essi vanno considerati alla stregua di elementi patologici”. Al di là delle legittime perplessità e delle riserve che una simile chiave di lettura – vincolata ad un’impostazione in ultima analisi biologista ed naturalista dei processi storico-sociali – può suscitare, l’opera di Lorenz rappresenta una delle più lungimiranti e pionieristiche denuncie della società moderna, di cui vengono con vigore demistificati i miti ed i valori fondanti. Fenomeni che secondo la tradizione del pensiero moderno venivano considerati quali espressione della più intima natura umana – la competizione economica, la ricerca del benessere materiale, l’indefinito progresso tecnologico – vengono denunciati, al contrario, quali vere e proprie “patologie”, che stanno allontanando sempre più l’uomo dalla sua vera essenza, riducendolo a mero strumento delle forze tecno-economiche da egli stesso messe in moto. “La competizione tra gli uomini – afferma – che promuove, a nostra rovina, un sempre più rapido sviluppo della tecnologia, rende l’uomo cieco di fronte a tutti i valori reali e lo priva del tempo necessario per darsi a quella attività veramente umana che è la riflessione”. Estraniatosi dal mondo e dai ritmi della natura, l’uomo vive ormai in una nuova dimensione puramente artificiale, dove sono le leggi ed i ritmi della tecnica a regolare la sua vita. Ciò ha condotto a stravolgere l’identità e la specificità stesse dell’uomo, con il progressivo inaridimento dei sentimenti e delle emozioni, l’estinzione del senso estetico, la distruzione delle tradizioni e delle istituzioni che avevano da sempre regolato la convivenza umana prima dell’avvento della società industriale. Lorenz arriva a sostenere che la situazione dell’umanità contemporanea può essere paragonata a quella delle specie animali allevate ed selezionate a scopi produttivi, presso le quali l’addomesticamento ha determinato una vera e propria alterazione dei loro caratteri naturali.
In tal senso, Lorenz pone le basi per un ambientalismo che, non limitandosi a denunciare la perturbazione degli ecosistemi o la devastazione dell’habitat naturale dell’uomo, mette l’accento sulla necessità di recuperare un’esistenza più conforme ai dettami ed ai limiti della natura; natura accettata e fatta propria anche nella sua dimensione tragica e dolorosa. Il progetto della modernità di voler bandire il dolore e la fatica dal mondo è visto infatti da Lorenz come una vera e propria iattura: “il progresso tecnologico e farmacologico favorisce una crescente intolleranza verso tutto ciò che provoca dolore. Scompare così nell’uomo la capacità di procurarsi quel tipo di gioia che si ottiene soltanto superando ostacoli a prezzo di dure fatiche”. Nella società del benessere e del comfort “l’alternarsi di gioia e dolore, voluto dalla natura, si riduce a oscillazioni appena percettibili, che sono fonte di una noia senza fine”, noia che è alla base di quella illimitata ricerca del “piacere” – che della “gioia” è solo la caricatura parossistica - su cui fa leva la società dei consumi. In tal senso Lorenz, che si impegnò spesso anche sul piano delle battaglie concrete intervenendo nei dibattiti pubblici e partecipando a molte iniziative ambientaliste, espresse anche posizioni controcorrente e trasversali rispetto a certo ambientalismo anche oggi prevalente, difendendo, ad esempio, la legittimità della caccia, e battendosi invece contro l’aborto, ritenuto una pratica innaturale. Al tempo stesso prese le distanze da ogni naturalismo inteso quale ritorno ad utopici quanto irrealistici “stati di natura”, in quanto vedeva la dimensione culturale e spirituale come consustanziale all’uomo, che privato di essa sarebbe privato quindi della sua “natura” più autentica. Lo stesso studio del mondo animale, che ha impegnato tutta la sua vita, non è stato mai inteso da Lorenz in senso puramente tecno-scientifico: “vorrei dire innanzitutto che io non ho cominciato a tenere degli animali perché ne avevo bisogno per scopi scientifici: no, tutta la mia vita è stata legata strettamente agli animali, fin dalla prima infanzia… Crescendo ho allevato gli animali più diversi… Mi sono comportato sempre in questo modo: per conoscere a fondo un animale superiore, ho vissuto con lui. L’arroganza di certi scienziati moderni, che credono di poter risolvere tutti i problemi studiando un animale soltanto a livello sperimentale, è stata sempre estranea alla mia mente”. Più che il canonico approccio “scientifico”, quello di Lorenz sembra essere, almeno nelle sue finalità ultime e al di là dei suoi fondamenti epistemologici, un atteggiamento di tipo “intuitivo”, volto ad una comprensione complessiva dei fenomeni naturali e alieno da ogni visione meramente sperimentale e quantitativa. Ciò che davvero gli interessava era alla fine risensibilizzare l’uomo moderno al legame simpatetico con il mondo degli animali e della natura in genere, legame andato quasi completamente perduto per l’uomo civilizzato. Questi paga tale perdita anche con l’estinzione del senso estetico, che per Lorenz si lega strettamente al contatto con l’incredibile varietà della forme naturali e la grandezza della creazione che sovrasta l’uomo. Per Lorenz i sentimenti estetici sono infatti parte del patrimonio genetico dell’umanità, e hanno svolto anch’essi, quindi, un compito importate nel corso dell’evoluzione umana ai fini adattativi; mentre oggi l’uomo si va pericolosamente assuefacendo al “brutto” che domina incontrastato nelle nostre metropoli, dove ogni senso della bellezza sembra essersi obliato. La disarmonia che caratterizza la vita del moderno uomo inurbato si lega ad un altro infausto fenomeno, quello della sovrappopolazione, che Lorenz non vede solo nell’ottica economicistica - anche oggi spesso prevalente nei movimenti ambientalisti e terzomondisti - dello squilibrio tra risorse disponibili e popolazione, ma sempre in rapporto a dimensioni “esistenziali” più profonde, ancora una volta suggeritegli dagli studi etologici. Come ogni specie vivente ha bisogno, in base all’istinto di territorialità, di un suo ben delimitato “spazio vitale” (inteso in senso “psicologico” e non solo materiale), anche l’uomo difficilmente può adattarsi a vivere tra folle anonime di individui sconosciuti, dato che il forzato contatto ravvicinato e permanente con “estranei” genera inevitabilmente tensione ed aggressività, favorendo l’insorgere di quelle patologie tipiche della modernità quali stress e nevrosi.
La radicale critica della società moderna portò Lorenz a scontrarsi violentemente con la cultura progressista che monopolizzava il dibattito intellettuale degli anni sessanta e settanta ed ispirava i movimenti politici alternativi di quegli anni, movimenti che auspicavano una “rivoluzione” che andava, per molti aspetti, nel senso contrario a quello indicato da Lorenz. Critico verso ogni ottimismo progressista che esaltasse “le magnifiche sorti e progressive” dell’era della tecnica, Lorenz denunciò con altrettanto vigore l’ideologia del “nuovismo”, che egli considerava espressione di puro infantilismo, dato che è tipico dei bambini l’ingenuo entusiasmo verso tutto ciò che si presenta come “nuovo”. Contro i miti contestatari giovanili, Lorenz difese invece le tradizioni, la cultura e le strutture sociali sulle quali si erano funzionalmente rette le comunità e le società del passato, con accenti che non ci aspetteremmo da uno scienziato del XX secolo, come difese il principio di autorità nei processi educativi, vedendo in tutto ciò il portato di dinamiche socio-adattative coerenti con i dettati dell’evoluzione naturale. Lo stesso concetto di “rivoluzione” era del resto vivacemente contestato da Lorenz, dato che “la natura non fa salti” e che l’evoluzione procede per passi lenti e spesso impercettibili. Per questo l’incomprensione generazionale tra padri e figli che caratterizzava quegli anni era da lui vista come un fenomeno deleterio e pericoloso per un armonioso sviluppo della società. La stessa valorizzazione della fatica e della sofferenza andava contro le spinte moderniste di gran parte del movimento contestatore, che le considerava assurde sopravvivenze di secoli oscuri che grazie al progresso della tecnica e allo sviluppo economico l’uomo si sarebbe lasciato completamente alle spalle, essendo la liberazione dal dolore e il perseguimento del benessere “diritti” inalienabili che a tutti dovevano essere garantiti. Indifferente alle critiche che gli venivano mosse, forte delle sue convinzioni, Lorenz non si peritò di mettere in discussione lo stesso principio dell’uguaglianza tra gli uomini, che egli vedeva come una malsana distorsione del legittimo riconoscimento dell’eguale dignità di ogni uomo così come di ogni essere vivente. Secondo Lorenz l’egualitarismo, unito a quella che egli chiama la dottrina “pseudo-democratica” di ispirazione comportamentista secondo cui sarebbe possibile cambiare gli uomini a piacimento se solo si muta il contesto ambientale in cui essi si trovano a vivere, altro non è che un falso mito espressione della progressiva omologazione culturale che caratterizza la società moderna; omologazione di cui egli individuava le responsabilità nello strapotere del mercato, delle multinazionali e dei mezzi di comunicazione di massa. Il mondo moderno è caratterizzato da “una uniformità di idee quale non si era mai vista in nessun’altra epoca della storia” – sottolinea Lorenz - a tutto detrimento del pluralismo culturale, che, quale espressione del più vasto fenomeno naturale della diversità biologica, è un patrimonio da salvaguardare come uno dei cardini su cui si reggono l’evoluzione e la possibilità di riproduzione della vita stessa. Lorenz ritiene pertanto l’ineguaglianza un fattore costitutivo della natura, senza il quale essa perderebbe la sua forza creativa ed espansiva, non solo in termini biologici, ma anche e soprattutto a livello sociale e culturale, in quanto è proprio “l’ineguaglianza dell’uomo – affermò - uno dei fondamenti ed una delle condizioni di ogni cultura, perché è essa che introduce la diversità nella cultura”. Allo stesso modo egli individuava già allora nella perniciosa influenza della cultura americana le origini dei mali che attanagliavano l’umanità: “le malattie intellettuali della nostra epoca – sostiene - usano venire dall’America e manifestarsi in Europa con un certo ritardo”, così come al dominio delle ideologie egualitarie e pseudo-democratiche “va certamente attribuita una gran parte della responsabilità per il crollo morale e culturale che incombe sugli Stati Uniti”.
Figura proteiforme, difficilmente inquadrabile secondo gli schemi consueti, Lorenz visse profondamente le forti contraddizioni e i radicali cambiamenti che caratterizzarono il suo tempo. La sua complessa disamina della società moderna, intrisa di un così esasperato pessimismo, sfugge anch’essa a facili classificazioni, suscitando spesso sbrigative prese di distanza così come semplicistiche ed entusiastiche adesioni. Se il parallelismo che egli pone tra i processi evolutivi del regno animale e le dinamiche storico-sociali può lasciare perplessi, prestando il fianco ad accuse di riduzionismo biologista, lo sfidare gli apologeti del progresso tecno-scientifico sul loro stesso terreno dell’argomentazione positiva spiazza molti dei suoi detrattori. Anche i suoi toni a volte apocalittici possono sembrare eccessivi ed ingiustificati; ma non bisogna dimenticare che Lorenz scriveva in un periodo in cui i problemi da lui diagnosticati stavano per la prima volta presentando i loro risvolti devastanti su scala planetaria, senza che si fosse ancora sviluppata una forte sensibilità condivisa verso di essi. Come accennato, Lorenz stesso rivide progressivamente alcune delle sue posizioni e ritenne non più giustificabile il radicale pessimismo che aveva espresso, costatando come le tematiche su cui aveva richiamato l’attenzione fin dagli anni sessanta erano sempre più al centro del dibattito culturale e ormai nell’agenda di impegni di molti gruppi e movimenti politici e ambientalisti. “Colui che credeva di predicare solitario nel deserto, parlava, come si è dimostrato, davanti ad un uditorio numeroso ed intellettualmente vivo” - riconosce Lorenz, e “i pericoli della sovrappopolazione e dell’ideologia dello sviluppo vengono giustamente valutati da un numero rapidamente crescente di persone ragionevoli e responsabili”. Per questo Lorenz finì per prendere le distanze dai “catastrofisti”, da coloro che credevano possibile figurarsi con certezza l’avvenire dell’umanità predicando la sua prossima fine, dato che, come recita il titolo del succitato libro scritto con Karl Popper, il “futuro è aperto”, e l’irriducibilità ad ogni possibile determinismo costituisce pur sempre la cifra dell’uomo e della storia. Se il futuro è certamente aperto e la critica all’ideologia sviluppista non è più patrimonio di isolati predicatori nel deserto, è pur vero, però, che molti dei “peccati della civiltà” stigmatizzati da Lorenz restano ancor oggi impuniti, se non si sono addirittura aggravati. Di fronte alla sua disamina, si ha anzi l’impressione, a volte, che molte delle sue riflessioni e degli allarmi lanciati appaiano scontati e banali; e ciò non perché l’odierna umanità abbia risolto o quanto meno imboccato la strada giusta per risolvere i mali denunciati, ma - ed è quel che è più disperante - semplicemente perché vi si è ormai assuefatta. Ecco perché, al di là di quanto è stato fatto o resta da fare, e al di là dei giudizi e dei convincimenti di ciascuno, riteniamo quanto meno indispensabile e di grande attualità, oggi, la rilettura della sua opera.
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:15 Publié dans anthropologie, Philosophie, Science, Sciences | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : biologie, étologie, sciences, science, sciences biologiques, animaux, konrad lorenz |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 14 janvier 2010
Qui était Barry Fell?
 Qui était Barry Fell ?
Qui était Barry Fell ?
Né en 1917 et décédé en 1994, Barry Fell était professeur d’océanographie à l’Université de Harvard aux Etats-Unis. Il déchiffra le Linéaire B crétois. Son domaine de recherche privilégié était la préhistoire de l’Amérique du Nord. Au cours de ses travaux, il s’intéressa tout particulièrement aux signes de l’Ibérie préhistorique, à l’écriture ogham irlandaise et à l’écriture tifinagh berbère, que les pionniers marins venus d’Europe en Amérique du Nord à la préhistoire ont laissé comme traces, surtout sous la forme d’inscriptions rupestres à l’âge du bronze. Fell est le savant qui a découvert les liaisons transatlantiques entre l’Europe et l’Amérique du Nord, telles qu’elles étaient organisées il y a des millénaires. Les résultats de ses recherches ont été publiés pour l’essentiel dans les Epigraphic Society Occasional Papers.
Ouvrages principaux :
America B.C. – Bronze Age America, 1982.
Saga America, 1988.
Son principal disciple est l’Allemand Dietrich Knauer (né en 1920).
00:10 Publié dans anthropologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthropologie, épigraphie, préhistoire, amérique, protohistoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 30 juillet 2009
Les Kafirs Kalash
Les Kafirs Kalash
La région autour de Chitral, dans la province frontalière du Nord-Ouest du Pakistan, nous offre des panoramas paradisiaques, des forêts riches en faune dans des vallées profondes entre des montagnes gigantesques et majestueuses. Les bipèdes humains de la région, il convient de s’en méfier: c’est là que Winston Churchill, jeune soldat et correspondant de guerre, écrivit son premier livre, “The Malakand Field Force” en 1897; les armées de la Reine Victoria y affrontaient l’Emir de Chitral et sa horde sauvage. La région est également célèbre pour son hashish de toute première qualité.
C’est là aussi que vivent encore deux mille Kafirs Kalash, terme qui signifie les “infidèles vêtus de noir”. Ce nom est dû aux vêtements masculins car les femmes y portent des étoffes très colorées. Ils honorent quelques dieux connus des védas indiennes, mais dont le culte est tombé en désuétude chez les Hindous. La principale de ces divinités est “Imra”, l’équivalent du sanskrit “Yama Rana” (ou “Roi Yama”), dieu des mortels et de la mort, dont le nom dérive d’une racine indo-européenne “*Jemo”, le “jumeau”. Cette divinité présente aussi un apparentement avec la figure mythologique perse “Yima” qui, premier mortel, est le père de l’humanité. Dans les panthéons indo-européens, nous trouvons également un “Ymir” vieux-norrois, géant primordial qui s’auto-sacrifia pour que les parties de son corps servent de composantes pour la construction du monde. Le dieu védique de l’assaut et des tempêtes, Indra, survit dans le culte des Kafirs Kalash, notamment sous l’appellation d’“Indotchik”, la foudre, et d’“Indrou”, l’arc-en-ciel. On chuchote aussi que leurs fêtes religieuses, à la tombée de la nuit, se terminent par des pratiques sexuelles de groupe, ce que d’aucuns qualifieront de typiquement “païen”.
Il y a une trentaine d’années, les Kafirs Kalash étaient bien plus nombreux, y compris leurs dieux, surtout grâce à l’isolement dont ils bénéficiaient, haut dans leurs montagnes. Le malheur les a frappés en 1979, l’année où éclata la guerre civile afghane qui entraîna l’intervention soviétique. De nombreux Afghans s’installèrent dans la région frontalière et y furent accueillis par les Deobandis pakistanais, les homologues locaux des Wahhabites saoudiens, les plus fanatiques des musulmans.
Rapt de femmes
Les nouveaux venus ont commencé par déboiser les vallées puis par occuper le territoire des Kafirs Kalash et, enfin, par enlever leurs femmes. Les Kalash sont de complexion plus claire que leurs voisins; les Européens qui ont voyagé au Pakistan ont souvent constaté que la peau blanche des hommes comme des femmes y est très appréciée sur le marché du sexe. Les parents des filles enlevées et mariées de force à un musulman ne pouvaient revoir leur enfant qu’après s’être convertis à l’islam. D’autres moyens de pression ont été utilisés pour les obliger à la conversion, notamment les prêts à taux usuraires, dont on pouvait se débarrasser à condition de subir la circoncision; ensuite, la discrimination dans l’octroi des moyens modernes de distribution d’eau et d’électricité, que le régime du Général Zia n’accordait qu’aux seuls musulmans. Les minorités religieuses au Pakistan subissent terreur et brimades de toutes sortes. La communauté kalash qui, contrairement aux chrétiens, ne bénéficie d’aucun appui international, était ainsi condamnée à disparaître. Dans les années 90, toutefois, les choses ont changé. Les voies carrossables et l’électricité avaient été installées: le gouvernement démocratique (mais qui ne le fut que brièvement) se rendit compte qu’il pouvait exploiter la région kalash sur le plan touristique, la population indigène servant d’attraction avec son folklore. Il n’y aurait pas un chat pour débourser de l’argent pour aller voir de près l’islam vivant de cette région mais, en revanche, pour assister aux prouesses chorégraphiques des derniers païens indo-européens, on sort les dollars de son portefeuille. Il faut désormais s’acquitter d’un droit de péage pour entrer sur le territoire des Kalash.
Le Yeti
Ensuite, il faut bien que le Pakistan ait quelques minorités religieuses, réduites à la taille d’un musée, pour faire croire qu’il respecte scrupuleusement les principes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Dans les médias occidentaux, on trouvera toujours quelques bonnes âmes mercenaires pour relayer la propagande du gouvernement pakistanais qui cherche à démontrer la “tolérance islamique”. Une ONG grecque, motivée par le mythe qui veut que les Kalash descendent des soldats d’Alexandre le Grand, a même reçu l’autorisation d’ouvrir une école et une clinique là-bas. L’enquête la plus récente, relevant de ce que l’on appelle aujourd’hui l’“observation participante”, a été menée, chez les Kalash, par Jordi Magraner (1958-2002). Ce zoologue catalan était parti là-bas, au départ, pour chercher le yeti, la variante himalayenne du monstre du Loch Ness. Ou, pour être plus précis, y chercher le “bar-manou”, le “grand homme”, comme l’appelle la population locale. Si le terme “bar-manou” est une transformation maladroite de “barf-manou”, alors il faudrait traduire ce vocable par “l’homme des neiges”. Lorsque j’eus une conversation avec Magraner peu avant sa mort, il me prétendait qu’il y avait du vrai dans les récits indigènes relatifs au “bar-manou”, même si lui ne l’avait jamais vu. Quoi qu’il en soit, ses intérêts s’étaient portés vers cette curiosité anthropologique que sont les derniers païens indo-européens. Il avait entrepris un vol vers l’Europe pour rendre visite à sa famille et pour communiquer le fruit de ses recherches à l’occasion d’un congrès à Paris; en fait, Magraner était lui-même devenu un Kalash.

Il avait appris à parler les trois langues de la région de Chitral. Les motivations de certains humains sont sublimes: lorsqu’on parle, comme Magraner, l’espagnol, l’hindi et le chinois, trois langues seulement, on peut communiquer avec la moitié du monde. Malgré cela, cet homme exceptionnel a fait l’effort considérable d’apprendre trois langues pour converser avec deux milliers de personnes (et au départ, cet effort n’a été entrepris que pour les questionner sur ce qu’elles savaient du “bar-manou”!). Les Kalash lui avait offert une fiancée, pour sceller son intégration. Certes, il restait au bas de l’échelle sociale, avec une seule femme, les Kalash les plus haut placés, eux, ont plusieurs épouses. Malheureusement pour ce chercheur formidable, les islamistes ont appris son engagement pour les “idolâtres”. On retrouva son corps, la gorge tranchée, comme Theo Van Gogh. Selon ses dispositions testamentaires, il fut enterré sur place, selon le rite kalash.
“Moestasjrik” / “ ’t Pallieterke”.
(article paru dans “’t Pallieterke”, Anvers, 29 mars 2006; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans anthropologie | Lien permanent | Commentaires (8) | Tags : pakistan, islam, paganisme, himalaya, indo-européens, ethnologie, kalash |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 22 février 2008
Introduction à l'oeuvre de L. F. Clauss

Robert Steuckers:
Introduction à l'œuvre de Ludwig Ferdinand CLAUSS (1892-1974)
Né le 8 février 1892 à Offenburg dans la région du Taunus, l'anthropologue Ludwig Ferdinand Clauss est rapidement devenu l'un des raciologues et des islamologues les plus réputés de l'entre-deux-guerres, cumulant dans son œuvre une approche spirituelle et caractérielle des diverses composantes raciales de la population européenne, d'une part, et une étude approfondie de la psyché bédouine, après de longs séjours au sein des tribus de la Transjordanie. L'originalité de sa méthode d'investigation raciologique a été de renoncer à tous les zoologismes des théories raciales conventionnelles, nées dans la foulée du darwinisme, où l'homme est simplement un animal plus évolué que les autres. Clauss renonce aux comparaisons trop faciles entre l'homme et l'animal et focalise ses recherches sur les expressions du visage et du corps qui sont spécifiquement humaines ainsi que sur l'âme et le caractère.
Il exploite donc les différents aspects de la phénoménologie pour élaborer une raciologie psychologisante (ou une «psycho-raciologie») qui conduit à comprendre l'autre sans jamais le haïr. Dans une telle optique, admettre la différence, insurmontable et incontournable, de l'Autre, c'est accepter la pluralité des données humaines, la variété des façons d'être-homme, et refuser toute logique d'homologation et de centralisation coercitive.
Ludwig Ferdinand Clauss était un disciple du grand philosophe et phénoménologue Edmund Husserl. Il a également été influencé par Ewald Banse (1883-1953), un géographe qui avait étudié avant lui les impacts du paysage sur la psychologie, de l'écologie sur le mental. Ses théories cadraient mal avec celles, biologisantes, du national-socialisme. Les adversaires de Clauss considéraient qu'il réhabilitait le dualisme corps/âme, cher aux doctrines religieuses chrétiennes, parce que, contrairement aux darwiniens stricto sensu, il considérait que les dimensions psychiques et spirituelles de l'homme appartenaient à un niveau différent de celui de leurs caractéristiques corporelles, somatiques et biologiques. Clauss, en effet, démontrait que les corps, donc les traits raciaux, étaient le mode et le terrain d'expression d'une réalité spirituelle/psychique. En dernière instance, ce sont donc l'esprit (Geist) et l'âme (Seele) qui donnent forme au corps et sont primordiaux. D'après les théories post-phénoménologiques de Clauss, une race qui nous est étrangère, différente, doit être évaluée, non pas au départ de son extériorité corporelle, de ses traits raciaux somatiques, mais de son intériorité psychique. L'anthropologue doit dès lors vivre dans l'environnement naturel et immédiat de la race qu'il étudie. Raison pour laquelle Clauss, influencé par l'air du temps en Allemagne, commence par étudier l'élément nordique de la population allemande dans son propre biotope, constatant que cette composante ethnique germano-scandinave est une “race tendue vers l'action” concrète, avec un élan froid et un souci des résultats tangibles. Le milieu géographique premier de la race nordique est la Forêt (hercynienne), qui recouvrait l'Europe centrale dans la proto-histoire.
La Grande Forêt hercynienne a marqué les Européens de souche nordique comme le désert a marqué les Arabes et les Bédouins. La trace littéraire la plus significative qui atteste de cette nostalgie de la Forêt primordiale chez les Germains se trouve dans le premier livre évoquant le récit de l'Evangile en langue germanique, rédigé sous l'ordre de Louis le Pieux. Cet ouvrage, intitulé le Heliand (= Le Sauveur), conte, sur un mode épique très prisé des Germains de l'antiquité tardive et du haut moyen âge, les épisodes de la vie de Jésus, qui y a non pas les traits d'un prophète proche-oriental mais ceux d'un sage itinérant doté de qualités guerrières et d'un charisme lumineux, capable d'entraîner dans son sillage une phalange de disciples solides et vigoureux. Pour traduire les passages relatifs à la retraite de quarante jours que fit Jésus dans le désert, le traducteur du haut moyen âge ne parle pas du désert en utilisant un vocable germanique qui traduirait et désignerait une vaste étendue de sable et de roches, désolée et infertile, sans végétation ni ombre. Il écrit sinweldi, ce qui signifie la «forêt sans fin», touffue et impénétrable, couverte d'une grande variété d'essences, abritant d'innombrables formes de vie. Ainsi, pour méditer, pour se retrouver seul, face à Dieu, face à la virginité inconditionnée des éléments, le Germain retourne, non pas au désert, qu'il ne connaît pas, mais à la grande forêt primordiale. La forêt est protectrice et en sortir équivaut à retourner dans un “espace non protégé” (voir la légende du noble saxon Robin des Bois et la fascination qu'elle continue à exercer sur l'imaginaire des enfants et des adolescents).
L'idée de forêt protectrice est fondamentalement différente de celle du désert qui donne accès à l'Absolu: elle implique une vision du monde plus plurielle, vénérant une assez grande multiplicité de formes de vie végétale et animale, coordonnée en un tout organique, englobant et protecteur.
L' homo europeus ou germanicus n'a toutefois pas eu le temps de forger et de codifier une spiritualité complète et absolue de la forêt et, aujourd'hui, lui qui ne connaît pas le désert de l'intérieur, au contraire du Bédouin et de l'Arabe, n'a plus de forêt pour entrer en contact avec l'Inconditionné. Et quand Ernst Jünger parle de “recourir à la forêt”, d'adopter la démarche du Waldgänger, il formule une abstraction, une belle abstraction, mais rien qu'une abstraction puisque la forêt n'est plus, si ce n'est dans de lointains souvenirs ataviques et refoulés. Les descendants des hommes de la forêt ont inventé la technique, la mécanique (L. F. Clauss dit la Mechanei), qui se veut un ersatz de la nature, un palliatif censé résoudre tous les problèmes de la vie, mais qui, finalement, n'est jamais qu'une construction et non pas une germination, dotée d'une mémoire intérieure (d'un code génétique). Leurs ancêtres, les Croisés retranchés dans le krak des Chevaliers, avaient fléchi devant le désert et devant son implacabilité. Preuve que les psychés humaines ne sont pas transposables arbitrairement, qu'un homme de la Forêt ne devient pas un homme du Désert et vice-versa, au gré de ses pérégrinations sur la surface de la Terre.
A terme, la spiritualité du Bédouin développe un “style prophétique” (Offenbarungsstil), parfaitement adapté au paysage désertique, et à la notion d'absolu qu'il éveille en l'âme, mais qui n'est pas exportable dans d'autres territoires. Le télescopage entre ce prophétisme d'origine arabe, sémitique, bédouine et l'esprit européen, plus sédentaire, provoque un déséquilibre religieux, voire une certaine angoisse existentielle, exprimée dans les diverses formes de christianisme en Europe.
Clauss a donc appliqué concrètement —et personnellement— sa méthode de psycho-raciologie en allant vivre parmi les Bédouins du désert du Néguev, en se convertissant à l'Islam et en adoptant leur mode de vie. Il a tiré de cette expérience une vision intérieure de l'arabité et une compréhension directe des bases psychologiques de l'Islam, bases qui révèlent l'origine désertique de cette religion universelle.
Sous le IIIième Reich, Clauss a tenté de faire passer sa méthodologie et sa théorie des caractères dans les instances officielles. En vain. Il a perdu sa position à l'université parce qu'il a refusé de rompre ses relations avec son amie et collaboratrice Margarete Landé, de confession israélite, et l'a cachée jusqu'à la fin de la guerre. Pour cette raison, les autorités israéliennes ont fait planter un arbre en son honneur à Yad Vashem en 1979. L'amitié qui liait Clauss à Margarete Landé ne l'a toutefois pas empêché de servir fidèlement son pays en étant attaché au Département VI C 13 du RSHA (Reichssicherheitshauptamt), en tant que spécialiste que Moyen-Orient.
Après la chute du IIIième Reich, Clauss rédige plusieurs romans ayant pour thèmes le désert et le monde arabe, remet ses travaux à jour et publie une étude très approfondie sur l'Islam, qu'il est un des rares Allemands à connaître de l'intérieur. La mystique arabe/bédouine du désert débouche sur une adoration de l'Inconditionné, sur une soumission du croyant à cet Inconditionné. Pour le Bédouin, c'est-à-dire l'Arabe le plus authentique, l'idéal de perfection pour l'homme, c'est de se libérer des “conditionnements” qui l'entravent dans son élan vers l'Absolu. L'homme parfait est celui qui se montre capable de dépasser ses passions, ses émotions, ses intérêts. L'élément fondamental du divin, dans cette optique, est l' istignâ, l'absence totale de besoins. Car Dieu, qui est l'Inconditionné, n'a pas de besoins, il ne doit rien à personne. Seule la créature est redevable: elle est responsable de façonner sa vie, reçue de Dieu, de façon à ce qu'elle plaise à Dieu. Ce travail de façonnage constant se dirige contre les incompétences, le laisser-aller, la négligence, auxquels l'homme succombe trop souvent, perdant l'humilité et la conscience de son indigence ontologique. C'est contre ceux qui veulent persister dans cette erreur et cette prétention que l'Islam appelle à la Jihad. Le croyant veut se soumettre à l'ordre immuable et généreux que Dieu a créé pour l'homme et doit lutter contre les fabrications des “associateurs”, qui composent des arguments qui vont dans le sens de leurs intérêts, de leurs passions mal dominées. La domination des “associateurs” conduit au chaos et au déclin. Réflexions importantes à l'heure où les diasporas musulmanes sont sollicitées de l'intérieur et de l'extérieur par toutes sortes de manipulateurs idéologiques et médiatiques et finissent pas excuser ici chez les leurs ce qu'ils ne leur pardonneraient pas là-bas chez elles. Clauss a été fasciné par cette exigence éthique, incompatible avec les modes de fonctionnement de la politicaille européenne conventionnelle. C'est sans doute ce qu'on ne lui a pas pardonné.
Ludwig Ferdinand Clauss meurt le 13 janvier 1974 à Huppert dans le Taunus. Considéré par les Musulmans comme un des leurs, par les Européens enracinés comme l'homme qui a le mieux explicité les caractères des ethnies de base de l'Europe, par les Juifs comme un Juste à qui on rend un hommage sobre et touchant en Israël, a récemment été vilipendé par des journalistes qui se piquent d'anti-fascisme à Paris, dont René Schérer, qui utilise le pseudonyme de «René Monzat». Pour ce Schérer-Monzat, Clauss, raciologue, aurait été tout bonnement un fanatique nazi, puisque les préoccupations d'ordre raciologique ne seraient que le fait des seuls tenants de cette idéologie, vaincue en 1945. Schérer-Monzat s'avère l'une de ces pitoyables victimes du manichéisme et de l'inculture contemporains, où la reductio ad Hitlerum devient une manie lassante. Au contraire, Clauss, bien davantage que tous les petits écrivaillons qui se piquent d'anti-fascisme, est le penseur du respect de l'Autre, respect qui ne peut se concrétiser qu'en replaçant cet Autre dans son contexte primordial, qu'en allant à l'Autre en fusionnant avec son milieu originel. Edicter des fusions, brasser dans le désordre, vouloir expérimenter des mélanges impossibles, n'est pas une preuve de respect de l'altérité des cultures qui nous sont étrangères.
Robert STEUCKERS.
-Bibliographie:
Die nordische Seele. Artung. Prägung. Ausdruck, 1923; Fremde Schönheit. Eine Betrachtung seelischer Stilgesetze, 1928; Rasse und Seele. Eine Einführung in die Gegenwart, 1926; Rasse und Seele. Eine Einführung in den Sinn der leiblichen Gestalt, 1937; Als Beduine unter Beduine, 1931; Die nordische Seele, 1932; Die nordische Seele. Eine Einführung in die Rassenseelenkunde, 1940 (édition complétée de la précédente); Rassenseelenforschung im täglichen Leben, 1934; Vorschule der Rassenkunde auf der Grundlage praktischer Menschenbeobachtung, 1934 (en collaboration avec Arthur Hoffmann); Rasse und Charakter, Erster Teil: Das lebendige Antlitz, 1936 (la deuxième partie n'est pas parue); Rasse ist Gestalt, 1937; Semiten der Wüste unter sich. Miterlebnisse eines Rassenforschers, 1937; Rassenseele und Einzelmensch, 1938; König und Kerl, 1948 (œuvre dramatique); Thuruja, 1950 (roman); Verhüllte Häupter, 1955 (roman); Die Wüste frei machen, 1956 (roman); Flucht in die Wüste, 1960-63 (version pour la jeunesse de Verhüllte Häupter); Die Seele des Andern. Wege zum Verstehen im Abend- und Morgenland, 1958; Die Weltstunde des Islams, 1963.
- Sur Ludwig Ferdinand Clauss:
Julius Evola, Il mito del sangue, Ar, Padoue, 1978 (trad.franç., Le mythe du sang, Editions de l'Homme Libre, Paris, 1999); Julius Evola, «F. L. Clauss: Rasse und Charakter», recension dans Bibliografia fascista, Anno 1936-XI (repris dans Julius Evola, Esplorazioni e disamine. Gli scritti di “Bibliografia fascista”, Volume I, 1934-IX - 1939-XIV, Edizioni all'Insegna del Veltro, Parma, 1994); Léon Poliakov/Joseph Wulf, Das Dritte Reich und seine Denker. Dokumente und Berichte, Fourier, Wiesbaden, 1989 (2ième éd.) (Poliakov et Wulf reproduisent un document émanant du Dr. Walter Gross et datant du 28 mars 1941, où il est question de mettre Clauss à l'écart et de passer ses œuvres sous silence parce qu'il n'adhère pas au matérialisme biologique, parce qu'il est «vaniteux» et qu'il a une maîtresse juive); Robert Steuckers, «L'Islam dans les travaux de Ludwig Ferdinand Clauss», in Vouloir, n°89/92, juillet 1992.
00:50 Publié dans anthropologie, Biographie, Histoire, Islam, Psychologie/psychanalyse, Révolution conservatrice, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 janvier 2008
Un entretien avec Georges Dumézil

Un entretien avec Georges Dumézil
Lors d'une interview de Georges Dumézil (55 min) sur ses recherches, sont abordés les thèmes suivants :
Les populations et langues indo européennes, et leur progression dans l'espace Européen.
Les mythes et la mythologie, et leur importance dans la restitution de notre identité.
Mais aussi les trois fonctions et la structure antique des sociétés européennes : la première fonction dite de souveraineté, politique et religieuse (oratores), la seconde fonction de la défense et de la sécurité (bellatores) et enfin la troisième fonction qui a trait à la reproduction aux échanges et à la fécondité (laboratores).
Notre monde crève aujourd'hui du surdimensionnement de cette troisième fonction !!!
Sont aussi abordés les différences entre l'âme Européenne et les Monothéismes...
Monothéismes qui ont aboutis à créer tant d'intolérances, qu'elles soient spirituelles ou économiques.
Bref 50 minutes à écouter, et à réécouter, ou à faire connaître pour qui cherche des repères dans ce monde de Barbares !!!
http://www.dailymotion.com/robertofiorini/video/x3rsds_le...
Toute littérature qui permettra d’étoffer cette interview est la bienvenue
00:10 Publié dans anthropologie, Entretiens, Traditions | Lien permanent | Commentaires (1) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 29 décembre 2007
M. Maffesoli et "La violence totalitaire"

Laurent SCHANG :
Un classique à relire: Michel Maffesoli et "La violence totalitaire"
Conférence tenue à l'Université d'été de "Synergies Européennes", 1999, Pérouse/Ombrie
«L’Etat qui se veut le propriétaire de la société en vient à exercer une violence pouvant prendre des formes diverses, mais dont le résultat est identique. En effet, que ce soit à la manière douce de la technostructure, ou brutalement sous les diverses tyrannies, ce qui se veut totalisant tend à devenir totalitaire».
Ces propos, introduction à l’essai d’anthropologie politique La violence totalitaire , illustrent le projet panoramique de sociologie politique du politologue Michel Maffesoli. C’est une œuvre puissante, volontariste, touffue également, qui trouve sa place au côté de son pendant philosophique, Michel Onfray.
Le lecteur y retrouve en filigrane les trois thèmes centraux de sa réflexion protéiforme et engagée, que sont:
-l’opposition ontologique entre puissance et pouvoir;
-la nature fondamentalement totalitaire de toute structure étatique; et
-l’immanence «ouroubore», ou cyclique de tout processus révolutionnaire.
Trois axes d’une pensée vivifiante directement située dans la continuité de ses lectures, à savoir Spengler, Tönnies, Weber, Freund, Schmitt et Durkheim. Des classiques de l’hétérodoxie politique dont Maffesoli s’est non seulement imprégné mais qu’il se réapproprie et réactualise dans une logique de contestation, pondérée par ce qu’on appellera génériquement un conservatisme cynique qui doit plus aux leçons de la sociologie qu’à des convictions personnelles nécessairement idéologiques.
Logique de contestation et conservatisme cynique
Chez Maffesoli, c’est la démarche «para-scientifique» qui fonde la qualité de sa réflexion, plus encore que la pertinence de ses développements et conclusions. «Une démarche proche du poétique pour laquelle il est moins important de changer le monde que daller au plus profond dans l’investigation et la monstration». Selon la formule de l’Ecclésiaste: «Quid novi sub sole? Nihil». Plus précisément, cela consiste, «comme le dit Rainer Maria Rilke, à affronter, à vivre ce problème essentiel qu’est l’existence, dans une "saisie du présent" qui récuse l’historicisme et revendique le droit à l’inutilité. Un existentialisme vitaliste qui puise à la source de Nietzsche et ne craint pas de recourir autant, sinon plus, aux enseignements des grandes plumes littéraires qu’aux cours magistraux des pères de la science politique. Qu’on juge plutôt: Raymond Aron est quasi-absent de La violence totalitaire, bel exploit pour un politologue français.
A l’inverse, ses influences «pirates» témoignent d’une absence d’a priori et d’une aspiration à la connaissance la plus large, qui traduisent un art de penser le monde et les hommes tout de souplesse et de circonvolutions. Livrées en vrac, les références qui parsèment La violence totalitaire, artistiques pour la plupart, parlent d’elles-mêmes: Artaud, Bloch, Breton, Céline, De Man, Hoffmansthal, Jouvenel, Klossowski, Krauss, Lukacs, Maistre, Michels, Orwell, Pareto, Vico, etc. La liste n’est pas exhaustive.
Et de fait, on ne peut rien comprendre au cheminement intellectuel de Michel Maffesoli si l’on n’a pas en tête, page après page, sa lumineuse formule: «Il y a toujours de la vie, et c’est cela qui véritablement pose problème».
Polythéisme des valeurs et néo-tribalisme
Sa réflexion va du nominalisme à l’empathie, et prône le dépassement des frontières dressées entre les divers aspects de la vie sociale et de la vie naturelle. Une nécessité dictée par les signes avant-coureurs d’une mutation de notre civilisation: achèvement du progressisme historique, accentuation a contrario du concept de temps présent, relativisation de la maîtrise bourgeoise du temps et de l’espace, remise en cause de l’exploitation de la nature, de la domination rationalisée de la société.
Une critique des Lumières donc, prémisse d’une révolution dans laquelle Maffesoli discerne le retour au polythéisme des valeurs et l’émergence d’un «néo-tribalisme diffus ne se reconnaissant plus dans les valeurs rationnelles, universelles, mécaniques qui ont marqué la modernité».
Le réveil de la communauté contre la réduction au même, la Spaltung
«En gros le [pouvoir] est l’apanage de l’Etat sous ses diverses modulations. Le pouvoir est de l’ordre de l’institué. Par contre la puissance (...) vient du bas, elle est le fondement même de l’être-ensemble»; elle est force spirituelle «indépendante des facteurs matériels, nombre et ressource» (H. Arendt).
Maffesoli récupère la Freund-Feind-Theorie de Carl Schmitt: il y a pouvoir là où il y a affaiblissement de la puissance (collective), deux facteurs indissociables et antagonistes qui composent toute constitution politique. Il reprend dans la foulée la distinction opérée par Vilfredo Pareto entre la puissance «résidus», constantes de l’activité humaine, et le pouvoir «dérivations», conceptions variables, pôle dynamique. «L’entrecroisement (des deux) constitue la trame sociale» dans un rapport de forces en équilibre toujours instable.
Parler de l’Etat, après Nietzsche, c’est «parler de la mort des peuples», tant sa logique élémentaire consiste à mettre en application l’équation «moi l’Etat, je suis le peuple».
Pour autant, le fantasme totalitaire n’est pas réductible «aux seuls fascisme et stalinisme, mais (...) il a tendance à se capillariser dans l’ensemble du monde par le biais du contrôle, de la sécurisation de l’existence ou du bonheur planifié», tel que l’exprime également l’american way of life.
Le propre du pouvoir réside dans le projet social idéalisé qu’il entend imposer, déniant «la réalité ou l’efficace des différences, des cultures, des mutations» sur la base de son idéologie positiviste.
«Une autre de ses facettes est (...) la laïcisation (...) de l’unicité salvatrice chargée d’assurer des promesses futures», dans une logique mise en évidence par Hobbes d’utilisation «du droit naturel comme substitut de la loi divine.»
Solidarité mécanique contre solidarité organique
L’unicité factice ainsi créée nie la solidarité d’ordre organique pour lui substituer une «solidarité mécanique» dont les rouages ont été mis en avant par les travaux de Durkheim. Pour asseoir sa domination, le pouvoir dispose de multiples ressorts: la lutte contre la faim, le besoin de sécurité, l’organisation du travail; autant de facteurs de déstructuration sociale qui jouent un rôle médiateur entre pouvoir et puissance.
Détenteur de la technique, le pouvoir méconnaît les limitations libérales du pouvoir par le pouvoir, du pouvoir par le savoir. La liberté abstraite véhiculée par l’égalité nie la pluralité de l’action sociale. L’anomie généralisée qu’elle suscite entraîne automatiquement le relâchement du lien communautaire. Son fondement individualiste néglige le fait que la vie individuelle découle de la vie collective, et non l’inverse. L’égalisation par l’économique achève de diluer le sens tragique du rapport désir individuel-nécessité sociétale dans ce que Maffesoli appelle «l’ennui de la sécurisation (...) ce qu’il est convenu d’appeler le progrès de la société.»
Héritage des Lumières et de l’Europe du XIXe siècle, l’idéologie technicienne amorce l’ère de la rationalité totalitaire. «La technique orientée vers une fin» selon les propos de Jürgen Habermas, qui ne manque pas de dénoncer la dérive sacralisante de la technique moderne, incarnée dans sa bureaucratie.
Mais, par bureaucratie, Maffesoli n’entend pas le poids de l’administration sur la société; il nomme «bureaucratie» le jeu démocratique même.
Idéologie technicienne et société du spectacle
«La bureaucratie de l’Etat moderne se reflète dans les partis». La prise de parole contestataire entretient «un état de tension qui lui assure dynamisme et perdurance». C’est d’ailleurs l’étymologie du verbe contester: con-tester, aller avec et non pas contre. L’opposition est avortée dans l’œuf, elle devient adjuvant de l’institution. Un consensus qui mime seulement la socialité participative. La bureaucratie n’écoute pas l’opinion atomisée, elle la met en scène périodiquement par le biais des élections, des sondages médiatisés, des enquêtes journalistiques.
On entre dans la société du spectacle de Guy Debord, qui dit que «Donner la parole, la concéder c’est déjà en empêcher l’irruption violente, c’est la châtrer de sa vertu subversive».
La Gesellschaft a vaincu la Gemeinschaft.
La révolution : «mythe européen» et «catharisme moderne»
A ce stade de son analyse, Michel Maffesoli convient que «tout pouvoir politique est conservateur», parce qu’il incarne une immanence que la circulation des élites ne fait que redynamiser. Ceci au besoin par l’action révolutionnaire, dont il désamorce la charge subversive. Sa définition de la révolution est la suivante: «La révolution est la manifestation d’une archaïque pulsion d’espérance ou d’un irrépressible désir de collectif, et en même temps le moyen par lequel s’expriment la "circulation des élites", le perfectionnement de l’idéologie productiviste et l’affermissement d’un contrôle social généralisé», «le remplacement d’un pouvoir faible par un pouvoir fort, purification sociale qui ne change rien à la structure réelle du pouvoir».
La révolution est un «mythe européen», dont «le monothéisme social» pour reprendre l’expression de Maffesoli est un projet totalitaire, est intégré au projet totalitaire intrinsèque au pouvoir. C’est le mythe prométhéen d’une société parfaite, utopique, un «catharisme moderne» dont le souci est la purification du monde. Sans ironie, on peut considérer la Compagnie de Jésus comme sa représentation la plus aboutie.
Le progressisme linéaire qui prévaut dans l’esprit révolutionnaire moderne rompt avec la présupposition d’un ordre éternel et d’une définition de la révolution comme restauration de cet ordre. Aujourd’hui, la révolution est conçue comme «un renversement violent du pouvoir établi avec l’appui des masses ou du peuple sous l’autorité de groupes animés par un programme idéologique». Cependant il est frappant de constater que, de 1789 à 1968, ce sont les mêmes références issues du passé qui ont mobilisé les énergies révolutionnaires. Chez Rousseau comme chez Marx se dessine la même rémanence d’une restauration d’une nature vraie, et perdue, de l’homme. Il n’y a pas d’épistémé, mais, dixit Bachelard, un «profil», une épaisseur épistémologique, où l’on retrouve dans des arguments divers des éléments semblables supérieurs au messianisme épiphénoménal de chaque période révolutionnaire. En ce sens, Maffesoli rejoint Freund, quand celui-ci dit que «le révolutionnaire authentique est un conservateur». «Une fois [la] fonction [révolutionnaire] accomplie [translatio imperii] sétablit un nouveau pouvoir dont le principal souci sera de juguler la révolte qui lui a donné naissance».
La révolution permanente prônée par les Robespierre, Saint-Just, Trotsky, et aussi d’une certaine manière Ernst Röhm, est une scorie phraséologique qu’il faut dépasser. Le calcul et le quantitatif doivent succéder au charisme et au qualitatif. Ce qui permet à Maffesoli de qualifier la révolution d’invariance du pouvoir et de reproduction du même. «Le révolutionnaire aime vivre dans l’ordre (...) . L’idée n’a rien de paradoxal. «La perspective révolutionnaire est réaction contre un ordre anarchique (...) elle fonctionne sur la nostalgie d’une totalité parfaite (...) où l’égalisation (...) serait le garant du bonheur total.»
La révolution annexe de l’ordre capitaliste industriel
Science, technique, raison et égalité forment autant la colonne vertébrale de la révolution que de la société de domination.
Avec Baechler, il faut mettre en exergue le fait que «le peuple ne fait jamais de révolution, mais participe à une révolution (...) le peuple ne prend jamais le pouvoir, mais aide une élite à le faire». La révolution n’est qu’une «circulation accélérée des élites», pour reprendre les termes de Jules Monnerot, un changement de vitesse et jamais un changement de structure.
On peut dire ainsi tant que l’homme sera homme, qu’à une révolution succédera une autre révolution, elle-même poursuivie par une révolution boutée par une autre révolution, dans un mouvement cyclique infini, puisqu’en finalité chaque révolution se rigidifie au contact du pouvoir, et se grippe.
La révolution est devenue l’annexe de l’ordre capitaliste industriel des XIXe et XXe siècles. Fondées sur l’idéal de «l’activité économique séparée et systématisée, et de l’individu comme personnalité autonomisée et référée comme telle», la révolution et le pouvoir sont les deux actes d’une même pièce, une tragédie appelée totalitarisme.
Le serpent «dont il faut venir à bout»
Pour conclure, et parce que, malgré tout, après la pluie revient le beau temps, je vous soumettrai en note d’espoir les quelques antidotes proposés par Michel Maffesoli pour contrer La violence totalitaire. Lesquels antidotes rejoignent par bien des aspects les positions défendues par Synergies Européennes:
-en premier, un devoir pour nous tous: «désamorcer, ainsi que le démontrait Durkheim, cette superstition d’après laquelle le législateur, doué d’un pouvoir à peu près illimité, serait capable de créer, modifier, supprimer les lois selon son bon plaisir (...) [et redécouvrir que] le droit est issu de nous, c’est-à-dire de la vie elle-même (...)»
-ensuite, restaurer l’authenticité de la question nationale dans son expression communautaire, seule formule historique qui ne cède pas à la «crispation particulariste» mais tend vers un «ailleurs universel».
-enfin, étendre l’idée incarnée dans la germanité nietzschéenne aux niveaux européen puis mondial. Briser la rationalité étriquée du centralisme étatique et bureaucratique par la dynamique de l’enracinement. Une manière d’exprimer le plus harmonieusement le développement individuel et social, et leur rapport à la nature comme nécessité.
Et puisque la révolution et le progrès sont tous deux d’essence mythique, je soulignerai que si l’Ouroubouros est le «gardien de la pérennité ancestrale» du pouvoir dans sa continuité, c’est aussi le serpent «dont il faut venir à bout». Peut-être parmi nous se trouvent déjà, ici même, les Saint-Michel, Saint-Georges, Jason ou Héraklès qui accompliront cette tâche civilisatrice.
Pour que cesse La violence totalitaire.
Laurent SCHANG.
Achevé décrire en 1979, publié chez Klincksieck depuis 1992, La violence totalitaire. Essai d’anthropologie politique de Michel Maffesoli est aussi disponible chez Desclée de Brouwer depuis cette année 1999.
00:25 Publié dans anthropologie, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 09 août 2007
Leo Frobenius
 9 août 1938 : Mort à Biganzolo sur les rives du Lac Majeur en Lombardie du grand africaniste et préhistorien allemand Léo Frobenius, né à Berlin en 1873. Pour lui, la seule méthode valable en ethnologie est l’approche culturaliste et historique. L’évolution culturelle, pensait-il, se développe en trois stades. Frobenius a mené douze expéditions en Afrique entre 1904 et 1935. Parallèlement à sa connaissance profonde de l’Afrique noire, il était aussi un spécialiste de l’art préhistorique européen, ce qui le conduisit à effectuer des recherches sur les contreforts des Alpes, en Norvège et en Espagne. L’objectif de sa vie de recherches était de comprendre les lois qui ont présidé à la naissance des cultures humaines. Il a procédé à une classification des cultures humaines en “complexes culturels” (en all. : Kulturkreise), chacun de ces complexes étant une entité vivante, biologique, qui connaît trois âges : la jeunesse, la maturité et la sénescence. Chaque culture possède son “noyau”, son centre spirituel, son âme, qu’il appelait, en grec, la “paideuma”. Les Africains, qui admirent son œuvre, se réfèrent essentiellement aux trois volumes parus en 1912-13, Und Afrika sprach (Ainsi parla l’Afrique). Pour Frobenius, l’humanité a toujours connu des phases soudaines d’Ergriffenheit, de saisie émotionnelle et subite du réel, suivies de longues phases d’application. Les phases d’Ergriffenheit consistent à voir de manière soudaine les choses “telles qu’elles sont dans le fond d’elles-mêmes”, indépendamment de leur dimension biologique. Pour Frobenius, il est probable que l’idée d’ordre et d’harmonie soit venue d’une observation du ciel et des lois cosmiques, observation qui conduit à vouloir copier cet ordre et cette harmonie, en inventant des systèmes religieux ou politiques. L’arrivée de facteurs nouveaux impulse de nouvelles directions à ces systèmes. Les systèmes ne sont donc pas seulement les produits de ce qui les a précédé objectivement, factuellement, mais le résultat d’un bilan subjectif, chaque fois original, dont la trajectoire ultérieure n’est nullement prévisible. Frobenius met ainsi un terme à cette idée de nécessité historique inéluctable. Dans le cadre de la “révolution conservatrice” et de la tentative d’Armin Mohler de la réactiver, la vision de Frobenius a inspiré la fameuse conception sphérique de l’histoire, où la personnalité charismatique inattendue (que cette personnalité soit un homme, un peuple, une élite militaire ou civile) impulse justement une direction nouvelle, chaque fois imprévisible et, donc, diamétralement différente de la vision linéaire et vectorielle du temps historique, propre des progressismes, et de la vision cyclique, où il y a éternel retour du même, propre des visions traditionnelles figées (Robert Steuckers). |
03:50 Publié dans anthropologie, Biographie, Histoire, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 23 juin 2007
L'anthropologue américain C. S. Coon

Sur l'anthropologue américain Carleton Stevens Coon
23 juin 1904 : Naissance à Wakefield dans le Massachusetts de l'anthropologue américain Carleton Stevens Coon. Sa méthode consistait à émettre des thèses en anthropologie sur base d'un matériel archéologique. Son œuvre majeure a été The Origin of Races (1962), ouvrage controversée à une époque où les études anthropologiques sont systématiquement soupçonnées de consolider un discours "raciste". L'investigation minutieuse des preuves archéologiques ne peut pourtant pas se réduire à des slogans ineptes, que ceux-ci soient de facture "raciste" ou "anti-raciste". L'hystérie de ses contradicteurs ne remplacera évidemment jamais le fait qu'il ait examiné plus de 31.000 outils, fragments d'outils ou récipients destinés à l'agriculture, dont certains remontaient à 6050 av. J. C. et provenaient de la grotte de Hotu en Iran. Ce chantier archéologique permettait, grâce à sa bonne conservation, d'explorer plusieurs strates successives de l'évolution préhistorique et proto-historique, allant du néolithique à l'Age du Fer en passant par l'Age du Bronze. Mieux, Coon y découvrit des restes humains de l'ère glaciaire, dont l'examen lui permit d'écrire, en 1954, The Story of Mankind (= L'histoire de l'humanité), panorama de l'histoire humaine depuis l'ère glaciaire jusqu'aux temps modernes. Pour Coon, cinq souches humaines existaient avant l'apparition de l'homo sapiens. Il a donc été l'avocat de la théorie polygéniste, opposée à la théorie monogéniste, propre de ceux qui interprètent la Bible stricto sensu et appartiennent généralement aux sectes protestantes les plus rétrogrades et propre aussi des "anti-racistes" professionnels qui se piquent d'un progressisme plus religieux que scientifique. Parmi les autres ouvrages majeurs de Coon, citons The Tribes of the Rif (= Les tribus du Rif, 1931) et The Races of Europe (1939). Carleton Stevens Coon meurt le 3 juin 1981 à Gloucester dans le Massachusetts (Robert Steuckers).
06:20 Publié dans anthropologie, Biographie | Lien permanent | Commentaires (2) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 01 mai 2007
Violences: racines du mal
06:05 Publié dans anthropologie, Ecole/Education, Politique, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 30 avril 2007
About www.fravahr.org
About Us
The task of Fravahr.org is bringing the artifacts of the Perso-Aryan vision in a state close to their original and living condition. It would be difficult to say what comprises the Aryan memory and or tradition — what questions, views, and general areas cover the field in a comprehensive way. We find how many open questions are concealed behind the apparently simple word. We do not approach the expressions of the Aryan vision with a preconceived thesis, or view them exclusively within the context of the Mazdaean ideology.
Research in any branch of the Perso-Aryan memory and tradition depends not only on good institutional surrondings, but even more so the availibility of personal help in the form of experienced researches and colleagues showing an interest in the work under research.
The object of Fravahr is double: one, to facilitate the study of the Aryan History ; the other, to stimulate interest in the emergence of the Aryan Ideas and Visions in the formative period.
Here we begin the process of writing a history of Aryan ideas. The works of the Fravahr can justly be regarded as paragraphs, even chapters of the future “History”, as more or less finished blocks of the building being erected. It is hoped that the reconstruction makes an obscure and difficult topic less obscure and less difficult.
11:25 Publié dans anthropologie, Eurasisme, Histoire, Politique, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




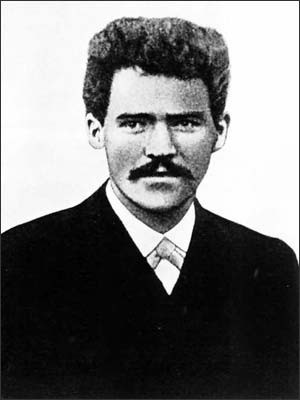 Comenzamos por señalar la corriente darwinista que reinterpretó la lucha de clases como una lucha de razas, en la que destaca la obra de Ludwig Gumplowicz (Der Rassenkampf), judío de origen polaco que, casualmente, sería considerado como maestro sociológico por el germanista radical Ludwig Woltmann. Precisamente, increpado Gumplowicz por su discípulo Woltmann al haber abandonado el concepto de raza, el sociólogo nostálgico respondió en los siguientes términos: «Me sorprendía … ya en mi patria de origen el hecho de que las diferentes clases sociales representasen razas totalmente heterogéneas; veía allí a la nobleza polaca, que se consideraba con razón como procedente de un tronco completamente distinto del de los campesinos; veía la clase media alemana y, junto a ella, a los judíos; tantas clases como razas … pero, en los países del occidente de Europa sobre todo, las distintas clases de la sociedad hace ya mucho tiempo que no representan otras tantas razas antropológicas y, sin embargo, se enfrentan las unas a las otras como razas distintas …».
Comenzamos por señalar la corriente darwinista que reinterpretó la lucha de clases como una lucha de razas, en la que destaca la obra de Ludwig Gumplowicz (Der Rassenkampf), judío de origen polaco que, casualmente, sería considerado como maestro sociológico por el germanista radical Ludwig Woltmann. Precisamente, increpado Gumplowicz por su discípulo Woltmann al haber abandonado el concepto de raza, el sociólogo nostálgico respondió en los siguientes términos: «Me sorprendía … ya en mi patria de origen el hecho de que las diferentes clases sociales representasen razas totalmente heterogéneas; veía allí a la nobleza polaca, que se consideraba con razón como procedente de un tronco completamente distinto del de los campesinos; veía la clase media alemana y, junto a ella, a los judíos; tantas clases como razas … pero, en los países del occidente de Europa sobre todo, las distintas clases de la sociedad hace ya mucho tiempo que no representan otras tantas razas antropológicas y, sin embargo, se enfrentan las unas a las otras como razas distintas …».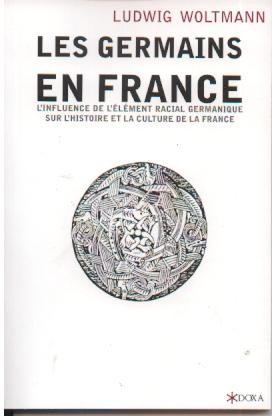 Las tesis iniciales de Woltmann, no obstante lo anterior, irían cobrando un intenso matiz germanista, hasta el extremo de no tolerar la unión de los alemanes con otras ramas de la familia nord-europea. Es más, una posible asimilación de los otros pueblos germánicos –daneses, holandeses, etc- la condicionaba a su dominio por parte de una gran Alemania. La extravagancia de Woltmann, que partía de la idea según la cual el valor de una civilización depende de la cantidad de raza rubia germana que contenga, le hizo asegurar que los grandes hombres (nobles, políticos, artistas, filósofos, etc) más representativos de la cultura y la sociedad italiana, francesa y española eran, sin duda alguna, de ascendencia germánica, pensando que sus cualidades anímicas y espirituales revelarían siempre los caracteres antropológicos del germano, dolicocéfalo y rubio, aun cuando su apariencia física externa fuera la de un alpino braquicéfalo o la de un oscuro mediterráneo.
Las tesis iniciales de Woltmann, no obstante lo anterior, irían cobrando un intenso matiz germanista, hasta el extremo de no tolerar la unión de los alemanes con otras ramas de la familia nord-europea. Es más, una posible asimilación de los otros pueblos germánicos –daneses, holandeses, etc- la condicionaba a su dominio por parte de una gran Alemania. La extravagancia de Woltmann, que partía de la idea según la cual el valor de una civilización depende de la cantidad de raza rubia germana que contenga, le hizo asegurar que los grandes hombres (nobles, políticos, artistas, filósofos, etc) más representativos de la cultura y la sociedad italiana, francesa y española eran, sin duda alguna, de ascendencia germánica, pensando que sus cualidades anímicas y espirituales revelarían siempre los caracteres antropológicos del germano, dolicocéfalo y rubio, aun cuando su apariencia física externa fuera la de un alpino braquicéfalo o la de un oscuro mediterráneo.