dimanche, 11 février 2024
Convulsions rurales

Convulsions rurales
par Georges FELTIN-TRACOL
À cinq mois des élections européennes, les campagnes du Vieux Continent s’emballent dans une exaspération variée. Espagnols, Britanniques, Belges, Allemands et Français suivent avec deux à cinq ans de retard la révolte de leurs homologues néerlandais. Ces derniers protestèrent contre les normes administratives, les injonctions officielles et les oukases écologiques punitifs. La Commission européenne a, d’une part, incité à prendre ces mesures et, d’autre part, insisté à ratifier les traités déments de libre-échange au moins disant agricole avéré.

Depuis bientôt trois semaines, les syndicats majoritaires de l’agriculture hexagonale, productiviste et mécanisée, la FNSEA (Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles) et les Jeunes Agriculteurs, rencontrent la concurrence non plus de la Confédération paysanne altermondialiste, mais de la Coordination rurale. Dissidence de la FNSEA en 1991 en réaction contre la réforme libre-échangiste de la PAC (Politique agricole commune), la Coordination rurale fusionne avec la FFA (Fédération française de l’Agriculture) dont l’une des figures marquantes fut l’infatigable défenseur de l’enracinement et grand activiste agricole à l’instar d’Henri Dorgères, Alexis Arette. Qu’on se souvienne du magnifique blocus paysan de Paris en 1992 ! Quant au MODEF (Mouvement de défense des exploitants familiaux), proche du PCF, il se met à la remorque des événements…
La présente crise agricole résulte de plus de six décennies d’« industrialisation », de « tertiarisation » et de « bureaucratisation » du secteur primaire. Les agriculteurs sont de nos jours les formidables aventuriers d’une ère moderne finissante. Certains commentateurs voient dans ces manifestations et autres blocages autoroutiers la synthèse des Bonnets rouges bretons de 2013 et des Gilets jaunes de 2018 – 2019, d’où le bonnet jaune porté avec fierté par les mécontents. D’autres y transfèrent leur nostalgie ruraliste et agrarienne alors que le monde agricole est à 100 % urbanisé dans les mentalités. La césure entre les aires rurales et les espaces urbains n’existe plus d’un point de vue psychologique.
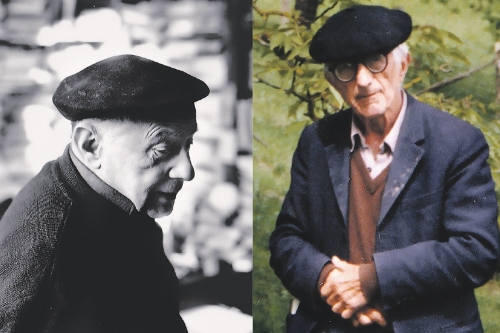
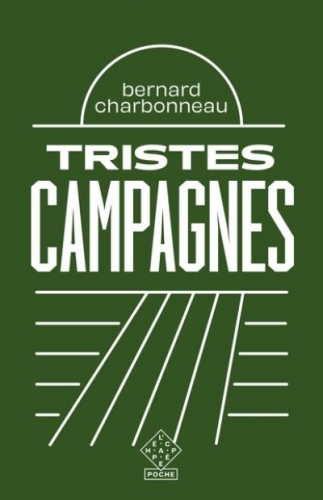
Photo: Jacques Ellul et Bernard Charbonneau
Ce constat, Bernard Charbonneau l’a fait dès 1973 dans son essai Tristes Campagnes (Éditions L’Échappé, coll. « Poche », 2023, 232 p., 12 €). Ami personnel du philosophe anti-technicien Jacques Ellul (1912 – 1994), Bernard Charbonneau (1910 – 1996) reste à l’écart des milieux politiques écologistes. C’est un paradoxe ! Son œuvre riche en essais édifiants constitue une belle somme intellectuelle non-conformiste. Méfiant envers le progrès technique, il clame son amour des patries charnelles. Il regardait d’un œil critique et sceptique l’entrée des écologistes dans l’électoralisme.
Amoureux des paysans du Béarn, des Landes et du Pays Basque, Bernard Charbonneau remarque qu’« autrefois maître de sa terre, le paysan béarnais n’en est plus que l’exploitant provisoire ». Il souligne que « la grande nouveauté de l’après-guerre c’est l’intégration de la campagne dans l’ensemble industriel et urbain, avec pour effet sa transformation en banlieue ». Il note en outre que « nous vivons dans une société qui n’a guère qu’une idée : produire ». Cette course au rendement explique l’endettement des exploitants agricoles, l’extension nécessaire des parcelles au grè des remembrements incessants et l’acquisition, de plus en plus en GAEC (Groupement agricole d’exploitation en commun), de machines automatisées coûteuses. L’introduction de la compétition dans le travail des champs explique le passage du paysan libre au salarié, plus ou moins direct, de l’industrie agro-alimentaire.
Dès 1973, Bernard Charbonneau écrit, visionnaire, qu’« au nom de la rentabilité on détruit l’exploitation familiale de polyculture établie ici depuis des siècles sur sa terre, pour la remplacer par la grande entreprise travaillant pour le marché européen ou mondial. Ou bien on persuade les derniers jeunes de mener un jeu pour lequel ils ne sont pas faits : Dieu – l’Économie – reconnaîtra les siens. Abandonnés dans un désert parsemé de ruines, ils vieilliront dans une angoisse de la faillite, sans pouvoir prendre femme, en attendant le jour où, liquidés par leur tracteur et les hasards de la monoculture, ils devront partir, laissant le nouveau Béarn aux mains de gros propriétaires ou de sociétés étrangères. »
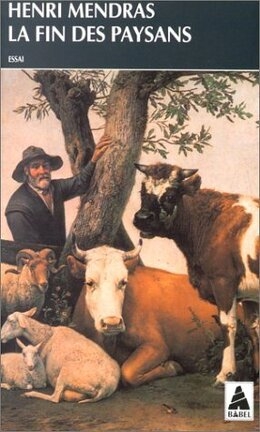 La « fin des paysans », pour reprendre le titre d’une célèbre enquête du sociologue Henri Mendras en 1967, n’implique toutefois pas la disparition des terroirs. Au contraire, les terres arables conservent toute leur valeur. Elles deviennent plutôt la propriété de multinationales chinoises, indiennes ou moyennes-orientales, car l’agriculture demeure un enjeu crucial pour le maintien de toute communauté politique surtout à un moment où la mondialisation atteint enfin ses limites. L’autosuffisance alimentaire comme d’ailleurs l’autosuffisance énergétique auraient dû être érigées depuis bien longtemps en priorités absolues. Or cela aurait impliqué l’affirmation de l’homme de la terre aux dépens de l’individu de bitume. En fin détracteur du modèle stato-national, Bernard Charbonneau observe que la « modernisation agricole » « a été décrétée d’en haut, en vertu d’un esprit hostile aux particularités, à l’invention et à l’originalité locale, ennemi de tout pays ou patrie ». Ainsi déplore-t-il qu’« un pays, une patrie – je ne dis pas un État-nation - c’est-à-dire un paysage et un style de vie, disparaît ».
La « fin des paysans », pour reprendre le titre d’une célèbre enquête du sociologue Henri Mendras en 1967, n’implique toutefois pas la disparition des terroirs. Au contraire, les terres arables conservent toute leur valeur. Elles deviennent plutôt la propriété de multinationales chinoises, indiennes ou moyennes-orientales, car l’agriculture demeure un enjeu crucial pour le maintien de toute communauté politique surtout à un moment où la mondialisation atteint enfin ses limites. L’autosuffisance alimentaire comme d’ailleurs l’autosuffisance énergétique auraient dû être érigées depuis bien longtemps en priorités absolues. Or cela aurait impliqué l’affirmation de l’homme de la terre aux dépens de l’individu de bitume. En fin détracteur du modèle stato-national, Bernard Charbonneau observe que la « modernisation agricole » « a été décrétée d’en haut, en vertu d’un esprit hostile aux particularités, à l’invention et à l’originalité locale, ennemi de tout pays ou patrie ». Ainsi déplore-t-il qu’« un pays, une patrie – je ne dis pas un État-nation - c’est-à-dire un paysage et un style de vie, disparaît ».
Réaliste pessimiste, Bernard Charbonneau estime aussi que « la campagne ne fait pas les révolutions; si elle subit le changement, elle ne favorise guère l’aptitude à le concevoir ». Il faut se défaire de l’envie de voir dans l’actuelle agitation agricole une répétition de la révolte paysanne du Schleswig-Holstein en 1928 - 1932 décrite dans La Ville (1932) d’Ernst von Salomon. Les conditions ne sont guère propices à un tel soulèvement. Il manque aux côtés des agriculteurs des penseurs organiques, des poètes et des artistes authentiques non subventionnés. En effet, dans un récit d’anticipation qui clôt Tristes Campagnes, Bernard Charbonneau rappelle à propos du rôle social de l’art – qu’il ne confond surtout pas avec l’art contemporain ! - qu’« une action révolutionnaire aurait la vertu de lui rendre, comme à la parole, sa dignité. L’art, ou plutôt la pensée vécue jusqu’au sang du cri, serait à nouveau force sociale, créateur de rites et de cérémonies ».
Par leurs actions coups de poing sur les autoroutes et au marché d’intérêt national de Rungis, les adhérents intrépides de la Coordination rurale et des fédérations départementales des exploitants agricoles démontrent cependant leur grand sens de la médiatisation. Hélas ! Ces convulsions rurales actuelles n’empêcheront pas la mort lente des campagnes et leur mutation en zones d’accueil permanent d’une immigration de peuplement en hausse constante. Le cosmopolitisme déteste toute pérennité. La société liquide inonde désormais les campagnes. On assiste en direct à la noyade du monde rural. Qui s’en soucie vraiment ?
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 101, mise en ligne le 7 février 2024 sur Radio Méridien Zéro.
19:18 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révoltes paysannes, actualité, europe, affaires européennes, jacques ellul, bernard charbonneau, paysannat, campagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 19 février 2018
L'Homme en son temps et en son lieu de Bernard Charbonneau
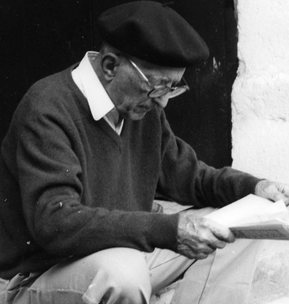
L'Homme en son temps et en son lieu de Bernard Charbonneau
par Juan Asensio
Ex: http://www.juanasensio.com
Quel merveilleux petit texte que cet Homme en son temps et en son lieu dont bien des fulgurances pourraient être rapprochées des pensées d'un Max Picard sur le délitement de notre monde, la fuite de Dieu et la déréliction de l'homme contemporain, celui des foules !
Aussi court soit-il, le texte de Bernard Charbonneau, écrit en 1960 alors qu'approchant de la cinquantaine, il n'a pas encore publié un seul ouvrage comme Jean Bernard-Maugiron l'explique dans sa Préface, est remarquable d'intuitions et de profondeurs, mais aussi de paradoxes. C'est sans doute d'ailleurs la nature essentiellement paradoxale des propositions que Charbonneau ne prend guère le temps d'expliciter en concaténations de pesants concepts qui risque de dérouter le lecteur, non seulement de plus en plus paresseux mais, et c'est plus grave, de moins en moins capable de comprendre une intelligence et une écriture qui avancent par bonds et intuitions plutôt que par démonstrations.
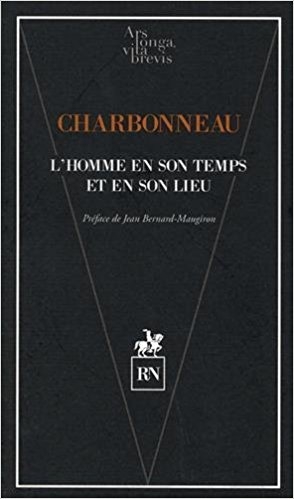 L'homme est au centre de l'univers selon Charbonneau, qui ouvre son texte de bien belle façon en affirmant qu'avant «l'acte divin, avant la pensée, il n'y a ni temps, ni espace : comme ils disparaîtront quand l'homme aura disparu dans le néant, ou en Dieu» (1). Si l'homme se trouve au centre d'une dramaturgie unissant l'espace et le temps, c'est qu'il a donc le pouvoir non seulement d'organiser ces derniers mais aussi, bien évidemment, de les déstructurer, comme l'illustre l'accélération du temps et le rapetissement de l'espace dont est victime notre époque car, «si nous savons faire silence en nous, nous pouvons sentir le sol qui nous a jusqu'ici portés vibrer sous le galop accéléré d'un temps qui se précipite», et comprendre que nous nous condamnons à vivre entassés dans un «univers concentrationnaire surpeuplé et surorganisé» (le terme concentrationnaire est de nouveau employé à la page 31, puis à la page 50), où l'espace à l'évidence mais aussi le temps nous manqueront, alors que nous nous disperserons «dans un vide illimité, dépourvu de bornes matérielles, autant que spirituelles».
L'homme est au centre de l'univers selon Charbonneau, qui ouvre son texte de bien belle façon en affirmant qu'avant «l'acte divin, avant la pensée, il n'y a ni temps, ni espace : comme ils disparaîtront quand l'homme aura disparu dans le néant, ou en Dieu» (1). Si l'homme se trouve au centre d'une dramaturgie unissant l'espace et le temps, c'est qu'il a donc le pouvoir non seulement d'organiser ces derniers mais aussi, bien évidemment, de les déstructurer, comme l'illustre l'accélération du temps et le rapetissement de l'espace dont est victime notre époque car, «si nous savons faire silence en nous, nous pouvons sentir le sol qui nous a jusqu'ici portés vibrer sous le galop accéléré d'un temps qui se précipite», et comprendre que nous nous condamnons à vivre entassés dans un «univers concentrationnaire surpeuplé et surorganisé» (le terme concentrationnaire est de nouveau employé à la page 31, puis à la page 50), où l'espace à l'évidence mais aussi le temps nous manqueront, alors que nous nous disperserons «dans un vide illimité, dépourvu de bornes matérielles, autant que spirituelles». Ainsi ni l'espace ni le temps ne sont a priori hostiles à l'homme, pourvu bien sûr que celui-ci, en s'obstinant à «remonter sa pente», finisse «un jour ou l'autre par dominer sa vie» (p. 20). Charbonneau a écrit son livre pour saluer l'unique beauté de l'homme : sa liberté, moins donnée que conquise. Cela signifie qu'il doit tenter de maîtriser l'espace et le temps, mais point tenter de les soumettre ni de les forcer, car la tentation totalitaire dont nous faisons montre ne peut que nous conduire à dépasser toutes les bornes, c'est le cas de le dire : «Notre faim d'espace nous conduira peut-être à la quitter [la Terre] en nous lançant dans le vide interstellaire, mais cette liberté n'appartiendra pas à un individu, tout au plus à un Empire. Il ne reste plus aux individus qu'un espace où se perdre : celui d'un vide intérieur où tourbillonnent des mondes imaginaires» (p. 25), car c'est à l'individu isolé que sont réservées «les errances du Bateau ivre, et aux ingénieurs et aux militaires disciplinés les fusées» (p. 26).
De la même façon, c'est son désir de maîtriser le temps qui confère à l'homme la volonté d'affronter le devenir qui est destruction, puisque c'est «le heurt de ce torrent du devenir sur sa conscience vacillante qu'il appelle le temps" (p. 28). Comme chez Max Picard, l'homme selon Charbonneau ne peut qu'exister dans la continuité, sauf à n'être qu'un démiurge dont le néant troue non seulement la conscience mais l'action, ainsi que l'est Adolf Hitler selon l'auteur de L'Homme du néant. Dès lors, écrit Charbonneau, si l'homme «renonçait à dominer la durée, son dernier éclair de conscience lui révélerait le visage d'un monstre, avant de s'éteindre dans l'informité du néant", car l'abandon à l'instant poursuit l'auteur, «la religion du devenir qualifiée de Progrès, ne sont que fantasme et fracas dansant sur l'abîme où le cours du temps engloutit l'épave de l'humanité» (p. 30).
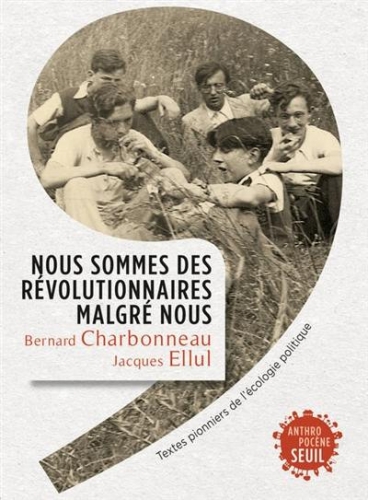 Hélas, l'homme moderne ne semble avoir de goût, comme le pensait Max Picard, que pour la fuite et, fuyant sans cesse, il semble précipiter la création entière dans sa propre vitesse s'accroissant davantage, la fuite appelant la fuite, bien qu'il ne faille pas confondre cette accélération avec le «rythme d'une existence humaine [qui] est celui d'une tragédie dont le dénouement se précipite». Ainsi, la «nuit d'amour dont l'aube semblait ne jamais devoir se lever n'est plus qu'un bref instant de rêve entre le jour et le jour; du printemps au printemps, les saisons sont plus courtes que ne l'étaient les heures. Vient même un âge qui réalise la disparition du présent, qui ne peut plus dire : je vis, mais : j'ai vécu; où rien n'est sûr, sinon que tout est déjà fini» (p. 22).
Hélas, l'homme moderne ne semble avoir de goût, comme le pensait Max Picard, que pour la fuite et, fuyant sans cesse, il semble précipiter la création entière dans sa propre vitesse s'accroissant davantage, la fuite appelant la fuite, bien qu'il ne faille pas confondre cette accélération avec le «rythme d'une existence humaine [qui] est celui d'une tragédie dont le dénouement se précipite». Ainsi, la «nuit d'amour dont l'aube semblait ne jamais devoir se lever n'est plus qu'un bref instant de rêve entre le jour et le jour; du printemps au printemps, les saisons sont plus courtes que ne l'étaient les heures. Vient même un âge qui réalise la disparition du présent, qui ne peut plus dire : je vis, mais : j'ai vécu; où rien n'est sûr, sinon que tout est déjà fini» (p. 22).C'est le caractère éphémère de la vie humaine, nous le savons bien, qui en fait tout le prix, et c'est aussi en affirmant sa liberté qu'il arrivera à faire du temps et de l'espace autre chose que des grilles où s'entrecroisent courbes et dates, de véritables dimensions où il pourra se risquer : «La liberté se risque, mais se situe. Devant elle, s'étendent les brumes du doute et de l'angoisse, les ténèbres de l'erreur. Mais elle taillera sa voie dans le vide si, partant d'un roc inébranlable, elle se fixe à l'étoile qui ne varie pas» (p. 32). Mais comment se fixer un cap si nous ne cessons de nous agiter et si nous détruisons l'espace qui nous a été donné, et le temps accordé pendant lequel gagner notre liberté ? Comment prétendre conquérir notre propre liberté en faisant de l'espace et du temps des territoires à explorer si le mouvement de l'histoire s'élargit comme la fissure d'une banquise (cf. p. 38) et que «le monde change trop pour que nous ne changions pas nous-mêmes», tandis que «le cours de ces changements est maintenant plus rapide que celui d'une vie» (p. 39) ?
Partant, «l'homme, aujourd'hui, sait qu'il meurt deux fois; les amarres qui l'ancraient dans le temps se sont rompues. Il le voit s'écouler sans fin au-delà de lui-même, comme une machine dont les freins auraient cédé sur la pente d'un abîme sans fond; tel un Styx qui tourbillonnerait éternellement tout autour de l’œil bleu de l'instant. D'autres civilisations, un autre homme... puis autre chose qui ne serait ni l'univers, ni le temps...» (p. 40), qui ne serait rien sans doute, qui serait le Néant, qui serait un temps et un espace privés d'homme pour en ordonner les royaumes, y promener son insatiable curiosité, en étudier les richesses prodigieuses.
De la même manière que le temps, l'espace est déformé, moins courbé que détruit, car nous «sommes tous là, les uns sur les autres, les Chinois de Taichen, les boutiquiers du Lot, les mineurs de la Ruhr, coincés entre Eisenhower et Khrouchtchev, dans ce globe qui tourne en rond dans le vide» (p. 41), et aussi car il n'y a plus «d'espace infini, d'au-delà sur terre; plus d'inconnu et de terreurs, mais aussi plus de terres libres dans un pays neuf pour le pauvre et le vaincu. Le désert où fuyait le prophète devient la zone interdite où César cache ses secrets d’État» (p. 42). C'est en somme dire que si tout nous maintient à notre place, «rien ne nous attache», puisque nous «n'avons ni feu ni lieu" et que «nous sommes perpétuellement en marche vers un ailleurs, que nous soyons le touriste individuel ou le numéro matricule de quelque division motorisée» (p. 43).
Le constat que pose Bernard Charbonneau est pour le moins amer, crépusculaire : que faire pour que la «tradition vivante» (p. 47) puisse résister à l'écoulement du temps ? Je ne suis pas certain que nous puissions lire le petit texte fulgurant de l'auteur comme un de ces manifestes faciles qui, aux idiots qui aiment se leurrer, fixent un cap commode agrémenté d'une multitude de repères clignotant comme autant de sémaphores dans la nuit ainsi balisée. Je n'en suis pas sûr car nous manquent les raisons de ne pas fuir l'atrocité de ce monde, mais de la combattre. En effet, «le monde actuel s'attaque à l'homme par deux voies apparemment contradictoires : d'une part, en l'attachant à une action et à des biens purement matériels; de l'autre, en privant ce corps sans âme de toute relation profonde avec la réalité». Dès lors, répudiant, selon l'auteur, «ce matérialisme et cet idéalisme, un homme réel, mais libre, cherchera d'abord à s'enraciner en un lieu», ce qui supposera qu'il accepte l'immobilité, qualifiée par l'auteur comme étant un «autre silence», et cela «afin de pénétrer ce lieu en profondeur plutôt que de se disperser en surface». Or, pour «accepter ainsi de rester à la même place», et, de la sorte, ne pas fuir, il faut que ce lieu en soit un, «et non pas quelque point abstrait» (p. 49). Il nous manque donc ce que George Steiner a appelé la réelle présence et d'autres, moins suspects de lorgner vers le vocabulaire de la théologie catholique, des raisons de ne pas désespérer.
Il faudrait dès lors tenter de faire renaître une société véritablement libre, et privilégier pour ce faire «la maison plutôt que l'immeuble, le bourg plutôt que la ville», solutions que nous sommes en droit de penser totalement inapplicables au monde actuel, comme s'en avise l'auteur qu'il serait ridicule de qualifier de doux naïf, qui affirme qu'elles «exigent évidemment une population moins dense et une autre économie» (p. 50) sur laquelle il ne souffle mot, alors que les dernières lignes de son texte semblent trahir la véritable nature de l'attente de l'auteur et, au fond, et même dans ses formes les plus bassement politicardes, de l'écologie, qui est proprement apocalyptique, messianique peut-être. De ce fait, toute écologie conséquente avec ses présupposés métaphysiques est parfaitement irréalisable dans le cadre d'une banale politique de la ville et même, plus largement, sauf à parier sur celui d'une organisation méta-politique de l'homme moderne dont, une fois de plus, Charbonneau ne nous dit rien, du moins dans ce petit texte, si ce n'est, magnifiquement, cela : «Puissions-nous accepter notre vie, soutenus par la nostalgie d'un autre règne, où l'espace et le temps, l'homme, ne seraient pas abolis mais accomplis», et aussi où «la moindre poussière et la plus humble seconde seraient recueillies dans le triomphe d'un amour infini» (p. 51).
Note
(1) Bernard Charbonneau, L'Homme en son temps et en son lieu (préface de Jean Bernard-Maugiron, RN Éditions, 2017), p. 19. Je salue une nouvelle fois ce jeune éditeur, aussi courageux qu'intéressant dans ses choix de publication.
09:56 Publié dans Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, bernard charbonneau, livre, juan asensio |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 octobre 2012
L'Ecologie politique avant l'écologisme
Bernard Charbonneau
L'Ecologie politique avant l'écologisme
Michel Lhomme
Ex: http://metamag.fr/
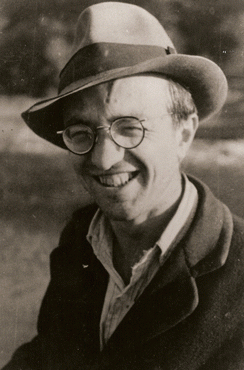 Jacques Ellul, l’auteur du Système technicien et du Bluff technologique, disait qu’il lui devait tout. Il y a peu, on a parlé de Jacques Ellul, sur Métamag à l’occasion d’un colloque qui lui était consacré en juin dernier, à Bordeaux. Je voudrai revenir ici sur son compagnon intellectuel Bernard Charbonneau (1920-1996) qui marqua toute la génération politique de la région, sortie des années 30 car son œuvre reste encore trop méconnue.
Jacques Ellul, l’auteur du Système technicien et du Bluff technologique, disait qu’il lui devait tout. Il y a peu, on a parlé de Jacques Ellul, sur Métamag à l’occasion d’un colloque qui lui était consacré en juin dernier, à Bordeaux. Je voudrai revenir ici sur son compagnon intellectuel Bernard Charbonneau (1920-1996) qui marqua toute la génération politique de la région, sortie des années 30 car son œuvre reste encore trop méconnue.





Daniel Cérézuelle, Ecologie et liberté. Bernard Charbonneau, précurseur de l’écologie politique, Ed. Parangon, Lyon, 2006 ;
00:05 Publié dans Biographie, Ecologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : écologie, bernard charbonneau |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


