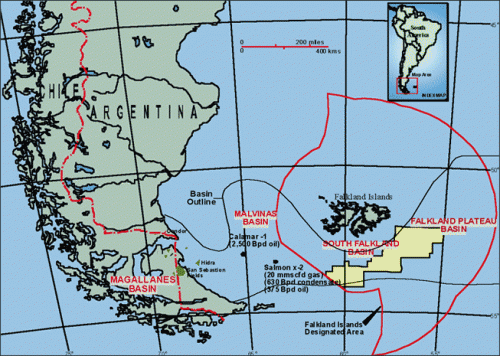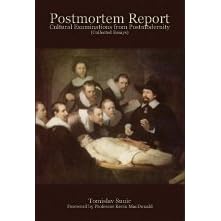mercredi, 24 février 2010
Le elezioni ucraine confermano l'arretramento dell'egemonia USA
K. G. Singh: “Le elezioni ucraine confermano l’arretramento dell’egemonia USA”
Il 13 febbraio l’ambasciatore (rit.) K. Gajendra Singh, corrispondente abituale di “Eurasia”, ha pubblicato un suo commento sull’esito delle recenti elezioni presidenziali in Ucraìna. Quella che segue ne è una sintesi, curata da Andrea Bogi; il testo completo (in lingua inglese) può essere letto qui.
I risultati del secondo turno delle combattute elezioni presidenziali ucraine hanno consegnato la vittoria al filo-russo Viktor Janukovič con il 48,95% dei voti, contro il 45,47 di Julia Timošenko. Circa il 70% dei votanti registrati ha esercitato il proprio diritto in queste elezioni di fondamentale importanza per la continua battaglia strategica tra Est e Ovest.
Il regolare svolgimento del voto è stato confermato da più di un organismo internazionale e da tutti gli osservatori, tanto russi quanto americani, nonostante le proteste della Timošenko, accusata per questo dal vincitore, in un’intervista alla CNN, di tradire gli stessi principi della sua Rivoluzione Arancione del 2004 (comunque finanziata e diretta dagli USA e dalle loro organizzazioni, fondazioni e marionette in Eurasia).
Nel commento alle elezioni, il New York Times ha scritto: “Timošenko ha aiutato a diffondere la Rivoluzione Arancione, che ha portato per la prima volta la democrazia di stile occidentale in Ucraina. Mentre la sua sconfitta potrebbe indicare un rifiuto della rivoluzione, il fatto che il paese sia riuscito a svolgere una controversa elezione presidenziale che è stata largamente considerata corretta suggerisce che l’eredità arancione è sopravvissuta”.
Dello stesso avviso è il professor Olexej Haran, insegnante di politica comparata all’Università Mohyla di Kiev, che sottolinea come la democrazia abbia riscosso grande successo tra gli ucraini, pur essendo rimasti delusi dalle mancate riforme sociali ed economiche.
Congratulandosi con Janukovič, anche il presidente americano Barack Obama si è complimentato per “l’ulteriore positivo passo verso il rafforzamento della democrazia in Ucraina, affermando inoltre la necessità di continuare la cooperazione reciproca nel “espandere la democrazia e la prosperità, proteggere la sicurezza e l’integrità territoriale, rafforzare la legalità, promuovere la non-proliferazione, e supportare le riforme economiche ed energetiche in Ucraina.”
Janukovič ha però chiarito di non prendere neppure in considerazione l’ingresso dell’Ucraina nella NATO: “L’Ucraina è interessata oggi nello sviluppo di un progetto per creare un sistema collettivo di sicurezza europeo. Noi siamo pronti a prendervi parte e a supportare l’iniziativa del presidente russo Dimitrj Medvedev.” Una chiara indicazione della sua volontà di restaurare i legami con la Russia, deteriorati a partire dal 2004 a causa delle politiche filo-occidentali di Juščenko.
A seguito della sconfitta di Janukovič cinque anni fa, Juščenko decise per una politica di contrapposizione con Mosca per far piacere a i suoi sostenitori, USA, UK e altri, con gravi danni e perdite per il paese. Ci sono state continue dispute con Mosca per il prezzo e le forniture di gas all’Europa centrale e occidentale, dalle quali gli ucraini hanno gudagnato ben poco. Questo ha provvisto gli organi della propaganda occidentale come BBC e CNN di materiale per parlar male della Russia, quando Mosca aveva intenzione di applicare prezzi di mercato al gas venduto all’Ucraina, che rubava il gas o strozzava le forniture di gas verso l’occidente.
La Germania vuole avere stabili e benefiche relazioni economiche con la Russia per togliersi l’arrogante Washington dalla schiena. Berlino ha persino garantito la copertura di 1 miliardo di euro dei costi del progetto Nord Stream per la stesura di un gasdotto sotto il Baltico per evitare l’attraversamento dellUcraina e di altri territori, con l’ex cancelliere Gerhard Schroeder che ha accettato la nomina di Gazprom per il posto a capo del consiglio d’amministrazione. Il cambiamento a Kiev è di buon auspicio per gli ucraini, che sono diventati una pedina nel gioco strategico tra Est e Ovest.
Subito dopo la vittoria di Juščenko 5 anni fa, marines americani comparirono persino per un’esercitazione navale in Crimea (un territorio russo che fu trasferito all’Ucraina dal leader sovietico Nikita Kruščёv, di origini ucraine), dove è ancorata la flotta russa. La popolazione di lingua russa protestò e cacciò gli Yankee costringendoli ad una rapida uscita di scena.
* K. Gajendra Singh è stato ambasciatore della Repubblica Indiana in Turchia, Azerbaigian, Giordania, Romania e Senegal. Oggi presiede la Foundation for Indo-Turkic Studies.
14:04 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affaires européennes, europe, ukraine, politique internationale, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Kriegsvorbereitungen: Nach 28 Jahren rüsten sich Argentinier und Briten vor den Falkland-Inseln für die nächste Schlacht
Kriegsvorbereitungen: Nach 28 Jahren rüsten sich Argentinier und Briten vor den Falkland-Inseln für die nächste Schlacht
Unbemerkt von deutschen »Qualitätsjournalisten« rüsten sich Briten und Argentinier für einen neuen Falkland-Krieg. Der letzte hat rund tausend Menschen das Leben gekostet. In der kommenden Woche wird sich der Ton verschärfen, die Argentinier durchsuchen nun alle Schiffe, die auf die Falkland-Inseln wollen. Denn die Briten wollen dort die Ölförderung aufnehmen. Die Argentinier aber sehen die Inselgruppe weiterhin als ihr Staatsgebiet an.
Zwischen April und Juni 1982 führten Großbritannien und Argentinien Krieg um die Falkland-Inseln (auch Malwinen – argentinisch »Islas Malvinas« – genannt), die Sandwich-Inseln und um Südgeorgien. Der damalige amerikanische Präsident Ronald Reagan sagte zu jener Zeit, er können nicht verstehen, warum sich zwei Verbündete um »einige eisige Felsen« stritten. Doch es ging nicht um die kaum bewohnten Felsen. Es ging schon damals um die vermuteten reichen Ölvorkommen. Argentinien beharrt seither weiterhin auf dem Besitzanspruch in Bezug auf die Inseln. Der Konflikt zwischen beiden Staaten um die Rohstoffe der Region ist zwar seither in Vergessenheit geraten, aber nicht gelöst.
Vor dem Hintergrund der schweren britischen Wirtschaftskrise sucht die Londoner Regierung nun nach neuen Einnahmen und nach einer Möglichkeit, die immer unzufriedender werdende britische Bevölkerung geschlossen hinter sich zu vereinen. Mit einem neuen Krieg um die Falkland-Inseln könnte sie beides erreichen: Die Briten patriotisch hinter sich aufreihen und Großbritannien nach den versiegenden Nordeefeldern endlich große neue Ölvorkommen dauerhaft sichern lassen. In aller Ruhe hat die Lononer Regierung in den vergangenen Wochen Ölbohrungen auf den Falkland-Inseln vorbereitet – und parallel dazu »rein zufällig« immer mehr Kriegsschiffe und Truppen in die Region verlegt.
Die Argentinier kontrollieren nun alle Schiffe, die in Richtung der umstrittenen Inselgruppe fahren und durchsuchen diese. Ein britisches Schiff mit Ölbohrausrüstung haben sie gerade beschlagnahmt.
Nun will Buenos Aires offiziell wieder die Kontrolle über den gesamten Seeverkehr zwischen Südamerika und der Inselgruppe ausüben, die ohnehin energisch von Argentinien beansprucht wird, auch wenn dort Briten leben. Mit der Entdeckung gewaltiger Erdöl- und Gasvorräte in dem Seegebiet um die drei großen Inseln geht der Streit nun in die nächste – möglicherweise kriegerische – Runde. Denn die großen britischen Ölkonzerne vermuten allein unter einem einzigen Feld südlich der Falklands mindestens 60 Milliarden Barrel Öl. Wenn das zutrifft, dann wäre es etwa ein Drittel mehr, als bislang in der gesamten Nordsee gefördert wurde. Man muss, um sich die gewaltige Dimension vorstellen zu könenn, auch wissen: Das größte Ölfeld der Welt, Ghawar in Saudi-Arabien, wird auf 80 Milliarden Barrel geschätzt.
Großbritannien hat zum Schutz der genannten Ölvorkommen schon wieder mehr als tausend Soldaten auf der Inselgruppe stationiert, vor der Küste zudem Fregatten und einen Zerstörer. Luftlandetruppen werden derzeit verlegt. In den nächsten Tagen wird eine Ölbohrinsel zu den Inseln geschleppt. Die Argentinier sehen das als offene Kriegserklärung an. Wenn die Londoner Regierung will, dann kann sie die unzufriedene eigene Bevölkerung nun jederzeit mit einem spontanen Krieg von den inneren Problemen ablenken.
Donnerstag, 18.02.2010
© Das Copyright dieser Seite liegt, wenn nicht anders vermerkt, beim Kopp Verlag, Rottenburg
Dieser Beitrag stellt ausschließlich die Meinung des Verfassers dar. Er muß nicht zwangsläufig die Meinung des Verlags oder die Meinung anderer Autoren dieser Seiten wiedergeben.
00:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européenne, s amérique latine, amérique du sud, argentine, malouines, falklands, antarctique, atlantique, océan atlantique, atlantique sud, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Postmortem Report: Cultural Examinations from Postmodernity
Dr. Sunic' Newest Book !
Editorial Reviews
Product Description
Tomislav Sunic is one of the leading scholars and exponents of the European New Right. A prolific writer and accomplished linguist in Croatian, English, French, and German, his thought synthesizes the ideas of Oswald Spengler, Carl Schmitt, Vilfredo Pareto, and Alain de Benoist, among others, exhibiting an elitist, neo-pagan, traditionalist sensibility. A number of themes have emerged in his cultural criticism: religion, cultural pessimism, race and the Third Reich, liberalism and democracy, and multiculturalism and communism. This book collects Dr. Sunic’s best essays of the past decade, treating topics that relate to these themes. From the vantage point of a European observer who has experienced the pathology of liberalism and communism on both sides of the Iron Curtain, Dr. Sunic offers incisive insights into Western and post-communist societies and culture. Always erudite and at times humorous, this highly readable postmortem report on the death of the West offers a refreshing, alternative perspective to what is usually found in the cadaverous Freudo-Marxian scholasticism that rots in the dank catacombs of postmodern academia.
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, postmodernité, postmodernisme, culture, sociologie, déclin, décadence, réflexions personnelles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
T. Sunic: Amérique réelle, Amérique hyperréelle

Synergies Européennes – Bruxelles / Zagreb – février 2009
Tomislav SUNIC :
Amérique réelle, Amérique hyperréelle
Un phénomène important est survenu dans les relations entre les élites américaines détentrices du pouvoir et les élites médiatiques. Au début du 21ème siècle, l’Amérique, contrairement aux autres pays européens, se vante ouvertement qu’elle garantit une liberté d’expression totale. Pourtant, les médias américains osent rarement soulever des thématiques considérées comme contraires à l’esprit postmoderne de l’américanisme. De fait, la « médiacratie » américaine postmoderne opère de plus en plus en liaison avec le pouvoir exécutif de la classe dominante. Cette cohabitation se déroule sur un mode mutuellement correcteur, où les uns posent des critères éthiques pour les autres et vice-versa. Les principales chaînes de télévision et les principaux journaux d’Amérique, comme CNN, The New York Times ou The Washington Post suggèrent aux hommes politiques la ligne à suivre et vice-versa ou, pour un autre sujet, les deux fixent de concert les critères du comportement politique général qu’il faudra adopter. Parmi les citoyens américains, l’idée est largement répandue que les médias représentent un contre-pouvoir face au système et que, de par leur vocation, ils doivent être par définition hostiles aux décisions prises par les élites au pouvoir. Mais en réalité, les médias américains ont toujours été les porte-paroles et les inspirateurs du pouvoir exécutif, bien que d’une manière anonyme, sans jamais citer les noms de ceux qui, au départ de la sphère gouvernementale, leur filaient des tuyaux. Depuis la première guerre mondiale, les médias américains ont eu une influence décisive, dans la mesure où ils ont créé l’ambiance psychologique qui a précédé et soutenu la politique étrangère américaine, en particulier en poussant les politiques américains à bombarder au phosphore les villes européennes pendant la seconde guerre mondiale. La même stratégie, mais avec une ampleur réduite, a été suivie, partiellement, par les médias américains lors de l’engagement US en Irak en 2003.
Médias et classe dominante : opérations conjointes
Dans le choix des mots, la classe dominante américaine et ses courroies de transmission dans les médias et l’industrie de l’opinion ne fonctionnent plus d’une manière disjointe et exclusive l’une de l’autre ; elles opèrent conjointement dans le même effort pédagogique de « répandre la démocratie et la tolérance » dans le monde entier. « Qu’il y ait ou non un soutien administratif au bénéfice des médias », écrit Régis Debray, « ce sont les médias qui sont les maîtres de l’Etat ; l’Etat doit négocier sa survie avec les faiseurs d’opinion » (1). Debray, figure de proue parmi les théoriciens de la postmodernité, ne révèle au fond rien de neuf, sauf que dans la « vidéo-politique » postmoderne, comme il l’appelle, et qui est distillée par les médias électroniques modernes, les mensonges des politiciens semblent plus digérables qu’auparavant. En d’autres mots, le palais présidentiel n’a plus d’importance politique décisive ; c’est la tour de la télévision qui est désormais en charge de la « haute politique ». L’ensemble des discours et récits politiques majeurs ne relève plus de la « graphosphère » ; il entre dans le domaine de la « vidéosphère » émergente. En pratique, cela signifie que toutes les absurdités que pense ou raconte le politicien n’ont plus aucune importance de fond : quel que soit leur degré de sottise, il faut qu’elles soient bien présentées, qu’elles suscitent l’adhésion, comme sa propre personne, sur les écrans de la télévision. Il peut certes exister des différences mineures entre la manière dont les médias, d’une part, et la classe dominante américaine, d’autre part, formulent leur message, ou entre la façon dont leur efforts correcteurs réciproques se soutiennent mutuellement, il n’en demeure pas moins vrai que la substance de leurs messages doit toujours avoir le même ton.
La télévision et les médias visuels ont-ils changé l’image que nous avons du monde objectif ? Ou la réalité du monde objectif peut-elle être saisie, si elle a été explicitée autrement qu’elle ne l’est par les médias ? Les remarques que les universitaires ou d’autres hommes politiques formulent et qui sont contraires aux canons et aux vérités forgées par les médias se heurtent immédiatement à un mur de silence. Les sources et informations rebelles, qui critiquent les dogmes de la démocratie et des droits de l’homme, sont généralement écartées des feux de la rampe. C’est vrai surtout pour les écrivains ou journalistes qui remettent en question l’essence de la démocratie américaine et qui défient la légitimité du libre marché.
Significations à facettes multiples
Les hommes politiques américains contemporains ont de plus en plus souvent recours à des références voilées derrière un méta-langage hermétique, censé donner à ses locuteurs une aura de respectabilité. Les hommes politiques postmodernes, y compris les professeurs d’université, ont recours, de plus en plus, à une terminologie pompeuse d’origine exotique, et leur jargon se profile souvent derrière une phraséologie qu’ils comprennent rarement eux-mêmes. Avec la propagation rapide du méta-discours postmoderne au début du 21ème siècle, la règle, non écrite, est devenue la suivante : le lecteur ou le spectateur, et non plus l’auteur, devraient devenir les seuls interprètes de la vérité politique. A partir de maintenant, le lexique politique est autorisé à avoir des significations à facettes multiples. Mais, bien sûr, cela ne s’applique pas au dogme du libre marché ou à l’historiographie moderne, qui doit rester à tout jamais en un état statique. Le discours postmoderne permet à un homme politique ou à un faiseur d’opinion de feindre l’innocence politique. De cette manière, il est libre de plaider l’ignorance si ses décisions politiques débouchent sur l’échec. Ce plaidoyer d’ignorance, toutefois, ne s’applique pas s’il osait tenter ou s’il désirait déconstruire le proverbial signifiant « fascisme » qui doit rester le référent inamovible du mal suprême.
Dans un essai de 1946, un an après la défaite totale du national-socialisme, Orwell notait combien le mot « fascisme » avait perdu sa signification originelle : « il n’a maintenant plus aucune signification sauf dans la mesure où il désigne quelque chose qui n’est pas désirable » (…). On peut dire la même chose d’un vaste éventail de référents postmodernes, y compris du terme devenu polymorphe de « totalitarisme », qui date du début des années 20 du siècle passé, quand il est apparu pour la première fois et n’avait pas encore de connotation négative. Et qui sait s’il aura toujours cette connotation négative si on part du principe que le système américain, monté en épingle, pourrait, en cas d’urgence, utiliser des instruments totalitaires pour garantir sa survie ? Si l’Amérique devait faire face à des affrontements interraciaux de grande ampleur (on songe aux clivages raciaux de grande envergure après les dévastations causées par l’ouragan Katrina à la Nouvelle Orléans en 2005, qui pourrait être le prélude de plus graves confrontations ultérieures), elle devra fort probablement adopter des mesures disciplinaires classiques, telles la répression policière et la loi martiale. On peut imaginer que la plupart des théoriciens postmodernes n’émettraient aucune objection à l’application de telles mesures, bien qu’ils esquiveront probablement le vocable « totalitaire ».
Incantations abstraites
Il y a longtemps, Carl Schmitt théorisa et explicita une vérité vieille comme le monde. Notamment, que les concepts politiques acquièrent leur véritable signification si et seulement si l’acteur politique principal, c’est-à-dire l’Etat et sa classe dominante, se retrouvent dans une situation d’urgence soudaine et imprévue. Dans ce cas, toutes les interprétations usuelles des vérités posées jusqu’alors comme « allant de soi » deviennent obsolètes. On a pu observer un tel glissement après l’attaque terroriste du 11 septembre 2001 à New York (un événement qui n’a pas encore été pleinement élucidé) ; la classe dirigeante américaine a profité de cette occasion pour redéfinir la signification légale d’expressions comme les « droits de l’homme » et la « liberté de parole ». Après tout, la meilleure façon de limiter les droits civiques concrets n’est-elle pas d’abuser d’incantations abstraites sur les « droits de l’homme » et sur la « démocratie » ? Avec la déclaration possible d’un état d’urgence à grande échelle dans l’avenir, il semble tout à fait probable que l’Amérique finira par donner de véritables significations à son vocabulaire politique actuel. Pour les temps présents, toutefois, la postmodernité américaine peut se décrire comme une sémantique transitoire et un engouement esthétique parfaitement idoine pour assumer une surveillance dans les sphères académiques et politiques, sous le masque d’un seul terme : celui de « démocratie ».
Contrairement au mot, le concept de postmodernité désigne un fait politique ou social qui, selon diverses circonstances, signifie tout et le contraire de tout, c’est-à-dire, finalement, rien du tout. La postmodernité est tout à la fois une rupture avec la modernité et sa continuation logique sous une forme hypertrophiée. Mais, comme nous avons déjà eu l’occasion de le noter, en termes de dogme égalitaire, de multiculturalisme et de religion du progrès, le discours postmoderne est resté le même que le discours de la modernité. Le théoricien français de la postmodernité, Gilles Lipovetsky, utilise le terme d’hypermodernité lorsqu’il parle de la postmodernité. La postmodernité est hypermodernité dans la mesure où les moyens de communication défigurent et distordent tous les signes politiques, leur font perdre toutes proportions. De ce fait, quelque chose que nous allons considérer comme hypermoderne doit simultanément être considéré comme ‘hyperréel’ ou ‘surréel’ ; c’est donc un fait gonflé par une prolifération indéfinie de mini-discours ; des mémoires historiques et tribales travesties en panégyriques aux commémorations de masses honorant les morts de la guerre. De nouveaux signes et logos émergent, représentant la nature diversifiée du système mondial américanisé. Lipovetsky note que « très bientôt, il n’y aura plus aucune activité particulière, plus aucun objet, plus aucun lieu qui n’aura pas l’honneur d’un musée institué. Depuis le musée de la crêpe jusqu’à celui des sardines, depuis le musée d’Elvis Presley jusqu’à celui des Beatles » (2). Dans la postmodernité multiculturelle, tout est objet de souvenir surréel et aucune tribu, aucun style de vie ne doit se voir exclu du circuit. Les Juifs se sont déjà taillé une position privilégiée dans le jeu global des cultes de la mémoire ; maintenant, c’est au tour d’une myriade d’autres tribus, de styles de vie ou de divers groupes marginaux cherchant à recevoir leur part du gâteau de la mémoire globale.
Obsession de la « race »
Officiellement, dans l’Amérique multiculturelle, il n’y a ni races ni différences raciales. Mais les quotas de discrimination positive (« affirmative action ») et l’épouvantail du racisme ramènent sans cesse le terme ‘race’ à l’avant-plan. Cette attitude qui se voit rejetée, de manière récurrente, par l’établissement postmoderne américain, est, de fait, une obsession ressassée à l’infini. Les minorités raciales réclament plus de droits égaux et se font les avocates de la diversité sociale ; mais dans les termes mêmes de leurs requêtes, elles n’hésitent jamais à mettre en exergue leur propre ‘altérité’ et le caractère unique de leur propre race. Si leurs requêtes ne sont suivies d’aucun effet, les autorités courent le risque de se faire accuser d’ ‘insensibilité’. De ce fait, pourquoi n’utiliserait-on pas, dès maintenant, les termes d’Hyper-Amérique hyperraciale ? Ce qui importe, ici, c’est que le lecteur saisisse ces termes dans leur sens aléatoire car la postmodernité, selon les circonstances, peut se donner des significations contradictoires.
L’Amérique est un pays aussi moderne qu’il a voulu l’être. La modernité et la religion du progrès font partie du processus historique qui l’a créé. En même temps, toutefois, les éléments méta-statiques de la postmodernité, en particulier l’ ‘overkill’, les tueries excessives, que l’on voit à satiété dans les médias, sont désormais visibles partout. La postmodernité a ses pièges. Afin de les éviter, ses porte-paroles font usage d’approches particulières du discours moderne en recourant à des qualifiants apolitiques et moins connotés. Dans le monde postmoderne, écrit Lipovetsky, « on note la prédominance de la sphère individuelle sur la sphère universelle, du psychologique sur l’idéologique, de la communication sur la politisation, de la diversité sur l’homogénéité, de la permissivité sur la coercition » (3). De même, certaines questions sociales et politiques apparaissent désormais sous les feux de rampe alors qu’elles étaient totalement ignorées et inédites au cours des dernières décennies du 20ème siècle. L’éventuelle impuissance sexuelle d’un candidat à la présidence est désormais considérée comme une événement politique de premier plan —souvent plus que sa manière de traiter un thème important de la criminalité publique. La mort d’un enfant en bas âge dans une Afrique ravagée par les guerres en vient à être considérée comme une affaire nationale urgente. Même le supporter le plus ardent du multiculturalisme aurait eu grand peine à imaginer, jadis, les changements phénoménaux qui se sont opérés dans le discours pan-racialiste des élites américaines. Même le progressiste américain le plus optimiste de jadis, avocat de la consommation à outrance, n’aurait jamais imaginé une telle exhibition colossale de permissivité langagière ni l’explosion de millions de signes de séduction sexuelle. Tout chose se mue en sa forme plus « soft » que suggère la nouvelle idéologie ; depuis l’idéologie du sexe jusqu’à la nouvelle religion du football en passant par la croisade idéologique contre le terrorisme réel ou imaginaire.
Transformations sémantiques
La culture de masse à l’âge de la néo-postmodernité, comme l’écrit Ruby, facilite le développement d’un individualisme extrême, au point où la plus petite parcelle d’une existence humaine doit dorénavant être perçue comme une commodité périssable ou hygiénique. « La personnalité de quelqu’un est jugée d’après la blancheur de ses incisives, d’après l’absence de la moindre gouttelette de sueur aux aisselles, de même d’après l’absence totale d’émotion » (4). La culture des mots en langue anglaise a, elle aussi, été sujette à des transformations sémantiques. Actuellement, ces mots transformés existent pour désigner des styles de vie différents et n’ont plus rien en commun avec leur signification d’origine. C’est pourquoi on pourrait tout aussi bien appeler l’Amérique postmoderne « Amérique hypermoderne », désignation qui suggère que, dans les années à venir, il y aura encore plus d’hyper-narrations tournant autour de l’hyper-Amérique et du monde « hyper-américanisé ».
Et qu’est-ce qui viendra après la postmodernité ? « Tout apparaît », écrit Lipovetsky, « comme si nous étions passés d’un âge ‘post’ à un âge ‘hyper’ ; une nouvelle société faite de modernité refait surface. On ne cherche plus à quitter le monde de la tradition pour accéder à la modernité rationnelle mais à moderniser la modernité, à rationaliser la rationalisation » (5). Nous avons donc affaire à la tentative d’ajouter toujours du progrès, toujours de la croissance économique, toujours des effets télévisés spéciaux pour, imagine-t-on, nourrir l’existence de l’Amérique hyperréelle. Le surplus de symbolisme américain doit continuer à attirer les désillusionnés de toutes races et de tous styles de vie, venus de tous les coins du monde. N’importe quelle image télévisée ou n’importe quelle historiette de théâtre sert désormais de valeur normative pour une émulation quelconque à l’échelle du globe —ce n’est plus le contraire. D’abord, on voit émerger une icône virtuelle américaine, généralement par le truchement d’un film, d’un show télévisé ou d’un jeu électronique ; ensuite, les masses commencent à utiliser ces images pour conforter leur propre réalité locale. C’est la projection médiatique de l’Amérique hyperréelle qui sert dorénavant de meilleure arme propagandiste pour promouvoir le rêve américain. Nous voyons se manifester un exemple typique de l’hyperréalité américaine lorsque la classe politique américaine prétend que toute erreur générée par son univers multiculturel ou tout flop dans son système judiciaire tentaculaire pourrait se réparer en amenant dans le pays encore plus d’immigrants, en cumulant encore davantage de quotas raciaux ou en gauchisant encore plus ses lois déjà gauchistes. En d’autres termes, la hantise d’une balkanisation du pays, qu’elle ressent, elle croit pouvoir s’en guérir en introduisant encore plus de diversité raciale et en amenant encore plus d’immigrants de souche non européenne. De même, les flops du libre marché, de plus en plus visibles partout en Amérique, elle imagine qu’elle leur apportera une solution, non pas en jugulant la concurrence sur le marché, mais en acceptant encore davantage de concurrence grâce à plus de privatisations, en encourageant plus encore la dérégulation économique, etc. Cette caractéristique de l’ ‘overkill’, de la surenchère postmoderne est l’ingrédient constitutif principal de l’idéologie américaine, qui semble avoir trouvé son rythme accéléré au début de l’âge postmoderne. Jamais il ne vient à l’esprit de l’élite américaine que le consensus social dans une Amérique multiraciale ne pourra s’obtenir par décret. Pourtant, si l’on recourrait à des politiques contraires à tous ces efforts hyperréels en lice, cela pourrait signifier la fin de l’Amérique postmoderne.
Tout doit pouvoir s’expliquer selon des formules toute faites
Déjà à la fin du 20ème siècle, l’Amérique a commencé à montrer des signes d’obésité sociale. C’est la nature irrationnelle de la croyance au progrès qui a crû démesurément à la manière des métastases et qui, de ce fait, annonce, le cas échéant, la fin de l’Amérique. Lash notait, il y a déjà pas mal d’années, que tout à la fin du 20ème siècle, les narcisses américains savoureraient les plaisirs sensuels et se vautreraient dans toutes les formes d’auto-gratification. ‘Prendre du plaisir’ est une option qui a toujours fait partie des prescrits de l’idéologie américaine. Cependant le narcisse américain postmoderne à la recherche du plaisir, comme le nomme Lipovetsky, a d’autres soucis actuellement. Son culte du corps et l’amour qu’il porte à lui-même ont conduit à des crises de panique et des anxiétés de masse : « L’obsession à l’égard de soi se manifeste moins dans la joie fébrile que dans la crainte, la maladie, la vieillesse, la ‘médicalisation’ de la vie » (6). Dans l’Amérique hyperrationnelle, tout doit absolument s’expliquer et s’évacuer à l’aide de formules rationnelles, peut importe qu’il s’agisse de l’impuissance sexuelle d’une personne particulière ou de l’impuissance politique du président des Etats-Unis. La nature imprévisible de la vie représente le plus gros danger pour l’homo americanus parce qu’elle ne lui offre pas sur plateau une formule rationnelle pour lui dire comment éviter la mort ; l’imprévisibilité de la vie défie par conséquent la nature intrinsèque de l’américanisme. Tout effraye l’homme américain aujourd’hui : du terrorisme au rabougrissement de son plan retraite ; de l’immigration de masse incontrôlée à la perte probable de son emploi. Ce serait gaspiller du temps de dénombrer et de chiffrer les maux sociaux américains en ce début de troisième millénaire : songeons à la pédophilie, à la toxicomanie, à la criminalité violente, etc. Le nombre de ces anomalies croîtra de manière exponentielle si la marche en avant du progressisme postmoderne américain se poursuit.
Tout est copie grotesque de la réalité
Chaque postmoderne utilise un méta-langage qui lui est propre et donne sa propre interprétation aux significations de l’histoire. Si nous acceptons la définition de la postmodernité que nous livre le théoricien français Jean Baudrillard, alors tout dans l’Amérique postmoderne est une copie grotesque de la réalité. L’Amérique aurait donc fonctionné depuis 1945 comme un gigantesque photocopieur xérographique, produisant une méta-réalité, qui correspond non pas à l’Amérique telle qu’elle est mais à l’Amérique telle qu’elle devrait être pour le bénéfice du globe tout entier. La seule différence est la suivante : à l’aube du 21ème siècle, le rythme doux et allègre de l’histoire de jadis s’est modifié continuellement, s’est mis à s’accélérer pour passer à la cinquième vitesse. Les événements se déroulent à la vitesse d’une bobine de film, comme détachés de toute séquence historique réelle, et s’accumulent inlassablement jusqu’à provoquer un véritable chaos. Selon Baudrillard, qui est à coup sûr l’un des meilleurs observateurs européens de l’américanisme, l’hyperréalité de l’Amérique a dévoré la réalité de l’Amérique. C’est pourquoi une question doit être posée : pour parachever le rêve américain, les Américains du présent et de l’avenir ne sont-ils pas sensés vivre dans un monde de rêve projeté ? L’Amérique ne se mue-t-elle pas dans ce cas en une sorte de « temps anticipatif » (« a pretense »), en une sorte de fiction, de métaréalité ? L’Amérique a-t-elle dès lors une substance, étant donné que l’américanisme, du moins aux yeux de ses imitateurs non américains, fonctionne seulement comme un système à faire croire, c’est-à-dire comme une « hypercopie » de son soi propre, toujours projeté et embelli ? Dans le monde virtuel et postmoderne d’internet et de l’informatique, toute mise en scène d’événements réels en Amérique procède toujours déjà d’un modèle de remise en scène antérieur et prêt à l’emploi, sensé servir d’instrument pédagogique pour différents projets contingents. Par exemple, les élites militaires américaines disposent de toutes sortes de formules possibles pour tous cas d’urgence qui surviendrait, en n’importe quel endroit du monde. On peut dès lors parier en toute quiétude qu’un scénario, selon l’une ou l’autre de ces nombreuses formules, pourra aisément correspondre à un événement réel sur le terrain. En bref, raisonne Baudrillard, dans un pays constitué de millions d’événements « fractaux », bien que surreprésentés et rejoués à satiété comme ils le sont, tout se mue en un non événement. La postmodernité rend triviales toutes les valeurs, même celles qu’elle devrait honorer pour sa propre survie politique !
De nouvelles demandes sociales émergent sans fin
L’Amérique et sa classe dirigeante pourraient peut-être un jour disparaître, ou, même, l’Amérique pourrait se fractionner en entités étatiques américaines de plus petites dimensions ; dans l’un ou l’autre de ces cas, l’hyperréalité américaine, cependant, continuera à séduire les masses partout dans le monde. L’Amérique postmoderne doit demeurer le pays de la séduction, même si cette séduction fonctionne davantage auprès des masses non européennes et moins auprès des Américains de souche européenne qui, en privé, rêvent de se porter vers d’autres Amériques, non encore découvertes. Dans un pays comme l’Amérique, écrit Baudrillard, « où l’énergie de la scène publique, c’est-à-dire l’énergie qui crée les mythes sociaux et les dogmes, est en train de disparaître graduellement, l’arène sociale devient obèse et monstrueuse ; elle se dilate comme un corps mammaire ou glandulaire. Jadis, cette scène publique s’illustrait par ses héros, aujourd’hui elle s’indexe sur ses handicapés, ses tarés, ses dégénérés, ses asociaux —tout cela dans un gigantesque effort de maternage thérapeutique » (7). Les marginalisés de la société et les marginaux tout court sont devenus des modèles, qui ont un rôle à jouer dans la postmodernité américaine. La « vérité politique » est d’ores et déjà devenue une thématique de la scène privée et émotionnelle, dans le sens où le membre d’une secte religieuse ou le porte-paroles d’un quelconque « lifestyle » (mode de vie) peut émettre sans frein ses jugements politiques nébuleux. Un toqué bénéficie d’autant de liberté de beugler publiquement ses opinions politiques que le professeur d’université. Il arrive qu’un serial killer devienne une superstar de la télévision, aussi bien avant qu’après ses bacchanales criminelles. En fait, comme la quête de diversité ne cesse de s’élargir, de nouveaux groupes sociaux, et, avec eux, de nouvelles demandes sociales émergent sans fin. Le stade thérapeutique de la post-Amérique, comme l’appelle Gottfried, est le système idéal pour étudier tous les comportements pathologiques.
En ces débuts du 21ème siècle, les postmodernistes aiment exhorter tout un chacun à remettre en question tous les paradigmes et tous les mythes politiques, mais, en même temps, ils adorent chérir leurs propres petites vérités étriquées ; notamment celles qui concerne l’une ou l’autre « vérité » de nature ethnique ou relevant des fameux « genders ». Ils continuent à se faire les avocats des programmes d’ « affirmative action » (= de « discrimination positive »), destinés à « visibiliser » les modes de vie non européens et à valoriser les narrations autres, généralement hostiles aux Blancs. Le terme « diversité » est devenu le mot magique des postmodernistes : c’est une diversité basée sur une légitimation négative, dans le sens où elle rejette toute diversité d’origine européenne en mettant l’accent sur la nature soi-disant mauvaise de l’interprétation que donne l’homme blanc de l’histoire.
Les narrations postmodernes ne peuvent être soumises à critique
Bien que la plupart des postmodernistes tentent de déconstruire la modernité en utilisant l’œuvre de Frédéric Nietzsche et en s’en servant de fil d’Ariane, ils persistent à soutenir leurs propres ordres du jour, micro-idéologiques et infra-politiques, basés sur la valorisation d’autres races et de modes de vie différents. Ce faisant, ils rejettent toute autre interprétation de la réalité, surtout les interprétations qui heurtent de front le mythe omniprésent de l’américanisme. L’approche intellectuelle sous-tendant leurs micro-vérités ou leurs micro-mythes ne peut être soumise à critique, en aucun circonstance. Leurs narrations demeurent les fondements sacro-saints de leur postmodernité. Pour l’essentiel, la narration de chaque tribu ou de chaque groupe apparaît comme un gros mensonge commis sur le mode horizontal, ce qui a pour effet que chacun de ces mensonges élimine la virulence d’un autre mensonge concurrent. Le protagoniste d’un mode de vie quelconque et bizarre, présent sur la scène américaine, sait pertinemment bien que sa narration relève de la fausse monnaie ; mais il doit faire semblant de raconter la vérité. Finalement, et dans le fond, le discours de la postmodernité est un grand discours de méta-mensonge, de méta-tromperie.
Si vous adoptez la logique de la postmodernité permissive et la micro-narration hyperréelle d’un zélote religieux ou d’un quelconque tribal de la planète postmoderne, indépendamment du fait qu’il souhaite ou non devenir l’hôte d’un talk show télévisé, ou devenir une star du porno, ou le porte-paroles imaginaire d’une guérilla, alors vous devez implicitement accepter également l’idée d’un « post-démocratie », d’un « post-libéralisme », d’une ère « post-holocaustique » et d’une « post-humanité » dans une post-Amérique. Comme toutes les grandes narrations de la modernité mourante peuvent être remises en question en toute liberté, on peut trouver plein de bonnes raisons pour remettre en question et pour envoyer aux orties la grande narration qui se trouve à la base de la démocratie américaine. En utilisant le même tour de passe-passe, on pourrait remettre au goût du jour en Amérique des penseurs, des auteurs et des hommes de science qui, depuis la fin de ce Sud antérieur à la guerre civile ou, plus nettement encore, depuis la fin de la seconde guerre mondiale en Europe, ont été houspillés dans l’oubli ou ont été dénoncés comme « racistes », bigots ou « fascistes » ou ont reçu l’un ou l’autre nom d’oiseau issu de la faune innombrable de tous ceux que l’on a campés comme exclus. Les auteurs postmodernes évitent toutefois avec prudence les thèmes qui ont été dûment tabouisés. Ils se rendent compte que dans la « société la plus libre qui soit », les mythes antifascistes et anti-antisémites doivent continuer à prospérer.
Tomislav SUNIC.
(extrait du livre « Homo Americanus – Child of the Postmodern Age », publié à compte d’auteur, 2007, ISBN 1-4196-5984-7, pp. 146 à 156 ; trad. franc. : Robert Steuckers).
Notes :
(1) Régis DEBRAY, Cours de médiologie générale, Gallimard, 1991, p. 303.
(2) Gilles LIPOVETSKY/Sébastien CHARLES, Les temps hypermodernes, Grasset, 2004, p. 124.
(3) Gilles LIPOVETSKY, L’ère du vide, Gallimard, 1983.
(4) Christian RUBY, Le champ de bataille postmoderne, néo-moderne, L’Harmattan, 1990.
(5) Gilles LIPOVETSKY/Sébastien CHARLES, Les temps hypermodernes, Grasset, 2004, p. 78.
(6) Ibidem, p. 37.
(7) Jean BAUDRILLARD, Les stratégies fatales, Grasset, 1983, p. 79.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, amérique, philosophie, sociologie, médias, médiacratie, manipulation, hyperréalité, baudrillard, lipovetsky |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Contre le capitalisme: du terrorisme rouge à d'Annunzio
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Contre le capitalisme: du terrorisme rouge à d'Annunzio
Entretien avec Enrico Galmozzi
 Enrico Galmozzi est l'un des fondateurs du mouvement d'extrême-gauche “Prima Linea” (= Première Ligne), et aussi l'une des principales victimes des “années de plomb” en Italie. Son engagement lui a coûté treize années de prison. Dans les geôles de l'Etat italien, il a étudié la sociologie et obtenu son doctorat. Aujourd'hui, la passion du politique continue à l'animer, ce qui l'amène à une intense activité intellectuelle et à dépasser les limites de l'idéologie à laquelle il a spontanément adhérer dans ses plus jeunes années: il fréquente désormais des auteurs inhabituels pour un ancien “communiste combattant”. En effet, Enrico Galmozzi vient de publier un essai sur Gabriele d'Annunzio, Il soggetto senza limite, auprès de la Società Editrice Barbarossa à Milan en 1994. Ensuite, il a dirigé le dossier Pareto de la revue Origini, éditée par Synergies Européennes en Italie. Ce passage de l'extrême-gauche au dannunzisme réputé d'extrême-droite est effectivement une curiosité. C'est pourquoi nous sommes allés nous entretenir avec Enrico Galmozzi.
Enrico Galmozzi est l'un des fondateurs du mouvement d'extrême-gauche “Prima Linea” (= Première Ligne), et aussi l'une des principales victimes des “années de plomb” en Italie. Son engagement lui a coûté treize années de prison. Dans les geôles de l'Etat italien, il a étudié la sociologie et obtenu son doctorat. Aujourd'hui, la passion du politique continue à l'animer, ce qui l'amène à une intense activité intellectuelle et à dépasser les limites de l'idéologie à laquelle il a spontanément adhérer dans ses plus jeunes années: il fréquente désormais des auteurs inhabituels pour un ancien “communiste combattant”. En effet, Enrico Galmozzi vient de publier un essai sur Gabriele d'Annunzio, Il soggetto senza limite, auprès de la Società Editrice Barbarossa à Milan en 1994. Ensuite, il a dirigé le dossier Pareto de la revue Origini, éditée par Synergies Européennes en Italie. Ce passage de l'extrême-gauche au dannunzisme réputé d'extrême-droite est effectivement une curiosité. C'est pourquoi nous sommes allés nous entretenir avec Enrico Galmozzi.
Comment peut-on se rapprocher à ce point de Gabriele d'Annunzio quand on a une base idéologique marxiste-léniniste?
La majorité de mes contemporains qui sont devenus communistes ont été mus par deux options essentiellement: la critique du capitalisme, comme modèle économique fondé sur l'exploitation mais aussi comme modèle culturel, c'est-à-dire comme consumérisme exaspéré. C'est ce consumérisme que combattait le mouvement de 68. Ensuite, deuxième motif: notre aversion profonde à l'égard des Etats-Unis. L'impérialisme américain, nous le percevions comme la représentation emblématique de ce modèle économique et culturel, mais aussi comme le gendarme de la planète, le garant de ce modèle et le véhicule de sa pénétration dans tous les pays du monde. L'effondrement des pays où dominait le socialisme réel et la crise du marxisme en Occident ont conditionné l'abandon de toutes ces problématiques qui furent les nôtres. Aujourd'hui, la gauche, notamment en Italie, ne représente plus qu'une option réformiste parfaitement compatible avec le modèle capitaliste. Veltroni est le plus philo-américain de tous nos politiciens. Tous ceux qui veulent continuer à refuser absolument le capitalisme comme modèle culturel américanomorphe se trouvent aujourd'hui face à un problème de références et de paradigmes: il faut revoir les théorèmes et les éléments traditionnels de la gauche. En récapitulant toute ma propre pensée, j'en viens à croire que le marxisme n'a jamais représenté une alternative authentique et vraiment radicale (qui va aux racines des choses) au positivisme et aux Lumières qui sont les prémisses théoriques et idéologiques de la bourgeoisie.
En fait, dans votre livre, vous procédez à une critique incessante du matérialisme marxiste, tout en faisant l'éloge des dimensions héroïques et vitalistes présentes chez d'Annunzio, que vous percevez comme un chef charismatique “qui affirme et choisit la vie” quand il passe de l'extrême-droite à l'extrême-gauche. Dans un passage de votre livre, vous soulignez explicitement une apologie de la guerre qui rappelle certains accents de la “Révolution Conservatrice” allemande, plus spécialement le “nationalisme soldatique”...
Quand il devient impossible de comprendre la réalité et de la changer avec les instruments qu'on a toujours employés, il faut procéder à une introspection. D'abord, premier constat, la gauche n'est pas la seule à avoir été inadéquate dans ses réalisations pratiques. Nous devons passer en revue toute l'histoire du XIXième siècle afin de réexaminer critiquement et transversalement tous les territoires idéologiques sans aucun schématisme, sans manichéisme et sans passéisme idéologique. Par exemple, nous devons admettre, à gauche, que la “droite radicale” n'a jamais produit une critique scientifique du capitalisme et qu'elle s'est toujours mobilisée sur base de catégories morales, sans réussir à dégager véritablement une vision scientifique de la société...
Mais Werner Sombart, lui, a développé une analyse fondamentalement scientifique de l'évolution du capitalisme en Europe, certes sur base d'un héritage résolument marxiste, mais en débouchant finalement sur une noologie qui n'a rien de matérialiste et qui n'est de ce fait pas attribuable à la “gauche”...
 C'est vrai, mais Sombart est bien le seul. Au fond, c'est Evola qui devrait faire son auto-critique car il a mené le discours de la droite radicale dans une optique plus morale et plus spirituelle que scientifique. Par ailleurs, on ne peut plus prendre l'analyse économique du marxisme telle qu'elle a été; on ne peut plus reprendre tel quel son déterminisme économique, où il n'y a pas de place pour d'autres valeurs en dehors de celles qui sont exclusivement relatives à l'économie. Voilà pourquoi il est utile de procéder à cette analyse critique transversale dont je viens de vous parler. Il y a des périodes et des moments historiques qui doivent être complètement réévalués et revus car, jusqu'à nos jours, la critique dominante et surtout la critique de gauche n'ont montré que leur myopie et leur caractère manipulatoire. Par exemple, à Fiume, le subjectivisme volontariste de d'Annunzio convenait parfaitement aux sensibilités et aux revendications sociales émanant des syndicalistes révolutionnaires, en particulier de De Ambris. Cela les a conduit à rédiger une constitution comme la Carta del Carnaro, qui est absolument exemplaire. L'interventionnisme italien pendant la première guerre mondiale est également un phénomène sur lequel il faudra jetter un regard nouveau parce qu'il a été un mouvement absolument transversal qui est passé à travers toutes les formations politiques et qui est très riche en motivations de toutes provenances: du centre, de la droite et de la gauche, des milieux impérialistes et nationalistes comme des milieux socialistes et révolutionnaires. C'est le même cocktail d'éléments que l'on retrouvera quelques années plus tard dans l'arditisme et dans l'organisation des Fasci jusqu'au second congrès.
C'est vrai, mais Sombart est bien le seul. Au fond, c'est Evola qui devrait faire son auto-critique car il a mené le discours de la droite radicale dans une optique plus morale et plus spirituelle que scientifique. Par ailleurs, on ne peut plus prendre l'analyse économique du marxisme telle qu'elle a été; on ne peut plus reprendre tel quel son déterminisme économique, où il n'y a pas de place pour d'autres valeurs en dehors de celles qui sont exclusivement relatives à l'économie. Voilà pourquoi il est utile de procéder à cette analyse critique transversale dont je viens de vous parler. Il y a des périodes et des moments historiques qui doivent être complètement réévalués et revus car, jusqu'à nos jours, la critique dominante et surtout la critique de gauche n'ont montré que leur myopie et leur caractère manipulatoire. Par exemple, à Fiume, le subjectivisme volontariste de d'Annunzio convenait parfaitement aux sensibilités et aux revendications sociales émanant des syndicalistes révolutionnaires, en particulier de De Ambris. Cela les a conduit à rédiger une constitution comme la Carta del Carnaro, qui est absolument exemplaire. L'interventionnisme italien pendant la première guerre mondiale est également un phénomène sur lequel il faudra jetter un regard nouveau parce qu'il a été un mouvement absolument transversal qui est passé à travers toutes les formations politiques et qui est très riche en motivations de toutes provenances: du centre, de la droite et de la gauche, des milieux impérialistes et nationalistes comme des milieux socialistes et révolutionnaires. C'est le même cocktail d'éléments que l'on retrouvera quelques années plus tard dans l'arditisme et dans l'organisation des Fasci jusqu'au second congrès.
Dans votre livre, vous n'avez guère mis en exergue le concept de nation qui fut pourtant le mythe qui unifia tous ces courants hétérogènes...
La réalité est un petit peu plus complexe, mais si ce que vous dites est vrai: c'est sûr, un des aspects les plus obsolètes de la pensée de Marx, c'est la thèse que “le prolétariat n'a pas de nation”. Le prolétariat appartient toujours à une nation, comme l'histoire l'a démontré. L'une des principales limites du marxisme est de n'offrir au prolétariat qu'un seul type abstrait d'identité, calque du processus de production capitaliste, c'est-à-dire une identité générale qui le pose définitivement comme travailleur, alors qu'en réalité personne n'est seulement travailleur. Tout prolétaire, en tant que personne, possède une identité intime beaucoup plus profonde qui plonge dans les legs de la tradition que véhicule chaque homme, dans la mémoire spécifique, dans une histoire particulière: autant de rapports complexes qui constituent une existentialité humaine et dont l'anthropologie marxiste n'a pas tenu compte. Ensuite, on peut aisément constater que ni l'interventionnisme de d'Annunzio ni celui de Marinetti se limitent au concept de “nation”. Ils souhaitent tous deux l'intervention parce qu'ils ont un projet de civilisation, un projet culturel qui s'inscrira dans un espace européen.
Autre aspect important de votre livre: vous accordez une très grande importance au culte des morts —d'aucuns prétendront que c'est typique d'une “tradition fasciste”— et vous insistez tout particulièrement sur le serment des Arditi qui jurent de combattre au nom de leurs camarades tombés au combat.
Au sein de la gauche, on trouve également une tradition “hérétique” représentée par Ernst Bloch, où ce culte des morts est également fondamental. Bloch nous parle d'un processus révolutionnaire qui est pure continuité depuis les guerres paysannes dans l'Allemagne du XVIième siècle, depuis Thomas Müntzer. Cette continuité est un puissant filon de mysticisme où les révolutionnaires communient et participent à une cause commune, qui a des assises spirituelles. Dans le marxisme classique, au contraire, nous débouchons rapidement dans le cursus théorique sur un point de non retour et nous basculons dans l'ultra-rationalisme, où plus aucune valeur n'a droit de cité, où tout réflexe irrationnel est banni et éradiqué. Alors que le communisme, au fond, n'est jamais qu'une étape dans un processus qui a commencé avec les gnoses et les mouvements utopistes, puis a passé par le filtre des sectes hérétiques, pour aboutir, en fin de course, dans la Première Internationale, où Marx a viré les blanquistes et les anarchistes. En imposant le déterminisme économique, Marx a jeté par dessus bord le culte des morts et celui du passé, sous prétexte que tout cela était “condamné par l'Histoire”.
Vous faites carrément l'éloge de la Carta del Carnaro. Et vous dites qu'elle est “embarrassante pour la droite et pour la gauche” et qu'elle ne pourra jamais plus se répéter. Que voulez-vous dire?
Je l'ai dit, effectivement. Et j'espère que je me trompe, parce que ce document contient des intuitions très en avance sur leur temps, des aspects qui sont encore parfaitement actuels, comme la définition qu'elle donne des rapports entre l'Etat et la société et l'Etat et le monde du travail. Le corporatisme que développe la Carta del Carnaro est très différent de celui qu'a proposé le fascisme —sauf celui de la dernière période, de la République Sociale Italienne. Dans la Carta, les corporations sont des articulations de l'Etat dans la société civile. Elles sont des institutions qui travaillent sans cesse pour qu'advienne l'extinction même de l'Etat. L'Etat, dans cette Charte de Fiume, doit être dépassé, il faut mobiliser les efforts des meilleurs voire de tous pour qu'il laisse le champ libre aux organisations communautaires spontanées. Cette charte présente ces intentions avec une pléthore de références historiques et culturelles surprenante, en rappelant les structures de fonctionnement des communes médiévales et l'organisation des Soviets. La conception du travail chez d'Annunzio et De Ambris est très en avance sur son temps, car ils ne conçoivent pas le travail seulement comme travail manuel et productif mais aussi comme travail intellectuel, artistique et artisanal, ce qu'il s'agit pour eux de valoriser et de sauvegarder face aux productions sérielles. Ils perçoivent enfin le peuple dans son intégrité et non pas au sens classiste, comme l'ont toujours fait les marxistes.
Plus récemment vous vous êtes penché sur l'œuvre de l'économiste et sociologue italien Vilfredo Pareto. Comment avez-vous découvert son œuvre? Comment êtes-vous arrivé à lui?
Pareto, Mosca et Michels sont des figures de format international. Ils constituent à eux trois l'unique école sociologique italienne et, bien évidemment, elle est méconnue chez nous! Pareto est au fond une figure scandaleuse qui examine —comme Machiavel— méticuleusement et jusqu'au tréfond des choses les mécanismes de la politique. En étudiant son œuvre, j'ai trouvé que ce qu'il nous démontrait gardait une incroyable actualité: il a prévu beaucoup d'éléments de la théorie de la communication, il en a dévoilé les mécanismes conscients et inconscients. Dans ses rapports avec le marxisme, enfin, il refuse le déterminisme historique mais il récupère la lutte des classes, en l'expliquant et en la faisant fonctionner mieux que ne le firent jamais les marxistes: c'est sa fameuse théorie de la circulation des élites.
En tant qu'intellectuel, comme voyez-vous l'avenir?
Je suis optimiste, j'espère que les nouvelles générations pourront enfin mettre au rencart les idéologies dépassées et rechercheront de nouvelles synthèses et ouvriront de nouvelles possibilités.
(propos recueillis par Pietro Negri et parus dans la revue romaine Pagine Libere, septembre 1995).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, années 70, italie, terrorisme, prima linea, idéologie, extrême gauche, gauche, gauchisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook