"Un vent glacial souffle sur le libre-échange", s'inquiète la RTS. Bigre! Le commerce mondial s'est-il effondré? Les marchandises pourrissent-elles au soleil face à des douaniers intraitables? Les commandes par Internet ne passent plus? Les gens sont-ils cloisonnés dans des frontières nationales devenues hermétiques à toute circulation de personnes?
Nous n'en sommes pas là. Un rapide souvenir de la douane de Bardonnex - guère plus qu'un dos d'âne à l'heure actuelle - permet de dissiper le cauchemar. Mais le libre-échange affronte bel et bien des vents contraires, comme s'en émeut ensuite Charles Wyplosz dans une longue interview consécutive au sujet.
L'accélération du monde
Mais le débat est piégé. Même le terme de libre-échange est galvaudé. Initialement, il représentait la libre circulation des marchandises, c'est-à-dire le commerce transfrontalier. Sur cette base historique légitime et paisible du commerce entre sociétés humaines, les apôtres de la disparition des états-nations l'ont étendu à celle des capitaux, des services, des personnes. À une échelle quasiment atomique, tout est devenu équivalent à tout et réciproquement. La rentabilité horaire de l'ouvrier qualifié, qu'il s'éreinte en Inde ou au Brésil. Le prix livré de la tonne d'acier, coulée en France ou en Chine. Le rendement d'un placement dans une compagnie américaine ou japonaise.
Certains se savent hors-course et en conçoivent de l'amertume. D'autres se réjouissent d'être les vainqueurs d'aujourd'hui tout en s'inquiétant de le rester demain. La migration des affaires est source d'incertitude. Entre deux crises financières la turbine économique tourne en surrégime, créant autant de vagues de protestation dans son sillage. Les médias s'attardent avec complaisance sur les groupuscules de casseurs communistes en maraude dans les centres-villes, mais les perdants de la mondialisation sont ailleurs, et bien réels. Les paysans au mode de vie ancestral, les salariés sans qualification, les entrepreneurs prisonniers de législations absurdes ou de la corruption des autorités, les working poors écrasés par l'effet des taxes sur le coût de la vie. Ils ne font pas la une des journaux. Les rares fois où ils sont évoqués, c'est pour donner la parole aux politiciens responsables de leur malheur.
Au capitalisme apatride et fier de l'être s'oppose un courant conservateur rejetant la réduction de l'homme à un agent économique. L'homme n'est pas aussi volage que le capital qui l'emploie ni les produits qu'il conçoit. Il s'inscrit dans une culture, une famille, un héritage, des valeurs. Il ne les sacrifie que rarement au nom de sa prospérité matérielle.
Les libéraux désarmés
Cet aspect du débat sème le trouble au sein des libéraux. Ils ratent le sujet en ne se concentrant trop souvent que sur sa seule dimension économique. Or, chacun n'a pas les ressources, la volonté ou même l'ouverture d'esprit pour se conformer à la nouvelle donne - et encore moins celles de changer son propre pays ou de le quitter. Comme le dit un sage, "Si vous vous affairez à calmer les plaintes d'un affamé en lui expliquant le recul de la faim dans le monde, vous réussirez juste à le rendre furieux."
Les théoriciens libéraux du passé ont apporté des solutions économiques à un monde dans lequel ces problèmes ne se posaient pas. Les délocalisations brutales, les revendications communautaristes, l'assaut migratoire sur les systèmes sociaux n'existaient pas à l'époque de Frédéric Bastiat. Ils sont absents de ses raisonnements élégants mais bien présents de nos jours.
Les libéraux se retrouvent privés d'arguments, ne sachant souvent articuler que des réponses économiques à des problèmes sociaux. Les postulats de base de l'humain libéral doué de raison sont battus en brèche par l'obscurantisme, le prosélytisme, le communautarisme. Face à ces comportements, les libéraux se contentent souvent de prôner la tolérance la plus absolue en fermant les yeux sur l'usage qui en est fait pour détruire la société hôte. Comment s'étonner que le libéralisme perde en influence?
Le protectionnisme, ce vieux compagnon de route
L'inanité économique du protectionnisme a été maintes fois démontrée, il faut le répéter. L'explication est fort simple: les taxes ne sont jamais payées par les producteurs mais in fine par les consommateurs locaux. Les prix surfaits dont ils s'acquittent les prive d'argent pour d'autres activités, d'autres consommations. Les habitants "protégés" par le protectionnisme s'appauvrissent.
En revanche, et c'est aussi avéré, le protectionnisme permet la survie d'entreprises locales qui ne seraient pas économiquement rentables sinon, et avec elles les emplois et les impôts que payent leurs salariés au lieu de les faire pointer au chômage.
Le score entre libre-échange et protectionnisme n'est donc pas si net qu'il y paraît. De nombreux pays comme la Suisse ou le Japon ont d'ailleurs atteint de hauts niveaux de prospérité tout en étant très protectionnistes sur de nombreuses catégories de marchandises, comme les produits alimentaires.
Bien qu'on annonce aujourd'hui son retour, le protectionnisme n'est jamais vraiment parti de nos contrées ; sous les assauts de l'OMC, il s'est déguisé en "normes de qualité" et autres certifications nécessaires à l'importation, l'objectif étant toujours de barrer la route aux produits fabriqués à l'étranger. Dans les mœurs, il est resté fortement ancré sous le prétexte de "consommer local" et "de saison", peu importe la compétitivité des denrées étrangères sur les étals. Même des gouvernements modernes se sont lancés sans vergogne dans le "patriotisme économique".
Les autres aspects du libre-échange moderne ne sont pas en reste: les populations sont violemment hostiles à la concurrence transfrontalière des services. Diverses affaires d'imposition impliquant de grandes entreprises ont éclairé sous un jour négatif l'optimisation fiscale, pour légale soit-elle. Enfin, la crise migratoire européenne a détruit pour de bon toute illusion d'une prospérité basée sur une immigration incontrôlée, au point que plus personne de sérieux n'ose la plaider. Il y a effectivement un mouvement de balancier.
Retour sous les projecteurs
Aujourd'hui, l'élection d'un candidat ouvertement protectionniste comme Donald Trump à la tête d'un pays comme les États-Unis libère aussi la parole sur cet aspect: le bon vieux protectionnisme ressort du bois. Est-ce une mauvaise chose? "Oui", crieront en chœur tous les libéraux. Mais la réponse ne jaillit-elle pas un peu trop vite?
Posons le problème. On le sait, à niveau de prélèvement égal, certains impôts sont plus destructeurs que d'autres, plus nuisibles à l'activité économique en quelque sorte. Qu'en est-il du protectionnisme? Après tout, en quoi un milliard soutiré aux consommateurs à travers des taxes douanières serait pire, ou meilleur, qu'un milliard soutiré aux consommateurs à travers la TVA? L'impôt sur le revenu? Les droits de succession?
Si on élimine le sophisme de base qui a tant servi le protectionnisme en acceptant de l'appeler pour ce qu'il est - un impôt - en quoi ce prélèvement serait-il plus grave que n'importe laquelle des myriades de taxes directes et indirectes que les consommateurs sont appelés à payer dès qu'ils achètent quelque chose? Voilà un thème de recherche passionnant, et bien peu défriché.
Aux États-Unis, Donald Trump promet de baisser les impôts des personnes physiques et morales mais aussi sans doute d'instaurer des taxes d'importation. La combinaison de ces deux changements pourrait durablement changer la physionomie de l'économie américaine sans modifier fondamentalement le niveau des recettes de l'État. L'expérience revêt donc un intérêt colossal pour le monde entier. Son slogan de campagne Make America Great Again dépendra largement de la réussite ou de l'échec de cette réforme fiscale.
Stéphane Montabert - Sur le Web et sur Lesobservateurs.ch, le 10 janvier 2017






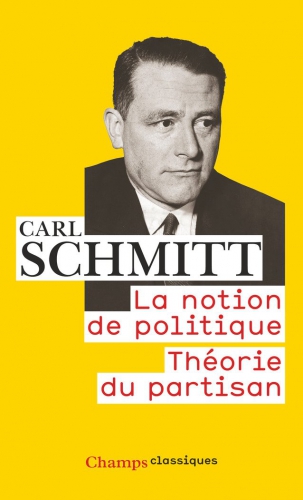 Cette citation brille par son actualité. Face à l’invasion migratoire et à la place de plus en plus
Cette citation brille par son actualité. Face à l’invasion migratoire et à la place de plus en plus
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
