mercredi, 08 octobre 2025
La Russie tenait à un fil au-dessus de l’abîme: pourquoi le 7 octobre est-il une fête nationale en Russie?

La Russie tenait à un fil au-dessus de l’abîme: pourquoi le 7 octobre est-il une fête nationale en Russie?
Alexandre Douguine
L’anniversaire de Poutine est une fête nationale, car Poutine lui-même incarne dans notre système politique le princeps. Il existe un concept romain — celui de princeps, du principat. C’est la figure centrale du système politique, intermédiaire entre la république et l’empire. Et Poutine, à cet égard, est un précurseur. Il transforme la république des années 1990 — en voie de désintégration, corrompue, pro-occidentale, privée de souveraineté et en pleine décomposition — en un futur Empire. Et lui-même est comme un pont vers celui-ci.

Autrefois, les empereurs (et même avant, à l’époque de la République romaine) étaient appelés Pontifes (pontifices), c'est-à-dire bâtisseurs de ponts. Plus tard, ce titre a été repris par le pape de Rome, mais à l’origine, il symbolisait le pouvoir sacré. Et Poutine est justement un tel bâtisseur de ponts. Il construit un pont de la république défaillante, chancelante, désintégrée vers un Empire en pleine ascension.

C’est là son rôle fondamental. Il ne tient pas seulement à sa position et à ses fonctions, car il existe différentes personnalités qui, une fois arrivées au sommet du pouvoir, en font des usages très divers. Certains pour le bien, d’autres pour le mal; certains pour la tyrannie et leur propre affirmation, d’autres, à l’inverse, vont trop loin dans la piété, oubliant la nécessité du côté redoutable du pouvoir d’État.
C’est pourquoi les possibilités du Souverain Suprême sont en effet immenses, mais beaucoup dépend de la manière dont l’individu, détenteur du pouvoir suprême, correspond à la nature même de ce pouvoir. Et chez Poutine, c’est précisément en tant qu’homme que cette combinaison s’est révélée extrêmement heureuse, voire salvatrice, déterminante pour notre pays à l’époque où nous vivons.

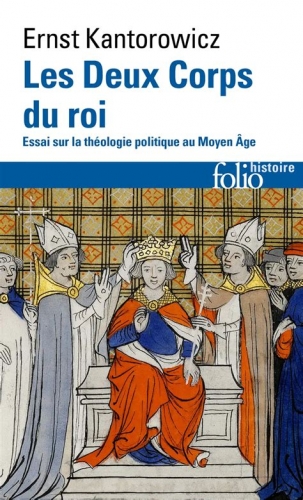
Il existe une tradition de la fin du Moyen Âge et jusqu’à la Réforme, étudiée par Ernst Kantorowicz, historien et philosophe politique remarquable. Il parlait du phénomène des « deux corps du roi ». L’un des corps est le corps individuel, l’autre — sa fonction de princeps, de souverain. Autrement dit, un corps — celui de l’individu, et l’autre — celui de cette fonction sacrée: être à la tête de la société, à la tête du système politique.
Chez Poutine, nous voyons l’harmonie entre ces deux corps: entre l’individualité de Vladimir Vladimirovitch Poutine, avec son parcours et son histoire personnels, et le corps du Souverain Suprême de la Russie à une période critique et décisive. Et selon la façon dont ces deux corps interagissent, il en résulte soit un tournant heureux ou salvateur, soit, au contraire, un échec.
Chez Poutine, nous voyons l’harmonie de ces deux subjectivités: la subjectivité sacrée du principat et le destin personnel, individuel, d’un homme issu des rangs de la sécurité, patriote, serviteur de sa Patrie à quelque poste que ce soit, même le plus modeste.
Poutine est un homme du peuple. Il est arrivé à sa position véritablement à partir des échelons les plus bas, servant la Patrie à chaque étape avec foi et loyauté. Il est un princeps méritocratique, c’est-à-dire ayant accédé au sommet du pouvoir grâce à ses mérites (meritas), et non par une position ou des privilèges initiaux. Il faut aussi en tenir compte.
À cet égard, Poutine, surtout lorsque nous regardons en arrière sur ses 25 années au pouvoir, a opéré un véritable (et souvent invisible) retournement incroyable dans l’histoire russe. Notre pays glissait vers l’abîme. Il est tombé dans l’abîme en 1991 et, en principe, il aurait dû glisser de la dernière falaise, perdre définitivement sa souveraineté, instaurer une gestion extérieure — ce vers quoi menait en fait la politique de l’ère Eltsine.

Et c’est précisément Poutine qui a rattrapé notre pays, suspendu à un dernier fil, encore accroché à la falaise avec le risque imminent de s’écraser au fond du gouffre et de voler en éclats (ce qui était alors une réalité à portée de main), et, grâce à un effort incroyable, mais aussi avec beaucoup de précaution, l’a ramené, du moins, sur cette falaise. Et nous avons commencé à penser comment retrouver notre place dans l’histoire, comment restaurer la plénitude de notre souveraineté, comment faire renaître la Grande Russie que nous semblions avoir définitivement perdue dans les années 1990.
À cet égard, Poutine est bien sûr un homme du destin, un homme marqué par le courant de l’histoire russe, difficile, parfois paradoxale, dont la langue, dont l’idéogramme nous échappent parfois. Nous ne comprenons pas toujours ce qu’elle attend de nous, car elle ne parle pas toujours clairement.
Les grandes actions ne sont pas toujours précédées de grands manifestes. Parfois, l’histoire émet des sons indistincts, et ensuite tout s’épanouit et commence à monter. L’histoire russe est pleine de paradoxes, et dans cette histoire, Poutine et son règne, sans aucun doute déjà maintenant (dès le début, c’était évident), sont placés sous le signe de la lumière.
Dans l’histoire romaine, il y avait une tradition de succession d’empereurs. L’un était mauvais, l’autre bon, puis à nouveau un mauvais, puis à nouveau un bon. Ils formaient une structure presque binaire, 1-0 : empereur réussi, empereur raté. Dans notre histoire, ce n’est pas toujours ainsi, mais il y a des souverains qui, à l’évidence, du point de vue des réalisations historiques, dans la trame, dans le texte de notre histoire, sont inscrits en lettres majuscules, dûment soulignées, en caractères gras. Et ils représentent quelque chose d’important, de bon, de salvateur…
Certains dirigeants étaient cruels, d’autres humains. Poutine lui-même, sans aucun doute, n’est pas cruel, il est humain, mais par la grandeur, il se tient au niveau des plus grandes figures de l’histoire russe. Et le fait qu’il parvienne à accomplir ses exploits incroyablement difficiles pour sauver la Russie en politique intérieure sans effusion de sang, qu’il n’usurpe jamais de pouvoirs supplémentaires, ne les dépasse jamais et, au contraire, se comporte de manière extrêmement humaine, bienveillante et tolérante, même envers ses adversaires idéologiques, cela fait de lui bien sûr une personnalité unique.
Je pense que Poutine construit un pont vers la véritable renaissance spirituelle, sociale et économique de la Russie. Et je félicite sincèrement notre Souverain Suprême, princeps, qui relève la Russie, à l’occasion de sa fête ! À l’Ange — couronne d’or !
15:44 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : alexandre douguine, actualité, vladimir poutine, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Géorgie – La Gaule du Caucase

Géorgie – La Gaule du Caucase
Source: https://www.anonymousnews.org/international/georgien-das-...
Qu'il s'agisse de l'assaut du palais, des barricades enflammées ou des dames âgées distribuant des biscuits, les routines des manifestants sont pratiquement les mêmes, tout comme celles de la police qui y réagit. C'est en Géorgie qu'a débuté en 2003 la première révolution colorée de l'espace post-soviétique – et c'est en ce même pays que cette ère prendra fin.
Par Alexander Nossowitsch
Dès la nuit suivant les élections, on a tenté, comme à l'accoutumée, de prendre d'assaut le palais présidentiel en Géorgie. Par habitude, on a brûlé des pneus et érigé des barricades. Tout aussi routinièrement, la police a éteint les pneus et dispersé les manifestants à l'aide de canons à eau. Tous ces événements ont éclaté au cours du week-end et se sont rapidement apaisés.
Il ne semble pas y avoir de suite au « banquet ». Il aura lieu tout au plus pour les leaders des manifestations, mais pas au sens habituel du terme: ils n'accèderont pas au pouvoir en tant qu'émissaires du « monde libre », mais seront très probablement emprisonnés pour avoir tenté de renverser l'ordre constitutionnel. Ils en ont eux-mêmes pris conscience: ils se renvoient la responsabilité de l'assaut du palais présidentiel et font référence aux mythiques « provocateurs russes ».
Les événements qui se sont déroulés samedi à Tbilissi peuvent être considérés comme une sorte de « post-scriptum » à l'échec de la tentative de « révolution colorée » en Géorgie.
Il y a un an, l'Occident libéral et mondialiste – qui agissait alors encore comme une entité unique – avait déployé des efforts considérables pour inciter les autorités géorgiennes à ouvrir un deuxième front contre la Russie. À l'époque, la situation politique en Géorgie était très agitée depuis plusieurs mois: des « émissaires » occidentaux étaient présents sur le « Maïdan » local, il y avait des manifestations de masse, des combats de rue, les réseaux sociaux étaient utilisés pour mobiliser les étudiants à des actions de protestation, et des dames âgées s'agenouillaient devant les forces spéciales – tout cela conformément aux méthodes habituelles quand l'on cherche à précipiter un changement de régime.
À l'époque, le gouvernement géorgien avait réussi à résister et à défendre la volonté majoritaire de la population lors des élections législatives. Ce qui se passe actuellement est un écho de ces événements, qui se répètent aujourd'hui sous forme de farce, en accéléré. De nouvelles élections ont lieu, mais cette fois-ci au niveau municipal. Une fois de plus, l'opposition affirme que la victoire lui a été volée, alors que cette fois-ci, elle n'a même pas participé aux élections dans de nombreuses circonscriptions et avait déclaré à l'avance que ces élections étaient illégitimes. Bruxelles ne s'est pas précipitée pour soutenir « ses » alliés en Géorgie, car ce ne sont pas des personnes pour lesquelles on sacrifierait ses week-ends, et pour Washington, ces personnes ne sont certainement pas « les siennes ».
Au fond, les partisans de Mikhaïl Saakachvili suivent le même chemin que Saakachvili lui-même: de président de la Géorgie à sans-abri, puis à prisonnier.
Deuxième point, et non des moindres: l'échec manifeste de ce cinquième «Maïdan» à Tbilissi en quatre ans marque non seulement la fin définitive de l'ère Mikhaïl Saakachvili en Géorgie, mais aussi la fin de l'ère des «révolutions de couleur» en soi. Cette époque est révolue. Il est symbolique que la Géorgie, où cette ère avait commencé dans l'espace post-soviétique en 2003, y mette désormais un terme.

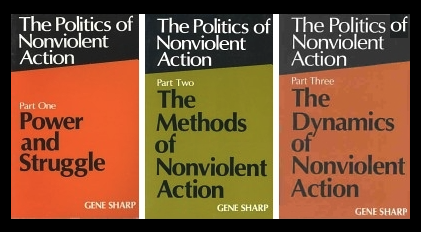
Les méthodes de changement de régime développées par Gene Sharp (photo) ont été utilisées pendant des décennies par des politiciens, des journalistes et des organisations non gouvernementales pro-occidentaux – en tant qu'agents des services secrets américains et européens – et analysées et étudiées dans les moindres détails. Afin de contrer ces méthodes, des contre-mesures efficaces ont déjà été développées et testées. La seule chose qui manque encore, c'est la souveraineté extérieure, la légitimité intérieure, un État qui fonctionne et la volonté politique des gouvernements concernés de mettre en œuvre ces contre-mesures.
Tout comme les méthodes simples, les méthodes sociales perdent également de leur actualité avec le temps.
La présence d'un « sacrifice sacré », la « colère juste » de la foule, la représentation d'activistes corrompus comme représentants de l'ensemble du peuple, de jolies filles qui cousent des rubans sur les uniformes des soldats et de touchantes grand-mères qui leur offrent des biscuits: toutes ces manipulations politiques ne fonctionnent plus. Le tour a été dévoilé et le magicien n'impressionne plus. Mais il ne faut pas se détendre, les escroqueries prennent sans cesse de nouvelles formes. Les escrocs s'adapteront toujours aux nouvelles conditions et développeront de nouvelles méthodes. Et cela ne concerne pas seulement les appels téléphoniques frauduleux et la correspondance sur les réseaux sociaux, mais aussi la grande politique.
15:08 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géorgie, caucase, révolution de couleur, gene sharp |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’accord Moscou-Téhéran redessine la carte stratégique de l’Arctique à l’océan Indien

L’accord Moscou-Téhéran redessine la carte stratégique de l’Arctique à l’océan Indien
Un nouveau corridor relie exportations de gaz, infrastructures nucléaires et systèmes militaires dans un bloc non occidental
par Global GeoPolitics
Source: https://ggtvstreams.substack.com/p/moscowtehran-agreement...
Le partenariat stratégique global entre la Russie et l’Iran, entré en vigueur en 2025, exige une analyse approfondie. Les partisans présentent l’accord comme un réalignement souverain et un rempart contre l’hégémonie occidentale. Les sceptiques mettent en garde contre des pièges cachés : un cartel énergétique déguisé, une subvention à l’escalade, et une fracture structurelle des chaînes d’approvisionnement mondiales. Aucune de ces lectures n’est suffisante seule. Le pacte incarne des contradictions qui définiront la géopolitique de la prochaine décennie.
Le traité instaure un cadre de 20 ans liant la Russie et l’Iran dans les domaines de l’énergie, des transports, de la défense, de la finance, de la technologie et de la diplomatie. Sa ratification a déjà été approuvée par la Douma russe. La mise en œuvre de ses dispositions testera les limites imposées par les sanctions, la méfiance, les capacités internes et la pression extérieure. Ses effets se feront sentir en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud et sur la carte énergétique mondiale.
Au cœur de l’alliance, la résilience stratégique mutuelle est l’objectif. La Russie cherche des échappatoires aux points d’étranglement occidentaux. L’Iran souhaite des technologies avancées, des garanties de sécurité et des marges de manœuvre face aux pressions. Le traité formalise la coopération dans le nucléaire civil (rôle de Rosatom sur quatre réacteurs iraniens, pour environ 25 milliards de dollars), un gazoduc passant par l’Azerbaïdjan vers l’Iran (potentiellement 55 milliards de m³ annuels), et la relance des échanges via le Corridor de transport international Nord-Sud (INSTC) afin de contourner les routes maritimes occidentales. Ce gazoduc serait comparable à l’ancien Nord Stream. L’Iran prévoit aussi de fournir 40 turbines MGT-70 à la Russie, sous licence Siemens, desserrant la pression sur les centrales thermiques russes soumises aux sanctions. Des mesures fondamentales comme l’intégration des systèmes de paiement (Mir en Russie, Shetab en Iran) figurent dans l’accord. La logique spatiale est claire : réorienter le commerce via l’Iran, réduire la dépendance au canal de Suez, à la mer Rouge, au Bosphore, à la Méditerranée, et concentrer les flux énergétiques sous un nouvel axe.
La dimension énergétique est la plus évidente. Si la Russie peut acheminer du gaz via l’Iran, elle gagne des routes d’exportation alternatives, moins vulnérables aux blocages. L’Iran devient un hub de transit, gagnant à la fois des droits de passage et un levier stratégique. Chine, Inde, Pakistan, Turquie et Irak sont tous sur des trajectoires potentielles. Le traité facilite aussi les investissements russes dans le pétrole/gaz et les infrastructures iraniennes, allégeant les contraintes capitalistiques imposées par les sanctions occidentales. Pour l’Iran, dont la croissance de la production gazière a ralenti (2 % par an récemment) tandis que la consommation explose et que l’infrastructure se dégrade, le capital et la technologie russes offrent un certain soulagement. Mais l’Iran fait face à un déficit gazier chronique (historiquement 90 millions de m³/jour, pouvant atteindre 300 millions en hiver). Sans aide extérieure, son réseau électrique s’effondre, les raffineries sous-performent, les industries tournent au ralenti. Le traité constitue une bouée partielle.
Cependant, les défis sont de taille. Un rapport du Stimson Center prévient que la construction de pipelines, l’exposition aux sanctions, les risques de transfert technologique, les inefficacités de gestion et la dépendance excessive au capital russe sont des dangers majeurs. L’Iran doit moderniser ses installations vieillissantes, surmonter les blocages du financement extérieur, corriger les mauvais incitatifs et gérer corruption et bureaucratie internes. La Russie doit assumer le risque d’investissements sous sanctions, dans des terrains difficiles, et faire confiance aux capacités de l’Iran.
La confiance politique et stratégique reste fragile. Les renseignements britanniques ont souligné la méfiance persistante et reconnu que le traité n’apportera peut-être pas de percées majeures. Eurasia Review qualifie l’alliance de « tiède », notant la concurrence énergétique entre Moscou et Téhéran, des volumes commerciaux modestes (environ 5 milliards de dollars), et l’inexécution d’accords antérieurs. En pratique, la Russie a refusé une clause de défense mutuelle complète. Le pacte interdit d’aider un agresseur tiers mais n’engage pas à une assistance militaire directe. La diplomatie iranienne a insisté sur le refus d’être entraînée dans des blocs militaires. Lors des récentes frappes américaines et israéliennes sur des sites nucléaires iraniens, Moscou a publiquement condamné les attaques mais n’a offert aucune réponse militaire. Ce fossé révèle la différence entre alliance rhétorique et pacte opérationnel.
Le traité modifie aussi la dynamique des sanctions et des juridictions légales. La Russie a déjà rejeté la récente réactivation des sanctions de l’ONU contre l’Iran (via le mécanisme de retour automatique) comme illégale et non contraignante. Cette position construit de fait une légalité parallèle où Moscou agit comme si les sanctions ne la concernent pas, favorisant ainsi leur contournement ou non-respect. Téhéran menace également de refuser inspections ou coopération avec l’AIEA si les sanctions perdurent. Avec deux grandes puissances ignorant ouvertement les mécanismes de coercition occidentaux, l’application des règles devient asymétrique. Les pays qui souhaitent commercer avec l’une ou l’autre seront exposés à des risques juridiques, diplomatiques ou devront compartimenter leurs relations.

Les implications régionales sont profondes. Dans le Caucase du Sud, le gazoduc passera probablement par l’Azerbaïdjan, donnant à Bakou un rôle de hub mais l’exposant aussi aux pressions concurrentes de Moscou, Téhéran et l’Occident. Les intérêts arméniens peuvent être affectés. Pakistan et Inde pourraient chercher à utiliser le corridor pour l’énergie et le commerce. L’INSTC vise à contourner Suez et à raccourcir de 40 % le transit Russie-Inde, offrant une alternative aux routes maritimes dominées par les marines occidentales. Pour l’Europe, de nouveaux flux gaziers pourraient réduire certains marchés ou leur pouvoir de négociation. Pour le Sud global, ce nouveau corridor offre une diversification potentielle des échanges, mais la plupart des États n’ont pas la capacité de gérer les risques géopolitiques.
Sur le plan énergétique mondial, le pacte favorise la dédollarisation. Russie et Iran privilégient les échanges bilatéraux en monnaies locales et les systèmes de paiement alternatifs. À terme, cela peut éroder la domination du dollar sur certains marchés de l’énergie, surtout parmi les pays tolérants aux sanctions. Le traité ne vise pas à renverser à lui seul la primauté monétaire américaine, mais il contribue à l’infrastructure de la fragmentation systémique.

Il faut se demander si le traité fait partie d’un plan « sombre » ou d’un virage souverain rationnel. L’architecture énergétique et de transport construite ici n’est pas neutre : contrôler les flux, les goulots d’étranglement, les dépendances et la fixation des prix, c’est le pouvoir. Cela peut favoriser l’escalade dans les conflits. La Russie utilise déjà des drones iraniens (Geran/Shahed) en Ukraine ; l’Iran accède à la défense anti-aérienne russe (S-400) et aux plateformes Su-35. Ce transfert accroît le risque militaire au Moyen-Orient et au-delà. Mais l’absence de clause de défense mutuelle indique que chaque partie souhaite préserver sa liberté d’action, sans engagement en cas d’escalade.
Des analystes indépendants, comme ceux du Centre for Analysis of Strategies and Technologies (CAST, basé à Moscou mais indépendant), notent que la logique des exportations d’armes russes s’aligne naturellement sur les besoins iraniens. L’Iran tire profit de l’accès à des systèmes lourds pour sa sécurité intérieure. Mais CAST relève aussi le risque d’une dépendance excessive, de fuite technologique et de contrecoups diplomatiques.
L’équilibre international se modifie. L’Occident ne peut traiter la Russie et l’Iran de la même façon : la Russie demeure économiquement plus stable, militairement plus puissante et centrale en Eurasie. L’Iran est un partenaire junior, limité par la démographie, la fragilité économique, les sanctions et la contestation interne. L’axe est donc asymétrique. La Russie gagne en influence, l’Iran obtient protection et investissement. Mais le danger réside dans des attentes démesurées: si la Russie échoue à livrer, la désillusion iranienne peut nourrir instabilité, coups d’État ou dérives agressives.
Il faut aussi juger le coût de la réaction occidentale. Les États-Unis peuvent sanctionner les entreprises tierces impliquées dans la construction du pipeline, bloquer les transferts de technologie, exercer des pressions sur les États du Golfe ou imposer des sanctions secondaires. Ces leviers existaient déjà partiellement. Le traité amplifie la confrontation : pipelines via l’Azerbaïdjan, corridors étendus via le Pakistan ou l’Inde suscitent des réactions régionales. Les pays situés sur la route peuvent subir des pressions.
Le risque d’escalade demeure élevé. Si les tensions avec Israël ou l’Arabie saoudite s’aggravent, l’Iran peut utiliser sa position énergétique ou son poids politique. Cela mettra la Russie sous pression pour répondre ou risquer la vassalisation. Le traité brouille la frontière entre géopolitique de l’énergie et sécurité. En Afrique, Amérique latine et Asie du Sud-Est, les pays observant cette alliance peuvent réévaluer leurs propres alliances. Certains s’aligneront, d’autres temporiseront.
Pourtant, le récit du virage souverain a du sens. Le traité élargit la multipolarité. Il offre aux États non occidentaux une alternative structurelle à la dépendance. Pour les pays soumis à des sanctions ou à la coercition occidentale, l’exemple est parlant : commerce via l’Iran, contrats énergétiques hors dollar, cadres juridiques contournant les tribunaux occidentaux, chaînes d’approvisionnement indépendantes. Dans les petits États (Venezuela, certaines régions d’Afrique, certains États asiatiques), l’alliance propose de nouveaux modèles. Si le corridor fonctionne et que les échanges augmentent, le traité pourrait contribuer à créer une économie mondiale parallèle.
Mais cela dépendra de la mise en œuvre, de la discipline et de la coordination mutuelle. De nombreux traités visionnaires échouent à l’application. La Russie doit éviter la surextension ; l’Iran doit maintenir les réformes structurelles ; les États non alignés doivent éviter d’être entraînés dans des conflits par procuration.


Le plus grand danger du traité réside dans la surconfiance. Si la Russie s’implique militairement trop tôt, elle risque l’enlisement. Si l’Iran attend trop de soutien, il pourrait provoquer une répression. L’architecture reste déséquilibrée, l’énergie, le transport et la finance étant largement russes. Mais le risque stratégique pèse sur les deux.
En somme, le traité Russie-Iran de 2025 fait partie d’une reconfiguration progressive de l’ordre mondial. Il ne s’agit pas simplement d’une réaction à la pression occidentale, ni d’une tentative conspirationniste de briser l’ordre mondial. Il s’agit plutôt de diplomatie d’État, où les puissances cherchent à accroître leur influence, à sécuriser des voies stratégiques et à affirmer leur autonomie. L’issue dépendra de l’exécution, de la dynamique de la guerre des sanctions, des évolutions régionales, du niveau de confiance réciproque et des capacités internes des acteurs. Les observateurs, surtout hors du récit dominant, devront voir si le corridor est à la hauteur des ambitions ou s’effondre sous la pression.
Rédigé par : GGTV
Popular Information vit grâce à des lecteurs qui croient que la vérité compte. Si quelques personnes de plus soutiennent ce travail, cela signifie plus de mensonges révélés, plus de corruption exposée, et plus de comptes à rendre là où cela manque. Si vous pensez que le journalisme doit servir le public, pas les puissants, et que vous pouvez aider, devenir ABONNÉ PAYANT fait vraiment la différence.
buymeacoffee.com/ggtv
14:42 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iran, russie, actualité, géopolitique, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
France: quand le «macronisme» s'effondre sur lui-même

France: quand le «macronisme» s'effondre sur lui-même
Elena Fritz
Source: https://pi-news.net/2025/10/frankreich-wenn-der-macronism...
L'affaire Lecornu montre que le macronisme n'a jamais été un mouvement politique, mais plutôt un mode de gestion du déclin assorti d'une prétention esthétique des plus discutables.
La démission de Sébastien Lecornu, à peine 24 heures après sa nomination au poste de Premier ministre, fait l'effet d'un scandale politique. En réalité, elle est l'expression d'une rupture structurelle plus profonde. La France assiste à la lente désintégration du macronisme, une forme de pouvoir technocratique qui a perdu sa base sociale.
Depuis 2017, Emmanuel Macron vend aux Français une image de «modernisation» qui signifie en réalité déréglementation, démantèlement social et exaltation morale. La soi-disant «voie européenne» n'est rien d'autre que l'institutionnalisation de l'irresponsabilité: les intérêts nationaux sont externalisés, les conflits sociaux européanisés, les décisions politiques anonymisées.

Lecornu était la figure idéale dans ce système: adaptable, loyal, ambitieux. Le fait qu'il jette l'éponge n'est pas un acte de rébellion, mais le dernier réflexe de son instinct de survie. Dans le macronisme, le poste de Premier ministre est un produit jetable: toute figure chargée de mettre en œuvre des réformes impopulaires est sacrifiée dès que les protestations deviennent trop fortes.
Lecornu, un symptôme, pas une solution
Derrière la rhétorique libérale se cache une politique d'austérité profonde. Retraites, éducation, santé: tout est réduit afin de financer de nouveaux projets d'armement.
L'Ukraine sert de prétexte moral à la transformation de l'économie française en économie de guerre. Le prix à payer: une perte silencieuse mais perceptible de cohésion sociale.
La démission de Lecornu n'est pas un échec personnel, mais le symptôme d'un ordre politique qui se consume lui-même. La France veut être à la fois un État social, un empire et une superpuissance morale – et perd peu à peu chacun de ces éléments.
Ce n'est pas « l'Europe » qui tremble, mais l'appareil bruxellois, dont la façade était soutenue par la stabilité française et la solvabilité allemande. Lorsque Paris vacille, l'équilibre politique de l'UE s'effondre. Sans la France, Bruxelles perd son ancrage légitime, son centre sémantique. L'UE, « projet de rationalité », se révèle de plus en plus comme un projet visant à préserver sa propre bureaucratie.
Conclusion
L'affaire Lecornu montre que le macronisme n'a jamais été un mouvement politique, mais un mode de gestion du déclin assorti d'une prétention esthétique des plus discutables. Maintenant que même les personnages les plus loyaux de ce macronisme quittent le navire, la vérité se révèle: la France n'est pas à l'aube d'un changement de pouvoir, mais d'une lassitude du pouvoir lui-même.
Et l'UE, qui a soutenu cette orientation, sent pour la première fois que ses fondements, basés sur une illusion technocratique et une hybris morale, ne tiennent pas la route lorsque le ciment français s'effrite.
13:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, macronisme, sébastien lecornu, emmanuel marcon, actualité, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


