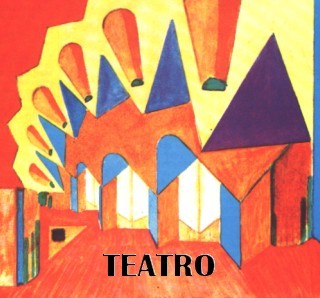Protectionnisme ou « Déglobalisation » ?
Trouvé sur: http://www.polemia.com
Que deviennent donc les grandes résolutions prises par le G20 réuni à Washington, le 15 novembre dernier, où les dirigeants des vingt principales puissances mondiales s’étaient engagés à s’abstenir « d’élever de nouvelles barrières aux investissements et au commerce des biens et des services » ? Ayant repris tous en chœur le mot d’ordre du moment, « Le protectionnisme : voilà l’ennemi » (1), où en sont-ils aujourd’hui ?
Au sein de l’Union européenne, la solidarité et la concertation résistent mal à l’ampleur des difficultés économiques que l’on ne mesurait pas dans les premières semaines de la crise et on s’achemine doucement mais sûrement vers le « chacun pour soi : « Chaque Etat est tenté d’agir en fonction de ses spécificités nationales », relève le commissaire chargé des affaires économiques et monétaires, Joaquin Almunia.
Sur le plan mondial, on constate le même repli sur soi.
Les Etats-Unis – A tout seigneur tout honneur – envisagent, par exemple, de réexaminer une disposition d'un vaste plan de relance économique protégeant les sidérurgistes nationaux contre les importations d'acier étranger. L'article, perdu dans un projet de près de 650 pages, interdit l'achat de fer ou d'acier étranger pour les projets d'infrastructures que financerait le plan. Par ailleurs, la nouvelle administration Obama s’interroge sur l’opportunité d’une nationalisation des banques.
En Chine, on a déjà assisté, durant les deux dernières années, à plusieurs conflits entre partenaires étrangers et chinois, comme ce fut le cas entre Danone et Wahaha. Récemment, c’est Alstom Transport qui a perdu le marché de la ligne à grande vitesse Pékin-Shanghaï au bénéfice exclusif de fournisseurs chinois. Il en est de même pour les télécommunications ou Coca-Cola ; ce dernier voit suspendre sa négociation engagée avec Huiyan Juice pour le rachat de la firme chinoise. Question : « La Chine va-t-elle favoriser ses champions nationaux en période de crise ? »
Alors, à l’épreuve de la crise, le libre-échange et la globalisation seraient-ils sur la sellette ? De Davos, où régnait un désarroi général, nous vient peut-être une réponse transmise par Frédéric Lemaître, rédacteur en chef du « Monde » (03/02/09) : « La mondialisation est devenue un handicap pour la reprise, et donc la croissance. » Est-ce un hasard si la presse anglo-saxonne parle déjà de « déglobalisation » ? Qu’en est-il ?
Polémia
Le dilemme de la « déglobalisation »
Le terme est utilisé par Sean O’Grady dans « The Independent » de ce 31 janvier 2009 : « Deglobalisation: What is it ? And why Britain should be scared » (De quoi s’agit-il ? Et pourquoi la Grande-Bretagne devrait-elle avoir peur ?). Le terme désigne évidemment le mouvement inverse de la globalisation, actuellement en cours pour des raisons de protection, de prudence, de protection devant la violence de la crise. Cette situation peut être caractérisée également par la montée du protectionnisme. Mais l’emploi du mot, forgé pour l’occasion, de « déglobalisation » implique de considérer ce renouveau de protectionnisme comme une mesure qui n’est pas seulement d’occasion, ni de simple réflexe, mais qui suggère un mouvement de mise en cause de la structure et de la philosophie de l’économie du monde, la crise elle-même suggérant cette attitude. Les Britanniques sont particulièrement concernés, et également préoccupés tant leur économie est fondamentalement orientée dans le sens de cette philosophie ainsi mise en péril, au niveau de sa structure même, dans tous les domaines de la vie nationale.
« La Cité de Londres est un exemple flagrant de main-d’œuvre étrangère et de capitaux circulant librement et, jusqu’à récemment, elle était capable de générer une immense richesse. Mais d’autres services financiers et d’affaires, depuis l’assurance jusqu’à l’expertise, dépendent aussi de ces flux internationaux circulant librement.
« La quasi-totalité de notre fourniture en électricité et de nos services des eaux appartient à des entités allemandes, françaises ou à d’autres d’essence étrangère, un grand nombre de nos banques de la High Street sont entre les mains du groupe espagnol Santander et nos principaux constructeurs automobiles sont japonais, allemands, indiens et américains – et ils exportent 80 pour cent de leur production. Même la poste appartiendra pour moitié aux Hollandais. Il y a aussi Heathrow, un centre de transit international. Le tourisme et les industries créatrices, qui sont le secret de notre prospérité, sont les uns et les autres des affaires mondiales. Regardez aussi les maçons polonais et lituaniens, les arracheurs de pommes de terre, les chauffeurs de taxi nigériens et les infirmières sud-africaines, tous ont fourni un net profit à l’économie britannique. Leur contribution à la baisse du coût de la vie et au maintien de la Sécurité sociale est à peine remarquée et encore moins louée. Sans parler de l’apparition du poulet tikka masala devenu notre plat national. »
Si l’on en revient au protectionnisme, qui est le signe le plus apparent, le plus spectaculaire de la « déglobalisation », il faut savoir qu’il a d’ores et déjà une dimension politique et qu’il interfère d’ores et déjà sur les relations entre l’Europe et les USA de Barack Obama. A cause de cela, on commence déjà à s’interroger sur la réalité de cette énième « lune de miel » entre l’Europe et les USA (…), annoncée bruyamment avec le nouveau président, une grosse semaine après que ce président eut pris ses fonctions. La crise brouille toutes les cartes, et à son rythme, qui est étourdissant.
Les Britanniques, les plus proches des USA, les « cousins » anglo-saxons, sont à nouveau sur le front, cette fois dans l’attaque contre les USA, sur le point précis de la réintroduction d’une forme de « Buy American Act » dans la loi sur le plan de relance (ou stimulus plan) en train d’être discuté à Washington. Le « Business Secretary » (nous laissons le titre dans sa langue originale tant la traduction en « ministre des Affaires » rend un son étrange) du gouvernement Brown, Lord Peter Mandelson, lance de Davos une critique violente contre Washington et les USA, rapportée par le « Times » de ce même 31 janvier.
« Se livrant à une attaque cinglante contre le plan, Lord Mandelson a déclaré que les projets nationaux consistant dans certains pays à inciter les consommateurs à acheter des produits fabriqués chez eux risquaient sérieusement de déclencher des affrontements dus au commerce protectionniste. “Je comprends pourquoi les gens désirent faire leur propre choix. C’est pourquoi, si on commence ces campagnes “Achetez américain”, ou “Achetez ceci”, ou “Achetez cela”, on court le risque que cela se traduise en de réels obstacles au commerce, ce qui est la dernière chose dont nous avons besoin en économie mondiale”, a-t-il ajouté. » (…)
« Lord Mandelson a condamné ce qu’il a qualifié de démarches protectionnistes naissantes engagées par certains gouvernements au sein de l’Union européenne des 27 nations. “Nous avons créé le marché unique pour soutenir une croissance économique et non pas pour commencer à s’en prendre les uns aux autres.” Toutefois, à Davos, lors d’un important déjeuner des chefs d’entreprise britanniques, il a souligné que la tendance était évidente, non pas seulement en Europe mais dans le monde entier : “Le commerce mondial s’engage cette année vers la régression pour la première fois depuis 1982. Je pense qu’il y a un risque réel que les gouvernements et les affaires voient dans le protectionnisme le remède nécessaire dans ces conditions-là mais pour ce qui concerne la guérison c’est aussi un poison”, a-t-il ajouté. “C’est la leçon que nous devons tirer des années 1930 – des erreurs que nous ne devons pas réitérer au XXIe siècle”. »
« Lord Mandelson conforte l’avertissement déjà formulé par Gordon Brown au sujet de ce qu’il a appelé le “mercantilisme financier” – une nouvelle tendance des banques à retirer des marchés étrangers des milliards pour les injecter dans leurs bases nationales. »
Il est vrai qu’à Bruxelles, dans les différents milieux européens, la question de la renaissance du protectionnisme est désormais centrale. « A la Commission européenne, nous dit une source européenne, la perception de la crise continue à être étrangement cloisonnée, tant est grande la lourdeur de cette bureaucratie et développée son irresponsabilité politique. Mais la question du protectionnisme est celle par laquelle la grandeur de la crise est en train de pénétrer les esprits. Il y a une crainte immense, presque de la panique, de constater tous les signes de résurgence du protectionnisme, d’abord, bien sûr, aux USA… »
Cette préoccupation a un écho officiel, tel que le rapporte le « EUObserver » le 30 janvier, et cette préoccupation concerne effectivement l’attitude US, le « plan de stimulation » :
« L’Union européenne attend avec beaucoup d’attention de voir si une clause « Achetez américain », relative à l’acier, figurera dans la version finale du Plan de relance américain qui va être signée par Barack Obama, redoutant qu’elle n’affecte les exportations européennes. La clause, obligeant les entrepreneurs à utiliser uniquement de l’acier produit aux Etats-Unis pour leurs programmes de développement financés par le plan de relance de 825 milliards de dollars (630 milliards d’euros) proposé, est incluse dans une version qui a été approuvée par la Chambre des représentants le mercredi 28 janvier. Le Sénat débat du projet de loi en ce moment.
« Lors d’un point de presse de jeudi, le porte-parole, Peter Powel, a déclaré que le commissaire au commerce, Catherine Ashton, suivait de près l’évolution de la situation. “Nous sommes en train d’examiner la situation. … Avant d’avoir un texte définitif … il serait prématuré de prendre position”, a-t-il déclaré. “Mais la seule chose dont nous pouvons être absolument certains, c’est que si un projet de loi est voté qui interdirait la vente ou l’achat de marchandises européennes sur le territoire américain, nous ne resterons pas là à ne rien faire et nous n’en tiendrons aucun compte”, a-t-il pousuivi. »
« Selon la proposition actuelle, l’acier étranger ne pourra être utilisé pour les projets d’infrastructure financés par le plan de relance que dans le cas où le chef du département fédéral décide que l’emploi du seul acier américain augmenterait les coûts de plus de 25%. »
Enfin, et pour compléter notre choix de références, le site « WSWS.org » publiait hier une analyse générale de la situation du domaine, selon l’appréciation d’une montée générale du « nationalisme économique ». Comme toujours sur ce site, l’analyse bien informée, exposée d’une façon didactique, comporte également, au niveau du jugement général, les engagements idéologiques qui, dans de telles situations, se rapprochent de l’enfermement du jugement. Il s’agit de condamner aussi bien cette sorte de « nationalisme », évidemment interprété comme une action des classes dominantes nationales, que la structure de libre-échange mise en cause, qui renvoie à la globalisation hyper-capitalistique. Contentons-nous du passage sur l’évolution de la situation US qui est, en l’occurrence, le point central de la question.
La nouvelle administration Obama a encouragé la marée montante du protectionnisme avec les commentaires, la semaine dernière, du secrétaire au Trésor, Tim Geithner, qui accusait la Chine de jouer avec ses devises pour développer ses exportations. Traiter Pékin de « manipulateur de monnaie » permettrait à la Maison Blanche de faire appel contre la Chine à une large gamme de taxes douanières dissuasives et autres pénalités économiques selon la législation commerciale américaine. »
Les démocrates de la Chambre des représentants sont allés plu loin en incluant mercredi une clause « Achetez américain » dans le plan d’ensemble de relance d’Obama et de ses 825 milliards de dollars approuvé mercredi. La clause, qui exige que les projets d’infrastructure financés par le paquet n’utilisent que du fer et de l’acier fabriqués aux Etats-Unis, a provoqué des protestations de la part des sidérurgistes européens. Le sénateur démocrate Byron Dorgan propose une plus large mesure visant à exclure le plus grand nombre de produits manufacturés fabriqués à l’étranger au moment où le plan parviendra au sénat (2). »
« De telles mesures menacent de provoquer une escalade de représailles et une guerre du commerce à grande échelle. Dans la revue américaine “Foreign Policy”, un commentateur mettait en garde contre le fait que le “langage explicitement protectionniste” exprimé dans le plan serait “certainement ressenti comme un mauvais signe par le reste du monde”. Le monde peut traiter avec une Inde ou une Indonésie protectionnistes. Les échanges commerciaux rencontreront beaucoup plus de problèmes si les Etats-Unis se mettent à renoncer à leur rôle traditionnel de leadership.” »
Les deux mots pour le dire
Il y a un faux affrontement intéressant de mots par ailleurs presque synonymes. S’agit-il de « protectionnisme » ou s’agit-il de « déglobalisation »? C’est une question qui mérite qu’on s’y arrête pour ce qu’elle recouvre – c’est même, en l’occurrence, la seule question qui vaille qu’on s’y arrête.
En général, le procès du protectionnisme est vite fait, d’autant qu’on retrouve dans le rôle du procureur aussi bien les hyper-libéraux à-la-Mandelson que les internationalistes trotskystes. Tout juste se demanderait-on si les jugements ne sont pas de circonstance ; le Royaume-Uni (où se recrutent ces chevaliers du libre-échangisme) ne se priva jamais d’être protectionniste, y compris avec un « grand marché » étendu au Commonwealth, lorsqu’il avait quelque chose à « protéger » ; aujourd’hui, on connaît sa situation… Par conséquent, on réservera une certaine méfiance vis-à-vis des sorties antiprotectionnistes de Mandelson et de Brown – dont, par ailleurs, l’intégrisme capitaliste n’est pas en cause, et pour le plus convaincant des propos (pour rappel, Brown, et non Blair, est désigné parmi les 25 coupables de la crise actuelle par le « Guardian »).
On notera également qu’on ferait bien de relire quelques classiques, pour rappeler, comme l’avait déterminé l’historien Lucien Romier en 1925 (« Qui sera le maître, Europe ou Amérique? »), que le protectionnisme n’est pas un concept qui s’expédie par quelques vitupérations. Romier distinguait le protectionnisme autarcique, établi par une nation pour développer d’une façon jugée en général déloyale sa puissance et prospérer sans interférences, ses caractéristiques la faisant se suffire à elle-même. L’exemple historique est celui des USA durant le « Gilded Age » (1865 jusqu’à la fin du XIXe siècle), époque paradoxalement du capitalisme le plus sauvage de l’histoire économique, des grandes fortunes, d’un développement industriel tonitruant faisant accéder les USA au rang de grande puissance au début du XXe siècle. L’autre protectionnisme est le « protectionnisme défensif », établi pour protéger l’économie et la nation affaiblies pour telle ou telle cause (crise, défaite militaire, etc.), parce que l’urgence ne laisse souvent guère de choix. C’est le cas aujourd’hui, et c’est un cas bien plus difficile à trancher qu’il n’y paraît, dans les circonstances actuelles. Le problème est en effet que le protectionnisme est vigoureusement condamné au nom de la survivance – ne parlons pas de « renaissance » – d’un système dont il est avéré par ailleurs qu’il a provoqué la crise où nous nous trouvons, par conséquent cause indirecte mais avérée de cette poussée protectionniste…
C’est à ce point où nous passons à la problématique des « deux mots ». S’agit-il aujourd’hui de « protectionnisme » ou de « déglobalisation » ? « Les deux, mon colonel », répond l’expert, finaud. Ce n’est pas faux, on l’a vu, et c’est un dilemme, qui se reflète d’ailleurs dans l’embarras de certains critiques du protectionnisme qui admettent par ailleurs « comprendre » le mouvement de déglobalisation. C’est le cas lorsque Pascal Lamy, qui dirige l’OMC, dit à Davos : « Il est naturel qu’il y ait dans une telle crise une grande demande de protection. Mais cela ne signifie pas qu’il devrait y avoir du protectionnisme » (« It is natural in such a crisis that there is a big call for protection. But that does not mean there should be protectionism »). Traduisons, mais traduisons vraiment, en fonction de la tournure un peu alambiquée, c’est-à-dire gênée aux entournures, des deux phrases : « Un peu de protection c’est naturel, le protectionnisme ce n’est pas bien. ». On se demande qui fera la différence entre « protection » et « protectionnisme », à part le « isme » qui permet aux éditoriaux du « Financial Times » de paraître vertueux.
Il est vrai que la globalisation est ce mouvement déstructurant, prédateur des identités et des souverainetés, qui a très largement contribué à massacrer les particularismes économiques, les équilibres des nations et des régions, l’équilibre universel de l’environnement ; qui a très largement contribué à massacrer les cultures (dans les deux sens, après tout), les sociétés, etc. ; et ainsi de suite. De ce point de vue, qui est fondamental pour définir la crise, la déglobalisation, dans tous les cas, un peu ou pas mal de déglobalisation, se justifie sinon s’impose, notamment pour lutter contre la crise. Mais la globalisation ne « marche » qu’appuyée sur le libre-échange avec le moins de restriction possible, et pas de restriction si possible, et, par conséquent, le protectionnisme est son grand ennemi ; dito, le protectionnisme, c’est par conséquent aussi la déglobalisation, – et le tout, si l’on accepte aussi que le protectionnisme est effectivement une menace d’aggravation de la crise, forme un dilemme entre deux appréciations et deux politiques éventuelles, entre lesquelles il est bien difficile de trancher puisqu'il se pourrait bien qu'elles soient semblables.
Au reste, personne ne tranchera. Les directions politiques sont aujourd’hui trop faibles, trop pressées par des menaces terribles, dont celle de troubles politiques devant la catastrophe sociale, pour pouvoir réagir comme il convient aux consignes du système. Le protectionnisme, dans cette atmosphère générale de déglobalisation, est quelque chose dont on voit mal comment il pourra ne pas se développer, d’une façon ou l’autre, notamment sous le nom de déglobalisation. Les USA mènent la charge, eux qui sont spécialisés dans le domaine de la tromperie à cet égard, grands donneurs de leçons et dénonciateurs du protectionnisme, et mainteneur du protectionnisme chez eux par des moyens variés ; mais, cette fois, bien peu préoccupés du qu’en-dira-t-on, ne dissimulant pas leurs intentions, parce que la maison brûle. Dira-t-on (les puristes de la logique) qu’ils se tirent une balle dans le pied, eux qui ont lancé la globalisation, faux-nez pour l’américanisation ? Qui a dit que la cohérence intellectuelle était la caractéristique du monde civilisé dans les heures que nous traversons, alors que ce ne fut même pas le cas lorsque tout allait bien ?
Encore une fois, la grande force des choses parlera pour nos élites, empêtrées dans leurs belles idées ornées de fortes pensées conformistes, leurs vanités diverses et leur inclination à prendre leurs intérêts pour le bien public. Nous dépendons d’une mécanique historique qui, elle, ne dépend pas de nous. Il est possible que cette mécanique, qui en a plus qu’assez de nos balourdises, ait choisi la déglobalisation, quitte à passer pour protectionniste.
Le dilemme de la « déglobalisation »
Faits et commentaires
31/01/09
www.dedefensa.org
Correspondance Polémia
05/02/09
(Trad. des citations de presse par RS pour Polémia)
Notes de la rédaction :
(1) Voir http://www.polemia.com/article.php?id=1817
(2) Selon une dépêche de l’AFP du 05/02/09 : « Le Sénat américain a assoupli une clause controversée “Buy American” (Achetez américain) du plan de relance économique, un plan dont l'adoption est par ailleurs retardée par l'opposition républicaine alors qu'il est attendu impatiemment par le reste du monde.
Les sénateurs ont voté à main levée pour changer la formulation du texte et stipuler que le plan de relance devra être conforme aux lois et traités commerciaux existants, c'est-à-dire les règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). »
Correspondance Polémia



 La CIA toujours à la besogne : Racak, le massacre n’était-il pas trop parfait ?
La CIA toujours à la besogne : Racak, le massacre n’était-il pas trop parfait ?
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg


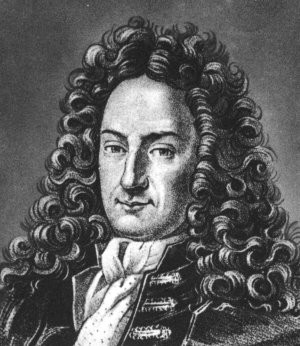



 De Roemeense schrijver Cioran schreef in zijn Syllogismes de l’amertume dat Hitler gepoogd heeft de beschaving te redden door de barbarij. Een barbaarse poging, maar niettemin de laatste poging in het Westen volgens Cioran. Dat is allicht de reden waarom westerse beschaving en westerse waarden nu het ordewoord zijn van barbaren, die zich ervan bedienen voor politiek en ander gewin. Voor hen geldt: zij verkrachten de beschaving om de barbarij te redden. Nationalisten die zich dit beschavingsdenken eigengemaakt hebben, slaan de bal volledig mis. In de volgende tekst leggen we uit waarom.
De Roemeense schrijver Cioran schreef in zijn Syllogismes de l’amertume dat Hitler gepoogd heeft de beschaving te redden door de barbarij. Een barbaarse poging, maar niettemin de laatste poging in het Westen volgens Cioran. Dat is allicht de reden waarom westerse beschaving en westerse waarden nu het ordewoord zijn van barbaren, die zich ervan bedienen voor politiek en ander gewin. Voor hen geldt: zij verkrachten de beschaving om de barbarij te redden. Nationalisten die zich dit beschavingsdenken eigengemaakt hebben, slaan de bal volledig mis. In de volgende tekst leggen we uit waarom.