mardi, 25 novembre 2025
Le moment Nerval, une crise dans le destin européen

Le moment Nerval, une crise dans le destin européen
Claude Bourrinet
Gérard de Nerval incarne parfaitement l'oscillation entre l'étreinte de la limite – discipline rationnelle, concept astreint, expression dirigée, ethos mesuré -, et la dynamique transgressive du dire, de l'émotion, de l'esprit, du rêve, de la folie, de la quête, balancement qui caractérise l'Occident depuis la Grèce préclassique jusqu'au romantisme historique et au-delà. On peut, comme Northrop Frye, George Steiner, ou René Girard, par exemple, évoquer un romantisme intemporel (comme l'est aussi, du reste, le classicisme). Autant dire que l'exploration de l'oeuvre nervalienne se prête singulièrement à une auscultation de l'Occident à la recherche de son identité, du moins de l'un de ses deux pôles dialectiques. Nerval incarne précisément cette crise où l'Occident ne peut plus rester le même, et où il lui faut se transmuer en ce qu'il est peut-être profondément: une fascination de l'illimité, une plongée vertigineuse, mortelle ou rédemptrice, dans ce gouffre qu'est l'homme.
Le moment Nerval, une crise dans le destin européen
La révolution romantique
L’œuvre de Nerval apparaît, en France, plus peut-être que celle d’un Chateaubriand ou d’un Hugo – nous verrons pour quelles raisons -, comme l’enregistrement enfiévré de la secousse sismique que fut la « crise de la conscience occidentale » de l’ère dite – selon la terminologie européocentrée des historiens - « contemporaine ». Précipitée par la déchirure révolutionnaire, elle fit suite à celle du XVIIe siècle, qui avait ébranlé l’Europe « baroque » par la critique dissolvante de la religion, de l’autorité de l’Église et de la tradition, commotion résultant de l’émergence de la science, du relativisme et du scepticisme hédoniste. Après les Guerres de religions, on s’efforça d’y faire face, avec plus ou moins de succès, par un surcroît de contrainte idéologique, étatique, et stylistique. Le classicisme mit de l’ordre dans les esprits, sinon dans le langage. Or, le romantisme fut le jaillissement d’une lave incandescente qui déforça et submergea le corset tellurique perclus de dogmes rationalistes, mais de plus en plus décrépits, dont la France des Lumières, des gazettes et des salons parisiens, avait ceintré l’Europe. La secousse se prolongea dans le symbolisme ; le surréalisme, après la convulsion dadaïste, en fut l'achèvement « existentiel », peut-être provisoire. Car le soulèvement spirituel qui avait presque tout emporté excédait les limites de l’art, et nous remue encore.
Afin de saisir le « cas Nerval », non sous un angle réducteur, par une polarisation sur la dimension littéraire (comment le classer ?), ou clinique (les circonstances sordides de son suicide … ou de sa « folie »), il est nécessaire d’opter pour un ouverture plus "civilisationnelle", en menant une analyse philosophique, théologique, religieuse et théosophique, et en prenant en compte le constat de la rupture entre le Divin et l’homme menacé d’un assèchement radical de sa présence au monde.

Dans la « suite » de poèmes intitulée « Le Christ aux Oliviers », Nerval s’inspire de Jean-Paul Richter, de son roman Siebenkäs (1796-1797) : Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei ; « Discours du Christ mort depuis l'édifice du monde, qu'il n'y a pas de Dieu », œuvre souvent appelée "Le Songe" en français, et traduite partiellement par Madame de Staël. Nerval place en épigraphe ces deux vers de Jean-Paul : Dieu est mort ! le ciel est vide… / Pleurez ! enfants, vous n’avez plus de père ! Au XIXe siècle, on entérine l’idée de la « Mort de Dieu » ( id est le Dieu « judéo-chrétien » sur qui pèse, du reste, le lourd soupçon d’avoir tué le « Grand Pan », le christianisme étant, selon Marcel Gauchet, la religion de la sortie de la religion).
Cette idée du « désenchantement du monde » (Max Weber ; Entzauberung der Welt), qu’incarne, si l’on ose dire, le cadavre du Dieu fait Homme (ainsi Dostoïevski fut-il frappé par le tableau d’Holbein représentant le corps rigidifié au regard vitreux du Christ martyrisé), hante l’Occident. Et, au fond, on pourrait penser qu’il s’agit-là, peut-être, d’un signe, d’une marque propre à l’identité occidentale, car le nihilisme semble se présenter déjà, sous certains aspects (la contingence absolue et angoissée des mortels, ou le « Crépuscule des dieux », et l’idée de Fin du monde – ou d’un monde), dans la Weltanschauung des Indo-européens ou des cultures sémitiques. Ce serait envisageable s’il n’existait le même mythème, d’une sorte de cataclysme final - ekpurosis, déluge, extinction du Soleil, ou toute autre déclinaison apocalyptique- (donc d’effondrement de l’Ordre et de dilution du Sens), dans la plupart des civilisations extra-eurasiatiques – idée obsédante qui nous travaille encore maintenant. Il est vrai que l’idée de renaissance cyclique, ou, plus rarement, de parousie (après parfois une période de souffrance), est affirmée dans tous les cas. Et pour des romantiques comme Nerval, l’espoir d’une palingénésie, de la métamorphose des dieux et des religions, idée que Pierre-Simon Ballanche avait soutenue, permet de ne pas perdre tout espoir.
Ainsi, en un premier temps, Nerval témoigne-t-il de la tentative réitérée depuis plus d’un siècle, face à une religion sclérosée et décadente, vidée de sa substance mystique, de recouvrer le lien rompu entre le Ciel et la Terre, de retrouver la lettre perdue de la langue cosmique, de récupérer l’âge d’or. Par voie de conséquence, le « péché » - qu’il ne faut pas appréhender dans un sens religieux, mais mythique - le « Mal » par conséquent -, c’est l’Exil, la perte, la séparation, hantise d’un homme dont la mère, qu’il connut à peine, alla trouver la mort, en 1810, dans un pays glacé comme l’enfer dantesque.
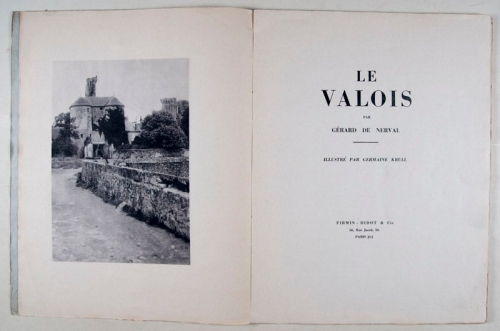
Cette bolgia infernale, où reposent, inapaisées, les cendres maternelles, est la prémonition d’une société de deuil. La révolution industrielle déshumanise le monde par le productivisme et la marchandise dissolvante. Les villes tentaculaires vont rassembler une humanité déshéritée, massifié, indifférenciée, mécanisée, par opposition à une campagne encore authentique, enracinée, différenciée, mais, elle aussi, de plus en plus rongée par l’esprit de gain et de fabrique, même dans ce vieux pays du Valois, où, pendant plus de mille ans, a battu le cœur de la France. Certes, la Fin du monde se présente, sous le roi bourgeois (et surtout en Grande Bretagne, qui profile l’avenir de l’Occident), selon des apparences moins grandioses que celles proposées par les traditions eschatologiques. Elle promet d’être plutôt froide, glaçante, et interminable, un long cauchemar. Et surtout, elle est descendue à un étiage sordide, radicalement sécularisé, Elle se traduit par un changement social profond, quasi anthropologique, dont l’homo œconomicus est l’acteur, personnage amoindri d’un âge de fer et de charbon, où Sylvie ne confectionne plus de dentelle (« on n’en demande plus, dans le pays ») : - Que faites-vous donc?» Elle alla chercher dans un coin de la chambre un instrument en fer qui ressemblait à une longue pince. « Qu'est-ce que c'est que cela ? — C'est ce qu'on appelle la mécanique; c'est pour maintenir la peau des gants afin de les coudre. — Ah! vous êtes gantière, Sylvie? — Oui, nous travaillons ici pour Dammartin, cela donne beaucoup en ce moment …
Paradoxalement, Nerval balance entre un progressisme inspiré par les Lumières – mais à vrai dire, du bout des lèvres, comme un réflexe idéologique acquis, ou peut-être parce que les Illuminés dont il a écrit la vie, dans l’ensemble, croyaient en un avenir délivré de l’étouffoir chrétien -, et un pessimisme profond devant les dégâts causés par la modernité.

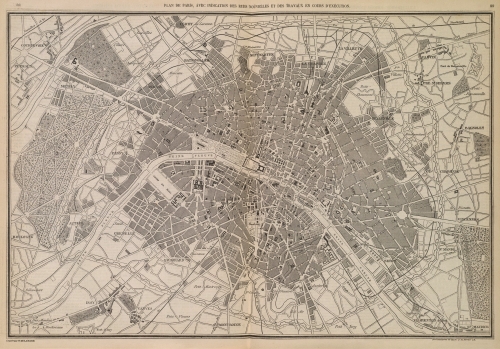

Dans le même temps où il se désole, par exemple, de la disparition du vieux Paris, les urbanistes louis-philippards n‘ayant pas attendu la curée Haussmannienne pour tailler en pièce la cité médiévale, il partage, avec un romantisme d’opposition, une autre acception du « Mal », à rebours de la religion officielle, se traduisant par une admiration fervente pour la révolte de Satan, (moi, qui suis feu issu de feu, le premier ange à avoir été façonné), que Jésus a vu « tomber du ciel comme l’éclair », ou la rébellion des Titans réfractaires à la tyrannie de Zeus. Nerval avait conté, dans la relation de son voyage en Orient, l’insoumission d’Adoniram, amant de la Reine de Saba, Balkis, victime de Salomon, et grand architecte, sculpteur génial, artiste maudit, maître du Feu. Tous ces factieux mythiques incarnent le progrès, comme Prométhée. Hiram et la Reine de Saba sont tous deux des figures majeures de la Franc-maçonnerie, dont Nerval était proche.

Toutefois, il ne faudrait pas exagérer l’engagement politique de Nerval qui, non seulement, est loin d’être constant, si l’on signifie par là qu’il aurait partagé les rêves républicains d’un renversement insurrectionnel, mais, quand, par aventure, on le constate, par exemple à la suite des Trois Glorieuses, on discute encore de son sérieux. Il ne fut souvent ajusté à ce monde, qu’il ne pouvait ignorer, car il côtoyait l’escouade des Bousingots, que de manière fort lâche, contingente. Mais cet emballement très contrôlé par une discrétion, une timidité, et une propension à la rêverie devenues proverbiales, ne dura qu’un temps fort bref. Les inductions réalisées par l’analyse de son œuvre permettent de définir, chez lui, une ferme opposition à toute censure (littéraire, morale, religieuse...), mais aussi un scepticisme idéologique non moins solide. Il réagissait en écrivain pour qui publier, chercher, penser, s’exprimer, est une respiration vitale, et un gagne-pain. Toujours est-il qu’il éprouvait une indifférence certaine à l’égard des dissensions politiques du moment, même en pleine révolution, en 1848, et qu’il a eu recours à l’aide ministérielle de la monarchie de Juillet, après 1840, pour se rendre en Orient, ou pour régler les frais de son hospitalisation, non qu’il appuyât le Roi-poire, mais parce que la vraie vie était ailleurs.

La voie du rêve
Ainsi Nerval ne propose-t-il pas de système, ni politique, ni métaphysique, et n’essaie-t-il pas de concevoir une mythologie structurée et cohérente, hormis en soulignant ses affinités avec Orphée, et surtout dans son insistance sur la figure d’Isis (qui peut d’ailleurs se décliner en avatars féminins, telles Artémis, Vénus, la Vierge, etc, véritable leitmotiv mystique, puisé dans le vaste corpus ésotérique de la théosophie néoplatonicienne égyptomaniaque). Loin d’être intellectualisée – ce qui ne signifie pas qu’il n’y mette de la méthode et une certaine lucidité logique -, son entreprise de réappropriation de l’Être, de la plénitude, pourvue de multiples facettes, ésotérique, théosophique, théurgique, occultiste, métaphysique, philosophique, part du sujet, désormais central depuis la cassure du XVIIe siècle, en plongeant, à la suite des romantiques allemands, en-deçà de la Raison, dans la deuxième vie qu'est le rêve (et les surréalistes suivront).

La théologie des Pères de l’Église et des docteurs scolastiques, englobait l’homme dans le tout cosmique. Adam et Eve avait été créés après le Cosmos (le péché originel est véritablement la révolte du sujet contre l’étau bienveillant d’un Dieu jaloux de son omnipotence, instaurant ainsi une dissonance, une sécession, un schisme dans l’Ordre divin). L’Un précédait, dans l’ordre de procession plotinienne, l’Intellect, l’âme et les sens (les dernières paroles de Plotin sont : « Je m’efforce de faire remonter ce qu’il y a de divin en moi à ce qu’il y a de divin dans l’univers »). Le microcosme était le reflet du macrocosme. Le sujet n’était pas central. L’anthropologie du monde traditionnel est holiste. En revanche, la centralité du sujet appartient à un monde éclaté, émietté, individualiste, orphelin : la solitude de l’homme face au cosmos est absolue, comme l’a constaté, avec des accents désespérés, un Pascal.
Le chemin de Nerval est très long, très ancien, archaïque, c’est une longue boucle, comme disent les randonneurs, non sans à-pics. Il renoue avec l'hellénisme des mythes, présents par exemple dans de nombreux poèmes des Chimères (Car la Muse m’a fait l’un des fils de la Grèce). Ces mythes, les "physiciens" (ceux que l’on nomme maintenant les « présocratiques ») de la Grèce préclassique, avaient tenté de s’en défaire en fondant une explication rationnelle du monde et de l’homme, et en distinguant globalement l'univers en deux dimensions, celle du Logos, et celle du sensible, du mouvant.

Le terme physis serait particulièrement approprié à la vision poétique de Nerval, car il s’agit-là d’une nature qui n’est pas du tout celle que la science moderne étudie et modifie (celle qui est objet de l’arraisonnement théorique et pratique du sujet), mais la totalité des phénomènes, de ce qui apparaît et se déploie pour former un monde. Mais ce qui le différencie des « sages » de l’époque pré-classique de la Grèce, c’est une irrationalité qui accompagne sa démarche ésotérique : ce qui apparaît (φαίνω, phaino, « apporter à la lumière, faire briller, remplir de clarté, briller, être brillant, resplendissant, devenir évident, être amené à la lumière... »), se déploie, cache le secret, et le révèle en même temps, mais seulement à l’initié. Nerval est plus proche des mystes d’Éleusis, que des Ioniens ou des Éléates, et il est dionysiaque, tout autant qu’apollinien, surtout orphique...
Enfin Platon vint. Réinterprétant le monisme de Parménide, dont il reprend la notion d’Être parfait, éternel, immuable, source de ce qui est, il a consacré la distance, entre le monde des sensations fuyantes et insaisissables, dégradées (celui des phénomènes selon Héraclite), et le monde des Idées, des essences, du Bien, lesquels sont subsumées, selon le néoplatonisme, au IIIe siècle, sous l’Un, par le mode de la procession, systématisant ainsi la hiérarchie ontologique platonicienne.
On sait que le nominalisme du XIVe siècle, dont l’illustre représentant est Guillaume d’Ockham, de l’Université d’Oxford, opposé à Thomas d’Aquin et à Duns Scot, confina les « Universaux » dans la sphère sémantique des signes (sémiotique), des noms, des structures mentales, des concepts, instaurant une rupture radicale entre les signifiants, les signifiés (le discours, la parole, la langue, le concept, la « représentation ») et les essences, le référent, qu’il fût « intérieur », ou « extérieur ». Et au fond, n’est-ce pas la condition de l’œuvre fictionnelle, d’être close et autoréférentielle ? Ainsi n’avons-nous plus accès à une gnose, à la connaissance absolue et initiatique des choses divines (qui relève désormais de la foi, de la théologie), ni aux réalités extra-mentales. C’était ainsi placer le problème de l’accès au « vrai », au niveau épistémologique, de l’étude de la constitution des sciences, ou de la connaissance en général (c’est ainsi que sont jetées les bases lointaines de la méthode analytique et logique anglo-saxonne). S’en trouvaient limités les pouvoirs cognitifs de l’homme – bornes relativisées par une approche empirique orientée vers les particularités, du singulier. Ainsi naquit l’Occident moderne, selon Foucault, Cassirer, Gilson, Guitton, et d’autres...

Deux ou trois siècles plus tard, ce nouvel « instrument » oxonien d’investigation du monde des phénomènes, trouvera un champion en Francis Bacon, dont le Novum Organon scientiarum – 1620 - tire les conséquences pratiques du rejet de l’aristotélisme. Dans le même temps, la mathématique constitue, en quelque sorte, après la tabula rasa cartésienne, une arkhê ferme pour étayer la science des Temps modernes. Les révolutions scientifiques du début du XVIIe siècle auront une portée utilitariste revendiquée et des conséquences politiques : la subjectivation, nécessairement centrée sur l’individu, donnera, explicitement ou implicitement, aussi bien l’absolutisme (Hobbes, « homo homini lupus est ») que la démocratie potentielle (Descartes, « […] la puissance de bien juger et distinguer le vrai d'avec le faux, qui est proprement ce qu'on nomme le bon sens ou la raison, est naturellement égale en tous les hommes »). Le baroque part du bas pour aller vers le haut toujours plus inaccessible ; il est vision humaine, d'un homme soudain perdu dans le cosmos. Montaigne a pris acte : ne reste plus que l'homme relatif, et il faut essayer d'en être heureux. Les jésuites ont essayé d'aménager la demeure, par une sorte de tranquillité active (Saint François de Salles, qui doit tant à Montaigne), suscitant l’indignation de Pascal.
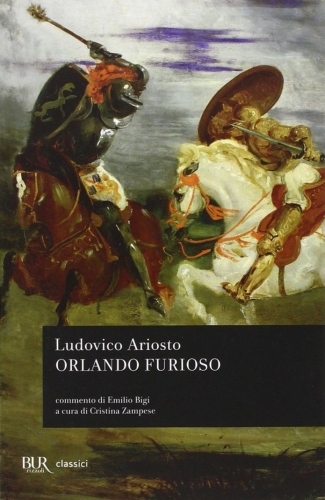
Ambivalent, le baroque donne une structure « culturelle » à la reconquête des esprits et des cœurs par l’Église catholique, mais il est aussi une aspiration violente à la liberté. Il préfigure le romantisme. L’aristocratie, dès la deuxième moitié du quattrocento, à partir du triomphe européen de la Renaissance et des grandes chevauchées italiennes, désirait ressusciter les Grands Hommes de l’Antiquité, les héros mythologiques grecs et romains, ou bien les preux de Charlemagne (ceux de la Matière de Bretagne étant passés de mode au XVIe siècle) – ainsi Boiardo, avec l’Orlando innamorato (1483), L’Arioste, avec son Orlando furioso (1516), et Le Tasse, avec sa Jérusalem délivrée -, tendance qui allait perdurer tout au long du XVIIe siècle, comme une réplique concurrente de divinisation royale, dont l’achèvement fut l’apothéose solaire de Versailles. Ces chimères épiques et tragiques, héroïques et flamboyantes, que Nerval n’aurait pas désavouées, destinées à se transmuer en œuvres opératiques ou en romans à clés, étaient impuissantes devant la froide nécessité socio-politique. Elles inspireront les chefs de la Fronde ou des guerres étrangères : c’étaient souvent les mêmes, comme Condé-Cyrus, mais les duchesses et comtesses n’avaient pas voulu être en reste sur ce chapitre glorieux.
Au début du siècle, après le chaos des Guerres de religions, Henri IV, ayant remis de l’ordre, du moins provisoirement, et le Cardinal Rouge ayant pris la suite, la mise en pratique des intuitions absolutistes développées par Bodin dans La République, s’imposait, en attendant leur réalisation complète avec Louis Le Grand. La contre-Réforme oriente les esprits dans les principes d’obéissance. Les poètes, dans les salons, notamment celui de la marquise de Rambouillet, se font arrangeurs de syllabes et joueurs mondains. Peu à peu, la nouvelle noblesse de cour, pénétrée par la bourgeoisie riche, prend le contre-pied des aristocrates du XVIe siècle, qui étaient animés par un esprit affranchi. Malherbe est venu et a initié ce qui allait devenir le classicisme, cette autodiscipline de l’art, faite de rétention, d’ascèse, d’appauvrissement de la langue et de contraintes consacrées par la création de l’Académie française en 1635, entreprise – souvent hasardeuse- de domestication des intelligences et des talents. Les règles, au théâtre, s’imposeront dans les années 30, ainsi que les « poètes grammairiens », les « docteurs en négative », comme le dénonce Mlle de Gournay.
La révolte poétique sera l’expression du refus d’une entreprise littéraire cornaquée par la Ragione di Stato, dont l’incarnation despotique est Richelieu. Les champions de la rébellion en seront, dans le domaine théâtral, Hardy, le grand Corneille lui-même, avant qu’il ne se plie, avec génie, aux règles, et en poésie, Régnier, anti-conformiste, individualiste original, Théophile de Viau, libertin converti, qui, bien que « moderniste », avait toujours sous sa plume le mot de « franchise », mort à 36 ans après avoir été mis au cachot par les cagots, Boisrobert, sévère envers un siècle voué à l’argent, Saint-Amant, La Ménardière, qui célébra « le grand Ronsard », le concettiste Tristan… Tous ces écrivains sont des êtres de plein air, des amants de la liberté, de la libre expression de soi (comme Angélique, cette Fille du Feu), sans laquelle il n’est pas de noblesse. Même Sorel, le satirique qui ne l’aimait pas, louait « l’âme véritablement généreuse ».

Et il n’est pas d’auteur exprimant mieux cette aspiration qu’Honoré d’Urfé, qui a donné à la France l’exquis roman pastoral L’Astrée, qu’il situe dans le Forez, au milieu des bergers et des druides. Rien de plus étranger à l’ancien ligueur catholique que la médiocrité. Il prône une éthique platonicienne, fondée sur l’amour, le sublime, l’enthousiasme, la générosité, tous mouvements de l’âme et du cœur qui portent le fini vers Dieu. Honoré d’Urfé, c’est l’anti-Descartes, le négateur de l’esprit géométrique. Racan le suivra dans ses Bergeries, célébrant l’âge d’or. Mais l’Astrée est une utopie dans un siècle qui s’adonne à l’intérêt, à l’utilité, à l’ambition calculée, à la ruse, à la mathématique appliquée.
Face à une modernité triomphante, celle de la Raison, le baroque, lui-même paradoxalement mouvement d’« avant-garde », se manifeste comme la prise hyperbolique d’une réalité vaine et fuyante, un tourbillon frénétique de sensations exaltantes ou mortelles, l'ivresse angoissée au cœur du vide, et la conviction que la vie, comme l’affirme Calderón de la Barca, se joue sur une scène, sur El Gran Teatro del Mundo : La vida es sueño. Quelle est donc la sagesse de Sigismond, jeune héritier du trône (ce roi dépossédé, comme Nerval l’héritier inconsolé d’un lointain empereur...), prisonnier du roi Basile (encore un thème nervalien!)? Même si l’existence est irréelle, si vraiment je rêve – comme un fou ?, et que rien ne prouve la réalité de ce que je crois avoir la consistance du réel, si bien que j’ai l’impression de vivre tout en rêvant, et de rêver, tout en vivant (« La vie est un songe, et les songes eux-mêmes ne sont que des songes »), j’agirai comme si c’était réel, fût-ce en rêve, c’est-à-dire avec honneur et humilité. Il est possible d’être maître de soi, même dans le songe. L’affirmation du moi transcende toute détermination psycho-sensorielle et mentale, tous les ancrages aux mondes possibles. Il est un absolu, telle la folie.
Au XVIIIe siècle, la séparation, dans l’ordre de l’épistémologie (que puis-je connaître?) entre l’homme et le monde qui lui est « extérieur », entre le phénomène et le noumène, comme dit Kant, entre ce que notre « conscience », générée par nos structures cognitives, perçoit, appréhende, et la « chose en soi », inaccessible, est admise, du moins dans certains cercles philosophiques (cela n’empêche pas le commun des mortels d’agir naïvement comme si le monde était « réel », et il aurait été bien surpris, ce jedermann, qu’on tentât de le persuader qu’il en fût autrement =. Cependant, l’idéalisme allemand va essayer de résoudre le problème de cette dichotomie en faisant abstraction du noumène.
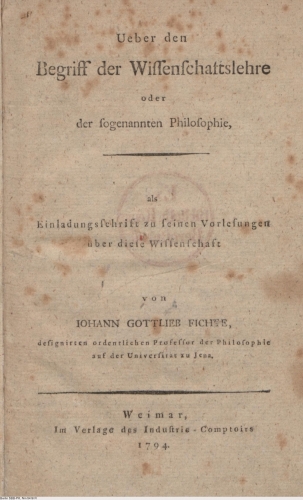
La Wissenschaftslehre (« Doctrine de la science »), est publiée en 1794. Fichte pose le moi comme fondement du monde, jetant ainsi les bases de ce que sera plus tard la phénoménologie. La réalité n’existe pas en-dehors de la conscience. Aucune frontière n’est destinée à interdire la création. Le rêve s’offrait ainsi à l’investigation du Je. Novalis en parsème son œuvre. Pour Friedrich Schlegel, il est un moyen d’accéder à des réalités supérieures. Gotthilf Heinrich Schubert en analyse la symbolique. Avec l’idéalisme allemand, les spéculations sur la fusion de l’art et du réel (de Novalis à Wagner) seront récurrentes (1). On ne connaît pas exactement la liste des romantiques germaniques que Nerval a pu étudier, et s’il a lu les idéalistes – Kant, Fichte, Schelling, Hegel – comme Madame de Staël l’avait fait. Il ne maîtrisait pas suffisamment la langue allemande pour aller loin, bien qu’il traduisît, outre Faust, plusieurs poètes allemands (Goethe lui-même, Schiller, Klopstock, Burger, Jean-Paul Richter etc.). Le romantisme français, comme le fait remarquer Julien Gracq, n’« a que très vaguement connu » le romantisme allemand, et a, dans l’ensemble, hormis Nodier et Nerval, parfois Hugo, méconnu la dimension infinie de l’être intérieur, pour se « pay[er] de menue monnaie [...] : médiévalisme, orientalisme, inauthentique charme des nuits de lune, petites mélancolie des crépuscules », à l’exception du « sens tragique, inexorable, de la pesée de l’histoire - ignoré de l’Allemagne de Kant et de Hegel » (Préface de Henri d’Ofterginden, de Novalis).
Toujours est-il que, pour Nerval, et du reste pour la plupart des romantiques, le Je est la source de toute connaissance et expérience. Mais il élargit ces plongées davantage que quiconque, jusqu’à l'"infra-conscient", dans les racines mêmes de ce qui fait « image », dont la nature cachée laisse pressentir des mystères, et peut-être même des divinités, des monstres, ou des lieux habités par les ancêtres, aussi graves que la réalité et peut-être plus denses, lestée d’une charge spirituelle plus forte que dans la vie éveillée. Car, par « infra-conscient », il faut comprendre le rêve, mais, lorsqu’on lit Nerval, on voit qu’on va aussi profondément que le fit Freud, lequel, on s’en souvient, suscita une admiration enthousiaste de Breton, en 1920, à la grande surprise du psychanalyste (au prix d’un malentendu, car, pour Breton, et, plus tard, dès 1924, les surréalistes, comme pour Nerval, l’explicitation du rêve, ou de tout récit profondément intériorisé, ne vise pas à guérir d’une psychopathologie, à s’en délivrer, mais à retrouver le monde, à l’habiter). Selon Nerval, il s'agit d'un Réel aussi tangible et existentiel que le monde de l'éveil, la balance égale entre le monde physique de la veille et l’aisance du sommeil, dit René Char. Le « Réel », la Poésie, donc, mise en pratique. La Poésie, c’est la vraie vie, excédant, ô combien, le graphisme de la feuille imprimée.
Toute cette manifestation subversive est dirigée contre la conception cartésienne de l'intellect, instrument de maîtrise, de domination de la nature. Le sensible, que Descartes considérait, à la suite de Platon, comme menteur, devient source de vérité, non seulement le sensible extérieur (les paysages, la beauté des choses, la musique etc., souvent mêlés de la mémoire des mythes et des souvenirs littéraires ou picturaux), mais aussi le sensible intérieur, qui est un continent inexploré, immense, qu'il faut parcourir pour restaurer le divin, et réanimer les anciens dieux et déesses, ainsi que les Titans révoltés. Le rêve est en effet sensation de monde qui mène jusqu’à l’origine de toute chose, qui offre la clé ouvrant à la vraie vie. "Je crois à la résolution future de ces deux états, en apparence si contradictoires, que sont le rêve et la réalité, en une sorte de réalité absolue, de surréalité, si l'on peut dire ainsi." (André Breton, Manifeste du Surréalisme (1924)).
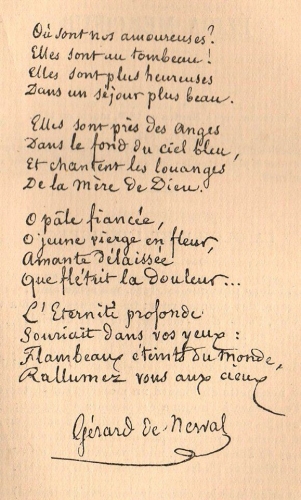
Nerval et l’écriture
Ainsi, une fois donc qu'on a parcouru la voie labyrinthique des œuvres de Gérard de Nerval, et qu'on pense, non sans quelque vanité, en être sorti, s'aperçoit-on bien vite qu'il est inutile de fonder la connaissance qu'on croit obtenir de lui sur les données, fiables ou non, qu'abandonnent à notre curiosité des documents divers sur sa vie, dûment enregistrés par les multiples instruments taxinomiques que possèdent les archives de la police, de la société des Lettres ou de la vie civile. Il échappe à la classification, et déborde les discours qui voudraient le fixer au mur de la critique comme un papillon.
Nerval est tout poésie, c'est-à-dire création, et avant tout de lui-même – c’est peut-être là source de fatalité et de tragédie - ; son identité erratique suit les méandres de son écriture. Ce mystère s’est inscrit dans sa mort. Son suicide, à l'aube du 26 janvier 1855, dont les causes vraisemblables s'imposent au bon sens – la misère, la maladie, le froid extrême (-20°), la nuit angoissante, la solitude, l’abandon -, demeure néanmoins de tous ses actes le plus énigmatique et le plus paradoxal, si l'on s'en rapporte aux accents lumineux et positifs de la fin d'Aurélia, œuvre posthume, notons-le, qui survit à sa mort biologique, non sans ironie hoffmannienne.
La situation de Nerval devant son œuvre manifeste un autre rapport au mot que la transparence naïve que louait le classicisme bannissant le trouble et le désordre. Il avait donc, dès 1828, touché par le charisme du « prophète » Hugo, embrassé la cause romantique. Plus profondément, il prit au sérieux le cahier des charges de la littérature, avant qu’elle ne subît, dès la Grèce classique du Ve siècle, l’opprobre de contredire la rationalité philosophique, scientifique, ou technique. Le romantisme va bien au-delà des mérites que l’« École » française lui accorda : le sens de l’Histoire, la liberté, l’imagination, la révolte, et même, à Paris et en Italie surtout, la tentation humanitariste et politique. Certes, la Révolution, plus que le royalisme qui, du reste, fut aussi rétif face à lui que les libéraux voltairiens, fut au fond le véritable ébranlement par lequel la passion s’immisça dans les cerveaux échauffés. Chateaubriand lui doit beaucoup, et jamais Nerval ne la renia. Saisissant même les romantiques allemands, et certains Illuminés, comme Louis-Claude de Saint-Martin, en France, qui espérait l’instauration d’une nouvelle religion, à la place du christianisme, elle ouvrait tous les possibles.
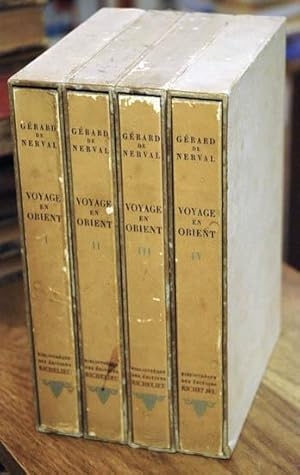
Pourtant, il faut aller chercher beaucoup plus loin les sources de la subversion romantique, et l’on retrouvera Nerval, qui est de son temps tout en l’excédant.
Nerval tenta, en décembre 1842, le retour aux sources, l’Exil volontaire, réponse décidée à la crise qui l’avait abattu en février 1841, le « Voyage en Orient » (dont on sait qu’il fut plus réécrit, que donné tel quel), la quête des origines du Divin, de la naissance de la Lumière et de la Sagesse. Ex Oriente Lux. Il y chercha la hiérogamie, le Dieu Soleil, la coïncidence de tous les contraires, de la femme et de l’homme, de l’homme et du Divin, de la Nuit et du Jour, de l’Est et de l’Ouest, du Feu et de la Poussière, de l’ascension et de la chute, de la base et du sommet, du passé et du présent. Mais il ne parvint pas à la conscience unificatrice. Tout échec mûrit. Il en garda une vérité : l’Orient se trouve au seuil de la maison, dans « le lit du poète », affirme-t-il. Pour Nerval, de retour d’Orient, le « chemin » de la demeure est d’abord le sol natal, le Valois, dont il essaiera de (re)trouver le cœur, la mémoire, et en même temps son identité profonde. Après l’épreuve du voyage, de l’étranger, de l’étrange, il faut que le poète « apprenne maintenant », comme l’écrit Heidegger à propos du poème Souvenir, de Hölderlin, « le libre usage de ce qu’il a en propre ». Mais ce sera encore une épreuve vaine.Les vrais paradis sont les paradis qu'on a perdus, affirme Proust. Définitivement. Pourtant, le secret se situe encore plus proche de soi, au plus profond de soi-même. Novalis le dit : « Le chemin mystérieux mène vers l’intérieur ».
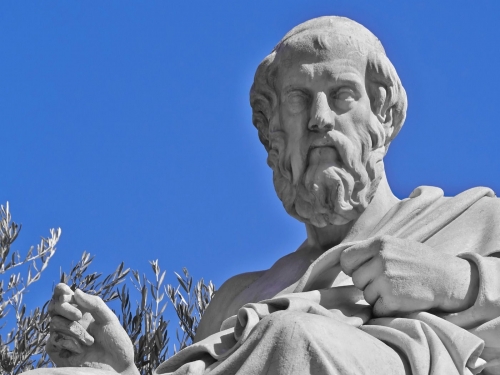
La quête intérieure
Revenons à Platon. Le « tournant platonicien », comme on le sait, bannit le poète de la Polis, comme fauteur d’erreur, susceptible donc de gâcher l’esprit des jeunes éphèbes. Son statut privilégié, que l’on note par exemple chez un Pindare, chez les Inspirés de l’âge préclassique de la Grèce, et qui semblait prévaloir depuis au moins Homère et Hésiode, fut soudain déchu, quand les Muses furent accusées de mentir. La poésie, premier langage de l’Occident, était le pont entre l’Olympe et les humains. Elle s'opposait à la prose, promue langue philosophique par Platon. Les « théologiens » (philosophes) pré-socratique usaient d’une langue qui se rapprochaient de la poésie. La poésie est versification, utilisation de l’allégorie, de la métaphore, codification qui lui montre sa mission mystique, d’établir un espace commun entre dieux et hommes. Ce n’est pas une utopie, comme le sera la République des Lettres de la Renaissance, ni l’Arcadie, mais une hétérotopie, un monde réel, autre (nous retrouverons cette dimension, mais dans le domaine du rêve), où les Muses servent d’intermédiaires entre les dieux et le poète « inspiré » s’adressant à un public pour qui l’existence des dieux ne fait aucun doute. La muse met en parole – ennepe ( ἄνδρα μοι ἔννεπε Μοῦσα ; « Muse, dis-moi l’homme ») – le message venu d’ailleurs. A partir de Platon, qui ne jurait que par la « géométrie », Calliope n'eut plus la prétention de servir de médiation entre le vates et le Divin, et se contenta d’orner la vie, comme une figure rhétorique.

La période hellénistique, alexandrine, fut une ère de rationalisation plus ou moins désacralisante de la poésie, malgré Théocrite. Et aussi malgré Virgile, qui l’entra dans le vaste corpus mystique du néo-pythagorisme. Mais le classicisme latin, volontiers scolaire, héritier de l’alexandrinisme, poli par la paideia, formateur du citoyen eruditio et institutio in bonas artes, eut tendance à réduire le poète à l’état d’artifex, de facteur de versification. La poésie, la langue poétique, s’afficha comme τέχνη, jusqu’à un âge encore assez récent. Rimbaud, déjà, s'en désolait : Voici de la prose sur l’avenir de la poésie -Toute poésie antique aboutit à la poésie grecque ; Vie harmonieuse. — De la Grèce au mouvement romantique, — moyen-âge, — il y a des lettrés, des versificateurs. D’Ennius à Théroldus, de Théroldus à Casimir Delavigne, tout est prose rimée, un jeu, avachissement et gloire d’innombrables générations idiotes ....
Marc Fumaroli avait, dans l’un de ses ouvrages brillants d’érudition, L'Age de l'éloquence : Rhétorique et «res literaria» de la Renaissance au seuil de l'époque classique, souligné combien un passage du Dialogue des orateurs, de Tacite - vers 102 ap J.C. - proposait aux Romains lettrés, entérinant l’inutilité civique de l’art oratoire dans un régime qui étouffait la liberté républicaine, désormais désuète, de nouvelles perspectives – le bonheur apolitique du locus amoenus, comme vita nova de l’honnête homme. Cette utopie bucolique et poétique, celle de Théocrite et de Virgile, qui avaient écrit dans un cadre monarchique, celle aussi du Cicéron du Jardin et de la Bibliothèque, sera restituée à la Renaissance, et l’Arcadie de Jacopo Sannazaro va nourrir l’imaginaire humaniste, puis baroque, jusqu’au romantique Rousseau, que Nerval idôlatra.
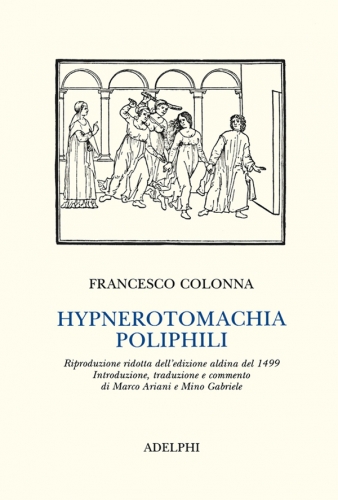
C’est aussi en 1499 que le fameux libraire-imprimeur vénitien Aldo Manuce édite l'Hypnerotomachia Poliphili, de Francesco Colonna, œuvre quasi onirique qui irrigua l'imaginaire européen, la littérature et l’art des jardins, jusqu'à Nerval, et dont l'esprit habite le merveilleux tableau de Watteau, Pèlerinage à l'île de Cythère (car il s'agit véritablement d'un périple sacré, pareil aux mystères antiques), que l’on retrouve, romancé ou rêvé, dans Sylvie, ainsi que dans Le Grand Meaulnes, Ce fut un retournement inouï, qui nous ouvrit à un monde intérieur, loin de tout engagement civique. Nerval, même s’il évoque des figures historiques, et parfois effleure, comme par inadvertance, en passant, pour ainsi dire, les évènements d’actualité, parfois tragiques, est dans un territoire en marge, hors de l’Histoire. Il partagea très vite, avec maints romantiques qui s’étaient illusionnés sur les promesses des Trois Glorieuses, la déception, et même le dégoût, qu’inspira alors la politique.
Mais s’il faut retrouver des précédents, à ces Écoles buissonnières si pleines de charmes, on peut remonter aux guerres civiles qui déchirèrent l’Urbs, et aboutirent à l’Empire, à ces Latins qui défièrent la virtus romaine exigeant qu'on ne devînt homme (uir, quiris) qu'en servant, les armes à la mains, dans les légions, aux confins de l'Univers, pour reculer ou défendre les frontières de l'Empire, ou bien sur le forum, en se donnant à la Res publica. Le fil d’or de la passion, asociale (Tristan et Iseut) et néanmoins dévoilement de vérité, court de Catulle à Baudelaire, en passant par Tibulle, Properce, Ovide, Pour aggraver le cas de ces déserteurs, l’amour est considéré comme le cœur de l’existence, dans une société guerrière qui l’appréhende comme une maladie, comme une déchéance. C’était anticiper. Plus tard, beaucoup plus tard, le troubadour Guiraut Riquier affirmera : « Non es hom senes amor valens » , « On ne peut avoir de valeur sans l'amour ». Amour, alors, fut cette torture merveilleuse, qui permit de découvrir les abysses jusque-là insondés du cœur humain, et prépara cette Odyssée où Nausicaa serait devenue la véritable héroïne d’Homère, et Aurélia l’inspiratrice d’un livre bouleversant, à nul autre pareil. Les chantres de l’amour passion, ou mystique, abondent (et, au XIIIe siècle, avons-nous bénéficié, peut-être, de l’apport raffiné de la poésie arabe, qui influença les Fidèles d’amour - dont l’existence est hypothétique -, source lyrique et ésotérique de la Vita nuova, de Dante) : Apulée et son exquis Âne d'or, puis les troubadours, Chrétien de Troyes, la Matière de Bretagne, Shakespeare, L'Astrée, d'Honoré d'Urfé, Madame de La Fayette, Les Lettres portugaises de Guilleragues, Stendhal, Nerval, etc. L’éros devint le plus sérieux concurrent de l’agapè chrétienne. « Elle n'est sujette, la nature, à s'illuminer et à s'éteindre, à me servir et à me desservir que dans la mesure où montent et s'abaissent pour moi les flammes d'un foyer qui est l'amour, le seul amour, celui d'un être. » (André Breton ; L’Amour fou) .
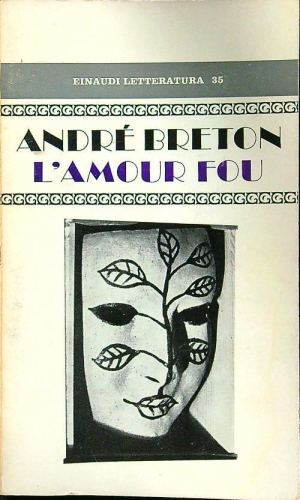
Bref, ce que l’Europe recouvra, avec le romantisme, c’est, en déliant les entraves de la convenance littéraire, qui tenaient le cœur en captivité, la saveur du grand large, le goût de l’infini et de la liberté, dont l’amour est comme l’allégorie.
Il ne fallut donc pas attendre la déchéance de Casimir Delavigne – inspirateur, au demeurant, du jeune Gérard, avant 1828 – pour que resurgît la poésie « grecque » : la Renaissance ranima l'étincelle mystique, par le revif de l'orphisme et du néoplatonisme, sève d'un ésotérisme qui va nourrir en partie les Temps modernes, ainsi que, subrepticement, l'inspiration nervalienne. Entre-temps, le souffle irradiant de la Bible, toujours sous braise depuis la destruction du Temple, mais désormais incandescent, fut attisé par la Réforme et le catholicisme inspiré, parfois soupçonné d’hérésie ou de saveur ésotérique, réfractaire à la « Philosophie ». A côté de la Raison démonstrative, de plus en plus dominatrice en Europe, et la contrariant, la « raison du cœur » rafraîchit la haute poésie, celle des prophètes, offrant à l'imagination et à la passion le Sturm und Drang qui lui était nécessaire, c'est-à-dire l'instinct de liberté et le sentiment de l'infini, dans le monde extérieur et au-delà, mais surtout dans l'intériorité de l'esprit, dans le rêve où se joignent microcosme et macrocosme, et où les contraires coïncident. Face à une civilisation de plus en plus froide et desséchée, sujette aux emballements matérialistes et à la réserve sceptique, on put ainsi redevenir prophète, vates, vaticinateur, et, pourquoi pas, magicien, ou brigand au grand cœur. Ou Illuminé. Ou Voyant. Et ce fut le Romantisme.
La « folie », une voie initiatique
Toutefois, l'œuvre de Nerval n'est pas, à la manière romantique, un épanchement, une confession lyrique, un abri pour le moi, mais le théâtre tragique de son élaboration, de son accomplissement, de son exaucement, dans l'angoisse et la joie. Le verbe est créateur de sens. Il réalise son sens, il est performatif, et c'est pourquoi il est dangereux. Il suit intimement, sans écart, les sinuosités du labyrinthe de la vie, et les éclairs de rêves. Il est lui-même lueur révélante, apocalyptique, illuminante, si l’on ose cette tautologie, et dédale où se dissimule le minotaure, ou bien grotte où s'ébattent les nymphes. Il est la clé qui force le sens, l'Absolu, l’Éternité, le Salut. Mais il est incomplet : il faut trouver la lettre qui manque ; chercher, toujours, sans fin, au-dessus de l'abîme.
Et l'on voit ce qui, soudain, change avec Nerval, et annonce un nouveau continent de la connaissance. Au lieu de se laisser happer par le monde des images, par les visions, de se perdre dans le gouffre de la folie, il tente de maîtriser cet « épanchement », avec une volonté remarquable et poignante, et non seulement d'en considérer les terribles merveilles comme un univers réel, au même titre que celui d'ici, de la terre lourde et laborieuse, mais d'en tirer toutes les leçons, d'en explorer les arcanes pour trouver la lumière. Rappelons l'émouvant et fameux aveu de Baudelaire, pourtant guère prolixe au sujet d'un poète si proche de lui dans le temps et dans l’inspiration, dans la tonalité, répondant au calembour injurieux de Veuillot, qui, dans L'Univers du 3 juin 1855, avait écrit que Nerval avait non pas spiritualisé, mais alcoolisé sa vie : « Qui ne se rappelle les déclamations parisiennes lors de la mort de Balzac, qui cependant mourut correctement ? — Et plus récemment encore, — il y a aujourd’hui, 26 janvier, juste un an, — quand un écrivain d’une honnêteté admirable, d’une haute intelligence, et qui fut toujours lucide, alla discrètement, sans déranger personne, — si discrètement que sa discrétion ressemblait à du mépris, — délier son âme dans la rue la plus noire qu’il put trouver, — quelles dégoûtantes homélies !... »
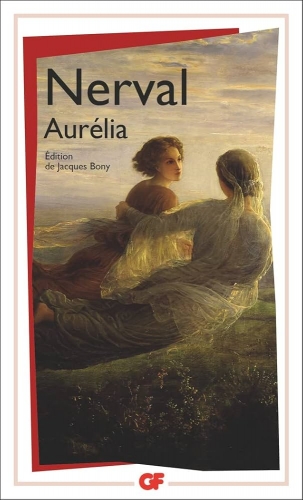
Nerval est peut-être l'être le plus pieux que le XIXe siècle eut sécrété. Dans Aurélia, il indique « les causes d'une certaine irrésolution [les principes de la Révolution, le rationalisme, le scepticisme voltairien] qui s'est souvent unie chez [lui] à l'esprit religieux le plus prononcé ». Il est passé à côté de son temps, et pourtant, il est l'âme d'un âge où la divinité a définitivement quitté la terre désormais désertifiée des hommes, comme l'est la Cythère de 1843, la Cérigo occupée par les Anglais, que surplombe, sur une colline desséchée battue par le clapotis de la Mer de Crète, cette Crète où Ariane dévide son fil, un pendu qui se voit de loin. Il clame dans le désert, en affrontant, dans son propre esprit, le nihilisme qui le ronge comme un monstre chimérique sorti du chaos.
L'expérience du rêve, liée à celle de la nostalgie des origines, transmute sa trajectoire en initiation, en « glissement vers le mythe », comme dit Albert Béguin. C'est retrouver l'aube de l'humanité, l'épanchement du rêve dans la vie réelle, et les déesses, les dieux rendus à la visibilité, à la vénération qui leur est due ; c'est l'expansion du moi, au-delà de la faute originelle, de la mort, de la souffrance, de la solitude, vers une dimension universelle qui concerne l'humanité entière et son destin. Se sauver est retrouver l'harmonie, lui redonner vie, peut-être même rappeler les dieux sur terre, et reconstituer l'Arcadie, l'âge d'or, une nouvelle Cythère, parée d'un amour printanier.

Non sans péril, celui de haute mer. Albert Béguin le rappelle : « Ceux qui se risquent à ces explorations intérieures en ramènent des œuvres singulières et durables, qui conservent de leur auteur, non point son être accidentel et périssable, mais son essence et sa figure mythique. Ils cherchent à rejoindre le plan profond où se déroule, non plus leur propre histoire terrestre, mais leur destinée éternelle. Comme le mystique, ils paient de l'anéantissement de leur personne la plongée dans la nuit. » Heidegger le dit de même : « La détresse en tant que détresse nous montre la trace du salut. Le salut é-voque le sacré. Le sacré relie le divin. Le divin approche de Dieu. / Ceux qui risquent plus appréhendent, dans l’absence de salut, l’être sans abri. Ils apportent aux mortels la trace des dieux enfuis dans l’opacité de la nuit du monde. »
Nerval dit de lui-même, dans Promenades et Souvenirs : « Je suis du nombre des écrivains dont la vie tient intimement aux ouvrages qui les ont fait connaître. » En vérité, Wege – nicht Werke : « Des chemins, non des œuvres », comme écrivait Heidegger quelques jours avant sa mort. Nerval reprocha à Alexandre Dumas de ne produire que des articles de consommation, des objets de divertissement. Lui, expérimentait. Ses livres étaient des quêtes risquées, des jeux d’arène dangereux où danse la corne du taureau. Lorsqu’avec lui, on évoque la « littérature », il est capital de s’enlever de l’esprit l’acception courante, triviale, de ce mot.
Être tout « littéraire », c’est-à-dire rêve, est une autre façon d’affirmer sa folie. Dans une Lettre à Mme Dumas, il s’indigne: "...Mais comme il y a ici des médecins et des commissaires qui veillent à ce qu’on n’étende pas le champ de la poésie aux dépens de la voie publique [ Nerval évoque la sempiternelle dénonciation de la littérature – vaine, inutile, nuisible – de la part des êtres positifs, ayant pieds sur terre, qui œuvrent pour le Bien commun, et mettent l’utilité pratique, celle des économistes et des banquiers, au-dessus de toute la beauté du monde – qui, le rappelle Gautier, ne sert à rien ], on ne m’a laissé sortir et vaguer définitivement parmi les gens raisonnables que lorsque je suis convenu bien formellement d’avoir été malade, ce qui coûtait beaucoup à mon amour-propre et même à ma véracité. Avoue ! avoue ! me criait-on, comme on faisait jadis aux sorciers et aux hérétiques, et pour en finir, je suis convenu de me laisser classer dans une affection définie par les docteurs et appelée indifféremment théomanie ou démonomanie dans le Dictionnaire médical. À l’aide des définitions incluses dans ces deux articles, la science a le droit d’escamoter ou réduire au silence tous les prophètes et voyants prédits par l’Apocalypse, dont je me flattais d’être l’un ! Mais je me résigne à mon sort, et si je manque à ma prédestination, j’accuserai le docteur Blanche d’avoir subtilisé l’esprit divin. »).
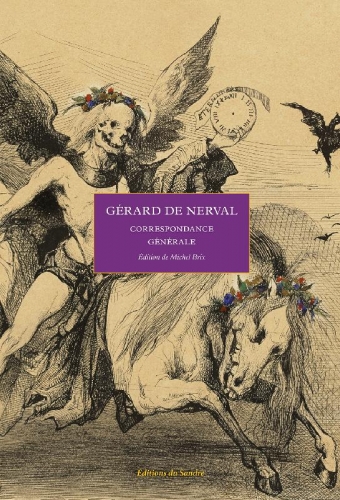
Nerval proteste contre la version clinique, et met l'accent sur la dimension "poétique" (existentielle, en vérité), sur la "voyance", à la suite des romantiques allemands comme Novalis. La "folie" (liée au rêve) est un autre nom pour désigner la création "poétique" (ces deux mots sont des pléonasmes), mais aussi le véritable royaume de la vie humaine, qui ne correspond pas au domaine restreint et restrictif de la conscience "diurne", trop mesquine et trompeuse. La vérité se trouve à l'intérieur de l'être humain, et le monde extérieur est le résultat de la projection de ce contenant trop inexploré. Évidemment, pour un scientifique comme le docteur Blanche (portant très ouvert, adepte de méthodes douces et intelligentes), c'est là une perception entachée de suspicion. Dans les faits, nous ne nous en apercevons pas, mais nous sommes des fous, nous vivons comme des fous. Certes, des fous qui se parent d'un costume "raisonnable", pour donner le change. A moins que nous ne soyons des rêveurs qui croient, parfois, ne pas rêver.
La littérature rend visible, lisible, réelle, cette « folie ». L’île de Calypso, l’antre du Cyclope, dans l’Odyssée, la Terre du Milieu, du Seigneur des anneaux, l’Enfer, de Dante, sont lestés de plus de réalité, de présence (parousia) que le décor urbain évanescent, exsangue et fantomatique de nos besoins erratiques, qui, de la maison au supermarché, de la voiture au bureau, ornent notre vacuité existentielle ; et Julien Sorel, Hamlet, Rastignac, le Grand Meaulnes, Rodion Romanovitch Raskolnikov, Erec et Enide, Don Quichotte (ce proto-Nerval), Madame Bovary, Bouvard et Pécuchet, sans parler du pharmacien Homais, et même, dans les Évangiles, Pierre, Paul, ou Jean, existent davantage, que mon voisin, ou que le ministre de l’économie du moment, et me sont peut-être comme des étoiles à suivre, ou à ne pas suivre. Ils sont la réalité, en vérité. Peut-être la plus authentique, celle qui possède un sens. Ne dit-on pas que les femmes du peuple montraient Dante du doigt, considérant le teint cuivré de son visage comme le témoignage irréfutable de son séjour en Enfer ? Elles avaient la foi du charbonnier. Combien ont cru que Malraux avait participé à la guerre civile de 1927, à Shanghai, et qu’il avait même été l’un des chefs de l’insurrection ? Ernst Jünger, quant à lui, entre deux coups de feu, lisait avec passion le Roland furieux, de L’Arioste. « Je veux dire que l’héroïsme, pour moi, naissait davantage d’une expérience littéraire que d’une effective et concrète possibilité de vie. » Il tint ses propos en 1995, à l’occasion de sa centième année.
Les paysages mentaux et le théâtre de nos songes, tout « imaginaires » qu’ils soient, peuplent davantage, même le jour, la salle obscure de notre existence, que ce que l’on appelle la « réalité », mais qui ne se résout qu’à une cascade de données sans signification véritable. Et nous ne sommes essentiellement cette « folie » : grande ou petite.
Note:
(1) « Après toutes ces citations poétiques, je puis moi aussi me permettre d’employer une image. La vie et les rêves sont les feuillets d’un livre unique : la lecture suivie de ces pages est ce qu’on nomme la vie réelle ; mais quand le temps accoutumé de la lecture (le jour) est passé et qu’est venue l’heure du repos, nous continuons à feuilleter négligemment le livre, l’ouvrant au hasard à tel ou tel endroit et tombant tantôt sur une page déjà lue, tantôt sur une que nous ne connaissions pas ; mais c’est toujours dans le même livre que nous lisons. »
[…]
« Si l’on se place, pour juger des choses, à un point de vue supérieur au rêve et à la vie, on ne trouvera dans leur nature intime aucun caractère qui les distingue nettement, et il faudra accorder aux poètes que la vie n’est qu’un long rêve. »
Arthur Schopenhauer, Le monde comme volonté et comme représentation, 1819 (mais la publication n'en a été faite, en France, qu'en 1886.
15:48 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, poésie, 19ème siècle, romantisme, romantisme français |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 17 avril 2025
Nerval, l'homo viator

Nerval, l'homo viator
par Claude Bourrinet
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002364487528
Seuls les ignorants ou les sots considéreront encore Nerval comme un écrivain mineur. Longtemps, il fut tenu dans les marges de la grande littérature, non seulement dans les manuels scolaires, mais aussi par la critique. Il y a des raisons à ce mépris, qui ne tiennent pas seulement aux carences des littérateurs. Nerval fut, dans la postérité, aussi intempestif que de son vivant. Il incarne, dans une sorte de pureté effrayante, qui aboutira à la mort sordide, l’essence de la littérature, qui est l’exil.
Car non seulement il illustra, en France, un mouvement romantique, qui, dans les faits, n’était pas homogène, mais il se rattachait à un courant, à une tradition, qui excédaient un XIXe siècle qui était aussi stupide que notre époque. Il fut un antimoderne, comme la plupart des écrivains « maudits » de cet âge scientiste et industriel qui reconnut ouvertement, dans une angoisse mortelle, la mort de Dieu. Il exprima une révolte profonde, au-delà des griseries idéologiques.
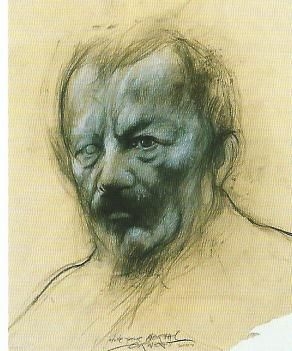
Il fut influencé par le romantisme allemand, autrement plus profond qu’un romantisme français volontiers historien, politique, et qui versa en partie dans un humanitarisme benêt. Il ne lut probablement pas Fichte, l’initiateur de l’idéalisme allemand, mais il connut Novalis, Brentano et Hoffmann. Le moi est un univers, c’est l’univers, le monde. La quête de Nerval, depuis l’explosion de démence qui le projeta vers l’Étoile, le 23 février 1841, et à la suite de son échec en Orient, en 1843, devint intérieure. Là se trouvait le divin, et le cosmos (et il rejoint dans cet itinéraire Goethe, et le Faust, le deuxième, celui de l’invocation des Mères). L’Univers est un tout, qui contient, et, dans le même temps, se trouve contenu. Avec Nerval, les frontières disparaissent, entre la vie vernaculaire et cette seconde vie, aussi réelle que la première, qu’est le rêve. Il s’y meut dans un monde aux multiples labyrinthes existentiels, à la recherche des origines, de la patrie mystique, celle qui octroie l’Identité (ayant cru, un moment, la retrouver dans son enfance, anamnèse déambulatoire qui lui faisait hanter les paysages de son Valois natal – mais l’essence du Paradis, dira Proust, est d’être à tout jamais perdu). Peut-être sa condition d’homo viator est-elle, au fond, sa véritable « identité », tant dans la première vie, que dans la seconde. S’il a trouvé quelque chose, un « sens », ce n’aura été qu’en ayant toujours à chercher, et finalement à se perdre.
Il ne faut pas prendre sa folie, dont l’une des déclinaisons est justement la dromomanie, geste dérisoire de la quête, comme uniquement la manifestation d’une pathologie – ce qu’elle est, bien entendu, en partie. Le surréalisme, qui poursuivit ce que Nerval avait commencé, y voyait une initiation à la vraie vie. L’existence sans folie n’est qu’un squelette sans chair et sans âme. Nous vivons aussi bien dans une dimension « matérielle », sociale, prosaïque, que dans un rêve qui s’y épanche, selon les dimensions de notre être, de notre capacité à recevoir « poétiquement » l’enchantement du monde, comme un souffle printanier se ruant par la fenêtre. Et cela, l’écriture, c’est-à-dire la littérature, en est l’inscription incantatoire, qui « chante », qui prodigue le carmen, mais souvent, chez Nerval, un chant par moment singulièrement clair, « classique », d’une tonalité limpide, « française », rarement sujette à des éruption de lave kaïnite, quand la lave perce la croûte du langage « civilisé ».
L’écriture est magie. Elle est plus que signes socialisés sur le papier (ou l’écran), elle est aussi hiéroglyphe de secrets enfouis, qu’il faut ramener à la lumière, peut-être en trouvant la « lettre qui manque » (d’où les recherches ésotériques, théosophiques d’un Nerval, qui s’inspire de l’alchimie, de la kabbale, des « Illuminés » de l’Ancien Régime, de Ballanche, son contemporain, et de la notion fondamentale de palingénésie religieuse, de l’orphisme, de l’hermétisme, surtout du culte d’Isis, amante-mère, qui réunit ce qui a été disloqué, et rappelle obstinément à sa mémoire douloureuse sa mère tragiquement disparue). Elle est aussi instrument de métanoïa, de transformation de l’homme voué à devenir Dieu. Avec Nerval, et avant Rimbaud, l’écriture devient la voie royale de la Connaissance. Nerval, à ce titre, incarne le Voyant, qu’évoque le jeune poète aux « semelles de vent », dans l’une de ses trois lettres à Izambard. Il fut en quelque sorte son Jean le Baptiste (quoiqu’il ne faille pas oublier Baudelaire, « le premier voyant, roi des poètes, un vrai Dieu », selon Rimbaud, qui fut l’un des rares à reconnaître en Nerval un Grand de la pensée – mais Rimbaud avait-il lu Nerval ?).
Illustration : Michael Ayrton (Britannique, 1920-1992) El Desdichado, 1944 signé et daté (en bas à gauche) huiles sur panneau.
20:29 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nerval, gérard de nerval, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, 19ème siècle, romantisme, poésie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 05 novembre 2020
Eloge de l'enchantement - Notes sur les Romantiques allemands

Luc-Olivier d’Algange:
Eloge de l'enchantement
Notes sur les Romantiques allemands
Le romantisme allemand fut à la fois une quête et une humeur. La quête romantique, au moins dans ses préférences, semble mieux connue que son humeur. Par des ouvrages didactiques, parfois hostiles, plus souvent hélas que par les œuvres, nous nous sommes formés, en France, une idée du Romantisme allemand comme d'une quête de l'irrationnel, d'un culte de la Nature et des forces obscures, d'un environnement de brumes et de forêts sur fond d'orchestrations wagnériennes. Nous savons de ces romantiques qu’ils écrivirent des romans d'initiation, qui s'aventurent du côté de l'orient et des arcanes du monde invisible. Les mieux informés, enfin, savent que les romantiques allemands furent aussi des philologues, des naturalistes, des mythologues qui eurent le souci de recueillir des contes et des légendes et d'esquisser une méditation sur la communauté de destin des Allemands.
La quête romantique, toutefois, ne se laisse pas distinguer de son humeur, qui ne se trouve que dans les œuvres, et relève d'une réalité plus subtile, plus impondérable que les « notions » dont la collecte peut satisfaire l'universitaire mais laisse ne suspens celui qui voudrait, lui aussi, « romantiser » avec les Romantiques, faire siennes leurs aspirations et leurs découvertes; ce qui est sans doute la seule manière de lire qui vaille mieux que l'ignorance.

Avant d'être une théorie, un système, s'il le fut jamais, le Romantisme allemand fut une façon d'être. Pour savants qu'ils eussent été, férus de toute les sciences de leur temps non moins que d'excellents humanistes, connaissant souvent non seulement le grec, le latin, les langues romanes, mais encore le sanscrit et l’hébreu, pour encyclopédiques que fussent leurs curiosités ( ne méconnaissons pas tout ce par quoi l’œuvre de Novalis, par exemple, relève encore du dix-huitième siècle), les Romantiques n’en tinrent pas moins leur modi essendi, leurs façons d’être, leur présence au monde, comme supérieures aux modi intellegendi, aux « modes de connaissance », à l’intelligence didactique ou critique.
A ces poètes-métaphysiciens, qui revendiquèrent la phrase de Goethe : « Je hais tout savoir qui ne contribue pas à rendre ma vie plus intense », toute science était vaine qui ne fût ordonnée à l’être, autrement dit à une connaissance supérieure, à une sapience à la fois sensible et intelligible qui se laisse traduire non par des systèmes et des doctrines, mais par une qualité d’élégance et d’enchantement, de noblesse et de légèreté à laquelle les esprits pompeux et lourds ne peuvent rien comprendre et qu’ils tiendront toujours, à juste titre, pour ennemie.
Novalis, qui fut bien le contraire d’un esprit chagrin, Novalis qui fut tant aimé des dieux qu’il mourut à l’âge de trente ans, reprochait précisément à la seconde partie du Wilhelm Meister de Goethe ce retour au sérieux, à la vie domestique, au savoir planifié, cette trahison de l’intensité et de la joie, qui éclate, au profit du bonheur qui dure et qui s’étale. Rien n’est plus difficile à définir qu’une humeur, elle est ce « je ne sais quoi », ce « presque rien » dont parlait Fénelon, qui nous emporte. On peut, sans trop prendre le risque de se tromper, la dire juvénile, quand bien même Jean-Paul Richter en perpétua toutes les vertus jusqu’au grand âge). On peut aussi, en hommage à Antoine Blondin, la dire vagabonde. La Lucinde de Schlegel, les Mémoires d’un propre à rien de Joseph von Eichendorf, annoncèrent la couleur : elle sera d’un bleu léger, d’une révolte sans pathos, souvent encline au libertinage, où le sens de la rencontre, du rêve et de l’ivresse avive le monde, délie les langues, dénoue les peurs, et nous précipite, avec impatience, vers le mystère des êtres et des choses.

Ces vertus, chères aux premiers Romantiques allemands, sont d’un genre viril. Elles se nomment liberté et courage, amitié chevaleresque et fidélité, et correspondent assez peu à l’image du Romantique se tordant les mains au clair de lune. L’humeur romantique se laisse aussi approcher par ce que Gobineau dit des « Calenders » dans son roman Les Pléiades, qui fut sans doute largement influencé par les romans de Jean-Paul Richter, et en particulier par Titan, - cet immense entrelacs de songes, d’aventures et de bonheurs. Si la peine et la mélancolie des temps qui nous abandonnent, la nostalgie et la déréliction, la folie même de ceux que frappe la foudre d’Apollon, la tragédie et la mort ne sont pas absente des œuvres romantiques, leur humeur, à qui fréquente leurs œuvres, fut d’emblée à la fantaisie, à l’audace, au rire et à l’ironie.
L’ombre et la lumière, au demeurant, n’existent que l’une par l’autre. Pour les Romantiques allemands, précurseurs, nous y reviendrons, de la logique du tiers-inclus, le Bien et le Mal ne sont pas des entités massive, irréductibles l’une à l’autre qu’affectionnent les esprits schématiques ; les crépuscules contiennent les aurores, et la Nuit dont Novalis écrivit les Hymnes, laisse se réfugier en elle, comme un éclat de lumière dans la prunelle de l’Aimée, tous les secrets du jour.
Il y aurait un livre entier à écrire sur l’ironie romantique. Cette ironie n’est point le ricanement de la certitude ou de la supériorité, l’antiphrase didactique et condescendante de Voltaire, mais une reconnaissance de la nature double, visible-invisible, du réel. Tout sens apparent divulgue, à celui qui s’y rend attentif, un sens caché. Toute apparence est transparence. Le monde n’est pas cette prison de convenances ou cette autre prison que serait une liberté dépourvue de sens. Le monde nous parle. Pour les Romantiques allemand, le langage que le monde nous adresse à travers les cristaux de neige, les murmures des feuillages ou les rumeurs de la mer n’est pas radicalement différents de celui dont nous autres humains usons et mésusons à loisir. Cette similitude, cette parenté est, pour les Romantiques allemands, une leçon d’humilité et de prodiges. Elle témoigne d’un accord possible entre le monde et l’homme, elle annonce des solitudes immensément peuplées d’âmes.

« La nature ne montre pas, ne dissimule pas, mais fait signe » écrivait Héraclite. Le Grand-Œuvre des Romantiques allemands sera le déchiffrement de ces signes, - déchiffrement dont l’humour, comme en témoignent le Contes de Hoffmann, n’est pas exclu. Tant qu’il est possible de rire, à travers l’herméneutique elle-même, rien n’est perdu. Les Romantiques allemands sont d’autant moins obscurantistes que l’interprétation qu’ils proposent des apparences et des signes, des textes sacrés (dont font partie les œuvres des poètes) est infinie. La sapience romantique est aussi peu administrative que possible. Le jeu de symboles et des correspondances, ne s’y trouve ni réglementé, ni instrumentalisé.
On pourrait dire, dans un apparent paradoxe, que ce qui sauve les Romantiques allemands de l’obscurantisme, c’est précisément cette défiance pour le rationalisme. Le culte de la « déesse Raison », dont on connaît les ravages, leur fut largement étranger. Le fou n’est pas celui auquel la raison fait défaut, mais bien celui qui a tout perdu sauf la raison. Toutefois, se défier de la raison n'interdit point d'être logicien ni de faire de la logique un instrument de spéculation et de prospection. L'accusation d'obscurantisme habituellement portée contre eux tient d'autant moins que ceux qui la formulent furent bien souvent les héritiers ou les instigateurs du totalitarisme moderne. Que le réel soit dialogique, pour reprendre le mot de Gilbert Durand, voire, polyphonique et gradué, - et avec une grande part d'imprévisible, - qu'il y eût une interdépendance entre la connaissance, celui qui connaît et la chose connue, que les ombres soient colorées et nos âmes chatoyantes et « tigrées » pour reprendre l'admirable formule de Victor Hugo, que les frontières entre la réalité et le songe soient indécises, que les métaphores soient à l'œuvre, qui changent les feuillages en serpents d'or, les amoureuses en sirènes, les arbres en patriarches, que les dieux puissent surgir et transparaître, que la parole soit donnée aux hiboux ou aux chats, que la différence entre les fées et les libellules puisse n'être, en certains cas, que de pure convenance, tout cela qui appartient au patrimoine imaginaire, ne reste point sans ouvrir des perspectives d'avenir, de nouvelles logiques et de neufs enchantements.

Peu encline à la linéarité, on ne saurait dire si la pensée romantique fut davantage tournée vers le passé ou vers l'avenir. Bien plus que rectiligne, la pensée romantique est encline à l'arborescence, à la sporade, à la spirale. « Grains de pollen », les pensées se dispersent, mais chacune d'elle tient en elle, mystérieusement, le ressouvenir de son origine. Ainsi, les Romantiques allemands ne furent ni progressistes, ni passéistes, ni excessivement confiant dans le « sens de l'histoire », ni adeptes d'une pure théorie de la décadence. Issus d'une tradition de l'intériorité, d'une spiritualité « paraclétique » illustrée par Angélus Silesius, Franz von Baader ou Jacob Böhme, ils répugnaient à se croire enchainés à quelque déterminisme historique: l'Histoire, avec des bonheurs divers, était en eux.
Certains critiques, non sans pertinence, ont distingué, chez les Romantiques allemands, deux courants, l'un « révolutionnaire » et quelque peu napoléonien, et l'autre, « réactionnaire», tourné vers l'anamnesis, l'ésotérisme, la recherche des fondements de « l'Allemagne secrète », ainsi que le nommera Stefan George. Ces deux courants, toutefois, s'opposent moins qu'il n'y paraît. Ce qui paraît juste, c'est de discerner un glissement, qui est moins d’ordre politique que mythologique. Peu à peu s'éloignant du dix-huitième siècle, de l'euphorie d'une Révolution vue de loin, Prométhée cède la place à Hermès. A la logique du voleur de feu (qui, par Hegel, est aux soubassements du marxisme qui voit en Prométhée la figure tutélaire des révolutions) succède le « feu de roue » des Alchimistes, les feux tournants de l'athanor, qui sont à la fois l'âme et le monde, l’intériorité et l'extériorité.
A la marche forcée du sens de l'Histoire, Novalis, Chamisso, Jean-Paul, préfèreront la promenade où, quelquefois, et comme par inadvertance, le vagabondage se change en pèlerinage, où la simple inclination au voyage devient une quête du Graal. On pourrait dire que le courant « hermésien » de l'Encyclopédie de Novalis s'oppose au courant prométhéen de la phénoménologie de l'Esprit de Hegel, comme, en retour, la volonté planifiante, étatique, hostile à la bigarrure du monde, s'oppose à la contemplation, au recueillement. Les choses, bien sûr, ne sont pas aussi simple, et il y eut bien un « hégélianisme de droite » qui, de Villiers de l'Isle-Adam à Jean-Louis Vieillard-Baron, tenta de donner à la procession hégélienne de l'Esprit une dimension verticale, et, pour tout dire, gnostique. Force est cependant de reconnaître qu'en sa postérité, comme le sut montrer Michel Le Bris, l'œuvre de Hegel engendra les philosophies et les idéologies les plus closes, poussant la raison triomphante à la folie et les hommes à la servitude.

Paradoxalement, ce passage de Prométhée à Hermès, du rationalisme à une sorte de sapience holistique, ajoute à la pensée romantique une finesse questionnante, un scepticisme, un « je ne sais quoi » de pyrrhonien qui fera toujours défaut à la lignée rivale, demeurée fidèle à l'hybris du voleur de feu.
Il y a davantage de question que de réponses dans les «grains de pollen » de Novalis, et si peu d'acrimonie et de ressentiment, que son œuvre nous apparaît aujourd'hui venir d'un autre monde. Voici belle lurette que les hommes n'écrivent plus sans haïr, au point que bien souvent la haine, le dépit, la rancœur semblent les seuls moteurs de leur écriture. Le fiel est ce qui demeure lorsque les enchantements ont disparu.
Au-delà la de leurs diversités qui sont grandes et qui rendent bien difficiles d'en parler en quelques pages, les Romantiques allemands, des plus sombres aux plus clairs, des plus rieurs aux plus tourmentés, des plus optimistes aux plus pessimistes, sont tous des hommes, et des femmes, de l'enchantement. Ces enchantements peuvent, eux aussi, être lumineux ou ténébreux, tels de douces brises sur la joue ou de noirs ensorcellements, des rencontres éblouies avec des paysages italiens, de suaves ensommeillements dans les bras des amantes ou des combats furieux contre des dragons; ces enchantements peuvent être austères ou dionysiaques, nous pencher de longues nuits sur des grimoires ou nous lancer dans de folles fêtes de fleurs ou de flamme; ces enchantements peuvent nous perdre ou nous sauver, peu importe, nous porter au-devant du monde sensible, dans les fracas, ou nous rassembler dans le silence d'une méditation mathématique, ils n'en demeurent pas moins la ressource commune à la tous les Romantiques allemands, leur irréfutable singularité, leur étrangeté dans un monde aussi désenchanté que le nôtre.
Nous sommes désormais si loin de tout enchantement que certains de nos intellectuels ont fait de l'enchantement l'ennemi par excellence: il facile de se faire un ennemi de qui ne règne plus ! Véritable arrière-garde, ces « intellectuels » (par antiphrase) persistent à batailler contre ce qui ne demeure plus qu'aux marges extrême de la vie. Dans ce monde planifié, rationalisé, médiatisé, dans ce technocosme surveillé, informatisé, où jamais la part du secret ne fut si rabougrie, ils voudraient encore nous persuader que l'enchantement est ce Mal à l'origine de tous les maux, ce germe du totalitarisme qu'il faut écraser avant qu'il ne s'éploie. Le désenchantement, la démystification, la déconstruction sont leurs grandes affaires, tout ce qui est numineux ou sacré est leur adversaire, comme si la grande « ruée vers le bas » et vers l'horreur n'était pas le démocratique produit du nihilisme et de l'hybris de la volonté, de la raison idolâtrée, planificatrice. Comme si de ne s'émerveiller de rien et de dénigrer toute chose, les hommes s'en trouvaient être meilleurs !

C'est méconnaître que l'enchantement est d'abord ce qui nous dénoue, ce qui nous surprend, ce qui sollicite notre hospitalité. C'est ne pas voir que l'enchantement est une « approche », ou, plus exactement, cette émotion qui survient au moment de l'approche, - à cette seconde magique où nous nous délivrons de nous-mêmes, de notre narcissisme individuel ou collectif, pour recevoir du monde un signe de bienvenue.
Voir dans l'enchantement un Mal est un étrange désespoir et ce désespoir mélangé d'optimisme historique ne laisse pas d'être inquiétant. Les Romantiques allemands pressentirent ce monde déserté des Anges et des Dieux, ce monde sans messagers, où plus rien n'advient de l'autre côté des apparences. Mais si plus rien ne doit advenir, alors les apparences ne sont plus des apparences, mais des murs de néant. D'où l’élan romantique vers les prodiges, qui sont en nous tout autant que dans le monde: « Il est étrange, écrit Novalis que l'homme intérieur n'ait été considéré que d'une manière si misérable et qu'on en ait traité que si stupidement. La soi-disant psychologie est aussi une de ces larves qui ont usurpé dans le sanctuaire la place réservée aux images véritables des dieux... Qui sait quelles unions merveilleuses, quelles générations étonnantes sont encore renfermées en nous-mêmes ? »
L'entendement humain apparaît aux Romantiques allemands comme un instrument prodigieux et méconnu, un stradivarius dont on se servirait comme d'un tambourin avant de le laisser brisé et à l'abandon. Refuser l'enchantement, c'est ainsi refuser non seulement le poème, le chant des sirènes, mais la spéculation elle-même, l'Intellect dans ses plus hautes œuvres. Il y a, certes, un danger dans le chant, comme dans la pensée, on peut s'y perdre mais ce danger est le propre de l'humain et sans doute n'est-il point si grand que le danger que recèle, pour la beauté de la vie, le culte bourgeois de la sécurité à tout prix.
Par ailleurs, l'enchantement romantique est fort loin de sa caricature. Il n'est point cet abandon aux forces de la vie et de la nature, ce panthéisme primaire, cette passivité végétale ou infrahumaine, ce culte de la Magna Mater ou ce fondamentalisme écologique que ses adversaires dépeignent avec complaisance : « Bien des gens, écrit Novalis, s'attachent à la nature, parce que, comme des enfants gâtés, ils craignent leur père et cherchent un refuge auprès de leur mère ». S'il importe d'apprendre à manier la baguette magique de l'analogie, ce n'est pas au détriment de la déduction, mais en contraste avec elle, sachant que « les contrastes sont des analogies inversées ». Ainsi, « la vie des dieux est mathématique » mais « c'est en l'humain que se manifeste l'empire des cieux ».
Pour le Romantique, la science chante comme les nombres et rien n'est véritablement abstrait. « Chaque descente du regard en soi-même est, en même temps, une ascension, une assomption, un regard vers l'extérieur véritable ». L'enchantement est ce point, cette frontière incertaine où le monde intérieur et le monde extérieur se rencontrent. Nous pouvons choisir de lutter contre le monde, de le prendre à bras le corps, de le défier, mais, en dernière instance, cette joute est nuptiale. Entre l'élan prométhéen et la sagesse d'Hermès, il est un accord possible, que Novalis, avec génie, résume en une seule phrase: « Nous ne nous comprendrons jamais entièrement; mais nous ferons et nous pouvons bien plus que nous comprendre ».
Luc-Olivier d'Algange
00:40 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, romantisme, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, luc-olivier d'algange |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 25 octobre 2020
L'Intellectualité musicale

L'Intellectualité musicale
par Luc-Olivier d'Algange
L'importance de la musique dans l'œuvre de Hoffmann n'est pas seulement d'ordre thématique ou anecdotique. Les Contes, et Le Vase d'Or, en particulier, s'ordonnent à des lois subtiles et mobiles qui requièrent du lecteur une attention que l'on pourrait dire « musicienne ». Etre attentif aux phrases, à l'enchaînement des circonstances du récit et à la pensée même de l'auteur, c'est, en la circonstance, changer en musique les mots écrits, élever les signes typographiques à la hauteur idéale du chant. Par cette exigence à l'égard d'elle-même et à l'égard du lecteur, l'œuvre de Hoffmann s'inscrit dans la tradition du Romantisme allemand tel que Novalis en sut formuler les idées majeures et le dessein. Albert Béguin écrit, à propos de Hoffmann: « Tard venu, il héritait d'une tradition qui remonte à Herder, dont Goethe avait été tributaire et dont Novalis avait élaboré la théorie. »
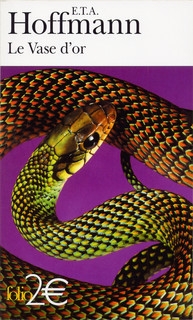 D'ordre prophétique, plutôt que systématique, les théories de Novalis éclairent la pensée qui, à l'œuvre dans Le Vase d'Or, risque de paraître allusive ou incertaine. Or, l'idée d'une intellectualité musicale, c'est-à-dire d'une intellectualité en mouvement suppose, dans la pensée de Novalis, que l'esthétique et la métaphysique soient indubitablement liées, unies, dans les variations infinies et les configurations sans cesse nouvelles de la musique. L'Intellect n'est point séparé des sens; il est, pour ainsi dire, le moyeu immobile de cette circularité synesthésique où, selon l'expression de Baudelaire, « les couleurs, les parfums et les sons se répondent. »
D'ordre prophétique, plutôt que systématique, les théories de Novalis éclairent la pensée qui, à l'œuvre dans Le Vase d'Or, risque de paraître allusive ou incertaine. Or, l'idée d'une intellectualité musicale, c'est-à-dire d'une intellectualité en mouvement suppose, dans la pensée de Novalis, que l'esthétique et la métaphysique soient indubitablement liées, unies, dans les variations infinies et les configurations sans cesse nouvelles de la musique. L'Intellect n'est point séparé des sens; il est, pour ainsi dire, le moyeu immobile de cette circularité synesthésique où, selon l'expression de Baudelaire, « les couleurs, les parfums et les sons se répondent. »
« Il est étrange, écrit Novalis, que l'intérieur de l'homme ait été jusqu'à présent exploré de façon aussi indigente et qu'on en ait traité avec tant d'insipidité, un tel manque d'esprit. La prétendue psychologie est encore une de ces larves qui ont pris, dans le sanctuaire, la place que devaient tenir d'authentiques images divines... Intelligence, imagination, raison, ce sont là des compartiments misérables de l'univers qui est en nous. De leurs merveilleuses compénétrations, des configurations qu'elles forment, de leurs transitions infinies, pas un mot. Il n'est venu à l'idée de personne de chercher en nous des forces nouvelles encore, et qui n'ont pas reçu de nom, d'enquêter sur leurs rapports de compagnonnage. Qui sait à quelles merveilleuses unions, à quelles générations prodigieuses nous pouvons encore nous attendre au-dedans de nous-mêmes. » La musique étant l'art des variations et des transitions infinies, l'intellectualité musicale, à l'œuvre dans Le Vase d'Or, sera le principe de passages entre des domaines, des règnes et des états habituellement séparés par des frontières rigoureuses. La réalité et le rêve, la nature inanimée et animée, les figures humaines et mythiques se confondent pour susciter ces « générations prodigieuses » que pressent Novalis. De cette mise-en-miroir d'aspects ordinairement distincts naît un vertige de reflets et de spéculations infinies où la réalité mystérieusement s'avive et s'agrandit.
Sous le sureau où s'est réfugié l'étudiant Anselme, soudain s'accroît l'intensité des couleurs. Les « vagues dorées du beau fleuve », les « clochers lumineux sur le fond vaporeux du ciel », les « prés fleuris et les forêts d'un vert tendre » annoncent les brillantes nuances des « serpents verts » et les teintes de la bibliothèque secrète de l'Archiviste Lindhorst. Les couleurs sont les accords magnifiques qui annoncent le passage de la réalité quotidienne, banale, à une réalité visionnaire et prodigieuse. Les images du conte sont annonciatrices. L'imprévisible est contenu dans le déjà advenu. La vastitude et la complexité du monde auquel l'expérience visionnaire convie l'étudiant Anselme, évoque un opéra féerique. La « folie » d'Anselme est le prélude d'une sagesse verdoyante. Développée à partir d'un thème unique, l'intellectualité musicale favorise l'arborescence logique des métamorphoses.
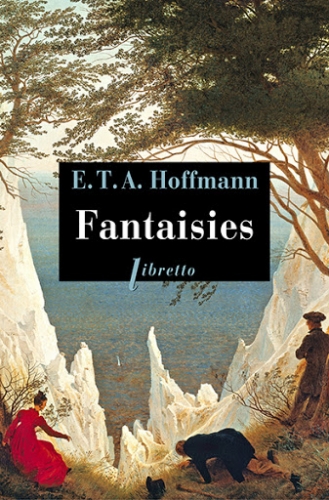 Les bruissements deviennent parole. L'inintelligible, le bruit sont gagnés par le Sens et par la musique: « Ici l'étudiant Anselme fut interrompu dans son soliloque par un étrange bruit de frôlements et de froufrous qui s'éleva dans l'herbe tout près de lui, pour glisser et monter bientôt après jusqu'aux branches et aux feuilles du sureau qui s'étalaient en voûte au-dessus de sa tête. On eût dit tantôt que le vent du soir secouait le feuillage, tantôt que les oiselets folâtraient dans les branches, agitant de-ci de-là leurs petites ailes en leurs capricieux ébats. Puis ce furent des chuchotements, des zézaiements, et il sembla que les fleurs tintaient comme autant de clochettes cristallines suspendues aux branches. Anselme ne se laissait pas de prêter l'oreille. Tout à coup, sans qu'il sut lui-même comment, ces zézaiements, ces chuchotements et ces tintements se changèrent en paroles à peine perceptibles, à moitié emportées par le vent... » La musicalité des mots coïncide avec leur ressaisissement par le sens: « Zwischen durch - zwischen ein - zwischen Zweigen, zwischen swellenden Bluten... » Le texte allemand, mieux que ses traductions françaises, restitue ce saisissement des rumeurs par la musicalité naissante du Sens dont la souveraineté soudaine tinte « comme un accord parfait de claires cloches cristallines » précédant l'apparition de Serpentina.
Les bruissements deviennent parole. L'inintelligible, le bruit sont gagnés par le Sens et par la musique: « Ici l'étudiant Anselme fut interrompu dans son soliloque par un étrange bruit de frôlements et de froufrous qui s'éleva dans l'herbe tout près de lui, pour glisser et monter bientôt après jusqu'aux branches et aux feuilles du sureau qui s'étalaient en voûte au-dessus de sa tête. On eût dit tantôt que le vent du soir secouait le feuillage, tantôt que les oiselets folâtraient dans les branches, agitant de-ci de-là leurs petites ailes en leurs capricieux ébats. Puis ce furent des chuchotements, des zézaiements, et il sembla que les fleurs tintaient comme autant de clochettes cristallines suspendues aux branches. Anselme ne se laissait pas de prêter l'oreille. Tout à coup, sans qu'il sut lui-même comment, ces zézaiements, ces chuchotements et ces tintements se changèrent en paroles à peine perceptibles, à moitié emportées par le vent... » La musicalité des mots coïncide avec leur ressaisissement par le sens: « Zwischen durch - zwischen ein - zwischen Zweigen, zwischen swellenden Bluten... » Le texte allemand, mieux que ses traductions françaises, restitue ce saisissement des rumeurs par la musicalité naissante du Sens dont la souveraineté soudaine tinte « comme un accord parfait de claires cloches cristallines » précédant l'apparition de Serpentina.
La pensée qui amoureusement s'unit à cette musique, mieux que la pensée profane, s'accorde aux secrètes concordances du monde. Les choses ne sont point ce qu'elles paraissent être. L'Invisible résonne dans le visible et les échos du visible se prolongent et se répercutent dans l'Invisible. Le monde, dans tous ses aspects est ainsi doué de parole: « Le vent du soir passa dans un frôlement et dit: « je me jouais autour de ton front mais tu ne m'as pas compris; le souffle est mon langage, quand l'amour l'enflamme ». Les rayons du soleil percèrent les nuées, et la lueur éclatait comme en paroles: « Je t'inondais de mon or embrasé, mais tu ne m'as pas compris; l'embrasement est mon langage quand l'amour l'enflamme. Et, plongeant toujours plus au fond des deux yeux magnifiques, la nostalgie se faisait plus ardente, le désir s'embrasait. Alors tout s'agita et s'anima, tout sembla s'éveiller à la vie et au plaisir. Les plantes et les fleurs embaumaient autour de lui et leur parfum était comme un chant magnifique de mille voix de flûtes; et les nuages du soir qui passaient en fuyant emportaient l'écho de leurs chansons vers les pays lointains. » En l'apogée de l'intellectualité musicale, la nature irradie. Le présent rayonne des hautes puissances d'un passé légendaire ou mythique. L'archiviste Lindhorst peut défier la clientèle bourgeoise car il est en vérité Prince des Esprits: « Il se peut que ce que je viens de vous raconter, en traits bien insuffisants, il est vrai, vous paraisse absurde et extravagant, mais ce n'en est pas moins extrêmement cohérent et nullement à prendre au sens allégorique, mais littéralement vrai »
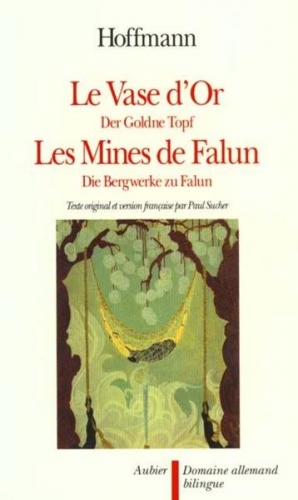 « Nullement allégoriques et littéralement vraies » sont, dans le Conte de Hoffmann, les métamorphoses. Les véritables « identités » ne sont pas détenues dans le monde profane mais elles sont les reflets des plus hautes et immémoriales identités des « seigneuries d'Atlantis ». De même que, selon Platon, le temps est l'image mobile de l'éternité, les identités des personnages sont les images mobiles d'une vérité provisoirement lointaine, mais source d'une lancinante nostalgie. Les objets eux-mêmes, menacés dans leur statut,- et par cela même menaçants,- ne sont pas exempts de ces métamorphoses. Ainsi en est-il du heurtoir de la porte de Lindhorst: « La figure de métal s'embrasant dans une hideuse fantasmagorie de lueurs bleues, se contracta en un grimaçant rictus...» Plus loin, c'est le cordon de la sonnette qui se change en reptile: « Le cordon de sonnette s'abaissant devint un serpent géant, blanc et diaphane qui l'enveloppa, l'étreignit; laçant ses anneaux de plus en plus serrés, si bien que les os flasques et broyés s'effritèrent en craquant et que le sang gicla de ses veines pénétrant le corps diaphane du serpent et le colorant de rouge. » Entre l'angoisse et l'extase, l'intellectualité musicale entraîne la pensée dans une imagerie mouvante où chaque thème et chaque image est en proie à l'exigence qui doit les changer en d'autres thèmes et d'autres images. Les métamorphoses angoissantes annoncent les métamorphoses extatiques. Le resserrement de l'angoisse va jusqu'à la pétrification. Face à l'archiviste Lindhorst, Anselme sent « un torrent de glace parcourir ses veines gelées » comme s'il était en train de se changer en statue de pierre. Par contraste, les métamorphoses extatiques n'en sont que plus ouraniennes et plus immatérielles. Sous le baiser de Phosphorus, la fleur de lys se défait de toute pesanteur et de toute compacité et s'embrase dans les hauteurs: « Et comme rayonnante de lumière, elle s'embrasa en hautes flammes, d'où fit irruption un être étranger, qui, laissant la vallée bien loi au-dessous de lui, erra en tous sens dans l'espace infini.»
« Nullement allégoriques et littéralement vraies » sont, dans le Conte de Hoffmann, les métamorphoses. Les véritables « identités » ne sont pas détenues dans le monde profane mais elles sont les reflets des plus hautes et immémoriales identités des « seigneuries d'Atlantis ». De même que, selon Platon, le temps est l'image mobile de l'éternité, les identités des personnages sont les images mobiles d'une vérité provisoirement lointaine, mais source d'une lancinante nostalgie. Les objets eux-mêmes, menacés dans leur statut,- et par cela même menaçants,- ne sont pas exempts de ces métamorphoses. Ainsi en est-il du heurtoir de la porte de Lindhorst: « La figure de métal s'embrasant dans une hideuse fantasmagorie de lueurs bleues, se contracta en un grimaçant rictus...» Plus loin, c'est le cordon de la sonnette qui se change en reptile: « Le cordon de sonnette s'abaissant devint un serpent géant, blanc et diaphane qui l'enveloppa, l'étreignit; laçant ses anneaux de plus en plus serrés, si bien que les os flasques et broyés s'effritèrent en craquant et que le sang gicla de ses veines pénétrant le corps diaphane du serpent et le colorant de rouge. » Entre l'angoisse et l'extase, l'intellectualité musicale entraîne la pensée dans une imagerie mouvante où chaque thème et chaque image est en proie à l'exigence qui doit les changer en d'autres thèmes et d'autres images. Les métamorphoses angoissantes annoncent les métamorphoses extatiques. Le resserrement de l'angoisse va jusqu'à la pétrification. Face à l'archiviste Lindhorst, Anselme sent « un torrent de glace parcourir ses veines gelées » comme s'il était en train de se changer en statue de pierre. Par contraste, les métamorphoses extatiques n'en sont que plus ouraniennes et plus immatérielles. Sous le baiser de Phosphorus, la fleur de lys se défait de toute pesanteur et de toute compacité et s'embrase dans les hauteurs: « Et comme rayonnante de lumière, elle s'embrasa en hautes flammes, d'où fit irruption un être étranger, qui, laissant la vallée bien loi au-dessous de lui, erra en tous sens dans l'espace infini.»
Rien n'échappe à ces variations, transitions et métamorphoses qui, par leurs enchantements, entraînent la pensée en des contrées surnaturelles. La nostalgie romantique qui s'empare de l'étudiant Anselme, recèle des pouvoirs extrêmes car elle est le principe d'embrasement du pressentiment lui-même. La nostalgie romantique, « sehnsucht », est une nostalgie prophétique, impérieuse, qui oeuvre à une véritable transmutation de l'entendement. Mais cette transmutation n'est pas sans dangers: « Je vois et je sens parfaitement désormais que toutes sortes de formes étrangères, venues d'un monde lointain et prodigieux que je ne contemplais jadis qu'en certains rêves singuliers, et bien particuliers, ont envahis à présent mes états de veille et ma vie active, et se jouent de moi. » Fidèle au dessein de Novalis, qui consiste à se saisir des configurations et des transitions nouvelles de l'intelligence, de l'imagination et de la raison, Le Vase d'Or de Hoffmann va proposer dans une adresse au lecteur, qui se situe à peu près au milieu du récit, une interprétation métaphysique des épreuves que traverse la pensée lorsqu'elle est vouée à l'aventure des métamorphoses: « Essaie, ami lecteur, dans le royaume féerique plein de sublimes prodiges, qui provoquent sous leur choc formidable les suprêmes délices aussi bien que la plus profonde épouvante,- dans ce royaume où l'austère déesse lève un coin de son voile, si bien que nous nous figurons contempler son visage,- ( mais un sourire brille souvent sous son regard austère, et c'est le caprice taquin qui se joue de nous et nous trouble et nous ensorcelle de mille façons, comme une mère aime à badiner avec ses enfants préférés),- dans ce royaume disais-je, dont l'esprit, du moins en rêve, nous ouvre si souvent les portes, essaie, ami lecteur, de reconnaître les silhouettes bien connues que tu coudoies journellement, suivant l'expression consacrée, dans la vie ordinaire. Tu seras alors d'avis que ce sublime royaume est beaucoup plus près de nous que, peut-être, tu ne l'estimais ordinairement... et c'est ce que je souhaite de tout mon coeur, et m'efforce de te faire comprendre dans l'étrange histoire de l'étudiant Anselme. »
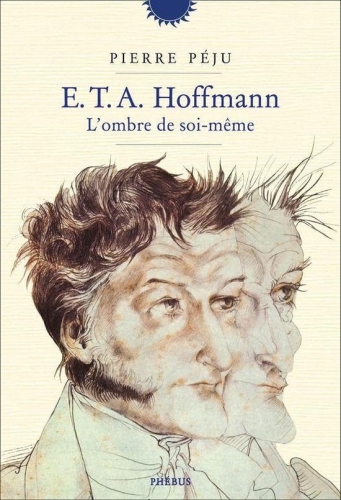
La « vie ordinaire » qui nous sépare des « suprêmes délices » et des « profondes épouvantes » est plus ténue qu'il n'y paraît. La proximité du « sublime royaume » est attestée par les pouvoirs de notre conscience à se concevoir elle-même comme changeante, soumise à cette hiérarchie infinie des états dont la veille, le rêve, le sommeil, l'extase offrent quelques exemples rudimentaires. Ce qui importe est plus subtil: cette orée miroitante qui unit et sépare la veille et le rêve, où tout, soudainement, devient possible. La nostalgie de l'étudiant Anselme n'est pas le regret d'un passé situé à un quelconque point antérieur de l'histoire humaine, c'est, au sens propre, une nostalgie de l'inconnu et de l'inouï. Hanté par la nostalgie, Anselme va à la conquête de formes nouvelles et de neuves harmonies: telle est l'inquiétude de l'intellectualité musicale qui, semblable au désir amoureux, ne connaît qu'une soif que seule comble une soif nouvelle.
Il n'est pas indifférent de constater que, distribuée en veilles,- qui sont autant de défis à l'ensommeillement de la pensée dans l'illusion de la vie ordinaire,- la poursuite initiatique et amoureuse que relate Le Vase d'Or, débute sous un arbre, en l'occurrence un sureau, dont la moelle légère fut évoquée, par André Breton, dans un poème de Clair de terre. Ainsi que le soulignent les études de René Guénon et de Mircéa Eliade, l'Arbre fut souvent identifié à l'axe du monde, lieu par excellence du passage entre les différents états de la conscience et de l'être. Or, l'expérience visionnaire d'Anselme sous le sureau rejoint, dans son illumination arborescente, ce symbolisme du passage et de l'axe du monde. Le caractère impérieux et fulgurant de la vision et l'embrasement de la conscience qui en résulte, montrent que l'arbre est habité par une puissance électrique, annoncée par les bruissements lumineux, dont le surgissement va littéralement transmuter la conscience de l'étudiant. « Cependant, écrit René Guénon, on pourrait se demander si le rapprochement ainsi établi entre l'arbre et le symbole de la foudre, qui peuvent sembler à première vue être deux choses fort distinctes, est susceptible d'aller encore plus loin que le seul fait de cette signification axiale qui leur est manifestement commune; la réponse à cette question se trouve dans ce que nous avons dit de la nature ignée de l'Arbre du monde, auquel Agni lui-même est identifié dans le symbolisme védique, et dont, par suite, la colonne de feu est un exact équivalent comme représentation de l'axe. Il est évident que la foudre est également de nature ignée et lumineuse; l'éclair est d'ailleurs un des symboles les plus habituels de l'illumination au sens intellectuel ou spirituel. L'Arbre de Lumière dont nous avons parlé traverse et illumine tous les mondes; d'après le passage du Zohar, cité à ce propos par A. Coomaraswamy, l'illumination commence au sommet et s'étend en ligne droite à travers le tronc tout entier; et cette propagation de la lumière peut facilement évoquer l'idée de l'éclair. Du reste, d'une façon générale, l'Axe du monde est toujours regardé plus ou moins explicitement comme lumineux... »
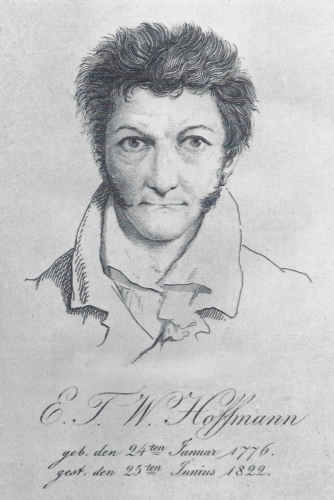
Illuminateur, le passage donne accès à un monde dont les configurations mobiles évoquent une partition symbolique. Les symboles, dans le récit, se répondent les uns aux autres. Chaque chose est le répons musical et mythique d'une autre. Hoffmann ne cite pas en vain Swedenborg, théoricien et visionnaire d'un univers de correspondances où les mondes se superposent infiniment dans l'Invisible. La responsabilité qui incombe aux personnages est de répondre à ces configurations imprévisiblement nouvelles qui naissent de l'identité mythique des personnages. « La précision mythique, écrit Ernst Jünger, est autre que celle de l'histoire. Elle lui est opposée pour autant qu'elle ne se fonde pas sur l'univocité mais sur la pluralité d'interprétations des faits. La personnalité historique est déterminée par une origine, une biographie, une fin. La figure mythique, au contraire, peut avoir plusieurs pères; plusieurs biographies, peut être tout à la fois dieu et homme, être à la fois morte et vivante, et toute contradiction, pour autant qu'elle soit réelle, ne fera qu'en accroître la netteté. Elle est amoindrie, enchaînée par le repérage historique. Son signe distinctif est qu'elle revient du fond de l'intemporel. »
Loin de contredire à cette dimension mythique, l'ironie, que Novalis tenait pour l'une des précellentes vertus romantiques, en réaffirme le pouvoir d'incertitude créatrice. L'ironie romantique, en effet, ne se réduit pas au ricanement. Elle se rapporte à la nature amphibolique de la réalité. L'euphorie du poète, son allégresse, sa légèreté riante,- qui entraînent le récit au-delà de la tragédie et du malheur,- proviennent de cette ironie essentielle selon laquelle ce qui est dit énonce autre chose qu'il n'y paraît. L'ironie romantique n'est pas l'expression d'un scepticisme ordinaire; elle est, au vrai, un moyen de connaissance accordé à l'intellectualité musicale que l'ambiguïté des choses, leur dualitude, exalte. Loin d'être mise en échec par l'amphibolie du réel, l'intellectualité musicale y trouve le principe de ses développements. Le ton de l'ironie, qui parcourt le récit du Vase d'Or, confirme la vérité mythique et symbolique car, dans le Mythe, le personnage est autre qu'il n'y paraît et le symbole toujours renvoie à son autre part, ainsi qu'en témoigne l'étymologie du mot. Ainsi les choses peuvent se changer les unes en les autres car elles sont déjà les unes dans les autres; le répons de l'autre est dans l'une, toujours la même et autre ironiquement, dans la plus entraînante joie musicale.
Luc-Olivier d’Algange
08:59 Publié dans Littérature, Musique, Musique, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, e. t. a. hoffmann, réalisme fantastique, musique, musicalité, philosophie, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, allemagne, romantisme, luc-olivier d'algange |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 mai 2016
NATION? – Un retour du «romantisme politique»?
 Le livre récent de Christian E. Roques , (Re)construire la communauté, a pour projet de présenter la réception du romantisme politique sous la République de Weimar par des philosophes et des penseurs politiques critiques de la modernité. Son but n'était pas de faire un travail sur la vérité des interprétations multiples qui en ont été faites, mais plutôt de voir ce que ces diverses lectures ont pu ouvrir comme perspectives politiques. L’enjeu est qu’au départ, le romantisme politique consiste en un discours en opposition à la philosophie des Lumières, qui met en question le pouvoir de la raison, et donc le pouvoir politique fondé sur l’exercice de la raison.
Le livre récent de Christian E. Roques , (Re)construire la communauté, a pour projet de présenter la réception du romantisme politique sous la République de Weimar par des philosophes et des penseurs politiques critiques de la modernité. Son but n'était pas de faire un travail sur la vérité des interprétations multiples qui en ont été faites, mais plutôt de voir ce que ces diverses lectures ont pu ouvrir comme perspectives politiques. L’enjeu est qu’au départ, le romantisme politique consiste en un discours en opposition à la philosophie des Lumières, qui met en question le pouvoir de la raison, et donc le pouvoir politique fondé sur l’exercice de la raison.
Genèse du romantisme politique
Le premier romantisme allemand s’organisme autour du Cercle d’Iéna, qui rassemble le théoricien de la littérature, Friedrich Schlegel, le philosophe Johann Gottlieb Fichte et des écrivains comme Ludwig Tieck, Wilhelm Heinrich Wackenroder et Novalis. Reprenant la thématique de Max Weber à propos du désenchantement du monde, le philosophe allemand Rüdiger Safranski identifie le projet romantique, dans sa globalité, comme une tentative pour ré-enchanter le monde et redécouvrir le magique, en repoussant la raison dans ses confins. Autour de 1800, le motif romantique s’inscrit dans plusieurs champs : la théologie protestante de Friedrich Schleiermacher définit ainsi la religion comme « le sens et le goût pour l’infini », et les études philologiques d’un Görres ou d’un Schlegel cherchent les racines de la langue et la vérité de l’origine dans l’Orient et l’Inde antiques. Ce désir des origines perdues s’exprime non seulement à travers des voyages spirituels dans le lointain, mais aussi dans la reconstitution d’un passé imaginaire. La Grèce de Friedrich Hölderlin illustre cette relation au passé, poétiquement condensée, et qui confronte une Antiquité mythologiquement sublimée à la réalité profane de sa propre époque :
«La vie cherches-tu, cherche-la, et jaillit et brille
Pour toi un feu divin du tréfonds de la terre,
Et frissonnant de désir te
Jettes-tu en bas dans les flammes de l’Etna.
Ainsi dissolvait dans le vin les perles l’effronterie
De la Reine ; et qu’importe ! si seulement
Tu ne l’avais pas, ta richesse, ô poète,
Sacrifiée dans la coupe écumante !
Pourtant es-tu sacré pour moi, comme la puissance de la terre,
Celle qui t’enleva, mis à mort audacieux !
Et voudrais-je suivre dans le tréfonds,
Si l’amour ne me retenait, ce héros.»
Dans un second temps, émerge le romantisme politique. Il prend racine à partir du concept de nation chez Fichte, de l’idée d’un « Etat organique » développée par Adam Müller, ainsi que dans le populisme artificiel de Ernst Moritz Arndt et de Friedrich Jahn. Il se nourrit également de la haine à l'encontre de Napoléon et des Français, transfigurée par la littérature de Heinrich von Kleist. Aussi le romantisme s’est-il éloigné de ses prémisses philosophiques. Cette prise de distance caractérisera également la littérature du romantisme tardif d’un Josef von Eichendorff et d’un E.T.A. Hoffmann.
Réceptions du romantisme : un concept polémique
Qui sont les philosophes ou les théoriciens qui, sous la République de Weimar, opposent le romantisme à ce qu’ils perçoivent comme des errements de la modernité? . Christian E. Roques distingue trois principales lectures du « romantisme politique ».
La première, de 1918 à 1925, fait immédiatement suite à l’instauration de la République weimarienne : elle met en place un discours à la recherche d’une communauté nouvelle ainsi qu’une critique de l’individualisme libéral. Le romantisme, traditionnellement identifié à un discours conservateur, a inspiré des projets communautaires d’inspiration à la fois socialistes et romantiques, cherchant à donner sens au politique après la conflagration guerrière de 1914-1918. A droite, au contraire, certaines voix comme celle du philosophe Carl Schmitt s’élèvent contre le romantisme.
La seconde lecture du « romantisme politique », de 1925 à1929, est plus apaisée : elle tente d’établir le romantisme comme fondement de la « pensée allemande ». C’est ce qui structure la pensée du philosophe et sociologue autrichien Othmar Spann tout au long des années 1920-1930. Le romantisme politique devient chez lui un discours droitier. Il met en place tout un travail philologique sur les auteurs romantiques. Quant au sociologue allemand Karl Manheim, il démontre dans sa thèse de 1925, comment le conservatisme est inhérent au romantisme. Il révèle ainsi à partir de ses travaux un nouveau rapport entre politique et savoir, ouvert sur la dimension irrationnelle de l’existence humaine.
Puis de la crise de 29 jusqu’à la veille de l’avènement du parti nazi, l’ampleur des troubles socio-économiques rend caduque le questionnement théorique sur la question de la modernité et de son dépassement, face à l’imminence de la crise politique et l’urgence de la question du « que faire ? » - qualifiée de léniniste par Christian Roques. Ainsi, si l'ancien officier de la Wehrmacht Wilhem von Schramm affirme encore l’actualité du projet romantique, c’est en proposant d’adopter la démarche de « l’ennemi bolchévique », à savoir sa méthode révolutionnaire d’enthousiasme pseudo-religieux, afin de retrouver l’esprit communautaire vécu dans les tranchées. Le théologien protestant allemand Paul Tillich ouvre dans un même temps un dialogue avec les forces « socialistes » de tout bord.
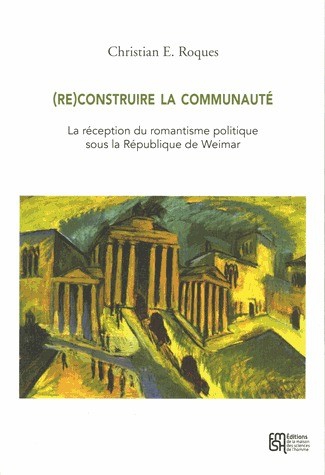 Réactiver la polémique du romantisme au XXIe siècle ?
Réactiver la polémique du romantisme au XXIe siècle ?
Mais l’essentiel se situe peut-être après le moment de Weimar : en effet, ce sont les discours et les actions politiques produites pendant la République à partir de ces lectures des romantiques, qui donneront sens aux réflexions et décisions politiques après Weimar. A ce titre, l’ouvrage de Christian E. Roques s’apparente au laboratoire d’une modernité en crise. Il y expérimente, par des lectures croisées du « romantisme politique », des rencontres imprévues entre des penseurs au positionnement politique opposé. De fait, dès Weimar, le « romantisme politique » est d’abord un concept polémique pour comprendre le réel présent : c’est une sorte d’instrument de mesure des idéologies politiques actuelles, à la lumière des idéologies passées d’Etats en crise.
Dans le monde moderne, le romantisme se présente comme le correctif salutaire aux discours politiques « rationnels », dans la mesure où ses aspirations transgressives font apparaître les limites de la rationalité. C’est en cela qu’on a pu y lire une opposition aux Lumières ou du moins une réflexion sur les limites du pouvoir de la raison. Le philosophe brésilien Michael Lôwy, déclarait, en faisant référence à Marx que le romantisme était d’abord une « vision du monde » en opposition à la bourgeoisie au nom d’un passé antérieur à la civilisation bourgeoise, et qu’il perdurerait tant que cette bourgeoisie sera là, comme son contre-modèle indissociable : « On pourrait considérer le célèbre vers de Ludwig Tieck, Die mondbeglanzte Zaubernacht, « La nuit aux enchantements éclairée par la lune », comme une sorte de résumé du programme romantique » .
Finalement, le travail de Christian Roques se justifie par sa conviction que le concept romantique n’aurait rien perdu de sa force polémique dans notre propre présent : « Au regard notamment du retour en force du discours écologique (voir éco-socialiste) qui repose fondamentalement sur un appel à une approche universaliste, dépassant les égoïsmes individuels pour adopter une conception globale, il semble légitime de se demander si nous ne sommes pas à l’aube d’une nouvelle "situation romantique". » . Présenté comme alternative au discours libéral en temps de crise, le romantisme politique réapparaît aujourd’hui avec des références politiques et philosophiques qui dépassent le cadre binaire des partis politiques. ![]()
Christian E. Roques, (Re)construire la communauté : La réception du romantisme politique sous la République de Weimar, MSH, 2015, 364 p., 19 euros
À retrouver sur nonfiction.fr :
Tous les articles de la chronique Nation ?

Présentation de l'éditeur:
(sur: http://www.fabula.org )
"Le "romantisme politique" connaît un regain d'intérêt important en Allemagne sous la République de Weimar (1918-1933), au point de devenir un élément essentiel du discours politique de l'époque. Avec la "communauté", la "nation" ou le "peuple", le "romantisme" va constituer un des mots magiques autour desquels se cristallisent les débats de la vie intellectuelle weimarienne. Le présent ouvrage entreprend donc d'analyser les stratégies de discours politiques qui se structurent autour du paradigme romantique entre 1918 et 1933. À partir d'un corpus d'auteurs variés, pour certains célèbres et pour d'autres tombés dans l'oubli (Arthur Rubinstein, Carl Schmitt, Othmar Spann, Karl Mannheim, Wilhelm von Schramm, Paul Tillich), il est possible de montrer l'existence non d'une idéologie politique clairement définie, mais d'une sensibilité "romantique" qui transcende les oppositions politiques traditionnellement conçues comme imperméables (gauche/droite, conservateur/progressiste, nationaliste/universaliste, etc.) et qui se construit dans l'opposition fondamentale à l'individualisme matérialiste du "libéralisme" capitaliste."
Sommaire:
- Introduction : La république de Weimar, laboratoire d'une modernité en crise -- Romantisme, romantisme politique : l'impossible définition ? -- La généalogie du romantisme : un paradigme fantôme -- Le romantisme politique : de gauche, de droite, au-delà ? -- Pour une archéologie de la réception -- La rupture méthodologique -- Le problème de la téléologie : savoir historique et condamnation morale des engagements en faveur du nazisme -- Le champ discursif du "romantisme politique" : les marqueurs d'une renaissance -- Des "néoromantiques" sous la République de Weimar ? -- La redécouverte d'Adam Müller -- Le socialisme romantique : un projet démocratique post-marxiste -- Socialisme, marxisme, romantisme : affinités électives ? -- Landauer, penseur socialiste vakisch -- Les jeunesses socialistes entre romantisme et marxisme -- Une révolution sous le signe des conseils -- Faire sens du moment révolutionnaire -- Crise de la théorie marxiste -- Une nouvelle idée émerge : des soviets allemands ? -- Le conseil au coeur de la nouvelle démocratie -- Du paradis médiéval aux abysses absolutistes -- Le Moyen Âge communautaire et démocratique -- La barbarie de l'absolutisme : contrat social et souveraineté -- Crise de l'absolutisme -- Romantisme et absolutisme -- Le romantisme comme projet d'avenir -- Le romantisme, une hérédité occultée -- Une critique radicale du libéralisme -- La radiographie de l'ennemi : Carl Schmitt contre le romantisme politique -- Un livre sous influences : les racines françaises de la critique schmittienne -- Le jeune Schmitt : une position atypique entre isolement et influence étrangère -- Les inspirateurs allemands -- Les parrains français -- Le romantisme politique : l'idéologie de l'ennemi -- Romantisme : l'impossible définition ? -- Aux sources intellectuelles du romantisme -- L'essence du romantisme : l'occasionnalisme subjectivisé -- Le romantisme comme impuissance politique -- Qui est l'ennemi ? Schmitt et la crise de l'idéologie allemande -- Schmitt l'inquisiteur de Carl ? -- Continuités d'une pensée en guerre -- La mort de l'intellectuel apolitique -- L'universalisme romantique d'Othmar Spann : la réponse allemande à l'individualisme moderne -- Spann et la galaxie universaliste -- Othmar Spann, père de l'Église néoromantique -- L'école néoromantique -- "L'État véritable" et l'actualité du romantisme politique -- De l'histoire économique au projet politique -- Les éléments de la contre-offensive romantique -- Rejet nazi de l'universalisme spannien : l'enjeu romantique -- Penser l'envers de la modernité : romantisme et conservatisme chez Karl Mannheim -- Penser à la marge -- L'émigré hongrois -- Un travail scientifique entre décentrement et écriture essayistique -- Trouver sa place à l'université : la thèse de 1925 -- La naissance romantique du conservatisme -- Conservatisme et traditionalisme : de l'anthropologie à l'idéologie -- Morphologie du conservatisme allemand : à contre-courant de la modernité -- Le locus antimoderne : le romantisme aux sources du conservatisme -- Une nouvelle synthèse ? -- S'ouvrir à l'irrationnel : penser comme conservateur -- La synthèse et ses "vecteurs" : une conceptualité romantique ?
- La politique radicale de Wilhelm von Schramm : victoire du christianisme romantique -- Wilhelm von Schramm : officier, écrivain et théoricien politique -- Au coeur des réseaux du nouveau conservatisme weimarien -- La fascination du modèle russe : le bolchevisme entre émulation et terreur -- Ernst Jünger : nationalisme militaire et théorie de la guerre -- Les jeunes-conservateurs et la tradition du romantisme politique -- Le modèle soviétique -- Le projet intellectuel : aller à l'essentiel -- Théorie générale du bolchevisme -- Bolchevisme et romantisme allemand : généalogie du nouvel universalisme -- Revenir aux racines allemandes : le romantisme comme solution -- Le XIXe siècle allemand : entre mission romantique et schizophrénie nationale -- Le projet romantique et chrétien de Wilhelm von Schramm -- Mythe romantique et décision socialiste : Paul Tillich à la recherche de l'unité du politique -- La "jeune droite" et la rénovation de la social-démocratie -- Des "jeunes-socialistes" à la "jeune droite" -- La plateforme du renouveau : les Neue Blatter flir den religilisen Sozialismus -- Le projet socialiste contre le mythe romantique -- Crise et division : penser le monde moderne à l'aune du jeune Hegel -- Ontologie politique : l'homme entre origine et devenir -- Le mythe de l'origine : retour critique sur le romantisme politique -- Antinazisme ou réconciliation ? -- Le projet politique de Tillich en 1933.
00:05 Publié dans Définitions, Livre, Livre, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, définition, romantisme, communauté, théorie politique, politologie, révolution conservatrice, carl schmitt, othmar spann, ernst jünger, allemagne, philosophie politique, paul tillich |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 10 mars 2015
From Romanticism to Traditionalism

From Romanticism to Traditionalism
Thomas F. Bertonneau
Ex: http://peopleofshambhala.com
The movement called Romanticism belongs chronologically to the last two decades of the Eighteenth and the first five decades of the Nineteenth Centuries although it has antecedents going back to the late-medieval period and sequels that bring it, or its influence, right down to the present day. Historically, and in simple, Romanticism is the view-of-things that succeeds and corrects its precursor among the serial views-of-things that have shaped the general outlook of the Western European mentality – what historians of ideas call Classicism, and which they identify as the worldview of the Enlightenment. A good definition of Classicism is: The devotion to prescriptive orderliness for its own sake in all departments of life; the submission of all things to measure, decorum, and, using the word metaphorically, the geometric ideal. Classicism implies the conviction that reason, narrowly delimited, is the highest faculty, and indeed almost the sole faculty worth developing. The Classicist believes that life can be perfected by rationalization. Certainly this is how the Romantics saw Classicism, but it is also in broad terms how the Classicists saw themselves. According to its own dichotomy, Romanticism would be a view of existence consisting of tenets diametrically opposed to those of Classicism.

Detail of “The Course of Empire: Desolation,” 1836, oil on canvas, by Thomas Cole (1801-1848), founder of the Hudson River School.
And so largely it was or is, as Romanticism is by no means a dead issue. As the Romantic sees it, imposed or conventional order tends to distort or obliterate the natural order; and by “natural order” the Romantics would have understood not only the order of nature, considered as Creation, but the order present in social adaptation to the natural order, as when agriculturalists follow the cycle of the seasons and attune their lives with the life of the soil or when builders of monuments and temples go to great effort to align them astronomically. In addition, the Romantic believes that a bit of disorder might stimulate and enliven life, preventing it from becoming stiff and ossified; that the quirky and unexpected can exert a benevolent influence. The Romantic also values emotion and intuition as much as he values reason, which he by no means disdains although he defines it more broadly than the Classicist. The Romantics explicitly rejected the utilitarian arguments of the Classicists. Romanticism prefigures and is the likely source of what in the second half of the Twentieth Century came to be known as Traditionalism.
I. Characteristics of Romanticism. Where the geometrically patterned gardens of the French kings, like those designed by Claude Millet in 1632 for Louis XIV at Versailles, might stand for the Classical Spirit, the “English Garden,” with its meandering paths, sprawling bushes, and indifference to the weeds might stand for the Romantic Spirit. Where Classicism took as its model Greece or Rome, Romanticism looked to the Middle-Ages. Where Classicism venerated the purest, most elevated Attic style of speech, Romanticism cultivated the Gothic, the Celtic, and the regional dialect; it was not averse to rude or rustic idiom. Classical playwrights like Pierre Corneille (1606 – 1684) and Jean Racine (1639 – 1699) imitated Euripides and Seneca; Romantic playwrights like Friedrich Schiller (1788 – 1805) and Victor Hugo (1802 – 1885) imitated Shakespeare, whom Voltaire had dismissed as a barbarian and his work as a formless affront to the unities. Classicism concerns itself with form, which prescribes content, Romanticism with content, which then suggests the form.
What have the scholars written about Romanticism? None exceeds the scholarly stature of Jacques Barzun (1907 – 2012), whose study From Dawn to Decadence: 500 Years of Western Cultural Life (2000) devotes three chapters to Romanticism. Remarking that Romanticism had, in the broadest sense, something of the quality of a religious or spiritual awakening, and that, unlike Classicism, it extended its horizon of curiosity very far indeed – as for example into myth and folklore considered as other than mere superstition – Barzun writes:
With their searching imagination in literature and art, it could be expected that the Romanticists’ intellectual tastes would be anything but exclusive. They found the Middle Ages a civilization worthy of respect; they relished folk art, music, and literature; they studied Oriental philosophy; they welcomed the diversity of national customs and character, even those outside the [Eighteenth Century] cosmopolitan circuit; they surveyed dialects and languages with enthusiasm. This was a genuine multiculturalism, the wholehearted acceptance of the remote, the exotic, the folkish, [and] the forgotten.
Barzun adds that, “in Romanticism, thought and feeling are fused; [Romanticism’s] bent is toward exploration and discovery at whatever risk of error or failure; the religious emotion is innate and demands expression… the divine may be reached through nature or art.” Under Barzun’s description, Romanticism would be humanly more whole than Classicism, with the latter excluding rather than incorporating the emotional impulse while granting to intuition a key role in the exploration of existence.
The Norwegian scholar, F. J. Billeskov Jansen (1907 – 2002), writing in the compendium Romantikken: 1800 – 1830 (Verdens Litteratur Historie, V. III, 1972), asserts that:
Opplysningstidens mennesker hade fryktet lidenskapene, som kunne true den sunne fornuft. Alt hos Klopstock ble likevel den religiøse lidenskap frigjort, og hos Rousseau elskovspasjonen og natursvermeriet. I romantikkens tidsalder blir diktere drømmere, Sjelen utvides I lengsel mot uendligheten, gjennom innføling forener poeten med nature, hans fantasi fører ham langt bort på eventyrets vinger eller langt tilbake i historien; hans håp får form av religiøse visjoner.
[The men of the Enlightenment had feared the passions, which could threaten right reason. Simultaneously in [the work of Friedrich Gottlieb] Klopstock religious enthusiasm gained liberation, (just) as in the work of (Jean-Jacques) Rousseau did amorous passion and ecstasy in nature. In the age of romanticism, poets became dreamers. The soul expands in longing for infinity, the poet attaining oneness with nature through his inward feeling, while his imagination leads him far afield on the wings of adventure or far back into history; his hope takes the form religious visions.]
Elsewhere in the same volume, another scholar characterizes Romanticism as a return of Platonic theology. Certainly Plato’s myths of the “Ladder of Philosophy,” “The Winged Horses and their Charioteer,” and “The Cave” find their later reflection in the imagery of the Romantic poets. For Plato, importantly, the phenomena of this world point to a purely spiritual world – the realm of God and the Ideas. We find a similar attitude in the poetry William Blake (1757 – 1827) and in that of William Wordsworth (1770 – 1850). The main point to be stressed, however, is Jansen’s description of Romanticism as the labor of the soul to break free from the trammels of degraded matter and to rejoin a vital spirit that suffuses the universe and renders it intelligible. The Romantics concluded that the assumptions of rationalism were parochial and constricting; that they did not give a true account of humanity or the universe.
In his study of Poetic Diction (1928), philologist and literary critic Owen Barfield (1898 – 1997) attempts to identify and prescind the fundamental Romantic ideas, one of which has to do with the role of “the rational principle”:
Now although, without the rational principle, neither truth nor knowledge could have been, but only life itself, yet that principle cannot add one iota to knowledge. It can clear up obscurities, it can measure and enumerate with greater and ever greater precision, [and] it can preserve us in the dignity and responsibility of our individual existences. But in no sense can it be said… to expand consciousness. Only the poetic can do this: only poesy, pouring into language its creative intuitions, can preserve its living meaning and prevent it from crystallizing into a kind of algebra. “If it were not for the Poetic or Prophetic character,” wrote William Blake, “the philosophic and experimental would soon be at the ratio of things, and stand still, unable to do other than repeat the same dull round.”
For Barfield, Romanticism qualifies not only as a revolt against the strictures of the Enlightenment; it is not only the accession of a new type of taste or sensibility that supersedes an earlier one: It is a change – and, for Barfield, a positive development – in human consciousness. Understood in the way that Barfield, Jansen, and Barzun see it, Romanticism resembles – or, rather it anticipates –Traditionalism. In The Crisis of the Modern World (1927), for example, René Guénon (1886 – 1951) describes the modern person as averse to referring “beyond the terrestrial horizon” and as crediting “no knowledge beyond what proceeds from the sense.” For Guénon, the modern world “is anti-Christian because it is essentially anti-religious; and it is anti-religious because, in a still wider sense, it is anti-traditional.” Writing in Harry Oldmeadow’s anthology The Betrayal of Tradition (2005) and invoking the spirit of T. S. Eliot, Brian Keeble asserts that fullness of humanity requires contact with “the transcendent dimension”; and, calling on Blake, he invokes the “sacred reality of the spirit.”
II. The Romantic Subject. Romanticism saw a great flowering of lyric poetry, and this was no coincidence. Lyric poetry is personal, even egocentric, poetry; or it is poetry personal in character even in the case where the putative “I” who speaks in the poem is purely fictional and is not to be identified with the author. The name lyric suggests the solo singer accompanying himself on the lyre, bursting out in song, as the spirit takes him. Lyric poetry is expressive: It represents in externalized imagery the internal state, intellectual or emotional, of the poet. Of course, inner states usually correlate themselves with external circumstances and conditions. Anyone who comments on the soul also necessarily comments on the world. The Romantics seized on the lyric as their primary mode of poetizing because the conventions of lyric so perfectly suited that part of the Romantic program that concerned the exploration of the subject’s inner life. Of course, the Romantic poet interests himself in much more than in pouring out the contents of his overflowing heart. That would be a sophomoric misapprehension. On the contrary, for the talented poet, well-schooled, mentally acute, moved by inveterate curiosity about the world, even a brief lyric poem can be the vehicle of a subtle critique or argument. If the Romantic poet were a prophet then he would also be a philosopher.
What does it mean to be a subject, an ego, an “I”? Subjectivity is self-consciousness, an abiding awareness that one is this person, with this biography (always thus far), and with these relations to and with and in the world – and not some other person with other relations. But every subject, every self-conscious person, is aware that the world is full of other self-conscious persons whose subjectivity, as he infers, is generically like his own right down to the detail that each has (or ought to have) a similar sense of his own particularity and difference from the others. Beyond persons, places, and things, the subject senses – although he can never empirically grasp – a totality of things, a cosmos, and an authorial or organizing principle, for which the common name is God. Wisdom consists in knowing that there was a world indefinitely before his own subjectivity began and there will be a world indefinitely after his own subjectivity ceases; he is a part of something larger than himself, which lies beyond the limits of his will.
Mood conditions subjectivity. The typical self-consciousness addressed in the previous paragraph should be qualified as the healthy self-consciousness. Because, however, no one can keep the world absolutely at bay, he must suffer the impingements of the world, whether happily or sadly. Forces beyond a subject’s control can alienate him from himself and through ignorance or perversity he can exacerbate his alienation. The Romantics believed that the worldview of Classicism, or the Enlightenment, described life and the world falsely, and that those who embraced its falsehoods must in some way become alienated. The Romantics regarded with acute skepticism the modern claims concerning material progress. “The world is too much with us, late and soon, / Getting and spending, we lay waste our powers,” wrote Wordsworth. In the labyrinth of the new metropolis, the soul might once again lose its way and suffer, as men once did in the Cities of the Plain, and experience pure indifference with respect to its own sickness. What kind of civic environment would arise from the presence together in large urban agglomerations of millions of such afflicted people? The psychic problem must inevitably become a social and a cultural problem.
It is worth quoting Wordsworth’s sonnet in full:
The world is too much with us; late and soon,
Getting and spending, we lay waste our powers;—
Little we see in Nature that is ours;
We have given our hearts away, a sordid boon!
This Sea that bares her bosom to the moon;
The winds that will be howling at all hours,
And are up-gathered now like sleeping flowers;
For this, for everything, we are out of tune;
It moves us not. Great God! I’d rather be
A Pagan suckled in a creed outworn;
So might I, standing on this pleasant lea,
Have glimpses that would make me less forlorn;
Have sight of Proteus rising from the sea;
Or hear old Triton blow his wreathèd horn.
The Romantics understood that consciousness rises to acuity in events and crises, like that experienced by Wordsworth’s monologist in the stale abjection of his despair. The growth of consciousness proceeds punctually rather than gradually, and it entails the tribulations of a solemn pilgrimage. Lyric poetry, being the poetry of the subject’s self-consciousness, therefore also tends to be the poetry of sudden events – discrete moments in which the subject suddenly discovers something about himself, the world, or himself in relation to the world, that hitherto he did not know and knowledge of which alters him. It might be, as in the case of “The world is too much with us,” the discovery of one’s own spiritual poverty; it might be an access of grace. Such moments sometimes bear the name of epiphany; they are in any case always revelatory – and they cannot be solicited. They impose themselves, as if by external guidance, as gifts, upon the percipient.
The epiphanic or revelatory quality of lyric poetry has to do with its effort to appear spontaneous. Every work of art requires arduous labor, even a fourteen-line sonnet, but Wordsworth, for example, insisted that he drew inspiration from abrupt visionary experiences and that articulating the vision although onerous entailed given textual form to a unitary idea. Discussing the origin of his major poems – The Prelude, The Excursion, and the unfinished Recluse – in letters to his friends, Wordsworth situated himself as the channel for impulses that had befallen him, as revelation befalls the prophet, whether he seeks his election or not.
The Romantic subject resembles – or, rather, it anticipates – the Traditionalist subject, as Guénon, Nicolas Berdyaev (1874 – 1948), and others have defined it. Guénon himself in The Reign of Quantity and the Signs of the Times (1945) characterizes modern man as having “lost the use of the faculties which in normal times allowed him to pass beyond the bounds of the sensible world.” This loss leaves modern man alienated from “the cosmic manifestation of which he a part”; in Guénon’s analysis modern man assumes “the passive role of a mere spectator” and consumer, which is exactly how Wordsworth saw it. Of course, Guénon does not write of loss as an accident, but as the logical consequence of choices and schemes traceable to the Enlightenment. As Wordsworth put it, “We have given our hearts away – a sordid boon.”
According to Berdyaev, writing in The Destiny of Man (1931), “Man is not a fragmentary part of the world but contains the whole riddle of the universe and the solution of it.” Berdyaev asserts that, contrary to modernity, “man is neither the epistemological subject [of Kant], nor the ‘soul’ of psychology, nor a spirit, nor an ideal value of ethics, logics, or aesthetics”; but, abolishing and overstepping all those reductions, “all spheres of being intersect in man.” Berdyaev argues that, “Man is a being created by God, fallen away from God and receiving grace from God.” The prevailing modern view, that of naturalism, “regards man as a product of evolution in the animal world,” but “man’s dynamism springs from freedom and not from necessity”; it follows therefore that “evolution” cannot explain the mystery and centrality of man’s freedom. When Berdyaev brings “grace” into his discussion, he echoes the original Romantics, whose version of grace was the epiphanic vision, the event answering to a crisis that brings about the conversion of the fallen subject and sets him on the road to true personhood.
III. Romantic Nature. The Romantic redefinition of nature, which the Romantics invariably capitalize as Nature, runs in parallel with the Romantic redefinition of selfhood. Where the Enlightenment had reduced nature to material processes – geological, chemical, physiological, mechanical, and optical – with no reference to anything outside themselves, Romanticism in reaction posited Nature not only as vital throughout but also as meaningful, and natural phenomena as pointing beyond themselves to things supernatural. This redefinition of nature was perhaps less a total innovation than it was the re-appropriation of an old idea going back to late-medieval thinkers like Jakob Boehme (1575 – 1624), Paracelsus (1493 – 1541), and even Johannes Kepler (1571 – 1630), who saw in nature a decipherable living message that implies a message-maker whose motivation must be that he wishes to establish contact with human beings. Behind those figures lies Christian Platonism. Under this late-medieval idea, the sensitive soul can not only come into communication through nature with what lies beyond nature; but he can also, through nature, come into communion with what is beyond nature. In Christian, rather than pagan, terms, the Romantic rediscovers Nature as “The Book of Nature,” a kind of supplement to the two Testaments, whose author is God, as normally or eccentrically conceived by the individual writer-thinker.
A longstanding and not altogether inaccurate thumbnail categorization of Romantic poetry is that it is nature poetry. The Romantic penchant for verbal picturesque redoubles the plausibility of the claim. Here, for example, is Samuel Taylor Coleridge (1772 – 1834) conjuring forth the abyss that lies beneath “The Pleasure Dome of Kubla Khan” in the fragmentary poem (1798) of that name.
But oh! that deep romantic chasm which slanted
Down the green hill athwart a cedarn cover!
A savage place! as holy and enchanted
As e’er beneath a waning moon was haunted
By woman wailing for her demon-lover!
And from this chasm, with ceaseless turmoil seething,
As if this earth in fast thick pants were breathing,
A mighty fountain momently was forced:
Amid whose swift half-intermitted burst
Huge fragments vaulted like rebounding hail,
Or chaffy grain beneath the thresher’s flail:
And mid these dancing rocks at once and ever
It flung up momently the sacred river.
Five miles meandering with a mazy motion
Through wood and dale the sacred river ran,
Then reached the caverns measureless to man,
And sank in tumult to a lifeless ocean;
And ’mid this tumult Kubla heard from far
Ancestral voices prophesying war!
In Coleridge’s poem, which he subtitles “a vision in a dream,” Nature is all depth, but better to say that for Coleridge in “Kubla Khan” Nature is vital depth; Nature is a wellspring of robust and creative urgencies that is almost everywhere and almost at every moment alive. The exception would be the “lifeless ocean,” a symbol perhaps of what we now call entropy, but in a world of perpetual emergence even a “lifeless ocean” might be redeemed and revivified. Indeed, Coleridge in the quoted verses seems to be rescuing the etymon of the word nature, which is the same etymon that gave rise to the French verb naître, “to be born” or “to give birth.” The “chasm” gives birth to “a mighty fountain,” which in turn transforms itself into “a sacred river.” Coleridge’s endowment on the scenario of the term “sacred” reminds us that his Nature is not only vital, but hallowed or divine. The creative processes in nature point to a divine creative power beyond nature that reveals itself in phenomena and solicits from the sensitive soul the idea of something that requires a formal acknowledgment of its generative awesomeness.
Coleridge’s “caverns measureless to man” stand for the unplumbed depths not only of Nature but of the soul. To explore the hidden depths of Nature means also to explore the soul and vice versa. Coleridge draws on ancient conceptions that the Enlightenment claimed to have debunked, such as the conception of the psyche or soul, as articulated by the archaic philosopher-seer Heraclitus of Ephesus in one of his surviving aphorisms (No. 45): “You will not find out the limits of the soul when you go, travelling on every road, so deep a logos does it have.” Where the Enlightenment assumed that everything might be measured – that is to say, brought within the horizon of finite knowledge – Coleridge insists that the world possesses a “measureless” dimension that resists logical summary or reduction to purely quantitative or propositional terms. The only way to discuss such things is in symbol, imagery, and figure-of-speech.
A similar view of Nature as the source of vital energy necessary to the soul informs the final scene of Johann Wolfgang von Goethe’s Faust Part II (1831), where the errant sinner, Doctor Johann Faust, at last finds redemption from his graceless and degraded state. Goethe (1749 – 1832) sets his scene in primeval nature:
Waldung, sie schwankt heran, Felsen, sie lasten dran, Wurzeln, sie klammern an, Stamm dicht an Stamm hinan, Woge nach Woge spritzt, Höhle, die tiefste, schützt. Löwen, sie schleichen stumm-– freundlich/ um uns herum, Ehren geweihten Ort, Heiligen Liebeshort.
[Forests, they wave around,
Over them, cliffs bear down,
Roots cling to rocky ground,
Trunk upon trunk is bound,
Wave after wave sprays up,
Deep caves protecting us.
Lions prowl silently,
Round us, still friendly,
Honouring sacred space,
Love’s holy hiding place.]
A few verses later, the character called Pater Profundis, who will play a mediating role in Faust’s redemption, utters these lines:
Wie Felsenabgrund mir zu Füßen Auf tiefem Abgrund lastend ruht, Wie tausend Bäche strahlend fließen Zum grausen Sturz des Schaums der Flut, Wie strack mit eignem kräftigen Triebe Der Stamm sich in die Lüfte trägt: So ist es die allmächtige Liebe, Die alles bildet, alles hegt. Ist um mich her ein wildes Brausen, Als wogte Wald und Felsengrund, Und doch stürzt, liebevoll im Sausen, Die Wasserfülle sich zum Schlund, Berufen, gleich das Tal zu wässern; Der Blitz, der flammend niederschlug, Die Atmosphäre zu verbessern, Die Gift und Dunst im Busen trug – Sind Liebesboten, sie verkünden, Was ewig schaffend uns umwallt. Mein Innres mög‘ es auch entzünden, Wo sich der Geist, verworren, kalt, Verquält in stumpfer Sinne Schranken, Scharfangeschloßnem Kettenschmerz. O Gott! beschwichtige die Gedanken, Erleuchte mein bedürftig Herz!
[As this rocky abyss at my feet,
Rests on a deeper abyss,
As a thousand glittering streams meet
In the foaming flood’s downward hiss,
As with its own strong impulse, above,
The tree lifts skywards in the air:
Even so all-powerful love,
Creates all things, in its care.
Around me there’s a savage roar,
As if the rocks and forests sway,
Yet full of love the waters pour,
Rushing bountifully away,
Sent to irrigate the valley here:
The lightning that flashed down,
Must purify the atmosphere,
With poisonous vapours bound –
They are love’s messengers, they tell
Of what creates eternally around us.
May it inflame me inwardly, as well,
Since my spirit, cold and confounded,
Torments itself, bound in the dull senses,
As sharp-toothed fetters’ agonising art.
Oh, God! Calm my thoughts, pacify us,
And bring light to my needy heart!]
For Goethe as for Coleridge, Nature is the bourn of life, to which the afflicted soul might return to be nursed back to health. We recall that in Wordsworth’s sonnet “The world is too much with us,” the lyric subject feels exiled from nature and, in his attempt to rejoin with nature, catastrophically rebuffed. The world seems to him lifeless and still, and he also with it; he wants revivification. Faust seeks the same. Goethe’s “forests” answer him not in stillness, but make constantly a motion as they “wave around.” Just so, the “cliffs” actively “bear down” and “roots cling.” The dimension of depth goes not missing, for in Goethe’s scene “deep caves protect us” in a landscape thickly tangled (“trunk upon trunk”) that is “sacred” and, like some lonely place where a ritual purification might occur, hidden (“Love’s holy hiding place”) from profane eyes. When Pater Profundis (“The Father of the Depth”) begins to speak, he credits the landscape with “its own strong impulse.” The tree, straining its branches skyward, responds to the attractive principle of “Love” that serves Goethe for the equivalent of the non-anthropomorphic energy suffusing the caverns beneath Coleridge’s “stately pleasure dome” in “Kubla Khan.”
A poignant recurrence of this Coleridgean-Goethean constellation of ideas about Nature may be found in the work of the late John Michell (1933 – 2009), who referred to himself as a “Radical Traditionalist.” Readers know Michell best for his persistent work on the megalithic monuments of the European Neolithic Period, especially in Britain, which he demonstrated to have constituted a continental, and perhaps even a global, network whose builders intended them to help in keeping the dominion of man in contact with the dominion of the stars and of the deities that the stars betokened. Like Coleridge and Goethe, Michell posited a vital energy inherent in the earth, which the old stone circles and the long straight lines connecting them channeled and tapped. Michell possessed that conviction of a deep past antecedent to himself that distinguishes both Romanticism and Traditionalism from the modern default-state of “historylessness” and dogmatic materialism.
In The View over Atlantis (1969; revised as The New View over Atlantis, 1985), Michell writes how “of the various human and superhuman races that have occupied the earth in the past we have only the dreamlike accounts of the earliest myths, which tell of the magical powers of the ancients.” In his bold assertion, Michell echoes the prophecies of Blake, who revived the Old Plato’s “true myth” from the Timaeus in his epic poem America (1793). As in the Genesis-story of the Deluge or in Plato’s “Atlantis” story, Michell pieces together a narrative about “an overwhelming disaster of human or natural origin which destroyed a system whose maintenance depended upon its control of natural forces across the entire earth.” In one sense, Michell has simply reiterated that the Enlightenment happened, cutting across the lines of Tradition and depriving humanity of its proper heritage. For Michell, as for Blake or Wordsworth or Goethe, history is not the “account… of a recent ascent from bestiality and barbarism to the triumphs of modern civilization, but of a gradual, barely interrupted decline from the universal high culture of [Neolithic] antiquity to the present state of fragmentation and impending dissolution.”
IV. Romantic Nature Continued. Often for the Romantic poet, nature gives cover to secret activities that betoken an older world that in modern civic domains has given way to the despiritualizing forces of measure and logic – in the sociological process that some historians refer to as de-mystification. Nature is mysterious; she is the “magic forest” of the fairy-tales and legends, to enter which is perforce to run the risk of impish enthrallment or initiatory imperilment. In the pathways of the forest, man, in his ancient role as hunter, pursues wild game and, taking the prey, becomes one with it. The opening stanzas of “le Cor” (1826) by the French poet Alfred de Vigny (1797 – 1863) instantiate this variant of the Romantic Nature:
J’aime le son du Cor, le soir, au fond des bois, Soit qu’il chante les pleurs de la biche aux abois, Ou l’adieu du chasseur que l’écho faible accueille, Et que le vent du nord porte de feuille en feuille. Que de fois, seul, dans l’ombre à minuit demeuré, J’ai souri de l’entendre, et plus souvent pleuré! Car je croyais ouïr de ces bruits prophétiques Qui précédaient la mort des Paladins antiques. [I love the sounding horn, of an eve, deep within the woods, Whether it sings the plaints of the threatened doe Or the hunter’s retreat but faintly echoed That the north wind carries from leaf to leaf.
[How often alone, in midnight shadows concealed, I have smiled to hear it, even shedding a tear! I thought to hear sounding prophetic plaints, Declaring the death-knell for knights of old.]
As in Coleridge and Goethe, Nature in Vigny’s poetry offers herself as depth; she furnishes the paradoxically unapprehended scene of a ritual performance, which, however, the lyric subject can reconstitute in his imagination, provoked to the activity by the very sound. The horn-call reaches the lyric subject of Vigny’s poem from far away in the concealment of the woods, a place of half-light and shadows. The horn-call incites the lyric subject, as he says, to love: “I love the sounding of the horn, of an eve, deep within the woods.” But what is this “love”? It is precisely the awakened desire for the transcendent and unseen, for depth and distance; and it is a response to the sacred, mirrored in the desire of man for woman, and of the soul for beauty.
Note how in the first stanza of Vigny’s poem the sound of the horn mingles with the rustling of the north wind, as though the two timbres had become one and therefore indistinguishable. In the second stanza, the horn-call comes to resemble “prophetic plaints, / declaring the death-knell for knights of old.” Not only the reunion of culture and nature, which have become alienated from one another, but also whole extinct worlds of medieval pageantry and hieratic drama, lie concealed in oaken and beechy precincts. Let it be noted finally, in passing, how Vigny’s “Cor” with its “prophetic plaints” makes a parallelism with Coleridge’s “Kubla Khan,” where “ancestral voices” are “prophesying war.”
What do the scholars say about the Romantic view of landscape and nature? François-René Chateaubriand (1768 – 1848), a second-generation French Romantic who was also one of the early scholars of Romanticism, writes in his great study of The Genius of Christianity (1802) concerning the distinction between ancient and modern poetry that “mythology… circumscribed the limits of nature and banished truth from her domain.” In modern poetry, by which Chateaubriand means Christian poetry: “The deserts have assumed a character more pensive, more vague, and more sublime; the forests have attained a loftier pitch; the rivers have broken their pretty urns, that in future they may only pour the waters of the abyss from the summit of the mountains; and the true God, in returning to his works, has imparted his immensity to nature.” Chateaubriand associates paganism with naturalism – that is to say, with the taxonomic or classifying study of natural phenomena, as exemplified in the work of Pliny the Younger. Chateaubriand thus opposes the Romantic or Christian view of Nature against the Classical or Pagan view of nature, which had been taken up again by the Enlightenment, favoring the former over the latter.
If, as Chateaubriand writes, “the prospect of the universe [excited not] in the bosoms of the Greeks and Romans those emotions which it produces in our souls,” then it follows that the Enlightenment mentality, surveying the same “prospect,” would come away from the encounter as affectively blank as did the Epicurean precursor whose view Eighteenth-Century Classicism has reinvented. The modern poet in confronting the universe, according to Chateaubriand, enjoys the differentiating privilege to “taste the fullness of joy in the presence of its Author.” It is true that there is no Pagan equivalent of the Fall-from-Grace. Because consciousness is equivalent to recollection, and because paganism never experienced Nature as lost, the Christian sense of Nature must exceed the Pagan sense in both quality and intensity. Christianity is a return to nature or a recovery of it, a homecoming, as it were, with all the poignancy thereof.
In Natural Supernaturalism (1973), one of the great studies of the Romantic Movement, and with specific reference to Wordsworth, M. H. Abrams (born 1912 – still living) writes that for the Grasmere poet “Scriptural Apocalypse is assimilated to an apocalypse of nature [whose] written characters are natural objects, which [the poet reads] as types and symbols of permanence in change.” Abrams shows in his study how Wordsworth in particular and the Romantics in general inherited from Edmund Burke and German idealism the aesthetic dichotomy of The Beautiful and the Sublime. The Beautiful is whatever is picturesque, pleasing, and amiable in Nature. The Sublime is whatever is awesome, threatening, and grandiose in Nature. In communing with Nature, the sensitive soul finds in Beauty the stepping-stone to the Sublime, and it is in the Sublime that he reads – or has read to him – the real lesson of Nature. Abrams writes that the “antithetic qualities of sublimity and beauty are seen [by the poet] as simultaneous expressions on the face of heaven and earth, declaring an unrealized truth which the chiaroscuro of the scene articulates for the [properly] prepared mind – a truth about the darkness and the light, the terror and the peace, the ineluctable contraries that make up our human existence.”
In American Sublime: Landscape Painting in the United States, 1820 – 1880 (2002), Andrew Wilton and Tim Barringer comment on the centrality of the Sublime in the Romantic conception of landscape. “The Sublime,” they write, “incorporated a further dimension [namely that] the imagination has an important part to play in our perception of what is immense, nebulous, beyond exact description.” When the percipient discovers “spiritual significance in nature,” he is not making a passive observation; on the contrary, he is participating in the constitution of such significance. Writing of Frederic Church’s panorama in oils of Niagara (1857), Wilton and Barringer remark that, “it is not a meditation on light, but on the power of nature manifested in the grandest geographical phenomena.” They go on to remark that “Church conceived [Niagara] as a show-piece, a masterpiece in the original sense: a specimen of his own powers at their most impressive – a match, perhaps, in a consciously humble way, to God’s own.” Church’s canvass also communicates with the “abyss” of Coleridge’s “Kubla Khan,” a metaphor of the soul and of the psychic component of the universe as “measureless to man.”
V. Traditionalism as the New Phase of Romanticism. Abrams’ attribution to Wordsworth of a sense of Nature as “apocalyptic” applies equally well to Church (1826 – 1900), for whom the great cataract, directly on the brink of which his painting positions the viewer, is also “apocalyptic” – God revealing His greatness through the sublimity of the falling waters, the magnificent roar, and the rearing luminous mists. Church painted a number of scenes that would have pleased Michell, such as his “Aegean Sea” (1877), with its ancient ruins, including the half-hidden entrance to a cave-shrine, against a brilliantly light island-harbor with mists and rainbows. Church’s “Cross in the Wilderness” (1857), with its rugged mountains and faraway, luminous horizon, implies a Chateaubriand-like grasp of the religious struggle, with its concluding vision, as the essentially human struggle. It probably implies Michell’s ley-lines and megalithic power-foci. The Hudson River School of painting, to which Church belonged, was a thoroughly Romantic phenomenon, motivated by an awareness of the disappearing wilderness, which it sought to record, and dedicated to the ideal that civilization must never violate the natural order; that humbleness before the sublimity of the natural world is the proper attitude for civilized people to assume.
The Lake Poets in England and the Hudson River painters in North America feared the tendencies of their era – the spread of callous industrialism, the aggrandizement of cities, the blighting of the countryside, and the coarsening of the soul. They warned against these trends even as it became evident that the trends would overwhelm any critique. The Lake Poets eventually came to grasp that their philosophical and aesthetic convictions implied a politics. Wordsworth and Coleridge became Tories, or as Americans would say, conservatives. Vigny and Chateaubriand were also on the right, the former describing himself as the sole male survivor of a parental generation that the Revolution had eaten alive. These men would better be described, however, as reactionaries – against the encroachments of the Reign of Quantity and the pseudo-ethos of “getting and spending” – and as Traditionalists: Defenders and conservators of the local against the metropolitan, of dialect against rhetoric, and of the spirit against a prescriptively and intolerantly materialist view of life and the world. Their opposite numbers were the propagandists for the insidious synergy of the laborites and socialists with the bankers and industrialists.
In The Communist Manifesto (1848), Karl Marx (1818 – 1883) and Frederick Engels (1820 – 1895) condemn the bourgeoisie, whom they propose to abolish, but they extol the “subjection of Nature’s forces to man, machinery, application of chemistry to industry and agriculture, steam-navigation, railways, electric telegraphs, clearing of whole continents for cultivation, canalisation of rivers, whole populations conjured out of the ground” that “Capitalism,” the project of the bourgeoisie, had created. Marx, as much as the industrialists, looked forward to the “extension of factories and instruments of production owned by the State; the bringing into cultivation of waste-lands, and the improvement of the soil generally in accordance with a common plan” and to the “establishment of industrial armies, especially for agriculture.” Scots poet Robert Burns (1759 – 1796) had already indicted the right riposte in his “Impromptu on the Carron iron Works” (1787):
We cam na here to view your warks, In hopes to be mair wise, But only, lest we gang to hell, It may be nae surprise: But when we tirl’d at your door Your porter dought na hear us; Sae may, shou’d we to Hell’s yetts come, Your billy Satan sair us!
In the prevailing situation in the second decade of the Twenty-First Century, the literature professors prefer denouncing the Romantic poets to understanding them, and the art-history professors regard the Hudson River painters as “illustrators” who could not possibly have believed in the Transcendentalist or spiritualist doctrines that they expounded. Prophets of modern thought like Theodore Wiesengrund Adorno (1903 – 1969) and Jacques Derrida (1930 – 2004) have, of course, conclusively demonstrated that all Lake Poets and all Hudson River painters, even the ones who were Unitarians hence half-way to being modern liberals, were and remain servitors of false consciousness and an oppressive “logocentrism,” from which everyone should be compulsorily liberated. In the colleges and universities, the Cultural-Marxist hatred for anything not Cultural-Marxist grows red-hot, white-hot, and ultraviolet-hot by swift stages. That is a metonymy of exactly what the early twentieth-Century Traditionalists predicted.
In The End of Our Time (1933), Berdyaev argues that, “The Renaissance began with the affirmation of man’s creative individuality; it has ended with its denial.” Creativity, which Michelangelo and J. S, Bach ascribed to God, produces unequal results that inspire “envy,” which in turn solicits a demand for “equality.” For Berdyaev, the principle of modernity is “envy of the being of another and bitterness at the inability to affirm one’s own.” Thus, according to Berdyaev’s analysis, “Our age is like to that which saw the passing of the ancient world” although “that was the passing of a culture incomparably finer than the culture of today.” It is possible, writes Berdyaev, to “trace the ruin of the Renaissance in modernist art, in Futurism, in philosophy, in Critical Gnoseology… and finally in socialism and anarchism,” all of which begin with a rejection of Romantic, and therefore of religious, values.
In The Meaning of the Creative Act (1916), Berdyaev, contrasting “Canonic” or “pagan” art with “Christian art, or, better, the art of the Christian epoch,” arrives at the dichotomy that “pagan art is classic and immanent” where “Christian art is romantic… and transcendent.” The parallelism between Berdyaev and Chateaubriand will be abundantly self-evident. As Berdyaev sees it, “In [the] classically beautiful perfection of form [in] the pagan world there is no upsurge towards another world… no abyss… above or below”; that is, no “caverns measureless to man.” The Romantic, knowing that he can never achieve perfection in this world, shies from utopian projects that inevitably become coercive and universal. Thus “a romantic incompleteness… characterizes Christian art,” which takes as a premise, among others, the conviction “that final, perfect, eternal beauty is possible only in another world.” That the Romantic often succumbs to the frustration inherent in eternal longing, Berdyaev notes; but the Romantics themselves knew their vulnerability in this regard well and were wont candidly to diagnose it, as Wordsworth does in “The world is too much with us,” candidly. Berdyaev saw in Nineteenth-Century Romanticism the last pause in the steady descent of the Western world into materialism, utilitarianism, and nihilism, the equivalent of Guénon’s Kali Yuga or Dark Age.
Contemporary Traditionalism picks up where Berdyaev, Guénon, and the mid-Twentieth Century anti-modernists, and again where the Romantics, in their century, left off. Traditionalists recognize that the critical situation of their time is deeper, more degraded, more irremediably catastrophic than the of one hundred or one hundred-and-fifty years ago, but they also see that it is the same crisis and that if the Endarkenment of their day were more acute by a magnitude at least than it was in 1820 or 1920 it would also be closer to its irrevocable finale. The problem for Traditionalists is how severe that finale will be. Will it conform itself to the Foundering of Atlantis or the Fall of Rome? The former constituted a choke-point after which civilized life had to begin again from the degree zero. The latter sacrificed the Imperial infrastructure, both physical and bureaucratic, for the reorientation of Western European humanity from the Mediterranean to the Atlantic. The Greeks and Romans feared to sail beyond the Pillars of Hercules. Significantly, the conquest of the Atlantic and the opening up of North America fell to those Northwestern Goths, the Vikings, at the very moment when Iceland was embracing Christianity. Leif Erikson was an early convert, as was Thorfinn Karlsefni.
Modernity is a Polyphemus, an angry unison-chorus, shouting like thunder that man is the measure and that there is nothing, not measurable by man. Traditionalism is the quiet voice, seeking parlay with other hushed voices, so that together they might enter conversation with the Forest Murmurs and even the distant Music of the Spheres and come to know better what they already suspect, that man must begin by measuring himself against the measureless.
[This essay is dedicated to Professors Cocks and Presley and to “The Two Scholars.”]
Thomas F. Bertonneau earned a Ph.D. in Comparative Literature from the University of Califonia at Los Angeles in 1990. He has taught at a variety of institutions, and has been a member of the English Faculty at SUNY Oswego since 2001. He is the author of three books and numerous articles on literature, art, music, religion, anthropology, film, and politics. He is a frequent contributor to Anthropoetics, the ISI quarterlies, and others.
00:08 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : courants littéraires, romantisme, littérature, lettres, traditionalisme, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 13 décembre 2011
Lumière de Herder
Lumière de Herder
 En cette période de montée des nationalismes – voire des « ethnicismes » – en Europe comme ailleurs, les ethnologues, qui redoutaient naguère d’être considérés comme des suppôts du colonialisme, éprouvent souvent aujourd’hui, à l’inverse, l’angoisse d’être, malgré eux, de par la nature et l’objet même de leur discipline, des apôtres du tribalisme, des défenseurs inconscients d’un romantisme contre-révolutionnaire exaltant les valeurs particularistes contre l’universalisme des Droits de l’homme et du citoyen.
En cette période de montée des nationalismes – voire des « ethnicismes » – en Europe comme ailleurs, les ethnologues, qui redoutaient naguère d’être considérés comme des suppôts du colonialisme, éprouvent souvent aujourd’hui, à l’inverse, l’angoisse d’être, malgré eux, de par la nature et l’objet même de leur discipline, des apôtres du tribalisme, des défenseurs inconscients d’un romantisme contre-révolutionnaire exaltant les valeurs particularistes contre l’universalisme des Droits de l’homme et du citoyen.
En penseur, qu’on a pris récemment, un peu rapidement, pour l’emblème même de ce tribalisme (1), semble, au contraire, être un de ceux dont l’œuvre peut aider à lever cette angoisse, en ouvrant le chemin à un rationalisme rénové, apte à comprendre le lien qui, à l’est de l’Europe en particulier, mais à l’ouest parfois aussi, unit nationalisme et recherche de la démocratie. Ce penseur, c’est Johann Gottfried Herder.
Herder et l’Aufklärung
Herder, honni par Joseph de Maistre (2) et vénéré, au contraire, par Edgar Quinet, Thomas Mazaryk et d’autres grandes figures de la démocratie européenne et américaine, est un héritier éclatant de la pensée des Lumières, de l’Aufklärung du XVIIe siècle, même s’il la critique parfois. En fait cette critique est une critique « de gauche », dirait-on aujourd’hui, et non « de droite », comme celle de Maistre ou Bonald. Comme l’a écrit Ernst Cassirer, en Herder, la philosophie des Lumières se dépasse elle-même et atteint son « sommet spirituel » (Cassirer 1970 : 237).
Effectivement, il n’est guère de thèmes fondamentaux de sa pensée, du relativisme à la philosophie de l’histoire, du naturalisme au déisme, etc., dont on ne retrouve les antécédents, au XVIIe et au XVIIIe siècle, chez les meilleurs représentants de la philosophie des Lumières, qu’il s’agisse de Saint-Evremont ou de Voltaire, de l’abbé Du Bos ou de David Hume, d’Adam Fergusson ou de D. Diderot. Y compris le thème du Nationalgeist. Y compris celui du relativisme (je préférerais dire « perspectivisme »).
Ce n’est pas Herder, mais Hume qui, dans ses Essais de morale, écrit : « Vous n’avez point eu assez d’égard aux mœurs et aux usages de différents siècles. Voudriez-vous juger un Grec ou un Romain d’après les lois d’Angleterre ? Écoutez-les se défendre par leurs propres maximes, vous vous prononcerez ensuite. Il n’y a pas de mœurs, quelque innocentes et quelque raisonnables qu’elles soient, que l’on ne puisse rendre odieuses ou ridicules lorsqu’on les jugera d’après un modèle inconnu aux auteurs » (Hume 1947 : 192). Il est vrai que ce souci d’équité ethnologique ne signifie pas, pour Hume, qu’il ne faut pas souhaiter l’effacement de différences nationales. Mais, dans l’idéal, Herder le souhaite pareillement. S’il lui arrive de faire l’éloge des « préjugés », c’est-à-dire des présupposés culturels attachés à telle ou telle nation ou civilisation, c’est uniquement dans la mesure où cela peut donner aux pensées la force et l’effectivité qui risquent de leur manquer lorsqu’elles s’efforcent d’atteindre l’humain et l’universel seulement par un refus abstrait du particulier. L’idée est d’ailleurs dans Rousseau. Elle n’empêche pas de poser que « l’amour de l’humanité est véritablement plus que l’amour de la patrie et de la cité » (Herder 1964 : 327).
Quant au Nationalgeist, Montesquieu le nomme « esprit du peuple », « caractère de la nation ». Même chez Voltaire on trouve les notions de « génie d’une langue » et de « génie national » (3). Il est vrai que, chez eux, ce ne sont sans doute pas des principes originels, mais qu’ils dépendent d’autres facteurs historiques. Cependant, il n’en est pas autrement chez Herder. En fait, Herder voit dans le peuple ou la nation un effet statistique, produit par un ensemble de particularités individuelles, modelées par un même milieu, un même climat, des circonstances historiques communes, des emprunts similaires à d’autres peuples et la tradition qui en résulte. La nation n’apparaît comme une entité substantielle qu’à un regard éloigné, qu’à une vue d’ensemble. Herder est, au fond, sur le plan de la théorie sociale, comme il l’est d’ailleurs sur le plan éthique, un individualiste (4). La primauté de la société ne signifie rien d’autre, chez Herder, que l’idée que l’histoire ne peut être que celle des peuples, celle du peuple, et non celle des rois et de leurs ministres ; elle ne peut être que celle de la civilisation. Et, de ce point de vue, Herder est un voltairien qui ne s’ignore pas…
Une anthropologie de la diversité
Il y a cependant deux sources majeures de la pensée de Herder, sans lesquelles il n’est pas facile de la comprendre, et toutes deux ont eu une énorme influence sur l’Aufklärung allemande : ce sont l’œuvre de Leibniz et celle de Rousseau.
Sans Rousseau, il n’est pas possible de comprendre la logique qui unit le rationalisme de Herder à son anthropologie de la diversité. C’est Rousseau qui, le premier sans doute, nous a fait comprendre que la raison et la liberté étaient une seule et même chose. Herder lui emboîte le pas. Précurseur de Bolk et de Géza Roheim (5), théoricien de l’immaturité essentielle de l’homme ou, tout au moins, de son indétermination, qui fait sa liberté, mais qui est également la raison même de sa raison, Herder montre clairement que la diversité des cultures est la conséquence directe de l’existence de cette raison, qui n’est pas une faculté distincte, mais, en quelque sorte, l’être même de l’homme. La différence entre l’homme et l’animal n’est pas une différence de facultés, mais, comme il le dit dans le Traité sur l’origine de la langue, une différence totale de direction et de développement de toutes ses facultés (1977 : 71).
Mais si la raison n’est pas une faculté séparée et isolée, elle est présente dès l’enfance, dès l’origine, dans le moindre effort de langage. La raison herderienne est une raison du sens, non une raison du calcul, une raison vichienne, non une raison cartésienne, mais c’est une raison tout de même. Et fort importante, puisque la seconde ne va pas sans la première ; et puis parce que la raison cartésienne ne fonde ni morale ni droit.
Herder, comme Vico, a pressenti à quoi conduisait un certain cartésianisme. S’il n’existe pas un trésor de sens, où chacun puisse puiser ce qui le fait cet être unique et, en même temps, de part en part dicible (donc, par là même, en qui subsiste toujours du non-dit), qu’est un être humain, alors on parvient rapidement à l’humpty-dumptisme, qui est la pire des tyrannies. Chacun va décréter le sens des mots dans la mesure du pouvoir dont il dispose. Il n’y aura plus aucun contrat possible, aucune entente, sinon par le pouvoir despotique de quelque Léviathan. La politique de Descartes, ce ne pourrait être, effectivement, dans ces conditions, que le monstre froid que décrit Hobbes et où c’est, effectivement, le souverain qui décide du sens des mots. C’est bien ce monstre que les grands hommes d’Etat du XVIIe siècle cherchent à réaliser, à commencer par le cardinal de Richelieu. Cela aboutit finalement à la fameuse « langue de bois », même si cela ne commence que par d’apparemment innocentes académies.
Un eudémonisme relativiste
L’idée de l’essentielle variabilité humaine conduit à une éthique d’une grande souplesse, puisque, pour Herder, la raison est d’abord inhérente à la sensibilité ; et donnant pour fin à l’homme le bonheur, elle en modèle la figure idéale en fonction de la diversité des besoins et des sentiments. L’infinie variété des circonstances produit aussi une infinie variété des aspirations et le bonheur, qui est le but de notre existence, ne peut être atteint partout de la même façon : « Même l’image de la félicité change avec chaque état de choses et chaque climat – car qu’est-elle, sinon la somme de satisfactions de désirs, réalisations de buts et de doux triomphes des besoins qui tous se modèlent d’après le pays, l’époque, le lieu ? » C’est que « la nature humaine… n’est pas un vaisseau capable de contenir une félicité absolue…, elle n’en absorbe pas moins partout autant de félicité qu’elle le peut : argile ductile, prenant selon les situations, les besoins et les oppressions les plus diverses, des formes également diverses » (Herder 1964 : 183).
Il y a donc chez Herder une sorte d’eudémonisme relativiste que Kant ne pourra supporter, et qui signifie que, pour Herder, l’individu n’est pas fait pour l’État ni, d’ailleurs, pour l’espèce. Les générations antérieures ne sont pas faites pour les dernières venues, ni les dernières venues pour les futures. Ainsi le sens de la vie humaine n’est pas dans le progrès de l’espèce, mais dans la possibilité pour chacun, à toute époque, de réaliser son humanité, quelle que soit la société dans laquelle il vit et la culture propre à cette société. Il y a là un humanisme qui s’oppose à celui de Kant, pour qui nous devons accepter que les générations antérieures sacrifient leur bonheur aux générations ultérieures ; celles-ci, seules, pourront en jouir. Herder, au contraire, pense que chaque époque a son bonheur propre ; chaque époque, chaque peuple et même chaque individu. Car chaque période, mais aussi chaque individu forme, pour ainsi dire, un tout qui a sa fin en soi. C’est pourquoi Herder en vient même à récuser tout finalisme dans l’explication historique, de peur d’avoir à subordonner le destin des individus au cours de l’histoire globale. Dieu n’agit dans l’histoire que par des lois générales naturelles, non téléologiques, et par l’effet de notre propre liberté.
Des monades dans l’histoire
Mais Herder est aussi un leibnizien. C’est dire que son individualisme n’est pas atomistique, mais monadique ; ce qui signifie qu’il a un caractère dynamique et que l’individu y intègre l’universel qui est dans la totalité organique de l’histoire.
Ce que dit Ernst Cassirer de la conception leibnizienne de l’individuel éclaire la conception herderienne :
« Chaque substance individuelle, au sein du système leibnizien, est, non pas seulement une partie, un fragment, un morceau de l’univers, mais cet univers même, vu d’un certain lieu et dans une perspective particulière… toute substance, tout en conservant sa propre permanence et en développant ses représentations selon sa propre loi, se rapporte cependant, dans le cours même de cette création individuelle, à la totalité des autres et s’accorde en quelque façon avec elle » (Cassirer 1970 : 65).
Pourtant, il y a, dans Une autre philosophie de l’histoire (Auch eine Philosophie der Geschichte), un passage où Herder semble nous dénier la possibilité d’être, comme il dit, « la quintessence de tous les temps et de tous les peuples ». En fait, il admet que nous avons en nous toutes les dispositions, toutes les aptitudes, toutes les potentialités qui se sont manifestées comme réalités achevées dans les diverses civilisations du passé. De ce point de vue, il y a, en chacun de nous une égale quantité de forces et un même dosage de ces forces. Mais un leibnizien ne sépare pas l’individualité des circonstances qui modèlent son développement. L’individualité est dans la continuité d’un développement qui intègre les circonstances qui permettent à cette individualité de se manifester.
Or chaque civilisation, chaque culture réalise un des possibles de l’humain et en occulte d’autres (6). Au cours de l’histoire, il se peut donc que l’ensemble des virtualités de la nature humaine se trouvent réalisées, mais tour à tour, non simultanément. Chaque moment, cependant, fruit d’une égale nécessité, possède un égal mérite. Cela ne contredit pas l’idée d’un progrès d’ensemble, mais va contre un évolutionnisme pour lequel l’humain ne se réalise pleinement qu’au terme de l’histoire (ou de la préhistoire, pour parler le langage d’un certain marxisme).
Herder utilise, au fond, le principe auquel Haeckel donnera son nom en le formulant en termes biologiques, mais qui est aussi la maxime d’une vieille métaphore : la phylogénèse se retrouve dans l’ontogénèse ; et on comprend à partir de là comment il peut concilier progression – Fortgang – et égalité de valeur. L’enfance vaut par elle-même, elle a ses propres valeurs, son propre bonheur ; l’adolescence, de même. Mais c’est quand même l’adulte qui est l’homme achevé, l’homme dans sa maturité.
Mais, mieux encore, l’égalité herderienne des cultures et des époques trouve sa justification dans ce que Michel Serres (1968 : 265) appelle, chez Leibniz, « la notion d’altérité qualitative dans une stabilité des degrés » : « En passant du plaisir de la musique à celui de la peinture, dit Leibniz, le degré des plaisirs pourra être le même, sans que le dernier ait pour lui d’autre avantage que celui de la nouveauté… Ainsi le meilleur peut être changé en un autre qui ne lui cède point, et qui ne le surpasse point. » Il n’en reste pas moins qu’« il y aura toujours entre eux un ordre, et le meilleur ordre qui soit possible ». S’il est vrai qu’« une partie de la suite peut être égalée par une autre partie de la même suite », néanmoins « prenant toute la suite des choses, le meilleur n’a point d’égal (7) ». Mais on peut aller beaucoup plus loin, et dire que, de même qu’il y a équipotence entre, non seulement la suite des nombres pairs et la suite des carrés, mais la suite des carrés, par exemple, et la suite des entiers, le meilleur a même puissance dans une partie de la suite et dans l’ordre du tout.
Chez Herder, il se peut donc que chaque phase ou chaque époque soit la meilleure, que chaque culture soit la meilleure, mais qu’il y ait, en plus, un meilleur dans l’ordre de succession, c’est-à-dire un ordre progressif, où le meilleur n’est atteint que dans le progrès même, en tant que succession bien ordonnée. Au-delà, on peut dire aussi que l’universel – un universel dynamique, celui de l’histoire comme totalité non fermée – est présent dans la singularité des cultures et des individus.
Inversement, d’ailleurs, l’universel n’existe qu’incarné dans des singularités historiques. C’est le cas, par exemple, du christianisme, religion universelle par excellence, mais qui n’existe que sous telle ou telle forme, particulière à telle ou telle époque, à telle ou telle civilisation : « Il était radicalement impossible que cette odeur délicate pût exister, être appliquée, sans se mêler à des matières plus terrestres dont elle a besoin pour lui servir en quelque sorte de véhicule. Tels furent naturellement la tournure d’esprit de chaque peuple, ses mœurs et ses lois, ses penchants et ses facultés… plus le parfum est subtil, plus il tendrait par lui-même à se volatiliser, plus aussi il faut le mélanger pour l’utiliser » (Herder 1964 : 209-211).
Un patriotisme cosmopolite
La présence de l’universel dans le singulier et le fait que le singulier et l’universel ne puissent être séparés rend compte de la possibilité, pour Herder, d’être à la fois cosmopolite et patriote, comme le furent ultérieurement quelques-uns de ses grands disciples. Le cosmopolite selon Herder n’est donc pas l’adepte d’un cosmopolitisme abstrait qui s’étonne de ne pas retrouver en chacun l’homme universel qu’il prétend lui-même incarner. Le cosmopolitisme de Herder est un cosmopolitisme de la compréhension entre les peuples et entre les cultures, c’est un cosmopolitisme « dialogique ».
De 1765 (année où il prononce à Riga son discours, Avons-nous encore un public et une patrie commune comme les Anciens ?) jusqu’à la fin de sa vie, Herder gardera cette position humaniste, hostile au particularisme aveugle, favorable seulement à un patriotisme qui ouvre sur l’universel. Herder récuse le patriotisme exclusif des anciens, qui regarde l’étranger comme un ennemi. Il veut, quant à lui, voir et aimer tous les peuples en l’humanité, dont il dit qu’elle est notre seule vraie patrie.
Il est vrai que cette vertu d’humanité, il pensera finalement que le peuple allemand sera, dans la période de l’histoire qui vient, celui qui l’incarnera probablement le mieux et que son aptitude à la philosophie en fait un excellent porteur d’universalité ; ce qui n’est pas si mal vu, si l’on pense à l’éclatante lignée de penseurs que l’Allemagne produira, de Kant à Marx et au-delà. De Lessing, Herder et Kant, avec Schiller et Goethe, Herzen (1843) dira que leur but commun fut de « développer les caractères nationaux pour leur donner un sens universel ».
On pourrait en dire autant de la génération suivante, celle des romantiques, pour laquelle on affiche quelquefois en France un bien curieux mépris. De Tieck, Novalis, Achim von Arnim, Clemens Brentano, Lucien Lévy-Bruhl (1890 : 336) écrivait : « Ce n’est pas un sentiment de patriotisme qui poussait ces écrivains à exhumer les trésors de l’Allemagne du Moyen Age. Le contraire est plutôt vrai : ce fut l’Allemagne du Moyen Age, retrouvée et passionnément aimée, qui réveilla en eux le patriotisme. Encore n’arrivèrent-ils à l’Allemagne que par un long et capricieux circuit, en faisant le tour du monde. Ils se seraient reproché, sans nul doute, de s’enfermer dans l’étude des antiquités germaniques. Elle eût offert à elle seule un champ de travail assez vaste ; mais les Romantiques ne s’y attardèrent point. Ils le parcoururent un peu, comme on l’a dit, en chevaliers errants. Leur humeur vagabonde, d’accord avec leur cosmopolitisme, les emportait bientôt ailleurs. »
Herder est préromantique dans la mesure où il y a, dans le romantisme, une sorte d’universalisme du populaire, où l’universalisme se concilie fort bien avec le pluralisme. En fait, ce qu’on retrouve dans le pluralisme littéraire de Goethe, de Herder et des romantiques d’Allemagne et d’ailleurs, c’est la volonté de réhabiliter le sensible et de fonder une esthétique, au sens large et au sens étroit. Peut-être même faut-il dire que le romantisme est là d’abord, et, de ce point de vue, il est déjà chez le Kant de la Critique du jugement, voire même chez Leibniz.
Mais cette réhabilitation du sensible est, en même temps et du même coup, une réhabilitation du sens, c’est-à-dire de la langue. Tout part de là chez Herder et tout y aboutit ; chez Herder comme aussi, par exemple chez Schlegel. Il s’agit d’édifier une science où l’on puisse vivre. Mais cette science est déjà présente dans la culture populaire, dans les cultures populaires. Cette réhabilitation du sensible s’intéresse donc au « populaire » en général, à l’« ethnique » si l’on veut, mais aussi à autrui, à l’autre en tant que tel, car autrui, c’est d’abord du sensible et il n’y a pas de monde sensible sans autrui. Autrui n’est accessible que comme sensible, et ce sensible ne peut être réduit. Feuerbach, de ce point de vue, est dans la postérité du romantisme, et le romantisme est peut-être ce qui a rendu possible l’ethnologie.
Herder « gauchiste »
Herder, cependant, reste un Aufklärer, mais, nous l’avons dit, un Aufklärer de gauche ; de gauche, et même d’extrême gauche. Et c’est la raison pour laquelle certains croient voir en lui un adversaire des Lumières, voire même un contre-révolutionnaire, ce qui constitue un assez joli contresens.
Il y a une autre raison de cette méprise, chez les auteurs français tout au moins : c’est que Herder se réclame du christianisme. C’est même un homme d’Église, un pasteur ; à l’époque (1784) où il écrit les Ideen (Herder 1962), il est évêque de Weimar. Or les Français pensent généralement que les Lumières sont nécessairement antichrétiennes, ce qui est une grave erreur historique, surtout en ce qui concerne l’Allemagne. Herder, en fait, est dans la tradition allemande de la Guerre des paysans, au temps de la Réforme, guerre dont l’idéologie fut celle d’un protestantisme populaire, millénariste et extrêmement avancé sur le plan social. C’est de Herder que Goethe tire l’idée de Goetz von Berlichingen. Mais on retrouve la même attitude chez le Herder tardif des Ideen, lorsqu’il fait l’éloge des hussites, de anabaptistes, des mennonites, etc., après avoir fait celui des bogomiles et des cathares pour les mêmes raisons. On le voit bien, dans ce chapitre des Ideen, où il se situe (Herder 1962 : 483-489). Cette position « gauchiste » de Herder aboutit effectivement à une critique de la philosophie des Lumières sur un certain nombre de points : théorie mystificatrice du contrat social, goût du despotisme « éclairé », tolérance envers l’esclavagisme et l’exploitation coloniale, avec sa brutalité destructrice, racisme, etc. Il s’agit bien d’une critique « de gauche », dont nous avons déjà vu une manifestation dans le refus de soumettre les individus aux « fins de l’histoire ».
En ce qui concerne la doctrine du contrat social, il ne faut pas oublier qu’elle a pris diverses formes et que chez certains de ses plus illustres défenseurs, elle aboutit à une légitimation de l’absolutisme. C’est le cas non seulement de la doctrine de Hobbes, mais de celles de Grotius et de Pufendorf. On oublie généralement le côté par où la théorie du contrat prétend engendrer la cité en engendrant le gouvernement de la cité. Hormis Rousseau, c’est le cas de nombre de ses adeptes. Et, dans ces conditions, ils admettront souvent que le gouvernement de la cité, quelles que soient sa nature et son origine de fait (y compris la conquête), existe par contrat tacite, ce qui n’est en fait, la plupart du temps, qu’une légitimation a posteriori de la force. C’est ce côté de la doctrine du contrat qu’attaque Herder, le côté par où, par une série de confusions, entre gouvernement et État, puis entre État et société, elle risque d’aboutir à l’absolutisme.
Herder est, avant tout, un adversaire du « despotisme éclairé », à la manière de Frédéric II et de quelques autres. Son soutien à ce que nous appellerions peut-être aujourd’hui des « ethnies » a principalement ce fondement. A tort ou à raison, il pense que la diversité ethnique, comme la multiplicité des corps intermédiaires (communautés diverses, villes-cités, etc.) est un puissant contrepoids à la force niveleuse du despotisme.
L’envers de cette haine du despotisme sous toutes ses formes, y compris le prétendu despotisme éclairé, c’est l’esprit démocratique. En dénonçant le nationalisme de Herder, on oublie que son nationalisme est lié à cet esprit démocratique. Les sujets d’un monarque n’ont pas de patrie. Le despotisme a aussi pour effet de freiner le développement des sciences et des arts. La culture, qui est créativité et non réception passive d’une tradition, est démocratique et nationale, tout à la fois et indissolublement.
Un nationalisme anarchiste
A vrai dire, Herder est non seulement antiabsolutiste, mais antiétatiste, contre l’État, anarchiste en ce sens-là. Contrairement à beaucoup de penseurs des Lumières, il soutient que l’État est, en lui-même, plutôt contraire au bonheur de l’individu que l’agent principal de ce bonheur. C’est un point important parce qu’il est à rattaché à cette méprise qui fait dire à Herder, par des citations isolées de leur contexte, qu’il est contre le mélange des nations et des cultures. Il n’est pas contre le mélange (8), il est contre l’État conquérant et impérialiste, qui groupe sous sa domination une foule de peuples divers dont il étouffe la diversité. C’est ce mélange-là que Herder repousse.
Herder est pour les peuples parce qu’il est pour le peuple, et il est pour le peuple parce qu’il est contre l’État, contre toute forme étatique, contre l’absurdité de la monarchie héréditaire (et la tradition, pour lui, sur le plan politique en tout cas, ne légitime rien du tout), contre la tyrannie des aristocraties, contre le Léviathan démocratique, dans la mesure où la démocratie reste un État, dans la mesure où elle est toujours cratie, même si elle est démo. Herder est aussi contre les classes sociales, qui vont contre la nature parce qu’elles ne sont établies que par la tradition, encore une fois – ce qui montre que Herder n’a rien d’un traditionaliste !
Pour Herder, tous les gouvernements éduquent les hommes pour les laisser dans l’état de minorité, dans une détresse infantile qui permet de mieux les dominer. Et, de ce point de vue, Herder retourne l’Aufklärung kantienne contre elle-même. Car c’est à Kant qu’il faut attribuer le principe cité par Herder dans les Ideen : « L’homme est un animal qui a besoin d’un maître et attend de ce maître ou d’un groupe de maîtres le bonheur de sa destination finale. » C’est un résumé de la position kantienne telle qu’elle est exprimée dans l’Idée d’une histoire universelle du point de vue cosmopolitique (Kant 1947 : 67 et sq.). Herder réplique : « L’homme qui a besoin d’un maître est une bête ; dès qu’il devient homme, il n’a plus besoin d’un maître à proprement parler… La notion d’être humain n’inclut pas celle d’un despote qui lui soit nécessaire et qui serait lui aussi un homme » (Herder 1962 : 157). Kant le prendra assez mal, mais c’est bien lui qui, dans sa philosophie de l’histoire prend position contre l’autonomie, et c’est Herder qui la défend.
L’antiétatisme de Herder est à relier à son antiartificialisme, à son antimécanicisme, et à cet organicisme dont on ne voit pas que, loin de subordonner l’individu aux finalités du tout, comme une pièce de la machine au fonctionnement de la mécanique entière, lui confère, au contraire, l’activité d’un organe sans lequel le tout ne pourrait s’animer. Il y a du Herder chez Stein, le ministre libéral de Frédéric-Guillaume IV, lorsqu’il soutient que l’Etat doit être non une machine, mais un organisme. Cette idée, précisément, est au fondement du libéralisme de Stein. Elle signifie que les sujets ne doivent pas être des instruments passifs aux mains de l’État, mais des organes actifs, capables d’initiatives.
L’antimilitarisme de Herder, sa polémique contre le principe de l’équilibre européen, invoqué par les princes pour mener leurs sujets au combat, sont à rattacher au même état d’esprit. La guerre est un instrument du totalitarisme de l’Etat monarchique, où personne « n’a plus le droit de savoir… ce que c’est que la dignité personnelle et la libre disposition de soi » (ibid. : 277), où le grain de sable qu’est l’individu ne pèse rien dans la machine (ibid. : 279).
Anticolonialisme
Mais Herder va plus loin dans le refus de certaines conséquences de la philosophie des Lumières, philosophie qui prône les vertus du commerce et de l’économie marchande. Dans une des pages les plus saisissantes de Une autre philosophie de l’histoire, il dénonce, avec une ironie voltairienne, les dévastations que fait subir à l’humanité la prédominance de cette économie marchande. C’est là une des clés de la pensée de Herder, qui a fort bien vu le lien étroit qu’il y a entre la colonisation « extérieure » et la colonisation « intérieure ».
Encore une fois, le point de vue de Herder est celui de la révolution paysanne. Herder est issu d’une famille de paysans pauvres et il a vécu à Riga, qui fut touchée par la révolte des anabaptistes au XVIe siècle. On peut peut-être rendre compte de son attitude à partir de là.
Il écrit donc : « Où ne parviennent pas, et où ne parviendront pas à s’établir des colonies européennes ! Partout les sauvages, plus ils prennent goût à notre eau-de-vie et à notre opulence, deviennent mûrs pour nos efforts de conversion ! Se rapprochent partout, surtout à l’aide de l’eau-de-vie et de l’opulence, de notre civilisation – seront bientôt, avec l’aide de Dieu, tous des hommes comme nous ! Des hommes bons, forts, heureux.
« Commerce et papauté, combien avez-vous déjà contribué à cette grande entreprise ! » Plus loin, il poursuit : « Si cela marche dans les autres continents, pourquoi pas en Europe ? C’est une honte pour l’Angleterre que l’Irlande soit si longtemps restée sauvage et barbare : elle est policée et heureuse. ».
Herder fait ensuite allusion au sort de l’Écosse. Mais il n’y en a pas que pour l’Angleterre ; la France n’est pas oubliée : « Quel royaume en notre siècle n’est devenu grand et heureux par la culture ! Il n’y en avait qu’un qui s’étalait au beau milieu, à la honte de l’humanité, sans académies ni sociétés d’agriculture, portant des moustaches et nourrissant par suite des régicides. Et vois tout ce que la France généreuse, à elle seule, a déjà fait de la Corse sauvage ! Ce fut l’œuvre de trois… moustaches : en faire des hommes comme nous ! des hommes bons, forts, heureux ! »
« L’unique ressort de nos États : la crainte et l’argent ; sans avoir aucunement besoin de la religion (ce ressort enfantin !), de l’honneur et de la liberté d’âme et de la félicité humaine. Comme nous savons bien saisir par surprise, comme un second Protée, le dieu unique de tous les dieux : Mammon ! et le métamorphoser ! et obtenir de lui par force tout ce que nous voulons ! Suprême et bienheureuse politique ! » (Herder 1964 : 271-273).
Plus loin encore, il récidivera, mettant cette fois en cause ce qu’il appelle le « système du commerce », et qui embrasse, semble-t-il, à la fois l’idéologie sous-jacente à la science économique et le capitalisme commercial, industriel et agraire : « Notre système commercial ! Peut-on rien imaginer qui surpasse le raffinement de cette science qui embrasse tout ? … En Europe, l’esclavage est aboli parce qu’on a calculé combien ces esclaves coûteraient davantage et rapporteraient moins que des hommes libres ; il n’y a qu’une chose que nous nous soyons permise : utiliser comme esclaves trois continents, en trafiquer, les exiler dans les mines d’argent et les sucreries – mais ce ne sont pas des Européens, pas des chrétiens, et en retour nous avons de l’argent et des pierres précieuses, des épices, du sucre, et… des maladies intimes ! Cela à cause du commerce, et pour une aide fraternelle réciproque et la communauté des nations ! « Système du commerce. » Ce qu’il y a de grand et d’unique dans cette organisation est manifeste : trois continents dévastés et policés par nous, et nous, par eux, dépeuplés, émasculés, plongés dans l’opulence, l’exploitation honteuse de l’humanité et la mort : voilà qui est s’enrichir et trouver son bonheur dans le commerce » (ibid. : 279-281).
On a rarement dénoncé avec autant de véhémence les ravages qui ont rendu possible l’édification de notre « économie-monde ». Herder a fort bien vu que l’entreprise, malgré « l’humanisme » de ses hérauts et thuriféraires, prenait volontiers appui sur un racisme ordinaire ou extraordinaire.
Antiracisme
Herder a fort bien vu aussi ce que la notion même de race, appliquée au genre humain, comporte de racisme implicite, dans la mesure où elle suppose, en fait, un polygénisme. Ceux qui, comme Buffon ou Kant se veulent monogénistes, mais parlent néanmoins de races humaines, sont donc, au moins, inconséquents. Herder est, lui, résolument monogéniste, contrairement à Voltaire, par exemple, qui pensait que « les Blancs et les Nègres, et les Rouges, et les Lapons et les Samoyèdes et les Albinos ne viennent certainement pas du même sol. La différence entre toutes ces espèces est aussi marquée qu’entre les chevaux et les chameaux »… Le monogénisme chrétien est donc à rejeter : « Il n’y a… qu’un brahmane mal instruit et entêté qui puisse prétendre que tous les hommes descendent de l’Indien Damo et de sa femme (9). »
Herder croit à la profonde unité de l’espèce humaine parce qu’il croit à la profonde unité des traditions. L’apparente diversité de ce qu’on appelle les races humaines n’est qu’un effet de la diversité des climats qui ne peut, tout au plus, produire que des variétés, mais qui ne pourrait, en aucun cas, engendrer des espèces. Cette diversité n’est donc pas un fait d’histoire naturelle, mais plutôt, pourrait-on dire, de géographie historique ou d’histoire géographique ; histoire qui témoigne, en tout cas, de la souplesse d’organisation de l’espèce humaine, c’est-à-dire de sa raison. Chez Herder, l’universalité de la raison prend appui non seulement sur la diversité des cultures, mais même sur la diversité d’apparence physique, de race, si l’on veut.
Selon lui, on perd le fil de l’histoire quand on a une prédilection pour une race quelconque et qu’on méprise tout ce qui n’est pas elle. L’historien de l’humanité doit être impartial et sans passion, comme le naturaliste, qui donne une valeur égale à la rose et au chardon, au ver de terre et à l’éléphant. La nature fait lever tous les genres possibles selon le lieu, le temps, la force. Conformément à l’inspiration leibnizienne de la pensée de Herder, « les nations se modifient selon le lieu, le temps et leur caractère interne », mais « chacune porte en elle l’harmonie de sa perfection, non comparable à d’autres » (Herder 1962 : 275). On retrouve ici ce que nous avons développé plus haut.
Herder est donc opposé également au racisme d’un Buffon, chez qui le racisme ou, comme dit Todorov, le « racialisme », entraîne la justification de l’esclavage et, bien entendu et a fortiori, de la colonisation et de la conquête (10). Mais il est probable qu’il ne pouvait non plus approuver Kant, pour qui, certes, même chez les Lapons, les Groenlandais, les Samoyèdes, même les « indigènes des mers du Sud » dont il est question dans les Fondements de la métaphysique des mœurs (1957 : 141) ont droit à notre respect, mais qui n’en sont pas moins à considérer comme moralement condamnables : en premier lieu parce qu’ils n’ont pas su constituer d’État. Or l’État est la condition pour que nous ayons quelque chance d’atteindre à la moralité. En second lieu, et surtout, parce qu’ils ne s’appliquent pas à développer leurs aptitudes par le travail, bref, parce qu’ils n’ont pas notre culture. Plaçant le droit, le droit « rationnel » moderne au-dessus du bonheur et, avec le droit, le travail, l’activité productive qui éveille en l’homme l’idée de la supériorité de la raison sur les sens, Kant aboutit en fait à un naïf européocentrisme, peu en accord avec la philosophie de Herder.
Un nouveau Vico
En Europe même, la prétention à se faire l’éducateur du genre humain risque d’aboutir à une dictature platonicienne des « spécialistes de l’universel ». L’anthropologie herderienne nous propose une conception de la culture qui relativise par avance l’opposition : culture (au singulier) / cultures (au pluriel) ou, plus clairement, l’opposition pensée / culture (au sens de l’anthropologie). Que les cultures, au pluriel, ne contiennent aucune pensée active, aucune créativité, n’est vrai que dans la mesure où « les cultures » ont été écrasées, tronçonnées, émiettées, ôtées à leurs courants d’échange « naturels », mais cela se révèle faux partout où on les laisse s’épanouir normalement.
Herder est un nouveau Vico, qui a compris qu’une éducation purement cartésienne, une éducation de la « table rase », laisse l’homme désemparé, privé de tout repère moral et politique, arraché aux dimensions sociales de son être. L’éducation de la pure pensée doit se compléter d’une éducation des sens et des sentiments, d’une éducation « humaniste » qui fasse place aux certitudes morales, c’est-à-dire au plus probable. Les arts du langage y doivent tenir leur rang, trop souvent méconnu : l’art du discours et des lettres, l’art de la traduction également, nécessaire à la connaissance morale d’autrui, et sans lequel on conçoit mal que puisse se constituer une raison « dialogique ».
Cette raison a besoin aussi de connaissances ethnologiques et historiques, elle a besoin de ce décentrement de la pensée qu’elles procurent, et sans lequel il n’y a point de reconnaissance d’autrui. L’histoire anthropologique, à la manière de Vico ou de Herder réunit ces deux types de connaissances. Elle préfigure l’histoire telle qu’elle a été pratiquée de nos jours, depuis Fustel de Coulanges jusqu’à Michel Foucault, en passant par l’école des Annales. Conformément à l’esprit herderien, cette histoire est, non plus histoire des gouvernants et des hommes de guerre, mais histoire des peuples, histoire des gens, histoire de tous. L’histoire continuiste, dont certains ont la nostalgie, c’est la mythologie du pouvoir, de ce pouvoir qui est, d’ailleurs, souvent responsable précisément des coupures, des cassures dans l’histoire des simples gens et de leurs mentalités, comme il est responsable de l’enfermement des ethnies en elles-mêmes, de leur emprisonnement dans des frontières fermées, bloquant les échanges spontanés entre cultures.
Ce que dit Giuseppe Cocchiara (1981 : 21) de Gian Battista Vico, à savoir qu’avec lui, les traditions populaires entrent, de manière décisive, dans l’histoire, qu’avec lui aussi, les peuples dits « primitifs » sont appelés à faire partie de l’histoire de l’humanité et qu’à ce titre, il est un précurseur des méthodes de l’ethnologie, on pourrait le redire de Herder. Il n’y a pas de peuple qui ne soit dans l’histoire. L’égalité des peuples, c’est aussi cela, c’est l’égale vocation à entrer dans l’histoire et c’est l’égale sympathie que doit leur vouer l’historien. Les insuffisances de l’Aufklärung sur ce point ont persisté souvent jusqu’à nos jours.
Conclusions
Si nous ne perdons pas de vue que la culture allemande des XVIIIe et XIXe siècles a apporté beaucoup à celle de l’Est européen, en Russie même et chez les nations qui connaissent aujourd’hui un réveil démocratique, l’importance de Herder, qui y fut souvent lu et apprécié, n’échappera à personne.
Bien loin d’être un danger pour la démocratie, l’esprit herderien peut être un facteur qui permette d’exorciser les fantômes d’un nationalisme rétrograde et agressif, et d’intégrer les valeurs ethniques et nationales à un esprit démocratique rénové, où l’individualisme ne fasse pas obstacle au sens de la communauté et la recherche du bien-être à la créativité culturelle.
Mais pour que cela soit possible, il ne faut pas caricaturer la pensée de Herder et dévaloriser systématiquement l’une des conquêtes les plus précieuses de l’esprit scientifique, à savoir le perspectivisme, dans la mesure même où il nous permet de rendre justice à toutes les formes d’humanité.
En fait, il est paradoxal que l’on trouve aujourd’hui, du côté des philosophes et des spécialistes des sciences humaines, une remise en cause du perspectivisme et du particularisme linguistique et culturel, à un moment précisément où, à l’inverse, les spécialistes des sciences « dures » et des techniques haut de gamme en viennent au perspectivisme eux aussi – consciemment, car ils l’ont toujours pratiqué en fait – et, dans le travail même de la recherche et de l’invention technique et scientifique, vantent les mérites de la tradition culturelle et son potentiel de créativité.
L’utilisation de l’ordinateur va elle-même dans le sens du perspectivisme. Presque toujours l’ordinateur calcule faux, et il faut trouver son chemin dans le brouillard des erreurs. Or il y a plusieurs chemins possibles…
Dans la physique moderne, l’absence d’ambiguïté et le caractère prédictible des phénomènes a disparu, du fait, en particulier, de l’absence de simplicité du point de départ de la ligne d’événements à prévoir. Comme l’écrit l’épistémologue italien Tito Arecchi (1989), « l’existence d’un point de vue privilégié pour effectuer la mesure, sur laquelle tous les physiciens étaient d’accord, est tombée en disgrâce ». C’est du sein même de la théorie et de la pratique expérimentale physiciennes que surgit le perspectivisme.
Mais il y a un point sur lequel des physiciens et des techniciens se retrouvent pour rapprocher la science moderne des savoirs anciens : dans la recherche de la créativité, l’étude de la dynamique de l’invention scientifique et technique fait ressortir l’importance de l’oral, de l’expression parlée, dans la science et, par conséquent, l’importance de la langue et de l’enracinement de cette langue dans un terreau culturel particulier. Ce sont les physiciens et les technologues, aujourd’hui, qui deviennent herderiens. Je cite Jean-Marc Lévy-Leblond (1990 : 25-26), physicien théoricien : « On peut… tranquillement affirmer que la science, en France, est faite de beaucoup plus de mots français (parlés) qu’anglais (écrits). Qu’il soit nécessaire de rappeler cette évidence montre à quel point le débat est faussé par une grave erreur de conception sur la nature de la recherche scientifique, identifiée à son produit final (les publications), plutôt qu’à son activité réelle. Or cette vitalité de la langue naturelle dans la science est utile et féconde. La science se fait comme elle se parle. A s’énoncer, donc à se penser, dans une langue autre que la langue ambiante, elle perdrait son enracinement dans le terreau culturel commun et serait ipso facto privée d’une source essentielle, même si elle est souvent invisible, de sa dynamique. Les mots ne sont pas des habits neutres pour les idées : c’est souvent par leur jeu libre et inattendu que se fait l’émergence des idées neuves… Et cela est encore plus vrai si l’on considère l’autre versant de la recherche scientifique, celui non de la création novatrice, mais de la réflexion critique. »
Et André-Yves Portnoff, directeur délégué de Science et technologie, va dans le même sens. Avec David Landes, il regrette que beaucoup de responsables du tiers monde « cultivent l’illusion de moderniser leur pays en faisant table rase de leur héritage historique », alors qu’« aujourd’hui, la créativité technologique et industrielle, comme la créativité artistique, fait appel à l’imaginaire », et que, de ce point de vue, « chaque langue, dans toute son épaisseur historique, avec toutes ses strates de mémoire collective, constitue un instrument d’une richesse indispensable » (1990 : 26).
A entendre de tels propos, l’ombre de Herder frémirait d’aise dans l’au-delà. Mais à propos de Herder faut-il parler d’ombre ? Ou de lumière ? Nous optons pour la lumière.
Max Caisson,
« Lumière de Herder », Terrain, numero-17 – En Europe, les nations (octobre 1991)
———————————
Bibliographie :
Arecchi T., 1989. « Chaos et complexité », Le Monde/Liber, n° 1, oct.
Cassirer E., 1970. La philosophie des Lumières, Paris, Fayard (Die Philosophie der Aufklärung, Tübingen, 1932).
Cocchiara G., 1981. Storia del folklore in Italia, Palerme, Sellerio.
Finkielkraut A., 1987. La défaite de la pensée, Paris, Gallimard.
Herder J. G., 1977. Traité sur l’origine de la langue, Paris, Aubier (Abhändlung über den Ursprung der Sprache, 1770).
1964. Une autre philosophie de l’histoire, Paris, Aubier (Auch eine Philosophie der Geschichte, 1774).
1962. Idées pour la philosophie de l’histoire de l’humanité, Paris, Aubier (Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit, 1784).
Herzen A. I., 1843. « Le dilettantisme dans la science », Annales de la patrie.
Hume D., 1947 (1751). Essai de morale, in Enquête sur les principes de la morale, trad. de A. Leroy, Paris, Aubier.
Kant E., 1947. Philosophie de l’Histoire (Opuscules), trad. de St. Piobetta, Paris, Aubier.
1957 (1797). Fondements de la métaphysique des mœurs, trad. de V. Delbos, Paris, Delagrave.
Lévi-Bruhl L., 1890. L’Allemagne depuis Leibniz, Paris, Hachette.
Lévy-Leblond J.-M., 1990. « Une recherche qui se fait comme elle se parle… », Le Monde diplomatique, janv.
Portnoff A.-Y., 1990. « La créativité victime des jargons », Le monde diplomatique, janv.
Roheim G., 1972. Origine et fonction de la culture, Paris, Gallimard.
Serres M., 1968. Le système de Leibniz et ses modèles mathématiques, I, Paris, PUF.
Todorov T., 1989. Nous et les autres, Paris, Le Seuil.
———————–
Notes :
1 – Cf. Finkielkraut (1987).
2 – J. de Maistre appelle Herder « l’honnête comédien qui enseignait l’Evangile en chaire et le panthéisme dans ses écrits ». C’est dire la sympathie qu’il éprouvait pour lui…
3 – Cf. l’article « Français » dans l’Encyclopédie.
4 – En ce qui concerne l’éthique herderienne, voir, dans le présent article, le paragraphe intitulé « Un eudémonisme relativiste. ».
5 – Voir notamment Roheim 1972.
6 – On pourrait, sur ce point, comparer la pensée de Herder avec certaines thèses de Cl. Lévi-Strauss.
7 – Leibniz, 1710. Essais de Théodicée : paragraphe 202.
8 – La preuve est que, pour lui, la prééminence actuelle de l’Europe est due, pour une part, à l’extraordinaire mélange de populations et de cultures qui la caractérise : « En aucun continent les peuples ne se sont autant mélangés qu’en Europe ; en aucun autre ils n’ont si radicalement et si souvent changé de résidences, et avec celles-ci de mode de vie et de mœurs… fusion sans laquelle l’esprit général européen aurait difficilement pu s’éveiller » (Herder 1962 : 309).
9 – Voltaire, Essai sur l’histoire générale et l’esprit des nations depuis Charlemagne jusqu’à nos jours, ch. III.
10 – Voir particulièrement le chapitre intitulé « Les voies du racialisme » dans l’ouvrage de Todorov (1989 : 179 et sq.).
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, herder, allemagne, différentialisme, 18ème siècle, idéologie des lumières, lumières, enracinement, théorie politique, politologie, sciences politiques, romantisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 02 septembre 2011
La critica a "la cosa en si"
La crítica a “la cosa en sí”
(Schopenhauer-Brentano-Scheler)
Alberto Buela (*)
La aparición de Kant (1724-1804) en la historia de la filosofía ha sido caracterizada, no sin razón, como la revolución copernicana de la disciplina. Y así como con Copérnico el sol se transformó en centro del universo desplazando a la tierra, así con Kant la filosofía en el problema del conocimiento dejó de considerar al sujeto un ente pasivo para otorgarle actividad. El mundo dejo de ser el mundo para ser “mi mundo”. El mundo es la representación que el sujeto tiene de él.
Pero Kant fue más allá y concibió a los entes siendo fenómenos para la gnoseología y noúmenos para la metafísica. Es decir, los entes nos ofrecen lo que podemos conocer pero además poseen un “en sí” ignoto. Y acá Kant comete el más grande y profundo error que produce la metafísica moderna: afirmar que existe “la cosa en sí”.
Ya Fichte(1762-1814), en vida de Kant y entrevistándose con él le dijo: ¿cómo puedo sostener, sin contradicción, la existencia de “la cosa en sí”, si al mismo tiempo no puedo conocerla?. Kant lo despachó con cajas destempladas.
Luego vino Schopenhauer (1788-1860) y demostró que la cosa en sí es la voluntad y el mundo no es otra cosa que voluntad y representación. La representación que nos hacemos de los fenómenos y la voluntad que es su fundamento. En forma inteligente y profunda, el solitario de Danzig, no fue contra todo Kant sino contra la parte espuria y errónea de su filosofía.
Se produce en el ínterin una especie de suspensión del pensamiento filosófico clásico con la aparición, cada uno en su estilo, de Feuerbach(1804-1872), A.Ruge(1802-1880), Marx(1818-1883), Stirner(1806-1856), Bauer(1809-1882), Kierkegaard (1813-1855), Nietzsche (1844-1900) donde el tema principal de la metafísica, “la cosa en sí o el ente en tanto ente” , es dejado de lado.
Pero resulta que hay un filósofo en el medio. Ignorado, silenciado, postergado, no comprendido. El hombre más inteligente, profundo y cautivador de su tiempo, Franz Brentano (1838-1917), que se da cuenta y entonces va a afirmar que el ser último de la conciencia es “ser intencional” y que dicha intencionalidad nos revela que el objeto no tiene una existencia en una zona allende, en una realidad independiente, sino que existe en tanto que hay acto psíquico como correlato de éste. De modo que el objeto es concebido como fenómeno, pero el ente es una realidad sustancial que está allí y que tiene existencia independiente del sujeto cognoscente. Es lo evidente, y lo evidente no necesita prueba, pues todo lo que es, es y lo que no es, no es.
Muchos años después, Heidegger (1889-1976) en carta el P. Richardson le cuenta que se inició en filosofía leyendo a Brentano y que su Aristóteles sigue siendo el de Brentano. Y que, “lo que yo esperaba de Husserl era las respuestas a las preguntas suscitadas por Brentano”.
Finalmente Max Scheler (1874-1928), discípulo de E. Husserl que lo fue, a su vez, de Brentano, es el que ofrece una respuesta total y definitiva al falso problema planteado por Kant cuando en uno de sus últimos trabajos afirma: “Ser real es mas bien, ser resistencia frente a la espontaneidad originaria, que es una y la misma en todas las especies del querer y del atender”. La cosa en sí no existe como tal sino que es el impulso de resistencia que el ente nos ofrece cuando actuamos sobre él.
Curiosamente en Heidegger, donde uno esperaría encontrar una crítica furibunda a la cosa en sí, no sólo no se encuentra sino que en el texto emblemático sobre el asunto, Kant y el problema de la metafísica, que para mayor curiosidad dedica a Max Scheler, aparece una aceptación explícita cuando hablando del objeto trascendental igual X afirma: “X es un “algo”, sobre el cual, en general, nada podemos saber…”ni siquiera” puede convertirse en objeto posible de un saber” [1]. ¿No se aplica acá, la objeción de Fichte a Kant?. ¿Será por esto que en las conversaciones de Davos, en torno a Kant, Ernst Cassirer afirmó: “Heidegger es un neokantiano como jamás lo hubiera imaginado de él”.
I- Schopenhauer: el primer golpe a la Ilustración
En Arturo Schopenhauer (1788-1860) toda su filosofía se apoya en Kant y forma parte del idealismo alemán pero lo novedoso es que sostiene dos rasgos existenciales antitéticos con ellos: es un pesimista y no es un profesor a sueldo del Estado. Esto último deslumbró a Nietzsche.
Hijo de un gran comerciante de Danzig, su posición acomodada lo liberó de las dos servidumbres de su época para los filósofos: la teología protestante o la docencia privada. Se educó a través de sus largas estadías en Inglaterra, Francia e Italia (Venecia). Su apetito sensual, grado sumo, luchó siempre la serena reflexión filosófica. Su soltería y misoginia nos recuerda el tango: en mi vida tuve muchas minas pero nunca una mujer. En una palabra, conoció la hembra pero no a la mujer.
Ingresa en la Universidad de Gotinga donde estudia medicina, luego frecuenta a Goethe, sigue cursos en Berlín con Fichte y se doctora en Jena con una tesis sobre La cuádruple raíz del principio de razón suficiente en 1813.
En 1819 publica su principal obra El mundo como voluntad y representación y toda su producción posterior no va a ser sino un comentario aumentado y corregido de ella. Nunca se retractó de nada ni nunca cambió. Obras como La voluntad en la naturaleza (1836), Libertad de la voluntad (1838), Los dos problemas fundamentales de la ética (1841) son simples escolios a su única obra principal.
Sobre él ha afirmado el genial Castellani: “Schopen es malo, pero simpático. No fue católico por mera casualidad. Y fue lástima porque tenía ala calderoniana y graciana, a quienes tradujo. Pero fue “antiprotestante” al máximo, como Nietzsche, lo cual en nuestra opinión no es poco…Tuvo dos fallas: fue el primer filósofo existencial sin ser teólogo y quiso reducir a la filosofía aquello que pertenece a la teología” [2]
En 1844 reedita su trabajo cumbre, aunque no se habían vendido aun los ejemplares de su primera edición, llevando los agregados al doble la edición original.
Nueve años antes de su muerte publica dos tomos pequeños Parerga y Parilepómena, ensayos de acceso popular donde trata de los más diversos temas, que tienen muy poco que ver con su obra principal, pero que le dan una cierta popularidad al ser los más leídos de sus libros. Al final de sus días Schopenhauer gozó del reconocimiento que tanto buscó y que le fue esquivo.
Schopenhauer siguió los cursos de Fichte en Berlín varios años y como “el fanfarrón”, así lo llama, parte y depende también de Kant.
Así, ambos reconocen que el mérito inmortal de la crítica kantiana de la razón es haber establecido, de una vez y para siempre, que los entes, el mundo de las cosas que percibimos por los sentidos y reproducimos en el espíritu, no es el mundo en sí sino nuestro mundo, un producto de nuestra organización psicofísica.
La clara distinción en Kant entre sensibilidad y entendimiento pero donde el entendimiento no puede separarse realmente de los sentidos y refiere a una causa exterior la sensación que aparece bajo las formas de espacio y tiempo, viene a explicar a los entes, las cosas como fenómenos pero no como “cosas en sí”.
Muy acertadamente observa Silvio Maresca que: “Ante sus ojos- los de Schopenhauer- el romanticismo filosófico y el idealismo (Fichte-Hegel) que sucedieron casi enseguida a la filosofía kantiana, constituían una tergiversación de ésta. ¿Por qué? Porque abolían lo que según él era el principio fundamental: la distinción entre los fenómenos y la cosa en sí”.[3]
Fichte a través de su Teoría de la ciencia va a sostener que el no-yo (los entes exteriores) surgen en el yo legalmente pero sin fundamento. No existe una tal cosa en sí. El mundo sensible es una realidad empírica que está de pie ahí. La ciencia de la naturaleza es necesariamente materialista. Schopenhauer es materialista, pero va a afirmar: Toda la imagen materialista del mundo, es solo representación, no “cosa en sí”. Rechaza la tesis que todo el mundo fenoménico sea calificado como un producto de la actividad inconciente del yo. ¿Que es este mundo además de mi representación?, se pregunta. Y responde que se debe partir del hombre que es lo dado y de lo más íntimo de él, y eso debe ser a su vez lo más íntimo del mundo y esto es la voluntad. Se produce así en Schopenhauer un primado de lo práctico sobre lo teórico.
La voluntad es, hablando en kantiano “la cosa en sí” ese afán infinito que nunca termina de satisfacerse, es “el vivir” que va siempre al encuentro de nuevos problemas. Es infatigable e inextinguible.
La voluntad no es para el pesimista de Danzig la facultad de decidir regida por la razón como se la entiende regularmente sino sólo el afán, el impulso irracional que comparten hombre y mundo. “Toda fuerza natural es concebida per analogiam con aquello que en nosotros mismos conocemos como voluntad”.
Esa voluntad irracional para la que el mundo y las cosas son solo un fenómeno no tiene ningún objetivo perdurable sino sólo aparente (por trabajar sobre fenómenos) y entonces todo objetivo logrado despierta nuevas necesidades (toda satisfacción tiene como presupuesto el disgusto de una insatisfacción) donde el no tener ya nada que desear preanuncia la muerte o la liberación.
Porque el más sabio es el que se percata que la existencia es una sucesión de sin sabores que no conduce a nada y se desprende del mundo. No espera la redención del progreso y solo practica la no-voluntad.
El pesimista de Danzig al identificar la voluntad irracional con la “cosa en sí” puede afirmar sin temor que “lo real es irracional y lo irracional es lo real” con lo que termina invirtiendo la máxima hegeliana “todo lo racional es real y todo lo real es racional”. Es el primero del los golpes mortales que se le aplicará al racionalismo iluminista, luego vendrá Nietzsche y más tarde Scheler y Heidegger. Pero eso ya es historia conocida. Salute.
Post Scriptum:
Schopenhauer en sus últimos años- que además de hablar correctamente en italiano, francés e inglés, hablaba, aunque con alguna dificultad, en castellano. La hispanofilia de Schopenhauer se reconoce en toda su obra pues cada vez que cita, sobre todo a Baltasar Gracián (1601-1658), lo hace en castellano. Aprendió el español para traducir el opúsculo Oráculo manual (1647). También cita a menudo El Criticón a la que considera “incomparable”. Existe actualmente en Alemania y desde hace unos quince años una revista de pensamiento no conformista denominada “Criticón”. También cita y traduce a Calderón de la Barca.
Miguel de Unamuno fue el primero que realizó algunas traducciones parciales del filósofo de Danzig, como corto pago para una deuda hispánica con él. En Argentina ejerció influencia sobre Macedonio Fernández y sobre su discípulo Jorge Luis Borges. Tengo conocimiento de dos buenos artículos sobre Schopenhauer en nuestro país: el del cura Castellani (Revista de la Universidad de Buenos Aires, cuarta época, Nº 16, 1950) y el mencionado de Maresca.
El último aporte hispano a Schopenhauer es la traducción de los Sinilia, los pensamientos de vejez (1852-1860) con introducción, traducción y notas de Juan Mateu Alonso, en Contrastes, Universidad de Málaga, enero-febrero, 2009.
II- Brentano, el eslabón perdido de la filosofía contemporánea
Su vida y sus influencias [4]
Franz Clemens Brentano (1838-1917) es el filósofo alemán de ancestros italianos de la zona de Cuomo, que introduce la noción de intencionalidad en la filosofía contemporánea. Noción que deriva del concepto escolástico de “cogitativa” trabajado tanto por Tomás de Aquino como por Duns Escoto en la baja edad media. Lectores que, junto con Aristóteles, conocía Brentano casi a la perfección y que leía fluidamente en sus lenguas originales.
Se lo considera tanto el precursor de la fenomenología (sus trabajos sobre la intencionalidad de la conciencia) como de las corrientes analíticas (sus trabajos sobre el lenguaje y los juicios), de la psicología profunda (sus trabajos sobre psicología experimental) como de la axiología (sus trabajos sobre el juicio de preferencia).
Nació y se crió en el seno de una familia ilustre marcada por el romanticismo social. Su tío el poeta Clemens Maria Brentano(1778-1842) y su tía Bettina von Arnim(1785-1859) se encontraban entre los más importantes escritores del romanticismo alemán y su hermano, Lujo Brentano, se convirtió en un experto en economía social. De su madre recibió una profunda fe y formación católicas. Estudió matemática, filosofía y teología en las universidades de Múnich, Würzburg, Berlín, y Münster. Siguió los cursos sobre Aristóteles de F. Trendelemburg Tras doctorarse con un estudio sobre Aristóteles en 1862,Sobre los múltiples sentidos del ente en Aristóteles, se ordenó sacerdote católico de la orden dominica en 1864. Dos años más tarde presentó en la Universidad de Würzburg, al norte de Baviera, su escrito de habilitación como catedrático, La psicología de Aristóteles, en especial su doctrina acerca del “nous poietikos”. En los años siguientes dedicó su atención a otras corrientes de filosofía, e iba creciendo su preocupación por la situación de la filosofía de aquella época en Alemania: un escenario en el que se contraponían el empirismo positivista y el neokantismo. En ese periodo estudió con profundidad a John Stuart Mill y publicó un libro sobre Auguste Comte y la filosofía positiva. La Universidad de Würzburg le nombró profesor extraordinario en 1872.
Sin embargo, en su interior se iban planteando problemas de otro género. Se cuestionaba algunos dogmas de la Iglesia católica, sobre todo el dogma de la Santísima Trinidad. Y después de que el Concilio Vaticano I de 1870 proclamara el dogma de la infalibilidad papal, Brentano decidió en 1873 abandonar su sacerdocio. Sin embargo, para no perjudicar más a los católicos alemanes —ya de suyo hostigados hasta llegar a huir en masa al Volga ruso por la “Kulturkampf” de Bismarck [5]— renunció voluntariamente a su puesto de Würzburg, pero al mismo tiempo, se negó a unirse a los cismáticos “viejos católicos”. Pero sin embargo este alejamiento existencial de la Iglesia no supuso un alejamiento del pensamiento profundo de la Iglesia pues en varios de sus trabajos y en forma reiterada afirmó siempre que: «Hay una ciencia que nos instruye acerca del fundamento primero y último de todas las cosas, en tanto que nos lo permite reconocer en la divinidad. De muchas maneras, el mundo entero resulta iluminado y ensanchado a la mirada por esta verdad, y recibimos a través de ella las revelaciones más esenciales sobre nuestra propia esencia y destino. Por eso, este saber es en sí mismo, sobre todos los demás, valioso. (…) Llamamos a esta ciencia Sabiduría, Filosofía primera, Teología» (Cfr.: Religion und Philosophie, pp.72-73. citado por Sánchez-Migallón).
Se desempeñó luego como profesor en Viena durante veinte años (entre 1874 y 1894), con algunas interrupciones. Franz Brentano fue amigo de los espíritus más finos de la Viena de esos años, entre ellos Theodor Meynert, Josef Breuer, Theodor Gomperz (1832-1912). En 1880 se casó con Ida von Lieben, la hermana de Anna von Lieben, la futura paciente de Sigmund Freud. Indiferente a la comida y la vestimenta, jugaba al ajedrez con una pasión devoradora, y ponía de manifiesto un talento inaudito para los juegos de palabras más refinados, En 1879, con el seudónimo de Aenigmatis, publicó una compilación de adivinanzas que suscitó entusiasmo en los salones vieneses y dio lugar a numerosas imitaciones. Esto lo cuenta Freud en un libro suyo El chiste.
En la Universidad de Viena tuvo como alumnos a Sigmund Freud, Carl Stumpf y Edmund Husserl, Christian von Ehrenfels, introductor del término Gestalt (totalidad), y, discrepa y rechaza la idea del inconsciente descrita y utilizada por Freud. Fue un profesor carismático, Brentano ejerció una fuerte influencia en la obra de Edmund Husserl, Alois Meinong (1853-1921), fundador de la teoría del objeto, Thomas Masaryk (1859-1937) KasimirTwardowski, de la escuela polaca de lógica y Marty Antón, entre otros, y por lo tanto juega un papel central en el desarrollo filosófico de la Europa central en principios del siglo XX. En 1873, el joven Sigmund Freud, estudiante en la Universidad de Viena, obtuvo su doctorado en filosofía bajo la dirección de Brentano.
El impulso de Brentano a la psicología cognitiva es consecuencia de su realismo. Su concepción de describir la conciencia en lugar de analizarla, dividiéndola en partes, como se hacía en su época, dio lugar a la fenomenología, que continuarían desarrollando Edmund Husserl (1859-1938), Max Scheler (1874-1928), Martín Heidegger (1889-1976), Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), además de influenciar sobre el existencialismo de Jean-Paul Sartre (1905-1980) con su negación del inconsciente.
En 1895, después de la muerte de su esposa, dejó Austria decepcionado, en esta ocasión, publicó una serie de tres artículos en el periódico vienés Die Neue Freie Presse : Mis últimos votos por Austria, en la que destaca su posición filosófica, así como su enfoque de la psicología, pero también criticó duramente la situación jurídica de los antiguos sacerdotes en Austria. In 1896 he settled down in Florence where he got married to Emilie Ruprecht in 1897. En 1896 se instaló en Florencia, donde se casó con Emilie Ruprecht en 1897. Vivió en Florencia casi ciego y, a causa de la primera guerra mundial, cuando Italia entra en guerra contra Alemania, se traslada a Zurich, donde muere en 1917.
Los trabajos que publicaron sus discípulos han sido los siguientes según el orden de su aparición: La doctrina de Jesús y su significación permanente; Psicología como ciencia empírica, Vol. III; Ensayos sobre el conocimiento, Sobre la existencia de Dios; Verdad y evidencia; Doctrina de las categorías, Fundamentación y construcción de la ética; Religión y filosofía, Doctrina del juicio correcto; Elementos de estética; Historia de la filosofía griega; La recusación de lo irreal; Investigaciones filosóficas acerca del espacio, del tiempo y el continuo; La doctrina de Aristóteles acerca del origen del espíritu humano; Historia de la filosofía medieval en el Occidente cristiano; Psicología descriptiva; Historia de la filosofía moderna, Sobre Aristóteles; Sobre “Conocimiento y error” de Ernst March.
Lineamientos de su pensamiento
Todo el mundo sabe, al menos el de la filosofía, que no se puede realizar tal actividad sino es en diálogo con algún clásico. Es que los clásicos son tales porque tienen respuestas para el presente. Hay que tomar un maestro y a partir de él comenzar a filosofar. Brentano lo tuvo a Aristóteles, el que le había enseñado Federico Trendelenburg (1802-1872), el gran estudioso del Estagirita en la primera mitad de siglo XIX.
En su tesis doctoral, Sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles, que tanto influenciara en Heidegger, distingue cuatro sentidos de “ente” en el Estagirita: el ente como ens per accidens o lo fortuito; el ente en el sentido de lo verdadero, con su correlato, lo no-ente en el sentido de lo falso; el ente en potencia y el ente en acto; y el ente que se distribuye según la sustancia y las figuras de las categorías. De esos cuatro significados, el veritativo abrirá en Brentano el estudio de la intencionalidad. Pero al que dedica con diferencia mayor extensión es al cuarto, el estudio de la sustancia y su modificación, esto es, a las diversas categorías. Esto se debe, en parte, a las discusiones de su tiempo en torno a la metafísica aristotélica. En ellas toma postura defendiendo principalmente dos tesis: primera, que entre los diferentes sentidos categoriales del ente se da una unidad de analogía, y que ésta significa unidad de referencia a un término común, la sustancia segunda, que precisamente esa unidad de referencia posibilita en el griego deducir las categorías según un principio.[6]
Investigó las cuestiones metafísicas mediante un análisis lógico-lingüístico, con lo que se distinguió tanto de los empiristas ingleses como del kantismo académico. Ejerciendo una gran influencia sobre algunos miembros del Círculo de Viena.
En 1874 publica su principal obra Psicología como ciencia empírica, de la que editará tres volúmenes, donde realiza su principal aporte a la historia de la filosofía, su concepto de intencionalidad de la conciencia que tendrá capital importancia para el desarrollo posterior de la fenomenología a través de Husserl y de Scheler.
Sólo lo psíquico es intencional, esto es, pone en relación la conciencia con un objeto. Esta llamada «tesis de Brentano», que hace de la intencionalidad la característica de lo psíquico, permite entender de un modo positivo, a diferencia de lo que no lograba la psicología de aquella época, los fenómenos de conciencia que Brentano distingue entre representaciones, juicios teóricos y juicios prácticos o emotivos (sentimientos y voliciones).
Todo fenómeno de conciencia es o una representación de algo, que no forzosamente ha de ser un objeto exterior, o un juicio acerca de algo. Los juicios o son teóricos, y se refieren a la verdad y falsedad de las representaciones (juicios propiamente dichos), y su criterio es la evidencia y de ellos trata la epistemología y la lógica; o son prácticos, y se refieren a la bondad o a la maldad, la corrección o incorrección, al amor y al odio (fenómenos emotivos), y su criterio es la «preferencia», la valoración, o «lo mejor», y de ellos trata la ética. Al estudio de la intencionalidad de la conciencia lo llama psicología descriptiva o fenomenología.
En 1889 dicta su conferencia en Sociedad Jurídica de Viena “De la sanción natural de lo justo y lo moral” que aparece publicada luego con notas que duplican su extensión bajo el título de: El origen del conocimiento moral”, trabajo que publicado en castellano en 1927, del que dice Ortega y Gasset, director de la revista de Occidente que lo publica, “Este tratadito, de la más auténtica filosofía, constituye una de las joyas filosóficas que, como “El discurso del método” o la “Monadología”… Puede decirse que es la base donde se asienta la ética moderna de los valores”.
Comienza preguntándose por la sanción natural de lo justo y lo moral. Y hace corresponder lo bueno con lo verdadero y a la ética con la lógica. Así, lo verdadero se admite como verdadero en un juicio, mientras que lo bueno en un acto de amor. El criterio exclusivo de la verdad del juicio es cuando, éste, se presenta como evidente. Pero, paradójicamente, lo evidente, va a sostener siguiendo a Descartes, es el conocimiento sin juicio.
Lo bueno es el objeto y mi referencia puede ser errónea, de modo que mi actitud ante las cosas recibe la sanción de las cosas y no de mí. Lo bueno es algo intrínseco a los objetos amados.
Que yo tenga amor u odio a una cosa no prueba sin más que sea buena o mala. Es necesario que ese amor u odio sean justos. El amor puede ser justo o injusto, adecuado o inadecuado. La actitud adecuada ante una cosa buena es amarla y ante una cosa mala, el odiarla. “Decimos que algo es bueno cuando el modo de referencia que consiste en amarlo es el justo. Lo que sea amable con amor justo, lo digno de ser amado, es lo bueno en el más amplio sentido de la palabra»”.
La ética encuentra su fundamento, según Brentano, en los actos fundados de amor y odio. Y actos fundados quiere decir, que el objeto de ser amado u odiado es digno de ser amado u odiado. El “ajuste” entre el acto de amor u odio al objeto mismo en ética, es análogo, según Brentano, a la “adecuación” que se da en el juicio verdadero entre predicado y objeto.
La diferencia que existe entre uno y otro juicio (el predicamental y el práctico) es que en el práctico puede darse un antítesis (amar un objeto y , pasado el tiempo, odiarlo) mientras que en el lógico o de representación, no.
Dos meses después el 27 de marzo de 1889 dicta su conferencia Sobre el concepto de verdad, ahora en la Sociedad filosófica de Viena. Esta conferencia es fundamental por varios motivos: a) muestra el carácter polémico de Brentano, tanto con el historiador de la filosofía Windelbang (1848-1915) por tergiversar a Kant, como a Kant, “cuya filosofía es un error, que ha conducido a errores mayores y, finalmente, a un caos filosófico completo” (cómo no lo van a silenciar luego, en las universidades alemanas, al viejo Francisco). b) Nos da su opinión sin tapujos sobre Aristóteles diciendo: “Es el espíritu científico más poderoso que jamás haya tenido influencia sobre los destinos de la humanidad”. c) Muestra y demuestra que el concepto de verdad en Aristóteles “adecuación del intelecto y la cosa” ha sido adoptada tanto por Descartes como por Kant hasta llegar a él mismo. Pero que dicho concepto encierra un grave error y allí él va a proponer su teoría del juicio.
Diferencia entre juicios negativos y juicios afirmativos. Así en los juicios negativos como: “no hay dragones”, no hay concordancia entre mi juicio y la cosa porque la cosa no existe. Mientras que sólo en los juicios afirmativos, cuando hay concordancia son verdaderos.
“el ámbito en que es adecuado el juicio afirmativo es el de la existencia y el del juicio negativo, el de lo no existente”. Por lo tanto “un juicio es verdadero cuando afirma de algo que es, que es; y de algo que no es, niega que sea”.
En los juicios negativos la representación no tiene contenido real, mientras que la verdad de los juicios está condicionada por el existir o ser del la cosa (Sein des Dinges). Así, el ser de la cosa, la existencia es la que funda la verdad del juicio. El “ser del árbol” es lo que hace verdadero al juicio: “el árbol es”.
Y así lo afirma una y otra vez: “un juicio es verdadero cuando juzga apropiadamente un objeto, por consiguiente, cuando si es, se dice que es; y sino es, se dice que no es”.(in fine).
Y desengañado termina afirmando que: “Han transcurrido dos mil años desde que Aristóteles investigó los múltiples sentidos del ente, y es triste, pero cierto, que la mayoría no hayan sabido extraer ningún fruto de sus investigaciones”.
Su propuesta es, entonces, discriminar claramente en el juicio “el ser de la cosa” que equivalente a ”la existencia”, de “la cosa” también denominada por Brentano ”lo real”. Existir o existencia, y ser real o realidad es la dupla de pares que expresan el “ser verdadero” y el “ser sustancial” respectivamente, que él se ocupó de estudiar en su primer trabajo sobre el ente en Aristóteles.
Conviene repetirlo, existir, existencia y ser verdadero vienen a expresar lo mismo: la mostración del ente al pensar. Y la cosa, lo real, el ser sustancial expresan lo mismo: el ente en sí mismo. Vemos como Brentano, liquida definitivamente “la cosa en sí” kantiana.
Aun cuando claramente Brentano muestra como “el objeto no tiene un existencia en la realidad independiente, o más allá del sujeto, sino que existe en tanto que hay un acto psíquico”, y este es el gran aporte a la psicología de Brentano.
Metafísicamente, todo lo que es, es. Y se nos dice también en el sentido de lo verdadero. En una palabra el ser de la cosa se convierte con la verdadero, sin buscarlo Brentano retorna al viejo ens et verum convertuntur de la teoría de los transcendentales del ente.
Y así da sus dos últimos y más profundos consejos: “Por último, no estaremos tentados nunca de confundir, como ha ocurrido cada vez más, el concepto de lo real y el de lo existente”. Y “podríamos extraer de nuestra investigación otra lección y grabarla en nuestras mentes para siempre…el medio definitivo y eficaz (para realizar un juicio verdadero) consiste siempre en una referencia a la intuición de lo individual de la que se derivan todos nuestros criterios generales”.
No podemos no recordar acá, por la coincidencia de los conceptos y consejos, aquella que nos dejara el primer metafísico argentino, Nimio de Anquín (1896-1979),: “Ir siembre a la búsqueda del ser singular en su discontinuidad fantasmagórica. Ir al encuentro con las cosas en su individuación y potencial universalidad”.[7]
Franz Brentano es el verdadero fundador de la metafísica realista contemporánea que luego continuarán, con sus respectivas variantes, Husserl, Scheler, Hartmann y Heidegger.
En el mismo siglo XIX, a propósito de la encíclica Aeterni Patris de 1879 se dará el florecimiento del tomismo, sostenedor también, pero de otro modo, de una metafísica realista.
Siempre nos ha llamado la atención que los mejores filósofos españoles del siglo XX se hayan prestado a ser traductores de los libros de Brentano: José Gáos de su Psicología, Manuel García Morente de su Origen del conocimiento moral, Xavier Zubiri de El provenir de la filosofía, Antonio Millán Puelles de Sobre la existencia de Dios. Y siempre nos ha llamado la atención que no se enseñara Brentano en la universidad.
El problema de Brentano es que ha sido “filosóficamente incorrecto”, pues realizó una crítica feroz y terminante a Kant y los kantianos y eso la universidad alemana no se lo perdonó. Realizó una crítica furibunda a la escuela escolástica católica y eso no se le perdonó. Incluso se levantaron invectivas denunciándolo, que al criticar el concepto de analogía del ser, adoptó él, el de equivocidad. Un siglo después, el erudito sobre Aristóteles, Pierre Aubenque, vino a negar en un libro memorable y reconocido universalmente, Le problème de l´être chez Aristote (1962) la presencia en los textos del Estagirita del concepto de analogía.(si detrás de esto no está la sombra del viejo Francisco, que no valga).
Polemizó con Zeller, con Dilthey, con Herbart, con Sigwart. Criticó, como ya dijimos, a Kant, Descartes, Hume, Hegel, Aristóteles, y a Überweg. No dejó títere con cabeza. Sólo le faltó pelearse con Goethe. Fue criticado por Freud, que se portó con él, como el zorro en el monte, que con la cola borra las huellas por donde anda. Husserl no solo tomó y usufructuó el concepto de intencionalidad sino también el de “retención” que es copia exacta de concepto bentaniano de “asociación original”, pero eso quedó bien silenciado.
Filosóficamente, esta oposición por igual al idealismo kantiano y a la escolástica de su tiempo le valió el silencio de los manuales y la marginalización de su obra de las universidades. Quien quiera comprender en profundidad y conocer las líneas de tensión que corren debajo de las ideas de la filosofía del siglo XX, tiene que leer, forzosamente a Brentano, sino se quedará como la mayoría de los profesores de filosofía, en Babia.
El es el testigo irrenunciable de la ligazón profunda que existe en el desarrollo de la metafísica que va desde Aristóteles, pasa por Tomás de Aquino y Duns Escoto, sigue con él y termina en Heidegger. No al ñudo, el filósofo de Friburgo, realizó su tesis doctoral sobre La doctrina de las categorías y del significado pensando que era de Duns Escoto, cuando después se comprobó que el texto de la Gramática especulativa sobre el que trabajó, pertenecía a Thomas de Erfurt (fl.1325).
La invitación está hecha, seguro que algún buen profesor o algún inquieto investigador recoge el guante.
Nota: Bibliografía de F. Brentano en castellano
Psicología (desde el punto de vista empírico), Revista de Occidente, Madrid, 1927
Sobre la existencia de Dios, Rialp, Madrid 1979.
Sobre el concepto de verdad, Ed. Complutense, Madrid, 1998
El origen del conocimiento moral, Revista de Occidente, Madrid 1927. (Tecnos, Madrid 2002).
Breve esbozo de una teoría general del conocimiento, Ed. Encuentro, Madrid 2001.
El porvenir de la filosofía, Revista de Occidente, Madrid 1936
Aristóteles y su cosmovisión, Labor, Barcelona 1951.
Sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles, Ed. Encuentro, Madrid 2007
Razones del desaliento en filosofía, Ed. Encuentro, Madrid, 2010
Existen además, en castellano, trabajos de consulta valiosos sobre su filosofía como los debidos a los profesores Mario Ariel González Porta y Sergio Sánchez-Migallón Granados.
III- Max Scheler y el sentido de la realidad
El tema de cómo saber que la realidad exterior existe no ha sido un asunto menor para la filosofía moderna. En general y desde sus primeros tiempos la filosofía ha desconfiado siempre de los sentidos externos: ya Heráclito sostenía, tirado en la playa: el sol es grande como mi pie.
En la modernidad Descartes: “he experimentado varias veces que los sentidos son engañosos, y es prudente, no fiarse nunca por completo de quienes nos han engañado una vez.” [8]
Max Scheler trata en tema, específicamente, en una meditación titulada La metafísica de la percepción y la realidad que estuvo incluida en uno de sus últimos trabajos Erkenntnis und Arbeit (Conocimiento y trabajo) de 1926.
Es sabido que el fundador de la fenomenología, Edmundo Husserl (1859-1938), maestro de Scheler, se propuso construir una filosofía como ciencia estricta y para ello sostuvo: zu den Sachen selbst (ir a las cosas mismas) que son las que aparecen a la conciencia. Esta conciencia es una trama de relaciones intencionales, pues la conciencia tiende a objetos, in-tendere. Y para ello Husserl no ha querido plantearse la existencia de objetos reales como existencias en sí y ha recurrido a la epoché, a la puesta entre paréntesis de la existencia en sí de las cosas. Limitándose a la descripción de las estructuras y de los contenidos intencionales de la conciencia. De modo tal que exista o no exista la realidad, ese no es un problema de la fenomenología de Husserl. En una palabra, Husserl postergó el tema o problema de “la cosa en sí” y no se animó a tomar partido, cosa que sí va a hacer su discípulo.
Max Scheler va a seguir con el método de fenomenológico de su maestro y su ontología como teoría general de los objetos pertenecientes a distintas esferas: reales (naturales y culturales), ideales, valores y metafísicos. Destacándose sobre todo con brillantes estudios sobre los objetos culturales y axiológicos. Pero al mismo tiempo se va a modificar o completar el mismo método.
Las categorías que son las que acompañan a cada tipo de ser, no son como en Aristóteles producto de la predicación o formas de decir el objeto y que previamente son modos de existencia. No, para la fenomenología las categorías son modos de presentación “en mi conciencia” de tales objetos y no de existencia fuera de mi.
Cuando Scheler en la plenitud de su capacidad filosófica aborda el tema concreto del trabajo, el objeto propio del mismo lo lleva a dar un paso más allá que su maestro. Mientras que para Husserl, sobre todo para el primero, el existir fuera de mi conciencia de las cosas es solo presuntiva. Presumimos que las cosas pueden tener un ser en sí mismas, pero no estamos tan seguros. En sus últimas conclusiones, niega esta existencia presunta (Cfr. Ideas), mientras que para Scheler podemos tener un saber cierto de esa realidad en sí.
Y lo afirma en forma tajante: “los centros de resistencia del mundo, tal cual han sido dados a la experiencia práctica de la voluntad de trabajo y del actuar en el mundo, han confirmado su eficacia en la relación práctica entre el hombre y el mundo”. [9]
De modo tal que solamente en el transcurso del trabajo ejercido sobre el mundo el hombre aprende a conocer el mundo objetivo y causal, aquel que se da en el espacio y en el tiempo. El trabajo y no la contemplación es “la raíz más esencial de toda ciencia positiva, de toda intuición, de todo experimento”.
El hombre posee además otra posibilidad de conocimiento a través de la percepción sensorial que se expresa en el conocimiento filosófico. Este conocimiento es de dos tipos: a) el de las esencias al que se llega a través “del asombro, la humildad y el amor espiritual hacia lo esencial” mediante la reducción fenomenológica de la existencia en sí de los objetos y b) de los instintos, impulsos y fuerzas que viene de las imágenes a la que se llega “por la entrega dionisíaca en la identificación con el impulso cuya parte es también nuestro ser impulsivo”.
Y concluye Scheler: “Pero el verdadero conocimiento filosófico sólo nace en la máxima tensión entre ambas actitudes y a través de la superación de esta tensión, en la unidad de la persona.” [10]
La existencia de un mundo real es preexistente a todo lo demás, tanto a la concepción natural del mundo cuanto cualidades de la percepción. Está ahí y preexiste a los dominios de la mundanidad interior y exterior, a la existencia de las categorías.
De este mundo sabemos por “la resistencia” que nos ofrece a la actividad sobre él. “Ser real es mas bien, ser resistencia frente a la espontaneidad originaria, que es una y la misma en todas las especies del querer y del atender.” [11]
Este ser real existe antes de todo pensar y percibir. El ser real puede preexistir también a todos los actos intelectuales, cuyo único correlato es la “consistencia” y nunca la existencia.
La existencia esta dada porque el ser real es algo preexistente al conocer y que solo sabemos de él por el impulso de resistencia que nos ofrece cuando actuamos sobre él.
En el fondo el ser real es “ser querido” y no “pensado” a través del fundamento del mundo y el principio de la experiencia de la resistencia es un acto volitivo. Scheler se da cuento y menta allí la sombra de Maine de Biran y de Schopenhauer.
Y termina enunciando las cuatro leyes que rigen la realidad y que preexisten a todo lo que aparece en las esferas de los objetos: 1) la realidad de algo “Real Absoluto”, esperado como posible. 2) la realidad del prójimo y de la comunidad, como el tú y el nosotros. 3) el mundo exterior como ser real de algo que existe y 4) la realidad del ser corporal, vivido como propio.
Estas cuatro leyes nos vienen a mostrar el principio fundamental de toda la filosofía de Scheler, aquel que aplica a todas las esferas del ser y los objetos según la cual lo real, lo resistente, lo que existe en sí, es mayor y surge allí donde nuestro dominio de las cosas es menor. Así, el domino del hombre es mínimo sobre el ser absoluto en cambio nuestro dominio es máximo sobre la máquina, que es nuestro producto. Frente a las personas nuestro dominio es muy limitado pero sobre los animales es mayor. “El dominio es infinitamente menor sobre lo viviente que sobre lo inanimado” [12]
Esto le permite establecer una jerarquía en las esferas que luego va a aplicar en su axiología y su ética. Y allí nos va a sorprender cuando enuncia que el espíritu carece de la fuerza y energía para obrar, pues toda la energía procede del impulso vital. Así, éste se espiritualiza sublimándose y el espíritu opera vivificándose. Pero solo la vida puede poner en actividad y hacer realidad en espíritu.
Breve biografía
Max Scheler (1874-1928) Hijo de un campesino bávaro luterano y madre judía, se bautiza católico en 1889. Es alumno de Simmel y Dilthey y le dirige su tesis Rudolf Eucken, quien hizo su tesis sobre el lenguaje de Aristóteles (el método de la investigación aristotélica 1872) y que había estudiado a su vez con Trendelenburg, el gran estudioso del Estagirita en el siglo XIX. En 1902 conoce a Husserl y su método fenomenológico y en 1907 al gran teólogo von Hildebrand. Por escándalos de su mujer, de la que se separa, en 1911 la universidad de Munich le retira la venia dicenti.
Prácticamente sin trabajo y viviendo de cursos privados y de la ayuda de sus amigos, Scheler produce sus mejores y más profundas obras. Este período, conocido como el del “Nietzsche católico”, dura hasta 1924, año en que se separa de su segunda mujer, se casa con una alumna y se aleja del catolicismo. Conrad Adenauer le devuelve la venia docente y se reintegra a la universidad. A partir de sus publicaciones de 1927 y 1928, año de su fallecimiento, Scheler cae en una especie panenteísmo. El puesto del hombre en el cosmos, su última obra, es ejemplo emblemático de ello.
Bibliografía en castellano
(1912) El resentimiento en la moral, de J. Gaos, Madrid, 1927; Buenos Aires, 1938; Edición de José Maria Vegas, Madrid, 1992; Caparros Editores, S. L. Madrid, 1993.
(1913) Etica, nuevo ensayo de fundamentacion de un personalismo etico. Traducción de de Hilario Rodríguez Sanz. Introducción de Juan Miguel Palacios. Tercera editción revisada. Caparrós Editores (Collección esprit, 45). Madrid, 2001, 758 págs.
(1916-23) Amor y conocimiento, di A. Klein, Buenos Aires, Sur, 1960.
De lo eterno en el hombre. La esencia y los atributos de Dios, de J. Marias, Madrid, 1940.
(1917) La esencia de la filosofía y la condición moral del conocer filosófico, de E.Tabernig de Pucciarelli e I. M. de Brugger, Buenos Aires, 1958, 1962.
(1913-22) Esencia y formas de la simpatía, de J. Gaos, Buenos Aires, 1923, 1943. Íngrid Vendrell Ferran revisó la traducción, 2005. Ediciones Sígueme Salamanca, España.
(1912) Los ídolos del autoconocimiento. Traducción e introdución de Íngrid Vendrell Ferran. Ed. Sígueme. Salamanca, 2003
(1914) Sobre el pudor y el sentimiento de vergüenza. Traducción e introducción de Íngrid Vendrell Ferran. Ed. Sígueme. Salamanca, 2004.
Sociologia del saber, de J. Gaos, Madrid, 1935.
(1928) El saber y la cultura, de J. Gomez, Madrid 1926, 1934; Buenos Aires, 1939; Santiago, 1960.
La idea del hombre y la historia, Madrid, 1926, e Buenos Aires, 1959.
(1928) El puesto del hombre en el cosmos, de V. Gaos, Madrid, 1929, 1936. Nueva traducción por V. Gómez. Introducción de W. Henckmann. Barcelona: Alba 2000.
El porvenir del hombre, Madrid 1927.
(1921) La idea de paz y el pacifismo, de Camilo. Santé, Buenos Aires, 1955.
(1911) Muerte y supervivencia. Traducción de Xavier Zubiri. Presentatión de Miguel Palacios. Ediciones Encuentro (opuscula philosophica, 3), Madrid, 2001, 93 págs.
(1914-16)Ordo Amoris, Traducción de Xavier Zubiri. Edición de Juan Miguel Palacios. Segunda edición. Caparrós Editores (Collección Esprit, 23), Madrid, 2001, 93 págs.
(1911-21) El Santo, el genio, el heroe, de E. Tabernig, Buenos Aires, 1961.
(1926) Conocimiento y trabajo, de Nelly Fortuna, Ed. Nova, Buenos Aires, 1969
(1918-1927) Metafísica de la libertad, E. Nova, Buenos Aires, 1960
arkegueta, mejor que filósofo
Universidad Tecnológica Nacional –Argentina-
[1] Heidegger, M: Kant y el problema de la metafísica, FCE, México, 1973, p.109
[2] Castellani, Leonardo: Schopenhauer, en Revista de la Universidad de Buenos Aires, cuarta época, Nº 16, 1950, pp.389-426
[3] Maresca, Silvio: En la senda de Nietzsche, Catálogos, Buenos Aires, 1991, p. 20
[4] Estos datos que pasamos nosotros y muchos más, se pueden encontrar en los buscadores de Internet, no así en los manuales al uso de la historia de la filosofía contemporánea, que, en general, escamotean la figura y los aportes de Brentano. O peor aún, lo limitan al lugar común de inventor de la intencionalidad de la conciencia.
[5] La persecución que sufrieron los católicos alemanes bajo el gobierno de Bismarck (1871-1890) ha sido terrible. Más de un millón de ellos huyeron a Rusia donde los recibió el Zar con un convenio de estadía por cien años. Pasado el siglo muchos de esos “alemanes del Volga” vinieron a radicarse en la Argentina en la zona de Coronel Suárez, al sur oeste de la provincia de Buenos Aires. Duró tanto el hostigamiento a los católicos de parte de la Kulturkampf, que cuenta Heidegger (1889-1976), que su padre era el sacristán de la iglesia de San Martín de su pueblo natal, y que los protestantes se la devolvieron, recién, un año antes de que él naciera.
[6] 80 años después, en 1942 publicó Nimio de Anquín en Argentina un trabajo definitivo sobre el tema Las dos concepciones del ente en Aristóteles, Ortodoxia Nº 1, pp.38-69, Buenos Aires, 1942, del que se han privado de leer hasta ahora los europeos. 40 años después, en 1982 con motivo de mi tesis doctoral en la Sorbona bajo la dirección de Pierre Aubenque, ví como éste gran erudito se arrastraba sobre las tintas del libro Z de la Metafísica de Aristóteles, sin poder llegar a la suela de los zapatos de de Anquín.
[7] Anquín, Nimo de: Ente y ser, Gredos, Madrid, 1962
[8] Descartes: Meditaciones metafísicas, meditación primera, ab initio.
[9] Scheler, Max: Conocimiento y trabajo, Ed. Nova, Buenos Aires, 1969, p. 274
[10] Scheler, Max: op.cit. p.279
[11] Scheler, Max: op.cit. p.280
[12] Scheler, Max: op.cit. p.301
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, allemagne, argentine, alberto buela, romantisme, max scheler, arthur schopenhauer, clemens brentano, amérique latine, amérique du sud |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 31 août 2011
Brentano, el eslabon perdido de la filosofia contemporanea
Brentano, el eslabón perdido de la filosofía contemporánea
Alberto Buela (*)
Su vida y sus influencias [1]
 Franz Clemens Brentano (1838-1917) es el filósofo alemán de ancestros italianos de la zona de Cuomo, que introduce la noción de intencionalidad en la filosofía contemporánea. Noción que deriva del concepto escolástico de “cogitativa” trabajado tanto por Tomás de Aquino como por Duns Escoto en la baja edad media. Lectores que, junto con Aristóteles, conocía Brentano casi a la perfección y que leía fluidamente en sus lenguas originales.
Franz Clemens Brentano (1838-1917) es el filósofo alemán de ancestros italianos de la zona de Cuomo, que introduce la noción de intencionalidad en la filosofía contemporánea. Noción que deriva del concepto escolástico de “cogitativa” trabajado tanto por Tomás de Aquino como por Duns Escoto en la baja edad media. Lectores que, junto con Aristóteles, conocía Brentano casi a la perfección y que leía fluidamente en sus lenguas originales.
Se lo considera tanto el precursor de la fenomenología (sus trabajos sobre la intencionalidad de la conciencia) como de las corrientes analíticas (sus trabajos sobre el lenguaje y los juicios), de la psicología profunda (sus trabajos sobre psicología experimental) como de la axiología (sus trabajos sobre el juicio de preferencia).
Nació y se crió en el seno de una familia ilustre marcada por el romanticismo social. Su tío el poeta Clemens Maria Brentano(1778-1842) y su tía Bettina von Arnim(1785-1859) se encontraban entre los más importantes escritores del romanticismo alemán y su hermano, Lujo Brentano, se convirtió en un experto en economía social. De su madre recibió una profunda fe y formación católicas. Estudió matemática, filosofía y teología en las universidades de Múnich, Würzburg, Berlín, y Münster. Siguió los cursos sobre Aristóteles de F. Trendelemburg Tras doctorarse con un estudio sobre Aristóteles en 1862,Sobre los múltiples sentidos del ente en Aristóteles, se ordenó sacerdote católico de la orden dominica en 1864. Dos años más tarde presentó en la Universidad de Würzburg, al norte de Baviera, su escrito de habilitación como catedrático, La psicología de Aristóteles, en especial su doctrina acerca del “nous poietikos”. En los años siguientes dedicó su atención a otras corrientes de filosofía, e iba creciendo su preocupación por la situación de la filosofía de aquella época en Alemania: un escenario en el que se contraponían el empirismo positivista y el neokantismo. En ese periodo estudió con profundidad a John Stuart Mill y publicó un libro sobre Auguste Comte y la filosofía positiva. La Universidad de Würzburg le nombró profesor extraordinario en 1872.
Sin embargo, en su interior se iban planteando problemas de otro género. Se cuestionaba algunos dogmas de la Iglesia católica, sobre todo el dogma de la Santísima Trinidad. Y después de que el Concilio Vaticano I de 1870 proclamara el dogma de la infalibilidad papal, Brentano decidió en 1873 abandonar su sacerdocio. Sin embargo, para no perjudicar más a los católicos alemanes —ya de suyo hostigados hasta llegar a huir en masa al Volga ruso por la “Kulturkampf” de Bismarck [2]— renunció voluntariamente a su puesto de Würzburg, pero al mismo tiempo, se negó a unirse a los cismáticos “viejos católicos”. Pero sin embargo este alejamiento existencial de la Iglesia no supuso un alejamiento del pensamiento profundo de la Iglesia pues en varios de sus trabajos y en forma reiterada afirmó siempre que: «Hay una ciencia que nos instruye acerca del fundamento primero y último de todas las cosas, en tanto que nos lo permite reconocer en la divinidad. De muchas maneras, el mundo entero resulta iluminado y ensanchado a la mirada por esta verdad, y recibimos a través de ella las revelaciones más esenciales sobre nuestra propia esencia y destino. Por eso, este saber es en sí mismo, sobre todos los demás, valioso. (…) Llamamos a esta ciencia Sabiduría, Filosofía primera, Teología» (Cfr.: Religion und Philosophie, pp.72-73. citado por Sánchez-Migallón).
Se desempeñó luego como profesor en Viena durante veinte años (entre 1874 y 1894), con algunas interrupciones. Franz Brentano fue amigo de los espíritus más finos de la Viena de esos años, entre ellos Theodor Meynert, Josef Breuer, Theodor Gomperz (1832-1912). En 1880 se casó con Ida von Lieben, la hermana de Anna von Lieben, la futura paciente de Sigmund Freud. Indiferente a la comida y la vestimenta, jugaba al ajedrez con una pasión devoradora, y ponía de manifiesto un talento inaudito para los juegos de palabras más refinados, En 1879, con el seudónimo de Aenigmatis, publicó una compilación de adivinanzas que suscitó entusiasmo en los salones vieneses y dio lugar a numerosas imitaciones. Esto lo cuenta Freud en un libro suyo El chiste.
En la Universidad de Viena tuvo como alumnos a Sigmund Freud, Carl Stumpf y Edmund Husserl, Christian von Ehrenfels, introductor del término Gestalt (totalidad), y, discrepa y rechaza la idea del inconsciente descrita y utilizada por Freud. Fue un profesor carismático, Brentano ejerció una fuerte influencia en la obra de Edmund Husserl, Alois Meinong (1853-1921), fundador de la teoría del objeto, Thomas Masaryk (1859-1937) KasimirTwardowski, de la escuela polaca de lógica y Marty Antón, entre otros, y por lo tanto juega un papel central en el desarrollo filosófico de la Europa central en principios del siglo XX. En 1873, el joven Sigmund Freud, estudiante en la Universidad de Viena, obtuvo su doctorado en filosofía bajo la dirección de Brentano.
El impulso de Brentano a la psicología cognitiva es consecuencia de su realismo. Su concepción de describir la conciencia en lugar de analizarla, dividiéndola en partes, como se hacía en su época, dio lugar a la fenomenología, que continuarían desarrollando Edmund Husserl (1859-1938), Max Scheler (1874-1928), Martín Heidegger (1889-1976), Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), además de influenciar sobre el existencialismo de Jean-Paul Sartre (1905-1980) con su negación del inconsciente.
En 1895, después de la muerte de su esposa, dejó Austria decepcionado, en esta ocasión, publicó una serie de tres artículos en el periódico vienés Die Neue Freie Presse : Mis últimos votos por Austria, en la que destaca su posición filosófica, así como su enfoque de la psicología, pero también criticó duramente la situación jurídica de los antiguos sacerdotes en Austria. In 1896 he settled down in Florence where he got married to Emilie Ruprecht in 1897. En 1896 se instaló en Florencia, donde se casó con Emilie Ruprecht en 1897. Vivió en Florencia casi ciego y, a causa de la primera guerra mundial, cuando Italia entra en guerra contra Alemania, se traslada a Zurich, donde muere en 1917.
Los trabajos que publicaron sus discípulos han sido los siguientes según el orden de su aparición: La doctrina de Jesús y su significación permanente; Psicología como ciencia empírica, Vol. III; Ensayos sobre el conocimiento, Sobre la existencia de Dios; Verdad y evidencia; Doctrina de las categorías, Fundamentación y construcción de la ética; Religión y filosofía, Doctrina del juicio correcto; Elementos de estética; Historia de la filosofía griega; La recusación de lo irreal; Investigaciones filosóficas acerca del espacio, del tiempo y el continuo; La doctrina de Aristóteles acerca del origen del espíritu humano; Historia de la filosofía medieval en el Occidente cristiano; Psicología descriptiva; Historia de la filosofía moderna, Sobre Aristóteles; Sobre “Conocimiento y error” de Ernst March.
Lineamientos de su pensamiento
Todo el mundo sabe, al menos el de la filosofía, que no se puede realizar tal actividad sino es en diálogo con algún clásico. Es que los clásicos son tales porque tienen respuestas para el presente. Hay que tomar un maestro y a partir de él comenzar a filosofar. Brentano lo tuvo a Aristóteles, el que le había enseñado Federico Trendelenburg (1802-1872), el gran estudioso del Estagirita en la primera mitad de siglo XIX.
En su tesis doctoral, Sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles, que tanto influenciara en Heidegger, distingue cuatro sentidos de “ente” en el Estagirita: el ente como ens per accidens o lo fortuito; el ente en el sentido de lo verdadero, con su correlato, lo no-ente en el sentido de lo falso; el ente en potencia y el ente en acto; y el ente que se distribuye según la sustancia y las figuras de las categorías. De esos cuatro significados, el veritativo abrirá en Brentano el estudio de la intencionalidad. Pero al que dedica con diferencia mayor extensión es al cuarto, el estudio de la sustancia y su modificación, esto es, a las diversas categorías. Esto se debe, en parte, a las discusiones de su tiempo en torno a la metafísica aristotélica. En ellas toma postura defendiendo principalmente dos tesis: primera, que entre los diferentes sentidos categoriales del ente se da una unidad de analogía, y que ésta significa unidad de referencia a un término común, la sustancia segunda, que precisamente esa unidad de referencia posibilita en el griego deducir las categorías según un principio.[3]
Investigó las cuestiones metafísicas mediante un análisis lógico-lingüístico, con lo que se distinguió tanto de los empiristas ingleses como del kantismo académico. Ejerciendo una gran influencia el algunos miembros del Círculo de Viena.
En 1874 publica su principal obra Psicología como ciencia empírica, de la que editará tres volúmenes, donde realiza su principal aporte a la historia de la filosofía, su concepto de intencionalidad de la conciencia que tendrá capital importancia para el desarrollo posterior de la fenomenología a través de Husserl y de Scheler.
Sólo lo psíquico es intencional, esto es, pone en relación la conciencia con un objeto. Esta llamada «tesis de Brentano», que hace de la intencionalidad la característica de lo psíquico, permite entender de un modo positivo, a diferencia de lo que no lograba la psicología de aquella época, los fenómenos de conciencia que Brentano distingue entre representaciones, juicios teóricos y juicios prácticos o emotivos (sentimientos y voliciones).
Todo fenómeno de conciencia es o una representación de algo, que no forzosamente ha de ser un objeto exterior, o un juicio acerca de algo. Los juicios o son teóricos, y se refieren a la verdad y falsedad de las representaciones (juicios propiamente dichos), y su criterio es la evidencia y de ellos trata la epistemología y la lógica; o son prácticos, y se refieren a la bondad o a la maldad, la corrección o incorrección, al amor y al odio (fenómenos emotivos), y su criterio es la «preferencia», la valoración, o «lo mejor», y de ellos trata la ética. Al estudio de la intencionalidad de la conciencia lo llama psicología descriptiva o fenomenología.
En 1889 dicta su conferencia en Sociedad Jurídica de Viena “De la sanción natural de lo justo y lo moral” que aparece publicada luego con notas que duplican su extensión bajo el título de: El origen del conocimiento moral”, trabajo que publicado en castellano en 1927, del que dice Ortega y Gasset, director de la revista de Occidente que lo publica, “Este tratadito, de la más auténtica filosofía, constituye una de las joyas filosóficas que, como “El discurso del método” o la “Monadología”… Puede decirse que es la base donde se asienta la ética moderna de los valores”.
Comienza preguntándose por la sanción natural de lo justo y lo moral. Y hace corresponder lo bueno con lo verdadero y a la ética con la lógica. Así, lo verdadero se admite como verdadero en un juicio, mientras que lo bueno en un acto de amor. El criterio exclusivo de la verdad del juicio es cuando, éste, se presenta como evidente. Pero, paradójicamente, lo evidente, va a sostener siguiendo a Descartes, es el conocimiento sin juicio.
Lo bueno es el objeto y mi referencia puede ser errónea, de modo que mi actitud ante las cosas recibe la sanción de las cosas y no de mí. Lo bueno es algo intrínseco a los objetos amados.
Que yo tenga amor u odio a una cosa no prueba sin más que sea buena o mala. Es necesario que ese amor u odio sean justos. El amor puede ser justo o injusto, adecuado o inadecuado. La actitud adecuada ante una cosa buena es amarla y ante una cosa mala, el odiarla. “Decimos que algo es bueno cuando el modo de referencia que consiste en amarlo es el justo. Lo que sea amable con amor justo, lo digno de ser amado, es lo bueno en el más amplio sentido de la palabra»”.
Dos meses después el 27 de marzo de 1889 dicta su conferencia Sobre el concepto de verdad, ahora en la Sociedad filosófica de Viena. Esta conferencia es fundamental por varios motivos: a) muestra el carácter polémico de Brentano, tanto con el historiador de la filosofía Windelbang (1848-1915) por tergiversar a Kant, como a Kant, “cuya filosofía es un error, que ha conducido a errores mayores y, finalmente, a un caos filosófico completo” (cómo no lo van a silenciar luego, en las universidades alemanas, al viejo Francisco). b) Nos da su opinión sin tapujos sobre Aristóteles diciendo: “Es el espíritu científico más poderoso que jamás haya tenido influencia sobre los destinos de la humanidad”. c) Muestra y demuestra que el concepto de verdad en Aristóteles “adecuación del intelecto y la cosa” ha sido adoptada tanto por Descartes como por Kant hasta llegar a él mismo. Pero que dicho concepto encierra un grave error y allí él va a proponer su teoría del juicio.
Diferencia entre juicios negativos y juicios afirmativos. Así en los juicios negativos “no hay dragones” no hay concordancia entre mi juicio y la cosa porque la cosa no existe. Mientras que en los juicios afirmativos cuando hay concordancia son verdaderos.
“el ámbito en que es adecuado el juicio afirmativo es el de la existencia y el del juicio negativo, el de lo no existente”. Por lo tanto “un juicio es verdadero cuando afirma de algo que es, que es; y de algo que no es, niega que sea”.
En los juicios negativos la representación no tiene contenido real, mientras que la verdad de los juicios está condicionada por el existir o ser del la cosa (Sein des Dinges). Así, el ser de la cosa, la existencia es la que funda la verdad del juicio. El “ser del árbol” es lo que hace verdadero al juicio: “el árbol es”.
Y así lo afirma una y otra vez: “un juicio es verdadero cuando juzga apropiadamente un objeto, por consiguiente, cuando si es, se dice que es; y sino es, se dice que no es”.(in fine).
Y desengañado termina afirmando que: “Han transcurrido dos mil años desde que Aristóteles investigó los múltiples sentidos del ente, y es triste, pero cierto, que la mayoría no hayan sabido extraer ningún fruto de sus investigaciones”.
Su propuesta es, entonces, discriminar claramente en el juicio “el ser de la cosa” que es equivalente a ”la existencia”, de “la cosa” también denominada por Brentano ”lo real”. Existir o existencia, y ser real o realidad es la dupla de pares que expresan el “ser verdadero” y el “ser sustancial” respectivamente, que él se ocupó de estudiar en su primer trabajo sobre el ente en Aristóteles.
De modo tal que todo lo que es, es. Y se nos dice también en el sentido de lo verdadero. En una palabra el ser de la cosa se convierte con la verdadero, sin buscarlo Brentano retorna al viejo ens et verum convertuntur de la teoría de los transcendentales del ente.
Y así da sus dos últimos y más profundos consejos: “Por último, no estaremos tentados nunca de confundir, como ha ocurrido cada vez más, el concepto de lo real y el de lo existente”. Y “podríamos extraer de nuestra investigación otra lección y grabarla en nuestras mentes para siempre…el medio definitivo y eficaz (para realizar un juicio verdadero) consiste siempre en una referencia a la intuición de lo individual de la que se derivan todos nuestros criterios generales”.
No podemos no recordar acá, por la coincidencia de los conceptos y consejos, aquella que nos dejara el primer metafísico argentino, Nimio de Anquín (1896-1979),: “Ir siembre a la búsqueda del ser singular en su discontinuidad fantasmagórica. Ir al encuentro con las cosas en su individuación y potencial universalidad”.[4]
Franz Brentano es el verdadero fundador de la metafísica realista contemporánea que luego continuarán, con sus respectivas variantes, Husserl, Scheler, Hartmann y Heidegger.
En el mismo siglo XIX, a propósito de la encíclica Aeterni Patris de 1879 se dará el florecimiento del tomismo, sostenedor también, pero de otro modo, de una metafísica realista.
Siempre nos ha llamado la atención que los mejores filósofos españoles del siglo XX se hayan prestado a ser traductores de los libros de Brentano: José Gáos de su Psicología, Manuel García Morente de su Origen del conocimiento moral, Xavier Zubiri de El provenir de la filosofía, Antonio Millán Puelles de Sobre la existencia de Dios. Y siempre nos ha llamado la atención que no se enseñara Brentano en la universidad.
El problema de Brentano es que ha sido “filosóficamente incorrecto”, pues realizó una crítica feroz y terminante a Kant y los kantianos y eso la universidad alemana no se lo perdonó. Realizó una crítica furibunda a la escuela escolástica católica y eso no se le perdonó. Incluso se levantaron invectivas denunciándolo, que al criticar el concepto de analogía del ser, adoptó él, el de equivocidad. Un siglo después, el erudito sobre Aristóteles, Pierre Aubenque, vino a negar en un libro memorable y reconocido universalmente, Le probleme de l´etre chez Aristote (1962) la presencia en los textos del Estagirita del concepto de analogía.(si detrás de esto no está la sombra de Brentano, que no valga).
Polemizó con Zeller, con Dilthey, con Herbart, con Sigwart. Criticó, como ya dijimos, a Kant, Descartes, Hume, Hegel, Aristóteles, y a Überweg. No dejó títere con cabeza. Sólo le faltó pelearse con Goethe. Fue criticado por Freud, que se portó con él como el zorro en el monte que con la cola borra las huellas por donde anda. Husserl no solo tomó y usufructuó el concepto de intencionalidad sino también el de “retención” que es copia exacta de concepto bentaniano de “asociación original”, pero eso quedó bien silenciado.
Filosóficamente, esta oposición por igual al idealismo kantiano y a la escolástica de su tiempo le valió el silencio de los manuales y la marginalización de su obra de las universidades. Quien quiera comprender en profundidad y conocer las líneas de tensión que corren debajo de las ideas de la filosofía del siglo XX, tiene que leer, forzosamente a Brentano, sino se quedará como la mayoría de los profesores de filosofía, en Babia.
El es el testigo irrenunciable de la ligazón profunda que existe en el desarrollo de la metafísica que va desde Aristóteles, pasa por Tomás de Aquino y Duns Escoto , sigue con él y termina en Heidegger. No al ñudo, el filósofo de Friburgo, realizó su tesis doctoral sobre La doctrina de las categorías y del significado pensando que era de Duns Escoto, cuando después se comprobó que el texto de la Gramática especulativa sobre el que trabajó, pertenecía a Thomas de Erfurt (fl.1325).
La invitación está hecha, seguro que algún buen profesor o algún inquieto investigador recoge el guante.
Nota: Bibliografía de F. Brentano en castellano
Psicología (desde el punto de vista empírico), Revista de Occidente, Madrid, 1927
Sobre la existencia de Dios, Rialp, Madrid 1979.
Sobre el concepto de verdad, Ed. Complutense, Madrid, 1998
El origen del conocimiento moral, Revista de Occidente, Madrid 1927. (Tecnos, Madrid 2002).
Breve esbozo de una teoría general del conocimiento, Ed. Encuentro, Madrid 2001.
El porvenir de la filosofía, Revista de Occidente, Madrid 1936
Aristóteles y su cosmovisión, Labor, Barcelona 1951.
Sobre los múltiples significados del ente según Aristóteles, Ed. Encuentro, Madrid 2007
Razones del desaliento en filosofía, Ed. Encuentro, Madrid, 2010
Existen además, en castellano, trabajos de consulta valiosos sobre su filosofía como los debidos a los profesores Mario Ariel González Porta y Sergio Sánchez-Migallón Granados.
arkegueta, aprendiz constante, mejor que filósofo
[1] Estos datos que pasamos nosotros y muchos más, se pueden encontrar en los buscadores de Internet, no así en los manuales al uso de la historia de la filosofía contemporánea, que, en general, escamotean la figura y los aportes de Brentano. O peor aún, lo limitan al lugar común de inventor de la intencionalidad de la conciencia.
[2] La persecución que sufrieron los católicos alemanes bajo el gobierno de Bismarck (1871-1890) ha sido terrible. Más de un millón de ellos huyeron a Rusia donde los recibió el Zar con un convenio de estadía por cien años. Pasado el siglo muchos de esos “alemanes del Volga” vinieron a radicarse en la Argentina en la zona de Coronel Suárez, al sur oeste de la provincia de Buenos Aires. Duró tanto el hostigamiento a los católicos de parte de la Kulturkampf, que cuenta Heidegger (1889-1976), que su padre era el sacristán de la iglesia de San Martín de su pueblo natal, y que los protestantes se la devolvieron, recién, un año antes de que él naciera.
[3] 80 años después, en 1942 publicó Nimio de Anquín en Argentina un trabajo definitivo sobre el tema Las dos concepciones del ente en Aristóteles, Ortodoxia Nº 1, pp.38-69, Buenos Aires, 1942, del que se han privado de leer hasta ahora los europeos. 40 años después, en 1982 con motivo de mi tesis doctoral en la Sorbona bajo la dirección de Pierre Aubenque, vi como éste gran erudito se arrastraba sobre las tintas del libro Z de la Metafísica de Aristóteles, sin poder llegar a la suela de los zapatos de de Anquín.
[4] Anquín, Nimo de: Ente y ser, Gredos, Madrid, 1962
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, allemagne, romantisme, argentine, alberto buela, amrique latine, amérique du sud |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 mai 2011
Ernst Moritz Arndt, jacobin romantique
Ernest Moritz Arndt, jacobin romantique
par Guy CLAES
 Ernst Moritz Arndt est la figure essentielle du nationalisme romantique allemand. « Je suis né dans le petit peuple proche de la glèbe », écrivait-il en 1819. À son propos, l'éminent historien Diwald (Cf. Vouloir n°8) disait : « Au contraire de presque tous les autres romantiques, le romantique Arndt est issu de ce terreau populaire, de cette glèbe que les ruraux travaillent ; il s'est hissé à l'esprit du romantisme et n'a pas suivi la voie inverse comme les Schlegel, Tieck, Novalis qui sont, eux, partis de l'intellect et de l'esprit pour découvrir les merveilles de la forêt et la joie des fêtes de la moisson ». Arndt est effectivement né d'une famille de paysans poméraniens de l'Ile de Rügen, en 1769, la même année que Napoléon.
Ernst Moritz Arndt est la figure essentielle du nationalisme romantique allemand. « Je suis né dans le petit peuple proche de la glèbe », écrivait-il en 1819. À son propos, l'éminent historien Diwald (Cf. Vouloir n°8) disait : « Au contraire de presque tous les autres romantiques, le romantique Arndt est issu de ce terreau populaire, de cette glèbe que les ruraux travaillent ; il s'est hissé à l'esprit du romantisme et n'a pas suivi la voie inverse comme les Schlegel, Tieck, Novalis qui sont, eux, partis de l'intellect et de l'esprit pour découvrir les merveilles de la forêt et la joie des fêtes de la moisson ». Arndt est effectivement né d'une famille de paysans poméraniens de l'Ile de Rügen, en 1769, la même année que Napoléon.
Aucun de ses ancêtres n'était libre. Son père fut affranchi par son seigneur puis devint inspecteur de ses terres et, enfin, métayer. Son père acquiert suffisamment de moyens pour lui payer un précepteur et l'envoyer au gymnasium de Stralsund. Après avoir quitté cet établissement sur un coup de tête et par dégoût pour l'étroitesse d'esprit petite-bourgeoise rencontrée chez ses condisciples, il étudie la théologie aux universités de Greifswald et d'Iéna. Après cette pose studieuse, il reprend sa vie errante, traverse et visite toute l'Europe, poussé par une soif de connaître la diversité des peuples et des mœurs. Cette vie vagabonde lui donne conscience de son identité d'Allemand et le récit de ses expériences vécues sera codifié dans son Geist der Zeit (= L'esprit du temps) dont l'impact, dans la société, fut finalement plus important que le Discours à la Nation Allemande du philosophe Fichte. Dans cet ouvrage fait de plusieurs volumes, sans prétention philosophique, il y a "flammes et enthousiasme".
Sa prise de conscience identitaire l'oblige à choisir son camp : il sera pour la Prusse de Gneisenau et de Clausewitz et Napoléon sera l'ennemi, le "Satan à la tête de ses troupes de bandits". Il sera l'ennemi mais aussi le modèle à suivre : il faudra faire de l'Allemagne une nation aussi solide que la France, et lui donner une constitution moderne calquée sur les acquis positifs de la Révolution française, acquis revus et corrigés par le Baron von Stein. Arndt sera un "jacobin allemand", un "jacobin romantique", les deux termes n'étant pas antinomiques dans le contexte de son époque et de sa patrie.
En 1818, Arndt, le paysan voyageur, devient professeur d'histoire à Bonn. Son esprit farouchement contestataire lui cause ennui sur ennui. Accusé de "démagogie", il est emprisonné, chassé de sa chaire, relâché sans explications, jamais jugé. À partir de 1822, il ne cessera d'écrire, notamment sur le problème de l'indépendance belge (nous y reviendrons). En 1848, il siège à l'Assemblée Nationale de Francfort pour en être chassé en mai 1849. En 1860, il meurt âgé de 90 ans et un mois.
Ces 90 années d'une vie dûment remplie et mise entièrement au service de la cause de son peuple, ont permis à Arndt d'élaborer, avec un vocabulaire clair et limpide que les Français croient rare en Allemagne, la théorie du "jacobinisme romantique". L'anthologie que nous offre la Faksimile-Verlag nous permet de saisir les piliers de cette vision (c'est à coup sûr davantage une vision qu'une théorie sèche et ardue) et de comprendre les racines du nationalisme populaire, non seulement allemand mais propre à tous les pays continentaux de langue germanique. Le Mouvement Flamand en a été fortement influencé et, dans l'élaboration de son corpus culturel, a tenu compte des écrits enthousiastes d'Arndt à propos de nos provinces, écrits qui ont précédé ceux de Hoffmann von Fallersleben (ajoutons ici qu'Arndt distinguait Wallons, Flamands et Luxembourgeois par la langue mais englobait les trois ethnies dans la sphère des mœurs sociales germaniques).
Né sujet du roi de Suède, Arndt a voulu favoriser l'union des Allemands au sein d'un même État. Son modèle initial fut le modèle suédois. Les Suédois constituaient, disait-il, un vrai peuple ("ein echtes Volk"), conscient, depuis Gustav Adolf, de la valeur des vertus politiques et de la nécessité de protéger le peuple par une structure étatique solide. L'anthologie de la Faksimile-Verlag nous dévoile le système d’Arndt : les rouages de sa conception du "Volk", les lois vitales du peuple, le peuple et l'État dans la perspective d'un double combat contre la réaction féodale et le révolutionnarisme de 1789 et les projets pour la constitution d'un État "völkisch".
L'idée de "Volk" repose sur trois batteries de définitions : empiriques, métaphysiques et politiques. Sur le plan empirique, tout observateur décèlera l'existence tangible et concrète de spécificités ethno-culturelles, de folklores immémoriaux, de réseaux de liens communautaires, d'us et de coutumes ancestrales. Sur le plan métaphysique, le "Volk" est le réceptacle d'une unicité idéelle, d'une religiosité particulière que rien ni personne ne saurait rendre interchangeable. Sur le plan politique, le "Volk" est une volonté. La volonté de demeurer dans l'histoire est une force redoutable : les Anglais et les Suédois ont tenu tête ou se sont imposés à des voisins plus puissants quantitativement parce qu'ils avaient une conscience très nette de leur identité et refusaient de se laisser guider par l'arbitraire de leurs gouvernants. Les peuples libres (et Arndt regrette ici que le peuple allemand n'en fasse pas partie) ont une claire conscience de leur honneur (Ehre) et de leur honte (Schande).
Arndt distingue la notion de "Volk" de celles de "Menge" (= masse, foule) et "Pöbel" (= populace). "Menge" est la masse "neutre", sans opinions clairement définies ; elle est cette "majorité silencieuse" que tous réclament comme clientèle. Le "Pöbel" est l'ensemble des éléments déracinés, incapables de discipliner leurs comportements parce que dépouillés de toute norme ancestrale, de toute pesanteur stabilisatrice. La Révolution française, par son individualisme (manifeste notamment dans les lois qu'elle édicte contre les corporations et contre le droit de coalition), a hissé au pouvoir le "Pöbel" qui a mené la "Menge" dans l'aventure révolutionnaire et napoléonienne. Le "Pöbel" s'est imposé en "maître", en despote sur une "Menge" d'esclaves. La collusion des "despotes" et des "esclaves" ne donne pas un "Volk". Pour que "Volk" il y ait, il faut une circulation des élites, une égalité des chances et une adhésion spontanée et non contrainte à un même ensemble de valeurs et à une même vision de l'histoire.
Pour Arndt, le peuple est un tout organique d'où jaillit une Urkraft (force originelle) qu'il convient de reconnaître, de canaliser et de faire fructifier. Sans ce travail d'attention constant, le "Volk" dégénère, subit l'aliénation (qui deviendra concept-clef du socialisme), sort de l'histoire. Arndt, poète, compare le "Volk" à un volcan, à un Vésuve que les despotes veulent maintenir éteint. Les éruptions sont pourtant inévitables.
Pour accéder à l'idée d'État, le peuple doit mener une double lutte contre la "réaction" et la "révolution". Cette lutte doit d'abord se concentrer contre la conception mécaniste de l'État, issue à la fois de l'absolutisme et de la Révolution française. L'enthousiasme créatif part d'un enracinement, d'une terre (Heidegger nous systématisera cette vision) où vit encore une dimension historique et non des belles et vibrantes rhétoriques abstraites que les premières heures de la Révolution française avaient connues et diffusées par la presse à travers l'Europe. Arndt, dès les séminaires de Stralsund, ressent un malaise inexplicable à l'écoute des discours parisiens contre l'absolutisme et la monarchie. Son "bon sens" paysan perçoit et dénonce la mascarade lexicale des clubs jacobins. Ce sentiment confus d'antipathie, Arndt le retrouvera lors d'une conversation en Haute-Italie en 1799 avec un officier républicain français qui s'enivrait de trop belles paroles à propos de la liberté (au nom de laquelle, expliquait-il, on venait de fusiller deux députés plus ou moins responsables de l'assassinat d'un tribun). Ces paroles sonnaient faux dans l'oreille d'Arndt et la légèreté avec laquelle beaucoup d'adeptes de la terreur envisageaient fusillades et "guillotinades" l'effrayait. La "force tranquille" de l'organicité se passait de tels débordements.
L'idée d'État née lors de la Révolution de 1789 est inorganique. Elle est "constructiviste" et néglige l'évolution lente qui a germé dans les inconscients collectifs. Malgré ce jugement sévère, partagé par Burke, par certains contre-révolutionnaires français ou par les romantiques traditionalistes (dits parfois réactionnaires) allemands, Arndt reconnaît les aspects, les éléments positifs de la Révolution. Les Allemands doivent beaucoup à cette Révolution : elle a permis leur prise de conscience nationale. Elle a accéléré le processus de décomposition amorcé déjà sous l'Ancien Régime. Elle nous a appris que les peuples ne commettaient, ni en intention ni en pratique, de crime contre les rois en voulant être gouvernés par des lois qu'ils connaissent et reconnaissent, qui sont le fruit d'une sagesse trempée dans l'expérience des générations antérieures. Il a manqué à la France révolutionnaire cette sagesse organique et le torrent révolutionnaire a débouché sur la Terreur puis sur un nouvel absolutisme ; ce qui fermait la boucle et ne résolvait rien. Les Princes allemands ont trahi leur peuple en se comportant comme des "grands mogols" ou des "khans tatars". C'est à cela que mène l'irrespect des liens organiques et de la faculté d'écouter qu'ils impliquent.
Arndt critique le droit romain, destructeur du droit coutumier (il préfigure ici von Savigny) et voit dans une paysannerie sainement politisée, le fondement de l'État völkisch (cette idée, Spengler, Spann et bien d'autres la reprendront à leur compte). Enfin, il nous expose les raisons pour lesquelles il ne croit pas en une Pan-Europe qui se ferait au-delà, par-delà les peuples. Cette Europe ne serait qu'une panacée insipide dépourvue de cette organicité stabilisante que cherchent, au fond, tous les peuples depuis l'effondrement de l'Ancien Régime. Cette anthologie est une lecture impérative pour tous ceux qui veulent comprendre l'Allemagne du XIXème siècle, la genèse des socialismes et les idéaux des acteurs du 1848 allemand.
G.C.
Ernst Moritz ARNDT, Deutsche Volkswerdung : Arndts politisches Vermächtnis an die Gegenwart, Bremen, Faksimile Verlag (Adresse : Postfach 10 14 20, D2800 Bremen 1, RFA), 160 pages avec un portrait d'Arndt et une courte biographie, DM 15.
00:05 Publié dans Histoire, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, allemagne, sciences politiques, politologie, 19ème siècle, romantisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 avril 2011
El romanticismo ruso
El romanticismo ruso
Adrià Solsona
Ex: http://idendidadytradicion.blogia.com/
El movimiento romántico ruso tendrá una espectacular repercusión en la literatura, en la formación de unas nuevas corrientes de pensamiento, en la estética, en la música y en la pintura de su país. La poesía será el gran galvanizador y aglutinador de todos los criterios románticos.
El siglo XIX puede considerarse la edad de oro de las letras rusas. Son cien años intensos y que técnicamente podemos dividir en cinco etapas:
1ª) 1790-1820: corriente prerromántica.
2ª) 1820-1840: Romanticismo.
3ª) 1840-1855: aparición de la escuela natural.
4ª) 1855-1880: Realismo.
5ª) 1880-1895: etapa de transición entre el Realismo y el Modernismo.
Esta fase dorada la podemos considerar iniciada con la época romántica. Los siguientes factores darán a las letras rusas una impronta superior, única y diferencial: la calidad técnica, la brillantez argumental, la capacidad de exprimir todas las potencialidades de una lengua, la forja de una literatura transmisora de una conciencia nacional, la recuperación del pasado, la elevación de la poesía a espejo del alma rusa y la presencia de un sentido de peculiaridad y de orgullo identitario.
Las primeras tendencias románticas llegarán de la mano de autores como M. N. Muraviov, N. M. Karamzín y I. I. Dmítriev. A ello le deberemos sumar la fuerte influencia alemana del movimiento Sturm und Drang.
El romanticismo ruso (del periodo 1800-1825), asoció lo propio y peculiar a la recuperación del antiguo espíritu de comunidad popular y esto se llevó a cabo a través de recuperar el mundo de las viejas mitologías eslavas y de todo aquel folklore que era portador de una substancial herencia histórica que, poco a poco, pasó a ser valorada como irrenunciable. La recuperación de cuentos y leyendas, pasaron a ser una bombona de oxígeno para la reactivación de ciertos valores que habían entrado en crisis. Todo ello se conjugó con una búsqueda intensa para intentar hallar cuáles eran las verdaderas esencias de su arte y su cultura. Este clima permitirá generar un elemento diferencial a todo el romanticismo europeo; el carácter optimista y, con él, la superación de la desesperación dramática y del sufrimiento universal. Tal vez, sin pretenderlo, los escritores rusos habían superado al cristianismo doliente y lastimero del que eran hijos. A partir de 1825-1830, se incorpora el elemento social que cobrará un protagonismo notable.

La poesía romántica rusa nace con El cementerio de la aldea, de V. A. Zhukovski. Pero este movimiento poético se especializará en la poesía épica, que será su verdadero estandarte y la prueba de madurez de las letras rusas. Esta épica es muy importante porque nace de la búsqueda del propio centro espiritual del ser ruso. Esta vía espiritual, lógicamente, fue trasladada al hombre, que tuvo que empezar a mirar en su interior para intentar hallar las respuestas personales al desafío del universo. En este sentido, tenemos que reconocer que no todos los autores lograron su objetivo. Igual que pasó en el resto de Europa, muchos se perdieron en el campo de lo sentimentaloide. Este inconveniente puede quedar, parcialmente, compensado con el hecho de que el orgullo y la dignidad, siempre acompañan a los grandes personajes que se crean por las plumas de estos inspirados románticos rusos. De este género épico, vale la pena citar El prisionero del Cáucaso, de Pushkin; El monje, de I. I. Kozlov; Voinarovski, de K. F. Ryléiev; Vladímir, de V. A. Zhukovski y La sirena y Riúrik, de K. N. Bátiushkov.
También el héroe romántico ruso tendrá algo de especial y diferente. Es un héroe que a diferencia de los héroes mitológicos y de muchos de los románticos, será un héroe próximo a las gentes, capaz de cosas y hechos asumibles por todos los lectores pero al mismo tiempo, siempre será un portador de valores eternos e indestructibles. Es el ejemplo a través del cual se intentaba reconquistar la dignidad colectiva y demostrar que todo héroe es, en sí mismo, un portador de valores espirituales.
El poeta V. A. Zhukovski (1783-1852), intuyó que el mundo se rige por una energía sutil, indefinible e inmaterializable[1] y que el hombre, por extensión, tiene un mundo interior que es muy superior a cuanto pueda acontecer en su exterior.
Discípulo del anterior fue K. N. Bátiushkov (1787-1855), el gran perfeccionista de la lengua rusa y que consideró que el hombre era prisionero de una fuerza misteriosa que gobernaba la humanidad en todas las épocas. Esta fuerza conducía a una realidad cruel que no podía ser cambiada por ningún esfuerzo mental ni político. Sólo la vía espiritual podía dar respuestas «porque es la única que puede ser útil en todos los tiempos y para todos los casos». Fíjese el lector que estos poetas están rozando o intuyendo el concepto del Eterno Retorno y también han sabido percibir que la única vía de salida es la interior.
La poesía será, especialmente, mimada y elevada a la categoría de virtuosismo por los decembristas [2], que consideraron el acto de la creación poética como un hecho heroico y una aproximación al espíritu. Este grupo también cantó a la libertad y a las acciones viriles en sus poemas. Es útil retener nombres como K. F. Ryléiev (1795-1826), W. K. Küchelbecker (1797-1846) y A. A. Bestúzhev (1797-1837).
Liubomudry, es el nombre del grupo que creó el poeta D. V. Venevítinov (1805-1827) y que dará paso al romanticismo filosófico. S. P. Shevyriov (1806-1864), definió magistralmente el sentido de este grupo: «la naturaleza no sólo está íntimamente unida al ser humano, sino que parece existir, ante todo, para explicar al hombre. Los misterios de la naturaleza son también los misterios humanos». Para el príncipe Odóievski, el poeta es la expresión universal de la búsqueda de la verdad única. Por ello, el poeta se halla en perpetua armonía con los dioses, las musas, la naturaleza y la belleza.
A. S Jomiakov, en El consuelo, nos plantea el tema de la muerte. Nunca hay una muerte definitiva, siempre queda algo… y el poeta, filosófico, comprendió que él era el portador del pensamiento inmortal. La única vía para conquistar la verdadera Libertad. ¡Éste fue el auténtico sentido de todas sus poesías! La suma de todas las obras y poemas que han tocado el tema de la muerte, durante este periodo, confirma aquello que luego Unamuno supo sintetizar magistralmente: «Dios es el resultado del instinto de inmortalidad del hombre».
Dos últimos personajes pondrán punto y final a esta somera presentación del poco conocido romanticismo ruso. En la figura de F. I. Tiútchev (1803-1873), tenemos a una de las cimas más altas de la poesía rusa, eslava y europea. Merece una reflexión profunda su Peregrino, pues por él transitan elementos sumamente interesantes para el discurso espiritual de la Tradición occidental. Finalmente, nos encontramos con A. S. Pushkin. Él ha representado los valores sólidos, la creación de versos que para siempre han acompañado el día a día de los rusos, es el motor de expansión de la brillantísima prosa rusa del siglo XIX, es el herrero de la lingüística rusa. Ha sido y es, la referencia para muchas generaciones de escritores de todas las tendencias y de todos los países europeos. Curiosamente, sólo se apartó del romanticismo, en el momento en que fue capaz de penetrar una parte de la sabiduría que subyace en la obra de Shakespeare.
Adrià Solsona
[1] Los actuales estudiosos han hecho una lectura restrictiva y se han limitado a hacer valoraciones psicológicas. Planteamiento que sólo consideramos aplicable a algunos de sus poemas. Pero en el conjunto de toda su obra se apunta hacia una percepción mucho más profunda de las cosas.
[2] Nombre asociado al pronunciamiento militar del 14 de diciembre de 1825.
00:05 Publié dans art, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, art, littérature, lettres, lettres russes, littérature russe, romantisme, romantisme russe, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 21 octobre 2010
Analisis de la Luna (der Mond) de los hermanos Grimm

Analisis de la Luna (der Mond) de los hermanos Grimm
Por Anamaría Hurtado
psiquiatra, psicoterapeuta, colaboradora de im Geviert
Ex: http://geviert.wordpress.com/
 Sumergirse en un cuento de hadas es iniciar una aventura en un bosque espeso, henchido de vida y de todo tipo de criaturas de la psique, no es azar que sea el bosque lugar por excelencia de los cuentos. Tras su aparente simpleza, los cuentos exponen las vicisitudes más trascendentes de la humanidad; el relato mítico, del cual se vale el cuento de hadas, más que un discurso lógico-formal, efectúa una apropiación analógica de las experiencias propiamente humanas en su entorno natural y social, manteniéndose en sincronía con los procesos del acontecer interno. No se detiene en la realidad externa, sino que va a penetrar la realidad psíquica individual, y de ella salta en circular retorno al ámbito mayor de la psique colectiva. A través de la imagen, vía regia para la manifestación arquetipal, los cuentos son una episteme integral y totalizante. Siempre hallaremos en los cuentos una condensación de múltiples niveles de significado, abundancia de símbolos, cuya cualidad polisémica les permite dar cuenta de lo inabarcable. En ese sentido, el conocimiento no queda seccionado por el intelecto, por el contrario se amplifica en extensión y profundidad. Por ello, cualquier análisis estructural, semiótico, psicológico, social o estético es apenas intento parcial de explicar un todo más amplio que los contiene: la propia realidad arquetipal; más fidedigna será siempre la conmoción que se origina en el espectador, niño o adulto, y que Jung acertadamente definiera como el carácter numinoso de los arquetipos.
Sumergirse en un cuento de hadas es iniciar una aventura en un bosque espeso, henchido de vida y de todo tipo de criaturas de la psique, no es azar que sea el bosque lugar por excelencia de los cuentos. Tras su aparente simpleza, los cuentos exponen las vicisitudes más trascendentes de la humanidad; el relato mítico, del cual se vale el cuento de hadas, más que un discurso lógico-formal, efectúa una apropiación analógica de las experiencias propiamente humanas en su entorno natural y social, manteniéndose en sincronía con los procesos del acontecer interno. No se detiene en la realidad externa, sino que va a penetrar la realidad psíquica individual, y de ella salta en circular retorno al ámbito mayor de la psique colectiva. A través de la imagen, vía regia para la manifestación arquetipal, los cuentos son una episteme integral y totalizante. Siempre hallaremos en los cuentos una condensación de múltiples niveles de significado, abundancia de símbolos, cuya cualidad polisémica les permite dar cuenta de lo inabarcable. En ese sentido, el conocimiento no queda seccionado por el intelecto, por el contrario se amplifica en extensión y profundidad. Por ello, cualquier análisis estructural, semiótico, psicológico, social o estético es apenas intento parcial de explicar un todo más amplio que los contiene: la propia realidad arquetipal; más fidedigna será siempre la conmoción que se origina en el espectador, niño o adulto, y que Jung acertadamente definiera como el carácter numinoso de los arquetipos.
Bajo esa antorcha intentaré adentrarme en La Luna de los Grimm. Lo primero que llama la atención es que el cuento discurre en un espacio de oscuridad, evoca esa selva oscura en la que se encuentra Dante al iniciar su camino. Es la noche la que nos acoge, todo el cuento se desarrolla entre tinieblas y la suave luz de la luna. Nos ubica en la inconsciencia primordial, la irracionalidad, el hombre en tanto naturaleza; de ese primer estadio salen los protagonistas, pero con la particularidad de que ellos salen simplemente a una excursión, al parecer no emprenden una búsqueda o una conquista, como suele suceder en otros relatos. Este inicio del camino no es buscado, acontece, más bien. Esto marca distancia con los cuentos clásicos de héroes, quienes inician un camino, que los lleva a luchas por encontrar algo valioso. Tampoco es un solo joven: son cuatro, es una tarea colectiva la que comienza. El número nos acerca en primera lectura al simbolismo del cuadrado, expresión geométrica de la cuaternidad , los cuatro elementos, los puntos cardinales, símbolo de la fijeza y quietud de la tierra, se constituye así el ámbito de la existencia humana, es la ubicación en el mundo. De inmediato, el mismo número nos llevará a las fases lunares, punto central del relato. Ocurre luego otra particularidad, los jóvenes encuentran en el crepúsculo, en el descenso solar, el globo de luz suave, lejana y amplia, la cual pende de un roble, árbol sagrado, puerta del conocimiento, arcaico símbolo materno. Este hallazgo es más bien un acontecer, un encuentro fortuito, pero de tal importancia que da inicio a la dramática del cuento. Ese segundo estadio nos habla de una luz en la noche. Todos esos elementos nos ubican en una atmósfera nocturna- lunar, símbolo de lo femenino y de un tipo de consciencia diferente a la consciencia diurna-solar, masculina.
Hasta acá hemos visto lo que el cuento no es, no relatará el periplo de un héroe, que en esencia simboliza el viaje del sol, es decir la aparición de la consciencia masculina patriarcal. Los cuatro jóvenes, quienes también parecen representar las cuatro funciones de la psique descritas por Jung, son tomados por la idea del Robo, cada uno aporta una facultad, reitero es un trabajo colectivo, un consenso. Las monedas de plata son otra conexión con el mundo lunar, por el elemento plata, asociado en la alquimia con la luna. El robo permitirá un acceder de los jóvenes y al pueblo al disfrute de una nueva consciencia, aún indiferenciada y apegada a la materia, pero que les evita tropiezos y pueden iniciar el conocimiento y el despliegue en el mundo.
La dinámica de lo femenino continúa, los jóvenes envejecen y mueren, no hay lucha, batallas ni pruebas, simplemente el ciclo de la vida y la muerte con el que tan íntimos vínculos tiene la feminidad. El descenso al inframundo, y la consecuente repartición de los cuartos de luna, repiten en otra octava lo que venimos señalando, ahora la luz lunar se traslada al mundo de los muertos, recordemos a Perséfone, Señora del Hades, también raptada y conectada al inframundo que la transforma aunque la retorne. Esa luz que no es intensa ilumina a los muertos, lleva luz al ámbito profundo de la existencia, al inconsciente, los muertos salen de sus lugares y actúan como si estuvieran vivos, pierden sus lugares, hay un predominio de la consciencia femenina que amerita, por parte del psiquismo, de una actitud compensatoria.
San Pedro, representante de la consciencia masculina patriarcal, hace su aparición tratando de poner orden, pero lo hace de una manera tremendamente insólita. El advenimiento del poder no es por la guerra, la batalla o la lucha, las huestes angélicas no obedecen al llamado. Pedro tiene que descender, se abaja, dialoga, ¡qué interesante! Sin embargo logra el cometido, lo muerto, lo ctónico regresa a su lugar, se establece un nuevo orden con la inclusión del elemento femenino lunar junto al elemento masculino: se efectúa la coniuctio, y se accede entonces a un estado de consciencia plena donde los opuestos se reúnen, lo racional y lo irracional, logos y naturaleza.
Pareciera, entonces que el cuento nos habla de la experiencia humana de integración de lo femenino en el alma individual y colectiva. Ese apropiamiento no es el robo prometeico de un fuego por el cual hay que pagar con el suplicio, este, por el contrario, es un robo hermético, un intercambio, nadie protesta, nadie castiga, sólo se obtiene a cambio la experiencia de las monedas de un metal femenino. Asimismo, la luz lunar debe ser mantenida con el cuidado de la cultura, el aceite, otro referente femenino de espera y paciencia. Recordemos las vírgenes prudentes cuidando el aceite de las lámparas para mantener viva la llama, mientras esperan al esposo.
Todo es suave en este cuento, nos pone al tanto de un desarrollo de la consciencia femenina, no en cuanto género, sino como forma de apercibir y percibirse con la suave luz lunar que permite claroscuros, matices, sombras, que otorga a la psique un conocimiento global, amplio y emotivo, en oposición a la consciencia solar del logos que ilumina y encandila, apercepción del mundo desde la razón y la lógica del intelecto. Se trata del advenimiento de lo femenino , tanto en la psique individual como colectiva, lo cual va a implicar un esfuerzo diferente, un estar, dejar que suceda, un trabajo silencioso y de espera, como el tejido, la cocina o la agricultura, diferentes a la caza, la conquista y la inmediatez.
Se hace posible otra dinámica del poder: San Pedro, el guardián, se relaciona con el submundo a través de un diálogo, no hay poder autoritario, hay reconocimiento del Otro, es un San Pedro que pide, solicita la vuelta a sus lugares de lo ya vivido, del pasado. No hay imposición cruenta. La omnipotencia suplicante, figura que integra dos aparentes opuestos.
El ascenso final de la luna, de manos del elemento masculino, bella imagen que evoca el dogma católico de la asunción de la Virgen para constituir una Cuaternidad a partir de la Trinidad, hay una nueva completud, un nuevo cosmos con la integración de la consciencia femenina.
Los Grimm intentan en el cuento la integración de los aspectos femeninos, como parte indispensable del proceso de individuación. Nos hablan de un viaje no heroico desde la inconsciencia primordial hasta la integración de los aspectos femenino y masculino, adquiriéndose así una consciencia más amplia. Es el dar lugar a otra forma complementaria de ver y estar en el mundo, haciendo posible el encuentro del alma y el espíritu. Nos devuelven la visión de un monje medieval- Guillame de Digulleville, quien ve a Dios en el cielo como un Rey sentado en un trono circular y radiante, y junto a él , la Reina del cielo en un trono de cristal oscuro. El relato nos ubica en el dilema de la humanidad a partir del Iluminismo, la concepción de un mundo atado a la razón, y el intento de echar a un lado la irracionalidad, lo emotivo, la intuición, formas alternativas de pensar, diferentes a la aparente pureza de la lógica y la objetividad científica, con lo cual contribuyó al empobrecimiento simbólico de la humanidad, expulsada desde entonces de su habitar poético (Holderlin). El romanticismo mostró la cara que se intentó ocultar, invitó a la Luna al cielo del mundo…
Links relacionados:
Ontología, mitopoiesis y estructura totalitaria de los cuentos de hadas
00:06 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, traditions, traditionalisme, contes, légendes, frères grimm, allemagne, romantisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 26 mai 2009
Goethe come fenomenologo

di Ludwig Klages
Fonte: tellus
Difficilmente il Romanticismo avrebbe ripreso con tanta decisione, com’è avvenuto, i simboli dell’androgino e del ginandro, se Goethe non gli fosse apparso come modello esemplare della congiunzione di tratti maschili e femminili. Noi non dobbiamo farci tante domande, sulle particolarità dell’anima maschile e femminile, poiché per i nostri scopi può bastare sapere che quella maschile è caratterizzata da un’attività estrovertita, quella femminile da una passività ricettiva. In quella si radica, perciò, il senso della fattualità; in questa il sentimento della realtà. Nel linguaggio comune non si tiene conto della distinzione tra realtà e fattualità, ma in filosofia queste non dovrebbero essere mai confuse. Mostriamo con un esempio la loro differenza. Nelle vicinanze di una città si trova in un prato un boschetto.
Questo è un “dato di fatto” (Tatsache) e - come tale - resta sempre il medesimo, indifferente a chi lo pensi e per quale scopo. Supponiamo che in una bella giornata d’estate si trovino davanti al boschetto tre persone: uno speculatore edilizio, un botanico, un pittore di paesaggio, tutti e tre rivolti al medesimo oggetto percettivo, cioè al boschetto. Lo speculatore edilizio, esaminato di sfuggita il bosco, fa un calcolo approssimativo: la stima della grandezza della superficie, il valore di vendita del legno abbattuto, il terreno necessario alla costruzione di un caseggiato, il valore crescente del terreno, perché al massimo in due anni vi passerà davanti una ferrovia, con una fermata poco lontano ecc... Il botanico ha immediatamente notato un’orchidea, più lontano del legno di tasso, e confida di servirsene per il proprio erbario. Per entrambi, come si nota, l’oggetto percettivo è divenuto all’istante un oggetto del pensiero, ed entrambi hanno subito posto l’oggetto del pensiero al servizio di interessi personali, per quanto notevolmente differenti l’uno dall’altro.
Entrambi si comportano quindi in modo spiritualmente attivo, e - se avvertiti - sarebbero anche capaci di riflettervi sopra. Ma una attività spirituale o azione era già presente a loro insaputa nella costituzione dell’oggetto percettivo stesso, nella misura in cui esso è un dato di fatto, ovvero un prodotto del giudizio. Ci convinciamo di ciò passando ad un breve esame di quel che ha vissuto intanto la terza persona, il pittore di paesaggio. Anch’egli ha innanzitutto percepito il medesimo gruppo di alberi, ma subito il suo sguardo indugia sulle forme dei tronchi, sulle masse di foglie in movimento e sulle loro tonalità di colore, da lì passa all’azzurro del cielo d’estate e al bianco di un gruppo di nubi più distante, racchiude - in ogni caso senza la minima riflessione - tutto ciò in una immagine, davanti a cui l’osservatore trascura di fissare in concetti il fatto percettivo “là c’è un bosco ed io sono qui”. Senza per ora indagare il senso di quel che gli accade, riconosciamo tuttavia già una cosa: tanto più l’artista è avvinto dall’immagine intuita, quanto più la sua condotta, da spiritualmente attiva, diventa passivamente ricettiva, e con ciò in egual misura il suo contenuto percettivo perde il carattere di fatto oggettivo.
Supponiamo, cioè, che a causa di un impulso interno, su cui torneremo, egli si senta indotto a trasferire l’immagine intuita sulla tela, ed inizi così subito uno schizzo di colori, ma non riesca a finirlo nel tempo stabilito e si veda costretto a rinviarlo successivamente; allora facilmente accade che il suo oggetto, se vogliamo chiamarlo così, nel frattempo è scomparso e ha lasciato il posto ad un oggetto essenzialmente diverso.
Il tempo è improvvisamente mutato, nubi grigio cupo si addensano nel cielo, gli alberi si piegano nella tempesta, e infine comincia a piovere. Il fatto (il bosco qui sul posto) è rimasto lo stesso, l'immagine intuita è divenuta un’altra. E se ora il nostro pittore dovesse intraprendere un lungo viaggio, per poi ritornare nel tardo autunno, egli incontrerebbe allora nello stesso posto un'immagine intuita che, per così dire, sembrerebbe appartenere ad un altro mondo. Ma è necessario generalizzare la nostra considerazione.
La realtà delle immagini intuite o, come si preferisce, dei fenomeni (Erscheinun-gen), si trova in incessante trasformazione; perciò i fatti, a cui ci riferiamo col pensiero come a stati di cose in sé identici di contro a questo stesso mondo fenomenico, sono prestazioni del nostro spirito, anche se a noi estorte in occasione dell’esperienza sensibile, e per questo senza dubbio prestazioni compiute necessariamente.
Ma se qualcuno si ponesse la domanda, perché attribuiamo una realtà originaria ai fenomeni e ai fatti solamente una derivata, allora dovrebbe bastare a convincerlo la seguente indicazione: il contenuto dell'oggetto del pensiero a poco a poco s'impoverirebbe e infine svanirebbe nel nulla col venir meno dell'esperienza intuitiva. Se si privasse di conseguenza l’essere vivente della vista, dell’udito, dell’odorato, del gusto, e infine anche del tatto, il suo oggetto del pensiero sarebbe progressivamente cancellato, finché alla fine non rimarrebbe più nulla con cui il suo spirito possa cimentarsi.
Chiediamoci ora quale profitto nelle proprie ricerche Goethe dovette al proprio lato femminile, ovvero all’eccitabile sentimento della realtà. Ci colpisce in primo luogo la fondamentale importanza che egli, in opposizione all’intera filosofia a partire da Cartesio, inclusi i più notevoli pensatori del proprio secolo, ha attribuito all’intuizione (Anschauung) come formazione conoscitiva. Egli riscoprì ciò che si era chiamato nei secoli precedenti - con espressione felice, ma con altri intenti - visio sine comprehensione, e per questo è divenuto - in opposizione perfino alla scienza del proprio tempo - il primo moderno fenomenologo (Erscheinungsforscher). Per l’importanza che ha, questo fatto esige un adeguato riconoscimento.
Se Goethe ritrova la fonte delle sue più notevoli convinzioni - una parola, che è tratta dal senso della vista - nelle immagini intuite del mondo, e specialmente, in quelle visive, allora si potrebbero trovare d’accordo con ciò il fisico, il “sensualista”, se solo non risultasse decisiva ’aggiunta, che - grazie ad una proprietà subito da discutere - la ad una proprietà subito da discutere - la contemplazione in questione permetterebbe alla facoltà di giudizio il ritrovamento immediato della verità; con ciò restituiamo al termine intuizione (Intuition), oggi logorato dall'uso popolare, il suo vero significato, che dovrebbe essere reso con “feconda illuminazione mediante visione (Anschauung)” o, più brevemente, con “ispirazione” (Eingebung). Spinoza aveva inoltre compreso qualcosa di diverso, cioè un tipo di evidenza immediata simile a quella usata dai matematici; ma Goethe crede, anche in questo caso, di poter fare affidamento su di essa. «Se tu dici», scrive nel 1785 a Jacobi, «che in Dio si può soltanto credere, io invece ti dico che attribuisco grande valore al contemplare, e se Spinoza parla di scientia intuitiva..., a me queste poche parole danno il coraggio di dedicare la mia intera vita all'osservazione delle cose»; e ancora nel 1801: se la filosofia «innalza, consolida e trasforma in un profondo, quieto intuire il nostro originario sentimento di essere una cosa sola con la natura, allora è la benvenuta». Tale capacità egli la chiama altrove “giudizio intuitivo” (anschauende Urteilskraf). Chi infine riuscisse a cogliere lo spirito di una frase simile: «I miei studi sulla natura si basano solo sull’esperienza», noterà - forse con proprio stupore - che è impossibile rinvenire nella fisica, anzi in tutte le scienze della natura, la parola che qui Goethe adopera come “fondamento” della propria intera ricerca: la parola erleben! E se costui considerasse, ancora, i due versi molto citati: «Chi è in relazione con la propria Madre, la Natura, questi trova nel calice a stelo tutto un mondo», allora forse si potrebbe insinuare in lui un sospetto: che la frattura metafisica (die metapbysische Spalte) non sia tra le cosiddette scienze della natura e le cosiddette scienze dello spirito, bensì fra entrambe e la scienza della vita, iniziata, nell’età moderna, con Goethe. La possibilità di una scienza dei fenomeni deve essere intanto garantita non da un mero cambiamento di metodo, bensì da un radicale cambiamento nel porre la questione. L’indagine dei fatti è indagine delle cause: ma le cause non sono trovate dall’Intuizione intellettuale, o come la si voglia chiamare.
D’altra patte il termine fenomeno (Erscheinung), se deve avere un senso, può solo significare l’apparire di un qualcosa, il manifestarsi di un’anima in tutti gli eventi, o il rivelarsi di un’essenza in esso. Abbiamo lasciato in sospeso, che cosa senta propriamente il pittore, quando si affida all'immagine intuita, e il motivo che lo induce a voler fissare con l’aiuto di un’immagine ritratta il contenuto della propria esperienza vitale. Vuole realmente produrre una mera copia, come potrebbe anche fare una lastra sensibile alla luce? La risposta è: quanto più egli s’imbatte nello stato della contemplazione, che gli antichi a ragione chiamavano ’patico’, tanto più entra in relazione con l’anima dell’immagine; e quel che egli, perciò, si sente spinto a trasferire sulla tela, non è tanto una copia del bosco, quanto piuttosto un’apparizione dell’anima del bosco. Con ciò conosciamo il senso di quella trasformazione, che è negata al fatto percettivo oggettivo: la vita insita nei fenomeni, che - in quanto tale - oscilla senza stabilità tra l’andare e il venire. Indagarla, per così dire, attraverso il fenomeno, è il compito degli spiriti fedeli alla vita, e solo questi sono veri fenomenologi. Proprio questo intendeva Goethe.
Egli ha pubblicato nel 1776 un geniale saggio sullo scultore francese Falconet, che - come ogni sua opera - è un frammento autobiografico, ma riguardante questa volta della propria cosiddetta originaria visione del mondo. Riportiamo alcuni dei passi più fortemente probatori. L’artista «può entrare nella bottega di un calzolaio o in una stalla; può guardare il volto dell’amata, i propri stivali o l’arte antica, dappertutto vede le sacre vibrazioni... con cui la Natura congiunge ogni cosa. Ad ogni passo gli si schiude il mondo magico, quello stesso che fervidamente e continuamente ha avvolto le opere dei grandi maestri, alla cui riverenza è spinto ogni artista che voglia emularli. Ogni uomo ha più volte sentito nella propria vita la forza di questo incantesimo... Chi entrando in un sacro bosco, non è stato assalito neppure una volta da un brivido? Chi l’avvolgente notte non ha assalito con inaudito terrore? A chi, in presenza dell’amata, il mondo intero non è apparso dorato?... Ecco, ciò che si agita nell’anima dell’artista, ciò che tende all’espressione più chiara, senza la mediazione del conoscere».
Assumiamo ora, che lo stato sopra descritto generi la facoltà di giudizio, accordiamogli ispirazioni, intuizioni; il risultato sarebbe allora un sapere riguardante l’essenza dei fenomeni, e per il ricercatore volto a ciò un definitivo chiarimento, una rivelazione, per così dire, illuminata dalla quale l’immagine intuita otterrebbe il carattere del “fenomeno originario”, irriducibile a ogni riflessione. Nelle Sentenze in prosa si dice: «Tutto ciò che chiamiamo, nel senso più elevato, invenzione, scoperta, è l’importante attività [...] di un innato sentimento della verità che, a lungo formatosi nel silenzio, improvvisamente come un lampo porta ad una intuizione feconda. Esso è una rivelazione che si sviluppa dall’interno verso l’esterno».
Quando Novalis, a proposito dei principi d’indagine del Romanticismo, che proseguì il cammino iniziato da Goethe, enuncia l’espressione oscuramente sibillina: «All’interno va il misterioso cammino», con questa egli non intende che - in modo simile ad una contemplazione “narcisistica” - si debba volgere lo sguardo a se stessi e distoglierlo dal mondo dei fenomeni, bensì che allo spirito l’occhio si apre soltanto nella dedizione al mondo delle immagini, per cui esso contempla ciò che appare nei fenomeni e trova nell’esteriore qualcosa di interiore, la cui vita sempre in trasformazione si esprime nell’esteriore. In altre parole, la meta della fenomenologia è un’indagine dell’essenza (Wesensforscbung), altrimenti non vi sarebbe più neppure un’indagine dei fenomeni!
Il testo di Ludwig Klages fa parte del volume Goethe als Seelenforscher (1932) edito da Bouvier, Berlin-Bonn.
© traduzione Mario Clerici
© Marco Baldino, 1996
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, philosophie, révolution conservatrice, psychologie, phénoménologie, romantisme, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 17 février 2009
Leibnis, Herder, la tradition romantique

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1985
Notions philosophiques de base.
La leçon de Leibniz; les monades:
Prédécesseur de Leibniz, Christian Thomasius (1655-1728), fondateur de l'Université de Halle, développe un système éthique/philosophique, selon lequel nos croyances doivent être sanctionnées à partir de notre seule intériorité et non à partir d'une autorité extérieure. L'individu, dans ce système fondé par Thomasius, doit être capable (et donc s'efforcer) de suivre sa propre lumière, sa propre "raison". De cette vision de la nature et de l'agir humains, découle automatiquement un relativisme, donc une acception des différences qui constituent la trame du monde, une acception inconditionnelle du pluriel, de la diversité. Pour Thomasius, son système et ses retombées, comme tout autre espèce de savoir, doit déboucher sur des applications pratiques in vita civilis . Cette figure de l'histoire des idées philosophiques, dont la personne constitue le lien entre la Renaissance et les Lumières, nous lègue ici des principes clairs, une éthique de l'action: la diversité est telle et l'on ne saurait la contourner. De ce fait, nos jugements doivent se laisser diriger par une approche relativiste, non mutilante et non réductionniste du monde et des hommes. Ce relativisme doit déboucher ensuite sur un agir respectueux de ces différences qui font le monde. Indubitablement, notre volonté de donner un autre visage à l'Europe, s'inspire de cette démarche vieille de presque trois siècles. Dans notre optique, les Lumières ne constituent nullement un programme rigide, un catéchisme stérélisateur, une religion sèche de la Raison (comme avaient voulu l'instaurer les Jacobins français) mais bien plutôt l'attention au monde, le respect des créations spontanées de l'esprit et de l'histoire, la sagesse du jardinier qui harmonise, dans ses parterres, les fleurs les plus diverses... Mais cette attention doit être couplée à une vigilance, une milice spirituelle qui veille à ce que les mutilateurs de toutes obédiences, les réductionnistes de tous acabits ne viennent troubler cette splendide harmonie du monde.
Avec Leibniz, les intuitions de Thomasius, les prolégomènes que ce fondateur de l'Université de Halle a posés, s'affineront. L'orientation rationaliste de sa pensée ne l'a nullement empêché de jeter les bases de la grande synthèse organiciste que furent le Sturm und Drang et le Romantisme. Le rationalsime cartésien et spinozien descendent, chez Leibniz, au niveau des monades. Celles-ci sont chacune différente: il n'y en a pas deux d'identiques. Et chacune de ces monades acquiert continuellement un "état" nouveau. Leibniz découvre ainsi un devenir constant, un développement incessant de forces et d'énergies intérieures, une continuité ininterrompue. L'état présent d'une monade est le résultat d'un état antérieur et, par suite, tout état présent est gros de son avenir. L'univers de Leibniz, contrairement à celui de Descartes, n'est plus une somme de parties, mais un tout qui déploie ses divers aspects . Le concert international, pour nous, est également une globalité politique qui déploie, sous l'impulsion d'agirs humains, des perspectives, des possibles divers. Cette variété infinie constitue une richesse et notre humanisme veillera à ce que cette richesse ne s'épuise pas. C'est là que s'inscrit la liberté: dans la capacité de déployer collectivement un possible original, d'inscrire dans l'histoire une geste unique à côté d'autres gestes uniques. In vita civilis , pour reprendre l'expression latine de Thomasius, cette vision implique l'organisation fédéraliste des grands ensembles civilisationnels (chaque monade peut ainsi assumer son devenir sans contraintes extérieures) et le dialogue fraternel entre les diverses civilisations du globe. Dialogue d'attention et non de prosélytisme mutilant...
Herder: des monades aux peuples
Herder va dépasser Leibniz. De l'œuvre de ce dernier, Herder avait retenu l'énergie interne des monades, génératrice de devenirs spécifiques. Mais, pour Leibniz, chaque monade, activée de l'intérieur, n'avait aucune "fenêtre" extérieure, aucune ouverture sur le monde. Leibniz dépassait certes l'atomisme qui voyait des particules sans énergie intérieure, mais ne concevait pas encore des monades en interaction les unes avec les autres. Cet isolement des monades disparaît chez Herder. Dans sa vision philosophique, chaque unité (un individu ou un peuple) entre en interaction avec d'autres unités. Toute individualité singulière ou collective, loin d'être renfermée sur elle-même, dérive la conscience intérieure qu'elle possède d'elle-même de l'extérieur, c'est-à-dire du contact d'avec le monde qui l'entoure. Si ce monde était absent, cette conscience ne pourrait jamais s'éveiller. Herder nous propose ainsi une image du monde où les diverses parties constituantes sont toutes activement liées les unes aux autres au sein d'un réseau dynamique de réciprocité. Cela signifie qu'aucune individualité ne peut, dans l'univers, ni exister indépendemment du contexte de ses inter-relations ni être comprise comme en dehors de celles-ci. En restant au niveau de développement conceptuel de Leibniz, on risquait de concevoir le concert international comme un ensemble de nations repliées sur elles-mêmes et jalouses de leurs petites particularités. On risquait l'albanisation ou, pire, l'incompréhension réciproque. On risquait d'asseoir une image du monde justifiant les nationalismes ou les particularismes d'exclusion, les réflexes identitaires de rejet. Et, donc, les bellicismes stériles... Avec Herder, ce risque s'évanouit, dans le sens où la diversité est production hétérogène et incessante d'un fond de monde, rationnellement indéfinissable. Les éléments divers ont pour tâche de mettre en exergue le maximum de possibles, de "colorier" sans relâche le monde, d'échapper sans cesse à la grisaille de l'uniformité. Le respect des identités postule la solidarité et la réciprocité. En termes politiques actualisés, nous dirions que la défense des identités régionales, nationales, culturelles, civilisationnelles, etc. exige comme indispensable corollaire la solidarité inter-régionale, internationale, inter-culturelle, inter-civilisationnelle, etc.
L'objectif d'une Europe alternative serait donc de valoriser les peuples avec les productions littéraires, culturelles et politiques qu'ils forgent et de lutter contre l'arasement des spécificités qu'entament automatiquement les systèmes niveleurs, en tout temps et en tout lieu, quelle que soient d'ailleurs leurs orgines et leurs référentiels philosophiques ou idéologiques.
La tradition romantique
Le système philosophique de Herder constitue indubitablement une réaction à l'encontre d'un certain despotisme éclairé, qui ne se donnait plus pour objet, comme dans le chef d'un Frédéric II, de défendre un pays en tant que havre de liberté religieuse par tous les moyens militaires modernes, mais un despotisme éclairé, transformé par l'érosion du temps en fonctionnarisme uniformisant, en praxis de mise au pas des libertés locales. Ce despotisme, perçu sous l'angle d'une praxis générale et définitive et non plus comme praxis postulée par l'Ernstfall permanent que vit une société contestataire (la Prusse de Frédéric était le havre des Huguenots et des Protestants de Salzbourg, de bon nombre de "non conformists" britanniques et d'Israëlites, de piétistes) menacée par ses voisines conservatrices, renforce l'autocratie au lieu de l'assouplir et la justifie, en dernière instance, au nom du progrès ou de la raison, se donnant, dans la foulée, l'aura d'un "humanisme". La vision organique de Herder génère, elle, un humanisme radicalement autre. Le peuple, la population, le paysannat, chez Herder, n'est pas le "cheptel" taillable et corvéable à merci d'une machine étatique, d'un appareil de pouvoir, qui justifie son fonctionnement par référence à la raison mécaniste. L'humanisme herdérien ne nie pas la vie intérieure, le devenir créatif, de cette population, de ce peuple. La substance populaire n'est pas déterminée, dans cette optique, par des ukases venus d'en-haut, promulgués par le pouvoir de l'autocrate ou d'une oligarchie détachée du gros de la population, mais se justifie d'en-bas, c'est-à-dire au départ des phénomènes de créativité littéraire ou scientifique, économique ou religieux que suscite la collectivité, le peuple. En un mot: c'est le Travail global du peuple qui justifie, doit ou devrait justifier, son existence politique ainsi que le mode de fonctionnement qui régirait cette même existence politique.
La tradition romantique procède donc d'un recentrement ontologique, écrit le grand spécialiste français du romantisme allemand, Georges Gusdorf. Ce recentrement, Thomasius l'avait déjà tenté, en réfutant toute détermination venue de l'extérieur. Le message démocratique et identitaire du romantisme postule ipso facto un système de représentation impliquant, comme en Suisse, le référendum, la participation directe des citoyens à la défense de la Cité, l'autonomie locale (cantonale, en l'occurrence) et la neutralité armée. Ces pratiques politiques et administratives éliminent les despotismes autocratiques, oligarchiques et partitocratiques, tout en tarissant à la source les vélléités impérialistes, les visées hégémoniques et les chimères conquérantes. En outre, le recentrement ontologique romantique, in vita civilis et à l'âge de l'économisme, signifie une protection du travail local, national (au sens de confédéral) contre les manipulations et les fluctuations des marchés extérieurs. La tradition romantique nous lègue un réflexe d'auto-défense serein et harmonieux qu'oublient, nient et boycottent les idéologies missionnaires et prosélytes qui régentent le monde d'aujourd'hui et colonisent les médias, dans l'espoir d'uniformiser le monde sous prétexte de l'humaniser selon les critères de l'humanisme mécanique. La soif d'alternative passe inmanquablement par un nouveau choix d'humanisme qui, à l'absence de sens observable à notre époque de désenchantement post-moderne (c'est-à-dire postérieur aux séductions actives de l'humanisme mécaniste), reconférera au monde une surabondance de sens. Au niveau des individus comme au niveau des individualités collectives que sont les peuples, l'existence n'a de sens que si elle permet le déploiement d'une spécificité ou, mieux, une participation active, concrète et tangible à la geste humaine totale.
Robert Steuckers.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, théorie politique, 18ème siècle, identité, romantisme, lumières, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 février 2009
Johann Wilhelm R. Ritter (1776-1810)
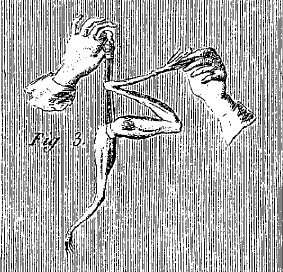
Archives de SYNERGIES EUROPÉENNES - DÉCEMBRE 1992
Robert Steuckers:
Johann Wilhelm R. Ritter (1776-1810)
Né le 16 décembre 1776 à Samitz bei Hainau en Silésie, ce pharmacien, qui étudia longtemps aux universités de Iéna, Gotha et Weimar, fut appelé en 1804 à siéger à l'Académie bavaroise de Munich. J.W.R. Ritter a découvert, avant tout le monde, un ensemble de phénomènes dans les domaines du galvanisme et de l'electricité physiologique. A partir de 1798, J.W.R. Ritter publie plusieurs ouvrages fondamentaux sur ces sujets. Après que Ash en 1796 et A. von Humboldt en 1797 aient observé des effets chimiques dans la chaîne galvanique, Ritter, en 1799 fait état d'observations fondamentales sur l'électrolyse; il prouve ensuite la décomposition de l'eau et des sels métalliques dans la chaîne et aux fils polaires de la colonne, si bien qu'on peut dire sans hésiter qu'il a devancé Nicholson et Carlisle. Mais la théorie énoncée par Ritter sur le processus de l'électrolyse est lacunaire, ce qui lui confisque tout retentissement immédiat. On peut également considérer Ritter comme l'inventeur de la colonne de charge et, en même temps que Behrens, comme celui de la colonne sèche. Ritter perçoit ensuite le réchauffement inégal des électrodes, puis, quelques années plus tard, à l'occasion d'une décomposition de la chlorargyrite, l'effet oxydant et phosphorescent des rayons ultra-violets, ainsi que l'effet réducteur de phosphorescence des rayons rouges et infra-rouges.
Ritter a étudié l'électricité animale et physiologique (à la suite de Galvani), jettant de la sorte un pont entre les sciences de la nature et la physique de l'électricité. Le galvanisme, dans l'optique de Ritter, donne à l'idée de force vitale une assise scientifique et expérimentale. La notion de force vitale ne relève plus désormais de la seule spéculation métaphysique, mais devient, grâce à Ritter, objet d'expérience empirique. Les investigations de Ritter campent cependant dans deux domaines: celui de l'expérience scientifique, où il excelle, et celui de la métaphysique, terrain qu'il n'abandonne pas et dans lequel il ancre, par une extrapolation audacieuse, son idée de galvanisme universel, qui devient, du coup, principe d'intelligibilité universel de l'organisme naturel, constitué comme une immense chaîne galvanique, embrassant la totalité du réel. De cette conjonction de l'empiricisme et de la métaphysique découle la thèse de l'organicisme universel. La physique de l'univers ne s'explique pas par une seule catégorie d'arguments phycisistes mais par une articulation où agissent magnétisme, électricité et dynamisme énergétique, soit trois formes de dynamisme à l'œuvre dans l'économie naturelle mais gardant chacune son individualité, tout en restant dans un rapport de continuité. Grâce aux travaux de Ritter, la force vitale, idée-force des biologistes romantiques, atteste de l'universalité du dynamisme et ne se limite pas au domaine organique, s'étend a fortiori dans le domaine inorganique, réduisant d'avance à néant tout dualisme qui revendiquerait une césure à ce niveau. Toutes les formes de vie, tous les éléments de l'univers, sont en communication permanente: tel est l'idée majeure que nous transmet l'œuvre de Ritter.
Contributions à une connaissance plus précise du galvanisme (Beyträge zur nähern Kenntnis des Galvanismus), 3 vol., 1800, 1802, 1805
Précis scientifique et empirique sur le galvanisme et l'électricité animale, ces Contributions évoquent les périodes communes que se partagent la Terre, en tant qu'astre, et tous les animaux et les plantes. L'homme, découvre Ritter, répercute, lui aussi, toutes les périodes que l'on peut observer dans la nature anorganique. On peut dire de l'homme que sa loi temporelle intérieure est demeurée la même que celle qui régit l'anorganique, même s'il y a apparemment indépendance complète entre les deux règnes, l'anorganique et l'humain. Chaque créature de l'univers, innervé par le galvanisme, dispose d'un temps dans lequel elle n'était pas encore mais où elle advient. Cette advenance de la créature dans une temporalité nouvelle constitue son individuation, son affranchissement par rapport à son unité primordiale avec la Terre. Affranchissement individuant qui n'exclut pas le lien ultime qui lie indéfectiblement toute créature à la terre. La différenciation procède par éclosion de périodicités propres pour chaque plante, chaque animal. Ce sont, explique Ritter en replongeant dans la métaphysique et la théologie, des décisions célestes (himmlische Beschlüße) qui ont provoqué cette différenciation dans les périodicités. L'hiéroglyphe le plus sublime de la Terre est l'homme, écrit-il dans sa conclusion. Cet être est né du giron de la Terre qui, depuis son advenance, n'a plus enfanté: l'homme est la dernière parole prononcée par la Terre.
(Robert Steuckers).
- Bibliographie:
Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensproceß im Thierreiche begleitet, Weimar, 1798; Beyträge zur nähern Kenntnis des Galvanismus und der Resultate seiner Untersuchung, Iéna, 1800-1805; Das elektrische System der Körper, ein Versuch, Leipzig, 1805; Physisch-chemische Abhandlungen in chronologischer Ordnung, Leipzig, 1806; Die Physik als Kunst, Munich, 1806; Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers, Heidelberg, 1810.
- Sur J.W. Ritter: Novalis, L'Encyclopédie, Fragments, classement Wasmuth, trad. Gandillac, éd. de Minuit, Paris, 1966, §649, p. 172; Karsten, "J.W. Ritter", in Allgemeine Deutsche Biographie, 28. Band, Leipzig, 1889; Paul Kluckhohn, Charakteristiken, Deutsche Literatur, Reihe Romantik, Bd. I, Stuttgart, Reclam, 1950, p. 162 sq.; Roger Ayrault, La genèse du romantisme allemand, t. III, Aubier, Paris, 1970, p. 69; t. IV, 1976, p. 118; Roger Cardinal, German Romantics in Context, Studio Vista/Casell & Collier Macmillan, Londres, 1975, pp. 86-91; Georges Gusdorf, Le savoir romantique de la nature, Payot, Paris, 1985, pp. 191-198; Georges Gusdorf, L'homme romantique, Payot, 1984, pp. 194-196; Georges Gusdorf, Fondements du savoir romantique, Payot, 1982, pp. 339-341.
- Sur les notions de magnétisme, d'électricité, de processus chimique et de galvanisme, cf. F.W.J. Schelling, System des transzendentalen Idealismus.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, 18ème siècle, galvanisme, romantisme, allemagne, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook






