INTRODUCTION (2016): Arnold Gehlen (1904-1976) est, avec Max Scheler et Helmut Plessner, l’un des représentants majeurs de l’anthropologie philosophique apparue dans les années vingt en Allemagne. L’homme est pour lui une créature dont la culture est la seule nature. Être imparfait (Mängelwesen), il compense sa déficience biologique par l’invention de la technique et des institutions. Libéré ainsi des sollicitations immédiates des besoins et des pulsions, il peut prévoir et planifier. Après avoir cédé à la tentation du national-socialisme pendant les années trente, Gehlen est devenu après 1945 un représentant du conservatisme technocratique et un critique avisé de la société moderne. Ses thèses ont nourri la réflexion de Jürgen Habermas, Hans Blumenberg, Ernst Tugendhat et Theodor W. Adorno. Quand les pollutions, le dérèglement climatique etc. menacent l’avenir de l’humanité, mais quand aussi s’exprime partout le souci de sa préservation, alors il est temps de découvrir l’anthropologie d’Arnold Gehlen (B.).
◊◊◊◊◊◊
Arnold Gehlen et l’anthropologie philosophique
Rédigé en 1979 et en 1980, le texte de cette conférence sur Arnold Gehlen mérite toujours d’être lu, malgré les années qui ont passé. En effet, parmi les éditeurs francophones, seules les Presses Universitaires de France ont estimé utile de publier ses Travaux d’anthropologie sociale. Livre indispensable, incontournable mais auquel il manque tout le contexte de l’œuvre. Puisse notre article y remédier, de façon fort simple et didactique.
***
Depuis longtemps déjà, notre courant de pensée se penche sur la nécessité de tracer les grandes lignes d’une anthropologie pour le XXe voire le XXIe siècle. Au seuil de cet exposé, il me semble bon de définir, avant toute chose, le terme “anthropologie”. L’anthropologie consiste en l’étude scientifique de l’homme ; cependant, il faut distinguer : 1) l’anthropologie culturelle ; 2) l’anthropologie biologique ; 3) l’anthropologie philosophique.
L’anthropologie culturelle s’attache à partir des sciences sociales (sociologie, économie, etc.), à étudier les phénomènes culturels humains, autrement dit, les variations de comportement observables à partir d’une même base génétique. Ainsi, l’anthropologie culturelle, étudiant une même race, peut expliquer des variations de comportement dues au milieu social. Par exemple, une étude d’anthropologie culturelle comparée de la société viking et de la Scandinavie moderne montre, pour une même race, des variations dans l’idéologie, dans l’éthique, le niveau des techniques, qui s’expliquent par l’évolution historique du dressage culturel et non par la biologie (cette race n’ayant pas fondamentalement varié depuis lors) (Secrétariat “Études et Recherches” du GRECE, « L’anthropologie philosophique », in : Études et Recherches n°2 [1ère série], supplément au n°10 d’éléments, 1975).
L’anthropologie biologique étudie l’homme du point de vue de la biologie, c’est-à-dire de la génétique et des lois de l’hérédité en particulier.
L’anthropologie philosophique s’efforce d’étudier l’homme scientifiquement de manière globale, c’est-à-dire en utilisant les ressources de toutes les sciences de l’homme. Elle s’efforce entre autres d’établir la synthèse entre l’apport de l’anthropologie biologique et celui de l’anthropologie culturelle. L’anthropologie philosophique cherche ainsi à définir une conception totale de l’homme à partir de laquelle peut se déduire une conception du monde (art. cit). Parler d’anthropologie philosophique équivaut à parler sans détours d’Arnold Gehlen, l’auteur qui a appliqué le fruit de ses recherches aux problèmes de la société industrielle moderne. Aucun de ses ouvrages n’est, à ce jour, traduit en français.
Qui est Arnold Gehlen ?
Qui est Arnold Gehlen ? Penchons-nous d’abord sur sa biographie. Il est né le 29 janvier 1904 à Leipzig, dans une famille originaire de Westphalie. En 1927, il acquiert le titre de docteur en philosophie. En 1930, il est professeur ordinaire à l’université de Leipzig. En 1938, il est nommé à Königsberg et, en 1940, à Vienne. Mobilisé, il interrompt son enseignement. Grièvement blessé au cours des combats de Silésie en janvier 1945, il échappe à la captivité. En 1947, il reprend ses activités à Spire (Speyer), puis, en 1962, il reçoit une chaire de sociologie à l’école technique supérieure d’Aix-la-Chapelle. On le constate: la carrière d’Arnold Gehlen est essentiellement universitaire.
Il a été un homme de son temps. Il a vécu quatre régimes politiques et sociaux différents : le IIe Reich wilhelminien, la République de Weimar, le IIIe Reich de Hitler et la République de Bonn. Cette succession de pouvoirs différents l’a tout naturellement amené à réfléchir sur l’obsolescence des régimes politiques et des philosophies qui leur servent d’assises intellectuelles. Il a ainsi perçu le ridicule des fantaisies passéistes qui ne sont que fuite devant le réel et refus de relever les défis du monde politique. Mais il a également perçu l’importance capitale de certains fondements inébranlables qu’il appellera les institutions.
En somme, la philosophie d’Arnold Gehlen reste ouverte aux situations nouvelles. Elle est comme l’homme, seul être vivant adaptable à des situations nouvelles, en état de malléabilité, de plasticité permanente. Cela peut paraître compliqué. Mon objectif, ce soir, visera principalement à démontrer pourquoi l’homme est cet être qui peut s’adapter à des situations différentes et qui, en fin de compte, est le créateur de son univers.
Nous allons analyser les différentes étapes de l’œuvre d’Arnold Gehlen, résultat d’une réflexion qui a l’immense mérite de n’avoir négligé aucune discipline. Nous analyserons donc sa démarche au niveau philosophique d’abord ; au niveau biologique, ensuite. En conclusion, nous parlerons des implications de ces investigations rigoureuses.
Les références philosophiques
Replaçons-nous dans le contexte du XVIIIe siècle, à l’aurore du Romantisme. Schopenhauer souligne dans Über den Willen in der Natur [1836, tr. fr. : De la volonté dans la nature, PUF, 1969] l’harmonie qui existe entre la constitution physique des animaux et le milieu dans lequel ils vivent. Schopenhauer admirait l’utilité de chaque organe chez l’animal, la mobilité des fauves à se porter là où ils pouvaient saisir leur proie, s’émerveillait, par exemple, du caractère préhensile de la queue des singes arboricoles. Chaque animal, concluait-il, est l’expression d’une volonté, voire d’une volonté globale qui se manifeste sous différents aspects. L’animal, en conséquence, est parfaitement adapté à son milieu. Il est doté des organes adéquats. Une des grandes questions auxquelles l’œuvre d’Arnold Gehlen s’efforcera de donner une réponse satisfaisante est la suivante : en est-il de même pour l’homme ?
Herder
En 1772, Johann Gottfried Herder, dans un ouvrage intitulé Vom Ursprung der Sprache [tr. fr. : Traité de l’origine du langage, PUF, 1992], distingue pertinemment l’homme de l’animal : l’homme n’a ni les instincts ni les potentialités physiques des animaux. Chaque animal, écrit Herder, vit et meurt dans sa « sphère », nous dirions aujourd’hui dans son “environnement”. Et si les sens d’un animal sont très développés, il aura une sphère d’autant plus réduite. C’est en quelque sorte une proportion inversée : plus la sphère est réduite, dit Herder, plus les capacités de l’animal seront perfectionnées. Ces capacités ont la possibilité de se concentrer sur le milieu réduit, sans être éparpillées sur une surface importante.
Avec la même pertinence, Herder définit l’homme comme un être auquel il “manque” beaucoup d’atouts, comme un être en état de manque (Mängelwesen). L’enfant nouveau-né, dit-il, est le plus démuni des êtres produits par la nature. Il est nu, faible, désarmé, privé de tous les moyens de protection et de défense que la nature offre à d’autres êtres, animaux ou végétaux. En somme, il faut définir l’homme négativement : par ses “manques”, par ses “lacunes organiques”. Pour dire, sans avoir notre vocabulaire scientifique, que l’homme n’a pas d’instincts précis, c’est-à-dire qu’il n’est pas phylogénétiquement programmé et que, par conséquent, il est soumis à un choix, placé devant un choix, Herder disait : « Ses sens, son organisation ne sont pas axés, concentrés sur une seule chose, sur un seul type d’activité. L’homme a des sens pour tout. Ses forces physiques sont répandues à travers le monde. Ses représentations ne vont pas dans une seule direction ». C’était la façon à Herder de rejeter le déterminisme. Car, de surcroît, l’homme n’a pas de milieu, n’a pas de sphère étroite et uniforme, où il n’y a qu’un seul type de travail à accomplir ; il y a un monde d’activités autour de lui et un grand nombre de vocations s’adressent à lui. Herder avait parfaitement pressenti ce que, plus tard, les recherches biologiques allaient confirmer : l’ouverture-au-monde et l’inadéquation biologique.
Pour Herder, le langage, ou plutôt les langages, cherchent à pallier la pauvreté organique et instinctuelle de l’être humain. Les langages produisent entendements et raisons. Ils rendent des facultés possibles. On peut donc dire que l’entendement et la raison ne reposent pas sur l’organisation animale de l’homme mais qu’elles sont une nouvelle direction, une nouvelle voie que la nature offre à l’homme. Depuis ces intuitions de Herder, l’anthropologie philosophique n’a pas fondamentalement progressé. Elle n’a fait qu’approfondir et cerner avec plus de précision « un état de chose, un fait dans l’ensemble des faits que constitue le monde », pour paraphraser Wittgenstein.
Nietzsche
Il nous semble utile, à ce stade-ci de notre exposé, de rappeler le contexte presque trimillénaire de la philosophie européenne : ce contexte, que nous allons schématiser considérablement voire outrancièrement, nous dévoile une opposition entre les philosophies de la volonté, d’une part, et les philosophies de l’esprit, d’autre part. Les premières, pourrait-on dire, sont inégalitaires parce que l’intensité des volontés est chaque fois différente ; les autres sont égalitaires parce que tous partagent indistinctement la même parcelle d’esprit. Ces philosophies s’opposent sur l’objet et sur les méthodes.
• À propos de l’objet :
— Les philosophies de l’esprit (que nous posons ici comme égalitaires) croient en une vérité absolue qu’il est possible d’atteindre en connaissant son essence, son être. Elles visent une ontologie.
— Les philosophies de la volonté (que nous posons ici comme inégalitaires) sont fondées sur l’idée que la vérité absolue n’existe pas. L’homme ne saisit qu’une perspective du monde. Nietzsche dit dans Wille zur Macht (La Volonté de puissance) : « Il n’y a pas de chose en soi, pas de connaissance absolue ; ce caractère perspectiviste et illusoire est inhérent à l’existence » [tr. G. Bianquis]. Ces philosophies de la volonté impliquent donc une connaissance des hommes, de “qui” peut connaître. Elles reposent sur une anthropologie.
• À propos des méthodes :
— Les philosophies de l’esprit partent du point de vue que l’homme dispose d’un esprit d’une raison (par ailleurs égale chez tous) qui permet de connaître “l’essence des choses”, “l’être”, les vérités “évidentes”. La méthode consiste à parler logiquement, à utiliser le verbe (nous renvoyons ici à la critique empiriste logique, à Bertrand Russell, à Ludwig Wittgenstein, à Louis Rougier et à la linguistique de Benjamin Lee Whorf).
— Les philosophies de la volonté considèrent qu’il n’y a d’autres vérités que les vérités d’expérience. Mais il faut avoir la volonté de faire ces expériences. Elles mettent comme le Faust de Goethe l’action au commencement de tout (Am Anfang war die Tat).
• L’opposition vue d’un point de vue historique :
Les philosophies de l’esprit ont Socrate pour initiateur. Thomas d’Aquin, Kant et Descartes ont continué le courant. Hegel lui a apporté la dialectique. Marx appelle “matière” l’“esprit” de Hegel mais ne révolutionne rien : en fait, sous un nom différent, nous avons toujours affaire au même “Être” immuable qui préside le débat et dont il faut connaître l’essence.
L’homme : un animal sans fixité
 Les philosophies de la volonté, parties d’Héraclite (mais avec Ernst Krieck on peut dire que Héraclite est à mi-chemin entre le mythe et le logos) vont être longtemps méconnues. Le Moyen Âge allemand a produit un Maître Eckhart. Avec le romantisme apparaissent Fichte, Herder, Schopenhauer. À la fin du siècle passé et au début de celui-ci, la philosophie de la Vie prend le relais avec Dilthey, Klages, Spengler, Tönnies, Spann. Mais Nietzsche reste celui qui nous a légué l’œuvre la plus considérable. Sa formule « deviens ce que tu es » implique que l’homme n’est pas un fait établi. Il est l’animal sans fixité. Il est à établir. L’homme doit réaliser ses virtualités par l’action. Son éthique doit justifier une discipline organisatrice du chaos instinctif qu’il est par nature. C’est aussi ce que nous enseignent les vieux mythes de l’humanité primordiale qui concevaient des dieux organisateurs du chaos primitif.
Les philosophies de la volonté, parties d’Héraclite (mais avec Ernst Krieck on peut dire que Héraclite est à mi-chemin entre le mythe et le logos) vont être longtemps méconnues. Le Moyen Âge allemand a produit un Maître Eckhart. Avec le romantisme apparaissent Fichte, Herder, Schopenhauer. À la fin du siècle passé et au début de celui-ci, la philosophie de la Vie prend le relais avec Dilthey, Klages, Spengler, Tönnies, Spann. Mais Nietzsche reste celui qui nous a légué l’œuvre la plus considérable. Sa formule « deviens ce que tu es » implique que l’homme n’est pas un fait établi. Il est l’animal sans fixité. Il est à établir. L’homme doit réaliser ses virtualités par l’action. Son éthique doit justifier une discipline organisatrice du chaos instinctif qu’il est par nature. C’est aussi ce que nous enseignent les vieux mythes de l’humanité primordiale qui concevaient des dieux organisateurs du chaos primitif.
Nietzsche a donc décrit l’homme comme « un animal non encore déterminé » (ein nicht festgestelltes Tier). L’homme n’est pas créé une fois pour toutes ; il continue en permanence à se créer lui-même. Il cherche le surhomme (c’est-à-dire le dépassement de sa condition physiquement déficiente), parce qu’« il danse sur une corde entre singe et le surhomme ». Nietzsche résume cet état instable de l’homme avec autant de brièveté que de pertinence : « L’homme n’est pas, il devient ». Pour lui, il faut toujours attribuer la première place au devenir. On ne peut pas régresser. Et nous retrouvons la position qu’Arnold Gehlen a toujours prise devant les transformations politiques successives de son pays. Ce qui devient change mais n’abandonne pas pour autant son identité. Ce qui change reste lui-même mais toujours sous de nouvelles formes. Ainsi, il n’y a pas d’opposition entre “tradition” et “changement”. La continuité de la tradition exige son renouvellement. Une double tâche pour l’homme : s’appuyer sur son héritage et réaliser ses potentialités créatrices. Sans passéisme et sans faux espoirs en des lendemains qui chanteront nécessairement, obligatoirement juste.
Max Scheler
À la base de la démarche d’Arnold Gehlen, il y a également une idée simple, tirée d’un livre que le philosophe juif allemand Max Scheler, s’inscrivant dans la tradition phénoménologique, a publié en 1928 (La situation de l’homme dans le monde). Ce petit volume devait servir d’esquisse à un plus vaste ouvrage que l’auteur, victime d’une attaque d’apoplexie, ne put jamais achever. Le problème de l’homme ne saurait être résolu, aux yeux de Max Scheler, ni par le naturalisme ni par le rationalisme dualiste. Il ne faut pas que la liaison intime de l’homme avec la nature fasse oublier son indépendance vis-à-vis d’elle. Il ne faut pas non plus que l’on exagère cette indépendance et cette supériorité au point d’arracher l’homme « aux bras maternels de la nature ». Le principe transcendant et même, en un sens, opposé aux forces vitales, qui assure à l’homme une situation métaphysique originale, c’est l’esprit (cf. M. Dupuy, préface à la traduction française de la situation de l’homme dans le monde, Aubier-Montaigne, 1951).

Les attributs de l’homme, en tant qu’être spirituel, doivent être « compris comme des perfectionnements ou des affinements des formes psychiques antérieures (instinct, mémoire, intelligence technique) » (cf. M. Dupuy, op. cit.). L’homme a, entre autres, la faculté de s’ouvrir au monde. Ni la théorie “négative” de l’homme, qui se représente l’esprit comme une dérivation d’ordre physico-chimique, ni la théorie “classique”, qui veut que l’esprit possède par lui-même la puissance et l’efficacité, alors qu’il n’a pas d’énergie propre, ne sont satisfaisantes. L’esprit, pour pouvoir se réaliser, doit recourir au dynamisme des formes inférieures de l’être, seules détentrices de puissance, mais auxquelles il apporte discipline et norme. Vie et esprit deviennent principes réciproquement complémentaires (M. Dupuy, op. cit.), malgré la possibilité qu’a l’homme de dire “non” aux phénomènes vitaux, de freiner ses pulsions.
Une anthropologie dérivée de l’action
À partir de cette position, Gehlen posera la question centrale de son anthropologie philosophique, celle de la validité de toute espèce de dualisme. Il en découle une théorie de l’action, qui n’implique pas seulement la différence entre l’homme et l’animal, mais récapitule tous les stades d’évolution que l’on considérait métaphysiquement comme inférieurs (Gehlen rejette la notion d’échelle du vivant présentée chez Scheler) dans une conception de l’homme incluant l’âme et le corps. C’est pourquoi l’anthropologie de Gehlen ne déduit pas la totalité de l’homme de l’esprit, c’est-à-dire d’un “principe” opposé à la vie, mais d’une catégorie médiane : l’action. Scheler, explique Gehlen (dans « Zur Geschichte der Anthropologie », in : Anthropologische Forschungen, Rowohlt, Reinbeck, 1974), n’a fait que déplacer le vieux dualisme, issu de la théologie médiévale et modernisé par Descartes au XVIIe siècle.
Pour mieux illustrer ce résumé, il nous paraît intéressant de laisser la parole à Max Scheler lui-même :
« La réalité la plus puissante qu’il y ait au monde est donc constituée par les centres de force du monde inorganique en tant qu’ils sont les points les plus bas où agit “l’impulsion” fondamentale ; ils sont aveugles à tout ce qui est idée, forme et structure. D’après une conception de plus en plus répandue de notre physique théorique : ces centres ne sont probablement pas soumis, dans leur rapprochement et leur opposition réciproques, à des lois ontiques mais seulement aux lois statistiques du hasard. C’est l’être vivant qui, parce que ses organes et fonctions sensoriels indiquent plutôt dans le monde les régularités que les anomalies, introduit le premier dans l’univers cette “légalité naturelle” que l’entendement y saisit ensuite. Aussi n’est-ce pas la loi qui se trouve ontologiquement parlant derrière le chaos du hasard et de l’arbitraire, mais c’est le chaos qui est situé derrière la loi du mécanisme formel. Si cette idée s’imposait, selon laquelle toutes les lois naturelles de cette sorte n’ont au fond qu’une signification statistique et que tous les phénomènes naturels (même dans la micro-sphère) résultent déjà de l’interaction d’unités dynamiques sans règle, — toute notre représentation de la nature subirait une transformation considérable. Il faudrait alors regarder comme les vraies lois ontiques ce qu’on nomme les lois de la forme, c’est-à-dire les lois qui prescrivent un certain rythme temporel de devenir, et en fonction de ce rythme, certaines formes statiques de l’existence corporelle (…).
Comme, dans le domaine de la vie, tant physiologique que psychique, ne sont assurément valables que des lois du type des lois de la forme (bien que ce ne soient pas nécessairement les seules lois matérielles de la physique), la légalité de la nature serait encore, grâce à cette conception, une légalité rigoureusement unitaire. Il ne serait pas impossible alors d’appliquer la forme de l’idée de sublimation à tout ce qui arrive dans le monde. Il y aurait sublimation en chacun des phénomènes essentiels par lesquels, au cours du devenir universel, des forces d’une sphère inférieure passeraient peu à peu au service d’une forme plus élevée de l’être et de l’évolution : ainsi par ex. les forces qui se déploient entre les électrons au service de la forme de l’atome ; ou les forces qui agissent dans le monde inorganique, au service de la structure de la vie. La formation de l’homme et la spiritualisation devraient alors être considérées comme la dernière en date des sublimations de la nature ; elle se manifesterait à la fois par l’emploi croissant des énergies externes assimilées par l’organisme, dans les processus les plus complexes que nous connaissions, les processus d’excitation de l’écorce cérébrale ; et, dans l’ordre psychique, par le phénomène analogue de la sublimation des tendances, en tant que conversion de l’énergie instinctive en activité “spirituelle” » (La situation de l’homme dans le monde, trad. M. Dupuy, cité in : Max Scheler, Alexandre Métraux, Seghers, 1973).
Le point de départ biologique : une définition de la néoténie
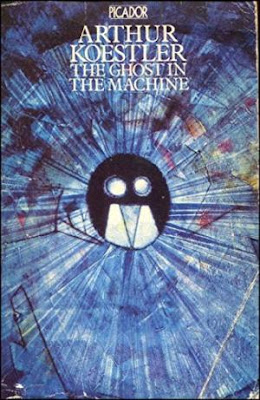
À propos de la néoténie, que dit le dictionnaire ? Que la néoténie est la persistance de la forme larvaire ou d’un autre stade antérieur de développement. Cette persistance peut ou bien être temporaire (à cause de l’influence du climat par ex.) ou bien rester permanente (dans ce cas, l’animal se reproduit à un stade juvénile de développement, exemple : l’axolotl parmi les batraciens). Une définition tirée d’un dictionnaire ne nous apparaît toutefois pas suffisante. C’est pourquoi, nous nous sommes inspirés de deux livres fondamentaux d’Arthur Koestler : The Ghost in the Machine (littéralement Fantôme dans la machine, tr. fr. : Le cheval dans la locomotive) et Janus : A Summing Up (tr. fr. : Janus). Si l’animal se reproduit à un stade juvénile de développement, cela signifie automatiquement que l’âge de la maturité sexuelle se trouve abaissée. Ce phénomène a deux aspects : d’abord, l’animal commence déjà à se reproduire à l’état larvaire ou au moins avant l’âge adulte ; ensuite, l’animal n’atteint jamais le stade adulte, qui est ainsi éliminé du cycle de la vie.
En conclusion, les stades “juvéniles” propres aux ancêtres deviennent définitifs chez leurs descendants. On assiste donc à un processus de “juvénilisation” et de dé-spécialisation, c’est-à-dire un processus qui permet à un être vivant de s’échapper d’une impasse dans l’évolution. Clarifions donc ce que Koestler appelle une impasse (en anglais : blind alley). Il commence par nous expliquer que la cause principale qui entraîne la stagnation, avant de provoquer l’extinction, est la sur-spécialisation. Il nous en donne un exemple, celui d’un animal tout-à-fait charmant, le koala d’Australie, qui se nourrit exclusivement de feuilles d’eucalyptus ; qui plus est, d’un certain type d’eucalyptus ! Cet animal possède des griffes en forme de crochets pour pouvoir grimper aux arbres. Il est absolument déterminé dans sa spécialisation. Koestler ajoute non sans humour que le koala à un équivalent humain, dépourvu toutefois de charme : le pédant, esclave de ses habitudes mentales. Et, ironise Koestler, nos universités regorgent de spécimens de ce genre, qui s’appliquent à fabriquer des “koalas”.
Les impasses de l’évolution
Sir Julian Huxley, un des plus éminents biologistes anglais, résume brièvement l’évolution comme suit : « À partir d’un type biologique général, plusieurs lignées se forment qui exploiteront l’environnement de diverses façons. Quelques-unes parmi ces lignées atteignent relativement rapidement leurs limites. Tout au moins en ce qui concerne les modifications importantes. Elles se contenteront dorénavant de former de nouveaux genres et de nouvelles espèces (ex. : du loup au chien et du chien primitif aux différentes races de chiens). D’autres lignées peuvent poursuivre leur “carrière”, générer de nouveaux types grâce à leur contrôle plus perfectionné de l’environnement et leur plus grande indépendance à son égard. Ces nouveaux types forment à leur tour un nombre de lignées qui se spécialiseront dans une direction particulière. La plupart de ces lignées aboutissent dans une impasse, ne progressent plus : leur spécialisation n’est qu’un progrès unilatéral, il finit par atteindre sa limite biomécanique… C’est alors l’extinction ou la stagnation. Un exemple de stagnation est l’embranchement des échinodermes (étoiles de mer, oursins). Généralement, une ou deux lignées subit ce sort, les autres poursuivent la différenciation. Les reptiles sont tous des blind alleys [des impasses, des sentiers qui ne mènent nulle part, ndt] sauf ceux qui ont permis l’éclosion des oiseaux et des mammifères. Tous les oiseaux sont des blind alleys. Et tous les mammifères. Sauf un : l’homme » (cité par A. Koestler, The Ghost in the Machine, Pan/Picador, London, 1970-75).
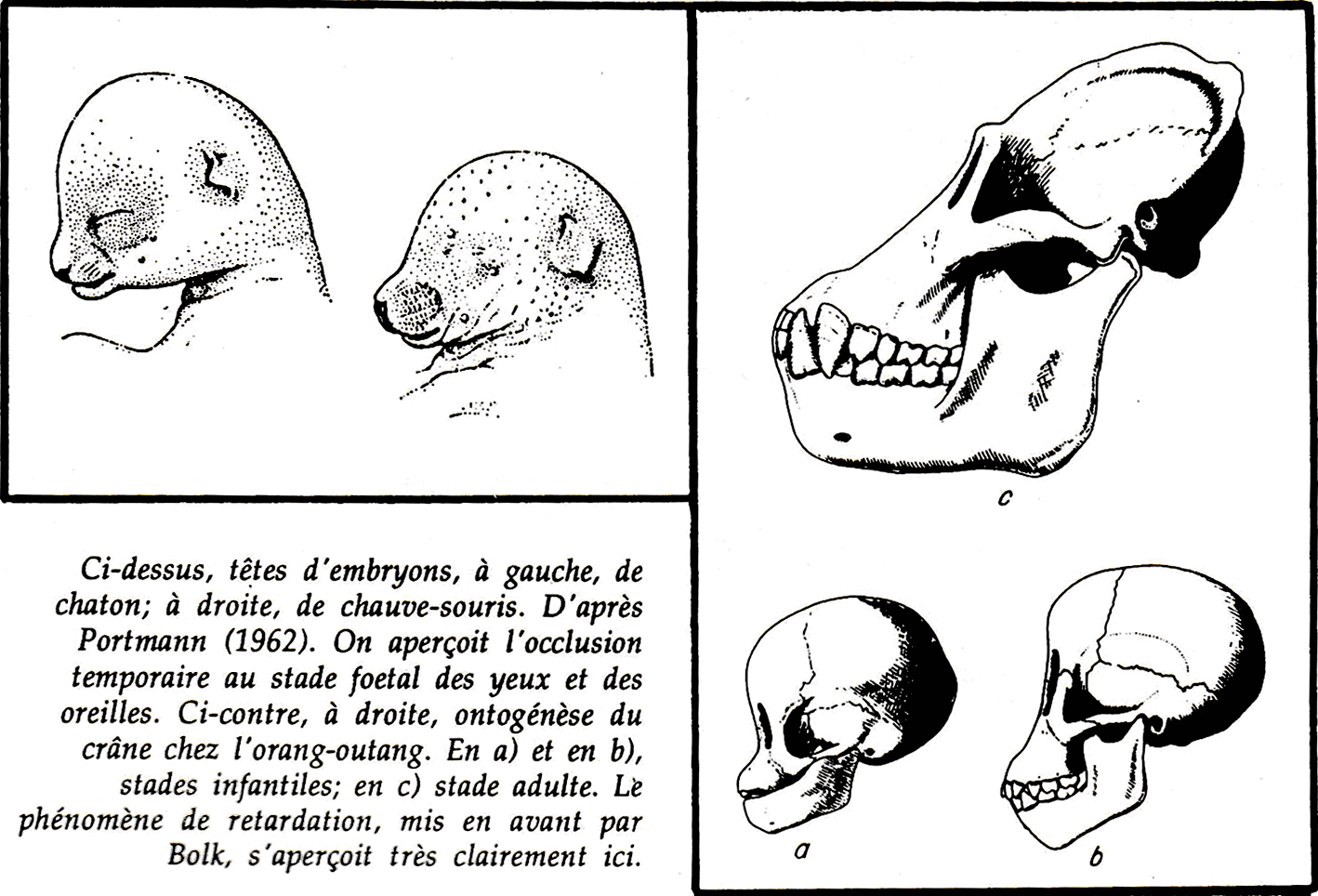 [Ci-contre : têtes d’embryons, à gauche, de chaton ; à droite, de chauve-souris. D’après Portmann (1962). On aperçoit l’occlusion temporaire au stade fœtal des yeux et des oreilles. Ci-contre, à droite, ontogenèse du crâne chez l’orang-outang. En a) et en b), stades infantiles ; en c) stade adulte. Le phénomène de retardation, mis en avant par Bolk, s’aperçoit très clairement ici]
[Ci-contre : têtes d’embryons, à gauche, de chaton ; à droite, de chauve-souris. D’après Portmann (1962). On aperçoit l’occlusion temporaire au stade fœtal des yeux et des oreilles. Ci-contre, à droite, ontogenèse du crâne chez l’orang-outang. En a) et en b), stades infantiles ; en c) stade adulte. Le phénomène de retardation, mis en avant par Bolk, s’aperçoit très clairement ici]
Effectivement, on peut constater que les insectes dérivent tous d’un ancêtre commun qui était une espèce de mie, de mille-pattes. Ils ne dérivent pas du stade adulte de ce dernier mais bien du stade larvaire, moins spécialisé. Les batraciens ou amphibiens représentent aujourd’hui encore de façon saisissante le processus. Ils naissent poissons, respirent avec des branchies mais acquièrent ultérieurement une respiration pulmonaire. Nous savons depuis les recherches du biologiste hollandais Louis Bolk que l’adulte humain “ressemble” plus à l’embryon d’un singe qu’au singe adulte. Tant chez l’embryon de l’anthropomorphe que chez l’adulte humain, le poids du cerveau par rapport au poids total est disproportionné. Dans les deux cas, au stade de l’embryon chez le singe et au stade du bébé chez l’homme les os du crâne ne se soudent pas, pour permettre au cerveau de croître. Nous verrons dans la suite de cet exposé, quand nous aborderons plus spécialement les théories de Bolk, que l’homme possède encore beaucoup de caractéristiques fœtales, embryonnaires. Le “chaînon manquant” entre l’homme et le singe, ajoute Koestler, ne sera peut-être jamais découvert, parce qu’il était tout simplement un… embryon.
Le recul pour mieux sauter
 [Ci-contre : Schéma présenté par Koestler dans Le Cheval dans la locomotive : l’évolution, perçue non comme linéaire mais comme zig-zaguante, avec des “reculs pour mieux sauter”]
[Ci-contre : Schéma présenté par Koestler dans Le Cheval dans la locomotive : l’évolution, perçue non comme linéaire mais comme zig-zaguante, avec des “reculs pour mieux sauter”]
La néoténie (ou pédomorphose ou encore juvénilisation) semble jouer un rôle capital dans la stratégie de l’évolution. Le néoténie implique un retrait par rapport aux formes adultes trop spécialisées, moins malléables. Les stades antérieurs de l’évolution ontogénétique permettent une réorientation, un changement de cap. Le fleuve de la vie remonte en amont. C’est, dit Arthur Koestler, un recul pour mieux sauter. Ce “modèle stratégique” se retrouve dans les sciences et dans les arts. L’évolution biologique est l’histoire des sorties hors des impasses de la sur-spécialisation, tout comme l’évolution des idées est le produit du refus des habitudes mentales et des routines sclérosées. L’émergence de nouvelles formes dans l’évolution et la création d’innovations culturelles partagent le même modèle : celui du faire et défaire (undoing-redoing). On constate donc par analogie, que ni l’évolution biologique ni le progrès culturel ne suivent une ligne continue ; ni ne sont strictement cumulatifs. Les deux types de progrès suivent le tracé d’un zig-zag. Ainsi, dit Koestler, la science ne progresse qu’aux époques immédiatement postérieures aux changements de paradigme. Autrement, la science entre dans une période de “consolidation” où règne une rigidité propre à toutes les orthodoxies. C’est l’impasse de la sur-spécialisation, analogue à la position du koala dans le règne animal.
Spengler : féconde barbarie
Mais précisons. La nouvelle structure théorique émergente n’est pas tout simplement ajoutée au vieil édifice ; son point de départ est là où l’évolution des idées a adopté une fausse piste. Comme en littérature et dans les arts, le tracé en zig-zag de l’évolution est bien en évidence ; quand une école succombe à la décadence du maniérisme, la crise se résoudra inévitablement par le fameux “recul pour mieux sauter”, amorce d’une révolution dans la sensibilité et dans le style. C’est ainsi qu’il faut comprendre le mot de Spengler, qui a tant heurté les âmes sensibles du vieux monde, tout occupées à cultiver leurs pénibles mièvreries : « Les temps sont venus où il n’y aura plus de place pour les âmes molles et les idéaux faibles. Elle se réveille, l’antique barbarie cachée et neutralisée pendant des siècles derrière la rigidité des formes d’une haute culture. Mais cette culture a achevé son cycle. Et la civilisation a commencé. La barbarie veut vivre une joie saine de guerrier, elle méprise la pensée rationaliste d’un siècle saturé de littérature. L’instinct dompté veut se débarrasser de la pression qu’exercent sur lui les idéaux livresques. Il nous faut un pessimisme de la bravoure!».
Koestler, pour illustrer son propos, nous parle de la différence entre pédomorphose — ce que nous venons d’expliquer — et gérontomorphose. La pédomorphose, avons-nous dit, permet une certaine plasticité. La gérontomorphose, c’est la modification de structures pleinement adultes et déjà hautement spécialisées. La gérontomorphose ne peut donc conduire à des changements radicaux et à de nouveaux départs. C’est ce qu’Arnold Gehlen appellera die Statik des unbewegt bewegten der modernen Kultur (le statisme du mouvant immobile de la culture moderne) ou encore die fortschrittlose Ruhelosigkeit des Betriebs (L’activité sans repos qui n’amorce aucun progrès). Au fond, le monde de la Zivilisation, au sens spenglérien du terme, ne tolère que des modifications fort superficielles parce qu’il craint et refuse le risque. Aux défis (les challenges décrits par Toynbee), il est incapable d’apporter des réponses (responses chez Toynbee) satisfaisantes, parce qu’il s’obstine à parier sur les idéologies dominantes.
Néoténie et régénération
Mais revenons à la néoténie strictement biologique. Nous devons également mentionner le phénomène de “régénération”, souvent confondu avec celui de reproduction. Quand on parle de régénération, il faut parler du phénomène qu’on constate chez les êtres les plus élémentaires. Lorsque l’on sectionne un ver ou une hydre, il se crée autant de nouveaux êtres qu’il y a de morceaux. Plus haut dans l’échelle de l’évolution, les batraciens sont encore capables de “régénérer” un membre ou un organe perdu. Ce mode d’auto-réparation s’accomplit au niveau ontogénétique. En revanche, l’auto-réparation phylogénétique est une série d’adaptation qui remodèle les structures mal adaptées en remontant l’échelle. La capacité de régénérer des parties du corps décroît au profit d’un accroissement de la puissance du cerveau et du système nerveux à réorganiser les comportements. Voilà qui détruit la conception réductionniste du système nerveux qui veut que celui-ci soit un automate condamné à répéter rigidement les mêmes réflexes. Finalement, la capacité de notre espèce à régénérer des parties du corps est réduite au minimum. Elle est remplacée par le pouvoir de remodeler les structures de pensée et de comportement En somme, de répondre aux défis critiques par des réponses créatives.
Le XIXe siècle avait une vue-du-monde mécaniciste, basée sur la fameuse doctrine de Clausius à propos de la “seconde loi de la thermodynamique”. C’était très pessimiste. Cette loi prétendait que l’univers allait vers sa dissolution finale car l’énergie se dissipait constamment, inexorablement, pour terminer en une unique et amorphe bulle de gaz de température uniforme. Le cosmos, dans cette optique, était condamné à être dissous dans le chaos. Mais il a bien fallu constater que cette seconde loi de la thermodynamique ne s’appliquait qu’aux systèmes appelés “fermés” (par ex. un gaz enfermé dans un conteneur parfaitement hermétique). Les organismes vivants sont des systèmes ouverts qui se maintiennent en tirant constamment des matériaux et de l’énergie de leur milieu. Les systèmes vivants absorbent de l’énergie pour en recréer. L’input est inférieur à l’output. Ainsi, ces organismes sont avant tout actifs, et non pas seulement réactifs. Il y a création continuelle de nouvelles structures. Cette conception des choses se heurte naturellement au Zeitgeist, à l’esprit de notre temps. Tous les réductionnistes, enfermés dans l’étroit secteur du réel qu’ils privilégient arbitrairement, ne savent apprécier la valeur des multiples produits d’une infinie différenciation. Les phénomènes de la vie ne se réduisent pas aux lois de la physique mécaniciste.
La logique de Lupasco
Cependant, il y a moyen de saisir la réalité physique-à partir d’une logique nouvelle. À la logique aristotélo-scolastique traditionnelle, Stéphane Lupasco a proposé une logique de l’antagonisme, de l’hétérogénéité. En clair, c’est faire la distinction entre un système vital caractérisé par une hétérogénéité sans cesse dominante (nous l’avons vu) et un système inanimé, caractérisé par une homogénéité sans cesse dominante. L’univers est un lieu où s’affrontent les antagonismes ; l’homogénéité affaiblit les antagonismes ; elle est une sorte de principe de mort, préludant l’extinction et la disparition définitive. Cela vaut pour les espèces vivantes et pouf les cultures, dont Spengler disait qu’elles étaient des organismes. L’hétérogénéité est la vie, productrice infatigable de différenciations.
L’apport d’Adolf Portmann
 [Ci-contre : Adolf Portmann, le biologiste suisse qui n’a jamais cessé de s’interroger sur le mystère du vivant. Son influence sur Arnold Gehlen a été capitale. En effet, il a été l’un des premiers à avancer la théorie qui veut que le milieu culturel est comme un second utérus pour le bébé et le jeune enfant humain. De là, Gehlen déduit que notre culture est en fait notre nature. Et que sans un “dressage” approprié et minutieux dans la jeune enfance, les civilisations ne tiennent pas. Quand le dressage est négligé ou ébranlé, les civilisations s’effondrent, perdent leur tonus]
[Ci-contre : Adolf Portmann, le biologiste suisse qui n’a jamais cessé de s’interroger sur le mystère du vivant. Son influence sur Arnold Gehlen a été capitale. En effet, il a été l’un des premiers à avancer la théorie qui veut que le milieu culturel est comme un second utérus pour le bébé et le jeune enfant humain. De là, Gehlen déduit que notre culture est en fait notre nature. Et que sans un “dressage” approprié et minutieux dans la jeune enfance, les civilisations ne tiennent pas. Quand le dressage est négligé ou ébranlé, les civilisations s’effondrent, perdent leur tonus]
Il serait trop long de parler ici de la fascinante personnalité d’Adolf Portmann et de toutes les facettes de son œuvre. Je me bornerai à parler de sa théorie la plus connue : celle de l’année extra-utérine de l’homme. Pour comprendre ce que Portmann veut dire par là, nous devons préalablement classer les mammifères en trois catégories :
- 1) casaniers du nid (mammifères inférieurs)
- 2) évadés secondaires du nid (chevaux, bovidés, …)
- 3) casaniers secondaires du nid (l’homme).
Cette théorie nous dévoile que le bébé est encore un embryon après sa naissance, que la première année de la vie de l’homme est une année embryonnaire. L’homme possède à la naissance un cerveau dont le poids est trois fois supérieur à celui des singes anthropomorphes. Mais la station verticale, qui lui est spécifique, il ne l’acquiert qu’après un an, presque en même temps que le langage. Ainsi, pour que l’homme ait le même stade que.les autres mammifères à leur naissance, la grossesse devrait durer 21 mois. Cette période de plus ou moins douze mois est d’une importance capitale pour notre espèce ; il se crée autour du bébé une espèce d’utérus social, où il apprend le langage et la communication. Le bébé apprend donc une foule de choses de l’extérieur. C’est la raison pour laquelle on parle de dressage (Dressur), c’est-à-dire d’acquisition de normes culturelles.
C’est à partir de ce point de vue qu’Arnold Gehlen a pu affirmer que la nature de l’homme, c’est la culture. La culture, c’est notre “seconde nature”, basée sur un système instinctuel incomplet. Bien sûr, l’hérédité joue un rôle très important, mais par comparaison aux animaux, le donné héréditaire est largement “ouvert”. Ce donné détermine l’ampleur, la direction et l’intensité des actes posés par le sujet. L’hérédité ne détermine pas le contenu, la forme concrète des réalisations culturelles. Le langage constitue un exemple assez frappant : au début, toutes les potentialités sont présentes, c’est-à-dire que les balbutiements du bébé peuvent engendrer n’importe quelle langue, avec son système phonétique particulier. Par l’influence du milieu culturel, il s’opère une sélection phonétique et une syntaxe s’impose. Désormais, l’acquisition de sons étrangers se fera avec difficulté. Qu’on songe aux [θ] et [ð] anglais et à certaines voyelles anglaises, telles [ʌ], [ɔ̹], [ae] que les Français sont incapables de prononcer spontanément de manière correcte. Notre [r] est plus proche du [ʁ] anglais ; les Français le prononcent sur un timbre plus aigu. Le [ʌ] se retrouve dans les dialectes ouest-flamands et le [ɔ̹] est courant en Brabant, alors que les Français privilégient le [o] long et ouvert, qui n’est pas toujours spontané chez nous.
L’homme, nous enseigne Portmann, est une étape de la vie qualitativement nouvelle. Il a une position particulière, mais reste inclus dans la « symphonie cosmique » des manifestations du vivant. Il prend part au secret du vivant ; c’est pourquoi l’œuvre de Portmann inaugure une recherche biologique de type post-cartésien, qui tend à dépasser la séculaire opposition que les métaphysiciens scolastiques posaient entre l’âme et le corps. J’ai dit, il y a quelques instants, que les organismes ne sont pas seulement réactifs mais surtout actifs. Ce qui est décidément neuf dans la théorie de Portmann, c’est l’acceptation du fait que tous les êtres vivants participent au monde en tant que sujets qui ont une relation avec le monde qui les entoure. Ils ne sont plus conçus comme posés dans le monde. On constate qu’ils réagissent activement aux influences du milieu.
La théorie de Bolk

Toutes les recherches biologiques et anatomiques que nous avons mentionnées mettent l’accent sur les caractères non spécialisés de l’organisme humain. Mais ce n’est pas tout. Ces recherches ont également démontré l’impossibilité d’attribuer une ascendance simiesque à ces caractéristiques. C’est au contraire les primitivismes, les archaïsmes de notre organisme humain qui permettent de déduire notre position assez particulière dans le monde vivant. Louis Bolk, biologiste natif d’Amsterdam, soulignait la proximité biologique des anthropoïdes et des humains. Il concluait même que ces derniers descendaient d’ancêtres singes. Mais là où ses théories deviennent plus intéressantes, pour la démarche ultérieure d’Arnold Gehlen, c’est quand il tente d’apporter une réponse à deux questions : 1) Qu’est-ce qui est essentiel à l’organisme humain ? 2) Quel est l’essentiel chez l’homme en tant que forme ? En résumé, Bolk répond : ce n’est pas parce que les corps se sont dressés que l’homme est devenu ce qu’il est, mais c’est parce que la forme s’est humanisée que le corps s’est redressé. Bolk énumère toute une série de caractéristiques anatomiques humaines qui prouvent le caractère “embryonnaire” de notre espèce. Par exemple, l’orthognathie, l’absence de poils, la configuration du pavillon de l’oreille, la persistance des “coutures” là où se joignent les os du crâne, etc.

Des traits fœtaux devenus permanents
[Ci-contre : Évolution vers la forme crânienne hominienne, au cours de la période tertiaire. D’après A. Naef. De gauche à droite : lémurien, anthropoïde, pré-hominien. L’anatomiste russe Bustrov compare le crâne volumineux du bébé à celui de l’homme adulte actuel. Progressiste, Bustrov estime que l’humanité future disposera d’un cerveau proportionnellement égal à celui du bébé]
Toutes ces particularités de l’anatomie humaine sont des traits fœtaux devenus permanents. Pour être plus précis, disons que ces traits qui sont passagers chez les primates, parce que propre à leurs embryons, sont devenus stables chez l’homme. Bolk en conclut que les traits spécifiquement humains ne sont pas de nouvelles acquisitions, mais des stabilisations de stades passagers communs à tous les primates. Mais, et c’est là que Bolk est original, il faut parler de freinage dans l’évolution de notre espèce. Ce freinage, qui provoque la conservation de traits propres au fœtus, ne doit pas être extérieur mais intérieur. L’homme est un être retardé, ce que prouve notamment le temps anormalement long, nécessaire à l’accomplissement total de sa croissance. On doit parler d’une phase prolongée de l’enfance, ce qui n’est pas animal.
| Exemples : |
Poids à la naissance |
Ce poids X2 après |
| Porc |
02 kg |
14 jours |
| Bœuf |
40 kg |
47 jours |
| Cheval |
45 kg |
60 jours |
| Homme |
3,5 kg |
180 jours |
Les hommes “préhistoriques”, différents de l’homo sapiens ont dû avoir une croissance plus rapide. En effet, les squelettes d’enfants, découverts sur les champs de fouille, montrent qu’ils perdaient leurs dents de lait comme les perdent les primates anthropomorphes. Ce serait ainsi que se serait formé le menton que n’ont pas les primates.
La retardation ne peut être due qu’à une action du système endocrinien. Celui-ci permet justement l’accélération ou la retardation du développement de membres ou d’organes. Si ce système endocrinien est, d’une façon ou d’une autre défectueux, on assiste à un développement qui va au-delà du stade où l’homme est resté stabilisé. Ainsi, le système pileux se développe, les os du crâne se soudent trop tôt ; les caractéristiques pithécoïdes sont toujours latentes et si le freinage rate, elles réapparaissent.
J’ai déjà mentionné les dents de lait dont parle Bolk. Sa théorie est encore plus pertinente quand on aborde l’étude de la puberté. À quatre ans, les ovaires de la fillette sont déjà mûres, avant que l’organisme ne soit somatiquement apte à la grossesse. Vers cinq ans, commence une période de repos. Et, si à l’âge de onze ans ou de douze ans, le sujet est capable de se reproduire, il faut admettre qu’il reste une contradiction biologique parce qu’il faudra encore attendre quatre à six ans avant que le corps ne soit entièrement arrivé à maturité. Il y a donc une accélération de la croissance (de 11 à 12 ans), en même temps qu’une seconde retardation (de 12 à 16 ou 18 ans).
L’essentiel chez l’homme, dit Bolk, est qu’il est le résultat d’une fœtalisation, que la marche de son existence est la conséquence de ce qu’il faut appeler la retardation. La fœtalisation de la forme est la nécessaire conséquence de la retardation de la forme dans son devenir.
L’impact des théories de Bolk
En bref, on peut dire que l’homme garde permanentes des situations juvéniles. Ainsi, l’hypothèse de Bolk, permet :
- 1) de déduire de la retardation toutes les non-spécialités spécifiques de l’homme
- 2) de déduire de la nécessaire longue durée de l’enfance, un cadre familial durable
- 3) de rejeter les vieilles conceptions que l’on se faisait de l’homme primitif, conceptions qui veulent que celui-ci soit littéralement descendu du singe. L’hominisation provient du système endocrinien
- 4) d’aborder le problème des races sous une lumière nouvelle. Avant Bolk, de nombreux auteurs avaient déjà parlé de différences issues de l’équilibre hormonal. Les races mongoloïdes ont, pour Bolk, des traits plus fœtaux que les autres races. Les Europoïdes ont certains de ces traits dans leur embryon. Les Négroïdes, écrit Bolk, se développent plus vite mais vieillissent également plus vite. Bolk poursuit son raisonnement en constatant que l’embryon négroïde présente des traits europoïdes que les adultes ont dépassés.
Arnold Gehlen, après avoir passé en revue les hypothèses de Bolk, nous signale leur importance pour l’anthropologie. Elles confirment la non spécialité et la non adéquation de l’homme à un milieu naturel bien défini. En somme, sa caractéristique majeure est d’être plein de “manques”. Ainsi se pose impérativement la question de savoir si un tel être est viable ? On répondra, avec Arnold Gehlen, que l’action nous éclaire sur la fonction biologique de la conscience. Il évacue les faux problèmes du dualisme véhiculé par la métaphysique aristotélo-thomiste, pour se pencher sur le fondement de l’hominisation, donc de la culture, qui se trouve au cœur des phénomènes.
L’œuvre d’Otto Storch
Le zoologue Otto Storch (1886–1951) a souligné la rigidité de la motricité héréditaire des animaux. Storch veut parler du nombre peu variable de mouvements que peuvent exécuter les animaux et aussi leur faible capacité d’apprendre de nouvelles combinaisons de mouvements. L’homme au contraire a une motricité acquise, malléable et variable à un degré très élevé. On ne découvre que peu de mouvements instinctuels et quand on en découvre, c’est chez les enfants en bas âge. Storch oppose donc une motricité héréditaire, peu différenciée et propre au règne animal, à une motricité acquise, très variable et propre à l’homme. La caractéristique principale que l’on constate chez l’homme, c’est le nombre réduit d’actes génétiquement déterminés et le nombre élevé d’actes acquis. Cela correspond à la disposition constitutionnelle de l’homme à l’action, c’est-à-dire à la transformation intelligente de situations imprévues qu’il rencontre dans le monde. Gehlen conclut donc qu’une réaction seulement instinctive constituerait une fuite.
Conclusions : l’homme et les institutions
Rappelons-nous que Max Scheler avait réintroduit, à partir de son intuition intéressante et malgré elle, le schéma dualiste des philosophies médiévale et cartésienne. Mais, comme dans le schéma que Koestler nous livre dans son ouvrage (cf. supra), il faut partir du moment immédiatement antérieur à la rechute schélérienne dans le dualisme. Appliquons la stratégie du “recul pour mieux sauter” et renonçons aux thèmes devenus stériles. Ce n’est pas sur l’esprit figé dans on ne sait quelle empyrée qu’il faut raisonner mais sur le comportement “intelligent”, c’est-à-dire transformateur de l’homme. L’homme ne pourrait survivre dans la nature. Son activité intelligente le porte d’abord à des transformations constructives du monde extérieur : c’est ainsi qu’il se procure et se fabrique des armes, des vêtements, qu’il n’a pas organiquement puisqu’il n’a ni griffes ni canines acérées ni toison chaude.
En poussant ses investigations plus loin, Arnold Gehlen a pu tirer des conclusions métapolitiques du plus haut intérêt. Il s’agit de :
- la fonction de décharge des institutions
- le dépassement du subjectivisme
- l’analogie institution/idée.
Les thèmes les plus importants de l’anthropologie sont ceux qu’aborde l’étude du droit, des mœurs, de la famille et de l’État. En bref, ce que Hegel appelait l’esprit objectif. Herder, Nietzsche et les biologistes dont j’ai parlés ont mis l’accent sur la pauvreté des instincts humains, sur la malléabilité du comportement de l’homme. Pour pallier cette pauvreté, l’homme a les institutions. Il se donne une définition courte mais riche.en enseignements des rapports qui existent entre la pauvreté instinctuelle et l’émergence des institutions : « Les instincts ne déterminent pas, chez l’homme comme chez l’animal, des modèles de comportement bien fixés. C’est pourquoi chaque culture choisit dans la pluralité des modes possibles de comportement qui s’offre à l’homme des variantes bien précises. Elles les érigent au rang de modèles, sanctionnés par la société et valables pour tous ses membres. Ainsi, l’individu se voit déchargé de la nécessité de faire trop de choix (c’est-à-dire d’être désorienté face aux multiples choix possibles). Ces institutions agissent en quelque sorte comme des poteaux indicateurs qui désignent à l’homme, submergé par les stimuli du monde sur lequel il s’ouvre, le chemin à suivre. Elles ont un effet indubitablement stabilisateur. Elles créent la “bienfaisante certitude” parce que l’individu se sait organiquement inclus dans un cadre professionnel, familial, national. C’est ainsi que se créent les mentalités » (Ilse Schwidetzky).

Arnold Gehlen va plus loin. Il dit que, grâce à la fonction de décharge des institutions, la personnalité peut se construire. La personnalité n’est pas l’affirmation protestataire du moi mais l’utilisation des énergies économisées grâce au rôle stabilisateur des institutions, une utilisation créatrice de formes originales. On peut poser la question de savoir ce qui se passe quand les institutions d’un peuple s’effondrent à cause d’une guerre, de catastrophes, de révolutions. Les populations concernées entrent alors dans un monde d’insécurité profonde. L’art et la littérature sont les miroirs de ces états de choses. Kafka, par exemple, nous décrit un monde où les points d’équilibre n’existent plus, où un grand nombre de “centres” entament une sarabande infernale autour du sujet bouleversé par ce qui arrive. Dans de telles périodes, même la philosophie évacue la “raisonnabilité” qui lui était propre. Le désorientement des peuples est tel, dit Arnold Gehlen, qu’il faudrait peut-être écouter Samuel Beckett et comprendre qu’il n’y a plus rien à dire, qu’il faut se taire, ou énoncer des discours purement phatiques.
Le débridement du subjectivisme par l’effondrement des institutions
Si les institutions s’effondrent, Je subjectivisme ne connaît plus de bornes. Les individus ne prennent plus en considération que leurs “problèmes”, leurs “convictions” et leurs “idées” personnelles. Ils vivent leurs sentiments immédiatement en croyant qu’ils ont une importance supra-personnelle. Les idées ont besoin d’organisations pour se traduire dans les faits. Les idées ne se meuvent pas par elles-mêmes, comme Hegel le voulait. Prenons l’exemple du socialisme, qui a voulu réagir, à juste titre, contre le déracinement et l’effondrement social dû aux révolutions française et industrielle. Proudhon, Fourier, malgré la pertinence de leurs vues, n’ont jamais pu les réaliser dans le concret. Parce qu’ils n’avaient pas, comme le marxisme allemand, une discipline d’organisation. Les idées doivent pouvoir mobiliser des hommes pour s’insinuer, se capillariser dans la société.
► Robert Steuckers, Orientations n°13, 1991.
 I have been reflecting of late on the concept of truth, both as a philosophical concept and as a value. Growing up, I always took the notion of truth completely for granted. “Tell the truth,” I was taught from an early age. “Don’t lie – not to your parents, your elders, and above all not to God.” Truth and falsehood was a primary duality, like light and darkness, good and evil.
I have been reflecting of late on the concept of truth, both as a philosophical concept and as a value. Growing up, I always took the notion of truth completely for granted. “Tell the truth,” I was taught from an early age. “Don’t lie – not to your parents, your elders, and above all not to God.” Truth and falsehood was a primary duality, like light and darkness, good and evil. Günther, in the same book, also notes that honor and honesty may share a common root, if not etymologically, then at least morally, for it is difficult to imagine an honorable man being fundamentally dishonest. The virtue of honesty is a corollary of the value of truth, and the history of Indo-European moral and ethical philosophy demonstrates a tradition of high regard for this virtue.
Günther, in the same book, also notes that honor and honesty may share a common root, if not etymologically, then at least morally, for it is difficult to imagine an honorable man being fundamentally dishonest. The virtue of honesty is a corollary of the value of truth, and the history of Indo-European moral and ethical philosophy demonstrates a tradition of high regard for this virtue.








 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg




 Les philosophies de la volonté, parties d’Héraclite (mais avec
Les philosophies de la volonté, parties d’Héraclite (mais avec 
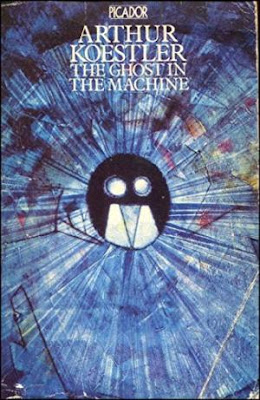
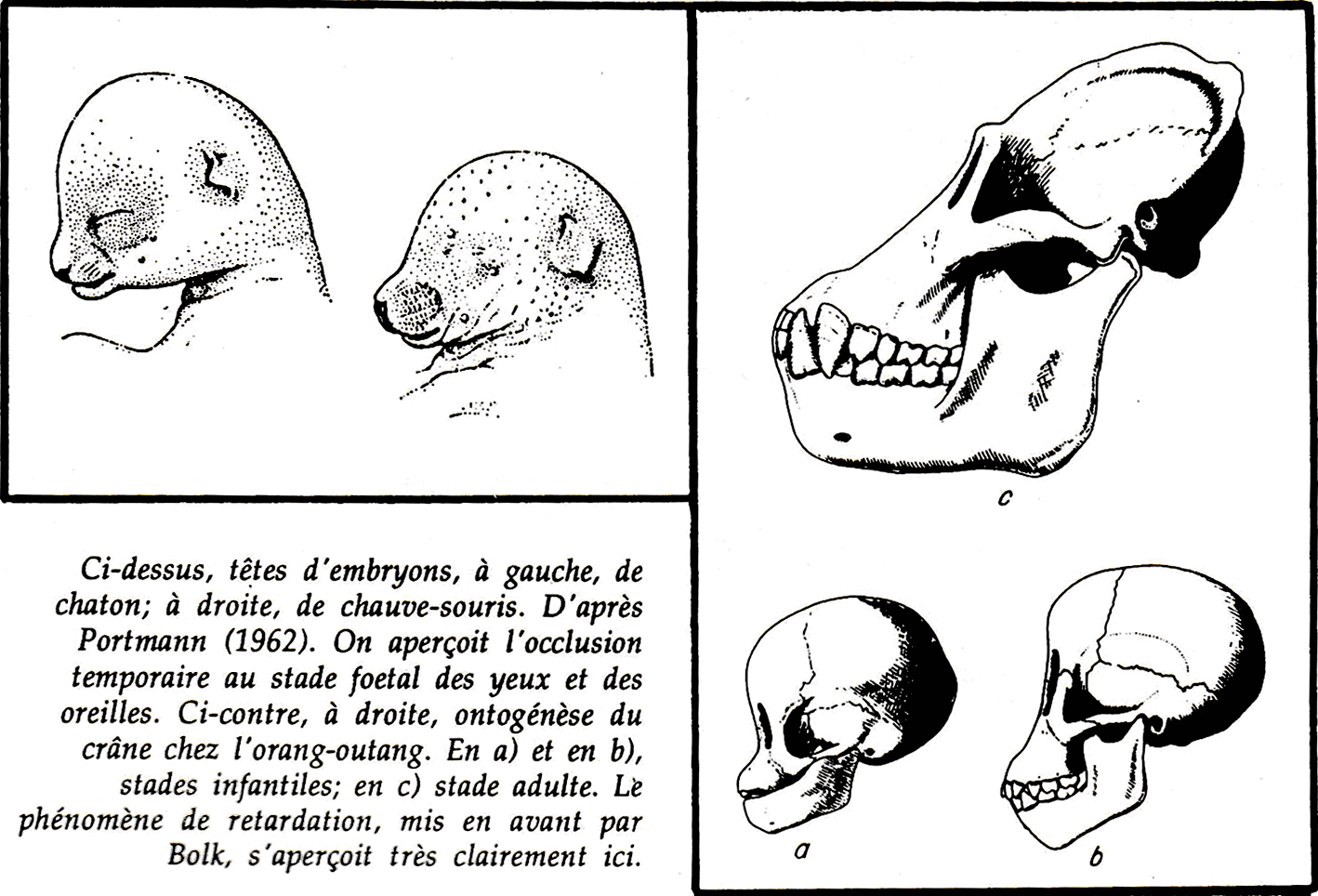






 Quando – si era nel 1921 – Malaparte scrisse il dirompente libro “Viva Caporetto!”, poi intitolato “La rivolta dei santi maledetti”, che rileggeva dalle fondamenta la fenomenologia di quella drammatica sconfitta, fece un’operazione di vera rottura ideologica, spingendo la provocazione ben oltre gli steccati della polemica antiborghese, osando toccare il nervo sensibile del superficiale orgoglio nazionale allora egemone in Italia: della rovinosa rotta dell’ottobre 1917 (che il generale Cadorna e molti osservatori attribuirono a un insieme di renitenza e insubordinazione di masse di fanti che in realtà erano abbrutiti dall’inumana vita di trincea) egli fece il simbolo di una rivolta politica in piena regola. Una volta vista non dall’ottica degli alti comandi e dei “bravi cittadini”, ma da quella del fantaccino analfabeta, quella sconfitta, che era un tabù rimosso dall’ipocrita mentalità borghese, diventava un atto politico e la massa dei disfattisti assurgeva a sua volta al rango di soggetto politico. Dando vita, come ha scritto Mario Isnenghi, a qualcosa di inedito e di potenzialmente incendiario, cioè “una interpretazione rivoluzionaria della prima guerra mondiale, della storia delle masse e della psicologia collettiva dentro la guerra”.
Quando – si era nel 1921 – Malaparte scrisse il dirompente libro “Viva Caporetto!”, poi intitolato “La rivolta dei santi maledetti”, che rileggeva dalle fondamenta la fenomenologia di quella drammatica sconfitta, fece un’operazione di vera rottura ideologica, spingendo la provocazione ben oltre gli steccati della polemica antiborghese, osando toccare il nervo sensibile del superficiale orgoglio nazionale allora egemone in Italia: della rovinosa rotta dell’ottobre 1917 (che il generale Cadorna e molti osservatori attribuirono a un insieme di renitenza e insubordinazione di masse di fanti che in realtà erano abbrutiti dall’inumana vita di trincea) egli fece il simbolo di una rivolta politica in piena regola. Una volta vista non dall’ottica degli alti comandi e dei “bravi cittadini”, ma da quella del fantaccino analfabeta, quella sconfitta, che era un tabù rimosso dall’ipocrita mentalità borghese, diventava un atto politico e la massa dei disfattisti assurgeva a sua volta al rango di soggetto politico. Dando vita, come ha scritto Mario Isnenghi, a qualcosa di inedito e di potenzialmente incendiario, cioè “una interpretazione rivoluzionaria della prima guerra mondiale, della storia delle masse e della psicologia collettiva dentro la guerra”.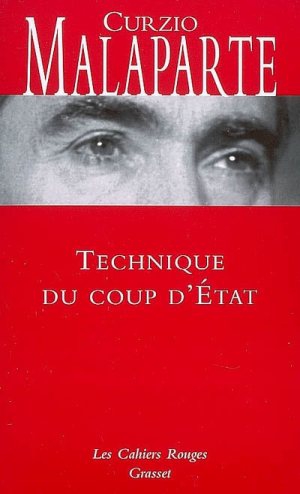 La critica feroce di Malaparte si indirizzava soprattutto verso la morale filistea del borghesismo, quel mondo ipocrita fatto di patriottismo bolso e da operetta, comitati di gentiluomini, patronesse inanellate, tutti gonfi di retorica, con le loro “marcie di umanitarismo e di decadentismo patriottico”, con la loro schizzinosa paura per il popolo vero e i suoi bisogni: questa marmaglia, diceva Malaparte, in fondo odiava i fanti veri, quelli che “non volevano più farsi ammazzare pel loro umanitarismo sportivo”. In questo ritratto di una classe dirigente degenere, obnubilata di retorica e falsi ideali, ognuno riconosce facilmente la classe dirigente degenere di oggi, che è la stessa, radical-chic e impudente, umanitaria per divertimento e per interesse, ieri con i comitati patriottici, oggi con le onlus dedite al business della tratta di carne umana: la morale è la stessa, e lo stesso è l’inganno. Soppesiamo bene quanta verità è contenuta nell’espressione malapartiana di “umanitarismo sportivo” delle oligarchie borghesi, e paragoniamo la casta al potere allora con quella di oggi.
La critica feroce di Malaparte si indirizzava soprattutto verso la morale filistea del borghesismo, quel mondo ipocrita fatto di patriottismo bolso e da operetta, comitati di gentiluomini, patronesse inanellate, tutti gonfi di retorica, con le loro “marcie di umanitarismo e di decadentismo patriottico”, con la loro schizzinosa paura per il popolo vero e i suoi bisogni: questa marmaglia, diceva Malaparte, in fondo odiava i fanti veri, quelli che “non volevano più farsi ammazzare pel loro umanitarismo sportivo”. In questo ritratto di una classe dirigente degenere, obnubilata di retorica e falsi ideali, ognuno riconosce facilmente la classe dirigente degenere di oggi, che è la stessa, radical-chic e impudente, umanitaria per divertimento e per interesse, ieri con i comitati patriottici, oggi con le onlus dedite al business della tratta di carne umana: la morale è la stessa, e lo stesso è l’inganno. Soppesiamo bene quanta verità è contenuta nell’espressione malapartiana di “umanitarismo sportivo” delle oligarchie borghesi, e paragoniamo la casta al potere allora con quella di oggi.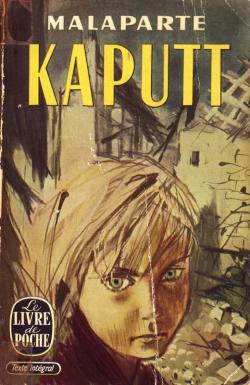 Si trattava di difendere un patrimonio che era prezioso per davvero: l’identità del popolo, che non è parola, non è retorica né slogan, ma vita e sostanza di un soggetto antropologico portatore di valori operanti lungo un arco di tempo pressoché incalcolabile. La minaccia avvertita da Malaparte era la violenza assimilatrice del mondo moderno, con la sua universale capacità di appiattire e annullare le diversificazioni culturali. Nel 1922, in uno studio sul sindacalismo italiano rimasto allora famoso, Malaparte lanciava un avvertimento del quale soltanto oggi, dinanzi all’enormità dell’aggressione che stanno subendo non solo gli italiani, ma tutti gli europei, possiamo valutare le tremende implicazioni: “In casa nostra ci è consentito di far soltanto degli innesti, non delle seminagioni. La semenza straniera non può essere buttata sul nostro terreno: la pianta che ne nasce non si confà al nostro clima. Bisogna a un certo punto bruciarla e tagliarne le radici”. L’essersi piegati senza resistenza ai diktat ideologici del liberalcapitalismo d’importazione anglosassone, il non aver ascoltato profezie come questa di Malaparte – che da un secolo in qua si levarono un po’ dappertutto in Europa – sta costando ai popoli europei la finale uscita di scena dalla storia, annegati nella degenerazione morale e nell’azzeramento della politica volute dalle agenzie progressiste cosmopolite.
Si trattava di difendere un patrimonio che era prezioso per davvero: l’identità del popolo, che non è parola, non è retorica né slogan, ma vita e sostanza di un soggetto antropologico portatore di valori operanti lungo un arco di tempo pressoché incalcolabile. La minaccia avvertita da Malaparte era la violenza assimilatrice del mondo moderno, con la sua universale capacità di appiattire e annullare le diversificazioni culturali. Nel 1922, in uno studio sul sindacalismo italiano rimasto allora famoso, Malaparte lanciava un avvertimento del quale soltanto oggi, dinanzi all’enormità dell’aggressione che stanno subendo non solo gli italiani, ma tutti gli europei, possiamo valutare le tremende implicazioni: “In casa nostra ci è consentito di far soltanto degli innesti, non delle seminagioni. La semenza straniera non può essere buttata sul nostro terreno: la pianta che ne nasce non si confà al nostro clima. Bisogna a un certo punto bruciarla e tagliarne le radici”. L’essersi piegati senza resistenza ai diktat ideologici del liberalcapitalismo d’importazione anglosassone, il non aver ascoltato profezie come questa di Malaparte – che da un secolo in qua si levarono un po’ dappertutto in Europa – sta costando ai popoli europei la finale uscita di scena dalla storia, annegati nella degenerazione morale e nell’azzeramento della politica volute dalle agenzie progressiste cosmopolite.