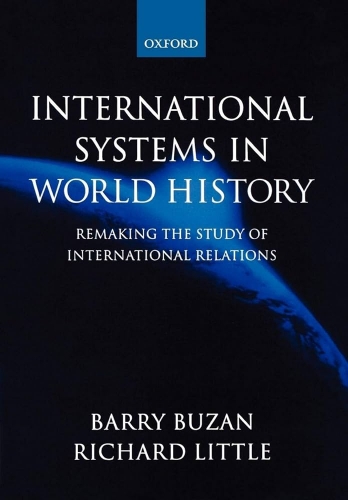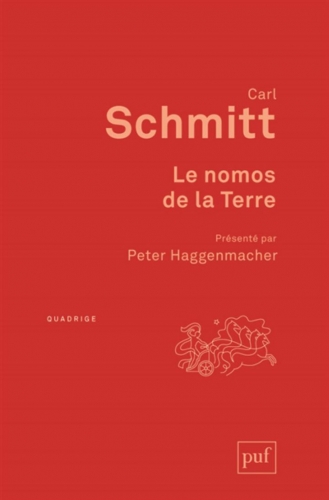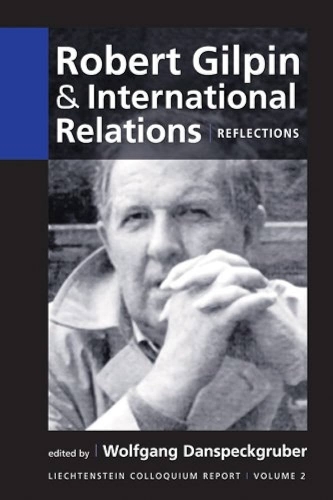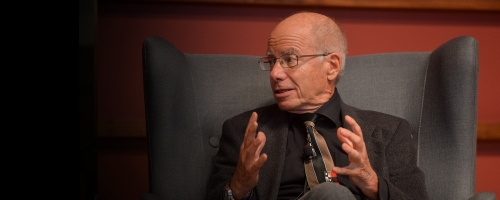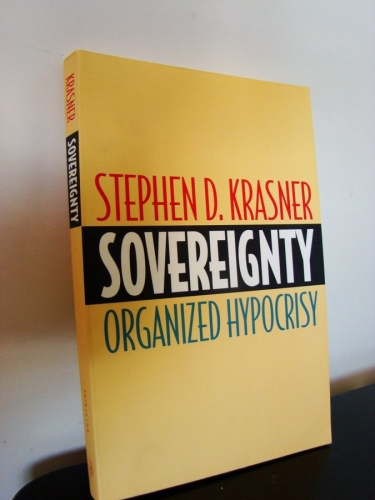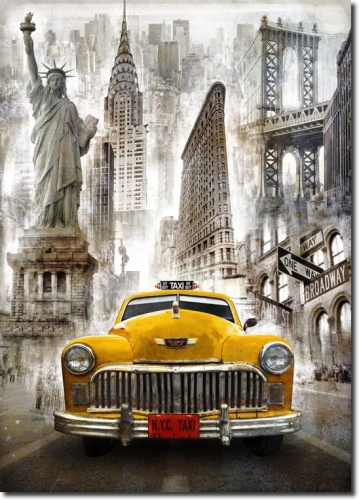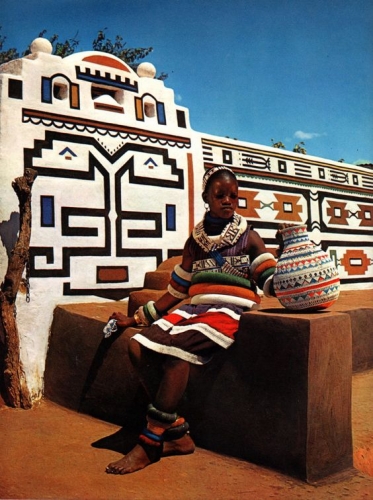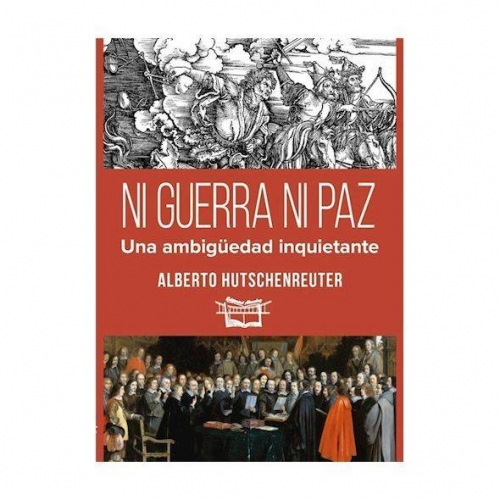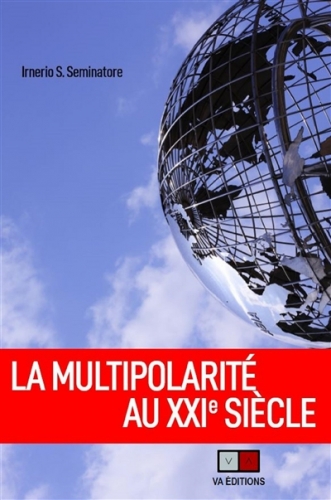Le nouvel ordre multipolaire. L'heptarchie et ses significations
Alexandre Douguine
Source: https://www.geopolitika.ru/article/novyy-mnogopolyarnyy-poryadok-geptarhiya-i-eyo-smysly
L'ordre mondial évolue si rapidement aujourd'hui que les institutions associées à la politique internationale n'ont pas le temps d'y répondre de manière adéquate et de le comprendre pleinement. En Russie, il existe une théorie timide selon laquelle le droit international est quelque chose de solide et de stable, qui prend en compte les intérêts de toutes les parties, tandis que la théorie des "règles" et de l'ordre fondé sur des règles promue par l'Occident collectif et les élites nord-américaines est une sorte d'astuce pour consolider l'hégémonie de Washington. Cette question mérite d'être examinée plus en détail.
L'ordre mondial prémoderne
Résumons les mutations fondamentales de l'ordre mondial au cours des 500 dernières années, c'est-à-dire depuis le début de l'ère moderne.
Avant le début de l'ère des Grandes Découvertes Géographiques (qui coïncide avec le passage du Prémoderne au Moderne, de la société traditionnelle à la société moderne), le monde était divisé en zones de plusieurs civilisations autonomes. Celles-ci échangeaient entre elles à différents niveaux, parfois de manière conflictuelle, mais aucune ne remettait en cause l'existence même de l'autre, acceptant tout tel que c'était.
Ces civilisations sont les suivantes:
- L'écoumène chrétien occidental (catholique) ;
- L'écoumène chrétien oriental (orthodoxe) ;
- Empire chinois (y compris ses satellites culturels - Corée, Viêt Nam, en partie Japon et certains États d'Indochine) ;
- Indosphère (comprenant en partie l'Indochine et les îles indonésiennes) ;
- L'Empire iranien (y compris les régions d'Asie centrale sous forte influence iranienne) ;
- L'Empire ottoman (héritant dans les grandes lignes de la plupart des dominations abbassides - y compris le Maghreb et la péninsule arabique) ;
- Un certain nombre de royaumes africains indépendants et développés ;
- Deux empires américains (Inca et Aztèque).
Chaque civilisation comprenait plusieurs pouvoirs et souvent de nombreux groupes ethniques très différents. Chaque civilisation avait une identité religieuse distincte qui s'incarnait dans la politique, la culture, l'éthique, l'art, le mode de vie, la technologie et la philosophie.
En substance, il s'agissait du zonage de l'humanité à l'époque où toutes les sociétés, tous les États et tous les peuples vivaient dans les conditions d'une société traditionnelle et construisaient leur existence sur la base de valeurs traditionnelles. Toutes ces valeurs étaient sacrées, profondément religieuses. En même temps, elles étaient différentes pour chaque civilisation. Parfois plus, parfois moins, selon le cas, mais en général, toutes les civilisations acceptaient l'existence des autres comme une évidence (si, bien sûr, elles se rencontraient).
Il est intéressant de noter que l'Occident et l'Orient chrétiens se sont considérés comme des écoumènes distincts, comme deux empires, avec une prédominance du rôler papal en Occident et du rôle impérial en Orient (de Byzance à Moscou, la Troisième Rome).
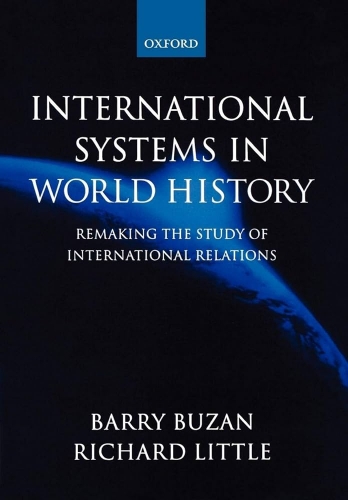
Cet ordre, Buzan et Little l'appellent "les systèmes internationaux antiques ou classiques" [1]. Carl Schmitt les compare au premier nomos de la terre [2].
Il s'agit du premier modèle de relations internationales. Il n'existait pas de droit international général à cette époque, car chaque civilisation représentait un monde complet et totalement autonome - non seulement une culture souveraine, mais aussi une compréhension parfaitement originale de l'existence environnante, de la nature. Chaque empire vivait dans son propre cosmos impérial, dont les paramètres et les structures étaient déterminés sur la base de la religion dominante et de ses principes.
Les temps modernes : l'invention du progrès
C'est ici que commence la partie la plus intéressante. Le nouvel âge de l'Europe occidentale (la modernité) a apporté une idée totalement étrangère à toutes ces civilisations, y compris à la civilisation catholique-chrétienne: l'idée d'un temps linéaire et d'un développement progressif de l'humanité (qui a pris plus tard la forme de l'idée de progrès). Ceux qui ont adopté cette attitude ont commencé à fonctionner avec les idées fondamentales selon lesquelles le "vieux", l'"ancien" et le "traditionnel" sont évidemment pires, plus primitifs et plus grossiers que le "nouveau", le "progressif" et le "moderne". En outre, le progrès linéaire affirme dogmatiquement que le nouveau supprime l'ancien, le dépasse et le surpasse dans tous les paramètres. En d'autres termes, le nouveau remplace l'ancien, l'abolit, prend sa place. Cela nie la dimension de l'éternité, qui est au cœur de toutes les religions et de toutes les civilisations traditionnelles et constitue leur noyau sacré.
L'idée du progrès linéaire a simultanément renversé toutes les formes de sociétés traditionnelles (y compris celle de l'Europe occidentale). C'est ainsi que l'"ancien système international" ou le "premier nomos de la Terre" ont été considérés collectivement comme le passé à remplacer par le présent sur la voie de l'avenir. En même temps, le modèle de la société européenne post-traditionnelle post-catholique (en partie protestante, en partie matérialiste-athée conformément au paradigme de la vision du monde des sciences naturelles) a été considéré comme le présent (moderne). Dans l'Europe occidentale des 16ème et 17ème siècles, l'idée d'une civilisation unifiée (civilisation au singulier), qui incarnerait en elle-même le destin de toute l'humanité, a été conçue pour la première fois. Ce destin consistait en un dépassement de la tradition et des valeurs traditionnelles, et c'est ainsi que le fondement même des civilisations sacrées qui existaient à cette époque a été balayé. Elles ne représentaient plus qu'un retard (par rapport à l'Occident moderne), un ensemble de préjugés et de fausses idoles.
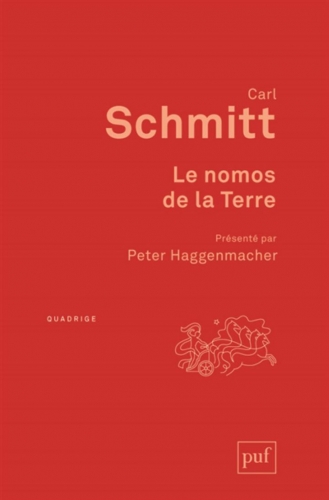
Le second nomos de la Terre
C'est ainsi qu'a commencé la construction du "système international global" (selon B. Buzan) ou du "second nomos de la Terre" (selon K. Schmitt).
Aujourd'hui, l'Occident commence à se transformer et, parallèlement, à influencer de plus en plus activement les zones d'autres civilisations. L'Europe occidentale elle-même connaît un processus rapide de destruction des fondements sacrés de sa propre culture, de démantèlement de l'influence papale (en particulier par la Réforme), de formation de nations européennes sur la base de la souveraineté (auparavant, seuls le siège papal et en partie l'empereur d'Europe occidentale étaient considérés comme souverains), de rupture et de déplacement vers la périphérie de la dogmatique théologique et de transition vers les sciences naturelles sur la base du matérialisme et de l'athéisme. La culture européenne a été démonétisée, déchristianisée et universalisée.
Parallèlement, la colonisation d'autres civilisations - le continent américain, l'Afrique, l'Asie - battait son plein. Et même les empires qui ont résisté à l'occupation directe - chinois, russe, iranien et ottoman - et qui ont maintenu leur indépendance, ont été soumis à une colonisation culturelle, absorbant progressivement les attitudes de la modernité de l'Europe occidentale au détriment de leurs propres valeurs traditionnelles sacrées.
La modernité, le progrès et l'athéisme scientifique ont colonisé l'Europe occidentale qui, à son tour, a colonisé le reste de la civilisation, directement ou indirectement. À tous les niveaux, il s'agissait d'une lutte contre la Tradition, le sacré et les valeurs traditionnelles. La lutte du temps contre l'éternité. La lutte de la civilisation au singulier contre les civilisations au pluriel.

La paix de Westphalie
Le point culminant de ce processus de construction du second "système international" (le second nomos de la Terre) fut la paix de Westphalie, qui mit fin à une guerre de 30 ans dont les principaux protagonistes étaient les protestants et les catholiques (à l'exception de la France catholique, qui prit le parti opposé en raison de sa haine pour les Habsbourg). La paix de Westphalie a établi le premier modèle explicite de droit international, le Jus Publicum Europeum, rejetant complètement les principes de l'ordre médiéval. Désormais, seuls les États-nations sont reconnus comme détenteurs de la souveraineté, indépendamment de leur religion ou de leur système politique (cependant, tous les États de l'époque étaient des monarchies). Ainsi, l'autorité suprême de la politique étrangère est reconnue comme l'État-Nation, dont le modèle n'est pas les empires ou civilisations traditionnels, mais les puissances européennes modernes, qui entrent dans l'ère du développement capitaliste rapide, partageant en général les principes des Temps Modernes, des sciences naturelles et du progrès.
L'Europe occidentale des Temps Modernes est devenue synonyme de civilisation en tant que telle, tandis que les autres entités politiques non européennes étaient considérées comme "barbares" (si la culture et la politique y étaient suffisamment développées) et "sauvages" (si les peuples vivaient dans des sociétés archaïques sans organisation et stratification politiques verticales strictes). Les "sociétés sauvages" étaient soumises à la colonisation directe et leurs populations "désespérément arriérées" à l'esclavage. L'esclavage est un concept moderne. Il est arrivé en Europe après la fin du Moyen Âge et avec le Nouvel Âge, le progrès et les Lumières.
Les "puissances barbares" (dont la Russie faisait partie) représentaient une certaine menace, à laquelle on pouvait répondre à la fois par une confrontation militaire directe et par l'introduction dans l'élite d'éléments partageant la vision du monde de l'Europe occidentale. Parfois, cependant, les "puissances barbares" ont utilisé la modernisation et l'européanisation partielles dans leur propre intérêt pour s'opposer à l'Occident lui-même. Les réformes de Pierre le Grand en Russie en sont un exemple frappant. Quoi qu'il en soit, l'occidentalisation a corrodé les valeurs traditionnelles et les institutions politiques de l'époque des "anciens systèmes internationaux".

C'est pourquoi Barry Buzan qualifie ce deuxième modèle d'ordre mondial de "système international global". Ici, une seule civilisation était reconnue, construite sur l'idée du progrès, du développement technologique, de la science matérialiste, de l'économie capitaliste et de l'égoïsme national. Elle devait devenir une civilisation mondiale.
Souveraineté : évolution du concept
Bien que ce système reconnaisse nominalement la souveraineté de chaque État-nation, il ne s'applique qu'aux puissances européennes. Les autres se voient offrir le statut de colonies. Quant aux "États barbares", ils font l'objet de moqueries désobligeantes et d'un mépris arrogant. Le passé, y compris celui de l'Europe occidentale, est vilipendé de toutes les manières possibles (d'où le mythe du "Moyen Âge sombre"), tandis que le progrès - l'humanisme, le matérialisme, la laïcité - est glorifié.
Progressivement, cependant, le statut de souveraineté a commencé à s'étendre à certaines colonies, si elles parvenaient à se soustraire à l'autorité des métropoles. C'est ce qui s'est passé pendant la guerre d'indépendance des États-Unis. Plus tard, cette voie a été suivie par d'autres entités coloniales, qui ont été progressivement acceptées dans le club européen. Désormais, les principes de Westphalie s'appliquent également à elles. C'est ce qu'on appelle le système westphalien de relations internationales.

À la fin du 19ème siècle, il s'est étendu à certaines colonies libérées et à un certain nombre de "puissances barbares" (Russie, Empire ottoman, Iran, Chine), qui ont conservé à l'intérieur leur mode de vie traditionnel, mais qui sont de plus en plus attirées par le "système international global" mis en place par l'Occident.
La Première Guerre mondiale a marqué l'apogée de l'ordre westphalien, car ce sont les grandes puissances nationales - l'Entente, la Russie tsariste, l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie - qui se sont affrontées. Dans ce conflit, les coalitions ont été créées de manière arbitraire, car les participants étaient des unités indépendantes et tout à fait souveraines. Ils pouvaient conclure une alliance avec certains et entrer en guerre avec d'autres, ne dépendant que de la décision du pouvoir suprême.
Idéologisation du système international
Dans les années 1930, le système westphalien commence à se transformer. La victoire des bolcheviks en Russie et la création de l'URSS ont entraîné une intrusion brutale de la dimension idéologique dans le système des relations internationales. L'URSS sort du dualisme "sociétés modernes" et "États barbares", car elle défie l'ensemble du monde capitaliste, mais n'est pas une continuation inertielle de la société traditionnelle (au contraire, la modernisation en URSS est extrêmement radicale et les valeurs sacrées sont détruites dans une mesure encore plus grande qu'à l'Ouest).
L'émergence du phénomène du fascisme européen, et en particulier du national-socialisme allemand, a encore aggravé les contradictions idéologiques - désormais horribles en Europe occidentale même. Après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, l'Allemagne a commencé à construire rapidement un nouvel ordre européen, fondé non pas sur le nationalisme classique, mais sur la théorie raciale, glorifiant la race aryenne et humiliant tous les autres peuples (partiellement aryens - Celtes, Slaves, etc.).
Ainsi, à la fin des années 30, le monde était divisé selon des lignes idéologiques. En fait, le système westphalien, encore reconnu en paroles, appartient au passé. La souveraineté est désormais détenue non pas tant par des États individuels que par des blocs idéologiques. Le monde devient tripolaire, où seuls l'URSS, les pays de l'Axe et les puissances occidentales libérales anglo-saxonnes comptent vraiment. Tous les autres pays se voient proposer de rejoindre l'un ou l'autre camp, ou.... de s'en prendre à eux-mêmes. Parfois, la question est réglée par la force.
La Seconde Guerre mondiale a été un affrontement entre ces trois pôles idéologiques. En fait, nous avons eu affaire à une esquisse à court terme d'un modèle international tripolaire avec un conflit prononcé et une domination idéologique antagoniste sur le système des relations internationales. Chacun des pôles, pour des raisons idéologiques, nie en fait tous les autres, ce qui conduit naturellement à l'effondrement de la Société des Nations et à la Seconde Guerre mondiale.

Là encore, différentes combinaisons pouvaient théoriquement être formées - le pacte de Munich suggérait la possibilité d'une alliance entre libéraux et fascistes. Le pacte Ribbentrop-Molotov - entre fascistes et communistes. Comme nous le savons, l'alliance des libéraux et des communistes contre les fascistes s'est réalisée. Les fascistes ont perdu, les libéraux et les communistes se sont partagé le monde.
Le système bipolaire
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un système bipolaire a vu le jour. Désormais, tous les pays "souverains" nominalement reconnus ne le sont plus, et seuls deux des trois camps idéologiques subsistent. La paix de Yalta a consolidé la division du pouvoir entre les camps capitaliste et socialiste, et l'ONU est devenue l'expression de ce nouveau modèle d'ordre mondial. Le droit international est désormais fondé sur la parité (essentiellement nucléaire) entre l'Ouest capitaliste et l'Est socialiste. Les pays du Mouvement des non-alignés se voient accorder une certaine liberté d'équilibre entre les pôles.
Carl Schmitt appelle la bipolarité et l'équilibre des forces dans les conditions de la guerre froide "le troisième nomos de la Terre", tandis que B. Buzan ne distingue pas de modèle particulier d'ordre mondial, le considérant comme une continuation du "système international global" (ce qui affaiblit quelque peu la pertinence de sa théorie générale).

Le moment unipolaire
L'effondrement du camp socialiste, le Pacte de Varsovie et la fin de l'URSS ont entraîné la fin de l'ordre mondial bipolaire fondé sur le principe idéologique du capitalisme contre le socialisme. Le socialisme a perdu, l'URSS a capitulé et s'est effondrée. De plus, elle a reconnu et accepté l'idéologie de l'ennemi. D'où la Fédération de Russie, construite sur la base de normes libérales-capitalistes. Avec le socialisme et l'URSS, la Russie a perdu sa souveraineté.
C'est ainsi que le "quatrième nomos de la Terre" a commencé à prendre forme, que Carl Schmitt lui-même n'a pas vu de son vivant, mais dont il avait pressenti la probabilité. Barry Buzan l'a défini comme un "système international postmoderne". De l'avis général, ce nouveau modèle de relations internationales et le système de droit international émergent auraient dû consolider l'unipolarité établie. Des deux pôles, il n'en restait plus qu'un, le pôle libéral. Désormais, tous les États, les peuples et les sociétés étaient obligés d'accepter le seul modèle idéologique, le modèle libéral.
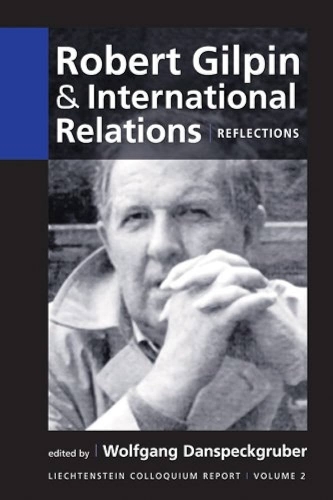
C'est à cette époque que sont apparues les théories consolidant l'unipolarité. La "théorie de l'hégémonie stable" de Robert Gilpin en est un exemple [3]. Charles Krauthammer a prudemment parlé de "moment unipolaire" [4], c'est-à-dire d'un état temporaire de la politique mondiale, et Francis Fukuyama a proclamé avec assurance la "fin de l'histoire" [5], c'est-à-dire le triomphe irréversible et définitif de la démocratie libérale, c'est-à-dire de l'Occident moderne, à l'échelle mondiale.
Au niveau politique, cela s'est traduit par l'appel du sénateur John McCain à la création d'une nouvelle organisation internationale - la Ligue des démocraties - en lieu et place de l'ONU, qui reconnaîtrait explicitement l'hégémonie complète et totale de l'Occident libéral et la suprématie des États-Unis à l'échelle mondiale.
Des objections à cette volonté de passer radicalement à un système international unipolaire-mondialiste - postmoderniste - ont été soulevées par Samuel Huntington, qui s'oppose plutôt à une culture fondée sur la modernité et le progrès linéaire, sur l'acceptation de l'universalisme de la civilisation occidentale, et à son apogée, a soudainement suggéré qu'après la fin du monde bipolaire, il n'y aura pas la fin de l'histoire (c'est-à-dire le triomphe complet du capitalisme libéral à l'échelle planétaire), mais la résurgence d'anciennes civilisations. Huntington a décodé la postmodernité comme la fin du moderne et le retour au prémoderne, c'est-à-dire au système international qui existait avant l'âge de la grande découverte (c'est-à-dire avant la colonisation planétaire du monde et le début du nouvel âge). Il a ainsi proclamé le "retour des civilisations", c'est-à-dire la nouvelle émergence des forces qui avaient dominé le "premier nomos de la Terre", le "système international antique et classique".
En d'autres termes, Huntington prédisait la multipolarité et une interprétation totalement nouvelle du postmodernisme dans les relations internationales - non pas un libéralisme total, mais au contraire un retour à la souveraineté des "grands espaces" civilisationnels sur la base d'une culture et d'une religion particulières. Comme nous le verrons par la suite, Huntington avait tout à fait raison, tandis que Fukuyama et les partisans de l'unipolarité étaient quelque peu hâtifs.
Synchronisme des différents types d'ordre mondial
Il convient ici de revenir sur le concept d'"ordre mondial fondé sur des règles". Les années 2000 ont été marquées par une situation particulière où tous les systèmes de relations internationales et, par conséquent, tous les types de droit international fonctionnaient simultanément. Des civilisations longtemps oubliées et effacées se sont réaffirmées sous une forme renouvelée et ont commencé à s'institutionnaliser, comme en témoignent les BRICS, l'OCS, l'Union économique eurasienne, etc. Le prémoderne s'est mêlé au postmoderne.
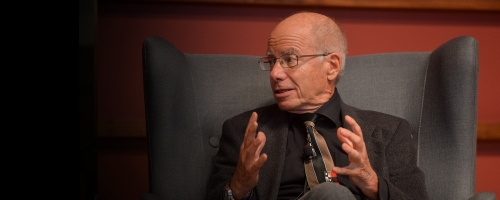
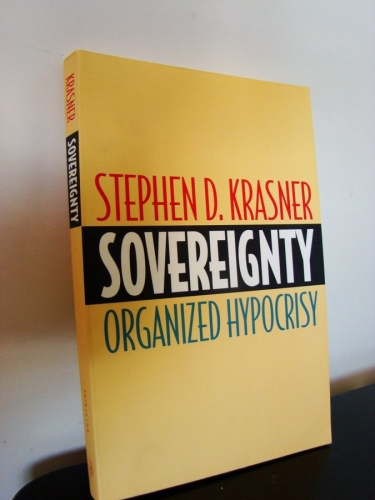
Dans le même temps, de nombreuses dispositions du système westphalien ont été préservées dans le droit international par inertie. La souveraineté des États nationaux est toujours reconnue comme la principale norme des relations internationales, même si ce n'est que sur le papier. Des réalistes comme S. Krasner [6] ont franchement reconnu que la thèse de la souveraineté appliquée à toutes les puissances de l'ordre mondial moderne, à l'exception des vraies grandes puissances, est une pure hypocrisie et ne correspond à rien dans la réalité. Mais la diplomatie mondiale continue à jouer le monde westphalien, dont il ne reste que des ruines fumantes.
Les règles de l'ordre mondial
Dans le même temps, le système de paix de Yalta conserve son influence et sa normativité. L'ONU est toujours basée sur la présomption de bi-polarité, où le Conseil de sécurité maintient une sorte de parité entre les deux blocs nucléaires - le capitaliste (États-Unis, Angleterre, France) et l'ancien socialiste (Russie, Chine). En général, l'ONU maintient l'apparence d'une bipolarité équilibrée et insiste sur le fait qu'il s'agit du système de droit international (bien que cela - après l'effondrement du camp socialiste et l'effondrement de l'URSS - soit plutôt une "douleur fantôme"). C'est à cela que les dirigeants de la Russie moderne aiment faire appel dans leur opposition à l'Occident.
L'Occident cherche à consolider le système unipolaire - la Ligue des démocraties, le Forum des démocraties, en reconnaissant ceux qui ne sont pas d'accord avec cette hégémonie comme des "États voyous". Jusqu'à présent, il n'a pas été possible de le faire au niveau du droit international, qui reste nominalement westphalien-bipolaire, de sorte que les mondialistes ont décidé d'introduire le concept de "règles" et ont proclamé un ordre mondial basé sur ces règles, où les règles sont créées, mises en œuvre et protégées par un seul centre - l'Occident mondial.
Dans le triomphe de la civilisation libérale-capitaliste occidentale, les théoriciens du mondialisme voient la preuve de la théorie du progrès. Tous les autres systèmes - civilisations, États-nations, confrontation des idéologies, etc. - appartiennent au passé. Ils sont supprimés, dépassés. Les règles de domination globale de l'Occident collectif deviennent dans ce cas un prolégomène à un Nouvel Ordre Mondial strictement unipolaire.
C'est pourquoi la Russie, qui prétend restaurer sa souveraineté civilisationnelle, attaque les règles avec tant d'acharnement, cherchant à insister soit sur sa souveraineté westphalienne (le second nomos de la Terre), soit sur quelque chose d'encore plus grand, garanti par des armes nucléaires et un siège au Conseil de sécurité de l'ONU.
Ce n'est que récemment, après le début de l'Opération militaire spéciale, que le Kremlin a commencé à réfléchir sérieusement à une véritable multipolarité, qui est en fait un retour à l'ordre mondial civilisationnel précolombien et traditionnel. La multipolarité présuppose un système de droit international fondamentalement différent de l'unipolarité, transférant le statut de souveraineté de l'État-nation à l'État-civilisation, c'est-à-dire une nouvelle édition de l'Empire traditionnel, ainsi que le principe de l'égalité de tous les pôles.
Heptapolarité
Aujourd'hui, après le 15ème sommet des BRICS, une telle heptapolarité de sept civilisations est largement esquissée :
- Occident libéral ;
- Chine maoïste-confucianiste ;
- Russie eurasienne orthodoxe ;
- Inde védantique ;
- Monde islamique (sunnite-chiite) ;
- Amérique latine ;
- l'Afrique.
Ses contours sont assez clairement dessinés. Mais bien sûr, ce modèle n'est pas encore devenu un nouveau système de droit international. Nous en sommes encore loin.
Cependant, nous devons être attentifs à la profondeur de la rupture totale et radicale avec l'Occident pour justifier le droit à l'existence des civilisations et de leurs valeurs traditionnelles. Tous les pôles devront rejeter les postulats de base de l'Occident qui leur ont été inculqués de manière constante et compulsive, ainsi qu'à l'ensemble de l'humanité, depuis le début du Nouvel Âge :
- l'individualisme,
- le matérialisme,
- l'économisme,
- la technologie comme destin,
- le scientisme,
- la laïcité,
- la domination de l'argent,
- la culture de l'hédonisme et de la décadence,
- le progressisme, etc.
Tout cela doit être retiré de la culture de toute personne qui revendique un pôle indépendant, une civilisation distincte. Aucune des grandes cultures, à l'exception de la culture occidentale, n'est fondée sur ces principes. Toutes les valeurs traditionnelles y sont totalement opposées.
La libération progressive de l'idéologie coloniale de l'Occident prédéterminera également les paramètres de base d'un nouveau système de relations internationales et d'un nouveau modèle de droit international.
Pour l'instant, les partisans d'un ordre multipolaire sont appelés à contrer de manière réactive l'enracinement des règles dictées par l'Occident global, qui s'accroche au moment unipolaire tout en connaissant un processus de lente agonie. Mais bientôt, cela ne suffira plus, et les pays des BRICS élargis - les civilisations qui ont (re)fait surface - devront poser la question du sens du sacré, de la Tradition et de ses valeurs, de l'éternité et de la dimension transcendante de l'existence.

Le nouveau nomos de la Terre est devant nous. Une bataille féroce s'engage pour en dessiner les contours. Tout d'abord en Ukraine, qui est le front entre l'ordre mondial unipolaire et l'ordre mondial multipolaire. Et toutes les structures des différentes couches du droit international - de l'antique classique au westphalien, du bipolaire à l'unipolaire - sont clairement présentes dans cette guerre brutale pour les significations et les orientations du nouveau monde qui est en train de se créer sous nos yeux.
Notes:
[1] Buzan B., Little R. International Systems in World History. Oxford : Oxford University Press, 2010.
[2] Schmitt C. Der Nomos der Erde im Völkerrecht des Jus Publicum Europaeum. Cologne : Greven, 1950.
[3] Gilpin R., Gilpin J. M. Global political economy : understanding the international economic order. Princeton, N.J : Princeton University Press, 2001.
[4] Krauthammer Ch. The Unipolar Moment// Foreign Affairs. New York : Council on Foreign Relations. 1991. N 70 (1). P. 23-33.
[5] Fukuyama F. La fin de l'histoire et le dernier homme. NY : Free Press, 1992.
[6] Krasner S. Sovereignty : Organised Hypocrisy. Princeton : Princeton University Press, 1999.








 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg