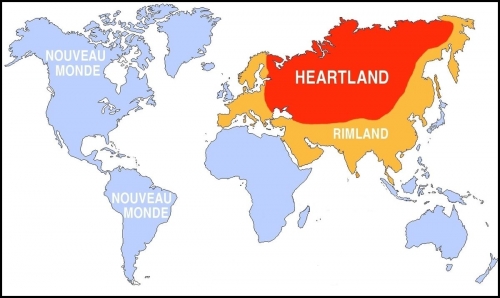lundi, 18 décembre 2023
Alexandre Douguine: Hegel et la théorie des relations internationales

Hegel et la théorie des relations internationales
Alexandre Douguine
Source: https://www.geopolitika.ru/article/gegel-i-teoriya-mezhdunarodnyh-otnosheniy?fbclid=IwAR2flWtFdtkg3eRNfPNycu8lz7xAzS9ej3-OgPlYcgeRj5ouM7suZqQThCc
Le paradigme général du système hégélien
Retraçons l'influence de la philosophie de Hegel sur la théorie des relations internationales. Elle se manifeste le plus clairement dans le marxisme et le libéralisme, alors que Hegel n'a pas eu une grande influence sur le réalisme. Examinons ce sujet plus en détail.
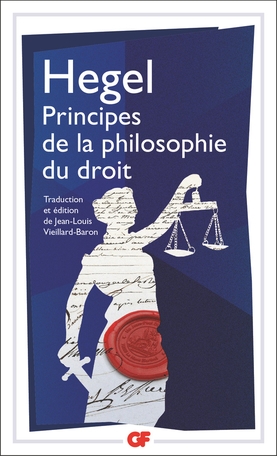 C'est dans la "Philosophie du droit" [1] que Hegel a le mieux exprimé son point de vue sur la politique. Ces opinions sont fondées sur l'ensemble de sa philosophie et font partie intégrante de tout le système. Néanmoins, la théorie du politique de Hegel est exposée d'une manière assez originale et, afin de révéler le bloc de ses idées sur la politique internationale, il est nécessaire de la décrire brièvement.
C'est dans la "Philosophie du droit" [1] que Hegel a le mieux exprimé son point de vue sur la politique. Ces opinions sont fondées sur l'ensemble de sa philosophie et font partie intégrante de tout le système. Néanmoins, la théorie du politique de Hegel est exposée d'une manière assez originale et, afin de révéler le bloc de ses idées sur la politique internationale, il est nécessaire de la décrire brièvement.
Tout d'abord, il convient de rappeler le paradigme général de la pensée de Hegel. Il repose sur le principe triadique formulé par Fichte : thèse - antithèse - synthèse [2]. Fichte, à son tour, l'a puisé dans la tradition néoplatonicienne. Hegel lui-même n'a pas utilisé l'expression "thèse - antithèse - synthèse", bien que la structure de sa dialectique tourne constamment autour d'un schéma triadique similaire.
Selon Hegel, au commencement de toute chose se trouve l'Idée-en-soi ou l'Esprit subjectif. C'est la thèse principale. Vient ensuite le moment de la négation. L'Esprit se nie lui-même, s'aliène et devient la Nature. L'Esprit, dans ce moment de négation, cesse d'être en-soi et devient pour-autrui. Mais la Nature et la substance ne sont pas le premier commencement. Ce n'est qu'un moment de négation. C'est pourquoi elle est négative. Étant négative, elle indique ce qu'elle nie, la suppression et en même temps l'ascension et l'élévation (Aufhebung) de ce qu'elle est [3]. Cette tension entre les deux moments dialectiques agit comme l'Esprit qui organise et fait bouger la nature. Il y a une "potentialisation" des couches de l'être extérieur, du physique-mécanique au chimique et enfin à l'organique. Ce processus de déploiement de l'esprit est l'esprit. Chez l'homme, l'esprit détermine la conscience.
La vie organique combinée à la conscience humaine détermine le troisième moment - la négation de la négation ou la synthèse. Dans l'homme, l'Esprit entame son dernier virage et se dirige vers le point où, à travers l'homme, l'Idée peut se contempler elle-même et où l'Esprit devient l'Esprit absolu, c'est-à-dire l'Idée pour elle-même.
Tel est le tableau général du système de Hegel. Dans la "Philosophie du droit", il ne considère que l'homme et les moments de sa "potentialisation", la dialectique du mouvement à travers les différentes couches de l'esprit qui se dévoile.
La structure de la pensée de Hegel dans la Philosophie du droit
 Hegel commence par le droit abstrait, une approche purement juridique qui établit la personne (au sens de la jurisprudence), c'est-à-dire l'individu. Le droit coutumier règle les relations de l'individu avec les autres individus et avec les objets du monde qui l'entoure. C'est ainsi qu'est postulé le modèle cartésien de la relation entre le sujet et l'objet. Le droit, selon Hegel, possède à ce stade sa propre ontologie et prédétermine le fonctionnement de la "conscience ordinaire". Le droit en tant que tel est une pure banalité qui traite d'abstractions. Il constitue les cartes intuitives du comportement et de l'expérience de tous les jours, mais n'a aucun contenu philosophique. Les lois précèdent donc l'État et le politique en tant que tels. On le voit dans les analyses des sociétés archaïques. Mais pour Hegel, il est important de réaliser ce domaine tout d'abord au niveau des concepts. Les relations juridiques sont l'abstraction de base qui structure les relations de l'homme avec le monde qui l'entoure au niveau de l'expérience immédiate. Le droit, au sens purement juridique, est le fond de l'existence humaine, sa limite extérieure.
Hegel commence par le droit abstrait, une approche purement juridique qui établit la personne (au sens de la jurisprudence), c'est-à-dire l'individu. Le droit coutumier règle les relations de l'individu avec les autres individus et avec les objets du monde qui l'entoure. C'est ainsi qu'est postulé le modèle cartésien de la relation entre le sujet et l'objet. Le droit, selon Hegel, possède à ce stade sa propre ontologie et prédétermine le fonctionnement de la "conscience ordinaire". Le droit en tant que tel est une pure banalité qui traite d'abstractions. Il constitue les cartes intuitives du comportement et de l'expérience de tous les jours, mais n'a aucun contenu philosophique. Les lois précèdent donc l'État et le politique en tant que tels. On le voit dans les analyses des sociétés archaïques. Mais pour Hegel, il est important de réaliser ce domaine tout d'abord au niveau des concepts. Les relations juridiques sont l'abstraction de base qui structure les relations de l'homme avec le monde qui l'entoure au niveau de l'expérience immédiate. Le droit, au sens purement juridique, est le fond de l'existence humaine, sa limite extérieure.
Hegel opère ici avec le droit romain et avec la tradition européenne d'interprétation du droit dans l'esprit de ce que Carl Schmitt appellera plus tard la "nomocratie" [4].
Le deuxième niveau, où le sujet autonome émerge pour la première fois, c'est-à-dire où le travail de l'esprit commence, est, selon Hegel, la moralité (die Sittlichkeit). Il se tourne ici vers la raison pratique de Kant. Hegel explique le passage du droit à la Sittlichkeit comme l'acquisition par l'homme du premier degré d'autoréflexion, la conquête de l'autonomie par rapport à la stricte distribution des rôles et des statuts dans le champ logiquement juridique antérieur. Le sujet moral ne coïncide pas avec une personne juridique (physique), c'est-à-dire qu'il est quelque chose de plus qu'un individu. Le système de relations avec les autres individus et les objets du monde extérieur devient plus complexe. Mais Hegel interprète cette personnalité morale comme un moment où l'on quitte les liens sociaux, rigidement fixés par la loi, pour entrer dans la zone de l'intériorité, c'est-à-dire l'immersion en soi-même, dans l'autoréflexion. C'est un geste dans l'esprit de Diogène le Cynique, le sceptique qui se détourne de la société au nom de la contemplation personnelle.
Ce n'est qu'au niveau suivant, le troisième, que l'on entre dans le domaine du Politique, où commence le véritable travail de ce que Hegel appelle "l'Esprit" (Geist) et qui est au cœur de tout son enseignement. Ici, Hegel suit entièrement Aristote. D'où le choix du terme : Hegel appelle le troisième domaine "moralité" (die Sittlichkeit), ce qui correspond au concept d'éthique d'Aristote (ἠθική, ἦθος). Les concepts de "moralité" et d'"éthique", qui semblent souvent synonymes, sont fondamentalement dissociés par Hegel.
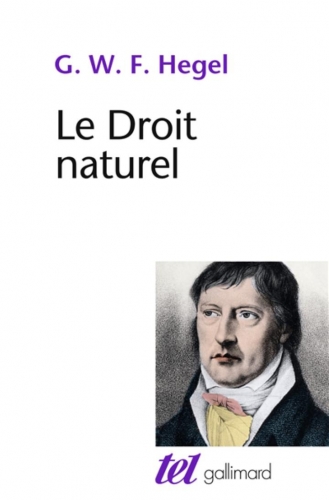 Généralement, les hégéliens le suivent dans la même voie. La moralité est l'immersion de l'individu en lui-même, la première capacité à détacher sa présence de l'abstraction purement juridique de lui-même en tant que personne. Dans la morale, en revanche, l'individu entre dans une forme de vie pratique active qui a déjà été réfléchie et a gagné la subjectivité morale, mais cette fois résolument tournée vers la possibilité pour l'esprit supérieur de se réaliser à travers l'action morale consciente. C'est le moment de la naissance de la société.
Généralement, les hégéliens le suivent dans la même voie. La moralité est l'immersion de l'individu en lui-même, la première capacité à détacher sa présence de l'abstraction purement juridique de lui-même en tant que personne. Dans la morale, en revanche, l'individu entre dans une forme de vie pratique active qui a déjà été réfléchie et a gagné la subjectivité morale, mais cette fois résolument tournée vers la possibilité pour l'esprit supérieur de se réaliser à travers l'action morale consciente. C'est le moment de la naissance de la société.
Nous passons au troisième niveau en suivant les étapes droit - morale - morale (société).
Ici encore, la triple division apparaît. Tout le domaine de la moralité est divisé par Hegel en trois moments : la famille, la société civile et l'État. Il s'agit là d'un prolongement exact de la pensée d'Aristote sur l'éthique et son développement. Selon Aristote, la politique fait partie de la sphère de l'éthique, car c'est elle qui décide de la question du bien, c'est-à-dire de la déontologie.
L'être dans la famille et sa négation dans la société civile
Le premier moment de la réalisation humaine est l'être-en-famille. C'est là que, pour la première fois, le sujet moral exprime sa volonté par une action concrète - en sacrifiant l'individu à la famille comme première communauté. Selon Hegel, la famille est un phénomène purement spirituel. Elle n'a pratiquement rien de corporel, elle est le caractère concret de l'être moral (Sittlichkeit). Dans la famille, l'homme s'affirme d'abord pleinement en tant qu'esprit, en tant qu'idée substantielle et concrète. La conscience et la volonté du sujet se révèlent dans la famille.
La société est constituée de familles en tant qu'ensembles organiques, où chaque individu est en unité morale avec les autres membres. Il n'y a pas ici de relations purement juridiques (d'individu à individu ou de sujet à objet) ni de détachement du sujet moral. L'être dans la famille est un dépassement de soi et le passage d'une humanité abstraite à une humanité concrète.
Hegel considère le moment suivant de manière dialectique, comme une sortie de la famille vers le domaine défini par la pluralité déjà existante des familles, qui forme la société civile (bürgerliche Gesellschaft). Il s'agit ici d'une aliénation de l'individu par rapport à la totalité organique de la famille et, en ce sens, elle est négative. La société civile expose l'organisme intégral de la famille à la négation. Mais à la différence du droit, avec lequel tout a commencé, la société civile se construit déjà sur la base du sujet agissant spirituel concret, qui se manifeste dans la famille. Dans l'interprétation de Hegel, la société civile est un phénomène négatif dans lequel l'esprit se retire de ses conquêtes apparentes dans la famille. Cela détermine l'attitude de Hegel à l'égard des Lumières, qui ont pris la société civile (c'est-à-dire le capitalisme - Bürger = bourgeois) comme principal point de référence. La société civile est une négation, une chute visible de l'Esprit, mais elle est nécessaire pour le prochain tournant dialectique. Ce tournant est le dépassement de la société civile dans l'État (der Staat).
L'État comme dépassement de la société civile
La famille est la thèse, la société civile est l'antithèse. L'État (der Staat) en est la synthèse.
L'État (der Staat) est l'expression la plus parfaite de l'Esprit. Dans l'État, un membre de la société civile, qui s'est réalisé en tant que sujet moral à part entière (à partir du stade de la famille), qui a acquis une autonomie sociale (en devenant un citoyen en soi), se surmonte lui-même par un service social gratuit. De même que, dans la famille, l'individu sacrifie son être en soi au profit de l'épanouissement de l'esprit, de même, dans l'État, le citoyen se sacrifie à un niveau encore plus élevé, se dépassant au service de l'ensemble. Non seulement la famille, mais une forme synthétique encore plus élevée de l'incarnation de l'esprit.
Au stade de l'État, la société civile (bürgerliche Gesellschaft) devient le peuple (das Volk).
Heidegger, commentant la Philosophie du droit, observe avec perspicacité que le peuple (das Volk) correspond au Dasein, et que l'État (der Staat) est le Sein (au sens heideggérien) - Staat als Seyn des Volkes [5].
Selon Hegel, l'État (der Staat) est le sommet de la moralité (Sittlichkeit). Il incarne l'horizon le plus élevé du déploiement de l'Esprit. L'État est pur Esprit, il est donc raisonnable et possède une volonté.
À son tour, la plus haute concentration de l'État est le monarque. Hegel était un monarchiste constitutionnel. Dans la figure du monarque, la dialectique de l'esprit atteint son point culminant. Tous les membres de l'État sont au service du monarque, et le monarque est au service de l'Idée.

Enfin, dans la phase de l'Esprit correspondant à l'État, Hegel identifie également trois moments. Encore une fois, thèse - antithèse - synthèse.
L'État lui-même (der Staat), en tant qu'organisme unique, apparaît ici comme une thèse, comme une unité spirituelle dans laquelle il atteint son épanouissement le plus complet possible. Mais l'État n'est pas le seul. Il en est un parmi d'autres. Il crée un système de relations internationales. C'est encore la négation. La présence d'un autre Etat limite la souveraineté du premier. Ainsi le système de relations internationales dans l'enchaînement des moments de la révélation de l'esprit est l'expression du négatif.
Ce négatif (antithèse) est finalement supprimé par l'affirmation de l'Idée universelle, c'est-à-dire l'Empire philosophique (das Reich). C'est en lui que l'histoire s'achève. Et l'esprit, après avoir traversé toutes ses étapes, atteint sa pleine et absolue révélation. Si, au commencement, elle était Idée-en-soi, puis elle est devenue, par l'aliénation de soi dans la nature (antithèse), Idée-pour-autrui, c'est dans l'Empire du monde (das Reich) qu'elle devient Idée-pour-soi. Mais l'Idée (ἰδέα) est ce qui est vu. Lorsqu'il n'y a pas d'Autre que l'Idée elle-même, elle ne peut être vue. L'esprit en tant que tel est le processus de déploiement de l'Idée, lorsqu'elle constitue l'Autre, et qu'ensuite l'Autre contemple l'Idée. Mais cet Autre n'est pas un Autre total ; c'est l'Idée elle-même, qui ne s'exprime qu'à travers l'Esprit, qui devient, à partir du subjectif, d'abord objectif, puis absolu. L'Empire mondial (das Reich) est l'achèvement de l'histoire en tant qu'histoire de l'Esprit, c'est-à-dire quelque chose de final et d'absolu.
Telle est l'image générale du système philosophique de Hegel.
Application du modèle de Hegel aux idéologies politiques de la modernité européenne
À partir d'une vue d'ensemble du système de Hegel, il devient parfaitement clair comment il peut être appliqué à certaines idéologies politiques, et surtout au communisme et au libéralisme.
Le fait que Marx ait construit son système sur la philosophie de Hegel est connu de tous et n'a pas besoin d'être prouvé. La reconstruction de l'histoire selon Marx, bien qu'elle introduise le facteur des classes dans la base de l'analyse, reprend en général complètement le scénario de Hegel. La seule chose est que dans la théorie matérialiste et de classe de Marx, qui exclut la primauté de l'Idée en soi et commence la construction de son propre système à partir du deuxième membre de la chaîne dialectique - à partir de la Nature, de l'antithèse, la "fin de l'histoire" n'est pas l'Empire mondial (das Reich), mais une société internationale sans classes - le communisme.
Cependant, le communisme de Marx est également précédé d'une phase de capitalisme, qui doit d'abord devenir un phénomène mondial. C'est ce sur quoi ont insisté les marxistes européens qui ont nié la révolution bolchevique en Russie en tant qu'exemple de marxisme authentique, et plus tard les trotskistes qui ont rompu avec Staline et, comme les sociaux-démocrates européens, ont condamné l'URSS en tant que "perversion du marxisme". Ainsi, l'hégélianisme de gauche supposait également une certaine analogie avec l'Empire mondial (das Reich), en tant que moment précédant la révolution prolétarienne mondiale dans la construction du capitalisme mondial.
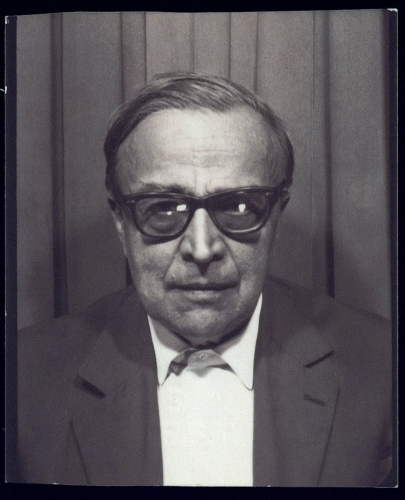

C'est ainsi que Hegel a été interprété par des théoriciens libéraux tels que Kojève [6] et Fukuyama [7]. Rejetant, bien sûr, la révolution marxiste et l'approche de classe, ils pensent que la "fin de l'histoire" se produira par l'unification de l'humanité dans un système supranational mondial unique. Ce serait la victoire complète du capitalisme et de l'internationalisme bourgeois. Mais contrairement aux marxistes, ils nient l'existence de classes, estimant que la classe moyenne s'étendra progressivement à l'ensemble de l'humanité et que l'égalité sera atteinte par des moyens évolutifs plutôt que révolutionnaires. Le globalisme planétaire que les marxistes affirment avant la révolution mondiale, et que les libéraux considèrent comme la "fin de l'histoire", correspond cependant précisément à la société civile de Hegel, qu'il considérait comme un moment dialectique précédant l'émergence de l'État. Ainsi, tant les libéraux que les marxistes sont déroutés et déformés qualitativement par le système de Hegel, puisqu'ils refusent de reconnaître dans l'État de Hegel une forme d'Esprit qualitativement supérieure à la société civile. Selon Hegel, les individus moraux, enracinés dans la famille et ayant réalisé le moment négatif de l'aliénation dans une société composée de nombreuses familles, doivent volontairement (ou plutôt sous l'influence de l'esprit qui travaille en eux) surmonter cette phase et par la négation de la négation, c'est-à-dire par la négation (suppression) de la société civile, passer à la monarchie constitutionnelle. Les libéraux restent au niveau du deuxième moment dialectique - au niveau de la société civile, en dépassant la famille (d'où l'abolition progressive de la famille dans le marxisme et le libéralisme), mais en ne dépassant pas le dépassé, c'est-à-dire le capitalisme et la démocratie bourgeoise. Ils restent donc dans le domaine antérieur à la compréhension hégélienne de l'État en tant que tel, c'est-à-dire en tant que moment de l'ascension de l'Esprit. Ainsi, même lorsqu'elles sont orientées sur le principe hégélien de la "fin de l'histoire", elles sautent par-dessus le moment essentiel le plus important de tout le système hégélien - l'État [8]. Hegel insiste sur le fait que la monarchie ne précède pas la société civile, mais la suit. Du moins la monarchie en question dans son système. La société civile annule historiquement la monarchie de l'ancien type, que Hegel, dans son système de déploiement de l'Esprit dans le domaine de la morale, ne mentionne pas du tout. Mais elle précède la monarchie philosophique, l'état de l'Esprit.
Nous pouvons donc conclure que les interprétations libérales et marxistes de Hegel s'écartent considérablement de son système dans le domaine de l'État et du droit, et que leur interprétation de la "fin de l'histoire" déforme gravement la pensée de Hegel et n'inclut pas en principe l'ontologie de l'État de Hegel. Hegel lui-même tire le sens de la "fin de l'histoire" de cette ontologie de l'Etat (der Staat) en tant que moment de l'ascension de l'Esprit. Si nous comprenons la "fin de l'histoire" comme l'internationalisation de la société civile, y compris ou non le critère de classe du marxisme, nous changeons complètement la structure de la philosophie de l'histoire de Hegel, sans jamais atteindre le point où la synthèse de la sphère morale a lieu et où la monarchie philosophique (pas encore un empire mondial), l'État de l'Esprit, est créée.
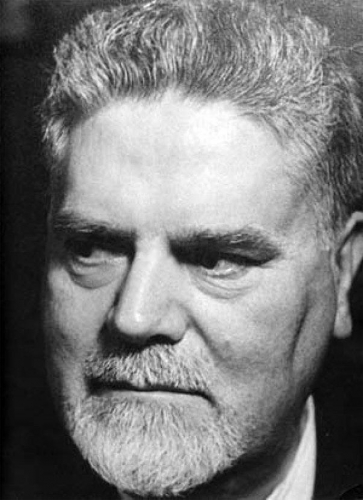
Les hégéliens de droite, comme Giovanni Gentile, étaient beaucoup plus proches de Hegel. Ils ont placé la notion d'État précisément dans un contexte hégélien et y ont vu la suppression de la société civile. Un tel État serait post-bourgeois, post-capitaliste.
Aussi étrange que cela puisse paraître, les bolcheviks russes étaient proches de Hegel, qui a d'abord annoncé la possibilité d'une révolution prolétarienne dans un seul pays, puis, sous Staline, la construction du socialisme dans un seul pays également. De même, la théorie et la pratique de la création d'un État post-bourgeois, dans lequel la société civile est surmontée, ont émergé au sein de la gauche. Si nous considérons le système qui s'est développé sous Staline comme une "monarchie" spontanée, il s'inscrit précisément dans la logique hégélienne.
Qu'est-ce que l'État de Hegel ?
Voici donc ce à quoi nous arrivons. Dans le système de Hegel, lorsqu'il s'agit de l'État comme aboutissement du déploiement moral de l'Esprit, il ne s'agit pas de n'importe quel État, mais d'un État dans lequel la société civile a été supprimée, dépassée. C'est entre de tels États - des monarchies post-démocratiques (constitutionnelles) - que se construit le système des relations internationales.
En fait, ces relations contiennent le moment philosophique le plus important. D'une part, la présence d'un autre État affaiblit le degré de généralisation philosophique que l'Esprit atteint dans chaque État individuel. La présence d'autres États souligne l'insuffisance et la non-finalité de cette expression. C'est pourquoi le système des relations internationales est une négation. L'Esprit dans la politique internationale reconnaît ses limites, c'est-à-dire sa forme et sa relativité. C'est la justification philosophique de la guerre - c'est l'œuvre du moment négatif.
Mais en même temps, la politique internationale acquiert la plus haute signification philosophique, car c'est là que se déroule l'avant-dernier acte, suivi de l'accomplissement de la "fin de l'histoire", c'est-à-dire de la finalisation de l'Esprit devenant absolu. Il n'y a donc rien de plus profond et de plus significatif que les processus qui se déroulent dans les relations internationales à ce stade dialectique. Les relations internationales représentent précisément le moment de l'Esprit, et c'est à ce point décisif que se joue le sort de savoir comment et sur la base de quel État sera construit l'Empire final de l'Esprit (Reich).
Nous approchons ici de l'apothéose du domaine moral lui-même, de son sommet. Toute l'histoire, selon Hegel, est un mouvement vers ce but - vers l'Empire mondial (das Reich) du sens, et les relations internationales en sont proches. C'est le moment où l'avenir projette son ombre la plus épaisse (adumbratio chez Husserl).
Exemples d'États quasi-hégéliens au 20ème siècle
Nous avons vu précédemment que ni une lecture communiste ni une lecture libérale de Hegel ne peuvent nous conduire à cette interprétation des relations internationales, puisqu'elles ne disposent pas d'une théorie de l'État post-démocratique. Cependant, si nous prêtons attention au vingtième siècle, nous verrons que dans la pratique de la politique mondiale, nous avons eu essentiellement affaire à de telles formations.
L'URSS, dans la version de Staline, était un "empire post-bourgeois". Les pays de l'Axe, également post-démocratiques, étaient les plus proches de la monarchie philosophique de Hegel dans leurs justifications théoriques, et même les régimes libéraux de l'Occident - surtout l'Angleterre et les États-Unis - n'ont pas affaibli leur statut d'État, mais - bien que sous la pression de circonstances pragmatiques - ont au contraire créé des systèmes politiques forts et centralisés. Si cette observation est valable, alors nous pouvons proposer une lecture hégélienne des relations internationales au 20ème siècle. Les développements majeurs dans ce domaine acquièrent alors une dimension philosophique vivante et profonde. On peut y voir les trois idéologies politiques qui sont devenues les axes des blocs respectifs - libéral, soviétique et nationaliste. À la veille de la résolution définitive de l'Esprit dans l'Empire mondial (das Reich), les trois idéologies, s'appuyant sur leurs États hôtes, s'affrontent dans la bataille pour la "fin de l'histoire".
Le 20ème siècle et les simulacres d'État
À la fin du 20ème siècle, il est possible de résumer cet affrontement séculaire et d'interpréter les relations internationales de la manière suivante. D'abord, l'alliance de l'URSS (hégéliens de gauche) et de l'Empire bourgeois (représenté par les Anglo-Saxons - hégéliens libéraux par convention) a vaincu les pays de l'Axe (le Troisième Reich d'Hitler et l'Italie fasciste de Mussolini), c'est-à-dire les hégéliens de droite. Puis, pendant la guerre froide, les libéraux ont finalement gagné, et il est significatif que Fukuyama ait écrit son manifeste libéral-hégélien sur la "fin de l'histoire" juste après la chute du système socialiste mondial. Cela coïncide avec le moment unipolaire et, en effet, dans les années 90 du vingtième siècle, il semble que l'"Empire mondial" sera un régime libéral-démocratique établi dans la superpuissance américaine la plus puissante et sans rivale et ses satellites libéraux en Europe et en Asie.
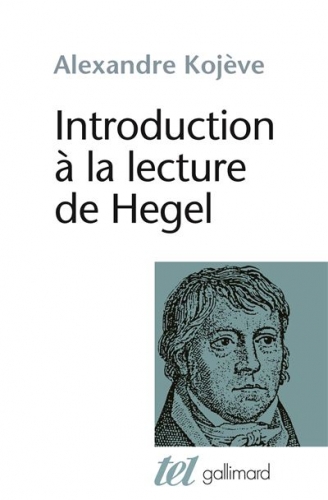 Mais c'est ici que nous sommes confrontés à la contradiction la plus grave. À première vue, la lecture libérale de Hegel, présentée dans ses grandes lignes et en détail dans les ouvrages de Kojève, l'a emporté. Ici aussi, les néoconservateurs américains, issus du trotskisme et donc profondément imprégnés d'hégélianisme, ont joué un rôle majeur. Contre la ligne stalinienne de l'"empire rouge", trop étroitement associée à leurs yeux à l'esprit et à l'identité russes, dans laquelle ils voyaient une trahison de l'internationalisme, les trotskistes américains se sont rangés du côté des libéraux mondialistes pour les aider à achever la construction de la société bourgeoise capitaliste à l'échelle planétaire, pour parvenir à l'abolition totale des nations, des races, des religions et de toutes les identités locales, et créer ainsi les conditions préalables à la réalisation d'une révolution prolétarienne mondiale strictement conforme aux préceptes de Marx, sans craindre de tomber dans le piège du national-bolchevisme stalinien, qui n'était à leurs yeux qu'"une forme de national-socialisme". La révolution mondiale était reportée à la victoire complète du capitalisme mondial.
Mais c'est ici que nous sommes confrontés à la contradiction la plus grave. À première vue, la lecture libérale de Hegel, présentée dans ses grandes lignes et en détail dans les ouvrages de Kojève, l'a emporté. Ici aussi, les néoconservateurs américains, issus du trotskisme et donc profondément imprégnés d'hégélianisme, ont joué un rôle majeur. Contre la ligne stalinienne de l'"empire rouge", trop étroitement associée à leurs yeux à l'esprit et à l'identité russes, dans laquelle ils voyaient une trahison de l'internationalisme, les trotskistes américains se sont rangés du côté des libéraux mondialistes pour les aider à achever la construction de la société bourgeoise capitaliste à l'échelle planétaire, pour parvenir à l'abolition totale des nations, des races, des religions et de toutes les identités locales, et créer ainsi les conditions préalables à la réalisation d'une révolution prolétarienne mondiale strictement conforme aux préceptes de Marx, sans craindre de tomber dans le piège du national-bolchevisme stalinien, qui n'était à leurs yeux qu'"une forme de national-socialisme". La révolution mondiale était reportée à la victoire complète du capitalisme mondial.
Mais ici apparaît une considération essentielle: se situant au niveau de la société civile et n'ayant pas réalisé (contrairement aux hégéliens de droite, plus fidèles à Hegel et à son système) la signification philosophique de l'Etat comme moment d'expression de l'Esprit, les hégéliens libéraux ne pouvaient correspondre pleinement à l'Empire final et prétendre que le libéralisme mondial sous la forme du mondialisme était le couronnement de l'épanouissement de l'Esprit pour lui-même. D'autant plus que les prémisses spirituelles du système hégélien ont été formellement niées par le marxisme et n'ont pas joué un grand rôle pour les libéraux.
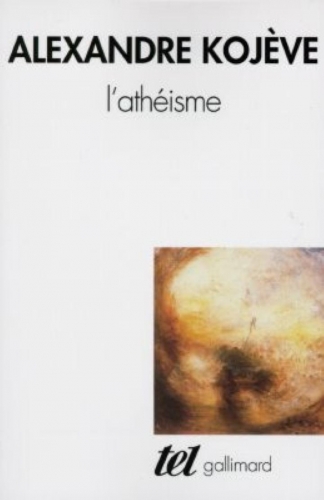 Mais s'il y a un trou noir aux origines du système, c'est ce que la civilisation libérale a dû affronter au moment de son triomphe suprême. Et ce n'est pas un hasard si Alexandre Kojève, hégélien libéral assez conséquent, a accordé tant d'attention au thème de la mort, de la négativité et du néant chez Hegel [9]. Si l'on lit le système hégélien avec les yeux d'un athée (et Kojève a consacré son étude fondamentale à l'athéisme [10]), l'Empire final de l'Esprit (das Reich) se transformera en un triomphe sporadique du nihilisme planétaire.
Mais s'il y a un trou noir aux origines du système, c'est ce que la civilisation libérale a dû affronter au moment de son triomphe suprême. Et ce n'est pas un hasard si Alexandre Kojève, hégélien libéral assez conséquent, a accordé tant d'attention au thème de la mort, de la négativité et du néant chez Hegel [9]. Si l'on lit le système hégélien avec les yeux d'un athée (et Kojève a consacré son étude fondamentale à l'athéisme [10]), l'Empire final de l'Esprit (das Reich) se transformera en un triomphe sporadique du nihilisme planétaire.
C'est exactement ce qui s'est passé au tournant des époques, et qui a été marqué par le premier coup d'éclat de l'islam radical contre les États-Unis, au moment symbolique de la chute des tours jumelles du World Trade Center à New York. Du point de vue de la philosophie des relations internationales selon le modèle hégélien, le 11 septembre 2001 a été le moment clé de tout le vingtième siècle. Au lieu d'un Empire mondial victorieux, c'est l'abîme du néant qui commence à se déployer devant l'humanité.
Il fallait donc ici franchir la ligne et tenter de repenser en termes hégéliens tout ce qui s'était passé et ce qui allait se passer désormais selon la logique fondamentale de Hegel.
Hegel et la carte politique du premier tiers du 21ème siècle
Si nous appliquons l'interprétation authentiquement hégélienne des moments de déploiement de l'Esprit à la situation du premier quart du 21ème siècle, nous obtenons l'image suivante. Les événements du 20ème siècle, malgré leur relative similitude avec la formation de trois États philosophiques (c'est-à-dire idéologiques, fondés sur l'Idée) - le libéralisme, le stalinisme et le fascisme - n'étaient en fait pas un véritable moment des relations internationales en tant qu'antithèse de l'État à part entière et précurseur de la synthèse, mais un monde inversé (verkehrte Welt) situé non pas au-dessus de la société civile, mais en dessous d'elle. Ces trois camps n'étaient pas des États hégéliens au sens plein du terme, ce qui signifie qu'ils restaient au niveau de la société civile, même si celle-ci était déformée. D'ailleurs, la victoire même du libéralisme sous la forme des États-Unis et des Anglo-Saxons en témoigne. Ce n'est pas l'Empire qui a gagné, mais un sous-état de type bourgeois libéral-démocratique (Not-Staat, aussere Staat ou pre-state, vor-Staat [11]). Le mondialisme n'est pas le moment du triomphe de l'Idée, découverte dans le dernier moment du déploiement de l'Esprit, c'est le remaniement des Lumières, qui ont été trop hâtivement enroulées dans des formes étatiques. En d'autres termes, nous ne sommes pas au moment des relations internationales hégéliennes, qui suivent logiquement la création de l'État post-démocratique, mais avant, dans l'état qui précède l'émergence des monarchies philosophiques à part entière.
Des relations internationales qui n'ont jamais existé
C'est ici que se révèle toute l'importance de Hegel pour la théorie du monde multipolaire.
Tout d'abord, les États idéologiques du 20ème siècle, qui se battent entre eux, doivent être reconnus non pas comme trois formes de l'Idée, mais comme des simulacres, c'est-à-dire des versions déformées qui précèdent le véritable original. Ce sont des ombres du futur (des adumbrationes selon Husserl) projetées par de véritables monarchies philosophiques dans lesquelles l'Esprit n'est pas encore incarné. La victoire du libéralisme dans les années 1990 n'a pas été l'accord final des relations internationales, car les sociétés civiles n'ont pas encore été formées en véritables nations.
Une nation, selon Hegel, émerge lorsqu'elle dépasse la société civile, c'est-à-dire le capitalisme. Mais ni l'URSS ni les pays de l'Axe de l'Europe centrale n'ont véritablement surmonté le capitalisme. Par conséquent, la victoire des libéraux a simplement rendu universel le moment de la société civile, c'est-à-dire l'État pré-étatique, pré-philosophique et monarchique. Cela signifie qu'il ne s'agissait pas de la "fin de l'histoire", mais seulement d'une préparation de l'humanité à la phase suivante - la phase des États réels.
Le monde multipolaire est appelé à devenir une telle transition vers le prochain moment de l'ordre moral, lorsqu'un homme nouveau apparaîtra - un homme de l'État philosophique, qui n'abandonnera pas la famille, mais au contraire, enraciné dans sa structure éthique, l'étendra et l'exaltera vers le haut - dans la direction de la monarchie philosophique. Les pôles du monde multipolaire devraient être précisément de telles monarchies philosophiques s'appuyant sur le peuple, formées en surmontant la société civile atomisée et déconnectée. Par conséquent, nous n'avons pas encore dépassé les relations internationales proprement dites, en tant que deuxième moment dialectique sur la voie de l'Empire mondial (Das Reich). Il est devant nous.
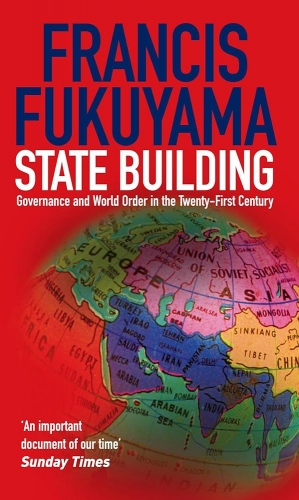 En outre, les États à part entière au sens hégélien du terme n'ont pas encore totalement émergé. La Chine et la Russie sont aujourd'hui les plus proches de la création d'une monarchie philosophique, et l'Inde s'oriente partiellement dans cette direction. Mais le moment clé sera la mutation dialectique nécessaire de l'Occident, lorsque là aussi, au lieu d'un pseudo-empire libéral, un véritable État émergera, et non un Not-Staat libéral, comme c'est le cas aujourd'hui. Même un libéral hégélien comme Fukuyama s'en est rendu compte, admettant que sa version de la "fin de l'histoire" a échoué et proclamant une orientation vers la "construction de l'État" [12]. Mais pour un libéral convaincu, il est difficile de comprendre la valeur philosophique du dépassement de la démocratie et du passage à l'organisation verticale de la monarchie. Par conséquent, la tentative de créer véritablement quelque chose de similaire à l'État hégélien tout en préservant le libéralisme et la société civile, bien que sous une forme modifiée, contient une contradiction irréductible. Les théoriciens et, plus encore, les praticiens de la construction d'un véritable État en Occident attendent toujours leur heure.
En outre, les États à part entière au sens hégélien du terme n'ont pas encore totalement émergé. La Chine et la Russie sont aujourd'hui les plus proches de la création d'une monarchie philosophique, et l'Inde s'oriente partiellement dans cette direction. Mais le moment clé sera la mutation dialectique nécessaire de l'Occident, lorsque là aussi, au lieu d'un pseudo-empire libéral, un véritable État émergera, et non un Not-Staat libéral, comme c'est le cas aujourd'hui. Même un libéral hégélien comme Fukuyama s'en est rendu compte, admettant que sa version de la "fin de l'histoire" a échoué et proclamant une orientation vers la "construction de l'État" [12]. Mais pour un libéral convaincu, il est difficile de comprendre la valeur philosophique du dépassement de la démocratie et du passage à l'organisation verticale de la monarchie. Par conséquent, la tentative de créer véritablement quelque chose de similaire à l'État hégélien tout en préservant le libéralisme et la société civile, bien que sous une forme modifiée, contient une contradiction irréductible. Les théoriciens et, plus encore, les praticiens de la construction d'un véritable État en Occident attendent toujours leur heure.
Et ce n'est que lorsque le monde multipolaire sera plus ou moins construit, c'est-à-dire lorsqu'un certain nombre de monarchies philosophiques post-démocratiques (constitutionnelles) et d'États hiérarchiques illibéraux à part entière émergeront dans le monde, construits conformément aux fondements du moment moral et sous l'influence directe de l'Esprit, aspirant à une expression de soi pleine et absolue, que nous passerons à la phase dialectique suivante, qui, pour la première fois, correspond véritablement à ce que Hegel entendait par "relations internationales". Ce n'est qu'à partir de cette position d'immersion dans le monde multipolaire que nous pourrons envisager l'avenir ultime dans la perspective ultime et nous faire une première idée de ce que sera le véritable Empire final de l'Esprit (das geistliche Reich), c'est-à-dire l'Idée universelle parvenue à son expression parfaite et donc la "fin de l'histoire".
Influence du système de Hegel sur la politique allemande
Dans la doctrine de l'État de Hegel, la clé est sa relation dialectique avec la société civile. Il convient ici de tenir compte de l'époque à laquelle Hegel écrivait. La Révolution française et le Siècle des Lumières ont clairement opposé la société civile aux anciennes monarchies. Le capitalisme et l'idéologie bourgeoise progressaient activement dans tous les pays européens. C'est à cette époque que Hegel crée la Philosophie du droit, dans laquelle il justifie le statut métaphysique et dialectique de l'État. Il ne parle pas simplement de l'État, qui comprendrait les anciennes monarchies européennes, mais d'un nouvel État, qui est un concept philosophique. En cela, il rejoint Platon. Le véritable État n'est que celui qui est établi et gouverné par des philosophes. Hegel insiste sur le fait qu'un tel État philosophique n'est possible qu'après la société civile. Avant la société civile, l'État est organique et immanent ; il n'a pas la pleine conscience de soi nécessaire au domaine de la moralité. Et la société civile elle-même ne peut établir l'État qu'à l'extérieur (aussere Staat [13]), comme un "gardien de nuit" dont le sort sera terminé lorsque la société civile pourra s'en passer (idée de Locke).
Pour parvenir à l'état philosophique, une société civile rationnelle et volontaire - morale au sens de Kant et déjà morale, c'est-à-dire fondée sur la famille (tout cela est présent dans le deuxième moment de la dialectique de la morale sous une forme dépouillée) - doit se résoudre à se dépasser elle-même. Non pas au sens de Hobbes, sous l'influence des circonstances (tel est l'ancien état), mais de bonne volonté - comme indicateur de maturité morale et de perspicacité philosophique. Le nouvel État doit être un acte de renoncement de la bourgeoisie libérale à elle-même, c'est-à-dire le dépassement du capitalisme, son élimination. Une fois la société civile abolie dans l'État, il n'est plus possible d'y revenir. La bourgeoisie cède le pouvoir au monarque philosophique, en qui l'idée morale se révèle pleinement.
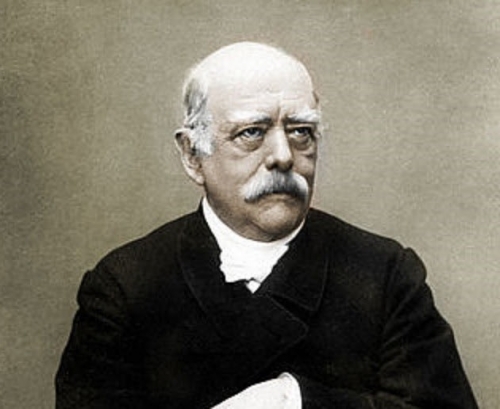
Hegel écrit ses œuvres à la veille de l'émergence de l'Empire allemand sur la base de la Prusse des Hohenzollern. En effet, contrairement à l'empire austro-hongrois des Habsbourg, le Deuxième Reich allait devenir l'expression historique du nouvel État de Hegel. C'est ainsi que les hégéliens ont perçu la création de l'Empire allemand par Bismarck. Et le mérite de Hegel dans la justification métaphysique, l'affirmation philosophique de cet Empire fut d'abord reconnu par tous. L'esprit prussien, minutieusement disséqué par Spengler [14], soulignait justement ceci : dans l'Empire allemand, le principe du service militaire abolissait l'individualisme bourgeois.
Dans une telle situation, les relations internationales décidaient de tout, car, selon Hegel, après son établissement, l'État philosophique entrait dans le moment dialectique qui suit la formation de l'État - le système des relations internationales. C'est ainsi que la politique internationale a acquis son contenu philosophique.
La Première Guerre mondiale a été le point culminant de la mise à l'épreuve par l'Allemagne de sa place dans la dialectique de l'Esprit. Le nouvel État, l'Empire allemand de Guillaume II Hohenzollern, et l'ancien État, l'Empire austro-hongrois des Habsbourg (dans lequel la société civile non seulement n'a pas été supprimée, mais s'est épanouie) se sont heurtés à l'Entente libérale, à laquelle l'Empire russe pré-bourgeois s'est joint par une incompréhension philosophique totale et contre toute logique. Le résultat est connu.
Mais d'un point de vue philosophique, ce qui suit est important: le Deuxième Reich n'est pas devenu un État philosophique au sens plein du terme, ce qui s'est révélé lorsque, après la défaite de l'Allemagne lors de la Première Guerre mondiale, la société allemande est retombée dans le libéralisme. La République de Weimar était une société civile typique dans laquelle les vestiges du IIème Reich se sont progressivement dissous. Par conséquent, cette société civile n'a pas été véritablement dépassée et l'Empire allemand s'est avéré être un simulacre par rapport au modèle de forme hégélienne.
La deuxième tentative d'établir un État post-bourgeois sous Hitler s'est également avérée être un simulacre. Le national-socialisme - du moins le "national-socialisme spirituel" auquel Heidegger faisait référence - a été conceptualisé dans certains cercles philosophiques comme un nouvel effort pour transformer la société civile (cette fois-ci, celle de la République de Weimar) en un peuple et construire un État philosophique.
Une fois de plus, la politique internationale est un affrontement entre le Troisième Reich, qui se veut un État philosophique, et le camp libéral auquel Staline s'est rallié. Du point de vue de la théorie marxiste, l'URSS est l'expression d'une société post-bourgeoise - mais civile ! - mais dans la pratique, le système stalinien ressemblait davantage à un modèle d'État éthique, c'est-à-dire à une version de l'hégélianisme qui supprimait le capitalisme. Les philosophes au pouvoir en URSS ont été remplacés par des bolcheviks idéologues. Cette caractéristique idéocratique du régime soviétique a été parfaitement comprise par les Eurasiens russes [15]. De nouveau, l'alliance contre nature dans les relations internationales (bourgeoisie et anti-bourgeoisie) et la défaite de l'Allemagne.
L'Allemagne s'est alors effondrée dans la société civile et a perdu toute subjectivité, avant de se fondre dans l'Union européenne et la mondialisation.
Qu'est-ce que cela signifie du point de vue de Hegel ? Une seule chose: ni le deuxième ni le troisième Reich n'étaient des États philosophiques. Ils appartenaient au siècle des Lumières, qu'ils n'ont pas réussi à dépasser. Quel que soit le degré de dépassement de la société civile, le capitalisme les a empêchés de passer véritablement à la phase historique suivante de l'épanouissement de l'Esprit. Il ne s'agissait pas de nouveaux États dotés d'une idée directrice, mais seulement de tentatives infructueuses de fonder un tel État. La pensée de Hegel ne se réfère donc pas à une description du passé, mais à un aperçu de l'avenir. L'Occident n'a toujours pas d'État au sens hégélien du terme, comme le soulignent la généralisation du mondialisme libéral et l'abolition parallèle des États traditionnels en Europe.
L'Occident n'a pas encore créé ce qu'il convient d'appeler un "État" au sens de la morale de Hegel. Cela signifie que les relations internationales n'ont pas encore acquis cette charge philosophique qui n'apparaît qu'à l'approche de la "fin de l'histoire", c'est-à-dire de l'Empire mondial de l'esprit (das geistliche Reich) et de l'Idée universelle.
La multipolarité : l'avènement de l'avenir
Dans sa phase actuelle, le monde multipolaire représente les premières tentatives systémiques de surmonter la société civile, qui s'incarne aujourd'hui dans la diffusion mondiale du capitalisme et du libéralisme. Les tendances illibérales dans les pôles du monde multipolaire - en Chine, en Russie, dans le monde islamique, etc. - sont les premiers signes du mouvement vers le nouvel État, selon Hegel. Il s'agit ici d'un mouvement dialectique vers la disparition du capitalisme. En Chine, l'accent est mis plus clairement, en Russie moins. Un certain nombre d'idéologues islamiques le comprennent très bien. En d'autres termes, nous sommes à l'aube de l'émergence d'États au sens hégélien du terme.
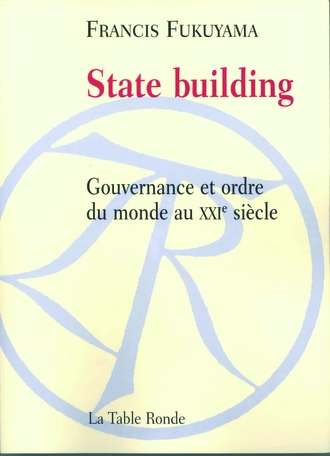 Tant que l'Occident s'identifie à la société civile et reste complètement dans le cadre des Lumières et de l'idéologie libérale, il n'y a pas lieu de parler d'État au sens hégélien. Ainsi, toutes les tentatives de Fukuyama pour justifier une nouvelle "construction de l'État" ne s'éloignent pas des théories de Locke ou de Voltaire sur le rôle des gouvernants éclairés qui doivent préparer la société à la démocratie. Selon Fukuyama, les régimes politiques modernes de l'Occident n'ont pas tout à fait rempli cette fonction, de sorte qu'une période préparatoire de gouvernement oligarchique par des élites libérales minoritaires et éclairées est nécessaire. Mais tout cela ne sert qu'à mettre en œuvre de manière encore plus efficace les normes de la société civile à l'échelle planétaire, et non à les surmonter. Cela signifie qu'un État hégélien est hors de question.
Tant que l'Occident s'identifie à la société civile et reste complètement dans le cadre des Lumières et de l'idéologie libérale, il n'y a pas lieu de parler d'État au sens hégélien. Ainsi, toutes les tentatives de Fukuyama pour justifier une nouvelle "construction de l'État" ne s'éloignent pas des théories de Locke ou de Voltaire sur le rôle des gouvernants éclairés qui doivent préparer la société à la démocratie. Selon Fukuyama, les régimes politiques modernes de l'Occident n'ont pas tout à fait rempli cette fonction, de sorte qu'une période préparatoire de gouvernement oligarchique par des élites libérales minoritaires et éclairées est nécessaire. Mais tout cela ne sert qu'à mettre en œuvre de manière encore plus efficace les normes de la société civile à l'échelle planétaire, et non à les surmonter. Cela signifie qu'un État hégélien est hors de question.
Mais en même temps, il n'est pas exclu qu'en réponse au renforcement des pôles illibéraux face aux États non occidentaux, l'Occident lui-même se tourne un jour vers l'horizon illibéral. Jusqu'à présent, il s'agit de tendances périphériques, instantanément absorbées par la dictature du libéralisme. Cela signifie que jusqu'à présent, l'Occident n'est pas dans l'élément des relations internationales au sens hégélien, puisqu'il n'a même pas encore atteint le niveau de l'État. Mais l'urgence est de plus en plus grande et les premières manifestations en sont les poussées des courants d'extrême droite, tant en Europe qu'aux États-Unis. À la périphérie du monde occidental, cela se manifeste par le soutien de l'Occident à des mandataires racistes tels que l'Ukraine ou Israël. En principe, Israël, en tant que phénomène régional, est un modèle de ce que l'Occident pourrait devenir s'il s'engageait sur la voie du dépassement de la société civile en direction d'une certaine idéocratie illibérale. Il ne s'agit cependant pas d'un projet d'avenir, mais plutôt d'une lueur du nationalisme européen et même du racisme, qui a été autorisé par l'Occident en Israël en vertu d'une complicité morale dans les souffrances des Juifs à l'époque nazie.
Mais ce retour à l'État au sens hégélien du terme exigera de l'Occident qu'il abandonne complètement le libéralisme, qu'il le surmonte consciemment. Jusqu'à ce que cela se produise, l'Occident en tant que civilisation restera sur la spirale précédente (au niveau du Not-Staat), ce qui, en soi, peut conduire à sa dégradation rapide face à l'édification d'un État à part entière auprès des autres pôles.
Les relations internationales et l'apocalypse
Relions maintenant la lecture hégélienne du monde multipolaire à la manière dont la tradition chrétienne décrit l'époque immédiatement adjacente à la fin des temps (c'est-à-dire la "fin de l'histoire" de Hegel).
La fin réelle de l'histoire, qui pour Hegel est l'achèvement du cycle d'autodécouverte de l'Esprit devenant absolu, est comprise par le christianisme comme la seconde venue du Christ et la descente de la Jérusalem céleste sur terre, décrite dans l'Apocalypse de saint Jean le Théologien. C'est l'émergence d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre. Ce n'est qu'ainsi que pourra se réaliser la véritable unité de l'humanité, au moment de la résurrection des morts et du Jugement dernier. L'Empire de l'Esprit (das geistliche Reich) peut être compris comme le Royaume des Cieux (das himmliche Reich) ou le Royaume de Dieu (das Gottesreich). Puisque Hegel voit dans la politique et l'histoire le déploiement de l'Esprit, une telle corrélation est tout à fait appropriée et clarifie mieux la pensée et l'ensemble du système de Hegel, qui était chrétien et a certainement construit sa théorie sur une base chrétienne (même s'il ne l'a pas toujours suffisamment souligné). C'est cette lecture qui serait la plus proche de Hegel lui-même, à l'opposé des interprétations laïques, athées et matérialistes de l'hégélianisme de gauche et des libéraux.

Si tel est le cas, les relations internationales entre les États précédant immédiatement le phénomène de la nouvelle Jérusalem seraient aussi logiquement placées dans le contexte de l'Apocalypse. Peut-être les États de Hegel correspondraient-ils alors aux images des anges participant au drame apocalyptique, ainsi qu'aux figures des bêtes de la mer et de la terre, qui rappellent clairement le Léviathan et le Béhémoth du livre de Job. Il est significatif que Hobbes ait choisi le Léviathan comme principale métaphore pour décrire son État. Dans ses textes géopolitiques, Carl Schmitt identifie le Léviathan à la puissance maritime (Sea Power) et les Béhémoths à la puissance terrestre (Land Power) [16]. Ils sont à leur tour en corrélation avec la Grande-Bretagne et les États-Unis (Sea Power, pays de l'OTAN, atlantisme) et la Russie (Land Power, Eurasie), c'est-à-dire avec les deux pôles du monde multipolaire.
Si la corrélation de certaines figures de l'Apocalypse avec les États du monde multipolaire repose sur une tradition stable en philosophie politique et en géopolitique, en raison de la dimension spirituelle de la théorie de Hegel, et parce que pour lui l'histoire et sa dialectique sont le déploiement des moments de l'Esprit, nous pouvons supposer que dans l'Apocalypse, le monde est en train de se transformer en un monde multipolaire, nous pouvons supposer que dans la réalité apocalyptique, non seulement la bête de la mer et la bête de la terre peuvent représenter des États, mais aussi d'autres figures - surtout les anges, qui sont décrits comme des armées, des armées qui combattent les armées adverses de démons sous l'égide de Satan. Les armées sont une fonction de l'État, et l'armée céleste ainsi que les forces de l'enfer sont également en corrélation avec les États, puisque l'armée est l'une des caractéristiques les plus frappantes de l'État en tant que tel.
Dans ce cas, nous pouvons considérer les événements décrits dans l'Apocalypse comme une carte symbolique des relations internationales à l'époque finale précédant immédiatement la "fin de l'histoire", c'est-à-dire la fin des temps.
Cette interprétation correspond bien à la théorie de Hegel lui-même, qui n'était ni athée ni matérialiste, mais au contraire chrétien. Mais il faut noter ici l'essentiel: les pôles du monde multipolaire sont des États au sens hégélien, c'est-à-dire des entités dans lesquelles la société civile a été fondamentalement et irréversiblement vaincue, c'est-à-dire le capitalisme, le système bourgeois et l'idéologie libérale. Ce n'est qu'au cours de l'élimination du libéralisme en tant que négation de la négation de la négation que la formation des États a lieu. Cela indique que malgré tous les signes de proximité de l'Apocalypse, particulièrement évidents dans la société libérale occidentale, l'humanité a encore un autre cycle à traverser, qui, en termes d'importance et de signification, dépasse de loin tous les précédents. Et le système des relations internationales du monde multipolaire, du fait de sa proximité avec la fin de l'histoire du monde, est doté d'une signification colossale du point de vue de l'histoire de l'Esprit. En effet, les images apocalyptiques d'anges et de démons indiquent symboliquement la participation directe et ouverte des esprits (célestes et souterrains) à l'aboutissement de l'histoire du monde.
Ainsi, le monde multipolaire n'apparaît pas comme une forme d'existence stable et sans problème, mais comme un moment extrêmement intense de l'histoire du monde, dynamique, extrêmement significatif et décisif en ce qui concerne les significations historiques finales les plus profondes.
Notes:
[1] Гегель Г.Ф.В. Философия права. М.: Азбука,2023.
[2] Фихте И.Г. Наукоучение. М.: Издательство «Логос»; Издательская группа «Прогресс», 2000.
[3] Мартин Хайдеггер предлагал толковать aufheben у Гегеля через три смысла, отраженных в латинчких глаголах tollere, conservare, elevare.
[4] Шмитт К. Политическая теология. М:. Канон-Пресс-Ц, 2000.
[5] Heidegger M. Seminare: Hegel – Schelling. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann, 2011. S. 115.
[6] Кожев А. Из Введения в прочтение Гегеля. Конец истории//Танатография Эроса, СПб:Мифрил, 1994.
[7] Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М.: ACT; Полиграфиздат, 2010.
[8] Те государства, которые не превосходят гражданское общество, а пытаются служить ему, Гегель называет «государством нужды» (Not-Staat) или «внешним государством» (aussere Staat). Heidegger M. Seminare: Hegel – Schelling. S. 607.
[9] Кожев А. В. Идея смерти в философии Гегеля. М.: Логос; Прогресс-Традиция, 1998.
[10] Кожев А. В. Атеизм и другие работы. М.: Праксис, 2007.
[11] Heidegger M. Seminare: Hegel – Schelling. S. 607.
[12] Fukuyama F. State-Building: Governance and World Order in the 21st Century. NY: Cornell University Press, 2004.
[13] Heidegger M. Seminare: Hegel – Schelling. S. 607.
[14] Шпенглер О. Пруссачество и социализм. М.: Праксис, 2002.
[15] Трубецкой Н.С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 1999.
[16] Шмитт К. Земля и море/Дугин А.Г. Основы геополитики. М.: Арктогея-Центр, 2000.
15:28 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hegel, alexandre douguine, relations internationales, politique internationale, philosophie, philosophie de l'histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 07 décembre 2023
Alexandre Douguine: le réalisme dans les relations internationales

Le réalisme dans les relations internationales
Alexandre Douguine
Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/realism-international-relations
Alexandre Douguine examine le monde multipolaire émergent, en soulignant les voies idéologiques et civilisationnelles distinctes de diverses régions du monde, en opposition au paradigme libéral occidental.
Les réalistes pensent que la nature humaine est intrinsèquement viciée (héritage du pessimisme anthropologique de Hobbes et, plus profondément encore, échos des notions chrétiennes de déchéance - lapsus en latin) et qu'elle ne peut être fondamentalement corrigée. Par conséquent, l'égoïsme, la prédation et la violence sont inéluctables. On en conclut que seul un État fort peut contenir et organiser les humains (qui, selon Hobbes, sont des loups les uns pour les autres). L'État est une inévitable nécessité et détient dès lors la plus haute souveraineté. En outre, l'État projette la nature prédatrice et égoïste de l'homme, de sorte qu'un État national a ses intérêts qui sont ses seules considérations. La volonté de violence et la cupidité rendent la guerre toujours possible. Cela a toujours été et sera toujours le cas, estiment les réalistes. Les relations internationales ne se construisent donc que sur l'équilibre des forces entre des entités pleinement souveraines. Il ne peut y avoir un ordre mondial capable de tenir sur le long terme; il n'y a que le chaos, qui évolue au fur et à mesure que certains États s'affaiblissent et que d'autres se renforcent. Dans cette théorie, le terme "chaos" n'est pas négatif, il ne fait que constater l'état de fait résultant de l'approche la plus sérieuse du concept de souveraineté. S'il existe plusieurs États véritablement souverains, il n'est pas possible d'établir un ordre supranational auquel tous obéiraient. Si un tel ordre existait, la souveraineté ne serait pas complète, et en fait, il n'y en aurait pas, et l'entité supranationale elle-même serait la seule souveraine.

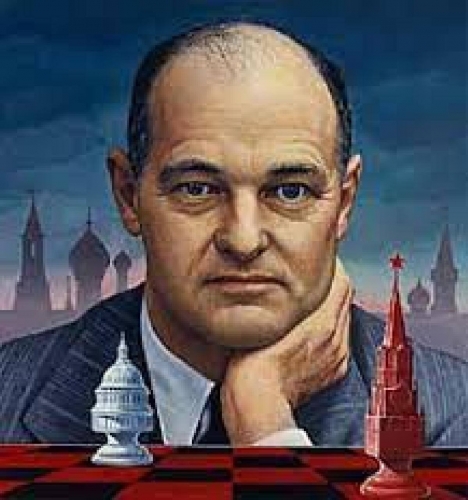
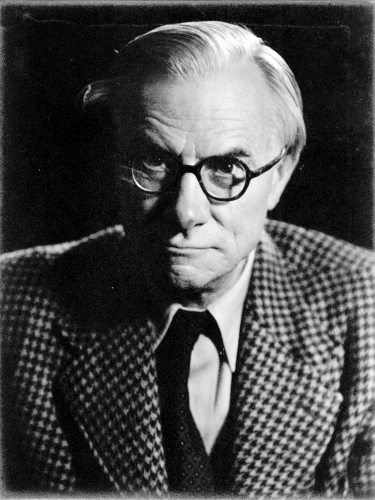
L'école du réalisme est traditionnellement très forte aux États-Unis, à commencer par ses premiers fondateurs : les Américains Hans Morgenthau et George Kennan, et l'Anglais Edward Carr.
Le libéralisme dans les relations internationales
Les libéraux en relations internationales s'opposent à l'école réaliste. Ils s'appuient non pas sur Hobbes et son pessimisme anthropologique, mais sur Locke et sa conception de l'être humain comme une table rase (tabula rasa) et en partie sur Kant et son pacifisme, qui découle de la morale de la raison pratique et de son universalité. Les libéraux en relations internationales croient que les gens peuvent être changés par la rééducation et l'intériorisation des principes des Lumières. C'est d'ailleurs là le projet des Lumières: transformer l'égoïste prédateur en un altruiste rationnel et tolérant, prêt à considérer les autres et à les traiter avec raison et tolérance. D'où la théorie du progrès. Si les réalistes pensent que la nature humaine ne peut être changée, les libéraux sont convaincus qu'elle peut et doit l'être. Mais tous deux pensent que les humains sont d'anciens singes. Les réalistes l'acceptent comme un fait inéluctable (l'homme est un loup pour l'homme), tandis que les libéraux sont convaincus que la société peut changer la nature même de l'ancien singe et écrire ce qu'elle veut sur son "ardoise vierge".
Mais si c'est le cas, l'État n'est nécessaire que pour l'éveil. Ses fonctions s'arrêtent là, et lorsque la société devient suffisamment libérale et civique, l'État peut être dissous. La souveraineté n'a donc rien d'absolu, c'est une mesure temporaire. Et si l'État ne vise pas à rendre ses sujets libéraux, il devient mauvais. Seul un État libéral peut exister, car "les démocraties ne se combattent pas".
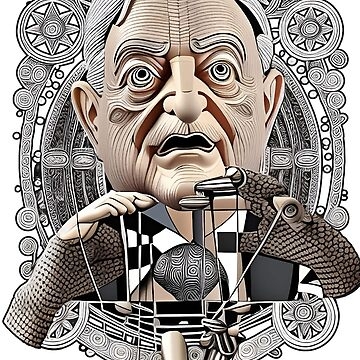
Mais ces États libéraux doivent s'éteindre progressivement pour laisser place à un gouvernement mondial. Ayant préparé la société civile, ils s'abolissent eux-mêmes. Cette abolition progressive des États est un progrès inconditionnel. C'est précisément cette logique que l'on retrouve dans l'Union européenne actuelle. Et les globalistes américains, parmi lesquels Biden, Obama, ou le promoteur de la "société ouverte" George Soros, précisent qu'au cours du déroulement du progrès, le gouvernement mondial se formera sur la base des États-Unis et de ses satellites directs - c'est le projet de la ligue des démocraties.
D'un point de vue technique, le libéralisme dans les relations internationales, opposé au réalisme, est souvent appelé "idéalisme". En d'autres termes, les réalistes en relations internationales croient que l'humanité est condamnée à rester telle qu'elle a toujours été, tandis que les libéraux en relations internationales croient "idéalement" au progrès, à la possibilité de changer la nature même de l'homme. La théorie du genre et le posthumanisme appartiennent à ce type d'idéologie - ils sont issus du libéralisme.
Le marxisme dans les relations internationales
Le marxisme est une autre orientation des relations internationales qui mérite d'être mentionnée. Ici, le "marxisme" n'est pas tout à fait ce qui constituait le cœur de la politique étrangère de l'URSS. Edward Carr, un réaliste classique en matière de relations internationales, a démontré que la politique étrangère de l'URSS - en particulier sous Staline - était fondée sur les principes du réalisme pur. Les mesures pratiques de Staline reposaient sur le principe de la pleine souveraineté, qu'il associait non pas tant à l'État national qu'à son "Empire rouge" et à ses intérêts.
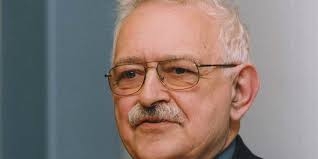
Ce que l'on appelle le "marxisme dans les relations internationales" est davantage représenté par le trotskisme ou les théories du système mondial d'Immanuel Wallerstein (photo). Il s'agit également d'une forme d'idéalisme, mais d'un idéalisme posé comme "prolétarien".
Le monde y est considéré comme une zone unique de progrès social, grâce à laquelle le système capitaliste est destiné à devenir global. C'est-à-dire que tout va vers la création d'un gouvernement mondial sous l'hégémonie complète du capital mondial, qui est international par nature. Ici, comme chez les libéraux, l'essence de l'être humain dépend de la société ou, plus précisément, du rapport à la propriété des moyens de production. La nature humaine est donc de classe. La société élimine la bête en lui mais le transforme en un rouage social, entièrement dépendant de la structure de classe. L'homme ne vit pas et ne pense pas, c'est la classe qui vit et pense à travers lui.
Cependant, contrairement au libéralisme dans les relations internationales, les marxistes dans les relations internationales croient que la création d'un gouvernement mondial et l'intégration complète de l'humanité sans États ni cultures ne seront pas la fin de l'histoire. Après cela (mais pas avant, et c'est là la principale différence avec le système soviétique, avec le "stalinisme"), les contradictions de classe atteindront leur point culminant et une révolution mondiale se produira. L'erreur du stalinisme est ici considérée comme la tentative de construire le socialisme dans un seul pays, ce qui conduit à une version de gauche du national-socialisme. Ce n'est que lorsque le capitalisme aura achevé sa mission de destruction des États et d'abolition des souverainetés qu'une véritable révolution prolétarienne internationale pourra se produire. D'ici là, il est nécessaire de soutenir le capitalisme - et surtout l'immigration de masse, l'idéologie des droits de l'homme, toutes les sortes de minorités, et en particulier les minorités sexuelles.
Le marxisme contemporain est principalement pro-libéral, mondialiste et accélérationniste.
Le réalisme dans la théorie d'un monde multipolaire
La question se pose ici de savoir ce qui est le plus proche de la théorie d'un monde multipolaire : le réalisme ou le libéralisme ? Le réalisme ou l'idéalisme ?
Pour rappel, dans cette théorie, le sujet n'est pas l'État-nation bourgeois classique de l'époque moderne (dans l'esprit du système westphalien et de la théorie de la souveraineté de Machiavel-Bodin), mais l'État-civilisation (Zhang Weiwei) ou le "grand espace" (Carl Schmitt). Samuel Huntington a esquissé avec perspicacité un tel ordre mondial multipolaire au début des années 1990. Plusieurs États-civilisations, après avoir mené à bien des processus d'intégration régionale, deviennent des centres indépendants de la politique mondiale. J'ai développé ce thème dans la Théorie d'un monde multipolaire.

À première vue, la théorie d'un monde multipolaire concerne la souveraineté. Et cela signifie le réalisme. Mais avec une mise en garde très importante : ici, le détenteur de la souveraineté n'est pas seulement un État-nation représentant un ensemble de citoyens individuels, mais un État-civilisation, dans lequel des peuples et des cultures tout entiers sont unis sous la direction d'un horizon supérieur - religion, mission historique, idée dominante (comme chez les eurasistes). L'État-civilisation est un nouveau nom purement technique pour l'empire. Chinois, islamique, russe, ottoman et, bien sûr, occidental. Ces États-civilisations ont défini l'équilibre de la politique planétaire à l'ère précolombienne. La colonisation et la montée en puissance de l'Occident à l'époque moderne ont modifié cet équilibre en faveur de l'Occident. Aujourd'hui, une certaine correction historique est en cours. Le non-Occident se réaffirme. La Russie se bat contre l'Occident en Ukraine pour le contrôle d'une zone liminale de cruciale importance. La Chine se bat pour dominer l'économie mondiale. L'Islam mène un djihad culturel et religieux contre l'impérialisme et l'hégémonie de l'Occident. L'Inde devient un sujet mondial à part entière. Les ressources et le potentiel démographique de l'Afrique en font automatiquement un acteur majeur dans un avenir proche. L'Amérique latine affirme également ses droits à l'indépendance.
Les nouveaux sujets - des États-civilisations et, pour l'instant, seulement des civilisations, qui envisagent de plus en plus de s'intégrer dans des blocs souverains et puissants, les "grands espaces" - sont conçus comme de nouvelles figures du réalisme planétaire.
Mais contrairement aux États-nations conventionnels, créés dans le moule des régimes bourgeois européens de l'ère moderne, les États-civilisations sont déjà intrinsèquement plus qu'un amalgame aléatoire d'animaux agressifs et égoïstes, comme les réalistes occidentaux conçoivent la société. Contrairement aux États ordinaires, un État-civilisation est construit autour d'une mission, d'une idée et d'un système de valeurs qui ne sont pas seulement pratiques et pragmatiques. Cela signifie que le principe du réalisme, qui ne prend pas en compte cette dimension idéale, ne peut s'appliquer pleinement ici. Il s'agit donc d'un idéalisme, fondamentalement différent du libéralisme, puisque le libéralisme est l'idéologie dominante d'une seule civilisation, la civilisation occidentale. Toutes les autres, étant uniques et s'appuyant sur leurs valeurs traditionnelles, sont orientées vers d'autres idées. Par conséquent, nous pouvons qualifier d'illibéral l'idéalisme des civilisations non occidentales montantes, qui forment un monde multipolaire.
Dans la théorie d'un monde multipolaire, les États-civilisations adoptent donc simultanément des éléments du réalisme et du libéralisme dans les relations internationales.

Du réalisme, elles retiennent le principe de la souveraineté absolue et l'absence de toute autorité obligatoire et contraignante au niveau planétaire. Chaque civilisation est pleinement souveraine et ne se soumet à aucun gouvernement mondial. Ainsi, entre les Etats-civilisations, il existe un "chaos" conditionnel, comme dans les théories du réalisme classique. Mais contrairement à ces théories, nous traitons d'un sujet différent - non pas d'un État-nation constitué selon les principes des temps modernes européens, mais d'un système fondamentalement différent basé sur une compréhension autonome de l'homme, de Dieu, de la société, de l'espace et du temps, découlant des spécificités d'un code culturel particulier - eurasien, chinois, islamique, indien, etc.
Un tel réalisme peut être qualifié de civilisationnel, et il n'est pas fondé sur la logique de Hobbes, justifiant l'existence du Léviathan par la nature intrinsèquement imparfaite et agressive des bêtes humaines, mais sur la croyance de grandes sociétés, unies par une tradition commune (souvent sacrée) dans la suprématie des idées et des normes qu'elles considèrent comme universelles. Cette universalité est limitée au "grand espace", c'est-à-dire aux frontières d'un empire spécifique. Au sein de ce "grand espace", elle est reconnue et constitutive. C'est le fondement de sa souveraineté. Mais dans ce cas, elle n'est pas égoïste et matérielle, mais sacrée et spirituelle.
L'idéalisme dans la théorie d'un monde multipolaire
Mais en même temps, nous voyons ici un idéalisme clair. Il ne s'agit pas de l'idéalisme de Locke ou de Kant, car il n'y a pas d'universalisme, pas de notion de "valeurs humaines universelles" qui sont obligatoires et pour lesquelles la souveraineté doit être sacrifiée. Cet idéalisme civilisationnel n'est pas du tout libéral, et encore moins illibéral. Chaque civilisation croit à l'absoluité de ses valeurs traditionnelles, et elles sont toutes très différentes de ce que propose l'Occident mondialiste contemporain. Les religions sont différentes, les anthropologies sont différentes, les ontologies sont différentes. Et la science politique, qui se résume à la science politique américaine, où tout est construit sur l'opposition entre "démocraties" et "régimes autoritaires", est complètement niée. Il y a de l'idéalisme, mais pas en faveur de la démocratie libérale comme "but et sommet du progrès". Chaque civilisation a son idéal. Parfois, il n'est pas du tout similaire à celui de l'Occident. Parfois, il est similaire, mais seulement en partie. C'est l'essence même de l'illibéralisme: les thèses de la civilisation libérale occidentale contemporaine en tant que modèle universel sont rejetées. Et à leur place, chaque civilisation propose son système de valeurs traditionnelles - russe, chinoise, islamique, indienne, etc.
Dans le cas des civilisations d'État, l'idéalisme est associé à une idée spécifique qui reflète les objectifs, les fondements et les orientations de cette civilisation. Il ne s'agit pas seulement de s'appuyer sur l'histoire et le passé, mais d'un projet qui nécessite une concentration des efforts, de la volonté et un horizon intellectuel important. Cette idée est d'une autre nature que le simple calcul des intérêts nationaux, qui limite le réalisme. La présence d'un objectif supérieur (en quelque sorte transcendantal) détermine le vecteur de l'avenir, la voie du développement conformément à ce que chaque civilisation considère comme bon et le guide de son existence historique. Comme dans l'idéalisme libéral, il s'agit de tendre vers ce qui devrait être, ce qui définit les objectifs et les moyens d'avancer dans l'avenir. Mais l'idéal lui-même est ici fondamentalement différent: au lieu de l'individualisme ultime, du matérialisme et de la perfection des aspects purement techniques de la société, que l'Occident libéral cherche à affirmer comme un critère humain universel, reflétant uniquement la tendance historico-culturelle de l'Occident à l'ère postmoderne, chacune des civilisations non occidentales met en avant sa propre forme. Cette forme peut très bien contenir la prétention à devenir universelle à son tour, mais à la différence de l'Occident, les civilisations-états reconnaissent la légitimité des autres formes et en tiennent compte. Le monde multipolaire est intrinsèquement construit sur la reconnaissance de l'Autre, qui est proche et qui peut ne pas coïncider dans ses intérêts ou ses valeurs. Ainsi, la multipolarité reconnaît le pluralisme des idées et des idéaux, les prend en compte et ne dénie pas à l'Autre le droit d'exister et d'être différent. C'est la principale différence entre l'unipolarité et la multipolarité.

L'Occident libéral part du principe que toute l'humanité n'a qu'un seul idéal et qu'un seul vecteur de développement: le vecteur occidental. Tout ce qui est lié à l'Autre et qui ne coïncide pas avec l'identité et le système de valeurs de l'Occident lui-même est considéré comme "hostile", "autoritaire" et "illégitime". Dans le meilleur des cas, il est considéré comme "en retard sur l'Occident", ce qui doit être corrigé. Par conséquent, l'idéalisme libéral dans son expression mondialiste coïncide en pratique avec le racisme culturel, l'impérialisme et l'hégémonie. Les États-civilisations du modèle multipolaire opposent à cet "idéal" leurs propres conceptions et orientations.
Versions de l'idée illibérale
La Russie a traditionnellement tenté de justifier une puissance continentale eurasienne fondée sur les valeurs du collectivisme, de la solidarité et de la justice, ainsi que sur les traditions orthodoxes. Il s'agit là d'un idéal totalement différent. Tout à fait illibéral, si l'on s'en tient à la manière dont le libéralisme occidental contemporain se définit. Dans le même temps, la civilisation russe (le monde russe) possède un universalisme unique, qui se manifeste à la fois dans la nature œcuménique de l'Église orthodoxe et, pendant la période soviétique, dans la croyance en la victoire du socialisme et du communisme à l'échelle mondiale.
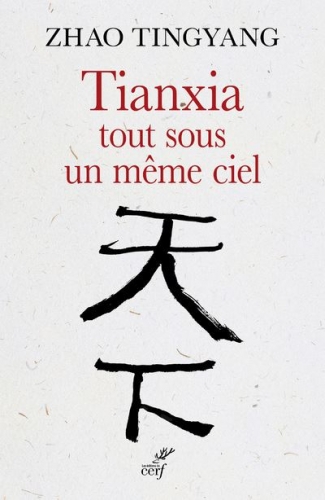
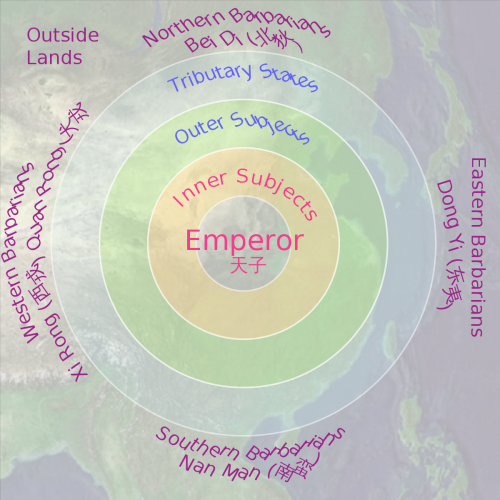
Le projet chinois de Xi Jinping de "communauté d'un avenir commun pour l'humanité" (人類命運共同體) ou la théorie de Tianxia (天下) représente un principe élargi de l'idéal confucéen traditionnel de l'Empire céleste, l'Empire chinois, au centre du monde, offrant aux peuples environnants le code culturel chinois comme idéal éthique, philosophique et sociopolitique. Mais le rêve chinois - tant dans sa forme communiste, ouvertement anti-bourgeoise et anti-individualiste, que dans sa version traditionnellement confucéenne - est très éloigné, dans ses fondements, du libéralisme occidental, et est donc essentiellement illibéral.
La civilisation islamique a également des principes inébranlables et est orientée vers la propagation de l'islam à l'échelle mondiale, en tant que "dernière religion". Il est normal que cette civilisation fonde son système sociopolitique sur les principes de la charia et sur l'adhésion aux principes religieux fondamentaux. Il s'agit là d'un projet illibéral.

Au cours des dernières décennies, l'Inde s'est de plus en plus tournée vers les fondements de sa civilisation védique - et en partie vers le système des castes (varnas), ainsi que vers la libération des modèles coloniaux de philosophie et l'affirmation des principes hindous dans la culture, l'éducation et la politique. L'Inde se considère également comme le centre de la civilisation mondiale et sa tradition comme l'apogée de l'esprit humain. Cela se manifeste indirectement par la diffusion de formes prosélytes simplifiées de l'hindouisme, telles que le yoga et les pratiques spirituelles légères. Il est évident que la philosophie du Vedanta n'a rien en commun avec les principes du mondialisme libéral. Aux yeux d'un hindou traditionnel, la société occidentale contemporaine est la forme extrême de dégénérescence, de mélange et de renversement de toutes les valeurs, caractéristique de l'âge des ténèbres : Kali Yuga.
Sur le continent africain, des projets civilisationnels propres émergent, le plus souvent sous la forme du panafricanisme. Ils s'appuient sur un vecteur anti-occidental et un appel aux peuples autochtones d'Afrique à se tourner vers leurs traditions précoloniales. Le panafricanisme a plusieurs directions, interprétant différemment l'idée africaine et les moyens de sa réalisation dans le futur. Mais toutes rejettent unanimement le libéralisme et, par conséquent, l'Afrique est orientée de manière illibérale.
Il en va de même pour les pays d'Amérique latine, qui s'efforcent de se distinguer à la fois des États-Unis et de l'Europe occidentale. L'idée latino-américaine repose sur la combinaison du catholicisme (en déclin ou complètement dégénéré en Occident, mais très vivant en Amérique du Sud) et des traditions revivifiées des peuples indigènes. Il s'agit là d'un autre cas d'illibéralisme civilisationnel.
Le choc des civilisations - une bataille d'idées
Ainsi, les idées russes, chinoises et islamiques ont chacune un potentiel universel exprimé de manière distincte. Elles sont suivies par l'Inde, tandis que l'Afrique et l'Amérique latine limitent actuellement leurs projets aux frontières de leurs continents respectifs. Cependant, la dispersion des Africains dans le monde a conduit certains théoriciens à proposer la création, principalement aux États-Unis et dans l'Union européenne, de zones africaines autonomes sur le principe des quilombos brésiliens. La population latino-américaine croissante aux États-Unis pourrait également influencer de manière significative la civilisation nord-américaine et le système de valeurs dominant à l'avenir. En raison de ses fondements catholiques et du lien préservé avec la société traditionnelle, il ne fait aucun doute qu'il entrera tôt ou tard en conflit avec le libéralisme, qui a des racines protestantes et nettement anglo-saxonnes.
Ainsi, la lutte entre un ordre mondial unipolaire et un ordre mondial multipolaire représente un conflit d'idées. D'un côté, le libéralisme, qui tente de défendre ses positions dominantes à l'échelle mondiale, et de l'autre, plusieurs versions de l'illibéralisme, qui s'expriment de plus en plus clairement dans les pays qui composent le bloc multipolaire.
20:13 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, réalisme, idéalisme, libéralisme, relations internationales, politique internationalen, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 01 novembre 2023
Les idéologues clés de la diplomatie russo-chinoise

Les idéologues clés de la diplomatie russo-chinoise
Olga Bonch-Osmolovskaya
Source: https://katehon.com/ru/article/klyuchevye-ideologemy-russko-kitayskoy-diplomatii?fbclid=IwAR0z2Oi4AngsvXqDXacDfX-6j1H7rkOBL6UkHmDQIL3eKnRYouTU26uL7H8
Depuis le 18ème Congrès du PCC (automne 2012), le concept de la diplomatie chinoise moderne a subi des changements significatifs, changeant de cap vers la construction d'une nouvelle "diplomatie de grande puissance d'origine chinoise" (tese dago waijiao 特色大国外交). Il faut tout de suite préciser que la diplomatie est la sphère la plus conservatrice dans l'activité intellectuelle de la Chine en général et du PCC en particulier. Elle a reçu un minimum d'innovations théoriques tout au long de l'histoire chinoise, et c'est à ce titre qu'il est très important de connaître et de comprendre ses racines historiques, son contexte, son vocabulaire et sa base idéologique. Je parlerai plus en détail de ces fondements dans la deuxième partie de l'article.
Lors du 19ème Congrès (2017), les nouvelles qualités suivantes de la diplomatie chinoise ont été annoncées : " omnidirectionnalité/inclusivité " (quanmianwei 全方位), " multi-niveaux " (dotseng 多层次) et " volumétrie " (lithihua 立体化). Sous Xi Jinping, le cap a été mis sur les contributions conceptuelles à la théorie et à la pratique des relations internationales en formant ses propres plateformes de discussion et en lançant ses propres initiatives stratégiques. En outre, cette nature multi-vectorielle et multi-niveaux est évidente dans la nature de la formation du réseau de politique étrangère de la Chine, qui est désormais ciblée : le ministère chinois des affaires étrangères a développé des stratégies pour chaque région du monde et les a présentées sous la forme de documents de programme. En particulier, deux stratégies africaines ont été adoptées en 2006 et 2015. Le 5 novembre 2008, le premier document a été élaboré pour les États d'Amérique latine et des Caraïbes (le deuxième programme a été publié le 24 novembre 2016), le 2 avril 2014 pour les pays européens (une version mise à jour est parue en décembre 2018), et le 13 janvier 2016 pour les États arabes. En janvier 2018, la première édition du Livre blanc "La politique arctique de la Chine" a été publiée [1].
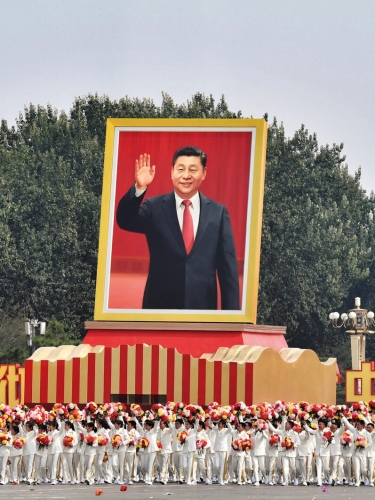
Lors du même 18ème congrès du PCC, Xi Jinping a exprimé l'élément clé de la doctrine de politique étrangère des dirigeants chinois modernes - le concept de "communauté de destin commun de l'humanité", qui est une continuation du concept des "cinq principes de coexistence pacifique" (1949). Aujourd'hui, toutes les initiatives et activités de la diplomatie chinoise sont liées à ce slogan. Il a acquis un statut normatif tant au niveau du parti qu'au niveau de l'État, puisqu'il est inscrit dans la Charte du PCC et dans la Constitution de la République populaire de Chine.
En conséquence, les auteurs et idéologues chinois développent un nouvel appareil terminologique adapté au paradigme moderne - "communauté de destin", "concept de compréhension correcte du devoir et du bénéfice". Compte tenu de la nature multisectorielle de la politique étrangère, des "concepts clés" spéciaux de relations sont également élaborés pour les différentes régions. Ainsi, pour le continent africain, une série de quatre hiéroglyphes est apparue : "véracité", "sens pratique", "proximité" ("parenté") et "sincérité". Notez que tous ces concepts sont l'essence d'anciennes catégories confucéennes tirées de traités philosophiques et de textes canoniques.
Par ailleurs, le concept de "rêve chinois du grand renouveau de la nation chinoise" (Zhonghua minzu weida fuxing de zhongguomen 中华民族伟大复兴的中国梦), ou "rêve chinois" en abrégé (Zhongguo meng 中国梦) a également été proposé par Xi Jinping lors du 18ème congrès du PCC en 2012. Il est souvent traduit et abrégé simplement par "Le rêve chinois", ce qui contribue à accroître sa popularité et à attirer des partenaires, mais j'attire votre attention sur la partie principale, la deuxième partie, "la grande renaissance de la nation chinoise". C'est l'idéologie qui a guidé la Chine après des années de traités inégaux, d'échecs militaires, de chocs et de stagnation complexe du développement. Ce concept est devenu la base sur laquelle les fondements conceptuels de la politique étrangère moderne de la Chine ont été construits - entrer dans l'arène mondiale en tant qu'initiateur de projets forts, accroître son influence pacifique dans les régions. Il est également soutenu idéologiquement par le concept diplomatique de "l'essor pacifique de la Chine" (Zhongguo heping jueqi 中国和平崛起), proposé en 2003 par Zheng Bijian.
En ce qui concerne l'attitude à l'égard des événements récents et de l'état actuel de la politique mondiale, Xi Jinping a présenté sa vision lors de la conférence annuelle du Forum de Boao, le 20 avril 2021. Il a donné une description négative de l'état du système des relations internationales, notant la croissance de l'instabilité et de l'incertitude, ainsi que le déficit de gouvernance, de confiance, de développement et de paix. Les tendances négatives mentionnées conduisent au fait qu'au cours des dernières années, il n'y a pas eu de changements fondamentaux dans le mouvement vers la formation d'un monde multipolaire [2]. Notez également que cette évaluation porte à nouveau la marque des notions traditionnelles de "relations idéales" ; à cet égard, il est nécessaire d'examiner brièvement leurs origines.

Les fondements traditionnels de la diplomatie, de l'idéologie et de la politique étrangère chinoises
Les années révolutionnaires, puis la victoire et l'établissement du pouvoir du PCC après 1949 ont entraîné une révision et une réorganisation des institutions étatiques et de la rhétorique de l'empire Qing et de la période du Kuomintang. Cependant, l'espace des pratiques diplomatiques a été transmis à travers ces changements d'une manière particulière : malgré le changement de régime politique et de cap, la Chine devait toujours rester et se positionner en tant que successeur de la sagesse ancestrale et en tant que promoteur de politiques visant à ce que l'État chinois prenne la place qui lui revient au sein de la communauté mondiale. À cet égard, la diplomatie chinoise, comme nous l'avons noté au début de l'article, était plus réticente que d'autres sphères à autoriser des changements dans son contenu et sa structure, continuant à puiser sa base de données et ses principaux idéologues dans les pratiques diplomatiques de la Chine ancienne et dans les traités des anciens philosophes chinois. Formulons les principales caractéristiques de cette école.
Les fondements de la doctrine de politique étrangère et de la culture diplomatique ont été formés sous l'influence des facteurs suivants :
- le culte des ancêtres ;
- le respect des aînés, le principe de la vénération filiale (xiao 孝) ;
- les pratiques de culture personnelle (xushen 修身) et le concept de stimulus-réponse (ganyin 感應, - accent mis sur la personnalité du souverain et les conséquences de ses activités) ;
- le culte de la loyauté envers le souverain (zhong 忠) et son statut sacral de Fils du Ciel (tianqi 天子) ;
- le concept de la fonction de civilisation et d'édification du monde de l'Empire céleste (tianxia 天下) ;
- le concept de "commandement du ciel" (tianming 天命), qui légitime le pouvoir politique du dirigeant ;
- l'idéologème centre-périphérie "Chine-barbares".
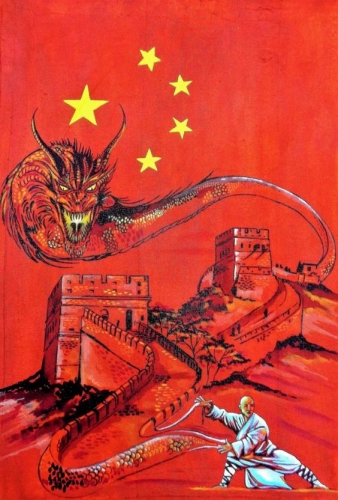
La position de centre civilisationnel, politique et culturel de l'Asie de l'Est a formé en Chine un complexe de supériorité culturelle, qui envisageait la haute mission du souverain chinois - le Fils du Ciel - de répandre son pouvoir aux peuples voisins [3]. D'où le système de tribut de "vassalité nominale", selon lequel pour recevoir du souverain chinois une aide militaire, des garanties de sécurité et des échanges commerciaux favorables pour les petits États voisins, il suffisait de reconnaître sa suzeraineté et d'apporter un tribut symbolique.
Tout cela a déterminé la priorité des orientations et idéologies clés de la diplomatie chinoise moderne (qui ont été diffusées à plusieurs reprises dans les discours officiels des dirigeants du PCC) [4] :
- L'accent mis sur le compromis ;
- la perception d'un pouvoir fort comme valeur suprême
- la centralisation et l'intégrité territoriale comme un bien ;
- priorité des méthodes politiques sur les méthodes militaires ;
- rationalisme, pragmatisme, sens pratique et prudence dans les actions ;
- respect scrupuleux de la hiérarchie, des conventions et des rituels ;
- la fierté chinoise pour l'histoire ancienne et la grande culture de la Chine;
- un appel à la mémoire historique ;
- le sens de la dignité nationale.

La diplomatie russo-chinoise contemporaine
Tout ce qui précède vise à souligner que le maintien du dialogue Russie-Chine exige que la partie russe étudie et comprenne en détail le vocabulaire idéologique traditionnel et le vocabulaire politique moderne de la Chine, et qu'elle suive de près les changements qui s'opèrent dans ce domaine.
Ainsi, la Fédération de Russie et la RPC ont conclu de nombreux traités et publié de nombreuses déclarations conjointes, notamment sur les relations internationales entrant dans une nouvelle ère et sur le développement durable mondial (2022).
Les points suivants peuvent être considérés comme des dispositions clés de ces accords :
- La "démocratie sans modèle", qui implique que, selon la structure sociopolitique, l'histoire, les traditions et les caractéristiques culturelles d'un État particulier, son peuple a le droit de choisir les formes et les méthodes de réalisation de la démocratie qui sont appropriées aux spécificités de cet État. Seul le peuple a le droit de juger si un État est démocratique. Cette disposition vise à lutter contre la monopolisation de la compréhension de la démocratie par des États individuels et à promouvoir une véritable démocratie.
- La nouvelle phase du développement mondial devrait être caractérisée par l'équilibre, l'harmonie et l'inclusion.
- L'accent est mis sur la garantie et le maintien de la sécurité.
- Une orientation vers la multipolarité.
D'autres documents peuvent être plus spécifiques, mais ils se résument fondamentalement à ces thèmes et dispositions. Je voudrais attirer l'attention sur le langage de ces documents - la déclaration des dirigeants des deux pays fait souvent référence à l'adoption de l'approche chinoise de divers concepts, par exemple, le concept de "développement". Dans la conscience publique chinoise, le développement est principalement perçu comme un processus de modernisation axé sur la technologie. En conséquence, le document conjoint Russie-Chine de 2019 a mis l'accent sur la priorité de la coopération en matière de science, de technologie et d'innovation. D'autres domaines, bien que reconnus comme importants, restent à l'arrière-plan. Pour la partie chinoise, c'est tout à fait logique, car un ensemble de significations pertinentes est formé autour de l'image du "rêve chinois" : technologie, innovation, développement technique, prospérité. L'image du "rêve américain" est également bien structurée, communiquant des significations pertinentes sur la liberté, les opportunités, la nouveauté, l'épanouissement personnel. Mais qu'est-ce que le "rêve russe" ? Ses significations forment-elles une structure cohérente et peuvent-elles être diffusées sur le circuit extérieur avec le même succès que les significations du "rêve chinois", par exemple?

On ne peut pas parler d'une large influence de l'idéologie russe ou des idéologèmes diplomatiques russes sur les Chinois, car la partie chinoise est capable de chinoiser tous les concepts et idéologèmes efficaces et de les intégrer dans son agenda, puis de les exporter à l'extérieur comme faisant partie de sa propre pensée chinoise (c'est notamment le cas de l'idée de multipolarité, qui, avec le soutien formel de la Chine, est remplacée dans le discours politique chinois proprement dit par le concept de "la communauté de destin commun de l'humanité"). Il semble qu'en ce qui concerne la Chine, les spécificités russes en matière de rhétorique, de message idéologique et de ciblage n'aient pas encore été suffisamment développées. Cela est lié au problème du positionnement de l'agenda idéologique russe dans le cadre du dialogue russo-chinois : la partie russe dispose de très peu d'outils efficaces en Chine pour travailler dans ce domaine (notez que la partie chinoise crée activement des centres culturels et linguistiques qui introduisent et promeuvent avec assurance la culture chinoise en Russie et dans le monde à un niveau de masse).
Il convient de noter qu'historiquement, un tel centre existait : depuis le XVIIe siècle, la mission spirituelle russe opérait à Pékin et jouait un rôle important dans l'établissement et le maintien des relations russo-chinoises. La mission était le centre d'étude scientifique de la Chine et de formation des premiers sinologues russes, et les représentants de la mission étaient chargés non seulement de tâches missionnaires et spirituelles, mais aussi politiques et diplomatiques. Au départ, la mission était subordonnée non pas au synode directeur, comme on pourrait le supposer, mais au département asiatique du ministère des affaires étrangères. La mission a continué d'exister après la révolution Xinhai en Chine en 1911, et après la révolution russe en 1917, et ce n'est qu'en 1955 qu'il a été mis fin à ses activités. L'Église orthodoxe chinoise moderne n'a plus de primat depuis longtemps et personne ne s'occupe réellement de l'entretien des temples et de leurs activités. Comme le note l'archiprêtre Dionisy (Pozdnyaev) : "Au cours des 30 dernières années, le nombre de chrétiens en RPC, selon les estimations les plus conservatrices, a été multiplié par plusieurs fois (catholiques - 4 fois depuis 1949, protestants - 20 fois au cours de la même période). L'Église orthodoxe reste la seule Église chrétienne dont le nombre de paroissiens et d'églises en Chine non seulement n'a pas augmenté, mais a même diminué" [5]. En d'autres termes, malgré l'augmentation du nombre de fidèles d'autres confessions chrétiennes, seul le nombre de chrétiens orthodoxes (et donc indirectement la connaissance de la culture russe) en Chine diminue.
En outre, l'Église orthodoxe russe ne peut officiellement pas influencer directement la recréation de l'environnement orthodoxe en Chine continentale, et les restrictions légales ne permettent pas de recréer l'environnement orthodoxe en RPC, de distribuer de la littérature spirituelle et éducative. Ce problème devrait progressivement gagner en visibilité, car il revêt une dimension à la fois culturelle et éducative, mais aussi diplomatique et politique. Sans centres spirituels et éducatifs qui diffusent la culture russe et introduisent les idées et la vie spirituelle russes, il est difficile d'imaginer un dialogue productif entre les civilisations. Si des mesures concrètes ne sont pas prises pour résoudre ce problème (notamment la restauration de l'Église orthodoxe autonome chinoise), le souvenir du passé historique soviétique commun s'estompera progressivement dans l'esprit de la génération plus âgée de Chinois, tandis que la jeune génération est déjà en train de se laisser gagner par l'agenda et l'idéologie occidentaux (même, comme nous le voyons, au niveau de la diffusion douce du catholicisme et du protestantisme). Alors que le concept du "rêve chinois" semble intuitif pour les Russes, le "rêve russe" et l'idée russe nécessitent une élaboration complète et une diffusion ciblée en Chine.
Notes :
[1] - Mokretsky A. Ch. On the diplomacy of China's "new opportunities" // East Asia : past, present, future. 2020. №7. С. 17.
[2] - Nezhdanov V. L., Tsvetov P. Yu. Les idées de Xi Jinping sur la diplomatie et le partenariat stratégique russo-chinois // Observer - Observer. 2021. №7 (378). С. 53-54.
[3] - Pour plus de détails sur le concept de puissance impériale dans la Chine traditionnelle, voir Martynov A.S. Status of Tibet in the XVII-XVIII centuries in the traditional Chinese system of political representations. Moscou : Nauka, 1978.
[4] - Barskiy K.M. K k kumu k o formirovanie sovremennoi chinese diplomatic school // Russian Chinese Studies, 1 (2023). С. 100-116.
[5] - Pozdnyaev D. Chinese Orthodoxy : Russian perspective // State, Religion, Church in Russia and abroad. 2011. №3-4. С. 164.
19:22 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chine, russie, diplomatie, relations internationales, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 08 juillet 2023
Vers un monde multipolaire: les défis à relever

Vers un monde multipolaire: les défis à relever
Foad Izadi
Source: https://katehon.com/ru/article/dvizhenie-k-mnogopolyarnomu-miru-vyzovy-kotorye-neobhodimo-preodolet
Texte d'un discours prononcé lors de la Conférence mondiale sur la multipolarité, le 29 avril 2023.
Note de la rédaction: Le texte du politologue iranien Foad Izadi est intéressant à plus d'un titre, non seulement parce que nous avons ici accès à son contenu, mais parce qu'il nous permet de saisir la vision iranienne des relations internationales, à une époque où l'OTAN nous induit à considérer l'Iran comme un ennemi absolu alors qu'aucun pays d'Europe centrale et occidentale n'a eu, au cours de l'histoire, de conflit avec la Perse. Pour rétablir la bonne santé économique de l'Europe, les relations économiques avec l'Iran devront être rétablies, même si le pays opte pour des rapports privilégiés avec les structures de coopération eurasiennes, pilotées par la Russie et la Chine, voire l'Inde. L'Europe n'a aucun intérêt, à long terme, à obéir aux injonctions de Washington et à pérenniser le bellicisme de l'Alliance atlantique.
L'évolution vers un monde multipolaire, où le pouvoir est partagé entre plusieurs grands acteurs mondiaux, peut s'accompagner de divers obstacles. Voici quelques défis courants qui peuvent se présenter :
1. Dominance des puissances existantes : les puissances mondiales établies, telles que les États-Unis, résisteront à l'idée de renoncer à leur position dominante et à leur influence dans le système international. Elles considéreront un monde multipolaire comme une menace pour leurs intérêts et chercheront à maintenir leur statut hégémonique.
2. Concurrence et conflits : comme le pouvoir est partagé entre plusieurs pôles, la concurrence et les conflits d'intérêts peuvent s'intensifier. Les rivalités entre les nouvelles puissances et les puissances existantes peuvent s'intensifier, entraînant des tensions géopolitiques, des guerres par procuration, voire des affrontements purs et simples.
3. absence de gouvernance mondiale : la transition vers un monde multipolaire nécessite des mécanismes de gouvernance mondiale efficaces. Cependant, il peut y avoir un manque de consensus sur les structures, les processus de prise de décision et les règles de la gouvernance mondiale. Cela peut entraver la coopération et la coordination entre les pays, ce qui rend difficile la résolution collective des problèmes mondiaux.
4. Conflits régionaux non résolus : de nombreux conflits régionaux en cours peuvent compliquer l'évolution vers un monde multipolaire. Les différends et les conflits non résolus entre les pays peuvent entraver l'établissement de relations stables et coopératives nécessaires à l'épanouissement d'un système multipolaire.
5. interdépendance économique : les interdépendances économiques existantes, telles que les relations commerciales et les chaînes d'approvisionnement, peuvent être perturbées par la transition vers un monde multipolaire. La concurrence économique et le protectionnisme entre les grandes puissances peuvent créer de l'instabilité et entraver les progrès vers la multipolarité.
6. Différences d'idéologie et de valeurs : les pays d'un monde multipolaire sont susceptibles d'avoir des idéologies, des valeurs et des systèmes politiques différents. Ces différences peuvent entraîner des conflits d'intérêts et entraver la coopération sur les questions mondiales, rendant difficile la recherche d'un terrain d'entente.
7. Dilemmes sécuritaires : dans un monde multipolaire, les pays peuvent être confrontés à des dilemmes sécuritaires, où les mesures prises par un État pour renforcer sa sécurité peuvent être perçues comme une menace par d'autres États. Cela peut conduire à une course aux armements, à la méfiance et à l'instabilité.
8. Manque de confiance et de coopération : l'instauration de relations de confiance et de coopération entre les pays est cruciale pour le succès d'un monde multipolaire. Toutefois, les rivalités historiques, les suspicions profondément ancrées et les intérêts nationaux divergents peuvent entraver le développement de la confiance et les efforts de coopération.
9. Asymétrie de puissance : la transition vers un monde multipolaire peut être difficile s'il existe une importante asymétrie de puissance entre les pays. Les États plus faibles peuvent se sentir marginalisés ou menacés par les puissances dominantes, ce qui entraîne une résistance ou des tentatives d'alliance contre elles.
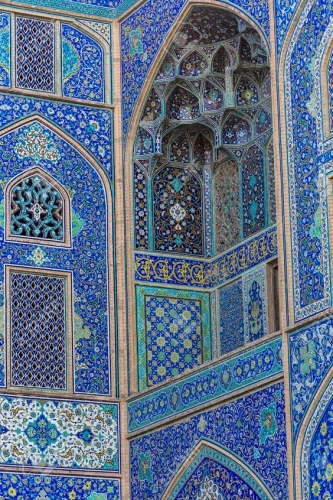
Pour surmonter ces obstacles, il faut de la diplomatie, du dialogue, des institutions multilatérales et une vision commune de la gouvernance mondiale. Cela nécessite un engagement en faveur du respect mutuel, de la coopération et du compromis entre les pays afin d'assurer une transition harmonieuse et pacifique vers un monde multipolaire.
Comme indiqué précédemment, les États-Unis résisteront farouchement à l'abandon de leur position dominante dans un monde multipolaire sur la base de schémas historiques et de considérations géopolitiques. Voici quelques stratégies que les États-Unis peuvent utiliser pour maintenir leur position :
1. la puissance économique : Les États-Unis se sont traditionnellement appuyés sur leur économie forte et sur l'innovation technologique pour maintenir leur influence mondiale. Ils peuvent continuer à donner la priorité à la croissance économique, à investir dans la recherche et le développement et à promouvoir l'innovation pour rester compétitifs.
2. Alliances diplomatiques : les États-Unis peuvent chercher à renforcer leurs alliances et leurs partenariats avec des pays aux vues similaires afin de maintenir une influence collective dans les affaires internationales. Le renforcement des alliances avec l'OTAN, l'Union européenne et d'autres démocraties peut constituer un front uni face aux défis posés à la domination américaine.
3. Capacités militaires : les États-Unis ont toujours maintenu une forte présence militaire dans le monde. Ils peuvent continuer à investir dans des technologies militaires de pointe, à maintenir une présence militaire mondiale et à assurer leur préparation militaire afin de projeter leur force et de dissuader leurs adversaires potentiels.
4. domination technologique : l'accent mis sur les avancées technologiques telles que l'intelligence artificielle, la cybersécurité, l'exploration spatiale et la biotechnologie peut aider les États-Unis à conserver un avantage concurrentiel et à accroître leur influence mondiale dans un monde en mutation rapide.
5. Soft power et influence culturelle : les États-Unis s'appuient depuis longtemps sur leur puissance douce (soft power), y compris les exportations culturelles, pour exercer une influence au niveau mondial. Un accent soutenu sur la propagande et la diplomatie publique, ainsi que sur la construction de perceptions internationales positives, peut contribuer à maintenir leur domination.
6. Adaptabilité et engagement multilatéral : conscients de l'évolution de la dynamique mondiale, les États-Unis pourraient être amenés à adapter leur approche et à s'engager auprès des puissances émergentes et des régions en plein essor. Cela pourrait inclure une participation active aux institutions internationales, aux négociations et aux structures multilatérales afin de façonner les normes et les règles mondiales.
7. politiques économiques et commerciales : les États-Unis peuvent mener des politiques économiques et commerciales stratégiques afin de protéger l'industrie nationale et d'aborder la question des droits de propriété intellectuelle et du transfert de technologie. Ces politiques peuvent viser à préserver les avantages économiques et à empêcher l'érosion de la position dominante des États-Unis.
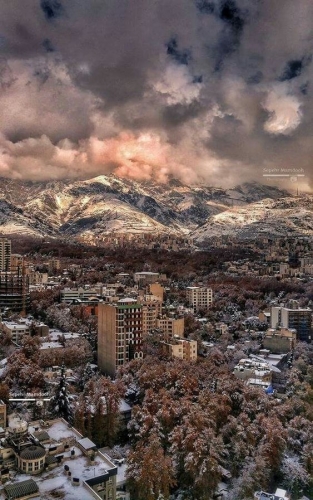
Il est important de noter que le paysage mondial est complexe et que les États-Unis sont susceptibles d'utiliser une combinaison de ces politiques, en s'adaptant à l'évolution des circonstances.
Pour contrer l'hégémonie américaine vers un monde multipolaire, les ONG et les intellectuels peuvent jouer un rôle important. Voici quelques moyens par lesquels ils peuvent affronter et influencer la dynamique du pouvoir mondial:
1. recherche et sensibilisation : les ONG et les intellectuels peuvent mener des recherches et fournir des analyses fondées sur des preuves afin d'exposer les implications et les limites de l'hégémonie américaine. Ils peuvent attirer l'attention sur des questions telles que les inégalités, les violations des droits de l'homme, la dégradation de l'environnement et l'exploitation économique résultant des structures de pouvoir dominantes. En sensibilisant l'opinion et en plaidant pour le changement, ils peuvent favoriser un discours critique sur la nécessité d'un ordre mondial plus juste et plus inclusif.
2. Mobilisation de la société civile : les ONG peuvent mobiliser la société civile et les mouvements de base pour promouvoir une vision alternative de la gouvernance mondiale. En organisant des campagnes, des manifestations et des initiatives de plaidoyer, elles peuvent amplifier les voix des communautés marginalisées, remettre en question les récits dominants et exiger une plus grande responsabilité de la part des acteurs puissants, y compris les États-Unis.
3. Mise en réseau et création de coalitions : les ONG et les intellectuels peuvent collaborer au-delà des frontières pour créer des réseaux et des coalitions qui promeuvent des perspectives alternatives et remettent en question les structures de pouvoir hégémoniques des États-Unis. En développant la coopération entre les organisations et les intellectuels de différentes régions, ils peuvent accroître leur influence et présenter un front uni contre la domination.
4. Promouvoir le dialogue et l'échange : les intellectuels peuvent promouvoir le dialogue et l'échange entre différentes cultures, sociétés et systèmes de connaissance. En encourageant le débat et en créant des plateformes pour des voix diverses, ils peuvent remettre en question les récits centrés sur l'Occident et promouvoir une compréhension plus inclusive des questions mondiales. Cela peut contribuer à un discours plus équilibré et multipolaire.
5. Plaidoyer politique : les ONG et les intellectuels peuvent s'engager auprès des décideurs politiques, des institutions internationales et des forums multilatéraux pour influencer les politiques et promouvoir des approches alternatives. En apportant leur expertise, en proposant des conseils politiques et en participant aux processus décisionnels, ils peuvent contribuer à façonner un ordre mondial plus juste et multipolaire.
6. Interaction avec les puissances en développement : les ONG et les intellectuels peuvent s'engager activement auprès des puissances en développement et des régions émergentes pour promouvoir le dialogue et la coopération. En facilitant la coopération entre ces acteurs et en partageant les connaissances et les meilleures pratiques, ils peuvent contribuer à la diversification du pouvoir et remettre en question la domination des puissances occidentales.
7. Promouvoir la solidarité mondiale : les ONG et les intellectuels peuvent plaider en faveur de la solidarité et de la coopération mondiales, en soulignant l'interconnexion des problèmes mondiaux tels que le changement climatique, la pauvreté et les conflits. En soulignant les intérêts communs et l'interdépendance des pays, ils peuvent promouvoir des efforts collectifs pour résoudre ces problèmes, réduisant ainsi l'influence d'une puissance hégémonique.

Il est important de noter que la lutte contre l'hégémonie des États-Unis et la promotion de la multipolarité nécessitent des efforts soutenus, une coopération et une perspective à long terme. Les ONG et les intellectuels peuvent apporter une contribution significative en fournissant une analyse critique, en mobilisant la société civile et en défendant une vision alternative de la gouvernance mondiale. Le plus important est de fournir des principes pour une idéologie qui cherche à résister à l'hégémonie des États-Unis. Voici quelques principes qui peuvent être liés à la remise en cause de l'hégémonie américaine :
1. Multipolarité : l'idéologie doit promouvoir l'idée d'un ordre mondial multipolaire dans lequel le pouvoir est réparti plus équitablement entre de multiples acteurs. Elle met l'accent sur la nécessité de remettre en cause la domination américaine et cherche à créer un système mondial plus équilibré et plus inclusif.
2. Souveraineté et autodétermination : l'idéologie reconnaît l'importance de la souveraineté nationale et le droit des nations à déterminer leurs propres systèmes politiques, économiques et sociaux sans ingérence extérieure. Elle s'oppose aux interventions, aux occupations militaires et à l'imposition de positions par les puissances dominantes qui sapent la souveraineté et l'autodétermination des nations.
3. Égalité et justice : l'idéologie souligne l'importance de l'égalité et de la justice dans les relations internationales. Elle remet en question les dynamiques de pouvoir inégales qui perpétuent les injustices mondiales telles que l'exploitation économique, l'inégalité sociale et les violations des droits de l'homme. Elle promeut des systèmes équitables et justes qui donnent la priorité au bien-être et à la dignité de tous les individus.
4. Solidarité et coopération : l'idéologie promeut la solidarité et la coopération entre les pays et les peuples. Elle recherche des alliances et des partenariats fondés sur des intérêts communs et le respect mutuel, encourageant la coopération pour trouver des solutions collectives aux problèmes mondiaux. Elle souligne l'importance du dialogue, de la diplomatie et du multilatéralisme dans la résolution des conflits et la réalisation d'objectifs communs.
5. Diversité culturelle et respect : l'idéologie reconnaît et valorise la diversité culturelle, en promouvant le respect des différentes cultures, traditions et perspectives. Elle s'oppose à l'homogénéisation culturelle. Elle soutient au contraire la préservation du patrimoine culturel et la promotion de la compréhension et du dialogue interculturels.
6. Développement durable et gestion de l'environnement : l'idéologie met l'accent sur le développement durable et la gestion de l'environnement. Elle reconnaît la nécessité d'une gestion responsable des ressources, d'une action climatique et d'une durabilité environnementale. Elle remet en question les modèles économiques dominants qui privilégient le profit au détriment du bien-être de la planète et des générations futures.
7. Anti-impérialisme et anti-colonialisme : l'idéologie s'oppose à l'impérialisme et au colonialisme sous toutes leurs formes. Elle cherche à supprimer l'héritage historique du colonialisme, notamment l'exploitation économique, l'esclavage culturel et l'occupation territoriale. Elle soutient le droit à l'autodétermination des peuples colonisés et opprimés.
Ces principes ne sont pas exhaustifs et les idéologies et mouvements peuvent mettre l'accent sur des aspects différents. Il est également important de noter que la lutte contre l'hégémonie est une tâche complexe et que les principes et stratégies spécifiques peuvent varier en fonction du contexte et des objectifs de ceux qui contestent les structures de pouvoir dominantes.
17:34 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, relations internationales, politique internationale, foad izadi, iran, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques, multipolarité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 24 mai 2023
Discours de Juan Antonio Aguilar à la Conférence mondiale sur la multipolarité

Discours de Juan Antonio Aguilar à la Conférence mondiale sur la multipolarité
Juan Antonio Aguilar
Source: https://www.geopolitika.ru/es/article/discurso-de-juan-an...
Introduction
L'objectif de ce document est d'établir un cadre à partir duquel développer les propositions politiques d'une puissance moyenne comme l'Espagne, dans un monde qui connaît des mouvements tectoniques et des "changements sans précédent depuis 100 ans" (Xi Jinping).
Le thème de notre époque : d'un monde unipolaire à un monde multipolaire
L'année 2020 risque d'être l'une des plus mémorables de l'histoire récente. L'humanité a subi un séisme sanitaire et surtout psychologique auquel nous n'étions pas préparés. Ces tristes événements ont provoqué de profondes transformations sur la scène internationale, dont les symptômes sont aujourd'hui perceptibles dans différentes parties du monde, avec une attention particulière pour l'Ukraine. Une rude bataille s'y déroule, le début d'une longue série qui façonnera l'avenir de la politique mondiale.

Quelque chose qui se dessinait progressivement (il y avait des signes importants : la guerre en Syrie, l'émergence des BRICS, le Pacte de Samarkand, etc.) et est maintenant en train de devenir une réalité: la fin de l'ancien ordre unipolaire en vigueur. Un système qui, en soi, était déjà mort, du fait de la volonté de domination des États-Unis. Son fonctionnement était très simple. D'une part, il profitait du vide mondial causé par l'effondrement du bloc soviétique. D'autre part, les niveaux de puissance et de développement étaient concentrés dans une seule nation, elle-même considérée comme indispensable à l'échelle mondiale. C'est pourquoi, dès le début, elle a tenté d'imposer son hégémonie mondiale, en affrontant la civilisation humaine et en tournant le dos à ses propres lois et aux accords qu'elle avait signés.
Les aventures guerrières, comme en Irak et en Afghanistan, ont révélé les limites des forces économiques et militaires des États-Unis, ainsi que la stagnation de leurs plans géostratégiques. Ces politiques agressives ont conduit à un chaos général dont nous subissons encore aujourd'hui les conséquences. Le monde ressemble de plus en plus à un dangereux volcan d'ambitions, qui risque clairement d'entrer en éruption et de menacer la stabilité mondiale. Ce qui est inquiétant, c'est que le danger s'accroît de jour en jour et qu'il est difficile d'en prévoir les conséquences. Aucun pays au monde n'est à l'abri de ses effets, et la grave inflation mondiale que nous connaissons n'est qu'un faible symptôme de ce qui nous attend. Une crise économique qui n'épargne même pas les États-Unis.
Si nous l'analysons d'un point de vue historique, nous constatons que les grands empires de l'Antiquité (romain, espagnol, britannique, musulman, ottoman, etc.) ont commencé à s'effondrer de l'intérieur. Il ne faut donc pas s'étonner de voir, à moyen ou long terme, le géant nord-américain se désintégrer en une énorme mosaïque de royaumes de type taïfa, en conflit les uns avec les autres. Un avenir compliqué que l'on retrouve également dans la vieille Europe. Le "jardin" s'est transformé en mélancolie et toutes les illusions et les attentes qui ont permis à l'Europe de vivre l'une de ses expériences les plus réussies au cours de l'ère moderne sont remises en question.

À cela s'ajoutent les tentatives des nouvelles puissances, telles que la Chine, l'Inde, la Russie, l'Iran et la Turquie, qui sont de plus en plus déterminées à se rebeller contre l'hégémonie occidentale. Pour la première fois depuis la défaite des Ottomans face à l'Empire russe lors de la guerre pour la Crimée (1766 et 1772), la domination occidentale semble toucher à sa fin.
Les innombrables conflits quotidiens, les luttes pour les ressources énergétiques, l'inefficacité des institutions supranationales bureaucratiques au service des grandes puissances, l'augmentation incontrôlée de la pauvreté, l'absence de règles communes pour organiser la structure mondiale et, surtout, la peur qui s'empare des êtres humains, indiquent que nous sommes au début d'une nouvelle ère de domination mondiale. Des expressions telles que celle du penseur italien Antonio Gramsci, selon laquelle l'ancien monde se meurt et le nouveau n'est pas encore né, annonçaient déjà cette naissance douloureuse.
Il s'agit d'une réalité qui ne peut être pleinement comprise que dans une perspective géopolitique, peut-être la plus appropriée, ou du moins celle qui peut le mieux nous aider à comprendre des situations aussi complexes que celles que nous voyons se dérouler autour de nous. En effet, les événements que nous vivons ne sont que les prémices d'autres à venir, notamment l'arc géographique qui s'étend de l'Atlantique à la muraille de Chine à l'est, et de l'Arctique à la Corne de l'Afrique et au Sahel africain au sud. Une vaste zone territoriale qui connaîtra le plus grand nombre de conflits, de guerres et d'actions terroristes.
Nous avons mis en évidence la situation compliquée que connaît aujourd'hui le monde à l'échelle planétaire. Une planète, la seule que nous ayons, qui s'enfonce dans une crise économique sans précédent et dont le niveau d'endettement atteint les chiffres historiques d'environ 300.000 milliards de dollars.

Le monde ne se limite pas à l'Occident, qui domine la scène internationale depuis deux siècles. Il y a d'autres pays et d'autres cultures, poussés par le vent de l'histoire. Et surtout, ils relèvent avec fermeté et dignité le défi d'offrir une alternative. C'est dans ce but que de nouvelles institutions sont mises en place et qu'elles dessinent d'autres courants de valeurs qui respectent l'idiosyncrasie de chaque peuple. En somme, il s'agit d'ouvrir une nouvelle ère: celle des civilisations ou de la diversité des cultures, fondée sur le dialogue et le respect, dans une recherche commune et constante de l'amélioration de la vie humaine.
Sans aucun doute, nous nous dirigeons vers un nouveau monde multipolaire, un système international qui doit être basé sur le respect, la coopération et le dialogue entre les cultures et les civilisations.
Géopolitique et réalisme dans les relations internationales
Ce que l'on a appelé le "retour de la géopolitique" à la fin du 20ème siècle a été provoqué par deux facteurs incontestables: d'une part, l'échec du "moment unipolaire" qui a émergé après l'effondrement de l'Union soviétique et qui a été dramatiquement mis en scène avec les événements du 11 septembre 2001 et leurs conséquences. Et deuxièmement, l'inadéquation des approches, des méthodologies et des paradigmes des sciences sociales, incapables d'offrir un cadre théorique capable d'expliquer ce qui se passait et qui nous a conduits à la situation actuelle de conflit et à l'échec de la mondialisation telle qu'elle avait été conçue dans les années du "moment unipolaire".
Si la mondialisation et la gouvernance mondiale commençaient à se déliter, c'est parce qu'il y avait des "espaces" (des territoires) qui échappaient au contrôle des puissances dominantes, c'est-à-dire que l'espace était à nouveau au centre de l'analyse... Et la science qui étudie l'influence de l'espace sur la vie des sociétés s'appelle la Géopolitique.
A cela s'ajoute la nécessité d'adopter l'approche de la théorie réaliste des relations internationales (RI). Il s'agit de la théorie qui perçoit l'État comme une entité suprême d'une grande importance et qui comprend que la société et la politique sont régies par des lois objectives, fondées sur la nature humaine elle-même et utilisant deux éléments : les faits et la raison. Dans le sens du réalisme, cela consiste à rassembler des faits et à leur donner un sens en utilisant la raison. La reformulation de cette thèse en termes pratiques consiste à se mettre dans la position d'un homme d'État confronté à un problème de politique étrangère, à examiner les alternatives possibles et à supposer, de manière rationnelle, quel sera le bon choix. Le moteur nécessaire entre la raison et les faits est l'intérêt défini en termes de puissance. C'est le principal indicateur de la politique internationale.

Le réalisme classique part de l'évidence que le monde est politiquement organisé par des nations, et que l'intérêt national est donc l'élément clé, d'où la création de l'État national. Le monde est rempli de nations qui rivalisent et s'affrontent pour le pouvoir, et les politiques étrangères de toutes les nations sont axées sur la survie, d'où l'apparition du modèle de l'État, pour protéger l'identité physique, politique et culturelle contre la menace constante de toutes les autres nations.
Dans le même sens, on suppose que le système international est anarchique, en ce sens qu'il n'y a pas d'autorité au-dessus des États capable de réguler leurs interactions; les États doivent être en relation les uns avec les autres et avec eux-mêmes, plutôt que d'être guidés par les directives d'une entité de contrôle supranationale (car il n'y a en fait pas de gouvernement mondial doté d'AUTORITÉ). Le réalisme repose également sur la conviction que les États souverains, et non les institutions internationales, les ONG ou les multinationales, sont les principaux acteurs des relations internationales.
Selon le réalisme, chaque État est un acteur rationnel qui agit toujours en fonction de ses propres intérêts, et l'objectif principal de chaque État est d'assurer sa propre sécurité. Par conséquent, les relations interétatiques sont conditionnées par le niveau relatif de puissance de l'État. Ce niveau de puissance est déterminé par les capacités économiques, sociales, médiatiques, scientifiques, démographiques et militaires de l'État.
La principale contradiction de notre époque
Dans tout processus, il y a toujours de nombreuses contradictions et, parmi celles-ci, il y en a nécessairement une qui est la contradiction principale (Mao Tse Tung), dont l'existence et le développement déterminent ou influencent l'existence et le développement des autres contradictions.
En géopolitique mondiale, la relation entre la contradiction principale et les contradictions non principales offre une image complexe.
Lorsque l'anglosphère déclenche tout un processus pour préserver son hégémonie mondiale, la contradiction entre l'unipolarité et les pays qui veulent maintenir leur souveraineté devient la contradiction principale, tandis que toutes les autres contradictions (de classe, idéologiques, sociales, culturelles,...) sont temporairement reléguées à une position secondaire et subordonnée.
À chaque stade de développement d'un processus, il n'y a qu'une seule contradiction principale, qui joue le rôle déterminant. Ainsi, s'il y a plusieurs contradictions dans un processus, l'une d'entre elles est nécessairement la principale, celle qui joue le rôle décisif et déterminant, tandis que les autres occupent une position secondaire et subordonnée. Par conséquent, lorsqu'on étudie un processus complexe dans lequel il y a deux ou plusieurs contradictions, il faut s'efforcer de découvrir la contradiction principale. Une fois la contradiction principale appréhendée, tous les autres problèmes peuvent être abordés avec une relative facilité. En ce moment historique, la contradiction principale est entre le monde unipolaire ou mondialiste et le monde multipolaire, le monde des patriotes.
Nous parlons communément du "remplacement de l'ancien par le nouveau". Dans tout processus, il existe une contradiction entre le nouveau et l'ancien, qui donne lieu à une série de luttes pleines de vicissitudes. À la suite de ces luttes, le nouveau passe de petit à grand et devient prédominant, tandis que l'ancien passe de grand à petit et s'approche progressivement de sa disparition. Tel est le carrefour historique où nous nous trouvons aujourd'hui.
Il s'agit d'une contradiction antagoniste, car il est impossible de trouver un compromis entre les deux conceptions géopolitiques, parce que les groupes concernés ont des visions du monde diamétralement opposées et que leurs objectifs sont si différents et contradictoires qu'aucune solution mutuellement acceptable ne peut être trouvée pour les deux parties. Les contradictions non antagonistes peuvent être résolues par un simple débat, mais les contradictions antagonistes ne peuvent être résolues que par la lutte.

Nous pouvons tirer quelques conclusions de ce qui précède :
Le sujet historique des relations internationales est l'État-nation.
Les États-nations sont confrontés à une puissance hégémonique UNIPOLAIRE issue de la fin du monde bipolaire de la guerre froide. Ce que nous appellerions l'ANGLOSPHÈRE (et ses États vassaux) ou l'OUEST actuel.
Cet hégémon est l'instrument des élites mondialistes dont le programme maximal est d'imposer leur modèle libéral-capitaliste à l'ensemble de la planète. En d'autres termes, une seule idéologie, d'essence totalitaire, que nous appelons le GLOBALISME, qui, pour atteindre ses objectifs, vise la disparition des Etats-nations.
Face à eux, les peuples qui ne veulent pas se soumettre au mondialisme. Ce sont les peuples PATRIOTIQUES, qui cherchent à conformer un monde MULTIPOLAIRE, où les différents Espaces de Civilisation peuvent converger dans des relations mutuellement bénéfiques (gagnant-gagnant) et en respectant les différentes identités de toutes les cultures, leurs valeurs et leur histoire.
Le choc entre ces deux visions ANTAGONIQUES du monde est la principale contradiction du moment historique actuel de l'humanité dans son ensemble.
Face à une contradiction antagoniste, il n'est pas possible de trouver une position "médiane", "centrée" ou "équidistante". Il n'est possible que de prendre parti, c'est-à-dire de prendre la DÉCISION politique qui déterminera automatiquement qui est l'AMI ou l'allié, et qui est l'ENNEMI.
La catégorie politique fondamentale en RI : LA SOUVERAINETÉ
Prendre parti pour résoudre la contradiction principale, comme nous l'avons souligné, implique une DÉCISION politique. Pour que le sujet géopolitique, l'État-nation, puisse prendre une décision, une condition est nécessaire: il doit être souverain. Sans Souveraineté, aucune décision libre n'est possible et les intérêts nationaux ne sont pas garantis.
La souveraineté est le pouvoir politique suprême d'un État indépendant, sans ingérence extérieure. Le contraire, quel que soit le nom qu'on lui donne, n'est qu'une forme de vassalité. La souveraineté est une capacité directement liée au POUVOIR que l'État-nation peut développer dans n'importe quel ordre de vie.
En conclusion, toute la politique internationale de l'État et la défense des intérêts nationaux sont subordonnées à l'exercice de la souveraineté et, par conséquent, c'est le facteur premier et fondamental que nous devons tous garantir dans le concert international.
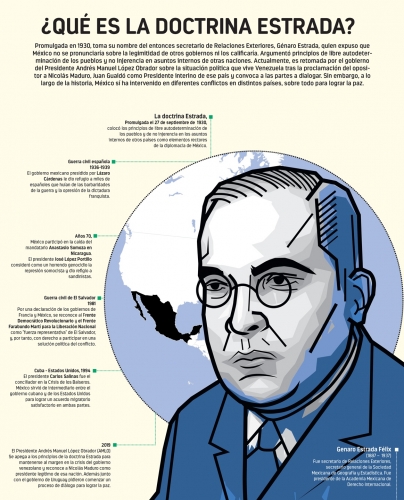
Un corollaire direct de la souveraineté est la doctrine d'Estrada en matière de relations internationales. Cette doctrine repose sur le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États et affirme que les gouvernements étrangers ne doivent pas juger, pour le meilleur ou pour le pire, les gouvernements ou les changements de gouvernement des autres nations, car cela impliquerait une violation de leur souveraineté.
Si nous voulons qu'ils respectent notre souveraineté, nous devons être cohérents et respecter la souveraineté des autres États.
Nous sommes conscients que ce qui précède est extrêmement ambitieux, qu'il s'agit d'un processus qui nécessite du temps, de la détermination et des moyens, que les difficultés sont immenses, mais que les récompenses le sont tout autant. De même, nous savons que chaque étape que nous franchissons doit être développée afin de lui donner solidité et rigueur. Mais l'important est de faire le premier pas : dire avec fermeté et rigueur : "voilà ce que nous voulons".
Car ce que nous voulons, c'est un monde multipolaire, juste, libre et souverain.
19:20 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualté, multipolarité, relations internationales, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 mai 2023
Perspectives sur la multipolarité et le Sud global

Perspectives sur la multipolarité et le Sud global
Dr. Naing Swe Oo
Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/perspectives-multipolarity-and-global-south
Transcription du discours du Dr. Naing Swe Oo lors de la Conférence mondiale sur la multipolarité le 29 avril 2023.
Conférence mondiale sur la multipolarité သို့ တက်ရောက် ဆွေးနွေးကြသော ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီးမှ ဂုဏ်သရေရှိ လူကြီးမင်းများအားလုံး မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။
Mesdames et Messieurs, un grand bonjour à tous.
C'est un grand honneur pour moi de participer à cette conférence mondiale sur la multipolarité.
Je m'appelle Naing Swe Oo. Je suis le fondateur et le directeur exécutif de l'Institut d'études stratégiques Thayninga, ainsi que le conseiller principal de l'Institut d'études stratégiques et internationales du Myanmar, qui dépend du ministère des affaires étrangères du Myanmar.

Aujourd'hui, j'aimerais vous faire part de mon point de vue sur la multipolarité et le Sud global.
Aujourd'hui, le monde est fragmenté, déchiré par des courants croisés, des contradictions et des champs de force multivalents, et non par des visions singulières. Le monde est actuellement confronté à de nombreuses difficultés, notamment des pandémies et des crises.
Nous assistons actuellement à une transition géopolitique de l'hégémonie mondiale de l'Ouest vers l'Est, ce qui est sans précédent dans l'histoire du système mondial capitaliste.
La multipolarité figure désormais en bonne place dans le vocabulaire quotidien des diplomates et des dirigeants mondiaux. Par exemple, le premier sommet des BRIC en juin 2009 a exprimé son soutien à "un ordre mondial multipolaire plus démocratique et plus juste".
Aucun pays ou groupe de pays ne domine la scène mondiale, et le pouvoir est partagé entre plusieurs acteurs importants.
Actuellement, le monde peut être considéré comme multipolaire, car plusieurs grandes puissances exercent une influence et un contrôle significatifs sur différents aspects des affaires mondiales.
La Chine, la Russie, les États-Unis et l'Union européenne sont tous des puissances majeures dotées d'un pouvoir économique, militaire et diplomatique important. D'autres pays comme le Japon, l'Inde, le Brésil et l'Afrique du Sud ont également une influence régionale significative et sont en train de devenir des acteurs mondiaux de premier plan.

Cet ordre mondial multipolaire a des conséquences importantes sur les relations internationales et la gouvernance mondiale. Cela signifie qu'aucun pays ne peut dicter à lui seul les règles du système international et que la coopération et la collaboration entre les pays sont nécessaires pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique, le terrorisme et les pandémies.
Le monde multipolaire actuel présente à la fois des opportunités et des défis pour les pays et la communauté internationale dans son ensemble, et la navigation dans ce paysage complexe et évolutif nécessitera une diplomatie, une coopération et un dialogue attentifs entre tous les acteurs concernés.
L'émergence d'un monde multipolaire offre une série d'opportunités aux pays et à la communauté internationale dans son ensemble. Voici quelques-unes de ces opportunités :
- Une plus grande diversité de perspectives et d'idées
- Une coopération et une collaboration accrues
- Le partage des responsabilités en matière de gouvernance mondiale
- Des opportunités économiques et un plus grand respect de la diversité et des différentes civilisations :
Dans l'ensemble, le monde multipolaire offre des possibilités de coopération, de diversité et d'intégration accrues dans les affaires mondiales. Toutefois, la concrétisation de ces opportunités nécessite un engagement en faveur du dialogue, de la collaboration et du respect de la diversité de la part de tous les acteurs concernés.
L'émergence d'un monde multipolaire a des implications significatives pour le Sud, qui comprend les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine. Dans un monde multipolaire, les pays du Sud ont la possibilité d'accroître leur influence et leur poids dans les affaires mondiales en s'alignant sur une ou plusieurs grandes puissances ou en formant des coalitions entre eux.
Le "Sud global" est en plein essor. On entend généralement par "Sud" les pays moins développés sur le plan économique.
Il s'agit d'un terme général qui englobe une variété d'États ayant divers niveaux d'influence économique, culturelle et politique dans l'ordre international. Le Sud global devient de plus en plus visible et influent dans tous les domaines.

Le monde non occidental - le Sud, longtemps ignoré, ou le "Reste", comme on l'appelle souvent - fait entendre sa voix. Ces régions de la planète, plus jeunes et dont la croissance est plus rapide que celle de l'Occident, mais aussi plus vulnérables au changement climatique, deviennent des acteurs de plus en plus puissants et de plus en plus affirmés de la politique mondiale.
On dit souvent que le monde entre dans une phase multipolaire de la gouvernance mondiale avec la "montée du Sud" ou les pouvoirs croissants des économies émergentes de la Chine, de l'Inde, du Brésil, de la Russie et de l'Afrique du Sud (les BRICS) et le renforcement de leurs relations.
Le monde multipolaire présente également des défis pour le Sud, car il peut entraîner une concurrence et une rivalité accrues entre les grandes puissances pour l'accès aux ressources, aux marchés et à l'influence dans la région. Cela pourrait exacerber les conflits existants et les luttes de pouvoir, et potentiellement conduire à l'exploitation du Sud par des puissances concurrentes.
Pour faire face à la complexité du monde multipolaire, les pays du Sud devront établir des partenariats et des alliances stratégiques qui équilibrent leurs propres intérêts et ceux des grandes puissances. Cela nécessitera une évaluation minutieuse des avantages et des risques liés à l'engagement avec différentes puissances, ainsi qu'un engagement à promouvoir la coopération et la collaboration entre tous les acteurs du système international.
Le Sud est confronté à une série de défis susceptibles d'entraver son développement et ses progrès, malgré les opportunités offertes par l'émergence d'un monde multipolaire. Voici quelques-uns de ces défis
- La pauvreté et l'inégalité
- L'instabilité politique et les conflits
- La faiblesse des institutions et de la gouvernance
- Le changement climatique et la dégradation de l'environnement
- L'accès à l'éducation et aux soins de santé
- Fossé numérique et
- la dette et la vulnérabilité financière
Pour relever ces défis, les gouvernements, les organisations internationales et les acteurs de la société civile doivent déployer des efforts soutenus et coordonnés. Il faut également reconnaître la diversité des besoins et des priorités des différents pays et communautés du Sud, et s'engager à promouvoir un développement inclusif et durable.
Aujourd'hui, le monde connaît des changements considérables et l'humanité entre dans une nouvelle ère de développement rapide et de transformation profonde. Il voit se développer des processus et des phénomènes tels que la multipolarité, la mondialisation économique, l'avènement de la société de l'information, la diversité culturelle, la transformation de l'architecture de la gouvernance mondiale et de l'ordre mondial ; l'interrelation et l'interdépendance entre les États s'accroissent ; une tendance à la redistribution du pouvoir dans le monde se dessine ; et la communauté internationale manifeste une demande croissante de leadership en vue d'un développement pacifique et progressif. Comme le mentionne la "Déclaration conjointe de la Fédération de Russie et de la République populaire de Chine sur les relations internationales entrant dans une nouvelle ère et le développement durable mondial".
En conclusion, l'avenir du Sud dans un monde multipolaire est complexe et incertain, mais il sera probablement façonné par une série de facteurs économiques, politiques et sociaux. Voici quelques-unes des implications potentielles pour le Sud :
- Opportunités économiques
- Alliances politiques :
- Un plus grand pouvoir de négociation :
- Innovation technologique :
- Les défis de la mondialisation :
L'avenir du Sud dans un monde multipolaire dépendra d'une série de facteurs, notamment les alliances politiques, les tendances économiques, l'innovation technologique et les structures de gouvernance mondiale. Pour prospérer dans ce nouvel ordre mondial, les pays du Sud devront adopter des stratégies souples et adaptables, capables de répondre aux opportunités et aux défis présentés par un paysage mondial en rapide évolution.
Je vous remercie de votre attention.
19:17 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : naing swe oo, multipolarité, relations internationales |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 18 avril 2023
L'influence des ONG dans les relations internationales

L'influence des ONG dans les relations internationales
Victoria Sliaktina
Source: https://novaresistencia.org/2023/04/08/a-influencia-das-ongs-nas-relacoes-internacionais/
Classiquement, on considère que les principaux acteurs des relations internationales sont les États. Mais dans la postmodernité, les acteurs non étatiques ont pris de plus en plus d'importance. Et parmi eux, aucun ne s'est davantage renforcé, dans l'ombre, que les ONG.
Les ONG modernes en tant qu'acteurs des relations internationales
De nombreuses organisations non gouvernementales (ONG) sont aujourd'hui connues pour jouer un rôle important dans la collecte et la diffusion de faits concernant des violations présumées des droits de l'homme. Les institutions financières et les organisations telles que les Nations unies s'appuient largement sur les données relatives aux violations des droits de l'homme fournies par les ONG. Il est également bien connu qu'un grand nombre d'ONG remplissent de nombreuses fonctions au nom des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le fait que les ONG contribuent également - et souvent de manière très significative - à l'élaboration de normes en matière de droits de l'homme est un aspect de l'activité des ONG qui est généralement négligé.
Les relations internationales, et en particulier le processus d'élaboration des traités, sont traditionnellement le domaine privilégié des gouvernements en tant que représentants des États-nations. Les gouvernements sont les principaux acteurs. Le terme "organisations non gouvernementales" implique qu'elles ne sont que des organisations secondaires ou auxiliaires. Cependant, ces organisations expriment souvent des valeurs et des intérêts communs à l'ensemble de l'humanité. Bien que les Etats restent les principaux acteurs législatifs, ils doivent prendre en compte la volonté des différents mouvements démocratiques, anti-guerre et anti-nucléaires.
Principales méthodes et mécanismes d'activité
L'implication des ONG dans le processus d'élaboration des normes en matière de droits de l'homme est généralement un phénomène récent. Toutefois, certaines ONG participent depuis longtemps à des campagnes internationales contre l'esclavage, la traite des femmes et des enfants. Les ONG ont créé un climat favorable à la conclusion de conventions internationales dans ces domaines.
Par exemple, une organisation non gouvernementale respectée, le Comité international de la Croix-Rouge, a joué un rôle important dans l'élaboration de normes en matière de droit humanitaire international. Parmi les exemples, citons la Convention de Genève de 1864 pour la protection des victimes de la guerre, les Protocoles de 1977, ainsi que les Conventions de Genève de 1949. L'Association internationale du droit du travail a lancé les conventions internationales du travail de Berne en 1905, 1906 et 1913, qui ont été les précurseurs de nombreuses conventions adoptées plus tard par l'Organisation internationale du travail.

Les Nations unies ont inventé le terme "ONG" pour la première fois après la Seconde Guerre mondiale. Les ONG ont été formellement reconnues dans le droit international pour la première fois en 1945 avec l'adoption de la Charte des Nations unies, qui fait référence aux "organisations non gouvernementales" à l'article 71. Cet accord a introduit une forme standardisée et actualisée de coopération entre les acteurs de la société internationale. Cependant, "la reconnaissance de leur existence n'a qu'un effet limité et ne peut en aucun cas être considérée comme équivalente à un statut juridique". D'une manière générale, malgré l'imprécision du terme, les Nations unies ont créé un terme pour leurs conseillers publics, qui a ensuite été largement utilisé.
En ce qui concerne l'élaboration proprement dite des normes internationales, les ONG choisissent de suivre différentes pratiques et procédures, en fonction des règles appliquées par les forums internationaux, de la réceptivité de ces forums aux contributions des ONG et du type de relation et de la proximité des ONG avec les secrétariats internationaux et les délégués gouvernementaux.
Il existe également de nombreux cas où les ONG produisent des textes complets d'instruments internationaux sur des questions qui les intéressent particulièrement. Les Principes d'éthique médicale, élaborés à l'origine par le Conseil des organisations internationales des sciences médicales (CIOMS) et finalement approuvés par l'Assemblée générale des Nations unies, en sont un exemple.
Statut juridique des ONG
Les ONG sont de plus en plus actives et efficaces dans leur travail de définition de normes dans le domaine de la protection des droits de l'homme. Dans le contexte des Nations unies et d'autres organisations internationales, certaines compétences et qualités sont très importantes, voire indispensables, pour influencer les ONG qui cherchent également à influencer les gouvernements et les parlements pour qu'ils acceptent les traités internationaux relatifs aux droits de l'homme par le biais de la ratification ou de l'adhésion. Ces activités sont importantes en tant que contrepoids à l'immobilisme et à la léthargie qui caractérisent de nombreuses bureaucraties nationales et internationales.
Du point de vue juridique des relations internationales, les ONG semblent rester une "terre inconnue". Une analyse historique de la perception des ONG dans le droit international montre que la question de la personnalité juridique internationale des ONG n'a pas encore reçu de réponse adéquate. Paradoxalement, alors que les États intègrent de plus en plus les ONG dans les structures et les procédures de gouvernance mondiale, on ne sait toujours pas ce qui les caractérise et quel statut elles ont officiellement en vertu du droit international. Si les États se félicitent de la contribution des ONG dans le domaine des droits de l'homme et ont accordé une reconnaissance spécifique aux "associations privées" au niveau national, ils ne se sont pas encore mis d'accord sur une norme pour les ONG travaillant dans le domaine transnational.
Une analyse des règles et réglementations du siècle dernier a montré que le droit international concernant le statut des ONG reste très peu développé. Les droits et obligations des ONG en vertu de la Charte des Nations unies ne sont pas suffisamment définis. On s'est davantage efforcé de réglementer les relations entre les ONG et d'autres entités, telles que les Nations unies, que d'établir des normes pour les ONG.

Ainsi, bien que les ONG soient de plus en plus impliquées dans la promotion de normes juridiques internationales sur une série de questions, le statut des ONG dans le droit international ne s'est pas encore amélioré. Compte tenu du nombre croissant d'ONG impliquées dans les affaires internationales et du rôle variable qu'elles jouent dans les processus de négociation, il est surprenant qu'il ne soit toujours pas clair comment caractériser les ONG en termes juridiques. Les ONG sont souvent invitées à participer à la protection des droits de l'homme parce qu'elles sont considérées comme des organisations représentatives de la société civile et que leur participation est interprétée comme légitimant ou démocratisant l'ensemble du processus. Toutefois, comme certains États profitent de cette situation pour sélectionner, nommer ou soutenir des ONG pro-gouvernementales spécifiques, la nécessité d'une réglementation juridique plus complète de ces organisations dans le cadre des normes internationales devient de plus en plus importante. En outre, il est dans l'intérêt des ONG de garder leur image "propre", sinon la représentativité des ONG - et donc leur raison d'être - pourrait être remise en question.
Source : Geopolitica.ru
20:50 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ong, relations internationales |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 mars 2023
Etats-Unis, Russie et Chine : l'avenir de l'Ukraine passe par le "triangle des équilibres"

Etats-Unis, Russie et Chine: l'avenir de l'Ukraine passe par le "triangle des équilibres"
Federico Giuliani
Source: https://it.insideover.com/guerra/usa-russia-e-cina-il-futuro-dellucraina-passa-dal-triangolo-degli-equilibri.html
La Chine a proposé sa solution politique pour la crise ukrainienne, en énumérant 12 points clés. Il ne s'agit pas d'un véritable plan de paix, comme l'ont qualifié certains commentateurs, mais plutôt d'une prise de position visant à exposer, une fois pour toutes, le point de vue de Pékin sur la guerre en Ukraine.
Parmi les propositions chinoises, le respect de la souveraineté, de l'indépendance et de l'intégrité territoriale de tous les pays, un cessez-le-feu et la reprise des négociations. Mais aussi la fin des sanctions contre la Russie, le dépassement de la mentalité de la guerre froide, c'est-à-dire l'affrontement entre blocs idéologiques opposés. On ne trouve cependant pas de condamnation explicite de la soi-disant opération militaire spéciale lancée par le Kremlin, comme s'y attendaient plusieurs gouvernements occidentaux, ni de feuille de route pour faire de la paix une réalité.
Et dire que Volodymyr Zelensky avait initialement accueilli avec prudence le document chinois. "J'ai l'intention de rencontrer Xi Jinping. Ce serait important pour la sécurité mondiale. La Chine respecte l'intégrité territoriale et doit tout faire pour que la Russie quitte le territoire de l'Ukraine", a déclaré Zelensky lors d'une conférence de presse à Kiev.
Il semblait que l'intercession chinoise pourrait remuer les choses en vue d'une éventuelle reprise des pourparlers de paix. Puis quelque chose a changé en l'espace de quelques heures. L'enthousiasme s'est évaporé dès que Mykhailo Podolyak, conseiller principal de Volodymyr Zelensky, a rejeté la proposition "irréaliste" de la Chine pour mettre fin au conflit.
Selon Podolyak, Pékin ne devrait pas "parier sur un agresseur qui a violé le droit international et qui perdra la guerre". Le document chinois a également été accueilli froidement, alors que depuis des mois, les gouvernements occidentaux appelaient Xi Jinping à accroître la pression sur la Russie pour qu'elle cesse les hostilités.
La diplomatie de la Chine
Pourquoi la Chine n'a-t-elle pas publié un plan de paix, se contentant de rédiger un document explicitant sa position ? Pour le comprendre, il est essentiel d'expliquer le fonctionnement de la diplomatie chinoise, qui est très différente de celle adoptée par l'Europe et les États-Unis.
En effet, pour la Chine, la diplomatie n'est pas une négociation. Les responsables chinois soulignent que, toutes proportions gardées, les négociations entre gouvernements occidentaux aboutissent toujours à des principes de base par le biais de la négociation. Eh bien, pour Pékin, c'est exactement le contraire qui s'applique : il faut d'abord se mettre d'accord sur certains principes de base, puis la phase de négociation a lieu.
En d'autres termes, du point de vue chinois, toute négociation se déroule sur la base de principes préalablement convenus. C'est pourquoi la Chine a rédigé un tel document, dont les 12 points clés peuvent être lus comme des principes sur lesquels entamer des pourparlers de paix. En effet, selon la diplomatie chinoise, il serait insensé d'établir une feuille de route sans partager au préalable les règles du jeu, c'est-à-dire les principes de base susmentionnés relatifs à la question à résoudre.
Comme l'a souligné Henry Kissinger, alors que les pays occidentaux ont l'habitude de faire certaines concessions dans les négociations, la Chine met ses principes sur la table jusqu'à ce que l'autre partie accepte la ligne. Dans le sens du "mode de négociation aux caractéristiques chinoises", sans l'acceptation de principes communs, il ne peut y avoir de négociation.
Pour en revenir à la crise ukrainienne, on peut supposer que Pékin sera (éventuellement) plus précis lorsque et si les parties concernées décident de dialoguer sur les bases posées par la diplomatie chinoise.
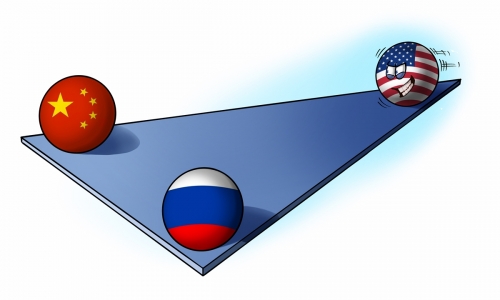
A la recherche d'un équilibre
Une fois cette réserve levée, il convient de se demander ce que la Chine cherche à obtenir. Pékin raisonne en termes de relations gagnant-gagnant, elle recherche un équilibre (réel ou supposé) avec tout interlocuteur et dans toute sphère. En d'autres termes, Xi Jinping ne veut pas aller trop loin dans le soutien aux causes de la Russie ni faire le contraire avec l'Europe et les États-Unis.
Nous pouvons penser à un triangle avec les Etats-Unis, l'Europe et la Russie aux sommets et la Chine au milieu. Chaque relation diplomatique chinoise avec chaque acteur doit être équilibrée, tout comme, idéalement, les autres relations des acteurs impliqués dans le dessin géométrique doivent également être équilibrées.
Pour l'instant, le Dragon préfère se concentrer sur l'amitié illimitée avec la Russie (attention : un partenariat, pas une alliance) car Moscou est la partie la plus déséquilibrée dans la relation avec les États-Unis et l'Europe. Lorsque et si le Kremlin rompt l'inertie et se place en position d'"avantage", Xi déploiera davantage d'efforts pour contrebalancer l'action russe.
L'avenir de l'Ukraine dépend de ce jeu complexe de miroirs et d'équilibres. Une réserve fondamentale demeure : sommes-nous sûrs que l'architecture diplomatique envisagée par la Chine convient également aux autres protagonistes de l'affaire ?
Donnez-nous encore une minute de votre temps !
Si vous avez aimé l'article que vous venez de lire, demandez-vous : si je ne l'avais pas lu ici, l'aurais-je lu ailleurs ? S'il n'y avait pas InsideOver, combien de guerres oubliées par les médias le resteraient ? Combien de réflexions sur le monde qui vous entoure ne seriez-vous pas en mesure de faire ? Nous travaillons chaque jour pour vous fournir des reportages de qualité et des reportages approfondis totalement gratuits. Mais le type de journalisme que nous pratiquons est tout sauf "bon marché". Si vous pensez qu'il vaut la peine de nous encourager et de nous soutenir, faites-le maintenant.
19:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, relations internationales, politique internationale, chine, russie, états-unis, ukraine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 22 janvier 2023
Présentation de Multipolarité au XXIème siècle et de L'Europe, la multipolarité et le système international

Présentation de Multipolarité au XXIème siècle et de L'Europe, la multipolarité et le système international
Age planétaire et nouvel ordre mondial
par Irnerio Seminatore
INSTITUT ROYAL D'ETUDES STRATEGIQUES de RABAT
8 Décembre 2022
TABLE DES MATIERES
Une vue d'ensemble
Alliance Anti-Hegemonique et nouveau Rimland
Crise de l'atlantisme et transition du système
Les issues du conflit ukrainien
L'hégémonie et le remodelage du système
Stabilité et sécurité. Alternance Hégémonique ou alternative systémique ?
Le conflits USA-Russie et la rupture de la continuité géopolitique Europe-Asie
Encerclement, politique des alliances et leçons de la crise
***
Une vue d'ensemble
L'ambition de ces deux publications sur la multipolarité, le tome 1 au titre La Multipolarité au XXIème siècle et le tome 2: L'Europe, la Multipolarité et le Système international. Age planétaire et nouvel ordre mondial, a été d'avoir essayé de dresser une vue d'ensemble sur la politique mondiale à l'époque où nous vivons.
Et cela, sous l'angle d'une pluralité de structures de souverainetés et donc d'équilibre des forces, mais également et surtout de l'antagonisme historique entre puissances hégémoniques et puissances montantes et donc d'un certain ordre politique et moral. On y repère ainsi les deux aspects principaux de tout narratif historique, l'acteur et le système, qui se projettent sur la toile de fond de l'action historique.
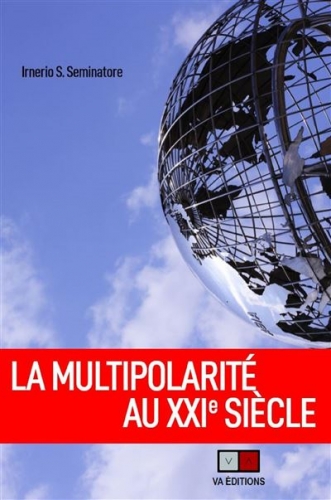
L'acteur, ou la figure de l'Hégémon, y apparaît comme le signifiant universel d'une époque et le système, comme englobant général de tous les antagonismes et de toutes les rivalités, en est le décor.
Ces deux ouvrages couvrent la transition qui va de la fin du système bipolaire à l'unipolarisme américain qui lui a succédé, puis au multipolarisme actuel, en voie de reconfiguration.
Parmi les changements des structures de pouvoir et des ordres internationaux, trois thèmes constituent le fil conducteur de l'antagonisme qui secoue le système, des débats qui animent ses rivalités et ses conflits et, comme tels, l'axe directeur de mes deux ouvrages
- la triade des puissances établies, qui se disputent l'hégémonie de la scène planétaire (Etats-Unis, Russie et Chine), scène devenue durablement instable;
- l'environnement stratégique mondial, comme cadre historique, cumulant les trois dimensions de l’action, d’influence, de subversion ou de contrainte;
- l'Europe, comme acteur géopolitique inachevé et à autonomie incomplète.
Dans ce contexte, l’interprétation des stratégies de politique étrangère prises en considération, obéit aux critères, jadis dominants de la Realpolitik, remis à l’ordre du jour par le World Politics anglo-saxon.
L'option réaliste en politique internationale est adoptée non pas pour garantir l'idéal de la puissance ou de l'Etat-puissance, comme au XIXème siècle, ou encore pour justifier la matrice classique de la discipline, l'anarchie internationale, à la manière de R. Niebuhr, mais pour comprendre les mutations des idées et des rapports de forces, intervenues dans la politique mondiale depuis 1945.
C'est uniquement par l'approche systémique et par conséquent par une vue générale et exhaustive, que l'on peut saisir les conditions idéologiques et structurelles de la remise en cause de la souveraineté des Etats et des Nations et l'apparition d'un univers d'unités politiques interdépendantes et toutefois subalternes à une hégémonie impériale dominante.
Ainsi l'ensemble des essais ici réunis, prétend conférer à ces deux tomes un statut d'éclairage conceptuel pour la compréhension de l'évolution globale de notre conjoncture et pour l'analyse du "Grand Jeu" entre pôles de puissances établies, défiant la stabilité antérieure.
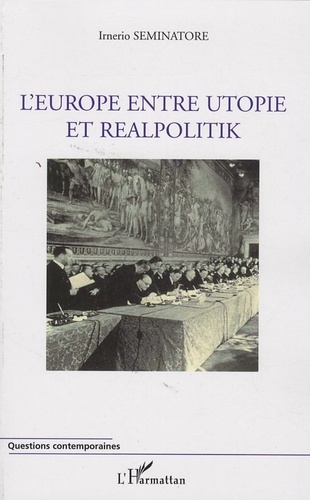
Alliance Anti-Hégémonique et nouveau Rimland
Sont mises en exergue, dès lors :
- l'alliance anti-hégémonique du pivot géographique de l'histoire, le Heartland, par la Russie, l'Iran et la Chine et, en position d'arbitrage la Turquie,
- la chaîne politico-diplomatique du "containement" de la masse eurasienne, par la ceinture péninsulaire extérieure du "Rimland"mondial, constituée par la Grande Ile de l'Amérique, le Japon, l'Australie, l'Inde, les pays du Golfe et l'Europe, ou, pour simplifier, l'alliance nouvelle des puissances de la terre contre les puissances de la mer.
Dans cet antagonisme entre acteurs étatiques, l'enjeu est historique, le pari existentiel et l'affrontement est planétaire.
En soulignant le déplacement de l'axe de gravité du monde vers
l'Asie-Pacifique, provoqué par l'émergence surprenante de l'Empire du Milieu, ce livre s'interroge sur le rôle de l'Amérique et de la Russie, ennemies ou partenaires stratégiques de l'Europe de l'Ouest, justifiant par là le deuil définitif de "l'ère atlantiste" qui s'était imposée depuis 1945.
Crise de l'atlantisme et transition du système
La crise de l'atlantisme, ou du principe de vassalité est aujourd'hui aggravée par deux phénomènes:
- la démission stratégique du continent européen, en voie de régression vers un sous-système dépendant;
- les tentatives de resserrement des alliances militaires permanentes en Europe et en Asie-Pacifique (Otan, Aukus) prélude d'un conflit de grandes dimensions.
Ouvrages didactiques, ces deux tomes prétendent se situer dans la postérité des auteurs classiques du système international, R. Aron, Kaplan, Rosenau, H. Kissinger, K. Waltz, Allison, Brzezinski, Strausz-Hupé, et plus loin, Machiavel et Hobbes, tout aussi bien dans la lecture des changements des équilibres globaux et dans la transition d'un système international à l'autre, que dans la lecture philosophique sur la nature de l'homme, la morphologie du pouvoir et les caractéristiques intellectuelles de la période post-moderne. Ce qui est en cause dans toute transition est le concept de hiérarchie.
Sous ce regard de changement et de mouvement, le retour de la guerre en Europe représente le premier moment d'un remodelage géopolitique de l'ensemble planétaire et une rupture des relations globales entre deux sous-systèmes, euro-atlantique et euro-asiatique.
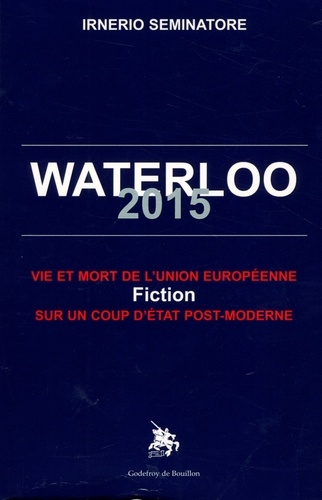
Au sein de ce retournement, l'Europe y perd son rôle d'équilibre entre l'Amérique et la Russie et le grand vide de puissance, qui s'instaure dans la partie occidentale du continent, est aggravé par l'absence de perspective stratégique, par le particularisme des options diplomatiques des Etats-Membres de l'Union Européenne, par le flottement des relations franco-allemandes jadis structurantes et, in fine, par la difficile recherche d'un Leadership commun.
Les issues du conflit ukrainien
L'issue du conflit ukrainien, comme guerre par procuration mené par l'Amérique contre la Russie, a été présenté au Forum sur la sécurité internationale de Halifax, au Canada, par Lloyd Austin, Secrétaire américain à la défense, comme déterminant de la sécurité et de l'ordre mondial du XXIème siècle fondé, sur des règles. Ce conflit prouve la difficulté de l'Union européenne à assurer une architecture européenne de sécurité "égale et indivisible" car il intervient comme modèle de rupture dans les relations de coopération internationales et préfigure en Asie-Pacifique une relation d'interdépendance stratégique et d'alliances militaires opposées, entre puissances du "Rimland" et puissances du "Heartland", face à l'ouverture prévisible, d'une crise, concernant le "statut" de Taiwan.
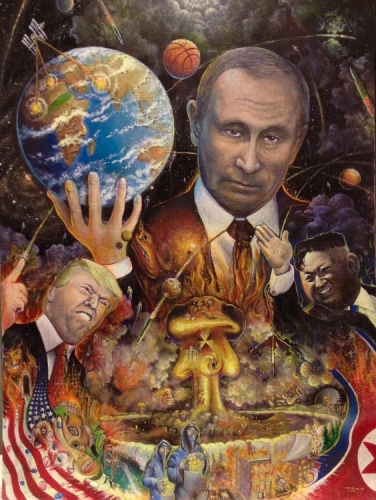
Dans la perspective d'une invasion de celle-ci par la Chine s'ouvriraient les portes de la géopolitique planétaire vers le Pacifique et l'Australie et changerait immédiatement le sens du conflit entre Moscou et l'Occident. Seraient particulièrement brouillés les calculs de Washington sur le rôle de la Russie en Europe, en Asie-centrale et en Asie-Pacifique, d'où le jeu ambigu de la Turquie et la recherche d'une profondeur stratégique pour l'emporter, qui demeure sans précédent.
Aujourd'hui, l'affrontement Orient et Occident est tout autant géopolitique et stratégique, qu'idéologique et systémique et concerne tous les domaines, bien qu'il soit interprété, dans la plupart des cas, sous le profil de la relation entre économie et politique.
Sous cet angle, en particulier, l'unipolarisme de l'Occident fait jouer à la finance, disjointe de l'économie, un rôle autonome pour contrôler, à travers les institutions multilatérales, le FMI et la Banque Mondiale, l'industrie, la production d'énergie, l'alimentation, les ressources minières et les infrastructures vitales de plusieurs pays.
Dans ce cadre les Etats qui soutiennent la multipolarité sont aussi des Etats à gouvernement autocratique, qui résistent au modèle culturel de l'Occident et affirment le respect de vies autonomes de développement, une opposition visant la financiarisation et la privatisation des économies , subordonnant la finance à la production de biens publics.

L'hégémonie et le remodelage du système
Or le remodelage du système international pose le problème de l'hégémonie comme nœud capital de notre époque et inscrit ce problème comme la principale question du pouvoir dans le monde. En effet nous allons vers une extension sans limites des conflits régionaux, une politique de resserrement des alliances militaires, occidentales, euro-asiatiques et orientales, qui donnent plausibilité à l'hypothèse d'une réorganisation planétaire de l'ordre global, par le biais d'un conflit mondial de haute intensité.
La plausibilité d'un conflit majeur entre pôles insulaires et pôles continentaux crée une incertitude complémentaire sur les scénarios de belligérance multipolaire dans un contexte de bipolarisme sous-jacent (Chine-Etats-Unis)
C'est l'une des préoccupations, d'ordre historique, évoquées dans ces deux tomes sur la multipolarité.
A ce propos, le théâtre européen élargi (en y incluant les crises en chaîne qui vont des zones contestées des pays baltes au Bélarus et à l'Ukraine, jusqu'au Golfe et à l'Iran, en passant par la Syrie et le conflit israélo-palestinien), peut devenir soudainement l'activateur d'un conflit général, à l'épicentre initial dans l'Est du continent.
Ce scénario, qui apparaît comme une crise du politique dans la dimension de l'ordre inter-étatique, peut être appelé transition hégémonique dans l'ordre de l'histoire en devenir.
Bon nombre d'analystes expriment la conviction que le système international actuel vit une alternance et peut être même une alternative hégémonique et ils identifient les facteurs de ce changement, porteurs de guerres, dans une série de besoins insatisfaits , principalement dans l'exigence de sécurité et dans la transgression déclamatoire du tabou nucléaire, sur le terrain tactique et dans les zones d'influence disputées (en Ukraine, dans les pays baltes, en Biélorussie, ainsi que dans d'autres points de crises parsemées).
L'énumération de ces besoins va de l'instabilité politique interne, sujette à l'intervention de puissances extérieures, à l'usure des systèmes démocratiques, gangrenés en Eurasie par l'inefficacité et par la corruption et en Afrique, par le sous-développement, l'absence d'infrastructures modernes, la santé publique et une démographie sans contrôle.
En effet, sans la capacité d'imposer la stabilité ou la défendre, Hégémon ne peut exercer la suprématie du pouvoir international par la seule diplomatie, l'économie, le multilatéralisme, ou l'appel aux valeurs.
Il lui faut préserver un aspect essentiel du pouvoir international (supériorité militaire, organisation efficace, avancées technologiques, innovation permanente, etc).
Hégémon doit tenir compte de l'échiquier mondial, de la Balance of Power, de la cohésion et homogénéité des alliances, mais aussi de l'intensité et de la durée de l'effort de guerre. C'est pourquoi les guerres majeures relèvent essentiellement de décisions systémiques (R. Gilpin).

Stabilité et sécurité. Alternance Hégémonique ou alternative systémique ?
La question qui émerge du débat actuel sur le rôle des Etats-Unis dans la conjoncture actuelle est de savoir si la "Stabilité stratégique" assurée pendant 60 par l'Amérique (R. Gilpin) est en train de disparaître, entrainant le déclin d'Hégémon et de la civilisation occidentale, ou bien, si nous sommes confrontés à une alternative hégémonique et à un monde post-impérial.
L'interrogation qui s'accompagne au déclin supposé des Etats-Unis et à la transition vers un monde multipolaire articulée, est également centrale et peut être formulée ainsi; "quelle forme prendra cette transition ?".
La forme déjà connue, d'une série de conflits en chaîne, selon le modèle de R. Aron, calqué sur le XXème siècle, ou la forme plus profonde d'un changement de la civilisation, de l'idée de société et de la figure de l'homme selon le modèle des "révolutions systémiques" de Strausz-Hupé, couvrant l'univers des relations socio-politiques du monde occidental et les grandes aires de civilisations connues?
Du point de vue des interrogations connexes, les tensions entretenues entre les Occidentaux et la Russie en Ukraine, sont susceptibles de provoquer une escalade aux incertitudes multiples, y compris nucléaires et des clivages d'instabilités, de crises ouvertes et de conflits gelés, allant des Pays baltes à la mer Noire et du Caucase à la Turquie. Ces tensions remettent à l'ordre du jour l'hypothèse d'un affrontement général, comme issue difficilement évitable de formes permanentes d'instabilité régionales, aux foyers multiples, internes et internationaux.
Cette hypothèse alimente une culture de défense hégémonique des Etats-Unis, dont la projection de puissance manifeste sa dangerosité et sa provocation en Europe, au Moyen Orient et en Asie.

Le conflits USA-Russie et la rupture de la continuité géopolitique Europe-Asie
En ce sens le conflit avec la Russie, par Ukraine interposée, peut être interprété comme une tentative de désarticulation de la continuité géopolitique de l'Europe vers l'Asie (Brzezinski) et de la Chine vers la région de l'Indopacifique. C'est sous l'angle de fracturation et de la vassalité, que s'aggravent les facteurs d'incertitudes et les motifs de préoccupation sur les tendances stratégiques des Etats-Unis.
En effet la différenciation vis à vis du Leader de bloc distingue en Europe les pays d'obédience et d'influence atlantique stricte (GB, pays nordiques, Hollande, Belgique, Pays baltes et Pologne) des pays du doute et de la résistance (France, Italie et Allemagne).
Au niveau planétaire font partie des zones à hégémonie disputée et demeurent sujettes à l'influence grandissante de la Realpolitik chinoise la région des Balkans, de la mer Noire, de la Caspienne, du plateau turc, du Golfe, de l'Inde, d'Indonésie, du Japon et d'Australie.
Pariant, sans vraiment y croire sur la "victoire" de Kiev", face à Moscou, l'Amérique entend clairement faire saigner la Russie, en éloignant le plus possible la perspective d'un compromis et d'une sortie de crise.
Par ailleurs la vassalité de l'Europe centrale vis à vis de l'Amérique deviendra une nécessité politique et militaire, afin de décourager l'Allemagne, réarmée, de vouloir réunifier demain le continent. Une vassalité semblable pourrait opposer les pays asiatiques à la Chine dans la volonté de restituer de manière unilatérale, l'Asie aux Asiatiques.
Encerclement, politique des alliances et leçons de la crise
Du point de vue des leçons à tirer et de ses répercussions, la crise ukrainienne a mis à l'ordre du jour la réflexion sur la morphologie des systèmes internationaux, stables, instables ou révolutionnaires, et, en particulier la politique des alliances, qui ont fait grands les empires et inéluctables les guerres.
Comme l'Empire allemand avant 1914, la Fédération de Russie a pu se sentir encerclée par l'Otan et a choisi, en pleine conscience du danger, de passer d'un mode défensif à un mode préventif et offensif, au nom de ses intérêts de sécurité et de la conception commune et incontestable de la "sécurité égale et indivisible" pour tous les membres de la communauté internationale. Une sécurité égale qui était justifiée, avant la première guerre mondiale, par une équivalence morale entre les ennemis, comme l'a bien montré Carl Schmitt, contre la diabolisation de l'Allemagne.
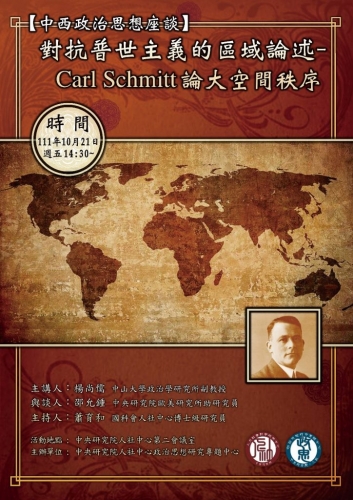
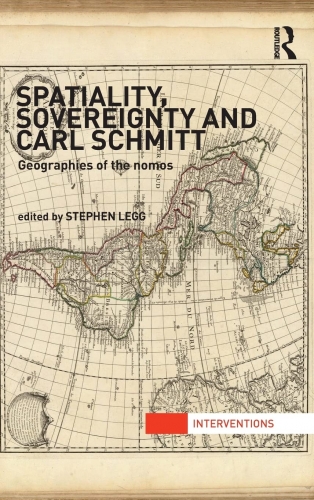
Telle est, à mes yeux, la vue d'ensemble de la conjoncture que nous vivons, si profonde et si grave, que j'ai essayé d'en décrire les formes et les enjeux et de la soumettre au jugement de nos contemporains, pour qu'en témoigne l'Histoire et pour qu'en tire profit la décision politique. Et cela dans le but de décrypter les dilemmes de la paix et de la guerre et de percevoir dans la détérioration des systèmes internationaux, un espoir de compatibilité civilisationnelle et stratégique entre acteurs principaux, portant sur la stabilité ou le retour à la stabilité
Pour rendre moins aléatoire cette recherche j'ai adoptée tour à tour cinq niveaux de compréhension :
- théorique (attributs systémiques, système et sous-systèmes, homogénéité- hétérogénéité, stabilité et sécurité);
- historique (la scène planétaire et sa morphologie ,les acteurs et les constellations diplomatiques);
- géopolitique (enjeux globaux, géopolitique continentale et géopolitique mondiale océanique);
- stratégique (la triade, le condominium USA-Chine ou le duel du siècle, hégémonie et compétition hégémonique);
- institutionnel (la crise de l’unipolarisme et de l’atlantisme, l’Europe et la multipolarité);
et j'en ai conclu à et opté pour un indéterminisme probabiliste, qui gouverne le sort de l'homme et des sociétés, dans le sens de la liberté ou de celui de la tyrannie, de la vie ou de la mort.
Ce travail, qui m'a demandé quarante ans, ne m'a consenti aucune certitude et aucune sentence définitive et m'a toujours rappelé que l'histoire reste ouverte au choix du bien ou du mal et à celui de la volonté la plus déterminée, soit-elle terrifiante.
Ce qui se prépare aujourd'hui et qui est conforme à la théorie des grands cycles et à la situation du monde actuel, demeure le duel du siècle entre les Etats-Unis et la Chine. Mais "quid" alors de la Russie et avec autant d'inquiétude de l’Europe ?
Les interrogations proposent à l'action les grandes options de demain, mais ne donnent que l'image approximative du possible et jamais la solution accomplie. Celle-ci appartient à l'imprévu, qui est l'enfant naturel du risque et l'appétit le plus cruel de l'aventure humaine.
Bruxelles le 8 Décembre 2022
19:56 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, hégémonisme, géopolitique, politique internationale, relations internationales, livre, irnerio seminatore, théorie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 janvier 2023
Henry Kissinger et le déficit de leadership mondial

Henry Kissinger et le déficit de leadership mondial
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2022/12/27/henry-kissinger-ja-globaali-johtajuusvaje/
La qualité du leadership mondial se détériore à un moment où il est désespérément nécessaire, affirme Henry Kissinger, un vétéran de la politique étrangère américaine. Il craint que la civilisation ne soit ainsi mise en danger. La culture occidentale, du moins, est déjà en déclin.
Kissinger est un réaliste, mais aussi un élitiste qui croit que seule une poignée de personnes comprend la structure complexe d'un ordre mondial viable. De même, il estime que très peu de personnes ont le talent de leadership nécessaire pour créer, défendre ou réformer un cadre international fragile.
Il ne suffit pas, pour un dirigeant efficace, de comprendre le système international. Kissinger pense qu'il existe un énorme fossé entre le monde que les citoyens d'un pays veulent voir advenir et le monde qui est réellement possible. Ce ne peut être le monde que, disons, l'opinion publique chinoise aimerait voir se constituer, ni le monde que de nombreux Américains aimeraient pérenniser. Il ne peut pas non plus être aussi islamique que certains musulmans le souhaiteraient.
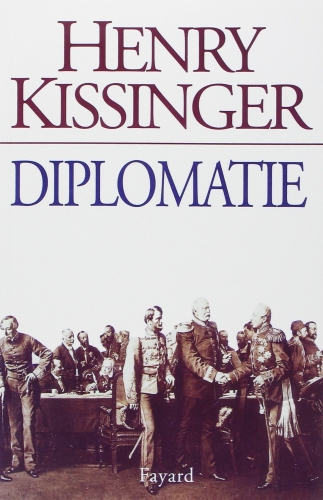
Les grands dirigeants, selon Kissinger, doivent combler le fossé entre l'opinion publique de leur propre pays et les compromis indissociables de la diplomatie internationale. Ils doivent avoir une vision suffisamment claire de l'état actuel du monde pour comprendre ce qui est possible et durable. Ils doivent également être capables de persuader leurs compatriotes d'accepter des solutions qui sont inévitablement des compromis souvent décevants.
Un tel leadership exige une combinaison rare de capacités intellectuelles, d'éducation et de compréhension intuitive de la politique que peu possèdent. Le dernier livre de Kissinger, Leadership : Six Studies in World Strategy, présente six études de cas historiques qui lui plaisent : l'Allemand Konrad Adenauer, le Français Charles de Gaulle, l'Américain Richard Nixon, l'Égyptien Anouar Sadate, la Britannique Margaret Thatcher et le Singapourien Lee Kuan Yew.
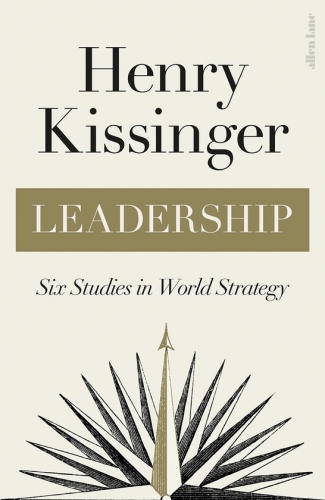
Comme le suggère le sous-titre du livre, Six Studies in World Strategy, le géopoliticien Kissinger s'intéresse surtout à la manière dont ces dirigeants se sont comportés sur la scène mondiale. Pour Kissinger lui-même, les manœuvres stratégiques étaient souvent plus importantes que les considérations morales ou juridiques, de sorte qu'il ne s'intéresse pas à la manière dont les dirigeants examinés se sont comportés dans leurs parlements nationaux.
Il est intéressant de noter que Kissinger semble même respecter Charles de Gaulle, un Français critique de l'OTAN et opposant à l'hégémonie anglo-américaine, qui a créé la réalité politique "par la seule force de sa volonté". Kissinger admire les qualités d'homme d'État de De Gaulle, suggérant que "sur toutes les questions stratégiques majeures qui ont confronté la France et l'Europe pendant trois décennies, De Gaulle a jugé correctement, contre un consensus écrasant".
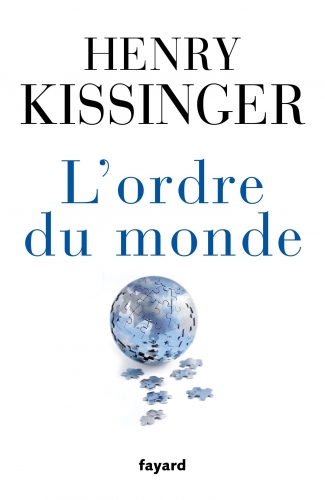
Les circonstances exceptionnelles faisaient autrefois ressortir les leaders nécessaires, mais Kissinger craint que dans le monde d'aujourd'hui, ce ne soit plus le cas. Il se demande si la culture d'aujourd'hui s'est érodée au point que les sociétés ne disposent plus de la sagesse nécessaire pour préparer les nouvelles générations au leadership. Beaucoup d'autres se sont également demandés si le monde du futur proche sera façonné par l'idiocratie de la comédie de science-fiction américaine.
Il ne s'agit pas seulement d'une question de politique d'identité libérale abrutissant l'éducation, mais aussi de la façon dont une culture médiatique plus visuelle et l'internet affectent la conscience collective, sapant la concentration et un examen profond et holistique des faits. Les médias créent également une grande pression pour se conformer, à laquelle il est difficile pour les politiciens d'échapper.
À près de 100 ans, Kissinger réfléchit aux problèmes de leadership depuis plus longtemps que la plupart des Américains. Lorsqu'il est arrivé sur le devant de la scène dans les années 1960, l'ancienne élite dominait encore la politique étrangère américaine. Mais l'ancienne garde a depuis été remplacée par une nouvelle. En particulier, les réalisations de l'homme d'État américain au 21ème siècle n'inspirent plus Kissinger.
Un initié occidental mondialiste estime que le problème de l'ordre mondial est désormais de plus en plus difficile. La lutte des grandes puissances s'intensifie, la Chine représente un défi plus complexe pour l'Occident que l'Union soviétique, et la confiance internationale dans l'hégémonie américaine a diminué.
Les tensions géopolitiques augmentent et les technologies de cyberguerre et d'intelligence artificielle sont entrées en scène. Kissinger estime que les défis d'aujourd'hui requièrent un sens de l'État et une sagesse classique, dont l'absence a conduit les populistes et les technocrates à mal gouverner le monde.
18:05 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : henry kissinger, états-unis, politique internationale, diplomatie, relations internationales |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 30 août 2022
Le désordre international conflictuel

Le désordre international conflictuel
Il sera très difficile pour la logique multilatérale d'avoir une chance.
Alberto Hutschenreuter*
Source : https://saeeg.org/index.php/2022/08/18/el-desorden-internacional-confrontativo/
L'état actuel des relations internationales est extrêmement préoccupant, car non seulement il n'existe aucune configuration qui assure une stabilité relative, mais le degré de discorde entre les centres prééminents nous laisse face à des scénarios qui n'excluent pas une détérioration majeure, face à laquelle le multilatéralisme, qui connaît sa plus profonde inutilité depuis les années 1990, ne pourra pratiquement rien faire, contrairement, d'ailleurs, à se qui s'est encore passé en avril 2009, lorsque, au lendemain de la crise financière de 2008, les dirigeants des principales puissances économiques réunis au sommet du G-20 à Londres ont adopté des mesures pour éviter une dépression majeure (selon l'ancien diplomate indien Shivshankar Menon, il s'agissait de "la dernière réponse cohérente du système international à un défi transnational").
Aujourd'hui, il y a un état de "non-guerre" entre l'Occident et la Russie, c'est-à-dire qu'il y a une confrontation ouverte entre la Russie et l'Ukraine, mais il y a aussi, au niveau supérieur ou stratégique de cette guerre, une confrontation indirecte entre la Russie et l'OTAN. Et peut-être sommes-nous prudents en disant "indirect", car lorsqu'on lit la récente vision stratégique de l'Alliance approuvée à Madrid et la conception navale russe plus récente, toutes deux montrent ces acteurs comme des "gladiateurs" sur le point de s'affronter (comme Thomas Hobbes concevait la prédisposition naturelle des États les uns envers les autres).
La guerre, les États et la discorde constituent les principaux éléments de l'équation des relations internationales. Et il est pertinent de le rappeler, car jusqu'avant la pandémie, malgré le climat international déjà endommagé par la guerre interne et internationale en Syrie depuis 2011 et les événements en Ukraine-Crimée en 2013-2014, les approches marquant le déclin de la violence humaine et même la dépréciation de la guerre entre centres prééminents étaient prédominantes.

Certains rapports réputés sont catégoriques par rapport à la contestation de ces approches. D'une part, les dépenses militaires : selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI), les dépenses militaires mondiales en 2021 ont dépassé pour la première fois les deux mille milliards de dollars, atteignant la somme impressionnante de 2113 milliards de dollars, soit 0,7 % de plus qu'en 2020 et 12 % de plus qu'il y a dix ans.
D'autre part, selon le Global Peace Index 2022, un rapport annuel publié par l'Institute for Economics and Peace, le scénario international et intra-national est sombre et inquiétant en raison de multiples conflits ouverts : le monde d'aujourd'hui est beaucoup plus instable et violent qu'il y a trois décennies. Le GEM utilise 23 indicateurs et trois axes pour mesurer le niveau de paix des États : le niveau de sécurité de la société, l'ampleur des conflits nationaux et internationaux en cours, et la militarisation des États. Selon cette étude, en 2021, les plus grandes détériorations ont concerné les relations entre pays voisins, l'intensité des conflits internes, le nombre de populations déplacées, l'ampleur de la terreur politique et l'instabilité politique. Depuis des lieux qui affirmaient naguère le cours presque invariable du monde vers une gouvernance centrée sur la galaxie des mouvements sociaux et l'éveil d'une nouvelle conscience mondiale animée par des questions thématiques qui perturbaient l'action individuelle et enracinaient l'effort concerté, l'anarchie n'était pas seulement dépassée, mais reflétait une mise en évidence "pathologique" (et donc "éternisante" au sens "tragique" que cela implique pour la réflexion théorique et la performance politique internationale) de l'absence d'autorité centrale parmi les États.

Eh bien, les cas de l'Ukraine et de Taïwan-Chine (plus les nombreux autres qui ont eu lieu au cours des années 2020 et 2021, les "années pandémiques") nous indiquent que l'anarchie, la guerre (sa conséquence la plus risquée) et la rivalité sont toujours en vigueur et que, de plus, il n'y a aucune raison de croire que la situation, au-delà de la pertinence de questions telles que l'environnement ou les technologies avancées, connaîtra un changement d'échelle. Il faut ajouter à cela que la pandémie, qui n'impliquait aucune menace d'une nation à l'autre, n'a pas donné naissance, au-delà des déclamations, à un nouveau système de valeurs coopératives ou à une nouvelle gouvernance fondée sur "l'humanité d'abord".
Il règne donc un désordre international, une situation qui, bien que défavorable à la sécurité et à la stabilité entre les États, constitue néanmoins une "régularité" dans les relations internationales. Mais ce qui est inquiétant, c'est le niveau de confrontation et de rivalité entre les acteurs. Une telle situation n'existe plus depuis longtemps, car après la "longue paix" du régime de la guerre froide (1945-1991), puis le "régime de la mondialisation" (1992-1998) et enfin l'hégémonie américaine (2001-2008), les relations internationales, notamment après les événements d'Ukraine-Crimée (2013-2014), se sont progressivement enfoncées dans un état de plus en plus hostile, sans qu'aucune de leurs puissances prééminentes ne fasse l'effort d'imaginer des schémas ou des techniques qui fourniraient de nouveaux biens publics pour un fonctionnement moins précaire de ces relations.
Le fait est que l'hostilité et la discorde n'impliquent aucun équilibre ni aucune modération, même dans le désordre. Nous revenons ici à Shivshankar Menon, déjà cité, qui vient d'avertir que tous les acteurs prééminents, même ceux des couches moyennes et aussi les institutionnalistes (comme l'Allemagne), présentent ce que l'on pourrait appeler un "comportement révisionniste" ; c'est-à-dire que chacun poursuit ses propres fins au détriment de l'"ordre" international et tente de changer la situation. Selon leurs propres termes : "De nombreux pays sont mécontents du monde tel qu'ils le voient et cherchent à le changer à leur avantage. Cette tendance pourrait conduire à une géopolitique plus mesquine et plus litigieuse et à des perspectives économiques mondiales moins bonnes. Faire face à un monde de puissances révisionnistes pourrait être le défi déterminant des années à venir".

En outre, le manque d'ordre implique déjà un manque de ce que l'on appelle des "tampons de conflit", c'est-à-dire des logiques d'influence de la part des puissances qui peuvent empêcher le déclenchement de confrontations entre des puissances moindres ; une situation de désordre conflictuel implique non seulement un tel manque stratégique, mais pourrait déclencher de dangereux conflits dormants ou latents qui existent dans diverses parties du monde, au-delà de ceux qui existent sur des "plaques géopolitiques" sensibles.
En bref, les relations internationales se sont détériorées au cours des presque 10 dernières années. La pandémie n'a créé aucune forme de coopération accrue entre les États (au contraire, elle a servi d'élément factuel qui a renforcé la méfiance). Sous Xi, la Chine est entrée dans un cycle de plus grande affirmation de soi au niveau national, tout en se fixant pour objectif de devenir une puissance à part entière entre 2035 et 2050. Les États-Unis sont prêts à jouer un rôle basé sur une nouvelle primauté ou un modèle étranger offensif.
La Russie est entrée en guerre pour empêcher l'Occident, par le biais de l'OTAN, de consommer une victoire finale ou une "paix carthaginoise" avant elle. L'Union européenne a peut-être compris qu'il ne suffit pas d'être une puissance institutionnelle (l'Allemagne a modifié la ligne classique de sa politique de défense tournée vers l'extérieur). Une nouvelle dynamique de blocs géostratégiques et géoéconomiques semble se dessiner dans la zone Indo-Pacifique. Le Japon a augmenté de manière significative ses dépenses militaires, tout en reprenant les pulsions d'affirmation nationale autrefois promues par Shinzo Abe, récemment assassiné.
Comme si cela n'était pas assez inquiétant, les acteurs dotés de l'arme nucléaire ne font aucun effort pour progresser vers des accords visant à réglementer ce secteur ; au contraire, il ne reste pratiquement plus de zones pour étendre (ou plutôt rétablir) l'équilibre, alors que pratiquement tous améliorent leurs capacités.
Dans ce cadre, il sera très difficile pour la logique multilatérale d'avoir une chance, sauf dans des cas très spécifiques. Par conséquent, si les deux grandes puissances, la Chine et les États-Unis, n'en viennent pas d'abord à une confrontation ou à une querelle majeure à la suite d'un incident ou d'une provocation américaine (une puissance qui décide d'une orientation extérieure basée sur "la tentation de la primauté", comme l'appelle Robert Kagan qui en fait la promotion), peut-être que le cours du monde vers un bipolarisme sino-américain pourrait donner forme à l'esquisse d'un ordre international, précaire, mais un ordre tout de même. Un "G-2" compétitif et conflictuel, certes, mais aussi avec une coopération minimale. L'expérience montre que les systèmes bipolaires ont tendance à être plus stables que les systèmes multipolaires.
Une accélération de la démondialisation économique et de la délocalisation technologico-industrielle pourrait également inciter, notamment les Etats-Unis, à la provocation. Mais même l'interdépendance économique ne garantit pas l'inhibition des conflits.
Par conséquent, un tel régime éventuel à deux bases n'est une possibilité que sous forme de conjecture, rien de plus. Ce qui est inquiétant, c'est qu'au-delà de cette conjecture, rien d'autre n'est en vue, du moins pour l'instant.
* * *

À propos de l'auteur :
* Doctorat en relations internationales (USAL). Il a été professeur à l'UBA, à l'Escuela Superior de Guerra Aérea et à l'Instituto del Servicio Exterior de la Nación. Membre et chercheur de la SAEEG. Son dernier livre, publié par Almaluz en 2021, s'intitule "Ni guerra ni paz. Une ambiguïté troublante".
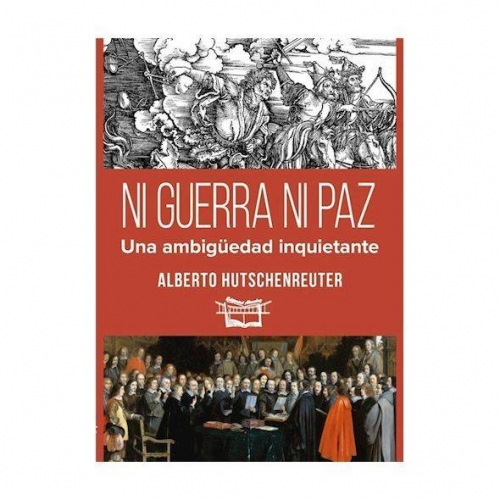
©2022-saeeg®
19:20 Publié dans Actualité, Géopolitique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, ordre international, relations internationales, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 26 mai 2022
Le cosmos comme espace de la géopolitique

Le cosmos comme espace de la géopolitique
Par l'équipe de katehon.com
Source : https://nritalia.org/2022/05/23/il-cosmo-come-spazio-della-geopolitica/
L'espace est devenu une arène de rivalité géopolitique entre trois puissances mondiales: les États-Unis, la Chine et la Russie, la Russie jouant le rôle d'outsider.
Au début du 21e siècle, le politologue américain Everett Dolman, dans son article "Geostrategy in the Space Age", a utilisé pour la première fois le terme "astropolitique", le qualifiant de géopolitique étendue au "royaume de l'espace" [1]. Par ailleurs, E. Dolman a défini l'astropolitique comme "l'étude de la relation entre l'espace extra-atmosphérique, la technologie et le développement de la stratégie politique et militaire" [2].
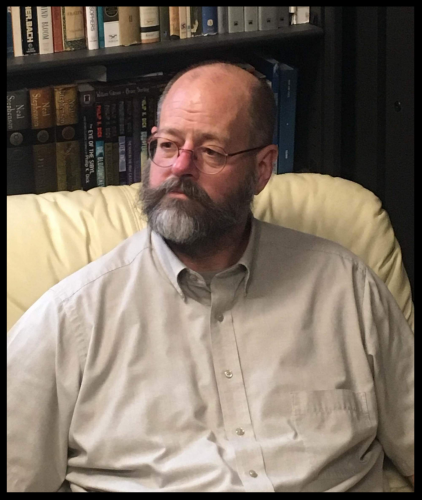
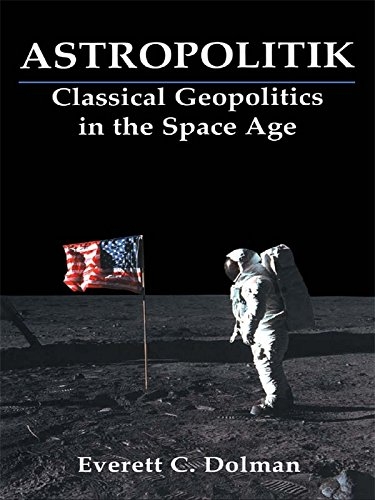
L'espace est en effet un lieu de compétition géopolitique. Par conséquent, outre les intérêts évidents en matière de science, l'espace a toujours été important en termes d'affaires militaires et de sécurité nationale. Pendant la guerre froide, lorsque l'ère de l'exploration spatiale a commencé, tous les programmes spatiaux ont été stimulés, avant tout, par la rivalité entre les deux puissances: l'URSS et les États-Unis. Cela s'applique à la fois à la sécurité internationale et aux programmes de recherche, y compris l'envoi de personnes, d'animaux, de satellites, de vaisseaux spatiaux, etc. dans l'espace.
La géopolitique/astropolitique d'Everett C. Dolman
Aujourd'hui, la pertinence des idées d'E. Dolman sur l'espace en tant que nouveau champ de bataille stratégique ne cesse de croître, les grandes puissances s'affrontent chaque année davantage dans l'espace et le nombre d'acteurs impliqués dans cette rivalité ne cesse d'augmenter. En outre, il y a une militarisation active de l'espace extra-atmosphérique, de sorte que l'un des aspects les plus importants de l'astropolitique est la prévention d'une menace militaire provenant de l'espace extra-atmosphérique.
Comme mentionné précédemment, le terme "astropolitique" est apparu au début des années 2000 grâce au politologue américain E. Dolman. Quelle est l'essence de la pensée astropolitique et pourquoi le travail d'un professeur américain écrit il y a 20 ans est-il toujours d'un grand intérêt ?
Le livre sensationnel de Dolman, Astropolitics : Classical Geopolitics in the Space Age, comme l'écrit l'auteur lui-même, poursuit le processus d'affinement des théories géopolitiques que Dolman "diffuse" au-delà de la Terre, dans l'espace. Le politologue interprète à sa façon la théorie du "Heartland" de Halford Mackinder. La formule est "celui qui gouverne l'Europe de l'Est possède le Heartland". Celui qui gouverne le Heartland possède l'île-monde (l'Eurasie). Celui qui gouverne l'île-monde possède le monde" est transformé en formule "celui qui contrôle l'orbite terrestre basse contrôle l'espace proche". Celui qui contrôle l'espace proche dirige la Terre (c'est-à-dire la Terre et l'espace). Celui qui domine la Terre détermine le sort de toute l'humanité".
Le professeur est convaincu que l'espace deviendra inévitablement un champ de bataille stratégique dont le contrôle sera toujours remis en question. Et il y a de nombreuses raisons à cela : premièrement, la domination de l'espace proche de la Terre est, selon lui, cruciale pour l'hégémonie mondiale (pour laquelle, soit dit en passant, toutes les grandes puissances se battent actuellement) ; deuxièmement, l'espace est un environnement où la présence d'intérêts économiques et commerciaux ne cesse de croître (ce n'est pas pour rien que la liste des entreprises privées dans le secteur spatial s'allonge). De plus, il existe une énorme quantité de ressources inexploitées dans l'espace, car presque tous les métaux extraits des couches supérieures de la Terre sont des restes d'astéroïdes. Et bien que l'extraction des ressources spatiales soit une tâche très difficile d'un point de vue technologique et logistique, les ressources sur Terre sont épuisées et les technologies se développent. Et à mesure que l'exploration spatiale progresse, la rivalité politique et économique, plutôt que la coopération, deviendra de plus en plus courante.
Il est évident que le sort des futures colonisations spatiales se décidera en mode "ici et maintenant". Tant que les puissances sont animées par des motifs impérialistes (et elles le seront probablement toujours), il ne peut être question d'"exploration spatiale pacifique". Bien sûr, la formule de Dolman "celui qui domine la Terre détermine le sort de toute l'humanité" est correcte et fonctionne dans la réalité d'aujourd'hui. Et tandis que certains jouent leurs vieux jeux géopolitiques, d'autres sont plus tournés vers l'avenir et développent des programmes spatiaux. Qui va donc "déterminer le destin de l'humanité"?

Réglementation juridique de l'espace
Le droit international de l'espace a commencé à se développer presque immédiatement après 1957, lorsque l'Union soviétique a réussi à lancer pour la première fois un satellite terrestre artificiel. Dès 1958, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution intitulée "La question de l'utilisation de l'espace à des fins pacifiques". Le message principal était l'exploration "pacifique" de l'espace, car à l'époque, la confrontation entre l'URSS et les États-Unis était féroce. L'année suivante, le Comité des Nations Unies sur les utilisations pacifiques de l'espace extra-atmosphérique a été créé, le premier organe international à coordonner les activités spatiales.
Les résolutions ultérieures de l'Assemblée générale des Nations Unies ont consacré l'extension du droit international à l'espace extra-atmosphérique, le principe de non-appropriation par un État de l'espace extra-atmosphérique et des corps célestes, et le principe de libre accès pour l'exploration et l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique et des corps célestes par les États.
Aujourd'hui, il existe cinq sources principales de droit spatial international :
1) le Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d'exploration et d'utilisation de l'espace extra-atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes (1967) ;
2) l'Accord sur le sauvetage des astronautes, le retour des astronautes et la restitution des objets lancés dans l'espace (1968) ;
3) la Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux (1972) ;
4) la Convention sur l'immatriculation des objets lancés dans l'espace (1975) ;
5) l'Accord sur les activités des États sur la Lune et les autres corps célestes (1979).
Parallèlement, la réglementation juridique des relations spatiales internationales s'est également développée. En 1963 est apparu le Traité sur l'interdiction des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace et sous l'eau, et en 1977 la Convention sur l'interdiction de l'utilisation militaire ou de toute utilisation hostile de moyens d'impact sur l'environnement naturel. Plus tard, il y a eu d'autres documents, dans lesquels l'accent était à nouveau mis sur l'exploration pacifique de l'espace.
Toutefois, il convient de noter que le droit international de l'espace présente certaines lacunes. Le problème réside notamment dans le fait que le modèle actuel de cette branche du droit international a été formé à une époque où l'utilisation de l'espace à des fins privées n'était pas envisagée. Par conséquent, les sujets du droit international sont exclusivement les États et les organisations internationales, c'est-à-dire qu'eux seuls ont le droit de conclure des traités spatiaux internationaux. Entre-temps, la liste des entreprises privées dans le secteur spatial, comme indiqué ci-dessus, ne cesse de s'allonger. Alors qui est responsable de leur travail dans l'espace ?
La réponse à cette question est assez simple: la responsabilité du travail des entreprises privées incombe à l'État sur le territoire duquel opère telle ou telle entreprise privée. En d'autres termes, leur travail est régi par la législation nationale de l'État, qui, à son tour, est soumise au droit spatial international.
Compte tenu de ce qui précède, il devient évident que la communauté internationale s'efforce de réglementer les principaux aspects de l'activité humaine dans l'espace, et cette réglementation juridique est basée uniquement sur les idées d'exploration spatiale pacifique. Il est également important que cet espace, selon le droit international de l'espace, ne fasse l'objet d'aucune appropriation nationale, que ce soit par déclaration de souveraineté, occupation ou par tout autre moyen. Néanmoins, la course à l'espace se poursuit et le terme "astropolitique", qui est, à la base, le concept de contrôle de l'espace, n'est pas apparu par hasard.
Le fait est que dans tout traité international, on peut toujours trouver la soi-disant "faille" qui permettrait de contourner tout accord. Par exemple, il n'existe aujourd'hui aucune réglementation juridique détaillée de l'exploitation minière en dehors de la Terre, ni des activités des colonisateurs sur d'autres planètes. En outre, l'espace, comme mentionné ci-dessus, n'appartient à personne en termes de droit spatial international, mais les États conservent la propriété des objets spatiaux lancés, ce qui soulève également certaines questions controversées.
Par conséquent, le droit international de l'espace ne fait pas exception à la règle et présente un grand nombre de "failles". Il est imparfait et nécessite une amélioration constante et de nouveaux accords. Sinon, dans un avenir lointain ou pas si lointain, une véritable "guerre des étoiles" pourrait éclater dans l'espace.
Pendant ce temps, la course à l'espace fait partie d'une guerre "froide" (au sens propre comme au sens figuré) entre de grandes puissances qui se battent pour le leadership mondial.
Empires spatiaux potentiels
Depuis 1957, de nombreux pays ont rejoint la course à l'espace, notamment le Japon, l'Inde, les pays de l'UE, l'Iran et les Émirats arabes unis. Cependant, seuls trois pays se battent réellement pour la domination de l'espace aujourd'hui : les États-Unis, la Russie et la Chine. Il est difficile de dire lequel du "trio spatial" est en tête dans cette course: tout dépend des critères de comparaison de leur puissance spatiale. La Russie a un palmarès riche et exceptionnel en matière de vols spatiaux habités, et le programme spatial chinois se développe actuellement plus rapidement et de manière plus dynamique que quiconque, car la République populaire de Chine a une capacité unique d'emprunter et de reproduire rapidement les technologies spatiales occidentales. Dans le même temps, les États-Unis occupent la première place pour l'exploration totale avec des engins spatiaux et l'espace profond.

Quant à la Russie, son industrie spatiale et des fusées est à la traîne de la Chine et des États-Unis à bien des égards, car elle ne dispose pas de fonds suffisants pour ce secteur depuis de nombreuses années. De plus, la situation ne s'améliore pas: le financement de Roskosmos a été réduit de 277 milliards de roubles en 2022, comme l'a déclaré le directeur général adjoint de l'entreprise publique Maxim Ovchinnikov dans une interview accordée au journal Vedomosti en février de cette année.

En outre, tous les nouveaux développements russes dans l'industrie spatiale sont basés sur les développements de l'Union soviétique. Par exemple, les projets de fusées tels que Soyuz-5 et Soyuz-6 sont en fait obsolètes, car ils sont basés sur la fusée soviétique de classe moyenne Zenit. Et s'il n'y a aucun doute sur la qualité des développements soviétiques, il convient de considérer le fait qu'ils ont été réalisés au siècle dernier et que les technologies des fusées spatiales du monde entier ont largement dépassé les développements soviétiques. Un autre problème de l'industrie spatiale dans la Fédération de Russie est sa structure monopolistique et le manque d'initiative entrepreneuriale.
En plus de tout ce qui précède, les sanctions imposées par l'Occident ont eu un impact négatif sur le programme spatial russe: à cause d'elles, de nombreux lancements ont été annulés, des livraisons ont été interrompues et des programmes de recherche ont été arrêtés. Par exemple, la microélectronique moderne nécessaire aux satellites n'est pas produite en Russie et il n'existe désormais aucun endroit où la trouver légalement.
Alors que les moteurs de fusée RD-180 et RD-181 hérités de l'URSS (photo), dont Roskosmos est si fier et qui ont été achetés par les Américains de 1996 jusqu'à récemment, ont été modernisés et améliorés, des concurrents sérieux proposant des lancements spatiaux moins chers sont apparus aux États-Unis. Par conséquent, les Américains sont devenus moins dépendants de la fourniture de moteurs russes.

Par conséquent, la cosmonautique russe actuelle est complètement différente de l'époque de Yuri Gagarin. Néanmoins, la Russie reste un acteur important dans la course à l'espace, malgré les nombreux échecs de Roskosmos et les critiques fréquentes du chef de la société d'État Dmitry Rogozin par les autorités elles-mêmes. Il est évident que la position actuelle de la Russie dans l'espace exige une action immédiate. Au lieu de préserver la mémoire historique de la Russie en tant que premier pays à explorer l'espace proche de la Terre, il faut aller de l'avant et développer de nouveaux projets, précisément parce qu'il n'y a pas eu de "percée" dans l'industrie spatiale de la Fédération de Russie depuis l'Union soviétique.
La situation avec la Chine et son ambitieux programme spatial est différente. La Chine est désormais le deuxième plus grand État après les États-Unis en termes de dépenses pour le programme spatial, ainsi que le leader en termes de nombre de lancements spatiaux : en 2021, la Chine a effectué un nombre record de 55 lancements de fusées spatiales.
Le fait est qu'en Chine, le développement du programme spatial est considéré comme un intérêt national essentiel et est directement lié aux questions de sécurité nationale. Le pays met également en œuvre un programme d'exploration spatiale pacifique et invite d'autres pays à participer à des projets communs. Par exemple, fin février, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Wang Wenbin, a annoncé que la Chine était prête à collaborer avec des astronautes du monde entier sur la station orbitale chinoise.
Nous sommes prêts à coopérer avec tous les pays. [...] La station orbitale chinoise invite les cosmonautes étrangers à s'engager dans l'exploration spatiale avec les taïkonautes chinois", a-t-il déclaré lors d'un briefing.
Le pays publie tous les deux ans un "Livre blanc" sur les activités spatiales de la Chine, qui résume les réalisations du pays en matière d'exploration spatiale. L'objectif de la Chine est d'atteindre le statut de superpuissance spatiale.

La Chine, contrairement à la Russie, accorde en fait beaucoup d'attention au développement de son programme spatial, combinant activement les lancements civils et militaires. En outre, Pékin construit sa propre station spatiale, crée sa propre version des systèmes mondiaux de positionnement par satellite, et compte un certain nombre d'autres réalisations dans le domaine de l'astronautique. On peut soutenir qu'un développement aussi actif du programme spatial chinois s'inscrit dans le cadre de la concurrence avec les États-Unis sur la scène internationale. Et Washington a de plus en plus peur des capacités de Pékin dans l'espace, notamment sur le plan militaire.
En parlant de la concurrence dans l'espace, nous pouvons dire, nous Russes, que les principaux rivaux sont désormais les États-Unis et la Chine. Les États-Unis abritent la plus grande agence au monde pour le développement et l'exploitation de programmes spatiaux: la NASA. La NASA et le Pentagone disposent d'énormes budgets spatiaux, ce qui est un indicateur important de la place du pays dans la course à l'espace. En outre, en termes de technologie, les États-Unis sont loin devant la Russie et la Chine. Les États-Unis sont également, à ce jour, le seul du "trio spatial" à s'être fixé l'objectif à long terme d'extraire et d'utiliser des ressources en dehors de la Terre. De toute évidence, la raison des énormes investissements américains dans l'industrie spatiale et l'exploration spatiale active est, comme toujours, le leadership mondial. Les États-Unis ont l'intention d'être le "numéro un" en tout temps et en toute chose, comme le confirment tous les documents doctrinaux du pays. Et si sur Terre, c'est loin d'être toujours possible, alors dans l'espace, peut-être, les États-Unis ont eu beaucoup de succès. Toutefois, la situation actuelle pourrait changer à l'avenir, étant donné que la Chine "marche sur les pieds". La Russie a également un bon potentiel pour prétendre au rôle de superpuissance spatiale la plus puissante à l'avenir, mais pour cela, elle doit réaliser un travail à grande échelle pour moderniser son industrie spatiale et reconsidérer ses "priorités spatiales".
La fin de l'espace "pacifique"
La plupart des programmes spatiaux modernes ont, d'une part, des objectifs pacifiques, mais, d'autre part, il devient évident que la rivalité actuelle dans l'espace n'est pas très différente de la rivalité de la seconde moitié du 20e siècle entre l'URSS et les États-Unis, lorsqu'il y avait une course aux armements active entre les pays. Seulement, le champ d'application de ce concours va déjà au-delà de la Terre.
Le fait est que les puissances mondiales ne sont nullement limitées à la mise en orbite de toutes sortes d'armes, à l'exception des armes nucléaires. À cet égard, l'espace extra-atmosphérique devient progressivement non pas un lieu de coopération pacifique, mais une arène de confrontation armée.
Aujourd'hui, l'espace est déjà partiellement utilisé à des fins de guerre, notamment pour brouiller les communications par satellite, intercepter les conversations téléphoniques et les flux de données, aveugler les satellites avec des lasers pour la photographie, etc. En général, si l'utilisation militaire de l'espace consiste à collecter des données de renseignement à l'aide de satellites, en plus de fournir des communications et une navigation aux branches traditionnelles des forces armées. La course à l'espace actuelle est une lutte pour le leadership mondial en fonction des capacités et des ressources de chacun des participants. Mais un véritable conflit armé dans l'espace est-il possible ?

De nombreux analystes doutent du caractère inévitable d'un choc des puissances dans l'espace. Bien que les pays aient des programmes pour créer des armes antisatellites, il est peu judicieux de détruire les satellites des autres. Tout d'abord, une attaque sur le satellite d'un autre pays est une étape désavantageuse pour toutes les parties impliquées, car l'environnement spatial sera rempli de débris qui interfèrent avec le travail, et entraînerait le début de la "chasse" de tous les satellites, y compris les appareils de la partie attaquante. Deuxièmement, abattre des satellites, par exemple des systèmes de navigation GLONASS ou GPS, est une tâche assez coûteuse et techniquement difficile. Par conséquent, cela ne sera pas aussi facile que d'abattre, disons, son propre satellite en orbite basse pour démontrer sa force et sa supériorité technologique. Enfin, de telles actions peuvent entraîner de graves conséquences économiques, qui ne sont jamais limitées à un seul pays. Cela peut se produire si le satellite par lequel transitent les transactions financières et les communications est détruit. Par conséquent, les expériences menées par les puissances, qui détruisent leurs vieux satellites avec des missiles, servent plutôt à démontrer leur puissance militaire dans la lutte pour le leadership spatial.
En outre, en avril 2022, les États-Unis ont annoncé une interdiction unilatérale des essais de missiles antisatellites. La vice-présidente américaine Kamala Harris, s'exprimant sur la base spatiale de Vandenberg en Californie, a ordonné "aucun essai destructif de missiles antisatellites à lancement direct". Selon elle, le refus volontaire des États-Unis est une tentative de donner un élan à la communauté internationale pour développer de "nouvelles normes de comportement responsable". Cette décision n'a pas été accueillie favorablement par tous les Américains: les Républicains ont déclaré qu'elle introduisait une asymétrie dans les relations entre les États-Unis d'une part et la Russie et la Chine d'autre part, et aussi que les États-Unis "se lient les mains" avec cette initiative.

Cette décision a été réfléchie et visait probablement à discréditer la Russie et la Chine sur la scène internationale. Le fait est que la Chine et la Russie ont respectivement testé leurs armes antisatellites en 2007 et 2021, ce qui a entraîné la formation d'une grande quantité de débris spatiaux. Évidemment, dans ce cas, les États ont décidé d'utiliser cet incident comme une sorte de "levier" sur leurs rivaux de l'espace en abandonnant ces tests. Cela fait partie de l'astropolitique américaine : démontrer que Washington vise l'exploration pacifique de l'espace et que les autres puissances avec leurs programmes spatiaux constituent une menace militaire directe pour la communauté mondiale.
Cependant, pour démontrer les intentions pacifiques des États-Unis dans l'espace, tout n'est pas aussi simple. Rappelons, par exemple, le décret de Donald Trump sur la création de la force spatiale américaine, signé en 2019. L'ancien président a présenté la création d'un nouveau type de troupes comme le plus grand programme militaire depuis Ronald Reagan. La mission de la Space Force est de protéger les satellites américains et les intérêts américains dans l'espace. Par la suite, Trump a également signé un ordre exécutif pour la création du Commandement spatial américain afin de tendre la main à la Chine et à la Russie dans ce domaine.

"Lorsqu'il s'agit de protéger l'Amérique, il ne suffit pas d'avoir une présence américaine dans l'espace. Nous devons assurer la domination américaine dans l'espace", a déclaré l'ancien président, rappelant que la Russie et la Chine sont depuis longtemps engagées dans la création de telles troupes.
Par conséquent, l'espace extra-atmosphérique est un territoire au potentiel militaire, mais pour l'instant, un véritable conflit armé dans l'espace n'est pas inévitable. Le fait est qu'il n'est rentable pour personne de se battre dans l'espace : les opérations militaires qui y sont menées peuvent entraîner la perte de la possibilité d'utiliser l'orbite terrestre pour la recherche scientifique. La rivalité spatiale fait partie de la guerre froide entre les puissances. C'est pourquoi la militarisation de l'espace et le développement de technologies militaires utilisées dans l'espace est plutôt l'une des orientations de la lutte des puissances pour le leadership mondial.
Notes :
[1] La géostratégie à l'ère spatiale de Dolman E. C.. Géopolitique, géographie et stratégie. Ed. C. S. Gray et G. Sloan. Portland. Oregon, 2003, p. 83.
[2] Dolman E. C. Astropolitique : la géopolitique classique à l'ère spatiale. Londres, 2002, p. 15.
Source : katehon.com
18:00 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, espace, cosmos, relations internationales, astropolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 19 mai 2022
George F. Kennan ou Leo Strauss?
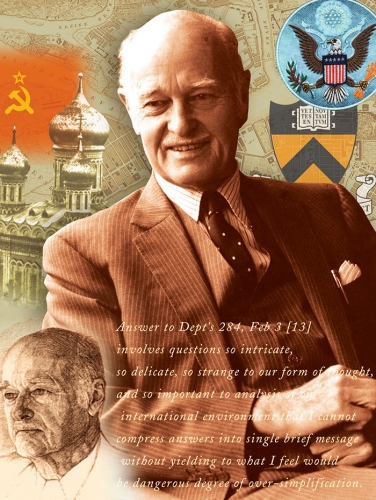
Matteo Luca Andriola:
George F. Kennan ou Leo Strauss?
Source: https://novaresistencia.org/2022/05/16/george-f-kennan-ou-leo-strauss/
Des années 1950 à 1997, les États-Unis ont pratiqué une politique d'endiguement à l'encontre de l'URSS et de son successeur, la Russie. La stratégie consistait à limiter l'influence de l'adversaire sans l'affronter directement. C'était la prescription de George F. Kennan. À partir des années 1990, cependant, l'influence néo-conservatrice au sein du département d'État américain a commencé à croître, lorsque des disciples de Leo Strauss ont accédé à des postes importants, favorisant l'expansion de l'OTAN et un encerclement de plus en plus serré contre la Russie.
"...l'expansion de l'OTAN serait l'erreur la plus fatale de la politique américaine de toute la période de l'après-guerre froide. On peut s'attendre à ce qu'une telle décision enflamme les tendances nationalistes, anti-occidentales et militaristes de l'opinion publique russe ; à ce qu'elle ait un effet négatif sur le développement de la démocratie russe ; à ce qu'elle ramène l'atmosphère de guerre froide dans les relations Est-Ouest ; et à ce qu'elle pousse la politique étrangère russe dans des directions résolument contraires à notre sensibilité..."
[Extrait de George F. Kennan, "A Fateful Error", New York Times, 5 février 1997].
La personne qui dit ces choses est George F. Kennan (1904-2005), connu comme "le père de la politique d'endiguement", une figure clé de la période émergente de la guerre froide, dont les écrits ont inspiré la doctrine Truman et la politique étrangère américaine visant à "contenir" l'Union soviétique. En effet, en 1947, c'est lui qui a dit :
"...l'élément principal de la politique américaine à l'égard de l'Union soviétique doit être un long, patient, mais ferme et vigilant endiguement des tendances expansionnistes russes... La pression soviétique contre les institutions libres du monde occidental est quelque chose qui peut être contenu par l'application habile et vigilante de contre-mesures qui répondent aux manœuvres politiques des Soviétiques." [George F. Kennan, "The Sources of Soviet Conduct", Foreign Affairs, XXV, juillet 1947, pp. 575, 576].
Qu'est-ce qui a changé depuis 1997 ? Pourquoi les propos d'un spécialiste aussi respecté de la géopolitique et de la géostratégie militaire américaines, au même titre que Zbigniew Brzezinski et Henry Kissinger, ont-ils été ignorés ? Car entre-temps, un lobby, celui des "straussiens", a prévalu dans l'establishment américain. Qui sont-ils ?
Le philosophe allemand d'origine juive, Leo Strauss, qui s'est réfugié aux États-Unis à l'arrivée des nazis au pouvoir, est devenu professeur de philosophie à l'université de Chicago et, à partir de réflexions platoniciennes et d'une conception hobbesienne du droit naturel, a donné naissance à une école de pensée qui est encore aujourd'hui hégémonique dans la politique américaine, chez les républicains et les démocrates, qui est l'école néo-con. Un grand groupe de disciples se forme autour de Strauss, d'abord tous de gauche.

Le groupe politique, une sorte de lobby, a été fondé en 1972, un an avant la mort du philosophe. Ils faisaient tous partie de l'équipe du sénateur démocrate Henry "Scoop" Jackson, en particulier Elliott Abrams, Richard Perle et Paul Wolfowitz. Ils étaient tous liés à un groupe de journalistes trotskystes, également juifs, qui se sont rencontrés au City College de New York et ont publié le magazine Commentary. On les appelait "les intellectuels de New York". Tant les straussiens que les intellectuels new-yorkais étaient étroitement liés à la CIA, mais aussi, grâce au beau-père de Perle, Albert Wohlstetter (un stratège militaire américain), à la Rand Corporation, le think tank du complexe militaro-industriel (celui dénoncé par Manlio Dinucci avant d'être censuré par Il Manifesto). Beaucoup de ces jeunes gens se sont mariés, jusqu'à former un groupe compact d'une centaine de personnes, toutes issues de la classe moyenne supérieure libérale juive américaine.
En plein scandale du Watergate (1974), le clan rédige et adopte l'"amendement Jackson-Vanik", qui oblige l'Union soviétique à autoriser l'émigration de la population juive vers Israël sous la menace de sanctions économiques. C'était son acte fondateur. En 1976, Wolfowitz est l'un des architectes de l'équipe B, chargée par le président Gerald Ford d'évaluer la menace soviétique. Le résultat serait d'accuser l'URSS de vouloir acquérir une "hégémonie mondiale", ce qui conduirait l'establishment américain à mettre en veilleuse la politique élaborée par George F. Kennan sur l'endiguement, mais à affronter Moscou, à l'épuiser et à sauver le "monde libre", comme ils l'ont fait, en l'occurrence, avec la guerre en Afghanistan.
Les "Straussiens" et les intellectuels new-yorkais, tous de gauche, se sont mis au service des présidents de droite Ronald Reagan et Bush père, pour être momentanément évincés du pouvoir pendant le mandat de Bill Clinton, et ont ainsi commencé à envahir les think tanks de Washington, pour consolider progressivement une hégémonie visant à donner aux États-Unis une vision belliciste des relations internationales.

En effet, c'est en 1992 que William Kristol et Robert Kagan (photo) (le mari de Victoria Nuland) publient un article dans Foreign Affairs dans lequel ils déplorent la politique étrangère timide du président Clinton et appellent à un renouveau de "l'hégémonie désintéressée des Etats-Unis" ; c'est en 1993 que l'American Enterprise Institute, dirigé par les "straussiens" Schmitt, Shulsky et Wolfowitz, avec lesquels Francis Fukuyama sera lié, publie le Project for a New American Century. Ce sera le "straussien" Richard Perle qui servira de conseiller en 1994 au leader islamiste Alija Izetbebovič en Bosnie-Herzégovine pour faciliter l'entrée de militants djihadistes d'Afghanistan liés au réseau Al-Qaeda pour combattre la République fédérale de Yougoslavie du leader du Parti socialiste de Serbie Slobodan Milošević. En 1996, les exposants "straussiens" du Projet pour un nouveau siècle américain, tels que Richard Perle, Douglas Feith et David Wurmser, ont rédigé une étude au sein de l'Institute for Advanced Strategic and Policy Studies pour le compte du nouveau Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu du Likoud, qui recommandait l'élimination du leader palestinien Yasser Arafat, l'annexion des territoires palestiniens et une guerre contre l'Irak pour déplacer ensuite les Palestiniens.
Le groupe s'est également appuyé sur les réflexions de Ze'ev Jabotinsky, fondateur du "sionisme révisionniste", une variante nationaliste du sionisme, dont le père de Netanyahu était le secrétaire spécial et qui a été formé en Italie par l'armée mussolinienne, évidemment dans un but anti-britannique. Le même groupe a dépensé de l'argent pour la candidature de George W. Bush, publiant un célèbre rapport, Rebuilding America's Defences, qui appelait à une catastrophe de type Pearl Harbor, devant servir de prétexte pour pousser les États-Unis dans une guerre pour l'hégémonie mondiale: exactement les termes utilisés le 11 septembre 2001 par le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, lui-même un "straussien" et membre du Project for a New American Century.
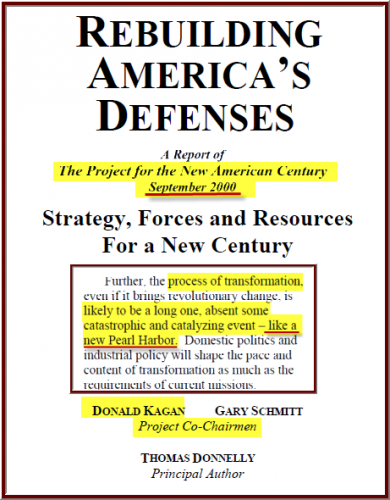
Comme nous le disions, le lobby "straussien" ne cherche que le pouvoir, et s'est tourné vers les démocrates pour favoriser d'abord Barack Obama - avec Hillary Clinton comme principal représentant des faucons - et aujourd'hui Joe Biden. On comprend pourquoi les propos de George F. Kennan, durs dans les années 1940 mais modérés et sensés dans les années 1990, étaient dictés par la Realpolitik: il était logique, dans une perspective atlantiste et libérale, de s'opposer à l'Union soviétique et de la contenir, l'un des objectifs de la géopolitique américaine depuis l'époque de Nicholas J. Spykman, mais quel était l'intérêt d'étendre l'OTAN vers l'est et de provoquer les Russes, au risque d'enflammer leur chauvinisme ? N'ont-ils pas été battus en 1989/1991 ?
Eh bien, on peut constater que le lobby néocon "straussien", qui a aujourd'hui l'hégémonie de l'establishment américain - et je dirais européen - est d'un avis différent. Ce qui prévaut aujourd'hui au sein de l'establishment, ce n'est pas la Realpolitik et le réalisme à la George J. Kennan, mais le projet unipolaire américain, esquissé dans les années 1970, hégémonique dans les années 1990, mais qui est entré en crise avec l'avènement de nouvelles puissances émergentes, de la Russie de Vladimir Poutine à la Chine populaire de Xi Jinping, et qui voudrait s'affirmer à tout prix, même avec une troisième guerre mondiale.
18:25 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : straussiens, néocons, néoconservateurs, leo strauss, georges f kennan, états-unis, bellicisme, bellicisme américaine, politique internationales, relations internationales |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 mai 2022
Heartland et Rimland dans la géopolitique de la Chine, de la Russie et des États-Unis: un retour à la lutte pour le Rimland au 21e siècle?
Heartland et Rimland dans la géopolitique de la Chine, de la Russie et des États-Unis: un retour à la lutte pour le Rimland au 21e siècle?
Par Pedro Sánchez Herráez
Source: https://kontrainfo.com/heartland-y-rimland-en-la-geopolitica-de-china-rusia-y-eeuu-retorno-a-la-lucha-por-el-rimland-en-el-siglo-xxi-por-pedro-sanchez-herraez/
Dans un contexte de reconfiguration géopolitique de la planète, et à une époque où, en raison tant de l'essor des "nouvelles technologies" que de la pandémie de COVID-19, il semble que tout soit nouveau, que tout soit différent (1), que tout reparte de zéro ou, du moins, que nous nous trouvions à un tournant de l'histoire sans parangon, avec peu ou pas de références, et dans lequel tout ce qui précède n'est pas valable et ne sert même pas de point de départ à la réflexion. Après la fin du système bipolaire de la guerre froide, le pouvoir croissant des acteurs non étatiques et l'augmentation de leur capacité d'action contre les États - il suffit de rappeler le 11 septembre et le début de la "guerre contre le terrorisme" qui annonçait une nouvelle ère et la fin des "disputes classiques" - ont semblé mettre un bémol aux théories géopolitiques classiques et ont donné des ailes aux idées de la fin de la rivalité entre les puissances, une réalité qui, pendant des siècles, avait été le moteur et la cause des disputes, des guerres, des accords, des alliances, des trahisons..... C'est pourquoi, apparemment, la recherche de l'hégémonie par une nation et les efforts des autres pour l'éviter, ou au moins pour atteindre un point d'équilibre des forces, un équilibre toujours instable, mais pour le maintien duquel les efforts de toutes sortes et dans tout le spectre de la stratégie (diplomatique, politique, informative, de renseignement, militaire, économique, etc.) des autres nations étaient dirigés, semblaient être une sorte de défi. ) des autres nations, semblait appartenir au passé. Une nouvelle ère s'ouvrait.
Et si en plus, comme à d'autres périodes de l'histoire, les "talibans" d'une tendance ou d'une autre(2), ou des prophètes plus ou moins bien informés ou intéressés théorisent sur la perte de valeur de tout ce qui a précédé sur la base de la nouveauté - qu'elle soit réelle ou non - des nouveaux environnements contestés - de l'espace extra-atmosphérique au domaine cognitif - et que de "nouveaux" termes sont inventés - tels que "influence"(3), "zone grise"(4), "guerre hybride"(5)..., parmi beaucoup d'autres - il se pourrait qu'une interprétation radicale des "nouveautés" conduise au sentiment qu'il n'existe en effet aucun parallèle antérieur pour le moment de contestation globale dans lequel la planète se trouve plongée. Ainsi, la résurgence progressive de la Russie depuis 2000 - sous la direction de Poutine -, le décollage de la Chine et son positionnement comme deuxième économie mondiale en 2011, et son rapprochement dans tous les domaines avec ce qui reste la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, ainsi que le néo-ottomanisme croissant de la Turquie et son désir d'expansion, peuvent en être la raison, ou du moins d'influence sur la plupart des territoires de l'ancien Empire ottoman, face, dans une certaine ou grande mesure, à une réduction relative des capacités et peut-être de la volonté d'autres nations ou groupes de nations (comme l'Union européenne) d'occuper une place adéquate dans cette dispute pour "une place au soleil", tout cela peut créer un environnement sans équivalent dans le passé. Et peut-être que c'est le cas, et que rien du passé ne peut servir de point de référence. Ou bien le peut-il ?
Questions du passé : le Rimland ?
Au-delà de l'éternelle querelle entre thalassocraties et tellurocraties (puissances fondées respectivement sur la puissance maritime et la puissance terrestre), ce qui est certain, c'est que l'accès à la mer confère un avantage compétitif à une nation par rapport à celle qui ne possède pas cette possibilité ; pour cette raison, la recherche d'un débouché sur l'océan a été un facteur polémique classique, déclenchant des conflits tout au long de l'histoire de l'humanité. Et si, en plus, ce débouché sur la mer est souhaité à partir d'un espace qui occupe près d'un sixième des terres émergées de la planète, la situation acquiert évidemment une signification et un niveau mondiaux.
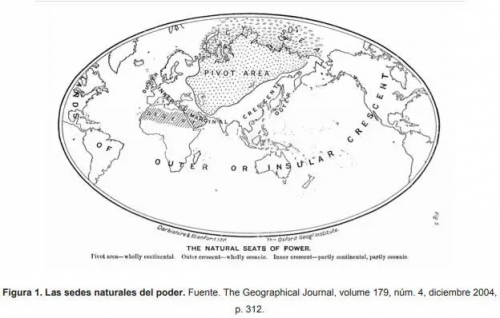
Cette grande masse terrestre du continent eurasien correspond essentiellement à l'espace que la Russie a occupé au cours des siècles dans plusieurs des différentes organisations politiques qui se sont succédé depuis le 18e siècle : l'Empire russe, l'Union soviétique (une partie de celle-ci) et la Fédération de Russie. Et ce n'est pas seulement "la taille qui compte", pas seulement l'espace qui est un facteur de puissance, mais sa position relative sur le continent et sur la planète qui est venue motiver sa définition comme "heartland". Le Britannique Halford J. Mackinder (1861-1947) a écrit en 1904 l'ouvrage The geographic pivot of history(6) dans lequel - sous une forme simplifiée et comme on peut le voir sur l'image ci-jointe - il a identifié le "monde insulaire" (Europe, Asie et Afrique) comme l'essence de la puissance mondiale, et au sein de cette vaste étendue de terre, il a défini un "heartland" - également connu sous le nom de pivot mondial - (coïncidant essentiellement avec l'Empire russe alors existant) ; et a divisé la planète en une "zone pivot", essentiellement ce cœur planétaire, entouré d'un arc (proximal ou marginal) de terre et d'eau autour de lui, laissant le reste des espaces dans un "anneau extérieur" défini.
La fin de la Première Guerre mondiale (1914-1918), outre la disparition de quatre empires, a vu un réarrangement des frontières en Europe et dans une grande partie du Moyen-Orient sans précédent dans le passé.
Cela a conduit Mackinder à indiquer non seulement que la guerre avait réaffirmé son point de vue, mais à l'étendre dans un nouvel ouvrage(8), en réitérant que la puissance qui occupait et dominait le cœur du pays dominerait le monde insulaire, et que celui qui dominait le monde insulaire dominerait la planète. Et il a ajouté un nouvel élément à cette lutte mondiale en soulignant que celui qui dominerait l'Europe de l'Est dominerait le centre du pays, celui qui dominerait le centre du pays dominerait le continent insulaire, et celui qui dominerait le continent insulaire dominerait le monde(9). (9) Évidemment, les critiques et les visions différentes et différentielles n'ont pas manqué (en fait, en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale (1939-1945), Mackinder a répondu aux propositions de mise à jour de sa théorie par un nouvel essai, The Round World and the Winning of the Peace(10), la réaffirmant ; mais, malgré les différences, le schéma général, avec des nuances, a apparemment continué à avoir des visions et des adeptes similaires.
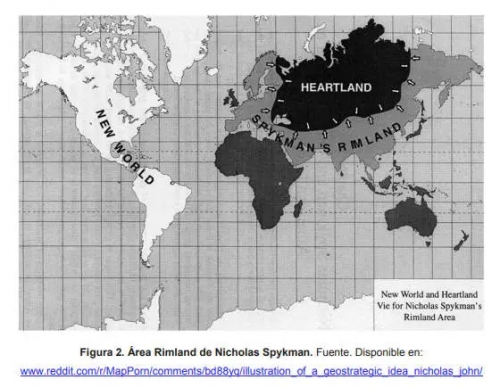
Également au milieu de la conflagration, alors que la Seconde Guerre mondiale faisait rage, Nicholas Spykman (1893-1943) a développé une théorie, largement complémentaire à celle de Mackinder, et qui a été exposée principalement dans son œuvre posthume, The Geography of Peace. Il y reprend également ce concept de heartland, dont il ne nie pas l'importance mais la nuance qu'il a introduite est la signification renouvelée de cet "anneau marginal", cet anneau de circonvallation - qu'il a appelé "Rimland", comme on peut le voir dans l'image ci-jointe - entourant la masse terrestre qui était posée comme l'essence même de la puissance mondiale dans la vision mackinderienne, soit une zone dont le contrôle maintiendrait cette puissance considérée comme mondiale isolée et incapable d'étendre son pouvoir sur sa périphérie. Par conséquent, il ne s'agissait pas de contrôler le Heartland, il suffirait de l'encercler. Spkyman a donc souligné que les efforts géopolitiques devraient être dirigés vers le contrôle du Rimland, car, a-t-il fait remarquer(11), celui qui le contrôle contrôle l'Eurasie, et celui qui contrôle l'Eurasie contrôle le destin du monde. Avec la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début de ce que l'on appellera la Guerre froide, les tensions permanentes entre les deux grandes superpuissances, les États-Unis et l'Union des républiques socialistes soviétiques (URSS), dans un monde divisé en blocs, une grande partie des litiges se déroulent dans le Rimland, dans cette zone qui permet le confinement ou l'expansion mondiale du heartland, selon qui la domine.
Et de la théorie de Spykman découle ce qui sera connu sous le nom de "politique d'endiguement"(12), qui visait à empêcher l'expansion de l'URSS et qui a été menée dans toute la zone entourant l'URSS - en plus d'autres parties de la planète - en utilisant la diplomatie, l'espionnage, les relations commerciales, la subversion et même l'intervention militaire directe. La nécessité perçue de renforcer ce Rimland est ce qui donnera naissance au plan Marshall(13) (1947), destiné à reconstruire une partie de l'Europe dévastée après la Seconde Guerre mondiale afin d'éviter qu'elle ne devienne une proie facile pour l'adversaire soviétique, et motivera également la "doctrine Truman"(14), (14), énoncé par le président américain Harry Truman en 1947, dans lequel les États-Unis déclaraient qu'ils aideraient tout pays pour l'empêcher de tomber aux mains de Moscou - ou des pays communistes dans leur ensemble, suite à la proclamation de la République populaire de Chine par Mao Tse Tung en 1949. La Chine, un grand pays physiquement situé dans le Rimland contesté, est devenue un nouveau rival, ce qui a conduit les États-Unis à adopter la "théorie des dominos", selon laquelle il fallait empêcher un pays de tomber aux mains des communistes pour que les autres, comme les pièces du jeu de société susmentionné, ne tombent pas les uns après les autres. De la guerre de Corée (1950) à la guerre en Afghanistan (1979) et à la longue guerre du Vietnam, le Rimland est riche en conflits et a été le terrain d'utilisation de toutes sortes d'outils géopolitiques pour prendre le contrôle de cette grande bande de terre et de ces littoraux.
Après la chute du mur de Berlin en 1989 - et le départ de l'orbite soviétique de tous les pays "satellites" d'Europe de l'Est, un espace clé du Rimland - et la disparition de l'URSS en 1991, il semble que le vingtième siècle ait largement répondu au postulat géopolitique du heartland et de son expansion ou de son endiguement par le biais de différends dans le Rimland. Mais, coïncidence - ou non - ce postulat trouve ses racines, du moins les plus récentes, dans le siècle précédent, le 19e siècle.
L'expression "Grand Jeu", popularisée par Rudyard Kipling après son inclusion dans l'une de ses œuvres les plus connues (15), faisait référence à la lutte entre la Grande-Bretagne, la grande puissance maritime du 19e siècle, et l'Empire russe pour empêcher l'accès de ce dernier à la mer, notamment en Asie centrale, bien que l'expression, au fil du temps et par extension, a fini par s'appliquer à des actions menées sur toute la longueur de l'immense frontière russe, utilisant tout expédient imaginable, de la création d'États tampons (comme dans le cas paradigmatique de l'Afghanistan) au soutien de forces et de mouvements anti-russes locaux, en passant par l'utilisation de puissances rivales (comme dans le cas de l'Empire ottoman) avec la maxime "l'ennemi de mon ennemi est mon ami"... instrumentalisant dans ce "jeu" toutes les mesures (16) à la portée des Britanniques - et évidemment, recherchant l'effet inverse du côté russe (17) - afin d'éviter le contrôle des espaces donnant accès à ce "cœur" depuis l'océan, de manière à permettre à Moscou d'avoir une porte ouverte sur l'océan et sur le monde par laquelle elle pourrait projeter son énorme puissance et son potentiel. Dix-neuvième siècle, vingtième siècle... il semble que les mêmes questions - avec d'autres acteurs - soient abordées avec le même entêtement et la même ténacité... En sera-t-il de même au vingt-et-unième siècle ?
Une question d'actualité: alliance pour le Rimland ?
Au-delà des disquisitions et des arguments, pour et contre, quant à savoir si la planète connaît une nouvelle "guerre froide", ce qui est certain, c'est que le monde est en pleine reconfiguration géopolitique ; et que le monde est en pleine reconfiguration géopolitique ; et que le monde est en pleine nouvelle "guerre froide". Bien que la première puissance mondiale, les États-Unis d'Amérique, ait pivoté ses efforts vers l'Asie-Pacifique depuis 2011, face à la puissance et l'influence croissantes de la Chine, elle a aussi simultanément procédé à un relatif abandon géopolitique de nombreuses régions de la planète - de l'Afrique à l'affaiblissement du lien transatlantique - ce qui a généré un vide qu'exploitent ses concurrents et rivaux.
Mais l'ampleur du défi (le contrôle du Rimland) est énorme, il n'est donc pas possible pour une seule puissance de l'entreprendre; c'est une tâche complexe même pour une superpuissance.
La Russie est une puissance régionale, mais ce n'est pas l'ancienne Union soviétique, même si elle travaille activement à retrouver son statut de potentiel mondial ; la Turquie est un acteur régional puissant, qui tente d'étendre ses capacités et son influence.
La Turquie est un acteur régional puissant, qui cherche à étendre ses capacités et son influence dans cet espace carrefour entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique ; et la Chine, deuxième puissance économique mondiale mais qui présente encore des lacunes dans d'autres domaines (qu'elle comble à toute vitesse) et avec l'aspiration d'être la première puissance mondiale et le désir d'être une superpuissance à part entière, peut-être la superpuissance du 21e siècle.
En termes d'histoire et de potentiel, la Russie a été le champion de la lutte pour le Rimland. Mais confrontée à l'impossibilité de le faire seule, à la réalité de la montée en puissance de ses anciens rivaux - les relations de la Russie avec la Turquie et la Chine sont depuis des siècles loin d'être amicales (17) - et à la nécessité d'assurer un débouché à sa principale source de richesse, la vente d'hydrocarbures - à la fois parce que ces pays sont consommateurs, notamment la Chine, et parce qu'ils sont les points de transit des oléoducs et gazoducs, notamment la Turquie, outre le fait qu'un puissant réseau de ces "artères de la planète" traverse le Rimland contesté, par lequel des flux d'hydrocarbures pourraient s'effectuer hors du contrôle russe, ce qui n'est pas du goût de Moscou - il se pourrait qu'en fin de compte, bien qu'étant des "rivaux stratégiques", une "alliance tactique" ait été forgée qui permet, au moins, à l'"Occident" de refuser le Rimland. Ou du moins pour le moment, pendant que les postes de la région sont occupés.
Russie : l'ours sort à nouveau de la taïga
Pour la Fédération de Russie, pour la Russie, la sécurité de ses frontières, comprise dans un sens très large, a été une obsession tout au long de l'histoire. Par conséquent, sa position par rapport à son ancienne zone d'influence est toujours constante, et il est d'une importance vitale pour les intérêts de la Russie de consolider un périmètre de sécurité qui ne s'arrête pas à ses propres frontières(18). Et, associée à ce fait, s'ajoute la perception constante par la Russie de l'intention récurrente de ses rivaux de tenter de l'encercler et de l'isoler, de la séparer de la mer et de la repousser à l'intérieur de la steppe(19), loin du Rimland, quel que soit le modèle utilisé, qu'il s'agisse du "Grand Jeu" ou de la "politique d'endiguement". Et, au cours de ce siècle, comme le souligne Poutine lui-même, "Une fois que nous avons réussi à stabiliser la situation, une fois que nous nous sommes redressés [dans les années 2000], la politique d'endiguement a été immédiatement mise en œuvre. D'abord, pas à pas, puis de plus en plus. Et plus nous devenions forts, plus la politique d'endiguement devenait forte"(20). (20) Et à cette fin, toujours du point de vue russe, ses rivaux utilisent toutes sortes d'outils géopolitiques, ce qui, parmi de nombreuses autres conséquences, a conduit aux soi-disant révolutions de couleur(21), des révoltes qui, du point de vue de Moscou, ne sont rien d'autre que des subversions sous les auspices des États-Unis, ne sont rien d'autre que des subversions parrainées par d'autres nations, rien d'autre que l'utilisation de l'extrémisme comme outil géopolitique et la redistribution des sphères d'influence(22), rien d'autre qu'une nouvelle tentative pour essayer de séparer la Russie du soi-disant "espace post-soviétique".
Le but de la Russie est de regagner ou du moins de maintenir un haut degré d'influence dans cet espace, soit dans les anciennes républiques qui, avec la Russie, formaient l'URSS (23) - la Russie est jaune sur la carte et le reste des républiques soviétiques dans des couleurs autres que le gris; cette tension est aggravée par la vision panrusse du soi-disant "monde russe" (24), qui inclut non seulement les zones où il y a des minorités ou des groupes de "Russes", mais même les zones qui sont sympathiques à la Russie.

Comme l'a souligné le président russe de l'époque peu après la guerre avec la Géorgie en 2008, en ce qui concerne les lignes de la politique étrangère russe, Moscou a des régions d'intérêt privilégié, outre bien sûr les régions frontalières, mais pas seulement celles-ci(25). Et les accusations selon lesquelles l'Union européenne (UE) et l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) tentent de pénétrer son glacis sécuritaire(26) ont pris de l'ampleur dans les déclarations de Moscou depuis le milieu de la dernière décennie. Et si la Russie continue de chercher activement à maintenir sa sphère d'influence, cette partie de l'Eurasie qu'elle considère comme essentielle à ses intérêts et à sa sécurité, il n'en est pas moins vrai que la présence croissante de la Chine et de la Turquie met à l'épreuve les capacités de la Russie en Eurasie, Car si les relations sont complexes, il existe des points d'accord avec Pékin - et moins avec Ankara - car en plus de partager la vision d'un monde multipolaire (c'est-à-dire "non dominé par l'Occident"), Moscou ne les considère pas comme une menace pour son ordre interne(27). (27) La nécessité a conduit Moscou, du moins pour l'instant, à se tourner vers ses anciens rivaux pour obtenir un soutien.
Et quels sont les intérêts de ces alliés/rivaux ?
Turquie : le loup hurle à nouveau
La Turquie, en pleine tentative de récupération de la géopolitique néo-ottomane, continue d'employer différents outils pour étendre son influence et sa présence dans cette partie clé du monde.
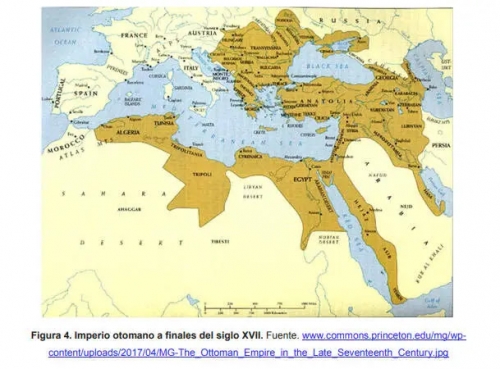
Sa propre position en tant que point de passage terrestre entre le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique - comme le montre l'image ci-jointe reflétant l'ancien Empire ottoman - ainsi que la présence de populations partageant les mêmes idées au Moyen-Orient et en Afrique - ainsi qu'au Moyen-Orient et en Afrique - comme le montre l'image ci-dessous.
La présence de populations apparentées sur le plan ethnique et linguistique, ainsi que de puissants efforts employant toute la panoplie des outils géopolitiques - y compris parfois face à des accusations de soutien au fondamentalisme islamique dans ses formes les plus violentes(28) - pour obtenir une position avantageuse dans la région, en font un acteur à considérer, au moins à l'échelle "régionale" dans ce Rimland contesté. Bien que la Russie et la Turquie, l'Empire russe et l'Empire ottoman, se soient livrés à des guerres continues jusqu'au XXe siècle, dans la quête de Moscou d'un débouché sur la mer, et que dans l'imaginaire et dans leurs visions du monde respectives, ils occupent des positions opposées, au cours de la dernière décennie, ils ont coopéré face aux différends que les deux nations ont avec l'Occident. Ainsi, des projets d'oléoducs et de gazoducs traversant le sol turc afin de transporter les hydrocarbures russes autour de l'Ukraine à la collaboration relative et aux accords conclus dans la guerre syrienne et dans le récent conflit du Nagorno-Karabakh (2020) dans le Caucase, la relation entre les deux puissances est basée sur le pragmatisme, mais sans oublier qu'en Libye, lors de la récente guerre civile, elles se sont rangées dans des camps opposés, ou que les rêves impériaux de la Turquie sont considérés avec suspicion par Moscou, car elles partagent des zones d'influence et un désir de contrôle. Ainsi, de temps à autre, il est possible de trouver des reportages sur la "grandeur des rêves impériaux de la Turquie"(29) dans les médias russes, soulignant l'appétit d'Ankara pour les régions des Balkans, du Caucase et de l'Asie centrale, et la manière dont elle y mène une politique active, voire agressive. La Turquie y voit une occasion d'essayer de restaurer la zone d'influence ottomane, de l'Adriatique à la Grande Muraille de Chine(30), et malgré sa rivalité avec la Russie, elle mène une politique étrangère très active, qui implique des négociations et des accords avec Moscou, soulignant que le 21e siècle sera le siècle de la Turquie (31).
Cependant, la Turquie, membre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN), en raison de ce néo-ottomanisme et de sa relation avec la Russie, est en désaccord avec plusieurs pays voisins, et même avec d'autres membres de l'OTAN, comme la Grèce et la France, avec lesquels il y a eu des incidents, surtout en Méditerranée orientale ; et en fait, les relations entre la Turquie et les États-Unis sont au plus bas, Washington évoquant même la perte d'un certain niveau de confiance(32). On fait également remarquer que les ambitions de la Turquie sont peut-être trop vastes et que, compte tenu de la nécessité éventuelle de choisir entre Washington et Moscou(33), les avantages pour Ankara seraient plus importants dans le premier cas qu'avec la Russie... le différend est couru d'avance. La maxime consistant à donner la priorité à ses propres intérêts sur toutes les autres questions est donc pleinement valable dans la lutte pour le Rimland... mais cet équilibre peut-il être maintenu face à la véritable puissance du Rimland, la Chine?
Chine : le dragon déploie ses ailes !
L'ascension irrésistible de la Chine au cours des dernières décennies lui a permis de dépasser le stade de "puissance émergente" pour devenir, au cours de la dernière décennie, une puissance "pleinement émergente", ce qui est apparu très clairement lorsqu'elle est devenue la deuxième plus grande économie du monde en 2011, dépassant le Japon.
En septembre 2013, lors d'une visite du président chinois Xi Jinping au Kazakhstan (un pays situé en Asie centrale, au milieu du Rimland), la Chine a lancé(34) la soi-disant Nouvelle route de la soie, une initiative qui sera complétée un mois plus tard par la proposition d'une Route de la soie maritime. Progressivement, la vision et les projets se sont développés en termes de portée, d'intensité et de domaines, ainsi qu'en termes de terminologie, l'acronyme OBOR (One Belt One Road) étant de plus en plus utilisé comme idée principale. Du point de vue chinois, la nouvelle route de la soie ne doit pas être considérée dans une perspective de guerre froide, ni comme un nouveau "plan Marshall", car il s'agit d'un élément de coopération(35) qui, en augmentant les possibilités de mobilité et d'interconnexion, augmentera également les possibilités de croissance économique pour tous les pays impliqués dans l'initiative, créant ainsi une sphère de prospérité partagée.

Mais cette nouvelle route de la soie - dont l'image ci-jointe montre l'une des diverses approches - envisage de contourner la l'espace centre-asiatique par voie terrestre et maritime et de créer une sphère de prospérité partagée, contournant donc le Heartland sur toute la longueur du Rimland, avec l'intention de la Chine de créer un autre axe majeur par le nord, à travers la Russie elle-même, le long du Transsibérien, qui n'a jamais été au goût de Moscou, indiquant que, bien qu'elle soutienne l'Initiative, elle n'en fait pas partie (36), et qu'elle fera toujours passer ses propres intérêts en premier.
Outre l'expansion de la Chine en Asie, dans la zone indo-pacifique (37) en utilisant, entre autres éléments, cette Initiative, elle se développe également dans de nombreuses régions de l'ancien espace post-soviétique, que ce soit en Asie centrale, dans le Caucase ou en Europe de l'Est même. Et la Russie voit nombre des nations dans lesquelles elle considère avoir un "intérêt privilégié" - selon sa propre terminologie - opter, à des degrés divers, pour le nouveau partenaire asiatique, ce qui entraîne une perte de la capacité d'influence de Moscou dans l'ensemble de son glacis de sécurité ; même au Belarus(38), la présence des investissements chinois est de plus en plus significative, ce qui ne satisfait pas pleinement les intentions et les prétentions russes, car Pékin offre une alternative puissante au précédent quasi-monopole de Moscou.
En effet, dans une zone d'influence russe classique comme les Balkans, la présence chinoise supplante progressivement Moscou ; des nouvelles telles que "la Chine remplace la Russie" comme principal investisseur au Monténégro" (39) ; "La Chine accroît sa présence dans les médias des Balkans"(40), ou "La Chine a dépassé la Russie comme principal allié de la Serbie" (41). D'autre part, et malgré l'approche possibiliste de l'Initiative, celle-ci comprend également, en plus de nombreux défis, la possibilité de plusieurs risques - entre autres, ceux communs à tout grand projet d'infrastructure -(42) : risque de dette et de non-paiement, risques de gouvernance (corruption), risque de travaux inachevés et non terminés, ainsi que risques environnementaux et sociaux. En effet, il est noté que l'Initiative change les villes et menace les communautés(43), alors que des projets massifs de construction d'infrastructures, de parcs d'affaires, de zones logistiques, de ports et d'aéroports, de pipelines, d'oléoducs et de gazoducs et d'autres projets d'infrastructures et de communication, etc. ne tiennent souvent pas compte, surtout dans les régions où la législation est plus laxiste, des aspects fondamentaux pour la qualité de vie et le développement des sociétés.
Le risque le plus analysé jusqu'à présent est ce que l'on appelle le "piège de la dette"(44), c'est-à-dire la situation générée par l'incapacité potentielle des pays à rembourser les prêts accordés et donc à rester dans une situation où ils sont incapables de payer leurs dettes et ainsi d'être laissés entre les mains de leur créancier - dans la plupart des cas, par rapport à l'Initiative, et sous différentes formes, la Chine. Et à cause de l'interdépendance des flux économiques, il est possible que la faillite d'une nation affecte celles qui l'entourent, au moins à l'échelle régionale, ce qui pourrait générer un nouvel "effet domino".
Cela pourrait générer un nouvel "effet domino" qui, comme par le passé, pourrait placer des régions entières du Rimland entre les mains d'une seule puissance. Et l'initiative se développe dans tous les domaines et espaces d'expansion possibles, en utilisant tous les outils géopolitiques disponibles ; dans un environnement pandémique, il est fait référence à la création d'une Route de la Soie saine(45) - liée à la diplomatie des masques et des vaccins pour le COVID-19 -, d'une Route de la Soie numérique(46) - dans le contexte de la lutte pour le déploiement des réseaux mondiaux de télécommunications et des technologies numériques dominantes... et il est même prévu de déployer une route de la soie polaire ! Sur ce dernier point, il faut noter que la Chine a obtenu le statut d'observateur pour l'Arctique en 2013(47), et que sa politique déclarée(48) pour ce nouvel espace en litige, qui, en raison du changement climatique, augmente sa capacité de navigation et l'exploitation de ses richesses, stipule que l'avenir de l'Arctique étant dans l'intérêt de toute l'humanité, sa gouvernance nécessite la participation de tous. Et la Chine est prête, dans le cadre de l'Initiative(49), à participer à toutes les activités dans l'Arctique, de la recherche active de ressources au déploiement de stations de surveillance sur terre, en passant par la création d'un corridor économique bleu dans l'océan Arctique.
Dans ce contexte, il convient de garder à l'esprit que, outre d'autres richesses potentielles, la région de la Sibérie du Nord devient de plus en plus un fournisseur d'hydrocarbures pour la Chine, et que l'intérêt pour la région et le secteur est croissant.
Des accords bilatéraux ont été signés entre Moscou et Pékin, y compris l'acquisition de parts dans le secteur du transport de l'énergie et d'autres infrastructures de transport dans l'Arctique(50) ; cependant, pour la Russie, l'Arctique, autrefois une zone passive en raison de la difficulté d'accès et de mobilité, constitue un nouveau flanc ouvert qui représente une menace puissante pour le cœur du pays et un espace sur lequel il est très actif.
L'Initiative atteint donc des espaces, des environnements, se matérialise dans des actions, génère des perceptions et de l'influence... elle constitue un outil géopolitique de premier ordre, englobant l'ensemble du Rimland - tant par voie terrestre que maritime -, s'aventurant dans la zone arctique et visant même à le faire directement à travers le heartland. La géopolitique à l'état pur. Face à cette réalité, il est souligné(51) que la Chine est très active et d'une manière qui implique fortement la sécurité de l'Alliance (OTAN) elle-même, puisque son contrôle d'une grande partie de l'infrastructure de l'Alliance - des réseaux de télécommunications aux infrastructures de transport et portuaires - affecte directement l'état de préparation, l'interopérabilité et la sécurité des communications des pays ; et que, compte tenu du système politique chinois, la distinction entre les secteurs militaire et civil, à certains niveaux, est très floue, de sorte que l'obtention de technologies et de connaissances du secteur civil, auprès d'entreprises chinoises déployées dans les pays membres de l'Alliance, pour une application ultérieure à des fins militaires n'est pas exclue ; De plus, Pékin planifie et exécute de puissantes campagnes d'information pour influencer les populations et les faiseurs d'opinion des pays de l'OTAN afin de diviser l'Alliance. Dans l'environnement actuel de conflit hybride en zone grise, cette réalité est dangereuse, même si elle peut être difficile à percevoir.
Et l'OTAN elle-même souligne que le concept stratégique de 2010 a été conçu pour une ère précédant la compétition entre grandes puissances ; mais cette ère est désormais à nos portes, et des mesures appropriées doivent donc être prises.
Mais nous sommes maintenant dans cette ère, et devons donc prendre des mesures appropriées(52), car les environnements gris et les conflits hybrides exigent de nouvelles approches de la dissuasion et de la défense. Face à un tel déploiement de capacités, face aux approches et aux positions des puissances qui se disputent le contrôle du Rimland, et dans la perspective d'un bloc de nations qui aspirent à avoir une représentativité et un poids au niveau mondial - ainsi qu'un intérêt direct et vital dans le différend - la question est : qu'en est-il de l'Europe ?
Et l'Europe ?
L'Europe, et surtout l'Europe de l'Est, est un espace très conditionné par cette question, non seulement parce qu'elle est une partie physique du Rimland, mais aussi parce que, si l'on se rappelle Mackinder, puisque c'est le contrôle de l'Europe de l'Est qui permet en fin de compte de contrôler et d'accéder au Heartland, cette partie de l'Europe devient - comme à d'autres moments de l'histoire - l'épicentre du Rimland et d'une bataille de dimension mondiale. Et pour illustrer cette réalité, l'image jointe à ce texte n'est pas celle de Mackinder d'il y a un siècle, elle est contemporaine et reflète la dite Plate-forme 17+1, qui comprend les pays d'Europe de l'Est, des Balkans et des Pays Baltes (53), 17 pays européens et la Chine, unis dans un cadre de coopération économique, commerciale, de développement économique et commercial, et de développement d'un nouveau partenariat mondial.

Apparemment, l'attitude du continent dans cette lutte mondiale est plus passive qu'active. Les propres contradictions et faiblesses de l'Europe (54) signifient qu'à l'ère du changement mondial, ce n'est pas seulement un échec: cette Europe n'est pas capable d'occuper une position adéquate dans le nouvel ordre qui se dessine, mais cela signifie aussi que son sol est aussi une partie contestée de cette reconfiguration planétaire. Et à une époque où de grands intérêts et de grandes forces sont en jeu, la non-union, voire la désunion, des pays européens pose un sérieux problème et rend impossible toute avancée réelle de l'UE. C'est là un grave problème et montre l'impossibilité de faire face à de puissants intérêts étrangers opposés aux leurs, sans oublier que la défense des valeurs de la démocratie et de la liberté au sens large, dont l'Europe est une référence mondiale, ne peut être défendue sans une position adéquate dans cet ordre.
Même les pays de l'Union européenne, en particulier ceux de l'Est et le soi-disant groupe de Visegrad (55), n'ont aucun problème à faire la sourde oreille à l'Union et à s'occuper des questions importantes d'un point de vue apparemment purement national, parfois en dépit des directives et des règles de Bruxelles. Dans cet environnement complexe, hybride, gris, où l'influence joue un rôle clé, il suffit de dire qu'à une époque aussi complexe que celle que nous vivons, tout comme lors de la première vague de la pandémie, on a inventé le terme de "diplomatie des masques", faisant allusion aux gains politiques recherchés par la livraison de ces éléments de protection à certaines nations, l'expression "géopolitique des vaccins" occupe déjà l'acquis international. Comme tout élément susceptible de générer un soutien, le vaccin contre le virus pandémique est devenu un nouvel instrument géopolitique(56), un moyen de renforcer les liens, de modifier les loyautés et de canaliser les sentiments vers une nation ou une autre, un moyen de gagner de l'influence. Le fait que le vaccin russe Sputnik V soit une propriété d'État signifie que le gouvernement peut clairement et directement décider à qui il est vendu, à qui il ne l'est pas et à quel prix, ce qui en fait un instrument direct de géopolitique pouvant être utilisé en fonction des besoins stratégiques du Kremlin (57) ; À cet égard, le président de la Commission européenne s'est interrogé sur les millions de doses offertes par la Russie à d'autres pays alors que Moscou progresse très lentement dans la vaccination de ses propres citoyens, ce à quoi la Russie répond qu'il s'agit de "politiser un problème de manière infondée [...]"(58).
Dans cette lutte et dans un contexte de pandémie, la géopolitique des vaccins est à son apogée. À tel point que même les pays de l'Union européenne ont demandé (et dans certains cas déjà reçu) le vaccin russe, arguant, selon les termes du Premier ministre slovaque, que la pandémie se moque de la géopolitique (59) ... bien que cette décision ait généré une crise au sein du gouvernement slovaque, étant donné que le vaccin russe (du moins jusqu'à présent) n'a pas été approuvé par l'Agence européenne des médicaments et où il a été suggéré par ceux qui sont en désaccord avec la décision d'accepter Sputnik-V qu'il ne s'agit pas seulement d'un vaccin, mais d'un instrument de guerre hybride (60). Et que des pays comme la Pologne, la Hongrie ou la Slovaquie envisagent - ou envisagent effectivement - de se procurer des vaccins auprès de la Chine ou même de la Russie(61) - une Russie à laquelle ces nations ne cessent de crier aide et soutien - est pour le moins surprenant. Face aux positions claires et fermes des puissances du Rimland, les ambiguïtés et les paradoxes des autres sont-ils d'une quelconque utilité ?
Conclusion : peut-il n'en rester qu'un ?
Apparemment, les grandes réalités reviennent toujours ; les moyens techniques changent, les possibilités et les domaines de litige évoluent, mais, dans de nombreux cas, les essences restent les mêmes. Et la géopolitique, comme la stratégie, sont des éléments de longue haleine, qui demandent de la clairvoyance et du recul, même si les objectifs peuvent être atteints par des étapes courtes, presque inaperçues. Il semble que, une fois de plus, il y ait une lutte pour le Rimland, menée par d'anciens et de nouveaux acteurs. Et ils "jouent" un jeu dangereux et prétendent, apparemment, dans cette circumnavigation du cœur, maintenir un équilibre qui semble inévitablement devoir disparaître à un moment ou à un autre, en fonction de la progression de l'influence et de la capacité d'action de l'un ou l'autre des principaux acteurs de la lutte. Bien que les choses puissent changer, et que des rivaux séculaires et structurels puissent devenir des alliés, il vaut peut-être la peine de se demander si ce qui se passe à Rimland n'est pas plus qu'une alliance "tactique", limitée dans le temps et l'espace, dans laquelle chacun cherche à obtenir une position avantageuse non seulement pour ses propres intérêts, mais aussi vis-à-vis des alliés du moment en vue d'une éventuelle confrontation ultérieure. Ce calcul du "risque pris" par ces puissances peut être très complexe, surtout lorsque l'un des acteurs est une puissance qui cherche à obtenir la primauté mondiale, qu'un autre a été une puissance mondiale et cherche à retrouver ce statut, et qu'un troisième aspire à gravir plusieurs échelons sur l'échelle de la puissance mondiale... les capacités de tous sont très différentes et les visions du monde elles-mêmes sont non seulement différentes, mais dans une large mesure, opposées.
Et si "un seul peut rester", l'Europe, qui "vit" dans le Rimland... quoi ?
Pedro Sánchez Herráez
Colonel de l'armée espagnole Docteur en paix et sécurité internationale. Membre de la faculté de sciences politiques et de sociologie. Département des sciences politiques et de l'administration I de l'Université Complutense de Madrid. Membre de l'Institut espagnol d'études stratégiques du Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional.
Notes :
1) AKON, Saifullah et RAHMAN, Mahfujur. "Remodeler l'ordre mondial dans l'ère post-COVID-19 : une analyse critique", Chinese Journal of International Review, juillet 2020, DOI : 10.1142/S2630531320500067. Disponible à l'adresse : https://www.researchgate.net/profile/SaifullahAkon/publication/343098068_Reshaping_the_Global_Order_in_the_Post_COVID19_Era_A_Critical_Analysis/links/5f6ad340458515b7cf46ebf2/Reshaping-the-Global-Order-in-the-PostCOVID-19-Era-A-Critical-Analysis.pdf?origin=publication_detail.
2) Dans ce sens SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. La lucha por el planeta y el futuro de las FAS españolas, Institut espagnol d'études stratégiques, document d'opinion 28/2017, 15 mai 2017. Disponible sur : http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2017/DIEEEO28-2017_Struggle_Planet_Future_FAS_Espanolas_PSH.pdf
3) Pouvoir d'une personne ou d'un élément de déterminer ou de modifier la façon dont les autres pensent ou agissent. SCANZILLO, Thomas M. et LOPACIENSKI, Edward M. "Influence operations and the human domain", U.S. Naval War College, CIWAG, U.S. Naval War College. Naval War College, CIWAG Case Studies numéro 13, 2015. Disponible à l'adresse suivante : https://www.hsdl.org/?view&did=814708
4) Espace entre la concurrence pacifique et les conflits armés. JORDAN, Javier. "Escalade dans les stratégies hybrides et la zone grise", Global Stratégies hybrides et zone grise", Rapport de stratégie globale 11/2020. Disponible sur : https://globalstrategy.org/la-escalada-en-las-estrategias-hibridas-y-en-los-conflictos-en-la-zona-gris/
5) Conflit dans lequel toutes sortes de moyens et de procédures sont employés, qu'ils soient "guerriers" ou "non guerriers". SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. Comprender la guerra híbrida... El retorno a los clásicos ?, Instituto Español de Estudios Estratégicos. Institut espagnol d'études stratégiques, Document d'analyse 42/2016, 21 juin 2016. Disponible à l'adresse suivante : http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2016/DIEEEA42-2016_Comprendre_la_guerre_hybride_Retour_aux_classiques_PSH.pdf
6) Réimprimé dans The Geographical Journal, volume 170, numéro 4, décembre 2004, pp. 298-321.
7) Ces changements peuvent être vus schématiquement dans TAZMAN, Howard. "Comment la Première Guerre mondiale a changé la carte du monde", Real Clear History, 29 novembre 2018. Disponible à l'adresse suivante :https://www.realclearhistory.com/articles/2018/11/29/how_world_war_i_changed_map_of_the_world_389.html
8) MACKINDER, Halford. "Idéaux démocratiques et réalité. Une étude de la politique de la reconstruction", Henry Holt and Company, New York, 1919.
9) Ibid. p. 194.
10) Publié dans Foreign Affairs, volume 21, numéro 4, juillet 1941, pp. 595-605.
11) SPKYKMAN, Nicholas J. 'The Geography of the Peace', Harcourt Brace, New York, 1944, p. 43.
12) Un bref résumé de ce qu'impliquait la politique d'endiguement peut être trouvé dans WILDE, Robert. "Containment : le plan américain contre le communisme", Thought.Co, 29 octobre 2018. Disponible à l'adresse suivante : https://www.thoughtco.com/what-was-containment-1221496
13) "Histoire du plan Marshall", La Fondation George C. Marshall. Disponible à l'adresse suivante :
14) LE PROJET AVALON, discours du président Harry Truman devant une session conjointe du Congrès, 12 mars 1947, Doctrine Truman. 12 mars 1947, Doctrine Truman. Disponible sur: https://web.archive.org/web/20041204183708/http://www.yale.edu/lawweb/avalon/trudoc.htm
15) L'œuvre en question est "Kim", publiée en 1901, qui a pour cadre la lutte entre l'Empire russe et l'Empire britannique en Asie centrale.
16) HOPKIRK, Peter. "The Great Game : the struggle for Empire in Central Asia", Kodanska America, New York, 1994.
17) Comme simple échantillon AYDIN, Mustafa. "La longue vue sur la rivalité et la coopération turco-russe", FMV, 8 juin 2020. Disponible sur : https://www.gmfus.org/publications/long-view-turkish-russianrivalry-and-cooperation ; YAU, Niva. "Russia and China's quiet rivalry in Central Asia", Foreign Policy Research Institute, septembre 2020. Disponible sur : https://www.fpri.org/wp-content/uploads/2020/09/cap1-yau.pdf
18) PIQUÉ, Josep. "Interpretar a Rusia para una relación posible", Política Exterior, 5 mars 2021. Disponible sur : https://www.politicaexterior.com/interpretar-a-rusia-para-una-relacion-posible/
19) En ce sens, SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. "Marco geopolítico de Rusia : constantes históricas, dinámica y visión en el siglo XXI", dans VVAA, Rusia bajo el liderazgo de Putin. La nueva estrategia rusa a la búsqueda de su liderazgo regional y el reforzamiento como actor global, Instituto Español de Estudios Estratégicos, Cuaderno de Estrategia número 178, Madrid, 2015, pp. 15-77. Disponible à l'adresse suivante : Cliquez pour accéder à CE_178.pdf.
20) "Poutine : les "forces adverses" exploitent le mécontentement social pour alimenter les protestations", Sputnik News, 13 février 2021. Disponible sur : https://mundo.sputniknews.com/20210213/1104021423.html
21) Très succinctement RT, Colour Revolutions, 6 mars 2015. Disponible à l'adresse suivante : https://actualidad.rt.com/actualidad/168235-revoluciones-colores-golpe-estado
22) 'Poutine : nous devons tirer la leçon des révolutions de couleur dans d'autres pays', RT, 20 novembre 2014. Disponible sur : https://actualidad.rt.com/actualidad/view/147716-putin-rusiarevoluciones-colores-extremismo
23) Dans les pays baltes : Estonie, Lituanie, Lettonie ; en Europe orientale : Biélorussie, Moldavie, Ukraine ; dans le Caucase : Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie ; en Asie centrale : Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, Turkménistan, Ouzbékistan.
24) ZEVELEV, Igor. "La Russie dans l'espace post-soviétique en mutation", Russialist.org, 25 novembre 2020. Disponible sur : https://russialist.org/russia-in-the-changing-post-soviet-space/
25) PRÉSIDENT DE LA RUSSIE, Dmitry Medvedev interview avec les chaînes de télévision russes, 31 août 2008. Disponible sur : http://www.kremlin.ru/events/president/news/1276
26) PIQUÉ, Josep. "Interpretar a Rusia para una relación posible", Política Exterior, 5 mars 2021. Disponible sur : https://www.politicaexterior.com/interpretar-a-rusia-para-una-relacion-posible/
27) MANKOFF, Jeffrey. "Un ours plus gentil, plus doux ? Pourquoi les rumeurs de retraite post-soviétique de la Russie sont prématurées". Center for Strategic & International Studies, 17 décembre 2020. Disponible à l'adresse suivante : https://www.csis.org/analysis/kinder-gentler-bear-why-rumors-russias-post-soviet-retreat-are-premature
28) ALSUMAIDAIE, Mujahed, 'Turkish influence in Central Asia and Islamist extremism', European Eye on Radicalization, 22 juillet 2020. Disponible sur : https://eeradicalization.com/turkish-influence-in-centralasia-and-islamist-extremism/
29) "Illusions impériales : les Turcs pourraient-ils dévorer la Crimée et le reste du sud de la Russie ?", Sputnik News, 15 février 2021. Disponible sur : https://mundo.sputniknews.com/20210215/ilusiones-imperialespodrian-los-turcos-devorar-crimea-y-el-resto-del-sur-de-rusia-1106771069.html
30) MARCOU, Jean et ÇELIKPALA, Mitat. "Regard sur les relations turco-russes : de la rivalité dans un monde bípolaire à la coopération dans un monde euroasitique ?", Institut français d'études anatolinnes, 2020, paragraphe 17. Disponible sur : https://books.openedition.org/ifeagd/3178?lang=es
31) " PM : le 21e siècle sera le siècle de la Turquie ", agence de presse Trend, 17 novembre 2013. Disponible sur : https://en.trend.az/world/turkey/2212128.html
32) VVAA, "Biden gives Turkey the silent treatment", Foreign Policy, 3 mars 2021. Disponible à l'adresse suivante : https://foreignpolicy.com/2021/03/03/biden-erdogan-turkey-silent-treatment-diplomacy-middle-east-syriacrisisnato/
33) ÖZEL, Soli. "Whither Turkey's ambitions ?", Institut italien d'études politiques internationales, 28 décembre 2020. Disponible sur : https://www.ispionline.it/en/publication/whither-turkeys-ambitions-28798
34) XINHUA, Chronologie de l'initiative chinoise "la Ceinture et la Route", 24 juin 2016. Disponible sur http://en.people.cn/n3/2016/0624/c90883-9077342.html
35) MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, Le ministre des Affaires étrangères Wang Yi rencontre la presse, 08 mars 2015. Disponible à l'adresse suivante : https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1243662.shtml
36) SHAH, Ankur. "La Russie desserre sa ceinture", Foreign Policy, 16 juillet 2020. Disponible à l'adresse suivante :
37) PARRA PÉREZ, Águeda. El juego geopolítico de la nueva Ruta de la Seda en Asia Pacífico, Instituto Español de Estudios Estratégicos. Institut espagnol d'études stratégiques, document d'opinion 126/2018, 10 décembre 2018. Disponible sur: http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2018/DIEEEO126_2018AGUPAR-RutaSeda.pdf
38) STANDISH, Reid. "Pour tenir Poutine à l'écart, le Belarus invite les États-Unis et la Chine à entrer", Foreign Policy, 1er janvier 2020. Disponible sur : https://foreignpolicy.com/2020/01/01/belarus-lures-us-china-to-forestall-putinrussia/
39) "La Chine remplace la Russie comme premier investisseur au Monténégro", Balkan Insight, 20 octobre 2020. Disponible sur : https://balkaninsight.com/2020/10/20/china-replaces-russia-as-largest-investor-inmontenegro/
40) "China increasing its footprint in Balkan media, study concludes", Balkan Insight, 9 décembre 2020. Disponible sur : https://balkaninsight.com/2020/12/09/china-increasing-its-footprint-in-balkan-media-studyconcludes/
41) "La Chine a dépassé la Russie comme grand allié de la Serbie", Balkan Insight, 6 juillet 2020. Disponible à l'adresse suivante : https://balkaninsight.com/2020/07/08/china-has-overtaken-russia-as-serbias-great-ally/
42) "Initiative "Belt and Road"" La Banque mondiale, 29 mars 2018. Disponible à l'adresse suivante : https://www.worldbank.org/en/topic/regional-integration/brief/belt-and-road-initiative
43) "How China's Belt and Road initiative is changing cities and threatening communities", The Conversation, 2 février 2021. Disponible sur : https://theconversation.com/how-chinas-belt-and-road-initiative-ischanging-cities-and-threatening-communities-153515
44) 'Health Silk Road of China : A new 'Debt trap health Diplomacy' in making', Diplomatist, 29 juin 2020. Disponible sur : https://diplomatist.com/2020/06/29/health-silk-road-of-china-a-new-debt-trap-healthdiplomacy-in-making/
45) AKON, Saifullah et RAHMAN, Mahfujur. "Remodeler l'ordre mondial dans l'ère post-COVID-19 : une analyse critique", Chinese Journal of International Review, juillet 2020, DOI : 10.1142/S2630531320500067, p. 4. Disponible sur : https://www.researchgate.net/profile/SaifullahAkon/publication/343098068_Reshaping_the_Global_Order_in_the_Post_COVID19_Era_A_Critical_Analysis/links/5f6ad340458515b7cf46ebf2/Reshaping-the-Global-Order-in-the-PostCOVID-19-Era-A-Critical-Analysis.pdf?origin=publication_detail
46) "China's Digital Silk Road", Cyber Security Intelligence, 5 mars 2021. Disponible à l'adresse suivante : https://www.cybersecurityintelligence.com/blog/chinas-digital-silk-road-5504.html
47) LANTEIGNE, Marc, "Les méandres de la route de la soie polaire", Over the Circle, 15 mars 2020. Disponible sur : https://overthecircle.com/2020/03/15/the-twists-and-turns-of-the-polar-silk-road/
48) LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE, Livre blanc, La politique arctique de la Chine, 26 janvier 2018.Disponible sur : http://english.www.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/content_281476026660336.htm
49) Texte intégral : Vision de la coopération maritime dans le cadre de l'initiative "la Ceinture et la Route", Xinhuanet, 20 juin 2017. Disponible sur : http://www.xinhuanet.com/english/2017-06/20/c_136380414.htm
50) STAALESEN, Atle. "De l'argent chinois pour la route maritime du Nord", The Barents Observer, 12 juin 2018. Disponible sur : https://thebarentsobserver.com/en/arctic/2018/06/chinese-money-northern-sea-route
51) DE MAIZIÈRE, Thomas et WESS MITCHELL, A. "L'OTAN doit faire face à la Chine de front", Foreign Policy, 23 février 2021. Disponible sur : https://foreignpolicy.com/2021/02/23/nato-china-brusselssummit-biden-europealliance/
52) Dans ce sens, l'OTAN, OTAN 2030 : unis pour une nouvelle ère. Analyse et recommandations du groupe de réflexion nommé par le Secrétaire général de l'OTAN, 25 novembre 2020. Disponible à l'adresse suivante : Cliquez pour accéder à 201201-Reflection-Group-Final-ReportUni.pdf.
53) VVAA, 'Empty Shell no more : China's growing footprint in Central and Eastern Europe', Association for International Affairs, Policy Paper, International Affairs, Policy Paper, avril 2020. Disponible sur : https://chinaobservers.eu/wpcontent/uploads/2020/04/CHOICE_Empty-shell-no-more.pdf
54) SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. Europa... ¿semblanzas balcánicas ?, Instituto Español de Estudios Estrategicos, Document d'analyse 05/2021, 03 février 2021. Disponible à l'adresse suivante : http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_analisis/2021/DIEEEA05_2021_PEDSAN_SemblanzaBalcanica.pdf
55) Slovaquie, Hongrie, Pologne et République tchèque. Sur leur position vis-à-vis de Bruxelles, BBC NEWS, Ce qu'est le groupe de Visegrad, les "mauvais garçons" défiant la France et l'Allemagne dans l'Union européenne, 2 février 2018. Disponible sur : https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-42879957
56) MOON, Suerie et ALONSO RUIZ, Adrián, La geopolítica de las vacunas contra el COVID-19, Política Exterior 199, 01 janvier 2021. Disponible sur https://www.politicaexterior.com/articulo/lageopolitica-de-las-vacunas-contra-el-covid-19/
57) "Vaccin contre Sputnik V : comment il est passé de la méfiance à l'outil d'influence de la Russie dans le monde", BBC NEWS, BBC NEWS, 15 février 2021. Disponible sur : https://www.bbc.com/mundo/noticiasinternacional-56012192
58) "La Russie est 'perplexe' face aux remarques de Von der Leyen sur les vaccins et dénonce la 'politisation'", Europa Press, 19 février 2021. Disponible à l'adresse suivante : https://www.europapress.es/internacional/noticia-rusia-muestra-perpleja-palabras-von-der-leyenvacunas-denuncia-politizacion-20210219144956.html
59) "Sputnik V : pourquoi beaucoup en Russie ont des doutes sur leur propre vaccin", BBC NEWS, 4 mars 2021. Disponible sur : https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-56266603
60) La coalition au pouvoir en Slovaquie en crise au sujet du vaccin Sputnik-V COVID-19, EURO NEWS, 4 mars 2021. Disponible sur : https://www.euronews.com/2021/03/04/slovakia-s-ruling-coalition-in-crisis-over-sputnik-vcovid-19-vaccine
61) "Certains tendent la main à Israël, d'autres se tournent vers la Russie et la Chine : plusieurs pays de l'UE se dissocient de Bruxelles pour rechercher davantage de vaccins", EURO NEWS, 4 mars 2021 & eldiario, 2 mars 2021. Disponible à l'adresse suivante : https://www.eldiario.es/internacional/acercan-israel-miran-rusia-china-paises-ue-desmarcan-bruselasbuscar-atajos-vacunas_1_7265469.html
SÁNCHEZ HERRÁEZ, Pedro. 21e siècle : le retour à la lutte pour le Rimland ? Document d'analyse IEEE 12/2021.
15:00 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : heartland, rimland, géopolitique, actualitén, relations internationales |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 mai 2022
Changement "du" système ou changement "dans" le système?

Guerre régionale ou guerre générale?
Irnerio Seminatore
Sources:
Clausewitz et ses enseignements
"Si l'un des deux belligérants est décidé à s'engager sur la voie des grandes décisions par les armes, ses chances de succès sont considérables, pour peu qu'il soit certain que l'autre ne désire pas s'y engager" (Clausewitz). Cette proposition s'applique parfaitement à la Russie et à l'Ukraine. Les deux belligérants y étaient engagés depuis longtemps et leur dialogue, diplomatique et militaire, était soutenu, en sous mains, par des co-belligérants occultes, américains, britanniques, allemands, français, polonais, baltes et autres, qui armaient et entrainaient les Ukrainiens de Zelenski. Ainsi le réveil européen pour la guerre n'a été qu'une "fake news". "La bulle" de la grande hypocrisie occidentale, qu'on avait ignoré. La primauté de la politique n'est point une proposition théorique. L'Occident et la Russie étaient déjà en guerre, mais ils ne le savaient pas encore officiellement, ou ils feignaient plutôt de l'ignorer. Sinistre Illusion ! Les Européens de l'Ouest ont mis dans les armoires de leurs chimères du passé, amnésiques, les livres trompeurs de Kant, Alain, Russell et autres munichois et humanistes.
Par ailleurs les institutions européennes, en antennes éminentes du cartel international de la morphine historique, dont la Commission s'est voulue l'outil "géopolitique”, sont passées à la livraison d'armements pour prolonger le carnage des peuples. Les plus lucides n'ont pas découvert aujourd'hui la guerre ou sa barbarie, mais le visage et la perversion d'eux-mêmes, sous le masque d'un agitateur de théâtre. C'était la violence des Yankees, le cynisme d’Albion, la logique déraisonnable et non rationnelle des Français et l'échine paralysée des Allemands. Tous croupis, au fond d'eux-mêmes, par la peur et par le manque de lucidité et de courage. Paix et Guerre, une intimité antique !
Révisons ensemble la dialectique de l'antagonisme historique et considérons les issues possibles de chaque type de paix et de chaque type de guerre. Une lecture qui sera conduite à la lumière de la politique étrangère, comportant l'unité du verbe diplomatique et de l'action militaire, unité qui, au sein de l'alliance atlantique, exclut la solidarité totale de tous les alliés. Or, puisque la subordination de la guerre à la politique dépend d'un ensemble d'intérêts, de facteurs et de circonstances, laquelle des politiques pratiquées les Européens suivront-ils, en calquant le chemin de Zelenski, de la Commission européenne et de l'Alliance Atlantique ? Pour quels enjeux et jusqu’où ? Clausewitz nous en rappelle les issues possibles: "Si la politique est grandiose et puissante, la guerre le sera aussi et pourra même atteindre les sommets, où elle prend sa forme absolue". Or l'inégalité des buts de guerre et l'inégalité de force et de résolution, subordonnera la montée aux extrêmes de la guerre à la réaction de l'autre et cela suite au principe de polarité.

La Macht-Welt-Politik et ses revers
Si nous assumons le principe que le "type de paix" souhaitée détermine en large partie le "type de guerre" à mener, dans le but de parvenir à une "paix de satisfaction", une classification ternaire des paix (d'équilibre, d'hégémonie ou d'empire), nous indique que la violence des conflits est imputable à la géométrie des rapports de force. C'est la grandeur des enjeux qui accroit la détermination politique et l'ardeur des combats. Dans le cas du conflit ukrainien l'enjeu pour les deux parties c'est le passage d'une configuration du système international à un autre (bipolaire à multipolaire). Cela signifie pour l'Ukraine sa disparition en tant qu'Etat de la scène inter-étatique et son passage d'une zone impériale (atlantique) à une autre (russe).
Pour la Russie l'enjeu existentiel, serait, en cas d'échec, un déclassement de puissance à long terme et un tremblement géopolitique inacceptable, interne et extérieur, qui serait tectonique et fatale pour l'Europe, la Russie et l'Eurasie. Par son étendue il concernerait une turbulence élargie à l'ensemble des relations systémiques, multipolaires, intercontinentales et inter-étatiques. Dans la perception de la Russie et des autres acteurs de la communauté internationale le glissement inévitable de la guerre vers un conflit d'ampleur, amènerait à la restauration d'une zone impériale, qui rivaliserait avec la puissance hégémonique déclinante. Dans cette hypothèse une guerre de grande ampleur serait inévitable car elle mettrait en cause le pivot dominant du système (les Etats-Unis), les poussant prématurément à agir.
La signification historique et systémique de la crise Ukrainienne
Entrer dans la crise ukrainienne ou s'y laisser entraîner revêt une signification plus générale et plus abstraite. En effet il s'agit d'une "crise d'équilibres" régionale qui déplace le centre de gravité du système, la fameuse "Balance of Power" vers l'Est et montre la vanité de la résistance d'une zone de jonction géopolitique (l'Ukraine de Zelenski), rendant évidente l'incapacité des Etats européens de l'Ouest à influer sur les autres et tous ensemble sur la Russie. Celle-ci, contrairement à l'Ouest du continent doit son existence et sa sécurité à elle-même, tandis que les Etats européens, derrière l'encadrement de l'alliance atlantique doivent leur existence et leur sécurité à un acteur extérieur au continent, l'Amérique.
C'est l'Amérique qui choisit son ennemi principal, son théâtre décisif et le centre de gravité de son empire futur, ailleurs (Asie- Pacifique), que dans une zone d'influence disputée. Gagner ici (théâtre régional européen), c'est perdre dans l'Indo-Pacifique (théâtre systémique), au profit de la puissance chinoise. Or la "Paix d'équilibre" qui conviendrait à l'Europe, dictée par "the anxiety with to the the balance of power is apparent..(David Hume) et se situe entre la puissance extérieure dominante (Etats-Unis) et la puissance extérieure révisionniste (Fédération de Russie).
Selon David Hume et selon "le common sens and obvious reasoning", jamais un Etat (en l'espèce la Russie? ou la Novorossyia? ou un nouvel Empire?), ne doit posséder des forces telles que les Etats voisins soient incapables de défendre leurs droits et leurs libertés contre lui (argument invoqué par la Pologne, les pays baltes, la Finlande et la Suède). Cet argument est à l'image du cas de l'empire romain, qui fut capable de soumettre l'un après l'autre ses adversaires et ses ennemis, avant qu'ils fussent en mesure de préserver les alliances qui auraient dû préserver leur indépendance. Cependant, puisque dans les relations internationales la réussite des grandes épreuves est fondée sur la légitimité, bien qu'hétérogène et sur les rapports de force, bien que variables, il est à supposer que l'unité des Etats européens de l'Ouest se réalisera davantage par la coordination des pays qui disposent d'un vrai noyau de force (France et Allemagne) et qui, par la perte de légitimité de l'Union, fera de celle-ci une expérience marginale, non prioritaire et non décisive du processus de rapprochement des Etats du continent. En réalité l'hétérogénéité du principe de légitimité de l'Union (cas de la Pologne et de la Hongrie) est à la base de sa fissuration politique et l’asymétrie de son "noyau dur", est à la base de sa différente conception de la souveraineté et de sa géopolitique mondiale, dont la crise ukrainienne est l'une des manifestations.
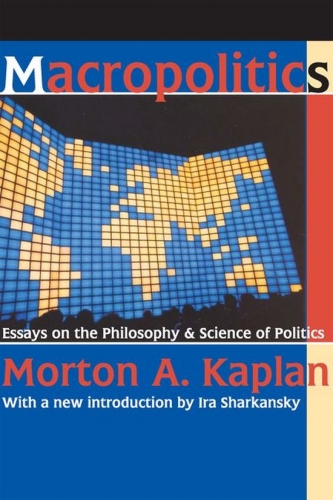
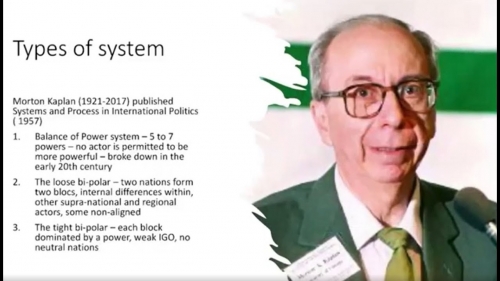
David Hume, Morton Kaplan et la théorie de l'équilibre
Que la politique de l'équilibre continental ou son statu-quo antérieur au conflit, plus favorable au camp de l'alliance atlantique, serve à préserver le système et justifie les puissances insulaires (Grand Bretagne et Etats-Unis), dans leur rôle de pourvoyeuses d'armements, est apparu immédiatement, comme l'un des objectifs de la coalition des puissances globalistes et de leur intervention indirecte, limitée et tardive. De ce point de vue il faut empêcher à tout prix l'unification des terres slaves par la Russie, -ont elles pensé- après l'élimination historique de l'Allemagne avec la IIème guerre mondiale, comme acteur principal du continent et porteur de la possibilité d'une soudure de la terre centrale (le Heartland) en fonction anti-hégémonique. La Russie sait pertinemment qu'elle est tenue pour un Etat perturbateur, soupçonné de vouloir reconstituer un ensemble politique impérial et dominateur dans son pourtour d’Etats indépendants.
Dans de pareilles conditions, après l'effondrement de l'Union soviétique elle s'attend à être tenue comme une menace pour l'hégémonie et, par les Etats-Unis, comme la réémergence d'un rival. Or, si en fonction du "système européen" du XIXème David Hume avait défini la formule la plus simple de l'équilibre, analysant en particulier la rivalité de la France et de l'Allemagne, la politique de " l'équilibre multipolaire" du XXIème, définie de façon générale comme "Balance of Power" a été formulée dans les années cinquante par Morton Kaplan, qui repère six règles abstraites, auxquelles doivent s'attendre les unités politiques si un Etat aspire à l'Hégémonie en perturbateur du système, suscitant l'hostilité de tous les Etats conservateurs. C'est exactement ce qui arrive à la Russie aujourd'hui, qui a pris l'initiative des hostilités, dans l'acharnement des sanctions économiques et financières et dans la tentative d'isolement international et d'affaiblissement politique et militaire, dont témoigne l'envoi d'armements lourds à l'Ukraine de Zelenski.
"Paix d'équilibre" ou "paix d'empire" ? Changement "du" système, ou changement "dans" le système ?
"Entre la "paix d'équilibre" et la "paix d'empire", s'intercale "la paix d'hégémonie" dit Raymond Aron, mais, il ajoute, "l'hégémonie est une modalité précaire de l'équilibre", assurée par une volonté marquée d'indépendance, car les amitiés et les inimitiés sont historiquement temporaires. La "paix d'équilibre" de l'Europe du XIXème avait un caractère conjoncturel et se limitait à la "prépondérance" de l'Allemagne de Bismarck, que la Grande Bretagne empêchera de se transformer en hégémonie continentale. Aujourd'hui, en cas de victoire de la Russie poutinienne, les occidentaux pourront-ils l'empêcher de devenir une puissance hégémonique à l'échelle multipolaire et globale (Russie, Chine, Inde, Iran, tiers non engagés), de puissance prépondérante qu'elle était à l'échelle continentale (Europe orientale et sud orientale) ?
Cette perspective historique est rendue plausible par le fait que le modèle "parfait" de guerre, selon la typologie classique, est la "guerre inter-étatique" ou nationale, qui met aux prises des unités politiques de même nature et de même zone de civilisation, dans le but de préserver l'existence du pays, tandis que les "guerres impériales" visent l'élimination d'un belligérant et la constitution d'une unité politique supérieure, composée de plusieurs unités hétérogènes.
La guerre qui caractérise l'issue entreprise par la Russie, serait pour ses adversaires le début d'une entreprise sans fin, une confrontation imparfaite et hétérogène qui met aux prises des relations inter-étatiques, trans-nationales et sociétales, qu'il faut stopper au plus vite et par tous les moyens. Il s'agirait d'un type de conflit qui ne peut donner lieu à une "paix de satisfaction", mais à des conflits prolongés, à des armistices précaires et belliqueux, asymétriques, terroristes et hybrides, dus à la coexistence d'intérêts contradictoires, dépourvus d'une perspective commune. Bien que né de la revendication d'un principe de légitimité, le principe de souveraineté étatique, revendiqué par l'Ukraine cet amalgame d'intérêts attisera des rivalités perpétuellement renaissantes surtout en Europe et conduirait qu'à une paix belliqueuse et, plus probablement, à un guerre civile permanente.
Dans le cas de la crise ukrainienne, dirigée de l'extérieur par les Etats-Unis et en subordre, par les Européens, le but de guerre et l'issue finale, changeront-ils "le" système international ou bien produiront-ils une modification des rapports de force "dans" le système ? On pourrait opiner avec Joe Biden que la "bonne" hypothèse est dans la première réponse et donc dans l'option d'une guerre limitée et dans la préservation de l'hégémonie américaine et avec Vladimir Poutine dans la deuxième, autrement dit dans le double désir de sécurité et de gloire (ou de prestige), car changeraient alors les deux éléments qui commandent à tout système international, le rapport de force, qui deviendrait plus favorable aux puissances de la terre (Russie, Chine, Inde, Iran, non-Alignés) et le principe de légitimité (oligarchique, autocratique ou despotique), renversant le cours de l'histoire, qui est allée jusqu'ici de l'Occident vers l'Orient.
Bruxelles le 23 avril 2022
20:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, relations internationales, ukraine, russie, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le Nouvel Ordre Mondial dans le contexte des théories des relations internationales
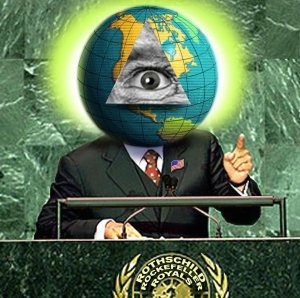
Le Nouvel Ordre Mondial dans le contexte des théories des relations internationales
Alexandre Douguine
Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/nwo-context-international-relations-theories
Nous devons comprendre ce qui se passe pour nous et autour de nous. Pour ce faire, le bon sens ne suffit pas, il faut des méthodologies. Considérons donc l'OMS (Opération militaire spéciale) dans le contexte d'une discipline comme les relations internationales (RI).
Il existe deux grandes écoles de pensée en relations internationales: le réalisme et le libéralisme. Nous allons discuter de celles-ci, bien qu'il en existe d'autres, mais ces deux-là sont les principales. Si vous n'êtes pas familier avec ces théories, n'essayez pas de deviner ce que l'on entend ici par "réalisme" et "libéralisme", la signification des termes serait tirée du contexte.
Ainsi, le réalisme en RI repose sur la reconnaissance de la souveraineté absolue de l'État-nation; cela correspond au système westphalien de relations internationales qui a émergé en Europe à la suite de la guerre de 30 ans qui s'est terminée en 1648. Depuis lors, le principe de souveraineté est resté fondamental dans le système du droit international.

Les réalistes RI sont ceux qui tirent les conclusions les plus radicales du principe de souveraineté et pensent que les États-nations souverains existeront toujours. Cela se justifie par la compréhension que les réalistes ont de la nature humaine: ils sont convaincus que l'homme, dans son état naturel, est enclin au chaos et à la violence contre les plus faibles, et qu'un État est donc nécessaire pour empêcher cela; en outre, il ne devrait y avoir aucune autorité au-dessus de l'État pour limiter la souveraineté. Le paysage de la politique internationale consiste donc en un équilibre des forces en constante évolution entre les États souverains. Le fort attaque le faible, mais le faible peut toujours se tourner vers le fort pour obtenir de l'aide. Des coalitions, des pactes et des alliances se forment. Chaque État souverain défend ses intérêts nationaux sur la base d'un froid calcul rationnel.
Le principe de souveraineté rend les guerres entre États possibles (personne ne peut interdire à quelqu'un d'en haut de faire la guerre, car il n'y a rien de plus élevé qu'un État), mais en même temps la paix est également possible, si elle est avantageuse pour les États, ou si dans une guerre il n'y a pas d'issue univoque.
C'est ainsi que les réalistes voient le monde. En Occident, cette école a toujours été assez forte et a même prévalu, aux États-Unis, elle reste assez influente aujourd'hui: environ la moitié des politiciens américains et des experts en RI suivent cette approche, qui a dominé pendant la présidence Trump, la plupart des républicains (sauf les néocons) et certains démocrates y penchent.
Considérons maintenant le libéralisme en RI. Ici, le concept est très différent. L'histoire est vue comme un progrès social continu, l'État n'est qu'une étape sur la route du progrès, et tôt ou tard, il est appelé à disparaître. Puisque la souveraineté est entachée d'une possibilité de guerre, il faut essayer de la surmonter et de créer des structures supranationales qui la limitent d'abord, puis l'abolissent complètement.
Les libéraux de la RI sont convaincus qu'un gouvernement mondial doit être établi et que l'humanité doit être unie sous l'impulsion des forces les plus "progressistes", c'est-à-dire les libéraux eux-mêmes. Pour les libéraux de la RI, la nature humaine n'est pas une constante (comme c'est le cas pour les réalistes) mais peut et doit être changée. L'éducation, l'endoctrinement, les médias, la propagande des valeurs libérales et d'autres formes de contrôle des esprits sont utilisés à cette fin. L'humanité dans son ensemble doit devenir libérale et tout ce qui est illibéral doit être exterminé et banni. Car ce sont là les "ennemis de la société ouverte", les "illibéraux". Après la destruction des "illibéraux", il y aura une paix mondiale - et personne ne sera en guerre contre personne. Pour l'instant, la guerre est nécessaire, mais uniquement contre les "illibéraux" qui "entravent le progrès", défient le pouvoir des élites mondiales libérales et ne sont donc pas "humains", en aucune façon, et peuvent donc être traités de n'importe quelle manière - jusqu'à l'extermination totale (y compris l'utilisation de pandémies artificielles et d'armes biologiques).
Dans un avenir proche, selon ce concept, les États seront abolis et tous les humains se mélangeront, créant une société civile planétaire, un seul monde. C'est ce que l'on appelle le "globalisme". Le globalisme est la théorie et la pratique du libéralisme dans les RI.
La nouvelle version du libéralisme comporte un élément complémentaire aujourd'hui: l'intelligence artificielle dominera l'humanité, les gens deviendront d'abord sans sexe, puis "immortels", ils vivront dans le cyberespace et leur conscience et leur mémoire seront stockées sur des serveurs en nuage, les nouvelles générations seront créées dans une éprouvette ou imprimées par une imprimante 3D.
Tout cela se reflète dans le projet Great Reset du fondateur du Forum de Davos, Klaus Schwab.
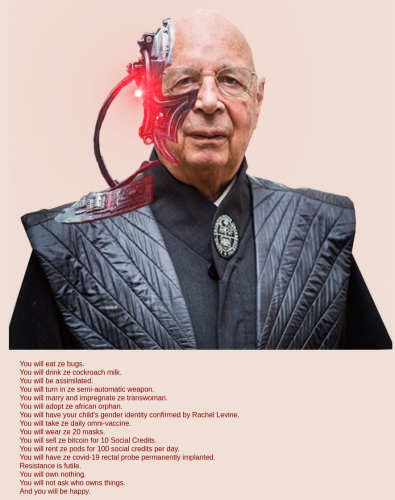
Les libéraux constituent l'autre moitié des politiciens et des experts en relations internationales en Occident. Leur influence augmente progressivement et dépasse parfois celle des réalistes en matière de RI. L'actuelle administration Biden et la majorité du parti démocrate américain sont des libéraux qui poussent dans ce sens. Les libéraux sont également dominants dans l'UE, qui est la mise en œuvre d'un tel projet, puisqu'elle vise à construire une structure supranationale. Ce sont les libéraux en matière de RI qui ont conçu et créé la Société des Nations, puis l'ONU, le Tribunal de La Haye, la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que le FMI, la Banque mondiale, l'OMS, le système éducatif de Bologne, la numérisation et tous les projets et réseaux mondialistes, sont tous l'œuvre des libéraux. Les libéraux russes font partie intégrante de cette secte mondiale, qui a toutes les caractéristiques d'une secte totalitaire.
Appliquons maintenant ces définitions au NOM (Nouvel Ordre Mondial). Après l'effondrement de l'URSS, l'Ukraine est devenue un outil des libéraux et des réalistes au sein des RI - précisément un outil de l'Occident. Les libéraux du MdD ont encouragé l'intégration de l'Ukraine dans le monde global et ont soutenu ses aspirations à rejoindre l'Union européenne et l'OTAN (l'aile militaire du globalisme); les réalistes du MdD ont utilisé l'Ukraine dans leurs intérêts contre la Russie; pour ce faire, il était nécessaire de faire de l'Ukraine un État-nation, ce qui contredisait l'agenda purement libéral. C'est ainsi que s'est formée la synthèse du libéralisme ukrainien et du nazisme contre laquelle l'Opération Militaire Spéciale se bat. Le nazisme en acte en Ukraine (l'Extrême droite, le Bataillon Azov et d'autres structures interdites en Russie) était nécessaire pour construire une nation et un État souverain le plus rapidement possible. L'intégration dans l'Union européenne exigeait une image ludique et comiquement pacifiste (ce fut le choix de Zelenski). Le dénominateur commun était l'OTAN. C'est ainsi que les libéraux et les réalistes IR ont obtenu un consensus russophobe en Ukraine. Lorsque cela était nécessaire, ils ont fermé les yeux sur le nazisme, les valeurs libérales et les parades de la gay pride.
Venons-en maintenant à la Russie. En Russie, depuis le début des années 1990, sous Eltsine, Tchoubais et Gaidar, le libéralisme a fermement dominé les RI. La Russie d'alors, comme l'Ukraine d'aujourd'hui, rêvait de rejoindre l'Europe et d'adhérer à l'OTAN. Si cela avait exigé une plus grande désintégration, les libéraux du Kremlin auraient été prêts à le faire aussi; mais à un moment donné, Eltsine lui-même et son ministre des affaires étrangères Evgueni Primakov ont légèrement ajusté l'agenda: Eltsine n'appréciait pas le séparatisme en Tchétchénie, Primakov a déployé un avion au-dessus de l'Atlantique pendant le bombardement de la Yougoslavie par l'OTAN. Il s'agissait de faibles signes de réalisme. La souveraineté et les intérêts nationaux étaient invoqués, mais de manière hésitante, timide.
Le vrai réalisme a commencé lorsque Poutine est arrivé au pouvoir. Il a vu que ses prédécesseurs avaient affaibli la souveraineté à l'extrême, happés qu'ils étaient par la mondialisation, et que le pays était par conséquent sous contrôle étranger. Poutine a commencé à restaurer la souveraineté. Tout d'abord, dans la Fédération de Russie elle-même - la deuxième campagne de Tchétchénie, la suppression des clauses de souveraineté de la Constitution, etc., puis il a commencé à s'occuper de l'espace post-soviétique - ce furent les événements d'août 2008 dans le Caucase du Sud, puis la Crimée et le Donbass en 2014. Dans le même temps, il est révélateur que la communauté internationale des experts (SWOP, RIAC, etc.) et le MGIMO ont continué à être complètement dominés par la ligne du libéralisme. Le réalisme n'a jamais été mentionné. Les élites sont restées libérales - tant celles qui s'opposaient ouvertement à Poutine que celles qui acceptaient à contrecœur de se soumettre à lui.
L'Opération Militaire Spéciale a, comme un flash-back, éclairé la situation au sein du ministère russe de la Défense. Derrière l'Ukraine, il y a une alliance de libéraux et, en partie, de réalistes au sein du ministère de la Défense, c'est-à-dire les forces du mondialisme qui se sont retournées contre la Russie. Pour les libéraux (et Biden et son administration (Blinken and Co.), comme Clinton et Obama avant lui, appartiennent précisément à cette école), la Russie est l'ennemi absolu, car elle constitue un obstacle sérieux à la mondialisation, à l'instauration d'un gouvernement mondial et d'un monde unipolaire. Pour les réalistes américains (et en Europe les réalistes sont très faibles et à peine représentés) la Russie est un concurrent pour le contrôle de l'espace de la planète. Ils sont généralement hostiles, mais pour eux, soutenir l'Ukraine contre la Russie n'est pas une question de vie ou de mort: les intérêts fondamentaux des Etats-Unis ne sont pas affectés par ce conflit. Il est possible de trouver un terrain d'entente avec eux, pas avec les libéraux.
Pour les libéraux de la RI, cependant, c'est une question de principe. L'issue de l'Opération Militaire Spéciale déterminera s'il y aura ou non un gouvernement mondial. La victoire de la Russie signifierait la création d'un monde entièrement multipolaire dans lequel la Russie (et la Chine et, dans un avenir proche, l'Inde) jouirait d'une souveraineté réelle et forte, tandis que les positions des entités alliées de l'Occident libéral, qui acceptent la mondialisation et sont prêtes à compromettre leur souveraineté, seraient dramatiquement affaiblies.
En conclusion, le libéralisme dans les RI vise à imposer la politique du genre, la guerre de l'information et la guerre hybride, l'intelligence artificielle et le post-humanisme, mais le réalisme évolue également de son côté: confirmant la logique de S. Huntington (incidemment, un partisan du réalisme dans les RI), qui parlait du "choc des civilisations", les principaux acteurs ne sont pas des États mais des civilisations, ce qu'il appelle les Grands Espaces. Ainsi, le réalisme glisse progressivement vers la théorie du monde multipolaire, où les pôles ne sont plus les États-nations, mais les États-continents, les empires. Ceci est également clairement visible dans le déroulement de l'Opération Militaire Spéciale.
En termes de diverses théories des relations internationales, l'Opération lancée par la Russie en Ukraine a simultanément inauguré un conflit entre :
- l'unipolarité et la multipolarité,
- le réalisme et le libéralisme dans les RI,
- la petite identité (nazisme ukrainien artificiel) et la grande identité (fraternité eurasienne de la Russie),
- la civilisation de la terre (Land Power) contre la civilisation de la mer (Sea Power) dans la bataille pour la zone côtière (Rimland), qu'a toujours explicité la géopolitique,
- l'État défaillant et l'empire résurgent.
Sous nos yeux et avec nos mains et notre sang, maintenant - en ce moment même - la grande histoire des idées est en train de se faire.
19:18 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, alexandre douguine, relations internationales, école réaliste, réalisme ri |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 22 avril 2022
Incendie en Europe - Intérêts géopolitiques et défi à l'ordre libéral

Incendie en Europe
Par Andrés Berazategui*
Source: https://nomos.com.ar/2022/04/19/fuego-en-europa/?fbclid=IwAR1-F33Lt9hPuz8XmKAezJvqzASFrI9ihsVdoDidWu4IH2x8f1_TtUa6SkM
Intérêts géopolitiques et défi à l'ordre libéral
Lorsque l'intervention de la Russie en Ukraine a débuté le 24 février, la principale raison invoquée par Vladimir Poutine pour lancer les opérations était le conflit vieux de huit ans au Donbass. Nous ne nous attarderons pas sur les faits, étant donné l'importante couverture médiatique en cours. Depuis quelques années, la situation dans la région semblait se calmer en raison de l'impasse qui a créé une frontière de facto entre les territoires contrôlés par les forces loyales au gouvernement ukrainien et ceux sous le contrôle des insurgés des républiques autoproclamées de Donetsk et de Lougansk. Il est donc clair que la décision du président russe de lancer une telle opération ne peut être uniquement liée au conflit dans le Donbass. Le différend entre la Russie et l'Ukraine doit être placé dans un cadre plus large dans lequel nous soulignerons deux aspects: d'une part, des considérations géopolitiques liées aux questions de sécurité et à la lutte pour l'hégémonie en Eurasie; et, d'autre part, un défi plus large où une Russie revigorée remet en question l'ordre international en déclin dirigé par les États-Unis.
La Russie et la géopolitique eurasienne
En stratégie, un "intérêt vital" est défini comme un intérêt pour lequel un acteur est déterminé à faire la guerre afin de le défendre. Dans la politique interétatique, la vie de la population, la possession ou l'accès à des ressources critiques, ou le territoire lui-même peuvent être identifiés comme des facteurs d'intérêt vital pour un État. Les États élaborent des stratégies pour neutraliser les menaces, c'est pourquoi les politiques de sécurité et de défense figurent souvent en bonne place dans les agendas publics. Il n'est pas surprenant que les puissances aient tendance à consacrer d'importantes ressources à cet effet. L'ex-URSS ne faisait pas exception, bien au contraire, et sa désintégration a laissé un grand nombre de conflits potentiels qui pourraient être très problématiques pour son principal État, la Russie d'aujourd'hui. Vladimir Poutine considère que l'effondrement de l'URSS est la plus grande catastrophe géopolitique du 20e siècle. Il a toutes les raisons de le croire. Mais le plus grave, au vu des événements qui ont suivi cet automne, était la menace que la Russie percevait dans une OTAN avançant vers l'est. Historiquement, le principal défi de la Russie a été de défendre son espace national contre une multitude de voisins actifs et souvent instables. Il n'est donc pas surprenant que l'avancée de l'alliance atlantique ait mis les dirigeants russes mal à l'aise. La raison est classique: aucune puissance ne veut de menaces près de ses frontières. Les Américains toléreraient-ils une alliance militaire chinoise incluant, par exemple, des pays des Caraïbes, le Canada ou même le Mexique ? Comment les États-Unis ont-ils réagi lorsque les Soviétiques ont envoyé des missiles à Cuba ? Pourtant, une Russie encore faible ne pouvait rien faire en 1999 lorsque la première expansion de l'OTAN de l'ère post-soviétique a eu lieu, la République tchèque, la Hongrie et la Pologne rejoignant l'alliance.
Selon certains analystes, la Russie ne s'inquiétait guère, au début des années 1990, de la capacité de l'OTAN à contenir une Allemagne nouvellement unifiée. Il n'y avait pas non plus de signe public de la volonté de l'OTAN de "marcher vers l'est", sans parler du fait que beaucoup en Russie estimaient que la propagation de la démocratie ne nécessitait pas l'expansion parallèle d'une alliance militaire. Mais plus d'un Occidental a considéré l'élargissement de l'OTAN comme une grave erreur, y compris le stratège George Kennan, celui-là même qui a conçu la politique d'endiguement de l'URSS pendant la guerre froide, dans un article du New York Times d'aujourd'hui intitulé "A fateful error" [1].
Cependant, d'autres voix se sont fait entendre et la géostratégie finalement conçue avait réservé à l'OTAN et à l'Union européenne le rôle fondamental d'être la "tête de pont démocratique" des Etats-Unis sur l'Eurasie, comme le soutenait Zbigniew Brzezinski en 1997 [2]. Il a écrit une stratégie séduisante pour Washington avec une relecture néo-mackinderienne de la géopolitique, car il voyait l'Eurasie comme le principal échiquier dans la lutte pour l'hégémonie mondiale et où il était nécessaire d'opérer sur trois fronts : L'Europe de l'Est, où l'UE et l'OTAN (deux architectures institutionnelles qui allaient de pair) devaient s'étendre; les "Balkans eurasiens", une région qui s'étend de l'est de la Turquie et d'une grande partie de l'Iran à l'Asie centrale, où régnait une grande instabilité qui devait être gérée par la diplomatie et l'équilibre; et enfin l'Extrême-Orient, où une Chine en pleine expansion devait être contenue afin de demeurer uniquement une puissance régionale.

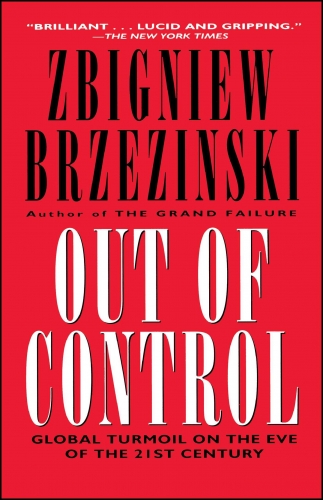
La plus grande crainte de Brzezinski était qu'une alliance anti-hégémonique prenne forme, qui contesterait la suprématie mondiale des Etats-Unis et finirait par chasser les Etats-Unis d'Eurasie. Une telle alliance, selon le stratège, pourrait se faire entre la Russie, la Chine et éventuellement l'Iran. Brzezinski avait des craintes particulières au sujet de la Russie, car son territoire lui permet d'opérer à la fois en Europe et en Extrême-Orient, mais aussi parce qu'elle est une puissance nucléaire.
Les universitaires libéraux ont joué leur rôle dans la politique d'expansion vers l'est de l'UE et de l'OTAN : ils étaient profondément ancrés dans l'idée que les États-Unis étaient destinés à apporter la liberté, la démocratie et la prospérité au monde entier. Le modèle américain de capitalisme et de démocratie avait réussi à résoudre les contradictions de l'histoire, ce n'était donc qu'une question de temps avant que ce modèle puisse être apporté au monde entier. C'est du moins ainsi que Francis Fukuyama l'a formulé, et beaucoup l'ont cru.
Ce n'est pas ce que pensaient les dirigeants russes ou de nombreux autres dirigeants dans le monde. Très tôt, Poutine a clairement indiqué que l'expansion de l'OTAN constituait une menace pour la sécurité de la Russie et il n'était pas disposé à tolérer la présence de membres de l'OTAN parmi les pays voisins. Cependant, la Russie ne pouvait rien faire non plus en 2004, lorsqu'un nouveau cycle d'élargissement est arrivé: cette fois, la Bulgarie, la Slovaquie, la Slovénie, la Roumanie et pas moins de trois pays voisins, la Lettonie, l'Estonie et la Lituanie (qui jouxte Kaliningrad), ont rejoint l'alliance. Mais la goutte d'eau qui a fait déborder le vase est arrivée en avril 2008 lorsque l'OTAN a déclaré sa volonté d'intégrer l'Ukraine et la Géorgie. Comme si cela ne suffisait pas, le mois suivant a vu le lancement officiel du Partenariat oriental, une initiative visant à établir des relations communes avec les pays d'Europe de l'Est sur la base de la promotion de valeurs, d'institutions et d'intérêts communs proclamés entre cette région et l'UE. Suite à une action militaire géorgienne dans deux régions séparatistes, la Russie est intervenue dans la zone et a soutenu les régions d'Ossétie du Sud et d'Abkhazie contre la Géorgie. Cette intervention russe aurait dû faire comprendre aux Occidentaux ce que Poutine pense de ses voisins qui ont manifesté leur décision de rejoindre l'OTAN.

À l'Ouest, cependant, les politiciens n'ont pas changé de cap et ont soutenu une "révolution colorée" en Ukraine qui a réussi à évincer le président pro-russe Ianoukovitch en 2014, tournant une fois de plus l'Ukraine vers l'Ouest. Le conflit a alors éclaté au Donbass, mais pas seulement là, mais dans presque toutes les régions russophones. Profitant de l'escalade, une Russie déterminée et active s'empare de la péninsule de Crimée. Malgré tout cela, loin de s'orienter vers une politique de négociations qui établirait la fin de la marche de l'OTAN vers l'est et définirait la neutralité de l'Ukraine, cette dernière a insisté sur l'intégration à l'Occident et l'OTAN a déclaré avec insistance que chaque pays pouvait décider de ce qu'il voulait faire. Les événements se sont radicalisés lorsque le Kremlin a pressenti l'intégration imminente de l'Ukraine dans l'alliance et que des missiles seraient déployés sur son territoire.
Le défi de l'ordre libéral international
Aussi important qu'il soit d'analyser la concurrence géopolitique sur l'échiquier eurasien, ce fait à lui seul n'explique pas entièrement les intentions de la Russie, car dans un aspect plus vaste, Vladimir Poutine remet en question l'ordre international libéral dirigé par les États-Unis. Le président russe a critiqué à plusieurs reprises les valeurs incarnées par l'Occident, notamment dans ses discours au Club Valdai. En outre, le défi est même logique, étant donné que la Russie, en tant qu'État revigoré, vise à revenir au pouvoir en proposant ouvertement la fin de l'ordre international actuel pour donner naissance à un ordre qui lui serait plus favorable. Poutine souhaite qu'un tel ordre lui permette d'avoir son mot à dire sur les questions importantes de politique internationale, en particulier les questions de sécurité. En outre, le Kremlin ne souhaite pas simplement adapter les changements à l'ordre international actuel, mais les dirigeants russes veulent en construire un qui tienne compte des nouvelles réalités de la répartition mondiale du pouvoir. Au fil du temps, il semble devenir évident que le monde évolue vers la multipolarité. Un commentaire sur ce point. La polarité du système international est donnée par sa structure, c'est-à-dire par la forme que prend le système international. C'est-à-dire que même si le système international est toujours un et le même, il peut prendre différentes formes en fonction des différentes répartitions des capacités matérielles: avec une seule puissance hégémonique, il sera unipolaire; avec deux puissances, bipolaire; avec trois puissances ou plus, multipolaire...
Cependant, après la fin de la bipolarité et la chute de l'URSS, le "moment unipolaire" est né lorsque les États-Unis sont devenus la seule superpuissance. Ainsi, ce pays s'est consacré à étendre ses propres valeurs et institutions au monde entier, dans ce qui semblait être le triomphe du libéralisme à l'échelle mondiale. C'est dans ce contexte de triomphalisme qu'est née la théorie de la paix démocratique, une théorie qui affirme que les démocraties ne se font pas la guerre, de sorte que le modèle démocratique et capitaliste occidental devait être élargi afin de parvenir à la paix internationale. Et cette expansion de la démocratie libérale était positive pour les États-Unis pour deux raisons. D'une part, s'il est vrai que les démocraties ne se font pas la guerre, quelle meilleure contribution à la paix internationale que de faire de tous les États des pays démocratiques ? Mais d'un autre côté, étant un ordre pacificateur, il a été interprété que les Américains eux-mêmes seraient plus en sécurité chez eux, puisqu'ils ne seraient pas "forcés" de s'impliquer à l'étranger et pourraient s'occuper de leur propre politique intérieure. Les libéraux américains des années 1990 ont défendu l'expansionnisme de leur propre modèle d'ordre, identifiant l'intérêt international pour la paix à leur propre intérêt national. Il se trouve que les puissances ont tendance à rechercher des ordres internationaux qui leur profitent, et ces ordres naissent comme une expression de la façon dont chaque peuple conçoit la réalité. C'est-à-dire que de chaque esprit national naît une vision du monde à partir de laquelle est projetée une manière de comprendre comment le monde devrait être ; appliquée à la politique internationale, c'est le substrat sur lequel sont conçus les ordres internationaux, et ce sont les puissances qui ont la volonté et les capacités matérielles de les construire et de les maintenir.
Mais les Russes n'ont pas la même vision du monde que les Américains. L'ordre international actuel repose sur une philosophie libérale, une philosophie qui considère l'individu comme l'alpha et l'oméga de tout ordre social. Fondée sur une confiance aveugle dans le pouvoir de la raison, cette philosophie part du principe que, tôt ou tard, toute l'humanité atteindra le même objectif dans le futur; le progrès est inéluctable. Mais alors que le progrès avance, il est évident que les individus ont des religions, des idées ou des intérêts différents, alors comment résoudre le problème de la coexistence tout en atteignant le but final de l'histoire? Avec un contrat né de volontés libres, rationnelles et suffisamment informées. C'est ainsi que sont nés le contractualisme, la pensée "sociétale" et les régimes démocratiques modernes. Transposez ce même raisonnement à la politique interétatique et vous obtenez l'ordre libéral international, un ordre fondé sur la promotion des droits de l'homme, de la libre économie et de la démocratie.
Bien sûr, le créateur, le soutien et le garant de cet ordre était et est toujours les États-Unis, qui ont leur propre façon de comprendre ces facteurs. Ainsi, avec l'ascension des États-Unis au sommet de la puissance mondiale, les droits de l'homme sont interprétés de manière individualiste, en prenant pour acquis l'existence d'atomes rationnels et libres guidés par l'intérêt personnel. L'économie de marché implique la déréglementation, la limitation de l'interventionnisme de l'État et la recherche acharnée du profit. Enfin, la démocratie se comprend non pas en termes de "volonté du peuple", mais dans l'articulation d'un système de contrepoids entre des pouvoirs équivalents, avec un système politique dont la représentation est monopolisée par les partis politiques et où l'alternance dans l'exercice du pouvoir est recherchée. Pour les États-Unis, toutes ces choses étaient positives lorsqu'ils ont décidé de les étendre dans les années 1990, car lorsqu'elles sont appliquées à la politique internationale, elles créent "un monde basé sur des règles". Mais bien sûr, les organisations et les institutions qui étaient censées faire respecter ces règles ont été largement créées et façonnées par les États-Unis eux-mêmes... il en a été de même pour l'ONU, le FMI, l'OMS, l'OTAN et ainsi de suite.
C'est cette situation que la Russie conteste et veut changer. Ses valeurs ne conçoivent pas les individus repliés sur eux-mêmes en marge de la vie collective, ni l'État comme un acteur secondaire de l'économie. Et quelle valeur peut avoir la démocratie de type occidental dans la tradition autocratique de la Russie ? Il est inacceptable pour le Kremlin de continuer à participer à un monde fondé sur l'expansion d'un ordre qui, selon lui, ne les représente pas adéquatement. C'est pourquoi nous affirmons que l'Ukraine ne concerne pas seulement le sort des territoires. Il est certain que la géopolitique est la première clé pour comprendre les intérêts de l'État russe. Mais le point principal à noter est le défi lancé par Vladimir Poutine à l'ordre libéral international.
Une perspective américaine
L'Argentine doit calibrer ses décisions de politique étrangère à la lumière des deux aspects que nous avons évoqués : le retour de la politique de puissance entre les puissances, avec son cortège de tensions géopolitiques, et l'évolution vers un nouvel ordre international qui est en cours. Avant d'analyser l'impact de ces réalités, disons quelques mots sur la construction du pouvoir national. Quel que soit le scénario qui se dessine, notre pays doit profiter des tensions et des réalignements internationaux à venir pour renforcer sa puissance nationale et accroître sa liberté d'action. La question est simple: peu de pouvoir, peu d'options; trop de pouvoir, trop d'options. Tous les scénarios sont mauvais pour un État faible. Et la puissance nationale se construit en renforçant des attributs matériels tels que le territoire, la population, l'économie ou la capacité militaire; mais aussi en renforçant des attributs immatériels tels que la volonté nationale, l'éducation de la société, la qualité des institutions ou la professionnalisation des élites dirigeantes. Vient ensuite, bien sûr, la capacité de ceux qui dirigent un État à traduire ce pouvoir en stratégies efficaces et efficientes pour atteindre les objectifs nationaux.

Passons maintenant aux deux questions prioritaires que nous avons identifiées. En ce qui concerne les tensions géopolitiques actuelles, un point est évident, mais mérite d'être souligné: l'échiquier fondamental de la compétition entre les puissances continuera d'être l'Eurasie, et notre pays et l'Amérique du Sud n'y sont pas. Les pays de notre région (et nous faisons expressément référence à l'Amérique du Sud) devraient avoir une politique cohérente et unifiée par rapport à ce scénario. Il est encore plus important de comprendre que l'Argentine ne doit pas adopter une stratégie d'alignement automatique sur l'un des acteurs du conflit. Il n'y a aucune raison de s'impliquer en "prenant parti" définitivement pour l'un ou l'autre des concurrents, car leurs principaux intérêts stratégiques se situent précisément là-bas en Eurasie, et non ici en Amérique du Sud. Par conséquent, il peut être commode pour eux de nous avoir comme alliés aujourd'hui, mais pas demain.
Un autre point, en rapport avec la concurrence sur l'échiquier eurasien, est qu'il n'est pas dans l'intérêt des États de notre région qu'une alliance anti-hégémonique expulse définitivement les États-Unis d'Eurasie, si cela peut se produire un jour. Une puissance nord-américaine expulsée du plateau de jeu principal (ou dont l'influence serait réduite à un niveau secondaire) se retirerait du grand continent eurasien, réévaluerait le concept de l'hémisphère occidental et tournerait ses principales ressources diplomatiques et militaires vers notre région ; dans cette nouvelle réorganisation, les États-Unis chercheraient à créer une nouvelle architecture de sécurité hémisphérique afin de protéger leurs intérêts et nos gouvernements seraient certainement confrontés à une pression encore plus forte de la part des États-Unis. Le meilleur scénario, pour les pays de notre Amérique, est celui d'une Amérique retirée de notre région, constamment et principalement impliquée dans l'Eurasie luttant pour l'hégémonie contre d'autres puissances.
En ce qui concerne l'émergence potentielle d'un nouvel ordre international, le fait que la Russie - ou toute autre puissance - défie les États-Unis est en soi une bonne nouvelle. Pour l'Argentine et les pays de notre région, les politiques interventionnistes américaines ont presque toujours laissé de mauvais souvenirs et, dans notre cas, seulement de mauvaises nouvelles. Nous n'avons pas bénéficié de l'alignement automatique dans les années 1990, bien au contraire. Et les architectures sécuritaires et économiques que les États-Unis ont créées, telles que la TIAR, le FMI, la BM, par exemple, ont été inefficaces ou ont rendu notre situation bien pire. Un ordre international dans lequel il y a plus d'acteurs importants sera plus positif pour des pays comme l'Argentine, car il y aura plus d'alternatives pour rassembler des intérêts ou chercher des ressources. Tout cela tient également compte du fait que la Russie tient tête à l'OTAN, une alliance militaire dont l'un des membres usurpe une partie de notre territoire, ce qui devrait faire réfléchir les politiciens argentins sur la manière de planifier la diplomatie et la défense nationale en ce qui concerne l'Atlantique Sud.
Mettons tout de suite les choses au clair : les États-Unis pensent aussi à l'évolution vers un monde multipolaire [3]. À Washington, on accepte de plus en plus le déclin des États-Unis en tant que puissance hégémonique, qui est perçu comme le produit d'une nouvelle répartition des capacités au niveau mondial. Il faut donc comprendre que nous ne sommes pas face à une compétition entre des Etats-Unis qui veulent revenir à l'unipolarité et une Russie ou une Chine qui promeuvent la multipolarité : nous sommes en présence de différentes manières de vouloir organiser un système international avec plus d'une puissance dans un futur proche; il se peut même qu'à long terme il n'y en ait que deux. On ne sait pas encore exactement à quoi ressemblera la nouvelle répartition du pouvoir.
Maintenant, pour revenir à notre pays et à notre région: nous devons construire une puissance nationale qui soit également orientée vers l'intégration avec le reste des pays d'Amérique du Sud. Le grand espace sud-américain doit devenir un acteur significatif reconnu et qui obtient une représentation adéquate et équitable dans l'ordre international à venir. En ce qui concerne la lutte qui se déroule en Eurasie, il convient d'élaborer des stratégies visant à tirer le meilleur parti de la marge de manœuvre qui subsiste toujours dans la politique internationale lorsqu'il y a plus d'une puissance. Lorsqu'il n'y a qu'une seule puissance hégémonique, comme ce fut le cas dans les années 1990, les options de politique étrangère sont considérablement réduites. Pour un pays comme l'Argentine, un monde multipolaire est en soi plus bénéfique qu'un monde unipolaire. Non pas parce qu'un système international avec plusieurs "pôles" est plus juste et plus pacifique qu'un système avec une seule puissance au sommet du pouvoir ; en effet, un monde multipolaire est peut-être plus instable et insécurisé, précisément parce que c'est un monde avec plusieurs acteurs concurrents. Non seulement cela, mais sous cette compétition, il y aurait une multiplicité d'États qui se disputeraient l'avantage. C'est pourquoi, pour notre pays, la neutralité active est la meilleure solution : une position qui évite de s'aligner automatiquement et en permanence sur un seul acteur, mais qui cherche activement à maximiser le pouvoir et à obtenir des ressources en profitant des tensions entre les grandes puissances. C'est un monde en transition où plusieurs alternatives vont émerger. Il s'agit d'en tirer parti.
*Andrés Berazategui, membre de Nomos, est titulaire d'une licence en relations internationales de l'Universidad Argentina John F. Kennedy, et d'un master en stratégie et géopolitique de l'Escuela Superior de Guerra del Ejército (ESGE).
Notes:
[1] Voir George Kennan, "A fateful error", dans The New York Times, 5 février 1997.
[2] Dans son livre The Great World Chessboard. La supremacía estadounidense y sus imperativos geoestratégicos, Paidem
Impératifs géostratégiques, Paidós, Barcelone, 1998.
[3] Voir, par exemple, l'article "Le nouveau concert des puissances. Comment prévenir les catastrophes et promouvoir la stabilité dans un monde multipolaire", publié le 23 mars 2021 dans Foreign Affairs, par Richard N. Haass et Charles A. Kupchan. Haass est président du Council on Foreign Relations.
17:01 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, relations internationales, politique internationale, argentine, amérique latine, amérique du sud, amérique ibérique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 19 avril 2022
La Russie, les Etats-Unis et la Chine dans une conjoncture de conflit. Quels sont les objectifs prioritaires de la "nouvelle guerre froide"?

Puisque la politique internationale a été tenue depuis toujours comme politique de puissance, Macht-Politik dans la culture allemande et Power politics dans le monde anglo-saxon, la conversion idéaliste des Etats en porteurs d'avenirs pacifiés n'a concerné que l'Europe post-moderne, héritière du droit des gens, des empires universels du passé et du cosmopolitisme des élites intellectuelles des XVIIIème et XIXème siècles.
La morphologie triadique du système multipolaire actuel distingue toujours entre objectifs historiques et objectifs éternels et accorde à la géopolitique et à dialectique de l'antagonisme la tâche de distinguer entre types de paix et types de guerres. En fonction des rôles joués par les grands acteurs historiques nous passerons en revue - et à des seules finalités de connaissance,- les différents types de paix, car ils déterminent non seulement les types de guerre, mais également les stratégies générales des acteurs majeurs du système.
Pour l'Europe l’Idéal-type de paix dans un système planétaire est une paix d'équilibre entre l'Amérique et la Russie, puisque le continent est situé à la jonction du Rimland et du Heartland, entre la terre centrale et la grande île du monde ; pour la Russie une paix d'empire, fédératrice de plusieurs peuples, de plusieurs terres et de multiples confessions religieuses. Une paix d'Hégémonie est celle qui convient au choix de l'Amérique, vouée, par sa mission universelle, à exercer son pouvoir sur les trois Océans, Indien, Pacifique et Atlantique, en respectant la souveraineté des pays de la bordure des terres. Pour l'Empire du milieu, le mandat du ciel situe le meilleur type de paix entre une architecture régionale équilibrée et une vision planétaire à long terme, déterminée en partie par sa position géopolitique et en partie par la rivalité qui découle de sa culture et du système mondial des forces. Quant à la crise ukrainienne et à son issue, la superposition de trois types d'hostilité et donc d'insécurité alimentera un conflit de longue durée. S'y entremêlent de manière contrastée:
- Une hostilité/insécurité de la Russie vis-à-vis l'Otan et des Etats-Unis.
- Une inimitié de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Une ambiguïté de la Chine quant à la pression américaine sur les sanctions occidentales, concernant l'économie russe et ses conséquences et ces incertitudes influent sur le dilemme de fond de notre époque, "affrontement ou condominium" sino-américain, auquel est subordonnée la paix mondiale.
Dans cette conjoncture de changement, le continent européen, sans hauteur symbolique et historique devient le reflet du type d'ordre qui règne dans le monde selon la formule d'une "Nouvelle guerre froide", contestée par certains (G. H. Soutou).
Les objectifs prioritaires de la "Guerre Froide" de l'âge de la bipolarité. Une approche comparée
Le conflit entre les deux blocs de l'époque de la bipolarité n'était qu'un aspect du processus de transformation et de passage du capitalisme au socialisme, qui se voulait révolutionnaire. Il conjuguait tous les aspects de la vie collective des peuples et des nations et excluait des accords durables comme celui d'une coexistence pacifique entre les deux systèmes. Tout devait se passer suivant le primat du conflit et guère de la paix, selon les lois inexorables et objectives de l'histoire.
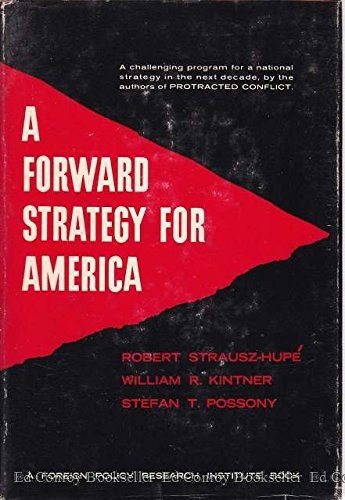 Cependant l’objectif stratégique de l'Occident, selon un courant de pensée américain offensif, représenté par Robert Strausz-Hupé, William R. Kintner et Stefan T. Possony et exposé dans le livre "A forward strategy for America", devait exiger comme "objectif prioritaire, la préservation et la consolidation de notre système politique, plutôt que le maintien de la paix". Selon ce courant, la survie du régime politique des Etats-Unis, n'autorisait "d'autre choix qu'une stratégie à la Caton": "Carthago delenda est !". La coexistence de deux empires rivaux était conçue comme une cause d'instabilité profonde, qui devait déboucher fatalement sur une guerre inexpiable. La situation multipolaire d'aujourd'hui est-elle comparable à celle de l'époque? Change-t-elle sur le fond, à l'essence de la rivalité et à la structure de l'hostilité déclarée? La précarité apportée à la sécurité de la Russie est-elle le premier pas d'une stratégie générale d'élimination d'un adversaire, pour qu'il ne s'allie au troisième, en vue d'un guerre totale, difficile à gagner ?
Cependant l’objectif stratégique de l'Occident, selon un courant de pensée américain offensif, représenté par Robert Strausz-Hupé, William R. Kintner et Stefan T. Possony et exposé dans le livre "A forward strategy for America", devait exiger comme "objectif prioritaire, la préservation et la consolidation de notre système politique, plutôt que le maintien de la paix". Selon ce courant, la survie du régime politique des Etats-Unis, n'autorisait "d'autre choix qu'une stratégie à la Caton": "Carthago delenda est !". La coexistence de deux empires rivaux était conçue comme une cause d'instabilité profonde, qui devait déboucher fatalement sur une guerre inexpiable. La situation multipolaire d'aujourd'hui est-elle comparable à celle de l'époque? Change-t-elle sur le fond, à l'essence de la rivalité et à la structure de l'hostilité déclarée? La précarité apportée à la sécurité de la Russie est-elle le premier pas d'une stratégie générale d'élimination d'un adversaire, pour qu'il ne s'allie au troisième, en vue d'un guerre totale, difficile à gagner ?
Le triple rôle de la Russie, national, eurasien et mondial
La rivalité est-elle compatible avec la paix, indépendamment du rôle historique d'un acteur de l'importance de la Russie ? Cet immense pays remplit aujourd'hui un triple rôle, national ou de régime, régional ou eurasien, et mondial ou de système. En fonction du premier, il constitue un modèle spécifique d'autocratie, porteuse d'une Weltanchauung anti-occidentale, qui doit résoudre en permanence le problème de la légitimité du pouvoir et du consensus des opinions; en rapport au deuxième, un facteur de stabilité et d'équilibre en Eurasie, convoité par le grand Turc. Par référence au système planétaire, un type d'ordre, de meneur du jeu et de leadership, qui apparaît indispensable contre l'entreprise multipolaire et désagrégeante de l'hégémonie américaine. Sur sa face européenne la menace d'une alliance germano-russe ferait de Moscou une candidate moderne à l'empire universel, ôtant la liberté des pays d'Europe centrale; sur l'échiquier de la jonction du Rimland planétaire et du Heartand continental, la Turquie et l'Iran se disputeraient le rôle d'alliés privilégiés pour un condominium, excluant l'hégémon de la terre centrale et agrégeant l'Inde à une entreprise de long terme. Et, dans la profondeur des espaces et du temps, vers les bordures des deux océans, indien et pacifique, la Russie se joindrait à l'Empire du milieu pour donner vie à une civilisation renouvelée et non décadente s'imposant sur la multiplicité des centres asiatiques de décision. Ce rôle de la Russie est à la fois ambivalent, entrainant et dangereux, pour l'Est et pour l’Ouest. Pour l'ensemble des menaces actuelles, politiques, idéologiques et militaires, la stratégie de Caton, définie dans les années soixante, demeure-t-elle toujours valable. "Carthago delenda est!". L'Occident et l'Otan recommandent l'asphyxie de l’économie russe, en pratiquant au même temps la stratégie de la provocation, de l'usure et de l'escalade militaire.
Se faire justice soi même
Puisque la théorie des relations internationales part de l'idée que chaque unité politique a le droit, en dernier recours, de se faire justice d'elle -même, l'enjeu de la décision finale sur la paix et la guerre est défini par le Chef de l'Etat- Chef de guerre. Comment les opérations militaires engagées sur le terrain des combats, peuvent-elles être reconduite à la logique de la négociation et du compromis? Et, faute d'univocité et d'objectifs communs, qui peut jouer, à une échelle diplomatique, le rôle du médiateur et de l’arbitre?
Qui peut juger enfin de la pertinence et satisfaction des objectifs atteints? La stratégie du Blitz initial imputée au Chef d'Etat-Chef de guerre du pouvoir perturbateur part du principe de la primauté du système interétatique, ce qui exclut la prédominance explicative du facteur économique. En effet la guerre d'Ukraine est une guerre politique et pas une guerre personnelle, d'homme à homme, soumise à l'idée d’une punition ou d'un crime.
Le système interétatique est un système dans lequel s'intègrent les Etats, dont aucun n'est soumis à un pouvoir central de contrôle et qui s'organise autour du principe de survie. En ce sens le recours à des fictions comme celles de la paix par la morale ou de la paix par le droit, voilent les relations d'inimitié, idéologiques ou géopolitiques. A ce propos, le changement de stratégie opérationnelle pratiquée par l'Etat major russe, après l'attaque initiale et le siège des métropoles, a été de consolider l'emprise sur la mer d'Azov et de lier plus étroitement la Russie à la Crimée, soustrayant celle-ci et l'intégralité de la Mer Noire, au contrôle de l'Otan. Par ailleurs et à propos de la conduite de terrain, tactique ou stratégique, le principe de solidarité des Etats-nucléaires face au risque paroxystique de l'atome, se fonde sur le principe du concept "d'acteur rationnel" et exclut toute notion d'effets pervers, par vice mental ou par égarement de la raison, qui constitue un des sujets de prédilection de la communication psycho-politique occidentale.
Inimitié et hostilité
Or, l'enjeu du conflit ukrainien, de nature géopolitique et sécuritaire, oppose deux frères-ennemis, qui ont beaucoup de choses en commun (ethnie, religion, histoire) et appartiennent à une même zone de civilisation, se réclamant des mêmes principes, poursuivis alternativement par le dialogue ou par le combat. Le dialogue a donné lieu à l'intérieur de l'aire culturelle de l'ancienne Byzance à l'antithèse classique de l'Etat et de l'Eglise sous la forme du césaro-papisme, come subordination du pouvoir idéologico-religieux au pouvoir étatique et à l'hybridation bicéphale de la souveraineté encore effective sous le régime soviétique. Le combat a marqué la division de l'Ukraine en deux zones culturelles, lors de la deuxième guerre mondiale, exploitées intensément par les médias mainstream et par leurs efforts de propagande.
Persuasion et subversion à l'heure du conflit ukrainien
L'effort constamment entretenu pour dresser les opinions contre leurs élites, (oligarques à l'Est, et anti-souverainistes à l'Ouest), désigne un mode d'action qui a pour but une conversion des esprits au profit de la cause défendue par l'un ou l'autre des deux belligérants. En l'absence d'un objectif commun d'ordre et de stabilité, visant à délimiter des zones d'influence légitimes, la mobilisation mondiale autour du conflit, acquiert la signification d'un choix entre globalisme occidental et souverainisme oriental (Russie et Chine) et cette signification a pour origine l'hétérogénéité des intérêts et des cultures des deux camps, démocratique en Occident et autocratique en Eurasie. L'objet de dispute demeure cependant la sécurité, et, en amont, la préservation d'une certaine conception de l'aire civilisationnelle, de la société et de ses mœurs. La propagande forcée du temps de la bipolarité est devenue guerre de l'information, brouillard de Fake news et théâtre de cyberwars. L'un et l'autre camps considèrent cette propagande comme une entreprise de subversion et tiennent la sienne propre pour persuasion.
Homogénéité et hétérogénéité des deux camps
Du point de vue des régimes constitutionnels pluralistes, l'hétérogénéité des structures politiques et sociales des pays de l'Ouest, favorise la liberté d'expression et la compétition des idées, tandis que l'homogénéité organisée, entretenue par les régimes autocratiques, de Russie ou de Chine, décourage la critique ou l'opposition et la propagande apparaît comme l'une des armes de l'arsenal politique du pouvoir en place. Les campagnes multiples contre les maux de la société post-moderne, par lesquels les opposants aux régimes occidentaux, s'efforcent de gagner des adeptes, sont amplifiés par une militance plus au moins déguisée, mais présentés comme des infiltrations intellectuelles du camp d'en face. Cette infiltration ne réussit pas à éliminer l'engagement du camp adverse, se situant entre le pouvoir et le peuple.
Dans le cadre du conflit ukrainien ces infiltrations sont emphatisées ou suscitées de toute pièce pour dénigrer le régime adverse. Ainsi les trois voix de la Triade (Chine, Occident et Russie), sont différemment audibles, car elles sont différemment ostracisées et l'adhésion intellectuelle et morale aux régimes du Heartland (Chine, Russie et Iran), ou du Rimland (Amérique, Europe, Grande Bretagne et Indopacifique ), est exaspérée et poussée aux extrêmes par la dialectique de la subversion et de la persuasion des deux camps, qui se rejettent réciproquement l'accusation d'agresseurs, de dangers publics et de criminels de guerre. Chacun des deux justifie son combat au nom de deux conceptions de la géopolitique actuelle qui oppose l'eurasisme au globalisme et donc le souverainisme du premier à l'individualisme démocratique du deuxième. Or, si , dans ce dialogue péremptoire et confus, la persuasion consiste à convaincre, la subversion et le langage de la passion attisent la flamme du mécontentement et incitent à la rébellion et à la révolte. Cependant la subversion suppose l'existence d'agents dormants et de structures opérationnelles, aptes à la transformation du mécontentement en rébellion et de la rébellion en révolte, puis, de celle-ci en révolution, de couleur ou pas et, à l'extrême en coup d'Etat de Palais A ce point, ce qui est décisif, ce sont la prise de pouvoir et le changement de régime, effectués grâce aux alliances militaires, supportées de l'extérieur par le pouvoir en place.
Les Etats-Unis et le "Regime change"
Une des finalités de l'action politique contemporaine est de mettre en œuvre la démocratie, de dénigrer le pouvoir autoritaire et d'assurer la stabilité du pouvoir. Une dégradation des conditions de vie ou un affaiblissement du soutien conscient et intentionnel du gouvernement peuvent inverser très rapidement les bases sociales ou le socle idéologique du pouvoir établi. Pour rappel, la politique américaine du "regime change" a été le cadre théorique de l'interventionnisme militaire dans plusieurs pays jugés faibles, au nom des intérêts stratégiques des Etats-Unis et de politiques d'incitation à des réformes politiques. Or, dans le cadre de sa visite à Varsovie du 27 mars dernier, le Président J. Biden, n'a pas hésité à proclamer, dès son arrivée, que le départ de Poutine du pouvoir, n'était pas un but de guerre pour les Etats-Unis, pendant que la presse anglaise formulait l'hypothèse qu'un insuccès militaire de l'armée russe condamnerait le Chef du Kremlin à quitter le pouvoir dans les deux ans. Ainsi dans une campagne orchestrée autour des résultats obtenus par l'invasion de l'Ukraine, de sa surprise stratégique et de son enlisement présumé, l'ex-oligarque et opposant russe Mikhail Khodorkovski, après 10 ans de prison, purgés en Sibérie pour "fraude fiscale", en appelle à l'histoire, pour prophétiser une chute prochaine de Poutine, comme une constante de l'histoire russe, en cas d'échec politique ou militaire. La guerre prochaine,- dit-il - dans une interview accordée au Figaro du 29 mars dernier, contre la Pologne ou un pays balte, scellera une prise de risque supplémentaire, marquant un décalage entre la vision des occidentaux et celle de Poutine.
A titre de rappel la politique d'Obama/Bush de "regime change", recherchant une ligne directrice pour résoudre le dilemme entre démocratie et stabilité, ou de l'actuelle administration démocrate pour articuler une stratégie globale et définir une doctrine pour le paix en Europe et dans le monde, a été de construire un ordre international pacificateur, en incitant les régimes en place à des réformes politiques et socio-économiques. Cependant, en partant de perspectives historiques antagonistes, les objectifs opposés de l'Occident et des puissances de l'Eurasie et du Pacifique, peuvent-ils trouver une conciliation dans leurs intérêts et stratégies divergentes? Ou bien, en revanche, ne contribuent-ils pas à frayer la voie des seules puissances montantes, visant à définir un nouvel ordre international plus adapté à l'époque de la multipolarité et, à l'aide de celui-ci, à définir un système post-wesphalien plus stable et une conception plus conséquente de la démocratie?
Bruxelles le 31 mars 2022.
19:17 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ukraine, chine, états-unis, russie, politique internationale, géopolitique, relations internationales |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Unipolarité, bipolarité, multipolarité et la guerre d'Ukraine

Unipolarité, bipolarité, multipolarité et la guerre d'Ukraine
Vers une multipolarité de plus en plus complexe: scénario pour l'avenir
Enric Ravello Barber
Source: https://www.enricravellobarber.eu/2022/04/unipolaridad-bipolaridad-multipolaridad.html#.Yl5zFNPP2Uk
Derrière la prétendue fin de l'histoire proclamée par le publiciste du Pentagone Francis Fukuyama, se cachait une aberration philosophique : sortir l'homme de son habitat, celui de l'Histoire, entendue comme son "faire-dans-le-monde", et ouvrir la porte au post-humanisme qui nous apparaît déjà aujourd'hui comme une réalité de fait. Cette entorse à l'histoire a signifié la mise en œuvre urbi et orbi de ce que les occupants successifs de la Maison Blanche, sans la moindre dissimulation, ont appelé le Nouvel Ordre Mondial - nous insistons sur le mot "Monde" - : c'est-à-dire l'unification du monde sous la direction des Etats-Unis, ou, en d'autres termes, un monde unipolaire, c'est-à-dire avec un seul centre de pouvoir : Washington.
Les erreurs stratégiques des administrations américaines successives, toujours sous inspiration néo-con unipolaire, ont donné à la Russie le temps nécessaire pour se reconstruire en tant que puissance militaire et la Chine a émergé comme une puissance mondiale de premier ordre, non seulement en tant que puissance militaire mais aussi en tant que puissance globale (économique, stratégique, industrielle, technologique et diplomatique).
La Chine est devenue le principal acteur de la deuxième vague de mondialisation. Ce n'était qu'une contradiction apparente pour une puissance communiste de prôner la réduction de tous les obstacles au commerce mondial, puisque la vente de ses produits manufacturés sur les marchés mondiaux était la principale cause de sa croissance en tant que puissance.
L'essor de la Chine annonce en quelque sorte la fin du rêve unipolaire des Etats-Unis et montre une nouvelle réalité bipolaire. Quelques décennies après la chute de l'URSS, le monde vit à nouveau la lutte pour l'hégémonie planétaire entre deux puissances: les États-Unis et la Chine.
La Russie, devenue le troisième acteur mondial, propose un pas en avant, une nouvelle correction au Nouvel Ordre Mondial de Washington: le monde multipolaire. La Russie constituerait un troisième pôle géopolitique, une situation qui se conjuguerait également avec l'émergence de puissances régionales qui fragmenteraient davantage le plan de domination mondiale de la Maison Blanche: la Turquie, l'Iran et l'Inde joueraient ce rôle.
Dans cette réalité, l'Europe, le non-sujet géopolitique par excellence, pourrait cependant jouer un rôle décisif - comme l'ont constaté certains de ses dirigeants. Dans ce contexte multipolaire, l'Europe devrait s'émanciper de sa soumission aux États-Unis et devenir un autre centre de pouvoir, capable d'agir sur la scène internationale selon ses propres dynamiques et intérêts, de plus en plus opposés et divergents de ceux de la métropole colonisatrice Stars and Stripes. Et pour cela, l'une des conditions nécessaires - de la culture à l'énergie - serait une synergie entre l'Europe et la Russie, qui renforcerait le rôle de ces deux réalités et, partant, remettrait en question et diminuerait celui des États-Unis.
Aujourd'hui, tous ces scénarios sont en jeu dans la guerre d'Ukraine. Les États-Unis, qui provoquent depuis des années des situations inacceptables pour Moscou, voient dans cette guerre la possibilité ultime de couper le rapprochement et la collaboration croissante entre la Russie et l'Allemagne - dont le gaz est l'un des éléments clés - et de détruire ainsi l'option de ce troisième pôle et la construction d'un monde multipolaire: son premier objectif est d'isoler Moscou de ses partenaires géopolitiques potentiels, le second est de détruire la Russie en tant que puissance et de réduire encore l'UE au statut de colonie. C'est pourquoi elle est aujourd'hui la principale intéressée à prolonger la guerre en Ukraine, afin que Washington regagne du terrain dans une logique unipolaire. La Chine joue une fois de plus son grand atout diplomatique, la patience, l'objectif est aussi un affaiblissement progressif de la Russie et son éloignement de l'Europe, une Russie faible et isolée dépendrait de plus en plus de sa relation avec Pékin, ce qui ferait de la Chine à nouveau la seule puissance disputant la domination du monde aux Etats-Unis (logique bipolaire). Une Russie renforcée, confortée dans son prestige diplomatique et militaire, renforcerait la logique multipolaire, une logique que certains dirigeants européens tentent de soutenir dans le peu de marge de manœuvre dont ils disposent ; le refus d'inclure le gaz et l'énergie dans les sanctions contre la Russie est la preuve de cette réalité.
En bref, l'issue finale de la guerre en Ukraine marquera le scénario mondial des prochaines décennies, et surtout pour les Européens. Deux options s'offrent à eux : soit la non-existence géopolitique et la soumission absolue à l'atlantisme américain, soit l'émancipation géopolitique et l'articulation en tant qu'acteur international dans une réalité multipolaire, et nous le répétons, cette dernière pour une synergie - et non une soumission - avec une Russie puissante et antagoniste à l'unipolarisme de Washington et au bipolarisme de Pékin.
10:27 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : unipolarité, bipolarité, multipolarité, relations internationales, politique internationale, europe, affaires européennes, chine, russie, états-unis, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 15 février 2022
Dislocations politiques et révolutions systémiques
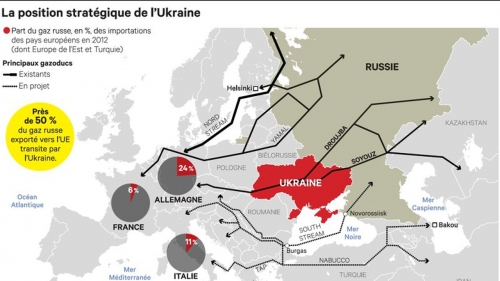
Dislocations politiques et révolutions
systémiques
La Russie, la Triade et l'onde de choc
de la crise ukrainienne
Irnerio Seminatore
Source: https://www.ieri.be/fr/publications/wp/2022/janvier/dislo...
TABLE DES MATIÈRES
AVERTISSEMENT
L'HÉGÉMONIE ET LA PUISSANCE GLOBALE
LA PUISSANCE GLOBALE ET SES ATTRIBUTS. LE LINKAGE, LA DIPLOMATIE TOTALE, L’ « ALLIANCE GLOBALE » ET LA « GUERRE HORS LIMITE »
STABILITÉ ET CRITIQUES DE L'HÉGÉMONIE
ASYMÉTRIE ET INCERTITUDES STRATÉGIQUES
DEREGULATION ET PRECARITE STRATEGIQUE DU SYSTÈME INTER-ETATIQUE
L’ERE DE L’ASYMETRIE
LES STRATÉGIES DES « COMBINAISONS CROISÉES »
STABILITE ET INSTABILITE DE L’ORDRE HEGEMONIQUE
HÉGÉMONIE ET EMPIRE
THEORIES DES CYCLES HEGEMONIQUES
STRAUSZ-HUPE ET LES REVOLUTIONS SYSTÉMIQUES
SECURITE ET SOUVERAINETE
L’UKRAINE, LA MER NOIRE ET LE THEATRE BALTIQUE
LA RUSSIE ET SES CONCEPTIONS POLITIQUES DE POLITIQUE ETRANGERE. LA RUSSIE EST ELLE A L’OFFENSIVE ?
L’HYPOTHESE D’INVASION DE L’UKRAINE ET L’ONDE DE CHOC PREVISIBLE
AVERTISSEMENT
Ce texte est divisé en deux parties, dont la première, à caractère académique, fait référence à l’Hégémonie et à ses interprétations et figure sur le site www.ieri.be
La deuxième partie, à orientation stratégique, s’insère dans le débat sur la sécurité européenne et sur les événements de dislocation politique en Europe de l’Ouest.
DEUXIEME PARTIE
SECURITE ET SOUVERAINETE
La grande majorité des analystes expriment la conviction que le système international actuel opère une transition vers une alternative hégémonique et ils identifient les facteurs de ce changement, porteur de guerres de haute intensité, dans une série de besoins insatisfaits et principalement dans l’exigence de sécurité, repérable dans les conflits gelés et dans les zones d’influence disputées (en Europe, dans les pays baltes, en Biélorussie et en Ukraine et, en Asie centrale, au Kazakhstan , au Kirghizistan, Afghanistan et autres points parsemés). L’énumération de ces besoins va de l’instabilité politique interne et de ses problèmes irrésolus, mais sujets à l’intervention de puissances extérieures, à l’usure des systèmes politiques démocratiques, gangrenés en Eurasie, par l’inefficacité ou par la corruption et, en Afrique, par le sous-développement, l’absence d’infrastructures modernes, la santé publique et une démographie sans contrôle. Cependant le trait prédominant et grave demeure l’absence, au niveau du système, d’un leadership mondial établi, capable d’imposer et de faire respecter les règles créées par lui-même.
Or, sans la capacité d’imposer la stabilité et de s’engager pour la défendre et sans pouvoir compter sur la relation symbiotique entre l’hégémonie déclinante (USA) et l’hégémonie montante (Chine), comme ce fut le cas entre la Grande Bretagne et les Etats-Unis, l'Hégémon ne peut exercer une prépondérance de pouvoir, par la diplomatie, l’économie, la coercition, ou la persuasion, que s’il ne garde pas une suprématie inégalée, dans au moins un aspect essentiel du pouvoir international (armée, organisation militaire, avancées technologiques, ou autres).
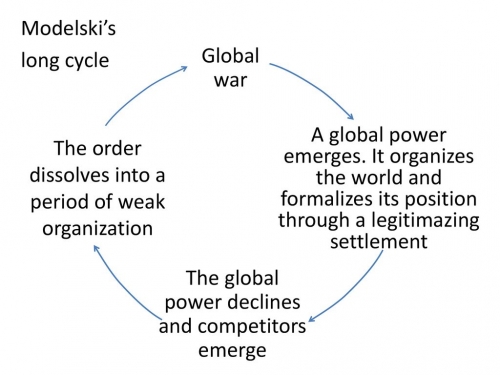
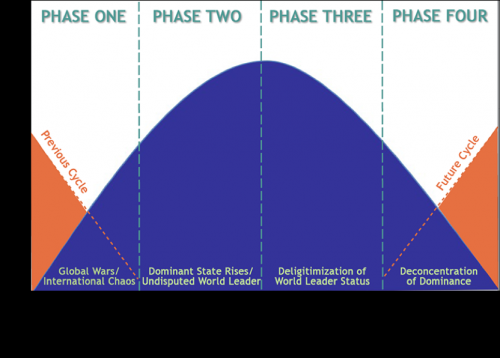
Fiche didactique sur le modèle de Modelski (en anglais): https://www.e-education.psu.edu/geog128/node/646
Or, selon le modèle de Modelski, les guerres majeures relèvent essentiellement de décisions systémiques. Elles doivent tenir compte de l’échiquier mondial, de la constellation diplomatique et du jeu des alliances, mais aussi de l’intensité et de la durée d’un engagement militaire éventuel ; en particulier de mauvais calculs et des pulsions irréfléchies et revanchardes de certains acteurs (Kiev -Donbass).
Un signe d’affaiblissement de la puissance hégémonique est constitué en outre par la considération, réelle ou symbolique, que l’acteur dominant n’est plus bénéfique ou déterminant pour les grandes puissances ainsi que pour la communauté internationale. La manifestation la plus évidente de ce retournement du poids international de l’Hégémon, repose sur le rabaissement diplomatique, la perte de rang et l’exclusion des négociations diplomatiques de ses alliés les plus proches (Union Européenne). C’est le signe d’une régionalisation contre-productive de la sécurité et de la distinction entre théâtres d’action futurs.
L’UKRAINE, LA MER NOIRE ET LE THEATRE BALTIQUE
Alors qu’aux frontières de l’Ukraine, une guerre de haute intensité ne peut être exclue et que les politiques extérieures de deux des puissances de la Triade (les Etats-Unis et la Russie) testent leurs volontés et déterminations réciproques en Europe centrale et orientale, la géopolitique de cette zone, apparait divisée, aux yeux de la Russie en deux théâtres, la Mer Noire et la Mer Baltique et comporte deux stratégies différenciées.
Dans la Mer Noire, depuis la guerre de 2008 entre la Russie et la Géorgie, puis à partir de 2014, avec le retour de la Crimée dans le giron de la mère-patrie, s’exerce une prédominance militaire russe, contrastée par les agissements militaires de la Turquie, gardienne des détroits du Bosphore et des Dardanelles selon la Convention de Montreux (1935). Moscou y montre une préoccupation légitime, face aux tentatives de l’Otan de prendre de l’ascendant dans son flanc Sud, en menaçant directement le cœur de la Russie et en brisant la continuité stratégique avec la Syrie, la Méditerranée, le Proche et Moyen-Orient et le Golfe.
Dans la deuxième en revanche, depuis 2010, l’hypothèse d’une projection des forces russes vers le théâtre de la Baltique (Estonie, Lettonie et Lituanie, auxquelles il faut joindre récemment la Finlande et la Suède), est l’un des scénarios d’affrontement prévisibles, selon le documentaire de la chaine britannique BBC, Word War Three. Inside the War Room. L’impact psycho-politique de cette hypothèse, prenant en considération le caractère indéfendable de ces pays par l’Otan et par l’Occident, a eu pour but d’influencer la politique régionale de l’Hégémon, sollicité à intervenir. Par la mise en œuvre d’une dissuasion par le déni, les pays baltes sont ainsi parvenus à influencer les orientations de l’Allemagne et des Etats-Unis, dans la conception de contre-mesures, politiques, économiques et énergétiques (blocage de Nord Stream 2), ainsi que le durcissement de la position de la Pologne.
A l’échelle globale, la surextension impériale de l’Hégémon, disposant de bases militaires dans plus de cinquante-cinq pays, produit d’elle-même des stress stratégiques et s’approche de plusieurs points de rupture.
Par ailleurs la vulnérabilité des pays de la Baltique, mise en exergue par un rapport de la Rand Corporation de 2016, a influencé le renforcement stratégique de la part de Moscou à Kaliningrad, dans la conception de sa défense du flanc occidental. L’extension des tensions et des intérêts en conflit entre la Russie, l’Otan et l’Europe occidentale, dans l’élargissement du cadre d’action de l’alliance atlantique et son rapprochement à Moscou, justifie la question capitale suivante : la Russie est-elle à l’offensive ? La réaction russe à ce rapprochement progressif de la menace est indéniablement liée, dans la pensée et dans les perceptions stratégiques russes au système de défense anti-missiles et engendre inquiétude et exacerbation pour la volte-face américaine consécutive à la dissolution de pacte de Varsovie.

Ces sentiments remontent aux promesses liées à l’effondrement de l’Union Soviétique et à la disparition illusoire de la notion d’ennemi. La réponse à cette question pose par ailleurs l’exigence d’un recours à des explications d’ordre historique et culturel, car, à l’opposé de la géopolitique occidentale, s’exprimant en termes de souveraineté juridique et abstraite, la géopolitique russe se conçoit en termes de rapports de forces et de zones d’influence. Autrement dit, dans le sens classique du réalisme politique. Les intérêts de sécurité de la Fédération russe vont jusqu’à la revendication de droits historiques (Crimée, étranger proche). Sur la base de cette clé de lecture, on ne sera pas surpris de la demande par Moscou, d’un engagement écrit pour une reconnaissance de ses droits. Ceux-ci sauraient interprétés comme une satisfaction de prestige pour la place de la Russie dans les affaires mondiales. Ainsi le déplacement de l’accent diplomatique sur un accord de principe justifierait paradoxalement les évidences de l’histoire et de la géographie, par l’abstraction formelle du droit, autrement dit sur le contraire d’une ligne politique traditionnelle, appuyée sur le réalisme, la méthode coercitive et l’image de la puissance.
L’HYPOTHESE D’UNE INVASION DE L’UKRAINE ET L’ONDE DE CHOC PREVISIBLE
Or, la puissance réelle et la balance mondiale du pouvoir renvoient au système international et au troisième pilier de la triade, l’Empire du milieu.
La montée en puissance de ce dernier apparait renforcée par l’offensive politico-diplomatique de l’Hégémon en Europe et provoque un rapprochement de la Russie et de la Chine. Le renforcement des liens entre la Russie et les pays d’Asie centrale est ainsi le corrélat continental de la stratégie océanique de l’Hégémon dans l’Indo-Pacifique, par la stipulation d’une alliance tripartite (AUKUS), entre les Etats-Unis, le Royaume Uni et l’Australie, en fonction antichinoise. Ce Traité actualise la politique du containment de la guerre froide, celle des puissances de la mer contre les forces militaires de la masse continentale, solidaires du même enjeu.
Ainsi, la modification régionale des conditions de sécurité en Europe, en apparence irréversible, sera le détonateur d’une onde de choc, qui transformera la configuration politique du continent et la balance mondiale, modifiant la hiérarchie de pouvoir au sein de la Triade et plus en général la multipolarité planétaire. L’instabilité du système internationale en sera affectée et convergera avec force dans la révolution systémique de l’âge moderne, décrite par Strausz-Hupé.
Bucarest le 27 janvier 2022
20:14 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : irnerio seminatore, politique internationale, relations internationales, géopolitique, révolutions systémiques, sciences politiques, politologie, théorie politique, europe, états-unis, russie, chine, asie, affaires européennes, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 21 janvier 2022
Stabilité contestée et guerres hégémoniques
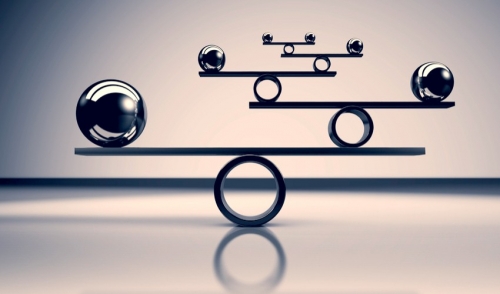
Stabilité contestée et guerres hégémoniques
Conflits limités ou affrontement global ?
Irnerio Seminatore
Source: https://www.ieri.be/
Stabilité contestée et dislocation de l'ordre
Réalisme et interdépendance en leur portée explicative
Geist, élites et leadership
Rivalité systémique
Vision régionalisée de la sécurité et politique d'alliances
Crise ukrainienne. Conflit limité ou affrontement global?
STABILITÉ CONTESTÉE ET DISLOCATION DE L’ORDRE
Il peut apparaître paradoxal de parler d'hégémonie établie, dans une situation internationale turbulente et chaotique, en Europe, en Afrique et en Asie, lorsque s’aggravent les signes d’une dislocation progressive de l’ordre existant et se précisent les prolégomènes d'un conflit de grande intensité et de portée systémique.
Avec l'effondrement de l’URSS et la brève période d’unipolarisme américain, s’est mis en place progressivement un système d'interactions non-hiérarchiques, où le parcours incertain de l’Amérique a privé le monde d’un leader incontesté, capable d’imposer un arbitrage planétaire. Ce phénomène signale l’entrée dans une phase de transition systémique et d’alternance du leadership. Dès lors, l’étude de l’hégémonie et des cycles hégémoniques devient l’objet primordial des préoccupations de la communauté des politistes, car cette étude a des répercussions sur les réalités et les métamorphoses de la puissance. Elle influe directement sur les stratégies qui concourent à la maintenir et à la préserver, ou en revanche, à la contraster et à l'abattre.
Ainsi, si le concept de l’hégémonie peut être reconduit au paradigme de l’acteur rationnel et sa conduite est susceptible d’être abordée en termes de fonction, de conjoncture et de système, l'étude de la puissance peut se prévaloir aujourd'hui de deux approches théoriques, réaliste et transnationale, dont la divergence relativise leur portée explicative.
REALISME ET INTERDEPENDANCE EN LEUR PORTEE EXPLICATIVE
Dans le cadre de cette opposition, l'approche réaliste présente les traits suivants :
- la prééminence du politique et l'importance de la rivalité de puissance au cœur d'un environnement hétérogène
- l'hégémonie comme principe régulateur « hard » de l'ordre global.
- l’anarchie, comme univers de relations dépourvues d’autorité centrale.
- l’existence de structures et d’institutions intermédiaires, conditionnant la liberté d’action des États.
- l'omniprésence virtuelle du conflit, comme facteur de remodelage de la scène planétaire, étatique et sub-étatique.
- la théorie, comme modèle explicatif prééminent et souhaitable.
En faveur des approches transnationales et de la conception de l'hégémonie comme pouvoir d'influence on repère les paradigmes qui suit:
- la théorie de l’interdépendance et du social international
- l’autonomie croissante des flux, échappant au contrôle des États vis-à-vis des acteurs de régulation traditionnels encore soumis à la sphère inter-étatique.
- le recours à la société civile et à ses acteurs
- la dialectique contradictoire de la globalisation et du localisme.
- la décentralisation des juridictions et des activités, en dehors des cadres de la souveraineté territoriale, apparaissant sous forme de réseaux régionaux.
- la sociologie et non la théorie, comme cadre d’intelligibilité envisageable.
C'est dans un pareil contexte que peuvent se comprendre les relations politiques de la scène internationale actuelle, relations dont la spécificité ne s’impose pas de manière évidente et dont la fragmentation cognitive découle d’une absence d’accord sur les centres d'intérêt essentiels, ou sur la signification à assigner aux phénomènes.
Ainsi l'autonomie de chaque discipline renvoie à des enjeux politiques qui demeurent des sources d'inspiration contradictoires pour les analystes et les hommes d’État.
On peut conclure que l'hégémonie est le pivot analytique vers lequel convergent de manière contradictoires les grands courants du réalisme et de l'interdépendance. Ainsi, l'utopie d'un gouvernement mondial ou d'une autorité supranationale efficace et contraignante résulte paradoxalement de l'égoïsme et de la rationalité de l’État, comme acteur virtuellement hégémonique. Dans cette hypothèse, la logique des « régimes internationaux » et de gouvernance globale, ne peuvent être compris que comme tentatives d'explication d'un ordre international non-hégémonique. Afin d'approfondir la conception de l'hégémonie et sa portée, il nous semble nécessaire de procéder par des essais de définition conceptuels.
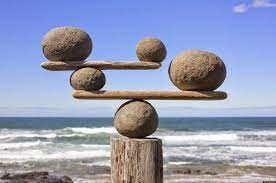
GEIST, ELITES ET LEADERSHIP
L'hégémonie apparait comme l’imprégnation de la puissance sociétale par le pays qui l’incarne et désigne historiquement la créativité globale d’une nation ou d’un peuple et, plus en profondeur, la réalisation de son « Geist ». Le leadership frappe par la capacité (ou l'incapacité) de direction d'une oligarchie ou d’une élite et se focalise autour de l'art d'orienter l'ensemble de l'agir collectif par un « sens » (idée historique, cause universelle ou grandes conceptions du monde).
Il faut conclure que le concept d'hégémonie est de nature sociologique et téléologique, celui de leadership de nature politique et stratégique. Le premier tient à l'épanouissement d'une société par la puissance. Le deuxième à l'affirmation d'une volonté par les rivalités de pouvoir et par la maîtrise d'un dessein. De surcroit, le leadership est un art de la contingence, l'hégémonie une permanence culturelle assurée par la durée.
L’objectif primordial du leadership est de devancer les rivaux, de prendre des risques, de calculer les avantages et les coûts et, in fine, d'imposer un ordre. Le leadership se propose comme une entreprise aventureuse car il définit une ligne directrice et à risque, en fixe les modalités et les moyens et force un ensemble organisé à s'y tenir.
L'hégémonie exprime une évidence dynamique objective et constitue le socle du leadership. Ce dernier en suggère et élabore le mouvement et l'action, la prééminence et la hiérarchie. Du point de vue interne, le leadership est la projection vers l'extérieur d'une ambition personnelle ou de groupe, tendanciellement individualiste et anti-égalitariste. Sa raison d'être est l'arbitrage, son horizon des objectifs larges, sa force entraînante une forte capacité de mobilisation sociale, sa finalité la confiance interne et internationale, son but ultime le succès, la victoire ou la gloire.
Or, puisque la lutte et la rivalité entre les unités politiques comportent toujours une dimension idéologique, la lutte pour l'Hégémonie se configure, dans la plupart des cas, comme une affirmation de primauté culturelle, informationnelle et militaire. Or la primauté culturelle est perçue en termes d’attirance pour un certain « mode de vie » et comme modèle d'excellence dans les domaines éducatif et scientifique. La primauté militaire s'oppose à la liberté inconditionnelle des rivaux et apparaît très peu conforme aux aspirations originelles de liberté des autres unités politiques. Elle se heurte ainsi au respect conservateur de la légalité internationale dans l'exercice du pouvoir dominant, respect qui est souvent bafoué et qui n'apparaît ni évident ni fréquent au cours de l'histoire

RIVALITÉ SYSTÉMIQUE
Le rival systémique d'Hégémon est, du point de vue stratégique, son «peer compétiteur» (Carthage pour Rome, Sparte pour Athènes, l'URSS pour les USA, la Chine pour l'Occident). C'est l'acteur montant qu'il faut isoler, diviser, encercler ou rabaisser. Le modèle de conflit d'Hégémon est systémique et global et son référent culturel est une civilisation. En effet est hégémonique l'acteur historique qui a universalisé ses intérêts et ses valeurs. L'Hégémonie n'est pas l'impérialisme comme domination directe, occupation territoriale et confiscation de la souveraineté, mais l’action d’endiguement qui assure la poursuite de buts communs et coopte d'autres alliés dans l’isolement puis dans l’élimination de l’adversaire.
VISION REGIONALISEE DE LA SECURITE ET POLITIQUE D’ALLIANCES
« Hégémon » fut la désignation, dans le monde hellène, du « commandement suprême » et d'une domination consentie. L'élément primordial d'une hégémonie historique est sa suprématie militaire, le « sine qua non » de son affirmation et de sa durée. Cette suprématie a deux fonctions : dissuader et contraindre. La force militaire qui lui est consubstantielle doit être écrasante, soit pour décourager un rival ou une coalition de rivaux, soit pour les vaincre et les punir, en cas d'échec de la dissuasion, face à une menace imminente ou en situation d'affrontement inévitable.
La supériorité militaire doit se traduire en une vision régionalisée de la sécurité et donc en une géopolitique d'alliances ou de coalitions (Serge Sur), appuyées sur des bases militaires, mobilisables en cas de besoin. Toute régionalisation de la sécurité ne doit pas contredire à la logique des équilibres mondiaux, ni aux intérêts stratégique et géopolitiques d'Hégémon.
La vision régionalisée de la sécurité est assurée aujourd'hui :
– par une diplomatie totale et par une série d'outils comme les institutions supranationales ou régionales de sécurité (ONU, OSCE, UEA, OTCS, etc) ou par des instances de coopération multinationales (BM, FMI, OIC).
– par la transformation de la puissance matérielle ou classique en puissance immatérielle et globale et, par conséquent, par l'intelligence et le Linkage vertical et horizontal qui constituent des transformations structurelles de l'hégémonie.
- par une association de la diplomatie et de la stratégie de la menace, allant jusqu’au risque nucléaire- Brinkmanship-
– par l'importance acquise par le « soft power » comme producteur de « sens » et comme facteur d'unification des valeurs et des pratiques sociales innovantes (l’éducation, la science et la culture).
L'idée de convertir le pouvoir militaire en pouvoir civil est confiée, en situations d'exception, à la légitimité acquise par l'exercice de la coercition et de la force, qui deviennent sur le long terme les sources du droit. La mesure de l'hégémonie interne a comme critère de référence l'asymétrie de statut, l'obéissance critique ou l'adhésion enthousiaste. Celle du pouvoir international, la supériorité de puissance et la capacité de structurer le champ d'action des autres unités politiques, par la définition unilatérale des règles de conduite et par le pouvoir de sanction qui leur est assigné. Lorsque l'hégémonie se prévaut du consensus et d'un système de légitimité fondé sur la culture ou sur le ralliement à un « modèle de vie », la force de l'hégémonie se mesure à la créativité d'une société et à sa capacité à proposer des images, des plans et des projets d’amélioration et d’ordre aux autres forces sociales et à d'autres unités politiques. Elle apparaît ainsi comme « Soft Power » (Joseph Nye).

CRISE UKRAINIENNE, CONFLIT LIMITE OU AFFRONTEMENT GLOBAL
La plupart des analystes occidentaux, interrogés sur les issues des tensions et des menaces que se renvoient les unes les autres à propos de la crise ukrainienne, justifient leurs prévisions sur le sens et les intérêts du président de la Fédération de Russie, évoquant l’hypothèse d’une gesticulation et faisant appel à la logique de l’acteur rationnel et donc au poids de l’aléas encouru. Ils en tirent la conviction que la montée en puissance de troupes et de matériel militaire obéit à une pression psychologique permettant d’obtenir les objectifs poursuivis, pesant sur les négociations diplomatiques et sans combattre. A l’opposé de cette hypothèse, l’argument contraire prétend évoquer le risque d’un conflit global et dans la faible possibilité de contenir et limiter la guerre en Europe du Sud- Est. La raison en est la menace à la sécurité existentielle de la Russie, à proximité de ses frontières, portée par l’OTAN et la puissance globale dominante, les Etats-Unis. Un conflit indirect, par personne interposé, conçu dans le but de donner une double leçon, aujourd’hui à la Russie et aux européens et demain à la Chine. En complément de la thèse théorique de Gilpin, selon lequel on peut parvenir à une stabilité globale par une guerre locale, G.Modelski fait intervenir une hypothèse concurrente, celle des cycles longs, afin d’expliquer la durée des phénomènes hégémoniques ( 80-100ans ) et décrit le lien qui existe entre le cycle des guerres, la suprématie économique et les aspects politiques et économiques du leadership mondial. En ce sens les guerres seraient des phénomènes physiologiques et naturelles du système international qui interviennent à intervalles réguliers. En effet, depuis 1500 et le début de l’ère moderne, les guerres font partie à chaque fois d’un système global plus large du simple système régional et impliquent des répercussions non seulement stratégiques mais systémiques et civilisationnelles ;
Ainsi les acteurs majeurs ne peuvent faire retrait à l’occasion d’un pari ou d’une grande aventure historique. Ils doivent jouer le jeu qu’ils ont entrepris et qui les portent, par une escalade systémique, à s’engager dans une épreuve de plus en plus périlleuse. Les considérations locales et d’ordre tactique portent en soi -l’horloge de l’histoire et poussent les facteurs de la stratégie à ramifier en direction de la grande politique et à concerner le système dans son ensemble.
Le danger vient alors de la transformation du conflit local en affrontement global, car l’acteur hégémonique ne peut jouer une pièce importante, restant cachés derrière les rideaux de l’Histoire et les frontières de la menace.
Bruxelles-Bucarest, 23 Décembre 2021
15:08 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, hégémonisme, sciences politiques, politologie, théorie politique, relations internationales, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 novembre 2021
L'Ile et le Continent
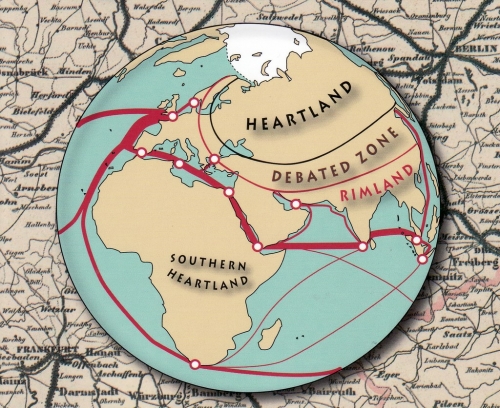
L'Ile et le Continent
Par Marco Ghisetti
Ex: https://www.eurasia-rivista.com/lisola-e-il-continente-2/
L'île et le continent à l'époque colombienne (XV-XIX)
Le géographe français Yves Lacoste définit la géopolitique comme "la situation dans laquelle deux ou plusieurs acteurs politiques se disputent un territoire" (1) et, par ailleurs, comme l'étude du conditionnement géographique de l'action de l'État. Le conditionnement du facteur géographique et du facteur interprétatif peut facilement être vérifié à l'aide d'un cas exemplaire. La France a été unifiée avant l'Allemagne parce que le réseau fluvial français s'est développé selon une forme radiale dont l'épicentre était Paris. Cela a permis à un centre de pouvoir basé à Paris d'étendre son pouvoir et d'absorber les autres entités politiques présentes dans l'espace français ; cette unification a eu lieu pendant l'ère moderne post-médiévale, car il y avait eu des développements technologiques qui rendaient possible l'unification politique de territoires plus vastes que la taille des entités politiques du Moyen Âge. En revanche, l'unification de l'Allemagne par la Prusse n'a pas eu lieu en même temps que l'unification française, car le réseau fluvial allemand s'est développé de manière parallèle, ce qui a entravé l'unification politique. La Prusse n'a pu organiser autour d'elle les différentes entités politiques allemandes qu'à la suite de nouveaux développements technologiques, notamment dans le secteur ferroviaire, qui lui ont permis de surmonter ses contraintes géographiques.

Lacoste a ensuite enrichi sa définition en y ajoutant une composante interprétativiste, selon laquelle une connaissance approfondie de son propre espace géographique et de la manière dont un acteur politique interprète son espace influence la manière dont cet acteur politique oriente son action dans le monde. Il est également possible ici de le montrer à travers un cas exemplaire. Vers le 15ème siècle, les Anglais et les Chinois disposaient de technologies assez similaires dans le domaine naval. Cependant, les Anglais, comme l'écrit Carl Schmitt, sont passés d'un "peuple d'éleveurs de moutons" à un "peuple d'écumeurs de mer et de corsaires, [de] fils de la mer" (2), tandis que les Chinois, comme le souligne Friedrich Hegel, sont restés un peuple qui considérait la mer comme le lieu où la terre se terminait, tout simplement (3). L'Angleterre devient une puissance maritime et fonde un empire transocéanique, tandis que la Chine reste une puissance continentale, sans révolutionner son image de l'espace, même si le niveau de développement technologique naval en Chine et en Angleterre était,à l'époque, très similaire.
La révolution spatiale anglaise du 15ème siècle est décrite par Schmitt comme une transformation qui a fait de l'Angleterre "une île", un territoire qui "est devenu le sujet et le centre du retournement élémentaire du continent vers la haute mer [...] héritier de toutes les énergies maritimes alors libérées [...] il est devenu une île dans un sens nouveau et jusqu'alors inconnu" (4), détachant "son regard du continent" et l'élevant même "jusqu'aux grandes mers du monde" (5), et générant un conflit entre la Mer (l'île anglaise, puissance maritime) et la Terre (les Etats européens, puissances continentales).

Antonio Zischka, contemporain de Schmitt, porte un jugement similaire en affirmant que "pendant l'époque romaine et le Moyen Âge, l'Angleterre n'avait aucune importance", mais qu'avec la guerre de Cent Ans (1337-1453), elle a "coupé, pour ainsi dire, le cordon ombilical" qui la reliait à l'Europe et, ce faisant, "sa nature insulaire s'est clairement affirmée" (6). Pendant la Seconde Guerre mondiale, Johann von Leers a écrit que "pendant tout le Moyen Âge, les îles britanniques ont eu peu d'importance pour l'histoire de l'Europe", alors qu'après la conquête normande (1090), les Anglais "appréciaient l'insularité anglaise, l'avantage d'être dans une terre sans voisins et inattaquable, comme une politique de puissance" (7).
L'Anglais et contemporain de ces auteurs, Halford Mackinder, définit cette transformation spatiale comme celle qui a ouvert une période historique différente de la période médiévale, la "période colombienne". Il s'agit d'une période historique au cours de laquelle les "découvertes colombiennes" ont fait de "l'Atlantique Nord [...] un bassin arrondi" et au cours de laquelle la "Grande-Bretagne", en raison de la "position centrale" dont elle a commencé à jouir dans ce bassin, combinée à sa "position insulaire [...] au large du grand continent [...] est progressivement devenue la terre centrale, plutôt que marginale, du monde" (8). Ayant atteint cette centralité dans le bassin atlantique, Mackinder souligne comment l'Angleterre a atteint la "dominance sur la mer", c'est-à-dire qu'elle a pu dominer, grâce à sa flotte, sa puissance économique et les différentes bases navales et transocéaniques qu'elle a installées tout au long de "la grande route océanique": l'Angleterre est devenue une puissance maritime qui, par rapport au grand continent dont elle s'est détachée en se donnant à la mer, maintient la " politique traditionnelle [de] faire des alliances avec des États plus petits en opposition à tout grand État qui menace de bouleverser l'équilibre des forces en Europe" (9).
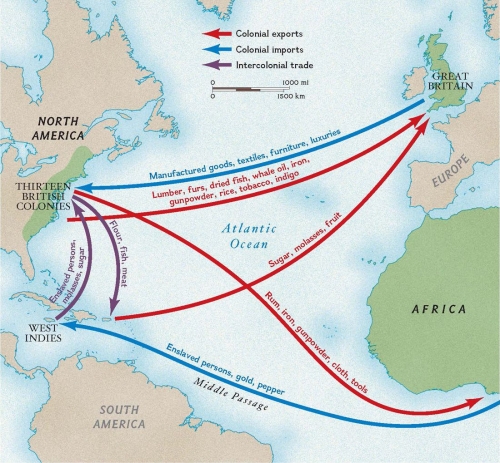
Claudio Mutti, en reconstituant ce en quoi consistait la politique d'équilibre des forces, écrit qu'il s'agissait davantage de "monter les nations européennes les unes contre les autres" en vue d'"empêcher l'unification politique de l'espace continental" (10) (d'où le choix anglais de soutenir la nation faible contre la nation forte) que d'une véritable défense des faibles. Tiberio Graziani a résumé la politique de puissance anglaise envers le continent pendant la période colombienne comme une "politique de puissance séculaire visant à contenir et à contrecarrer les accords d'amitié et/ou d'intégration entre les nations du continent européen" (11). C'était la stratégie britannique car, écrit Jean Thiriart, "la formation d'une Europe unifiée [...] entraînerait la création d'une force capable de l'envahir" (12).
En affirmant son insularité, la stratégie générale anglaise était donc de maintenir sa domination maritime et, en même temps, de garder le continent divisé. Cette stratégie est aussi généralement qualifiée d'"isolationnisme" dans la littérature, mais il convient de préciser qu'elle ne doit pas être assimilée, par exemple, à la politique fermée du Sakoku du Japon, par laquelle l'Empire de la Fleur de Cerisier (également un groupe d'îles flanquant un continent) entendait minimiser toute forme de contact avec les autres puissances. L'isolationnisme britannique, en revanche, était une véritable politique de puissance, un isolationnisme qui "était en fait très extraverti" (13). Pendant la période colombienne, la puissance hégémonique était donc l'Angleterre, l'île hégémonique face au continent.
L'île et le continent à l'époque postcolombienne (XX-)
Cependant, entre le 19ème et le 20ème siècle, il y a eu des changements et des développements technologiques qui, comme ceux qui avaient provoqué le passage du monde médiéval au monde colombien (qui était caractérisé à la fois par l'ouverture européenne au monde et par l'unification des microstructures politiques médiévales en États modernes), ont conduit à la naissance du monde post-colombien, dans lequel il n'y avait plus de terrae nullius et qui était caractérisé par l'unification des empires continentaux. Ces transformations ont fait de l'Angleterre une "petite île [qui n'a pas] une productivité suffisante pour établir un empire capable de tenir tête aux grands empires continentaux qui émergent" (14) (la Russie, les États-Unis, et potentiellement la Chine, l'Inde et le Brésil).
En outre, écrit Mackinder, "le continent combiné de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique" est devenu "effectivement et pas seulement théoriquement une île : [...] le monde insulaire" (15). Les autres macro-régions du monde (Amérique du Nord et du Sud, Australie, dominions britanniques), étant des terres beaucoup plus petites avec beaucoup moins de ressources naturelles et de population que l'île-monde, sont considérées par Mackinder comme des "satellites" de l'île-monde. Pour Mackinder, l'île-monde est constituée d'un centre appelé "cœur de la terre" (heartland) et de quatre appendices (le croissant intérieur/inner crescent) qui se développent autour de lui: l'Europe péninsulaire, l'Asie du Sud-Ouest (Proche et Moyen-Orient, Afrique du Nord), l'Inde et la Chine ; ces quatre zones sont des appendices mais font néanmoins partie intégrante de l'île-monde. Les appendices seront plus tard appelés "rimlands" par Nicholas Spykman. Le potentiel de puissance de la World Island est tel que si une puissance ou un concert de puissances locales parvenait à organiser cette World Island, elle ou ils auraient à leur disposition "l'utilisation de vastes ressources continentales pour la construction de flottes, avec la possibilité conséquente de conquérir la domination du monde" (16) . L'ère post-colombienne est devenue, pour Mackinder, l'ère des "empires continentaux", dans laquelle les structures politiques modernes s'unissent en États de dimensions continentales.
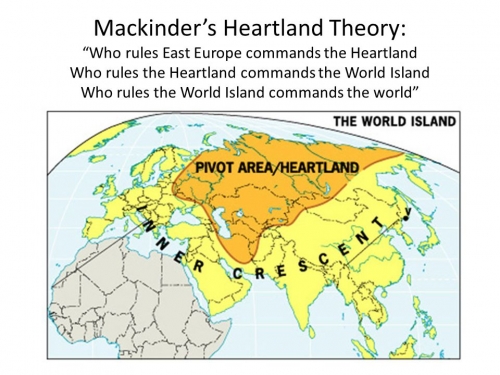
Les changements radicaux survenus entre le 19ème et le 20ème siècle ont également été identifiés par Alfred Thayer Mahan, "le premier à théoriser la stratégie maritime [et] à souligner l'importance, dans la géopolitique contemporaine, de la "domination maritime"" (17) et celui qui allait devenir le père de la doctrine géopolitique américaine. Il est le père de la doctrine militaire américaine parce qu'il est celui qui a systématisé la stratégie maritime américaine pour le monde post-colombien et indiqué les constantes stratégiques que les États-Unis devaient suivre pour devenir la "véritable île contemporaine", l'"île continentale" du 20ème siècle et au-delà. Mahan écrit :
"Les États-Unis sont à toutes fins utiles une puissance insulaire, comme la Grande-Bretagne. Nous n'avons que deux frontières terrestres, le Canada et le Mexique. Ce dernier pays dernière est désespérément inférieure à nous dans tous les éléments de la force militaire. Quant au Canada [...] les chiffres indiquent clairement que l'agression ne sera jamais sa politique. [...] Nous sommes, répétons-le, une puissance insulaire, donc dépendante de la marine. En outre, une puissance navale durable dépend en fin de compte des relations commerciales avec les pays étrangers" (18).
Suivant l'étoile polaire indiquée par Mahan, les États-Unis ont promu une double ligne d'expansion, verticale et horizontale, afin de devenir la véritable puissance insulaire contemporaine. Avec le percement du canal de Panama, fortement préconisé par Mahan, les États-Unis ont obtenu la condition du bi-océanisme avec les côtes reliées par la mer. Au sud, les États-Unis ont promu l'expulsion des puissances européennes, faisant de la mer des Caraïbes et de la mer du Mexique une mer intérieure américaine, hégémonisée par les États-Unis, et, par une déclinaison agressive de la doctrine Monroe, ont favorisé, comme l'écrit Tiberio Graziani, "l'unité géopolitique pour [l'Amérique du Nord] [et] la fragmentation excessive pour l'Amérique centrale et du Sud" (19).
En ce qui concerne l'expansion horizontale, Mahan insiste sur l'unité de la puissance marchande et militaire des puissances maritimes, plaide pour la nécessité d'hériter de l'empire maritime britannique, de maintenir l'équilibre des forces en Europe afin qu'un challenger ne se présente pas, maintenir l'équilibre des forces en Méditerranée afin de disposer d'un "libre accès au canal de Suez", le "chemin de fer maritime" (20) qui relie la mer Méditerranée au golfe Persique car, à travers lui, on accède par mer à l'océan Indien, au Pacifique et, par le canal de Panama, à l'Atlantique à nouveau. En exerçant l'hégémonie maritime sur ces routes, on crée ce que Mahan appelle "l'océan uni", qui selon l'amiral est le siège principal de la puissance mondiale; une hégémonie qui peut être partiellement soulagée et partagée avec des puissances maritimes secondaires. Le Moyen-Orient et l'Asie doivent être maintenus dans un équilibre des forces, comme c'est le cas en Europe.

Les conclusions maritimes de Mahan ont été développées par Isaiah Bowman, qui renforce la thèse de l'interconnexion de l'Amérique latine avec les États-Unis en vue d'augmenter les débouchés commerciaux américains en Amérique du Sud et de diminuer les débouchés européens sur le "continent vertical" et, d'autre part, développe l'analyse des processus géoéconomiques et des opérations financières de contrôle du marché sur les relations politiques interétatiques en vue d'élire les États-Unis au rôle de garant de l'équilibre mondial, liant ainsi doublement la puissance navale américaine à la puissance financière (21).
Pendant la Seconde Guerre mondiale, la géopolitique de Mahan a été développée par Nicholas Spykman, un auteur qui a réalisé "l'achèvement de la géopolitique anglo-saxonne classique" (22), qui a déplacé le siège de la puissance mondiale de l'océan Indien vers les zones frontalières eurasiennes (rimlands) et a ajouté un "conflit permanent" entre le "nouveau monde", c'est-à-dire l'Amérique, et le "vieux monde", qui, ayant un potentiel de puissance plus important que le nouveau monde, doivent être maintenus dans un équilibre neutralisant par les Etats-Unis en y installant des bases militaires américaines et en liant l'économie de ces zones à l'économie américaine, afin qu'elles ne regardent pas vers le cœur de la terre eurasienne (23). Selon Spykman, dans la période post-colombienne, les États-Unis font face à l'Eurasie de la même manière que l'Angleterre faisait face à l'Europe pendant la période colombienne.
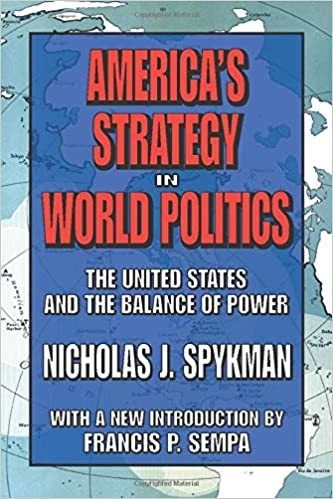 Les travaux de Mackinder, Mahan et Spykman constituent toujours le pivot de la doctrine géopolitique américaine, l'étoile polaire qui guide l'action des États-Unis dans l'ère post-colombienne (24) toujours en cours.
Les travaux de Mackinder, Mahan et Spykman constituent toujours le pivot de la doctrine géopolitique américaine, l'étoile polaire qui guide l'action des États-Unis dans l'ère post-colombienne (24) toujours en cours.
Henri Kissinger écrit :
Géopolitiquement, l'Amérique est une île au large du grand continent eurasien. La domination par une seule puissance de l'une des deux sphères principales de l'Eurasie - Europe ou Asie - est une bonne définition d'un danger stratégique pour les États-Unis, guerre froide ou pas. Ce danger doit être écarté même si cette puissance ne manifeste pas d'intentions agressives, car si cette puissance devait devenir agressive par la suite, l'Amérique se retrouverait avec une capacité de résistance efficace très réduite et une incapacité croissante à influencer les événements (25).
Zbigniew Brzezinski écrit :
L'Eurasie est le supercontinent axial du monde. Une puissance dominant l'Eurasie exercerait une influence décisive sur deux des trois régions les plus productives économiquement du monde: l'Europe occidentale et l'Asie orientale. Un coup d'œil à la carte suggère également qu'un pays dominant en Eurasie commanderait presque automatiquement le Moyen-Orient et l'Afrique [...] la puissance potentielle de l'Eurasie éclipse même celle de l'Amérique. [La stratégie américaine consiste donc à] s'assurer qu'aucun État ou combinaison d'États n'acquiert la capacité d'expulser les États-Unis ou même de diminuer leur rôle [...] en Eurasie (26).
Phil Kelly écrit, en résumant les études géopolitiques américaines :
Toutes les visions stratégiques géopolitiques présentent l'Eurasie comme le facteur central. Tout comme pour l'Angleterre, pour les États-Unis, c'est de là que vient la principale (bien que plus lointaine) menace pour la sécurité. [La conscience de la vulnérabilité de l'Eurasie a longtemps été présente dans la pensée géopolitique américaine, et continue de l'être aujourd'hui. [...] La géopolitique américaine est étroitement liée aux principes de base des doctrines classiques des Britanniques [...] Tous deux se dépeignent comme une "île", flanquée d'une masse continentale menaçante qui doit être maintenue divisée pour protéger leur propre sécurité (27).
Kissinger lui-même résume ainsi toute la signification des interventions militaires américaines au cours du 20ème siècle : "Dans la première moitié du 20ème siècle, les États-Unis ont mené deux guerres pour empêcher la domination de l'Europe par un adversaire potentiel [...] Dans la seconde moitié du 20ème siècle (en fait à partir de 1941), ils ont mené trois guerres pour défendre le même principe en Asie - contre le Japon, en Corée et au Vietnam" (28). Nous constatons qu'en deux phrases seulement, Kissinger révèle le sens des guerres menées par les États-Unis tout au long du 20ème siècle, en les dépouillant de toute justification idéologique qui leur est habituellement attachée (guerres antifascistes, anticommunistes, guerre pour la liberté, pour la démocratie, pour la civilisation, etc.).
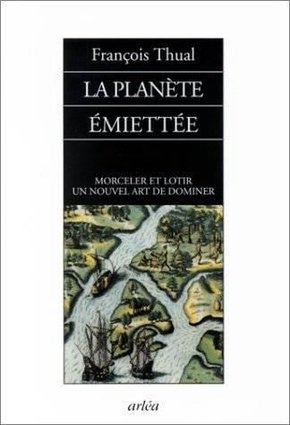 Alors que cela était vrai au 20ème siècle, François Thual note avec le début du troisième millénaire un paradoxe apparent dans l'évolution historique : là où la modernité se caractérisait par l'unification des microstructures politiques médiévales, l'époque contemporaine se caractérise par la multiplication des "impuissances géopolitiques", c'est-à-dire par la fragmentation, selon des lignes ethnoculturelles plus ou moins artificielles, des empires et des États de taille moyenne en petits États, donc en États qui ne sont que nominalement souverains. L'"éclatement de la planète" comme "stade suprême de la mondialisation", écrit Thual, s'explique par le fait que le "morcellement de la planète est le résultat de manipulations génétiques [...] l'expression d'un volontarisme [...] avec des États réels et des États que l'on pourrait qualifier d'"effacés" et qui sont généralement des "États dominés"" (29).
Alors que cela était vrai au 20ème siècle, François Thual note avec le début du troisième millénaire un paradoxe apparent dans l'évolution historique : là où la modernité se caractérisait par l'unification des microstructures politiques médiévales, l'époque contemporaine se caractérise par la multiplication des "impuissances géopolitiques", c'est-à-dire par la fragmentation, selon des lignes ethnoculturelles plus ou moins artificielles, des empires et des États de taille moyenne en petits États, donc en États qui ne sont que nominalement souverains. L'"éclatement de la planète" comme "stade suprême de la mondialisation", écrit Thual, s'explique par le fait que le "morcellement de la planète est le résultat de manipulations génétiques [...] l'expression d'un volontarisme [...] avec des États réels et des États que l'on pourrait qualifier d'"effacés" et qui sont généralement des "États dominés"" (29).
Les considérations de Thual ont été développées par Tiberio Graziani, qui affirme que la politique de fractionnement de la planète est menée par les États-Unis, qui, après avoir réussi au 20ème siècle à devenir - dans le langage de John Mearsheimer - le seul "hégémon régional" du monde, font maintenant "tout pour affaiblir, voire détruire" (30) un État qui se propose de faire de même. Le "processus de déstabilisation [...] de l'espace eurasiatique", lancé par les États-Unis après l'échec de la fonction d'équilibrage de l'Union soviétique, visait à exploiter les deux piliers de la puissance américaine - "le rôle de Wall Street en tant que centre financier incontesté du monde [et] la puissance de guerre nord-américaine du Pentagone" (31) - afin de diviser ce que Brzezinski avait appelé le "grand échiquier eurasiatique" (l'Île-Monde) et de hisser les États-Unis au rang de "première, unique et vraiment dernière superpuissance mondiale" (32). En bref, réaliser ce qu'un "employé du Département d'État américain" (33), Francis Fukuyama, avait appelé la "fin de l'histoire" (34).
Toutefois, le processus de fractionnement des États-Unis s'est accompagné d'un autre processus égal et opposé: celui des intégrations continentales, promu principalement par la Russie post-soviétique - qui "tente d'endiguer la marche des États-Unis vers l'Est par le tissage méthodique d'un système d'alliances stratégiques avec la Chine, le sous-continent indien et l'Iran" (35) - et par la Chine - qui, ayant survécu au "projet de transformer la République populaire de Chine en colonie économique américaine" (36) - tente de se présenter comme un hégémon régional en Asie. Les frictions générées par les deux tendances divergentes de l'intégration et de la fragmentation transforment les quatre annexes de l'île-monde en "décharges" (37) de tensions internationales, où se dérouleront les prochaines batailles pour la domination mondiale. Le succès ou non de la création d'un monde multipolaire ou, inversement, le succès des États-Unis à rester le Léviathan hégémonique, dépendra de la preuve et de la solidité de la collaboration intégrationniste sino-russe.
Claudio Mutti, commentant les projets d'intégration sino-russes, écrit: "La perspective d'un rapprochement entre l'Europe et la Russie, qui inquiète tant les États-Unis, devient un véritable cauchemar à Washington si l'on considère qu'au terme du parcours d'intégration représenté par la nouvelle route de la soie, la Russie et l'Europe pourraient être rejointes par la Chine; dans ce cas, en effet, l'Eurasie deviendrait le siège du pouvoir géopolitique mondial. Les "analyses" préconisant un nouveau renforcement des relations entre les États-Unis et l'Europe découlent de cette "anxiété américaine" (38).
Alain de Benoist écrit, en établissant un parallèle entre l'Angleterre de la période colombienne et les Etats-Unis d'aujourd'hui: "comme l'Angleterre d'hier, l'hégémonie américaine repose sur la domination mondiale des mers, prolongée par la domination des airs, et sur l'absence d'unité dans l'espace eurasien. L'axe Madrid-Paris-Berlin-Moscou acquiert toute son importance, aux côtés de l'axe Moscou-Téhéran-New Delhi [tandis que] l'inconnu chinois domine tout le reste" (39). Ainsi, comme dans la période colombienne et au 20ème siècle, l'histoire du 21ème siècle sera très probablement celle du choc entre deux tendances opposées: celle de la tentative d'unification et d'organisation de l'espace eurasiatique, voulue par les grandes puissances eurasiatiques, et celle de la tentative de l'empêcher, poursuivie par les États-Unis. Aujourd'hui comme hier, en utilisant les catégories géo-historiques de Mackinder et Schmitt, nous assistons à l'affrontement entre les loups de la mer et les loups de la terre, entre la Mer et la Terre, entre Poséidon et Antée, entre l'Île et le Continent.
BIBLIOGRAPHIE :
– Federico Bordonaro, La geopolitica anglosassone, Milano, Guerini, 2012
– Isaiah Bowman, The New World: Problems in Politics Geography, Nuova York, World Book, 1921.
– Zbigniew Brzezinski, “A Geostrategy for Eurasia”, in Foreign Affairs, Vol. 76, No. 5, Sep.-Oct., 1997
– Zbigniew Brzezinski, La grande scacchiera: il mondo e la politica nell’era della supremazia americana, Longanesi, 1998.
– Alain de Benoist, “Géopolitique”, in Nouvelle Ecole, No. 55, 2005, 1
– William Engdahl, “L’odierna posizione geopolitica degli Usa”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010.
– Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli, 1992
– Marco Ghisetti, Talassocrazia: I fondamenti della geopolitica anglo-statunitense, Cavriago, Anteo, 2021.
– Tiberio Graziani, “Editoriale”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 2/2005
– Tiberio Graziani, “Il Patto atlantico nella geopolitica Usa per l’egemonia globale”, eurasia-sito.com, 1 gennaio 2009, https://www.eurasia-rivista.com/patto-atlantico-nella-geo...
– Tiberio Graziani, “Il risveglio dell’America indiolatina”, eurasia-sito.com, 1 luglio 2007, https://www.eurasia-rivista.com/il-risveglio-dellamerica-...
– Phil Kelly, “Geopolitica degli Stati Uniti d’America”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010
– Henri Kissinger, Does America Need a Foreign Policy?, Simon & Schuster, 2002
– Henry Kissinger, L’arte della diplomazia, Milano, Sperling & Kupfer
– John Mearsheimer, La logica di potenza. L’America, le guerre e il controllo del mondo, Milano, UBE, 2008
– Friedrich Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, Bari, Laterza, 2003.
– Yves Lacoste, “Che cos’è la geopolitica”, eurasia-rivista.com, 17 luglio 2007, https://www.eurasia-rivista.com/yves-lacoste-che-cose-la-...
– Pascal Lorot, Storia della geopolitica, Trieste, Asterios, 1995, 35.
– Halford Mackinder, Britain and the British Seas, Londra, William Heinemmann, 1902
– Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality, Washington, National Defence, 1996
– Halford Mackinder, Geographical Conditions Affecting the British Empire. I. The British Islands’, in “Geographical Journal”, Vol. 33, 1909
– Halford Mackinder, “Il perno geografico della storia”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 2/2018
– Halford Mackinder, Nations of the Modern World: An Elementary Study in Geography, Londra, Philip and Son, 1911
– Alfred Mahan, The Interest of America in Sea Power: Present and Furure, Boston, 1917
– Alfred Mahan, The Problem of Asia and its Effects upon International Politics, Boston, 1900
– Claudio Mutti, “Editoriale”, eurasia-sito.com, 15 settembre 2020, https://www.eurasia-rivista.com/negozio/lx-guerra-senza-l...
– Claudio Mutti, “Guerra senza limiti”, eurasia-sito.com, 15 settembre 2020, https://www.eurasia-rivista.com/guerra-senza-limiti-2/
– Claudio Mutti, “L’isola e il continente”, eurasia-rivista.com, 18 luglio 2017, https://www.eurasia-rivista.com/lisola-e-il-continente/
– Costanzo Preve, Elogio del comunitarismo, Napoli, Controcorrente, 2006
– Johann von Leers, L’Inghilterra: il nemico del continente europeo, , Parma, Insegna del Veltro, 2004, p. 41-2
– Daniele Scalea, “Come nacque un ‘impero’ (e come finirà presto)”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010
– Carl Schmitt, Terra e mare: una considerazione sulla storia del mondo, Milano, Giuffrè, 1986
– Nicholas Spykman, America’s Strategy in World Politics. The United States and the Balance of Power, Yale, 1942.
– François Thual, Il mondo fatto a pezzi, Parma, Insegna del Veltro, 2008
– Antonio Zischka, Le alleanze dell’Inghilterra. Sei secoli di guerre inglesi combattute con le armi altrui, Roma, Mediterranea, 1941-XIX, p. 41.
Notes:
- (1) Yves Lacoste, “Che cos’è la geopolitica”, eurasia-rivista.com, 17 luglio 2007, https://www.eurasia-rivista.com/yves-lacoste-che-cose-la-...
- (2) Carl Schmitt, Terra e mare: una considerazione sulla storia del mondo, Milano, Giuffrè, 1986, p. 54-5.
- (3) Friedrich Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, Bari, Laterza, 2003.
- (4) Carl Schmitt, op. cit., p. 17.
- (5) Ibid, p. 99.
- (6) Antonio Zischka, Le alleanze dell’Inghilterra. Sei secoli di guerre inglesi combattute con le armi altrui, Roma, Mediterranea, 1941-XIX, p. 41.
- (7) Johann Von Leers, L’Inghilterra: il nemico del continente europeo, Parma, Insegna del Veltro, 2004, p. 41-2
- (8) Halford Mackinder, Britain and the British Seas, Londra, William Heinemmann, 1902, pp. 3-4.
- (9) Halford Mackinder, Nations of the Modern World: An Elementary Study in Geography, Londra, Philip and Son, 1911, p. 291.
- (10) Claudio Mutti, “L’isola e il continente”, eurasia-rivista.com, 18 luglio 2017, https://www.eurasia-rivista.com/lisola-e-il-continente/
- (11) Tiberio Graziani, “Il Patto atlantico nella geopolitica Usa per l’egemonia globale”, eurasia-sito.com, 1 gennaio 2009, https://www.eurasia-rivista.com/patto-atlantico-nella-geo...
- (12) Jean Thiriart, Il fallimento dell’impero britannico, in “Eurasia. Rivista di studi geopolitici”, Vol. 3/2019, 2019, pp. 183-191.
- (13) Daniele Scalea, “Come nacque un ‘impero’ (e come finirà presto)”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010, p. 49.
- (14) Halford John Mackinder, Geographical Conditions Affecting the British Empire. I. The British Islands’, in “Geographical Journal”, Vol. 33, 1909, p. 474.
- (15) Halford Mackinder, Democratic Ideals and Reality, Washington, National Defence, 1996, 45.
- (16) Halford Mackinder, “Il perno geografico della storia”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 2/2018, 40.
- (17) Pascal Lorot, Storia della geopolitica, Trieste, Asterios, 1995, 35.
- (18) Alfred Mahan, The Interest of America in Sea Power: Present and Furure, Boston, 1917.
- (19) Tiberio Graziani, “Il risveglio dell’America indiolatina”, eurasia-sito.com, 1 luglio 2007, https://www.eurasia-rivista.com/il-risveglio-dellamerica-...
- (20) Alfred Mahan, The Problem of Asia and its Effects upon International Politics, Boston, 1900, 191.
- (21) Isaiah Bowman, The New World: Problems in Politics Geography, Nuova York, World Book, 1921.
- (22) Federico Bordonaro, La geopolitica anglosassone, Milano, Guerini, 2012, 116.
- (23) Nicholas Spykman, America’s Strategy in World Politics. The United States and the Balance of Power, Yale, 1942.
- (24) Marco Ghisetti, Talassocrazia: I fondamenti della geopolitica anglo-statunitense, Cavriago, Anteo, 2021.
- (25) Henry Kissinger, L’arte della diplomazia, Milano, Sperling & Kupfer, 634-5.
- (26) Zbigniew Brzezinski, “A Geostrategy for Eurasia”, in Foreign Affairs, Vol. 76, No. 5, Sep.-Oct., 1997, 50-1.
- (27) Phil Kelly, “Geopolitica degli Stati Uniti d’America”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010, p. 31.
- (28) Henri Kissinger, Does America Need a Foreign Policy?, Simon & Schuster, 2002, 110.
- (29) François Thual, Il mondo fatto a pezzi, Parma, Insegna del Veltro, 2008, 113.
- (30) John Mearsheimer, La logica di potenza. L’America, le guerre e il controllo del mondo, Milano, UBE, 2008, 39.
- (31) William Engdahl, “L’odierna posizione geopolitica degli Usa”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 3/2010, 57.
- (32) Zbigniew Brzezinski, La grande scacchiera: il mondo e la politica nell’era della supremazia americana, Longanesi, 1998, 284.
- (33) Costanzo Preve, Elogio del comunitarismo, Napoli, Controcorrente, 2006, 182.
- (34) Francis Fukuyama, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli, 1992.
- (35) Tiberio Graziani, “Editoriale”, in Eurasia. Rivista di studi geopolitici, Vol. 2/2005, 5.
- (36) Claudio Mutti, “Guerra senza limiti”, eurasia-sito.com, 15 settembre 2020, https://www.eurasia-rivista.com/guerra-senza-limiti-2/
- (37) Zona di scaricamento è un’espressione coniata da Karl Haushofer.
- (38) Claudio Mutti, “Editoriale”, eurasia-sito.com, 15 settembre 2020, https://www.eurasia-rivista.com/negozio/lx-guerra-senza-l...
- (39) Alain de Benoist, “Géopolitique”, in Nouvelle Ecole, No. 55, 2005, 1.
16:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, théorie géopolitique, théorie politique, relations internationales, politique internationale, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 août 2021
Sur la guerre de demain et sur l'ordre mondial post-occidental

Irnerio Seminatore
Source: http://www.ieri.be/fr/publications/wp/2021/ao-t/sur-la-gu...
***
TABLE DES MATIÈRES
Paix et guerre, une coexistence historique
Gouverner la guerre?
T. Hobbes, de "l'état de nature" ou de l'insociabilité de l'homme
La "Loi contre le Séparatisme" en France et la "Guerre Civile" menaçante
Hobbes, la société sans maître et la dictature consulaire
L'impérialité mutipolaire et ses guerres
Diplomatie et guerre. Sur les grandes rivalités hégémoniques
Le "Mémorandum Crowe" et la rivalité anglo-allemande
La "Déclaration Stoltenberg" et la rivalité sino-américaine
La prise de conscience historique et la subordination de la démocratie à l'hégémonie
La dés-occidentalisation du monde et l'asymétrie des volontés
L'amplification des dangers et la guerre de demain
Hétérogénéité du système et multipolarité
Fin de la stabilité hégémonique et monde post-occidental
"Conflits en chaîne" ou "révolution systémique"?
***

Paix et guerre, une coexistence historique
Scruter les signes c'est maîtriser l'avenir, car tout est signe et indice dans les plus hautes combinaisons stratégiques! Dans le domaine de la menace et du défi de la mort imminente, toute mutation exige déchiffrement et interprétation, car le réel est instable et s'habille de configurations transitoires en mutation permanente. Agir c'est non seulement prévoir, mais interpréter les formes, à partir de manifestations infimes. En effet on peut passer soudainement de la prééminence stabilisatrice d'une politique sans combat, la dissuasion réciproque, à une stratégie de frappe en premier. Ce qui est constant dans l'affrontement belliqueux, c'est la destruction sanglante et la mort à grande échelle. Les pays faibles ou affaiblis deviennent des proies pour leurs rivaux prédateurs, car dans la guerre la violence est originelle et comporte, comme idée maîtresse, le principe d'anéantissement. En tant qu'action guerrière elle conjugue stratégie et politique et oppose l'affrontement à l'évitement du combat. Elle doit porter un préjudice à l'ennemi et pas seulement le tromper par la ruse. Pour les réalistes, une fois déchaînée, la guerre s'érige en sujet et refuse tout modèle et toute maîtrise à son encontre,car elle se commue en royaume de l'incertitude et en brouillard. Elle devient un pari, pris sur la décision et une affaire aventureuse et aléatoire. Puisque la guerre, en tant que conflit de grands intérêts reglé par le sang, est un acte de violence poussé à ses limites extrêmes et destiné à contraindre l'adversaire à exécuter notre volonté, quelle est sa nouvelle nature et quel sont les signes avant coureurs de la guerre de demain? Une ambition, une nécessité politique, une rupture? Si le centre de gravité de la guerre repose sur la psychologie des duellistes et sur leurs volontés de se battre, le fondement de leur nature est dans l'homme lui même. La concrète historicité du conflit repose sur les moyens, les modalités et les techniques, mais le principe de la guerre est an-historique. Ce principe est ancré dans l'inimitié et l'hostilité radicales, constamment renouvelés par la politique. Il est enraciné dans la nature imparfaite de l'homme et de la société, ainsi que dans le prix du sang à payer pour la course improbable vers le principe de coopération et la métaphysique de la paix. La guerre n'est pas une arène de la raison, même si l'histoire mondiale est un tribunal qui a pour mission de gouverner le monde. L'aphorisme d’Héraclite selon lequel "Polemos, pater panton" (la guerre est le père de toutes choses), exprime l'idée selon laquelle la loi plus générale, inexorable et immuable de la nature exige un gouvernement par l'homme des instincts fondamentaux et primaires, la bellicosité et la "jealous emulation", qui mènent irréversiblement à la guerre. Celle-ci cependant a un but constant, de créer de nouvelles relations de coopération, bref une paix plus sûre et meilleure. Gouverner au même temps la paix et la guerre est la tâche suprême de la politique mondiale, car la paix et la guerre, qui coexistent dans le monde, constituent les deux revers d'une même médaille, l'expression de l'autonomie de l'hommes des conditionnements de la vie sur terre, naturels et sociaux, surnaturels et physiques, coercitifs et libres.
Gouverner la guerre?
Gouverner la guerre! C'était l'ambition de la grandeur, de César à Napoléon, à Hitler! Gouverner le conflit c'est l'ambition du politique; bref de la politique et de l’État, ou de l'ubiquité du culturel et du social, par la contrainte du stratégique et du militaire. Les théories de la guerre et les philosophies de l'histoire constituent les deux revers de l'être et du devoir être, comme contradiction du réel et de l'idéal, sous la législation de l'intention hostile et de l'Histoire turbulente, autrement dit, d'une idée pessimiste de l'homme, gouverné par la chute, par le Mal et par la nature insociable de l'homme (Hobbes). L'homme gouverné par le fanatisme du Bien ne peut être conduit que par l'idée d'une croisade ou par une inspiration faible, celle de la paix, de la seule coopération et d'un multilatéralisme de groupe, bref, par une "gouvernance civile" et a-stratégique (Union européenne) ou par une "défense collective" (OTAN), menées sous la houlette d'un tutorat brutal (américain).
Le prix de la mort et de la destruction inhérent à la guerre exige une qualité civique, la citoyenneté et une légitimité incontestable, celle d'un pouvoir souverain, maître de la décision d'exception, l'ouverture des hostilités, du commandement politique, l'ordre de mourir, et de l'insatiable volonté de nuire et de détruire, plier la volonté de l'autre ou des autres.
La guerre commence, s’affirme et se termine par la destruction de tout système dogmatique de pensée. Elle résulte à chaque fois et d'abord d’une percée intellectuelle. Or, le système dogmatique de nous jours, en Europe, consiste à émousser par le droit, l’économie, le scientisme et l’humanitaire, l’effet brutal de l’épée, du sang, de la destruction et de la mort. En effet c’est l’élément culturel qui constitue le concept d’ennemi et avec lui tout concept de guerre.
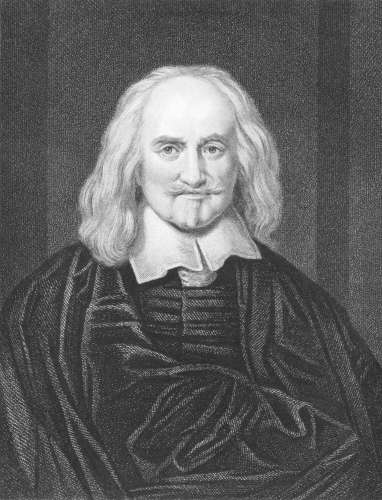
T. Hobbes, l'état de nature ou l'insociabilité de l'homme
Thomas Hobbes, lorsqu’il s'exprime sur la guerre avait été précédé par Machiavel, Grotius et Pufendorf et ces deux derniers par la prééminence philosophique d'Aristote et de Cicéron. Leurs postulats implicites vont commander aux spéculations sur la guerre de demain, en distinguant ce qui est variable, l'historicité des moyens et des modes de combat, soient-ils stratégiques ou tactiques, de leurs traits invariants et marquants, le caractère politique de la guerre et l'occurrence an-historique de l'affrontement belliqueux. Les occasions infiniment renouvelées d'hostilités entre les hommes et entre les États imposent la distinction sur les différents usages de la violence brute, puisque la guerre implique la mise un œuvre planifiée et à long terme d'une politique de défense et de sécurité, à caractère proprement géopolitique et stratégique. La politique de défense est fondée sur la taille de l'ennemi, la passionalité du peuple, l'espérance politico-stratégique de gain, les prévisions des buts, le calcul des moyens, les renseignements disponibles, l'état de la société et l'univers de la parole et des images, qui sont des pouvoirs puissants et inséparables de la pratique de la guerre. Il s'agit des aspects tactiques et opérationnels, ceux de la bataille, des duels et de la conquête des cœurs. Tout autre est par contre l'importance, pour la transformation du champ diplomatique et par les acteurs aux prises, de la constitution de coalitions et d'alliances, afin d'équilibrer ou déstabiliser le jeu adverse et maintenir ou consolider la cohésion entre les alliés, autour de principes communs. Le débat actuel sur la guerre de demain, robotisée, numérisée, atomique et spatiale appartient au domaine du combat et du terrain, tandis que l'état d'insécurité appartient à l'ordre dominant des États, à la condition hiérarchique et au même temps chaotique des unités politiques, à leurs équilibres et rapports de forces, ou en d'autres termes, à l'état de nature perpétuelle "des monstres froids". Cependant l'expérience de la guerre entre les États, qui a été lourdement oubliée par les européens, n'ajoute rien à la guerre civile entre citoyens et non citoyens, à l'intérieur des différents pays-membres (entre croyants en la valeur de l'autorité établie et opposants de toute nature au principe d'autorité et de leadership, principalement étrangers). La guerre entre puissances souveraines est en effet de même nature que celle entre races, ethnies et peuples, décolonisés, insurgés, anarchistes, LGBT, wokistes et black-matters, qui vivent dans les entrailles des sociétés et pullulent dans le désordre de ses ruines. Il s'agit d'assemblages chaotiques de masses sans "surmoi", encore endormies dans l'esclavage intellectuelle de l'humanité, qui n'a jamais cessé d'exister et qui perdure dans l'illusoire robotisation des esprits, sous le vernis hideux de l'égalité et de la civilité apparente.

La "Loi contre le Séparatisme" en France et la "Guerre Civile" menaçante
Tout vaux mieux, pour Hobbes, que la guerre civile. La France voudrait l'éviter, tardivement, par la "loi contre le séparatisme" et pour le "Respect des principes de la République", votée à l'Assemblée Nationale le 23 juillet 2021. A propos de la guerre civile,dont le risque est cachée sous le terme de "séparatisme", une analogie s'impose. En situant "l'état de nature" qui caractérise las rapports inter-étatiques au même niveau que celui des rapports internes, Hobbes donne tout son sens aux relations d'hostilités qui assimilent en profondeur les deux types de guerre, la crainte permanente de la mort violente, ou encore la désagrégation des États. Ainsi "l'état de société" ressemble à "l'état de nature", et celui-ci est déjà la guerre de demain, mais de l'intérieur. Or, puisque "l'état de nature" est identifié à l'hostilité et au chaos, l'état d'insécurité qui en résulte est une condition de déchirement, où le pouvoir commun cesse d'assurer l'ordre et la sécurité et chacun reprend en main son droit de se défendre par lui même (Jus gladii privati). Cette condition de dissolution et de calamité, si semblable aux "zones de non droit" des banlieues françaises, soumises à une loi incompatible avec celle de l’État en place, la Charia, fait naître le besoin d'un maître, car n'importe quel régime ou quelle tyrannie vaux mieux, dit Hobbes, qu'une société sans maître et sans lois. Sans un gouvernement "d'arbitrage", au sens de l'équilibrage des forces et de gouvernement des affaires courantes, les hommes et les groupes vivraient dans un état de "guerre civile permanente".
Hobbes, la société sans maître et la dictature consulaire
Là où les regroupements sociaux ont de surcroît des appartenances culturelles et civilisations antagonistes et étrangères, comme en beaucoup de pays occidentaux, la fonction d'arbitrage du pouvoir doit s'imposer comme autorité inconditionnelle et, si nécessaire, comme "dictature consulaire" ou dictature transitoire, appuyée sur les légions, plutôt que sur le Sénat, sur la décision plutôt que sur la délibération sans fin. La dictature consulaire n'est guère à confondre avec la tyrannie, qui est l'abus de pouvoir de gouvernants qui se placent eux mêmes en état de guerre contre le consensus des dominés, suscitant une "rébellion". Un tel recours à l'arbitraire de la part des gouvernants, typique de l'état de nature et de l'absence de lois qui le caractérise, provoquerait, chez les individus, d'après Locke, le droit naturel de se défendre. Le but d'éviter une rechute dans le chaos et d'éviter la dissolution de la société, qu'elle puisse s'appeler, France, Allemagne ou Europe, rend plausible, suivant les classiques, un recours à un gouvernement, qui embrasse à la fois les deux concepts, de paix et de guerre,afin de préserver la cohésion sociale De paix, puisque la paix n'existe pas en nature et elle est l’œuvre de la politique et de l’État et de guerre, sanglante et brutale, car la guerre, en vue de la paix civile est un moyen en vue de sa fin,autrement dit, la pacification durable des hommes. En réalité, si la paix a pour cadre général et artificiel la société civile, elle s'accomplit dans la cité et dans la nation. En Europe, selon le modèle augustinien de la séparation des deux cités, de Dieu et de César, en Islam, selon la loi divine, supérieure et unique du Coran. Guerre de religions et guerre des dieux ? C'est l’enjeu de la guerre de demain sur le plan intérieur. La guerre, comme gouvernement de la coexistence entre les États, implique une coexistence complexe de la paix et de la guerre et donc un difficile gouvernement du système-monde. Le désordre chaotique des États et de leurs regroupements géopolitiques doivent en somme cohabiter avec "l'insociable sociabilité" des sociétés civiles de Hobbes. Dans ce cas, l'idée de paix fait figure d'ultime rationalité de l'espoir humain.

L'impérialité mutipolaire et ses guerres
La guerre inter-étatique de demain sera dictée, comme toujours, par un cumul de crises sans issues. La recherche d'un espace de liberté de la part des unités politiques majeures sera portée par la logique de prééminence ou de suprématie, qui ne coïncidera pas toujours avec le concept d'impérialité hégémonique et sa vision. La naissance de celle-ci a précédé la naissance de l'Europe et a comporté une série séculaire d'affrontements sanglants. Quant à l'Europe d'aujourd'hui, structurellement allergique à tout projet de prise de souveraineté et à toute culture agonistique, ses guerres seront dictées et presque imposées par son avenir eurasien et euro-atlantique, une posture inconfortable qui la lie, par l'histoire à son passé civilisationnel et par la géopolitique à sa dimension euro-continentale. Les formes politiques de ces enchevêtrement de conflits ne serons plus celles menées par les démocraties parlementaires des États nationaux, mais celles autocratiques ou présidentialistes des empires continentaux de jadis.
L'Europe des nations, issue du reflux de la mondialisation (2015-2021), n'est plus celle des nationalismes offensifs et rivaux des entre deux guerres, mais celle de la sauvegarde de leurs identités menacées. Le contenu de l'idée nationale est autre aujourd'hui que par le passé. La politique de dissociation nationale (Brexit) et d'intégration impériale (atlantisme), répugne à la France, isolée et déclinante, mais séduit l'Allemagne montante, dépourvue de la vieille conscience historique et passée de la doctrine du "peuple-maître" à celle du "peuple-partenaire", mal cousue dans les habits d'un fédéralisme administratif et d'un européanisme exsangue. La France, minée de l'intérieur par l'effondrement de l'autorité est à l'aube d'une "surprise stratégique" venant de l'intérieur, par la remise en cause, qui lui sera fatale, de son unité constitutive, le peuple-nation.
Quelle que soit la part de l'Europe dans les batailles pour la suprématie du système, la victoire militaire, au plan historique, sera t-elle encore, celle des puissances maritimes, auxquelles elle appartient? Dans une conjoncture totalement inédite, les guerres majeures de demain seront des guerres d'une impérialité multipolaire, à échiquier systémique, à projection planétaire et au choc violent et rapide, dévalorisant le principe de l'équilibre des forces. Les acteurs mineurs, européens et asiatiques, joueront leur partition robo-numérique, en vassales de chaque pôle, sous la coordination autoritaire des trois maîtres dominants de bloc (États-Unis, Chine et Russie), et les buts de guerre assignés, excluront toute paix de compromis.
Il s'agira de guerres d'anéantissement ou de soumission, car la violence paroxystique de leurs concepts stratégiques excluront toute coexistence civilisationnelle. L'enjeu sera, dès le début, une impérialité sans partage et celle-ci aura une dominance, scientifique, cognitive et intellectuelle, qui soumettra l'affrontement global, aux ambitions et aux projets de leurs maîtres.

Le monde des Impérialités établies sera soumis à une sorte de "soft balancing" de la part des puissances régionales existantes, réagissant, en contre-tendance, à toute politique de primauté. Cette évolution n’infirme pas la considération de fond que la solution des problèmes majeurs exigera toujours une intervention ou un soutien de la part des puissances majeures. L’avenir du multilatéralisme, asservi à la logique des grandes puissances sera un multilatéralisme de groupe, qui pourra jouer un rôle influent, à la condition qu'il y soient inclus les grands acteurs du système.
Quoi donc de la future distribution des pouvoirs intermédiaires, ou encore de la démographie et des ressources? Quoi de la justification et de la légitimité des nouvelles hiérarchies et des nouveaux souverains-gouverneurs? Dans ce nouveau Moyen-Age post-moderne de l'affrontement, nous assisterons à l'émergence d'une nouvelle sacralité du pouvoir,ritualisé avec des liturgies modernisés, à la manière des anciens royaumes, légitimant, aux jeux des opinions, la victoire de la robotique guerrière et de la puissance numérique. Entre l’Égypte des Pharaons et la ruche des abeilles, l'architecture des souverainetés impériales choisira les formes de soumission du travail planétaire et le nouveau servage des continents, où des lutte pour la liberté, marginales et rebelles, rappellerons l'ancien mythe de Sisyphe.
Les masses dépolitisées des ingénieurs, scientifiques, business-man et financiers, apporterons leurs savoirs et compétences aux plate-formes systémiques des États majeurs, jusqu'à la surveillance semi-permanente des données sensibles. La géopolitique des données constituera le reflet et la substance de cette rupture culturelle et scientifique .
In fine, dans ce tournant décisif du procès historique, l'opprobre impérial tombera sur la démocratie, l'égalité et l'histoire sociale du progrès et la nouvelle ère sera inégalitaire, positiviste, post-humaniste et post-hégélienne, dessinée par la force de transformation des rivalités de la triade (Chine, États-Unis et Russie) et par la montée des périphéries du monde.
A partir d'ici, l'histoire du futur engendrera une nouvelle guerre contre la renaissance de la dialectique de la raison, philosophiquement iconoclaste et l'Impérialité s'en défendra avec acharnement. Le rêve même de la grande Harmonie se désagrégera alors de l'intérieur et tombera en ruine, enfermé par la grande muraille de l'oubli et des utopies.
Un débat se fait jour dans l'immédiat sur la guerre inter-étatique de demain, s'interrogeant sur la forme que prendra le conflit, de haute intensité, de "guerre sans limites", ou encore de "guerre invisible", secrète et souterraine? La conjoncture que nous vivons, par sa réticence dans l'emploi de la force militaire de la part des acteurs majeurs de la scène internationale et de de l'extension visible des domaines de l'affrontement, impliquera "un changement de la grammaire stratégique, mais pas de la logique de la guerre" (Clausewitz). Il en résultera un nouveau visage de la guerre, profondément modelé par la révolution technétronique et par le complexe militaro-numérique, qui affecte la stratégie des moyens et le champ de bataille, provoquant une inversion de l'innovation qui va désormais du civil au militaire et du stratégique au politique.
L'impérialité, comme tendance à la suprématie et à l'empire découle d'une vision moniste de l'histoire, à la différence de la multipolarité, fondée sur l'hétérogénéité et le pluralisme des États, unifiés par l'unicité du système et distincts par la race, par la culture et l'histoire.
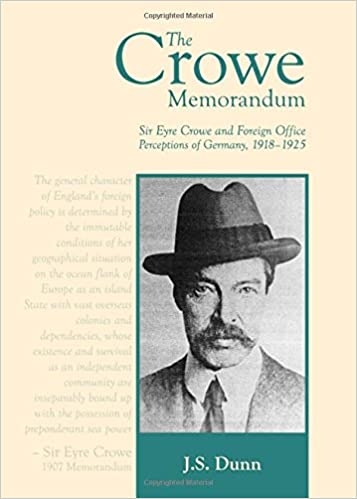
Diplomatie et guerre. Sur les grandes rivalités Hégémoniques
Le "Mémorandum Crowe" et la rivalité anglo-allemande
Dans le contexte des théories sur la "montée pacifique" de la Chine et sur l'avènement d'un "monde harmonieux", le niveau d'assurance de ces déclarations dépend du niveau de crédibilité de la diplomatie et du degré de confiance, induit par la stabilité régionale. Ces deux référents peuvent être compromis par le développement de la technologie et des systèmes d'armes, conçus en vue d'acquérir une avancée stratégique significative et cet impact amène en retour à une course aux armements et à des risques de conflits. C'est au sujet d'une analyse comparée des équilibres internationaux du concert européen du XIXème et des perturbations dans le calcul des rapports de force, successifs à l'unification de l'Empire allemand en 1871, que le débat sur le destin national de la Chine (2007-2010), a suscité une quête sur les sources de la confiance d'un pays millénaire, la tradition, l'idéologie et l'esprit national. L'analyse historique semble avoir démontré que les causes du conflit de la première guerre mondiale en Europe furent moins les structure des rapports de forces issus de l'unification allemande, que les enjeux et les ambitions des élites de l'Empire et, parmi d'autres importants facteurs, le plus influents de tous, le nationalisme et les irrédentismes diffus. La rivalité anglo-allemande, qui se greffait sur cette tension permanente, domina la politique européenne de la fin du XIXème, lorsque le monde se résumait à l'Europe et fut caractérisée par les difficultés d"une diplomatie rigide et sans flexibilité, limitant le champ d'action des principaux pays du concert européen. En effet, compte tenu de l'unification de l'Allemagne montante, qui se sentait entourée d'hostilité et de limites à son influence, poussa le Foreign Office britannique à s'interroger sur la menace objective de l'Empire allemand, pour sa survie et pour la compatibilité de la montée en puissance, surtout navale, d'un pays continental, avec l'existence même de l'Empire britannique.

Aujourd'hui comme hier la compétition est devenue stratégique et la limitation des espaces de manœuvre consentis, a provoqué la lente création de deux blocs d'alliances rivales, auxquelles le nationalisme ou le souverainisme renaissants fournissent l'aliment idéologique pour les futurs belligérants. En ce qui concerne l'analogie historique, toujours imprécise, entre la situation européenne du XIXème et celle eurasienne du XXIème, la question de fond,qui préoccupait la Grande Bretagne de l'époque et les États-Unis d'aujourd'hui, était de savoir si la crise d'hégémonie et le problème de l'alternance qui iraient se manifester, étaient dus à la structure générale de la configuration du système ou à une politique spécifique de l'un ou de l'autre des deux "compétitors" et si, in fine, l'existence même de l'empire américain serait menacée et avec elle, celle de l'Occident et de la civilisation occidentale, jusqu'à sa variante russo-orthodoxe. Le "Mémorandum Crowe", dans le cas de l'Allemagne montante et dans le cadre d'une analyse de la structure de la puissance, concluait pour l'incompatibilité entre les deux pouvoirs, britannique et allemand, et excluait la confiance et la coopération de la part de la Grande Bretagne. Ainsi l'importance des enjeux, interdisait à celle-ci d'assumer des risques et l'obligeait à prévoir le pire. Ce qui arrivera avec la première et deuxième guerre mondiales.
La "déclaration Stoltenberg" et la rivalité sino-américaine
Y t-il quelque chose d'équivalent du "Mémorandum Crowe" dans la crise d'hégémonie des États-Unis et dans la montée en puissance de la Chine, comparable à celle des deux pouvoirs anglo-allemand du XIX /XXème siècle et, dans notre cas à l'existence même de l'Occident?
Partie et juge de ce "Grand-Jeu" d'alternance historique, l'Alliance Atlantique, devenue une alliance de sécurité à perspective globale, par la voix de son Secrétaire Général, Jens Stoltenberg, a souligné l'importance du "moment charnière" de l'OTAN, dans le but de relever la gravité de l' inversion de prééminence entre États-Unis et Chine et l'exigence, pour les puissances occidentales, d'en relever le défi.

L'hégémonie chinoise paraît inacceptable à l'Amérique impériale, comme l'allemande à la Grande Bretagne du XIXème siècle et, par l'intermédiaire de l'OTAN en Europe et de l'Anzus en Extrême Orient, elle doit apparaître comme telle, à une grande partie de ces pays.
Ainsi le Sommet du 15 juin 2021 à Bruxelles pourra-t-il avoir la même signification et portée pour les États-Unis que le "Mémorandum Crowe" pour l'empire britannique du XIXème? L’ambiguïté des interprétations n'exclut pas le risque du pire. Donner la priorité à l'isolement de la Chine et à la désescalade avec la Russie, en a été la lecture plus optimiste pour le destin de l'Occident L'idée de créer une alliance mondiale des démocraties à deux pôles, l'OTAN, pour le théâtre européen et le Quad (Usa, Japon Australie et Inde) pour l'Asie-Pacifique, a justifié, en arrière fond, deux projets concordants, une indépendance politique et une autonomie stratégique de l'Europe vis à vis des États-Unis et simultanément la recherche d'un apaisement vis à vis de la Russie. Face à la résilience de l'Alliance atlantique et à l'influence grandissante de la Chine, la menace immédiate est apparue cependant celle de la Russie (Ukraine, Bélarus et Pays Baltes), restaurant la confiance contradictoire des élites asservies à l'Amérique déclinante.
La prise de conscience historique et la subordination de la démocratie à l'hégémonie
Ainsi, sommes nous étonnés qu'une alliance politique et militaire (l'OTAN), à un "moment charnière" de son histoire, fonde, par une déclaration de son Secrétaire général, sa prise de conscience historique sur un tournant décisif dans l'évolution du monde comme géopolitique accomplie et qu'elle présente ce moment comme une leçon pour l'avenir et comme une liaison du présent et du passé? Moment éclairant ou paradoxe sans précédents? Que signifie-t-elle cette conscience, si non l'inscription de notre futur proche dans les déterminismes des grandes forces historiques, autrement dit dans les traits originaux d'une conjoncture planétaire, où une seule question est essentielle: "Le "Grand Jeu" du XXIème siècle se passera-t-il à l'intérieur du système ou sera-t-il une remise en cause de ce dernier, remettant en question la structure et la hiérarchie de celui-ci et renversant la civilisation de l'Occident?" Dans cette perspective le dilemme de la paix et de la guerre n'est plus une pure hypothèse, mais un alignement nécessaire à Hégémon, dont la portée transcende le conjoncture et concerne l'histoire de l'humanité toute entière. Avoir l'idée d'être engagés dans l'histoire suppose, pour une collectivité donnée,d'avoir une vision plus large de la simple connaissance, incluant un choix d'action, comme un engagement "libre" et à haut risque.
Concrètement et stratégiquement l'antagonisme sino-américain au Sommet de Bruxelles, a pris le dessus sur le rapprochement russo-chinois, de telle sorte que la logique de la contingence transforme la nature traditionnelle des concepts et que la démocratie devient un instrument de l'hégémonie (et pas le contraire); une modalité pour garder ou pour atteindre le pouvoir global, puisque la protection et la sécurité sont conditionnées par l'obéissance (Hobbes).
 Dès lors le débat sur le "destin national" (Liu Mingfu), qui s'est tenu en Chine dans les années 2010, a quitté le terrain du politique pour devenir le mode de penser d'une civilisation en marche et d'un puissant univers qui ré-émerge et s'affirme (Chine) à l'échelle mondiale.
Dès lors le débat sur le "destin national" (Liu Mingfu), qui s'est tenu en Chine dans les années 2010, a quitté le terrain du politique pour devenir le mode de penser d'une civilisation en marche et d'un puissant univers qui ré-émerge et s'affirme (Chine) à l'échelle mondiale.
La menace régionale est devenue systémique et elle n'est plus seulement d'ordre militaire mais repose sur l'unité organique d'un "sens", qui mobilise les esprits et les forces de toute une époque et trouve sa forme accomplie non pas dans un régime politique précaire et abstrait (la démocratie et l'universalisme politique régnant et contingent), mais dans l'empire, la forme "perfectissima" du gouvernement des hommes, transcendant la politique et les changements séculaires des équilibres des pouvoirs.
Pouvons nous dire avec certitude qu'une hégémonie politico-culturelle sur l'Eurasie, plus encore qu'une supériorité politico-stratégique menace l'indépendance des autres États du monde et l'existence même de leur souveraineté?
La logique du doute est de méthode, car le critère de l'ami et de l'ennemi reste latent dans la politique intérieure et sert à briser toute opposition (Navalny, Hong-Kong, Taïwan, Xinjiang), remettant en cause la distinction traditionnelle de légalité et de légitimité, poussée à son extrême dans la politique internationale. L'ennemi devient une puissance objective et hostile et c'est là, dans les "moments charnière" de Stoltenberg, que la tension latente devient active et maintient l'histoire du monde en mouvement
La confiance stratégique et la coopération authentique d'un Sommet de l'OTAN pourront elles interdire, freiner ou retarder la confrontation ou le "duel du siècle"? De la part de qui et sous quelle forme viendra-t-elle la décision? Sera-t-elle individuelle ou collective, proche ou à long terme, vue l'énormité des enjeux et la rupture de la digue, fissurée par l'antagonisme des mondes, qui retient l’Himalaya et le Tibet de leur glissement tectonique vers les deux Océans, Indien et Pacifique, eux mêmes périclitants.
La désoccidentalisation du monde et l'asymétrie des volontés
Les formes de antagonisme dans les différentes régions de la planète est l'un des thèmes majeurs du "Rapport de la CIA sur l’État du monde en 2020", publié en 2005, au titre significatif: "La désoccidentalisation du monde". Celle-ci peut être résumée à une augmentation des dépenses militaires, bien supérieures à celles de l'Europe et donc à une inversion de l'asymétrie des moyens, comme preuve d'une asymétrie des volontés.
Dilemme global, dans un cadre géopolitique planétaire et contraignant, celui d'un système international en pleine transformation, dont les principes constitutifs, la hiérarchie et les interdépendances, sont contestés et remises en cause politiquement.
Le concept-clé de cette remise en discussion est celui de monde multipolaire et le cadre dominant celui de sa triade, États-Unis, Russie et Chine. L'Europe en revanche est entrée à nouveau dans un processus d'instabilité et de désagrégation (Brexit, fissuration est-ouest, tensions euro-turques, crises migratoires etc). Le terme extrême et radical de cette transformation s'appelle "guerre" et celle ci concerne la configuration système lui même, sa hiérarchie et sa philosophie, bref, son pouvoir et son impérialité historique.
L'amplification des dangers et la guerre de demain
Scruter les signes de cette évolution c'est maîtriser l'avenir, car tout est signe et indice dans les plus hautes combinaisons stratégiques! En effet on ne combat pas les accidents mais les vagues montantes et irrésistibles. Or, la guerre de demain c'est la menace d'aujourd'hui, qui grandit sous un nouveau visage et au cœur des défis les plus grands. La guerre de demain n'est pas seulement limitée à la modification du visage apparent de la guerre ou à sa "grammaire", mais, et encore plus, à l'extension de sa "logique" profonde, politique et systémique.
Cette logique s'appelle direction de l'histoire, ou, en d'autres termes, inversion d'une hégémonie montante, que nous appelons une 'impérialité, élevée à la sommité des événements par le sentiment métaphysique de l’homme. Or dans les guerres s'affrontent les peuples qui partagent les mêmes métaphysiques ou les mêmes dieux et toutes les divinités de la lutte, même endormies, sont réveillés par les passionalités des peuples en situation de danger.

Ainsi nous pouvons dire, par une sorte d'analogie hasardeuse, que la perte de l'unité stratégique de l'Occident, la crise des démocraties, l'émergence des régimes autoritaires et l'ère de la démondialisation actuelle, coïncident avec une période d'amplification des dangers, représentés par des ruptures de la rationalité dissuasive et, au niveau conventionnel, par des combats déréglés, hybrides et hors limites.
Hétérogénéité du système et multipolarité
Enfin, compte tenu de l'hétérogénéité du système, cette situation engendre une stratégie défensive de la part d'Hégémon, consistant à anticiper la dissidence de membres importants de la communauté d'appartenance (sortie de la Grande Bretagne de l'UE et l'éloignement de l'UE des États-Unis), en maintenant au même temps la cohésion des alliances (OTAN/ANZUS).
Au niveau des nouvelles incertitudes et des nouveaux défis, l'Europe aura des difficultés à établir une connexion entre la diplomatie multilatéraliste, pratiquée jusqu'ici et la diplomatie multipolariste dominante dans la scène planétaire. Le multipolarisme s'affirme comme tendance à la régularité classique des regroupements politiques dans l'organisation des relations internationales et la compréhension de cette évolution exige, aux vues de la puissance dominante du système (les États-Unis), de faire recours à deux grandes interrogations :
- Quelle stratégie adopter vis à vis d'une grande coalition eurasienne et anti-hégémonique, Russie-Chine-Iran ?
- Quelles hypothèses de conflits ouverts entre pôles et quels scénarios de belligérance entre pôles continentaux et pôles insulaires.
Fin de la stabilité hégémonique et monde post-ioccidental
La question qui émerge du débat sur le rôle des États-Unis, dans la conjoncture actuelle, en Europe et dans le monde, est de savoir si la "stabilité hégémonique" (R. Gilpin), qui a été assurée pendant soixante dix ans par l'Amérique, est en train de disparaître, entraînant le déclin d'Hégémon et de la civilisation occidentale, ou si nous sommes confrontés à une alternance hégémonique et à un monde post-occidental. La transition de la fin de la guerre froide au système unipolaire à intégration hiérarchique incomplète s'est précisé comme une évolution vers un pouvoir partagé et un leadership relatif.
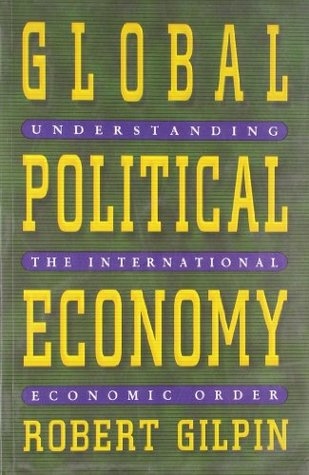
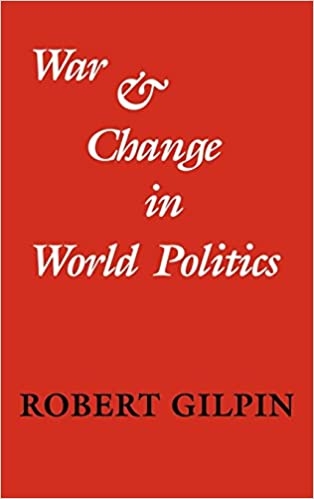
La transition nouvelle (celle de la nouvelle guerre froide), s'est manifestée comme :
- l'incapacité d'Hégémon d'imposer un ordre planétaire contraignant et comme lente décomposition du moment américain (déclin progressif de l'unipolarisme capacitaire et de l'unilatéralisme décisionnel).
Cela s'est traduit:
- par le passage de la "global dominance" de la période unipolaire au "global leadership", qui définit une série d'équilibres de réseaux et une fonction d'arbitrage que la puissance dominante (USA) exerce au sein de ses équilibres de réseaux.
En ce sens, le "leadership global" des États-Unis, face a la Russie et à la Chine, dispose d'un large éventail d'options, lui permettant de faire recours à une panoplie des moyens politiques plus différenciés :
*un réseau mondial inégalé d’alliances militaires; des partenariats stratégiques de choix, à l’extrémité ouest du Heartland (Europe), ou dans la jonction intercontinentale du plateau turc et sur la façade littorale de Moyen Orient (Israël), ainsi qu'une constellation insulaire et péninsulaire des "pays pivots", tout au long du Rimland (Japon, Inde, Golfe)
* in fine, un multilatéralisme institutionnel et informel, alternatif et de convenance.
Au passif des États-Unis, ces atouts ne peuvent cacher les déconvenues et les échecs, dont le plus retentissant a été l'Afghanistan. Ici les leçons apparaissent en toute lumière: la reconquête du pouvoir par les taliban, la poursuite et l'extension de l’instabilité en Asie centrale au détriment de l’Ouzbékistan, du Tadjikistan et du Pakistan, et, indirectement de la Russie, mais à l'avantage de la Chine. La poursuite du conflit n'a d'autre but que de déstabiliser l'Iran.
En termes plus imaginatifs on pourrait traduire cette situation comme celle des souverains des trois empires qui, dans la "Grande salle du Millenium", enfouie au cœur du Karakorum, se disputent le monde, le billiard à côté du cercueil, le Groenland contre la Terre du feu et l’Arctique contre l'Antarctique aux confins des Océans, et sous le regard perçant de la Force, de la Justice et de la Morale.
Conflits en chaîne ou "révolution systémique"?
L'interrogation qui s'accompagne à ce déclin et à la transition vers un système multipolaire articulé, est également centrale et peut être formulée ainsi: "Quelle forme prendra-t-elle cette transition?"
La forme, déjà connue, d'une série de conflits en chaîne, selon le modèle de Raymond Aron calqué sur le XXème siècle, ou la forme plus profonde, d'un changement bouleversant de la civilisation, de l'idée de société et de la figure de l'homme, selon le modèle des "révolutions systémiques", de Stausz-Hupé, embrassant l'univers des relations socio-politiques du monde occidental et couvrant les grandes aires de civilisations connues? Dans ce cas, il apparaît évident que cette transition ne marquera pas un accord sur des principes de légitimité, pouvant assurer la stabilité du monde, comme aux temps du Congrès de Vienne de 1815, mais la concordance fatale d'un condominium sur le monde entre les États-Unis et la Chine, ou une guerre générale et totale pour la prééminence impériale, comme dans la guerre du Péloponnèse. Concordance inexorable, inhérente à la dimension contingente de l'histoire humaine et à la fatalité des destins politiques, selon l'interprétation globale du devenir et selon les modèles stylisés de "rupture", qui n'ont épargné aucune grande civilisation. Hier, comme aujourd'hui, la réflexion sur la guerre est à la base de toute philosophie de la paix, car la ruine d'un système est aussi la naissance d'un autre, lié à une autre idée constitutive, ou à une autre civilisation.
Bruxelles, le 11 Août 2021
***
VIDEOS
***
Les vidéos ci jointes ébauchent une réflexion sur une pédagogie européenne et internationale alternative et préludent à cinq réalisations thématiques, produites il y a cinq ans (2017).
Ces deux premières vidéos portent les titres:
"Changer d'Europe, sans changer de civilisation"
https://www.youtube.com/watch?v=BX72peB9Mm0
"La révolution des patriotes et la Reconquista de l'Europe"
https://www.youtube.com/watch?v=4u3k4gnfT7M
12:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : irnerio seminatore, relations internationales, politique internationale, actualité, géopolitique, multipolarité, ordre mondial, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 23 juillet 2021
Le paradigme monopolaire dans un monde polycentrique
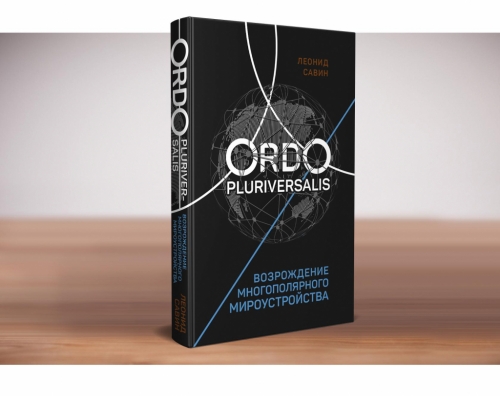
Le paradigme monopolaire dans un monde polycentrique
par Yevgeny Vertlieb
Recension de la monographie de Leonid V. Savin Ordo Pluriversalis : the Revival of a Multi-polar World Order.
Alexandre Douguine, penseur et leader bien connu du mouvement international eurasien, est convaincu que le meilleur des systèmes est un ordre mondial multipolaire qui remplacerait à terme l'ordre "unipolaire " (1). La défense d'un modèle d'ordre mondial multipolaire est le leitmotiv de la monographie, que nous analysons ici, et qui émane du politologue L.V. Savin (2). Le livre a été écrit et publié à l'occasion du 100ème anniversaire de la publication de l'ouvrage du prince N. S. Trubetskoï "L'Europe et l'humanité" - le premier, selon Douguine, qui constitua un véritable texte eurasiste, une théorie structurée de l'eurasisme de première mouture, composé "pour vaincre l'Occident de l'intérieur". La publication d'information et d'analyse Geopolitika, dirigée par Leonid Savin, a été amenée, en raison de sa farouche position orthodoxe et pro-eurasienne, à être considérée par le département d'État américain comme l'un des piliers de "l'écosystème de la propagande et de la désinformation russes". Le comité de rédaction de ce think tank russe, quant à lui, considère les sanctions américaines comme punitives - "faisant partie d'une répression soutenue dirigée contre les sources d'information alternatives qui n'acceptent pas l'ordre du jour néolibéral, celui d'un monde unipolaire".
L'analyste du système qu'est Leonid Savin mène tambour battant un "brainstorming" pour identifier les dispositifs des systèmes adverses et développer des règles et des mécanismes pour l'établissement et le fonctionnement d'une sécurité globale pour tous. L'argument est que le vieux modèle de "la bonne démocratie contre le mauvais autoritarisme" ne fonctionne plus; que des alternatives aux modèles et aux dogmes dépassés sont nécessaires; que le courant occidental du néolibéralisme-mondialisme cède la place à un monde multipolaire dominé par des valeurs conservatrices. Le changement devient le déclencheur de la dé-modernisation et annonce la réadaptation des modèles et des schémas antérieurs qui avaient régi relations internationales.

Cette expertise par Savine de la multipolarité est désormais le thésaurus d'une approche non occidentale déterminée par une perspective multivariée sur l'ordre mondial.
Cette monographie repense les fondements de l'État pour y inclure la religion, l'économie, les visions du monde propres aux peuples réels, les attitudes à l'égard du temps et de l'espace, les thèmes de la sécurité et de la souveraineté, le nationalisme et les civilisations. Cette exploration à plusieurs niveaux de la structure polycentrique du système politique mondial s'appuie sur une abondance de faits illustratifs et contient des conclusions existentielles-substantielles originales.
L'équilibre des forces est une loi de la politique et une condition de la non-guerre. Le trouble bipolaire est un malaise bloquant de la politique et une aggravation des contradictions de la société. L'équilibre des pôles mutuellement opposés a pris fin avec l'effondrement de l'URSS. Pour la sécurité mondiale, une telle rupture dans le système bien rodé d'extinction des conflits en résonance est comparable au cataclysme naturel de la croûte terrestre lorsque les plaques tectoniques nord-américaine et eurasienne ont divergé et que des failles géantes sont apparues - le danger des conséquences du déséquilibre de la parité des pouvoirs : la tentation d'une frappe impunie contre l'ennemi ontologique. Et le pathos du discours de Winston Churchill à Fulton en 1946 confirme cet axiome : "L'ancienne doctrine de l'équilibre des forces est désormais inadaptée. Nous ne pouvons pas nous permettre - autant que faire se peut - d'agir à partir d'une position de faible prépondérance, qui introduit une tentation d'engager une épreuve de force". D'où : même une petite prépondérance de forces stratégiques provoque l'expansion.
Le "moment unipolaire" de l'ordre mondial centré sur les États-Unis a duré de la fin 1991 (année de l'effondrement de l'URSS) au 15 septembre 2008 (avec l'effondrement de Lehman Brothers). Les États-Unis sont toujours une superpuissance. Mais ne sont plus un tuteur mondial: ils sont un centre de gravité, un médiateur. Les universitaires J. Nye et R. Keohane estiment qu'en tant que régulateur mondial, un seul État fort ayant le pouvoir d'approuver les règles de base régissant les relations interétatiques et la volonté de le faire est suffisant. Un centre de pouvoir parallèle et émergent revendique de manière hégémonique sa ceinture chinoise mondiale. À court terme, cependant, il n'y aura pas d'"ère à deux pôles".
Le "soft power" de la Chine obtient ce qu'il veut. La Chine a utilisé avec succès la mondialisation pour mener à bien la modernisation sans occidentalisation. Elle s'obstine à former ses propres espaces géopolitiques (SCO, BRICS) et géoéconomiques (zones de libre-échange). Avec son ambitieux projet "One Belt, One Road", elle fait d'une pierre trois coups : 1) elle empêche le pays de tomber dans le "gouffre d'un ralentissement économique imminent", 2) elle construit et protège ses infrastructures avec des bases militaires, et 3) elle attire les pays en développement dans l'orbite des plans stratégiques chinois. Leurs stratèges archaïques parlent de domination économique, culturelle et militaire sur les autres pays et d'un "ordre international fondé sur un système unipolaire" dans lequel la Chine fixe seule les règles. Ils n'ont certainement pas oublié les trois siècles de confrontation géopolitique avec la Russie. Après le conflit de Daman en 1969, les Chinois se sont jusqu'à présent contentés d'un "voisinage harmonieux" avec la Russie, considérée comme "l'arrière" de la géopolitique chinoise. Mais ils ont aussi la géostratégie du fouet à revendre : l'établissement d'une alliance temporaire avec un pays lointain pour vaincre un ennemi voisin. Pékin est capable de tirer un maximum de dividendes - même de l'effondrement de la bipolarité USA-URSS.
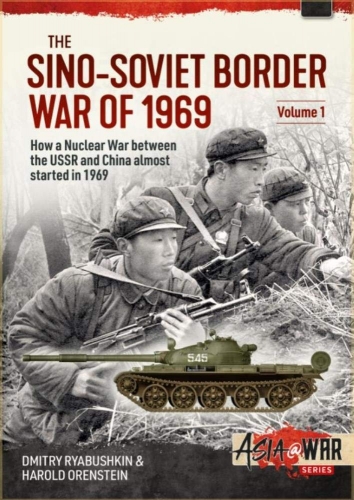
Dans un monde en mutation, l'azimut de la confrontation géopolitique n'est plus Ouest-Est, mais les conglomérats rivaux : l'Union européenne, la zone de libre-échange nord-américaine (ALENA), la zone de la "grande économie chinoise", le Japon et le groupe des pays de l'ANASE. Le monde est consolidé institutionnellement par paires (OTAN-ODCB, G7-SCO, UE-CIS) (3). Un ordre mondial trop interdépendant (aux États-Unis, par exemple, les produits pharmaceutiques de la Chine) est marqué par la prudence puisqu'il faut adhérer au "consensus de légitimité, de souveraineté et de gouvernance".
Mais dans l'actuelle "tripolarité" conflictuelle, il est difficile de parvenir à une harmonie dans les relations internationales. Le modèle multipolaire est né avec la consolidation de la géopolitique comme stratégie visant la sécurité et la justice dans les affaires internationales depuis le Congrès de Vienne en 1815. La multipolarité correspond à la géostratégie actuelle de la Russie, qui consiste à "équilibrer l'équidistance" (ou généraliser le principe d'"équidistance").
Le livre de Leonid Savine établit une méthodologie permettant d'évaluer la multipolarité de retour: c'est un concentré de propédeutique (le commencement des commencements), d'anamnèse (repérer ce qui a précédé), de diagnostic (ce qui est) et de prédiction (ce qui sera) de l'état transitoire actuel où l'ordre mondial est en phase de reformatage. Le concept de culture stratégique (4) est considéré comme un élément d'identification spécial, important pour l'État.
Dans une confrontation multipolaire "tout contre tout", une connaissance inexacte de l'ennemi est dangereuse pour un état-major militaire. Cette vulnérabilité a coûté à Joachim von Ribbentrop la potence et à Adolf Hitler sa défaite dans la guerre. Il est utile pour les développeurs des systèmes qui gèreront les nouvelles relations internationales et la politique globale de se familiariser avec les concepts avancés par Leonid Savine: la théorie du néo-pluralisme, la synthèse de la politique esthétique et de la quatrième théorie politique. La théorie de la politique durable de notre auteur repose sur une pensée holistique conservatrice; elle est particulièrement attrayante pour les personnes orientées "extra-libérales". Le rejet du libéralisme radical, qui caractérise les sociaux-démocrates européens ainsi que les républicains de droite du type gaulliste-adenauérien, pourrait constituer la base d'un rapprochement entre les partisans d'un équilibre durable dans la communauté mondiale. La Russie, dans une situation d'agitation anarchique au siècle dernier, a changé le paradigme de l'orientation spirituelle et civique de la société - vers un libéralisme modéré. "Seule l'énergie du conservatisme raisonnable et libéral, écrivait le savant et homme politique russe B. N. Tchicherine, peut sauver la société d'une vacillation sans fin".
Dans le livre de Leonid Savine, l'abondance des méthodes scientifiques proposées pour décrire un nouveau type d'ordre mondial est frappante: système de systèmes, néofonctionnalisme, systèmes adaptatifs complexes, relationnisme, multiplexité, polylogue, systase et synérèse.
Les zones aveugles de la pensée postmoderne, où l'homme est désorienté dans un "tunnel", deviennent "visibles" grâce aux centres d'intérêt de Savine. Qui repousse les limites de la connaissance de l'homme et du monde. Cette familiarisation avec la vision eurasienne-conservatrice de la polycentricité aidera les analystes de systèmes à développer des stratégies optimales en politique étrangère et une approche multipolaire-polycentrique-pluriverse dans les sciences politiques, des innovations très nécessaires pour le système de sécurité mondial à une époque de turbulences géopolitiques. Le potentiel de conflit dans la multipolarité dépend du résultat de l'intégration stratégique de ses composantes, sous le parapluie unique d'une puissance forte en tant qu'arbitre mondial des différends. Cette approche est proche des idées de Carl Schmitt, Richard Rosencrantz, et Alexander Douguine.
Notes:
(1) Unipolaire et monopolaire sont synonymes. En anglais, "unipolar" ou "monopolar". En traduction anglaise, nous utiliserons "monopolar".
(2) Ordo Pluriversalis : la renaissance d'un ordre mondial multipolaire. Maison d'édition Oxygen, Moscou, 2020. Traduction anglaise publiée sous le titre Ordo Pluriversalis : The End of Pax Americana and the Rise of Multipolarity. Black House Publishing Ltd, Londres, 2020.
(3) OTAN : Organisation du traité de l'Atlantique Nord ; OTSC : Organisation du traité de sécurité collective ; G-7 : Groupe des sept ; OCS : Organisation de coopération de Shanghai ; UE : Union européenne ; CEI : Communauté des États indépendants.
(4) Il est intéressant de noter que l'auteur a fait une lecture aux diplomates et aux militaires au George C. Centre européen Marshall, Allemagne, son cours spécial "L'esprit russe". Pendant le cours, une grande attention a été accordée à "l'importance stratégique de la culture".
Publié dans Global Security and Intelligence Studies - Volume 6, Number 1 - Spring / Summer 2021.
20:13 Publié dans Définitions, Géopolitique, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, leonid savine, géopolitique, relations internationales, livre, politique internationale, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 01 mai 2021
Rethinking Chinese School of IR from the Perspective of Strategic Essentialism

Rethinking Chinese School of IR from the Perspective of Strategic Essentialism
As early as 1977 Stanley Hoffmann claimed that International Relations (IR) is an American social science (Hoffmann 1977), and according to Ann Tickner (2013), little has changed since then. Mainstream IR scholars perceive different regions of the world as test cases for their theories rather than as sources of theory in themselves. Thereby, the “non-West” became a domain that IR theorists perceived as backward; a domain which requires instruction in order to reach the “end of history” that Western modernity encapsulates (Fukuyama 1992). The phenomenon of American-centrism is closely related to the experience of the United States as a world hegemonic power after World War II. Although US hegemony has often been challenged by other countries in the world, its hegemonic status has never been replaced. Even if other countries looked like they would surpass the US at certain times (the Soviet Union in the 1970s, and Japan in the 1980s), they actually did not have the global, sustainable and all-round appeal of the American model. Therefore, American hegemony in the contemporary world not only enjoys technological, economic, and political superiority, but is also cultural, ideational and ideological.
However, any great power in history has its rise and fall, and the United States is no exception. The financial crisis in 2008, Brexit, the emergence of populism in Western countries, as well as the rise of non-Western countries, have challenged the current liberal order led by the United States. First of all, the stability of American society itself has been declining in recent years, especially under Trump’s administration. Racial divisions, coupled with other accumulated social and economic problems, have plunged the United States into serious trouble.
The COVID-19 pandemic that began in 2020 has weakened the West as a role model for governance and accelerated the transfer of power and influence from the West to the “rest.” In addition, the voice of developing countries and non-Western regions has become stronger in the past few decades as their wealth and power has increased. The combined nominal GDP of the BRICS countries, for instance, accounts for approximately one-quarter of the world’s total GDP. Some scholars have pointed out that the norms, institutions, and value systems promoted internationally by the West are disintegrating. The world is entering a “post-Western era” (Munich Security Report 2017).
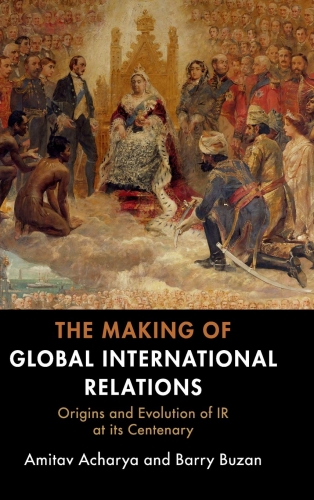
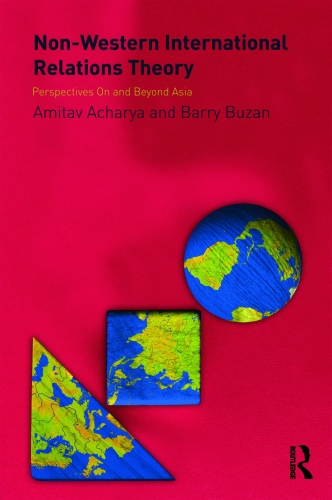
The views and experiences of non-Western subjects have increasingly been recognized as an indispensable part of the discipline, which is a consequence of the decline of the West and the wider dissemination of non-Western cultural and philosophical concepts. Various research agendas and appeals have been put forward around this theme. Among the most representative and influential are two initiatives: “Non-Western/Global IR” and “Post-Western IR.” Advocates of Non-Western/Global relations theory, such as Amitav Acharya and Barry Buzan, not only criticize the Western-centrism of the discipline, but also advocate the establishment of IR research based on the histories and cultures of other regions, and encourage the development of non-Western IR theories (See Acharya and Buzan 2010; 2019). The “World Beyond the West” research series (World Beyond the West), initiated by Ann Tickner, Ole Wæver, David Blaney and others, hope to present the local knowledge production practiced by multiple sites, so as to criticize Western-centrism in the discipline, and to respond to the political and ethical challenges faced by the discipline in the post-Western era. Both initiatives expect to develop diverse IR theories and concepts based on “non-Western” historical experience, thoughts and viewpoints.
The rise of interest in non-Western thought in the field of IR has had a positive significance for the development of Chinese IR theory. Many Chinese scholars believe that a Chinese School of IR should be established. For these advocates, Chinese IR not only needs to develop its own epistemological system to understand international relations from China’s perspective; it can also contribute to discussion of what kind of world order China wants. Qin Yaqing, one of the most representative advocates of the Chinese School, believes that the formation of the Chinese School is not only possible but also inevitable. As he states, the Chinese School has three sources of thought from which it can draw nourishment, namely: (1) the Tianxia concept and the practice of the tributary system, (2) modern communist revolutionary thought and practice, and (3) the experience of reform and opening up. Judging from the efforts of Chinese scholars in recent years, most of their efforts have focused on the use of Chinese history, culture and traditional philosophical ideas (Qin 2006). Among them, Yan Xuetong’s moral realism, Zhao Tingyang’s Tianxia system, and Qin Yaqing’s theory of relationality are most influential.

Yan’s moral realism tries to learn from the concept of “humane authority” in Chinese pre-Qin thought as a source of knowledge and ideas in order to reconceptualize the realist view of power. According to Yan, humane authority is not something that one can strive for; rather, it is acquired by winning the hearts of the people through setting an example of virtue and morality. In this vein, virtues and morality are qualities that can be inherent in the conduct of the state and its leaders, and which can influence others to act in one’s favor. It is the source of “political power”(See Yan, Bell and Sun 2011; Yan 2018). Zhao’s Tianxia system draws from an idealized version of the Tianxiasystem of the Zhou dynasty (c. 1046–256 BC) as the paradigmatic model. He argues that the system was an all-inclusive geographical, psychological, and institutional term. It therefore belongs to all humans equally and is more peace-driven than the Westphalian system which has dominated the world order for centuries (See Zhao 2006; Zhao and Tao 2019). Qin’s theory is centered around the concept of relationality, or guanxi, an idea that is embedded in Confucianism. From a Chinese relational perspective, the international society is not as simple as just comprising of independent entities acting in an egoistically rational way in response to the given structures. Instead, it is a complex web of relations made up of states related to one another in different ways (See Qin 2009; 2016; 2018).
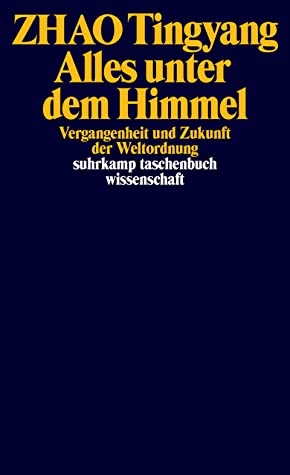
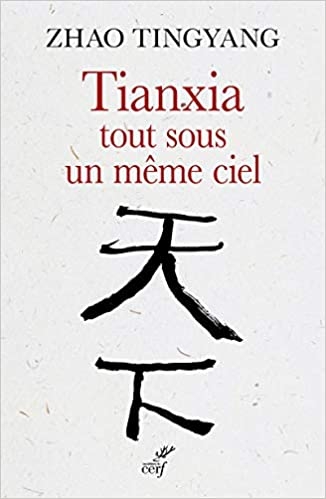
The nascent popularity of the Chinese School has received many criticisms in the IR subject area, the most important of which are the following two criticisms. The first argues that the Chinese School’s references to historical documents and classics are either inaccurate or overly romanticized. It is a kind of anachronism, which also infers an imperious form of Chinese exceptionalism – a form of wishful thinking that “China will be different from any other great power in its behavior or disposition” (Kim 2016). The second criticism is that the knowledge developed by Chinese School is only used to legitimize the rise of China. As Nele Noesselt (2015) notes, the search for a Chinese paradigm of IR mainly aims “to safeguard China’s national interests and to legitimize the one-party system.” The above two criticisms are valid, but not unique to China, and by this standard much other work in IR would also have to be discounted. American IR scholarship also uses source material anachronistically, as critics of realism have observed, and its agenda often reflects US interests and concerns. As E.H. Carr noted in his letter to Hoffman in 1977, “What is this thing called international relations in the “English speaking countries” other than the “study” about how to “run the world from positions of strength”?…[it] was little more than a rationalization for the exercise of power by the dominant nations over the weak” (Carr 2016: xxix).
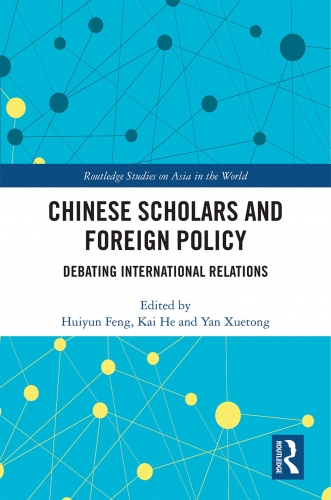

Yan Xuetong
Of course, making comparisons between American hegemony and its connection to mainstream IR on the one hand, and the rise of China with the Chinese School on the other, does not by itself justify the enterprise of the Chinese School from the critical IR perspective.
It is worth mentioning that on various occasions critics like Callahan (2008) have been cautious about the Chinese School as merely another familiar hegemonic design. To some extent, Chinese School scholars are indeed replicating the mainstream western IR theory and its problems (Chen 2010). Attempts by Yan, Zhao and Qin to reinvigorate traditional Chinese concepts – i.e. humane authority, the Tianxia system, and relationality – actually channel the Chinese Schools of IR into American mainstream IR discourse – i.e. a realist notion of power, a liberal logic of cosmopolitanism, and a constructivist idea of relationality. The Chinese School uses, against the West, concepts and themes that mainstream IR currently uses against the non-Western world. As Shani (2008) points out, true post-Western theories should not only mimic modern Western discourse; they must develop a critical discourse from within non-Western traditions, liberating non-Western regions from Western dominance. However, one might ask: is it possible that imitating Western discourse can constitute a kind of critical resistance? In order to think about this issue, it is worth looking at Bhabha’s concept of “mimicry.”
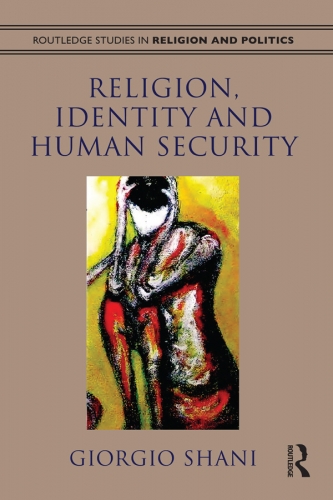
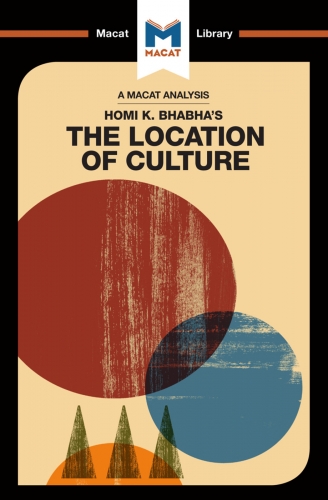
For Bhabha, “mimicry” is a complex, ambiguous, and contradictory form of representation, and it is constantly producing difference/différance and transcendence. As Bhabha notes (1994: 86), “the discourse of mimicry is constructed around an ambivalence: in order to be effective, mimicry must continually produce its slippage, it excess, its difference.” As a result, imitation by the Chinese School is not simply to duplicate the Western discourse, but to change Western concepts and practices to bring them more into line with Chinese local conditions. “Almost the same, but not quite.” Thus, non-Western scholars including the Chinese School can still make novel and innovative contributions to the literature of IR through hybridization, mimicry and the modification of the initial notions, as Turton and Freire (2016) note. More importantly, this mimicry is a concealed and destructive form of resistance in the anti-colonial strategy. Firstly, imitating the West will create similarities between non-Western theories and Western theories, which in turn confuses the identity of the West. Moreover, the relationship between the “enunciator” and the one who is articulated can potentially be reversed. Whether in support or in opposition, mainstream IR scholarship has been forced to respond to various ideas, concepts and approaches proposed by Chinese School scholars. Thirdly, the Chinese School also verifies that the European experience is a local experience. This is readily exposed when the starting points of mainstream IR – often taken for granted – are used in different contexts.
Nevertheless, there seems to be an issue at the heart of the enterprises of the Chinese School from Bhabha’s colonial resistance perspective. To Bhabha (1994: 37), “hierarchical claims to the inherent originality or ‘purity’ of cultures are untenable, even before we resort to empirical historical instances that demonstrate their hybridity.” Undeniably, the Chinese School has manifested several degrees of essentialism in its account of Chinese history and political thoughts, believing that Chinese culture have a homogenous, nonmalleable, and deep-rooted essence. It has indeed juxtaposed China and the West, essentializing and fixating on the existence of “Chinese culture,” which in nature is hybrid. When Orientalist IR meets Occidentalist IR, hatred and conflict will become possible and perpetuate questionable practices in world politics. In that context, the enterprise of the Chinese School might close down the creative space needed to imagine a different way of engagement. Essentialism is something of a taboo in the critical line of IR scholarship. However, when critical theory’s criticism of essentialism is too extreme, it may threaten the base on which resistance depends. In order to meaningfully challenge the hegemony, we need a site of agency, or a subject. A theoretical difficulty derived from this point of view is the extent to which a degree of essentialism is desirable.
To Spivak, essentialism is the object to be deconstructed, however, deconstruction depends on essentialism. As she stated (1990: 11), “I think it’s absolutely on target to take a stand against the discourse of essentialism…But strategically, we cannot.” On the issue of feminism, Spivak opposes the so-called feminine nature. She believes that it is practically impossible to define “women.” An implication of defining women is the creation of a strict binary opposition, a dualistic view of gender, and as a deconstructionist, she is against positing such dualistic notions. Although she opposes defining an absolute and fixed nature of women, from the standpoint of political struggle, she believes that the historical and concrete nature of women still exists and can be used as a weapon of struggle. In light of Spivak’s thought, it is inevitable to adhere to essentialism to a certain extent when engaging in post-Western theories, although we must be vigilant. In other words, the Chinese School as a “strategy” is not permanent but is specific to the situation of non-Western voices needing to be heard on the global stage, noting that the main challenge in the IR discipline today is to address the legacy of “Western hegemony.”

To conclude, the rise of the Chinese School has stimulated discussions, ignited debates, and sparked inspiration among IR scholars. It has challenged Western hegemony within international relations as well as the study of it. As pointed out at the inception of this article, the field of IR theory has been highly Eurocentric to date and international relations are dominated by the Western hegemony. Hence, there is no need to discard Chinese School perspectives altogether. Rather, we need to use the Chinese School strategically and critically, rather than treating them as purely objective standpoints that produce truths. IR knowledge of all sorts needs to be produced with a reflective spirit.
References:
Acharya, A., & Buzan, B. (2010). Non-Western international relations theory : Perspectives on and beyond Asia. London ; New York: Routledge.
Acharya, Amitav & Buzan, Barry. (2019). The Making of Global International Relations. Cambridge: Cambridge University Press.
Bhabha, Homi (1994). The location of culture. London [etc.]: Routledge.
Callahan, William A. (2008). Chinese Visions of World Order: Post-Hegemonic or a New Hegemony? International Studies Review, 10(4), 749-761.
Carr, Edward H. (1939/2016). The twenty years’ crisis, 1919-1939 : An introduction to the study of international relations. London: Macmillan.
Chen, Ching-Chang. (2011). The absence of non-western IR theory in Asia reconsidered. International Relations of the Asia-Pacific, 11(1), 1-23.
Fukuyama, F. (1992). The end of history and the last man. New York, NY [etc.]: Free Press [etc.].
Hoffmann, S., An American social science: International relations. Daedalus, 106 (1977), pp. 41-60.
Kim, Hun Joon. (2016). Will IR Theory with Chinese Characteristics be a Powerful Alternative? The Chinese Journal of International Politics, 9(1), 59-79.
Munich Security Report (2017). Post truth, post West, post order? Munich Security Report 2017. https://issat.dcaf.ch/Learn/Resource-Library/Policy-and-R...
Noesselt, Nele. (2015). Revisiting the Debate on Constructing a Theory of International Relations with Chinese Characteristics. The China Quarterly (London), 222(222), 430-448.
Qin, Yaqing. (2006). The possibility and necessity of a Chinese School of international relations theory (in Chinese), World Economics and Politics, 2006:3, pp.7-13.
Qin, Yaqing. (2016) A relational theory of world politics’, International Studies Review, 18:1, pp.33–47.
Qin, Yaqing. (2018). A Relational Theory of World Politics. Cambridge University Press.
Shani, Giorgio. (2008). Toward a Post-Western IR: The “Umma,” “Khalsa Panth,” and Critical International Relations Theory. International Studies Review, 10(4), 722-734.
Tickner, Arlene B. (2013) ‘Core, Periphery and (Neo)imperialist International Relations’, European Journal of International Relations, 19:3, pp. 627-646.
Turton, Helen Louise, & Freire, Lucas G. (2016). Peripheral possibilities: Revealing originality and encouraging dialogue through a reconsideration of ‘marginal’ IR scholarship. Journal of International Relations and Development, 19(4), 534-557.
Spivak, G., & Harasym, S. (1990). The post-colonial critic : Interviews, strategies, dialogues. New York, NY [etc.]: Routledge.
Worlding Beyond the West: https://www.routledge.com/Worlding-Beyond-the-West/book-s....
Yan, Xuetong, Bell, Daniel A, Zhe, Sun, & Ryden, Edmund. (2013). Ancient Chinese thought, modern Chinese power (The Princeton-China Series). Princeton: Princeton University Press.
Yan Xuetong. (2019). Leadership and the Rise of Great Powers (Vol. 1, The Princeton-China Series). Princeton: Princeton University Press.
Zhao, Tingyang. (2006). Rethinking Empire from a Chinese Concept ‘All-under-Heaven’ (Tian-xia, ). Social Identities, 12(1), 29-41.
Zhao, T., & Tao, L. (2019). Redefining a philosophy for world governance (Palgrave pivot).
14:15 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : chine, relations internationales, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique, asie, affairesasiatiques, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook