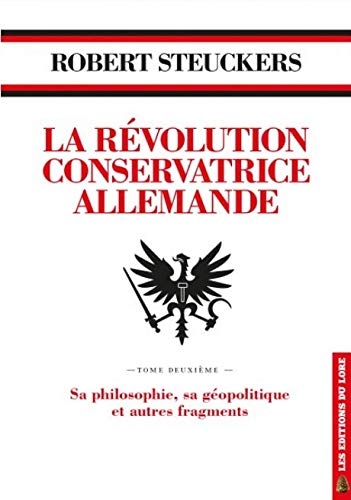jeudi, 08 septembre 2022
Ernst Jünger en tant que psychonaute

Ernst Jünger en tant que psychonaute
Par Fernando Trujillo
Quelle : https://guerradelasideas.blogspot.com/2022/06/junger-como-psiconauta.html?spref=tw
Des états de conscience altérés
Soldat, voyageur, intellectuel, homme d'action, mystique, la figure d'Ernst Jünger combine tant de nuances contradictoires qui font de lui l'un des hommes les plus intéressants de la littérature du 20ème siècle.
Dès son plus jeune âge, il a ressenti en lui un rejet de la vie bourgeoise, choisissant la voie de l'action, ce qui l'a conduit à s'engager dans la Légion étrangère, puis à faire son baptême du feu pendant la Première Guerre mondiale, une expérience qu'il a retranscrite dans des œuvres telles que Orages d'acier.
Cependant, des auteurs tels que José Luis Ontiveros et Armin Mohler ont parlé de sa facette de penseur, de guerrier et d'anarque, cependant, une facette presque totalement ignorée, à mon avis, est sa facette de psychonaute.
Le terme psychonaute signifie étymologiquement "navigateur de l'âme" et s'applique aux personnes qui, grâce à certaines drogues, peuvent entrer dans un état de perception où elles peuvent accéder à une gnose ou entrevoir les mystères de l'Univers dans lequel nous vivons. Il convient de préciser que le terme ne définit pas seulement un consommateur d'hallucinogènes, mais que ces états peuvent également être atteints par la solitude ou la méditation.
Avant de poursuivre, il convient de préciser que ce texte, ici, ne vise pas une apologie de la consommation de drogues ; la manière irresponsable dont la civilisation occidentale utilise les drogues comme moyen de "s'amuser" est une parodie de l'utilisation des drogues chez les Amérindiens et les sages orientaux. Jünger lui-même, dans ses Approches, affirme que la possession de drogues crée des formes d'esclavage et de servitude démoniaque dans lesquelles aucun geôlier n'est nécessaire et compare les trafiquants de drogues qui partagent gratuitement leur marchandise avec des adolescents à une version maléfique du joueur de flûte de Hamelin.
Cela montre clairement que, bien que Jünger ait été un consommateur de LSD et d'autres substances, il ne les utilisait pas pour "passer un bon moment", mais pour en ressentir les effets et les étudier en profondeur.
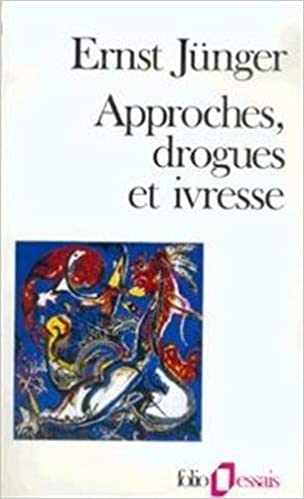 Dans son ouvrage Approches, drogues et ivresse, Junger se penche sur ses expériences avec différents types de drogues telles que le LSD, l'opium, la cocaïne, ainsi que sur les effets de l'ivresse tout en nous parlant des auteurs qui l'ont précédé sur cette voie tels que Poe, Baudelaire et Quincey et de la fascination que les stupéfiants ont exercée sur l'humanité. L'auteur écrit : Depuis les temps primordiaux, les chamans et les devins, les magiciens et les mystagogues connaissent l'étroite relation entre l'ivresse et l'extase. C'est pourquoi les drogues ont toujours joué un rôle dans leurs consécrations, initiations et mystères. C'est un véhicule d'ouverture parmi d'autres : comme la méditation, le jeûne, la danse, la musique, la contemplation égocentrique d'œuvres d'art ou d'émotions violentes. Son rôle ne doit donc pas être surestimé. En outre, elle ouvre également les portes sombres ; Hassan Ibn Al Sabbah avec ses assassins nous offre son exemple".
Dans son ouvrage Approches, drogues et ivresse, Junger se penche sur ses expériences avec différents types de drogues telles que le LSD, l'opium, la cocaïne, ainsi que sur les effets de l'ivresse tout en nous parlant des auteurs qui l'ont précédé sur cette voie tels que Poe, Baudelaire et Quincey et de la fascination que les stupéfiants ont exercée sur l'humanité. L'auteur écrit : Depuis les temps primordiaux, les chamans et les devins, les magiciens et les mystagogues connaissent l'étroite relation entre l'ivresse et l'extase. C'est pourquoi les drogues ont toujours joué un rôle dans leurs consécrations, initiations et mystères. C'est un véhicule d'ouverture parmi d'autres : comme la méditation, le jeûne, la danse, la musique, la contemplation égocentrique d'œuvres d'art ou d'émotions violentes. Son rôle ne doit donc pas être surestimé. En outre, elle ouvre également les portes sombres ; Hassan Ibn Al Sabbah avec ses assassins nous offre son exemple".
Dans ces mots, nous voyons comment Jünger donne à ces drogues un rôle de clés pour ce que Blake définirait comme les portes de la perception et comment diverses cultures anciennes les ont utilisées comme moyen de contacter leurs dieux et leurs esprits.
Tout au long de son ouvrage Approches, l'auteur fait l'expérience de ces états altérés, décrivant ses moments et les comparant à des expériences similaires vécues par d'autres auteurs. Ainsi, dans un chapitre, Jünger raconte ses expériences avec l'opium après son séjour dans la Première Guerre mondiale et fait référence à l'écrivain britannique Thomas de Quincey (illustration), avec lequel il établit des comparaisons dans ses expériences avec l'opium.

Après la défaite allemande, l'auteur raconte son retour chez lui, épuisé et blessé, et dans son introduction à la consommation d'opium, il nous montre l'état de l'Europe après la guerre.
Pendant la République de Weimar, le peuple allemand s'est adonné au nihilisme, à la toxicomanie, aux bordels, au matérialisme et à l'hédonisme. Une situation similaire s'est produite après la Seconde Guerre mondiale, qui a tué tout vitalisme et tout romantisme, laissant un vide que la jeunesse a tenté de combler avec les drogues, la "révolution hippie" et le sexe libre.
Jünger n'était pas un décadent comme on pourrait le penser, mais un explorateur de ces états de conscience altérés. Pendant cette décadence de l'Allemagne, l'auteur faisait partie du mouvement dit de la "Révolution conservatrice", né pour contrer le libéralisme et le marxisme.
Son penchant pour l'opium durera jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, quand il occupait un poste militaire dans la France de Vichy où il fréquentait les salons littéraires avec leurs fumeurs d'opium, rencontrant des artistes et des intellectuels tels que Jean Cocteau, Pablo Picasso et Henri de Montherlant.
La frontière est mince entre un décadent et un psychonaute, tout comme entre un toxicomane et un chaman indien, pour ne citer que ces exemples-là. L'exploration du cosmos par les drogues, l'atteinte de ces états altérés comme un but supérieur et non comme une fuite éphémère hors de la réalité. Jünger se situait quelque part entre les deux, entre un homme en quête d'évasion et un explorateur de la psyché, subissant une métamorphose qui le fit passé de l'escapiste potentiel au chaman contemporain.
LSD et autres hallucinogènes
En 1945, Jünger se lie d'amitié avec Albert Hoffman (photo, ci-dessous), le créateur du LSD, alors qu'ils avaient correspondu quelques années auparavant en raison de l'admiration que vouait Hoffman au travail de l'auteur. Jünger s'est intéressé à la relation pouvant exister entre la nouvelle drogue et la création artistique. À cette époque, l'auteur travaillait sur son roman dystopique Heliopolis, dont le protagoniste Antonio Peri est un expérimentateur de drogues que l'on pourrait qualifier de psychonaute littéraire.

Au printemps 1951, Jünger, avec Hoffman et le pharmacologue Heribert Konzett, a réalisé une expérience en prenant une petite dose de LSD qui, bien qu'elle n'ait pas eu les effets désirés, a ouvert à notre auteur les portes de la perception mystique.
"Ce n'est pas plus qu'un chat domestique comparé au vrai tigre, à la mescaline, ou tout au plus à un léopard", a affirmé Jünger après cette première expérience. Bien que cela ne soit pas suffisant, à d'autres moments, Jünger a réussi à franchir ces portes de la perception. Son initiation au LSD a eu lieu au moment où Huxley avait écrit le livre The Doors of Perception dans lequel il raconte l'utilisation du LSD à des fins mystiques.
Jünger a ensuite expérimenté les effets du peyotl, à base de champignons hallucinogènes, lors de son voyage au Mexique dans le cadre de son exploration du royaume des rêves.
La culture de la drogue compte de nombreux charlatans tels que Timothy Leary, un agent de la CIA que Hoffman a lui-même accusé de ne vouloir qu'attirer l'attention de la galerie sur sa propre personne, et Carlos Castañeda, soupçonné d'avoir inventé une grande partie de ce qui est exposé dans ses livres et qu'Alejandro Jodorowsky, un autre charlatan, qu'il a accusé d'être un opportuniste. L'intention de Jünger n'est pas de promouvoir une culture de la drogue au niveau des masses, des livres comme Approches ne doivent pas être considérés de cette façon.
Pour Jünger, ces drogues doivent être utilisées avec prudence et retenue, le psychonaute ne peut pas rester tout le temps dans cet espace intérieur, il doit sortir dans le monde sobre, banal et quotidien pour raconter ce qu'il a appris et ce qu'il a vu.
À cet égard, le point de vue de Jünger sur certains hallucinogènes est similaire à celui de l'anthropologue mexicain Fernando Benítez qui, dans son ouvrage En la tierra mágica del peyote, parle de l'utilisation cérémonielle du peyotl chez les Indiens Huichol dans le cadre d'un pèlerinage religieux annuel. Benítez établit une comparaison entre l'utilisation du peyotl par les Huichols pour des motifs sacrés et l'utilisation du LSD dans la civilisation occidentale, dépourvue de toute voie mystique et utilisée dans le but d'améliorer l'amusement et l'expérience sexuelle.


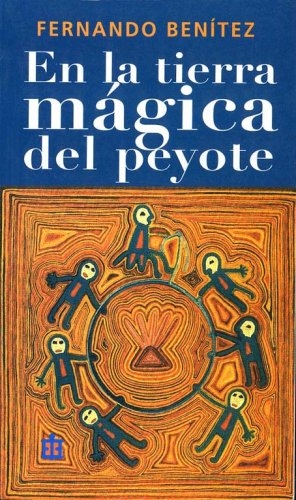
Pour Jünger, l'utilisation du LSD nous offre une possibilité de connaissance de soi, d'apprentissage de notre relation au soi et au monde dans lequel nous vivons. En ce sens, l'utilisation du LSD et d'autres hallucinogènes conduit à ces portes de la perception, à condition qu'ils soient utilisés avec parcimonie et à des fins dépassant le divertissement banal.

Ivresse
Jünger écrit : "le buveur ivre est souvent considéré avec bienveillance comme l'ennemi de l'ennui et du découragement. Un messager de Dionysos fait irruption pour ouvrir la porte du monde carnavalesque. Elle a même un effet contagieux sur les personnes sobres".
Jünger raconte dans Approches ses expériences avec le vin et la bière, depuis sa jeunesse jusqu'à ses expériences dans l'armée. Pour l'auteur, l'ivresse est une clé qui ouvre les portes de la perception, grâce à laquelle nous pouvons accéder ou voir la réalité d'une manière différente. Jünger raconte comment le vin et la bière ont fait partie de la culture européenne en tant que boissons sacrées.
Les peuples germaniques et leur relation à l'ivresse sont visibles dans la boisson mythique qu'est l'hydromel bu par les guerriers tombés au Valhalla, les banquets et les rituels sacrés tels que le Blot où la bière était consacrée pour leurs rituels. Wotan est un buveur d'hydromel modéré tandis que son fils Thor est un gros buveur, ce que raconte Jünger en montrant le caractère sacré de l'ivresse chez les Allemands.
Dans l'ivresse, la figure de Dionysos, le dieu grec du vin, est essentielle. Elle représente son pouvoir toxique, ses influences sociales et bénéfiques, et révèle les traits clairs et sombres de l'ivrogne. Dionysos est le libérateur, celui qui fait tomber les masques révélant les aspects sombres de la personnalité du buveur. Tout au long d'Approches, Jünger le mentionne souvent.
Mais Dionysos n'est pas seulement le dieu du vin, mais aussi du théâtre, de la joie de vivre, de l'extase, de la folie, des instincts sains et sombres de l'homme. Jünger était un homme dionysiaque, un homme qui a goûté aux excès de l'ivresse mais qui était aussi animé par le désir de vivre, de se battre.
Pour Jünger, la guerre est une expérience intérieure telle qu'il la définira dans Orages d'acier, ce coup porté au matérialisme et au conformisme de la paix bourgeoise, une notion dionysiaque qui rompt avec un ordre établi pour provoquer une régénération. Sans chaos, il ne peut y avoir d'ordre et vice versa. Jünger, Marinetti et D'Annunzio ont tous parlé de la guerre comme d'un fait indiscutable de l'histoire tout en considérant la paix comme une utopie.
Dionysos est le dieu des pulsions violentes, il est le chaos et l'ivresse apporte ce sentiment de rupture avec le monde et d'entrée dans un monde différent. Sur ce terrain, Dionysos est un dieu dangereux et à ne pas prendre à la légère, l'ivresse peut ouvrir les portes de la perception mais aussi détruire celui qui la porte en lui.
Dans l'ivresse, on peut percevoir les choses d'une manière différente de celle de la sobriété, mais cela peut aussi conduire à des moments de violence irrationnelle, réveillant les instincts les plus sombres du porteur et provoquant tout, des situations embarrassantes aux tragédies.
La venue de Dionysos et les effets de l'ivresse sur les individus et les peuples entraînent ce que Jünger définirait comme un Grand Passage (Übergang).

Que signifie "Grand Passage" ?
Jünger fait la distinction entre le Grand Passage et le Petit Passage, le premier étant une sortie de l'espace historique, un saut par-dessus le mur du temps ou une approche extrême. Les éphémérides historiques sont elles-mêmes de petits passages, tandis que la naissance et la mort d'une personne seraient un Grand Passage.
Un exemple donné par l'auteur d'un Grand Passage serait la musique de Wagner, l'opéra wagnérien est venu briser les schémas musicaux de son époque, pour créer une œuvre au-delà de l'histoire, les Grands Passages sont liés à la destruction des formes, les masses d'énergie qu'ils emmagasinent déclenchent choc et violence.
Ainsi, les deux guerres mondiales seraient des Grands Passages de l'histoire et Jünger fut le témoin des deux.
C'est là que l'ivresse prend son rôle, non seulement une simple ivresse due à l'alcool mais une ivresse pour la guerre, pour l'art, un excès de vie qui change constamment l'histoire.
Nous pouvons alors définir l'ivresse dans ce cadre comme étant le chaos, le changement constant et dionysiaque, par opposition à la sobriété du type passif, ordonné et apollinien. L'un est un destructeur de mondes et l'autre est la préservation d'un statut, tous deux complémentaires. Il ne peut y avoir de nouveau monde sans détruire l'ancien, tout comme il ne peut y avoir de chaos perpétuel. La sobriété a besoin de l'ivresse et vice versa comme une dualité de l'Univers.
Conclusion
Blake a dit dans ses Proverbes sur l'enfer que le chemin de l'excès mène au Palais de la sagesse. Comme nous l'avons vu, Jünger et les psychonautes ont parcouru ce chemin, certains ont survécu, d'autres sont morts jeunes et d'autres encore ont sombré dans la folie.
La leçon d'Approches, à la fin, est de fouler le chemin de l'excès, d'atteindre la sagesse et de vivre avec modération. Jünger a appris, après ses excès, à avoir de la retenue, à être capable de contrôler ses impulsions et à ne pas sombrer dans le vice.
Finalement, après avoir expérimenté tous ces excès, Jünger a choisi la voie de la sobriété, de la maîtrise de soi, il a eu ses excès dans sa jeunesse afin d'atteindre la vieillesse en homme sage. Ainsi, la jeunesse est faite pour les excès, pour apprendre et faire des erreurs, et la vieillesse est faite pour la sagesse et la contemplation.
Si un homme n'a jamais foulé le chemin de l'excès, comment peut-il voir la sagesse ? Il est nécessaire de traverser l'enfer pour aboutir au paradis, tout comme Dante dans sa Divine Comédie. Jünger a vécu jusqu'à l'âge avancé de 103 ans, a écrit de nombreux mémoires, romans et essais tout en regardant passer sous ses yeux l'ensemble du vingtième siècle, voyant se dérouler les petits et les grands passages, les captant dans ses livres.
Un homme qui a cherché la guerre et a survécu, qui a voyagé à la recherche de cette sagesse éternelle et a eu une vie des plus intéressantes.
Cette ivresse de vivre finalement, c'est ce qu'il a gardé tout au long de son existence dans ce monde, ce désir de savoir, d'expérimenter et d'écrire. Dans les drogues, on peut trouver ce chemin vers la sagesse, mais la modération et la préparation mentale sont indispensables pour ne pas vivre une expérience banale. Jünger l'a vécu et a vécu pour pouvoir raconter ce qu'il a découvert.
Notre monde moderne et technicisé manque d'une ivresse de vivre, de sortir des schémas, de quitter l'apathie et de marcher sur le chemin de la connaissance de soi et de la sagesse, nous péchons par trop de sobriété et nous écartons l'idée d'aventure.
La leçon de toute l'œuvre d'Ernst Jünger est l'ivresse de la vie, de quitter la vie bourgeoise et de pouvoir être aventureux, être un connaisseur, commettre des excès et chercher la voie de l'action dans ce monde étouffant et conformiste.
Avril 2016
Bibliographie:
1) Junger, Ernst, Approches, drogues et ivresse (1978). Enrique Ocaña (trans.) Tusquets. Barcelone (2000).
2) Auteur inconnu "Ernst Junger" (S.F) Cannabis Magazine [En ligne] Récupéré sur http://www.cannabismagazine.es/digital/ernst-juenger
3) Publié à l'origine dans l'anthologie Jünger : After War and Peace, quatrième volume de la collection Pensamientos y perspectivas de Editorial Eas https://editorialeas.com/producto/junger-tras-la-guerra-y-la-paz/.
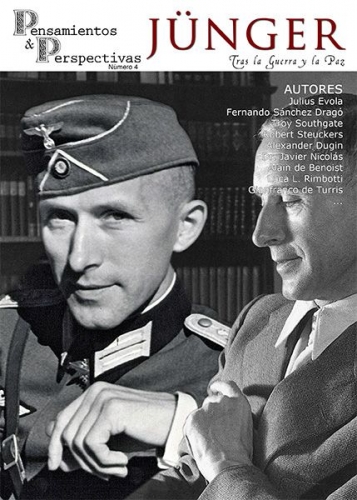
21:55 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : allemagne, ernst jünger, philosophie, drogues, lsd, révolution conservatrice, lettres, littérature, littérature allemande, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 26 août 2022
Ernst Jünger et la technique

Ernst Jünger et la technique
"Ernst Jünger. Le visage de la technique" de Michele Iozzino analyse les réflexions de l'écrivain allemand sur les dynamiques qui sont en train de changer l'humanité
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/105696-ernst-junger-e-la-tecnica/
Ernst Jünger était, pour reprendre une expression que Giuseppe Prezzolini a inventée pour lui-même, un "fils du siècle", un fils du vingtième siècle. Il l'était, non seulement en termes d'âge, mais aussi en tant que sismographe attentif des bouleversements existentiels et spirituels de l'homme européen au siècle dernier. En particulier, son iter théorique complexe est profondément marqué par l'exégèse de la technologie. C'est un jeune universitaire, Michele Iozzino, qui le rappelle, avec un texte organique et persuasif, dans le volume Ernst Jünger. Il volto della tecnica, récemment mis en librairie grâce à la maison Altaforte Edizioni (pour toute commande : info@altafortedizioni.it, pp. 195, euro 15,00). Le livre est agrémenté de la préface de Luca Siniscalco, non seulement un exégète des textes jüngeriens, mais aussi un connaisseur attentif de la pensée allemande du vingtième siècle.
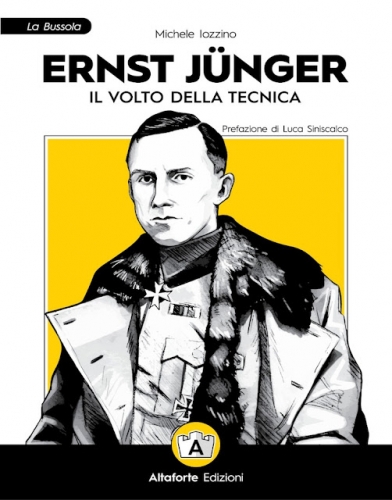
Il va sans dire que le penseur a eu sa première rencontre avec la technologie moderne dans les tranchées de la Première Guerre mondiale. Les pages dramatiques et passionnantes de ses journaux de guerre en témoignent admirablement. Le thème de la mobilisation totale, caractéristique des modernes, a été pleinement saisi et présenté par Jünger dans Der Arbeiter, en 1932. Depuis lors, ce thème est réapparu plus d'une fois, dans les phases ultérieures de la production littéraire de cet Allemand hors du commun. Siniscalco note que l'intention d'Iozzino est de présenter "un recueil utile et complet des premières thèses de Jünger [...] en dialogue avec la phase plus mature de sa pensée et sa théorie de la subjectivité" (p. 10). L'auteur fait ressortir, dans ces pages, tant le moment déconstructif des thèses du penseur analysé que leur pars construens. En bref, chez le Travailleur, l'esprit de la technique se forge une seconde nature, qui lui permet de contrôler tous les aspects de l'appareil technique. Pour cette raison, la tâche primordiale de ce sujet de l'histoire est de "façonner" le monde. Son trait constitutif, la "magie" démiurgique.
Le long du parcours jüngerien, le Travailleur donnera naissance à d'autres "figures", modifications profondes de cette première incarnation d'une nouvelle typologie humaine, toujours, selon Iozzino, en continuité avec elle. Deux d'entre eux sont d'une importance absolue: le Rebelle, celui qui se retire dans les forêts, et l'Anarque, capable de pratiquer, face à l'irruption du pouvoir technique soutenu par l'appareil de l'État Léviathan, un apolitisme métaphysique en vertu de la liberté que garde et maintient son "cœur aventureux". Ces trois "figures" sont, de différentes manières, ancrées dans la dimension de l'élémentaire. Le primordial rend les références anthropologiques de l'écrivain totalement étrangères à l'individu de la société bourgeoise. Cet individu-là a fait taire en lui la voix de la physis, des puissances qui l'habitent. Son temps est une linéarité progressive, oublieuse du "destin stellaire", à la recherche duquel se déplacent les trois "figures" évoquées, qui ne peut être fondé que sur une récursivité cyclique. Le même, rappelle Siniscalco, que Jünger a vécu sur sa propre personne lorsqu'à Kuala Lampur, il a assisté, pour la deuxième fois de sa vie, au passage de la comète de Halley. Une temporalité qui préfigure un possible Nouveau Départ, sous le signe du mythe et de l'astrologie traditionnelle, à laquelle Jünger fait allusion de manière exemplaire dans les pages de Au mur du temps.
Après tout, comme le montre l'ensemble de sa production, l'Allemand voulait montrer à l'homme contemporain une issue au désastre de la modernité et le ramener à la dimension cosmique. L'expérience de la revue Antaios, visant à reproposer aux hommes la loyauté ancestrale à la Terre, doit également être lue dans ce sens. Seule la rencontre avec l'élémentaire est capable de faire ressortir en l'homme la dimension profonde, le Soi, le lien holistique avec le Tout. Chez l'Arbeiter, cette rencontre est induite par la mobilisation: la puissance de l'Implant, si elle est contrôlée par un type humain ouvert à la "transcendance immanente", à la destructivité nihiliste montrée sur les champs de bataille, peut se transformer en force plastique, en ouverture à la "forme": "étant donné que ce qui manque aujourd'hui "c'est précisément la forme" [...] c'est cette vraie grandeur qui ne s'obtient pas par l'effort, ni par la volonté de puissance" (p. 14). Cet aspect sera également propre au Rebelle et à l'Anarque, qui tenteront d'affirmer l'être dans le devenir.

Les trois figures jüngeriennes sont des compossibles, qui peuvent se manifester sous l'impulsion de tendances spirituelles données ou de différentes contingences historiques. Iozzino s'attarde, en développant une riche exégèse, sur le texte Maxima-minima, dans lequel le penseur affronte, trente ans plus tard, les thèses du Travailleur, en constatant comment son essence est réductible à la recherche d' "une autre puissance" (p. 15). Une puissance capable de réconcilier Prométhée avec Orphée, afin de limiter les excès d'imposition du premier envers le réel. À ce moment de l'histoire, il fallait trouver, dans la catastrophe apocalyptique conjuguée à l'utilisation prométhéenne de la technologie, une "force ordonnatrice" capable d'accorder les hommes et l'origine. Aujourd'hui, cette question a pris le trait de l'inéluctabilité. La technique a une nature ambiguë, d'une part elle se réfère à l'Indistinct, d'autre part elle peut conduire à l'Ineffable du Néo-Platonisme.
Il nous semble qu'une continuité entre les figures et les phases de l'écrivain, comme le note l'auteur, est évidente, par contre entre l'Arbeiter, le Rebelle et l'Anarque il y a aussi une différence substantielle. Les deuxième et troisième figures ont dilué, dans une sorte de philosophie de la conscience, la volonté d'action historico-politique qui a émergé des pages de l'Arbeiter. Cela s'est produit parce que la référence jüngerienne, plutôt que sur la "transcendance immanente", profitait maintenant d'une position "religieuse". Evola l'avait bien compris et, pour cette raison, il appréciait surtout le premier Jünger.
Giovanni Sessa
20:49 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, allemagne, littérature allemande, philosophie, lettres allemandes, lettres, littérature |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 juillet 2022
Frédéric Schiller et le déclin qualitatif de la civilisation en Occident

Frédéric Schiller et le déclin qualitatif de la civilisation en Occident
Nicolas Bonnal
Un génie visionnaire apparait en Allemagne au moment de la révolution française et de l'étrange épopée napoléonienne ; il y a tous les poètes, tous les philosophes et toutes ces visions des Grecs et du déclin occidental : pensez à Hölderlin, Hegel, Novalis, à Humboldt, à une dizaine d’autres. Une génération miraculeuse : car, après, Nietzsche et Heidegger seront bien seuls, sinon en tant que philosophes du moins en tant qu’Allemands. La grandeur allemande fut d’avoir perçu avant les héritiers aristocratiques français (Tocqueville, Chateaubriand, Musset même) la chute de notre civilisation devenue trop technique et administrée: il lui aurait fallu retomber à l’état naturel ou remanger de l’arbre de connaissance (wieder von dem Baum der Erkenntnis essen), comme dit Kleist dans son texte sublime sur le théâtre des marionnettes qui annonce notre bouffon transhumanisme. Et le sibyllin Hölderlin pleure lui « les dieux qui sont peut-être passés dans un autre monde. »
J’ai évoqué il y a peu les textes où Goethe, surtout dans ses entretiens avec Eckermann, évoque le déclin de la force vitale chez nos hommes occidentaux devenus modernes. Je rappelle deux brefs extraits pour rafraîchir la mémoire à mes lecteurs les plus attentifs.
Le premier sur les unités administratives et économiques :
« …si l'on croit que l'unité de l'Allemagne consiste à en faire un seul énorme empire avec une seule grande capitale, si l'on pense que l'existence de cette grande capitale contribue au bien-être de la masse du peuple et au développement des grands talents, on est dans l'erreur. »
Le deuxième sur le déclin de la poésie vitale :
« Et puis la vie elle-même, pendant ces misérables derniers siècles, qu'est-elle devenue ? Quel affaiblissement, quelle débilité, où voyons-nous une nature originale, sans déguisement ? Où est l'homme assez énergique pour être vrai et pour se montrer ce qu'il est ? Cela réagit sur les poètes ; il faut aujourd'hui qu'ils trouvent tout en eux-mêmes, puisqu'ils ne peuvent plus rien trouver autour d'eux. »
Mais une génération avant, le jeune Schiller (il a trente-cinq ans) évoque les difficiles contradictions et le cul-de-sac de la modernité advenue. Et cela donne dans sa sixième et dans sa dixième lettre sur l’éducation esthétique de l’homme (remercions encore le site québécois classiques.uqac.ca) plusieurs réflexions solides, rédigées dans un allemand étincelant qui ne perd pas tant que ça à être traduit.
On le dira d’abord dans l’allemand romanisé de Schiller (à prononcer comme Horst Frank dans les Tontons flingueurs...)
…die Schönheit nur auf den Untergang heroischer Tugenden ihre Herrschaft gründet.
…la beauté ne fonde sa domination que sur la disparition de vertus héroïques.

Pour Schiller la « civilisation » coûte cher. La civilisation est comme une blessure. Et ça donne :
« Ce fut la civilisation elle-même qui infligea cette blessure à l’humanité moderne. Dès que d’un côté une séparation plus stricte des sciences, et de l’autre une division plus rigoureuse des classes sociales et des tâches furent rendues nécessaires, la première par l’expérience accrue et la pensée devenue plus précise, la seconde par le mécanisme plus compliqué des États, le faisceau intérieur de la nature humaine se dissocia lui aussi et une lutte funeste divisa l’harmonie de ses forces. L’entendement intuitif et l’entendement spéculatif se confinèrent hostilement dans leurs domaines respectifs, dont ils se mirent à surveiller les frontières avec méfiance et jalousie ; en limitant son activité à une certaine sphère, on s’est donné un maître intérieur qui assez souvent finit par étouffer les autres virtualités. »
Nietzsche se moquera dans le Zarathoustra du spécialiste du cerveau de la sangsue. Mais restons sur Schiller. La faculté d’abstraction des modernes va les détruire :
« Tandis que sur un point l’imagination luxuriante dévaste les plantations laborieusement cultivées par l’entendement, sur un autre la faculté d’abstraction dévore le feu auquel le cœur aurait dû se réchauffer et la fantaisie s’allumer. »
Nous sommes nous euphorisés jusqu’à l’obscénité, par l’illusion et le simulacre technologique. Mais Schiller s’obstine : tout devient/deviendra mécanisme.
« Ce bouleversement que l’artifice de la civilisation et la science commencèrent à produire dans l’homme intérieur, le nouvel esprit des gouvernements le rendit complet et universel. Il ne fallait certes pas attendre que l’organisation simple des premières républiques survécût à la simplicité des mœurs et des conditions primitives ; mais au lieu de s’élever à une vie organique supérieure, elle se dégrada jusqu’à n’être plus qu’un mécanisme vulgaire et grossier. »

Comparaison avec les Grecs :
« Les États grecs, où, comme dans un organisme de l’espèce des polypes, chaque individu jouissait d’une vie indépendante mais était cependant capable, en cas de nécessité, de s’élever à l’Idée de la collectivité, firent place à un ingénieux agencement d’horloge dans lequel une vie mécanique est créée par un assemblage de pièces innombrables mais inertes. Une rupture se produisit alors entre l’État et l’Église, entre les lois et les mœurs ; il y eut séparation entre la jouissance et le travail, entre le moyen et la fin, entre l’effort et la récompense. »
Vision de l’homme moderne, règne de la quantité proche de Guénon, quand le philosophe sera remplacé par le prof de philo à l’allemande (de Kant à Husserl) ou à la française (après Nuremberg) :
« L’homme qui n’est plus lié par son activité professionnelle qu’à un petit fragment isolé du Tout ne se donne qu’une formation fragmentaire ; n’ayant éternellement dans l’oreille que le bruit monotone de la roue qu’il fait tourner, il ne développe jamais l’harmonie de son être, et au lieu d’imprimer à sa nature la marque de l’humanité, il n’est plus qu’un reflet de sa profession, de sa science. »
Conséquence regrettable :
« Mais même la mince participation fragmentaire par laquelle les membres isolés de l’État sont encore rattachés au Tout, ne dépend pas de formes qu’ils se donnent en toute indépendance (car comment pourrait-on confier à leur liberté un mécanisme si artificiel et si sensible ?) ; elle leur est prescrite avec une rigueur méticuleuse par un règlement qui paralyse leur faculté de libre discernement. La lettre morte remplace l’intelligence vivante, et une mémoire exercée guide plus sûrement que le génie et le sentiment. »
On répète cette dernière phrase en allemand :
« Der tote Buchstabe vertritt den lebendigen Verstand, und ein geübtes Gedächtnis leitet sicherer als Genie und Empfindung.“
Dans la dixième lettre Schiller évoque le déclin de la civilisation liée à l’esthétisme. Ici aussi on pense à Nietzsche et surtout au si incompris (et germanique) Rousseau :
« …à presque toutes les époques de l’histoire où les arts sont florissants et où le goût exerce son empire, l’humanité se montre affaissée ; inversement on ne petit pas citer l’exemple d’un seul peuple chez qui un degré élevé et une grande universalité de culture aillent de pair avec la liberté politique et la vertu civique, chez qui des mœurs belles s’allient à des mœurs bonnes et l’affinement de la conduite à la vérité de celle-ci. »
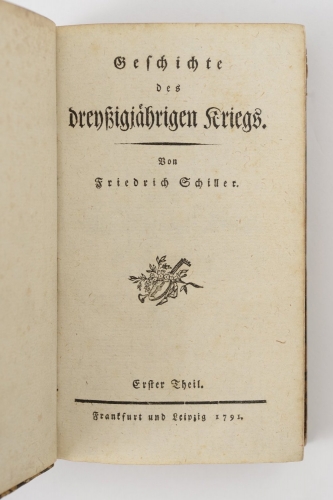
La culture comme arme de destruction massive ? Schiller – qui est aussi historien, voyez sa belle Guerre de Trente ans, première guerre mondiale en Europe moderne) multiplie les exemples italiens, romains, grecs, et aussi arabes :
« Aux temps où Athènes et Sparte maintinrent leur indépendance et où le respect des lois était la base de leur constitution, le goût manquait encore de maturité, l’art était encore dans son enfance et la beauté était loin de régner sur les âmes. Sans doute la poésie avait-elle déjà pris un essor grandiose, mais seulement sur les ailes du génie dont nous savons qu’il est tout proche de la sauvagerie et qu’il est une lumière qui brille volontiers dans les ténèbres ; il témoigne donc contre le goût de son époque plutôt qu’en faveur de celui-ci. Lorsqu’au temps de Périclès et d’Alexandre vint l’âge d’or des arts et que le goût étendit sa domination, on ne trouve plus la force et la liberté de la Grèce : l’éloquence faussa la vérité ; on fut offensé par la sagesse dans la bouche d’un Socrate et par la vertu dans la vie d’un Phocion. »
Après le modèle grec, Schiller évoque les autres exemples :
« Il fallut, nous le savons, que les Romains eussent épuisé leur force dans les guerres civiles et que, énervés par l’opulence de l’Orient, ils fussent courbés sous le joug d’un souverain heureux, pour que nous voyions l’art grec triompher de la rigidité de leur caractère. De même l’aube de la culture ne se leva pour les Arabes que lorsque l’énergie de leur esprit guerrier se fut amollie sous le sceptre des Abbassides. Dans l’Italie moderne les Beaux-Arts ne se manifestèrent que lorsque l’imposante Ligue des Lombards se fut dissociée, que Florence se fut soumise aux Médicis et que l’esprit d’indépendance eut dans toutes ces villes pleines de vaillance fait place à un abandon sans gloire. Il est presque superflu de rappeler encore l’exemple des nations modernes chez qui l’affinement devint plus grand dans la mesure où leur indépendance prit fin. Sur quelque partie du monde passé que nous dirigions nos regards, nous constatons toujours que le goût et la liberté se fuient l’un l’autre et que la beauté ne fonde sa domination que sur la disparition de vertus héroïques. »

Sa triste conclusion :
« Et pourtant cette énergie du caractère, dont l’abandon est le prix habituel de la culture esthétique, constitue justement le ressort le plus efficace de toute grandeur et de toute excellence humaines, et son absence ne peut être remplacée par aucun autre avantage, aussi considérable qu’il soit. »
Le constat étant pire encore deux siècles après, on négligera ici l'optimiste solution de Schiller…
Sources:
Frédéric Schiller - Lettres sur l’éducation esthétique de l’homme, sixième et dixième lettres, classiques.uqac.ca
Kleist – Notes sur le théâtre des marionnettes
Goethe – Conversations avec Eckermann
Nietzsche – Deuxième considération inactuelle ; Ainsi parlait Zarathoustra
13:26 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich schiller, lettres allemandes, lettres, littérature, littérature allemande, allemagne, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 juillet 2022
Les ciseaux de Jünger, un livre qui arrête le train en marche des faux dieux prométhéens

Les ciseaux de Jünger, un livre qui arrête le train en marche des faux dieux prométhéens
Par Francesco Marotta
Source: https://www.grece-it.com/2022/07/15/la-forbice-di-junger-ferma-il-treno-in-corsa-dei-falsi-dei-di-prometeo/?fbclid=IwAR0dfDlYMPbu-2QTPZCI83Ik201aXbUIrmcPZtTwBKD1fcx4y-5vYyDWD64
Les souvenirs s'effacent et réapparaissent souvent simultanément à la relecture. On ne sait pas pourquoi les lectures qui nous ont le plus impressionnés sont recouvertes de "ce voile fin tissé, en règle générale, par le temps qui passe". C'est le cas de la surprise d'un cadeau inattendu, "Les ciseaux" - Die Schere - d'Ernst Jünger, dans la réédition de Guanda Editore du 17 mars 2022, traduite par Alessandra Iadicicco et avec une stimulante postface de Quirino Principe.
Soudain, le temps semble faire un bond en arrière jusqu'à cette lointaine année 1996, lorsque j'ai lu le livre pour la première fois. Ce qui change, en revanche, c'est toute une perspective : l'imaginaire collectif est complètement bouleversé. Dans ces aphorismes de Jünger, il était facile de reconnaître l'essence d'une vision horizontale des choses. Le génie de Heidelberg les avait écrites à l'âge avancé de quatre-vingt-quinze ans à la fin des années 1980 et, dans cette nouvelle publication, plusieurs années après la publication de la première édition en Italie, il est encore plus facile de discerner toutes leurs gradations.

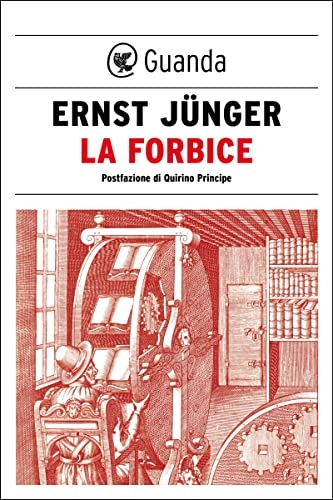
Quirino Principe met très bien en évidence le "Jünger attentif à la cosmologie cyclique de cette fin de siècle" et encore mieux lorsqu'il souligne ce qui pour Paolo Isotta aurait certainement pu être un tabou : "Le regard tardif de Jünger n'est pas chrétien". Il crée l'angle d'observation entre le païen Hölderlin et l'antichrétien Nietzsche, entre la gnose et l'Umwertung aller Werte - entre la gnose et la transvaluation de toutes les valeurs -, exigeant avec le plus grand respect des confirmations illustres et décoratives dans le panthéisme sceptique de Goethe et sa religio esthétique". Cependant, cette interminable recherche subtile (disquisizione) d'années sur le premier Jünger "païen" et le dernier Jünger, quelque part entre le polythéiste et le chrétien, laisse du temps au temps.
La prouesse de Jünger ne se comprend pas par la simple identification du finalisme chrétien, qui est maintenant clair pour tous. C'est plutôt dans le moment où il a pu traverser le temps d'une époque à l'autre, faire l'expérience de la véhémence née de la fin de la modernité, pénétrer les bruyères complexes du postmodernisme : sachant pertinemment que "le temps avancé sous l'influence de la fumée est volé aux dieux". La fumée dans les yeux de ceux qui refusent la rencontre avec eux-mêmes et sont habitués aux sauts temporels, suivant un procéduralisme grossier où "en principe il n'y a rien de prodigieux" mais une grande partie du drame de Faust. À cet égard, si l'on veut faire une comparaison, on pense au décor du train en fuite dans Snowpiercer, le film du réalisateur et scénographe sud-coréen Bong Joon-ho.
 Qui, en 2013, a eu l'heureuse intuition de verser dans ce train brise-glace traversant le globe, une intrigue en partie seulement surréaliste, miroir de certaines prérogatives inavouables de la société actuelle. Attention à ne pas risquer une comparaison avec "Les ciseaux" de Jünger et avec le passage de l'observateur et du voyant au Selbstdenker, celui qui est un libre penseur et qui est capable de "penser par lui-même", le destin du Nostro était déjà accompli depuis longtemps. Cependant, le film rappelle fortement ces wagons de train, où la fiction et le jeu d'acteur pactisent avec la tangibilité pas du tout onirique des faits, où les misérables sont assis à l'arrière et les privilégiés sont en tête du train. La société de la forme capitale, le déploiement de la Technique et de la Science désengagées de l'égide de l'homme, l'annulation du paradigme classique, étaient pour Jünger, et seraient 23 ans plus tard dans la même mesure pour le réalisateur Bong Joon-ho, des notions déjà largement discutées.
Qui, en 2013, a eu l'heureuse intuition de verser dans ce train brise-glace traversant le globe, une intrigue en partie seulement surréaliste, miroir de certaines prérogatives inavouables de la société actuelle. Attention à ne pas risquer une comparaison avec "Les ciseaux" de Jünger et avec le passage de l'observateur et du voyant au Selbstdenker, celui qui est un libre penseur et qui est capable de "penser par lui-même", le destin du Nostro était déjà accompli depuis longtemps. Cependant, le film rappelle fortement ces wagons de train, où la fiction et le jeu d'acteur pactisent avec la tangibilité pas du tout onirique des faits, où les misérables sont assis à l'arrière et les privilégiés sont en tête du train. La société de la forme capitale, le déploiement de la Technique et de la Science désengagées de l'égide de l'homme, l'annulation du paradigme classique, étaient pour Jünger, et seraient 23 ans plus tard dans la même mesure pour le réalisateur Bong Joon-ho, des notions déjà largement discutées.

Mais Jünger avait déjà eu l'intuition de quelque chose en rapport avec la machination, le calcul, une idéologie et sa doctrine, indiquant l'exact opposé de ce qui pourrait lui être opposé. En cela, sa pensée n'est pas si différente de celle de Heidegger. Les questions que nous trouvons dans "La question de la technique", en particulier dans la réponse sur le dévoilement qui régit la technique moderne, étaient les mêmes pour les deux : "Le dévoilement qui régit la technique moderne, cependant, ne se déploie pas dans une pro-duction au sens de ποίησις. Le dévoilement qui prévaut dans la technologie moderne est une pro-vocation (Herausfordern) qui exige de la nature qu'elle fournisse de l'énergie qui peut en tant que telle être extraite (herausgefördert) et accumulée". Une énergie transformée en une autre forme : en un dispositif, une structure de réseau, un mécanisme, un protocole, un appareil et un système, d'un "pouvoir qui n'est ni humain ni non-humain". Ce totalitarisme qui montre le visage du spectacle dans le spectacle de la Technique en politique, remplacé par un appareil administratif et gestionnaire, dont le but ultime est la perpétuation de sa propre domination et de son autosatisfaction.
Le mérite de Bong Joon-ho est de mettre l'accent sur le protagoniste principal, Curtis, qui attend le moment opportun pour reprendre la tête du train, ainsi que toute la communauté des outsiders. Celle de Jünger, en revanche, est d'avoir compris à l'avance combien il est important de rétablir un ordre des choses, contre tout ce qui anéantit, désertifiant la volonté et l'esprit : l'écrasante démesure qui a supplanté la physis en dépassant toutes les limites, pour la raison que "la spirale appartient à l'espace, les ciseaux au temps". Le leitmotiv des "Ciseaux" de Jünger est l'homogénéisation qui n'épargne rien, plus cet étrange surréalisme qui voudrait faire passer le néo-alchimisme du "Progrès" et la nouvelle forme de prométhéisme pour irréversibles, alors que tout nous pousse à penser à une alternative.

En fait, "aujourd'hui, il semble plutôt que le progrès doive être arrêté", même si les gourous dévoués au technomorphisme bizarre disent le contraire. On ne peut que se demander si, "maintenant que les roues tournent à fond" et que le train de Snowpiercer roule à toute vitesse vers le désastre, il est encore possible de l'arrêter. Selon le testament de Curtis, celui que nous devrions tous avoir, le dernier arrêt est proche. Il est clair que pour Jünger, la pensée et l'écriture aidant, l'ensemble des choses ne représentait pas une descente en avant dans un ravin qui assimile une pandémie mondiale à une nouvelle guerre au cœur de l'Europe, sans parler de la restauration d'une mondialisation 2.0. En fin de compte, le fossé temporel entre le philosophe et le cinéaste est large.
Le génie de Heidelberg, contrairement au réalisateur Bong Joon-ho, nous invite à redécouvrir non pas l'âme et/ou le succès qui naît du complexe d'activités industrielles et techniques : le Sud-Coréen n'a pas échappé à l'attrait du gadget productiviste de la cinématographie scintillante. Pour Jünger, en revanche, l'esprit et l'enchantement du monde étaient de première importance, ce qui n'avait rien à voir avec l'abandon d'une Kultur sympathique aux forces vitales de la Terre et du Cosmos, en étroite relation les unes avec les autres. De nos jours, la ruée vers un film de science-fiction, post-apocalyptique, au box-office hollywoodien, importe peu.
Le désir d'oublier ce que signifie être dans le monde et faire partie d'une communauté a fait de l'homme un être voué au calcul, au profit, au seul intérêt de veiller à ses intérêts particuliers. Notre Seigneur connaissait bien les chimères des titans, générateurs de "figures devenues étrangères à la conscience historique", comme les alchimistes modernes, les inquisiteurs, les deamhains gaéliques ; donnons un nom à ces démons qui ont traversé les siècles et toutes les conceptions du "Sacré". Mettez-nous en garde contre la vénération de l'individualisme qui sévit partout, la spectacularisation des médias, le bureaucratisme et le technicisme qui sont descendus en politique : "de ces crétins qui osent se présenter", parce qu'ils sont "d'excellents spécialistes", on ne peut rien attendre de bon.
Une tyrannie du "bien" que Jünger, qui a vécu longtemps, décrit méticuleusement dans "Les ciseaux", obsédé par le désir de battre tous les records possibles. Penser, en outre, à parvenir même à vaincre la mort : une chose qui, pour nos prédécesseurs, était considérée comme inviolable, pour la raison que le temps n'était pas perçu de manière uniforme et linéaire comme il l'est devenu à notre époque. En ce sens, les paragraphes consacrés à la vie et à la mort, à la "technique capable de prolonger considérablement le temps nécessaire pour mourir", à une médecine qui se moque du serment d'Hippocrate, alors que tout autour "le nombre d'accidents mortels" ne cesse d'augmenter, y compris la menace de petites et grandes catastrophes. L'hyperbole descendante d'une société déjà en partie compromise dès 1901, au point d'amener Léon Bloy à écrire sa fameuse "Exégèse des lieux communs", s'indignant de ces rengaines hypocrites et faussement moralisatrices, de ces faux "principes" que l'on exhibe à toute occasion : "La bicyclette et l'automobile sont dépassées, car les principes sont encore plus rapides, et écrasent mieux, de façon plus satisfaisante, plus irrémédiable". Un hymne à la lâcheté conformiste qui ferait pâlir certains des "non-conformistes" d'aujourd'hui, si trompeurs.
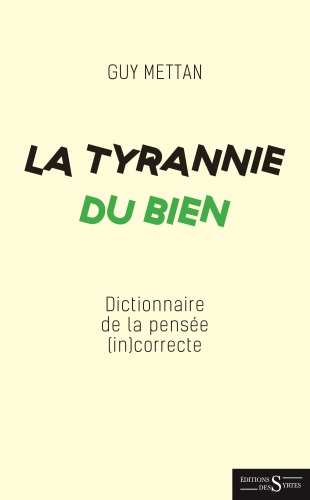
On ne peut s'empêcher de se rappeler ce que Guy Mettan, journaliste et historien genevois, a écrit dans son essai "La Tyrannie du Bien. Dictionnaire de la pensée (in)correcte" : "la recherche effrénée de la vertu est devenue une obsession universelle qui ne se limite pas aux cercles d'éveil et aux ONG moralistes". Après tout, elle est pratiquée dans ces salles de conseil feutrées, dans les bureaux à aire ouverte des managers, dans les antichambres inclusives des ministères, dans les salles de classe aseptisées des universités et sur les réseaux sociaux. Des lieux où la tyrannie du "Bien" décide, administre, gère, planifie et assiste : légiférer, confiner, condamner les idées non conformes, souvent bombarder et tuer. Du faux mythe de l'Empire, le "Bien" montre son visage, celui d'une des tyrannies les plus pernicieuses de l'histoire humaine.
La métaphore des "Ciseaux" conduit le lecteur vers la fin d'une société, en montrant tous ses dysfonctionnements. La forme chaotique, dédiée au catastrophisme qui ne contemple pas les autres êtres, les différences qui existent et les relations qui existent entre eux, croyant qu'il suffit d'universaliser ce qui convient grâce à la domination de la rationalité. Pointer du doigt quiconque ne pense pas de cette façon, comme un primate en voie de disparition, tendant à résoudre les problèmes depuis l'intérieur d'une bulle autoréférentielle, totalement incontrôlable et aléatoire, éloignant la vérité et la réalité. Ce qui en fait une exception, un mystère. Et c'est Jünger lui-même qui nous ouvre la voie, en traçant le seul chemin à suivre, qui est de combattre et de gagner la bataille des idées, contre l'indistinction et l'atomisation de nos peuples.
Ernst Jünger, La forbice, traduction par Alessandra Iadiccicco, postface par Quirino Principe, Gaunda Editore, 17/03/2022, pp. 204, euro 18.00.
18:37 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, livre, littérature, littérature allemande, allemagne, lettres, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 11 mai 2022
Günter Maschke: un hommage à Ernst Jünger, l'anarque, le sylvestre, l'esthète de l'horreur

Günter Maschke: un hommage à Ernst Jünger, l'anarque, le sylvestre, l'esthète de l'horreur
par Günter Maschke
Source: https://wir-selbst.com/2022/05/07/gun/
Le discours suivant a été écrit en 1982 à l'occasion de la remise du prix Goethe à Hilmar Hoffmann, un fonctionnaire de premier plan de la ville de Francfort-sur-le-Main, qui se consacrait à la culture et avait approuvé l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger et s'était ensuite vu confronté à de vives critiques de la part de ses amis au sein de son parti. Les chances, minimes dès le départ, que ce discours soit prononcé n'ont pas pu être exploitées. Si le ghost-writer de l'époque, Günter Maschke, l'avait prononcé de sa propre initiative, il aurait sans doute été plus clair en bien des points et aurait moins cherché à susciter la compréhension. Le lecteur d'aujourd'hui doit donc garder à l'esprit les circonstances ainsi que la vieille phrase de Georg Lukacs : "Un discours n'est pas une écriture". Cet hommage à Ernst Jünger a été publié pour la première fois sous la plume de Günter Maschke dans la très recommandable revue Etappe - Magazin für drakonisches Denken.
Günter Maschke
(* 15 janvier 1943 à Erfurt ; † 7 février 2022 à Francfort-sur-le-Main)
***
En décernant le prix Goethe à Ernst Jünger, la ville de Francfort rend hommage au dernier grand survivant de la génération de Gottfried Benn et Bertold Brecht, d'Alfred Döblin et Hans Henny Jahnn, de Heinrich et Thomas Mann. La vie littéraire et intellectuelle contemporaine n'est guère plus féconde, ni plus débordante de talents, pour que l'on puisse passer à côté de l'un des représentants les plus importants de l'époque héroïque de notre littérature sans lui rendre hommage. Cela vaut même si de nombreuses pensées de Jünger nous apparaissent désormais incompréhensibles ou nous semblent insupportables. Nous devrions nous rendre compte que le prétendu "précurseur du national-socialisme" et le "glorificateur de la guerre" est considéré sereinement comme le "plus grand écrivain allemand" de notre époque en France, un pays que nous avons attaquée deux fois - et les deux fois, le soldat Jünger était impliqué. In Stahlgewittern - aus dem Tagebuch eines Stoßtruppführers est paru en 1920, et depuis lors, Ernst Jünger est un auteur controversé, toujours contraint à la polémique et à la controverse.
"Il existe aujourd'hui peu de penseurs avec l'œuvre desquels on entretient pendant des années une relation qui alterne sans cesse entre l'approbation spontanée et le rejet déterminé... Nous avons besoin d'Ernst Jünger. Nous en sommes arrivés à la conclusion qu'une erreur, si elle est compréhensible et honnêtement acquise à la vie, est plus à même de nous aider que la constatation d'une vérité à laquelle manque le pouvoir de conviction", écrivait Eugen Gottlob Winkler. "La querelle autour d'Ernst Jünger", tel pourrait être le titre d'une documentation à éditer en plusieurs volumes, et la protestation des Verts et du SPD contre l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger fait également partie de cette querelle. Alors que dans les années 1960, l'auteur semblait entrer dans un panthéon sans danger, cette querelle semblait toucher à sa fin, elle s'enflamme à nouveau aujourd'hui. Ces intervalles de plus d'un demi-siècle dans la querelle, me semblent être un indice certain du rang de cet homme.
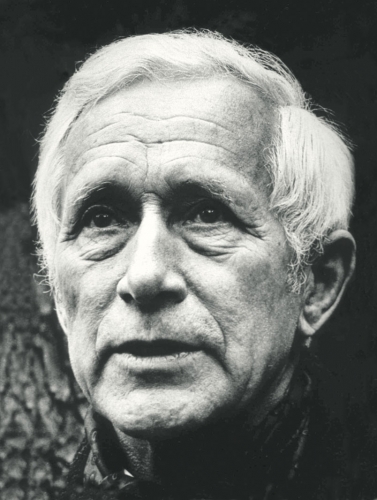
On peut objecter beaucoup de choses à Jünger, selon son point de vue idéologique, mais il me semble impossible de nier son importance comme essayiste et mémorialiste, comme descripteur et penseur de la nature, comme diagnostiqueur des guerres, des guerres civiles et du travail industriel. On peut douter que ses romans et ses récits aient une importance similaire. Un prix tel que le Goethe Preis ne peut être décerné qu'en raison d'une réalisation intellectuelle et/ou artistique. C'est précisément lorsqu'un auteur est à ce point controversé que la preuve de sa performance est apportée. Un lauréat qui satisferait tout le monde serait également celui dont le travail ne nous interpellerait en rien - il serait récompensé pour ses propos édifiants, généralement acceptés et généralement ennuyeux. Le prix Goethe n'aurait aucun sens s'il était l'hommage à une médiocrité qui ne passionne personne. Dans quelques réflexions intitulées Autor und Autorschaft, Jünger écrit en 1980: "Mon jugement ne doit pas se fonder sur le fait qu'un auteur pense différemment de moi - mais sur le fait qu'il pense même et peut-être mieux que moi. Je dois le placer dans son système. Mais je peux le rejeter. Encore une fois, cela n'exclut pas l'estime". Je pense que ces mots doivent nous servir de guide et je suis sûr que les membres du jury, qu'ils aient ou non le passage cité sous la main, pensaient de la même manière.
La vie intellectuelle en République fédérale souffre d'une crispation très idéologisée et policée. Ce que l'on dit et pense est en permanence interrogé: d'où cela vient-il? Puis vient régulièrement la question: où cela peut-il mener? Pour finir, nous entendons le jugement de condamnation déjà standardisé: c'est dangereux ! - ce qui revient à dire qu'une pensée inoffensive pourrait être intéressante. Vous avez le choix: la chute du monde libre ou l'esclavage impérialiste, la monotonie mortelle de l'égalité ou le retour des prédateurs (c'est-à-dire le "fascisme"), Vorkhuta ou Auschwitz. La question de savoir d'où l'on vient - par exemple de Marx (comme Lukacs, également lauréat du prix Goethe) ou de Nietzsche (comme Jünger, lui aussi lauréat du prix Goethe) - ne peut bien sûr pas être écartée et la question de savoir à quelles conséquences une pensée peut conduire (mieux encore: à quoi elle peut être utilisée) est non seulement permise, mais aussi utile. Cependant, il doit y avoir un espace au-delà de ces discussions, l'espace réel de la pensée et de la discussion. Et ici, la question est: qu'a-t-il remarqué? Qu'a-t-il vu? L'essentiel est ici, comme le dit très justement la justification du prix décerné à Jünger, dans "l'indépendance de la perception". Ce qui est décisif, c'est de savoir si nous apprenons quelque chose sur l'homme, si notre regard est aiguisé pour les domaines problématiques. Que signifie la Première Guerre mondiale en tant que première guerre des machines? Nous savons qu'il s'agissait d'une boucherie, et que l'officier de première ligne Jünger le sait aussi, c'est certain. Mais que révèlent ces paysages de feu et de sang? Et qu'est-ce qui s'exprime dans la technique industrielle moderne, qu'est-ce qui se cache derrière elle? C'est la question que pose Jünger dans Der Arbeiter. Il y a un domaine d'observation, de constatation des faits ou, en ce qui me concerne, d'affirmation des faits - et il y a un autre domaine où l'on essaie de tirer des conclusions et de trouver des instructions pour agir. Les deux domaines sont souvent difficiles à séparer, mais le lecteur, plus encore que l'auteur, doit toujours essayer de le faire. Si l'on nie l'existence d'un tel terrain neutre de la connaissance, du constat, de la constatation, alors on est également incapable de mener des discussions encore fructueuses par-delà les fronts idéologiques et politiques. Un tel boycott des discussions est régulièrement payé par une augmentation de la stupidité au sein de tous les partis: on ne peut même plus se mettre les arguments de l'adversaire dans sa propre poche. Karl Marx, par exemple, a critiqué le système industriel naissant avec les arguments des idéologues conservateurs semi-féodaux et il a critiqué leur glorification de l'époque préindustrielle avec les arguments des théoriciens enthousiastes du jeune capitalisme. Ce n'est là qu'un exemple. Comme pour tous les auteurs vraiment importants, l'œuvre de Jünger possède une force qui transcende les frontières et les camps, et on peut tout à fait identifier une gauche jüngerienne, comme Alfred Andersch. Il faut également se souvenir que deux des amis les plus proches de Jünger, qui l'ont accompagné toute sa vie, étaient presque homonymes Carlo Schmid et Carl Schmitt. Carlo Schmid, lui aussi lauréat du prix Goethe, l'un des pères de la Constitution de la deuxième République allemande, et Carl Schmitt, le critique sarcastique et incisif de Weimar, le pourfendeur implacable des illusions démocratiques, libérales et pacifistes, un homme dont les démocrates ont beaucoup à apprendre s'ils veulent se défendre. Cette amitié étroite avec deux hommes aussi opposés politiquement, qui travaillaient en outre dans le même domaine, en tant que penseurs de la politique, ne prouve pas que Jünger était un opportuniste à la langue de vipère, mais que des hommes d'esprit et d'horizons totalement différents trouvent notre lauréat stimulant et fructueux. Dans les années 1920, la vie littéraire berlinoise était polarisée par Bert Brecht et Ernst Jünger. Mais à l'époque, Brecht défendait toujours Jünger en disant : "Laissez le Jünger tranquille !".

Le rang intellectuel d'une personne ne se prête donc que de manière limitée à l'excitation morale. Il ne s'agit pas d'un problème démocratique. Pour le dire en termes crus, Goethe n'était pas non plus un démocrate, ne serait-ce que parce qu'il s'intéressait avant tout au perfectionnement de sa propre personne. Les lauréats du prix Goethe, Georg Lukács et Arno Schmidt, ne l'étaient pas non plus. Georg Lukács a certes été l'un des plus grands critiques marxistes du stalinisme, mais il a aussi été longtemps stalinien, ou du moins son collaborateur pendant longtemps. Sa distance vis-à-vis du stalinisme a sans doute toujours été inférieure à celle d'Ernst Jünger vis-à-vis des nationaux-socialistes et c'est à Lukács que l'on doit, une fois qu'il n'y a plus eu de doute sur les crimes du stalinisme, cette phrase horrible dans ses implications : "Le pire des socialismes est toujours meilleur que le meilleur des capitalismes". Arno Schmidt, cependant, dont l'affront au jury du prix Goethe est encore frais dans les mémoires, s'est montré non démocrate d'une manière plus inoffensive, mais sans doute plus provocante: en proclamant la primauté de l'esthétique sur la morale, de l'artistique sur le social, et en mettant en avant le grand écrivain, d'une manière qui semble aujourd'hui audacieuse, sur les nombreux (trop nombreux ?) qui font le travail normal dans une société. La démocratie n'est qu'un principe d'organisation politique - mais la question de savoir si le principe démocratique doit s'appliquer à d'autres domaines de la pratique humaine doit être posée, en particulier aux démocrates.
Au cours de ses plus de soixante années d'écriture, Ernst Jünger a fait l'objet d'appréciations très diverses. L'auteur d'écrits tels que In Stahlgewittern, Der Kampf als inneres Erlebnis, Das Wäldchen 125 a été considéré comme un militariste, voire un va-t-en-guerre. L'auteur de Der Friede, écrit en 1941 et diffusé en copies à partir de 1943, était considéré comme un pacifiste. Après le livre Der Arbeiter (1932), Jünger apparaît comme un technocrate sans conscience. Avec Am Sarazenenturm (1959), avec ses innombrables essais sur les pierres, les papillons, la capture de coléoptères, l'horticulture ou avec ses œuvres allant dans le sens d'une philosophie de la nature comme Subtile Jagden (1967), enfin sa collaboration à la revue Scheidewege fondée par son frère défunt Friedrich Georg, il était considéré comme un écologiste. Le fait que Jünger soit un pionnier du mouvement vert peut être prouvé avec une extraordinaire facilité.
L'harmonie entre l'homme et le cosmos est un thème récurrent chez Jünger, au moins depuis le milieu de son œuvre. Son aversion pour toute science naturelle simplement quantifiante et pour la maîtrise de la nature est tout aussi constante. Le soldat nationaliste Jünger, qui - comme tout le monde doit l'admettre - a lutté à juste titre contre le traité de Versailles, semble être l'ennemi du bon Européen qui, en 1941, avec La Paix, fait ses adieux au nationalisme et appelle à la réconciliation, afin que les efforts et l'héroïsme de la guerre, ces "premières œuvres communes de l'humanité", ne soient pas vains; afin que la haine se transforme en solidarité. Enfin, il y a aussi "l'anarchiste conservateur", comme le politologue Hans-Peter Schwarz a appelé notre lauréat en 1962 dans un livre qu'il convient de lire (H.-P. Schwarz: Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst Jünger). Et c'est ce Jünger qui nous apprend non seulement comment se soustraire à un pouvoir totalitaire en "marchant dans les bois", en contournant, en esquivant et en sabotant, et comment préserver ainsi sa propre souveraineté, - c'est aussi le Jünger qui est en contact étroit avec des résistants comme Ernst Niekisch, Speidel et von Stülpnagel, et qui est renvoyé de l'armée de manière déshonorante après le 20 juillet 1944. Il ne fait guère de doute que Jünger s'en est sorti à l'époque parce qu'il était déjà devenu un mythe de la génération des combattants de la Première Guerre mondiale. Cet "anarchiste conservateur" qu'est Jünger est aussi celui qui a un organe réceptif pour les représentants de la sous-culture, pour les marginaux et les hippies, en général pour le déviant et son importance, voire sa nécessité. Les aspects souvent déroutants, voire contradictoires, de Jünger s'expliquent notamment par le fait que les décennies, avec leur lot d'expériences, travaillent sur les textes et en font ressortir sans cesse de nouvelles facettes. Mais en même temps, Jünger n'a cessé de se transformer et d'orienter son intérêt vers de nouvelles questions. Même parmi les auteurs les plus importants du siècle, il est l'un des rares à évoluer jusqu'à un âge avancé, une caractéristique qui rappelle Goethe. Le roman Eumeswil, paru en 1977, en est la preuve évidente. Il dépasse de loin, du moins en pensée, la plupart de la prose allemande des années 1970.
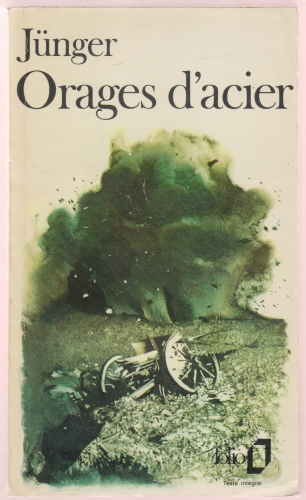
On entend souvent dire que Jünger a toujours été un porte-parole de l'esprit du temps. En réalité, c'est l'esprit du temps qui s'exprimait à travers lui, alors qu'il était également considéré comme intempestif. Les moments de son influence ont coïncidé avec les moments de conscience critique de l'histoire allemande. Hans-Peter Schwarz écrit à ce sujet: "En 1920 ... lorsque le lieutenant de la Reichswehr ... publia son journal de guerre In Stahlgewittern, il fut l'un des premiers à donner une forme littéraire complète à l'expérience de la guerre mondiale du combattant des tranchées. Der Kampf als inneres Erlebnis (1922) procédait déjà à l'approfondissement du diagnostic de l'époque sur la rencontre avec la guerre. L'expérience marquante de Jünger - la bataille de matériel sur le front occidental - était aussi celle de nombreux membres de la génération de la guerre... Un avant-gardiste de l'âge de fer, un porte-parole de la jeunesse activiste, un représentant de la génération qui allait prendre le pouvoir - c'est ainsi qu'il était compris par un nombre sans cesse croissant de lecteurs fidèles...
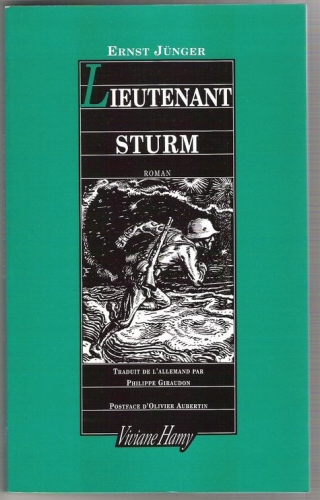
En 1932, la crise de l'Etat et de la société est entrée dans sa phase décisive, personne ne sait où l'on va; le besoin de faire des prévisions est d'autant plus vif. C'est à ce moment-là que parut Der Arbeiter. Il devint la sensation littéraire des mois d'octobre et de novembre 1932 et, comme certains s'en souviennent encore aujourd'hui, l'ouvrage décisif de l'année pour plus d'un. Il s'agissait d'un homme dont les propos, par la magie de son style, pouvaient être considérés comme crédibles et qui annonçait, sur un ton qui n'admettait aucune contradiction, la fin de l'ère bourgeoise libérale et l'avènement d'un État national, socialiste et impérialiste. Les courbes rouges de l'époque et de l'existence de l'auteur avaient convergé au cours de ces années.
1939 - l'année du début de la guerre - et 1942, celle de la plus grande extension de la sphère d'influence allemande, mais en même temps annonciatrice de la catastrophe qui se profilait déjà, ont à nouveau apporté deux livres qui ont rapidement gagné un grand nombre de lecteurs, en particulier auprès de la Wehrmacht: Sur les falaises de marbre et le journal de guerre Jardins et routes. Il trouva à nouveau le mot de l'heure ; mais cette fois-ci pour ceux qui recherchaient la possibilité d'une existence juste, décente et saine. En 1945, il publie Der Friede (La Paix), conçu en 1941, et en 1949 Strahlungen: ces deux ouvrages interviennent directement dans le débat sur l'attitude des Allemands vis-à-vis du Troisième Reich et sur les principes de la politique future. En l'étudiant a posteriori, on a l'impression que, pour certains, la confrontation avec leur destin personnel s'est faite quasiment en confrontation avec l'évolution intérieure de cet homme". - Cette longue citation donne une idée à la fois de l'étendue et de l'actualité sans cesse renouvelée de l'écriture de Jünger, comme nous l'avons déjà évoqué.
Considérons quelques-uns des écrits les plus importants d'Ernst Jünger, et en particulier ceux de ses débuts, dans lesquels on ne peut nier un barbarisme militariste, un romantisme sanguinaire dissuasif, voire un lansquenettisme malveillant - tout comme on ne peut nier la glorification critiquée de la guerre. "Le sang gicle dans les veines en étincelles divines, lorsque l'on s'élance au combat avec la conscience claire de sa propre audace. Sous le pas qui rythment l'assaut, toutes les valeurs du monde s'envolent comme des feuilles d'automne. Sur de tels sommets de la personnalité, on éprouve du respect pour soi-même... Certes, le combat est sanctifié par sa cause, mais plus encore, une cause est sanctifiée par le combat". On rencontre régulièrement ce genre de kitsch d'acier dans les premières œuvres, mais il reste périphérique. Néanmoins, l'indifférence totale à l'égard de toute problématique morale de la guerre fait peur. Mais cette indifférence a au moins un avantage: c'est grâce à elle - au-delà d'hystéries comme celle citée - que le regard froid de Jünger est possible, qui se pose sur la réalité de la bataille de matériel qui menace de dépasser l'homme en tant qu'homme et donc aussi en tant que héros.
Alors que d'autres chroniqueurs littéraires de la Première Guerre mondiale comme Erich Maria Remarque et Ludwig Renn, avec des romans comme A l'ouest rien de nouveau et Guerre, n'ont pas grand chose à nous dire de plus, même si leur récit et leur morale sont saisissants, si ce n'est que la guerre est quelque chose d'horrible, Jünger essaie de comprendre la loi de la guerre des machines, son sens métaphysique et se demande en outre comment les sociétés industrielles européennes évolueront après une telle guerre. Dans les batailles de matériel de la Somme, de Cambrai, des Flandres, une nouvelle époque naît et le monde de la sécularité bourgeoise s'enfonce. Et pourtant, cette guerre avait commencé de manière si romantique: "Nous avions quitté les amphithéâtres, les bancs de l'école et les établis et nous nous étions fondus en un grand corps enthousiaste pendant les courtes semaines de formation. Ayant grandi dans une ère de sécurité, nous ressentions tous la nostalgie de l'inhabituel, du grand danger. La guerre nous avait alors saisis comme une ivresse. Nous étions sortis sous une pluie de fleurs, dans une ambiance d'ivresse de roses et de sang".
Ce début est connu: la guerre a été accueillie avec soulagement dans toute l'Europe. Et bien que la réalité de la guerre décrite par Ernst Jünger, faite de boue, de jours de pilonnage et de combats épuisants, se soit ensuite imposée, nous nous heurtons à chaque page à cette question qui nous paraît aujourd'hui monstrueuse: l'homme a-t-il besoin de la guerre? La nostalgie de l'époque, bientôt si terriblement comblée, le beuverie au bistrot des années plus tard ne doivent-ils pas être compris comme la critique la plus acerbe et la plus désespérée de la paix et de la vie quotidienne, avec sa routine, ses chaînes forgées dans du papier de chancellerie, ses luttes dérisoires et pourtant si épuisantes pour l'influence et le prestige, ses préoccupations mornes entre la fiche de rappel, la facture d'électricité et la revendication juridique ? On ne peut comprendre ni ici ni plus tard la pensée de Jünger, qui n'est souvent qu'une pensée sous le coup d'affects violents, si l'on ne comprend pas la haine du monde de la rentabilité et de l'utilité bourgeoises et bureaucratiques, de l'angoissant "renoncement au monde", que Jünger fuit d'abord dans la guerre, puis dans la nature, enfin dans le mysticisme ou dans l'isolement stylé, souvent trop prétentieux. Il faut prendre en compte le sentiment de vie d'une grande partie de la génération soldatesque de 1914. Celui qui ne veut pas pardonner devrait au moins pouvoir comprendre.

La guerre est pour Jünger un événement élémentaire et l'élémentaire ne lui semble finalement pas touché par le fait de la bataille matérielle. Il assume une envie primitive de combattre et de tuer et les soldats qu'il décrit, assourdis par le tonnerre des machines de destruction, par le "mur de feu flamboyant, haut comme une tour ..., baptisé dans un brouillard rouge, dans la soif de sang, la rage et l'ivresse, vivent dans un monde qui, en tant que réalité extrême, semble aussi onirique que choquant. C'est là que s'enracine "l'esthétique de l'horreur" de Jünger (selon son interprète Karl-Heinz Bohrer dans le livre du même nom), avec des effets artistiques qui font de lui peut-être le seul surréaliste de la littérature allemande. Le moment dangereux que l'homme vit de manière aussi somnambule que tranchante et surlignée, et que Jünger a raconté et étudié comme aucun autre, confère à ces œuvres, souvent insupportables dans leur vision du monde, un rang artistique si élevé qu'elles doivent être considérées comme ses plus importantes. La bataille matérielle est exaltée métaphysiquement, considérée par Jünger comme "l'expression d'un élémentaire", comme "un jeu somptueux et sanglant", comme "le besoin du sang de fête, de joie et de célébration" et l'héroïsme, que l'on croyait perdu, devient possible d'une nouvelle manière grâce à la maîtrise parfaite de l'appareil technique de destruction. C'est dans la guerre, dans la proximité de la mort, que la vie s'exprime avec intensité, tandis qu'en même temps la guerre consume les hommes comme le matériau d'une grande idée. C'est la guerre qui crée un Homme Nouveau, une nouvelle aristocratie, celle des tranchées, qui doit remplacer l'élite bourgeoise et ses idéaux éclairés datant du temps des perruques, sa confiance joufflue dans le progrès, le développement et l'humanité, une élite bourgeoise qui se prolonge dans le personnel dirigeant du mouvement ouvrier devenu pacifiste et bourgeois. Une telle esthétisation de l'horreur est du pur nihilisme, mais elle s'enracine tout naturellement dans le sentiment de vie d'une génération qui ne peut plus croire aux idées générales, à la vérité et à la justice des Lumières bourgeoises et du socialisme. Seule la lutte en soi, le fait que l'on lutte et la manière dont on le fait, confère le rang.
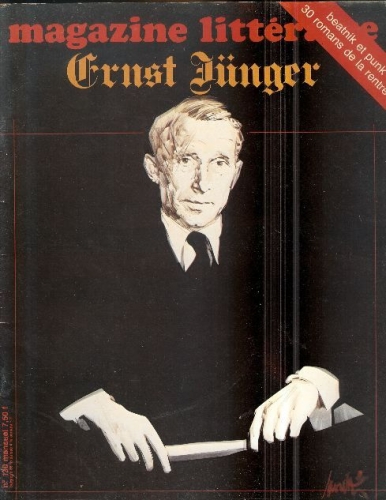
Avant de nous indigner, nous devrions nous pencher sur cette génération qui avait perdu toutes ses illusions, y compris celles que nous nourrissions déjà à nouveau, pour devenir la victime d'une nouvelle et plus terrible illusion, celle de la violence libératrice, purificatrice et fortifiante. De là, on peut tracer des lignes vers Georges Sorel et Benito Mussolini, vers Adolf Hitler comme vers Che Guevara et Frantz Fanon. Le sacrifice, la lutte, la souffrance, l'endurance ennoblissent une cause - mais une telle attitude semble être le dernier recours dans un monde désenchanté, banal, organisé, où la soif d'excitation la plus forte augmente de manière totalement inéluctable. Les œuvres du fasciste Pierre Drieu la Rochelle, du conservateur Henry de Montherlant, du socialiste André Malraux ou du sympathisant franquiste et hitlérien Wyndham Lewis montrent que cet enthousiasme a touché de nombreux hommes en Europe à cette époque. Ce sentiment de vie se retrouve au moins jusqu'à la fin de la guerre civile espagnole, à droite comme à gauche. La religion, la convention morale, le progrès, la réconciliation des peuples - ces idées sont devenues de vaines bulles d'air et la stabilisation du moi n'est plus possible que dans le groupe combattant, dans l'endurance fraternelle de monstrueuses épreuves, dans l'action concrète. L'idéologie, toujours défendue, devient alors périphérique. C'est dans l'action que les choses deviennent claires et exigeantes, que la décision est prise, que prend fin la discussion épuisante, le pour et le contre angoissant, le bavardage intellectuel où chaque argument trouve un contre-argument aussi évident que douteux.
Il faut comprendre la confusion, la profonde perplexité, l'ampleur du désenchantement de la génération de Jünger pour ainsi dire sur le plan de l'histoire culturelle: "Casca il mondo ! Le monde s'écroule !". Puis vint la mort avec la machine, dans laquelle la société européenne avait placé de tout autres espoirs, une société dans laquelle, du monarque au dernier chômeur, on avait cru que, peu à peu, l'humanité progressait quand même. De ce point de vue, la Première Guerre mondiale a été un événement bien plus important que la Seconde, qui n'en a été qu'une copie agrandie et déformée. Au-delà de toute idéologie qui nous fait peur, c'est Jünger qui a enregistré le plus laconiquement à l'époque, quasiment comme un graveur à la pointe sèche, ces bouleversements dans lesquels beaucoup ne trouvaient de soutien que dans une existence de soldat. Il était l'un des rares à trouver le courage de le faire ; après l'enthousiasme général, c'est un flot de paroles pacifistes confuses qui prévalait. On pourrait ici se placer sur le plan purement artistique et louer le niveau stylistique élevé de ces textes, à quelques dérapages près. Mais deux choses sont décisives. Premièrement, nous sommes ici conduits vers les abîmes de l'âme humaine (peu importe que Jünger le fasse avec presque autant d'enthousiasme), que nous ne pouvons pas nier, surtout si nous voulons la paix. Cette thèse selon laquelle il existe un besoin d'action guerrière et que ce besoin ne peut pas être expliqué comme le résultat d'intérêts économico-militaires et de manipulation - cette thèse ne mérite pas l'indignation, mais l'examen. Ainsi, pour la plupart d'entre nous, les premiers écrits de Jünger soulèvent la question de savoir si la condition humaine n'est pas encore pire que ce que croit l'amoureux de la paix effrayé par la guerre. Deuxièmement, dans l'horreur de la première guerre industrielle, Jünger parvient à découvrir les structures et les forces motrices de la société industrielle "pacifique". Là encore, l'affirmation de la cause par l'auteur ne change rien à la force d'ouverture des phénomènes de travaux tels que le court essai de 1930 Die totale Mobilmachung. Bien sûr, entre les premiers écrits sur la guerre, la "Mobilisation totale" et le "Travailleur", il y a un livre comme Das abenteuerliche Herz (1929), dans lequel Jünger anticipe sa pensée de promeneur que l'on trouve dans ses derniers journaux et essais, notant sa pensée sur la nature, la société et le quotidien. L'attente au bureau de poste, le shopping, la contemplation des animaux et des plantes, les rêves, les descriptions oppressantes de machines de torture que nous ne connaissons que de Kafka - ce qui caractérise ce recueil, ce n'est pas seulement la certitude du caractère symbolique de tous les phénomènes, mais aussi la volonté de récupérer la réalité la plus fugitive au moyen des sens de l'ouïe, du toucher, de l'odorat et du goût. Dans la littérature allemande de notre siècle, seul Walter Benjamin y est peut-être parvenu de manière similaire. Un tel comportement esthétique, dans lequel le fragment de conscience et de perception devient en un éclair le miroir de l'époque, n'est possible qu'en des temps où le sol vacille, où, comme l'a dit un jour Jacob Burckhardt en 1876, en se référant davantage à la politique, "toute certitude a une fin".
Jünger a souvent dit de lui-même: "Après le tremblement de terre, on frappe sur les sismographes". Et si, pour beaucoup, cette expression traduit l'intention de minimiser son propre travail, elle rend compte en grande partie de la situation. Tous ceux qui ont contribué à détruire les illusions de l'optimisme du progrès au début de notre siècle ne pouvaient le faire sans sarcasme, voire avec une joie malveillante. Les opposants à l'attribution du prix Goethe à Ernst Jünger l'ont qualifié de chantre de la "mobilisation totale" avec une indignation vraiment infatigable. Mais le fait qu'Adolf Hitler aimait utiliser ce terme (c'est pourquoi Jünger l'évitait pendant le Troisième Reich) et que Jünger ne regrettait pas seulement la défaite allemande de 1918, mais espérait une revanche, n'est pas une raison pour nier la valeur diagnostique de cet essai. Il montre que les Etats à structure corporative ou féodale comme la Turquie ou la Russie n'étaient guère à la hauteur de la guerre et que l'Allemagne, qui présentait jusqu'à la fin de la guerre de fortes structures traditionnelles, a également perdu la partie pour cette raison. Les pays qui ont gagné la guerre sont ceux qui possédaient une classe dirigeante métropolitaine et technicisée et qui ont réussi - sur la base de l'égalité civique - à exploiter toutes les réserves de matériel et d'hommes. L'Allemagne n'a réussi qu'une mobilisation partielle et n'avait même pas d'idéologie unifiée. Désormais, tous les pays développés devaient, s'ils voulaient se maintenir dans le monde, orienter toute leur économie et leur technique vers la possibilité d'une guerre totale. Ils devraient aussi, pour assurer l'unité idéologique de la nation, se préoccuper de manipuler une opinion publique favorable aux objectifs du pouvoir. Rarement la tendance de la machine à faire la guerre et l'avenir de la propagande auront été vus avec autant d'acuité. Jünger voyait dans les chars, les canons, les sous-marins, les avions et les mitrailleuses des machines en réalité parfaites. Et comme Nietzsche avant lui, il était clair pour notre auteur que la technique et la science "voulaient" la destruction du monde, tout en croyant encore que la technique ouvrait de nouvelles possibilités d'héroïsme et donc d'humanité. Mais ce n'est que parce qu'il voyait dans les machines la volonté de destruction qu'il affirmait alors, qu'il a pu se lancer plus tard dans une critique aussi convaincante de l'ère technique. L'opposition entre "gauche" et "droite" n'était déjà plus pertinente pour Jünger. Il était convaincu qu'elle avait été dépassée par la bureaucratie et la technocratie qui se servaient alternativement des mots "gauche" et "droite" et des luttes correspondantes entre les camps pour contraindre l'individu à s'adapter. La lutte entre les camps n'était qu'un tour de vis ...
Le caractère inéluctable de ce monde, Jünger le voyait sans doute de la même manière que Max Weber, qui était certes trop prompt à croire que l'on pouvait être "humainement à la hauteur". Dans "La mobilisation totale", Jünger écrivait : "L'abstraction, donc aussi la cruauté de toutes les conditions humaines, augmente sans cesse. Le patriotisme est remplacé par un nouveau nationalisme fortement imprégné d'éléments de conscience. Dans le fascisme, dans le bolchevisme, dans l'américanisme, dans le sionisme, dans les mouvements des peuples de couleur, le progrès fait des avancées que l'on aurait crues impensables jusqu'ici ; il se précipite pour ainsi dire, pour continuer son mouvement sur un plan très simple, après un cercle de dialectique artificielle. Il commence à se soumettre les peuples dans des formules qui ne se distinguent déjà plus guère de celles d'un régime absolu, si l'on veut bien faire abstraction du degré bien moindre de liberté et de convivialité. En de nombreux endroits, le masque humanitaire est déjà tombé, mais un fétichisme mi-grotesque, mi-barbare de la machine, un culte naïf de la technique, apparaissent, précisément dans les lieux où l'on n'a pas de rapport direct, productif, avec les énergies dynamiques dont les canons à longue portée et les escadrons de combat armés de bombes ne sont que l'expression guerrière. En même temps, l'appréciation des masses augmente; le degré d'adhésion, le degré de publicité devient le facteur décisif de l'idée. En particulier, le socialisme et le nationalisme sont les deux grandes meules entre lesquelles le progrès écrase les restes de l'ancien monde et finalement lui-même.
Pendant plus d'un siècle, la "droite" et la "gauche" se sont renvoyé comme des balles les masses aveuglées par l'illusion optique du droit de vote; il semblait toujours y avoir chez l'un des adversaires un refuge contre les prétentions de l'autre. Aujourd'hui, dans tous les pays, le fait de leur identité se révèle de plus en plus clairement, et même le rêve de liberté s'évanouit comme sous la poigne de fer d'une pince. C'est un spectacle grandiose et terrible que de voir les mouvements des masses de plus en plus uniformément formées, auxquelles l'esprit du monde tend ses filets de pêche. Chacun de ces mouvements contribue à une capture plus aiguë et plus impitoyable; et il y a là des sortes de contraintes plus fortes que la torture: si fortes que l'homme les accueille avec jubilation. Derrière chaque issue dessinée avec les symboles du bonheur se cachent la douleur et la mort. Heureux celui qui entre dans ces espaces équipé".

"La mobilisation totale": c'était aussi la nouvelle annoncée de l'enterrement de l'individu, une évolution qui semblait totalement inéluctable à Jünger, et qu'il affirmait donc avec un pessimisme héroïque. Ce thème est développé plus en détail dans Le Travailleur. Le monde est entré dans l'ère du "grand aménagement de l'espace", où la rationalisation du travail devient parfaite; les moyens techniques déterminent de plus en plus l'homme sur le plan social, psychique et physique. Sous la dictée de la technique, la guerre et le travail industriel se ressemblent de plus en plus. Le soldat devient un technicien de l'extermination, le technicien "civil" agit dans le paysage planifié du nouvel État total comme un soldat de la production: "La tâche de la mobilisation totale est la transformation de la vie en énergie, telle qu'elle se manifeste dans l'économie, la technique et les transports dans le vrombissement des roues ou sur le champ de bataille comme feu et mouvement". Sausen, Blitz, Brausen, Fliegen, Schwirren, Donnern - nous trouvons une accumulation de tels mots dans le livre de Jünger, dans lequel une fascination pour la technique est clairement visible, comme elle l'est par exemple dans la Neue Sachlichkeit (Nouvelle Objectivité) à la même époque. Et pourtant, le fait d'être livré à l'appareil technique est très clair, même si Jünger le salue comme une fatalité à laquelle il faut adhérer. Le mythe de l'ouvrier, qui est le mythe d'une société planifiée et industrielle disciplinée, une sorte de bolchevisme sous des auspices nationalistes, ce mythe est pour Jünger lié à un système autoritaire qui abolit l'inefficacité et la convivialité de l'ère libérale. Les figures du Waldgänger et de l'Anarque qu'il dessinera plus tard, toutes deux ennemies de la technique, se réfèrent au "travailleur". Jünger est un homme des extrêmes et il voit les phénomènes de l'intérieur. C'est ce qui rend cette pensée séduisante, mais c'est aussi ce qui fait sa force : l'exagération qui amplifie les phénomènes en fait ressortir la tendance. Et la déclaration suivante s'applique également à Der Arbeiter: "Notre tâche ... consiste à voir, mais pas à faire de la publicité".
1933-1945. Il ne fait aucun doute que Jünger n'aimait pas la République de Weimar et qu'il espérait un autre système. Mais qui la défendait encore dans sa phase finale, qui l'aimait même? Avec ses chômeurs, son désespoir à peine imaginable aujourd'hui, sa large acceptation du Traité de Versailles, considéré à juste titre comme un diktat insupportable, son (auto-)humiliation nationale? Et: pour comprendre Jünger, il faut au moins considérer comme discutable la thèse selon laquelle, à partir de 1930, après la démission du gouvernement Hermann Müller, la question n'était plus: démocratie ou dictature? - mais seulement: quelle dictature et de qui? C'est un simple fait qu'une grande partie de la population, jusque dans l'électorat des partis démocratiques, n'était pas démocrate et que, si elle voulait le devenir, l'évolution de Weimar ne lui facilitait pas la tâche. The proof of the pudding is in the eating. La démocratie est quelque chose de difficile à faire et nous ne devons pas oublier que Reinhold Maier et Theodor Heuß ont voté en faveur des lois d'habilitation - alors qu'Ernst Jünger et Carl Schmitt n'ont pas eu cette chance...
Certes, il y avait une certaine proximité de Jünger avec le national-socialisme. Mais cette proximité était à l'époque aussi normale que compréhensible. Il suffit de penser à un Ernst Niekisch, dont la résistance, aujourd'hui louée, s'enracinait surtout dans l'opinion qu'Hitler n'était pas assez radical, qu'il était une marionnette de l'"Occident". Cette proximité n'est pas non plus disqualifiante en soi, comme le prouvent les hommes du 20 juillet, qu'il est impossible de maquiller en démocrates et qui ont opposé la résistance qui faisait généralement défaut aux démocrates convaincus. Sous le troisième Reich, Jünger s'est comporté de manière tout à fait irréprochable. Il a refusé d'être admis à l'Académie prussienne de littérature, il a interdit aux journaux nationaux-socialistes de publier ses œuvres, il a immédiatement refusé un mandat au Reichstag qui lui avait été proposé par la NSDAP, il a écrit Auf den Marmorklippen (Sur les falaises de marbre), une œuvre qui a été lue par beaucoup comme une attaque téméraire contre le régime hitlérien, il a fait preuve d'une rare solidarité avec les persécutés (par exemple avec Niekisch), il entretient des contacts étroits et amicaux avec Speidel et von Stülpnagel, il confie à son journal des commentaires sur la situation qui étaient plus que dangereux, si l'on considère que les perquisitions de la Gestapo chez lui ne comptaient pas parmi les raretés. Nous avons déjà évoqué sa démobilisation après le 20 juillet 1944. Si l'on lit dans les Strahlungen les passages concernant Hitler et Goebbels, il est impossible de considérer cet homme comme un ami des nationaux-socialistes. Gärten und Straße, paru en 1942, a été indexé parce que Jünger note le 29 mars 1940 : "Ensuite, je me suis habillé et j'ai lu le psaume 73 à la fenêtre ouverte".

Les possibilités de résistance d'un capitaine, qui avait en outre l'intelligence de voir en Hitler l'homme providentiel, étaient modestes. Jünger n'a même pas été en mesure de résoudre le problème central: "Comment puis-je entrer dans le cercle d'exclusion 1 avec la bombe?" - On lui a reproché, à partir de ses écrits Le travailleur et La mobilisation totale, de défendre l'idéologie de l'État total et on a ensuite construit, notamment dans le document de protestation des Verts, une ligne Jünger-Hitler. L'"État total", que Jünger a parfois voulu, était pourtant le concept opposé à celui d'Hitler. Il voulait dire la dictature de la Reichswehr contre la combinaison négative NSDAP/KPD, telle que l'ancien chancelier Kurt von Schleicher, assassiné par les nazis en 1934, l'avait imaginée dans son idée de "front transversal" incluant les syndicats. Le NSDAP ne voulait pas d'un "Etat total" - il voulait une communauté populaire volontaire, car l'Etat total exprimait à la fois la contrainte, qui n'était plus nécessaire entre les heureux membres du peuple, et le caractère légal de la forme politique souhaitée. La polémique contre l'"État total" est presque la caractéristique unificatrice de toutes les théories nationales-socialistes. Il est tout aussi absurde de reprocher à Jünger de constater la tendance à une "caractérologie mathématique et scientifique", par exemple "sur une recherche raciale qui s'étend jusqu'au comptage des globules sanguins". Sa conclusion selon laquelle "ce n'est qu'avec l'apparition de ces phénomènes ... que l'art d'État et la domination à grande échelle, c'est-à-dire la domination mondiale, seront possibles", est tout à fait plausible ; de même que le fait que Jünger constate ici aussi la "renumérotation du monde". Et lorsqu'il écrit en 1920: "L'intégration de tous les Allemands dans le grand peuple de cent millions de personnes de l'avenir, voilà le but pour lequel il vaut bien la peine de mourir et d'écraser toute résistance", ce sont les mots d'un nationaliste déçu, dont la nostalgie est compréhensible même aujourd'hui...
Il est indéniable que Jünger a tenu quelques propos antisémites. Mais avant 1933, de telles prises de position étaient très répandues et les Juifs étaient considérés comme des représentants de la modernité et de l'abstraction, des partisans du système de Weimar en faillite, des organisateurs d'une industrie culturelle décadente. Il faut toujours tenir compte du contexte de telles déclarations, il faut distinguer si elles veulent quelque chose ou si elles ne font que constater quelque chose et il faut enfin accorder ceci ou cela à un homme qui n'a pas seulement écrit quelques livres importants, mais qui a fait preuve de courage, de courage civique et de galanterie à d'innombrables reprises. On ne peut pas non plus attendre d'un homme qui a grandi dans la tradition militaire de l'Empire qu'il devienne un libéral-démocrate enthousiaste. De plus, la critique de la démocratie n'est pas forcément fausse, la sociologie politique en fournit suffisamment de preuves, il suffit de penser à Michels, Pareto, Sorel, Mosca, Ostrogorski et même Schumpeter.

Dans le cadre de cet article, il n'est pas possible d'aborder de nombreux écrits, comme la magnifique étude An der Zeitmauer (1959), dans laquelle Jünger éclaire les raisons de la fascination pour l'astrologie, ou l'essai Der gordische Knoten (1953), dans lequel il retrace les racines historiques du conflit Est-Ouest. Il faut également passer sous silence son activité d'éditeur de la revue Antaios (en collaboration avec Mircea Eliade), son œuvre narrative, ainsi que ses derniers carnets de voyage Soixante-dix s'effacent. "Là où l'on met la main, c'est intéressant", disait Goethe à propos de la vie. C'est aussi une maxime de Jünger, dont l'universalité des intérêts rappelle autant Goethe que son talent pour l'aventure de l'étonnement. Certes, tous les écrits du lauréat ne sont pas réussis, et il va de soi que beaucoup d'entre nous n'aiment pas son message, ou du moins pas toujours. Mais qu'est-ce que cela signifie par rapport à l'œuvre d'un grand passeur de frontière entre la poésie, la contemplation et la science, d'un homme avec lequel il vaut toujours la peine de se confronter - même si ce n'est pas de la manière la plus insipide des protestataires contre l'attribution du prix? Avec le Waldgänger dans Der Waldgang (1951) et avec l'Anarchen dans Eumeswil (1977), Jünger nous a esquissé deux types de résistance à la domination. Certes, le Waldgänger qui attend, se tient prêt, frappe de temps en temps, et dont les moyens de lutte sont avant tout le sabotage et le refus, n'est pas quelqu'un qui se jette dans la gueule du loup du pouvoir en place. Mais ce n'est pas le sens de la résistance. Mais il nous est donné ici une suggestion décisive sur la manière dont un système totalitaire pourrait peut-être être contraint de battre en retraite. Certaines phrases de ce travail font l'effet d'une illustration de ce qui se passe aujourd'hui en Pologne et la quintessence de Jünger est donc la suivante: "Là où un peuple se prépare à marcher dans la forêt, il doit devenir une puissance redoutable". La marche en forêt n'est ni plus ni moins qu'une théorie sur l'érosion de l'appareil de domination par les réactions imprévisibles de nombreux individus déterminés. A l'opposé, l'"anarque" (qui ne veut pas, comme l'anarchiste, abolir la domination, car celle qui est combattue à chaque fois ne serait que remplacée par une autre) est une figure plus désespérée. L'anarque comprend que sa résistance est sans espoir et ne se préoccupe que de sa propre liberté de mouvement et de pensée. Il se bat égoïstement pour sa liberté: contre ses parents, contre la "société", contre l'opinion publique, contre les "idées", contre son propre confort. Ce sont deux modèles de liberté qui sont presque toujours négligés dans les discussions sur le grand sujet. On peut reprocher à ces approches de se concentrer trop fortement sur la fuite, l'évitement, la survie. Il n'y a pas ici de guerre d'agression fraîche et joyeuse contre la très grande et la très authentique liberté, mais le "manque d'optimisme" n'est guère un reproche au vu des expériences de l'époque. Peut-être qu'aujourd'hui, en particulier dans les sociétés où la domination des hommes est organisée par des moyens psychiques et intellectuels plutôt que par l'usage classique de la force, la capacité de résistance individuelle et consciente de l'individu est plus nécessaire que celle des groupes sociaux qui, la plupart du temps, ne veulent que participer à l'oppression subtile et lutter pour leur quota légal de possession du pouvoir. C'est parce que Jünger, à ses débuts, a saisi de manière radicale la menace qui pèse sur la liberté individuelle, que le dernier Jünger a pu devenir un partisan de cette liberté. Il est impossible de voir en lui un agent de l'absence de liberté organisée ; nous pouvons encore lire le premier comme un diagnostic, même si nous rejetons ses conséquences - les conseils du dernier peuvent nous être utiles. Dans un écrit comme La Paix - que Rommel a salué comme le fondement éthique de la résistance - Jünger montre un net éloignement de son militarisme antérieur et nomme très clairement les "meurtres sacrilèges" dans les camps de concentration. Les grands efforts de la guerre, avec leurs sacrifices et leur héroïsme, sont pour lui "la semence" d'où doit germer le fruit: la paix. "On peut bien dire que cette guerre a été la première œuvre générale de l'humanité. La paix qui la termine doit être la seconde". Peut-être que seul un vieux soldat comme Jünger pouvait dire le 24 juin 1979 devant les anciens combattants allemands et français à Verdun: "Ne devrions-nous pas, désormais à l'échelle de la planète, commencer tout de suite là où tant de détours de tant de victimes nous ont conduits ?"
Chaque nouvelle lecture prouve à quel point l'œuvre de cet aventurier intellectuel et pisteur est riche en facettes, complexe et même contradictoire. Nul doute qu'il s'agit là d'une œuvre majeure et durable, d'un homme qui a franchi bien des frontières, qui a célébré le pouvoir et qui lui a résisté, qui a exalté la voix du sang et qui, sans doute pour cela, a redécouvert le geste de la fraternité, ce geste si simple et si lourd ; d'un homme qui a souvent été un sismographe et souvent un oiseau d'orage ; d'un homme, enfin, dans l'œuvre duquel se reflètent la tension, le tourment, le cœur des conflits de l'époque qui déchirent les individus. Ernst Jünger est un lauréat digne de ce nom.
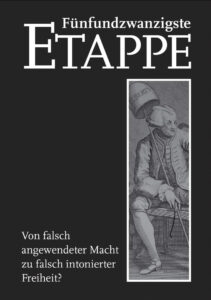
25. Etappe
L'article de Günter Maschke est d'abord paru dans: Fünfundzwanzigste Etappe, mai 1990. Nous remercions l'éditeur, le Dr Theo Homann, pour l'autorisation de publication. Des exemplaires individuels peuvent être commandés ici: https://etappe.org/25-etappe/
20:55 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : günter maschke, ernst jünger, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, histoire, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 03 avril 2022
Massimo Donà et la philosophie de Goethe: une seule vision

Massimo Donà et la philosophie de Goethe: une seule vision
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/massimo-dona-e-la-filosofia-di-goethe-una-sola-visione-giovanni-sessa/
Un livre très important de Massimo Donà vient de paraître, Una sola visione. La filosofia di Johann Wolfgang Goethe (pp. 327, euro 14,00). Dans ses pages, le philosophe se confronte à la pensée du grand poète allemand, dont il lit les œuvres en termes théoriques. Ce livre a été précédé de deux autres monographies, consacrées respectivement à Leopardi et à Shakespeare. Le motif qui unit les trois volumes est le même. Donà interprète ces trois grands, en soulignant, à la lumière de ses propres positions spéculatives, leurs traits anti-platoniques, anti-universalistes. Ce n'est pas un hasard, soutient l'auteur, si Goethe était mû par un "amour surhumain pour l'unicité irrépétable de l'existence" (p. 21) : il comprenait la vie et la nature comme "l'expression d'une puissance incoercible dont il aurait été vain d'essayer de prédéterminer le cours et la direction [...] puisque "en tout lieu nous sommes en son centre"" (p. 22). Sur la base de cette intuition, le génie de Weimar a compris l'inanité des "universaux", des "idées", pour comprendre la réalité. Les concepts déterminent, "pétrifient" le connu, au mieux compartimentent, par la procédure analytique, l'Un-Tout.
L'observateur le plus superficiel de la nature est conscient de son mouvement perpétuel. Comment, dès lors, est-il concevable de prétendre la connaître à partir de la "tranquillité" des idées ? Goethe était clairement conscient de cette contradiction. Il savait également que l'attitude gnoséologique platonicienne avait survécu dans la philosophie moderne. Les formes a priori de Kant, en effet, se caractérisent par la même nature statique que les universaux. Et pourtant, chez le penseur de Könisberg, dans la Critique du jugement, palpite une autre-non-autre manière de se rapporter au monde. La même vision se manifeste chez Bruno, Leibniz, de La Mettrie et Leopardi, sans oublier Spinoza. Leur pensée ne réduisait pas la nature à une série de "problèmes" (en tant que tels solubles) mais se présente sous le trait d'une "véritable écriture de l'énigme" (p. 28). Une position qui réapparaîtra, souligne Donà, également dans la philosophie du vingtième siècle: chez Deleuze, chez Arendt et, ajouterions-nous, également dans l'idéalisme magique d'Evola. Des formes de pensée qui échappent au logo-centrisme. Pour comprendre l'ubi consistam réel de l'idée de nature de Goethe, il est bon de se référer à la "matière": elle, l'être de tout ce qui est, en un : "dit son être placé et son ne pas être placé par moi" (p. 35).
Cela signifie, d'une part, que moi, le sujet connaissant et l'objet connu, vivons une relation d'attraction, qui fait que nous ne sommes pas autres l'un par rapport à l'autre, mais identiques. En même temps, nous sommes obligés de reconnaître que cette relation se développe de manière contradictoire, dans la mesure où la signification, la "compréhension" du monde me le fait vivre comme absolument autre que moi-même. Toute réalité est : "à la fois phénomène (dans la mesure où elle est référençable pour moi) et noumène (inconnaissable)" (p. 36). La matière est donc constituée de deux forces, dont Kant et Schelling avaient déjà parlé, l'une attractive et l'autre répulsive. Dans ce contexte spéculatif, Goethe introduit le concept de "métamorphose", cœur vital de son exégèse du naturel. Cette expression doit être comprise comme ce qui se passe "au-delà de la forme". En elle, précise Donà, il n'y a pas de référence à la cyclicité, mais à ce qui dépasse toute forme donnée. Pour cette raison, l'instrument privilégié dans l'exégèse de la nature est l'analogie, et non la similitude. Connaître par analogie implique de comprendre que, dans des espaces différents, il y a la même chose. L'idée même d'identité doit être repensée. Elle ne peut être posée que d'une seule manière: "comme ce qui en vérité n'a pas de forme" (p. 41), puisque ce qui revient dans les métamorphoses continues de la nature est "toujours et seulement la négation d'une forme" (p. 41).

La "matière" représente ce mouvement qui n'est aucun des "déterminés", des entités que je rencontre dans l'expérience, mais qui est seulement donné en eux. La métamorphose de Goethe, soutient Donà, est différente du dialectisme hégélien (et, en partie, de celui de Schelling également). Le système panlogistique a des règles déterminées, capables de dessiner une identité. Chez Hegel, la synthèse, le point d'arrivée, est déjà inscrit au commencement : "La nature n'a pas de système [...] elle a la vie [...] Elle est vie et succession d'un centre inconnu vers une limite inconnaissable" (p. 50). L'energheia, pour reprendre l'expression leibnizienne, est une force centrifuge, dispersive, entropique qui, du centre, tend vers l'extérieur. La désintégration du vivant n'a pas lieu: "précisément en vertu d'une force opposée [...] "centripète" (p. 51), qui tend vers l'extérieur (p. 51), qui tend à se spécifier, à "se préserver". Nous sommes enveloppés par la nature, l'horizon transcendantal de l'homme, comme dirait Löwith, et nous ne pouvons y échapper. Face à la luxuriance des jardins de Palerme, l'Allemand comprend que l'Urpflanze, la plante originelle, n'est pas réductible à la dimension de la Gestalt, de la forme platonicienne; au contraire, elle fait allusion au centre inconnu du Tout. C'est pourquoi Goethe, comme plus tard Heidegger, considérait que la physis coïncidait avec l'être, avec l'"épanouissement".
Où que l'on soit, on est toujours au centre de la nature, impliqué dans sa danse éternelle, dans le jeu éternel de la métamorphose dionysiaque. Dans ce livre : "Tout est nouveau et pourtant toujours ancien" (p. 61). L'Antiquité est l'informe, la négation originelle qui se donne "positivement" dans les entités. Notre action est donc le fait de la nature elle-même. En elle, Orphée et Prométhée ne font qu'un et nous faisons l'expérience du fini comme quelque chose qui doit toujours être dépassé, nous avons tendance, dans la mesure où nous relevons de la physis, à nous déterminer/à nous in-déterminer (la conception augustinienne du temps comme distensio animae a une grande pertinence pour Donà à cet égard). Le postulat hermétique "tout pense" découle de cette vision du Tout, de ses corrélations sympathiques. La pensée, en somme, est l'ouverture d'un monde. Goethe devient le porteur de cette connaissance non verbale particulière, qu'Aristote qualifie dans le livre IV de la Métaphysique, en l'attribuant aux plantes, de connaissance de ceux qui "ne disent rien" (p. 122). Cette connaissance, qui ne s'oppose pas au principe d'identité, adoucit sa lumière apodictique et évite le jeu du "être autre que moi-même", auquel elle renvoie inévitablement. Après tout, c'est la pensée du néant! Elle est pensée autrement que non-autrement par rapport au théorème et, chez Goethe, elle conduit à l'intuition.
Massimo Donà
Il nous permet "d'embrasser dans une seule vision ordonnatrice l'activité vitale infiniment libre d'un seul royaume de la nature" (p. 155). L'unité véritable devait se caractériser par l'infini et la liberté: "explosion d'un multiple jamais contraignable à des 'distinctions irréversibles'" (p. 157). En bref, le mouvement naturel est pensé par Goethe "comme une unité immédiatement destinée à se dire dans la "forme de deux", c'est-à-dire comme une polarité absolue. Absolu parce qu'il est original" (p. 161). Cette thèse est confirmée dans la Théorie des couleurs. Les couleurs ne sont déterminées qu'à partir d'une impossible superposition de l'obscurité sur la lumière ou de la lumière sur l'obscurité: " qui sont 'un' [...] parce qu'ils ne peuvent pas se déterminer comme absolument différents les uns des autres " (p. 265). Les couleurs ressortent (comme l'a également souligné Steiner) sur la frontière ambiguë qui semble diviser la lumière de l'obscurité. Le jeu des contraires est retracé par Donà, dans une exégèse précise des Affinités électives, dans les relations amoureuses des quatre personnages principaux du roman.
Un livre important, Un sola visione, non seulement pour la lecture éclairante de Goethe, mais aussi pour ceux qui souhaitent regarder le monde avec un regard renouvelé.
Giovanni Sessa
19:13 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : goethe, allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, livre, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 février 2022
Otto Braun, écrivain soldatique: "Je vais m'accrocher, quoi qu'il arrive"

Otto Braun, écrivain soldatique: "Je vais m'accrocher, quoi qu'il arrive"
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/io-terro-duro-qualunque-cosa-accada-otto-braun-giovanni-sessa/
 Nous avons souvent noté que le destin des livres est insondable. Des volumes précieux, porteurs d'une nouvelle vision du monde, se sont révélés tels quelques décennies seulement après leur publication. D'autres, au contraire, moins significatives, mais imprégnées du bon sens de la conjoncture historique dans laquelle elles étaient appelées à voir le jour, ont obtenu un écho immédiat. Le livre que le lecteur s'apprête à lire, Io terrò duro, qualunque cosa accada. Il s'agit du Journal et de lettres d'un jeune volontaire de guerre, Otto Braun, et de son témoignage paradigmatique. La première édition italienne, publiée en 1923, a été éditée par le philosophe politique Enrico Ruta sous le titre Journal et lettres, et a attiré l'attention d'un petit groupe d'intellectuels dont, comme on le verra, les philosophes Benedetto Croce et Julius Evola. L'un des premiers à avoir saisi le caractère exceptionnel de ce recueil a été l'idéaliste magique, qui a identifié le jeune auteur comme un porte-flambeau ante litteram de ses propres positions spéculatives.
Nous avons souvent noté que le destin des livres est insondable. Des volumes précieux, porteurs d'une nouvelle vision du monde, se sont révélés tels quelques décennies seulement après leur publication. D'autres, au contraire, moins significatives, mais imprégnées du bon sens de la conjoncture historique dans laquelle elles étaient appelées à voir le jour, ont obtenu un écho immédiat. Le livre que le lecteur s'apprête à lire, Io terrò duro, qualunque cosa accada. Il s'agit du Journal et de lettres d'un jeune volontaire de guerre, Otto Braun, et de son témoignage paradigmatique. La première édition italienne, publiée en 1923, a été éditée par le philosophe politique Enrico Ruta sous le titre Journal et lettres, et a attiré l'attention d'un petit groupe d'intellectuels dont, comme on le verra, les philosophes Benedetto Croce et Julius Evola. L'un des premiers à avoir saisi le caractère exceptionnel de ce recueil a été l'idéaliste magique, qui a identifié le jeune auteur comme un porte-flambeau ante litteram de ses propres positions spéculatives.
[...] La publication de ce texte est également liée à un souvenir de l'écrivain. Il fait également référence au "destin" du livre que nous présentons. En 2008, j'ai contacté le philosophe Franco Volpi par téléphone, bien que je ne le connaisse pas personnellement. Quelques années auparavant, il avait écrit la préface des Essais sur l'idéalisme magique d'Evola : je lui ai demandé s'il accepterait de répondre à mes questions concernant son parcours intellectuel, l'état d'avancement de la traduction des œuvres de Heidegger dans laquelle il était engagé, la Révolution conservatrice et Evola. L'interview devait être publiée par un petit éditeur romain. Il a été très gentil, mais a décliné l'invitation. Au cours de la conversation, qui a duré plus d'une heure, nous avons longuement discuté de l'idéalisme magique. À la fin, il m'a dit, en tenant compte de mes intérêts : "Je vous conseille vivement de vous intéresser à Otto Braun. C'est un auteur vraiment extraordinaire, dont on sait peu de choses. J'ai demandé à mes étudiants de faire des recherches sur lui en Allemagne, mais la partie la plus importante de son œuvre est essentiellement son journal et ses lettres. Veuillez faire de votre mieux, si possible, pour réaliser une nouvelle édition afin que nous puissions enfin en discuter à nouveau. J'ai accepté son invitation. Je dédie ces brèves notes à la mémoire de Volpi, un intellectuel courageux et profond qui est toujours allé au-delà des barrières de l'"académiquement correct".

Otto Braun est né à Berlin le 27 juin 1897. Il était le fils du Dr Heinrich Braun et de Lily von Kretschmann, auteur de Memorien einer Sozialistin (1910-1911) inspiré du Memorien einer Idealistin de Malwida von Meysenburg, connu dans les milieux socialistes allemands pour avoir pris une part active à la controverse théorique et politique entre l'orthodoxie de Bebel et le révisionnisme de Bernstein. Dans cette diatribe, le jeune Otto et samère se sont rangés du côté de ces derniers. Le jeune homme est influencé intellectuellement par ses parents bien-aimés, mais il est aussi sensible à l'amour de son pays, qu'il vit avec enthousiasme, sans jamais atteindre le piètre niveau du nationalisme chauvin. Lorsque la guerre éclate, il tente de s'engager comme volontaire, mais sans succès. Il demanda de l'aide à un général connu et ami de la famille et put ainsi reprendre le mousquet. Il fut blessé à plusieurs reprises et tomba héroïquement au front en 1918, alors qu'il avait une vingtaine d'années.
Pour comprendre la valeur théorique et existentielle de l'expérience de cet enfant prodige, il faut tenir compte du fait suivant : son époque a vu la condensation de tensions inexplicables, qui ont agi avec force tant au niveau individuel que collectif en Europe, plus précisément en Europe centrale, qui, après la Grande Guerre, a vu la dissolution de deux structures impériales, l'empire des Habsbourg et le Second Reich.

D'un point de vue général, il est donc nécessaire de placer les pages de Io terrò duro, qualunque cosa accada (Je tiendrai bon, quoi qu'il arrive) à côté des expériences de vie et de pensée contemporaines d'Otto Weininger et de Carlo Michelstaedter, profondément marquées par la réémergence du tragique. Les trois auteurs appartiennent à ce vaste mouvement intellectuel qui a transcrit dans ses productions à la fois les signes tangibles de la fin d'un monde, le monde bourgeois-chrétien selon l'expression de Hegel, et la possibilité de la réalisation d'un Nouveau Départ de l'histoire européenne.
Nous faisons référence, ici, à ce corps de pensée que Massimo Cacciari a défini comme la "métaphysique de la jeunesse" et qui englobe la génération née "autour" du 20 novembre 1889, jour où Gustav Mahler a dirigé sa première symphonie à la Philharmonie de Budapest : "C'est le temps de la mémoire. Tous ceux qui sont nés "autour" de la première symphonie de Mahler y participent : leur "jeunesse" n'est qu'un élément de composition, un mouvement dans le contexte de la symphonie, fuyant vers leur propre Trauermarsch (marche funèbre)".
Une expérience spéculative marquée par le négatif et le refus de toute référence transcendante qui, traversant Stirner et Nietzsche, partageait aussi le platonisme inversé de Lukács: "L'absolu, ce qui n'admet pas de médiation, l'univoque, n'est que le concret, le phénomène individuel ". Nos auteurs ont été amenés à vivre socratiquement, en privilégiant la dimension éthique, la décision et le choix qui, chez eux, à la différence de Kierkegaard, ne visait plus le religieux au sens propre, mais le Werk, l'œuvre qui, de ce point de vue, aurait dû réaliser la réunification de la vie et de la pensée, du fini et de l'infini.
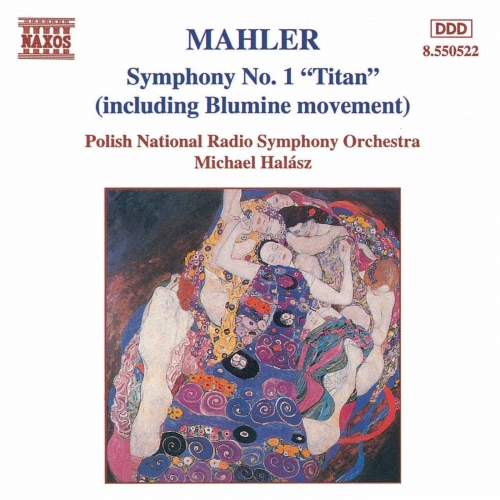
Weininger, Michelstaedter et Braun présupposent le fondement spéculatif non avoué de la philosophie weiningerienne du als-ob, du comme si. Selon Cacciari, l'"héroïsme" théorico-pratique auquel ils se consacrent "consiste [...] à nous préserver de toute illusion et, dans cet état d'âme, à viser à donner forme à notre in-dividuel, comme si nous vivions dans une Culture, comme si cet in-dividuel était réellement un symbole". [...]
Les pages de ce livre marquent les étapes de l'éducation d'Otto, visant à conquérir la dimension proprement humaine que les Grecs bien-aimés avaient attribuée au seul aner, et jamais au simple anthropos, l'homme "dimidié", centré sur la dimension biologique-existentielle. Dans la philosophie classique, l'homme était considéré comme "incapable de se posséder lui-même", en proie aux corrélations de la conscience induites par le rapport toujours changeant entre le moi et le monde, typique de l'homme "rhétorique", proie facile du dieu de la philopsuchía.
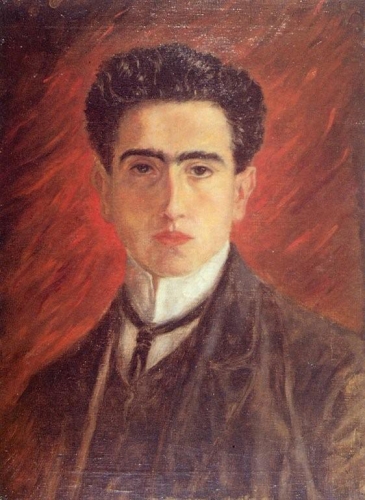
Michelstaedter (portrait, ci-dessus) dit de cet "animal humain": "Sa fin n'est pas sa fin, il ne sait pas ce qu'il fait ni pourquoi il le fait : son action est un être passif parce qu'il n'est pas lui-même tant que la faim de vie vit en lui, irréductible, obscure". Eh bien, le jeune Otto Braun, comme en témoignent les pages passionnées de ce volume, visait à réaliser en lui l'hégémonikon, le centre intérieur capable de donner une direction hyperbolique à notre parcours existentiel, à travers l'élan déterminé par l'acquisition de la qualité d'andreia, de "force d'âme". [...] Seuls des hommes puissants et vertueux auraient pu relever la fortune de l'Allemagne (pour le jeune homme, l'Allemagne, en raison de son intime relation de fraternité avec la Grèce antique, était synonyme d'Europe), la crise dans laquelle tombait la Kultur était trop grande : "a-t-on jamais vu chez les hommes une telle prostitution de tout sentiment, une désertion aussi maligne de tout ce qui est fort et sévère, une destruction aussi méthodique de toute idée de noblesse ?".
Il était certain que l'incipit vita nova porterait les stigmates de la civilisation hellénique, car : "l'homme futur portera inconsciemment en lui un esprit qui sera en partie conséquent à l'esprit grec". Il ne prône pas un retour au passé, rien à voir avec des perspectives régressives. Dans la nouvelle civilisation, les réalisations de la modernité et celles des Anciens palpitent ensemble. Le Nouveau Départ verrait la formation d'un monde ancien-moderne.
Ainsi, la prophétie de Gémiste Pléthon se serait réalisée : "Une religion s'élèvera, à laquelle tous les hommes se soumettront ; seulement elle ne sera ni chrétienne ni païenne, mais très semblable au paganisme". En Grèce, il a apprécié la superbe synthèse du dionysiaque et de l'apollinien dans toutes ses créations. Chez ce peuple, la forme conquise dans les arts, la poésie et la philosophie faisait pourtant allusion à l'origine chaotique du monde. La religion grecque, en outre, était "civile", politique, dans la mesure où elle avait son ubi consistam in : "un consentement du peuple". Cela a conduit ces hommes à ne pas se livrer à la contemplation de sur-mondes, ni à dissoudre leur individualité dans le Tout, à la recherche d'un nirvana annulateur. Au contraire, ils n'ont jamais fait de distinction entre nature et super-nature, corps et esprit. Otto a été confirmé dans cette conviction par sa lecture passionnée de Sappho et d'Alceus. Il s'est également attardé sur Protagoras et, réfléchissant à sa pensée, a compris la nécessité de laisser les Grecs parler enfin de leur propre voix, alors que nous, les modernes, "traduisons tout dans une terminologie chrétienne".
[...] D'où la déclaration explicite de lui-même comme "polythéiste", "païen", "fidèle à la vie". Cette profession de foi se manifeste le plus souvent par l'exaltation de la nature et de sa beauté. [...] L'intérêt d'Evola pour Braun, nous l'avons mentionné déjà dans ses lignes. A l'époque où le philosophe romain se proposait, après l'expérience Dada, de tracer les coordonnées théoriques sur lesquelles construire l'idéalisme magique, il regardait avec admiration Braun, dont il avait lu l'œuvre dans l'édition allemande de 1921. Le penseur traditionaliste place Braun aux côtés d'autres "esprits de la veille", tels que Weininger, Michelstaedter, Gentile, Hamelin et Keyserling [...] .
Dans Braun, selon Evola, "ce qui est mis en évidence [...], c'est essentiellement l'aspect de la puissance efficace, de la transformation de la valeur en force absolue opérant au sein même de l'antithèse de la réalité brute". Chez lui, il ne s'agirait pas de philosophie au sens scolastique, de l'élaboration d'un système, car ce qui intéresse vraiment le jeune Allemand, c'est : "le spectacle grandiose de l'autocréation d'une volonté titanesque, d'une foi inébranlable, d'un pouvoir démiurgique pour que la valeur devienne vie, réalité absolue". Le dieu auquel Braun fait référence veut devenir un "corps", l'homme. Par conséquent, à la lumière de "l'évangile de la volonté", noyau vital de la vision du monde d'Otto Braun, il est nécessaire de transformer ce que la vie nous offre, en le conformant à notre but. C'est en cela que réside la liberté de la volonté.
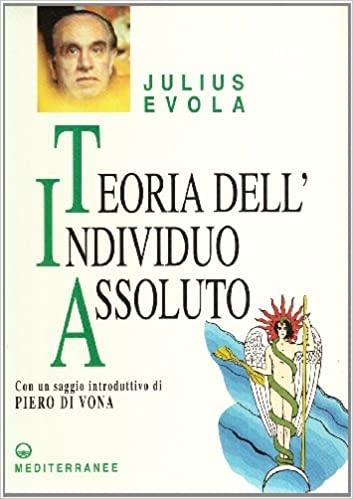
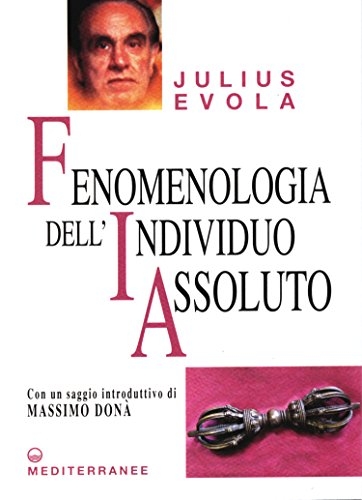
Evola ne peut manquer d'apprécier, chez le jeune homme, la "fidélité à la vie", le débarcadère grec impliquant la récupération de la physis et l'attribution à l'art d'un rôle essentiel sur le chemin de l'épanouissement. Il reconnaît également le trait carlylien de l'héroïsme politique de Braun, de son appréciation de l'homme d'État : "au religieux, au poète et au sage, il opposait le héros, et pour lui, de nos jours, héros signifiait homme d'État". Il était conscient que la véritable "domination" sur soi et sur la réalité ne devenait un fait réel que pour ceux qui avaient résolu la corporéité en liberté, comme cela se produit le long des chemins initiatiques, mais ce n'était qu'une intuition le long de ce chemin. La limite de la proposition de Braun se trouve, pour Evola, dans le fait qu'il a vécu la volonté de l'homme comme subordonnée : "à une obéissance supérieure, il a humilié le Moi en le soumettant à une tâche, à une mission qui semblait procéder presque d'un démon, d'une puissance supérieure". Le fait de " se mettre au service d'un dieu " aurait détourné Braun de la réalisation de l'immanence pure : le daimon, dans cette perspective, représentant une réalité transcendante. Michelstaedter s'était reconnu dans la centralité originelle de l'ego, la Persuasion, Braun, selon Evola, ancrait cette centralité au devoir. Il est donc inévitable, pour mettre véritablement en œuvre une vie de liberté et de puissance, qui sera pour Evola celle de l'individu absolu, d'intégrer les perspectives des deux jeunes "divins" en une seule.
En effet, il nous semble que, malgré une certaine ambiguïté théorique, liée au traitement du devoir à poursuivre résolument, qui pourrait lier l'ego, ne le rendant pas absolu, libre, Braun reste, en ce qui concerne le daimon, dans la perspective hellénique de la transcendance immanente, également typique de la vision évolienne. Selon la leçon de Gian Franco Lami, vivre "au service d'un dieu", n'implique pas l'abandon mystique au Principe, mais est un moment essentiel du parcours vertueux, anagogique, du philosophe qui, reconnaissant ses limites, n'a pas la prétention : "d'atteindre et de posséder définitivement la "vraie sagesse"". Dans l'acceptation du résultat aporétique du philosopher, dans la reconnaissance du "savoir socratique du non-savoir", l'homme prend conscience que le processus d'ordonnancement, en lui-même et dans la communauté, est toujours in fieri, comme la vie.


En outre, Lami lui-même a précisé comment le daimon pythagoricien-socratique "est qualifié au niveau terrestre, comme une fonction naturellement humaine, qui s'exprime dans l'accompagnement de l'individu, en tant qu'agent pensant, le long de son parcours existentiel spécifique". Dans ces mots nous pouvons voir le sens du destin personnel de Braun, fidèle au daimon, à la voie réalisable de la transcendance immanente toujours in fieri, pleinement en ligne avec l'idéalisme magique évolien. Le philosophe romain sait que le Moi, comme l'a précisé Massimo Donà "dans la mesure où il est inconditionné, ne peut être identifié à aucune forme", il doit nier toute norme irréfutable, se soustraire à tout impératif, même lorsqu'il est lié par "la liberté inconditionnelle elle-même". L'individu absolu, incapable de trouver la paix dans un positum, bien que non limité, ne manque pas le non-moi, n'exclut pas la limite. Cette situation l'incite à refaire, à refonder, à la lumière de l'infondabilité du principe, la liberté, lui-même et le monde. Raison de plus pour y retourner et lire, Je m'accrocherai, quoi qu'il arrive.
(extrait de la préface de Giovanni Sessa, Destinée et Postérité. Le Printemps Sacré d'Otto Braun, au livre d'Otto Braun, Io terrò duro, qualunque cosa accada. Journal et lettres d'un jeune volontaire de guerre, en librairie aux éditions OAKS à partir du 19 janvier - pp. 255, euro 20.00).
14:54 Publié dans Hommages, Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : otto braun, première guerre mondiale, hommage, giovanni sessa, philosophie, révolution conservatrice, allemagne, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, littérature soldatique, esprit soldatique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 25 janvier 2022
L'anarchisme spirituel chez l'Anarque de Jünger

L'anarchisme spirituel chez l'Anarque de Jünger
par Urside
Source: https://www.liberecomunita.org/index.php/spiritualita/84-l-anarchismo-spirituale-nell-anarca
L'Anarque est cet individu souverain issu d'une mentalité hors du commun qui puise dans le puits sans limite de l'histoire, de la philosophie et de l'art.
Il est au-delà de la gauche ou de la droite, se déplaçant sans cesse de manière nomade avec une liberté de mouvement par la pensée, synthétisant des idées contradictoires. Mais toujours fermement ancré dans le nihilisme. Voilà le véritable anarchiste. C'est l'anarchie qui a produit (et produit encore) une vaste sous-culture hermétique et littéraire souterraine.
Depuis les romans noirs de Baudelaire, Gide, Mallarmé, le Blanc (et d'autres), en passant par l'avant-garde du futurisme jusqu'à Breton et Tzara, du surréalisme (et ses alentours), jusqu'à la nouvelle avant-garde de Barthes, Bataille et des "post-modernistes", dans les nouveaux romans noirs d'Abellio, Parvulesco, Onfray et Bey... La liste est continue, nomade et délirante. C'est l'anarchie du Mouvement Anarchiste, partie du Réseau Synarchique, qui s'est développé à partir d'un engagement politique au sein des cercles hermétiques et littéraires en France.
L'Anarque doit, dans son essence, être un nihiliste. Il ne s'agit pas d'une position négative. C'est un point de départ libre et nomade pour l'exploration. Si l'anarque est dogmatique, les points de départ sont limités et il n'y a pas d'anarchie. L'anarchisme et le nihilisme vont de pair. Le nihilisme a un bel héritage, des modes classiques et russes à la pensée actuelle de Michel Onfray (enracinée dans l'individualisme aristocratique de Georges Palante). Un parallèle transatlantique avec l'aristocratie radicale de Hakim Bey et son TAZ. Aujourd'hui, le nihilisme anarchiste est une force croissante.
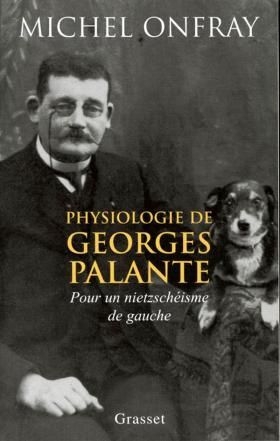

Le livre que Michel Onfray a consacré à Georges Palante; Hakim Bey.
L'Anarque, étant un nihiliste, est libre d'explorer et de synthétiser. Un monde ouvert à cette mentalité est la Décadence. Une autre manifestation évolutive depuis le début du siècle, avec sa fusion de l'art, de la philosophie et de l'occulte, dans le monde de Bohème. De nombreux écrivains ont porté le titre de décadents : Baudelaire, Gide, Peladan, Mallarmé, Breton, Barthes, Bataille, Bonnefoy, Palante, Onfray et bien d'autres encore... La décadence est la capacité de rechercher la poétique et l'esthétique dans chaque situation et de traverser la vie avec un détachement actif.
Le réseau Synarchique appartient aux cercles hermétiques et littéraires, centrés en France, dont il est issu. L'hermétisme utilise les clés de la philosophie occulte (et aujourd'hui du surréalisme) non seulement pour ouvrir le flux intérieur de l'anarchiste, mais aussi dans la politique pragmatique et hermétique, l'interaction entre l'occulte et le surréel en action. Cette interaction est née (à l'époque moderne) dans les années 1890 au sein de l'underground anarchiste, et continue aujourd'hui. Nous sommes sa manifestation actuelle. C'est la véritable anarchie - la révolution gothique. Comme l'ont exploré des gens comme Marinetti, Tzara, Breton, Lautréamont et leurs compagnons de route. Nous travaillons avec eux vers une société hermétique et anarchique.
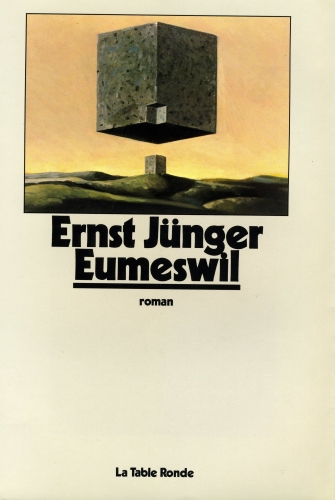
L'anarque - terme composé du grec an (ἀν) " sans " et -árchìs, de árchein (ἄρχειν), " gouverner, commander " - est une figure qui apparaît dans le roman Eumeswil d'Ernst Jünger, publié en 1977. L'anarchiste reprend des traits caractéristiques de L'Unique de Max Stirner : souveraineté absolue de l'individu, mais dans le refus du pouvoir ; absence de soumission aux lois de la société, mais recherche d'une loi naturelle ou cosmique ; désir d'une forme de maîtrise héroïque de soi ; recherche de la liberté comme but ultime de toute action ; absence d'esprit d'appartenance à un drapeau ou à une idéologie.
Bien qu'il considère l'anarchie comme l'élément premier de l'existence, dans la mesure où, dans le roman de Jünger, l'anarchie devient le véritable motif de l'histoire du monde, l'auteur allemand distingue l'anarque de l'anarchiste (bien qu'il définisse également le premier comme un "anarchiste radical"). L'anarchiste, en effet, vivant dans l'obsession d'une opposition constante au pouvoir, en reste prisonnier, et est donc voué à une existence qui n'est pas vraiment libre. L'anarque, au contraire, à travers une forme d'indifférence, non loin de l'ataraxie stoïcienne, se distancie de la société et du temps historique, pour s'ouvrir à une dimension libre de l'existence au sein d'un cycle cosmique qui le domine. En ce sens, la figure de l'anarque reprend, au sein de la tradition anarcho-individualiste, les modèles classiques, également développés par la tradition romantique et Nietzsche, dans lesquels l'individu est configuré comme un point d'équilibre entre la dimension libre de la volonté et la nécessité de la nature ou du destin.

L'anarque peut être lu comme une continuation ou une évolution de la figure du Waldgänger, que Jünger avait décrite dans les années 50.
L'anarque est celui qui parvient à briser les liens de ces positions morales et politiques dogmatiques et inamovibles ; il est cet individu qui a réussi à gagner la souveraineté sur lui-même en s'émancipant de la pensée de masse - à laquelle il échappe en se jetant dans l'infini de l'histoire, de la philosophie et/ou de l'art.
Il évolue en dehors du cadre de tout jeu politique actuel. Pour lui, des concepts tels que la gauche ou la droite, le progressisme ou le conservatisme, n'ont aucune signification au-delà de leur valeur manipulatrice. Sa pensée ignore toutes ces limites et classifications qui font de l'homme un menteur et un mesquin : pour lui, la vérité se construit à partir de tout et de rien.
L'Anarque n'a pas d'idéal bien défini, il ne peut être catalogué. C'est un nomade des idées et de la pensée en éternel conflit qui se déplace entre différents points, souvent apparemment contradictoires, mais qui en même temps cherche la vérité et voit des liens profonds que les autres ne voient nulle part, ces liens si fermes qu'ils constituent pour lui un modus vivendi.
La recherche de ces liens indissolubles est dans son combat intérieur, car l'anarque, face à la politique de masse et au consensus électro, avec sa rhétorique mensongère et trop souvent cruelle, ne peut s'empêcher de se rebeller contre l'éternel jeu que jouent les politiciens et les partis : celui de manipuler les imprudents et de faire de fausses promesses aux non-informés qui voient dans la classe politique un salut... mais qui en réalité ne sauvent personne : l'anarque est donc un nihiliste absolu. En tant qu'être émancipé.

Celui qui réussit à s'élever à un tel être est au-dessus de toute intention matérialiste de transformer la société, et aussi au-dessus de toute idéologie collective.
Être un anarque est une façon d'être : il n'est pas un réformateur, encore moins un "révolutionnaire" au sens habituel du terme. Il est absolument vrai que la figure de l'Anarque coïncide avec celle de l'anarchiste, il souhaite ardemment lutter pour l'Anarchisme, puisque la véritable Anarchie vit en lui. Elle commence par la pensée et se manifeste ensuite par l'action. Jamais l'inverse. Il ne s'agit pas d'un "positionnement" (qui est généralement toujours avant quelque chose), et encore moins d'une "pose" apparente (comme c'est généralement le cas), mais d'une manière intime et éternelle d'être.
Malgré son individualisme farouche, consciemment ou inconsciemment, l'Anarque appartient inévitablement à ce que l'on pourrait appeler le "Mouvement Anarchiste Mondial", quelque chose comme un réseau de syn-anarchies formées par d'innombrables individus influençant des cercles socialement, artistiquement ou culturellement plus ou moins importants.
L'Anarque, dans son aspect le plus fondamental, est toujours un nihiliste. Il ne s'agit pas d'une position négative. Il s'agit simplement d'un point de départ libre et nomade pour l'exploration de son environnement. Un anarchiste dogmatique se serait limité et serait donc sorti de l'anarchie. Le nihilisme a un héritage délicat, depuis les voies de la Russie classique jusqu'à la pensée actuelle de Michel Onfray.
En 1978, à l'âge de 83 ans, Ernst Jünger fait émerger la figure de l'Anarque dans la ville d'Eumeswil, une ville sans espace et sans temps et pour cette raison même le lieu idéal de l'Anarque. Eumeswil est l'un des fruits tardifs de l'État mondial après la dissolution des États-nations qui ont disparu dans le cataclysme des "grandes conflagrations", c'est-à-dire du mondialisme et du globalisme qui détruisent la diversité et la spécificité. C'est peut-être aussi pour cela qu'Eumeswil est polymorphe : tantôt elle nous est présentée comme une ville, tantôt comme un village dominé par le palais du Condor. Même la localisation spatiale échappe à toute détermination précise : Eumeswil est bordée par la mer - tantôt la Méditerranée, tantôt l'océan Atlantique -, par le désert du Khan jaune, mais aussi par des forêts vierges. Même dans le temps, Eumeswil n'a pas d'âge, notamment parce que le Luminar - un instrument réservé à quelques privilégiés - permet de se souvenir et de vivre chaque époque du passé, en la rendant présente.
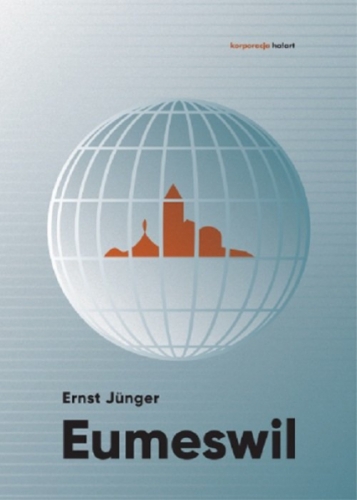
Dans cette ville-état, pendant du terrible Metropolis de Fritz Lang, le pouvoir est entre les mains du Condor, dont le coup d'État a chassé les tribuns et dont le palais s'appelle la Casbah, signe que le pouvoir, sous l'apparence de l'ordre, ne cache que le chaos. Ici vit Martin Venator, ou Manuel comme l'appelle le Condor, sensible à la sonorité des noms. C'est un jeune historien qui, la nuit, travaille comme serveur dans le bar de la Casbah, au service direct du dictateur. Martin Venator concilie les deux activités à la fois du point de vue de son intérêt historique pour la politique du Condor et de ses intimes, et surtout du fait qu'il est l'Anarque, donc ni contre ni pour le pouvoir, mais intimement étranger à celui-ci, indifférent donc autant à le servir qu'à le combattre.
Il y a déjà ici une différence fondamentale entre l'Anarque et l'anarchiste, bien que l'humus qui les a générés soit le même. En fait, tout le monde est anarchique et, pour cette raison, la famille, la société et l'État interviennent immédiatement pour conditionner et émonder cette force primordiale ; cependant, l'élément anarchique reste à l'arrière-plan, peut-être inconscient, mais toujours prêt à jaillir comme de la lave. Tout ce qui est agent de force est anarchique - l'amour, le guerrier, le meurtre, le Christ - alors que leurs homologues bourgeois - le mariage, le soldat, le meurtre, Saint Paul - ne le sont pas.
"L'histoire du monde est mue par l'anarchie".
14:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : anarque, anarchisme, ernst jünger, eumeswil, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 04 janvier 2022
Du Loup des steppes à Bardamu : Hesse et Céline contre le monde moderne

Du Loup des steppes à Bardamu: Hesse et Céline contre le monde moderne
Nicolas Bonnal
C’est le hasard de mon livre sur Céline qui me fit retrouver Hermann Hesse, écrivain déjà bien oublié. Mais dans le Loup des steppes il nous semble, sans nous balancer dans la littérature comparée, qu’il aborde le problème de la modernité comme Céline. On est à l’époque de la guerre, de la massification, des abrutissements modernes et des années folles. Voyez la Foule de King Vidor pour évaluer le beuglant…
On commence par les hommes-masse de notre époque (traduction de Juliette Parry) » :
« Il ne s’agit pas ici de l’homme tel que le connaissent l’école, l’économie nationale, la statistique, de l’homme tel qu’il court les rues à des millions d’exemplaires et qu’on ne saurait considérer autrement que le sable du rivage ou l’écume des flots : quelques millions de plus ou de moins, qu’importe, ce sont des matériaux, pas autre chose. »
Hesse décrit aussi la vie ennuyée de cet homme-masse façonné par l’industrie et cet écœurement qui en sourd :
« …celui qui a vécu des jours infernaux, de mort dans l’âme, de désespoir et de vide intérieur, où, sur la terre ravagée et sucée par les compagnies financières, la soi-disant civilisation, avec son scintillement vulgaire et truqué, nous ricane à chaque pas au visage comme un vomitif, concentré et parvenu au sommet de l’abomination dans notre propre moi pourri, celui-là est fort satisfait des jours normaux, des jours couci-couça comme cet aujourd’hui ; avec gratitude, il se chauffe au coin du feu ; avec gratitude, il constate en lisant le journal qu’aujourd’hui encore aucune guerre n’a éclaté, aucune nouvelle dictature n’a été proclamée, aucune saleté particulièrement abjecte découverte dans la politique ou les affaires…»

Comme Céline ou Ortega Y Gasset (et des dizaines d’autres), Hermann Hesse dénonce cette émergence cette civilisation de la masse satisfaite :
« Je ne comprends pas quelle est cette jouissance que les hommes cherchent dans les hôtels et les trains bondés, dans les cafés regorgeant de monde, aux sons d’une musique forcenée, dans les bars, les boîtes de nuit, les villes de luxe, les expositions universelles, les conférences destinées aux pauvres d’esprit avides de s’instruire, les corsos, les stades… »
Une brève allusion à notre américanisation – qui frappe aussi Chesterton ou Bernard Shaw à cette époque :
« En effet, si la foule a raison, si cette musique des cafés, ces plaisirs collectifs, ces hommes américanisés, contents de si peu, ont raison, c’est bien moi qui ai tort, qui suis fou, qui reste un loup des steppes, un animal égaré dans un monde étranger et incompréhensible, qui ne retrouve plus son cli mat, sa nourriture, sa patrie. »
Le personnage couche avec des danseuses lesbiennes découvre le fox-trot et la musique nègre. Mais voici ce que dit la danseuse:
« Crois-tu que je ne puisse comprendre ta peur du fox-trot, ton horreur des bars et des dancings, ta résistance au jazz-band et à toutes ces insanités ? Je ne les comprends que trop, et aussi ton dégoût de la politique, ton horreur des bavardages et des agissements irresponsables des partis et de la presse, ton désespoir en face de la guerre, celle qui fut et celle qui viendra, en face de la façon dont on pense aujourd’hui, dont on lit, dont on construit, dont on fait de la musique, dont on célèbre les cérémonies, dont on fabrique l’instruction publique ! Tu as raison, Loup des steppes, tu as mille fois raison, et pourtant tu dois périr. Tu es bien trop exigeant et affamé pour ce monde moderne, simple, commode, content de si peu ; il te vomit, tu as pour lui une dimension de trop. »

Après on donne une définition de loup des steppes (titre d’un groupe de pop au temps jadis) :
« Celui qui veut vivre en notre temps et qui veut jouir de sa vie ne doit pas être une créature comme toi ou moi. Pour celui qui veut de la musique au lieu de bruit, de la joie au lieu de plaisir, de l’âme au lieu d’argent, du travail au lieu de fabrication, de la passion au lieu d’amusettes, ce joli petit monde-là n’est pas une patrie… »
Et si Céline a dit que la vérité de ce monde c’est la mort :
« Il en fut toujours ainsi, il en sera toujours ainsi ; la puissance et l’argent, le temps et le monde appartiennent aux petits, aux mesquins, et les autres, les êtres humains véritables, n’ont rien. Rien que la mort… »
Et si Céline a dit que la postérité c’est pour les asticots :
« La gloire, ça n’existe que pour l’enseignement, c’est un truc des maîtres d’école. »
Antisémitisme ; Hesse le voit pointer comme la prochaine guerre dès le début des années vingt, au moment où Céline vit le Voyage :
« Il n’a pas vécu la guerre, ni le bouleversement des bases de la pensée par Einstein (cela, pense-t-il, est du domaine des mathématiciens) ; il ne voit pas comment se prépare autour de lui la prochaine guerre ; il tient pour haïssables les Juifs et les communistes ; il est un brave gosse insouciant et gai qui se prend au sérieux, il est digne d’être envié. »
L’Allemagne est déjà prête pour la prochaine guerre comme le voit Bainville à la même époque. On a aussi fait ce qu’il fallait au traité de Versailles (lisez Guido Preparata à ce sujet) :
« C’est cela qu’ils ne me pardonnent pas, car, bien entendu, ils sont tous innocents : le Kaiser, les généraux, les grands industriels, les politiciens, les journaux, nul n’a rien à se reprocher, ce n’est la faute de personne. On croirait que tout va on ne peut mieux dans le monde ; seulement, voilà, il y a une douzaine de millions d’hommes assassinés. »

Hesse aussi hait ces journaux qui rendront fou Céline :
« Deux tiers de mes compatriotes lisent cette espèce de journaux, entendent ces chansons matin et soir ; de jour en jour, on les travaille, on les serine, on les traque, on les rend furieux et mécontents ; et le but et la fin de tout est encore la guerre, une guerre prochaine, probablement encore plus hideuse que celle-ci. »
Hesse décrit dégoûté une absorption des journaux :
« C’est bizarre, tout ce qu’un homme est capable d’avaler ! Pendant près de dix minutes, je lus un journal et laissai pénétrer en moi, par le sens de la vue, l’esprit d’un homme irresponsable, qui remâche dans sa bouche les mots des autres et les rend salivés, mais non digérés. C’est cela que j’absorbai pendant un laps de temps assez considérable. »
Et si Céline parle de la musique judéo-saxo-nègre, Hesse aussi :
« Lorsque je passai devant un dancing, un jazz violent jaillit à ma rencontre, brûlant et brut comme le fumet de la viande crue. Je m’arrêtai un moment : cette sorte de musique, bien que je l’eusse en horreur, exerçait sur moi une fascination secrète. Le jazz m’horripilait, mais je le préférais cent fois à toute la musique académique moderne ; avec sa sauvagerie rude et joyeuse, il m’empoignait, moi aussi, au plus profond de mes instincts, il respirait une sensualité candide et franche ».
Céline et les nègres ? Hermann Hesse et les nègres, et la bonne musique nègre :
« Et cette musique-là avait l’avantage d’une grande sincérité, d’une bonne humeur enfantine, d’un négroïsme non frelaté, digne d’appréciation. Elle avait quelque chose du Nègre et quelque chose de l’Américain qui nous paraît, à nous autres Européens, si frais dans sa force adolescente. L’Europe deviendrait-elle semblable ? Était-elle déjà sur cette voie ? »

Toute la vieille culture est remise en cause comme chez Elie Faure à la même époque :
« Nous autres vieux érudits et admirateurs de l’Europe ancienne, de la véritable musique, de la vraie poésie d’autrefois, n’étions-nous après tout qu’une minorité stupide de neurasthéniques compliqués, qui, demain, seraient oubliés et raillés ? Ce que nous appelions « culture », esprit, âme, ce que nous qualifiions de beau et de sacré n’était-ce qu’un spectre mort depuis longtemps, et à la réalité duquel croyaient seulement quelques fous ? Ce que nous poursuivions, nous autres déments, n’avait peut-être jamais vécu, n’avait toujours été qu’un fantôme ? »
Comme dit Debord l’ancienne culture elle est congelée.
Néanmoins Hesse ne fait pas preuve d’hypocrisie, et il nous donne sa deuxième définition du loup des steppes c’est un bohême collaborateur de cette bourgeoisie.
« En effet, la puissance de vie du bourgeoisisme ne se base aucunement sur les facultés de ses membres normaux, mais sur celles des outsiders extrêmement nombreux, qu’il est capable de contenir par suite de l’indétermination et de l’extensibilité de ses idéals. Il demeure toujours dans le monde bourgeois une foule de natures puissantes et farouches. Notre Loup des steppes Harry en est un exemple caractéristique. Lui, qui a évolué vers l’individualisme bien au-delà des limites accessibles au bourgeois, lui qui connaît la félicité de la méditation, ainsi que les joies moroses de la haine et de l’horreur de soi, lui qui méprise la loi, la vertu et le sens commun, est pourtant un détenu du bourgeoisisme et ne saurait s’en évader. »
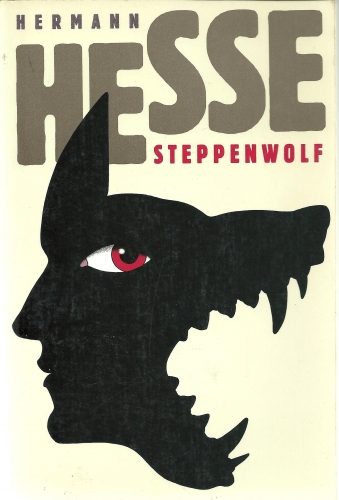
On se vent âme et corps au monde moderne et à sa technique de divertissement. Si notre Céline a dit que les Américains font l’amour comme les oiseaux, Hermann Hesse montre que son époque est libérée et son Allemagne de Weimar aussi :
« La plupart étaient extraordinairement douées pour l’amour et assoiffées de ses joies ; la plupart le pratiquaient avec les deux sexes ; elles ne vivaient que pour l’amour, et à côté des amis officiels et payants elles cultivaient d’autres liaisons amoureuses. Actives et affairées, soucieuses et frivoles, sensées et pourtant étourdies, ces libellules vivaient leur vie aussi enfantine que raffinée, indépendantes, ne se vendant que selon leur bon plaisir, attendant tout d’un coup de dés et de leur bonne étoile, amoureuses de la vie et cependant bien moins attachées à elle que ne le sont les bourgeois, toujours prêtes à suivre un prince charmant dans son château de conte de fées, toujours demi-conscientes d’une fin triste et fatale. »
La fille lui reproche de ne pas savoir danser, d’avoir appris le grec et le latin. Vian dira qu’il vaut mieux apprendre à faire l’amour que s’abrutir sur un livre d’histoire. Mais Céline tape tout le temps sur notre éducation et veut nous rapprendre le rigodon.
Le cinéma cette petite mort (Céline) ; voici comment Hesse décrit le procès.
« En flânant je passai devant un cinéma, je vis des enseignes lumineuses et de gigantesques affiches coloriées ; je m’éloignai, je revins sur mes pas et finalement j’entrai. Je pourrais demeurer là bien tranquillement jusqu’à onze heures environ. Conduit par l’ouvreuse avec sa lanterne, je trébuchai dans la salle obscure, je me laissai tomber sur un siège et me trouvai tout à coup en plein dans l’Ancien Testament. Le film était un de ceux qu’on tourne à grands frais et avec force trucs soi-disant non pas pour gagner de l’argent, mais dans des buts sublimes et sacrés ; les maîtres de catéchisme y conduisent en matinée leurs élèves. »
Après il tape encore plus fort sur ce cinéma :
« Ensuite, je vis le Moïse monter sur le Sinaï, sombre héros sur une sombre cime, et Jéhovah lui communiquer les dix commandements, avec le concours de l’orage, de la tempête et des signaux lumineux, cependant que son peuple indigne, entre-temps, dressait au pied du mont, le veau d’or et s’abandonnait à des distractions plutôt bruyantes. Il me paraissait bizarre et incroyable de contempler ainsi les histoires saintes, leurs héros et leurs miracles, qui avaient fait planer sur notre enfance les premières divinations vagues d’un monde surhumain ; il me semblait étrange de les voir jouer ainsi devant un public reconnaissant, qui croquait en silence ses cacahuètes : charmante petite saynète de la vente en gros de notre époque, de nos gigantesques soldes de civilisation… »
Et il dit ce qu’il en pense de cette société de consommation et de divertissement :
« Seigneur mon Dieu ! pour éviter cette saleté, c’étaient non seulement les Égyptiens, mais les Juifs et tous les autres hommes qui eussent dû périr alors d’une mort violente et convenable, au lieu de cette petite mort sinistrement mesquine et bourgeoise dont nous mourons aujourd’hui. »
La petite mort du monde bourgeois est ici là dans le poste de T.S.F.
« Mais c’était, je le vis bientôt, un appareil de T.S.F. qu’il avait dressé et mis en marche ; installant le haut-parleur, il annonça : « Vous entendrez Munich, le Concerto grosso en F-Dur de Haendel. »
En effet, à ma surprise et à mon épouvante indicible, l’appareil diabolique se mit à vomir ce mélange de viscose glutineuse et de caoutchouc mâché que les possesseurs de phonographes et les abonnés de la T.S.F. sont convenus d’appeler musique… »
Sources :
Le loup des steppes
Céline, le pacifiste enragé
16:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, céline, hermann hesse, lettres, lettres allemandes, lettres françaises, littérature, littérature française, monde moderne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 31 décembre 2021
Hermann Hesse, biographe de l'âme allemande et loup des steppes

Hermann Hesse, biographe de l'âme allemande et loup des steppes
par Alexander Markovics
Il y a un peu plus de 59 ans, le poète allemand Hermann Hesse mourait à l'âge de 85 ans, le 9 août 1962 à Berne. Né en 1877 à Calw sur la Nagold, dans le Wurtemberg, dans une famille de missionnaires piétistes qui avait auparavant travaillé en Inde, Hesse a été exposé à de nombreuses influences : d'une part, l'influence de l'Asie à travers les expériences de sa famille et le mysticisme chrétien. Son père était un Allemand de la Baltique, son grand-père, le Dr Carl Hermann Hesse, était médecin et conseiller d'État russe, qu'il qualifiera plus tard de jeune, fougueux, drôle et pieux jusqu'à un âge avancé.

Dans la maison de ses parents à Calw, des influences du monde entier se rencontrent, on ne discute pas seulement des événements en Allemagne et en Europe, mais on s'exerce aussi à la philosophie de Lao Tseu et de Bouddha. Plus tard, Hesse consacrera son livre "Siddharta" à la pensée bouddhiste. Le jeune Hesse passe également quelques années de sa jeunesse à Bâle, en Suisse. Par conséquent, le Souabe d'origine concentre son œuvre sur le "chemin vers l'intérieur", ce qui se traduit par de nombreux aspects autobiographiques dans ses écrits - Hesse traite par exemple de son aversion pour les établissements d'enseignement publics et les fréquents changements d'école dans son livre Unterm Rad.

Au cours de sa longue vie, Hesse a été le témoin de nombreux bouleversements dans l'histoire allemande : élevé dans la splendeur de l'empire wilhelmien en pleine industrialisation, Hesse veut se porter volontaire en tant que représentant des "idées de 1914" à l'ambassade d'Allemagne lorsque la guerre éclate, mais il est rejeté comme inapte à ce poste. Au lieu de cela, on confie à Hesse, à Berne, la mise en place d'une centrale de livres pour les prisonniers de guerre allemands. D'abord partisan de la guerre, le poète se transforme de plus en plus en opposant à la guerre, appelant à la modération dans la guerre civile européenne. Lorsqu'il publie dans la Neue Zürcher Zeitung l'article "O Freunde, nicht diese Töne", dans lequel il critique vivement la haine fratricide des Européens et l'action d'autres poètes qui font leur "service à la plume", une vague de haine lui vient d'Allemagne.
Lorsque sa première femme Maria Bernoulli est internée dans un hôpital psychiatrique et que son fils de trois ans est victime d'une méningite, l'homme intérieur qu'est Hesse est sur le point de s'effondrer. Ces moments difficiles de sa vie ne l'empêchent pas de créer, mais stimulent au contraire sa créativité. Hesse lui-même entretient une relation d'amour-haine avec le matérialisme bourgeois et l'étiquette formelle, il critique la technique moderne ainsi que la société bourgeoise, pour mieux aspirer au calme et à la stabilité. Le poète lui-même se transforme en pacifiste sous l'influence de la guerre, il tourne son regard vers l'intérieur pour devenir le biographe de l'âme de lui-même, mais aussi le spectateur de l'âme de ses contemporains, qui vivent non seulement comme lui l'effondrement d'un ancien monde, mais aussi le chaos qui accompagne les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle ère.
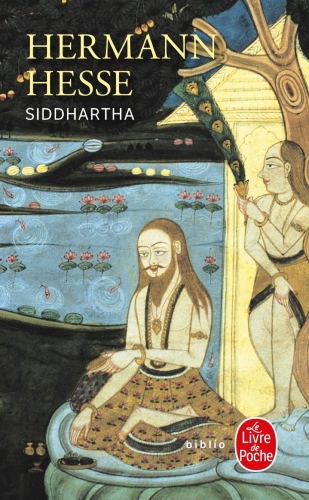
La raison de son succès réside dans le fait que Hermann Hesse ne pratique pas la poésie comme une invention arbitraire, mais dans le sens d'une tentative d'expression, "(...) qui présente des processus profondément vécus dans le vêtement d'événements visibles", selon le poète lui-même. Cependant, le chrétien croyant Hesse ne s'en tient pas servilement à une représentation réaliste de la vie, mais intègre également des éléments fantastiques dans la représentation d'expériences enivrantes et transcendantes, un procédé qui lui valut de nombreuses critiques lors de la parution du "Loup des steppes" en 1927.
Dans cette œuvre, nous rencontrons la philosophie de l'âme profondément allemande de Hesse, qui ne s'inscrit pas seulement dans une tradition indo-européenne, mais se rattache également à la mystique allemande de Jean Tauler et de Maître Eckhart. Ici, deux "moi" sont en conflit : Le moi historique, enraciné dans le monde, suivant ses besoins trop humains et impatient, avec le moi sacré, l'âme immortelle, qui correspond à l'atman de l'hindouisme, patient et exigeant de l'homme son évolution permanente.
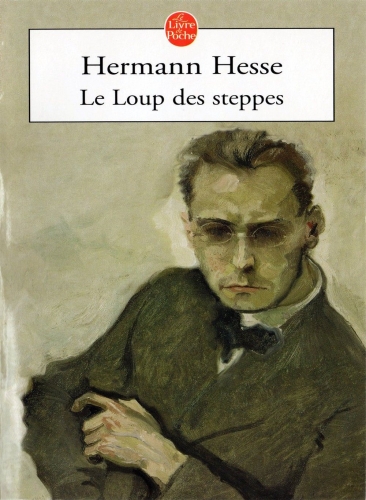
Ce récit met en scène un homme de 50 ans, Harry Haller, un marginal et un excentrique qui rejette la société bourgeoise tout en mettant en garde contre une nouvelle guerre mondiale. L'érudit Haller ne s'oriente que dans ses livres, mais pas dans le monde, car il semble avoir deux natures dans sa poitrine : l'homme bourgeois qui aspire à la sécurité et à la sûreté d'une part, et d'autre part un loup des steppes, un animal noble qui préfère la solitude à la société et la liberté dans la misère matérielle au confort. Mais alors que le loup des steppes est domestiqué et limité par le moi bourgeois de Haller, c'est sa nature sauvage qui est à son tour asservie par ses besoins bourgeois. D'un côté, il est repoussé par la technicisation croissante du monde, l'évaluation de toutes choses en fonction de leur valeur financière et le nihilisme abyssal de la société libertaire, de l'autre, l'homme solitaire en lui a justement soif de quelqu'un qui le comprenne et de compagnie.
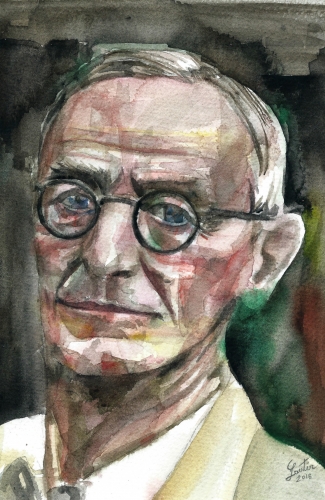
Alors qu'il est sur le point de se suicider et que seul l'alcool peut l'en dissuader, Harry Haller tombe sur un mystérieux théâtre magique et sur Hermine, une femme qui lui est proche et qui fréquente le demi-monde, et qui lui rappelle son ami d'enfance Hermann. Grâce à ces rencontres, Haller apprend qu'il n'y a pas que deux aspects de sa personnalité, mais qu'il y en a beaucoup et que, s'il veut atteindre l'immortalité comme Mozart et Goethe, les génies qu'il admire, il doit vivre ces aspects et les réconcilier. En chemin, il doit vivre lui-même la maladie du temps, descendre en enfer, faire des rencontres fantastiques et finalement se retrouver face à lui-même.
Hermann Hesse parvient à décrire tous ces thèmes avec un humour parfois espiègle, qui couvre de moqueries et de railleries l'individualisme bourgeois de la République de Weimar incarné par la personne de Haller, uniquement pour apprendre au héros comment surmonter le nihilisme de son époque. Si l'œuvre de Hesse a été récupérée par la scène hippie dans les années 60 et 70, elle est toujours d'actualité 60 ans après sa mort et reste également d'une grande actualité philosophique. La technicisation et la numérisation éloignent également l'homme du 21e siècle de son âme et lui présentent un monde bourgeois illusoire qui ne nous mène ni à l'éternité ni à Dieu, mais nous fait chercher un sens dans le nihilisme de la consommation permanente et de l'accumulation de possessions. Or, ce n'est qu'au plus profond de notre âme que nous pouvons chercher Dieu et devenir clairs sur ce que nous sommes. En même temps, ce n'est qu'en redécouvrant nos racines et nos traditions que nous pourrons retrouver la sécurité et le soutien de la communauté nationale.
Ce sont des thèmes que l'on retrouve non seulement dans le Loup des steppes, mais aussi dans le reste de l'œuvre de Hermann Hesse. Son mérite est justement d'avoir attiré l'attention sur l'intériorité et la philosophie de l'âme des Allemands en tant qu'alternative au monde technicisé et globalisé, à travers la confrontation avec l'Asie.
13:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hermann hesse, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 26 novembre 2021
Le Mur du Temps d'Ernst Jünger ou l'accès au "fond originel"

Le Mur du Temps d'Ernst Jünger ou l'accès au "fond originel"
Marco Maculotti
Un essai sur le volume de 1959 de l'intellectuel allemand publié par l'association Eumeswil : ici aussi une comparaison avec Mircea Eliade, Julius Evola et René Guénon
SOURCE : https://www.barbadillo.it/101843-al-muro-del-tempo-di-ernst-junger-e-laccesso-al-fondo-originario/
Cette contribution vise à analyser certains des concepts les plus prégnants de l'œuvre d'Ernst Jünger, An der Zeitmauer ("Au mur du temps"), publiée à l'origine en 1959, peut-être l'œuvre la plus énigmatique et en même temps la plus prophétique du penseur allemand. Nous avons déjà analysé d'autres perspectives du texte en question, de l'astrologique (1) à la méta-histoire (2), jusqu'à mettre en évidence les prophéties faites par l'auteur (3), il y a plus de soixante ans, sur l'Âge des Titans dans lequel nous nous trouvons.
Nous allons analyser ici quelques questions plus métaphysiques, en utilisant, comme dans les articles déjà publiés, la comparaison, lorsque cela est nécessaire et éclairant, avec certains auteurs contemporains de Jünger lui-même et à certains égards comparables à lui - à savoir Mircea Eliade, Julius Evola et René Guénon - et même d'autres avec lesquels la comparaison est encore plus surprenante, en vertu du contexte culturel et existentiel très différent.
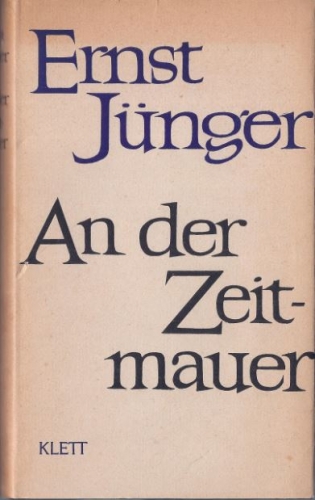
Nous commencerons notre discussion par le concept de "rupture de niveau", étroitement lié à celui de "sortie de l'histoire", que nous avons déjà mentionné dans des études précédentes, pour ensuite examiner deux des expressions les plus énigmatiques et en même temps les plus significatives de l'œuvre de Jünger, à savoir celles de "fond originel" et d'"esprit de la terre".
1. La "rupture de niveau
Parlant de l'expérience de la " sortie du temps abstrait ", Jünger [§185] décrit la "rupture de niveau", qui seule permettrait à l'homme d'accéder à la dimension transcendante: "Au moment où l'esprit est capable de faire des pas vers les hauteurs ou les profondeurs, en se libérant de la sphère des phénomènes, ce monde de nos formes se dissout: la lumière devient trop forte, elle doit se retirer. Tout ce qui est personnel équivaut à une séparation, à un emprunt. Il existe un bonheur plus grand que celui qu'implique la personnalité, et c'est l'abnégation. Ici, le père et la mère sont une seule et même chose".
Commentant certains passages de cette œuvre de Jünger, L. Caddeo a écrit ces remarques sur ce type d'expérience, soulignant comment elle dérive invariablement de la rencontre avec ce qu'il définit comme le "phénomène originel": "Lorsque l'intellect rencontre le phénomène originel, il ne peut que s'arrêter. Son impulsion à la connaissance est satisfaite parce qu'elle est éclairée par "quelque chose" d'éternel qui ne peut être évalué conceptuellement mais qui, dans un sens difficilmente afferrable, est le transcendantal de toute mesure, sa possibilité. Le pathos apparemment sans fin de la connaissance est ainsi satisfait, le monde faustien s'accomplit".
Ces concepts, typiques de la vision mythopoétique de Jünger, font écho aux obsessions de l'historien des religions roumain Mircea Eliade concernant ce qu'il appelait la "sortie de l'histoire" et l'accès conséquent à la dimension atemporelle (ou pré-temporelle) (5), mais aussi aux cogitations d'autres savants du siècle passé, habituellement qualifiés de "traditionalistes", dont René Guénon et Julius Evola. Ces derniers, à partir des années 1930, ont insisté sur la nécessité d'une révolution, avant tout interne, qui pourrait donner à l'individu perdu dans les méandres de la modernité les conditions préalables à la création d'un nouveau niveau de conscience (6). Cette transcendance de la réalité phénoménale (le voile de Maya de la tradition indo-bouddhiste) pour accéder à un autre niveau, ontologiquement plus élevé, consiste, pour Evola, à dépasser le "niveau ordinaire d'éveil" suggéré par Gurdjieff, afin d'atteindre une "rupture de niveau" permettant d'accéder à la dimension transcendante. Il s'agirait, tout d'abord (7), "d'être central ou de se rendre central à soi-même, de remarquer ou de découvrir l'identité suprême avec soi-même [...] de percevoir en soi la dimension de la transcendance et de s'y ancrer, d'en faire la charnière qui reste immobile même quand la porte claque" pour arriver à "l'activation consciente en soi du principe autre et de sa force dans des expériences, d'ailleurs, non seulement subies mais aussi recherchées".
Cela reviendrait, en dernière analyse, à - comme l'a paraphrasé Pio Filippani Ronconi (8) en analysant l'œuvre d'Evola - " activer un type de liberté que les hommes possèdent déjà en puissance " ou - comme l'a afferminé Nietzsche, cité par Evola - à imprimer au devenir le caractère de l'être. Ceci, commente Evola (9), "après tout, conduit à une ouverture au-delà de l'immanence unilatéralement conçue, conduit au sentiment que "toutes choses ont été baptisées dans la source de l'éternité et au-delà du bien et du mal"". La dimension transcendante - l'Autre Monde - n'est pas une autre réalité, mais "une autre dimension de la réalité, celle où le réel, sans être nié, acquiert une significance absolue, dans l'inconcevable nudité de l'être pur" (10).
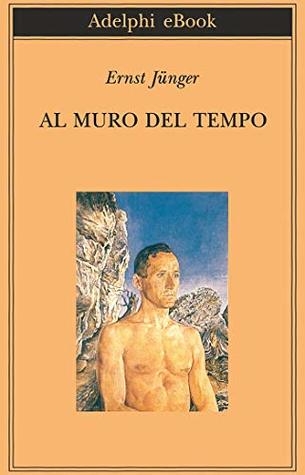
C'est en ces termes qu'Evola parle de la nécessaire "rupture du niveau", thème central de son Chevaucher le Tigre, qu'il faut chercher à tout prix, surtout en ces temps sombres (11): "Ayant pris le chemin de l'affirmation absolue et ayant fait toutes ces formes d'"ascétisme" et d'activation d'une intensité supérieure de vie [.... la seule solution de salut est donnée par un changement conscient de polarité, par la possibilité qu'à un moment donné, dans des situations ou des événements donnés, par une sorte de rupture de niveau ontologique, l'extrême intensité de la vie se transforme, presque se renverse, en une qualité différente" - cette transformation pourrait s'exprimer, selon l'auteur, comme le passage d'un état de conscience dionysiaque à un état de conscience apollinien. Une telle "rupture de niveau" peut parfois avoir "le caractère d'une violence faite à soi-même [...] pour vérifier si l'on sait rester debout même dans le vide, dans l'informe" (12).
Par cette attitude, qu'Evola appelle "anomie positive", on transformerait ainsi, selon l'ancien précepte tantrique et pythagoricien, le poison en médicament, c'est-à-dire qu'on transformerait une situation potentiellement négative en une situation effectivement positive, ou du moins neutre. Si l'expérience a un résultat positif, poursuit-il (13), la dernière limite tombe; transcendance et existence, liberté et nécessité, possibilité et réalité se rejoignent. Une centralité et une invulnérabilité absolues sont obtenues, sans restrictions, dans n'importe quelle situation".
2. Le "sol originel" et "l'esprit de la terre"
Il nous semble nécessaire à ce stade de nous attarder sur le concept, fondamental dans Le Mur du Temps, de "l'esprit de la terre". Jünger écrit [§79]: "Cette vision de l'esprit de la terre, nous devons l'imaginer comme un courant animé qui traverse le monde et l'imprègne, sans en être encore séparé. Aujourd'hui encore, il s'agit d'une force inconsciente, mais inévitable, dans tous les diagnostics et prévisions".
L'auteur semble utiliser l'expression "esprit de la terre" - et dans d'autres passages de son œuvre celle de "sol originel" - d'une manière extrêmement similaire au concept hindou de l'Akasha (14), une sorte d'éther ou de quintessence connue de la tradition hindoue: une substance éternelle et invisible qui imprègne tout, l'essence de toutes les créations du monde empirique, ainsi que l'élément de base du monde astral, à ne pas confondre avec l'élément plus spirituel et élevé, à savoir Brahman, qui coïncide avec le Logos des Grecs. On peut déceler des similitudes avec l'Akasha plutôt avec ce que les Grecs appelaient Zoé (ζωή), le principe et l'essence de la vie qui appartient en commun, indistinctement, à l'universalité de tous les êtres vivants, ou avec la conception ésotérique du culte du Grand Dieu Pan (15), comprise comme la puissance transcendante et vivifiante de tous les niveaux du cosmos, des étoiles aux pierres, en passant par les daimones, les hommes, les animaux et les plantes - et en même temps les désintégrant, pour les ramener, une fois leurs cycles terrestres respectifs terminés, à la "source originelle" d'où tout est né et à laquelle tout retourne.
De manière peut-être encore plus significative, le concept de " source originelle " de Jünger trouve un autre pendant dans le concept néo-platonicien de l'Anima Mundi, repris ensuite par la filite hermétique de la Renaissance et plus récemment par C.G. Jung et J. Hillman: la vie ne fonctionne pas par assemblage de parties individuelles jusqu'à atteindre les organismes les plus évolués, mais part aussi d'un principe unitaire et intelligent, à partir duquel prennent forme les plantes, les animaux, les hommes et toute autre réalité empiriquement existante.
Selon Helena Petrovna Blavatsky, initiatrice du courant théosophique à la fin du 19ème siècle, l'Akasha, de par sa capacité à contenir et à relier chaque événement du continuum espace-temps, représenterait une sorte de "bibliothèque universelle", qui rassemblerait potentiellement toutes les connaissances du monde et de l'histoire cosmique (les fameuses " Chroniques de l'Akasha ") [voir La Doctrine secrète].
En accédant à ce principe universel, source primordiale de l'Être, il serait possible de comprendre la nature et le cosmos dans leur ensemble et tous les éléments individuels qui sont des émanations de son souffle vital et vivifiant, et pas autrement.
À l'ère du nihilisme et de la "mort de Dieu", l'accès au "fond originel" permettrait ainsi à l'individu de différencier la rencontre réelle avec le divin: Jünger parle de cette expérience comme d'une "sortie du temps abstrait" [§13] et donc, pourrions-nous paraphraser, d'une entrée dans le temps sacré. C'est à la fois la "descente aux enfers" des mythologies païennes et la descente du Christ aux enfers pour racheter les âmes des damnés, ainsi que le triple voyage dans l'autre monde de la Divine Comédie, qui souligne, si besoin était, que pour atteindre le Paradis, il faut d'abord passer par l'enfer et le purgatoire (16). C'est précisément aux Enfers, compris comme le "fond originel", que l'on peut rencontrer les "puissances magiques" [§117]: c'est la seule façon de connaître les puissances célestes, mais seulement et uniquement en se confrontant d'abord à ces puissances titanesques-asuriques que Jünger appelle "puissances mythiques".
C'est en cela que réside le grand risque du descensus ad Infera, mais c'est aussi en cela que réside la bataille à gagner maintenant, au mur du temps. Descendre au "fond originel" et s'immerger complètement dans le dualisme uranico-tellurique prétéritoire: c'est la seule façon d'entrer dans la nouvelle ère. Ce n'est que de cette manière que l'individu peut à nouveau faire l'expérience du Sacré et de la Vérité. Ce concept peut sembler trop ésotérique (au sens péjoratif du terme), mais Jünger soutient que sa vision n'est peut-être pas totalement en contradiction avec les connaissances scientifiques de son époque, soulignant que [§118] "Derrière chaque théorie scientifique et, en particulier, matérielle, se cache aujourd'hui la croyance que l'être réside dans le fond originel et non dans l'esprit, et que c'est à partir de ce fond même que la baguette magique est levée".
Quelle est la relation de l'homme avec ce "sol originel" ? On peut supposer - affirme le philosophe d'Europe centrale [§118] - que "le fonds originel aspire à la spiritualisation et qu'à cette fin il utilise (entre autres) l'homme comme moyen". Il s'agirait alors d'une nouvelle phase de spiritualisation de la terre, comme beaucoup d'autres qui ont déjà eu lieu, et la tâche responsable de l'homme serait de la maintenir en mouvement afin d'éviter qu'elle ne se cristallise comme par magie". Ou bien, on pourrait émettre l'hypothèse que l'homme, grâce à une conscience toujours plus grande, "pénétrant couche après couche - dont la plus superficielle s'appelle l'histoire - arrive dans une certaine mesure à puiser dans le fond originel, en spiritualisant et en activant des parties de celui-ci. Partout où le contact est établi, il y aura des réponses extraordinaires. Quelques années auparavant, dans le Traité du rebelle, Jünger l'avait déjà prévu (17): "Ce n'est qu'en apparence que tout cela est dispersé dans des temps et des lieux éloignés. En réalité, chaque homme l'a en lui, elle est transmise à chacun sous forme cryptée pour lui permettre de se comprendre dans sa forme la plus profonde, supra-individuelle (18).
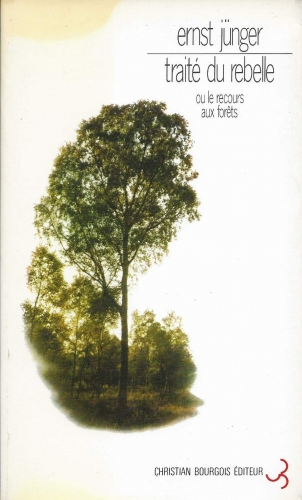
D'après ce qui a été dit, on peut supposer qu'en fin de compte, les deux hypothèses peuvent être considérées comme valables, car elles sont les deux faces d'une même médaille. De cette façon, nous reconnaissons à nouveau le rapport de communion et de réciprocité entre le cosmos et l'homme, une conception qui est d'ailleurs très courante dans la Tradition et chez les traditionalistes du 20ème siècle. Selon Eliade, ce processus même de "cosmisation" ou de "solidarité avec le cosmos" est la conditio sine qua non pour dépasser le domaine du yuga et échapper au temps abstrait. Guénon, quant à lui, confirme que l'axiome de la réciprocité entre l'homme et le cosmos est établi dans toutes les cultures traditionnelles, allant jusqu'à affirmer (19): "Considérer l'histoire de l'homme comme en quelque sorte isolée de tout le reste est une idée exclusivement moderne, en nette opposition avec l'enseignement de toutes les traditions qui, au contraire, sont unanimes à affirmer l'existence d'une corrélation nécessaire et constante entre l'ordre cosmique et l'ordre humain".
Quelques mots encore sur l'utilisation de l'expression "esprit de la terre" dans Le Mur du temps. Jünger [§67] s'y réfère avec le terme "magie", en précisant la référence à "une force terrestre qui ne peut être davantage expliquée, dont la contrepartie au sein du monde fixé est l'électricité". En ce sens, "l'esprit de la terre ne devient magique qu'au moment où il revient", lorsque "nous le voyons se coaguler, se cristalliser et se durcir comme dans les premières villes, les villes de l'âge d'argent". Il semble donc que Jünger entende par "esprit de la terre" cette énergie transcendante que l'on peut activer en la faisant naître du "sol originel" et en l'utilisant ensuite dans le continuum espace-temps. En ce sens, l'esprit de la terre peut revenir aux hommes et aux institutions, et c'est seulement en y adhérant que "les cultes, les œuvres d'art, les villes prennent un caractère magique" [§67]. Dans cette optique, le concept d'"esprit de la terre" de Jünger se reflète également dans l'aither des présocratiques (Empédocle), considéré comme une force vitale, une "chose continue qui se déplace de la surface de la terre aux étoiles et au-delà"(20), qui se déplace comme un pendule oscillant entre les régions supérieures et inférieures, apportant ses dons à tous les niveaux du cosmos.
L'"esprit de la terre", dit Jünger, n'est pas sacré, du moins comme nous sommes habitués à comprendre ce terme dans les religions monothéistes, mais il est plutôt similaire à ce que les anciens Romains appelaient Genius et les Grecs Daimon (21): "Il n'habite pas dans des espaces privilégiés et fermés. On peut plutôt imaginer qu'elle se condense et se manifeste en certains lieux, voire chez certains hommes, tout comme l'électricité peut faire briller certaines parties d'un matériau" [§67]. Une telle définition paraît, en outre, facilement approchable de conceptions archaïques que l'on retrouve un peu partout, du pranad des Hindous au mana des Polynésiens ; de la huaca des Andes à l'orenda des Iroquois de la zone subarctique. Mais il faut surtout souligner la correspondance presque parfaite avec le sens originel du concept latin de numen, un terme qui, à l'origine, ne désignait pas une divinité spécifique, mais désignait aussi une force surnaturelle diffusée dans les éléments naturels et cosmiques, rendue sacrée par la puissance divine qui se manifestait à travers eux, à tous les niveaux du Mundus. Dans cette optique, l'esprit de la terre apparaîtrait comme une puissance transcendante et primordiale, une force vitale et vivifiante dotée d'un pouvoir symbolique et archétypal et, en définitive, donc "sacrée" dans son sens archaïque, traditionnellement reconnu dans le monde entier.
Il n'est pas passé inaperçu que l'expression "esprit de la terre" a été utilisée, quelque trente ans avant la publication de An der Zeitmauer, par le poète espagnol Federico Garcia Lorca (22), à propos du Duende, ou l'équivalent du Génie latin et du Daimon hellénique : il s'agit, selon l'écrivain, de "l'esprit de la terre [...] puissance mystérieuse que tout le monde ressent et qu'aucun philosophe n'explique".
"Dans toute l'Andalousie", poursuit-il, "les gens parlent constamment du duende et le découvrent dès qu'il apparaît avec un instinct efficace". Le sens du terme n'est jamais explicité par l'auteur, mais il est bien connu que, dans le dialecte andalou, on attribue principalement à ce substantif le sens de "lutin", bien qu'il puisse également être traduit par "brocart" ou "étoffe/tissu précieux(se)". Dans la duplicité conceptuelle du terme, on souligne donc d'une part une dimension d'élévation et d'excellence par rapport à la norme, et d'autre part une dimension plus obscure et panique, qui agit néanmoins comme un élément fondateur et causal de la première, plus lumineuse: "Tout ce qui a des sons noirs a duende [...] Ces sons noirs sont le mystère, les racines qui affonde dans la bave que nous connaissons tous, que nous ignorons tous, mais d'où vient ce qui est substantiel dans l'art".


Quoi qu'il en soit, chez García Lorca, comme chez Jünger, la dichotomie conceptuelle s'harmonise de manière cohérente entre ses deux opposés: seul celui qui a le duende (au sens panique du terme) en lui peut aspirer à l'excellence, à s'élever au-dessus de ses semblables, ceci ne dépendant pas de son individualité, mais plutôt du fait d'avoir éveillé en lui une sorte de force primordiale qui, "possédant" l'individu, le conduit au-delà des limites établies pour le reste de la société humaine. Certains aphorismes du poète espagnol semblent presque avoir été écrits par Jünger lui-même, notamment lorsqu'il vaticine: "le duende est un pouvoir et non une action, c'est une lutte et non une pensée", et "ce n'est pas une question de faculté, mais de style de vie authentique ; c'est-à-dire de sang; c'est-à-dire de culture ancienne, de création en action".
Marco Maculotti (du site de l'association Eumeswil)
Bibliographie :
- Helena Petrovna Blavatsky, La Doctrine Secrète [1888].
- Luca Caddeo, Approches stéréoscopiques, des Annales de la Faculté de Lettres et Philosophie de l'Université de Cagliari, (vol LXV), 2011
- Stefano Cascavilla, Il dio degli incroci. Nessun luogo è senza genio, Exòrma, Roma 2021.
- Julius Evola, Cavalcare la tigre, Mediterranee, Rome 2012 [1961].
- Id., introduction à R. Guénon, La crisi del mondo moderno, [1937].
- Pio Filippani Ronconi, J. Evola un destino, in G. de Turris (ed.), Testimonianze su Evola, Mediterranee, Rome 1985
- Federico Garcia Lorca, Gioco e teoria del duende, Adelphi, Milan 2007 [1933].
- René Guénon, Formes traditionnelles et cycles cosmiques, Mediterranee, Rome, 2012
- Ernst Jünger, Al muro del tempo, Adelphi, Milan 2012 [1959].
- Id., Traité du rebelle, Adelphi, Milan 1990 [1951].
- Peter Kingsley, Mysteries and Magic in Ancient Philosophy. Empédocle et la tradition pythagoricienne, Il Saggiatore, Milan 2007 [1995].
- Marco Maculotti, "Al muro del tempo" : la questione della Storia e la crisi del mondo moderno, sur "AxisMundi.blog", mars 2020
- Id., "Al muro del tempo" : le propezie di Ernst Jünger sull'Era dei Titani, sur "AxisMundi.blog", mars 2020
- Id., Arthur Machen, prophète de l'avènement du Grand Dieu Pan, dans Aa.Vv., Arthur Machen. L'apprendista stregone, Bietti, Milan 2021.
- Id., Il dio degli incroci : nessun posto è senza genio, sur "AxisMundi.blog", juillet 2021
- Id., Il "revival" dell'Astrologia nel '900 secondo Eliade, Jünger e Santillana, sur "AxisMundi.blog", décembre 2018.
- Id., Parallelisms between Dante's inframundia and the Indo-Buddhist and shamanic traditions of Asia, in "Arthos" no. 30/year 2021 [forthcoming].
NOTES :
[1] Cf. M. Maculotti, Le " renouveau " de l'astrologie dans les années 1900 selon Eliade, Jünger et Santillana, sur " AxisMundi.blog ", décembre 2018.
[2] Cf. M. Maculotti, " Au mur du temps " : la question de l'Histoire et la crise du monde moderne, sur " AxisMundi.blog ", mars 2020.
[3] Cf. M. Maculotti, "Al muro del tempo" : le propezie di Ernst Jünger sull'Era dei Titani, sur "AxisMundi.blog", mars 2020.
[4] L. Caddeo, Approches stéréoscopiques, extrait des Annales de la Faculté de Lettres et Philosophie de l'Université de Cagliari, (vol LXV), 2011 et disponible en ligne au "Centro Studi la Runa" (mars 2012).
[5] Pour plus de détails, voir l'article déjà cité "Al muro del tempo" : la questione della Storia e la crisi del mondo moderno [voir note 2].
[Dans l'introduction à la première édition italienne (1937) de La crise du monde moderne de R. Guénon, Evola écrit : " Au-delà de tout ce qui est conditionné par le temps et l'espace, qui est sujet au changement, qui est imprégné de sensibilité et de particularité ou lié à des catégories rationnelles, il existe un monde supérieur, non pas comme une hypothèse ou une abstraction de l'esprit humain, mais comme la plus réelle des réalités. L'homme peut le "réaliser", c'est-à-dire en faire une expérience aussi directe et certaine que celle qui est médiatisée par les sens physiques, lorsqu'il parvient à s'élever à un état, précisément, supra-rationnel, ou, comme le dit toujours Guénon, de "pure intellectualité", c'est-à-dire à un usage transcendant de l'intellect, dissous de tout élément proprement humain, psychologiste, affectif et même individualiste ou confusément "mystique"".
[7] J. Evola, Cavalcare la tigre, Mediterranee, Rome 2012, pp. 62-63.
[8] P. Filippani Ronconi, J. Evola un destino, dans G. de Turris (ed.), Testimonianze su Evola, Mediterranee, Rome 1985, p. 122.
[9] Evola, op. cit. p. 50.
[10] Ibid, p. 62. La conception de l'Autre Monde trouve ses débuts connus dans le Phédon de Platon [109a-113c], qui y fait référence comme à la "vraie terre", affirmant que le monde dans lequel nous vivons n'est qu'une pâle reproduction d'une autre terre aux dimensions cosmiques, plus pure et plus belle que la nôtre, dans laquelle les âmes purifiées vont vivre après la mort. Les pythagoriciens, quant à eux, parlaient d'un " autre monde éthéré, céleste ou olympien ", souvent qualifié d'invisible, lui-même habité ; parmi eux, Philolaus l'appelait antichtōn (" anti-Terre " ou " contre-Terre ") - c'est-à-dire : une terre opposée à la nôtre [P. Kingsley, Mysteries and Magic in Ancient Philosophy. Empedocles et la tradition pythagoricienne, Il Saggiatore, Milan 2007, pp.101-2]. Dans son sens littéral, "le terme évoque aussi l'image d'une terre à l'envers, une sorte de terre-ombre, une terre reflétée ou miroitée qui représente l'Autre Monde : le monde des morts" [Ibid, p.187]. Cette dichotomie apparemment paradoxale de l'Autre Monde, à la fois monde "éthéré", "céleste" et "olympien" et "monde des morts", doit être gardée à l'esprit lors de l'analyse ultérieure de la conception jüngerienne du "fond originel" comme siège des puissances magico-uraniennes et mythico-titaniques.
[11] Evola, op. cit. p. 58.
[12] Ibid, p. 67.
[13] Ibidem.
[14) Selon Helena Petrovna Blavatsky, initiatrice du courant théosophique de la fin du XIXe siècle, l'Akasha, de par sa capacité à contenir et à relier chaque événement du continuum espace-temps, représenterait une sorte de " bibliothèque universelle ", qui rassemblerait potentiellement toutes les connaissances du monde et de l'histoire cosmique (les " Chroniques de l'Akasha ") [voir La Doctrine secrète].
[15] Voir M. Maculotti, Arthur Machen, prophète de l'avènement du Grand Dieu Pan, in Aa.Vv., Arthur Machen. L'apprendista stregone, Bietti, Milan 2021.
[16] Cf. M. Maculotti, Parallelismi fra gli inframondi danteschi e la tradizione indo-buddhista e sciamanica dell'Asia, in "Arthos" n. 30/anno 2021 [à paraître].
[17] E. Jünger, Trattato del Ribelle, §20 ; traduit par Adelphi.
[18] Dans le même paragraphe, il est également dit : "Toujours et partout, il y a la conscience que le paysage changeant cache les noyaux originels de la force et que sous l'apparence de l'éphémère jaillissent les sources de l'abondance, de la puissance cosmique. Cette connaissance représente non seulement le fondement symbolico-sacramentel des Eglises, non seulement elle se perpétue dans les doctrines ésotériques et dans les sectes, mais elle constitue le noyau des systèmes philosophiques qui se proposent fondamentalement, aussi éloignés que soient leurs univers conceptuels, d'étudier le même mystère".
[19] R. Guénon, Formes traditionnelles et cycles cosmiques, Méditerranée, Rome, 2012, p. 13.
[20] P. Kingsley, op. cit. p. 30.
[21] Voir, à ce propos, S. Cascavilla, Il dio degli incroci. Nessun luogo è senza genio, Exòrma, Roma 2021, et l'article du même nom publié sur "AxisMundi.blog", juillet 2021.
[22]F. Garcia Lorca, Gioco e teoria del duendo, Adelphi, Milan 2007.
11:28 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, tradition, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Quand Massimo Cacciari a invité Ernst Jünger à Venise

Quand Massimo Cacciari a invité Ernst Jünger à Venise
Franco Volpi
Le philosophe italien (alors maire de Venise a proposé d'accueillir Ernst Jünger dans la ville de San Marco - pour célébrer le 100e anniversaire de l'écrivain - en mars 1995. Voici le récit de cette initiative par Franco Volpi
SOURCE : https://www.barbadillo.it/101685-quando-massimo-cacciari-invito-ernst-junger-a-venezia/
VENISE - La ville est divisée au sujet d'Ernst Jünger, le philosophe et écrivain allemand que Massimo Cacciari a invité sur la lagune le 29 mars (1995) pour célébrer son 100e anniversaire. L'affaire Jünger secoue les eaux calmes de la cité des Doges, ébranle les fondations du conseil progressiste qui soutient Cacciari, et menace de devenir une affaire internationale, avec l'Italie au banc des accusés devant la culture mondiale. Cacciari veut que Jünger soit à Venise parce que, selon lui, il est l'un des plus grands penseurs de ce siècle. Ceux de Rifondazione Comunista, Alleanza Democratica, certains Verts, certains Pidiessiniens et certains représentants de la communauté juive ne veulent pas de lui, parce qu'ils disent qu'il était un nazi et un complice des nazis. "Il est contesté dans le monde entier", affirme Rifondazione, qui a demandé la suspension des célébrations en son honneur, menaçant de faire sauter le conseil municipal. "N'importe quoi. C'est n'importe quoi", rétorque Cacciari, qui rappelle comment Jünger a participé à la révolution conservatrice contre Hitler. C'est un cas qui rappelle celui de Vargas LLosa car, toujours à Venise, l'année dernière, un conseiller pidiessin de la Biennale ne voulait pas qu'il fasse partie du jury du festival du film parce qu'il était trop à droite. Pour le philosophe-maire, il s'agit davantage d'une question de culture que de politique. Et il n'a pas l'intention de revenir sur son invitation à Jünger, malgré la controverse. Si le conseil et le conseil municipal s'y opposent, dit-il, M. Jünger viendra quand même à Venise: "Il sera mon invité personnel et logera chez moi". En outre, le maire rappelle qu'il n'y a pas eu de controverse lorsque Jünger avait été invité de la Biennale, il y a quelques années à Venise, et que c'est Cacciari lui-même qui a prononcé le discours d'introduction.

Habitué à aller à contre-courant, le philosophe vénitien a été parmi les premiers - on ne peut certes pas l'accuser de sympathies conservatrices - à réévaluer, ou plutôt à apprécier à leur juste valeur, les œuvres d'auteurs "de droite", à commencer par Nietzsche, qu'une certaine "gauche" avait mis à l'index. Le 29 mars, Ernst Junger franchira le seuil de son centième anniversaire. On dirait vraiment qu'il a fait un pacte secret avec le temps. Des célébrations se préparent partout : pour son centenaire, un volume d'écrits en son honneur lui sera offert : Magie der Heiterkeit (Magie de la sérénité), et la dernière partie de ses journaux intimes : Siebzig verweht (Soixante-dix s'efface) sera dans les librairies. En France, le Magazine littéraire lui a consacré un numéro: "Jünger, cent ans d' Histoire". En Italie, Cacciari aimerait le voir à Venise. Jünger aurait certainement prévu que son pacte secret avec le temps aurait aussi des implications amères. Mais il n'imaginait peut-être pas que ce serait l'Italie - le pays dans lequel il a vécu et où, plus tôt qu'ailleurs, son œuvre a été largement comprise et libérée de l'hypothèque de la droite - qui troublerait les célébrations avec la controverse entourant l'invitation de Cacciari.
Mais Jünger était-il vraiment un national-socialiste ? Bien sûr, celui qui accepte son époque et s'y plonge comme Jünger ne peut manquer d'être contaminé par elle. On sait que les nationaux-socialistes auraient voulu faire de lui l'écrivain national. Mais Jünger, qui ne croit pas au rôle du parti, qui déteste la "démocratie plébiscitaire" et l'agitation des masses, qui considère la prise de pouvoir de 1933 comme la victoire de la "populace", refuse l'engagement politique et se retranche dans un rôle d'observateur. Sa position de lauréat multi-décoré de la Grande Guerre lui permet d'afficher son hostilité envers le régime. En 1933, il a refusé d'être nommé membre de l'Académie littéraire; il a décliné une invitation à publier dans le Völkischer Beobachter; lorsque le national)-bolchevik Niekisch a été condamné par les nazis, il a accueilli la femme et l'enfant de l'homme persécuté. Lorsque l'association des anciens combattants du 73e Fusiliers, son unité pendant la Première Guerre mondiale, s'est vu interdire d'accepter des Juifs, il a protesté et a quitté l'association. À l'automne 1939, il publie son roman Sur les falaises de marbre, dans lequel il aborde l'idée du tyrannicide. Beaucoup pensaient qu'il avait déjà dépassé les bornes, et il semble que seule la clémence du tyran l'ait sauvé. Hitler lui-même, qui ressentait le charme du personnage, aurait dit : "Laissez Jünger tranquille".
Sa situation risquée a été résolue quand il s'est engagé dans la Wehrmacht et en étant envoyé sur la ligne Siegfried. Mais lors de la guerre-éclair qui a amené les Allemands à Paris, le caractère d'"anarchiste" et d'esthète de Jünger est apparu. La guerre ne le saisit plus comme l'événement primordial où la vie révèle ses cartes. Au contraire, elle produit en lui de la répulsion, de l'éloignement, du détachement et de l'indifférence. La vie est ailleurs. Dans son journal, il note : "Tout est une effrayante antichambre de la mort, dont le passage me secoue brutalement. Dans une phase antérieure de ma formation intellectuelle, je me suis souvent plongé dans des visions d'un monde complètement sans vie et désert, et je ne nie pas que ces rêves lugubres me procuraient du plaisir. Ici, je vois ces pensées se réaliser et je crois que, si les soldats manquaient aussi, l'esprit deviendrait rapidement fou - au cours de ces deux jours, j'ai senti que la vision d'anéantissement a commencé à secouer ses charnières".
Lors de la marche vers Paris, au lieu de viser la capitale, il a détourné ses troupes vers la forteresse médiévale de Laon. Il s'y est arrêté pour sauver les trésors inestimables de la splendide bibliothèque de l'abbaye de Saint-Martin. Il y a quelques années, le maire de Laon, en accord avec les associations partisanes, lui a décerné la citoyenneté d'honneur. Les détracteurs de Cacciari devraient lire le compte rendu de la cérémonie. A Paris, il est chargé de la censure de la correspondance. En réalité, il s'intéressait aux rencontres avec des écrivains et des artistes, aux musées, aux galeries, aux antiquaires, à la vie de salon et aux heures de flânerie que Paris lui offrait. Ses journaux intimes parisiens témoignent non seulement de sa vie détachée dans la ville occupée, mais aussi de son indépendance vis-à-vis de l'idéologie nationale-socialiste. L'ambiance prédominante est celle d'une mélancolie lugubre: "Poe, Melville, Hölderlin, Tocqueville, Dostoïevski, Burckhardt, Nietzsche, Rimbaud, Conrad" - une bonne partie de la littérature nihiliste qui l'a accompagné pendant un certain temps. Sur le tyran de Berlin, il est d'accord avec Carl Schmitt, qui lui rend visite à Paris : non possum scribere contra eum, qui potest proscribere. Il fut impliqué dans la rébellion contre Hitler. Après la tentative d'assassinat manquée de von Stauffenberg, il ne s'en tire que parce qu'aucune preuve contre lui n'a été trouvée. Ceux qui continuent à qualifier l'"anarchiste" Jünger de national-socialiste sont soit mal informés, soit de mauvaise foi. Il est consolant de constater que le jugement le plus pénétrant et le plus différencié sur le prétendu national-socialisme de Jünger a été prononcé par une juive : Hannah Arendt. Présidente de la Commission pour la reconstruction de la culture juive européenne après la guerre, Arendt a rédigé un compte rendu de l'état culturel de l'Allemagne d'après-guerre.

À propos de Jünger, elle a écrit : "Les journaux de guerre d'Ernst Jünger offrent peut-être le meilleur et le plus honnête exemple des immenses difficultés auxquelles l'individu s'expose lorsqu'il veut garder intactes ses valeurs et sa conception de la vérité dans un monde où la vérité et la moralité ont perdu toute expression reconnaissable. Malgré l'influence indéniable que les premiers travaux de Jünger ont exercée sur certains membres de l'intelligentsia nazie, il a été, du premier au dernier jour du régime, un opposant actif au nazisme". Dans tous les cas, les consciences bien intentionnées peuvent être tranquilles. Jünger ne va nulle part. Tout ce qu'il a dit, c'est qu'il aimerait s'échapper dans un atoll isolé du Pacifique et attendre que les célébrations du centenaire soient passées. (extrait de La Repubblica du 11 février 1995)
Franco Volpi.
10:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, massimo cacciari, italie, venise, franco volpi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 novembre 2021
Jünger et la Grande Mère - Méditations méditerranéennes

Jünger et la Grande Mère
Méditations méditerranéennes
Giovanni Sessa
https://www.centrostudilaruna.it/junger-e-la-grande-madre-meditazioni-mediterranee.html
Ernst Jünger, éminent représentant de la révolution conservatrice allemande, était un écrivain exceptionnel, diagnosticien de la modernité, interprète éclairé de la technologie et prophète d'un nouveau départ. Dans sa vaste production littéraire, ses journaux de voyage jouent un rôle important. Les réussites stylistiques de l'auteur dans ces journaux sont évidentes dans sa prose élégante et sa capacité peu commune à engager le lecteur. Ceci est confirmé par le volume, Ernst Jünger, La Grande Madre. Meditazioni mediterranee, édité par Mario Bosincu et publié dans le catalogue de l'éditeur Le Lettere (pp. 209, euro 15.00). Le texte rassemble les journaux intimes des voyages de l'écrivain en Méditerranée entre 1955 et 1975, qui l'ont conduit en Sardaigne, en Espagne, en Turquie, en Crète, en Égypte, à Samos et même dans le Sinaï.
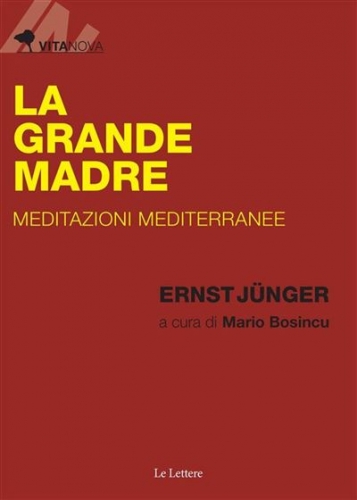
Il est bon de prendre connaissance de ce que Marguerite Yourcenaur a écrit sur le sens du voyage. Elle disait que, de même qu'un prisonnier en attente d'exécution est amené à voyager autour de la prison dans laquelle il est enfermé, de même les humains, animaux véritablement mortels en ce qu'ils ont conscience de la fin qui les attend, sont amenés à voyager par cette tragique certitude. Dans cette perspective, les humains feraient, sic et simpliciter, le tour de la "cellule" dans laquelle ils sont enfermés. L'affirmation de Yourcenar est forte, elle a un trait gnostique. Jünger, en revanche, est mû par une vision totalement divergente. Il est animé par une inspiration néo-platonicienne, convaincu que l'homo symbolicus peut interpréter la nature en termes hiérophaniques. Dans la multiplicité kaléidoscopique de la réalité, Jünger identifie les différents visages de l'Un. Dans ses pages, le voyage devient un outil cathartique : à travers le mouvement dans l'espace (qui est toujours aussi un mouvement dans le temps), devant les trouvailles et les merveilles archéologiques ou le terrifiant qui habite la physis, nous nous libérons de l'accessoire que la raison moderne a construit. En revenant à l'essentiel qui nous constitue, nous nous découvrons nouveaux, toujours en progrès, ouverts aux potestats du cosmos.
Les carnets de voyage en Méditerranée sont, en particulier, le récit de la rencontre de Jünger avec l'énergie antéïque, avec la Terre comme point de référence essentiel pour les civilisations qui ont surgi sur les rives de Mare Nostrum. Ce pouvoir revient faire entendre sa voix dans les journaux intimes et, pour sa récupération, l'intellectuel allemand, avec Eliade, fonde la revue Antaios, dans laquelle Evola écrivit. Dans le paysage dionysiaque de la Méditerranée, dans le midi panique, admirablement présenté par Jünger, le lecteur redécouvre le lien indissoluble de l'homme avec la Grande Mère, et revenant à Elle, dans l'"immense moment" de la contemplation, fait l'expérience de l'éternel. Ce n'est pas un hasard si Angelo Silesius est cité à ce sujet : "Celui pour qui le temps est comme l'éternité/ et l'éternité comme le temps/ est libéré de toute souffrance" (p. 101). Cette libération est possible car : "ce qui est intemporel ne nous est pas étranger. Nous venons d'elle et allons vers elle : elle nous accompagne dans le voyage comme le seul bagage qui ne peut être perdu" (p. 199).

Dans La Grande Madre, Jünger, parmi les nombreuses dettes culturelles contractées au cours de son intense vie d'érudit, règle celle qu'il a envers Bachofen. Cela est évident dès les premières lignes du journal sarde de 1955. Décrivant l'extase qu'il a ressentie lors d'une baignade rafraîchissante à Capo Carbonara, près de Villasimius, où les eaux douces du Rio Campus se jettent dans les eaux saumâtres de la mer, il s'exclame : "J'ai ressenti un immense plaisir et j'ai remercié ma deuxième Grande Mère, la Méditerranée" (p. 72). (Pour l'écrivain, les eaux primordiales et la Terre, le ventre originel, deviennent des symboles de vie, de mort et de renaissance. Ce cycle cosmique est bien symbolisé par cette notation, transcrite en marge d'une visite au cimetière de Carloforte, d'où l'on peut voir le rapport entre la tombe et la fleur, celui entre la mort et l'incipit vita nova : "La paradisea liliastratum s'était déjà en grande partie fanée, tandis que sa parente plus grande de couleur rose était encore visible sur certaines tombes" (p. 81). Il a compris la futilité du progrès dans son errance sur le Sinaï. Dans son journal, il note: "Le progrès linéaire [...] se réduit [...] au progrès de la technique et n'a aucune influence sur le comportement civil, l'art, la morale" (p. 180). Il est inessentiel par rapport à ce qui est important, dans un sens éminent, pour l'humanité.


De cette déclaration, on peut comprendre le trait de "zélateur" de la vision du monde de Jünger, terme utilisé par le préfacier dans l'introduction bien documentée et organique. Il s'agit d'une conception anti-moderne, contraire au moralisme bourgeois, ancrée dans la Kultur qui, au début du siècle dernier, palpitait dans de nombreuses expressions de la production intellectuelle. L'opposition de Jünger à la Zivilisation, évidente dans ses carnets de voyage, est empruntée à Nietzsche et, surtout, à Spengler. De l'auteur du Déclin de l'Occident, il a tiré l'appréciation du sacré qui vit dans la nature. Comme le souligne à juste titre Bosincu, Schleiermacher et Rudolf Otto, dont Jünger appréciait l'exégèse du numineux, ont contribué à l'élaboration de sa vision post-romantique de la réalité. Grâce à leurs intuitions, pendant la Première Guerre mondiale, l'écrivain allemand a vu dans le combat la possibilité, pour ceux qui l'interprétaient activement, de réaliser une rupture de niveau capable d'ouvrir de nouvelles perspectives ontologiques. Les forces chthoniennes auraient dû avoir le champ libre, à l'image de ce que l'Arbeiter aurait dû réaliser dans la société civile.

Jünger s'est ensuite converti au christianisme. Dès lors, il estime que le tellurisme doit être, non pas réprimé, certes, mais refroidi par la référence à l'Esprit. Si, au départ, le rôle de l'écrivain devait être mytho-poétique, visant à façonner, sur la base de la référence de Spengler au césarisme, l'homo totalitarius, dans les journaux intimes, l'écrivain pour Jünger assume la fonction de mystagogue, qui doit inciter le lecteur à passer par les mêmes degrés "initiatiques" qu'il a expérimentés pendant le voyage de la "connaissance".
Les errances méditerranéennes, dans des lieux non subjugués par les feux fatals de la mobilisation totale, se résolvent: "en actes de résistance visant à cultiver "l'autre côté de l'homme" [...] la région psychique [...] en contact avec les ressorts de l'inconscient et ouverte à la transcendance" (p. 65). Pour l'auteur de ces lignes, la référence à la transcendance représente une diminutio des positions jüngeriennes. La rencontre avec la physis est libératrice, à notre avis, pour le fait qu'elle est, stoïquement, la seule transcendance au-dessus de nous. Malgré cette divergence, La Grande Madre reste un livre éclairant que nous recommandons vivement.
16:35 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, livre, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, méditerranée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 10 novembre 2021
Gustav Meyrink, Thomas Mann et une réunion éditoriale ennuyeuse
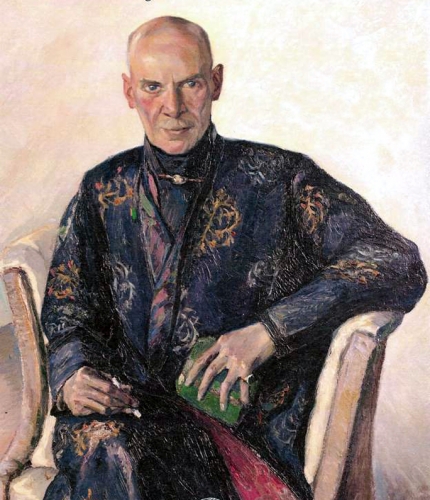
Gustav Meyrink, Thomas Mann et une réunion éditoriale ennuyeuse
Andrea Scarabelli
Ex: https://blog.ilgiornale.it/scarabelli/2021/10/29/gustav-meyrink-thomas-mann-e-una-noiosa-riunione-di-redazione/
La nouvelle édition de La Mort Pourpre (Der violette Tod) vient de sortir, publiée par Il Palindromo dans la série "I Tre Sedili Deserti", dirigée par Giuseppe Aguanno. Les vingt-huit nouvelles de cette anthologie de Gustav Meyrink, datant des années 1901-1908, sont fondamentales pour comprendre la personnalité littéraire d'un auteur qui, avant de s'essayer à la nouvelle, a fréquenté des cercles ésotériques, en a fondé plusieurs, a étudié et pratiqué les disciplines traditionnelles de l'Orient et de l'Occident, ne dédaignant pas les crises existentielles profondes et les brusques revirements du destin. Nombre d'entre eux sont présents dans le "no man's land" de ces contes, qui précèdent les romans qui permettront à Meyrink d'accéder au panthéon de la grande littérature des 19èmee et 20ème siècles, avec des chefs-d'œuvre tels que Le Golem (1915), Le Visage vert (1916), La Nuit de Walpurgis (1917), Le Dominicain blanc (1921) et L'Ange à la fenêtre d'Occident (1927).

Des romans paraissent dans divers périodiques, dont Der liebe Augustin, dont Meyrink devient rédacteur en mai 1904: dans ses colonnes, il publie August Strindberg, Verhaeren traduit par Stefan Zweig, Maurice Maeterlinck, Dante Gabriel Rossetti, Edgar Poe... Sans oublier les récits publiés dans le légendaire Simplicissimus. Ceux qui veulent réduire l'œuvre de Meyrink à une "fiction de second ordre" devraient jeter un coup d'œil aux autres noms qui figurent dans le Simplicissimus : Hermann Hesse, Knut Hamsun, Alfred Kubin, Hugo von Hofmannsthal et Rainer Maria Rilke. Parmi les collaborateurs figure aussi Thomas Mann, qui, dans son Tonio Kröger, offre un portrait très curieux du futur auteur du Golem: "Je connais un banquier, un homme d'affaires grisonnant, qui a le don d'écrire des romans. Il utilise ce don dans son temps libre, et ses œuvres sont excellentes". Et pourtant, "malgré, je dis bien 'malgré', cette sublime disposition, l'homme n'est pas tout à fait courroucé; au contraire, il a déjà eu à purger une grave peine de prison". C'est dans la captivité d'une cellule de prison que Meyrink "a réalisé son talent", poursuit Mann, "et ses expériences de prisonnier sont le thème fondamental de ses œuvres littéraires". [...] Un banquier qui écrit des romans est une rareté, vous ne trouvez pas ?". Il ne s'en cache pas.
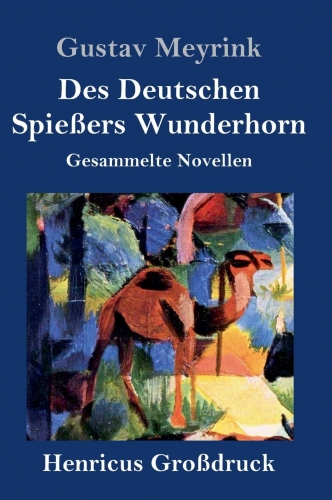
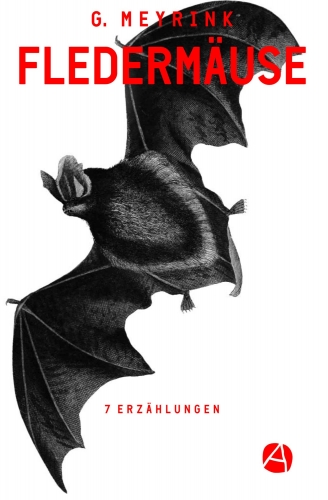
Publiées dans des revues, ces histoires ont été rassemblées dans diverses anthologies au cours de la première décennie du siècle dernier et, en 1913, elles ont été réunies dans les trois volumes de Des deutschen Spiessers Wunderhorn, qui sont et restent la principale référence de sa nouvelle, à laquelle il faut ajouter l'anthologie Fledermäuse, publiée en 1916, qui contient sept histoires. Bien que des romans antérieurs aient été identifiés (c'est le cas de Tiefseefische, datant de 1897), le véritable "baptême de l'édition" de Meyrink a lieu au début du siècle: il s'agit du récit Der heisse Soldat (premier récit de La Mort pourpre), publié dans les colonnes du Simplicissimus le 29 octobre 1901.
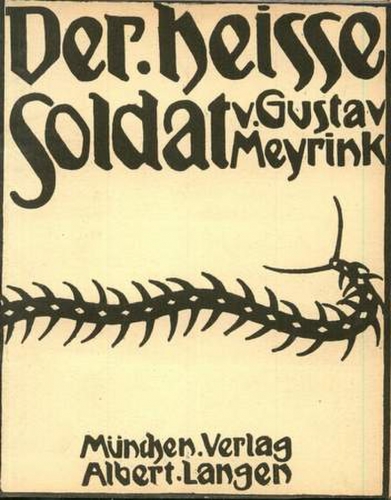
Meyrink nous a raconté à plusieurs reprises comment il en est venu à l'écrire et à le publier, en le reliant à un écrivain et à un été. Nous sommes en été 1901, et l'écrivain est Oskar A. H. Schmitz, qu'il a rencontré au sanatorium Lahmann de Dresde. Poète et ami d'Alfred Kubin (dont il a épousé la sœur Hedwig), Schmitz écoute avec ravissement le futur écrivain, qui lui raconte quelques-unes de ses "aventures occultes" (médiums, saints hommes et sociétés secrètes). L'écrivain l'interrompt alors en lui demandant simplement: "Pourquoi n'écrivez-vous pas sur eux ?
"Et comment faites-vous cela ?" rétorque Meyrink.
"Écris tout comme ça, simplement comme tu parles."
S'ensuit l'écriture de Der heisse Soldat, envoyé au Simplicissimus (Schmitz lui-même lui donnera l'adresse). Une série de coïncidences ? Peut-être. Mais pas selon Meyrink: ces faits représentent pour lui le rallumage d'un feu beaucoup plus ancien, le couronnement d'un chemin déjà parcouru. L'objectif ? Penser en images, comme il le note dans son long essai autobiographique La metamorfosi del sangue (La métamorphose du sang), datant des dernières années de sa vie sur terre et qui vient d'être publié en italien par Bietti : "Incidemment, la faculté de vision intérieure [...] a été le premier tournant de mon destin, qui a transformé d'un coup, pour ainsi dire, un commerçant en écrivain: mon imagination est devenue concrète. Si j'avais auparavant pensé en mots, j'étais maintenant capable de penser en images. Et ces images étaient tangibles, cent fois plus tangibles et réelles que n'importe quel objet corporel".

Pour mémoire, les "coïncidences" qui l'ont amené à publier ne se sont pas arrêtées à sa rencontre avec Schmitz. Alfred Schmid Noerr, un ami de l'écrivain autrichien, raconte ce qui s'est passé lorsque le manuscrit est arrivé à la rédaction de Simplicissimus dans une enveloppe portant le nom de l'expéditeur "Gustav Meyrink" - le véritable nom de famille de l'auteur, Meyer, n'apparaissait pas.
Une réunion de rédaction était prévue ce jour-là, qui n'était pas particulièrement stimulante - comme le sont toutes les réunions de rédaction, après tout.
Cependant, c'est Geheeb, l'un des assistants de l'éditeur, qui a ouvert l'enveloppe. Il a jeté un rapide coup d'œil aux pages et a soufflé: "Ce truc a été écrit par un fou". Dommage, une partie d'entre eux acquièsce. Mais voilà. Et il a jeté le tout à la poubelle.
C'était la première histoire que Meyrink avait envoyée; si elle n'avait pas été acceptée, il n'en aurait probablement pas écrit d'autres. Qui sait ce qui se serait passé si le rédacteur en chef, Ludwig Thoma, n'était pas arrivé entre-temps. "Taciturne, enveloppé dans la fumée de sa pipe, se souvient Noerr, il s'est assis sur sa chaise et, plutôt ennuyé par le ton de la réunion, a tâtonné avec le bout de sa canne dans la corbeille à papier.
"Qu'avons-nous là ?" a-t-il demandé, intrigué, dès qu'il a trouvé le tapuscrit.
"Le témoignage d'un fou", a été la réponse de Geheeb.
"Un fou ? Peut-être. Mais brillant", répondit Thoma, après un rapide coup d'œil. "Oui, oui, Geheeb, le génie et la folie. Gardez ce nom en tête: Meyrink. Et écrivez-lui tout de suite pour lui demander s'il a d'autres trucs comme ça. Nous la publierons immédiatement."
Comme nous l'avons dit, les débuts littéraires d'un auteur sont souvent le fruit d'un concours de circonstances. C'est encore plus vrai pour quelqu'un comme Meyrink, qui attribuait à tout événement de sa vie une autre signification, inscrite dans les règles régissant la relation entre l'homme et le cosmos.
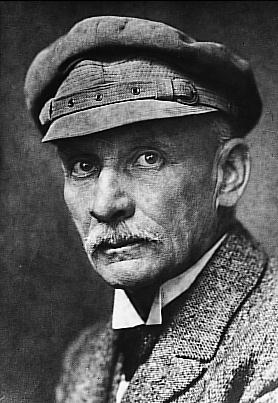 Plus d'un siècle après ces événements, c'est précisément Der heisse Soldat qui ouvre La Mort pourpre, à nouveau disponible pour les lecteurs italiens. Que pouvons-nous dire ? Peut-être devons-nous la publication de cette histoire et d'autres récits de Meyrink à l'ennui d'une salle de rédaction à l'aube du siècle dernier. C'est peut-être la façon dont le destin a choisi de conclure la métamorphose littéraire et existentielle de l'un des plus grands maîtres du fantastique.
Plus d'un siècle après ces événements, c'est précisément Der heisse Soldat qui ouvre La Mort pourpre, à nouveau disponible pour les lecteurs italiens. Que pouvons-nous dire ? Peut-être devons-nous la publication de cette histoire et d'autres récits de Meyrink à l'ennui d'une salle de rédaction à l'aube du siècle dernier. C'est peut-être la façon dont le destin a choisi de conclure la métamorphose littéraire et existentielle de l'un des plus grands maîtres du fantastique.
18:34 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gustav meyrink, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le dernier Jünger révèle l'harmonie et l'ordre entre la Terre et le Cosmos
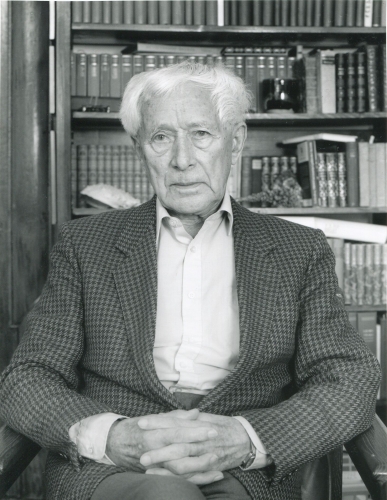
Le dernier Jünger révèle l'harmonie et l'ordre entre la Terre et le Cosmos
Par Francesco Marotta
Ex: https://www.grece-it.com/2021/11/10/lultimo-junger-disvela-larmonia-e-lordine-tra-la-terra-ed-il-cosmo/
Mario Bosincu est chercheur en littérature allemande à l'université de Sassari. Profond connaisseur et chercheur infatigable des œuvres d'Ernst Jünger - une grande passion commune, le feu qui ne s'éteint pas et qui dégage lumière et chaleur - il associe depuis longtemps les études sur Jünger à la critique de la civilisation et de la société, dans un contexte phénoménal qui n'exclut pas l'anthropologie et l'histoire des religions. Dans l'une de ses principales publications, Sulle posizioni perdute, forme della soggettività moderna dell’anticapitalismo romantico a Ernst Jünger, nous voyons un intellect à l'aise dans la lecture de toutes les ondulations d'un futur dystopique, se déplaçant avec perspicacité et efficacité dans le monde complexe des transformations de la planète : notamment celles concernant l'axiomatique de l'intérêt, l'individualisme méthodologique, l'idéologie de la croissance infinie, la doctrine du progrès, les "droits de l'homme" et l'expansion de la valeur marchande dans tous les domaines.

Après la publication en 2020 d'Autunno in Sardegna, un volume qui réunit trois des écrits de Jünger, San Pietro, Serpentara et Autunno in Sardegna, à partir du 1er juillet 2021, il sera possible de lire les autres entrées du journal de ses voyages en Méditerranée ; le grand calibre spirituel, intellectuel, philosophique, esthétique et dialogique du sublime génie de Heidelberg est tel qu'il fait honte à Hérodote d'Halicarnasse et à ses Histoires. Un autre excellent ouvrage, également du professeur Bosincu, intitulé La Grande Madre. Meditazioni mediterranee, suscite l'intérêt du lecteur pour les "étoiles de feu", les Pléiades : l'introduction est si pleine de sagacité, de sagesse et de bon sens, qu'elle suggère des hymnes en l'honneur d'Agni, la divinité védique qui les préside.
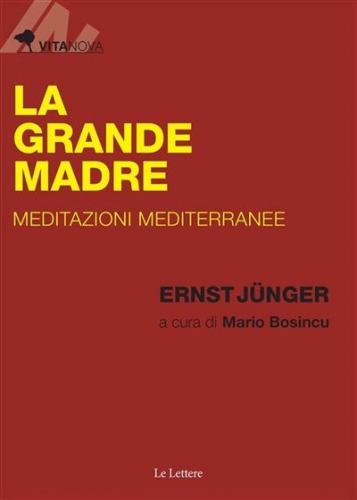
Elle nous rapproche inéluctablement de l'insolite, de la triple essence et, par conséquent, de l'archétype de la Quaternité, que l'on retrouve dans l'esprit et la personnalité de Jünger. En un homme qui portait en lui l'ensemble cosmogonique bien décrit par Empédocle, les quatre éléments qui composent toutes choses, les "racines" : feu, terre, air et eau -ριζώματα, rhizòmata -. Le Jünger, un formidable messager, parfaitement capable de médiatiser et de comprendre pleinement l'ordre humain et divin, en tant que participant et attentif à la multiplicité intrinsèque de chaque dimension.
Le "contemplateur solitaire" si cher au germaniste et traducteur Quirino Principe, qui dans les écrits de La Grande Madre. Meditazioni mediterranee, observe et contemple les mêmes forces telluriques du cœur palpitant de la Terre: l'Omphalos, le nombril du monde le plus ancien, la Sardaigne, ne fait qu'un avec les vagues fluctuantes d'une mer fermée comme la Méditerranée, avec les pouvoirs contradictoires de la Titanomachie et avec les forces qui rayonnent du Cosmos. Mais l'avertissement de Jünger est clair, il nous met en garde contre toute erreur d'interprétation possible : les Titans "vaincus par Zeus et bannis au Tartare font un retour", l'exemple de Prométhée libéré de ses chaînes en est la preuve. Dans les terres baignées par le Mare nostrum, "les Titans opèrent et donnent vie à leurs inventions dans le temps" et non hors du temps.
Cela signifie que tout ce qui n'est pas soumis au calcul, au tintement des aiguilles, à la fixité d'un temps mécaniquement marqué, réside ailleurs et est intemporel. Après tout, le "titanisme prométhéen", les anciens et les nouveaux titans, "sont davantage liés à la technologie qu'aux arts". Et comme le conseille sagement Hölderlin, il est préférable pour le poète de "se consoler avec le dieu Dionysos", en s'appuyant sur ces rêves qui génèrent créativité et inspiration "pendant le règne de la race de l'âge du fer". Bientôt les dieux reviendront, rétablissant l'harmonie perdue, les mêmes dieux qui ne sont jamais partis mais que nous avons oubliés, mettront fin à cette domination.

L'interrègne de la technologie libérée de la domination humaine et de "la science qui touche ses limites et commence à les dépasser" est la représentation, ou plus exactement l'une des visions de Jünger, d'un monde devenu un théâtre de l'absurde, un Grand Guignol dirigé par des géants et des chimères, mis en scène par des formes prométhéennes qui dansent extatiquement dans la phase aiguë de l'intérim : le nivellement absolu d'une civilisation mourante, où "leur pouvoir est confirmé par l'éternel retour". Et comme l'écrit justement Jünger, prouvant une fois de plus qu'il est un voyant, à comprendre comme celui qui est doté de la faculté de voir, "cette forme d'éternité ne représente pas la fin du temps et des temps, mais leur extension à l'infini".
Ce désir tenace d'atteindre une impossible immortalité est clairement visible dans les temps difficiles que nous traversons ; là, où tout est dépassé, en premier lieu les dieux et le concept du sacré, les énergies libérées par l'éclat de "l'homme augmenté" se perdent dans un savoir qui n'est plus contemplatif mais productif. Du geste, emblème à la prérogative du seul exécutant technique, pensant réaliser les conditions humaines de survie et s'éloigner définitivement des stimuli de l'habitat et de l'environnement qui l'entourent. L'expression la plus élevée d'un homme qui se suffit à lui-même, pour la raison qu'il a déjà renoncé a priori à tout finalisme de la pensée et de l'action tant qu'elle est individuelle.
Le "sismographe" Jünger, comme on l'a souvent défini, a compris à l'avance ce que déplace l'idée d'artifice et/ou l'illusion de vouloir dépasser l'espace et une dimension définie par d'autres possibles, en donnant libre cours aux désirs de l'individu, au dogme des besoins abstraits qui en génèrent toujours de nouveaux. Redécouvrir une liberté instrumentale capable d'inverser les pôles : l'homme au service de la technologie et non la technologie au service de l'homme. En même temps, il abolit les frontières et les horizons, les projetant dans un futur post-humain où la physicalité, l'esprit, le toucher, la vue, l'ouïe, les expériences sensorielles et cérébrales, les émotions et les identités passent par d'autres corps, présumés ou réels, n'attribuant plus à l'homme le rôle de créateur mais celui d'élément performant.

Dans le pire des cas, un "automate", l'équation animal-machine de Descartes alternait avec l'équation homme-machine, plus malheureuse encore : l'élévation au pouvoir de l'artificiel, dans l'exactitude de l'artifice, identique à tout ce qui n'est pas, y compris l'homme, qui peut être étudié de la même manière qu'une machine. Une vision des choses qui contraste fortement avec celle du conservateur de La Grande Madre. Meditazioni mediterranee et avec une grande partie de la bibliographie de Jünger.
Au terme de cette lecture, on se souvient de la discorde de pensée manifestée par Heidegger à Jünger, à propos de la situation en général et du fameux " point zéro ", décrit dans Über die Linie, (Au-delà de la ligne) : " La ligne est aussi appelée méridien zéro. Vous parlez du point zéro. Le zéro fait allusion au rien, et précisément au rien vide. Là où tout mène au néant, le nihilisme domine. Au méridien zéro, le nihilisme approche de son accomplissement. Jamais comme dans la publication éditée par Bosincu, les deux grands de la pensée européenne n'ont convergé par moments, avec toute la prudence requise.
Laissant de côté la querelle du sens et de la dénomination, du point ou du méridien zéro - ici Heidegger avait raison -, le dernier Jünger fait un clin d'œil à ce que voulait dire le "petit magicien" du Bade-Wurtemberg, surnom amical que lui donnaient les étudiants de Heidegger. La source de bons conseils de Jünger était sa "deuxième grande mère, la Méditerranée". La Terre et le Cosmos, les profondeurs telluriques, les puissances "chthoniques", les cycles célestes et l'érudition du Cosmos, n'ont jamais été aussi proches.
Ernst Jünger, La Grande Madre. Meditazioni mediterranee - volume édité par Mario Bosincu, Editoriale Le Lettere, Série Vita Nova, 214 pages, 15,50 euros.
16:12 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, ernst jünger, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice, méditerranée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 09 novembre 2021
Le voyage atlantique de l'impubliable Jünger
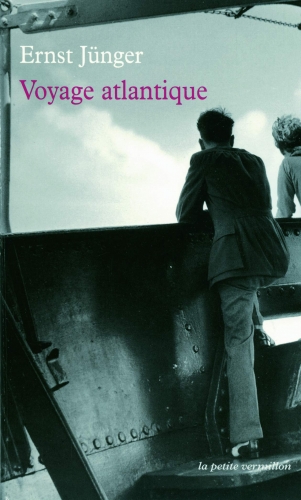
Le voyage atlantique de l'impubliable Jünger
Andrea Scarabelli
Ex: https://blog.ilgiornale.it/scarabelli/2017/08/07/il-viaggio-atlantico-dellimpubblicabile-junger/
Ernst Jünger, Voyage atlantique, Londres, 1947. Deux ans après la fin de la guerre mondiale, un petit livre inhabituel a été publié dans une série destinée aux prisonniers de guerre allemands en Angleterre. Ernst Jünger est donc l'auteur de Atlantische Fahrt, récemment publié en italien chez Guanda sous le titre Traversata atlantica, dans une traduction d'Alessandra Iadicicco et avec un éditeur enfin digne de ce nom. En plus du texte, le volume contient un riche appareil de correspondance, des annexes bio-bibliographiques, un grand nombre de notes et une critique d'Erhart Kästner de 1948. Reconstituée à travers ces riches apports, l'histoire éditoriale de Atlantische Fahrt est comique dans un certain sens. Le premier livre d'après-guerre de Jünger n'a pas été publié en Allemagne, en raison de la répression "démocratique" qui l'a interdit de publication et de parole, en même temps que d'autres dieux de la philosophie du 20ème siècle, dont Martin Heidegger et Carl Schmitt. L'épuration culturelle et anthropologique de la nouvelle Allemagne finit par le toucher lui aussi, abandonné à lui-même, incapable d'écrire et de publier et pourtant imprimé et réimprimé à l'étranger (surtout en Suisse, dans ces années-là), alors qu'une longue lignée d'intellectuels était intervenue en sa faveur. Le veto des autorités alliées durera jusqu'en 1949. Jusque-là, rien ne pouvait être fait. "Faut-il être un prisonnier allemand pour pouvoir lire un certain auteur interdit en Allemagne?" a amèrement remarqué l'écrivain Stefan Andres en critiquant Jünger en 1949.
À la fin des années 1940, le futur lauréat du prix Goethe est donc enchaîné : mais Jünger, le paria, s'est métamorphosé, a changé de peau, assumant la tâche de "phare aristocratique de la douleur", comme il le dira quelques années plus tard. C'est la chair des vaincus qui réclame l'attention dans ces pages lumineuses, que la sagesse européenne ne pourra pas ignorer longtemps. Un cri qui sera certainement malvenu pour certaines belles âmes, mais qui fait de ses paroles l'un des chants les plus intenses du 20ème siècle.

En tout cas, le livre a été publié en 1947, mais il s'agit du récit d'un voyage au Brésil onze ans plus tôt : de Hambourg à Belém, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro et Bahia. Avec une escale préliminaire aux Açores, occasion idéale pour faire le point sur la situation de l'Allemagne qu'il vient de quitter: "Leur archipel me semblait un symbole de notre situation: comme une chaîne de volcans qui, à l'extrême frontière de l'Europe, s'élève au milieu de solitudes infinies". Il décide de faire une pause dans une civilisation dont il commence à entrevoir les ombres, changeant d'hémisphère, sous un soleil et des constellations différents. Ce voyage allait marquer un profond changement dans sa vision du monde, en déplaçant l'accent de la situation en Allemagne vers celle du monde dans son ensemble, comme le note Detlev Schöttker dans son essai à la fin du livre. Mais Jünger ne le sait pas encore, et dans le Nouveau Monde, dans sa surabondance protéiforme, il cherche les images, les phénomènes originaux dont parlait Goethe dans ses écrits sur la métamorphose des plantes. Chacune de ces images réveille des réminiscences anciennes, faisant de chaque homme un artiste et un artifice. L'Atlantique comme un miroir, dans lequel le poète d'Orages d'acier se reconnaît et se retrouve. Ici, chaque découverte est une (auto)révélation, un retour à la maison. Il s'en rend compte lorsqu'il aperçoit un poisson de forme bizarre, inconnu des classifications occidentales. Quelque chose de dormant se réveille en lui :
"A la vue de ces créatures fabuleuses, ce qui nous frappe, c'est avant tout l'accord entre l'apparition et l'imagination. Nous ne les percevons pas comme si nous les découvrions, mais comme si nous les inventions. Elles nous surprennent et en même temps nous nous sentons intimement familiers avec elles, comme si elles étaient des parties de nous-mêmes réalisées en images. Parfois, dans certains rêves et, très probablement, à l'heure de la mort, cette imagination acquiert en nous une force extraordinaire. Les mythes naissent là où les réalités supérieures et suprêmes s'accordent avec le pouvoir de l'imagination".
Mais l'Amérique du Sud n'est pas seulement une nature non contaminée. Au milieu des dédales de végétation et des humbles rives de rivières sans fin se dressent d'imposantes mégalopoles, encore inconnues des Européens de l'époque. C'est en présence de ces agglomérations vertigineuses que s'opère la révolution copernicienne de l'écrivain : la technologie, vue à l'œuvre dans la Première Guerre mondiale puis dans l'industrie, est devenue un phénomène mondial. Les acolytes du Travailleur ont envahi le globe, le transfigurant et redessinant ses frontières. Rio de Janeiro le consterne: "La ville a une forte impression sur moi. C'est une résidence pour l'esprit du monde". Et c'est précisément dans ces pages qu'apparaît le nom d'Oswald Spengler, qui dans Le Déclin de l'Occident avait indiqué dans les métropoles inorganiques et amorphes l'un des symptômes des phases terminales d'une civilisation. Des prophéties aussi amères que d'actualité, même un siècle après la publication de son monumental traité sur la morphologie des civilisations.
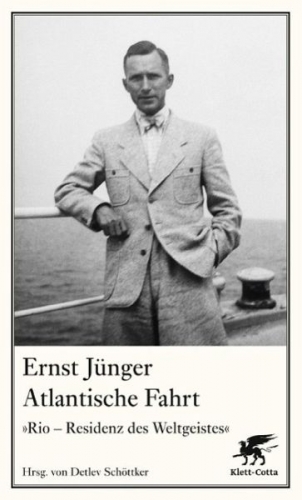
Et pourtant, comme l'écrivait Hölderlin, là où le danger grandit, surgit aussi ce qui sauve, et au cours de ce voyage au bout de l'Occident, une fois encore, la nature sauvage et intacte agit comme un buen retiro, comme un contrepoids à la technicisation planétaire effrénée. Une lettre à son frère Friedrich Georg, écrite le 20 novembre 1936 à Santos, en témoigne: "Dans ces contrées, il y a un proverbe que j'aime beaucoup ; il dit: la forêt est grande, et cela signifie que quiconque se trouve en difficulté ou est victime de persécutions peut toujours espérer trouver refuge et accueil dans cet élément". Il est probable que certains de ses compagnons de voyage pensent la même chose, et lorsqu'ils arrivent au Brésil, ils décident de quitter le navire et de ne pas retourner en Allemagne. Au contraire, il l'a fait, vivant la tragédie européenne jusqu'à son dernier acte, mais emportant avec lui cette image de la forêt, développée quelques années plus tard dans Le traité du rebelle. Dans la forêt, il verra l'authentique patrie spirituelle de l'homme, par opposition au navire, domaine de la vitesse et du progrès, et le rebelle sera celui qui se tournera vers la forêt, en se donnant à la brousse - en quittant le navire, en fait.
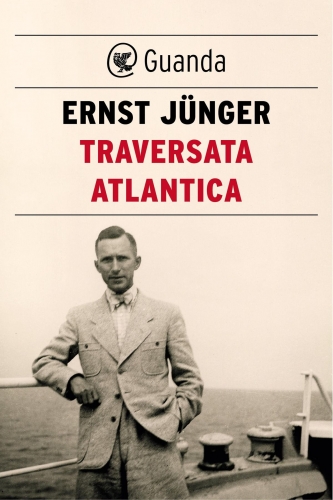
Mais il n'y a aucune trace de cela dans sa biographie. Pour l'instant, il n'y a que la haute mer et les îles, l'immensité de l'Atlantique et l'abri des atolls et des archipels, pour réitérer l'irréductible dualité qui constitue la quintessence littéraire - mais pas seulement - d'Ernst Jünger. L'océan, sous le charme duquel "notre être s'écoule et se dissout ; tout ce qui est rythmique en nous s'anime, résonances, battements, mélodies, le chant originel de la vie qui berce les âges". Son charme nous fait revenir vides, mais heureux comme après une nuit passée à danser". Les îles, en revanche, contiennent la promesse d'une joie "plus profonde que le calme, que la paix dans cet élément orageux déplacé des profondeurs". Même les étoiles sont des îles dans la mer de lumière de l'éther".
Les îles, la mer... Il est tard. Notre voyageur note ces mots en retournant dans son Europe, martelée par l'urgence de l'histoire, secouée par des vents qui vont bientôt révéler leur forme monstrueuse et titanesque. Les derniers mots du journal brésilien sont datés du 15 décembre 1936 :
"Je suis satisfait de ce voyage. Éole et tous les autres dieux ont été propices. Plus intense encore est le plaisir que j'y ai ressenti par rapport aux temps menaçants qui s'annoncent de plus en plus clairement, dont les flammes vacillent déjà à l'horizon".
Ces flammes qui finiront par embraser une civilisation entière, une civilisation dont Jünger choisira d'être le témoin, payant à la première personne, comme beaucoup d'autres, sa propre inactualité.
15:25 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, livre, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, révolution conservatrice, allemagne, atlantique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 16 septembre 2021
Ernst Jünger's Anarch figure in Eumeswil - discussion with Russell A. Berman
13:32 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, philosophie, anarque, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 18 juillet 2021
"Ernst Jünger et les fulgurances d'un contemplateur solitaire"

"Ernst Jünger et les fulgurances d'un contemplateur solitaire"
Un entretien avec Luca Siniscalco, éditeur chez Bietti du livre de Nicolaus Sombart "Ernst Jünger. Un dandy dans les tempêtes d'acier".
Propos recueillis par Michele De Feudis
Ex: https://www.barbadillo.it/98602-ernst-junger-e-le-folgorazioni-di-un-contemplatore-solitario/
Luca Siniscalco, vous qui êtes spécialiste de la tradition et de la littérature allemandes, comment est né l'essai de Nicolaus Sombart sur Ernst Jünger ?
"Le petit volume Ernst Jünger. Un dandy nelle tempeste d'acciaio (= "Ernst Jünger. Un dandy dans les tempêtes d'acier") traduit une brève mais importante contribution de Nicolaus Sombart parue sous le titre Der Dandy im Forsterhaus (littéralement, "Le dandy dans la maison du forestier") dans le journal allemand Der Tagesspiegel du 29 mars 1995.
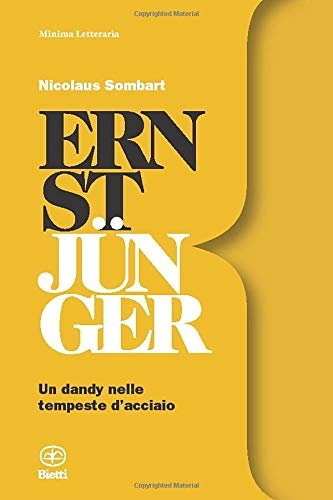
La version italienne que j'ai éditée, qui contient également une brève introduction au texte et une bibliographie essentielle de l'œuvre de Sombart, met à la disposition des lecteurs italiens une œuvre que l'auteur, qui s'est largement intéressé à la tradition révolutionnaire-conservatrice, quoique sous un angle essentiellement critique, tout au long de sa production d'essayiste, a conçue à l'occasion du centenaire d'Ernst Jünger (1895-1998) - et au moment même où Klett publiait le quatrième volume des journaux de Jünger intitulé Siebzig verweht.
Le texte de Sombart est donc une "mise au point" sur le Contemplateur solitaire, une esquisse "radiographique" d'un protagoniste fascinant et énigmatique du vingtième siècle, tout d'abord en raison de son caractère universel, au sein duquel toute définition possible est engloutie par sa fréquentation assidue des lieux "au mur du temps".
Pourquoi l'auteur définit-il Jünger comme la "conscience stylistique de l'Allemagne" ?
"Selon Sombart, Jünger est un auteur paradoxal - et pour cette raison même fécond - parce qu'il est déchiré par une dialectique interne entre l'identité allemande et le souffle "cosmopolite" international. Jünger est donc la "conscience stylistique de l'Allemagne", un "phénomène dans l'histoire de la littérature allemande", un "sismographe" (définition d'Ernst Niekisch, mais c'est Sombart lui-même qui la cite) de l'Allemagne moderne dans toutes ses transformations du 20ème siècle. "Plus que quiconque, il peut être décrit comme le chroniqueur d'un siècle d'histoire allemande - son siècle. Jünger est donc la forme, le type, l'archétype, le style - ça va sans dire au sens nietzschéen - de l'Allemagne. Dans le même temps, Jünger est toujours au-delà, épiant les domaines de cette superhistoire qui ne parle ni allemand, ni français, ni italien, ne connaissant que les silences de l'ineffable.

L'écriture de Sombart est intentionnellement consacrée à l'identification des tendances fondamentales de l'œuvre de Jüngler, qui se situe entre l'héritage allemand (lui-même le résultat de la conjonction de quatre idéaux-types, que Sombart considère, dans sa perspective d'adepte actuel des Lumières, avec une suspicion évidente: le militarisme aristocratique prussien, l'idéal de l'"Allemagne secrète", l'amour anti-moderne de la nature, le goût de l'insolite, qui se traduit par une passion pour la collection et le catalogage) et l'idéal "européen" et "international" du dandy. Sombart souligne que c'est le "dandysme" de Jünger qui apparaît comme son véritable trait dominant. C'est la quintessence d'une prise de pouvoir qui l'élève au-dessus du niveau du conteur allemand des bois et des prairies et qui fait de lui une superstar internationale. En cela, il surpasse ses rivaux Stefan George et Thomas Mann, qui, malgré tout leur talent, sont et restent des Allemands de province.
Quelle est la pertinence de la figure de l'écrivain allemand des Orages d'acier dans l'Allemagne d'aujourd'hui ?
Le succès, l'interprétation et " l'histoire des effets " de Jünger en Allemagne semblent comparables, pour autant que je sache, à son destin italien. Jünger est généralement connu comme un grand écrivain et un grand styliste - n'oublions pas qu'en 1982 il a remporté le prestigieux prix Goethe -, il a évoqué un petit cercle de "dévots" et d'enthousiastes, souvent liés à des cercles politiques conservateurs, pour les premiers, à des contextes de recherche académique (philosophique surtout) pour les seconds. Il reste un objet de suspicion au niveau de la vision anthropologico-politique et en vertu de son approche mythico-symbolique de la connaissance. Le destin d'un Anarque excentrique et inaccessible, que la modernité peine à métaboliser et préfère souvent marginaliser.
La Ernst und Friedrich Georg Jünger Gesellschaft, une association d'études dédiée aux frères Jünger, basée à Wilflingen, à laquelle j'ai le plaisir d'être associé, protège sa figure avec beaucoup de sérieux et de rigueur.
À l'heure du mondialisme, est-il possible de revenir à la vision de l'"État universel" développée par Jünger ?
"Ce n'est pas seulement possible, c'est nécessaire. C'est précisément parce que le statu quo exige des réponses capables de dépasser l'idée d'État-nation du 19ème siècle pour se tourner vers des perspectives continentales et futuristes que le texte de Jünger est plus que jamais d'actualité pour nous fournir des stimuli prospectifs.
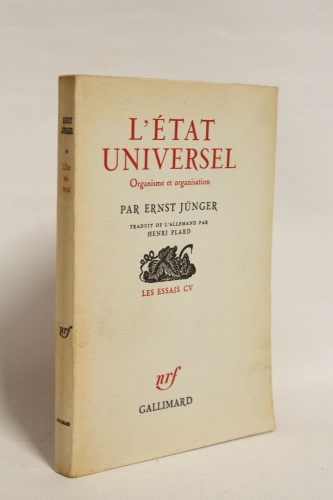
À première vue, l'enquête de Jünger sur l'État universel semble confirmer les espoirs des mondialistes. En fait, si l'on lit attentivement l'essai, il apparaît clairement que l'approche de l'auteur est avant tout phénoménologique, c'est-à-dire descriptive et non normative. Le fait que nous soyons destinés à évoluer vers un État mondial ne fait aucun doute pour tout analyste avisé. Les puissances titanesques et telluriques dont la technologie et le capitalisme sont l'épiphénomène historique vont dans ce sens. Ainsi, "l'état du monde n'est pas simplement un impératif de la raison, à réaliser par l'action conséquente d'une volonté. Si c'était le cas, si ce n'était qu'un postulat logique ou éthique, tout irait mal pour nous à l'avenir. C'est aussi quelque chose qui arrive. Dans l'ombre qu'elle projette devant elle, les anciennes images s'effacent. Jünger semble probablement avoir négligé la réapparition récente, à la fin du 20ème siècle, des racines ethnico-religieuses, du "choc des civilisations" sur lequel Huntington avait attiré l'attention. Et pourtant, si sa prophétie politique, qui rejoint d'une certaine manière l'idée de la "fin de l'histoire", semble, du moins dans le présent, loin de se réaliser, il est indiscutable que l'État mondial s'est réellement affirmé dans notre for intérieur, au sein d'un globalisme subtilement envahissant, qui, grâce à un solutionnisme technique et à la fourniture d'une anthropologie de nivellement des masses, conquiert les consciences plutôt que les territoires.
L'homme a la tâche d'affronter cette tendance avec une posture et un style dignes (mais pas nécessairement statiques). Jünger évoque, une fois de plus, le style de l'Anarque, qui, par son pouvoir de transfiguration, impose sa propre forme à la chaîne des événements. Même l'État mondial, selon la thèse de Jünger, peut devenir un nouveau Heimat si, pour citer l'introduction perspicace de Quirino Principe à cet essai, "l'individu, dans un monde dépourvu de formes symboliques, en produit de nouvelles, privilégiant la liberté à l'organisation et à l'ordre".
@barbadilloit
propos recueillis par Michele De Feudis
21:08 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, livre, nicolaus sombart, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 30 juin 2021
Le solitaire en période d'incertitude

Le solitaire en période d'incertitude
Ex : Association Minerva, https://grupominerva.com.ar/2021/06/
Par David Porcel Dieste
Je suis invité, ici, à écrire quelque chose sur Ernst Jünger (1895-1998) à l'occasion de l'anniversaire de sa mort. Si mon temps le permet, j'écrirai sur le Solitaire, car Jünger était, bien sûr, un Solitaire. À une époque comme la nôtre, où de plus en plus de personnes vivent connectées les unes aux autres, comme des constructions intersubjectives dans lesquelles l'inter est plus important que la subjectivité, parler du Solitaire peut sembler étrange, ou, du moins, étranger. Et ce, bien qu'une série d'écrivains chevronnés, tels que Peter Handke dans Essai sur le lieu tranquille (titre original : Versuch über den stillen Ort) ou le Japonais Seicho Matsumoto, l'aient déjà fait, et de quelle manière !
Solitaires étaient toutes ses Figures, qu'il a magistralement représentées dans chacun des moments du 20ième siècle dans lequel il a vécu. Solitaire est le Soldat inconnu qui, dans Orages d'acier (1920), incarne le sentiment d'aventure de celui qui fait de son expérience intérieure une expérience partagée. Indifférent aux couleurs et aux drapeaux, le soldat Jünger de la Première Guerre mondiale, armé de son fusil et de son ‘’journal thanatique’’, entame un nouveau rapport au danger qu'il n'abandonnera plus jamais: "Nous avions quitté les salles de classe des universités, les pupitres des écoles, les tableaux des ateliers, et en quelques semaines d'entraînement nous avions fusionné jusqu'à devenir un seul corps, grand et plein d'enthousiasme. Ayant grandi à l'ère de la sécurité, nous avons tous ressenti une envie de choses inhabituelles, de grands dangers. Et puis la guerre nous avait pris comme une ivresse. Nous étions partis pour le front sous une pluie de fleurs, dans une atmosphère enivrée de roses et de sang. C'est elle, la guerre, qui devait nous apporter cela, les choses grandes, fortes et splendides." [1].
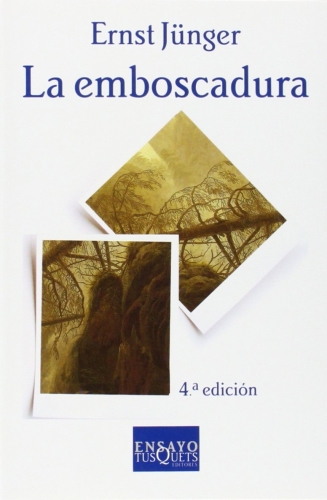
On a beaucoup réfléchi à l'eros et à ses formes, comme la polis et les théories politiques, l'art ou les typologies sociales, mais, par rapport à cela, on s'est peu intéressé au thanos et à ses fins, présents dans les figures du Soldat inconnu et de son héritier le Travailleur. Si tous deux sont mus par l'eros, ils incarnent également cette autre impulsion vers la destruction et le renouvellement. En effet, l'impératif de performance, que prend sur lui le "travailleur", héritier du soldat anonyme de la Première Guerre mondiale, est en même temps à l'origine de la construction et de la destruction, puisqu'il ne peut être construit que sur les ruines d'un passé suffisamment obsolète pour ne plus servir de fondement. Il convient de noter que Jünger n'est pas anti-Lumières, car il ne croit pas nécessaire d'affronter les Lumières; à ses yeux, il s'agit d'une autre tentative ratée de dompter le sauvage, de marquer le caché. C'est, redisons-le, un Solitaire, ou un Embisqué, comme il aimait à se définir, qui croyait au pouvoir des mythes.
Malgré le style combatif de son livre Le Travailleur (1932), avec sa mythologie de l'ouvrier, il n'avait pas l'intention de mobiliser ou de révolutionner les masses, comme on l'interprétait à son époque, mais de témoigner de l'entrée dans l'histoire d'une nouvelle force métaphysique qui se matérialiserait plus tard dans les grandes formations technologiques et politiques supranationales. Le travail est le rythme des poings, des pensées et du cœur ; le travail est la vie jour et nuit ; le travail est la science, l'amour, l'art, la foi, le culte, la guerre; le travail est la vibration de l'atome et le travail est la force qui fait bouger les étoiles et les systèmes solaires[2] - proclame Jünger pour souligner l'omniprésence de la figure du Travailleur. Car le "travail" est, pour l'Allemand, tout ce qui existe, organisé selon la loi du timbre et de l'empreinte [3], qui n'a rien à voir avec le principe moderne de causalité. La première inclut l'élémentaire ; qui, cependant, se rebelle contre la logique de cause à effet. Et parce qu'il inclut l'élémentaire, les cœurs énergiques et solitaires de ceux qui sont poussés à la mobilisation totale [4], que ce soit pour combattre sur les champs de bataille ou pour capituler dans les usines, sont aussi sous l'influence de cette force venue du fond primordial.
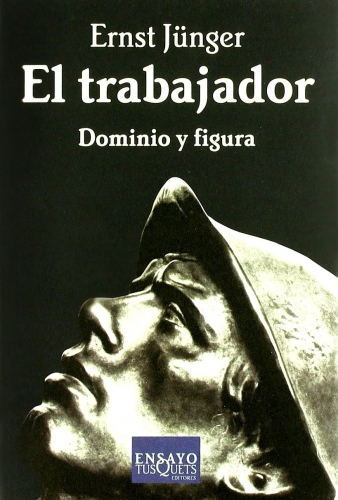
Mais Jünger voulait aussi se réfugier loin du monde des fonctions et de l'appel à la mobilisation. Et c'est dans ce but qu'il a inventé, au milieu du siècle dernier, son autre Figure - pendant du Travailleur - qu'il a lui-même représenté pratiquement jusqu'à la fin de sa vie, et qu'il a appelé le Rebelle (l’Emboscado en espagnol). Avec le titre Traité du Rebelle/Recours aux forêts (1951), Jünger écrit pour ceux qui résistent à être annihilés par le défaitisme et le fatalisme de l'époque. Écrit en pleine guerre froide, il dépeint les sentiments de ceux qui ne se laissent pas gagner par la peur et décident de résister activement au monde des diktats et de l'automatisme: "Nous appelons rebelle, en revanche, ceux qui, privés de leur patrie par le grand processus et transformés par lui en individu isolé, finissent par se livrer à l'anéantissement. Ce destin pourrait être celui de beaucoup et même de tous - il n'est donc pas possible de ne pas ajouter une précision. Et cela consiste en ceci : la personne rebelle est déterminée à offrir une résistance et a l'intention de poursuivre la lutte, une lutte qui n'a peut-être aucune perspective" [5].
La forêt n'est pas pour Jünger un lieu naturel concret de retraite, comme la Forêt Noire l'était pour Heidegger ou les cabanes de Thoreau, mais le résultat d'une confrontation avec le monde par laquelle un territoire vierge s'ouvre à l'homme singulier pour se retirer du nihilisme et de la destruction. La forêt est maison (Heim), patrie (Heimat), secret (heimlich), non seulement dans le sens où elle cache, mais aussi dans le sens où, en cachant, elle protège. La forêt est l'intemporel, et c'est là que se retirent les personnages d'après-guerre de Jünger. Et ils se laissent submerger, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un abri. Ils résistent aux forces du nihilisme par le seul esprit, se donnant à la tâche qui les sort d'eux-mêmes et les ramène à une Nature qui semblait les attendre depuis l'éternité: "Tandis que le crime fleurissait dans le pays comme la moisissure pousse dans la forêt pourrie, nous étions de plus en plus profondément absorbés par le mystère des fleurs, et leurs calices nous paraissaient plus grands et plus rayonnants que jamais. Mais nous avons surtout poursuivi nos études sur le langage, car dans le mot nous avons reconnu l'épée magique dont l'éclat fait pâlir le pouvoir des tyrans. La parole, l'esprit et la liberté sont trois aspects et une seule et même chose " [6].

La dernière de ses Figures, l'Anarque, présent dans ses romans dystopiques du dernier quart du siècle, notamment dans Eumeswil (1977), représente le dernier refuge à partir duquel initier un nouveau rapport au monde et aux autres. Si le Rebelle représente la résistance active et l'ardeur de la passion, l'anarque incarne la résistance passive et la passion froide. L'Anarque n'est pas l'anarchiste, ni même l'Unique de Stirner. L'anarchiste croit encore à la société, à la possibilité de faire une société meilleure; il en va de même pour l'Unique de Stirner, qui s'unit en vue de renverser les drapeaux et les ismes. L'Anarque, lui, ne croit ni ne reconnaît aucun régime, ni ne plonge dans des paradis perdus. Au contraire, il n'a pas de société. Il vit, disons-le, éloigné de tout, ce qui peut le rattacher à un monde assez inconstant pour se retourner contre soi-même. Mais c'est précisément dans cette retraite qu'il trouve la sécurité et la paix: "L'Anarque, par contre, connaît et évalue bien le monde dans lequel il se trouve et a la capacité de s'en retirer quand il en a envie. En chacun de nous, il y a un fond ‘’anarquique’’, une impulsion originelle vers ‘’l'anarquie’’. Mais dès notre naissance, cet élan est limité par notre père et notre mère, par la société et l'État. Ce sont des saignements inévitables dont souffre l'énergie originelle de l'individu et auxquels personne ne peut échapper"[7]
Avec le proverbe "Pour l'homme heureux, aucune horloge ne dit les heures", si souvent répété dans son œuvre [8], Jünger semble nous rappeler que nous ne pouvons pas retourner à notre première enfance, mais que nous pouvons la ramener à nous, en provoquant le monde d'une manière totalement nouvelle pour laquelle seuls les esprits solitaires sont préparés. L'aventurier d’Orages d'acier, l'amoureux d'Héliopolis ou le navigateur d'Approches partagent un vif désir d'accumuler de nouvelles expériences et de viser de nouveaux buts, puis de les partager avec ceux qui, comme eux, sont également mus par le désir de se nourrir de l'innommé. Car la tradition, semble nous dire Jünger, nous a incités à tort à nous saisir de la vie, en y voyant un flux qu'il faut réorienter ou un champ de possibilités susceptible d'être confiné dans le domaine ennuyeux du ‘’dû’’. La tradition nous a incités à faire de la vie un ethos et de la pensée une éthique. Mais l'innommé compte aussi, prévient Jünger. Même la vie peut devenir quelque chose de poreux, ouvert à ce qui est déjà là, le laissant entrer, jusqu'à ce qu'il ne puisse plus nous enseigner: "La douleur est une de ces clés avec lesquelles nous ouvrons les portes non seulement du plus intime, mais aussi du monde. Lorsque nous nous approchons des points où l'être humain se montre à la hauteur de la douleur ou supérieur à elle, nous accédons aux sources d'où découle sa puissance et au secret qui se cache derrière sa domination"[9].
(1) Tempestades de acero, Tusquets, Barcelone, 1987, p. 5.
(2) Le travailleur, Tusquets, Barcelone, 1993, p. 69, 70.
(3) "La loi qui, dans le domaine de la Figure, décide de l'ordre hiérarchique, n'est pas la loi de la cause et de l'effet, mais la loi, toute différente, du timbre et de l'empreinte; et nous verrons que, dans l'époque où nous entrons, nous devrons attribuer l'empreinte de l'espace, du temps et de l'être humain à une figure unique, la figure du Travailleur", Le Travailleur, p. 38
(4) Voir La movilización total, Tusquets, Barcelone, 1995.
(5) La emboscadura, Tusquets, Barcelone, 1993, p. 59, 60.
(6) Sobre los acantilados de mármol, Ediciones Destino, Barcelone, 1990, p. 92, 93.
(7) Los titanes venideros, Península, Barcelone, 1998, p. 56.
(8) Voir El libro del reloj de arena, Tusquets, Barcelone, 1998, p.13.
(9) Sobre el dolor, Tusquets, Barcelone, 1995, p. 13.
Tiré de : https://posmodernia.com/el-solitario-en-tiempos-de-incertidumbre/
18:12 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, lettres, littérature, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 15 juin 2021
Zweig et Bernanos : la vie sans passeport (sanitaire ou autre) avant 1914

Zweig et Bernanos : la vie sans passeport (sanitaire ou autre) avant 1914
par Nicolas Bonnal
Le cataclysme totalitaire qui nous tombe dessus a des précédents dans notre Europe si démocratique et lumineuse, qui a aura inventé toutes les monstruosités du monde moderne. A l’heure ou le passe sanitaire est imposé à tous, où les comptes des non vaccinés, et leur téléphone, et leur eau, et leur électricité sont en passe d’être coupés (1), il est bon de le rappeler.
On va reprendre deux de nos écrivains favoris qui sont frères d’âme, le « juif libéral » et pacifiste Stephan Zweig, ami de Romain Rolland, et le catholique monarchiste Georges Bernanos, qui il y a un siècle dénonçaient la montée de l’étatisme totalitaire en Occident. Les deux grands esprits à cette époque remarquent l’émergence de deux contraintes : le passeport et le visa… Nos lecteurs pourront retrouver aussi nos écrits sur Chesterton et son détestable voyage en Amérique dans les années vingt. Contrôle et obsession anticommuniste au programme.
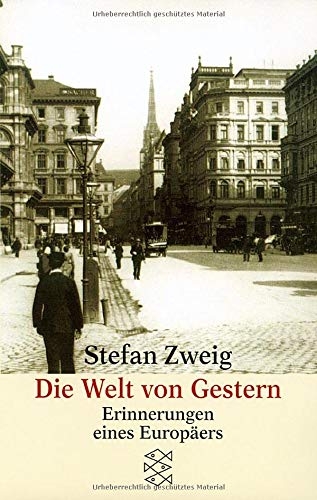 On commence par Zweig et son fastueux Monde d’hier (le plus grand livre du monde selon nous sur le vingtième siècle, ce siècle tué en 1914 et partiellement survivant dans les années vingt) :
On commence par Zweig et son fastueux Monde d’hier (le plus grand livre du monde selon nous sur le vingtième siècle, ce siècle tué en 1914 et partiellement survivant dans les années vingt) :
« La chute de l'Autriche a produit un changement dans ma vie privée que j'ai d'abord considéré tout insignifiant et purement formel : j'ai perdu mon passeport autrichien et j'ai dû demander aux autorités britanniques un document de substitution, un passeport apatride. Dans mes rêves cosmopolites, j'avais souvent imaginé dans mon cœur combien splendide et conforme à mes sentiments seraient de vivre sans État, de n'être obligé à aucun pays : et, par conséquent, appartiennent à tous sans distinction. Mais encore une fois, j'ai dû reconnaître à quel point le fantasme humain et dans quelle mesure nous ne comprenons pas les sensations les plus importantes jusqu'à ce que les ayons vécues nous-mêmes. »
Ce que nous allons vivre avec la dictature sanitaire de Macron-Schwab-Leyen nous allons bientôt le comprendre. Zweig poursuit :
« Tout consulat ou officier de police autrichien avait le droit ou l’obligation de me le prolonger en tant que citoyen à part entière. Au lieu de cela, le document pour étranger que les Anglais m'ont donné, j'ai dû le demander. C'était une faveur, mais une faveur qu’ils pouvaient me retirer à tout moment. Du jour au lendemain, il avait descendu un échelon de plus. Hier, il était encore un invité étranger et, en quelque sorte, un gentleman qui a passé ses revenus internationaux et payé ses impôts, et aujourd'hui j'étais devenu un émigré, un "réfugié". »
Préparez-vous, non-vaccinés, à ce statut de réfugié sur votre sol ; on est à 45% de vaccinés, attendez 51 puis 60% ; et arrêtez de dire que les chiffres sont truqués, de toute manière ils s’en moquent.
Zweig décrit l’entrée dans un monde pré-totalitaire en 1919 :
« En effet : rien ne démontre peut-être de façon plus palpable la terrible chute que le monde de la Première Guerre mondiale a connu comme limitation de la liberté de mouvement de l'homme et la réduction de son droit à la liberté. Avant 1914, la Terre appartenait à tout le monde. Tout le monde allait où il voulait et y restait aussi longtemps qu'il le voulait. Il n'y avait pas de permis ou autorisations; je m'amuse de la surprise des jeunes chaque fois que je leur dis qu'avant 1914 j'ai voyagé en Inde et en Amérique sans passeport et je n'en avais jamais vu de ma vie. »
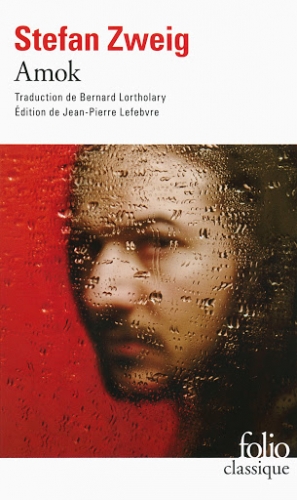 L’auteur d’Amok décrit ensuite ce monde d’avant la guerre mondiale éternelle voulue par les banquiers mondialistes :
L’auteur d’Amok décrit ensuite ce monde d’avant la guerre mondiale éternelle voulue par les banquiers mondialistes :
« Là les gens montaient et descendaient des trains et des bateaux sans demander ou être invités, ils n'avaient pas à remplir un seul des cent papiers qui sont requis aujourd'hui. Il n'y avait pas de sauf-conduits ou les visas ou l'un de ces tracas ; les mêmes frontières qu'aujourd'hui les douanes, la police et gendarmes se sont transformés en fil de fer barbelé, à cause de la méfiance pathologique de tous vis-à-vis de tous, ils ne représentaient que des lignes symboliques qui croisaient la même nonchalance que le méridien de Greenwich. »
La laisse électronique et même psychologique (désolé, il y a ou aura 80 ou 90% de volontaires extatiques) a perfectionné cette horreur. Zweig poursuit en n’oubliant pas les vaccins, conséquence du militarisme, des guerres et aussi cause partielle du génocide planifié et faussement nommé grippe espagnole :
« Toutes les humiliations qui avaient été autrefois inventés uniquement pour les criminels, ils étaient maintenant infligés à tous les voyageurs, avant et pendant le voyage. L'un devait être représenté de droite et de gauche, visage et profil, coupé ses cheveux pour qu'on puisse voir ses oreilles, laisser ses empreintes digitales, d'abord celles du pouce, puis ceux de tous les autres doigts ; De plus, il fallait présenter des certificats de toutes sortes : de santé, de vaccination et de bonne conduite, lettres de recommandation, invitations et adresses de parents, garanties morales et économiques, remplir des formulaires et signer trois ou quatre exemplaires, et si un seul de cette pile de papiers manquait, on était perdu. Cela ressemblait à des bagatelles, mais… »

Bernanos va utiliser le même mot : bagatelle. C’est le même en allemand. Zweig évoque ensuite notre avilissement qui en découle surnaturellement :
« Nous, les jeunes, avions rêvé d'un siècle de liberté, de l'âge futur du cosmopolitisme. Quelle part de notre production, de notre création et de notre la pensée s'est perdue à cause de ces singeries improductives qui avilissent en même temps l’âme! »
C’est dans le chapitre l’Agonie de la paix.
Voyons Bernanos, réfugié au Brésil comme Zweig, de six ans son cadet, et qui défendit la liberté comme personne, ce qui le rend peu lisible par les temps qui courent. Il fait les mêmes observations avec les mêmes mots que Zweig sur cette volonté médicale et donc pathologique de tout contrôler et de tout vérifier :
"Ce que vos ancêtres appelaient des libertés, vous l’appelez déjà des désordres, des fantaisies". « Pas de fantaisies ! disent les gens d’affaires et les fonctionnaires également soucieux d’aller vite, le règlement est le règlement, nous n’avons pas de temps à perdre pour des originaux qui prétendent ne pas faire comme tout le monde… », comme ne pas se vacciner par exemple. »
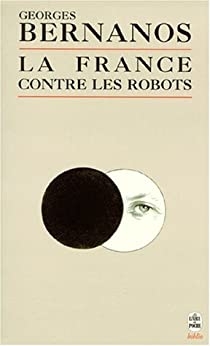 Après Bernanos évoque le passeport :
Après Bernanos évoque le passeport :
« Cela va vite, en effet, cher lecteur, cela va très vite. J’ai vécu à une époque où la formalité du passeport semblait abolie à jamais. N’importe quel honnête homme, pour se rendre d’Europe en Amérique, n’avait que la peine d’aller payer son passage à la Compagnie Transatlantique. Il pouvait faire le tour du monde avec une simple carte de visite dans son portefeuille. »
Oui, cela sonne un peu rustique et bucolique aux temps des commissaires politiques et sanitaires, pas vrai ? Puis on parle des empreintes digitales, autre bagatelle :
« Les philosophes du XVIIIe siècle protestaient avec indignation contre l’impôt sur le sel — la gabelle — qui leur paraissait immoral, le sel étant un don de la Nature au genre humain. Il y a vingt ans, le petit bourgeois français refusait de laisser prendre ses empreintes digitales, formalité jusqu’alors réservée aux forçats. Oh ! oui, je sais, vous vous dites que ce sont là des bagatelles. Mais en protestant contre ces bagatelles, le petit bourgeois engageait sans le savoir un héritage immense, toute une civilisation dont l’évanouissement progressif a passé presque inaperçu, parce que l’État Moderne, le Moloch Technique, en posant solidement les bases de sa future tyrannie, restait fidèle à l’ancien vocabulaire libéral, couvrait ou justifiait du vocabulaire libéral ses innombrables usurpations. »
Après on arrive au siècle des intellectuels qui comme les BHL ou Onfray vont tout justifier :
« Au petit bourgeois français refusant de laisser prendre ses empreintes digitales, l’intellectuel de profession, le parasite intellectuel, toujours complice du pouvoir, même quand il paraît le combattre, ripostait avec dédain que ce préjugé contre la Science risquait de mettre obstacle à une admirable réforme des méthodes d’identification, qu’on ne pouvait sacrifier le Progrès à la crainte ridicule de se salir les doigts. »
Et là comme Zweig, esprit peu religieux s’il en fut, Bernanos évoque l’avilissement de nos âmes :
« Erreur profonde ! Ce n’était pas ses doigts que le petit bourgeois français, l’immortel La Brige de Courteline, craignait de salir, c’était sa dignité, c’était son âme. »
Depuis ces temps nous n’avons fait que descendre. On va voir maintenant qui est prêt à payer pour la liberté.
Sources :
Bernanos – la France contre les robots (PDF sur le web)
Zweig – Le monde d’hier (LDP)
Nicolas Bonnal – Guénon, Bernanos et les gilets jaunes
09:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : stefan zweig, georges bernanos, littérature, lettres, lettres allemandes, lettres françaises, littérature allemande, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 28 mai 2021
Stefan Zweig et la grande uniformisation du monde

Stefan Zweig et la grande uniformisation du monde
par Nicolas Bonnal
« On aurait dit des grosses bêtes bien dociles, bien habituées à s’ennuyer. »
Le Voyage dans le passé.
La dictature sanitaire a renforcé la tendance lourde à l’extermination des nations, des cultures et des traditions. L’unification parfois folle et aberrante des politiques de santé au détriment de la santé des nations a bien renforcé ce « capitalisme totalitaire » (Bernanos) et anglo-saxon dont le but est le meurtre du monde par le lit social-impérialiste de Procuste de la mondialisation. Les persécutions et la dérive autoritaire des soi-disant démocraties occidentales et de l’Europe de la monstrueuse Van Der Leyen (descendante de nazis et d’esclavagistes tout de même, voyez Wikipédia) ne connaissent plus de limites et n’e connaitront plus, si nous n’y mettons un terme, d’une manière ou d’une autre.
Liquéfaction des nations, des sexes, des religions (avec la bonne volonté papiste c’est entendu) d’un côté, renforcement du terrorisme sanitaire et administratif de l’autre, le tout pour créer ce paradis infernal dont rêvent nos utopistes depuis des siècles (voyez le grand livre de Mattelart qui détaille bien la montée séculaire de cette utopie planétaire). L’alliance de la finance, du capital, des administrations et des médias sous contrôle rendent cette opération de magie noire apparemment imparable.

Cette dénonciation a souvent été l’apanage de gens de droite comme Céline ou Bernanos. Comme j’e l’ai montré c’est dans la Conclusion des mémoires d’outre-tombe que résonne le premier appel à la mobilisation politique et spirituel contre le monde moderne. Dans mon livre sur Céline j’ai établi un aparallèle entre les dénonciations souvent incomprises de Céline et les meilleurs chapitres du surprenant Loup des steppes de Hermann Hesse, qui lui aussi se déchaîne contre l’entrée en vigueur d’une civilisation basée sur la consommation, l’abrutissement et la massification ; j’ai nommé la civilisation américaine, pas la première qui a ses défauts et ses qualités comme toutes (qui va jeter la pierre à Poe, Melville, Frank Lloyd Wright ou Charles Ives ?) mais la deuxième celle de l’écrasement des identités de tout ordre, et qui réunit le monde sous la grand étendard (standardisation) de la consommation. C’est la révolution hollywoodienne si l’on veut, celle que célèbre Bernays dans un livre célèbre que j’ai maintes fois évoqué.
Elle apparait dans les années vingt et commence à gêner des gens plus à gauche, et même des « juifs cosmopolites » comme Stefan Zweig l’alors l’écrivain le plu dans le monde, et qui avant de devenir un nostalgique furieux (voyez l’admirable Monde d’hier) tente de dénoncer cette uniformisation/ américanisation du monde et de nous donner les moyens (toujours plus difficiles) d’y échapper.
C’est dans une dissertation que Zweig dénonce en 1926 cette entropie du monde moderne. Il voit deux choses : cette menace est américaine, et elle menace l’Europe, qui est encore le continent de la variété et des nations – aujourd’hui un conglomérat affairiste et russophobe. Zweig :
« Une impression tenace s’est imprimée dans mon esprit : une horreur devant la monotonie du monde…. Nous devenons les colonies de la vie américaine, de son mode de vie, les esclaves de la mécanisation de l’existence …»
Certes cette américanisation peut aussi enchanter les imbéciles ; mais Zweig voit dans cette américanisation une tendance lourde à la servitude volontaire. A la même époque Céline parle de ce troupeau américain de bêtes dociles, bien habituées à obéir. Un coup de woke et de Biden, de masque et de vaccin ?
Zweig : « Pour les âmes serviles tout asservissement parait doux et l’homme libre sait préserver sa liberté en tout lieu… Le vrai danger pour l’Europe me parait résider dans le spirituel. »
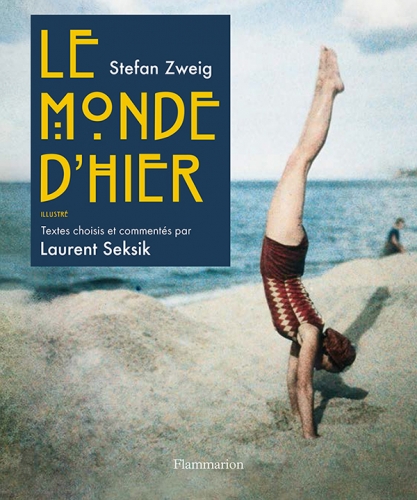
La Boétie parlé comme Chrysosotome des boissons, des tables et des spectacles pour abrutir les massés (voyez le passage sur les origines lydiennes du mot ludique) ; et Zweig de noter :
« La plupart des gens ne s’aperçoivent pas à quel point ils sont devenus des particules, des atomes d’une violence gigantesque. Ils se laissent ainsi entrainer par le courant qui les happe vers le vide ; comme le disait Tacite : « Ruere in servitium » ils se jettent dans l’esclavage ; cette passion pour l’auto-dissolution a détruit toutes les nations… »
La dissolution ici en Espagne comme en France (où l’on a pas besoin d déconsruire une histoire qui n’est plsu enseigéne depuis des décennies, pas vraie ?) de la nation est notoire. Et on ne parlera aps de ‘lAllemagne et du reste.
Zweig ajoute sur ce renforcement à la passivité (le masque étant un vêtement à la mode comme les autres maintenant) :
…Cette uniformité enivre par son gigantisme. C'est une ivresse, un stimulant pour les masses, mais toutes ces merveilles techniques nouvelles entretiennent en même temps une énorme désillusion pour l’âme et flattent dangereusement la passivité de l’individu. Ici aussi comme dans la danse, la mode et le cinéma, l’individu se soumet au même gout moutonnier, il ne choisit plus à partir de son maître intérieure mais en se rangeant à l’opinion de tous… Conséquences : la disparition de toute individualité, jusqu’à dans l’apparence extérieure. »
La conclusion de Zweig :
« Le fait que les gens portent tous les mêmes vêtements, que les femmes revêtent toutes la même robe et le même maquillage n'est pas sans danger : la monotonie doit nécessairement pénétrer à l’intérieur. Les visages finissent tous par se ressembler parce que soumis aux mêmes désirs… Une âme unique se crée, mue par le désir accru d’uniformité, et la mort de l‘individu en faveur d’un type générique».
Et à l'époque ou un serviteur de la Bête comme Bernays, encense ce monde de la manipulation et d’uniformisation, Zweig écrit : "Séparons-nous à l'intérieur mais pas à l'extérieur: portons les mêmes vêtements, adoptons le confort de la technologie, ne nous consumons pas dans une distanciation méprisante, dans une résistance stupide et impuissante au monde. Vivons tranquillement mais librement, intégrons nous silencieusement et discrètement dans le mécanisme extérieur de la société, mais vivons enfin en suivant notre seule inclination, celle qui nous est la plus personnelle et gardons notre propre rythme de vie...".

Zweig lutte contre l'empire (le monde moderne donc). Ce n'est pas un hasard s'il se rapproche d'une autre machine à niveler, l'empire romain, dont le résultat fut de rendre les hommes sots (voyez nos réflexions sur Hollywood et l'idiocratie) pour des siècles. Il rapproche donc notre écrivain de Sénèque qui note (Lettre à Lucilius, V): "Ayons des façons d'être meilleures que celles de la foule, et non par contraire (Id agamus ut meliorem vitam sequamur quam vulgus, non ut contrariam...)".
C’est que Sénèque aussi avait en tant que penseur fort à faire avec son empire…
On peut trouver le texte en bilingue de Zweig aux éditions Allia, pour une somme dérisoire.
18:44 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, stefan zweig, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 30 mars 2021
»Hans Fallada« Erik Lehnert und Götz Kubitschek im Livestream
00:49 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hans fallada, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 28 mars 2021
Au-delà du conservatisme, une nouvelle figure de l'homme (Ernst Jünger)
00:58 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, révolution conservatrice, philosophie, nationalisme révolutionnaire, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 mars 2021
Goethe et la dévitalisation des Européens

Goethe et la dévitalisation des Européens
par Nicolas Bonnal
Nous avons vu que Goethe pressent le grand déclin du monde dans ses Entretiens avec Eckermann. Concrètement nous allons rappeler qu’il pressent aussi le déclin physique hommes du continent, lié à son développement industriel. Bien avant Nietzsche ou Carrel, l’auteur de Werther, qui aspirait à un idéal classique européen, pressent cet affaissement. Et comme Rousseau, mais à sa manière, Goethe rejette le monde occidental et sa civilisation préfabriquée. Nous sommes en 1828 :
« Du reste, nous autres Européens, tout ce qui nous entoure est, plus ou moins, parfaitement mauvais ; toutes les relations sont beaucoup trop artificielles, trop compliquées ; notre nourriture, notre manière de vivre, tout est contre la vraie nature ; dans notre commerce social, il n’y a ni vraie affection, ni bienveillance. Tout le monde est plein de finesse, de politesse, mais personne n’a le courage d’être naïf, simple et sincère ; aussi un être honnête, dont la manière de penser et d’agir est conforme à la nature, se trouve dans une très-mauvaise situation. On souhaiterait souvent d’être né dans les îles de la mer du Sud, chez les hommes que l’on appelle sauvages, pour sentir un peu une fois la vraie nature humaine, sans arrière-goût de fausseté. »
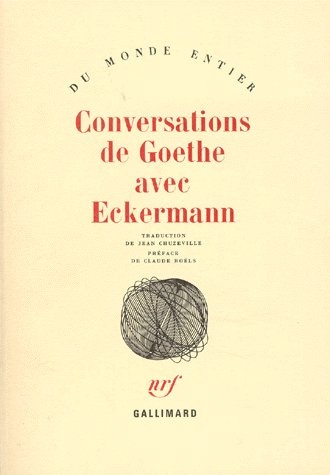 D’un coup le grand homme olympien se sent neurasthénique :
D’un coup le grand homme olympien se sent neurasthénique :
« Quand, dans un mauvais jour, on se pénètre bien de la misère de notre temps, il semble que le monde soit mûr pour le jugement dernier. Et le mal s’augmente de génération en génération ! Car ce n’est pas assez que nous ayons à souffrir des péchés de nos pères, nous léguons à nos descendants ceux que nous avons hérites, augmentés de ceux que nous avons ajoutés. »
Mais Eckermann tente de le rasséréner. On n’est qu’au début du dix-neuvième siècle, au sortir des meurtrières guerres napoléoniennes qui ont fait s’effondrer la taille du soldat français (quatre pouces, dira Madison Grant en reprenant les études de Vacher de Lapouge) :
« — J’ai souvent des pensées de ce genre dans l’esprit, dis-je, mais si je viens à voir passer à cheval un régiment de dragons allemands, en considérant la beauté et la force de ces jeunes gens, je me sens un peu consolé et je me dis : l’avenir de l’humanité n’est pas encore si menacé ! »
Car Schmitt dans son grand et beau texte sur le partisan souligne le fondement : il faut garder son caractère tellurique ; c’est en effet la clé pour tromper d’un ennemi surpuissant. A l’heure où nous sommes dévitalisés par les confinements et notre addiction à la technologie, cette leçon est de toute manière bien oubliée.
Goethe fait confiance bien sûr à la solide classe paysanne qui sera exterminée par les guerres mondiales, le communisme puis par la politique agricole commune européenne :
« — Notre population des campagnes, en effet, répondit Goethe, s’est toujours conservée vigoureuse, et il faut espérer que pendant longtemps encore elle sera en état non-seulement de nous fournir de solides cavaliers, mais aussi de nous préserver d’une chute et d’une décadence absolues. Elle est comme un dépôt où viennent sans cesse se refaire et se retremper les forces alanguies de l’humanité. Mais allez dans nos grandes villes, et vous aurez une autre impression. Causez avec un nouveau Diable boiteux, ou liez-vous avec un médecin ayant une clientèle considérable, il vous racontera tout bas des histoires qui vous feront tressaillir en vous montrant de quelles misères, de quelles infirmités souffrent la nature humaine et la société. »

Le coût encore du divin Napoléon ? Eckermann en parle :
Je me rappelle aussi avoir vu sous Napoléon un bataillon d’infanterie française qui était composé uniquement de Parisiens, et c’étaient tous des hommes si petits et si grêles qu’on ne concevait guère ce qu’on voulait faire avec eux à la guerre. »
« Les montagnards écossais du duc de Wellington devaient paraître d’autres héros, dit Goethe. »
« — Je les ai vus à Bruxelles un an avant la bataille de Waterloo. C’étaient en réalité de beaux hommes ! Tous forts, frais, vifs, comme si Dieu lui-même les avait créés les premiers de leur race. — Ils portaient tous leur tête avec tant d’aisance et de bonne humeur, et s’avançaient si légèrement avec leurs vigoureuses cuisses nues, qu’il semblait que pour eux il n’y avait pas eu de péché originel, et que leurs aïeux n’avaient jamais connu les infirmités. »
Tout de même cette époque – le début du dix-neuvième siècle donc - est encore féconde en beaux hommes (voir Custine époustouflé par les russes). Et Goethe se lance dans un beau développement sur le gentleman anglais façon Jane Austen qui alors fascine l’Europe et le monde. On se rappelle du somptueux Wellington de Bondartchuk dans le film Waterloo et on laisse Goethe parler :

« — C’est un fait singulier, dit Goethe. Cela tient-il à la race ou au sol, ou à la liberté de la constitution politique, ou à leur éducation saine, je ne sais, mais il y a dans les Anglais quelque chose que la plupart des autres hommes n’ont pas. Ici, à Weimar, nous n’en voyons qu’une très-petite fraction, et ce ne sont sans doute pas le moins du monde les meilleurs d’entre eux, et cependant comme ce sont tous de beaux hommes, et solides ! Quelque jeunes qu’ils arrivent ici en Allemagne, à dix-sept ans déjà, ils ne se sentent pas hors de chez eux et embarrassés en vivant à l’étranger ; au contraire, leur manière de se présenter et de se conduire dans la société est si remplie d’assurance et si aisée que l’on croirait qu’ils sont partout les maîtres et que le monde entier leur appartient. C’est bien là aussi ce qui plaît à nos femmes, et voilà pourquoi ils font tant de ravages dans le cœur de nos jeunes dames. »
Les âges d’or ou les grands moments n’ont qu’un temps. On ne comparera pas les massacrés des tranchées aux marcheurs de Moscou.
Sources :
Conversations avec Eckermann. 1828 (Wikisource.org).
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : goethe, allemagne, nicolas bonnal, 19ème siècle, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 10 mars 2021
Goethe et l’unité allemande

Goethe et l’unité allemande
par Nicolas Bonnal
Nous sommes en 1828. Nous sommes encore dans l’Allemagne paisible et cultivée, celle de la musique de cour et des universités, des châteaux et des jardins princiers, des poètes et des philosophes. Goethe discute avec Eckermann de la future unité allemande. Il la sent inévitable économiquement mais il la redoute culturellement.
Nota : sur cette question de la taille qui rompt les équilibres, surtout politiques, j’ai rappelé les écrits de Léopold Kohr, le chercheur autrichien qui avait inspiré Koyaanisqatsi et qui était l’auteur du Breakdown of nations. Je commencerai par Kohr par conséquent :
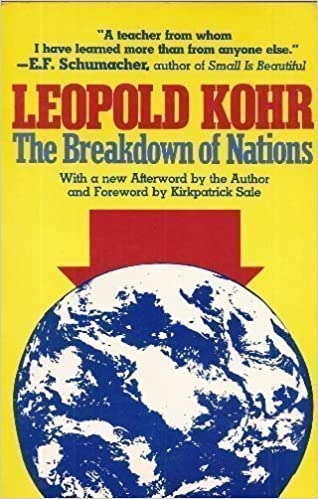 « Léopold Kohr est un peu comme René Girard. Son explication doit tout expliquer. Voici ce qu’il écrit au début de son ''effondrement des nations'' :
« Léopold Kohr est un peu comme René Girard. Son explication doit tout expliquer. Voici ce qu’il écrit au début de son ''effondrement des nations'' :
« Comme les physiciens de notre temps ont essayé d'élaborer une théorie unique, capable d'expliquer non seulement certains mais tous phénomènes de l'univers physique, j'ai essayé de développer une seule théorie à travers laquelle non seulement certains mais tous les phénomènes de l'univers social peuvent être réduits à un commun dénominateur. »
Et son secret, inspiré par une remarque de notre Jonathan Swift est le refus du bulk, de la masse, de la taille :
« Le résultat est une philosophie politique nouvelle et unifiée centrée autour de la taille. Elle suggère qu'il semble y avoir une seule cause derrière toutes les formes de misère sociale: la grandeur. Aussi simpliste que cela puisse paraître, nous trouverons l'idée plus facilement acceptable si nous considérons que la grandeur, ou sur-dimension, est vraiment beaucoup plus que juste un problème social. Elle semble être le seul et unique problème imprégnant toute la création. Où quelque chose ne va pas, c’est que quelque chose est trop gros. »
Un autre historien, le passionnant marxiste Eric Hobsbawn faisait remarquer la chute italienne sur le plan culturel après l’unification. Mais Bakounine l’avait déjà dénoncée en 1869, cette unification piémontaise et maçonne qui avait déçu tout son monde au bout de cinq ans, avec son inefficacité administrative et sa corruption politique, tout en ruinant le pays – dont le budget était quatre fois supérieur à celui de tous les états italiens avant l’unité. Citons-le :
« Sortie d’une révolution nationale victorieuse, rajeunie, triomphante, ayant d’ailleurs la fortune si rare de posséder un héros et un grand homme, Garibaldi et Mazzini, l’Italie, cette patrie de l’intelligence et de la beauté, devait, paraissait-il, surpasser en peu d’années toutes les autres nations en prospérité et en grandeur. Elle les a surpassées toutes en misère.
Moins de cinq années d’indépendance avaient suffi pour ruiner ses finances, pour plonger tout le pays dans une situation économique sans issue, pour tuer son industrie, son commerce, et, qui plus est, pour détruire dans la jeunesse bourgeoise cet esprit d’héroïque dévouement qui pendant plus de trente ans avait servi de levier puissant à Mazzini.

Le triomphe de la cause nationale, au lieu de tout raviver, avait écrasé tout. »
Ces prémisses établis je reviens à Goethe. Il souligne les dangers de cette course au gigantisme et au centralisme qui a coûté si cher à la France (voyez mon livre sur le coq hérétique) :
« Mais si l’on croit que l’unité de l’Allemagne consiste à en faire un seul énorme empire avec une seule grande capitale, si l’on pense que l’existence de cette grande capitale contribue au bien-être de la masse du peuple et au développement des grands talents, on est dans l’erreur. — On a comparé un État à un corps vivant, pourvu de membres nombreux ; la capitale, c’est le cœur, et du cœur coulent partout dans tous les membres la vie et le bien-être. C’est fort bien ; mais lorsque les membres sont éloignés du cœur, la vie qui s’en échappe y arrivera affaiblie et elle s’affaiblira toujours en s’éloignant. Un Français, homme d’esprit, Dupin, je crois, a dressé une carte du développement intellectuel de la France, et teinté en couleurs plus ou moins claires ou foncées les divers départements, d’après leur culture plus ou moins avancée ; on voit les départements du sud, éloignés de la capitale, teintés en noir foncé, signe de l’ignorance épaisse qui y règne. — Ce serait un bonheur pour la belle France si, au lieu d’un seul centre, elle en avait dix, tous répandant la lumière et la vie. »
Goethe qui dit que le propre de l’allemand c’est l’individualisme et la liberté (et comme il a raison !) souligne le caractère pluriel et décentralisé du génie allemand. L’Allemagne et son génie auront été les plus grandes victimes du passage à la modernité gigantesque.

Reprenons Eckermann, en rappelant que cette unité est inéluctable sur le plan administratif et économique (cf. « la doctrine de la fatalité » de l’ineffable Tocqueville) :
« Nous causâmes alors de l’unité de l’Allemagne, cherchant comment elle était possible et en quoi elle était désirable.
« Je ne crains pas que l’Allemagne n’arrive pas à son unité, dit Goethe ; nos bonnes routes et les chemins de fer qui se construiront feront leur œuvre. Mais, avant tout, qu’il y ait partout de l’affection réciproque, et qu’il y ait de l’union contre l’ennemi extérieur. Qu’elle soit une, en ce sens que le thaler et le silbergroschen aient dans tout l’empire la même valeur ; une, en ce sens que mon sac de voyage puisse traverser les trente-six États sans être ouvert ; une, en ce sens que le passeport donné aux bourgeois de Weimar par la ville ne soit pas à la frontière considéré par l’employé d’un grand État voisin comme nul, et comme l’égal d’un passeport étranger. »
Puis Goethe insiste sur notre point ; le génie allemand de cette époque est lié à son caractère pluriel et décentralisé :
« Où est la grandeur de l’Allemagne, sinon dans l’admirable culture du peuple, répandue également dans toutes les parties de l’empire ? Or, cette culture n’est-elle pas due à ces résidences princières partout dispersées ; de ces résidences part la lumière, par elles elle se répand partout. Si depuis des siècles nous n’avions en Allemagne que deux capitales, Vienne et Berlin, ou même une seule, je serais curieux de voir ce que serait la civilisation allemande, et ce que serait aussi le bien-être matériel, qui va de pair avec la civilisation morale. »
La grande culture est alors partout, grâce aux princes, évêques et mécènes :
« L’Allemagne a plus de vingt Universités, répandues dans tout l’empire, et plus de cent bibliothèques publiques. Elle a également un grand nombre de collections d’art et de collections d’objets de tous les règnes de la nature, car chaque prince a cherché à avoir près de lui de beaux échantillons en ce genre. Des collèges, des écoles pour les arts pratiques et pour l’industrie, il y en a en excès. Il n’y a guère en Allemagne de village qui n’ait son école. En France, où en est-on sous ce rapport ? Et cette quantité de théâtres allemands, au nombre de plus de soixante-dix, établissements qui ne sont pas du tout à dédaigner comme moyen de répandre et d’encourager dans le peuple une haute instruction ! — Le goût et la pratique de la musique et du chant ne sont dans aucun pays aussi répandus qu’en Allemagne, et c’est là encore quelque chose ! ».
A la place de la musique on aura les usines et les parades militaires. Goethe ajoute :
« Pensez à ces villes comme Dresde, Munich, Stuttgart, Cassel, Brunswick, Hanovre, et à leurs pareilles, pensez aux grands éléments de vie que ces villes portent en elles ; pensez à l’influence qu’elles exercent sur les provinces voisines et demandez-vous : Tout serait-il ainsi, si depuis longtemps elles n’étaient pas la résidence de princes souverains ? Francfort, Brème, Hambourg, Lubeck sont grandes et brillantes ; leur influence sur la prospérité de l’Allemagne est incalculable. Resteraient-elles ce qu’elles sont, si elles perdaient leur indépendance, et si elles étaient annexées à un grand empire allemand, et devenaient villes de province ? J’ai des raisons pour en douter. »
Sources principales :
Jeudi, 23 octobre 1828. Conversations de Goethe avec Eckermann, wikisource.org.
https://fr.wikisource.org/wiki/Conversations_de_Goethe/Ann%C3%A9e_1828
http://www.dedefensa.org/article/small-is-beautiful
https://fr.wikisource.org/wiki/Bakounine/%C5%92uvres/Tome...
https://www.lesechos.fr/2013/11/des-tontons-flingueurs-a-thomas-daquin-332339
10:34 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, goethe, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, 19ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




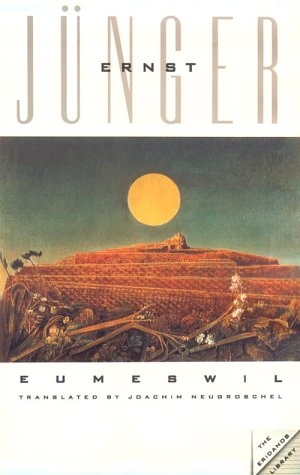


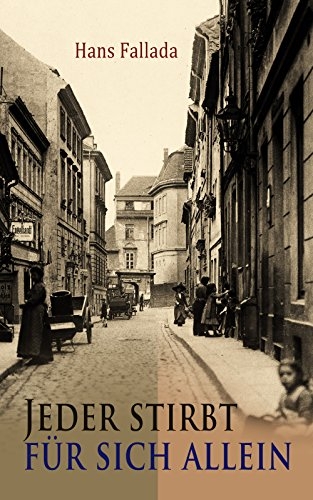

 Pour se procurer les livres de Robert Steuckers sur la Révolution Conservatrice :
Pour se procurer les livres de Robert Steuckers sur la Révolution Conservatrice :