vendredi, 26 mars 2021
Le souverainisme gallois, pas plus identitaire que sa version écossaise

Le souverainisme gallois, pas plus identitaire que sa version écossaise

En tant que tel, le projet de souveraineté est officiellement porté par le Plaid Cymru d’Adam Price, parti dont le programme n’est pas sans rappeler celui des socio-démocrates du Scottish National Party (SNP) ou du Parti québécois (PQ). À l’origine ce parti fondé en 1925 faisait de la défense des traditions et de l’ethnie galloises le point central de son programme, une démarche “volkish” qui le rapprocha idéologiquement d’autres mouvements anticonformistes de l’avant-guerre. Toutefois, il s’est converti dans les années 60 dans la défense d’une souveraineté civique vidée de tout substance. Le parti annonce d’entrée de jeu son adhésion au multi-culturalisme en faisant une profession de foi, qui, bien qu’historiquement pas tout à fait vraie, est sans ambiguïté : « L’idée du Pays de Galles comme une communauté de communautés, unies dans sa diversité, a toujours été au cœur de la mission du Plaid Cymru. » (LIEN).
Exactement comme c’est le cas dans cette constellation séparatiste qui comprend les Écossais, les Catalans, les Basques, les Québécois, les Bretons et tant d’autres.
Ce n’est pas nécessairement que ces peuples ont renié leurs racines ou ne tiennent pas à leur identité, mais plutôt que les élites indépendantistes rejettent toute forme de nationalisme pour adopter une approche mièvre dictée par la rectitude politique. La souveraineté peut donc avancer sans risque de se faire diaboliser. Mais le remède est parfois pire que le mal qu’on veut curer : en renonçant à définir le peuple qu’ont dit représenté, en le limitant à une expression purement géographique, on porte un projet vide. L’indépendance est un projet visant à permettre à un peuple, doté de caractéristiques qui lui sont propres, et non à un territoire, qui n’est sans le peuple qui l’habite qu’une parcelle de terre, au rang de nation souveraine.

Sans cette prise de conscience, tout rêve souverainiste reste un simple projet de bureaucrate qui espère éviter de dédoubler sa paperasse à deux administrations.
Mais il y aussi le terme souveraineté que ni le SNL, ni le PQ, ni même le Plaid ne définissent réellement. On fait l’impasse sur le « peuple » mais également sur la « souveraineté » comme telle. Car dans les faits, comme l’a fort bien souligné Pierre Hillard, ce que proposent souvent les souverainistes actuels c’est de simplement faire sauter l’administration nationale pour se placer directement sous tutelle des organismes internationaux. Sur ce point il n’a pas tout à fait tort : le SNL et le Plaid sont partisans d’une Union européenne forte et le Parti québécois n’envisage pas de se libérer de la tutelle mondialiste actuelle; il aimerait juste qu’un siège à l’OTAN, à l’ONU et au FMI soit marqué d’un fleurdelysée. La souveraineté en ce sens n’est qu’une déformation sémantique : on recherche dans les faits une gestion plus localisée du mondialisme.
Pour en revenir au Pays de Galles, il est peu probable qu’un référendum soit tenu sur la question à brève échéance. Lorsque la poussière retombera après la pandémie, la balloune indépendantiste risque de se dessouffler, à moins bien sûr que le Plaid ne redonne un moteur à sa cause en lui insufflant un sens profond.
00:21 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Terres d'Europe | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pays de galles, pays celtiques, plaid cymru, grande-bretagne, royaume-uni, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 18 avril 2020
Littératures et nationalités de combat

Littératures et nationalités de combat
Par Pieter Jan Verstraete
Jelle Krol, Frison de cœur et de tripes, collaborateur au « Tresoor », a passé récemment une thèse de doctorat, qui est remarquable, et sur laquelle je souhaite attirer l’attention de mes lecteurs. Le « Tresoor » à Leeuwarden, capitale de la Frise néerlandaise, est, dans une certaine mesure, l’équivalent de la Maison des Lettres AMVC en Flandre.
L’objectif premier de la thèse de Krol est de situer les littératures produites par les minorités ethno-linguistiques dans la période qui a immédiatement suivi la première guerre mondiale et qui ont été exprimées par des écrivains qui se posaient comme les dirigeants politiques de minorités linguistiques auxquels ils s’identifiaient. Il aborde des auteurs tels Douwe Kalma (1896-1953), Frison, Saunders Lewis (1893-1985), Gallois, Hugh MacDiarmid (1892-1978), Ecossais, et Roparz Hemon (1900-1978), Breton.
Avant-Garde
Pendant la première guerre mondiale, le Président américain Woodrow Wilson avait annoncé que des nations sans langue jusqu’alors officielle allaient recevoir l’autonomie. Après la guerre, la carte de l’Europe avait pris un tout autre aspect. Si on la compare à celle d’avant 1914, on constate que le nombre d’Etats souverains avait augmenté d’environ un tiers. Des langues qui, auparavant, n’avaient aucun statut, sont devenues en 1918, des langues d’Etat, comme notamment le Polonais et le Slovaque. L’Islande avait obtenu un plus grand degré d’indépendance et l’Irlande (moins l’Irlande du Nord) était devenue une république indépendante.
Conséquence du débat public sur l’auto-détermination des minorités ethno-nationales, les sentiments propres au nationalisme culturel se sont intensifiés pendant l’entre-deux-guerres. Ces sentiments se sont exprimés tant et si bien que de jeunes écrivains d’avant-garde, partout en Europe, surent capter l’attention des lecteurs et des auteurs de langues majoritaires pour les littératures des langues minoritaires et, par suite, de créer de la sorte un espace plus indépendant pour leur propre littérature. Ces écrivains d’avant-garde se percevaient comme les leaders d’une nouvelle vague, au seuil de temps nouveaux. En tant que disciple de la spécialiste française ès-littératures comparées, Pascale Casanova, Jelle Krol pose ces littératures des langues minoritaires comme des « littératures de combat ».
Avec acribie, Krol explore la vie et l’œuvre des quatre auteurs ethno-nationalistes mentionnés ci-dessus, sans perdre de vue le contexte politique, socio-économique et religieux de leurs régions respectives. Les auteurs sélectionnés par Krol sont des contemporains, tous nés dans la dernière décennie du 19ème siècle. Il les décrit comme des littérateurs de premier plan, qui ont vigoureusement stimulé l’usage de leurs langues (le frison, le gallois, le breton et l’écossais), en démontrant qu’elles pouvaient exprimer des valeurs intellectuelles et culturelles de haut niveau. On les comparera à nos flamingants d’avant la première guerre mondiale qui ont su prouver à leurs détracteurs que la langue néerlandaise était aussi une langue scientifique (notamment dans le cadre de la lutte pour faire ouvrir une université de langue néerlandaise).
L’idée de la Grande Frise
 Douwe Kalma opposait l’idée d’une Grande Frise à celle d’une Grande Néerlande, en exprimant de la sorte les liens, qu’il ressentait comme réels et charnels, entre les Frisons des Pays-Bas et ceux de Frise septentrionale et de Frise orientale qui vivaient sous les administrations allemande et danoise. Simultanément, il plaidait pour une Grande Frise qui aurait eu pour fonction de faire pont entre la Scandinavie et l’Angleterre, afin de lier des peuples qui, selon lui, étaient très proches depuis longtemps et qui présentaient certaines affinités mentales. Pour pouvoir donner forme à cette fonction de pont, la Frise, selon Kalma, devait réclamer une plus grande autonomie ; il fallait, pour cela, que ses compatriotes soient culturellement structurés.
Douwe Kalma opposait l’idée d’une Grande Frise à celle d’une Grande Néerlande, en exprimant de la sorte les liens, qu’il ressentait comme réels et charnels, entre les Frisons des Pays-Bas et ceux de Frise septentrionale et de Frise orientale qui vivaient sous les administrations allemande et danoise. Simultanément, il plaidait pour une Grande Frise qui aurait eu pour fonction de faire pont entre la Scandinavie et l’Angleterre, afin de lier des peuples qui, selon lui, étaient très proches depuis longtemps et qui présentaient certaines affinités mentales. Pour pouvoir donner forme à cette fonction de pont, la Frise, selon Kalma, devait réclamer une plus grande autonomie ; il fallait, pour cela, que ses compatriotes soient culturellement structurés.
Inspirés par la lutte pour l’indépendance irlandaise, Saunders Lewis et Hugh MacDiarmid insistaient sur la nécessité de promouvoir des changements politiques et des réformes culturelles, notamment au niveau de l’enseignement. En 1925, Lewis participe à la fondation du « Plaid Genedlaethol Cymru » (le Parti National du Pays de Galles) ; en 1928, MacDiarmid devint l’un des fondateurs du « National Party of Scotland ».

Saunders Lewis.

Hugh MacDiarmid.
Roparz Hemon, au contraire, pensait qu’une Bretagne plus autonome ne pourrait être concrétisée que si les Bretons se donnaient la peine de parler la langue bretonne, au-delà des cercles familiaux et religieux. Il croyait surtout que si la Bretagne devenait davantage bretonne sur les plans de la langue et de la culture, elle finirait par acquérir tout naturellement une plus large indépendance.
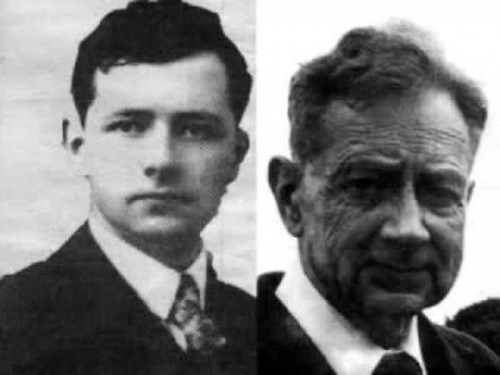
Roparz Hemon.
En langue anglaise
Chacun de ces quatre auteurs, dans sa propre sphère linguistique, s’est avéré comme critique radical, qui exigeait une plus ample reconnaissance de sa langue. En même temps, ils incitaient leurs collègues écrivains à créer une littérature de haut niveau dans leurs langues minoritaires. Leur attitude combattive pourrait s’expliquer par leurs sentiments meurtris qui les auraient conduits à une ferme détermination : celle de se consacrer entièrement à leur mission. Chez ces quatre hommes, la minimisation ou, parfois, le mépris à l’endroit de la langue de leurs parents et de leurs ancêtres, ont constitué, consciemment ou inconsciemment, l’élément moteur de leur engagement.
Ils se posaient comme des dirigeants appelés à parfaire une mission. Indépendamment les uns des autres, ces quatre écrivains ont formulé plus ou moins le même objectif : ils voulaient que l’on déplace le foyer nodal de la civilisation des centres du pouvoir vers les périphéries. Ils avaient tous quatre conscience que le chemin vers ce noble but serait parsemé d’embûches et de défis. Leurs langues étaient toutefois davantage associées à la tradition et à la simplicité plutôt qu’à l’innovation et à la modernité.
Finalement, ces quatre écrivains étaient tous convaincus que leur langue et leur culture pouvaient jouer un rôle significatif dans l’après-guerre de 1918, non seulement dans leurs environnement réduit mais aussi à un niveau plus vaste, sur le plan international. Ils ont réussi à donner plus de respectabilité à leur littérature. Ces quatre militants linguistes plaidaient aussi pour une large autonomie culturelle, pour le maintien de leur identité et pour une autonomie de leurs régions.
J’ai esquissé ici les lignes de force de la thèse du Dr. Jelle Krol. Cette thèse recèle toutefois un grand désavantage : elle est écrite en anglais (avec seulement un résumé en néerlandais à la fin). C’est devenu la règle dans les universités aux Pays-Bas.
Hélas, cette tendance à l’anglicisation devient aussi de plus en plus fréquente dans les universités flamandes. Je ne sais pas si cette thèse paraîtra un jour en néerlandais, en frison, en gallois, en écossais ou en breton. Quoi qu’il en soit, elle constitue un solide dossier, fourmillant de points de vue originaux, qui devraient intéresser nos lecteurs.
Pieter Jan Verstraete.
(ex : ‘t Pallieterke, 20 septembre 2018).
Jelle Krol, « Combative Minority Literature Writers in the Aftermath of the Great War », Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, 2018. 408 pages, ISBN-978-94-60016-51-6.

00:57 Publié dans Livre, Livre, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : frise, écosse, pays de galles, bretagne, pays celtiques, celtisme, culture celtique, livre, ethnisme, histoire, littérature, lettres |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 16 juin 2016
Hen Wlad Fy Nhadau Land of My Fathers Welsh National Anthem
Hen Wlad Fy Nhadau
Land of My Fathers
Welsh National Anthem
00:05 Publié dans Musique, Musique, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pays de galles, pays celtiques, hymnes nationaux, grande-bretagne, langue galloise, gallois |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 mai 2016
The Rise of the Celts and Britain’s Doom

The Rise of the Celts and Britain’s Doom
The main outcome of yesterday’s local elections in the UK does not concern the gains or losses of Labor or the Tories. The point is not even the first Muslim mayor of London, Sadyq Khan, although this is, of course, important. Nor is the point the modest gains of UKIP in England. The most crucial result was none other than the Welsh nationalist party, Plaid Cymru, coming in second place in Wales, a country which has long been a stronghold of the Labor Party. In tandem with the Scottish National Party’s majority in Scotland for the third time in a row, Plaid Cymru’s success is a sign of the ongoing identity crisis in the UK. Whiles these two Celtic parties support the independence of their lands from England, their rise presumes that a large part of the Welsh and Scottish peoples no longer wish to be associated with Great Britain. This has also been fueled by growing disenchantment with the rivaling Labor and Tory parties, and the search for new leaders outside of the existing political elite. UKIP’s rising popularity, on the other hand, is also an alternative, but one quite different from the Celtic “revanche.”
Plaid Cymru’s Left Continentalism
With each new election, Plaid Cymru confidently gains more votes. It is not difficult to predict that they soon might be the ruling party just as the Scottish National Party rallies a firm majority in Scotland. Then, the question of Wales’ self-determination will once again be relevant. In terms of domestic policy, Plaid Cymru advocates socialist economic and social policies, a progressivist cultural agenda, and promotes Welsh identity. The party pays significant attention to local Welsh problems, which is what has brought it close to ordinary people. In terms of foreign policy priorities, Plaid Cymru intends for Wales to leave the UK and seek independent membership in the EU. Plaid Cymru is also the only significant British party which firmly stands against independent Wales’ membership in NATO. Even the SNP abandoned this ideal in 2012. Thus, from a geopolitical point of view, the Welsh nationalist party can be describes as European-Continentalist.
The Battle of Dragons
The Welsh people are descendants of the native Britons, a Celtic people displaced on the outskirts of the island of Britain by the Anglo-Saxon invasion. The interactions, fights, and mergers between the Celtic and Germanic, Anglo-Saxon identities is what formed the historical uniqueness of Britain. The battle of the Red Dragon which is symbolic for the Celts against the White Dragon which symbolizes the Saxons as part of broader Arthuriana (an episode first described in the 8th century Historia Brittonum) has been enshrined in the historical identity of the Welsh people. Interestingly enough, according to a prophesy attributed to Merlin, the Red Dragon of Wales will ultimately defeat the English.

The fight between the red and white dragons: an illustration from a 15th-century manuscript of Geoffrey of Monmouth's History of the Kings of Britain.
A failed identity
Since the end of the Second World War and following the collapse of Britain’s colonial empire, the isles have witnessed an ongoing crisis of identity. Previously, the British identity was an imperial one closely linked with the famous imperative of “ruling the waves.” To be British meant building an empire, bearing the burden of the white man, and triumphantly conquering the world. From a geopolitical point of view, this was the adoption of the maritime mission as fate. Yet this identity disappeared almost overnight. The UK is no longer a global power like it used to be, and it has not been the center of empire for many decades already. But what is it supposed to be now? A simple European nation-state? Unlike France, Britain never embraced a homogenous, nationalist agenda as its state ideology. The pre-1789 ethnically diverse population of France was made “French”, while in Britain, even though the Irish and Welsh were repressed, these nations managed to maintain their identity and languages.
From Empire to monarchical federation
Insofar as it centered around the imperial mission, British identity was broad, heterogeneous, and embraced the English, Welsh, Scottish, and Irish origins of Britishness. It was thus constructed for imperial expansion. When this expansion ceased to be necessary, Britain was still too big and diverse to become a normal European nation-state. This structural change unleashed previously suppressed Scottish and Irish national identities, whose nationalist movements began to grow. The UK predictably began to evolve in the direction of a European style de-facto federation like Germany or Spain and granted more autonomy to all the major ethni, except the English one. Surprisingly, the English were forgotten. As the independent nations of Britain started to develop autonomy, the logical consequence of federalism on an ethnic basis, England was left out of this process.
The English devolution
As a result, the Irish, Scots, and Welsh have their own assembles and even parliaments, while the English people do not. The Westminster parliament is allegedly their representative organ, but it is also simultaneously supposed to represent the whole country. Unlike the other native ethnic groups, the English people have no independent voice since English identity is absorbed by the larger British one. Thus, the core people of the UK have become the most vulnerable to multicultural propaganda to the point that contemporary British identity mostly concerns one’s passport, rather than history or ethnic origin. The old British identity is being destroyed by hordes of migrants from the Third World, yet a new one is not emerging. As usual, any emphasis on “English identity” is portrayed as extremism. Unlike the Scottish and Welsh nationalists who are respected by the government and media, their English counterparts are labeled as mere fascists. Artificially suppressed English nationalism is thus prevented from manifesting itself in a healthy form, thus channeling the vital energy of those who are not absorbed by mere consumerism into the abyss.
The problem of England
On the other hand, the Celtic peoples of Britain perceive the rule of London as English rule. This assumption is historically true, but is now unfair. This perception will continue until England will develop its own governing institutions paralleling the general British ones. In addition, the presence of Scottish and Welsh deputies in the general English parliament as well as their own legislatures allows for these national minorities to effectively defend their rights, even often at the expense of England in their pushing of nationalist and even separatist agendas.
There have been and still are calls for a devolved English parliament. In 2014, this initiative was supported by 59% of Englishmen according to opinion polls. Theoretically, this would turn Britain into a federation of equilibrium, where the special status of the border regions would be balanced by the English voice. But this nationalism is built on the resistance by inertia of the weak, liberal Britishness, and thus bolsters the trend towards secessionism in other parts of the kingdom.
The two dragons fly in different directions
Besides this, the rise of any independent English voice (whose people are now the secret people of Chesterton who have “not spoken yet”) now will only aggravate the messy situation in the country because of the different views held by the peoples of the UK on the most crucial of matters today - Brexit.
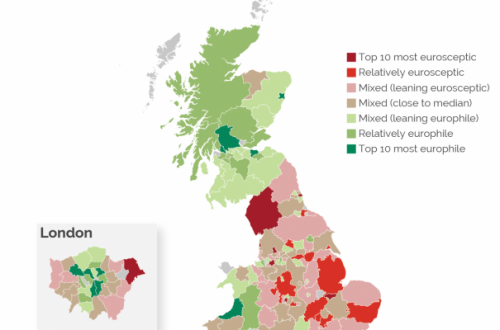
For example, while the Welsh and Scotts (and people of Northern Ireland as well) are pro-EU, most English are against the Union. If England were to have its own Parliament, it would be highly Eurosceptic with new radical parties gaining power as it was in Scotland and Wales in similar situations, and would thus enter into conflict with those of Wales and Scotland. This issue demonstrates that the peoples of the UK see their futures differently, thus aggravating the situation in the country. The economic benefits associated with membership in EU are themselves highly disputable, even in the cases of Wales and Scotland.
Thus, support for the EU is a deliberately political choice on their parts. And this is the main cause for concern. If it were otherwise, separatist parties would not have received such support. Overall, we are dealing with:
1. The rule of liberal, multicultural ideology which blurs the common British identity
2. The rise of new Celtic nationalisms
3. A vague new English nationalism as a response to the above-mentioned trends
4. Diametrically different approaches among the English and British Celts to the country's future.
These internal problems can ruin Britain any moment, even quicker than the growth of the Muslim population.
17:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grande-bretafgne, royaume-uni, pays de galles, écosse, angleterre, iles britanniques, europe, affaires européennes, politique, politique internationale, élections britanniques, pays celtiques, celtisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 mars 2015
Keltischer Patriotismus

Keltischer Patriotismus
von Niels Krautz
Ex: http://www.blauenarzisse.de
Die Schotten sorgten 2014 mit einer Unabhängigkeitsabstimmung für weltweites Aufsehen. Doch auch in Wales, der Bretagne und sogar im kleinen Cornwall gibt es freiheitsliebende Kelten.
Die im vergangenen Jahr angefachte Diskussion und die folgende Abstimmung über Schottlands Unabhängigkeit zeigen: Eine langfristige Spaltung des Vereinigten Königreiches Großbritannien ist unausweichlich.
Denn viele Menschen in den von England okkupierten Ländern sehnen sich nach mehr Freiheit und vollständiger Souveränität. Sie fürchten sich davor, ihre Identität und ihre Bräuche zu verlieren. Und sie erkennen, dass ihr Land regelrecht ausgeblutet wird. Das geschieht durch eine Politikerkaste, die weit entfernt im britischen Parlament in London Westminster sitzt.
1000 Jahre in Unfreiheit
Seit dem Jahr 1066, als französische Normannen die britischen Inseln eroberten, befinden sich die Völker der Iren, Waliser, Schotten sowie andere keltische Stämme in Unfreiheit. Wales, das seit dem Jahre 1284 und dem damaligen Statut von Rhuddlan unter englischer Herrschaft steht, wurde zwangsweise mit dem „Act of Union“ 1536 an das englische Königreich angegliedert. Schottland folgte mit dem Act of Union 1707 und Irland im Jahre 1800. Nur Irland konnte bisher seine Souveränität vom Vereinigten Königreich Anfang des 20. Jahrhunderts halbwegs zurückgewinnen. Doch es wurde geteilt: Die sechs Grafschaften der nordirischen Provinz Ulster verblieben in englischer Hand.
Aufgrund unterschiedlichster Probleme und des wachsenden Nationalstolzes haben sich in den betroffenen Ländern patriotische Parteien und Gruppierungen gebildet. Sie wollen die vollständige Unabhängigkeit erlangen. In Schottland, dem „William-Wallace-Land“, rief die Scottish National Party (SNP) im letzten Jahr zu einem Referendum auf, das über den Verbleib Schottlands im Vereinigten Königreich entscheiden sollte. Damit scheiterte sie nur knapp, rund 45 Prozent stimmten für die Unabhängigkeit. Die „Plaid Cymru“, die „Walisische Partei“, fordert schon seit vielen Jahren die Unabhängigkeit ihres Heimatlandes von England. Eine Umfrage von 2007 aus Nordwales zeigte, dass etwa 50 Prozent der dortigen Bevölkerung für die Unabhängigkeit sind. Seit dem schottischen Referendum ist die Tendenz steigend.
Jeder fünfte Bretone für Unabhängigkeit
 Republikanische Parteien Irlands, wie etwa die „Sinn Fein“, können auf eine lange Geschichte des Kampfes um Unabhängigkeit zurückblicken. Seit dem Jahr 1905 tritt sie als Partei auf und fordert die vollständige, ungeteilte Souveränität ihres irischen Heimatlandes. Ins Deutsche übersetzt bedeutet „Sinn Fein“ nichts anderes als „Wir selbst“. Und selbst im kleinen Cornwall, im äußersten Südwesten Britanniens, verlangt man nunmehr „Devolution“ – also die Übertragung zusätzlicher Macht. Lord Alwyn aus Cornwall fand dazu einst passende Worte im britischen Oberhaus: „Nicht bloß in Wales – auch in Cornwall wächst das Bewußtsein, wie vernachlässigt das Land von London wird. Auch in Cornwall leben Kelten, und keine Engländer.“
Republikanische Parteien Irlands, wie etwa die „Sinn Fein“, können auf eine lange Geschichte des Kampfes um Unabhängigkeit zurückblicken. Seit dem Jahr 1905 tritt sie als Partei auf und fordert die vollständige, ungeteilte Souveränität ihres irischen Heimatlandes. Ins Deutsche übersetzt bedeutet „Sinn Fein“ nichts anderes als „Wir selbst“. Und selbst im kleinen Cornwall, im äußersten Südwesten Britanniens, verlangt man nunmehr „Devolution“ – also die Übertragung zusätzlicher Macht. Lord Alwyn aus Cornwall fand dazu einst passende Worte im britischen Oberhaus: „Nicht bloß in Wales – auch in Cornwall wächst das Bewußtsein, wie vernachlässigt das Land von London wird. Auch in Cornwall leben Kelten, und keine Engländer.“
Doch dieser neu entflammte keltische Patriotismus ist nicht nur ein britisches Phänomen. Auch in Westfrankreich lodert das Feuer der Unabhängigkeit. Fast jeder fünfte Bretone sprach sich 2013 in einer repräsentativen Umfrage für die vollständige Unabhängigkeit von Frankreich aus. Am Ostersamstag 2014 demonstrierten in Nantes bis zu 15.000 Bretonen für die Unabhängigkeit.
Die wohl bekannteste aller Unabhängigkeitsbewegungen in Großbritannien bleibt die „Irish Republican Army“ (IRA). Es handelt sich dabei um eine paramilitärische Einheit, die den Anschluss Nordirlands an die Irische Republik mit Waffengewalt erzwingen wollte. Sie ging 1919 aus den „Irish Volunteers“ hervor, die den Osteraufstand 1916 auslösten. Die IRA unterstand der damals ausgerufenen Republik Irland als legitime irisch-republikanische Armee. Von da an führte sie den irischen Unabhängigkeitskrieg gegen die englische Herrschaft.
Irische Unterstützung aus Amerika
Bekannt wurde sie durch die sogenannte „Border Campaign“ von 1956 bis ’62, eine Anschlagsserie, die sich an der Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland abspielte. Die IRA erhielt seit ihrer Gründung finanzielle und materielle Unterstützung von in Amerika lebenden Iren, den sogenannten „Feniern“. Der Begriff kommt vom irischen „Fianna“, einem sagenumwobenen Heerhaufen des mythischen keltischen Heerführers Fiann Mac Cumhaill. Die modernen Fenier gründeten sich als Untergrundorganisation in Amerika 1859. Sie erlangten Aufmerksamkeit, als sie englische Forts in Kanada angriffen um die dortigen Truppen zu binden und damit den bewaffneten Widerstand in Irland zu unterstützen.
Auch heute noch existiert die IRA. Doch in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts gab es etliche Spaltungen und Zerwürfnisse der verschiedenen republikanischen Gruppierungen. 2012 erfolgte ein erneuter Zusammenschluss: Diese neue Army hat schätzungsweise über 600 Mann unter Waffen und zählt als terroristische Vereinigung.
Englands protestantischer Kampf
In den Geschichtsbüchern wird bis heute von einem Bürgerkrieg gesprochen, der zwischen irischen Katholiken und Protestanten stattfand. Doch das ist falsch. Es gibt keinen Bürgerkrieg zwischen den Iren, es gibt einen Befreiungskrieg Irlands gegen die englische Besatzung. Denn England hat seit der Besetzung Irlands die irische Bevölkerung mit Waffengewalt und gesellschaftlichen Repressalien unterdrückt. Der Großteil aller Kämpfe rund um den Nordirlandkonflikt waren Straßenschlachten der IRA gegen die englischen Besatzer oder von England provozierte ethno-kulturelle Konflikte. Denn seit 1600 siedelte England ausschließlich walisische, schottische und englische Menschen im Nordosten Irlands an, um gegen die Iren eine protestantische Hausmacht zu bilden.
 Auch in Wales gab es kleinere Gruppen nationalistischer Separatisten. Zum einen existierte die „Free Wales Army“, die aus nur 20 Mann bestand. Zum anderen gab es die „Mudiad Amddiffyn Cymru“, die „Bewegung zur Verteidigung Wales“. Sie erlange 1969 Aufmerksamkeit, als sie im Vorfeld der Investitur von Prinz Charles an verschiedenen Orten in Wales Bomben explodieren ließen. In der Bretagne existiert ebenfalls eine Unabhängigkeitsfront mit Namen „Bretonische Revolutionäre Armee“. Sie verübte zwischen den Jahren 1993 und 2000 17 Anschläge, unter anderem 1978 auf das Schloss Versailles. Als politischer Arm wird die linksnationalistische, bretonische Partei „Emgann“ angesehen.
Auch in Wales gab es kleinere Gruppen nationalistischer Separatisten. Zum einen existierte die „Free Wales Army“, die aus nur 20 Mann bestand. Zum anderen gab es die „Mudiad Amddiffyn Cymru“, die „Bewegung zur Verteidigung Wales“. Sie erlange 1969 Aufmerksamkeit, als sie im Vorfeld der Investitur von Prinz Charles an verschiedenen Orten in Wales Bomben explodieren ließen. In der Bretagne existiert ebenfalls eine Unabhängigkeitsfront mit Namen „Bretonische Revolutionäre Armee“. Sie verübte zwischen den Jahren 1993 und 2000 17 Anschläge, unter anderem 1978 auf das Schloss Versailles. Als politischer Arm wird die linksnationalistische, bretonische Partei „Emgann“ angesehen.
Nationalismus von Links
Was lehrt uns dieser Unabhängigkeitskampf? Die politische Richtung ist nicht ausschlaggebend dafür, ob man seine Heimat, seine Kultur und sein Erbe liebt. Denn Parteien wie die SNP und die walisische Plaid Cymru sind eher im linksliberalen Lager beheimatet. Sie wollen sich, sofern die Unabhängigkeit gelingt, dem nächsten System unterordnen – der Europäischen Union. Die bretonische Unabhängigkeitsbewegung Emgann wird von ihren Mitgliedern als kommunistisch bezeichnet. Auch die irische Sinn Fein gilt als sozialdemokratisch, doch sie hat eine kritische Haltung gegenüber der EU. Selbst die IRA hatte sich in den späten 1960er Jahren zum Teil dem Marxismus zugewandt.
Nationalstolz muss also nicht nur von rechts kommen: Gerade der sogenannte Linksnationalismus hat in den keltischen Ländern, die überwiegend landwirtschaftlich und industriell geprägt sind, einen hohen Stellenwert. Wir dürfen gespannt sein, ob der Geist des schottischen Freiheitskämpfers William Wallace weiterhin über die britischen Inseln weht – und den Funken der Unabhängigkeit in den Herzen weiter brennen lässt.
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Terres d'Europe, Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nationalisme, pays celtiques, celtisme, irlande, bretagne, écosse, pays de galles, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 17 février 2015
Redécouvertes des Europe chevelues

Jean Ansar
Ex: http://metamag.fr
Les légendes sont des mensonges qui nous parlent de vérités. Et les forêts des dieux anciens témoignent de la vivacité d’un continent peuplé de divinités variées au cœur de forêts aujourd’hui englouties et redécouvertes.
Dans la baie de Cardigan, sur la côte ouest du pays de Galles, les rafales de vent à répétition ont déplacé des milliers de tonnes de sables sur les plages, découvrant des dizaines de souches d'arbres vieilles de plusieurs milliers d'années. Il s'agirait, rapportent le Guardian et le Daily Mail, de la forêt préhistorique de Borth, où s'enracine la légende de "l'Atlantide galloise", le royaume englouti de Cantre'r Gwaelod, submergé après qu'une fée l'a délaissé.
 Les arbres seraient morts il y a plus de 4500 ans, au moment de la montée des eaux, mais auraient été préservés grâce à la constitution d'une couche de tourbe très alcaline où, privées d'oxygènes, les petites bêtes qui se chargent normalement de décomposer les arbres morts n'ont pas survécu, et donc pas pu faire disparaître ces souches. Le mythe, comme tant d'autres, est peut-être un souvenir collectif populaire laissé par la montée graduelle du niveau de la mer à la fin de la période glaciaire ; sa structure est comparable à la mythologie du Déluge comme tant d'autres que l'on retrouve dans pratiquement tous les cultures anciennes. Les restes d'une forêt ancienne engloutie à Borth, et à Sarn Badrig, près de la, peuvent avoir suggéré qu'une grande tragédie pouvait avoir emporté une ville qui se trouvait la autrefois. Il n'y a pas encore d'évidence physique solide qu'une ville substantielle existait sous la mer dans cette région.
Les arbres seraient morts il y a plus de 4500 ans, au moment de la montée des eaux, mais auraient été préservés grâce à la constitution d'une couche de tourbe très alcaline où, privées d'oxygènes, les petites bêtes qui se chargent normalement de décomposer les arbres morts n'ont pas survécu, et donc pas pu faire disparaître ces souches. Le mythe, comme tant d'autres, est peut-être un souvenir collectif populaire laissé par la montée graduelle du niveau de la mer à la fin de la période glaciaire ; sa structure est comparable à la mythologie du Déluge comme tant d'autres que l'on retrouve dans pratiquement tous les cultures anciennes. Les restes d'une forêt ancienne engloutie à Borth, et à Sarn Badrig, près de la, peuvent avoir suggéré qu'une grande tragédie pouvait avoir emporté une ville qui se trouvait la autrefois. Il n'y a pas encore d'évidence physique solide qu'une ville substantielle existait sous la mer dans cette région.
Plus récemment encore, l’'océanographe Dawn Watson a fait de son coté une découverte des plus étonnantes : une forêt entièrement immergée dans la Manche, qui a été engloutie lors de la dernière fonte des glaces il y a environ 6000 ans. Avant d'être un fond marin, cette terre abritait un des terrains de chasse et de pêche les plus riches de toute l'Europe. Le niveau de la mer était alors plus bas d'une centaine de mètres par rapport à celui d'aujourd'hui. «J'ai d'abord pensé que c'étaient des morceaux d'épaves», a déclaré Dawn Watson au journaliste de la BBC qui l'a interviewée. En réalité, il s'agissait de troncs d'arbre entièrement recouverts d'algues. D'après la scientifique, la tempête de 2013 ayant sévi près des côtes de Norfolk aurait permis la découverte de ces vestiges vieux de milliers d'années. C'est en plongeant au large de la côte du comté de Norfolk (Grande-Bretagne) dans la Mer du Nord, à quelques 200 kilomètres au nord-est de Londres, que l'océanographe britannique Dawn Watson a découvert une forêt préhistorique engloutie sous les eaux, s'étendant sur plusieurs milliers d'hectares.
Datée à environ 10000 ans, cette forêt était située sur une ancienne terre émergée connue des géologues sous le nom de Doggerland, qui reliait l'actuelle Grande-Bretagne au continent européen à l'époque des glaciations du quaternaire. Il faut savoir en effet que lors du dernier maximum glaciaire il y a un peu plus de 20000 ans, le niveau de la mer était plus bas qu'à l'époque actuelle, d'une centaine de mètres environ, ce qui faisait émerger une partie de la mer du Nord.

Et c'est avec la fin de la dernière glaciation que l'eau a commencé à monter, pour atteindre son niveau actuel il y a 6000 ans environ. Résultat : l'étendue émergée du Doggerland, dont on pense qu'elle était autrefois fréquentée par les chasseurs-cueilleurs du Mésolithique (-10000 à -5000 ans avant notre ère, en Europe), a été engloutie sous les eaux. Et avec elle... la forêt découverte par l'océanographe Dawn Watson.
Selon Dawn Watson, cette forêt aurait été rendue visible à cause d'une forte tempête ayant touché la côte du comté de Norfolk, en décembre 2013. Il y a encore beaucoup à découvrir sur notre plus ancienne mémoire et l’origine des peuples des forets et des mers.
00:05 Publié dans archéologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : archéologie, grande-bretagne, manche, mer du nord, pays de galles, baie de cardigan, doggerland, préhistoire, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 août 2013
De l’étude des racines celtiques au projet politique pan-celtique de la République d’Irlande
Robert Steuckers:
De l’étude des racines celtiques au projet politique pan-celtique de la République d’Irlande
Conférence prononcée au Château Coloma, Sint-Pieters-Leeuw, le 2 mars 2013.
Prologue:
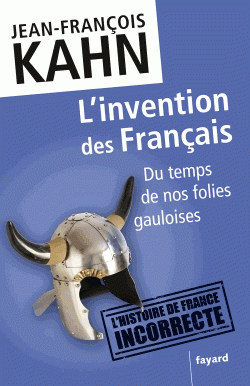 Quelle surprise, la veille de notre rendez-vous annuel en ce château, de découvrir à l’étal des librairies un ouvrage sur le thème de notre colloque d’aujourd’hui, les Celtes et le celtisme. Il est de la plume du célèbre Jean-François Kahn, directeur de l’hebdomadaire “Marianne”, du moins de sa version française, puisqu’il existe désormais une version belge qui ne me semble pas avoir le tonus de sa consoeur parisienne, si bien que je ne parie guère sur sa survie. Jean-François Kahn ne semble pas homme, a priori, qui encombre ses réflexions d’un souci permanent des racines celtiques ou gauloises de la France actuelle: ses sujets de prédilection sont à l’évidence les problèmes sociaux, les dysfonctionnements politiques qui affectent son pays. Dans la littérature géopolitique et dans certains atlas historiques, cet “Hexagone” est désormais qualifié d’ “espace gallique”, recouvrant ainsi l’acception de “Francie occidentale” lors du partage de Verdun en 843. Le reste, soit la part de l’Hexagone qui n’est pas “gallique”, est inclu dans un “espace germanique et lotharingien” par les auteurs d’un précieux “Atlas des peuples d’Europe occidentale”, soit Jean et André Sellier (La Découverte, Paris, 1995-2006). L’espace “germanique et lotharingien” étant, pour J. et A. Sellier, l’addition des héritages de Lothaire et de Louis le Germanique (la “Francie orientale”) en 843. Dans son livre “L’invention des Français – Du temps de nos folies gauloises” (Fayard, Paris, 2013), Jean-François Kahn se penche sur ce qui s’est passé sur le territoire aujourd’hui “français” (y compris la part lotharingienne —et burgonde— absorbée et dénaturée) entre 600 av. J. C. (date présumée de l’arrivée massive de tribus celtiques) et 500 après J. C., quand les Francs, venus de nos régions, prennent le relais des Romains moribonds ou disparus. Ces onze siècles, pour Kahn, sont le véritable creuset où s’est formée la “nation française”, en dépit des apports romains et germaniques, campés comme des adstrats sans réelle importance. Ce creuset est celui d’un “invraisemblable capharnaüm de bandes et de hordes, de cités et de nations”, d’où sortira, en bout de course, “un étrange mille-pattes à mille têtes qu’on appellera les Français”. Kahn privilégie évidemment l’idée d’un creuset où se mêlent toutes sortes d’ingrédients hétérogènes au détriment de toutes les homogénéités qui se sont juxtaposées dans les espaces gallique, lotharingien et burgonde. Kahn tente de retracer les épisodes qualifiables d’anarchisants et de libertaires dans ces onze siècles quasi inconnus de nos contemporains, en manifestant sa sympathie pour ce magma tissé de turbulences, rétif à tout ordre politique.
Quelle surprise, la veille de notre rendez-vous annuel en ce château, de découvrir à l’étal des librairies un ouvrage sur le thème de notre colloque d’aujourd’hui, les Celtes et le celtisme. Il est de la plume du célèbre Jean-François Kahn, directeur de l’hebdomadaire “Marianne”, du moins de sa version française, puisqu’il existe désormais une version belge qui ne me semble pas avoir le tonus de sa consoeur parisienne, si bien que je ne parie guère sur sa survie. Jean-François Kahn ne semble pas homme, a priori, qui encombre ses réflexions d’un souci permanent des racines celtiques ou gauloises de la France actuelle: ses sujets de prédilection sont à l’évidence les problèmes sociaux, les dysfonctionnements politiques qui affectent son pays. Dans la littérature géopolitique et dans certains atlas historiques, cet “Hexagone” est désormais qualifié d’ “espace gallique”, recouvrant ainsi l’acception de “Francie occidentale” lors du partage de Verdun en 843. Le reste, soit la part de l’Hexagone qui n’est pas “gallique”, est inclu dans un “espace germanique et lotharingien” par les auteurs d’un précieux “Atlas des peuples d’Europe occidentale”, soit Jean et André Sellier (La Découverte, Paris, 1995-2006). L’espace “germanique et lotharingien” étant, pour J. et A. Sellier, l’addition des héritages de Lothaire et de Louis le Germanique (la “Francie orientale”) en 843. Dans son livre “L’invention des Français – Du temps de nos folies gauloises” (Fayard, Paris, 2013), Jean-François Kahn se penche sur ce qui s’est passé sur le territoire aujourd’hui “français” (y compris la part lotharingienne —et burgonde— absorbée et dénaturée) entre 600 av. J. C. (date présumée de l’arrivée massive de tribus celtiques) et 500 après J. C., quand les Francs, venus de nos régions, prennent le relais des Romains moribonds ou disparus. Ces onze siècles, pour Kahn, sont le véritable creuset où s’est formée la “nation française”, en dépit des apports romains et germaniques, campés comme des adstrats sans réelle importance. Ce creuset est celui d’un “invraisemblable capharnaüm de bandes et de hordes, de cités et de nations”, d’où sortira, en bout de course, “un étrange mille-pattes à mille têtes qu’on appellera les Français”. Kahn privilégie évidemment l’idée d’un creuset où se mêlent toutes sortes d’ingrédients hétérogènes au détriment de toutes les homogénéités qui se sont juxtaposées dans les espaces gallique, lotharingien et burgonde. Kahn tente de retracer les épisodes qualifiables d’anarchisants et de libertaires dans ces onze siècles quasi inconnus de nos contemporains, en manifestant sa sympathie pour ce magma tissé de turbulences, rétif à tout ordre politique.
Toujours privilégier les faits romains et francs
Ce qui est vrai dans sa démonstration, comme dans la démonstration de bon nombre de celtisants bretons ou autres, c’est que l’historiographie dominante a toujours privilégié les faits romain/latin et franc/germanique dans l’espace gallique, au détriment de ce que Kahn campe aujourd’hui comme “celtique” ou “gaulois”. Effectivement, le facteur celtique a été longtemps oublié dans l’historiographie dominante. Rome a évidemment apporté la langue latine dans l’espace gallique et, comme l’histoire repose sur l’étude des textes, nous n’avons jamais disposé que de textes latins. Il n’y a pratiquement pas de textes longs, sinon des épigraphies, en langues celtiques continentales. La démarche de l’historien repose sur des textes, sur des travaux sauvés de l’oubli comme ceux de Tacite et de Tite-Live. La Renaissance carolingienne privilégie, elle aussi, le latin, toutefois elle collationne en marge de ses activités des récits populaires germaniques, sous l’impulsion d’Alcuin (natif de York) et d’Eginhard (un Rhénan). Même sous l’égide de Dicuil, moine irlandais au service du pouvoir installé par Charlemagne, le latin triomphe comme langue officielle de l’Empire, pourtant germanisé. Les Germains ont pris le relais de Rome, surtout sur le plan militaire. Dans le bassin parisien, les Francs, venus de Taxandrie et de l’espace rhénan au Nord de Cologne, puis de Tournai et de Soissons, donnent leur nom à l’espace gallique: après eux, on ne parlera plus de “Gaule” mais de “Francie” ou de “France”, de “Franken-Reich”, de l’Empire des Francs. La loi salique, droit coutumier germanique rédigé vers l’an 600 dans une langue dont dérive directement les parlers néerlandais actuels (du moins les dialectes “bas-franciques”), s’impose à tous. La mémoire populaire —non celle des historiens spécialisés dans le haut moyen âge— oublie généralement un apport celtique très important (non linguistique et non démographique), celui des missions irlandaises de Colomban, Columcille, Vergile (Fergill), sauveurs des textes antiques qu’ils se mettront à recopier, parfois en s’opposant, comme Vergile dans l’espace alpin à cheval sur l’Italie et l’Autriche actuelles, à la papauté romaine.
Aujourd’hui encore, les instances officielles campent la Wallonie comme germanique de race et latine de culture
 En tenant compte de ce contexte historique lointain, carolingien et bas-lotharingien —il existait une Basse-Lotharingie et une Haute-Lotharingie— la Wallonie actuelle, notamment sous l’impulsion d’un historien haut en couleurs aujourd’hui décédé, Léopold Génicot, et dans un ouvrage sur “Le français en Belgique”, publié par l’ex-Communauté française (devenue la “Fédération Wallonie-Bruxelles”), se pose comme héritière de Rome et du catholicisme, en tant que cadre forgé par un Empereur romain, Constantin. Les Wallons, officiellement, ne revendiquent donc aucune racine celtique, même si a existé un fond pré-romain et pré-germanique, aujourd’hui difficilement définissable. Pour Génicot, les Wallons descendent des Lètes germaniques de l’Empire romain, chargés de garder la frontière contre d’autres incursions germaniques. Rapidement latinisés, avec leurs officiers qui accèdent souvent à la citoyenneté romaine, ces Lètes ont précédé les Francs sur le territoire aujourd’hui wallon, surtout dans la vallée mosane: dans le chef de Génicot, le germanisme avait un droit d’aînesse en Wallonie dans le cadre belge et non la Flandre! Pour les héritiers de Génicot, qui ont confectionné cet excellent ouvrage, très précis, méticuleux et philologique, sur “Le français en Belgique”, les soldats germaniques de l’armée romaine installés en Wallonie actuelle auraient été recrutés, non pas en Rhénanie ou dans les tribus vivant sur la rive droite du Rhin, mais le long des côtes de la Mer du Nord en Hollande, en Frise, dans les régions de Brème et de Hambourg et en Scandinavie parmi les tribus classées sous le nom d’ “Ingwéoniens”. Ce n’est pas moi qui le dit, pour paraphraser Himmler et Degrelle: ce sont les historiens de la dite “Communauté française”... qui ne partagent apparemment pas les vues de Jean-François Kahn quand celui-ci déplore l’oubli des facteurs celtiques dans l’espace gallique et critique la surévaluation, à ses yeux, des facteurs romains et francs. Nous vivons une époque étonnante...
En tenant compte de ce contexte historique lointain, carolingien et bas-lotharingien —il existait une Basse-Lotharingie et une Haute-Lotharingie— la Wallonie actuelle, notamment sous l’impulsion d’un historien haut en couleurs aujourd’hui décédé, Léopold Génicot, et dans un ouvrage sur “Le français en Belgique”, publié par l’ex-Communauté française (devenue la “Fédération Wallonie-Bruxelles”), se pose comme héritière de Rome et du catholicisme, en tant que cadre forgé par un Empereur romain, Constantin. Les Wallons, officiellement, ne revendiquent donc aucune racine celtique, même si a existé un fond pré-romain et pré-germanique, aujourd’hui difficilement définissable. Pour Génicot, les Wallons descendent des Lètes germaniques de l’Empire romain, chargés de garder la frontière contre d’autres incursions germaniques. Rapidement latinisés, avec leurs officiers qui accèdent souvent à la citoyenneté romaine, ces Lètes ont précédé les Francs sur le territoire aujourd’hui wallon, surtout dans la vallée mosane: dans le chef de Génicot, le germanisme avait un droit d’aînesse en Wallonie dans le cadre belge et non la Flandre! Pour les héritiers de Génicot, qui ont confectionné cet excellent ouvrage, très précis, méticuleux et philologique, sur “Le français en Belgique”, les soldats germaniques de l’armée romaine installés en Wallonie actuelle auraient été recrutés, non pas en Rhénanie ou dans les tribus vivant sur la rive droite du Rhin, mais le long des côtes de la Mer du Nord en Hollande, en Frise, dans les régions de Brème et de Hambourg et en Scandinavie parmi les tribus classées sous le nom d’ “Ingwéoniens”. Ce n’est pas moi qui le dit, pour paraphraser Himmler et Degrelle: ce sont les historiens de la dite “Communauté française”... qui ne partagent apparemment pas les vues de Jean-François Kahn quand celui-ci déplore l’oubli des facteurs celtiques dans l’espace gallique et critique la surévaluation, à ses yeux, des facteurs romains et francs. Nous vivons une époque étonnante...
La “Gaule Françoise” de François Hotman
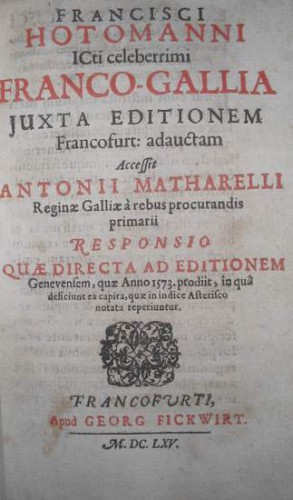 Le facteur celtique a effectivement été escamoté par toutes les renaissances intellectuelles qui ont jalonné l’histoire d’Europe occidentale jusqu’à la fin du 18ème siècle. Nous ne trouvons que quelques vagues évocations au 16ème siècle, où, une fois de plus, les facteurs classiques, gréco-latins, et germaniques sont seuls valorisés. Dans sa critique d’une monarchie française, qu’il considérait comme dévoyée après les massacres de la Saint-Barthélémy (1572), le juriste huguenot français d’origine allemande François Hotman, né à Paris, évoque une “Franco-Gallia” ou une “Gaule Françoise” (1573). Hotman souligne les origines franques-germaniques de la France médiévale. Ces tribus, qui ont franchi le “Rhein” (sic), avaient une notion innée de la liberté, comme le soulignait aussi Tacite: le principe germanique est donc un principe de liberté (et de liberté religieuse pour le protestant Hotman), idée que l’on véhiculera jusqu’à la première guerre mondiale. Il y a donc, d’un côté, cette idée de liberté, et, de l’autre, l’idée féroce de l’absolutisme, qui n’hésite pas à recourir à des massacres comme celui de la Saint-Barthélémy. Quand les principes libertaires germaniques régnaient sur tous les esprits, écrit Hotman, “Les rois n’avaient pas une puissance infinie ni absolue” (cf. André Devyver, “Le sang épuré – Les préjugés de race chez les gentilshommes français de l’Ancien régime (1560-1720)”, Ed. de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1973). Kahn inverse simplement le raisonnement ancien du Huguenot Hotman: le fonds pré-celtique, celtique et autre est réservoir de liberté, tandis que les systèmes mis en place par Rome et par les Francs sont tyranniques. Pour retrouver leurs libertés face à une droite et une gauche qui deviennent “mabouls”, les Français contemporains doivent, selon Kahn, recourir au fonds hétérogène pré-romain. Chez Hotman, le fonds pré-franc et pré-romain était réservoir de cruelle anarchie: le système libertaire germanique est venu l’humaniser (avant la lettre).
Le facteur celtique a effectivement été escamoté par toutes les renaissances intellectuelles qui ont jalonné l’histoire d’Europe occidentale jusqu’à la fin du 18ème siècle. Nous ne trouvons que quelques vagues évocations au 16ème siècle, où, une fois de plus, les facteurs classiques, gréco-latins, et germaniques sont seuls valorisés. Dans sa critique d’une monarchie française, qu’il considérait comme dévoyée après les massacres de la Saint-Barthélémy (1572), le juriste huguenot français d’origine allemande François Hotman, né à Paris, évoque une “Franco-Gallia” ou une “Gaule Françoise” (1573). Hotman souligne les origines franques-germaniques de la France médiévale. Ces tribus, qui ont franchi le “Rhein” (sic), avaient une notion innée de la liberté, comme le soulignait aussi Tacite: le principe germanique est donc un principe de liberté (et de liberté religieuse pour le protestant Hotman), idée que l’on véhiculera jusqu’à la première guerre mondiale. Il y a donc, d’un côté, cette idée de liberté, et, de l’autre, l’idée féroce de l’absolutisme, qui n’hésite pas à recourir à des massacres comme celui de la Saint-Barthélémy. Quand les principes libertaires germaniques régnaient sur tous les esprits, écrit Hotman, “Les rois n’avaient pas une puissance infinie ni absolue” (cf. André Devyver, “Le sang épuré – Les préjugés de race chez les gentilshommes français de l’Ancien régime (1560-1720)”, Ed. de l’Université de Bruxelles, Bruxelles, 1973). Kahn inverse simplement le raisonnement ancien du Huguenot Hotman: le fonds pré-celtique, celtique et autre est réservoir de liberté, tandis que les systèmes mis en place par Rome et par les Francs sont tyranniques. Pour retrouver leurs libertés face à une droite et une gauche qui deviennent “mabouls”, les Français contemporains doivent, selon Kahn, recourir au fonds hétérogène pré-romain. Chez Hotman, le fonds pré-franc et pré-romain était réservoir de cruelle anarchie: le système libertaire germanique est venu l’humaniser (avant la lettre).
Vogue celtisante et “Sturm und Drang”
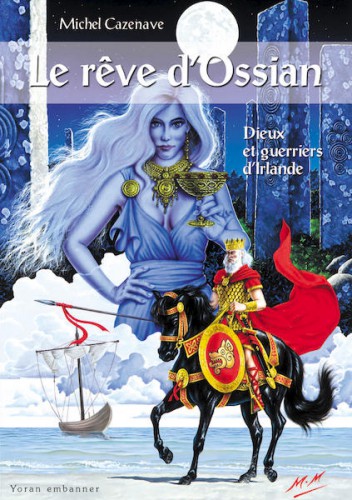 Les 16ème et 17ème siècles sont donc peu enclins à redécouvrir le fait celtique dans l’histoire des espaces gallique et lotharingien/germanique. Il faudra attendre la fin du 18ème siècle pour que naisse une véritable “vogue celtisante”, qui se poursuit encore aujourd’hui, notamment dans l’univers de la chanson, dans la bande dessinée et avec un festival comme le “Festival inter-celtique de Lorient”. Le “Sturm und Drang” littéraire allemand secoue les bonnes habitudes ancrées dans la culture européenne. Les protagonistes de ce mouvement littéraire en ont assez de la répétition des modèles classiques. Ils recherchent autre chose. Ils veulent un retour à des thèmes plus variés, comme chez Shakespeare, qui s’inspire certes de la culture classique, mais puise aussi dans les traditions de la très vieille Angleterre et de la Scandinavie du haut moyen âge. Ils espèrent aussi un retour à l’hellénité homérique, plus âpre que l’Athènes classique. Le philosophe Herder démontre dans la foulée du “Sturm und Drang” que l’excellence littéraire vient uniquement des racines, des sources les plus anciennes et non pas d’une répétition ad nauseam des mêmes thèmes classiques. Les frères Grimm, célébrés en 2012 outre-Rhin, seront ses héritiers en Allemagne. Les slavophiles russes le seront en Russie. En Ecosse, James McPherson, un écrivain pré-romantique, épigone du “Sturm und Drang” allemand, prétend avoir découvert les écrits d’un barde celtique ancien et de les avoir traduits. Ce barde se serait appelé “Ossian”. Il n’y a jamais eu d’Ossian: ces magnifiques poèmes, construits sur des canons non classiques, sortaient tout droit de l’imagination de McPherson. La vogue celtisante était lancée. Elle ne s’arrêtera plus.
Les 16ème et 17ème siècles sont donc peu enclins à redécouvrir le fait celtique dans l’histoire des espaces gallique et lotharingien/germanique. Il faudra attendre la fin du 18ème siècle pour que naisse une véritable “vogue celtisante”, qui se poursuit encore aujourd’hui, notamment dans l’univers de la chanson, dans la bande dessinée et avec un festival comme le “Festival inter-celtique de Lorient”. Le “Sturm und Drang” littéraire allemand secoue les bonnes habitudes ancrées dans la culture européenne. Les protagonistes de ce mouvement littéraire en ont assez de la répétition des modèles classiques. Ils recherchent autre chose. Ils veulent un retour à des thèmes plus variés, comme chez Shakespeare, qui s’inspire certes de la culture classique, mais puise aussi dans les traditions de la très vieille Angleterre et de la Scandinavie du haut moyen âge. Ils espèrent aussi un retour à l’hellénité homérique, plus âpre que l’Athènes classique. Le philosophe Herder démontre dans la foulée du “Sturm und Drang” que l’excellence littéraire vient uniquement des racines, des sources les plus anciennes et non pas d’une répétition ad nauseam des mêmes thèmes classiques. Les frères Grimm, célébrés en 2012 outre-Rhin, seront ses héritiers en Allemagne. Les slavophiles russes le seront en Russie. En Ecosse, James McPherson, un écrivain pré-romantique, épigone du “Sturm und Drang” allemand, prétend avoir découvert les écrits d’un barde celtique ancien et de les avoir traduits. Ce barde se serait appelé “Ossian”. Il n’y a jamais eu d’Ossian: ces magnifiques poèmes, construits sur des canons non classiques, sortaient tout droit de l’imagination de McPherson. La vogue celtisante était lancée. Elle ne s’arrêtera plus.
Nous verrons que ce “Sturm und Drang” et ce “celtisme” britannique sont à replacer dans un contexte révolutionnaire dans la période 1780-1795 mais un révolutionnarisme qui tient compte des racines, tout en se montrant fort virulent dans ses critiques de l’absolutisme royal de l’Ancien Régime. Après Ossian, nous avons la renaissance du druidisme au Pays de Galles et l’émergence des Gorsedd, concours de poésie en langue galloise. Ailleurs en Europe, en dehors des régions où l’on a parlé des langues celtiques jusqu’à nos jours, l’archéologie tchèque (W. Kruta), hongroise (M. Szabo) et autrichienne s’est penchée sur les civilisations celtiques de la Tène et de Halstatt, découvrant un celtisme alpin et danubien, dont le 18ème siècle du “Sturm und Drang” et de l’“ossianisme” n’avait pas encore conscience
◊ ◊ ◊
Le Pan-celtisme actuel
Recension et source majeure de cet exposé: Peter Berresford Ellis, The Celtic Dawn – A History of Pan-Celticism, Constable, London, 1993.
 Avant de parler de “pan-celtisme”, il convient préalablement de définir le terme, l’“ethnonyme” de “Celte”. Pour la plupart des celtisants ou des militants indépendantistes celtophones, est “Celte” seulement celui qui est locuteur d’une langue celtique, comme le gaëlique irlandais ou le gallois, le cornique ou le breton. A l’exclusion de tous les autres. Cette exclusivité celtophone a posé quelques problèmes, notamment quand les Galiciens et les Asturiens de la péninsule ibérique ont voulu adhérer au club des nations celtiques. Galiciens et Asturiens défendaient leurs positions en arguant qu’une émigration britannique (brythonique!), face à l’invasion des Angles, Jutes et Saxons, s’était installée dans le Nord-Ouest de l’Espagne, en même temps qu’en Bretagne. L’argument des adversaires de leur adhésion était de dire que les dialectes galiciens et asturiens (le “bable”) contenaient moins de mots d’origine celtique que le français ou l’anglais. De plus, le Nord-Ouest de la péninsule ibérique recèle encore d’autres ingrédients ethniques, suèves, wisigothiques, basques et alains. Sont cependant acceptés les locuteurs d’une des deux “linguae francae”, l’anglais et le français, si les postulants peuvent se dire d’origine gaëlique, cornique, bretonne ou galloise, parce que dans leurs régions des langues celtiques ont encore été parlées à l’époque médiévale ou post-médiévale.
Avant de parler de “pan-celtisme”, il convient préalablement de définir le terme, l’“ethnonyme” de “Celte”. Pour la plupart des celtisants ou des militants indépendantistes celtophones, est “Celte” seulement celui qui est locuteur d’une langue celtique, comme le gaëlique irlandais ou le gallois, le cornique ou le breton. A l’exclusion de tous les autres. Cette exclusivité celtophone a posé quelques problèmes, notamment quand les Galiciens et les Asturiens de la péninsule ibérique ont voulu adhérer au club des nations celtiques. Galiciens et Asturiens défendaient leurs positions en arguant qu’une émigration britannique (brythonique!), face à l’invasion des Angles, Jutes et Saxons, s’était installée dans le Nord-Ouest de l’Espagne, en même temps qu’en Bretagne. L’argument des adversaires de leur adhésion était de dire que les dialectes galiciens et asturiens (le “bable”) contenaient moins de mots d’origine celtique que le français ou l’anglais. De plus, le Nord-Ouest de la péninsule ibérique recèle encore d’autres ingrédients ethniques, suèves, wisigothiques, basques et alains. Sont cependant acceptés les locuteurs d’une des deux “linguae francae”, l’anglais et le français, si les postulants peuvent se dire d’origine gaëlique, cornique, bretonne ou galloise, parce que dans leurs régions des langues celtiques ont encore été parlées à l’époque médiévale ou post-médiévale.
Solidarités celtiques
On ne parlait pas de “celtisme” ou de “celtitude” avant la seconde partie du 18ème siècle. Cependant, pour l’historien du celtisme et écrivain Peter Berresford Ellis, Président de la “Celtic League” de 1988 à 1990, on peut repérer, tout au long de l’histoire médiévale des Iles Britanniques, des solidarités politiques inter-celtiques contre la prépondérance des éléments angles, saxons, jutes et normands, notamment quand il s’agit de porter secours à l’Ecossais Robert Bruce en 1314 ou d’aider les Tudor suite à la Guerre des Deux Roses au 15ème siècle. Richard III reçoit effectivement un appui de troupes corniques, galloises, écossaises et bretonnes. Quand les Tudor accèderont au trône d’Angleterre, ils oublieront leurs racines celtiques et se montreront plus anglais que les Anglais, tout simplement parce qu’il auront alors hérité du pouvoir central et que celui-ci, quel qu’il soit, s’oppose toujours à ses marges géographiques et ethniques.
Les pionniers de la redécouverte du fait celtique sont Edward Lhuyd, en Angleterre, dont les oeuvres paraissent en 1707. C’est lui qui réintroduit les termes “celte” et “celtique” dans le vocabulaire (d’abord philologique). Son travail est purement académique. En Bretagne, l’Abbé Pezron se penche pour la première fois sur la littérature celtique et amorce, encore timidement, la “vogue celtique”, qui prendra, comme on l’a vu, sa vitesse de croisière avec James McPherson (1736-1796). Tributaire de la mode lancée par le “Sturm und Drang” allemand, McPherson écrit des ballades et des poésies, attribuées à un barde du nom d’Ossian, qu’il aurait soi-disant traduites du gaëlique écossais. C’est un faux qui aura une postérité incroyable. L’engouement pour la poésie bardique atteint toutes les couches de la société: Napoléon était un lecteur fervent de McPherson. Bernadotte, le futur roi de Suède, figure au départ picaresque et époux d’une Irlandaise née à Marseille, nommera son fils héritier “Oscar”, du nom du fils d’Ossian. A la même époque, les Gallois celtisants organisent leur premier “Eistedfodd”, un festival de musique, de chants et de poésie celtique, ancêtre du fameux “festival inter-celtique de Lorient”.
Méchantes racines et bons nomades
Aujourd’hui, vu l’hostilité des idéologies dominantes aux racines, surtout dans l’espace linguistique francophone, on a tendance à dissocier complètement recours aux racines et volonté révolutionnaire: ne peut être “révolutionnaire” ou “progressiste” que celui qui s’arrache à ses racines, comme le réclame explicitement, sans la moindre nuance, un Bernard-Henri Lévy depuis son fameux “Testament de Dieu”, où, comme Moïse, il nous annonçait, sans rire, les nouvelles tables de la Loi, qu’un hypothétique Yahvé lui aurait confiées. Pour être acceptable, non condamnable, il faut être un “nomade”, un “vagabond” errant partout sur la planète: les “errants” sont les nouveaux Übermenschen pour ce fatras idéologique. Les braves enracinés, les nouveaux Untermenschen. Cette optique hostile à toutes racines est peut-être vraie pour la France, où le Club des Jacobins donnera le ton, et luttera contre les “patois” et les “pequenauds”: ce n’est pas vrai ailleurs et cela explique, notamment, le renversement unanime des révolutionnaires allemands les plus virulents (Fichte, Arndt, Jahn, etc.), qui prendront fait et cause contre la domination napoléonienne, quitte à s’allier aux rois. Cette optique franco-jacobine est fausse pour le monde celtique, où recours aux racines et volonté révolutionnaire ne faisaient qu’un. Dès 1789, Thomas Jones, un révolutionnaire anti-monarchiste, organise les premiers “Gorsedd”, les assemblées druidiques, dont on se gausse au départ. Cependant, tous s’y mettront rapidement avec enthousiasme, au Pays de Galles, en Cornouailles et en Bretagne. Iolo Morganwg lance, le 21 juin 1792, jour du solstice d’été, une assemblée annuelle des Bardes.
Idées républicaines et renaissance des langues
 En 1820, se crée en Ecosse la “Celtic Society”, sous l’impulsion, notamment, du célèbre romancier Walter Scott, dont les opinions politiques sont républicaines. Il utilise l’anglais pour son oeuvre mais n’aborde que des thèmes hostiles à la monarchie d’origine normande, en opposant les Saxons (Ivanhoe, Robin des Bois) aux Normands. En Flandre, cette manière de présenter les choses sera reprise par Hendrik Conscience, qui y ajoute, consciemment ou inconsciemment, la thématique du Huguenot François Hotman: l’élément germanique est vecteur de liberté populaire (ou de fougue révolutionnaire — ce qui n’est pas le cas de Conscience, qui a l’appui de Léopold I), l’élément normand (chez Scott) ou capétien (chez Conscience) est synonyme d’absolutisme et de tyrannie. La “Celtic Society” de Walter Scott est à l’origine de deux revues, qui paraîtront jusqu’à la fin du 19ème siècle, le “Celtic Magazine”, et le “Celtic Monthly”. Ces publications se fixent deux buts: 1) promouvoir les idées républicaines; 2) promouvoir la renaissance des langues celtiques. La notion de “république”, que l’on répète inlassablement aujourd’hui en France, sur un ton incantatoire qui nous agace profondément en dehors des frontières de l’Hexagone, ne correspond dont pas du tout à l’idée républicaine véhiculée dans les pays celtiques et en Ecosse à l’époque de la révolution française.
En 1820, se crée en Ecosse la “Celtic Society”, sous l’impulsion, notamment, du célèbre romancier Walter Scott, dont les opinions politiques sont républicaines. Il utilise l’anglais pour son oeuvre mais n’aborde que des thèmes hostiles à la monarchie d’origine normande, en opposant les Saxons (Ivanhoe, Robin des Bois) aux Normands. En Flandre, cette manière de présenter les choses sera reprise par Hendrik Conscience, qui y ajoute, consciemment ou inconsciemment, la thématique du Huguenot François Hotman: l’élément germanique est vecteur de liberté populaire (ou de fougue révolutionnaire — ce qui n’est pas le cas de Conscience, qui a l’appui de Léopold I), l’élément normand (chez Scott) ou capétien (chez Conscience) est synonyme d’absolutisme et de tyrannie. La “Celtic Society” de Walter Scott est à l’origine de deux revues, qui paraîtront jusqu’à la fin du 19ème siècle, le “Celtic Magazine”, et le “Celtic Monthly”. Ces publications se fixent deux buts: 1) promouvoir les idées républicaines; 2) promouvoir la renaissance des langues celtiques. La notion de “république”, que l’on répète inlassablement aujourd’hui en France, sur un ton incantatoire qui nous agace profondément en dehors des frontières de l’Hexagone, ne correspond dont pas du tout à l’idée républicaine véhiculée dans les pays celtiques et en Ecosse à l’époque de la révolution française.
Ainsi, Thomas Muir, proclamé “Président d’Ecosse”, suite à une rébellion républicaine en 1797, fuit en Irlande où il est reçu au sein de la confrérie occulte des “United Irishmen”, opposés aux Anglais et à la monarchie (avec leurs collègues des “United Scotsmen” et des “United Englishmen”). Les “United Irishmen” se révolteront avec l’appui d’unités françaises débarquées en 1797 mais, contrairement aux clivages à l’oeuvre depuis le soulèvement catholique de gauche de Bernadette Devlin en 1972, les nationalistes-révolutionnaires des “United Irishmen” seront plutôt protestants que catholiques, ces derniers, inquiétés par les dérapages de la révolution française en Vendée et en Bretagne, seront plutôt loyalistes.
Des racines celtiques de l’idée républicaine en France
Autre indice, qui confirme la thèse de Peter Berresford Ellis: les députés républicains bretons de l’Assemblée Nationale française, Armand Kersaint et Lafayette (homme de paradoxes...!) réclament une intervention militaire ou navale pour sauver les républicains écossais de la défaite et de la répression. Ces députés bretons sont opposés au centralisme parisien et ne cessent de réclamer l’autonomie de la Bretagne, inaugurant ainsi un filon qui perdure jusque aujourd’hui dans le mouvement breton. Thomas Paine, Gaëlique écossais, rédige le premier manifeste des “Droits de l’Homme”: l’édition gaëlique connaîtra, à l’époque, un chiffre de vente et de diffusion plus important que sa version française, preuve que les Jacobins, les BHListes parisiens actuels et les chaisières du bazar droit-de-l’hommard, de Mitterrand à Hollande, se soucient comme d’une guigne des véritables droits de l’homme, qu’ils galvaudent au rang de pur slogan. Le premier manifeste des “Droits de l’Homme” a été rédigé par un militant, peut-être naïf, diront les conservateurs, mais dont les convictions républicaines ne peuvent être mises en doute ni la volonté d’émanciper ses contemporains, mais cette volonté n’est pas séparable d’un recours aux racines les plus profondes. Robert Price, autre militant celtique du Pays de Galles, écrit en 1776, suite à la révolution américaine, un manifeste “Civil Liberties” qui inspirera les rédacteurs de la première constitution républicaine française: il y a donc en celle-ci un élément républicain gallois. Price en a été l’inspirateur, ainsi que son propre maître Thomas Roberts. Les républicains celtisants insulaires sont donc, à un certain moment, en porte-à-faux par rapport aux Bretons, qui abandonnent l’idéal républicain vicié par les Jacobins et les centralistes parisiens qui refusent la reconstitution du Parlement de Bretagne, et adhèrent à la chouannerie royaliste.
L’oeuvre de Charles De Gaulle (1837-1880)
Au dix-neuvième siècle, le celtisme breton sera structuré par Charles De Gaulle (1837-1880), oncle du général de même nom et prénom. Natif de Valenciennes, dans le Hainaut annexé et toujours occupé, cet homme, malade et invalide, mourra dix ans avant la naissance de son neveu, que l’on prénommera Charles en son souvenir. Les De Gaulle, originaires du Hainaut mutilé et de la Flandre irrédente, ont des origines irlandaises, en la famille d’un certain Sean McCartan, Colonel d’une brigade irlandaise de l’armée royale française. Charles De Gaulle (numéro un) est un infirme: il est paralysé et habite au 282 de la Rue de Vaugirard à Paris. C’est dans ce logis, qu’il ne quittera pratiquement jamais, qu’il va tout imaginer, explique Peter Berresford Ellis. Il devient le secrétaire de “Breurez Breiz”, la société des poètes bretons de Paris, où il rencontre Théodor Hersart de la Villemarqué (1815-1895), qui a publié en 1836 le “Barzaz Breiz”, anthologie remarquée de chants populaires de la Bretagne. Les deux hommes sont également liés à l’Association Bretonne, fondée auparavant par Armand de la Rouerie en 1791. Elle avait pour objectif de restaurer l’autonomie de la Bretagne (comme avant 1532). De la Rouerie restera fidèle à la révolution française, en dépit de son départ pour l’Amérique, jusqu’à l’abolition du Parlement de Bretagne. Il meurt en 1793. Son Association est dissoute mais recréée en 1843, formulant les mêmes revendications. En 1858, elle est à nouveau dissoute par Napoléon III, bête noire des polémistes en Belgique à l’époque, sans doute pour cette hostilité à toute autonomie bretonne mais surtout pour son annexion, jugée totalement inacceptable à Bruxelles, de la Savoie et du Comté de Nice, encore deux fragments de l’ancienne Burgondie impériale détachés d’un Etat héritier de ce Saint-Empire: la crainte était grande de voir Napoléon III, comme auparavant Philippe le Bel ou Louis XIV, diriger ses efforts vers l’espace bas-lotharingien, après avoir grignoté l’espace burgonde ou haut-lotharingien. Charles De Coster, libertaire d’opinion, ne se lassera pas de fustiger ce “Napoléon-le-petit”, comme disait Victor Hugo en exil à Bruxelles, et le Philippe II de son “Tyl Uilenspiegel” est parfois une caricature de Napoléon III.
Charles De Gaulle le celtisant, est royaliste, catholique et conservateur, contrairement à bon nombre de celtisants des Iles Britanniques. Il fait basculer le mouvement breton, jusqu’aux années 60 du 20ème siècle, dans le camp conservateur, avec l’appui, il faut le dire, d’un roman à grand succès, celui d’Alexis-François Rio, intitulé “La petite Chouannerie” (1842). Ce roman donne le coup d’envoi à la volonté récurrente, en Bretagne, de suggérer une autre vision de l’histoire. La revue “Stur” d’Olier Mordrel, avant la seconde guerre mondiale, son livre “Le mythe de l’Hexagone”, les articles de la revue “Gwenn ha Du”, sont autant d’expressions de cette volonté. De Gaulle plaide pour la résurrection de la langue, comme les celtisants des Iles Britanniques s’efforcent de raviver le gallois ou le gaëlique irlandais. Les efforts de De Gaulle seront dès lors plus linguistiques que politiques. Autre petit fait intéressant à signaler: lorsque le Gallois Michael D. Jones fonde une colonie galloise en Patagonie, De Gaulle soutient le projet mais demande de respecter là-bas l’identité araucarienne: nous voyons là l’émergence d’un thème cher à Jean Raspail, la défense de toutes les racines, et au créateur de bandes dessinées Bilal, qui fait émigrer tout un village breton, hostile à des promoteurs immobiliers sans scrupules, vers la pampa argentine. De Gaulle veut une langue celtique unifiée, d’abord en Bretagne même, puis dans l’ensemble de l’espace celtophone. Sous son impulsion, les études celtiques sont enfin prises au sérieux en milieux académiques. Une véritable renaissance peut commencer, se consolider et être sûre de sa pérennité.
Les trois tendances du mouvement celtique
Trois tendances vont alors se juxtaposer dans le mouvement celtique, toutes nations particulières confondues:
1. Une tendance littéraire avec l’émergence d’une littérature d’inspiration celtique mais rédigée en français ou en anglais. William Butler Yeats en sera l’exemple le plus connu mais son ésotérisme, assez éthéré, sera critiqué notamment par la revue “Stur” en Bretagne, cet ésotérisme oblitérant toute référence directe au réel concret, tout recours fécond au “vécu” (Mordrel).
2. Une tendance purement philologique qui se focalisera sur la renaissance des langues et leur emploi dans la vie quotidienne et publique.
3. Une tendance politique, qui englobera le travail littéraire et le travail philologique mais les doublera de revendications politiques et sociales, articulées dans les parlements et dans la vie politique du Royaume-Uni surtout, dont la dévolution sous Blair, avec l’émergence de parlements autonomes gallois et écossais et les tentatives actuelles de faire aboutir un référendum pour l’indépendance de l’Ecosse sont les dernières manifestations.
Cens décent, “fixity of tenure”, Home Rule
La dimension politique du combat celtique, voire pan-celtique, va s’arc-bouter dans un premier temps sur un problème très important et fort épineux: la question agraire, suite notamment aux famines qui ont frappé l’Irlande. La question agraire n’est pas résolue dans le Royaume-Uni au 19ème siècle, ni en Irlande ni en Ecosse. Au Pays de Galles, elle se greffe sur le problème du “tithe”, soit le paiement d’une dîme au propriétaire terrien (généralement protestant et anglais). Le but des “Panceltes” qui veulent résoudre la question agraire est d’imposer aux latifundistes qu’ils se satisfassent d’un cens décent et qu’il acceptent la “fixity of tenure”, soit le droit des exploitants ruraux à ne pas être chassés de leur lopin. Ce combat sera notamment mené par William O’Brien (1852-1928), dont l’inspiration politico-culturelle était panceltique, mais dont l’action était concrète: il fut, outre un combattant pour le droit des petits paysans irlandais contre les propriétaires absents (les “absentee lords”), un défenseur de l’idée de “Home Rule”. Lloyd George, avant de détenir les plus hautes fonctions dans le Royaume-Uni, était partisan d’une alliance parlementaire entre députés gallois et irlandais (la périphérie contre le centre) et d’un “self-government” gallois, équivalent du Home Rule irlandais réclamé à Dublin. Dans le sillage de ce combat pour la question agraire et pour le Home Rule naît l’association culturelle “Conradh na Gaeilge”, visant la renaissance des langues dans la vie quotidienne: elle militera pour le bilinguisme dans les écoles.
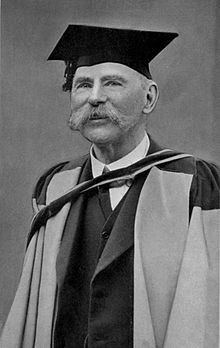 A l’aube du 20ème siècle, les anciennes structures panceltiques sont remplacées par le “Celtic Congress” puis par la “Celtic League”. Ce sont des organisations faîtières qui chapeautent tout le mouvement panceltique. La figure principale, la plus notable, dans le cadre de ces organisations a été le Dr. Douglas Hyde (1860-1949), issu directement du “Conradh na Gaeilge”. Il sera le premier président de l’Irlande indépendante en 1937. Avant cela, il fut le premier professeur d’irlandais moderne (“Modern Irish”) à l’Université de Dublin. Des tiraillements existaient dans le mouvement irlandais avant la première guerre mondiale: fallait-il privilégier le combat linguistique, en visant l’ancrage de l’irlandais moderne dans les réseaux d’enseignement? Ou fallait-il privilégier l’union panceltique? La majorité a privilégié le combat linguistique; le combat panceltique était jugé difficile voire impossible sur le plan purement pragmatique à l’époque: de plus, il se heurtait à des clivages religieux qu’on ne saurait minimiser; les Irlandais étaient majoritairement catholiques et puisaient dans les ressources de leur catholicisme des énergies pour combattre l’Angleterre, tandis que les Ecossais étaient majoritairement presbytériens et les Gallois, méthodistes. Dans ces réseaux, issus du “Conradh na Gaeilge”, s’activait un futur martyr de la cause irlandaise, Padraig Pearse (1879-1916), l’un des seize fusillés suite à l’insurrection des Pâques 1916. Pearse mêlait dans son oeuvre des références au passé païen d’avant la conversion de l’Irlande par Patrick à un catholicisme celtique de l’époque mérovingienne, dont l’idéalisme de Columcille, l’un des sauveteurs de l’héritage antique. Il développait une éthique du sacrifice, à laquelle il a eu le courage de ne pas se soustraire.
A l’aube du 20ème siècle, les anciennes structures panceltiques sont remplacées par le “Celtic Congress” puis par la “Celtic League”. Ce sont des organisations faîtières qui chapeautent tout le mouvement panceltique. La figure principale, la plus notable, dans le cadre de ces organisations a été le Dr. Douglas Hyde (1860-1949), issu directement du “Conradh na Gaeilge”. Il sera le premier président de l’Irlande indépendante en 1937. Avant cela, il fut le premier professeur d’irlandais moderne (“Modern Irish”) à l’Université de Dublin. Des tiraillements existaient dans le mouvement irlandais avant la première guerre mondiale: fallait-il privilégier le combat linguistique, en visant l’ancrage de l’irlandais moderne dans les réseaux d’enseignement? Ou fallait-il privilégier l’union panceltique? La majorité a privilégié le combat linguistique; le combat panceltique était jugé difficile voire impossible sur le plan purement pragmatique à l’époque: de plus, il se heurtait à des clivages religieux qu’on ne saurait minimiser; les Irlandais étaient majoritairement catholiques et puisaient dans les ressources de leur catholicisme des énergies pour combattre l’Angleterre, tandis que les Ecossais étaient majoritairement presbytériens et les Gallois, méthodistes. Dans ces réseaux, issus du “Conradh na Gaeilge”, s’activait un futur martyr de la cause irlandaise, Padraig Pearse (1879-1916), l’un des seize fusillés suite à l’insurrection des Pâques 1916. Pearse mêlait dans son oeuvre des références au passé païen d’avant la conversion de l’Irlande par Patrick à un catholicisme celtique de l’époque mérovingienne, dont l’idéalisme de Columcille, l’un des sauveteurs de l’héritage antique. Il développait une éthique du sacrifice, à laquelle il a eu le courage de ne pas se soustraire.
Une ambiance révolutionnaire
Le “Celtic Congress” avait des dimensions essentiellement académiques. Il voulait celtiser l’enseignement et a donc axé son combat sur la question scolaire en Irlande. C’est à ce niveau que se rejoignent les dimensions culturelles et politiques parce que ce combat devait se gagner forcément dans les assemblées élues et légiférantes. La propagande anglaise soulignait alors l’“archaïsme” qu’il y avait à parler et écrire des langues celtiques: Pearse et ses compagnons rétorquèrent que les parler devenait de ce fait un acte politique contestataire de l’ordre établi. En 1914, avec l’éclatement de la Grande Guerre, le “Celtic Congress” a dû interrompre ses activités. Elles ne reprendront ni en 1915 ni en 1916. Elles reprennent toutefois en 1917, quand le souvenir cuisant de l’échec de l’insurrection d’avril 1916 se fait encore douloureusemet sentir. Ces activités se font à feu doux. Pearse est mort, d’autres sont encore emprisonnés. L’ambiance est révolutionnaire. Parmi les fusillés de 1916, il y avait le fougueux et très original leader socialiste irlandais, James Connolly, adepte et théoricien d’un marxisme virulent (appelé à résoudre la question agraire et les problèmes ouvriers), mais un marxisme “hibernisé”, avec des références à la mythologie celtique. Peter Berresford Ellis, également auteur d’une histoire du mouvement ouvrier irlandais (1), rappelle quelles ont été les grandes lignes de ce marxisme hibernisé. Il repose principalement sur l’idée d’un “communisme primitif” des tribus celtiques irlandaises, avant la conquête anglaise du 12ème siècle. Friedrich Engels apprendra même des rudiments de la langue celtique d’Irlande pour étudier ces structures tribales communautaires, avant d’ajouter un chapitre (jamais achevé) de son ouvrage essentiel sur les “Origines de la famille, de la propriété privée et de l’Etat”. L’appui de Marx et d’Engels à l’indépendantisme irlandais, comme expression de la lutte des classes et de l’émancipation des ruraux exploités par les latifundistes, ont suscité l’enthousiasme non seulement des pionniers du socialisme irlandais mais aussi des nationalistes, qui seront toujours reconnaissants à l’endroit et de Marx et d’Engels.
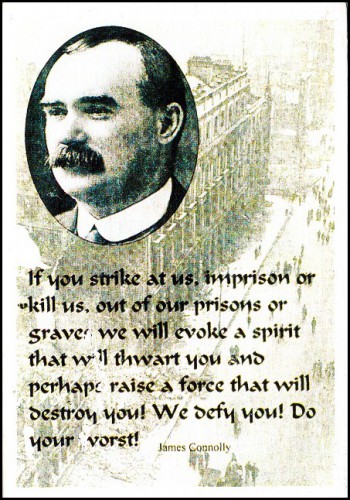
James Connolly: alchimie marxiste et nationaliste
De cet enthousiasme du “Dr. Marx” qui prend fait et cause pour l’indépendance de l’Irlande, même face à l’hostilité des socialistes anglais, découle le mixte, étonnant ailleurs en Europe et dans le monde, de nationalisme et de marxisme. Pierre Joannon, dans son “Histoire de l’Irlande et des irlandais” (Perrin, Paris, 2006), nous explique très bien l’alchimie nationaliste et marxiste de la pensée de James Connolly, tout comme, en marquant une distance plus nette, l’historien anglais F. S. L. Lyons (2) nous avait démontré comment nationalisme, catholicisme et socialisme s’étaient combinés en une synthèse originale et difficilement transposable en d’autres contextes. Pour Connolly, le socialisme en place, devenu routinier et opportuniste, ne faisait plus que du “syndicalisme étroit aux objectifs limités” (Joannon, op. cit., p. 345). Le socialisme irlandais devait donc recevoir un apport d’énergie complémentaire que seul le nationalisme pouvait lui procurer, surtout le mixte de catholicisme sacrificiel et de nationalisme celtique mythologisé, chanté par Padraig Pearse (3). Ces réflexions sur le combat social, bien ancré dans le mouvement ouvrier et marxiste de son époque, et sur l’apport indispensable de la religion, de la mythologie et du nationalisme, conduisent Connolly à se joindre aux insurgés de Pâques 1916, à être capturé par les Anglais les armes à la main dans le “Grand Post Office” de Dublin et d’être condamné à mort et exécuté. Peter Berresford Ellis rappelle qu’en pleine guerre, les ouvrirers gallois envisagent de faire grève pour obtenir la grâce de Connolly. Ils volent même des explosifs qui seront expédiés en Irlande. Plus tard, des volontaires gallois et écossais (notamment la “Scottish Brigade” de Jim Reeder) se battront aux côtés des insurgés républicains entre 1919 et 1923.
Les événements qui secouent l’Irlande de 1916 à 1923 éveillent les esprits en Bretagne armoricaine. Les militants bretons sont fascinés par la création du premier Etat celtique moderne. Morvan Marchal est l’un de leurs chefs de file. Il appelle en 1925 les peuples celtiques à créer une organisation faîtière pour défendre leurs droits politiques et culturels, doublé d’un “Comité international pour les minorités nationales”. Forts de cette idée, les Bretons de “Breizh Atao” dépassent très vite les limites du seul “panceltisme”; ils appellent Corses, Flamands et Basques à se joindre à leur combat. Du “panceltisme”, on passe à l’idée d’un fédéralisme européen, celui que véhiculeront, chacun à leur manière et en dehors de tout contexte socialiste et marxiste, des figures comme Olier Mordrel, Marc Augier (dit “Saint-Loup”), Jean Mabire ou Yann-Ber Tillenon. “Breizh Atao” est ainsi la toute première organisation politique à énoncer l’idée d’un parlement européen, ne représentant pas des partis (corrompus) mais des populations réelles, concrètes, inscrites dans l’histoire.
De quelques nationalistes écossais
Le clivage gauche/droite, tel qu’il est manipulé par les idéologies dominantes et leurs médias actuellement, n’est nullement de mise quand on évoque les pages de l’histoire du panceltisme. Ainsi, le nationaliste écossais, le baron Ruraidh Erskine, est un aristocrate de vieille famille mais aussi un marxiste et un socialiste, qui va transmettre au nationalisme écossais, jusqu’à nos jours où il enregistre ses meilleurs succès, une idéologie de gauche. Erskine est en faveur d’une “république socialiste d’Ecosse”, tout comme son compatriote John Mclean (1879-1923), mort des suites des tortures qu’il a endurées après avoir protesté contre “la guerre impérialiste imposée aux Ecossais” en 1914. Dix mille personnes suivent son cercueil jusqu’au cimetière, à Glasgow lors de ses obsèques. Erskine, qui prend le relais de ce martyr, encourage, outre la lutte ouvrière comme Connolly en Irlande avant 1914, des aspects plus traditionnels, plus culturels et littéraires, selon les bonnes habitudes prises en pays celtiques. Lewis Spence (1874-1950) s’intéresse ainsi au druidisme, à l’art magique, aux traditions celtiques en général. Hugh MacDiarmid (1892-1978) lance le mouvement de la “Scottish Renaissance” qui ne se borne pas à ressusciter le gaëlique écossais des franges littorales occidentales de l’Ecosse mais aussi les dialectiques germanisés (influencés par l’anglais et le norvégien) des autres territoires écossais. MacDiarmid est également, comme Erskine, partisan d’une “république radicale-socialiste d’Ecosse”. Il est l’un des fondateurs du SNP (“Scottish National Party”) en 1928, ce qui nous ramène à l’actualité britannique, où, justement, ce SNP a le vent en poupe et s’apprête à demander que se tienne un référendum sur l’indépendance de l’Ecosse. Les avatars du nationalisme écossais nous montrent clairement que les démarches panceltiques sont inséparables des questions sociales et du monde ouvrier traditionnel, teinté de marxisme mais d’un marxisme somme toute bien différent de ce que nous connaissons sur le continent.
L’itinéraire étonnant de Hugh MacDiarmid
Revenons à MacDiarmid: son marxisme, rappelle Peter Berresford Ellis, n’est ni celui d’un Marchais et du PCF ni celui de la RDA ou de l’URSS mais, bien évidemment, celui de Connolly. MacDiarmid a également eu sa (brève) période mussolinienne, ce qui étonnera plus d’un simplet qui gobe aujourd’hui les terribles simplismes des médias actuels. Mais Mussolini était un socialiste vigoureux, aimé de Lénine, et, surtout, apprécié de Jules Destrée chez nous, dont l’énorme statue de bronze se dresse sur une place à Charleroi, sans qu’on ne se rappelle qu’il fut un vibrant mussolinien! L’engouement passager de MacDiarmid pour Mussolini ne l’empêche pas de devenir communiste par la suite pour être exclu plus tard pour “déviationnisme national”. Cette exclusion ne l’empêche pas d’être réintégré, à un moment fort mal choisi, en 1956, immédiatement après l’intervention soviétique en Hongrie.
Exclusion des Bretons et discours de De Valera
La persistance d’une fidélité à Marx —qui avait réclamé l’indépendance de l’Irlande dès les années 60 du 19ème siècle et avait ébauché des plans précis pour concrétiser ce projet— fait qu’après la seconde guerre mondiale, les Bretons sont exclus de l’orbe panceltique, vu l’engagement de nombreux nationalistes dans une formation paramilitaire, la “Bezen Perrot”, mise sur pied et armée par l’occupant allemand, pour venger un prêtre philologue très populaire, le paisible Abbé Perrot, assassiné par des militants communistes pro-français. Le mouvement nationaliste breton, en porte-à-faux idéologique par rapport aux autres nationalismes celtiques des Iles Britanniques, subit la répression française de plein fouet à partir de la fin 1944. Dans les Iles, la situation est calme: l’Irlande est restée neutre et les Ecossais et les Gallois ont combattu dans le camp allié. En 1947 se crée la “Celtic Union”, avec l’appui du Président irlandais Eamon de Valera (1882-1975). Celui-ci adresse un message intéressant à relire à ses amis gallois. Peter Berresford Ellis nous en rappelle la teneur et la clarté: “En étant fidèles à leurs traditions et à leurs langues, même dans des circonstances qui peuvent être jugées très critiques, les Gallois ont prouvé qu’une nation peut préserver son individualité tant que sa langue, qui lui procure l’expression le plus parfaite de sa personnalité, demeure utilisée dans la vie quotidienne. Un lien fort relie le peuple du Pays de Galles à celui d’Irlande, non seulement parce tous deux procèdent de la même matrice celtique, mais aussi parce qu’ils marquent une dévotion aux choses de l’esprit; cette attitude a été prouvée au-delà de tout doute possible par le désir passionné de chacune de ces nations à préserver leur culture. Nos deux nations savent qu’en agissant ainsi, elles sauvegardent quelque chose qui enrichit l’humanité toute entière, et, en particulier, renforce les liens qui unissent les peuples celtiques entre eux”. On retiendra de ce discours la nécessité impérieuse de garder sa langue ou ses traditions dans la vie quotidienne. Aussi que toute politique sérieuse, acceptable, toute politique qui n’est pas inéluctablement vouée à sombrer dans la plus veule des trivialités, doit uniquement envisager les “choses de l’esprit”, comme le voulait aussi un précurseur fascinant du nationalisme irlandais au 19ème siècle, Thomas Davis. La primauté accordée au spirituel par De Valera en 1947 permet effectivement d’enrichir l’humanité entière: les idéologies et les pratiques politiques qui n’accordent pas cette primauté à la culture, à la mémoire, constituent donc, sous-entendu, autant de dangers pour tous les hommes, quelles que soient leurs origines, leur race, leur position sur la carte du globe.
En 1947, les Bretons sont toujours exclus des organisations faîtières panceltiques. Mais les Gallois et les Ecossais finissent par apprendre que la répression française ne frappe pas seulement les volontaires de la “Bezen Perrot”. D’autres Bretons, apolitiques et non collaborateurs, parfois fort hostiles à l’idéologie nationale-socialiste allemande, ont été assassinés par les Français, dont le poète Barz Ar Yeodet, l’historienne Madame de Gerny et les écrivains Louis Stephen et Yves de Cambourg. Ces dérapages, les Gallois ne peuvent les admettre. Ils envoient une délégation en Bretagne et en France qui mènera une enquête minutieuse du 22 avril au 14 mai 1947. Le rapport de cette délégation est accablant pour Paris. Il donne tort à la France sur toute la ligne. Les Gallois déclenchent alors une campagne de presse dans tout le monde anglo-saxon qui conduit notamment à la grâce du militant Geoffroy, condamné à mort. Les Bretons sont aussitôt réhabilités et à nouveau acceptés dans les organisations panceltiques: l’attitude de la France est si inacceptable aux yeux des nationalistes gallois marxisés que la collaboration avec l’Allemagne hitlérienne est considérée sans doute comme un pis-aller, de toutes les façons comme un dérapage inéluctable dans le contexte tragique de l’époque.
Sean MacBride
En 1948, les Unionistes pro-britanniques gagnent les élections en Ulster, créant de la sorte les conditions d’une partition définitive de l’Ile Verte. Cette victoire conduit à l’émergence du “mouvement anti-partition”, dont les objectifs se poursuivent encore de nos jours. De Valera: “Pour nous, c’est une simple question de justice. L’Irlande est une; c’est donc une injustice criante que nous soyons partagés entre deux Etats. La partition est un mal qui doit être rectifié”. Dans la suite de son discours, résumé par Peter Berresford Ellis, De Valera exprimait son espoir de voir les peuples celtiques apprendre davantage les uns des autres parce qu’une nouvelle société, partout dans le monde, ne pouvait se construire que sur base de rapports entre ethnies profondément enracinées et non sur base de rapports entre empires ou Etats multi-nationaux, dominés par une seule nation. Il n’y avait pas de meilleur plaidoyer pour un ethnopluralisme planétaire, l’année même où les blocs se formaient suite au “coup de Prague” et allaient enfermer les peuples jusqu’à la perestroïka dont les retombées n’apporteront pas l’émancipation mais un esclavage nouveau sous l’emprise du néo-libéralisme.
 Le ministre irlandais des affaires étrangères, Sean MacBride, fils de John MacBride, fusillé en 1916, avait été le chef de l’état-major de l’IRA. Cet avocat, fondateur du “Clann na Poblachta”, petit parti nationaliste radical, deviendra aussi le président d’Amnesty International, puis obtiendra le Prix Nobel de la Paix en 1974 et le Prix Lénine de la Paix en 1977! L’homme était un nationaliste irlandais pan-celte. Interviewé par le journal “Le Peuple breton”, il déclare, rappelle Peter Berresford Ellis: “Ce qui manque au monde, c’est un idéal basé sur un système où la liberté et la dignité humaines sont reconnues parce que la liberté, l’indépendance et l’intégrité des peuples sont protégées... les peuples celtiques peuvent aider (le monde) à propager cet idéal, qui est absent aujourd’hui”.
Le ministre irlandais des affaires étrangères, Sean MacBride, fils de John MacBride, fusillé en 1916, avait été le chef de l’état-major de l’IRA. Cet avocat, fondateur du “Clann na Poblachta”, petit parti nationaliste radical, deviendra aussi le président d’Amnesty International, puis obtiendra le Prix Nobel de la Paix en 1974 et le Prix Lénine de la Paix en 1977! L’homme était un nationaliste irlandais pan-celte. Interviewé par le journal “Le Peuple breton”, il déclare, rappelle Peter Berresford Ellis: “Ce qui manque au monde, c’est un idéal basé sur un système où la liberté et la dignité humaines sont reconnues parce que la liberté, l’indépendance et l’intégrité des peuples sont protégées... les peuples celtiques peuvent aider (le monde) à propager cet idéal, qui est absent aujourd’hui”.
De 1947 à 1954, l’idéal panceltique est porté, entre autres organisations, par la revue “An Aimsir Cheilteach”, soucieuse de l’avenir des langues sans exclure un souci profond et permanent pour les questions sociales, en bonne logique “connollyste”. Cet engagement social rapproche les militants panceltes du “Labour” britannique. Mais suscite aussi les moqueries acides de la presse anglaise. En France, la répression jacobine, portée par son habituelle bêtise à front de taureau, s’abat sur cette revue, qui est interdite. Car le recours aux “interdits”, en bonne logique orwellienne, est une pratique qui coïncide avec la devise de la “République”: liberté, égalité, fraternité... MacBride, avocat, estime, pour sa part, que c’est une violation des droits de l’homme et engage un procès contre l’Etat français, qu’il gagne bien évidemment. Comique: la patrie des “droits de l’homme”, qui se targue de cette qualité depuis les délires à l’emporte-pièce énoncés par le très médiatisé Bernard-Henri Lévy, a été condamnée pour violation des droits de l’homme, lors d’un procès mené par un ministre irlandais des affaires étrangères, Prix Nobel et Prix Lénine de la Paix et président d’Amnesty International... Un petit épisode à rappeler, un sourire narquois aux lèvres, quand on a devant soi un fort en gueule qui pontifie son pauvre catéchisme “droit-de-l’hommard” à la sauce BHL! L’hydre jacobine cède de mauvaise foi: la revue n’est plus interdite. On fait simplement pression pour qu’elle ne soit pas distribuée. Rien de nouveau sous le soleil!
Première session du “Conseil de l’Europe”
En 1949, se tient la première session du “Conseil de l’Europe”, présidé par Paul-Henri Spaak. Les délégués irlandais déclarent que “l’Europe a sombré dans un marécage” et que “la vision celtique (ethnopluraliste définie par De Valera et MacBride) peut la sauver”. John Legonna (1918-1978) abondait dans ce sens, lors de son discours: “par leur exemple et par l’action de leurs dirigeants, les peuples celtiques pourraient fournir à l’Europe une voie pour retrouver le salut et s’extraire du marais dans lequel s’enfonce progressivement la civilisation européenne. Nous, dans les pays celtiques, disposons de tous les éléments nécessaires pour mener à bien une tâche historique de la sorte. Nous, les Celtes, avons toujours une puissante contribution à offrir à la civilisation humaine”. Les délégués celtiques demandent la création d’une “Union Fédérale des Nationalités Européennes”, pour sauvegarder les droits des minorités ethniques. Ce sera en vain: la Grande-Bretagne bloque la résolution parce qu’elle ne veut pas que les Irlandais d’Eire ouvrent le dossier de la partition, qu’ils jugent inique. La France, elle, refuse la constitution d’une “Court européenne des Droits de l’Homme”! Encore un bon rappel pour les zélotes actuels... Les Irlandais, dépités, haussent les épaules: “encore une manifestation des ‘power politics’”, conclueront-ils.
Une autre figure, également mise en exergue par Peter Berresford Ellis, mérite d’être extraite de l’oubli, celle de la juriste galloise Noëlle Davies, auteur d’ouvrages sur le nationaliste romantique Danois Grundvigt et sur Connolly. Elle suggère, pour les peuples celtiques comme pour les peuples européens, un modèle “pan-nordique”, semblable à l’Union Scandinave. En 1961, la “Celtic League” élit comme Président le Breton Alan Heusaff, un ancien combattant de la “Bezen Perrot”, qui lance la revue “Cairn”, qui paraît toujours actuellement.
Le panceltisme, qui permet de penser le politique en dehors du clivage gauche/droite, tel que nous le subissons dans le prêt-à-penser dominant, ouvre des pistes non encore exploitées:
- l’anti-impérialisme en des termes euro-centrés, centré sur des identités européennes visibles et concrètes et non sur des identités loitaines difficiles à comprendre, soit un anti-impérialisme qui ne soit pas uniquement à l’usage de peuples du dit “tiers monde”, quoique ces derniers ont évidemment bien le droit d’en développer des formes propres, à leur bon usage; l’impérialisme contemporain pratique la colonisation mentale et la dépendance économique en Europe aussi: ce que bon nombre de tiers-mondistes des années 60 et 70 avaient oublié.
- Un socialisme réel, non détaché d’une certaine matrice marxiste, qui pourrait renouer aussi avec des filons fédéralistes-proudhoniens, comme l’avaient proposé les auteurs d’un groupe animé à Nice par Alexandre Marc ou certains théoriciens italiens; la solidarité populaire, génératrice de formes politiques socialistes, ne peut être optimale qu’au sein d’identité concrètes; les autres formes de socialismes s’accomodent trop aisément du système; on l’a vu avec le néo-libéralisme, la fausse “troisième voie” du travailliste Blair, le bellicisme de ce dernier, les timidités et les atermoiements des sociaux-démocrates qui fâchaient déjà James Connolly.
- Un féminisme sainement conçu dans le sillage d’une autre héroïne irlandaise, dont il faudra un jour parler à cette tribune, la Comtesse Markiewicz (1869-1927), où la citoyenne d’une république socialiste, nationaliste et panceltique aurait été un “zoon politikon” au même titre que les mâles.
- Une piste écologique intéressante, où la préservation de la nature est aussi un impératif dicté par le désir naturel de préserver les paysages exaltés par la poésie traditionnelle et les traditions populaires. Cette piste écologique est inséparable d’un recours au local, même de dimensions réduites, au nom du slogan “Small is beautiful” de Kohr et Schumacher, et surtout respectueuse des “lois de la variété requise”, selon l’idée qu’avait formulée le militant breton devenu citoyen irlandais, Yann Fouéré.
S’engager sur les pistes qu’ouvrent les études serrées du panceltisme ou du socialisme irlandais, comme celles réalisées par Peter Berresford Ellis, permet de s’insinuer profondément dans les dispositifs de nos adversaires, d’utiliser leur propre vocabulaire en lui donnant une épaisseur bien plus substantielle, en le ramenant de force à ses matrices historiques: en effet, la métapolitique d’en face procède par affirmations péremptoires, assénées par la répétition ad nauseam dans les “mainstream medias”, par une méthode Coué qui finit par saoûler. Toutes ses affirmations, aussi tonitruantes que boîteuses, qu’elles se réfèrent à une forme ou une autre de marxisme ou au corpus des “droits de l’homme”, sont posées comme détachées de tout contexte historique. Elles n’ont dès lors aucune consistance car leur donner consistance, en les plongeant dans un empirisme historique, serait les transformer en armes redoutables contre le système planétaire, aliénant et amnésique qui nous oppresse. Le nationalisme et le socialisme identitaires des Irlandais a bien fait fléchir l’Empire britannique au faîte de sa puissance. Le système ne veut pas de consistance car toute consistance est, en fin de compte, un matériau pour l’érection d’un môle de résistance à l’homogénéisation globale, à l’homocratie en marche (Jan Mahnert). Nous voulons redonner de la consistance à nos peuples pour qu’ils s’émancipent, tout comme BHL veut nous arracher à nos racines et à nos mémoires pour que nous soyons d’éternels moutons de Panurge. Le modèle irlandais est une bonne source d’inspiration pour réapprendreà résister.Une source d’inspiration à laquelle nous allons sans cesse retourner, ainsi qu’à d’autres chantiers similaires. J’espère que le résultat de ce colloque sera de susciter de telles vocations.
Robert Steuckers.
(Forest-Flotzenberg, février 2013; version finale: août 2013).
Notes:
(1) Peter Berresford Ellis, Historia de la clase obrera irlandesa, Ed. Hiru, Hundarribia (Guipuzcoa), 2013 (traduction espagnole d’un livre aujourd’hui épuisé et intitulé A History of the Irish Workig Class, 1985).
(2) F. S. L. Lyons, Culture and Anarchy in Ireland 1890-1939, Oxford University Press, 1982.
(3) F. S. L. Lyons, op. cit.; cf. également: Ruth Dudley Edwards, Patrick Pearse, The Triumph of Failure, Gollancz, London, 1977.
00:15 Publié dans Affaires européennes, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, politique internationale, pays celtiques, celtisme, celtitude, irlande, bretagne, pays de galles, europe, affaires européennes, robert steuckers |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 05 janvier 2010
Intégration ou isolement? Le dilemme de la Grande-Bretagne face au continent
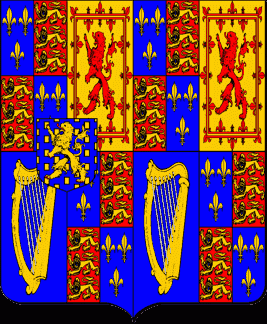 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES - 1990
Intégration ou isolement?
Le dilemme de la Grande-Bretagne face au continent
par Gwyn DAVIES
Le samedi 24 février 1990 s'est tenu à Londres le colloque annuel de l'association IONA. Sous la présidence de Mr. Richard Lawson, plusieurs orateurs ont pris la parole: le Prof. Hrvoje Lorkovic, Robert Steuckers, Gwyn Davies et Michael Walker. Vouloir publiera chacune de ces interventions. Nous commençons par celle de Mr. Davies.
A une époque de grande fluidité, lorsque des changements soudains bouleversent les modèles devenus conventionnels de la vie quotidienne, il est souvent nécessaire de juguler nos impulsions immédiates qui nous poussent à participer à l'euphorie générale que suscite la nouveauté. Lorsque des concepts jadis tenus pour intangibles et immuables s'effritent à une vitesse insoupçonnée, il est trop facile de se laisser porter par l'effervescence d'une liberté nouvelle. Mais l'homme rationnel doit maintenir une saine distance devant l'immédiateté provocatrice du changement, car le changement per se n'est pas un but en soi mais un simple catalyseur qui fera advenir un but. Les actions prestées à des époques aussi décisives ne doivent pas s'arcbouter sur le rien de l'éphémère mais, au contraire, réfléchir des analyses solides, denses et raisonnées. Car lorsque les pratiques conventionnelles subissent une révision radicale, des décisions doivent être prises rapidement, des choix doivent être posés; dans ces moments où nous sommes confrontés à des dilemmes, les fonctions sélectives de notre intelligence doivent pouvoir travailler à bon escient. Si les choses doivent se passer ainsi dans la vie personnelle de chacun d'entre nous, il est d'autant plus impératif qu'elles empruntent la même voie temporisatrice, réfléchie, délibérée, lorsque la destinée des nations est en jeu.
Lorsque les constantes rigidifiées de l'orthodoxie politique acceptée par tous sont challengées voire balancées par-dessus bord, lorsque la Grundnorm (la norme fondamentale) du gouvernement des Etats est minée et affaiblie derrière le paravent de la cohésion structurelle de l'ordre existant, les groupes sociaux qui souhaitent devenir des pièces influantes sur l'échiquier transformé n'enregistreront des succès, ne réaliseront leurs ambitions, que s'ils identifient correctement puis résolvent les questions-clefs que soulève la réalité nouvelle.
Susciter de nouveaux foyers d’énergie en Europe
Les événements récents qui ont agité la partie orientale de l'Europe au cours de ces derniers mois, ont soulevé l'espoir de voir disparaître la division artificielle du continent. Les deux blocs, aux contours bien distincts, qui se sont regardés en chiens de faïence depuis une quarantaine d'années, abrités derrière leurs retranchements respectifs (d'ordre tant physique que philosophique), se sont débarrassé aujourd'hui de leur antipathie mutuelle, au point de permettre à leurs satellites de dévier de leurs orbites préétablies.
En effet, avec l'implosion imminente de l'une des composantes du binôme USA/URSS, les liens gravitationnels qui avaient préalablement entravé le mouvement des planètes satellisées pourraient très bientôt se dissoudre. Mais les lois de l'ordre naturel nous enseignent que dans tout univers nouvellement émergé, de nouveaux foyers d'énergie doivent rapidement jaillir du chaos pour imposer de la discipline dans le vide désordonné. En gardant ces lois à l'esprit, il est d'une importance vitale de bien évaluer les modèles émergeants hors de ce bouillonnement de transformations et de forger, sur base de telles données, un concept global pour indiquer à la Grande-Bretagne la marche à suivre dans la décennie tumultueuse qui s'ouvre devant nous.
Le contexte historique des relations euro-britanniques
Avant de vous livrer notre contribution à l'élaboration de ce concept, il m'apparaît nécessaire de passer en revue le contexte historique des relations euro-britanniques.
D'abord, il me semble opportun de constater que les Iles britanniques n'ont pas eu la moindre influence sur la scène européenne avant la conquête normande. L'installation par la force d'une aristocratie étrangère a conduit l'Angleterre à participer activement aux rivalités et machinations des dynasties de l'Occident chrétien et, plus particulièrement, à la longue lutte d'hégémonie avec les Capétiens de France. Le rêve angevin d'un Etat anglo-français faillit réussir après le mariage d'Henri II avec Eléonore d'Aquitaine mais le projet s'enlisa dans une orgie de luttes fratricides. Après l'échec de cette union, le Royaume d'Angleterre n'a plus eu la possibilité de jouer un rôle déterminant sur la scène politique européenne et les Français affrontèrent seuls les faiblesses du Saint Empire et les prétentions fragiles des Hohenstaufen.
Dès le début du XIIIième siècle, la Couronne anglaise ne s'engagea plus qu'à la périphérie de l'arène européenne en jouant le rôle d'un agent interventionniste. Beaucoup, sans doute, ne seront pas d'accord avec mon affirmation et citeront, pour la réfuter, les triomphes d'Edouard III et de Henri V en France et la grandiose participation du Prince Noir dans la querelle pour la succession au trône de Castille. Il n'en demeure pas moins vrai que, malgré les épisodes héroïques de Crécy, Poitiers, Navarette et Azincourt, l'Etat anglais fut incapable de transformer ses succès tactiques en gains stratégiques permanents.
Avec le début de la Guerre des Deux Roses (entre les partis de York et de Lancaster), la Guerre de Cent Ans touchait à sa fin et le conflit interne, très sanglant, qui se déroula sur le sol anglais, empêcha toute déviation des forces nationales vers des objectifs étrangers.
Ce ne fut pas avant le règne de Henri VIII que l'appétit pour les engagements transnationaux revint à la charge, aiguillonné par le tort causé au commerce de la laine flamande par la rivalité entre les maisons de Valois et de Habsbourg. L'intervention théâtrale et sans conséquence du Roi Henri peut être considérée comme la dernière expression de l'ancienne doctrine de l'absolutisme monarchique. Ses royaux successeurs ne purent plus se payer le luxe de traiter la politique étrangère comme un instrument au service de leurs ambitions personnelles.
L’ère impériale commence
avec Elizabeth Ière
L'ère élizabéthaine ouvrait un âge nouveau. La philosophie du temps s'accomodait parfaitement aux exigences du commerce, dont les demandes pressantes annulaient tous les autres impératifs qui tentaient de s'imposer à la Cour. Le commerce devint ainsi le premier moteur de l'action royale. La Couronne répondit au défi économique en élargissant ses perspectives et en adoptant une vision impériale, reflet de sa propre gloire et de l'agitation vociférante des princes marchands dont les fortunes aidèrent à asseoir l'ordre intérieur.
L'hégémonie monolithique des Habsbourgs d'Espagne sur le commerce avec l'Orient créa un goulot d'étranglement et obligea les négociants britanniques à chercher d'autres voies de communication; la royauté marqua son accord tacite pour l'organisation de telles expéditions; des compagnies à participation se mirent à proliférer, tirant profit des découvertes et de leur exploitation. Les bénéfices engrangés grâce au trafic d'esclaves et à la piraterie frappant les possessions espagnoles dans le Nouveau Monde ont conféré une légitimité officielle à l'idéologie expansioniste. Et comme les raiders et les marchands avaient besoin de bases et que les bases demandaient à être défendues, l'Angleterre élabora une stratégie coloniale pour protéger et fournir en matériaux divers ses postes d'outre-mer. L'existence même de ces dépendances lointaines postulait l'inévitable développement de colonies, car colons, soldats et artisans débarquaient sans cesse dans les comptoirs initiaux, processus qui assurait la promotion et l'expansion du commerce.
La protection des routes commerciales conduisit l'Angleterre à mener des guerres successives contre les puissances continentales, la Hollande, la France et l'Espagne. Ces guerres induisirent à leur tour la politique de Balance of Power (équilibre de puissance), qui atteindra son abominable apex dans les désastres humains de la première guerre mondiale.
En résumé, l'approche doctrinale des Britanniques vis-à-vis des querelles continentales était la suivante: soutien politique et militaire au parti ou à l'alliance dont la victoire empêcherait la création d'un bloc unitaire hostile disposant de suffisamment de ressources pour priver l'Etat britannique de l'oxygène du commerce. Les résultats engrangés par ce calcul astucieux ont été énormes; il suffit de se remémorer les triomphes britanniques à la suite de la Guerre de Succession d'Espagne (1701-14) et de la Guerre de Sept Ans (1756-63). A la fin de ce conflit, le continent nord-américain était devenu chasse gardée de la Grande-Bretagne et sa suprématie maritime pouvait faire face à tous les défis.
Arrivé au sommet de sa puissance, le régime des rois hannovriens oublia les prudences d'antan et poursuivit les projets d'outre-mer dans le plus parfait isolement. Mais cet oubli de la politique européenne traditionnelle coûta très cher; il entraîna la perte des treize colonies américaines rebelles, soutenues par ses alliés européens, trop heureux de porter des coups durs à la vulnérable Albion.
La clef de la suprématie britannique: le système des coalitions
Mais les leçons de la défaite américaine ont été rapidement assimilées. Les guerres de la Révolution et de l'Empire offrirent l'occasion de remettre en jeu les règles du système des coalitions. Tandis que les alliés de l'Angleterre recevaient de considérables subventions et affrontaient les Français sur terre, les Britanniques agissaient sur mer avec brio, contrôlaient les voies de communication maritimes et purent ainsi survivre au blocus continental napoléonien, fermé au commerce britannique, et à la défaite de toutes les puissances européennes devant les armées de l'Empereur corse.
 Ensuite, après l'effondrement des rêves bonapartistes de conquête de l'Orient consécutif à la bataille perdue du Nil, les Britanniques purent débloquer des ressources considérables pour asseoir leur domination aux Indes et s'emparer de colonies étrangères dont le site détenait une importance stratégique. Au Congrès de Vienne en 1815, c'est un second Empire britannique, fermement établi, qui se présentait face aux autres puissances européennes.
Ensuite, après l'effondrement des rêves bonapartistes de conquête de l'Orient consécutif à la bataille perdue du Nil, les Britanniques purent débloquer des ressources considérables pour asseoir leur domination aux Indes et s'emparer de colonies étrangères dont le site détenait une importance stratégique. Au Congrès de Vienne en 1815, c'est un second Empire britannique, fermement établi, qui se présentait face aux autres puissances européennes.
Dès le début du XIXième siècle, une destinée impériale prenait son envol et allait occuper toutes les imaginations britanniques pendant près d'un siècle. Les troubles intérieurs qui agitaient les puissances rivales permirent à cette destinée de se déployer sans opposition. L'Europe perdait tout intérêt aux yeux des Anglais. J'en veux pour preuves les abandons successifs d'atouts stratégiques en Europe continentale: la dissolution de l'union avec le Royaume du Hannovre en 1837 et, plus tard, l'abandon d'Héligoland pour obtenir des réajustements de frontière en Afrique orientale.
Les Indes: pièce centrale de l’Empire britannique
L'ère de la Splendid Isolation commençait et les seules menaces qui étaient prises en compte, étaient celles qui mettaient l'Empire en danger, et plus particulièrement les Indes. De là, le souci quasi hystérique qui s'emparait des milieux décisionnaires londoniens lorsque la fameuse «question d'Orient» faisait surface et l'inquiétude qui les tourmentait face à l'expansionisme des Tsars en Asie Centrale. Avec toutes les ressources de ses vastes domaines d'outre-mer, la Grande-Bretagne se croyait à l'abri de toute attaque directe et les paroles de Joseph Chamberlain, prononcées en janvier 1902, sont l'écho de cette confiance: «Nous sommes le peuple d'un grand Empire... Nous sommes la nation la plus haïe du monde mais aussi la plus aimée... Nous avons le sentiment de ne pouvoir compter que sur nous-mêmes et c'est pourquoi j'insiste en disant que c'est le devoir de tout homme politique britannique et que c'est le devoir du peuple britannique de ne compter que sur eux-mêmes, comme le firent nos ancêtres. Je dis bien que nous sommes seuls, oui, que nous sommes dans une splendid isolation, entourés par les peuples de notre sang».
Mais au moment même où ces paroles étaient prononcées, les réalités politiques du jour heurtaient de plein fouet cette arrogance. L'alliance anglo-japonaise de 1902 marquait une limite dans le déploiement de la politique étrangère britannique: Londres était obligée d'abandonner les «formules obligatoires et les superstitions vieillottes» (comme l'affirma Lansdowne à la Chambre des Lords), c'est-à-dire ne plus considérer l'isolement comme désirable et adopter à la place une approche plus active de la scène internationale, avec un engagement limité auprès de certaines puissances pour des objectifs spécifiques.
L'Allemagne wilhelmienne, aveuglée par les possibilités d'un destin impérial propre, renia, à cette époque, les principes de la Realpolitik, en rejetant toutes les offres d'alliance britanniques. La conséquence inévitable de ce refus fut le rapprochement anglo-français, avec l'Entente Cordiale de 1904, impliquant la résolution à l'amiable des querelles coloniales qui, jusqu'alors, avaient envenimé les relations entre les deux puissances occidentales. Cette amitié nouvelle fut encore renforcée par les crises successives au Maroc et par la «conciliation des intérêts» entre Russes et Britanniques au détriment de la Perse.
La polarisation en Europe était désormais un fait et l'équilibre savamment mis au point par Bismarck pour éviter une tragédie fatale fut remisé au placard et tous se précipitèrent avec une criminelle insouciance vers la destruction mutuelle. L'inutile catastrophe que fut la première guerre mondiale blessa et mutila l'Europe au point que même les puissances victorieuses en sortirent exsangues et épuisées par leur victoire à la Pyrrhus. Non seulement ce conflit inutile sema les graines de misères futures mais tous les protagonistes furent désormais exposés aux usurpations extra-européennes. Les bénéficiaires réels des carnages de la Somme et de l'Isonzo, de Verdun et de Tannenberg, furent des puissances observatrices et opportunistes, des belligérants prudents, comme le Japon et les Etats-Unis. Par le sacrifice de ses soldats dans la Forêt d'Argonne, les Etats-Unis, par le droit du sang versé, demandèrent à siéger à la Conférence de Versailles. Pour la première fois, une ombre transatlantique voilait un soleil européen, pâle et malade. La puissance américaine n'était encore qu'au stade de l'enfance et, bien que ses marchands avaient exploité à fond les opportunités laissées par les Européens occupés à s'entre-déchirer et avaient systématiquement braconné les anciens marchés réservés de l'Europe sur les autres continents, de vastes zones du globe restaient à l'abri de la pénétration américaine grâce au protectionnisme colonial.
Le premier après-guerre
Durant ces années cruciales du premier après-guerre, quand la marée montante des nationalismes envahissait les débris d'anciens empires continentaux, la Grande-Bretagne quitta, dépitée, le théâtre européen, pour se vautrer une nouvelle fois dans les délices nostalgiques de sa gloire impériale d'antan. Mais la puissance de l'Empire s'était ternie dès les années 90 du siècle passé, lorsque le principe du Two Power Standard (équilibre des forces entre, d'une part, la Grande-Bretagne, et, d'autre part, les deux nations les plus puissantes du continent) ne s'appliquait plus qu'à la flotte. Dans les années 30, qu'en était-il de ce tigre de papier? N'était-ce plus qu'illusion?
Tandis que les Français cherchaient à contrer une Allemagne renaissante en forgeant un jeu d'alliances complexes avec des Etats est-européens et balkaniques, les Britanniques restaient stupidement aveugles. La politique étrangère du gouvernement national-socialiste allemand fonctionnait à l'aide du Führerprinzip. Les signes avant-coureurs d'un désastre imminent étaient parfaitement perceptibles. Mais un malaise débilitant paralysait les ministères britanniques successifs. La crise tchécoslovaque demeurait, pour ces diplomates, «une querelle dans un pays lointain, entre des peuples dont nous ne savons rien». L'arrogance et l'ignorance venaient d'atteindre leur apogée.
L'incapacité de Neville Chamberlain à saisir le projet hitlérien dans sa totalité apparaît à l'évidence dans les garanties aussi pieuses que sans valeur que son gouvernement accorda à toute une série d'Etats est-européens instables. Ces gestes vains ne firent rien pour arrêter les ambitions germaniques et ne servirent qu'à entraîner la Grande-Bretagne dans une guerre où la victoire était impossible et la défaite inévitable.
Si la première guerre mondiale avait permis aux Etats-Unis d'entrer dans un club d'élite de «courtiers de puissance» internationaux, la seconde leur permit d'assumer simultanément les rôles de Président et de trésorier. A la Grande-Bretagne, il ne restait plus qu'à devenir le secrétaire scrupuleux, qui enregistre et annonce les motions décidées par le patron-contrôleur.
Les buts de guerre des Etats-Unis
Les Etats-Unis ne sont pas entrés dans le conflit à son début, animés par une ferveur libérale, par le feu d'une croisade. Ils sont entrés en guerre à contre-cœur, contraints d'agir de la sorte par une agression japonaise délibérée. Mais dès que leurs forces pesèrent dans la balance, les Etats-Unis décidèrent que leurs sacrifices pour la cause de la liberté ne seraient pas si vite oubliés et que le monde devrait leur en savoir gré. Le prix exigé par les Américains pour la sauvegarde de l'Europe était élevé: c'était le remodelage du Vieux Continent ou, du moins, de sa portion dite «libre». L'Europe devait être à l'image de ses libérateurs et le Plan Marshall était l'instrument destiné à provoquer la métamorphose.
Il n'est guère surprenant que les Américains aient largement réussi dans la tâche monumentale qu'ils s'étaient assignée, à savoir transformer l'Europe sur les plans culturel et économique. Le Vieux Continent, ébranlé, a été obligé d'embrasser la main tendue qui offrait les moyens de la reconstruction, quelqu'aient d'ailleurs été ces moyens. Les Etats-Unis utilisèrent l'aide alimentaire et les transfusions de dollars pour reconstituer les économies des pays tombés dans leur sphère d'influence. Les Soviétiques utilisèrent, quant à eux, des moyens nettement plus frustes: l'Armée Rouge comme élément de coercition et la mobilisation en masse des forces de travail. Quoi qu'il en soit, l'assistance américaine précipita les bénéficiaires dans un réseau étroit de dépendance économique. Par leur «générosité» magnanime, les Etats-Unis s'assurèrent la domination de leur zone de comptoirs à l'Ouest de l'Elbe pendant quelque deux décennies après la fin de la guerre.
Si tel était le magnifique butin ramassé par les Américains, que restait-il aux Britanniques, sinon les fruits amères d'une défaite réelle mais non formelle? Les années d'austérité qui s'étendirent jusqu'à la fin des années 50 ternirent la «victoire» et mirent cruellement en exergue le coût de la guerre. L'Empire se désagrégea lentement, malgré la conviction têtue que la nation britannique restait un arbitre dans les affaires du monde. Cette illusion fit que les Britanniques se préoccupèrent d'une stratégie globale, au détriment d'une stratégie européenne. L'énorme charge des budgets militaires, due à cette volonté de garder une position en fait intenable, retarda la restructuration économique de la métropole, ce qui provoqua la chute de la livre sterling, devant un dollar qui ne cessait de monter.
Et malgré le désir de préserver le statut de super-puissance pour la Grande-Bretagne, la politique des gouvernements successifs ne put nullement ôter aux observateurs objectifs l'impression que notre pays n'était guère plus qu'un pion de l'Amérique. L'opération de Suez, qui sera un fiasco, fut lancée par l'état-major britannique malgré l'opposition de Washington. La réaction négative du State Department suffit à arrêter prématurément l'opération, ce qui contribua à aigrir les relations franco-britanniques pendant toutes les années 60. La Grande-Bretagne battit sa coulpe et ne tenta plus aucune intervention unilatérale sans recevoir au préalable l'imprimatur de son «allié» d'Outre-Atlantique.
Les «special relationships»
Les fameuses special relationships, dont on parle si souvent, sont effectivement spéciales, car quel Etat souverain délaisse volontairement ses intérêts légitimes pour satisfaire les exigences stratégiques d'un partenaire soi-disant égal? Le mythe de la dissuasion nucléaire indépendante de la Grande-Bretagne montre le véritable visage de ces «relations spéciales»: car sans la livraison par les Etats-Unis des fusées lanceuses, sans leur coopération dans la conception des bombes, sans leurs matériaux nucléaires, sans les facilités qu'ils accordent pour les essais, sans leurs plateformes de lancement, sans leurs systèmes de navigation et sans leurs informations quant aux objectifs, où résiderait donc la crédibilité de l'arme nucléaire anglaise?
Un tel degré de dépendance à l'endroit de la technologie militaire américaine fait qu'un flux continu de concessions part de Londres pour aboutir à Washington: cela va des arrangements particuliers qui permettent aux forces américaines d'utiliser des bases britanniques d'outre-mer —ce qui réduit à néant les discours pieux sur l'auto-détermination— jusqu'aux droits de décollage et de survol pour les appareils de l'USAF en route pour attaquer des Etats tiers, sans que le gouvernement britannique ne soit mis au courant! Toutes ces concessions font que les Européens perçoivent de plus en plus souvent la Grande-Bretagne comme un simple pion dans la politique américaine; la promptitude empressée de nos politiciens qui obéissent aux moindres lubies du Pentagone signale qu'ils accordent une pleine confiance aux requêtes de Washington.
L'affaire de Suez, au moins, a prouvé la fragilité de l'édifice impérial. La course au désengagement qui s'ensuivit conduisit à accorder l'indépendance tant aux colonies qui la désiraient qu'à celles qui ne la désiraient pas. Le «rôle global» du Royaume-Uni ne se justifiait plus, ne méritait plus les soucis et l'attention qu'on lui avait accordé dans le passé. Pendant ce temps, la situation changeait en Europe.
Le défi du Traité de Rome
En 1957, les Six signent le Traité de Rome et mettent ainsi sur pied deux corps supra-nationaux, la CEE et l'EURATOM, destinés à compléter la CECA déjà existante. Le but déclaré de ces organisations, c'était de favoriser une plus grande unité entre les Etats participants par l'harmonisation des lois et par une libéralisation des régimes commerciaux. Inutile de préciser que ces changements ne suscitèrent que fort peu d'enthousiasme en Grande-Bretagne; les Traités furent ratifiés avant le discours de Macmillan (Wind of Change), quand le Royaume-Uni se laissait encore bercer par la chimère de la Commonwealth Preference (La préférence au sein du Commonwealth). Mais l'institution de tarifs douaniers communs par les Etats membres de la CEE frappait les marchandises d'importation venues de l'extérieur. Il fallait répondre à ce défi et c'est ainsi que le RU devint l'un des principaux signataires du Traité de Stockholm de 1959, établissant l'AELE (Association Européenne du Libre Echange; EFTA en anglais). Cette Association fut créée comme un simple mécanisme destiné à faciliter le commerce et n'avait pas d'objectifs en politique extérieure allant au-delà des buts purement mercantilistes.
Il apparut très vite que l'adhésion à l'AELE/EFTA n'était pas un substitut adéquat à la pleine adhésion à la CEE. Rapidement, les représentants des intérêts commerciaux de la Grande-Bretagne exercèrent une pression constante sur le gouvernement, afin qu'il leur garantisse un accès préférentiel aux marchés plus lucratifs, c'est-à-dire qu'il demande la pleine adhésion du RU à la CEE. Macmillan s'exécuta et la première demande britannique fut soumise en juillet 1961, pour être finalement rejetée par De Gaulle en 1963, à la suite de longues négociations inutiles. L'opposition française n'empêcha pas qu'une seconde demande fut formulée en 1967. L'amertume laissée par l'affaire de Suez était passée. Et la Grande-Bretagne entra finalement dans la Communauté le 1 janvier 1973, en même temps que l'Irlande et le Danemark. Un référendum en 1975 donna des résultats en faveur de l'adhésion: 67% des votants ayant émis un avis favorable. Les rapports ultérieurs du RU avec la CEE furent souvent turbulents et difficiles, ce qui trahit la profonde ambiguïté des attitudes britanniques à l'égard des principes constitutifs de l'eurocentrisme.
La Grande-Bretagne reste en marge de l’Europe
A tort ou à raison, la Grande-Bretagne se perçoit toujours comme une nation à part, jouissant d'un lien particulier, bien que souvent ambigu, avec les pays associés au Commonwealth, lesquels forment un monde où les affinités historiques acquièrent fréquemment plus d'importance que la solidarité interne.
L'influence pernicieuse des «relations spéciales» freine le développement d'une approche plus eurocentrée des relations internationales. Lorsque les intérêts militaires américains exigent que les politiques nationales de Londres et de Washington soient parallèles, comment cela peut-il être possible, comment la collaboration RU/USA peut-elle s'avérer rentable, si la Grande-Bretagne participe activement à un système protectionniste eurocentré? Il vaudrait la peine de noter le nombre de fois où le gouvernement britannique a résisté aux initiatives communautaires parce qu'elles offusqueraient inutilement Washington et provoqueraient une «guerre commerciale» soi-disant au détriment de tous.
De plus, malgré que la Grande-Bretagne ait accepté l'Acte Unique Européen, dont le premier article déclare que «les communautés européennes et que la coopération politique européenne auront pour objectif de contribuer ensemble à faire des progrès concrets en direction de l'unité européenne», Londres ne respecte que formellement ces aspirations. Tout ce qui va au-delà des paramètres de pure coopération économique est perçu d'un très mauvais oeil à Westminster et les privilèges locaux et étriqués de la Grande-Bretagne sont défendus fanatiquement, bec et ongles.
Pareilles équivoques ne donnent nullement confiance aux autres Européens; la crédibilité de la Grande-Bretagne est ruinée. De plus en plus de voix réclament la construction d'une Europe à deux vitesses avec, d'une part, les Etats récalcitrants relégués à un étage inférieur, de façon à permettre aux éléments plus progressistes de poursuivre le rêve de l'unité sans trop d'entraves. Tandis que la Grande-Bretagne croupit, asservie, sous le régime thatchérien, il semble inconcevable qu'une convergence réelle puisse un jour avoir lieu entre les partenaires européens.
Alors que notre gouvernement proclame à grands cris l'importance du progrès scientifique et technologique, la contribution britannique à l'Agence Spatiale Européenne est incroyablement basse. Alors que notre gouvernement se déclare le défenseur impavide de la livre sterling, il refuse de participer au mécanisme de stabilisation qu'est le serpent monétaire européen. Voilà qui est absolument déconcertant. Si des objectifs éminement conservateurs comme ceux-là ne sont même pas activement poursuivis, pourquoi nous étonnerions-nous que le gouvernement de Madame Thatcher s'oppose implacablement à l'augmentation des droits des travailleurs grâce à une nouvelle Charte sociale?
Dans tous ses domaines, le RU exerce ses prérogatives pour bloquer et retarder les résolutions de la Communauté et pour satisfaire ses propres objectifs, en fin de compte négatifs pour le salut du continent. Si cette opposition s'appuyait sur une critique tranchante des principes mécanicistes et bureaucratiques qui sous-tendent le processus d'unification européenne porté par les institutions communautaires, la position britannique jouirait d'un certain capital de sympathie. Mais, malheureusement, cette hostilité ne consiste pas en une censure permanente et constructive du modus operandi; au contraire, elle présente toutes les caractéristiques d'un nombrilisme malsain et pervers. En effet, cet égoïsme étroit, justifié par l'«intérêt national», nous oblige à nous demander si le RU doit demeurer associé au processus d'unification européenne, tant que la seule justification qu'il évoque pour son engagement, repose sur la base douteuse de l'expédiant économique.
Une orientation européenne sans arrière-pensées pour la Grande-Bretagne
Or c'est précisément aujourd'hui, en ces jours décisifs, dans le tourbillon de changements qui balaye ce dualisme moribond auquel nous devons la division de notre continent, que les têtes pensantes en Grande-Bretagne doivent se mobiliser pour construire le futur de l'Europe. Ces têtes pensantes doivent ignorer les événements périphériques de l'Afrique du Sud et de Hong Kong, montés en épingle pour les distraire. Ce sont des soucis résiduels, hérité d'un Empire qui est bel et bien mort aujourd'hui. Le seul défi actuel consiste, pour nous, à définir quelles relations le RU entretiendra avec l'Europe. Cette question cruciale nous conduit à un dilemme tranché. En effet, deux voies, qui s'excluent l'une l'autre, s'offrent à notre choix: celle de l'isolement et celle de l'intégration.
La première de ces voies ne demande pas un effort particulier de lucidité car la politique actuelle de la Grande-Bretagne accentue déjà la tendance au désengagement en Europe. Cependant, il nous faudra bien mettre en évidence les dangers inhérents à ce retrait.
Un exemple: combien de temps le programme Inward Investment (Investissement intérieur), tant vanté par Madame Thatcher, survivra-t-il dans un RU découplé? Après tout, le rôle de Cheval de Troie pour les industries japonaise et américaine, que joue notre pays, n'est possible que parce que les investisseurs nippons et yankee considèrent le RU comme une tête de pont vers la CEE, idéale pour les opérations «tourne-vis». Ces opérations seraient rapidement évacuées ailleurs si disparaissaient les opportunités de pénétrer le marché européen dans sa totalité.
Certes, les conséquences économiques d'un repli sur soi seraient catastrophiques. La menace qui pèse sur nous est toutefois plus terrible encore si on l'envisage d'un point de vue plus large. Si le RU prend ses distances par rapport à l'Europe, sans plus avoir d'ancrage de sécurité dans un Empire, il dérivera, erratique, sur la mer des relations internationales sans motivation et sans punch. Très rapidement, notre nation se réduirait à un simple appendice des puissants Etats-Unis et perdrait, dans la foulée et sans doute à jamais, tout vestige de son ascendance morale et culturelle.
Avec un tel destin à l'horizon, la perspective de voir un RU isolé, survivant comme une entité bien distincte au XXIième siècle, s'avère pure illusion. La seule vraie chance de préserver l'héritage culturel unique de nos îles, c'est, paradoxalement, de les immerger dans un idéal européen. Cette solution n'est pas aussi contradictoire qu'elle en a l'air à première vue car l'éthos européen n'exige pas un renoncement total à nos identités (à rebours du modèle américain si vorace et destructeur). L'éthos européen appelle une synthèse entre l'élément national/ethnique et le projet continental. L'élément national/ethnique acquiert ainsi un sens du contexte civilisationnel, soit un sens vital du destin. Le concept d'Europe peut s'accomoder de la multiplicité de ses composantes sans mutiler celles-ci par quelque concentration artificielle, par quelque corset de conformisme.
Dans cette optique, l'idée d'une «Europe aux cent drapeaux» demeure parfaitement compatible avec l'objectif d'un continent plus fort et plus confédéré. Les progrès dans le sens de l'hétérogénéité doivent toutefois toujours avancer dans le même sens que la marche à l'unité, si l'Europe veut éviter les pièges des monolithismes de tous ordres.
Comme la réunification allemande est désormais davantage une question de calendrier que de conjoncture, il existe un risque réel de voir les faibles économies est-européennes basculées dans une nouvelle Mitteleuropa germanocentrée. Les tentations de se livrer à un paternalisme germanique menacent la logique d'une Europe des peuples, car la diversité serait asphyxiée sous une uniformité germano-industrielle, terreau sur lequel pourraient germer de nouvelles idéologies autoritaires. Un tel scénario doit être évité à tout prix, si l'on veut faire l'économie d'un conflit. La Grande-Bretagne ne doit pas fuir ses responsabilités et doit participer à la sécurité collective du continent.
La notion de Balance of power est sans doute démodée. Mais sauf si l'on pousse le processus d'unification européenne jusqu'à son ultime conclusion, avec la pleine participation de toutes les nations européennes dans l'enthousiasme, le retour de cette vénérable doctrine serait inévitable pour contrer les prédominances dangereuses. Dans le cas particulier qui nous préoccupe, l'énergie déployée par la ferveur pangermanique ne pourra être canalisée que par le consensus et non par la coercition, de façon à ce que, demain, l'Europe puisse être une et que tous les peuples du Continent puissent prospérer avec une égale vigueur.
Nous, peuples des Iles britanniques, devons être prêts à renier l'hypocrisie et la rhétorique propagée pendant des siècles de désintérêt hautain puis embrasser avec une conviction venue tout droit du cœur notre identité européenne réelle et concrète. La barrière illusoire que constitue le Pas-de-Calais a longtemps été plus difficile à traverser pour nous que les immensités de l'Atlantique. Toutefois, le retour de la vraie perspective européenne doit recevoir la priorité absolue. Reconnaître notre héritage européen commun, vouloir agir positivement à la lumière de cette évidence, voilà les impératifs vitaux à honorer si nous voulons préserver la paix, si nous voulons résister puis repousser l'avance d'une culture créole globale, faites de bric et de broc.
Gwyn DAVIES.
00:07 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, grande-bretagne, iles britanniques, angleterre, pays de galles, ecosse, politique, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 12 janvier 2009
Les Gallois: une nation qui refuse de mourir

Archives de SYNERGIES EUROPEENNES / VOULOIR - 1989
Les Gallois: une nation qui refuse de mourir
par Gwyn DAVIES
Je voudrais vous parler aujourd'hui du Pays de Galles et des Gallois, une nation à laquelle on dénie le droit de vouer un culte à son héritage et d'avoir sa place juridiquement parlant au sein de l'ordre international des Etats. Et pourtant cette nation survit toujours sous une forme reconnaissable et conserve tous les attributs nécessaires d'un Etat, même si des forces extérieures l'empêchent d'exercer sa fonction souveraine en toute indépendance. Cette nation a magnifiquement résisté à la culture étrangère qu'on lui a imposée, une culture perverse, envahissante qui a déjà corrompu et édulcoré bien des peuples dans le monde.
A notre époque, où l'auto-détermination est invoquée comme un droit naturel de l'homme et où les mouvements de libération nationale dans le tiers-monde sont acceptés avec la ferveur des croisades, il s'avère tout à fait impossible de contester intellectuellement la légitimité de la lutte pour la liberté des populations indigènes d'Europe, enfermées dans les structures étatiques actuellement existantes. Nous sommes au crépuscule des empires coloniaux et les derniers restes de ces vieilles instances peuvent aisément se repérer dans les colonies intérieures, retranchées à l'intérieur même des frontières de la plupart des Etats européens modernes. Le Pays de Galles est l'une de ces colonies.
C'est un objet d'étonnement pour tous d'apprendre que ce promontoire occidental des Iles Britanniques ait pu maintenir son identité et son caractère face à l'hostilité incessante de la puissance occupante au cours de près de vingt siècles. C'est l'histoire de cette résistance remarquable que je vais tenter de vous résumer aujourd'hui.
Du départ des légions romaines à l'époque arthurienne
Après le départ des légions romaines au début du Vième siècle, la province de Britannia dut assumer seule sa défense. L'historien grec Zozime nous relate cet épisode: «Les Bretons prirent les armes et, bravant le danger pour la sauvegarde de leur indépendance, libérèrent les cités des barbares qui les menaçaient». Les ennemis des Bretons étaient nombreux et menaçaient l'île de toutes parts. Le danger majeur, toutefois, était représenté par l'invasion et l'installation sur les côtes est et sud de tribus germaniques migrantes, connues sous le nom collectif de Saeson, ainsi que les nommait la population autochtone.
Pendant cette période romantique, cet «âge héroïque», l'Etat romano-breton se fragmenta en plusieurs petits sous-royaumes guerroyant entre eux. Chaque regulus luttait pour établir sa propre domination sur ces cymru (= compatriotes), au moins avec le même zèle qu'il combattait les barbares. Malgré les efforts de chefs comme Ambrosius Aurelianus et le légendaire Arthur, les Saeson (que nous appelerons "Anglais" par facilité dans la suite de ce texte) poursuivirent inlassablement leur avance vers l'Ouest.
En 577, la bataille de Dyrham coupa les Bretons du sud-ouest de leurs compatriotes du nord. En 615, la bataille fatidique de Chester interrompit les communications entre Ystrad Clud, le «Vieux Nord» et la région que l'on appelera par la suite le «Pays de Galles».
A cette époque où les Anglais s'accrochent et s'installent, les Bretons parvinrent quand même à repousser des envahisseurs irlandais qui s'étaient établis sur leurs côtes occidentales. De puissantes dynasties s'imposèrent à Gwynedd, Deheubarth et Powys dans l'actuel Pays de Galles. Ce sont ces dynasties qui incarnèrent au mieux la résistance des Gallois à l'agression anglaise, agression violente dont témoigne l'horrible massacre de 1200 moines à Bargor-Is-Coed par Aethelfrith, Roi de Northumbrie. Ce grand monastère et scriptorium était un centre d'érudition et témoignait de la continuité de la civilisation romaine, dont les Bretons étaient les fidèles héritiers.
Le triomphe des Northumbriens à Chester permit d'étendre la puissance anglaise dans tout le pays breton, situation qui connut son point culminant dans l'invasion de Gwynedd et la fuite de Cadwallon, son souverain, en Irlande.
Mais Cadwallon ne devait pas mourir ignominieusement en exil. Dès son retour, il leva une armée contre les Anglais qui furent mis en déroute en 632 à la bataille de Meigen. Leur chef, le puissant Edwin, mourut au combat. On apprend, par la plume de Bède le «Vénérable», propagandiste anti-breton virulent, quelles étaient les intentions de Cadwallon: «totum genus Anglorum Brittaniae finibus erasorum se esse deliberans» («ils complotèrent entre eux d'exterminer toute la race des Anglais présente dans le pays de Bretagne»). Que Cadwallon ait ou non planifié un tel génocide, il est clair que ses actions visaient la restauration de la domination bretonne dans les territoires conquis par les Anglais.
Le grand projet de Cadwallon ne se réalisa pas à cause de son décès précoce. Toutefois, sa marche vers l'est détruisit la prééminence de la Northumbrie. Les Bretons du Pays de Galles, bien que coupés de leurs frères du Nord, n'auront plus jamais à faire face à un danger anglo-saxon aussi mortel pour leur existence.
Arrêt de la progression anglaise et guerres intestines
Les quatre siècles qui suivirent connurent bien des aléas, chanceux et malchanceux. Gallois et Anglais luttèrent pour déterminer le tracé de leur frontière commune, laquelle fut effectivement fixée, grosso modo contiguë à celle d'aujourd'hui. Les Anglais dressèrent la Offa's Dyke (= la Digue d'Offa), une ligne de fortifications en terre le long de la frontière, prouvant une mutation dans la philosophie politique anglaise: les Gallois ne doivent plus être conquis mais «contenus».
Au-delà de la Dyke, les Gallois se livrèrent à d'incessantes querelles fratricides; des royaumes rivaux se combattaient mutuellement, assortissant leurs luttes de changement d'alliances si rapides que l'image que nous avons de cette époque est particulièrement confuse. Mais le grand legs laissé à l'histoire par ces roitelets gallois, c'est le soutien qu'ils ont accordé à la tradition bardique. Grâce à ce patronage, les Gallois purent atteindre un haut degré de civilisation, unique en soi et qui mérite parfaitement le qualificatif de «classique». Cette culture représente l'une des plus anciennes traditions littéraires d'Europe. Le Oxford Book of Welsh Verse commence par une œuvre de Taliesin, un poète du VIième siècle. Le premier poème présenté dans le Oxford Book of English Verse date du XIVième siècle!
Ces poèmes composés il y a quinze siècles nous semblent toujours d'une importance vitale aujourd'hui, aussi vitale qu'au moment de leur conception. Laissez-moi illustrer cela en citant un vers de Y Gododdin, une élégie guerrière de Aneirin, datant du VIième siècle:
«Gwyr a aeth Gatraeth oedd ffraeth eu Llu,
Glasfedd eu harcwyn a gwerwyn fu,
Trichart trwy beiriart yn catau,
Ac wedi elwch tawelwch fu».
Aux yeux de beaucoup, la littérature galloise atteint son apogée dans le Mabinogion, une collection de douze récits incarnant plus de mille ans de narration bardique: ce sont des récits comme Culhwch ac Olwen, une romance arthurienne qui anticipe l'Historia Regum Britanniae de Geoffrey of Monmouth, et The Dream of Macsen Wledig, une épopée ayant pour héros central Magnus Maximus, l'Empereur Maxence, l'«usurpateur» de l'Empire d'Occident au IVième siècle.
Un code de lois
très modernes
Mais les Gallois n'étaient pas que des poètes. Sous la férule d'un chef du Xième siècle, Hywel Dda («le Bon»), un code de lois complet fut esquissé et maintenu en pratique jusqu'à ce que la conquête anglaise ne l'annule. Ce code, rédigé en gallois, contenait des idées juridiques révolutionnaires pour l'époque: les femmes pouvaient réclamer une compensation lorsqu'elles étaient battues par leurs maris et revendiquer une part de propriété égale en cas de divorce; le vol n'était pas punissable si le but de l'acte délictueux était la survie physique; un fils illégitime avait des droits égaux au patrimoine de son père, comme tous les autres fils.
Jacques Chevalier écrit que «le peuple du Pays de Galles était le plus civilisé de son époque et avait atteint le plus haut degré d'intellectualité... Le Pays de Galles au Xième siècle était le seul pays d'Europe possédant une littérature nationale à côté d'une littérature impériale en latin».
Les années qui ont immédiatement suivi la conquête normande de l'Angleterre furent traumatisantes pour les Gallois. Des aventuriers normands se rassemblaient à l'Ouest pour se tailler des fiefs et de la puissance. Le Pays de Galles, malgré sa division en un réseau de petits royaumes, résista aux envahisseurs avec davantage d'efficacité que les royaumes anglo-saxons. Lorsque les Normands tuèrent à Hastings le Roi Harold, ils emportèrent, d'un coup, un royaume centralisé, mais lorsqu'ils éliminaient un petit chef gallois, ils n'enregistraient qu'un succès local.
Néanmoins, la marée montante de la conquête normande finit par battre les contreforts des royaumes gallois et, au début du XIième siècle, le destin des dynasties autochtones semblait scellé.
Conquête normande et
«âge des Princes»
Mais la tenacité des Gallois s'avéra aussi âpre que l'appétit des Normands. Dans sa Descriptio Kambriae, Geraldus Cambrensis, prélat «cambro-normand» du XIIième siècle, écrit à propos des Gallois que leur esprit «est entièrement voué à la défense de leur pays et de leur liberté; c'est pour leur pays qu'ils se battent, pour leur liberté qu'ils œuvrent; pour cela, il leur semble doux, non seulement de lutter l'épée à la main, mais aussi de mettre leur vie à disposition... Lorsque sonne le clairon de la guerre, les paysans abandonnent leur charrue et se précipitent sur leurs armes, avec la même promptitude que le courtier vers sa cour».
Les historiens surnomment les 300 années qui suivirent la prise du pouvoir par les Normands d'«Age des Princes». Pendant toute cette période, les chefs gallois comme Owain Gwynedd et Lord Rhys de Deheubarth luttèrent vaillamment pour résister aux incursions étrangères et pour unir leurs turbulents sujets en une nation capable de résister aux menaces extérieures.
Pendant cette époque, les Gallois enregistrèrent plusieurs victoires importantes, comme la destruction d'une armée normande et flamande à Crug Mawr en 1136, l'humiliation de Henri II Plantagenet à Basingwerk en 1157 et à Cadair Berwyn en 1165. Mais malgré ces victoires, la résistance des chefs gallois a toujours été freinée par les guerres fratricides endémiques. Ces luttes intestines s'expliquent pour une part par le système des héritages, lequel, même s'il est équitable, divise et partitionne les terres. Contrairement au système de la primogéniture appliqué en Angleterre, où le fils aîné hérite de l'entièreté des propriétés de son père, en Pays de Galles, tous les fils ont droit à une part égale de la propriété paternelle, ce qui engendre des rivalités et des antagonismes sur une base inter-familiale. Ces disputes sont alors exploitées, encouragées et soutenues par des forces extérieures et intéressées.
Le seul espoir de conserver l'indépendance, c'était d'établir un Etat unitaire. Les efforts de la Maison des Gwynedd visaient un tel objectif. Sous l'égide de Llywelyn Fawr ("le Grand") et de son petit-fils, Llywelyn ap Gruffudd, les Gwynedd prouvèrent leur prédominance sur toutes les autres dynasties autochtones. Ce clan de chefs chercha à fonder une structure féodale semblable à celle des Normands; leur effort connut son apogée lors du Traité de Montgomery de 1267, par lequel la Couronne anglaise reconnaît le droit de Llywelyn ap Gruffudd à porter le titre de «Prince de Galles» et à avoir le droit de recevoir l'hommage des autres princes mineurs.
Les Anglais deviennent maîtres du pays
Une telle concession n'a pu être arrachée que par moyens militaires car les Anglais auraient autrement refusé d'abandonner leurs projets de rapines et n'auraient jamais accepté un compromis politique. Mais inévitablement, la toute-puissance de l'Empire anglais et la volonté indomptable d'Edouard I, combinées, ruinèrent les aspirations des Gwynedd. En 1282, Llywelyn est tué et ses terres démembrées.
Les succès anglais, dus aux armées nombreuses et à la finance génoise, ont été renforcés par la construction d'un réseau de puissantes forteresses garnies de garnisons permanentes, symboles de l'autorité royale et destinées à surveiller et à réprimer la population autochtone. Un chroniqueur anglais de l'époque écrivit: «L'histoire du Pays de Galles arrive à sa fin». Ce jugement était assurément fort prématuré! Face à l'arrogance anglaise, les Gallois refusèrent de reconnaître leur défaite.
Les Anglais durent déployer une formidable puissance militaire pour mater de nombreuses rébellions, dont la plus sérieuse fut celle menée par Madog ap Llywelyn en 1294-95. Ce soulèvement, pour être contré, exigea une campagne de neuf mois et la mobilisation de 35.000 hommes. Il empêcha la réalisation du plan d'Edouard d'envahir la France.
De nombreux Gallois avaient fui leur pays pour se rendre en France afin de poursuivre la lutte contre l'ennemi comme l'avaient fait les Wild Geese (= les «Oies Sauvages») d'Irlande. Le plus connu de ces exilés fut Owain Lawgoch (= «la Main Rouge»), qui se proclama Prince de Galles et Capitaine de France. Le Duc Yvain de Galles, ainsi qu'il fut baptisé par les Français, commanda la flotte française qui s'empara de Guernesey. Yvain retournait en son pays lorsque le Roi de France le rappela pour investir La Rochelle et entrer dans le Poitou. Le Pays de Galles s'est souvenu des gestes d'Owain et les récits contant sa bravoure ont été chantés à profusion par les Bardes. La Couronne anglaise voyait en lui une telle menace qu'elle loua les services d'un assassin pour le tuer lors du siège de Mortagne-sur-Mer.
Owain Glyndwr, le plus grand et le plus célèbre des patriotes gallois
Mais à peine un quart de siècle s'écoule après l'assassinat du premier Owain, qu'un autre se dresse, Owain Glyndwr, le plus grand et le plus célèbre des patriotes gallois. Les exploits de ce héros inspirèrent de nombreux esprits et ce n'est pas un hasard si les nationalistes activistes gallois d'aujourd'hui, qui s'attaquent aux propriétés détenues par des Anglais dans tout le Pays de Galles, ont choisi de s'appeler «Meibion Glyndwr» ou «les Fils de Glyndwr».
Au tournant du XVième siècle, le Pays de Galles était travaillé par le ressentiment. Aucun Anglais ne pouvait être mandé devant une cour de justice par un Gallois et dans les arrondissements ruraux (les boroughs), la détention des terres et le commerce étaient des privilèges exclusifs des planteurs anglais. Le Parlement, averti de la colère des Gallois, émit une remarque méprisante: «Qu'avons-nous cure de ces pendards et va-nu-pieds?». Dans une telle atmosphère, Glyndwr fut proclamé «Prince de Galles» et, sous les acclamations ferventes de son peuple, il fut salué comme le sauveur tant attendu, le fils du destin, l'icône des prophéties bardiques.
De 1400 à 1415, le Pays de Galles connut le tumulte et les feux de la rébellion, menaçant du même coup la construction de l'Angleterre moderne. En 1404, la plus grande année de Glyndwr, le jeune chef n'avait aucun rival en Pays de Galles; même les grandes forteresses royales de Harlech et de Aberystwyth étaient tombées entre ses mains. Cette année-là, Owain convoqua son premier parlement national à Machynlleth et, en présence d'émissaires d'Espagne, de France et d'Ecosse, avec la bénédiction du Pape d'Avignon, il fut couronné formellement Dei Gratia Princeps Walliae (= Prince de Galles par la Grâce de Dieu). On élabora des plans pour détacher l'Eglise du Pays de Galles de la tutelle de Canterbury et pour fonder des universités dans le nord et le sud du pays. Ces plans attestent le projet authentiquement national de Glyndwr.
La défaite de ses alliés en Angleterre, de ses co-signataires du Tripartite Indenture qui voulaient partager l'Ile de Bretagne en un nord, un sud et un ouest, pesa considérablement sur la stratégie d'Owain; même l'aide d'une armée française ne put garantir son invulnérabilité. Entre-temps, avec toutes les ressources de la puissance anglaise dirigées contre lui, Glyndwr perdit du terrain. Mais si l'étau royal se refermait sur lui, Owain ne fut jamais battu définitivement sur le champ de bataille. Vers 1412, ses activités se résumaient à des coups de guerilla. Les légendes entourant son personnage se multiplièrent et s'amplifièrent. Glyndwr disparait de la scène vers 1415 et un voile de mystère entoure sa mort. Un chroniqueur gallois de cette époque relate que «la majorité affirme qu'il est mort; les devins disent qu'il n'est pas mort».
Les Tudor, une dynastie galloise oublieuse
de ses racines
Bien qu'elle ait été écrasée par un Etat dont la population était quinze fois supérieure et dont les richesses étaient incomparablement plus importantes, la nation galloise, par sa guerre d'indépendance, s'était signalée à l'attention de toute l'Europe. A la Conférence de Constance de 1415, la délégation française maintint avec succès que le Pays de Galles était une nation distincte en tous points de l'Angleterre. Les efforts de Glyndwr n'avaient pas été vains.
Depuis l'échec de Glyndwr jusqu'aujourd'hui, il a été refusé au peuple gallois le droit à l'auto-détermination. Même l'accession de Henry Tudor au trône d'Angleterre avec l'appui d'une armée galloise, ne déboucha pas sur une reconnaissance de la spécificité galloise. En effet, le couronnement d'un roi d'Angleterre de nationalité galloise retarda considérablement la lutte de libération car les membres les plus compétents de la gentry galloise abandonnèrent leur rôle traditionnel de chefs du gwerin (le peuple, le Volk) pour partir en Angleterre à la recherche de postes, de richesses et d'influence.
La politique des Tudor fut d'assimiler le Pays de Galles à l'Angleterre et, en conséquence, de détruire l'identité nationale distincte des Gallois. A cette fin, deux actes d'union passèrent en 1536 et en 1543. Le préambule de celui de 1536 mérite d'être cité ici: «... le dominion, la principauté et le pays de Galles est incorporé, annexé, uni et soumis à et sous la Couronne impériale de ce Royaume... parce que dans le dit pays, principauté et dominion existent divers droits, usages, lois et coutumes très différents des lois et coutumes de ce Royaume et aussi parce que le peuple du dit dominion possède un langage quotidien utilisé dans le dit dominion ne ressemblant pas et n'ayant pas la même euphonie que la langue maternelle utilisée dans le Royaume... Son Altesse, en conséquence, manifeste l'intention de les réduire à l'ordre parfait et à la connaissance des lois du Royaume et d'extirper complètement les coutumes et usages singuliers et sinistres différant de ce qui est en ce Royaume... Elle a ordonné que le dit pays et dominion de Galles sera à l'avenir, pour toujours et dorénavant incorporé et annexé au Royaume d'Angleterre».
La traduction de la Bible en gallois sauve la langue de la disparition
Le gouvernement anglais fit donc de la langue galloise un problème politique. La situation est restée telle jusqu'à nos jours. La survie de la langue, exclue de la vie publique et des instances légales, doit beaucoup à la traduction de la Bible en gallois, terminée en 1588. Cette traduction permit à la langue de ne pas dégénérer à la suite de l'effondrement de l'ordre bardique et fournit la base linguistique nécessaire au Y Diwygiad ou «Grand Réveil». Le revival religieux qui souffla sur le pays au XVIIIième siècle fut alimenté par des prêcheurs charismatiques qui s'adressaient en gallois et en plein air à des foules de milliers de personnes. Ce qui est plus significatif encore, c'est que ce revival permit la création d'écoles itinérantes dont l'objectif était d'enseigner au gwerin comment lire afin qu'il soit instruit des principes de la foi chrétienne. Bien sûr, la langue d'enseignement était le gallois. A la fin du XVIIIième siècle, le nombre total des élèves fréquentant les classes de jour et de nuit s'élevait à quelque 300.000 et, avec les 3/4 de la population ayant fréquenté les écoles, le Pays de Galles était la région la plus lettrée d'Europe à cette époque.
L'éducation du gwerin conduisit, inévitablement, à sa politisation et, dans les premières années du XIXième siècle, une agitation sérieuse agita le sud nouvellement industrialisé et les régions centrales encore rurales. En 1831, les ouvriers de Merthyr, la ville du fer et du charbon, brandirent le drapeau rouge et prirent d'assaut les positions tenues par les troupes gouvernementales. Il fallut quatre journées de combat, avec l'appui de renforts en soldats réguliers, pour que le soulèvement soit maté. Huit années plus tard, la ville de Newport lançait à son tour un défi à l'Etat britannique.
Les Chartists gallois constataient que leur lutte pour la justice sociale ne réussirait pas s'ils n'adoptaient pas les méthodes qui avaient fait le succès de la Guerre d'Indépendance américaine et de la Révolution française. En conséquence, ils décidèrent d'utiliser la force physique pour renverser l'ordre existant. Une armée, composée surtout de «sans armes», comptant 20.000 hommes, se rassembla pour marcher sous la bannière de CYFIAWNDER (= Justice) afin de fonder une République Galloise (Silwian Republic). L'entreprise échoua sous le feu des canons du 45ième Régiment à Pied.
Après les révoltes des Chartists, les Anglais décident de détruire la langue et la culture galloises
Les autorités anglaises étaient bien conscientes que le Pays de Galles était au bord de la révolution. Le Times rapporte que «le Pays de Galles est devenu aussi volcanique que l'Irlande», tandis que le Morning Herald déclare: «Le Pays de Galles est devenu un théâtre où l'on proclame des doctrines révolutionnaires, où l'on prêche la violence et l'effusion de sang. Les horreurs de la "petite guerre des Chartists ont frappé les dominions de la reine, qui n'avaient plus été souillés par le sang de la guerre civile depuis le temps d'Owen Glandower (sic)».
La solution préconisée par les Anglais était simple: détruire la langue galloise et le pays deviendrait ainsi une province anglaise comme les autres. A cette fin, des commissaires sont envoyés au Pays de Galles pour récolter des "preuves" du primitivisme et de l'ignorance du peuple autochtone. Et bien que sept huitièmes de la population était de langue galloise, les commissaires unilingues interrogeaient les témoins en anglais. De ce fait, ce n'est pas une surprise d'apprendre que leur rapport concluait les choses suivantes: «Le langage gallois dessert considérablement le Pays de Galles et constitue une barrière complexe au progrès moral et à la prospérité commerciale du peuple... A cause de sa langue, la masse du peuple gallois est inférieure au peuple anglais dans tous les domaines du savoir pratique et technique».
Armées d'un pareil rapport, les autorités possédaient enfin l'excuse qu'elles avaient recherchée pour asseoir une politique d'éducation obligatoire en anglais, afin d'angliciser le gwerin de façon si systématique qu'il serait totalement assimilé. Cette politique fut imposée sans ambages et les enfants des écoles que l'on entendait parler leur langue maternelle interdite étaient punis et humiliés. Pas de surprise donc que de telles mesures, appliquées systématiquement pendant plusieurs générations, combinées à l'immigration massive d'Anglais dans les zones industrielles, s'avérèrent catastrophiques pour l'avenir de la langue galloise. Alors que 88% de la population étaient de langue galloise vers la moitié du XIXième siècle, la proportion est, aujourd'hui, d'environ 20%. Comme prévu, la perte de la langue a conduit à la perte de la conscience nationale et des pans entiers de la société galloise ont transféré leurs allégeances au concept parfaitement illusoire de la Britishness, véhicule à peine voilé de la suprématie anglaise.
De telles défections se sont répercutées sur la scène politique. Dans les dernières années du XIXième siècle, un puissant mouvement de home rule naît au Pays de Galles sous l'appellation de Cymru Fydd (= Le Pays de Galles du Futur). Cette organisation doit être mise en parallèle avec le mouvement contemporain Young Ireland (= Jeune Irlande): elle vise à créer un parti national pour le Pays de Galles, qui, au début, devait se développer à l'intérieur du parti libéral gallois. Mais le Cymru Fydd était profondément divisé et sa vision d'un Pays de Galles autonome dans une Grande-Bretagne fédérale, marquée par l'éthos impérial anglais, n'avait rien de révolutionnaire. Par la suite, le lobby du home rule capota par la défection de ses chefs, partis à Londres pour exercer des responsabilités gouvernementales, comme Tom Ellis et, plus tard, David Lloyd George.
Premières menées activistes
Il fallut attendre 1925 pour que le Pays de Galles ait son premier parti national indépendant, avec l'apparition du Plaid Genedlaethol Cymru, dénommé ultérieurement Plaid Cymru (Le Parti du Pays de Galles). Sous la présidence de Saunders Lewis pendant l'entre-deux-guerres, le parti reçut son principal soutien de la part d'écrivains et d'intellectuels et cherchait à donner au Pays de Galles une doctrine nationaliste rigoureuse qui mettait l'accent sur la préservation de l'identité des communautés de langue galloise contre toute installation étrangère. Cette campagne eut pour moment fort l'incendie d'une école de l'armée de l'air, où les pilotes de bombardiers devaient être entraînés, que les militaires avaient fait construire au cœur du Pays de Galles. Cette action provoqua l'inculpation et l'emprisonnement de trois membres importants du parti. Ce fut un procès célèbre qui fournit à la cause nationaliste l'appui d'un public nouveau. Mais le parti ne put enregistrer que de très faibles succès électoraux et la plupart des critiques le dénoncèrent pour ses tendances dangereusement fascistes.
Pendant la seconde guerre mondiale, le Plaid Cymru resta résolument neutre, affirmant que son premier devoir était de défendre la nation galloise et non un Etat britannique artificiel; cette politique aboutit à l'arrestation et à l'emprisonnement de beaucoup de membres de l'organisation nationaliste.
Après la guerre, le Plaid Cymru se débarrassa de ses principes les plus pointus afin de s'attirer un électorat plus nombreux; ce fut une politique qui s'avéra fructueuse quant au nombre de sièges gagnés à Westminster mais qui compromit l'intégrité de la cause nationaliste au Pays de Galles. Dans sa volonté d'obtenir une représentation en Angleterre, le Plaid avait trahi sa nation et sa langue. Beaucoup d'activistes se sentirent frustrés par cette "trahison" de la direction du Plaid, dont le président en exercice se décrivit un jour sottement comme un «socialiste intellectuel britannique». Cela déboucha sur la formation de plusieurs groupes alternatifs et plus radicaux, dont le plus réussi fut le Cymdeithas yr Iaith Gynraeg (La Société de la Langue Galloise).
Une action directe
et non violente
L'organisation opta pour une action directe non violente, de façon à attirer l'attention sur le statut inférieur de la langue galloise. Les campagnes du mouvement ont ainsi lutté pour l'élimination de la signalisation routière en anglais, pour l'installation d'un bon service de radiodiffusion gallois (cet objectif a été partiellement réalisé avec l'apparition de la chaîne S4C) et l'accroissement de l'usage du gallois dans la vie publique. Actuellement la Cymdeithas met l'accent sur l'importance qu'il y a d'accroître l'enseignement moyen en gallois et fait campagne pour obtenir un nouveau Language Act pour le Pays de Galles.
Dans les années 60, certains radicaux gallois furent impliqués dans des organisations proto-terroristes comme la Free Wales Army (FWA) et le Mudiad Amddifyn Cymru (MAC; Le Mouvement de Défense du Pays de Galles). Ces groupes se formèrent en réponse à l'échec des méthodes constitutionnelles visant à éviter la destruction des communautés galloises en proie aux autorités anglaises. Lorsque plusieurs districts unilingues gallois furent mis sous eau afin de fournir de l'eau et de l'électricité à bon marché à des villes anglaises, les tracés d'aqueducs et les pylônes devinrent les cibles légitimes des attaques à la bombe des groupes en question.
L'investiture de Charles comme Prince de Galles au cours d'une cérémonie arrogante rappelant les conquêtes anglaises déclencha une campagne accrue d'attentats à la bombe dans tous le Pays de Galles. Mais les autorités étaient bien conscientes de la menace et, le jour même de l'investiture, les membres dirigeants de la FWA furent traduits en justice et emprisonnés pour appartenance à une organisation quasi militaire. Incident plus sérieux, le même jour, deux membres du MAC sont tués par l'explosion prématurée de leur engin, alors qu'ils étaient en route pour attaquer la voie de chemin de fer que devait emprunter le train royal. On soupçonne, à bon droit semble-t-il, que la machine infernale avait été «arrangée» par les services de sécurité… L'arrestation et l'inculpation des membres de la FWA et du MAC mit un terme aux attentats à la bombe mais la stratégie de l'«action directe» constitue toujours une option pour le Meibion Glyndwr. Ce groupe nationaliste clandestin a mené une campagne d'attentats incendiaires contre les propriétés possédées par des Anglais dans les districts de langue galloise au nord et à l'ouest du pays. Le Meibion Glyndwr prend pour appui le souci des Gallois face à l'impact destructeur du «syndrome de la résidence secondaire». L'organisation nationaliste a travaillé à grande échelle et elle jouit indubitablement d'un appui populaire tacite, ce qui explique qu'elle n'a pas pu être repérée et est restée opérationnelle depuis neuf années.
Pour en terminer avec ce tableau nécessairement schématique des bases de l'identité galloise, je voudrais citer les mots de Saunders Lewis, écrits pour une émission de la BBC en 1930, émission interdite parce qu'elle était «forgée pour enflammer les sympathies nationalistes»: «Il ne peut y avoir de lendemains heureux pour le Pays de Galles si nous ne nous montrons pas capables de passer à l'action, de nous imposer une auto-discipline, de nous donner un esprit fort et viril d'indépendance et si nous ne cultivons pas la fierté qui a animé nos ancêtres. Ce dont le Pays de Galles d'aujourd'hui et de demain a besoin, c'est de l'appel de l'héroïsme. La touche d'héroïsme n'a jamais vibré dans la politique galloise. Et c'est la raison pour laquelle je suis un nationaliste politique, parce que le nationalisme est appel à l'action et à la coopération, parce que le nationalisme referme les divisions de classe et impose aux riches et aux pauvres, aux clercs et aux travailleurs, un idéal qui transcende et enrichit l'individu: l'idéal de la nation et du terroir».
Gwyn DAVIES.
Conférence prononcée le 11 mars 1989 dans les salons de l'Hôtel Bedford à Bruxelles.
00:05 Publié dans Terroirs et racines | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : terres d'europe, europe, celtisme, peuples celtiques, caltitude, celticité, pays de galles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


