dimanche, 12 décembre 2010
Geopolitische Hintergründe der NATO Intervention im Kosovo
Archives - 2000
GEOPOLITISCHE HINTERGRÜNDE
DER NATO INTERVENTION IM KOSOVO
Serge TRIFKOVIC
Ex: http://trifkovic.mystite.com/
Aussage vor dem ständigen Komitee für auswärtige Angelegenheiten und internationalen Handel im kanadische Unterhaus, Ottawa, 17. Februar 2000
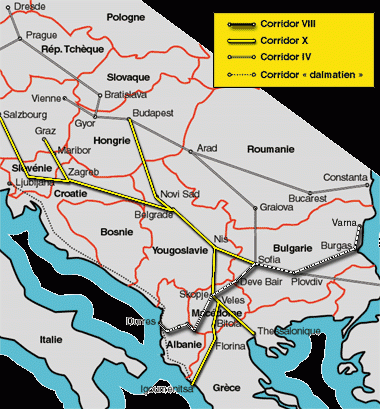 Der Krieg der Nato gegen Jugoslawien im Jahre 1999 markiert einen deutlichen Wendepunkt, nicht nur für Amerika und die NATO sondern auch für den gesamten Westen. Das Prinzip der nationalen Souveränität und sogar das Prinzip der Rechtstaatlichkeit wurde Namens einer angeblichen humanitären Ideologie untergraben. Tatsachen verdrehte man zu Erfindungen und sogar diese Erfindungen, die ausgegeben wurden um die eigene Handlungsweise zu rechtfertigen, erheben keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit mehr.
Der Krieg der Nato gegen Jugoslawien im Jahre 1999 markiert einen deutlichen Wendepunkt, nicht nur für Amerika und die NATO sondern auch für den gesamten Westen. Das Prinzip der nationalen Souveränität und sogar das Prinzip der Rechtstaatlichkeit wurde Namens einer angeblichen humanitären Ideologie untergraben. Tatsachen verdrehte man zu Erfindungen und sogar diese Erfindungen, die ausgegeben wurden um die eigene Handlungsweise zu rechtfertigen, erheben keinen Anspruch auf Glaubwürdigkeit mehr.
Traditionelle Systeme für den Schutz nationaler Freiheiten auf politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Ebene sind jetzt in Instrumente für deren Zerstörung umgewandelt worden. Aber weit entfernt davon, dass die westlichen Regierungseliten mit ihrem rücksichtslosen Durchsetzen der Ideologie einer multiethnischen Gesellschaft und internationalen Menschenrechten ihre Vitalität zeigen, könnte ihr Engreifen im Balkan möglicherweise der verstörende Ausdruck des kulturellen und moralischen Zerfalls eben dieser herrschenden Eliten sein. Ich werde darum meine Anmerkungen den Folgen des Krieges widmen, in Hinblick auf das sich bildende neue internationale System und die letztendliche Auswirkung auf die Sicherheit und Stabilität selbst der westlichen Welt.
Fast ein Jahrzehnt trennte Wüsten-Sturm von der Bombardierung aus humanitären Gründen. 1991 war der Vertrag von Maastricht unterzeichnet, und mit der Verlauf des restlichen Jahrzehnts hat die stückweise Usurpierung der traditionellen europäischen Souveränität durch ein Regime von kontrollierenden Körperschaften in Brüssel und nicht gewählten Beamten platzgegriffen, die sich mittlerweile dreist genug fühlen Osterreich vorschreiben zu können, wie es seine eigenen Angelegenheiten zu führen hätte. Auf dieser Seite des Ozeans (der Autor spricht in Ottawa. d. Übers.) Gab es die Einsetzung der NAFTA und 1995 brachte die Uruguay-Runde des GATT die WTO. Die neunziger Jahre waren somit ein Jahrzehnt in dem nach und nach die neue internationale Ordnung begründet wurde. Das Anschwärzen nationaler Souveränität hypnotisierte die Öffentlichkeit derart, dass sie dem Prozess der Demontage gerade der Institutionen applaudierten, die noch alleiniger Ausdruck der Hoffnung auf Volksvertretung waren. Der Prozess ist soweit fortgeschritten, dass Präsident Clinton behaupten kann (in: Ein gerechter und notwendiger Krieg, New York Times, 23. Mai 1999): Hätte die NATO Serbien nicht bombardiert, wäre sie selbst in Hinblick auf gerade die Werte, für die sie selbst steht, unglaubwürdig geworden.
Tatsächlich aber war der Krieg sowohl unrecht als auch unnötig. Aber das bemerkenswerte an Clintons Aussage lag darin, dass er vor aller Öffentlichkeit das internationale System, das seit dem Westfälischen Frieden (1648) besteht, für null und nichtig erklärt hat. Es war zwar ein unvollkommenes System, dass oftmals gebrochen wurde, es stellte aber die Grundlage für internationale Verständigung dar, an die sich lediglich einge wenige rote und schwarze Totalitaristen offenkundig nicht gehalten haben. Seit dem 24. März 1999 wird es mit der sich immer deutlicher abzeichnenden Clinton Doktrin ersetzt, die eine Blaupause der Breschnev Doktrin der eingeschränkten Souveränität darstellt und die seinerzeit die sowjetische Invasion in der Tschechoslowakei 1968 rechtfertigte. Wie sein sowjetischer Vorgänger gebrauchte Clinton eine abstrakte und weltanschaulich befrachtete Vorstellung - die der universellen Menschenrechte- als Vorwand für die Verletzung des Rechts und der Tradition. Die Clinton Doktrin hat ihre Wurzeln in der beiden Parteien eigenen Hybris der Washingoner aussenpolitischen "Elite", der ihr eigens Gebräu von ihrer Rolle als "letzter und alleiniger Supermacht" zu Kopf gestiegen ist. Rechtliche Formalitäten sind passé und moralische Vorstellungen - die in internationalen Angelegenheiten niemals sakrosankt sind - werden durch einen zynischen Gebrauch einer situationsgebundenen Moral ersetzt, je nach Lage der im Bezugsystem der Supermacht handelnden.
Nun ist also wieder imperiales Grossmachtdenken zurückgekehrt, aber in neuer Form. Alte Religion, Fahnen und nationale Rivalitäten spielen keine Rolle. Aber das starke Verlangen nach Aufregung [exitement] und Wichtigkeit, das die Briten bis nach Peking, Kabul und Khartum, die Franzosen nach Faschoda (s. Fussnote#1 d. Übers.) und Saigon, die Amerikaner nach Manila trieb ist jetzt wieder aufgetaucht. Das Resultat war, dass ein unabhängiges Land mit einem Krieg überzogen wurde, weil es sich weigerte, fremde Truppen auf seinem Boden zuzulassen. Alle anderen Rechtfertigungen sind nachträgliche Rationalisierungen. Die Mächte, die diesen Krieg geführt haben, haben es begünstigt und dazu aufgehetzt, dass eine ethnische Minderheit die Loslösung betreiben konnte, eine Loslösung, die, wenn sie einmal formal vollzogen ist, manch eine europäische Grenze in Frage stellen wird. In Hinblick auf jede andere europäische Nation würde diese Geschichte surreal klingen. Die Serben wurden jedoch so weitgehend dämonisiert, dass sie nicht mehr davon ausgehen können, dass man sie so wie andere behandelt.
Doch die Tatsache dass der Westen mit den Serben machen kann, was er will, erklärt noch nicht, warum er das tun soll. Es ist kaum Wert, dass man es widerlegt, und dennoch: Die fadenscheinigen Ausreden für eine Intervention. Humanitäre Gründe wurden angeführt. Aber was ist mit Kaschmir, Sudan, Uganda, Angola, Sierra Leone, Sri Lanka, Algerien? Feinsäuberlich auf Video aufgenommen und amanpourisiert [s. Fussnote#2 d. Übers.], jedes hätte zwölf Kosovos leicht aufgewogen. Natürlich gab es keinen Völkermord. Verglichen mit den Schlachtfeldern der Dritten Welt war das Kosovo ein unbedeutender Konflikt auf niedriger Ebene, etwas schmutziger vielleicht als in Nordirland vor einem Jahrzehnt, aber weit geringer als Kurdistan. Bis Juni 1999 gab es 2108 Opfer auf allen Seiten im Kosovo, in einer Provinz von über 2 Millionen Menschen. Es schneidet selbst im Vergleich zu Washington D. C. (Bevölkerung: 600 000) mit seinen 450 Selbstmorden besser ab. Leichen zählen ist unanständig, aber wenn man die Brutalität und ethnischen Säuberungen bedenkt, die von der NATO ignoriert oder, wie die 1995 in Kroatien oder die in der Osttürkei, sogar geduldet wurden, dann wird deutlich, dass es im Kosovo nicht um universale Prinzipien ging. In Washington gilt Abdullah Ocalan als Terrorist, aber die UCK sind Freiheitskämpfer.
Worum ging es dann? Die Stabilität der Region, wurde als nächstes behauptet. Wenn wir den Konflikt jetzt nicht stoppen, greift er auf Mazedonien, Griechenland, die Türkei und praktisch den ganzen Balkan über. Gefolgt von einem grossen Teil Eurpopas. Aber die Kur - Serbian solange bombardieren bis ein ethisch reines albanisches Kosovo unter den wohlwollenden Augen der NATO an die albanische UCK Drogen-Maffia übergeht - wird eine Kettenreaktion in der exkommunstischen Hälfte Europa auslösen.
Sein erstes Opfer wird die frühere jugoslawische Republik Mazedonien sein, in der die widerspenstige albanische Minderheit ein Drittel der Gesamtbevölkerung ausmacht. Wird denn das Modell Pristina nicht auch von den Ungarn in Rumänien, (die dort zahlreicher sind als Albaner im Kosovo), und in der Südslowakei gefordert werden? Was soll die Russen in der Ukraine, in Moldavien, in Lettland und im Norden Kasachstan davon abhalten sich dem anzuschliessen? Oder die Serben und Kroaten im chronisch instabilen Dayton - Bosnien? Und wenn schliesslich, die Albaner auf Grund ihrer Anzahl ihre Trennung bekommen, trifft dass selbe dann auch auf die Latinos in Südkalifornien oder Texas zu, sobald die ihre angelsächsischen Nachbarn zahlenmässig überwiegen und eine zweisprachige Staatlichkeit verlangen könnten die zu einer Wiedervereinigung mit Mexiko führen würde? Sollen Russland und China die Vereinigten Staaten mit Bombardierung drohen, wenn es nicht einlenkt?
Das was jetzt im Kosovo herausgekommen ist, stellt ein äusserst unvollkommenes Modell einer neuen Balkanordnung dar, das die Ambitionen aller ethnischen Gruppen des früheren Jugoslawiens, mit Ausnahme der Serben, zu befriedigen sucht. Das ist für alle Betroffenen eine zerstörerische Strategie. Auch wenn man sie jetzt mit Gewalt zum Gehorsam gezwungen hat, sollen die Serben bei der entstehenden künftigen Ordnung der Dinge nichts einzusetzen haben. Früher oder später werden sie darum kämpfen, den Kosovo zurück zugewinnen. Der Frieden von Karthago, den man heute Serbien auferlegt, wird für künftige Jahrzehnte zu chronischer Instabilität und Streit führen. Er wird den Westen auf dem Balkan in einen Morast verstricken und, sobald Mr. Clintons Nachfolger kein Interesse mehr daran haben, für die auf üblem Wege gewonnenen Erwerbungen ihrer Balkanverbündeten gerade zu stehen, garantiert einen neuen Krieg geben.
Die NATO hat jetzt gewonnen, aber der Westen hat verloren. Der Krieg hat genau die Prinzipien unterminiert, die den Westen ausmachen, nämlich, die Herrschaft des Rechts. Der Anspruch auf Menschenrechte kann weder für die Herrschaft des Rechts noch der Moral jemals die Grundlage bilden. Universelle Menschenrechte, die von ihrer Verwurzelung im jeweiligen Ort und der Zeit losgelöst sind, öffnen jedem Hauch einer Empörung und jeder Laune des Augenblicks darüber, wer gerade ein Opfer darstellt, den Weg. Die fehlgeleitete Bemühung, die NATO von einer Verteidigungs-gemeinschafft in eine Mini-U.N. zu verwandeln, mit selbstverfassten Verantworlichkeiten über das Gebiet seiner Vertragspartner hinaus, ist ein sicherer Weg zu weiteren Bosniens und Kosovos. Jetzt, da die Clintonistas und die NATO im Kosovo erfolgreich waren, können wir mit weiteren neuen und noch gefährlicheren Abenteuern anderswo rechnen. Aber beim nächsten Mal werden die Russen , die Chinesen, Inder und andere schlauer sein und uns nicht mehr die Sprüche über Freie Märkte und demokratische Menschenrechte abkaufen. Die Zukunft des Westens wäre in einem dann womöglich unvermeidlichen Konflikt unsicher.
Kanada sollte die Folgen eines solchen Kurses gut bedenken und um seinetwillen und den Frieden und die Stabilität der ganzen Welt seinen Mut zusammentun und Nein zum weltweiten Eingreifen sagen. Muss es wirklich in widerspruchsloser Unterwerfung zusehen, wie ein langdauerndes gefährliches militärisches Experiment gestartet wird, dass uns in einen wirklichen Krieg um Zentralasien hineinzieht? Soll es demnächst neue UCKs entlang Russlands islamischen Rand gegen "Völkermord" "verteidigen", darunter ethnische Gruppen deren Namen heute noch keine westliche Presse kennt und die eine Reihe guter Begründungen für eine Intervention hergeben könnten, gut genug, soll heissen so schlecht wie die der Kosovo-Albaner.
War Kanadas Geschichte als Teil des englischen Weltreiches so süss, dass es ein Herrschaftszentrum in Washington braucht, als Ersatz für das verlorene London? Fühlt sich Kanada bei der Wahrheit, die sich heute langsam herausschält, wohl, dass es über Krieg und Frieden weniger die Wahl hat, als in der Zeit, als es ein freies Dominion unter dem alten Statut von Westminster war? Denn ganz ohne Zweifel kann derKrieg, den die NATO im April und Mai 1999 geführt hat von etwas, das "die Allianz" genannt werden kann, weder beabsichtigt noch gewollt worden sein, wenn 1998 innerhalb des Ringes (der oberen Kommandoebene d. Übers.) der Einsatz von Gewalt ausgeheckt worden war.
Wert zu fragen wäre auch, wie diese Zurückstufung Kanadas und anderen NATO-Mitglieder auf den Status einer zweitrangigen imperialen Macht, einen von den Medien angeführten politischen Prozess in Gang setzt, der dazu führt, dass nationale Meinungsbildung- und Beschlussfassung, ausser einer rein formalen Einpeitschfunktion [Cheer-leader funktion], bedeutungslos werden. Es wäre auch zu fragen wie es dazu kommen konnte, dass das Hauptkriegsziel der Nato war "die Allianz zusammen zu halten", und welche Disziplinen damit gemeint waren und wie leicht und blutig sich das wiederholen lässt. Der moralische Alleinvertretungsanspruch der von den Befürwortern der Intervention als Ersatz für eine rationale Argumentation gegeben wurde kann nicht länger aufrechterhalten werden. Ein echter Zwiespalt in Hinblick auf unsere gemeinsame menschliche Verantwortung, sollte nicht dafür herzuhalten haben, um den Virus Imperialismus eines sich wiedererweiternden Westen zu reaktivieren. Je arroganter die neue Doktrin auftritt, um so grösser die Bereitschaft für die Wahrheit zu lügen. Die Fähigkeit etwas zu tun, unterstützt die moralische Selbstachtung, wenn wir den Gedanken von uns weisen können, dass wir weniger moralisch Handelnde als Verbraucher von vorgekauten Wahlmöglichkeiten sind. Am Aufgang des Jahrtausends leben wir in einem virtuellen Collosseum in dem exotische und finstere Unruhestifter nicht von Löwen sondern von mystischen Flugapparaten des Imperiums getötet werden. Während die Kandidaten für die Bestrafung - oder das Martyrium - in die Arena gestossen werden, reagieren viele der Bevölkerung im Westen auf die Show wie imperialen Konsumenten und nicht wie Bürger mit einem parlamentarischen Recht und einer demokratischen Verpflichtung, die Vorgänge zu hinterfragen. Mögen die Ergebnisse ihrer gegenwärtigen Untersuchungen erweisen, dass ich unrecht habe. Vielen Dank.
FUSSNOTEN DES UEBERSETZERS (Hartmut Gehrke-Tschudi)
FUSSNOTE #1: Faschoda: Stadt im Südsudan, am weissen Nil. 1898 war es der Schauplatz des Faschoda Konflikts der Frankreich und England an den Rand eines Krieges brachte und 1899 zum englisch-französischen Grenzabkommen führte, das die Grenze zwischen dem Sudan und franz. Kongo entlang der Wasserscheide des Kongo und Nil Beckens festlegte. Die Bildung einer englisch-französischen Entente 1904 veranlasste die Briten dazu, den Namen der Stadt in »Kodok« umzuändern, in der Hoffnung die Erinnerung an diesen Vorfall zu vertuschen.
FUSSNOTE #2: ein Sarkasmus des Autors, betr.: Christiane Amanpour die Leni Riefenstahl der USA, seit Golfkriegszeiten Kriegsberichterstatterin des CNN und Frau von US-Stabschef James Rubin. A. wollte wenige Wochen vor Kriegsbeginn in den Kosovo reisen, um für die westliche Wertegemeinschaft den "Beweis" zu bringen, dass dort ethn.Vertreibungen und Völkermord stattfinden. Die jugosl. Regierung erlaubte ihr aber nicht die Einreise. Sie hatte A. Art der manipulativen Berichterstattung schon kennengelernt und wollte der NATO keinen Vorwand zum Krieg geben.
00:05 Publié dans Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, kosovo, balkans, europe, affaires européennes, otan, europe balkanique, corridor 8, politique internationale, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 29 octobre 2010
Serbia Surrenders Kosovo to the EU
Ex: http://www.slobodanjovanocvic.org/
Probably, the Tadic government had expected something better, and had planned to follow up a favorable ICJ opinion with an appeal to the General Assembly to endorse renewed negotiations over the status of Kosovo, perhaps enabling Serbia to recover at least the northern part of Kosovo whose population is solidly Serb.

Diana Johnstone: In its dealings with the Western powers, recent Serbian diplomacy has displayed all the perspicacity of a rabbit cornered by a rattlesnake. After some helpless spasms of movement, the poor creature lets itself be eaten.
(September 20, Paris, Sri Lanka Guardian) On September 10, at the UN General Assembly, Serbia abruptly surrendered its claim to the breakaway province of Kosovo to the European Union. Serbian leaders described this surrender as a “compromise”. But for Serbia, it was all give and no take.
In its dealings with the Western powers, recent Serbian diplomacy has displayed all the perspicacity of a rabbit cornered by a rattlesnake. After some helpless spasms of movement, the poor creature lets itself be eaten.
The surrender has been implicit all along in President Boris Tadic’s two proclaimed foreign policy goals: deny Kosovo’s independence and join the European Union. These two were always mutually incompatible. Recognition of Kosovo’s independence is clearly one of the many conditions – and the most crucial – set by the Euroclub for Serbia to be considered for membership. Sacrificing Kosovo for “Europe” has always been the obvious outcome of this contradictory policy.
However, his government, and notably his foreign minister Vuk Jeremic, have tried to conceal this reality from the Serbian public by gestures meant to make it seem that they were doing everything possible to retain Kosovo.
Thus in October 2008, six months after U.S.-backed Kosovo leaders unilaterally declared that the province was an independent State, Serbia persuaded the UN General Assembly to submit the following question to the International Court of Justice for an (unbinding) advisory opinion: “Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo in accordance with international law?’”
The surrender has been implicit all along in President Boris Tadic’s two proclaimed foreign policy goals: deny Kosovo’s independence and join the European Union.
This was risky at best, because Serbia had more to lose by an unfavorable opinion than it had to gain by a favorable one. After all, most of the UN member states were already refusing to recognize Kosovo’s independence, for perfectly solid reasons of legality and self-interest. At best, a favorable ICJ opinion would merely confirm this, but would not in itself lead to any positive action. Serbia could only hope to use such a favorable opinion to ask to open genuine negotiations on the status of the province, but the Kosovo Albanian separatists and their United States backers could not be forced to do so.
One must stop here to point out that there are two major issues involved in all this: one is the status and future of Kosovo, and the other is the larger issue of national sovereignty and self-determination within the context of international law. If so many UN member states supported Serbia, it was certainly not because of Kosovo itself but because of the larger implications. Nobody objected to the splitting of Czechoslovakia, because the Czechs and the Slovaks negotiated the terms of separation. The issue is the method. There are literally hundreds, perhaps thousands, of potential ethnic secessionist movements within existing countries around the world. Kosovo sets an ominous precedent. An armed separatist movement, with heavy support from the United States, where an ethnic Albanian lobby had secured important political backing, notably from former Senator and Republican Presidential candidate Bob Dole, carried out a campaign of assassinations in 1998 in order to trigger a repression which it could then describe as “ethnic cleansing” and “genocide” as a pretext for NATO intervention.
This worked, because US leaders saw “saving the Kosovars” as the easy way to save NATO from obsolescence by transforming it into a “humanitarian” global intervention force.
Bombing Serbia for two and a half months to “stop genocide” was a spectacle for public opinion.
The only people killed were Yugoslav citizens out of sight on the ground.
It was the lovely little war designed to rehabilitate military aggression as the proper way to settle conflicts.
This worked, because US leaders saw “saving the Kosovars” as the easy way to save NATO from obsolescence by transforming it into a “humanitarian” global intervention force. Bombing Serbia for two and a half months to “stop genocide” was a spectacle for public opinion. The only people killed were Yugoslav citizens out of sight on the ground. It was the lovely little war designed to rehabilitate military aggression as the proper way to settle conflicts.
The reality of this cynical manipulation has been assiduously hidden from Americans and most Europeans, but elsewhere, and in certain European countries such as Spain, Greece, Cyprus and Slovakia, the point has not been missed. Separatist movements are dangerous, and whenever the United States wants to subvert an unfriendly government, it has only to incite mass media to portray the internal problems of the targeted government as potential “genocide” and all hell may break loose.
So Serbia did not really have to work very hard to convince other countries to support its position on Kosovo. They had their own motivations – which were perhaps stronger than those of the Serbian government itself.
What did Serb leaders want?
The question put to the ICJ did not spell out what Serb leaders wanted. But it had implications. If the Kosovo declaration of independence was illegal, what was challenged was not so much independence itself as the procedure, the unilateral declaration. And indeed, there is no reason to suppose that Serb leaders thought they could reintegrate the whole of Kosovo into Serbia. It is even unlikely that they wanted to do so.
What did Serb leaders want?
The question put to the ICJ did not spell out what Serb leaders wanted. But it had implications. If the Kosovo declaration of independence was illegal, what was challenged was not so much independence itself as the procedure, the unilateral declaration. And indeed, there is no reason to suppose that Serb leaders thought they could reintegrate the whole of Kosovo into Serbia. It is even unlikely that they wanted to do so.
There are very mixed feelings about Kosovo within the Serb population. It is hard to know how widespread is the sense of concern, or guilt, regarding the beleaguered Serb population still living there, vulnerable to attacks from racist Albanians eager to drive them out. The sentimental attachment to “the cradle of the Serb nation” is very strong, but few Serbs would choose to go live there, even if the province were returned to them. In former Yugoslavia, the province was a black hole that absorbed huge sums of development aid, and would certainly be a heavy economic burden to impoverished Serbia today. Economically, Serbia is probably better off without Kosovo. Nearly twenty years ago, the leading Serb author and patriot Dobrica Cosic was arguing in favor of dividing Kosovo along ethnic and historic lines with Albania. Otherwise, he foresaw that the attempt to live with a hostile Albanian population would destroy Serbia itself.
Few would admit this, but the proposals of Cosic, echoed by some others, at least suggest that in a world with benevolent mediators, a compromise might have been worked out acceptable to most of the people directly involved. But what made such a compromise impossible was precisely the US and NATO intervention on behalf of armed Albanian rebels. Once the Albanian nationalists knew they had such support, they had no reason to agree to any compromise. And for the Serbs, the brutal method by which Kosovo was stolen by NATO was adding insult to injury – a humiliation that could not be accepted.
By taking the question to the UN General Assembly and the ICJ, Serbia sought endorsement of a reopening of negotiations that could lead to the sort of compromise that might have settled the issue had it been taken up in a world with benevolent mediators.
International Court of No Justice
On July 22, the ICJ issued its advisory opinion, concluding that Kosovo’s “declaration of independence was not illegal”. In some 21,600 words it evaded the main issues, refusing to state that the declaration meant that Kosovo was in fact properly independent. The gist was simply that, well, anybody can declare anything, can’t they?
On July 22, the ICJ issued its advisory opinion, concluding that Kosovo’s “declaration of independence was not illegal”. In some 21,600 words it evaded the main issues, refusing to state that the declaration meant that Kosovo was in fact properly independent. The gist was simply that, well, anybody can declare anything, can’t they?
Of course, this was widely interpreted by Western governments and media, and most of all by the Kosovo Albanians, as endorsement of Kosovo’s independence, which it was not.
Nevertheless, it was a shameful cop-out on the part of the ICJ, which marked further deterioration of the post-World War II efforts to establish some sort of international legal order. Perhaps the most flagrant bit of sophistry in the lengthy opinion was the argument (in paragraphs 80 and 81) that the declaration was not a violation of the “territorial integrity” of Serbia, because “the illegality attached to [certain past] declarations of independence … stemmed not from the unilateral character of these declarations as such, but from the fact that they were, or would have been, connected with the unlawful use of force or other egregious violations of norms of general international law…”
In short, the ICJ pretended to believe that there has been no illegal international military force used to detach Kosovo from Serbia, although this is precisely what happened as a result of the totally illegal NATO bombing campaign against Serbia. Since then, the province has been occupied by foreign military forces, under NATO command, which both violated the international agreement under which they entered Kosovo and looked the other way as Albanian fanatics terrorized and drove out Serbs and Roma, occasionally murdering rival Albanians.
The ICJ judges who endorsed this scandalous opinion came from Japan, Jordan, the United States, Germany, France, New Zealand, Mexico, Brazil, Somalia and the United Kingdom. The dissenters came from Slovakia, Sierra Leone, Morocco and Russia. The lineup shows that the cards were stacked against Serbia from the start, unless one actually believes that the judges leave behind their national mind-set when they join the international court.
Digging Itself Deeper Into a Hole
Probably, the Tadic government had expected something better, and had planned to follow up a favorable ICJ opinion with an appeal to the General Assembly to endorse renewed negotiations over the status of Kosovo, perhaps enabling Serbia to recover at least the northern part of Kosovo whose population is solidly Serb.
Oddly, despite the bad omen of the ICJ opinion, the Tadic government went right ahead with plans to introduce a resolution before the UN General Assembly. The draft resolution asked the General Assembly to state the following:
Aware that an agreement has not been reached between the sides on the consequences of the unilaterally proclaimed independence of Kosovo from Serbia,
Taking into account the fact that one-sided secession cannot be an accepted way for resolving territorial issues,
1. Acknowledges the Advisory opinion of the ICJ passed on 22 July 2010 on whether the unilaterally proclaimed independence of Kosovo is in line with international law,
2. Calls on the sides to find a mutually acceptable solution for all disputed issues through peaceful dialogue, with the aim of achieving peace, security and cooperation in the region.
3. Decides to include in the interim agenda of the 66th session an item namely: “Further activities following the passing of the advisory opinion of the ICJ on whether the unilaterally proclaimed independence of Kosovo is in line with international law.”
The resolution dictated by the EU made no mention of Kosovo other than to “take note” of the ICJ advisory opinion, and concluded by welcoming “the readiness of the EU to facilitate the process of dialogue between the parties.”
According to this text of the resolution, which UN General Assembly adopted by consensus; “The process of dialogue by itself would be a factor of peace, security and stability in the region. This dialogue would be aimed to promote cooperation, make progress on the path towards the EU and improve people’s lives.”
By accepting this text, the Serbian government abandoned all effort to gain international support from the many nations hostile to unilateral secession, and threw itself on the mercy of the European Union.
The key statement here was “the fact that one-sided secession cannot be an accepted way for resolving territorial issues”. This was the point on which the greatest agreement could be attained. The United States made it known that it was totally unacceptable for the General Assembly to hold a debate on such a resolution. The main Belgrade daily Politika published an interview with Ted Carpenter of the Cato Institute in Washington saying that the Serbian draft resolution on Kosovo was “irritating America and the EU’s leading countries”. American diplomats were “working overtime” to thwart the resolution, he said. Carpenter said that the Serbian resolution was seen in Washington as an unfriendly act that would lead to a further deterioration in relations, and that as a result of its Kosovo policy, Serbia’s EU ambition could suffer setbacks that would have negative consequences for the Serbian government “and the Serb people”.
Carpenter conceded that this time around, the country would not be threatened militarily, but noted that the United States was influential enough to “make life very difficult” for any country that stood up against its policies. He concluded that Serbia would “have to accept the reality of an independent Kosovo”, and that Washington would thereupon leave it to Brussels to deal with the remaining problems.
The American stick was accompanied by a dangling EU carrot. Carpenter expressed his hope that the EU would consider various measures, “including adjustment of borders, regarding Kosovo, and the rest of Serbia”, but also, he noted, Bosnia-Herzegovina, suggesting that Serbs could be satisfied if a loss of Kosovo were compensated by a unification with Bosnia’s Serb entity, the Republika Srpska. Giving his own opinion, Carpenter said such a solution would at least be much better than the current U.S. and EU policy, “which seems to be that everyone in the region of the former Yugoslavia, except Serbs, has a right to secede”.
Carpenter, who was a sharp critic of the 1999 NATO bombing of Serbia, and who warned that secessionist movements around the world could use the Kosovo precedent for their own purposes, said that such a solution was possible “in the coming decades”… a fairly distant prospect.
The decisive arm twisting was perhaps administered by German foreign minister Guido Westerwelle on a visit to Belgrade. Whatever threats or promises he made were not disclosed, but on the eve of the scheduled UN General Assembly debate, the Tadic government caved in entirely and allowed the EU to rewrite the resolution.
The resolution dictated by the EU made no mention of Kosovo other than to “take note” of the ICJ advisory opinion, and concluded by welcoming “the readiness of the EU to facilitate the process of dialogue between the parties.”
According to this text of the resolution, which UN General Assembly adopted by consensus; “The process of dialogue by itself would be a factor of peace, security and stability in the region. This dialogue would be aimed to promote cooperation, make progress on the path towards the EU and improve people’s lives.”
By accepting this text, the Serbian government abandoned all effort to gain international support from the many nations hostile to unilateral secession, and threw itself on the mercy of the European Union.
Still More to Lose
In a TV interview, I was asked by Russia Today, “What does Serbia stand to gain?” My immediate answer was, “nothing”. Serbia implicitly abandoned its claim to Kosovo in return for nothing but vague suggestions of “dialogue”.
In a TV interview, I was asked by Russia Today, “What does Serbia stand to gain?” My immediate answer was, “nothing”. Serbia implicitly abandoned its claim to Kosovo in return for nothing but vague suggestions of “dialogue”.
A usual aim of all policy is to keep options open, but Serbia has now put all its eggs in the EU basket, in effect rebuffing all the member states of the UN General Assembly which were ready to support Belgrade as a matter of principle on the issue of unnegotiated unilateral secession.
Rather than gain anything, the Tadic government has apparently chosen to try to avoid losing still more than it has lost already. After the violent breakup of Yugoslavia along ethnic lines, Serbia remains the most multiethnic state in the region, which means that it includes minorities which can be incited to demand further secessions. There is a secession movement in the ethnically very mixed northern province of Voivodina, which could be more or less covertly encouraged by neighboring Hungary, an increasingly nationalist EU member attentive to the Hungarian minority in Voivodina. There is another, more rabid separatist movement in the southwestern region of Raska/Sanjak led by Muslims with links to Bosnian Islamists. Surrounded by NATO members and wide open to NATO agents, Serbia risks being destabilized by the rise of such secession movements, which Western media, firmly attached to the stereotypes established in the 1990s, could easily present as persecuted victims of potential Serb genocide.
Moreover, no matter how the Serbs vote, the US and UK embassies dictate the policies. This has been demonstrated several times. Little Serbia is actually in a position very like the Pétain government in 1940 to 1942, when it governed a part of France not yet occupied but totally surrounded by the conquering Nazis.
Moreover, no matter how the Serbs vote, the US and UK embassies dictate the policies. This has been demonstrated several times. Little Serbia is actually in a position very like the Pétain government in 1940 to 1942, when it governed a part of France not yet occupied but totally surrounded by the conquering Nazis.
It would take political genius to steer little Serbia through this geopolitical swamp, infested with snakes and crocodiles, and political genius is rare these days, in Serbia as elsewhere.
EU to the rescue?
Under these grim circumstances, the Tadic government has in effect abandoned all attempt at independence and entrusted the future of Serbia to the European Union.
Under these grim circumstances, the Tadic government has in effect abandoned all attempt at independence and entrusted the future of Serbia to the European Union. Serb patriots quite naturally decry this as a sell-out. Indeed it is, but Russia and China are far away, and could not be counted on to do anything for Serbia that would seriously annoy Washington. The fact is that much of the younger generation of Serbs is alienated from the past and dreams only of being in the EU, which means being treated as “normal”.
How will the EU reward these expectations?
Up to now, the EU has responded to each new Serb concession by asking for more and giving very little in return. At a time when many in the core EU countries feel that accepting Rumania and Bulgaria has brought more trouble than it was worth, enlargement to include Serbia, with its unfairly bad reputation, looks remote indeed.
In reality, the most Belgrade can hope for from the EU is that it will muster the courage to take its own policy line on the Balkans, separate from that of the United States.
Given the subservience of current EU leaders to Washington, this is a long shot. But it has a certain basis in reality.
United States policy toward the region has been heavily influenced by ethnic lobbies that have pledged allegiance to Washington in return for unconditional support of their nationalist aims. This is particularly the case of the rag-tag Albanian lobby in the United States, an odd mixture of dull-witted politicians and gun-running pizza parlor owners who flattered the Clinton administration into promising them their own statelet carved out of historic Serbia. The result has been “independent” Kosovo, in reality occupied by a major US military base, Camp Bondsteel, NATO-commanded pacifiers and an EU mission theoretically trying to introduce a modicum of legal order into what amounts to a failing state run by clans and living off various criminal activities. Since Camp Bondsteel is untouchable, and the grateful hoodlums have erected a giant statue to their hero, Bill Clinton, in their capital, Pristina, Washington is content with this situation.
But many in Europe are not. It is Europe, not the United States, that has to deal with violent Kosovo gangsters peddling dope and women in its cities. It is Europe, not the United States, that has this mess on its doorstep.
The media continue to peddle the 1999 fairy tale in which heroic NATO rescued the defenseless “Kosovars” from a hypothetical “genocide” (which never took place and never would have taken place), but European governments are in a position to know better.
As evidence of this is a letter written to German Chancellor Angela Merkel on October 26, 2007 by Dietmar Hartwig, who had been head of the EU (then EC) mission in Kosovo just prior to the NATO bombing in March 1999, when the mission was withdrawn. In describing the situation in Kosovo at a time when the NATO aggression was being prepared on the pretext of “saving the Kosovars”, Hartwig wrote:
“Not a single report submitted in the period from late November 1998 up to the evacuation on the eve of the war mentioned that Serbs had committed any major or systematic crimes against Albanians, nor there was a single case referring to genocide or genocide-like incidents or crimes. Quite the opposite, in my reports I have repeatedly informed that, considering the increasingly more frequent KLA attacks against the Serbian executive, their law enforcement demonstrated remarkable restraint and discipline. The clear and often cited goal of the Serbian administration was to observe the Milosevic-Holbrooke Agreement to the letter so not to provide any excuse to the international community to intervene. … There were huge ‘discrepancies in perception’ between what the missions in Kosovo have been reporting to their respective governments and capitals, and what the latter thereafter released to the media and the public. This discrepancy can only be viewed as input to long-term preparation for war against Yugoslavia. Until the time I left Kosovo, there never happened what the media and, with no less intensity the politicians, were relentlessly claiming. Accordingly, until 20 March 1999 there was no reason for military intervention, which renders illegitimate measures undertaken thereafter by the international community. The collective behavior of EU Member States prior to, and after the war broke out, gives rise to serious concerns, because the truth was killed, and the EU lost reliability.”
EU governments lied then, for the sake of NATO solidarity, and have been lying ever since.
Other official European observers said the same at the time, and in 2000, retired German general Heinz Loquai wrote a whole book, based especially on OSCE documents, showing that accusations against Serbia were false propaganda. While the public was fooled, government leaders have access to the truth.
In short, EU governments lied then, for the sake of NATO solidarity, and have been lying ever since.
Now as then, there are insiders who complain that the situation in reality is very different from the official version. Voices are raised pointing out that Republika Srpska is the only part of Bosnia that is succeeding, while the Muslim leadership in Sarajevo continues to count on largesse due to its proclaimed victim status. There seems to be a growing feeling in some leadership circles that in demonizing the Serbs, the EU has bet on the wrong horse. But that does not mean they will have the courage to confront the United States. In Kosovo itself, the most radical Albanian nationalists are ready to oppose the EU presence, by arms if necessary, while feeling confident of eternal support from their U.S. sponsors.
The Betrayal of Serbia
Pro-Western politicians in Belgrade labored under the illusion that throwing Milosevic to the ICTY wolves would be enough to ensure the good graces of the “International Community”. But in reality, the prosecution of Milosevic was used to publicize the trumped up “joint criminal enterprise” theory which blamed every aspect of the breakup of Yugoslavia on an imaginary Serbian conspiracy.
If the latest self-defeat at the UN General Assembly can be denounced as a betrayal, the betrayal began nearly ten years ago. On October 5, 2000, the regular presidential election process in Yugoslavia was boisterously interrupted by what the West described as a “democratic revolution” against the “dictator”, president Slobodan Milosevic. In reality, the “dictator” was about to enter the run-off round of the Yugoslav presidential election in which he seemed likely to lose to the main opposition candidate, Vojislav Kostunica. But the United States trained and incited the athletically inclined youth organization, Otpor (“resistance”), to take to the streets and set fire to the parliament in front of international television, to give the impression of a popular uprising. Probably, the scenarists modeled this show on the equally stage-managed overthrow of the Ceaucescu couple in Rumania at Christmas 1989, which ended in their murder following one of the shortest kangaroo court trials in history. For the generally ignorant world at large, being overthrown would be proof that Milosevic was really a “dictator” like Ceaucescu, whereas being defeated in an election would have tended to prove the opposite.
Proclaimed president, Kostunica intervened to save Milosevic, but not having been allowed to actually win the election, his position was undermined from the start, and all power was given to the Serbian prime minister, Zoran Djindjic, a favorite of the West who was too unpopular to have won an election in Serbia. Shortly thereafter, Djindjic violated the Serbian constitution by turning Milosevic over to the International Criminal Tribunal for Former Yugoslavia (ICTY) in The Hague – for one of the longest kangaroo court trials in history.
Having abandoned all attempt to assert its moral advantage, Serbia is counting solely on the kindness of strangers.
Pro-Western politicians in Belgrade labored under the illusion that throwing Milosevic to the ICTY wolves would be enough to ensure the good graces of the “International Community”. But in reality, the prosecution of Milosevic was used to publicize the trumped up “joint criminal enterprise” theory which blamed every aspect of the breakup of Yugoslavia on an imaginary Serbian conspiracy. The scapegoat turned out to be not just Milosevic, but Serbia itself. Serbia’s guilt for everything that went wrong in the Balkans was the essential propaganda line used to justify the 1999 NATO aggression, and by going along with it, the “democratic” Serbian leaders undermined their own moral claim to Kosovo.
In June 1999, Milosevic gave in and allowed NATO to occupy Kosovo under threat of carpet bombing that would destroy Serbia entirely. His successors fled from a less perilous battle – the battle to inform world public opinion of the complex truth of the Balkans. Having abandoned all attempt to assert its moral advantage, Serbia is counting solely on the kindness of strangers.
Diana Johnstone is author of Fools’ Crusade: Yugoslavia, NATO and Western Delusions (Monthly Review Press). She can be reached at diana.josto@yahoo.fr
00:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serbie, kosovo, balkans, ex-yougoslavie, europe, affaires européennes, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 12 septembre 2010
Kosovo: le droit des gens sur la sellette

Kosovo: le droit des gens sur la sellette
Question : quel est le principe du droit des gens qui est le plus important et qui doit recevoir la priorité ? Le droit à l’auto-détermination des peuples ou le principe de l’intégrité territoriale des Etats ? C’est la question à laquelle le Tribunal international devait répondre récemment dans le cas de son rapport d’expertise sur le Kosovo. Abstraction faite du contenu concret de ce rapport d’expertise et de ses effets politiques, le cas du Kosovo montre que le droit des gens n’est plus tellement une question de faire valoir le droit et de justifier celui-ci par des principes, mais n’est plus qu’une question de pouvoir et de force. Pourquoi ? Lors de la déclaration unilatérale d’indépendance du Kosovo, il y a peu d’années d’ici, on s’est réclamé du droit à l’auto-détermination des peuples, qu’il fallait octroyer aux Albanais ethniques du Kosovo ; on a également justifié ce choix du fait que l’ancien régime serbe avait commis, à l’encontre de ceux-ci, des crimes contraires aux droits de l’homme, lors de la guerre ayant précédé l’indépendance kosovare. Pour cette raison, on devait, dit-on, accorder l’indépendance aux Kosovars et leur octroyer le droit à l’auto-détermination. On n’a dès lors tenu aucun compte de l’intégrité du territoire de l’Etat de Serbie, ce qui a eu pour résultat que, jusqu’ici, le Kosovo n’a été reconnu que par un nombre très limité d’autres Etats.
Il est de notoriété publique que cette indépendance du Kosovo a été rendue possible par des pressions extérieures, surtout américaines, et que les Européens, de ce fait, l’ont acceptée bon gré mal gré. Dans toutes ces démarches, on a complètement ignoré un fait : la construction qu’est le Kosovo est totalement dépendante sur le plan économique, n’est pas viable et constitue probablement le premier Etat entièrement musulman sur le sol européen.
La Serbie veut que l’on entame de nouvelles négociations pour fixer un statut définitif au Kosovo mais l’opinion générale estime évidemment qu’elle ne l’obtiendra pas et que sa démarche est absurde car l’indépendance du Kosovo ne pourra plus être rendue nulle et non avenue. En vérité, le vrai problème est celui de la région du Nord du Kosovo, qui possède un peuplement serbe compact, pour lequel il conviendrait bien évidemment d’appliquer les mêmes principes du droit des gens, que nous venons de citer. Les Serbes du Kosovo sont pleinement en droit de faire valoir à leur profit le droit à l’auto-détermination. Et si l’on considère le Kosovo comme un Etat souverain à part entière, son intégrité territoriale ne doit pas être une vache sacrée, pas davantage que celle de la Serbie, puisqu’il est né précisément du rejet de ce principe d’intégrité territoriale. En clair : les Serbes vont être contraints d’accepter un compromis, dans la mesure où ils ne récupèreront que les seules régions peuplées de Serbes et devront entériner la sécession du reste du Kosovo.
Ensuite, la grande question se pose à l’UE : ce territoire nouvellement indépendant, de peuplement albanais sera-t-il vraiment viable sur le long terme ou devra-t-on l’alimenter et le soutenir pour les siècles des siècles, en tant que pur protectorat de l’UE ? Ou bien se décidera-t-on d’élargir et de tester le principe de l’auto-détermination des peuples à tous les Albanais et Albanophones, en se demandant s’il ne serait pas utile de créer un Etat panalbanais, Kosovo compris, dans les Balkans occidentaux, qui serait rapidement lié à l’UE. Et comme les Européens financent déjà le tout, il faudrait tout de même veiller à ce que cet ensemble soit inclus dans une perspective géopolitique allant dans le sens des intérêts de l’Europe, en développant une vision au-delà des simples principes du droit des gens, et non pas dans une perspective allant dans le sens des intérêts, utilitaires et calculés, des Etats-Unis d’Amérique ou abondant dans le sens des visées expansionnistes et ubiquitaires du monde musulman. Si un « ordre nouveau » doit advenir dans les Balkans occidentaux et si cet « ordre nouveau » doit s’aligner sur l’UE et participer à l’intégration du continent européen, les principes du droit des gens devront obéir aux critères de la raison pragmatique. Celle-ci postule qu’il ne faut pas léser les intérêts et la fierté des autres grands peuples de cette région. Dans le cadre de cette évolution, la Serbie devra historiciser le mythe de la Bataille du Champs des Merles. Et les Kosovars musulmans devront accepter qu’ils ne resteront pas une république islamique souveraine par la grâce des Américains et aux frais des Européens.
Andreas MÖLZER.
(article paru dans « zur Zeit », Vienne, n°30/2010 ; http://www.zurzeit.at/ ).
00:15 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kosovo, balkans, ex-yougoslavie, europe, affaires européennes, albanie, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 30 juin 2010
Lettre à un ami, trop sensible à la propagande de CNN...

SYNERGON - SYNERGIES EUROPÉENNES
Bruxelles/Metz
Mardi 20 avril 1999
ATELIER "MINERVE"
Lettre à un ami, trop sensible à la propagande de CNN...
par Robert Steuckers,
Secrétaire Général du Bureau Européen de SYNERGIES EUROPEENNES
Mon cher Quentin,
J'ai promis de répondre par une lettre ouverte à tes questions, traduisant l'inquiétude de nos contemporains face aux problèmes qui affectent la population albanaise du Kosovo aujourd'hui. Effectivement, plusieurs personnes m'ont posé les mêmes questions que toi: pourquoi nous sommes-nous engagés de manière aussi décisive contre l'intervention de l'OTAN, apparemment sans tenir compte des tragédies humaines qui plongent le Kosovo dans les horreurs de la guerre? Nous ne l'avons pas fait pour des raisons morales, mais pour des raisons historiques et géopolitiques, que je t'explicite dans cette lettre. Les souffrances des civils ne nous laissent pas indifférents et nous souhaitons que le programme de la Croix Rouge Internationale (CICR) pourra mettre ses structures au profit de toutes les victimes de cette guerre, dans l'esprit d'impartialité qui a fait la grandeur de Henri Dunant. Sur le plan géopolitique, je reste toutefois inébranlablement fidèle à un principe: l'espace européen, notre espace civilisationnel, ne peut en aucun cas subir des interventions américaines, chinoises, turques, islamistes ou autres. Ce doit être un axiome inébranlable dans notre pensée et notre action politiques.
Dans l'un de mes derniers communiqués, j'ai dit clairement que cette guerre n'a rien à voir avec les droits de l'homme, ni même avec le Kosovo ou les Albanophones de cette province d'Europe, ni même avec les Serbes ou avec Milosevic. Mais, pour les Américains et les Européens décérébrés et félons qui servent l'OTAN, instance foncièrement anti-européenne visant la ruine de notre culture, il s'agit avant toutes choses de bloquer le Danube, de bloquer l'Adriatique, de fermer l'espace aérien dans le Sud-est européen, de contrôler à leur guise la Méditerranée orientale et, enfin, de créer et d'entretenir le chaos dans un bon quart de notre continent pendant plusieurs décennies. Je raisonne en termes géopoltiques et rien qu'en termes géopolitiques, car un cadre géographique et historique cohérent est le seul garant possible d'une convivialité politique et civilisationnelle harmonieuse. Je ne suis l'apôtre d'aucune morale toute faite, prête-à-ânonner, d'aucune éthique de la conviction qui, dans tous les cas de figure, fait la bête en voulant faire l'ange. Bien sûr, je ne vais pas aller dire que Milosevic et ses soldats sont des enfants de choeur, tout comme les combattants de l'UCK kosovar ne sont pas davantage des enfants de choeur. Mais en temps de guerre, en politique, qui ose lever le doigt et dire: "moi, m'sieur, j'suis un bon, un gentil, un tout propre". Et les généraux de l'OTAN ne font certainement pas plus partie de la confrérie des enfants de choeur que les miliciens d'Arkan ou de l'UCK. Même s'ils prétendent qu'à coups de missiles, de bombes ou de roquettes, ils vont apporter le "Bien" (avec un grand "B") dans les Balkans, comme les cloches ou le Lapin de Pâques apportent des oeufs en chocolat à nos chères têtes blondes. Croire au "kalokagathon" des militaires de l'OTAN ou du SHAPE, c'est de la pure déraison!
Au lieu de hurler avec CNN, les intellectuels auto-proclamés et la sordide canaille journalistique (dont les plus répugnants exemplaires grenouillent à Paris) feraient bien mieux de lire quelques solides bouquins sur l'histoire de la péninsule balkanique. Dans les événements de ces dix dernières années, ni les Serbes ni les Croates ni les Albanais ne sont les "coupables" en dernière instance: les malheurs et les tragédies des Balkans sont le triste résultat de 500 ans de domination ottomane. Au cours de cette période horrible, les peuples des Balkans ont été écrasés, martyrisés, des populations entières ont été expulsées de leurs patries d'origine: les Serbes ont fui les armées ottomanes pour se réfugier en Croatie; les Croates se sont repliés en Slovénie, en Carinthie, en Italie et dans tout le reste de l'Europe (en France, il y avait des régiments croates), une partie des Albanais de souche ont dû s'installer en Italie du Sud. Les Ottomans et les convertis à l'Islam ont dominé sans partage. Chaque année, 10% des garçons étaient enlevés à leur famille, déportés en Anatolie, dressés dans des écoles de janissaires, transformés en mercenaires de la "Sublime Porte". Dans notre Occident pourri de confort, on a du mal à s'imaginer la profonde horreur que fut cette domination ottomane en Albanie, en Serbie, en Bosnie et en Croatie. Très tôt, les techniques de la guerre des partisans ont été appliquées contre les occupants dans les Balkans ottomanisés: les partisans de ces siècles d'oppression s'appelaient les Haiduks; en Albanie, ils ont été conduits par un capitaine sublime, surnommé Skanderbeg. Il avait été enlevé à sa famille, éduqué pour devenir janissaire: il s'est évadé d'Anatolie pour rejoindre son peuple dans les montagnes et combattre le joug ottoman. Dans les Balkans, il y a assez de thématiques historiques pour créer un cinéma européen pendant 300 ans, avec des films autrement plus captivants que les fades historiettes de cow-boys ou les soap-operas de la sous-culture américaine! Tout le folklore croate de Dalmatie et d'ailleurs, avec ses costumes magnifiques, rappelle la lutte pluriséculaire contre les Turcs. Pendant 500 ans, les Balkans se sont insurgés contre la culture composite de l'empire ottoman, exécrable préfiguration de la multiculture qu'on cherche à nous fourguer aujourd'hui comme la panacée définitive, qui mettra un terme aux tumultes de l'histoire et dissolvera toutes nos traditions, tous les ressorts de notre identité, toutes les constantes de nos systèmes juridiques. Relis les retentissantes sottises qu'ont écrites des Bernard-Henry Lévy et des Alain Finkielkraut. Mais cette mutliculture, on est bien forcé de le reconnaître, ne peut pas fonctionner. Elle laisse des séquelles indélébiles, elle provoque des tragédies que les siècles ne parviennent pas à effacer, elle déboussole les peuples, elle ne leur procure aucun apaisement. La preuve? La succession ininterrompue des tragédies balkaniques en ce siècle.
En Espagne, quand les armées asturiennes, aragonaises, castillanes et basques prennent enfin pied en Andalousie pour ramener cette terre à la grande patrie européenne, mettre ainsi un terme à la Reconquista et faire de la péninsule ibérique un Etat viable, ils se rendent rapidement compte qu'aucune culture composite ne permettra de donner une colonne vertébrale solide à cet Etat en jachère. Ou bien l'Ibérie était musulmane et appliquait un droit dérivé du Coran (ce qui est parfaitement respectable en soi), ou bien l'Ibérie était chrétienne et appliquait un droit dérivé du droit coutumier wisigothique (en vigueur en Espagne avant l'islamisation forcée et dans les régions non conquises par les Arabes). Un mixte de droit coranique et de droit coutumier germanique ne peut fonctionner harmonieusement, donc aucune convivialité sociale ne peut surgir si des règles boiteuses et peu claires sont appliquées dans la société. Cette impossibilité d'un droit composite a scellé le sort des vaincus, qui ont dû se replier en Afrique du Nord ou dans les provinces ottomanes, jusqu'à Istanbul, où ils pouvaient vivre sous le droit coranique selon leurs voeux et leurs convictions.
Dans les Balkans, après la terrible défaite des Serbes et de leurs alliés bosniaques, croates et albanais dans la Plaine du Kosovo, au Champ des Merles en 1389, les armées chrétiennes n'ont plus pu s'imposer. Une croisade hongroise du Roi Sigismund, aidée de chevaliers français et allemands, n'a pas pu délivrer les Balkans: elle a été écrasée en 1396 par le Sultan Bayazid Yildirim. La date de 1389 marque le début d'une affreuse tragédie pour l'Europe, qui s'agravera encore par la trahison du Roi de France, François Ier, qui s'allie aux Turcs pour prendre l'Europe centrale dans une redoutable tenaille: à l'Ouest les Français, à l'Est les Turcs. Cette alliance va durer 300 ans. Qu'on en juge: en 1526, François Ier veut s'emparer de la ville impériale de Milan. Charles-Quint, Empereur, le bat à Pavie, avec l'appui, notamment, d'une troupe d'élite: les bandes d'ordonnance des Pays-Bas, regroupant les meilleurs guerriers de la noblesse du Brabant, des Flandres, du Luxembourg et du Hainaut. Mais, l'alliance franco-turque déploie déjà sa logique implacable, celle des attaques concertées et simultanées, sur deux fronts: la même année que Pavie, les Ottomans envahissent et dévastent la Croatie, après leur victoire à Mohacs. Le vieil Etat médiéval croate, havre d'une culture incomparable, cesse d'exister, connait le même sort que la Serbie en 1389. La perte de la Croatie a été une tragédie pour l'Europe. Présents en Croatie, les Ottomans peuvent menacer et envahir la Hongrie et la Basse-Autriche à leur guise. Deux fois, Vienne sera assiégée et sauvée par le courage et la tenacité de ses milices bourgeoises et des troupes impériales et polonaises (Jan Sobiesky). Chaque fois que les Ottomans attaquent à l'Est, les Français attaquent à l'Ouest. Le Reich se défendra bec et ongles pour échapper à cette tenaille, épuisant toutes ses forces.
A la fin du 17ième siècle, se constitue la SAINTE-ALLIANCE (Bavière, Saint-Empire, Autriche-Hongrie, Pologne-Lithuanie, Russie), sous l'impulsion d'un Capitaine exceptionnel, le Prince Eugène de Savoie, qui force les Ottomans à céder 400.000 km2 aux pays de cette Sainte-Alliance. L'Empire ottoman recule partout, de la Dalmatie au Caucase. Le Reich peut respirer, mais insuffisamment: Louis XIV attaque à l'Ouest, ravage la Lorraine (50% de morts ou de réfugiés parmi les autochtones), la Franche-Comté (60% de morts et de réfugiés, notamment au Val d'Aoste), le Palatinat (66% de morts et de réfugiés). Comme dans les Balkans, les ressortissants du Saint-Empire de langue romane fuyent devant les Français comme leurs infortunés confrères des Balkans fuyaient devant les Turcs. Les Lorrains ont été recasés en Allemagne, en Suisse, dans les Pays-Bas, dans le Banat serbe et roumain, en Italie (où 6000 d'entre eux mourront de paludisme en tentant d'assécher les marais pontins près de Rome, que leur avait donnés le Pape...). En 1695, le Maréchal de Villeroy, pour soulager les Turcs et attirer vers l'Ouest une parties des armées impériales, fait bombarder à boulets rouges Bruxelles, gratuitement. C'est le premier bombardement terroriste de l'histoire, la sinistre préfiguration de Coventry, Dresde, Berlin, Hambourg, et, plus récemment, Hanoi, Bagdad et aujourd'hui Belgrade, Novi Sad, etc. La Sainte-Alliance et le Saint-Empire ont certes vaincu à l'Est, mais ils ont perdu à l'Ouest de belles provinces: la Flandre méridionale, l'Artois, le Cambrésis, la Bresse, la Franche-Comté, la Lorraine et l'Alsace. Preuve, s'il en est, qu'il est impossible de guerroyer sur deux fronts. En 1718, Belgrade est libérée par un régiment de Huy, ville de la vallée de la Meuse, où les drapeaux du Sultan, prix comme trophées, ont longtemps été conservés dans la collégiale.
En 1791, les Anglais se décident à soutenir en toutes circonstances la Turquie moribonde contre TOUTES les puissances européennes s'approchant de la Méditerranée orientale, point de passage obligé pour atteindre l'Egypte convoitée, où l'on envisageait déjà de creuser le Canal de Suez, pour rejoindre plus facilement les Indes, via la Mer Rouge. Cette politique de "containment" avant la lettre est consignée dans un mémorandum remis à Pitt, Premier Ministre anglais. Les axiomes de la politique maritime de l'Angleterre y ont été fixés une fois pour toutes: les Autrichiens ne doivent pas avancer trop loin dans les Balkans; les Russes, qui occupent la Crimée depuis 1783, doivent être contenus au Nord du Bosphore et ne pas se rendre totalement maîtres de la Mer Noire. Il faut réfléchir à ce mémorandum quand on analyse les événements d'aujourd'hui. La révolution française, en envahissant les Pays-Bas autrichiens en 1792, obligent, par leur diversion, les Serbes à capituler une nouvelle fois devant les Ottomans, à abandonner leur vague autonomie, récente et précaire, parce qu'ils ne bénéficient plus de l'appui militaire autrichien, Vienne étant obligée de mobiliser ses réserves, y compris ses régiments croates, pour faire face au déferlement des sans-culottes qui pillent et assassinent à qui mieux mieux de Tournai au Rhin (la magnifique abbaye de Villers-la-Ville sera ainsi réduite en cendres et jamais reconstruite). Ces hordes "révolutionnaires" faisaient le travail des Anglais: elles allaient éliminer quelques mois plus tard un Roi qui avait fait alliance avec l'Autriche et renoncé à la calamiteuse politique des François Ier, Richelieu et Louis XIV. Louis XVI avait mis sur pied de guerre une flotte redoutable qui avait réussi à battre la Royal Navy à Yorktown en 1783, humiliant ainsi Londres. Il avait ensuite lancé des expéditions lointaines (dont celle de La Pérouse qui l'a obsédé jusqu'au pied de l'échafaud: "A-t-on des nouvelles de La Pérouse?" a demandé ce Roi sage avant d'être décapité). L'Angleterre se débarrassait machiavéliquement d'un Roi apparemment débonnaire, mais dont la politique était européenne, offensive en direction de l'Atlantique et clairvoyante. Louis XVI est mort parce qu'il avait tourné le dos à l'alliance franco-turque, renoncé à la séculaire hostilité du Royaume de France au Saint-Empire, aperçu l'avenir de son pays au Canada (ces "arpents de neige" de la Pompadour...), dans l'Atlantique, sur les océans. Face à l'Ouest, dos au Reich, comme celui-ci pouvait désormais sans craindre de coup de poignard dans le dos, faire face aux Ottomans.
Ce n'est qu'à la fin du XIXième siècle que la France et la Russie manipuleront la Serbie contre l'Autriche. Mais avant cela, il a fallu éliminer totalement en 1903 la famille régnante des Obrenovic, qui seront remplacés par les Karageorgevic, qui dénonceront tous les liens antérieurs de la Serbie avec l'Autriche, détentrice de la dignité impériale. L'attentat de Sarajevo est le triste et dramatique aboutissement de cette prise du pouvoir par les Karageorgevic au détriment des Obrenovic. Après 1919 et la révolution bolchevique, la France exsangue utilise son or pour financer les gigantesques budgets des armées polonaises et yougoslaves (serbes), afin de contenir l'Allemagne, ni la nouvelle Turquie kémaliste ni la Russie bolchevique ne pouvant ou ne voulant plus jouer ce rôle. C'est une ironie de l'histoire de voir que la Serbie a accepté le rôle d'"ersatz" de la Turquie après le Diktat de Versailles. Mais rapidement des hommes d'Etat serbes s'apercevront que cette situation est artificielle et intenable sur le long terme; elle risquait de faire de la Yougoslavie un Etat assisté, incapable de développer de manière autonome une économie viable, en harmonie avec ses voisins. En 1934, la diplomatie de Goering (décrite par les Américains comme la tentative de construire dans le Sud-Est européen "a German informal Empire") réussit une réconciliation entre l'Allemagne et le Royaume de Yougoslavie, dirigée par la poigne de l'économiste serbe Milan Stojadinovic (1888-1961), qui comprend qu'une Yougoslavie isolée de ses voisins ne peut survivre économiquement. Stojadinovic renoue avec l'Italie et la Bulgarie (ennemie héréditaire de la Serbie) et s'appuie sur les Serbes, les Slovènes et les Bosniaques musulmans; sa popularité est nettement moindre chez les Croates catholiques (qui implicitement refuse l'alliance allemande, alors qu'on leur reproche aujourd'hui d'être des germanophiles inconditionnels!). L'alliance germano-yougoslave durera jusqu'en 1941. La Yougoslavie adhèrera à l'Axe. En mars 41, un putsch pro-britannique (Colonel Simovic) renverse le gouvernement légal. Les troupes de l'Axe entrent dans le pays pour sauver une légalité qui leur convenait. Les Croates changent de camp, trouvant dans une alliance avec l'Allemagne et l'Italie une chance de quitter l'Etat yougoslave qu'ils jugent composite (comme quoi rien n'est simple dans les Balkans, où les alliances changent souvent!). Avec l'entrée des troupes allemandes, hongroises, bulgares et italiennes, une tragédie sans nom s'abat sur tous les peuples de la Yougoslavie, avec, en plus, de nouveaux tracés pour les frontières intérieures, toujours contestés par les toutes les parties aujourd'hui, tant les populations, dispersées antérieurement par la terreur ottomane vivent les unes dans les autres, sans frontières précises. De 1941 à 1945, le gouvernement serbe du Général Nedic reste en selle, assez fidèle à l'Axe malgré le chaos dans lequel il plonge les Balkans. Il s'appuie sur une armée de 10.000 hommes bien entraînés et très disciplinés, dont les militaires allemands feront l'éloge. Mais le pays est plongé dans une abominable guerre civile: ethnie contre ethnie, mais aussi Serbes contre Serbes (soldats de Nedic, tchetniks royalistes et partisans titistes dans une terrifiante lutte triangulaire), Croates contre Croates (Oustachistes contre Partisans, Tito étant, ethniquement parlant, un Croato-slovène; Tudjman, l'actuel président croate, était partisan communiste, alors que des esprits simples, mal intentionnés et mal informés en font un fasciste de toujours!), Slovènes contre Slovènes (Domobrans contre Partisans), etc.
Aujourd'hui, après la mort de Tito, après l'indépendance de la Croatie et de la Slovénie, l'alliance franco-turque de 1526 à 1792, l'alliance anglo-turque de 1791 à nos jours, fait place à un Axe américano-turc, visant à recréer une chaîne de petits Etat inféodés à l'OTAN et à la Turquie, pour faire pièce aux Européens dans le Sud-Est balkanique et y entretenir des foyers de tensions permanentes, semant la zizanie dans toute l'Europe. Ce sont essentiellement les Russes et les Allemands qui sont visés, mais aussi les Italiens qui ont toujours eu des intérêts en Méditerranée orientale (Rhodes, Cilicie), les Grecs (Chypre), les Chrétiens d'Orient (Liban, Syrie), la France (qui ne pourra plus jamais jouer son rôle de protectrice des chrétientés d'Orient). Le mémorandum adressé à Pitt est toujours d'actualité, mais c'est le Pentagone qui le concrétise dans les faits. Cette politique est inadmissible pour tous les Européens. Cette politique est anti-impériale, elle empêche l'Europe de retrouver une conscience impériale au sens de la Sainte-Alliance de 1690 à 1720. Tous ceux qui refusent de voir ce nouvel état de choses, de tirer clairement les leçons de l'histoire, sont des imbéciles. Ceux qui travaillent à occulter les leçons de l'histoire, ceux qui entretiennent délibérément l'ignorance des masses et des élites, ceux qui occupent des postes importants, ministériels ou autres, diplomatiques ou économiques, et qui ne raisonnent pas en termes d'histoire, sont de vils traîtres. Leur sort doit être mis aux mains d'une nouvelle Sainte-Vehme, tribunal occulte oeuvrant au seul salut du Saint-Empire. Et qui ne connait que deux sentences: l'acquittement ou la mort.
- Je suis un héritier spirituel des Bandes d'Ordonnance des Pays-Bas qui ont combattu contre François Ier à Pavie en 1526.
- Je suis un héritier spirituel de Don Juan d'Autriche, vainqueur à la bataille navale de Lépante en Méditerranée orientale en 1571, en tentant de reprendre Chypre aux Ottomans (puisse une flotte hispano-italo-franco-germano-croato-serbo-russo-grecque, totalement dégagée du machin OTAN, cingler très bientôt vers cette île et en faire un bastion inexpugnable de la Grande Europe!).
- Je suis un héritier spirituel du Prince Eugène de Savoie, que l'on nommait le Noble Chevalier ("Der edle Ritter").
- J'admire le long combat héroïque des Haiduks slaves et roumains et l'épopée du héros albanais Skanderbeg (tout Albanais qui ne rend pas hommage à Skanderbeg est un traître à son albanitude; tout Albanais qui ne combat pas pour son albanitude face au sud, dos au nord, n'est pas un Albanais, mais un mercenaire ottoman).
- Je place mes travaux géopolitiques sous le signe de la Sainte-Alliance de 1690 à 1720.
- Je suis un héritier spirituel des milices de la Ville de Bruxelles qui ont défendu leur ville contre les artilleurs terroristes du Maréchal de Villeroy, à côté des soldats bavarois et savoisiens de la garnison. Je te rappelle aussi, cher Quentin, qu'à l'âge de huit ans, mon cousin, de 22 ans mon aîné, m'a dit de toujours regarder la façade d'une maison de la Grand'Place de Bruxelles, sur laquelle figure un Phénix, symbolisant la cité et le Brabant résistant aux assauts du Roi Soleil et lui faisant la nique. Mon cousin m'a demandé de ne jamais oublier ce symbole. Je ne l'ai jamais oublié.
- Je suis un héritier spirituel des soldats hutois de l'armée autrichienne qui ont enlevé Belgrade en 1718, l'ont rendue à l'Europe.
- Je suis un héritier spirtuel des soldats des régiments de Baulieu, de Clerfayt, de Ligne, de Latour, qui ont tenté d'endiguer le flot des sans-culottes se déversant vers le Rhin en 1792, tandis que leurs alliés turcs reprenaient Belgrade sur le Danube et privaient les Serbes de leurs libertés.
- Je suis un héritier politique de Bismarck (et de Léopold I) qui s'opposaient à l'alliance anglo-franco-turque lors de la Guerre de Crimée contre la Russie, ancienne puissance de la Sainte-Alliance de 1690 à 1720.
- Je me souviens avec horreur de l'attentat de Sarajevo qui a coûté la vie à l'Archiduc d'Autriche et à son épouse, la Comtesse Chotek, tout comme je me souviens avec horreur du sort de la famille Obrenovic.
- Je déplore l'alliance franco-serbe d'après 1918, où la Serbie a été un "ersatz" de la Turquie ottomane et a été infidèle à son histoire.
- Je respecte rétrospectivement la politique économique et diplomatique de Milan Stojadinovic, soucieux de replacer son pays au sein de la famille des peuples de la Mitteleuropa et des Balkans.
- Je respecte l'attitude de Nedic, jeté dans un désarroi indescriptible, à l'époque la plus tragique de notre siècle.
- Je respecte tous les Yougoslaves, de quelle qu'ethnie que ce soit, qui ont combattu au cours de l'histoire du côté du Saint-Empire et de la Sainte-Alliance comme haiduks ou comme soldats réguliers, en particulier comme "granicar" (garde-frontières) le long du limes organisé par l'Autriche pour défendre l'Europe contre les Ottomans.
- Je déplore que Tito se soit laissé manoeuvrer par les Anglais contre les Allemands, les Hongrois, les Italiens et les Russes, sans pour autant condamner a priori sa politique de non-alignement (Bandoeng, etc.) et son socialisme fédéral et auto-gestionnaire, sorte de troisième voie entre le capitalisme et le panzercommunisme, à une époque où rien d'autre n'était possible.
- J'ai accepté l'indépendance de la Slovénie et de la Croatie en 1991, parce que je sais que des Etats composites sont inviables, incapables de susciter l'adhésion à des codes de droit précis (curieux que les défenseurs, en théorie, des droits de l'homme, sont ceux qui manipulent des idéologies qui nient le droit concret, seul vecteur de civilité viable!). De plus, ces deux pays offraient enfin une façade méditerranéenne-adriatique aux pays d'Europe centrale, ce que la France et l'Angleterre ont toujours voulu leur confisquer, les condamnant à l'enclavement continental (on se souviendra ici des "départements illyriens" inventés par Napoléon pour couper la Hongrie et l'Autriche de la mer, fonction que devait reprendre la Yougoslavie selon Poincaré et Clémenceau).
- Je défends l'indépendance de ces deux pays, mais sans développer de serbophobie, à la manière de certains philosophes parisiens.
- Je pense que la Serbie a droit à sa spécificité au même titre que l'Albanie illyrienne, la Bosnie bogomil, la Croatie et la Slovénie. Toutes ces identités et spécificités s'enracinent et doivent nécessairement s'enraciner dans l'esprit haiduk (ou granicar).
- Je m'oppose à l'alliance américano-turque d'aujourd'hui, tout comme Bismarck s'est opposé à l'alliance anglo-franco-turque lors de la Guerre de Crimée.
- Je demeure un fidèle lecteur de Carl Schmitt (dont les deux épouses ont été serbes!), qui a théorisé l'interdiction d'intervention des puissances extérieures à un espace donné.
- Je demeure un fidèle disciple de Carl Schmitt, car je me souviens qu'il a décrit, avec force arguments juridiques solidement étayés, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis comme des Etats pirates.
- Je demeure encore et toujours un fidèle disciple de Carl Schmitt, dans le sens où il a toujours décrit les bons apôtres de la morale internationaliste comme de dangereux ferments de la dissolution des Etats, donc de la civilisation, de l'urbanité, de la culture et surtout du droit.
Telles sont mes positions. Je persiste et je signe. Rien ne m'ébranlera. Je suis dans la continuité historique donc dans le réel. Tant pis pour ceux qui restent en dehors de l'une et de l'autre.
Je reste à la disposition de mes lecteurs pour leur conseiller de bonnes lectures sur tout ce qui précède.
A bientôt, cher Quentin, meilleures amitiés.
Robert Steuckers.
00:05 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : serbie, balkans, kosovo, guerre des balkans, otan, cnn? médias, manipulations médiatiques, histoire, yougoslavie, albanie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 12 février 2010
Phase 2 in Kosovo. Total ethnic cleansing
Phase 2 in Kosovo. Total ethnic cleansing
| di: Ugo Gaudenzi _ http://www.rinascita.eu/ |

For what concerns Kosovo Metohija – the harshest wound inflicted by Atlantics in the heart of Europe, still looking for its own freedom, after World War II – we have to underline how, after the territory forced division, they are now planning the eradication of Kosovo from Serbia. After 11 years of occupation, the NATO Atlantic commando has decided to force the status quo, transforming the 5 operation forces, placed to keep an eye on the North, South, East, West and Central part of the region, in an only device of strategic responsibility over all the Kosovarian territory, left aside the 5 zone dislocations: every Kfor sub-command has, since this February, the possibility of intervention during emergencies, everywhere throughout Kosovo.
The strategic idea is that of forcing, even military, the unification of Kosovo Metohija under the Albanian “government” of Pristine. Every race which is hostile to the separation of the province from its homeland, will be weakened, even at the cost of using acts of terrorism and of Albanian violence against churches and Serbian enclaves, as a pretext for a forced pacification. It has already occurred in 2004.
The very same declaration of Albanian “independence” of Pristine, immediately after the birth of Eulex, on February 2008, had been possible, thanks to the transformation of UCK gangs of terrorism into “internal police forces” in zones controlled by Albanians. Eulex’s mission, UE’s “general affairs” board (obviously not elected by the members of the Community), had been decided, two years ago, with the excuse of implementing the 1244 resolution of the UNO. The very same Eulex – which has in Kosovo, an armed force of 1400 “gendarmes”, among civilians and soldiers – ensures “safety”, i.e. armed control of the denser regions, still inhabited by Serbians, especially in the Northern part of the province (Mitrovica).
The eradication of the populations identities.
This is the Atlantic mission and of the so-called European Union.
Of which, colonial Italy is, a happy member.
00:25 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, balkans, épuration ethnique, kosovo, albanie, serbie, europe, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 09 février 2010
Kosovo, Phase 2: l'épuration ethnique totale!
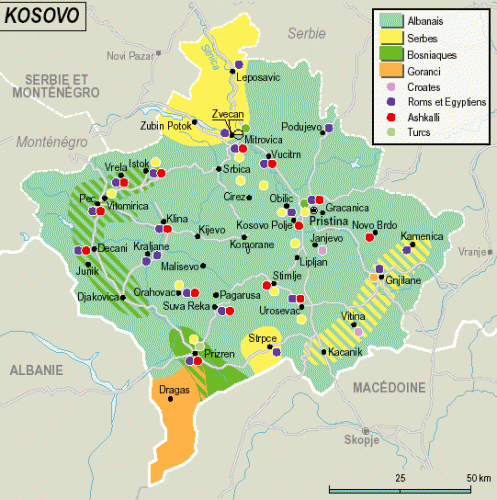
Udo GAUDENZI:
Kosovo, Phase 2: l’épuration ethnique totale!
Depuis le premier février 2010, les forces d’occupation de l’OTAN ont été diminuées de 2600 hommes ; ces forces sont stationnées dans la province serbe de Kosovo, arrachée à la tutelle de Belgrade par l’agression atlantiste de 1999 et la proclamation unilatérale d’indépendance du Kosovo en février 2008. La réduction de la présence atlantiste armée à 10.000 hommes au total a été justifiée « avec élégance » par les gouvernements intéressés comme une « amélioration d’ordre tactique », garantissant aux troupes déployées une « flexibilité accrue » lors de leurs interventions, quand elles s’interposent entre les diverses ethnies (principalement Albanais « skipetars », Serbes, Croates et Goranis), qui s’opposent les unes aux autres de manière ininterrompue depuis l’expulsion en masse de tous les non Albanais de cette province serbe ; il y a en effet 250.000 réfugiés au-delà des frontières du nouvel Etat autoproclamé. En réalité, la « guerre infinie », voulue par les atlantistes, réclame des troupes ailleurs, en Afghanistan par exemple, ce qui amène à réduire les effectifs de l’OTAN au Kosovo, mesure directement liée à la requête formulée par les Etats-Unis à l’endroit de leurs « alliés » (il faudrait dire de leurs « vassaux » ou de leurs « colonies »), à qui ils demandent d’augmenter les effectifs de leurs troupes dans l’Hindou Kouch.
Revenons au Kosovo, à la blessure la plus grave qu’ont infligée les atlantistes au cœur d’une Europe toujours à la recherche de sa liberté depuis la fin de la seconde guerre mondiale. Depuis la partition forcée du territoire initial de la Serbie, nous constatons que les atlantistes veulent désormais « compléter » leur objectif : arracher définitivement tous les liens qui pourraient encore unir le Kosovo à la Serbie. Depuis onze ans, l’OTAN occupe le pays et vient de décider, depuis son commandement suprême, de renforcer le statu quo, de le pérenniser, en transformant la structure de commandement des forces atlantistes au Kosovo. Cette structure prévoyait au départ le déploiement de cinq forces d’intervention distinctes, contrôlant respectivement le nord, le sud, l’est, l’ouest et le centre de la province. Dorénavant, il n’y aura plus qu’un seul dispositif, qui aura compétence stratégique sur l’ensemble du territoire kosovar, au lieu des cinq zones de compétence initiales. Toute subdivision du commandement de la Kfor dispose donc, depuis ce premier février, de la possibilité d’intervenir dans des situations conflictuelles d’urgence partout sur le territoire du Kosovo et non plus seulement dans la zone circonscrite qui leur était préalablement assignée.
L’idée stratégique qui se profile derrière cette modification structurelle est d’obliger toutes les parties concernées d’accepter, y compris sur le plan militaire, l’unité de facto du Kosovo, sous la férule du gouvernement albanais de Pristina. Toute ethnie hostile à la sécession kosovare et donc fidèle, dans une certaine mesure à la Serbie, sera désormais affaiblie dans ses revendications et ses aspirations et ne pourra plus évoquer comme prétexte les actes de terrorisme et de violence perpétrés par les Albanais contre les églises et les enclaves serbes, actes de violence qui avaient pourtant justifié la présence des troupes de la Kfor, appelées à « pacifier » la région. Ce refus de prendre en compte les déprédations et le vandalisme sauvage des Islamo-Albanais, on avait déjà pu l’enregistrer en 2004.
La déclaration unilatérale d’indépendance par les Albanais de Pristina s’est faite, rappelons-le, immédiatement après la création de l’Eulex, en février 2008. la création de l’Eulex avait eu pour corollaire de transformer les bandes terroristes de l’UÇK en une « force de police intérieure » dans les zones contrôlées par les Albanais. La « mission » de l’Eulex, un organisme créé par le Conseil des « affaires générales » de l’UE (organisme qui, bien entendu, n’est pas élu par les peuples de l’Union), avait déjà été décidée deux ans auparavant, sous le prétexte de traduire dans la réalité kosovare la résolution 1244 des Nations Unies. L’Eulex alignait au Kosovo une force de quelque 1400 gendarmes plus un nombre complémentaire de civils et de militaires. Elle devait assurer la « sécurité » et le contrôle armé des zones encore densément peuplées de Serbes, surtout dans le nord de la province, autour de la ville de Mitrovica. Derrière tout le prêchi-prêcha édulcorant des instances atlantistes et mondialistes, qui nous parlent de « démocratie » et de « droits de l’homme », l’objectif réel et concret de cette opération était de déraciner les Serbes, de les arracher à la terre kosovare et de les contraindre à l’émigration. Bref : l’objectif des atlantistes est de faire et de parfaire de manière totale et irréversible ce qu’ils ont bruyamment reproché aux autres de faire de manière ponctuelle et circonstanciée : de l’épuration ethnique à grande échelle, sous le couvert de propos lénifiants.
Voilà le type de mission que se donnent les atlantistes et leurs auxiliaires lâches et véreux de l’Union Européenne. Et les dirigeants de la colonie US qu’est devenue l’Italie ont participé allègrement à ce crime.
Udo GAUDENZI.
(éditorial du journal « Rinascita », Rome, 3 février 2010).
Site internet : http://www.rinascita.eu/
Courrier électronique : Rédaction de Rome : redazione@rinascita.net
Rédaction de Belgrade (Mirjana Vukidic – beograd@rinascita.net )
00:20 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, affaires européennes, kosovo, albanie, balkans, politique internationale, géopolitique, épuration ethnique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 17 septembre 2009
Acuerdo bilateral Kosovo-EEUU sobre ayuda economica
Acuerdo bilateral Kosovo-EEUU sobre ayuda económica
 Kosovo y Estados Unidos firmaron este lunes su primer acuerdo bilateral de ayuda económica, centrado en las infraestructuras, aunque el monto no fue precisado, anunciaron fuentes oficiales en Pristina.
Kosovo y Estados Unidos firmaron este lunes su primer acuerdo bilateral de ayuda económica, centrado en las infraestructuras, aunque el monto no fue precisado, anunciaron fuentes oficiales en Pristina.
“La ayuda se destinará al desarrollo (de Kosovo) y en particular a las diferentes infraestructuras, y en consecuencia a la economía, los transportes y la educación”, declaró el presidente kosovar, Fatmir Sejdiu.
El canciller kosovar indicó en un comunicado que otro acuerdo de 13 millones de dólares fue firmado con Estados Unidos para reforzar el Estado de derecho en Kosovo.
El ministro de Relaciones Exteriores, Skender Hyseni, indicó que la ayuda sería empleada en crear “una estructura legal estable” en Kosovo.
Estados Unidos fue uno de los primeros países en reconocer la independencia de Kosovo, proclamada de manera unilateral en febrero de 2008.
Belgrado no reconoce la independencia y considera que Kosovo es una provincia serbia.
Extraído de Univisión.
00:20 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, kosovo, etats-unis, économie, balkans, impérialisme, impérialisme américain, géopolitique, europe, affaires européennes, politique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 08 septembre 2009
Albanokosovares responsables del agravamiento de la situacion
Albanokosovares responsables del agravamiento de la situación
 El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Andréi Nesterenko, declaró hoy que los albanokosovares son los responsables del agravamiento de la situación en la provincia serbia de Kosovo.
El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Andréi Nesterenko, declaró hoy que los albanokosovares son los responsables del agravamiento de la situación en la provincia serbia de Kosovo.
“Los albanos de Kosovo son los responsables del continuo agravamiento de la situación en esa provincia”, manifestó el diplomático ante la prensa.
En la ciudad de Kosovska Mitrovica, en el norte de Kosovo, se registraron varios enfrentamientos en dos semanas después que varias familias albanesas decidieran volver a la parte serbia (norte) de la ciudad. Varias personas recibieron heridas en los enfrentamientos.
El descontento de los serbios se debe a que los albaneses intentan restaurar sus casas destruidas durante el sangriento conflicto interétnico de 1998-1999. Según los serbios, esas casas se encuentran en la parte serbia de la ciudad.
La policía kosovar y las fuerzas de la misión de la Unión Europea en Kosovo (Eulex) intervienen frecuentemente para detener los enfrentamientos.
“Los albanokosovares quieren restaurar sus casas, pero ese mismo derecho se les niega a los serbios haciendo reducir aún más su espacio étnico”, explicó Nesterenko.
Los serbios kosovares afirman que, en principio, no se oponen al retorno de los albaneses a la parte norte de Kosovska Mitrovica, pero insisten en que la devolución de los bienes inmuebles a los unos y otros sea equitativa y que se garantice la seguridad a los serbios que también deseen regresar a sus casas abandonadas hace años.
“Es tarea de las misiones internacionales presentes en Kosovo de mantener la seguridad en esa provincia y prevenir las provocaciones antiserbias porque el problema de Kosovo representa uno de los mayores retos a la seguridad en los Balcanes”, señaló el portavoz de la diplomacia rusa.
Extraído de RIA Novosti.
08:06 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : albanie, kosovo, balkans, ex-yougoslavie, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 juin 2009
El gobierno kosovar y el crimen organizado
El gobierno kosovar y el crimen organizado
 Ex: http://labanderanegra.wordpress.com/
Ex: http://labanderanegra.wordpress.com/
Para suscitar desórdenes y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de Belgrado en Kósovo, la OTAN reclutó a delincuentes locales que formaron el «Ejército de Liberación de Kósovo» (UÇK). Estos individuos nunca abandonaron su actividad criminal. En lo consecutivo, la OTAN se avendrá, de tal manera, a esta organización mafiosa que dejará manifiesto su imposibilidad de reclutar gente honesta para servir a los intereses extranjeros. El ascenso unilateral del Kósovo ocupado al rango de Estado independiente, en 2008, ha conferido la impunidad a un gobierno dirigido por una organización criminal muy bien conocida por los servicios de policías occidentales, tal como lo demuestra un artículo de Weltwoche, publicado en 2005 y que reproducimos en nuestras columnas.
Tres de los políticos más importantes de Kosovo están profundamente involucrados en el crimen organizado, en particular, del tráfico de droga. Esto es, precisamente, lo que demuestran los documentos secretos de los Servicios de Inteligencia alemanes, de la ONU y de la Kfor (Kosovo Force), una fuerza internacional de estabilización. Estos documentos inculpan a Ramush Haradinaj, quien ocupó el cargo de Primer Ministro hasta marzo de 2005; a Hashim Thaçi, Primer Ministro desde enero de 2008 hasta la fecha y líder del Partido Democrático de Kosovo y a Xhavit Haliti, miembro de la presidencia del Parlamento. Cada uno de ellos hizo carrera en el Ejército de Liberación de Kosovo, vivieron varios años en Suiza y, hasta hoy, mantienen relaciones de negocio y personales en ese mismo país.
En el análisis de las 67 páginas del informe de los Servicios de Inteligencia alemanes del 22 de febrero de 2005, se puede leer, por ejemplo: « Gracias a actores claves (como Haliti, Thaçi y Haradinaj) existe una relación estrecha entre la política, la economía y estructuras criminales que operan a nivel internacional. Las redes criminales que la sostienen propician la inestabilidad política, porque no tienen, evidentemente, interés en que se instaure un orden estatal eficaz que podría perjudicar sus prósperos negocios. Fácil de entender por qué los principales actores del crimen organizado aspiran apuestos de primera importancia dentro del gobierno o dentro de partidos y/o mantienen muy buenas relaciones con esas esferas ». El crimen organizado se transforma, de este modo, en « un medio político propicio ». Este es el análisis que los Servicios de Inteligencia consideran « información clasificada ».
Uno de estos personajes claves, Hashim Thaçi, apodado « la Serpiente » es el presidente del Partido Democrático de Kosovo y muy conocido en Suiza. Según los Servicios de Inteligencia alemanes, Thaçi controla parte importante de las actividades criminales de Kosovo. «Se presume que Thaçi, junto a Haliti, es uno de los financiadores del asesino profesional Afrimi», presunto responsable de, al menos, once asesinatos por encargo.
Thaçi, de 36 años, vivió desde 1995 varios años en Suiza en calidad de refugiado. Gracias a una beca, hizo estudios en la Universidad de Zúrich de historia de los países del Este. En 1992 fue uno de los fundadores del UÇK y, más tarde, se convirtió en su líder. En 1999, se hizo súbitamente conocido por su participación, en calidad de jefe de la delegación de la tienda albano-kosovar en las negociaciones de paz albano-serbias de Rambouillet. Allí se dio a conocer por la comunidad internacional como hombre político.
En esta misma época, de acuerdo a los Servicios de Inteligencia alemanes, Thaçi controlaba un «servicio de seguridad», «una red criminal que operaba en todo Kósovo». « Es probable que en 2001 mantuviera contacto con la mafia checa y la albanesa. En octubre de 2003 habría estado ligado estrechamente, en el marco del tráfico de armas y droga, a un clan al que se le acusa de lavado de dinero y chantaje.
El clan de los albaneses de Kosovo
El segundo personaje clave, Ramush Hardinaj de 37 años, es, sin duda, uno de los políticos más controvertidos de Kósovo. En el informe de los Servicios de Inteligencia alemanes se le hace mención de la siguiente forma: « La estructura que rodea a Haradinaj es, fundamentalmente, un clan familiar de la ciudad de Decani que se dedica a todo tipo de actividades criminales, políticas y militares, que influyen, considerablemente, en las condiciones de seguridad de todo Kósovo. El grupo comprende alrededor de 100 miembros implicados en el tráfico de droga, armas y mercancía sometida al régimen aduanero. Además, Haradinaj controla gobiernos comunales».
En un informe secreto del 10 de mayo de 2004, la Kfor designa a este grupo como «la más poderosa organización criminal» de la región y agrega que Haradinaj a puesto su mano, también, en la distribución de la ayuda humanitaria y la ha utilizado como instrumento de poder.
Gracias a la colaboración activa de la comunidad internacional y, particularmente a la de Estados Unidos, Haradinaj ha podido abrirse camino. Llega a Suiza en 1989, hablando inglés y francés de corrido, en calidad de trabajador inmigrante. Se desempeñó como guardia en una discoteca de la estación de ski de Leysin. En febrero de 1998 vuelve a Kósovo y organiza operaciones militares del UÇK. Después de la guerra, se hará conocido por estar involucrado en enfrentamientos armados con otros clanes, hechos que inmediatamente fueron interpretados por la ONU como « actos de venganza y ajuste de cuentas ». Efectivamente, se trató de un caso de lucha de poder entre familias mafiosas, como lo muestra el ejemplo siguiente.
La Central Intelligence Unit ( CIU ), el servicio de inteligencia de la ONU describe, en su informe del 29 de diciembre de 2003, un caso en el que ven implicados diplomáticos: El 7 de julio del año 2000 Haradinaj ataca la casa de un clan de un clan rival que le hacía competencia en el tráfico de drogas. Según la CIU, Hadinaj pretendía robar 60 kilos de cocaína que esta familia escondía. Resultó herido en intercambio de balas y debió escapar.
Antes de que Haradinaj pudiera ser interrogado por los policías de Naciones Unidas, fue puesto en un helicóptero militar italiano y llevado a una base de la armada estadounidense, en una operación rápidamente organizada por dos presumibles agentes de la CIA. La policía de Naciones Unidas recibió, desde su cuartel general en Pristina, la orden de « renunciar a todas las medidas en su contra».
La razón por la que la policía se abstuvo de realizar lo pertinente al caso es que se temió que su arresto, que pudo convertirse en la imputación de un « héroe de combate por la liberación », caldeara los ánimos en una situación que ya era tensa. Después de este incidente, Haradinaj fue puesto a salvo en Estados Unidos. « Durante su estadía recibió entrenamiento y Estados Unidos le prometió ayudarlo en su carrera política, si Kosovo lograba independizarse, él sería su candidato favorito ».
De regreso en Kosovo, el protegido de USA funda un nuevo partido, la « Alianza por el futuro de Kosovo » y en diciembre de 2004 se convierte en Primer Ministro conforme al deseo de Estados Unidos. Sin embargo, no durará más de tres meses en el cargo. En marzo de 2005 renuncia y se presenta ante el Tribunal Penal Internacional de la Haya. Se le acusa por haber cometido, de manera sistemática, crímenes de limpieza étnica acompañados de torturas y violaciones en contra de serbios y gitanos. A pesar de ello, bajo la fuerte presión de Estados Unidos y contra la voluntad de la fiscal en jefe a cargo del caso, Carla del Ponte, fue liberado de la prisión preventiva y pudo dedicarse de momento a la actividad política. Su procesamiento comenzará en la Haya, probablemente, en 2007. Ninguna denuncia ha sido presentada, hasta el momento, por crimen organizado. ( Terminó siendo absuelto el 3 de abril de 2008).
El atentado de Zúrich
Xhavit Haliti, apodado «Bunny», también es uno de los personajes que juegan un rol importante en Kósovo. Según la Kfor, este miembro de la presidencia del Parlamento y vicepresidente del Partido Democrático de Kósovo « es un criminal conocido, implicado en tráfico de drogas y armas». El informe de los Servicios de Inteligencia alemanes afirma que «Haliti está involucrado tanto en el lavado de dinero, el tráfico de droga, armas y de humanos, como en asuntos de prostitución, además de pertenecer al principal círculo de la mafia. Como personaje clave en el crimen organizado, manipula, siempre, grandes sumas de dinero».
Al igual que Haradinaj y Thaçi, Haliti comenzó su carrera en Suiza. Estudió psicología en ese país, a fines de los años ochentas. En 1990 fue víctima de un atentado con motivaciones políticas. Un año más tarde, era parte de la presidencia del Movimiento Popular de Kósovo y organizaba el UÇK desde Suiza. Se cree que antes y durante la guerra abasteció de armamento a el UÇK y controló el Homeland Calling Fund. Inmigrantes albano- kosovares de Suiza y Alemania donaron, más o menos voluntariamente, 400 millones de dólares a este fondo.
La Kfor escribió: « Una vez que las donaciones disminuyeron después de la guerra, Haliti se arroja a la actividad criminal organizada a gran escala ». Según la misma fuente, Haliti no representa un caso único; « lo sorprendente es que casi todos los cabecillas del crimen organizado son comandantes o jefes de unidades especiales de la UÇK ». Respecto a Haliti, tampoco se cuenta, aún, con nada que justifique una querella penal.
Estos tres ejemplos demuestran, una vez más, que Suiza fue un centro de actividad del UÇK. Es allí donde, antes del conflicto, se recolectaron millones destinados a la compra de armas y a la propaganda y, también, donde se reclutó a los combatientes para la « lucha por la libertad de los albaneses oprimidos de Kósovo ». En el verano de 2001, el Consejo Federal decidió que los representantes de las organizaciones albano-kosovares debían descontinuar su actividad política y la recaudación de fondos. Respecto a Haliti, el Consejo Federal emitió la prohibición de su entrada en territorio suizo.
Opio para Europa
Los informes secretos de los Servicios de Inteligencia alemanes hacen suponer que, a pesar de la administración de la ONU y la Kfor, Kósovo es uno de los principales centros de convergencia del crimen en Europa. Una de las razones es que el tráfico de drogas es altamente lucrativo. Gran parte del opio que se cosecha, de manera creciente, en Afganistán llega al mercado europeo convertido en heroína desde Albania y Kósovo. Según Klaus Schmidt, jefe de la Misión de Asistencia de la Comunidad Europea (PAMECA), cada día 500 a 700 kilos de opio llegan a Albania y Kósovo para ser transformados en sus laboratorios. Diariamente, un millón de euros de dinero de la droga se intercambian en el mercado gris de la capital albanesa de Tirana. Los especialistas afirman que se trata de cártel de droga más importante formado en curso de los últimos años.
De acuerdo al informe de los Servicios de Inteligencia alemanes, incluso los desórdenes de 2004, que llevaron a Kósovo al borde de una nueva guerra civil, fueron fomentados por criminales quisieron continuar dedicándose al tráfico con toda tranquilidad. « A principios de abril de 2004 sabíamos, gracias a medios encargados de la seguridad en los Balcanes, que los disturbios de Kósovo habían sido planeados y ejecutados a petición del crimen organizado. Durante los disturbios, camiones repletos de heroína y cocaína pasaron las fronteras sin ningún control, porque la policía de la ONU y los soldados de la Kfor estaban totalmente ocupados en el control de los disturbios ». Este hecho lo confirmaron policías de la ONU en Pristina, quienes prefirieron guardar sus identidades por seguridad. La policía de la ONU se queja de que no se ha hecho nada, hasta el momento, en contra de los criminales.
La ONU y la Kfor no han resuelto el problema, ni siquiera una parte de él. La policía de la ONU carece, particularmente, de medios. « Vamos a la batalla con espadas de madera », se lamenta un policía de alto rango de la ONU. Pero, sobre todo, carece de apoyo político para actuar, de manera eficaz, contra los clanes mafiosos. Según los Servicios de Inteligencia alemanes « ni los gobiernos regionales ni el Ejecutivo están interesados en la lucha contra el crimen organizado, porque están vinculados a él ». Un jefe de policía de la ONU, encargado de la lucha contra el crimen organizado, declaró a Weltwoche que « personeros de renombre, incluyendo el ex Primer Ministro, fueron propulsores de los disturbios de marzo, que fueron organizados por una estructura criminal conocida. Numerosos servicios lo saben, sin embargo, nada se hace en contra de esta estructura ». Ésta es su explicación: « Evitan que se desaten nuevos desórdenes, que se producirían sin duda, en el caso de que se iniciara una investigación criminal en contra de Ramush Haradinaj ».
Una de las consecuencias que trae dejar las cosas tal como están es que en Europa, especialmente en Suiza, alemania e Italia, los clanes albano-kosovares constituyen un poder criminal dominante. Los Servicios de Inteligencia alemanes consideran que aquello representa «un gran peligro para Europa ». Muchas comisarías de policía de la ONU se restituyen a los servicios de la policía kosovar. El problema es que los antiguos encargados permanecen en sus puestos y son los mismo que están bajo sospecha por mantener lazos estrechos, a menudo familiares, con jefes conocidos de la mafia.
Los documentos citados descansan en el resguardo de los cajones de los tribunales.
Jürgen Roth
Traducido por Carla Francisca Carmona, extraído de Red Voltaire.
00:35 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, balkans, affaires européennes, albanie, kosovo, crime organisé, mafia, diasporas mafieuses |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 01 mai 2009
Quelles règles géopolitiques ont joué dans le conflit du Kosovo?
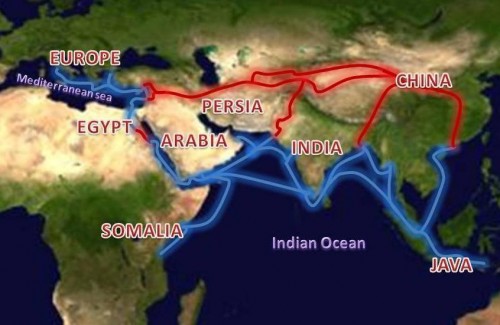
Archives de "Synergies Européennes" - 1999
Quelles règles géopolitiques ont joué dans le conflit du Kosovo ?
Intervention de Robert Steuckers au Colloque de « Synergon-Deutschland », 24-25 avril 1999 & à la Conférence sur la Guerre en Yougoslavie de la « Lega Nord », Milan, 6 mai 1999
Avec le déclenchement du conflit en Yougoslavie, le 25 mars 1999, toute géopolitique européenne, russe, euro-russe, eurasienne ou germano-russe (peu importe désormais les adjectifs !), doit :
Premièrement : être une réponse au projet de Zbigniew Brzezinski, esquissé dans son livre The Grand Chessboard.
Deuxièmement : organiser une riposte à la stratégie pratique et réelle qui découle de la lecture par les états-majors de ces thèses de Brzezinski. Cette stratégie s’appelle « New Silk Road Land Bridge Project », comme vient de le rappeler Michael Wiesberg dans l’éditorial de Junge Freiheit, la semaine dernière.
Le Projet « New Silk Road Land Bridge » (= Pont Terrestre sur le Nouvelle Route de la Soie) repose cependant sur des réflexions géopolitiques et géostratégiques très anciennes. Elle est une réactualisation de la stratégie du « containment » appliquée pendant la guerre froide. Le « containment » dérive des théories géopolitiques
1. d’Homer Lea, dont Jean-Jacques Langendorf, expert militaire suisse, a réédité le maître-ouvrage en allemand au début des années 80. Dans The Day of the Saxons, Lea fixait la stratégie britannique du « containment » de l’Empire russe, du Bosphore à l’Indus. Lea expliquait que les Russes ne pouvaient pas s’emparer des Dardanelles ou les contrôler indirectement (on se souvient de la Guerre de Crimée et des clauses très dures imposées à l’Empire russe par le Traité de Paris de 1856), qu’ils ne pouvaient pas franchir le Caucase ni dépasser la ligne Téhéran-Kaboul.
2. d’Halford John Mackinder, pour qui les puissances maritimes, dont l’Angleterre, devaient contrôler les « rimlands », pour que ceux-ci ne tombent pas sous l’hégémonie du « heartland », des puissances du milieu, des puissances continentales.
La dynamique de l’histoire russe, plus précisément de la Principauté de Moscovie, est centripète, dans la mesure où la capitale russe est idéalement située : au départ de Moscou, on peut aisément contrôler le cours de tous les fleuves russes, comme, au départ de Paris, on peut aisément contrôler tous les fleuves français et les régions qu’ils baignent. Moscou et Paris exercent une attraction sur leur périphérie grâce à la configuration hydrographique du pays qu’elles contrôlent.
La dynamique centrifuge de l’histoire allemande
Au contraire, la dynamique de l’histoire allemande est centrifuge parce que les bassins fluviaux qui innervent le territoire germanique sont parallèles les uns aux autres et ne permettent pas une dynamique centripète comme en Russie d’Europe et en France. Un pays dont les fleuves sont parallèles ne peut être aisément centralisé. Les bassins fluviaux restent bien séparés les uns des autres, ce qui sépare également les populations qui se fixent dans les zones très œcuméniques que sont les vallées. L’unification politique des pays à fleuves parallèles est très difficile. Face à cet inconvénient du territoire allemand, plus spécialement de la plaine nord-européenne de l’Yser au Niémen et, plus particulièrement encore, au territoire du Royaume de Prusse (du Rhin à la Vistule), l’économiste Friedrich List préconisera la construction de chemins de fer et le creusement de canaux d’une vallée parallèle à l’autre, de façon à les désenclaver les unes par rapport aux autres.
Outre l’Allemagne (et la Prusse), d’autres régions du monde connaissent ce parallélisme problématique des fleuves et des vallées.
1. La Belgique, dont la configuration hydrographique consiste en une juxtaposition des bassins de l’Yser, de l’Escaut et de la Meuse, avec un quasi parallélisme de leurs affluents (pour l’Escaut : la Lys, la Dendre ; puis la Senne, la Dyle et le Demer), connaît en petit ce que la grande plaine nord-européenne connaît en grand. Au début de l’histoire de la Belgique indépendante, le Roi Léopold I a fait appel à List, qui lui a conseillé une politique de chemin de fer et le creusement de canaux permettant de relier les bassins de l’Escaut et de la Meuse, puis de la Meuse et du Rhin, en connexion avec le système allemand. De ce projet, discuté très tôt entre Léopold I et F. List, sont nés le Canal Albert en 1928 seulement (d’Anvers à Liège) et le Canal du Centre (reliant la Haine, affluent de l’Escaut, à la Sambre, principal affluent de la Meuse). Ensuite, autre épine dorsale du système politico-économique belge, le Canal ABC (Anvers-Bruxelles-Charleroi). L’unité belge, pourtant très contestée politiquement, doit sa survie à ce système de canaux. Sans eux, les habitants de ces multiples micro-régions flamandes ou wallonnes, auraient continué à s’ignorer et n’auraient jamais vu ni compris l’utilité d’une certaine forme d’unité politique. L’idée belge est vivace à Charleroi parce qu’elle repose, consciemment ou inconsciemment, sur le Canal ABC, lien majeur de la ville avec le large (les ports de mer de Bruxelles et d’Anvers) (le Ministre-Président flamand, Luc Van den Brande, confronté récemment à de jeunes étudiants wallons de Charleroi, dans un débat sur la confédéralisation des régions de Belgique, a entendu de vibrants plaidoyers unitaristes, que l’on n’entend plus ailleurs en Wallonie ; dans leur subconscient, ces jeunes savent ou croient encore que leur avenir dépend de la fluidité du trafic sur le Canal ABC).
2. La Sibérie, comme « Ergänzungsraum » de la Russie moscovienne, connaît également un parallélisme des grands fleuves (Ob, Iénisséï, Léna). Si la Russie semble être, par son hydrographie, une unité géographique et politique inébranlable, en dépit d’un certain particularisme ukrainien, les immenses prolongements territoriaux de Sibérie, eux, semblent avoir, sur le plan hydrographique, les mêmes difficultés que l’Allemagne et la Belgique en plus petit ou en très petit. Raison pour laquelle le Ministre du Tsar Sergueï Witte, au début de ce siècle, a réalisé au forceps le Transsibérien, qui alarmait les Anglais car les armées russes acquéraient, grâce à cette voie ferroviaire transcontinentale, une mobilité et une vélocité inégalées. La réalisation du Transsibérien donne l’occasion à Mackinder de formuler sa géopolitique, qui repose essentiellement sur la dynamique et l’opposition Terre/Mer. Parce que les voies ferrées et les canaux donnent aux puissances continentales une forte mobilité, comparable à celle des navires des thalassocraties, Mackinder théorise le containment, bien avant la guerre froide, au moment où la moindre mobilité habituelle de la puissance continentale russe cesse d’être véritablement un handicap.
3. L’Indochine possède également une configuration hydrographique de type parallèle (avec le Hong rouge, le Mékong, le Ping, le Yom, le Salween, l’Irrawaddy). Cette configuration explique la « Kleinstaaterei » de l’ensemble indochinois, manipulé par les Français à la fin du XIXième siècle, par les Américains après 1945.
4. La Chine a aussi des fleuves parallèles, mais elle a pu y pallier en organisant des liaisons par une navigation côtière bien organisée. Autre caractéristique de l’hydrographie chinoise : les sources des grands fleuves se trouvent pour une bonne part sur les hauts plateaux du Tibet, ce qui explique l’acharnement chinois à conserver ce pays conquis dans les années 50. Qui contrôle les sources tibétaines des grands fleuves chinois et indochinois risque à terme de contrôler l’alimentation en eau de la Chine.
Ce regard jeté sur l’hydrographie démontre surtout que la géopolitique est bien souvent une hydropolitique.
Le projet « New Silk Road Land Bridge »
Revenons au projet américain de « New Silk Road Land Bridge ». Ce projet vise à créer une barrière d’Etats et de bases contenant la Russie loin des mers et de l’Océan Indien. Cette barrière commence à l’Ouest sur l’Adriatique (avec l’Albanie) et se termine en Chine. Elle relie, comme la Route de la Soie du temps de Marco Polo, les deux parties les plus peuplées de la masse continentale eurasienne. En termes militaires, cette barrière serait constituée de l’Albanie réorganisée par les partisans de l’UCK, encadrés par des officiers américains et turcs, une Macédoine où l’on aura sciemment minorisé les Slaves au profit des Albanais renforcés par les réfugiés du Kosovo, une Turquie comme pièce centrale de la nouvelle OTAN, l’Azerbaïdjan qui vient de mettre à la disposition de l’OTAN la plus importante base aérienne de l’ex-Armée Rouge, l’Ouzbékistan à proximité de la Caspienne qui vient de dénoncer le pacte qui le liait à la Russie (dans le cadre de la CEI). A ce dispositif turcocentré, s’ajoutera très vite la Géorgie (qui vient aussi de se désolidariser du Pacte d’entraide de la CEI), la Tchétchénie qui a déjà perturbé l’acheminement par oléoduc des pétroles de la Caspienne en direction du port russe en Mer Noire, Novorossisk. Plus au nord, dans la région de l’Oural, deux républiques autonomes musulmanes de la Fédération de Russie, le Tatarstan, le Bachkortostan et, au Sud, l’Ingouchie (voisine de la Tchétchénie et également musulmane), par la bouche de leurs présidents respectifs, ont exprimé leurs réticences face à la solidarité qu’exprimait l’immense majorité des Russes à l’égard des Serbes dans le combat qui oppose ceux-ci à l’OTAN et aux Kosovars albanais de l’UCK, manipulés par Washington et Ankara. A l’Est de Moscou mais à l’Ouest de l’Oural, sur le cours d’un affluent important de la Volga, la Kama, au sud des régions moins œcuméniques du nord de l’Oural, se trouvent donc des régions susceptibles d’entrer en rébellion ouverte contre Moscou, si le pouvoir russe cherche à disloquer la barrière américano-turque de l’Adriatique aux confins chinois.
Dans The Grand Chessboard, Zbigniew Brzezinski table clairement sur la turcophonie d’Asie centrale, appelée à être organisée par Ankara, et, par ailleurs, évoque la possibilité d’étendre la sphère d’influence chinoise jusqu’au Kazakhstan, rejoignant ainsi le pôle turcophile et turcophone s’étendant de Tirana à l’Ouzbékistan. La barrière serait ainsi soudée, le verrou serait complet. Les Russes de Sibérie et d’Asie centrale seraient « contenus ». La barrière serait consolidée par un appui inconditionnel à une Turquie de 70 millions d’habitants (et bientôt 100 millions !). Ankara recevrait des armes et un équipement technologique de pointe. Les Etats-Unis donneraient ainsi aux Turcs l’accès à des satellites de télécommunications, leur permettant d’inonder l’Asie centrale turcophone d’émissions de télévision orientées. Des fondations apparemment « neutres » offrent d’ores et déjà des bourses d’étude à des étudiants turcophones d’Asie centrale pour étudier à Istanbul et à Ankara. Washington ferme les yeux sur le génocide que subissent les Kurdes, non turcophones et locuteurs d’une langue indo-européenne proche du persan. Les Kurdes pourraient disloquer le verrou en proclamant leur indépendance et en s’alliant aux autres indo-européophones de la région : les Arméniens, orthodoxes et alliés traditionnels des Russes, ennemis jurés de la Turquie depuis le génocide de 1916, et l’Iran, adversaire des Etats-Unis et alliés potentiels de Moscou.
Carte musulmane obligatoire pour la Russie
Cette carte musulmane jouée par les Etats-Unis jette le désarroi à Moscou. Evguenii Primakov sait désormais qu’il doit trouver une parade mais sans brusquer les 20 millions de musulmans de la Fédération de Russie et les ressortissants des ex-républiques musulmanes et turcophones de l’URSS, constituant l’ « étranger proche ». La Russie est contrainte de forger à son tour un projet cohérent pour les peuples turcophones, sous peine de bétonner définitivement son propre encerclement, mis en œuvre par les Américains. C’est ce qui explique, notamment, l’intérêt que porte notre ami Alexandre Douguine à l’Islam, en tant que force traditionaliste que l’on pourrait opposer à l’Ouest. Douguine fonde sa théorie de l’Islam sur l’œuvre de deux auteurs : Constantin Leontiev et René Guénon. Constantin Leontiev voulait au XIXième siècle une alliance des Orthodoxes et des Musulmans contre l’Ouest (catholique, protestant et libéral). Leontiev s’opposait au soutien russe apporté aux petits peuples slaves des Balkans, parce que ceux-ci, disait-il, étaient animés par des idéologies émancipatrices et libérales, téléguidées depuis Vienne, Paris et Londres. Leontiev s’opposait ainsi au théoricien du nationalisme serbe Ilia Garasanin (Garachanine), qui liait l’orthodoxie balkanique à une revendication anti-ottomane et émancipatrice des communautés paysannes slaves. Garasanin demandait l’aide russe, mais ne souhaitait pas introduire l’autocratisme dans les Balkans. A ce titre, il apparaissait comme subversif pour les traditionalistes, dont Leontiev. La référence à Guénon, qui s’est converti à l’Islam et retiré au Caire, participe essentiellement, chez Douguine, d’une critique générale du « règne de la quantité ». Diverses instances en Russie cherchent donc à justifier et à consolider intellectuellement une politique d’ouverture à l’Islam qui puisse faire pièce à celle que déploient les Etats-Unis autour de la turcophonie centre-asiatique.
Hydropolitique carolingienne
En Europe, en prenant pied dans les Balkans (en Albanie, au Kosovo et en Macédoine) et en frappant Belgrade et Novi Sad sur le Danube, les Etats-Unis tentent de barrer la nouvelle grande voie d’eau qui traverse l’Europe, de l’embouchure du Rhin à Rotterdam en passant par le Main, le nouveau canal Main-Danube et le cours du Danube lui-même jusqu’à Constantza en Roumanie. Cette volonté d’entretenir une liaison fluviale à travers le continent est très ancienne. Déjà Charlemagne avait eu ce projet, à l’aube de l’histoire européenne occidentale. On oublie très souvent que les Carolingiens raisonnaient en termes d’hydropolitique. Charlemagne, doté d’une solide santé physique, s’est rendu compte des difficultés géographiques et physiques à centraliser son empire. Pour maintenir l’édifice en place, il a été obligé, pendant toute sa vie, de voyager sans cesse d’un château palatin à l’autre. Les missi dominici ont pris le relais, transmettant les consignes à travers tout l’empire. Les seules voies de communication permanentes et faciles à l’époque étaient les fleuves. Les Francs, par exemple, pour s’emparer de ce qui allait devenir l’Ile-de-France et en faire le centre de leur puissance politique, ont descendu le cours de l’Oise sur des radeaux. Seuls les fleuves permettaient d’acheminer d’énormes quantités de marchandises dans des temps raisonnables. Pour ceux qui ne perçoivent pas l’importance des fleuves après la disparition des routes romaines, le partage de l’empire à Verdun en 843, entre les trois petits-fils de Charlemagne, apparaît absurde. Pourtant, ce partage est d’une logique limpide pour qui raisonne en termes d’hydropolitique. Charles le Chauve, roi de la Francie occidentale (qui deviendra la France), reçoit les bassins de la Somme, de la Seine, de la Loire et de la Garonne. Lothaire, empereur, reçoit la Lotharingie, de la Frise au Latium, ce qui apparaît illogique voire aberrant, sauf si l’on regarde bien la carte hydrographique : Lothaire reçoit les bassins du Rhin (avec la Moselle), de la Meuse, du Rhône (avec la Saône et le Doubs) et du Pô. Louis le Germanique, avec la Francie orientale (qui deviendra l’Allemagne) reçoit en héritage la dualité allemande qui repose, physiquement parlant, sur la dualité de la configuration hydrographique du pays : il hérite des fleuves parallèles de la plaine nord-européenne (Ems, Weser, Elbe, Oder) et, surtout, du Danube qui ouvre d’immenses perspectives en aval.
L’héritage de Louis le Germanique, qui s’emparera de la Lotharingie, scelle la dualité de l’histoire allemande, où, plus tard, la Prusse organisera la grande zone des fleuves parallèles, tandis que l’Autriche prendra en charge le système danubien. Cet état de choses explique pourquoi les Allemands se sont immédiatement entendus avec les Hongrois et qu’ensemble, ils ont guerroyé des siècles durant contre l’Empire ottoman qui entendait, lui aussi, s’emparer du Danube en en remontant le cours pour s’emparer de la « Pomme d’Or » (Vienne). Après les premières tentatives de Frédéric II de Prusse, au XVIIIième siècle, de doter son royaume d’un bon système de canaux raccourcissant les distances pour les marchandises à transporter, réalisations qu’il récapitule lui-même dans son « Testament politique » de 1752, l’économiste du XIXième siècle Friedrich List élabore des projets pour tous les pays d’Europe et pour l’Allemagne en particulier. Il demande aux hommes d’Etat d’ « organiser le Danube » et d’accélérer le creusement du Canal joignant le Main au Danube. De là vient cette grande idée de relier Rotterdam à Constantza et la navigation fluviale danubienne au système de la Mer Noire et des fleuves russes qui s’y jettent. Plus tard, cette idée récurrente dans les politiques d’aménagement du territoire se retrouve chez le géopolitologue Walther Pahl, qui signale que la majeure partie des exportations russes en céréales, en pétrole et en produits sidérurgiques empruntent les voies et les ports de la Mer Noire pour se répandre dans le monde. Plus précis, le géopolitologue Arthur Dix, en 1923, quelques mois après la signature des accords germano-russes de Rapallo, entre Rathenau et Tchitchérine, dessine une carte montrant la synergie potentielle entre les systèmes fluviaux russes, allemands et danubiens, permettant d’organiser l’Europe centrale et orientale, éventuellement contre les politiques anti-européennes de la France et de l’Angleterre. Max Klüver, historien controversé des prolégomènes de l’affrontement germano-russe de 1941-45, étudie dans son ouvrage Präventivschlag, les requêtes successives de Molotov auprès de Ribbentrop dans la période du pacte germano-soviétique de 39-41, demandant une participation soviétique dans la gestion du trafic fluvial danubien. Klüver rappelle que Ribbentrop devait tenir compte de réticences roumaines et hongroises et d’abord apaiser le conflit qui opposait ces deux petites puissances danubiennes entre elles. Ce sera l’objet des deux arbitrages de Vienne, œuvre diplomatique de Ribbentrop.
La maîtrise du Danube : cauchemar britannique
L’ouverture d’un trafic transeuropéen via le Danube a toujours été le cauchemar des Britanniques, depuis 1801.Cette année-là, le Tsar Paul I, allié de Napoléon, demande à celui-ci d’envoyer des troupes via le Danube et la Mer Noire, pour amorcer une campagne contre les possessions indiennes de l’Angleterre en passant par la Perse. Le Danube devait remplacer la Méditerranée comme voie de communication rapide par eau, parce que Nelson en avait chassé les Français et anéanti les projets napoléoniens en Egypte. L’hostilité britannique à tout trafic danubien s’explique :
- Parce que le Danube relativise les voies maritimes méditerranéennes contrôlées par les Britanniques ;
- En 1942, pendant la seconde guerre mondiale, des journalistes anglais publient une carte montrant un « Très Grand Reich allemand » centré autour d’un système « Rhin-Main-Danube », lui permettant d’exercer son hégémonie sur l’Ukraine et le Caucase. Pour une certaine opinion à Londres en 1942, le danger nazi n’est donc pas incarné par une idéologie totalitaire ou raciste, ou par un dictateur arbitraire aux réactions imprévisibles, mais par un simple projet d’aménagement du territoire et des voies fluviales, vieux de mille ans. Comme quoi, selon cette « logique », Charlemagne était déjà « nazi » sans le savoir ! Et bien avant la fondation de la NSDAP ! Aujourd’hui, pour dénoncer le processus d’unification européen en cours, un géopolitologue français germanophobe, Paul-Marie Coûteaux, ressort la même carte dans un article récent de la revue Géopolitique (mars 1999). Coûteaux se situe ainsi dans la même logique qu’un de ses prédécesseurs, André Chéradame, géopolitologue durant la première guerre mondiale et architecte oublié du système de Versailles, notamment pour ce qui concerne ses plans d’accroissement démesuré de la Roumanie et de la Yougoslavie, et de destruction de la Hongrie et de la Bulgarie. Chéradame cherchait à morceler le cours du Danube après Vienne en autant de tronçons nationaux possibles. Sa géopolitique rencontrait davantage les intérêts anglais que les intérêts français.
- Tout accroissement du trafic fluvial danubien limite le monopole des transports maritimes exercé par les armateurs de la Méditerranée, généralement britanniques ou financés par la City. Rappelons à ce propos qu’au moment où Soviétiques et Allemands signent le Traité de Rapallo, les Américains, par les Accords de Washington de 1922, imposent à la France et à l’Italie une réduction considérable de leur tonnage, limité à 175.000 tonnes.
Une succession de crises bien préparées
Quelle est la situation actuelle, en tenant compte de tous les facteurs historiques que nous venons de mentionner ?
A. Depuis quelques années, le système Rhin-Main-Danube est devenu une réalité, vu le percement du Canal Main-Danube sous l’avant-dernier gouvernement Kohl en Allemagne. Notons que la postérité reconnaîtra forcément le mérite de Kohl, d’avoir réalisé après 1100 ans d’attente un projet de Charlemagne. Mais, inévitablement, en connaissant l’hostilité foncière de la Grande-Bretagne à ce projet, on pouvait s’attendre à des manœuvres de diversion, dont la guerre contre la Serbie, avec le bombardements des ponts de Novi Sad et de Belgrade, a constitué un prétexte en or.
B. Depuis l’annonce de la fin des travaux du percement du Canal Main-Danube, bon nombre de voies de communication dans le système euro-russe du Danube, de la Mer Noire et de la Caspienne subissent des crises violentes, provoquant des instabilités de longue durée, avec
1. le conflit de la Tchétchénie, où un oléoduc important acheminant le pétrole de la Caspienne vers un terminal russe sur la Mer Noire, a été bloqué par les troubles qui ont affecté cette république ethnique de la Fédération de Russie.
2. Une intensification observable des liens entre la Turquie, fermement appuyée par les Etats-Unis, et les ex-républiques soviétiques turcophones, qui quitte l’orbite de la CEI et donc de la Russie.
3. Un conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan pour l’enclave arménienne du Nagorno-Karabach, où l’Arménie, sans accès à la mer, est coincée entre son adversaire et l’allié de celui-ci, la Turquie.
4. Un chaos permanent dans les Balkans, surtout depuis la crise bosniaque et la démonisation médiatique de la Serbie, décrite comme une sorte de croquemitaine politique en Europe.
5. L’échec d’un plan complémentaire, du temps de Kohl et de Mitterrand, visant à joindre le Rhin au Rhône et donc le système Rhin-Main-Danube au bassin occidental de la Méditerranée ; ce projet « carolingien » a été torpillé par l’aile pro-socialiste du parti des Verts en France, orchestrée par une certaine Madame Voynet, aujourd’hui ministre dans le gouvernement Jospin.
6. La crise financière qui secoue l’Extrême-Orient et affaiblit ainsi des alliés potentiels de la Russie et de l’Europe.
7. L’arrestation du leader kurde Öcalan, quelques semaines avant le déclenchement des opérations de l’OTAN, afin que le mouvement de résistance kurde soit neutralisé et ne puisse organiser de diversion contre les opérations américano-turques dans les Balkans, avec l'appui militaire de leurs mercenaires et de leurs vassaux européens.
8. Le bombardement des ponts sur le Danube en Serbie et en Voïvodine, coupant la voie fluviale la plus importante d’Europe et annulant l’effort financier qu’avait consenti le gouvernement allemand du temps de Kohl pour réaliser le canal Main-Danube. Les frappes contre ces ponts sont des frappes contre l’Europe et, plus spécialement, contre l’Autriche, dont le commerce extérieur a connu un boom spectaculaire depuis la chute du Rideau de fer et l’indépendance de la Slovénie et de la Croatie, et contre l’Allemagne. Ainsi, selon un article du Washington Times, un armateur allemand de Passau en Bavière risque la ruine de son entreprise parce que le Danube n’est plus navigable au-delà de Belgrade ; de même, un armateur autrichien, disposant d’une flotte plus considérable, a vu 60 de ses embarcations bloquées à l’Est de la frontière yougoslave. La Bulgarie et la Roumanie sont isolées et coupées du reste de l’Europe. Ces pays sont contraints d’accepter les conditions de l’OTAN et de mettre leurs espaces aériens à la disposition de l’alliance.
9. Fin mars, début avril 1999, trois républiques de la CEI, la Géorgie, l’Azerbaïdjan et l’Ouzbékistan déclarent se désolidariser du pacte de défense collective qui les liait à la Russie. Ce qui conduit à l’encerclement complet de l’Arménie, enclavée entre trois pays ennemis, avec pour seule issue l’Iran. Les oléoducs passeront donc par la Turquie pour aboutir au terminal de Ceyhan sur la côte méditerranéenne, se soustrayant de la sorte à la dynamique Danube/Mer Noire.
De cette façon, le « Pont terrestre » (Land Bridge) sur la nouvelle Route de la Soie devient une réalité géopolitique, au détriment de l’Europe et de la Russie.
Une riposte est-elle encore possible ?
Quelle stratégie opposer à ce gigantesque verrou qui coupe l’Europe et la Russie de leurs principales sources d’approvisionnement énergétique ? Il a été un moment question de forger une nouvelle alliance entre la Russie et :
1) La Serbie
2) La Macédoine, à condition qu’elle reste majoritairement slave et orthodoxe ;
3) La Grèce, qui se détacherait de l’OTAN pour manifester sa solidarité avec les autres puissances orthodoxes, mais se verrait coincée entre une Albanie surarmée et appuyée par les Etats-Unis et une Turquie qui n’a jamais cessé de la menacer en Mer Ionienne.
4) Chypre, qui serait libérée des Turcs qui occupent sa portion septentrionale, et deviendrait une base de missiles de la marine russe. On doit rappeler ici l’enjeu important que constitue cette île, véritable porte-avions dans la Méditerranée orientale. Chypre se situe à 200 km des côtes syriennes et libanaises, à 500 km des côtes égyptiennes. Elle est passée sous domination britannique en 1878 et quasiment annexée en 1914, année où les Cypriotes ont pu acquérir des passeports britanniques. Ce n’est qu’en 1936 que l’armée, la marine et l’aviation britanniques transforment cette île en forteresse, au même moment où les Italiens font de Rhodes, qu’ils possèdent à l’époque, une forteresse et une base aérienne. Rhodes se situe à 400 km à l’Ouest de Chypre et également à 500 km des côtes égyptiennes, à hauteur d’Alexandrie. En 1974, la Turquie occupe le Nord de l’île et y constitue une république fantoche qu’elle est la seule à reconnaître. L’an passé, de graves incidents ont opposé des manifestants grecs à des policiers de l’Etat fantoche turc de l’île. Un manifestant grec a été abattu froidement par cette police, devant les caméras du monde entier, sans que cela ne suscite d’indignation médiatique ni d’intervention militaire occidentale.
5) La Syrie, dont les fleuves, le Tigre et l’Euphrate, sont asséchés par la politique des barrages turcs, installés en Anatolie du temps d’Özal. Seule la Syrie ne peut résister à la Turquie ; au sein d’une alliance avec la Russie (et si possible, avec l’Europe), elle serait à nouveau en mesure de faire valoir ses droits.
6) Le Kurdistan, de manière à dégager l’Arménie de son enclavement et, si possible, de lui donner un accès à la Mer Noire ;
7) L’Irak, qui serait le prolongement mésopotamien de cette alliance et une ouverture sur le Golfe Persique.
8) L’Iran qui échapperait aux sanctions américaines (mais on apprend que l’Iran soutient les positions de l’OTAN au Kosovo !).
9) L’Inde, dont le gouvernement nationaliste vient de tomber à la date du samedi 17 avril 1999, alors qu’il avait déployé une politique de défense et d’armement indépendante, pourrait donner corps à cette alliance planétaire, visant à encercler le « Land Bridge » entre l’Europe et la Russie au Nord, et une chaîne de puissances du « rimland » au Sud.
10) L’Indonésie et le Japon, puissances extrême-orientales affaiblies par la crise financière qui les a frappées l’an passé. L’alliance éventuelle du Japon et de l’Indonésie, avec le Japon finançant la consolidation de la marine de guerre indienne (notamment les porte-avions), afin de protéger la route du pétrole du Golfe au Japon. Cette alliance avait inquiété les géopolitologues américain et australien Friedmann et Lebard, il y a quelques années (cf. The Coming War with Japan, St. Martin’s Press, New York, 1991). Dans son éditorial du Courrier International (n°441, 15/21 avril 1999), Alexandre Adler, dont les positions sont très souvent occidentalistes, craint les hommes politiques japonais hostiles aux Etats-Unis. Il cite notamment Shintaro Ishihara, devenu gouverneur de Tokyo. Il écrit : « Si un Japon nationaliste et communautaire décide de devenir le banquier de la Russie néonationaliste, … nous aurons encore beaucoup à réfléchir sur les effets à long terme de la crise serbe que nous vivons pour l’instant avec autant d’intensité».
Le flanc extrême-oriental de cette alliance potentielle s’opposerait au tandem Chine-Pakistan, soudé à l’ensemble albano-turco-centre-asiatique.
Deux stratégies face à la Chine
Dans ce contexte, nous devons réfléchir sur l’ambiguïté de la position chinoise. Brzezinski veut utiliser la Chine dans la constitution du barrage anti-européen et anti-russe ; il cherche à en faire l’élément le plus solide du flanc oriental de cette barrière, de ce « Land Bridge » sur la Route de la Soie, dont l’aboutissement —on le sait depuis Marco Polo— est le « Céleste Empire ». Une alliance sino-pakistanaise tiendrait ainsi en échec l’Inde, allié potentiel du Japon dans l’Océan Indien. D’autres observateurs américains, au contraire, voient en la Chine un adversaire potentiel des Etats-Unis, qui pourrait devenir autarcique et développer une économie fermée, inaccessible aux productions américaines, ou se transformer en « hegemon » en Indochine et en Mer de Chine. C’est pourquoi on reproche régulièrement à la Chine de ne pas respecter les droits de l’homme. A ce reproche la Chine répond qu’elle entend généraliser une pratique des droits de l’homme « à la carte », chaque civilisation étant libre de les interpréter et de les appliquer selon des critères qui lui sont propres et qui dérivent de ses héritages religieux, philosophiques, mythologiques, etc.
Les Etats-Unis développent donc vis-à-vis de la Chine deux concepts stratégiques :
a) Ils veulent « contenir » la Chine avec l’aide du Japon et de l’Indonésie, voire du Vietnam.
b) ou bien ils veulent l’arrimer à la barrière anti-russe, favoriser son influence dans le Kazakhstan et renforcer l’alliance anti-indienne qui la lie au Pakistan (l’optique américaine est tout à la fois anti-européenne sur le Danube et dans les Balkans ; anti-russe dans les Balkans, en Mer Noire, dans le Caucase et en Asie centrale turcophone ; anti-indienne dans d’Himalaya et dans l’Océan Indien ; en toute logique les diplomaties européennes, russes et indiennes devraient faire bloc et afficher une politique globale du grand refus).
c) Reste la question irrésolue du Tibet. Si la Chine accepte le rôle que lui assignent les disciples de Brzezinski, l’Europe, la Russie et l’Inde doivent donner leur plein appui au Tibet, prolongement himalayen de la puissance indienne. Le Tibet offre l’avantage de pouvoir contrôler les sources de tous les grands fleuves chinois et indochinois ainsi que les réserves d’eau du massif himalayen, vu que l’eau devient de plus en plus un enjeu capital dans les confrontations entre les Etats (cf. Jacques Sironneau, L’eau, nouvel enjeu stratégique mondial, Economica, Paris, 1996). La Chine tient à garder une mainmise absolue sur le Tibet pour ces motifs d’hydropolitique.
Trois pistes à suivre impérativement
En conclusion, ce tour d’horizon des questions stratégiques actuelles nous montre l’absence tragique de l’Europe sur l’échiquier de la planète. Politiquement et géopolitiquement, l’Europe est morte. Ses assemblées ne discutent plus que des problèmes impolitiques. Aucune école de géopolitique connue n’a pignon sur rue en Europe. Que reste-t-il à faire dans une situation aussi triste ?
A. Développer une politique turque européenne, qui rejette tout retour de la Turquie dans les Balkans, terre d’Europe, mais, au contraire, favorise une orientation des potentialités turques vers le Proche-Orient et la Mésopotamie, en synergie avec les puissances arabo-musulmanes de la région. La Turquie ne doit plus être instrumentalisée contre l’Europe et contre la Russie. Elle doit permettre l’accès aux flottes européennes et russe à la Méditerranée via les Dardanelles. Elle doit cesser de pratiquer la désastreuse politique d’assécher la Syrie et l’Irak qu’avait amorcée Özal, en dressant des barrages haut en aval du cours de l’Euphrate et du Tigre. Elle doit renouer avec l’esprit qui l’animait au temps du grand projet de chemin de fer Berlin-Bagdad (autre hantise de l’Empire britannique).
B. Généraliser une politique écologique et énergétique qui dégage l’Europe de la dépendance du pétrole. C’est le contrôle des sources du pétrole au Koweit, à Mossoul, dans le Caucase et le pourtour de la Mer Caspienne qui induit les Etats-Unis à développer des stratégies de containment. Un désengagement vis-à-vis du pétrole doit forcément nous conduire à adopter des énergies plus propres, comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne. Ces énergies seraient dans un premier temps un complément, dans un deuxième temps, un moyen pour réduire la dépendance. De Gaulle avait compris que la diversification des sources d’énergies était favorable à l’indépendance nationale. Sous De Gaulle, de nouvelles techniques ont été mises en œuvre, comme les usines marémotrices de la Rance, l’énergie solaire dans les Pyrénées, une politique de construction de barrages dans tout le pays et le pari sur l’énergie nucléaire (qui n’est plus une alternative absolue depuis la catastrophe de Tchernobyl). L’objectif de toute politique réelle est d’assurer l’indépendance alimentaire et l’indépendance énergétique, nous enseignait déjà Aristote.
C. Vu que la supériorité militaire américaine dérive, depuis le Golfe et la guerre contre la Yougoslavie, d’une bonne maîtrise des satellites d’information, il est évident qu’une coopération spatiale plus étroite entre l’Europe et la Russie s’impose, de façon à offrir à terme une alternative aux monopoles américains dans le domaine de l’information (médias, internet, etc.). Il est évident aussi que l’utilisation militaire des satellites s’avère impérative, tant pour les Européens que pour les Russes. La minorisation de l’Europe vient de son absence de l’espace.
Robert STEUCKERS,
Forest/Cologne, 24 avril 1999.
Bibliographie :
- Stjepan ANTOLJAK, A Survey of Croatian History, Laus/Orbis, Split, 1996.
- Ali BANUAZIZI & Myron WEINER, The New Geopolitics of Central Asia and its Borderlands, I. B. Tauris, London, 1994.
- Dusan BATAKOVIC, « Il mosaico balcanico fra Realpolitik e “scontro di civiltà” », in Limes, Rome, 3/1995.
- Gregory BIENSTOCK, La lutte pour le Pacifique, Payot, Paris, 1938.
- André BLANC, L’économie des Balkans, PUF,1965.
- Patrick BRUNOT, « La dynamique nouvelle du projet politique turc », in : Vouloir, n°9/1997.
- Zbigniew BRZEZINSKI, The Grand Chessboard. American Primacy and its Geostrategic Imperatives, Basic Books, New York, 1997.
- André CHÉRADAME, Le Plan Pangermaniste démasqué. Le redoutable piège berlinois de “la partie nulle”, Plon, Paris, 1916.
- André CHÉRADAME, La mystification des peuples alliés, Hérissey, Evreux, 1922.
- Francis CONTE, Les Slaves ; Aux origines des civilisations d’Europe centrale et orientale, Albin Michel, 1986.
- Mihailo CRNOBRNJA, The Yugoslav Drama, I. B. Tauris, London, 1994.
- Alexandre DEL VALLE ; Islamisme et Etats-Unis. Une alliance contre l’Europe, L’Age d’Homme, 1997.
- Alexander DEMANDT, Deutschlands Grenzen in der Geschichte, Beck, München, 1991.
- Xavier DESPRINGRE, « A un carrefour de la Mitteleuropa, les barrages du Danube », in : Hérodote, n°58-59, 1990.
- Marcel DE VOS, Histoire de la Yougoslavie, PUF, 1965.
- Cornelia DOMASCHKE & Birgit SCHLIEWENZ, Spaltet der Balkan Europa ?, AtV, Berlin, 1994.
- Lucien FAVRE, « La revue “Athéna 1996“ : sécurité européenne », in Nouvelles de Synergies Européennes, n°27/1997.
- Vladimir Claude FISERA, Les peuples slaves et le communisme de Marx à Gorbatchev, Berg International, 1992.
- George FRIEDMANN & Meredith LEBARD, The Coming War with Japan, St. Martin’s Press, New York, 1991.
- FRIEDRICH der Große, Das Politische Testament von 1752, Reclam, Stuttgart, 1974.
- Pierre GEORGE, Géographie de l’Europe centrale slave et danubienne, PUF, 1968.
- Martin GILBERT, The Dent Atlas of Russian History. From 800 BC to the Present Day, Dent, London, 1993.
- Kiro GLIGOROV, «Italia e Turchia hanno le chiave per salvare i Balcani », in : Limes, Rome, 3/1995.
- William S. GRENZBACH, jr., Germany’s Informal Empire in East-Central Europe. German Economic Policy Toward Yugoslavia and Rumania, 1933-1939, Franz Steiner, Stuttgart, 1988.
- St. HAFNER, O. TURECEK, G. WYTRZENS, Slawische Geisteswelt, Band II, West- und Südslawen. Staatlichkeit und Volkstum, Holle-Verlag, Baden-Baden, 1959.
- Richard HENNING & Leo KÖRHOLZ, « Fluvialité et destin des Etats », in : Vouloir, n°9/1997 (Chapitre tiré de Einführung in der Geopolitik, 1931).
- Erwin HÖLZLE, Die Selbstentmachtung Europas. Das Experiment des Friedens vor und im Ersten Weltkrieg, Musterschmidt, Göttingen, 1975.
- Nicole JANIGRO, « La battaglia delle “neolingue” », in : Limes, Rome, 3/1995.
- Hans KOHN, Le panslavisme, son histoire et son idéologie, Payot, Paris, 1963.
- Wolfgang LIBAL & Chrisitna von KOHL, Kosovo : gordischer Knoten des Balkan, Europaverlag, München/Wien, 1992.
- Wolfgang LIBAL, Die Serben. Blüte, Wahn und Katastrophe, Europaverlag, München/Wien, 1996.
- Jordis von LOHAUSEN, Mut zur Macht. Denken in Kontinenten, Vowinckel, Berg am See, 1979 (surtout le chapitre VII : « Die Raumgemeinschaft der Donau »).
- Paul Robert MAGOCSI, Historical Atlas of East Central Europe, Vol. I, University of Washington Press, Seattle & London, 1993 (Cartographic design by Geoffrey J. Matthews).
- Ferenc MAJOROS & Bernd RILL, Das osmanische Reich 1300-1922. Die Geschichte einer Großmacht, F. Pustet/Styria, Regensburg, 1994.
- Noel MALCOLM, Bosnia. A Short History, M-Papermac, Macmillan, London, 1994.
- Dominikus MANDIC, Kroaten und Serben – zwei alte verschiedene Völker, Heiligenhof-Bad Kissingen, 1989.
- Antun MARTINOVIC, « Eléments pour une nouvelle géopolitique croate », in : Vouloir, n°9/1997.
- Claire MOURADIAN, La Russie et l’Orient, Documentation Française, Paris, 1998.
- W. H. PARKER, Mackinder. Geography as an Aid to Statecraft, Oxford, Clarendon Press, 1982.
- Jean PARVULESCO, « Géopolitique d’une conjoncture planétaire finale », in Nouvelles de Synergies Européennes, n°38/1999.
- Hugh POULTON, The Balkans. Minorities and States in Conflict, Minority Rights Publications, London, 1993.
- Paolo RAFFONE, « Una chiave geopolitica : il “confine militare” », in : Limes, Rome, 3/1995.
- Michel ROUX, « La question nationale en Yougoslavie », in : Hérodote, n°58-59, 1990.
- Michel ROUX, « Kosovo : Rugova per uno scambio di territori », in : Limes, Rome, 2/1994.
- Lothar RUEHL, Russlands Weg zur Weltmacht, Econ, Düsseldorf,
- Ferdinand SCHEVILL, A History of the Balkans. From the Earliest Times to the Present Day, Dorset Press, New York, 1991.
- Michel SCHNEIDER, « La Russie face à l’élargissement de l’OTAN ou comment rétablir l’insécurité en Europe », in Nouvelles de Synergies Européennes, n°26/1997
- Peter SCHOLL-LATOUR, Im Fadenkreuz der Mächte. Gespenster am Balkan, C. Bertelsmann, 1994.
- Josef SCHÜSSELBURNER, « Les Etats-Unis veulent l’adhésion de la Turquie à l’UE », in Nouvelles de Synergies Européennes, n°28/1997.
- Louis SOREL, « L’élargissement de l’OTAN et la Croatie », in Nouvelles de Synergies Européennes, n°27/1997.
- Louis SOREL, « La géopolitique entre modernité et post-modernité », in Nouvelles de Synergies Européennes, n°35-36/1998.
- Robert STEUCKERS, « 2000 ans d’histoire balkanique », in Nouvelles de Synergies Européennes, n°26/1997.
- Robert STEUCKERS, « Les implications géopolitiques des Accords de Munich en 1938 », in Nouvelles de Synergies Européennes, n°37/1998.
- François THUAL, Geopolitica dell’ortodossia, SEB/Sinergie, Milano, 1995 (nous avons consulté l’édition italienne).
- Pavel TOULAEV, « Les rapports germano-russes : rétrospective historique et perspectives futures », in Nouvelles de Synergies Européennes, n°38/1999.
- Michael W. WEITHMANN, Balkan Chronik. 2000 Jahre zwischen Orient und Okzident, F. Pustet/Styria, Regensburg, 1995.
- Anton ZISCHKA, C’est aussi l’Europe, Lafont, Paris, 1960.
00:05 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kosovo, balkans, dorsale islamique, new silk road, nouvelle route de la soie, stratégie, guerre, conflit, danube, océan indien |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 18 mars 2009
L'implication des Etats-Unis en Europe de l'Est à travers les conflits yougoslave et kosovar
L’implication des Etats-Unis en Europe de l’Est à travers les conflits yougoslave et kosovar
Durant l’été 98, suite à des accrochages avec la police serbe et des actions de représailles de celle-ci, l’UçK lance des opérations militaires dans la province. Ces opérations vont déboucher sur un état de guerre, des campagnes de purification ethnique (celles-ci furent menées par la Serbie, aujourd’hui elles sont menées par les albanais du Kosovo) et les frappes aériennes de l’OTAN.
Le premier interlocuteur envoyé auprès des autorités serbes n’est pas formellement de l’ONU mais est le « groupe de contact » représenté par les délégués américains Richard Holbrooke et Christopher Hill. Le groupe qui tente de s’imposer dans un premier temps pour une médiation va par la suite (malgré des divergences avec la Russie) joindre son action diplomatique aux pressions et actions militaires de l’Alliance Atlantique. Dans le mois de juin 98, alors que Richard Holbrooke rencontrait des officiers de l’UçK au Kosovo à l’initiative du premier ministre albanais, Bill Clinton pris une décision qui allait avoir une influence sur la suite des évènements. William Cohen son ministre de la Défense avait demandé aux experts et au comité militaire de l’OTAN de préparer une intervention militaire, ce à quoi Clinton donna son soutien et son autorisation.
A ce stade du conflit, deux acteurs majeurs émergent, les Etats-Unis et l’OTAN, l’ONU a pour sa part une implication qui paraît bien plus superficielle. Le poids des Etats-Unis se renforce : d’un côté par ses médiateurs envoyés à Belgrade formant l’essentiel de l’action diplomatique, de l’autre par des contacts entre le Pentagone, la CIA et l’UçK. Les tractations menées par le premier ministre albanais Fatos Nano avec son allié américain semblent être assez fructueuses, les Etats-Unis commencent à prendre en compte l’UçK comme acteur à part entière. L’organisation kosovare jouira d’un soutien mais limité dans un premier temps.
La cause de la limitation de ce soutien vient de divergences dans le gouvernement américain. Madeleine Albright (secrétaire d’Etat) et William Cohen ne s’entendent pas sur les buts de l’OTAN, l’utilité de frappes aériennes ou encore le rôle à donner à l’UçK. Ces débats internes ne doivent pas masquer un fait essentiel : même si l’action militaire de l’OTAN était discutée, elle l’était seulement sur ses modalités et n’était aucunement remise en question. L’OTAN dans ses préparatifs et évaluations a recours à des informations prises sur le terrain par l’UçK elle-même. Les informations sur les positions ou mouvements de troupes serbes étaient transmises par des téléphones cellulaires fournis aux officiers kosovars par l’Alliance Atlantique.
La stratégie adoptée vise à terme la marginalisation de l’ONU. Les Etats-Unis ne peuvent passer par l’ONU et son Conseil de Sécurité qui risqueraient de freiner voire stopper son action. Le veto russe est envisagé et la France a déclaré qu’une intervention de l’OTAN ne devrait se faire que dans le cadre d’un mandat du Conseil de Sécurité L’offensive serbe reprit durant l’été 98, l’ONU avait peu de prise sur la situation aussi bien que sur les négociations. Le groupe de contact sert d’émissaire officiel auprès de Milošević et jouit du total soutien de l’OTAN dans ses négociations. Cela signifie plus nettement que l’accord provisoire et ceux qui suivraient s’accompagneraient de pressions militaires s’ils devaient s’imposer par la force. Durant le mois de janvier 99, une réunion se tint à Bruxelles au siège de l’Alliance Atlantique et portait encore sur les conditions d’exercice de l’OTAN, les Etats-Unis plaidant l’autonomie et la France défendant une implication majeure de l’ONU et du Conseil de Sécurité.
Parallèlement aux réunions, le 30, Robin Cook (le ministre britannique des Affaires Etrangères), se rendait auprès de Milošević et des leaders albanais du Kosovo afin de leur remettre une convocation pour venir négocier à Rambouillet la semaine suivante.
Les négociations se tenaient du 6 au 23 février puis du 15 au 20 mars à Paris sans qu’on aboutisse à un quelconque résultat. La délégation albanaise accepta la constitution d’une force multinationale sous commandement de l’OTAN. Parallèlement le 23 février le rôle primordial de l’OTAN était réaffirmé par Madeleine Albright et suscitait la désapprobation de la Russie. L’accord était placé sous la menace de sanctions militaires si une des parties ne signait pas. Le refus serbe de signer et la signature tactique des délégués kosovars amenait l’OTAN à intervenir par le biais de frappes aériennes le 24 mars et ce, pour plus de deux mois.
Le retrait des troupes serbes et la « fin » du conflit s’amorcent durant le mois de juin 99. Le Conseil de Sécurité de l’ONU adopte le 10 juin la résolution 1244. Comme le rappelle Evette Guendon, cette résolution 1244 « …a officialisé la mission de la présence de sécurité internationale fournie par la KFOR et celle de la présence civile internationale provisoire ou MINUK… ».
Pour la MINUK qui est l’administration civile des Nations Unies envoyée dans la province il est tout à fait normal que son action soit légitimée par une résolution du Conseil de Sécurité. En revanche pour la KFOR cette situation est un peu plus particulière. Etant un contingent multinational sous commandement de l’OTAN et du siège de l’Alliance Atlantique à Bruxelles (donc aucun lien avec l’ONU), l’organisation atlantique est fortement intégrée et influencée par le gouvernement américain et son administration dans les prises de décisions stratégiques. La résolution revient à légitimer dans ce cas une action unilatérale qui dès le début a tendu à marginaliser le système des Nations Unies et contourner le Conseil de Sécurité pourtant seul acteur légitime.
Le 12 juin 1999, la KFOR rentrait au Kosovo et le 21 juin, l’UçK s’engageait par un accord (signé au quartier général de la KFOR à Priština) à déposer les armes et changer de statut. L’OTAN s’était imposé de manière décisive dans le conflit par le groupe de contact au début, par l’action diplomatique américaine menée à l’ONU ou auprès de certains Etats (soutien britannique, alliances, déploiements de troupes en Grèce, Albanie) et n’avait pas hésité à user de la force.
Durant les attaques aériennes de l’OTAN sur différents objectifs en Serbie (usines de Pančevo, sites industriels, officiels ou symboliques de Belgrade) et au Kosovo (sur les troupes serbes ou les frappes sur des colonnes de réfugiés qualifiées de « dommages collatéraux ») Brzezinski exposait au journal Le Monde du 17 avril 1999 l’enjeu du conflit et la stratégie employée: « Le fait est que l’enjeu dépasse infiniment désormais, le simple sort du Kosovo. Il n’est pas excessif d’affirmer que l’échec de l’OTAN signifierait tout à la fois la fin de la crédibilité de l’Alliance et l’amoindrissement du leadership mondial américain. »
Aussi bien en Bosnie qu’au Kosovo, l’OTAN fut à la tête de chaque intervention soit en parallèle avec l’ONU soit de manière très autonome. Cette coopération militaire transatlantique semble être de plus en plus préjudiciable à la crédibilité de l’ONU et aux gouvernements européens, à leurs intérêts et à leur capacité de gérer des crises. Le général Jean Cot souligne que l’action militaire menée par l’OTAN avait donné au début l’illusion d’une coopération entre les Etats-Unis et leurs alliés européens mais ce sentiment changea suite à des déconvenues. Un rapport du ministre français de la Défense se plaignait du fait que les américains définissaient souvent des cibles de manière unilatérale sans en informer leurs alliés européens. Cet exemple est révélateur et illustre le problème qui est posé à l’Europe, notamment en matière de défense : elle semble être privée de toute initiative au profit d’un Etat tiers (les Etats-Unis) ou d’une coalition dirigée par ce même Etat et ses intérêts dans la résolution d’un conflit ne sont pas pris en compte alors qu’il s’agit de la stabilité, de l’avenir et de l’unité de notre continent européen.
L’émergence d’un véritable organisme de défense européenne ne peut qu’être freinée par cet état de fait. Les 23 et 24 avril 1999, le Conseil de l’Atlantique du Nord réaffirmait les buts de l’OTAN et les liens entre Etats-Unis et Europe dans la Déclaration de Washington. Ceci n’est pas fait pour aller dans le sens d’un véritable système européen de défense indépendant, donc apte à gérer les crises survenant en Europe sans que les intérêts d’une puissance tierce n’interfèrent. L’hostilité américaine au concept de défense européenne est assez marquée au point que Richard Holbrooke ne réduise les conflits européens et leur résolution qu’à la volonté des Etats-Unis : « Que nous le voulions ou non, nous sommes une puissance européenne. L’histoire de ce siècle nous démontre que lorsque nous nous désengageons, l’Europe verse dans une instabilité qui nous oblige à y retourner ».
Du point de vue de la politique extérieure (et d’actions militaires qui peuvent parfois y être liées) de l’Union Européenne, la présence d’une entité a là aussi des conséquences néfastes. Le dossier irakien en est le meilleur exemple et illustre la division de l’Europe qui n’a pas pu adopter de vraie position sur le sujet. Les trois pays baltes, la Pologne (le plus gros contributeur de ce groupe de pays membres de l’OTAN), la Tchéquie, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie ont envoyé des troupes en Irak. Comme l’analyse Jacques Rupnik dans Le Point du 16 janvier 2004 le lien entre la « nouvelle Europe » et les Etats-Unis a été permis par «… la peur d’un couple franco-allemand trop puissant. » Le concept d’Europe indépendante, jouant le rôle de contrepoids aux Etats-Unis et menée par le tandem franco-allemand n’intéresse pas l’Europe de l’Est bien au contraire. Les pays d’Europe de l’Est craignent que leurs voix et leurs intérêts soient mineurs dans un tel système (on peut repenser à la réaction peu diplomatique de Jacques Chirac concernant ces pays suite à leurs choix pro-américains).
L’identité de l’Europe est remise en cause tout comme sa stabilité dans un contexte international qui a changé. Depuis la Guerre Froide, les relations entre les Etats-Unis et l’Union Européenne ont muté au point que Jacques Rupnik affirme de manière révélatrice : « Pour la première fois depuis la guerre, l’administration américaine ne considère plus son soutien à l’intégration européenne comme une priorité. Au contraire, elle érige la division européenne en vertu de la relation transatlantique ».
Sur ce sujet on pourra notamment se référer aux ouvrages suivants :
* Bianchini, Stefano (1996). La question yougoslave. Firenze : Giunti/ Casterman.
* Brzezinski, Zbigniew (1997). Le grand échiquier. L’Amérique et le reste du monde. Paris : Hachette/Pluriel.
* Laurent, Eric (1999). Guerre du Kosovo. Le dossier secret. Paris : Plon.
* Volkoff, Vladimir (1999). Désinformation- flagrant délit. Monaco : Editions du Rocher.
* Sous la direction de Chiclet, Christophe(1999). Kosovo- n°30 de Confluences Méditerranée. Paris : L’Harmattan.
* Sous la direction du Général Gallois, Pierre-Marie (2002). Guerres dans les Balkans. La nouvelle Europe germano-américaine. Paris : Ellipses.
* Gubert, Romain et Bran, Mirel (16 janvier 2004).Europe de l’Est, l’OPA américaine et entrevue avec Jacques Rupnik. Le Point n°1635.
Rodion Raskolnikov
00:40 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, etats-unis, otan, yougoslavie, serbie, kosovo, balkans, géopolitique, stratégie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 21 novembre 2008
Marti Ahtisaari bought by Albanian Mafia

13:49 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kosovo, albanie, mafia, balkans, nations unies, atlantisme, services secrets |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 03 septembre 2008
Doctrine de Monroe et géopolitique moderne

James Monroe
Pankraz / “Junge Freiheit”:
Doctrine de Monroe et géopolitique moderne
Les héritiers de Friedrich Ratzel et de Karl Haushofer ont bien du pain sur la planche ces jours-ci. Le concept de “géopolitique”, qu’ils ont forgé jadis, est dans toutes les bouches. En effet, les événements de Géorgie et autour de la Géorgie ont fait prendre conscience même au plus obscur des téléspectateurs que la politique étrangère actuelle n’est pas un jeu simple, qui se joue sur un damier rudimentaire et enfantin et sur base de quelques règles proprettes de politologie et de quelques principes juridiques relevant du droit de gens, mais qu’elle est bien plutôt un art de jonglerie, d’une haute complexité, avec un nombre incalculable de balles qui, de surcroît, sont de dimensions différentes, et dont le mouvement propre est seulement “devinable” par les acteurs en piste et ne peut jamais, ne pourra jamais, être totalement prévisible.
Celui qui voudra sur le long terme connaître le succès en politique étrangère devra, par la force des choses, se faire géopolitologue. Il ne suffit pas de se réclamer pompeusement des droits de l’homme, qui sont abstraction, et, pour le reste, s’efforcer d’avoir un potentiel supérieur de suffrages ou de présenter de bons scores électoraux, il faudra bien plutôt immerger ses pensées dans le “génie de l’espace” (comme disait Rudolf Kjellén), c’est-à-dire respecter au cas par cas les traditions régionales, prendre au sérieux les passions du lieu, se donner des idées claires, sans illusions, au-delà de l’espace réduit de ses propres compétences et autorités.
En fait, ce que je dis là sont de pures évidences, que l’on pouvait déjà lire chez Montesquieu (1689-1755). L’ère du colonialisme européen et, à la suite de celui-ci, l’époque de la communication technique embrassant le globe tout entier (la “globalisation”) ont fait en sorte que ces évidences ont perdu de leur lustre. On s’est mis à cultiver l’illusion que l’on pourrait (et devrait) mettre tout dans le même sac, juger tout à la même aune, en matière de politique. On a tenté de mettre en pratique des doctrines sotériologiques universelles, ce qui eut des conséquences désastreuses. La fable qu’un “policier mondial”, soi-disant hissé au-dessus de tous les partis, a eu son heure de gloire; un “policier mondial” qui aurait eu le droit de s’immiscer partout dans tout, avec ou sans l’aval d’un caucus ou d’un conseil autorisé.
Ce que nous apercevons aujourd’hui, c’est la fin de cette politique de la “planche à dessin”, de l’épure permanente hors du réel, et le retour de la géopolitique. On reconnaît désormais, lentement mais sûrement, que les “droits fondamentaux”, conçus par la pensée aux heures les plus sublimes de l’histoire occidentale, se télescopent en permanence dans le concret des situations spatiales/territoriales; il en va ainsi de la doctrine de l’intangibilité des Etats et de leurs frontières; cette doctrine de l’intangibilité se heurte, sans espoir aucun d’accalmie, à celle du droit des peuples à l’auto-détermination.
Si les Albanais du Kosovo ont le droit de se débarrasser des structures étatiques qui les liaient à la Serbie, pourquoi les Ossètes du Caucase n’auraient-ils pas, à leur tour, le droit de se séparer de l’Etat géorgien? Quelle loi autorise-t-elle l’une sécession et interdit l’autre? Quelle loi autorise-t-elle l’OTAN, instance étrangère à l’espace balkanique, de bombarder Belgrade dans l’intérêt des Albanais? Quelle loi interdit-elle à la Russie, qui est depuis des siècles la puissance protectrice des Ossètes, d’intervenir à leur profit en Géorgie? Ces lois, que j’évoque dans mes questions, n’existent pas, ni réellement ni potentiellement.
Il n’existe que des intérêts et des rapports de force entre regroupements d’Etats, proches ou étrangers à l’espace où se déroulent les affrontements. Sur leurs torts ou leurs raisons ne statue pas une “table de lois” transcendantale, mais, à chaque fois, une constellation régionale concrète, faite d’accords, de conventions et de nécessités. Il est clair, bien évidemment, que les forces inhérentes à l’espace ou proches de cet espace, c’est-à-dire les forces qui sont immédiatement confrontées à la teneur de ces accords et conventions, les forces dont le quotidien est marqué par ceux-ci, ont un droit plus direct et prépondérant à agir ou réagir sur le terrain que les forces qui sont étrangères à cet espace. Ce principe demeure valable même à notre époque de communication globale, où la politique qui régit le flux des finances et des matières premières est mondiale.
Lorsque le président américain James Monroe proclame en 1823 la fameuse doctrine qui porte son nom, il a posé, à coup sûr, le premier grand acte de géopolitique prévoyante, visant le long terme. Les Etats-Unis ne se mêleront pas des affaires européennes, disait Monroe, rassurant; mais il fallait aussi que les Européens s’interdisent toute immixtion dans les affaires américaines ou toute implantation de colonies sur un territoire américain. La devise était: “L’Europe aux Européens”, ce qui avait pour corollaire implicite, “L’Amérique aux Américains”.
Bien entendu, nous pourrions dire que ce sont là des déclarations et des mots d’ordre antérieurs à la globalisation: il n’en demeure pas moins vrai qu’ils recèlent un solide noyau de réalisme, transcendant les époques; les peuples auraient eu un avenir bien meilleur, s’ils avaient écouté ces déclarations et mots d’ordre plus attentivement; nous aurions pu éviter toute l’ère du colonialisme européen et des guerres mondiales. Aujourd’hui, sous les conditions dictées par les technologies globales de la communication à haute vitesse, plus aucune Doctrine de Monroe n’est possible, sous quelque forme que ce soit. Mais son intention première était juste, comme nous nous en apercevons à nouveau, chaque jour, dans les faits.
Prenons en considération la guerre d’Irak et ses conséquences catastrophiques. Le gouvernement Bush, à Washington, disposait de toutes les informations nécessaires pour évaluer de manière réaliste les conséquences de cette guerre. Mais il a obtenu exactement le contraire de ce qu’il avait planifié. Il voulait affaiblir l’Iran, mais celui-ci s’est considérablement renforcé. Mais, au fond, il ne s’agissait pas vraiment d’informations disponibles mais bien plutôt de l’incapacité américaine —parce que l’Amérique, là-bas, est une puissance totalement étrangère à l’espace moyen-oriental— à comprendre et à interpréter correctement les informations disponibles dans le cadre des spécificités régionales de cette partie du monde.
Les géopolitologues conclueront dès lors: lorsque l’on cherche à résoudre les conflictualités d’une région du monde, il faut appliquer une sorte de principe de subsidiarité, tenant compte du degré d’éloignement spatial par rapport au foyer du conflit. Cet éloignement devant constituer l’instrument de mesure le plus important. Les premiers à pouvoir exercer le droit de résoudre un conflit devraient être les Etats, les peuples et les ethnies qui sont directement concernés par les affrontements. Dans ce cadre, la voix des acteurs les plus modestes devraient peser davantage dans la balance que celle des acteurs les plus puissants. Les forces qui, elles, sont éloignées géographiquement et mentalement du foyer de conflit devront se contenter de patienter et, dans les cas où elles interviendraient effectivement, elles devraient le faire avec beaucoup de décence, de distance et d’indépendance. Elles devraient juguler leur fringale de puissance et surtout faire montre d’une réelle retenue dans leurs médias.
Tout beuglement médiatique émis au départ d’un poste soustrait à tous les dangers de la belligérance, dans des rédactions ou des bureaux très lointains sont une nuisance, du point de vue géopolitique. Bien sûr, cela vaut aussi, et d’abord, pour les parties directement concernées. Pour le reste, la géopolitique relève bien de l’esprit de notre temps. Elle vit une nouvelle haute conjoncture. C’est bon signe.
PANKRAZ.
(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°36/2008 – 29 août 2008 – trad. franç.: Robert Steuckers).
00:25 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, etats-unis, europe, amérique, irak, otan, kosovo |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



