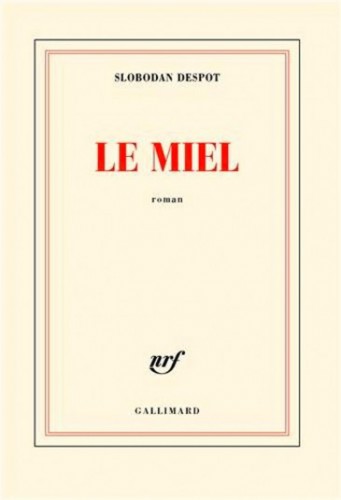Slobodan Despot est un écrivain suisse d’origine serbe. Il est entre autres l’auteur de La Signification du Kosovo dans l’histoire du peuple serbe, de Valais Mystique et des romans Le Miel et Le Rayon bleu, les deux aux éditions Gallimard. Il est aussi le traducteur de la remarquable étude d’Alexandre Zinoviev sur le globalisme politique intitulée La Grande Rupture. Ami et confident du célèbre dissident soviétique, il restera marqué par sa philosophie. Un héritage qui éclaire la compréhension des temps étranges que nous traversons. Slobodan Despot est le cofondateur et le directeur des éditions Xenia. Depuis fin 2015, il publie chaque dimanche une lettre d’information numérique intitulée Antipresse. Une source d’information attentivement scrutée par la rédaction de Strategika.

Strategika — On lit beaucoup d’éléments contradictoires selon les différentes sources d’information disponibles ou selon les avis des professionnels de la santé. Quelle est la réalité effective de cette pandémie selon vous?
Slobodan Despot – Qu’est-ce que la réalité effective d’un phénomène et comment la saisir dans cette confusion? On connaît très bien le paradoxe des guerres: le soldat en première ligne ne voit que ses cent mètres de front. Il ne sait pas s’il s’agit d’une bataille dantesque ou d’une escarmouche, sinon par les nouvelles que lui transmet sa hiérarchie. Laquelle ne lui transmet que qu’elle a besoin qu’il sache.
Nous nous trouvons dans la situation de ce soldat, à une nuance près: l’état-major, en théorie, est aussi exposé que nous (même s’il a des brancardiers de piquet dans le couloir), et il n’est pas sûr qu’il ait une meilleure vision du front. Plus exactement, on est fondé à penser que sa vision est brouillée par la superposition de deux angles de vue qui se déforment mutuellement: d’une part, le tableau de l’épidémie en soi; de l’autre, sa projection utilitaire.
De même que les guerres servent souvent à régler des problèmes de politique intérieure au prix de vies cyniquement sacrifiées, de même cette épidémie tombe à pic comme alibi d’un faisceau de mesures suspendues en l’air et qui attendaient leur heure. Faisceau (je n’utilise pas le mot au hasard) qu’on peut ramener à un constat simple: la parenthèse démocratique est terminée!
Ce brouillage, aggravé par le bombardement émotionnel, est si généralisé qu’on est tout étonné de voir passer encore des analyses strictement ancrées dans la réalité de la chose. Ainsi le pathologiste britannique John Lee, dans une remarquable tribune du Spectator (à paraître en traduction française ce dimanche dans l’Antipresse) s’interroge sur la létalité réelle du coronavirus, une fois dégagée de la dramatisation médiatique et — hypothétiquement — isolée du «parasitage» statistique des morts de la grippe, de pathologies diverses ou simplement… de vieillesse. En un mot: dans quelle mesure meurt-on du coronavirus, dans quelle mesure meurt-on avec? Tant qu’on n’aura pas un aperçu de ces données de base, nous serons dans la manipulation de la peur:
«Une grande partie de la réaction à Covid–19 semble s’expliquer par le fait que nous surveillons ce virus d’une manière qui n’a jamais été observée auparavant. Les scènes des hôpitaux italiens ont été choquantes, et font de la télévision un lieu sinistre. Mais la télévision n’est pas une science.»
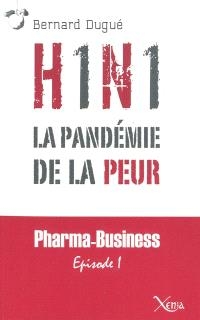 Nous avons observé un phénomène d’ampleur équivalente, mais de bien moindre intensité, avec la grippe A (H1N1). Au printemps 2009, j’avais repéré sur Agoravox les chroniques d’un pharmacologue français, Bernard Dugué, qui relevait les incohérences de la communication officielle — OMS comprise — sur cette épidémie naissante qui, déjà, promettait de faucher le quart de l’humanité. Si elle est si terrible, observait Dugué, pourquoi n’entreprend-on aucune des mesures connues et établies pour l’endiguer? De cette chronique, nous avons fait un livre. A la rentrée 2009, H1N1, la pandémie de la peur était l’unique ouvrage, sur les 38 titres consacrés à ce sujet dans l’édition française, à dédramatiser la pandémie. Pour ma part, j’étais intuitivement et rationnellement convaincu de l’issue et mon comportement libre, à l’époque, avait suscité des réactions d’une surprenante agressivité (mais qui, du moins, ne pouvaient encore s’adosser à un dispositif policier).
Nous avons observé un phénomène d’ampleur équivalente, mais de bien moindre intensité, avec la grippe A (H1N1). Au printemps 2009, j’avais repéré sur Agoravox les chroniques d’un pharmacologue français, Bernard Dugué, qui relevait les incohérences de la communication officielle — OMS comprise — sur cette épidémie naissante qui, déjà, promettait de faucher le quart de l’humanité. Si elle est si terrible, observait Dugué, pourquoi n’entreprend-on aucune des mesures connues et établies pour l’endiguer? De cette chronique, nous avons fait un livre. A la rentrée 2009, H1N1, la pandémie de la peur était l’unique ouvrage, sur les 38 titres consacrés à ce sujet dans l’édition française, à dédramatiser la pandémie. Pour ma part, j’étais intuitivement et rationnellement convaincu de l’issue et mon comportement libre, à l’époque, avait suscité des réactions d’une surprenante agressivité (mais qui, du moins, ne pouvaient encore s’adosser à un dispositif policier).
Dugué avait évidemment raison au vu des résultats, pratiquement indiscernables dans le tableau général de la mortalité en 2009–2010. Personne ne l’en a remercié, bien entendu. On avait l’impression que l’issue relativement bénigne de cette pandémie avait déçu bien du monde. La «soif d’apocalypse», ai-je pu observer alors comme aujourd’hui, imbibe l’inconscient collectif de notre temps.
Comparaison n’est pas raison, le COVID_19 semble plus vicieux et plus insaisissable à la fois, mais les parallèles demeurent et ils sont éclairants. Pourquoi cette antinomie, dans les gouvernements occidentaux, entre d’une part la propagation de la panique et l’intimidation martiale, et d’autre part la cautèle, la lenteur et l’ineptie dans le traitement concret? L’affaire Didier Raoult en est un exemple éclatant.
On a l’impression que H1N1 fut, en effet, un ballon d’essai, mais qui aura surtout servi à… ne rien entreprendre. Sinon à peaufiner la communication et affaiblir les structures de défense collectives au profit du seul pharma-business.
 Strategika — Cette pandémie précède-t-elle un effondrement économique et systémique?
Strategika — Cette pandémie précède-t-elle un effondrement économique et systémique?
Slobodan Despot – Je ne suis pas économiste, mais je dirais plutôt qu’elle l’accompagne ou qu’elle le camoufle. De bulle en bulle, ce système en était arrivé à de telles tensions, à un tel écart entre la réalité concrète et ses représentations, qu’un effondrement était inéluctable. D’une certaine façon, nous assistons à l’aboutissement global d’une expérience initiée simultanément, voici un demi-siècle, des deux côtés du Rideau de Fer et qui s’est brutalement arrêtée à l’Est voici trente ans avec l’effondrement de l’URSS. C’est ce dédoublement de la réalité en simulacre total et conscient que l’anthropologue Alexei Yourtchak (photo) a appelé l’hypernormalisation — concept dont le cinéaste britannique Adam Curtis a tiré un film documentaire saisissant. Pour faire court, les élites dirigeantes, ayant compris que le système était inéluctablement voué à la désagrégation, n’ont pas eu la force ou le courage d’essayer de le réformer, mais se sont uniquement soucié de prolonger le statu quo. Pour s’acheter ce sursis, elles ont construit un monde parallèle, un immense «village Potemkine» à vocation sédative.
«Politiques, financiers et utopistes technologiques, résume Curtis, plutôt que de faire face aux complexités du monde, ont battu en retraite. Au lieu d’affronter la réalité, ils ont construit une version plus simple du monde.» L’intelligentsia «créative» — média, art, cinéma — leur a emboîté le pas et l’alliance du pouvoir financier avec l’utopie informatique a rapidement fourni à cet hologramme des moyens techniques et matériels illimités. On allait presque oublier que ce monde idéal, gouverné par les bonnes intentions et la bien-pensance, où des minorités infimes de population reçoivent davantage d’attention et de protection que la majorité laborieuse, ne pouvait rester en lévitation indéfiniment.
Nous ne sommes pas loin du scénario de Matrix, sauf qu’ici les protagonistes sont bien réels. On croise d’ailleurs, à l’aube même de cette vaste falsification un jeune requin de l’immobilier new-yorkais du nom de Donald Trump. Mais voyez plutôt le film.[1]
Strategika — Plus de 3 milliards de personnes sont appelées à se confiner dans le monde. Pour la première fois de son histoire, l’humanité semble réussir à se coordonner de manière unitaire face à un ennemi global commun. Que vous inspire cette situation?
Slobodan Despot – Elle évoque bien entendu le souvenir de tous ces films de science-fiction où seule une invasion venue de l’espace, ou la menace d’un astéroïde géant, parvient à nous faire surmonter nos divisions et à faire front commun. On peut aussi dire, d’un point de vue moins romancé, que la suprasociété globale est de plus en plus homogène. Il ne se trouve aucune autorité, dans aucun pays, à évaluer par exemple cette épidémie à l’aune de ses problèmes sociaux et sanitaires prioritaires et à intégrer le risque qu’elle représente dans un tableau global de la mortalité non naturelle. Dans un pays comme l’Inde où les vieux et les malades meurent dans les rues des grandes villes sans que personne ne s’en soucie, voici qu’on réprime les infractions à la «distanciation sociale» avec la dernière rigueur. Même en Syrie, on verra les hommes en treillis s’entremitrailler avec des masques sur le nez.

Tout cela a quelque chose d’irréel, comme si l’humanité entière jouait une pièce sur la pandémie. Tous les pouvoirs, quels qu’ils soient, se sentent tenus de payer leur dîme à la narration imposée, quitte à la contourner ou la détourner selon leurs intérêts locaux. La nature stéréotypée de la réaction montre que ces pouvoirs sont très largement unifiés à l’échelle globale. Les exceptions sont rarissimes. Par exemple, certaines Églises orthodoxes rappelant que les nourritures consacrées de la communion ne peuvent par définition être porteuses de maladies. Dans le climat actuel, une telle hérésie risque de leur valoir le bûcher.
Strategika — Cette pandémie va-t-elle forcer l’humanité à se doter d’un gouvernement mondial comme le préconisait Jacques Attali lors de la pandémie de grippe A en 2009?
SB – La réponse est dans la question. «L’humanité», tout d’abord, qui est-ce? Que veut-elle? Si vous imaginez un référendum sur la question en temps normal à l’échelle des quatre milliards de citoyens en âge de voter, la réponse sera certainement cacophonique. Aujourd’hui, si vous leur posez la question de manière adéquate — par exemple: «Acceptez-vous un gouvernement mondial qui organise une lutte efficace contre la pandémie et vous assure une levée du confinement sous deux semaines», vous aurez 99 % d’adhésion. Pour ceux qui ne pensent qu’à ça, qui n’œuvrent qu’à ça et qui y voient un intérêt concret, c’est la meilleure fenêtre de tir depuis la Grande Peste.
Concrètement, l’ensemble de l’humanité se retrouve aujourd’hui en Corée du Nord, à obéir du matin au soir sans rien attendre en retour que la miséricorde d’une simple survie. La population de Corée du Nord est-elle en mesure de «se doter» de quoi que ce soit qui ne lui soit pas imposé?
Strategika — En 2009 toujours, Jacques Attali expliquait que «l’Histoire nous apprend que l’humanité n’évolue significativement que lorsqu’elle a vraiment peur». Que vous inspire cette idée?
SB – Il a raison. La masse effrayée court effectivement bien plus vite que des individus prévenus et sceptiques. La question est de savoir vers quoi. Nous avons l’exemple édifiant des lemmings.
Strategika — Comment voyez-vous l’évolution de la pandémie et ses conséquences politiques et sociales dans les semaines à venir?
SB – Tout dépend des pays. En France ou en Suisse, je vois une levée du confinement au plus tard début mai, faute de quoi c’est une pandémie plus grave — violences, dépressions, suicides et troubles sociaux — qui prendra la relève. Les gens préféreront affronter le virus que la famine ou l’extermination conjugale. En Suisse, où les milieux économiques ont manifestement (quoiqu’en coulisses) pris en main les rênes, je pense que l’instant du «break even» sera rapidement déterminé et qu’on tentera une sortie «en douceur», par exemple en filtrant la population et déconsignant les valides, immunisés ou testés négatifs. En France, l’ineptie du pouvoir et l’existence de «zones de non droit» me font penser que l’issue sera plus aléatoire. Il est beaucoup plus aisé de prononcer le confinement que de le lever. Il suffit d’un coup d’œil sur les réseaux sociaux pour entendre gronder la colère, souvent irrationnelle, contre les autorités. Si vous enfermez votre meute dans un chenil, que vous l’affolez de peur et que vous ne lui accordez pas les soins minimaux, il vous faudra tirer la clenche du portail avec une très longue ficelle.

D’un autre côté, si la pandémie ne tient pas ses horrifiques «promesses», je pense que cette mesure extrêmement brutale qu’est le confinement ne tiendra pas. L’été arrive. L’humain fera n’importe quoi pour accéder à l’air libre. Même à Londres sous les V2, la vie continuait. Mais peut-être essaie-t-on justement de remplacer cet animal trop dégourdi et trop gourmand en espace vital par une espèce mieux calibrée? Pour cela, il faudra accélérer la fabrication de drones et de dobermans robotiques pour remplacer les garde-chiourme encore trop humains. Méditons sur l’ultime mise en garde de Julian Assange parlant d’une «vile poussière intelligente» imprégnant toute notre vie grâce aux nanotechnologies (relayées demain par la 5G et l’«internet des objets»). C’était son dernier message d’homme presque libre, juste avant qu’on lui coupe l’internet.
Strategika — Existe-t-il une issue politique à la situation que vous venez de décrire et quelle forme pourrait-elle prendre selon vous?
SB – Je pense, et j’espère, qu’il n’existe pas une issue politique à cette crise, mais une palette d’issues, déterminées selon les circonstances locales et les rapports gouvernants-gouvernés locaux. La seule issue unique consisterait en ce fameux gouvernement mondial que la suprasociété appelle de ses vœux. Et encore, à voir comment les instances supranationales «gèrent» les crises, on peut se demander en quoi cette concentration de pouvoirs serait plus salutaire que les piteux gouvernements en place.
J’observerai, ceci dit, que la notion même de politique implique un substrat humain et social en tout point opposé à l’ingénierie sociale que la crise actuelle cherche à imposer. Depuis la Deuxième guerre mondiale, comme l’a montré un Pierre Legendre, la société technologique globale évolue vers un «Empire du management» où la politique ne joue plus qu’un rôle ornemental. Toutes les contraintes environnementales, climatiques, «sociétales» et «genderiques» qu’on nous impose ces dernières années achèvent de transférer des pans entiers du champ ouvert de la politique vers la zone fermée et intangible de la nécessité et du tabou moral. Le bac à sable de la politique, dans le monde d’avant le confinement, se résumait à de vaines querelles de personnes et à des enjeux subalternes, avec un personnel d’une sidérante petitesse. Comment pouvait-on à la fois se laisser acheter pour deux costumes et prétendre manier le feu nucléaire? Dans bien des cas, la «carrière» politique était devenue l’équivalent social de l’entrée dans les ordres sous l’Ancien régime: une voie de garage pour les cadets de famille, les veules et les surnuméraires. Il n’est qu’à voir la morgue avec laquelle les ingénieurs (managers, financiers, technologues et juristes) considèrent les «politiques» pour comprendre le divorce de ces deux castes et la dégénérescence qu’il recouvre.
Strategika — Comment liez-vous la crise actuelle à votre domaine d’expertise et votre champ de recherche?
SB – D’une certaine manière, la crise est mon domaine d’expertise et de préoccupation, que ce soit en tant qu’éditeur et journaliste ou en tant qu’écrivain. Le choc de l’éclatement provoqué de mon pays natal, la Yougoslavie, a changé le cours de mes études, l’orientation de mes pensées et de manière générale toute ma vie.
Mon premier roman, Le Miel, a pour théâtre les décombres encore fumants de la Yougoslavie. Le deuxième, Le Rayon bleu, traite de la rarissime prise de conscience effective de la menace d’une extinction nucléaire. La crise actuelle n’est que l’aboutissement inéluctable de processus connus et amplement décrits. D’un point de vue spirituel, elle est inscrite de toute éternité — disons pour simplifier comme une des étapes finales du Kali Yuga, cet âge de fer où le monde se vide littéralement de sa substance comme par une blessure ouverte pour succomber au règne morbide de la quantité.
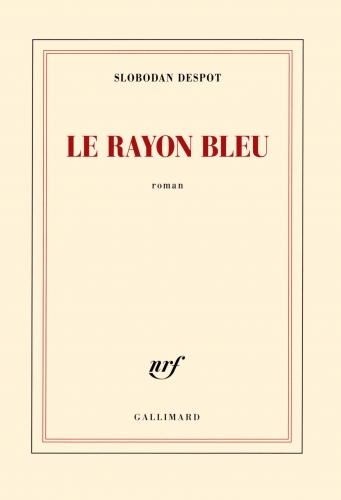
L’âge où nous sommes n’a été capté dans son essence que par les visionnaires et par ces médiums sociaux que sont les grands écrivains. De même que Dostoïevski avait décrit le bolchevisme dans sa nature démoniaque un demi-siècle avant la Révolution d’octobre — et un bon siècle avant que le rideau de cette colossale illusion finisse par se déchirer —, de même un C. S. Lewis avait dépeint avec minutie la simplification mécaniste de l’humain et le putsch des gestionnaires dans sa Trilogie cosmique (1938–1945), en particulier dans sa dernière partie, Cette hideuse puissance. Sans oublier sa prophétie très précise de l’Abolition de l’Homme non par des régimes totalitaires, ni par des cataclysmes, mais par des messages anodins diffusés par d’insipides manuels scolaires qui, goutte à goutte, subliminalement, en «déconstruisant» nos mythes et notre «irrationalité», ont fait de nous ces êtres frémissants tapis au fond de leurs clapiers et mendiant la survie. L’homme se distingue justement du bétail en ceci qu’il refuse la survie à n’importe quel prix.
Je n’ai pas de domaine d’expertise. Je dirais même qu’au stade où nous en sommes l’expertise nous égare alors que la conscience universelle nous sauve. Nous avons besoin de connaissance, toujours, mais aujourd’hui nous avons surtout besoin d’âme et de cœur, autrement dit de vertu au sens antique. Si nous rampons vers la termitière, ce n’est pas seulement qu’on nous y pousse: c’est que nous sommes des termites.
Mon champ de recherche s’apparente à la déambulation de Diogène avec sa lanterne. Je traque l’homme derrière l’«individu» et le «citoyen», je l’interroge et le provoque, et je l’encourage à se hisser au-dessus des rôles qu’on lui fait endosser. C’est tout le sens de l’Antipresse, ce projet qui m’occupe depuis quatre ans, et qui n’est rien d’autre qu’une messagerie où les humains parlent aux humains.
[1] Pour plus de détails, je renvoie à mes textes «Pourquoi il ne se passe rien (1/2)», Antipresse 101 | 05/11/2017, «Pourquoi il ne se passe rien (2/2)», Antipresse 102 | 12/11/2017.





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
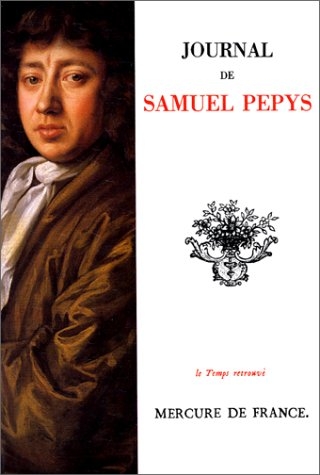 Dans son Journal, le fonctionnaire de l’Amirauté Samuel Pepys tient le «blog» de la peste de 1665. Alors que la classe aisée s’est prudemment réfugiée à la campagne, Samuel reste à Londres, accaparé par ses affaires. Chacun est libre, alors, de fixer ses « distances sociales ». Pepys décrit sans dramatiser la propagation de l’épidémie et ses ravages. Tel cocher s’est mal senti le matin : il était mort le soir. Telle famille de sa connaissance a été entièrement exterminée. Lorsqu’il se rend en ville, il doit éviter certaines rues, particulièrement touchées, pour ne pas enjamber des cadavres... Cela ne l’empêche pas, par ailleurs, de se commander un nouveau costume et de se le faire livrer à une adresse d’emprunt pour ne pas irriter sa femme contrariante. Ni de se rendre à un mariage — avec du retard, évidemment. Des connaissances s’en vont, de nouveaux visages arrivent. Samuel remet son destin entre les mains de Dieu et vaque à ses affaires, plutôt favorables du reste. Il ne manque pas de s’en féliciter. Samuel Pepys n’était ni insensible ni inconscient. Il était un homme plutôt ordinaire de son époque, vif d’esprit et doté d’humour. Il savait, à la différence de nos contemporains, que la mort nous guette au tournant et que l’homme ne contrôle rien. Son journal est un document de premier plan sur la vie quotidienne au XVIIe siècle. Il consigne aussi le terrible incendie qui ravagera Londres à peine la peste terminée, en 1666. La reconstruction inaugurera la période la plus glorieuse de la ville sur la Tamise. La peste avait emporté un quart des Londoniens. Eh, quoi, ce n’était pas la fin du monde...
Dans son Journal, le fonctionnaire de l’Amirauté Samuel Pepys tient le «blog» de la peste de 1665. Alors que la classe aisée s’est prudemment réfugiée à la campagne, Samuel reste à Londres, accaparé par ses affaires. Chacun est libre, alors, de fixer ses « distances sociales ». Pepys décrit sans dramatiser la propagation de l’épidémie et ses ravages. Tel cocher s’est mal senti le matin : il était mort le soir. Telle famille de sa connaissance a été entièrement exterminée. Lorsqu’il se rend en ville, il doit éviter certaines rues, particulièrement touchées, pour ne pas enjamber des cadavres... Cela ne l’empêche pas, par ailleurs, de se commander un nouveau costume et de se le faire livrer à une adresse d’emprunt pour ne pas irriter sa femme contrariante. Ni de se rendre à un mariage — avec du retard, évidemment. Des connaissances s’en vont, de nouveaux visages arrivent. Samuel remet son destin entre les mains de Dieu et vaque à ses affaires, plutôt favorables du reste. Il ne manque pas de s’en féliciter. Samuel Pepys n’était ni insensible ni inconscient. Il était un homme plutôt ordinaire de son époque, vif d’esprit et doté d’humour. Il savait, à la différence de nos contemporains, que la mort nous guette au tournant et que l’homme ne contrôle rien. Son journal est un document de premier plan sur la vie quotidienne au XVIIe siècle. Il consigne aussi le terrible incendie qui ravagera Londres à peine la peste terminée, en 1666. La reconstruction inaugurera la période la plus glorieuse de la ville sur la Tamise. La peste avait emporté un quart des Londoniens. Eh, quoi, ce n’était pas la fin du monde...






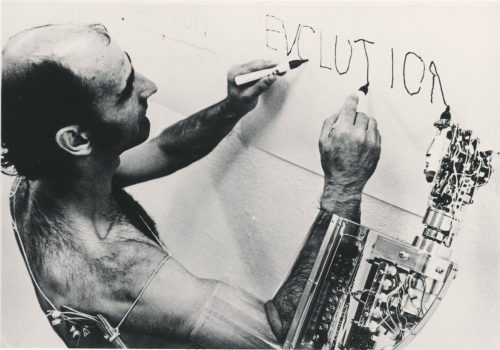











 Jan Marejko est mort. Je l’ai appris par un mail d’un ami suisse qui avait reçu le mail d’un ami allemand. Lequel Allemand le tenait d’un prêtre genevois qui avait été son dernier confident.
Jan Marejko est mort. Je l’ai appris par un mail d’un ami suisse qui avait reçu le mail d’un ami allemand. Lequel Allemand le tenait d’un prêtre genevois qui avait été son dernier confident.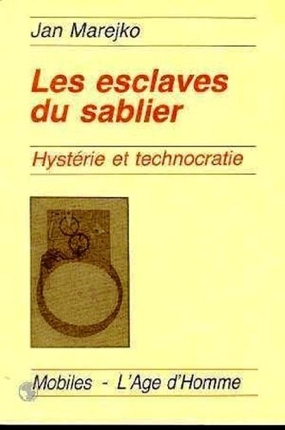 Je connaissais Jan Marejko depuis l’époque de mes études. Il était l’un des mentors avec qui je correspondais dans ma solitude. Lui, Robert Hainard, Alexandre Zinoviev ou Eric Werner étaient des poches d’oxygène dans la mare de conformisme qu’était le monde universitaire où je barbotais. J’ai fini du reste par en sortir, sans bruit, vomi par un milieu qui me rejetait (et me débectait) organiquement.
Je connaissais Jan Marejko depuis l’époque de mes études. Il était l’un des mentors avec qui je correspondais dans ma solitude. Lui, Robert Hainard, Alexandre Zinoviev ou Eric Werner étaient des poches d’oxygène dans la mare de conformisme qu’était le monde universitaire où je barbotais. J’ai fini du reste par en sortir, sans bruit, vomi par un milieu qui me rejetait (et me débectait) organiquement. Ils se sont trompés lourdement. Ils se croyaient veilleurs de la cité, ils se sont découverts parias. La carrière d’Eric Werner a été entravée et bridée de toutes les façons. Celle de Jan Marejko a été avortée avant même d’avoir commencé. Son dossier de candidature à un poste d’enseignement lui fut retourné avant même que quiconque ait eu le temps matériel de le lire. Cela ne se passait pas à Pyongyang, mais près de chez vous. Il ne s’en est jamais remis. Pendant le reste de sa vie, ce grand métaphysicien, disciple des grands penseurs de la liberté qu’étaient Aron ou Hannah Arendt, a dû voir défiler aux postes pour lesquels il était fait des pions qui ne lui arrivaient pas à la cheville et gagner sa vie comme journaliste.
Ils se sont trompés lourdement. Ils se croyaient veilleurs de la cité, ils se sont découverts parias. La carrière d’Eric Werner a été entravée et bridée de toutes les façons. Celle de Jan Marejko a été avortée avant même d’avoir commencé. Son dossier de candidature à un poste d’enseignement lui fut retourné avant même que quiconque ait eu le temps matériel de le lire. Cela ne se passait pas à Pyongyang, mais près de chez vous. Il ne s’en est jamais remis. Pendant le reste de sa vie, ce grand métaphysicien, disciple des grands penseurs de la liberté qu’étaient Aron ou Hannah Arendt, a dû voir défiler aux postes pour lesquels il était fait des pions qui ne lui arrivaient pas à la cheville et gagner sa vie comme journaliste.
 Le prince africain racheté au Turc par un aventurier serbe et devenu filleul du tsar russe fera dix enfants à la Scandinave tirant ses origines de la noblesse suédoise, norvégienne et danoise. Leur fils aîné Ivan, né hors mariage, fondera la ville de Kherson et accédera en 1898 au titre de général en chef, le deuxième grade le plus élevé de la hiérarchie impériale russe. Leur petite-fille Nadejda fera encore mieux : elle donnera naissance à Alexandre Pouchkine, l’un des plus grands génies littéraires de tous les temps… Pouchkine, dont le huitième de sang africain sera encore bien présent, tant dans sa physionomie que dans son tempérament.
Le prince africain racheté au Turc par un aventurier serbe et devenu filleul du tsar russe fera dix enfants à la Scandinave tirant ses origines de la noblesse suédoise, norvégienne et danoise. Leur fils aîné Ivan, né hors mariage, fondera la ville de Kherson et accédera en 1898 au titre de général en chef, le deuxième grade le plus élevé de la hiérarchie impériale russe. Leur petite-fille Nadejda fera encore mieux : elle donnera naissance à Alexandre Pouchkine, l’un des plus grands génies littéraires de tous les temps… Pouchkine, dont le huitième de sang africain sera encore bien présent, tant dans sa physionomie que dans son tempérament.
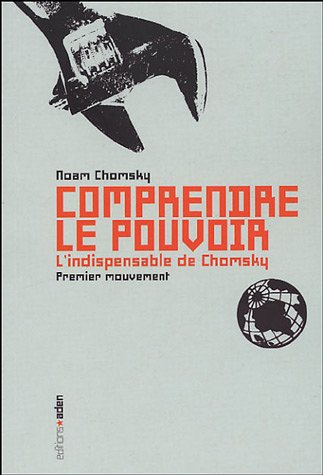
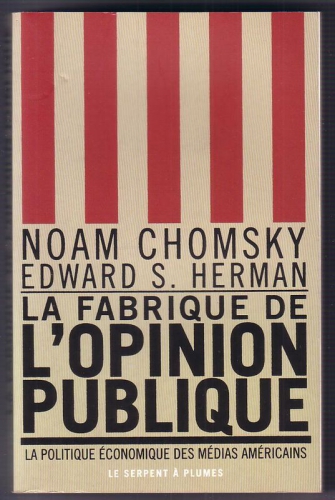 Dans les dernières années du bloc soviétique, nous étions quotidiennement abreuvés de nouvelles sur la lutte du syndicat Solidarnošć et de la Pologne catholique contre la dictature communiste. L’élection d’un pape polonais — le premier non italien depuis des siècles — avait évidemment offert à cette cause un écho mondial. La nouvelle de la torture et de l’assassinat de l’aumônier du syndicat, le père Popieluszko, en 1984, a sonné le glas du régime du général Jaruzelski. 500’000 personnes ont assisté aux funérailles du prêtre martyr, qui fut béatifié en 2010.
Dans les dernières années du bloc soviétique, nous étions quotidiennement abreuvés de nouvelles sur la lutte du syndicat Solidarnošć et de la Pologne catholique contre la dictature communiste. L’élection d’un pape polonais — le premier non italien depuis des siècles — avait évidemment offert à cette cause un écho mondial. La nouvelle de la torture et de l’assassinat de l’aumônier du syndicat, le père Popieluszko, en 1984, a sonné le glas du régime du général Jaruzelski. 500’000 personnes ont assisté aux funérailles du prêtre martyr, qui fut béatifié en 2010.

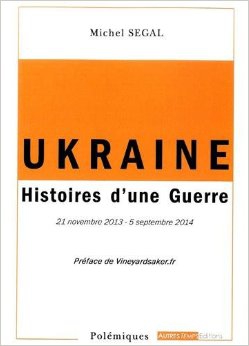 Les exemples de ce genre sont légion. Le livre très rigoureux du mathématicien français Michel Segal, Ukraine, histoires d’une guerre (éd. Autres Temps), en décompose un certain nombre en détail. Il faut reconnaître que le camp « occidentiste » a l’initiative de la « propagande contre la propagande », c’est-à-dire de la montée en épingle d’opérations d’influence supposées. Il jouit en cela d’une complaisance ahurissante des médias occidentaux. Or, dans un conflit comme celui-là, où tous les protagonistes sortent des écoles de manipulation soviétiques, les chausse-trapes sont partout et seul un jugement fondé sur la sanction des faits avérés et sur la question classique « à qui profite le crime ? » permettrait d’y voir clair. Nous en sommes loin ! Le plus cocasse, c’est que l’officialité nous sert à journée faite des théories du complot russe toujours plus échevelées tout en condamnant le « complotisme » des médias alternatifs …
Les exemples de ce genre sont légion. Le livre très rigoureux du mathématicien français Michel Segal, Ukraine, histoires d’une guerre (éd. Autres Temps), en décompose un certain nombre en détail. Il faut reconnaître que le camp « occidentiste » a l’initiative de la « propagande contre la propagande », c’est-à-dire de la montée en épingle d’opérations d’influence supposées. Il jouit en cela d’une complaisance ahurissante des médias occidentaux. Or, dans un conflit comme celui-là, où tous les protagonistes sortent des écoles de manipulation soviétiques, les chausse-trapes sont partout et seul un jugement fondé sur la sanction des faits avérés et sur la question classique « à qui profite le crime ? » permettrait d’y voir clair. Nous en sommes loin ! Le plus cocasse, c’est que l’officialité nous sert à journée faite des théories du complot russe toujours plus échevelées tout en condamnant le « complotisme » des médias alternatifs …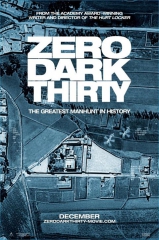 Slobodan Despot : C’est évident. Il se développe en milieu anglo-saxon (et donc partout) une véritable osmose entre l’écriture scénaristique et l’écriture documentaire. Cas extrême : le principal « document » dont nous disposions sur l’exécution supposée de Ben Laden en 2011 est le film de Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty, qui a tacitement occupé dans la culture occidentale la place du divertissement et de l’analyse, et de la preuve. La réussite cinématographique de ce projet (du reste dûment distinguée) a permis d’escamoter toute une série d’interrogations évidentes.
Slobodan Despot : C’est évident. Il se développe en milieu anglo-saxon (et donc partout) une véritable osmose entre l’écriture scénaristique et l’écriture documentaire. Cas extrême : le principal « document » dont nous disposions sur l’exécution supposée de Ben Laden en 2011 est le film de Kathryn Bigelow, Zero Dark Thirty, qui a tacitement occupé dans la culture occidentale la place du divertissement et de l’analyse, et de la preuve. La réussite cinématographique de ce projet (du reste dûment distinguée) a permis d’escamoter toute une série d’interrogations évidentes. Cette nation qui a donné Pouchkine et Guerre et Paix, Nijinsky et le Lac des Cygnes, qui a l'une des plus riches traditions picturales au monde, qui a classé les éléments de la nature, qui fut la première à envoyer un homme dans l'espace (et la dernière à ce jour), qui a produit des pelletées de génies du cinéma, de la poésie, de l'architecture, de la théologie, des sciences, qui a vaincu Napoléon et Hitler, qui édite les meilleurs manuels — et de loin — de physique, de mathématiques et de chimie, qui a su trouver un modus vivendi séculaire et pacifique, sur fond de respect et de compréhension mutuelle, avec ses Tatars et ses indénombrables musulmans, khazars, bouddhistes, Tchouktches, Bouriates et Toungouzes, qui a bâti la plus longue voie de chemin de fer au monde et l'utilise encore (à la différence des USA où les rails légendaires finissent en rouille), qui a minutieusement exploré et cartographié les terres, usages, ethnies et langues de l'espace eurasien, qui construit des avions de combat redoutables et des sous-marins géants, qui a reconstitué une classe moyenne en moins de quinze ans après la tiers-mondisation gorbatcho-eltsinienne, cette immense nation, donc, qui gouverne le sixième des terres émergées, est soudain traitée, du jour au lendemain, comme un ramassis de brutes qu'il s'agit de débarrasser de leur dictateur caricatural et sanglant avant de les éduquer à servir la « vraie » civilisation !
Cette nation qui a donné Pouchkine et Guerre et Paix, Nijinsky et le Lac des Cygnes, qui a l'une des plus riches traditions picturales au monde, qui a classé les éléments de la nature, qui fut la première à envoyer un homme dans l'espace (et la dernière à ce jour), qui a produit des pelletées de génies du cinéma, de la poésie, de l'architecture, de la théologie, des sciences, qui a vaincu Napoléon et Hitler, qui édite les meilleurs manuels — et de loin — de physique, de mathématiques et de chimie, qui a su trouver un modus vivendi séculaire et pacifique, sur fond de respect et de compréhension mutuelle, avec ses Tatars et ses indénombrables musulmans, khazars, bouddhistes, Tchouktches, Bouriates et Toungouzes, qui a bâti la plus longue voie de chemin de fer au monde et l'utilise encore (à la différence des USA où les rails légendaires finissent en rouille), qui a minutieusement exploré et cartographié les terres, usages, ethnies et langues de l'espace eurasien, qui construit des avions de combat redoutables et des sous-marins géants, qui a reconstitué une classe moyenne en moins de quinze ans après la tiers-mondisation gorbatcho-eltsinienne, cette immense nation, donc, qui gouverne le sixième des terres émergées, est soudain traitée, du jour au lendemain, comme un ramassis de brutes qu'il s'agit de débarrasser de leur dictateur caricatural et sanglant avant de les éduquer à servir la « vraie » civilisation !