Le retour de Jacques d’Arribehaude
Dans la nouvelle livraison de son journal, qui englobe la première moitié des années 80, Jacques d’Arribehaude écrit ceci qui mérite d’être relevé : « En fin de compte, je n’aimerais pas être considéré, uniquement, pour les propos, si remarquables soient-ils, que j’enregistrais à Meudon auprès de Céline peu avant sa mort. Je sais ma dette envers Céline, j’admire son génie visionnaire et pamphlétaire, mais mon vrai modèle est Saint-Simon. Je ne prétends évidemment pas me situer à son niveau, et loin de moi l’idée d’établir une quelconque échelle de valeurs artistiques et littéraires, mais Saint-Simon, en décalage complet avec son siècle comme je le suis avec mon époque, avait résolu de s’adresser à d’autres générations que la sienne, et de s’en remettre à la providence pour être lu et reconnu bien après sa mort. » Et de préciser : « Je m’attache à cet exemple parce qu’il m’offre un espoir, qu’il me reste une œuvre à écrire, susceptible de quelque intérêt par la suite, et que je garde obstinément au fond du cœur, moi aussi, la foi de mon enfance. » S’il est vrai que Jacques d’Arribehaude n’est connu de la plupart des céliniens que pour les entretiens que le grand homme voulut bien lui accorder, à lui et à son complice Jean Guenot, il est aussi apprécié de quelques amateurs d’écrits intimes pour cette somme foisonnante composée de plusieurs opus aux titres évocateurs : Une saison à Cadix, L’encre du salut, Complainte mandingue, Le royaume des Algarves, Un Français libre et, à présent, S’en fout la vie. L’auteur nous apprend que ces mots figuraient sur de grands écriteaux pavoisant certains véhicules surchargés pour défier l’adversité le long des pistes d’Afrique noire. Cette expression correspond aussi, on l’aura compris, à la manière aventureuse et désinvolte avec laquelle l’auteur a mené sa propre existence.
À défaut de rencontrer au moment de sa sortie un succès de librairie, cette œuvre a été saluée par la critique. Ainsi, Pol Vandromme : « Ce journal est d’un homme libre. Libre devant les intimidations du siècle comme devant celle des mantes religieuses et des benêts pâmés. Libre comme on a désappris à l’être aujourd’hui : en esprit fort et en vivant magnifique. » On peut parier que, dans quelques années, il se trouvera de fervents lecteurs de Jacques d’Arribehaude comme aujourd’hui on en compte de Paul Léautaud, même si leur univers n’est en rien comparable. Le premier, grand voyageur, fut un amoureux impénitent ; le second, sédentaire résolu, se révéla un sentimental refoulé, prônant avec conviction le seul amour sensuel. Rien de commun avec Arribehaude, chantre de l’amour absolu : « Je ne suis sensible, qu’au naturel du désir – et du plaisir – librement partagés dans la simplicité et la pureté d’une émotion réciproque, entre deux êtres qui s’aiment vraiment ». Impossible, quand on le lit, de ne pas trouver attachant ce diariste sensitif. Surtout lorsqu’il nous confie avec une franche ingénuité ses désarrois sentimentaux ou son refus du carriérisme dans ce monde de la télévision qui en est l’exemplaire illustration. Comme Léautaud, c’est un rêveur épris d’indépendance et de liberté. Autre point commun : le style, superbe et délié, d’un naturel parfait. Au risque de contrarier l’auteur – mais la nature de ce bulletin a ses contraintes –, comment ne pas constater que Céline occupe, une fois encore, une place de choix dans ce volume alors qu’il est bien éloigné le temps où l’auteur gravissait la route des Gardes pour recueillir les propos désabusés du génial anachorète. Nulle complaisance envers lui dans ce journal ; il relève ses propos très durs envers Robert Brasillach et l’équipe de Je suis partout. « Même attitude rageuse de Céline à l’égard de Drieu, mis par lui dans le même sac que Brasillach, coupable de n’avoir songé qu’à se livrer ou au suicide », ajoute-t-il. Lisant le journal de Jünger, il note que « le Paris où il lui était si plaisant de flâner à sa guise avec le plus grand détachement, de rencontrer un petit nombre de merveilleux amis, de garder, malgré la guerre, sa fidélité à cet idéal chrétien et chevaleresque que je m’obstine moi-même à respecter depuis l’enfance, tout cela me touche. Mais il n’a manifestement pas compris Céline et l’a rejeté, ce qui surprend quand on le voit par ailleurs sensible à l’œuvre de Léon Bloy qui fut un écorché et un imprécateur de même espèce. »
Ne dédaignant pas les propos politiquement (très) incorrects, il relate un déjeuner chez Jean et Monette Guenot, en compagnie de Pierre Monnier et de Maurice Ciantar. À propos de celui-ci, il souligne que « rien, dans son apparence, sa tenue stricte et soignée, qui puisse déceler la bohème anarchique et désordonnée de ses premiers textes, et voilà que, l’âge venu, nous aboutissons aux mêmes conclusions. La décomposition de l’Occident est conforme aux visions prophétiques de Céline et justifie ses pamphlets sur l’impuissance des démocraties, leur niaiserie bénisseuse dans l’incapacité d’admettre la pérennité du mal et la nécessité de s’en préserver pour que le progrès technique cesse d’être un leurre et un instrument de crétinisation définitive de l’espèce humaine ». La maîtresse de maison n’est pas en reste qui « confie, en souriant que, de tout Céline, elle admirait par-dessus tout la puissance et la verve des pamphlets. » Revenant sur le sujet peu de temps après, celui qui rallia à dix-huit ans les « Forces Françaises Libres » écrit : « Je ne dissimule pas l’horreur du nazisme, mais je comprends que, dans le chaos économique, la corruption et la misère des années 20 en Allemagne, il ait pu naître, faire illusion, et séduire par ses réformes sociales non seulement le peuple, mais aussi la fine fleur de grands esprits, philosophes, artistes, savants, intellectuels de tous bords célèbres dans le monde entier, et dont l’énumération serait longue. Et je comprends mieux les hurlements de Céline contre une guerre que nous ne pouvions que perdre et que nous aurions pu et dû éviter, l’objectif d’Hitler étant essentiellement l’espace russe, son fameux Lebensraum, où il était voué à l’usure et à l’échec. » Comparant Céline à Drieu, il relève, après avoir relu Gilles, qu’il y avait « une belle naïveté dans les attitudes de Drieu devant la guerre. Il est très loin ici de Céline, qui a osé rire et faire rire à propos de sa frousse éperdue face aux boucheries inconcevables de 14-18, et sa volonté forcenée de s’y soustraire. C’est cela, qui a manqué à Drieu. La vraie distance qui permet l’humour et peut faire de toute tragédie une farce. Du moins admirait-il Céline et lui rendait-il hommage, là où, on y revient, un autre combattant de 14-18, Jünger, n’a ressenti devant Céline que roide incompréhension, aversion spontanée, haine viscérale. » Certains diraient que ce fut sans doute réciproque. S’il n’a jamais rencontré Jünger, l’auteur a bien connu Dominique de Roux qui « se plaisait à croire que ce monde n’est fait que d’apparence et que, très loin de l’apparence, la réalité du pouvoir appartient à un petit nombre d’initiés très secrets, qu’il se piquait de découvrir. À la source de la puissance créatrice et visionnaire de Céline, il voyait une importance démesurée dans l’appartenance aussi fugitive que superficielle de l’auteur du Voyage aux services secrets durant son séjour à Londres en 1916. Il en rêvait tout haut. Il aurait pu en parler des heures. » À mettre en parallèle avec cette interview télévisée que Dominique de Roux fit de Marcel Brochard ; la période londonienne l’intriguait de toute évidence. Mais Brochard, n’ayant connu Louis Destouches qu’à partir de l’époque rennaise, soit quatre ans plus tard, laissa le fondateur des cahiers de L’Herne sur sa faim…
On a parfois commenté sur un ton désapprobateur le refus de Céline, à la fin de sa vie, de voir ses petits-enfants. Nul blâme ici : « Je comprends Céline d’avoir concentré ses faibles forces et ses émotions jusqu’au refus de tout contact avec sa fille et ses petits-enfants. Il n’avait d’autre choix que de les sacrifier à son œuvre, s’il voulait l’achever. Même chose pour Proust, qui fut le vide autour de lui pour terminer fébrilement avant de mourir les ultimes pages de la Recherche et du Temps retrouvé. » Comme on le voit, les résonances de l’œuvre célinienne sont nombreuses dans ce journal. Mais celui-ci vaut surtout par sa peinture acerbe du milieu télévisuel ébranlé par l’arrivée de la gauche au pouvoir en 1981. Sa valeur tient aussi au fait que Jacques d’Arribehaude n’enjolive jamais, ne dissimule rien du mal-être qui l’étreint, des joies intenses mais éphémères, des déboires sans cesse renouvelés et de cette quête si difficile de la sérénité.
Marc LAUDELOUT
Jacques d’ARRIBEHAUDE, S’en fout la vie, The Book Edition, 2008, 418 pages (25 €, franco). On peut commander ce livre sur Internet : www.thebookedition.com ou auprès de Pierre-Vincent Guitard, 76 bd Saint-Marcel, 75005 Paris.
Les volumes précédents du journal ont été édités à L’Age d’homme, où l’on trouve aussi la réédition de ses deux plus beaux romans, Semelles de vent (1959) et Adieu Néri (Prix Cazes, 1978).




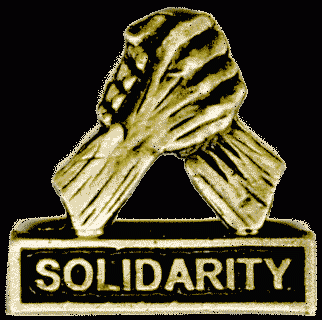

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
