mardi, 30 septembre 2008
R. Poulet: "D'un château l'autre"
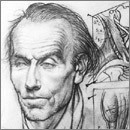
Robert Poulet:
« D’un château l’autre »
[1957]
Il est toujours dangereux d’enterrer les gens ; ils ressuscitent à l’improviste et on ne sait plus où les mettre. Depuis Féerie pour une autre fois, on posait en fait que le grand Céline, celui du Voyage au bout de la nuit, était mort. Erreur complète ! Le prétendu défunt détrompe son monde en poussant un nouvel éclat de rire dont les échos ont même réveillé les critiques parisiens, dans leur fauteuil à roulettes. Et ces messieurs en oublient que – par convention tacite, conclue en 1944 – « Céline, ce n’est rien », « un personnage très surfait », grossier comme un chauffeur de car, artificieux, puéril ; d’ailleurs tout à fait inconnu de la jeunesse. Inconnu, justement, parce que pendant dix ans on s’est abstenu de le faire connaître !... Est-ce que les jeunes connaîtraient Proust si la conspiration du silence s’appliquait à la Recherche du temps perdu ?... Pendant qu’Aristarque effaré et irrité s’empêtre ainsi dans ses contradictions, proclamons tranquillement que D’un château l’autre, s’il était signé Tartempion, ferait pousser des hurlements d’admiration et de stupeur à toute l’avant-garde littéraire, dont les choryphées se sont signalés par des innovations qui paraissent imperceptibles au prix de ce discours prodigieux, encore bien plus hardi et plus expressif que celui du Voyage.
Seulement ce livre-là contenait un sentiment, valable pour tous les hommes de ce siècle. Sentiment de découverte furieuse, de scandale qui répond au scandale ; la vie moderne, non plus décrite, mais vomie toute fumante ; et par-dessus le marché la Rigolade : un être qui tombe des nues, qui voit le monde où nous sommes – la civilisation faussée, l’âme salie, l’esprit plein de mensonges – et qui se tord.
Des deux inventions énormes qui constituent (renforcée dans Mort à crédit) la surprise célinienne, il ne reste évidemment que la seconde ; celle qui a pour fin d’introduire dans la littérature le langage de notre temps. Le vrai, non celui que jargonnent les romanciers réalistes, populistes, néo-naturalistes, etc. Il suffit de contempler le hachis et le pataugis des sous-Céline, dont quelques-uns portent des noms partout vantés, pour mesurer l’habileté cachée de notre homme, faux cacographe, pseudo-débraillé, qui calcule ses diatribes à une virgule près, et qui s’apparente bien plus, pour le souci du style, à José-Maria de Hérédia qu’au Père Duchesne.
Que nous conte-t-il cette fois ? Tout ce qui lui passe par la tête. Et d’abord ses malheurs, ses aventures, ses observations d’émigré malgré lui, en 1944-45. On sait que le père de Bardamu s’enfuit à la Libération, encore qu’en réalité il n’eût même pas mis le bout du doigt dans les engrenages de la Collaboration ; mais, comme il le dit très bien, à Paris on lui aurait arraché les tripes. Grâce à ce malentendu tragi-comique, nous avons ici, sur l’Allemagne aux abois, sur Sigmaringen (où vivaient onze cents condamnés à mort), sur les geôles et les geôliers danois (qui tinrent dans une oubliette, pendant six ans, le pauvre Louis-Ferdinand, accusé là-bas d’avoir « vendu les plans de la Ligne Maginot »), sur les rapports de l’auteur avec son éditeur, « ce salaud de Gaston » (et l’impossibilité du seigneur Gallimard, tirant à moult exemplaires les injures dont il est abreuvé, ajoute encore à l’effet d’hilarité) un témoignage sans doute inexact – les poètes ni les prophètes ne voient les choses comme elles sont – mais épique. Sur un fond de vociférations, d’hallucinations et de protestations, dans la matière desquelles il n’entre pas une seule phrase : rien que de petits groupes de mots démantibulés, qui hoquètent et qui cliquètent ; dents d’une roue sans fin, que meut un moteur inquiétant, plein d’éclairs et de fumée.
Mais quand le mouvement s’arrête, avec sa charge d’images puissantes, de sarcasmes inouïs et de plaintes enfantines, on s’avise qu’à l’origine de tout ce tumulte, strictement distribué par le génie le plus mécanique de l’ère contemporaine, il pourrait bien y avoir ceci : une forme désespérée de la grandeur d’âme. Une sensibilité, une générosité, qui se mutilent et se meurent elles-mêmes, comme dans le conte d’Edgar Poë.
Robert POULET
(Pan, 26 juillet 1957)
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, lettres françaises, littérature, littérature française, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 28 septembre 2008
Sur "Gobalia" de Jean-Christophe Rufin
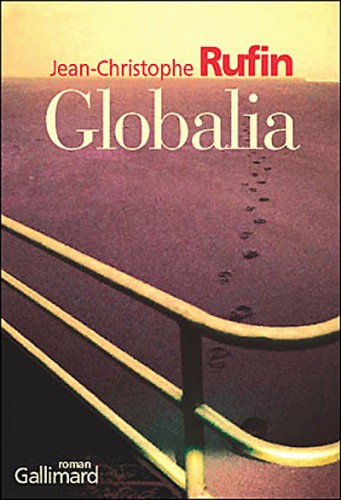
Ecole des cadres - Synergies Européennes - septembre 2008
Sur "Golbalia" de Jean-Christophe Rufin
http://users.skynet.be/pierre.bachy/rufin-globalia.html...
A lire à la suite de nos travaux sur George Orwell et Aldous Huxley
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, utopie, dystopie, lettres, littérature, littérature française, mondialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 27 septembre 2008
A propos du 300ième numéro du Bulletin Célinien

À propos d'un trois centième numéro du Bulletin célinien
J'ai entendu parler pour la première fois du Bulletin célinien à l'époque déjà ancienne où j'assurais, au moins nominalement, la présidence de la Société des Études céliniennes naissante. J'en étais en tout cas le parrain pour avoir imaginé l'intitulé. Elle était destinée à servir de liaison entre la poignée de chercheurs qui s'intéressaient alors à Céline, et – après mes expériences américaines – j'y mettais naturellement mes espoirs. C'est pourquoi je me souviens avec netteté des sentiments que suscita à Paris la naissance du Bulletin célinien à Bruxelles. On en parlait avec réserve, pas mal de suspicion, mais comme d'une chose transitoire.
Or, voici le 300ème numéro. Le BC a non seulement vécu et survécu mais il s'est imposé, il est devenu une institution ; comment expliquer la chose ?
J'y vois d'abord un effet de la distance. Cela ne pouvait sans doute se faire que dans cette Belgique qui, à travers Denoël, Évelyne Pollet et Marc Hanrez, avait élu Céline. On y était suffisamment loin de Paris pour ne pas ressentir le clapotis parisien. Vivant avec tranquillité affrontements et conflits, sa double nature flamande et française lui assure la placidité nécessaire devant les mauvais coups : on sait encaisser.
Quand j'ai aperçu Marc Laudelout pour la première fois dans l'un des colloques qui se tint vers là-bas j'avais été surpris par sa jeunesse, mariée à une réserve sénatoriale. Cela contrastait avec la nervosité ou la fébrilité de céliniens rencontrés de part et d'autre de l'Atlantique. Ce tempérament lui a permis de négocier les emballements, les compétitions, les conflits et les paniques périodiques que provoque Céline. Non pas que le directeur du BC ait le cuir épais, je le crois sensible et même ultra sensible aux critiques, mais la périodicité mensuelle lui donne le temps de voir. De Bruxelles-Sirius, on distingue mieux le qui du quoi. Chacune des chapelles de la cathédrale chante l'évangile à sa façon, et tout en veillant au respect de la lettre, le directeur du BC se garde des procès aux hétérodoxes et aux dissonants, à moins de croire le grand homme attaqué.
Il a maintenu ce calme et ce sérieux d'arbitre dans les empoignades qui ont mis périodiquement aux prises les officiants qui s’assomment à coup d'encensoirs comme les moines des différentes confessions à l’entrée du Saint-Sépulcre. Céliniens de gauche ou de droite, ayants droit, celtisants, passionnés de la virgule et du texte pour le texte, acharnés du petit fait vrai ou de la mémoire du lieu, experts en exploration d'archives, collectionneurs et marchands de reliques, tous ont reçu leur dû chez lui. Il n'y a eu, je crois, qu'un chanoine pour refuser le contact. Ces rares qualités ont permis à Marc Laudelout de tenir la gageure du sujet unique.
Encore fallait-il que ce sujet tint lui-même en haleine, et c'est justement la survie exceptionnelle de Céline qui permet au Bulletin à lui consacré de vivre depuis trente ans.
Il m'a toujours semblé que chacun des admirateurs de Céline élisait l'une de ses qualités ou de ses défauts pour les cultiver dans son laboratoire, certains le misérabilisme, d'autres la folle audace associée à une extrême prudence, d'autres encore la peur des riches et des puissants, je passe sur les mimétiques de la forme, Laudelout, lui, me paraît avoir élu le désir de vie de l’increvable qui, tout en parlant périodiquement de « se filer au gaz », a sans doute été le moins suicidaire des écrivains du temps.
La tentation d’en finir avec ce Bulletin, qui lui apportait à longueur d’année palpitations et vertiges devant le numéro à remplir, à boucler et à payer, a dû se présenter dix fois. Il lui a résisté, il a tenu grâce à celui qui – il faut le constater – n’a pas connu une année de purgatoire depuis la publication de L’Herne, les colloques de J.-P. Dauphin ou le premier numéro du Bulletin célinien.
Montherlant s’est lourdement trompé en disant qu’on ne lirait pas plus Céline dans cinquante ans qu’on ne lisait Paul Alexis ou Paul Lombard. On pourrait même croire qu’il a payé son erreur. Et ceci nous amène fatalement à la question inéluctable : pourquoi lit-on l’un et plus l’autre ? Une fois écartée la fausse réponse du style, il faut imaginer le lecteur, jeune ou vieux, gavé de l’aube au crépuscule de bons sentiments, envers les femmes, les immigrés et les sans-papiers, sommé de tenir tous les bipèdes pour ses semblables et convaincu de culpabilités rétrospectives variées, il faut imaginer ce lecteur découvrant la prose lyrique du seul qui sache piétiner nos tabous les plus chers entre deux ballets et trois idylles. L’impunité fournie par le temps et le talent assure la renaissance du phénix.
Laudelout s’est fait une spécialité d’évoquer le drôle d’oiseau, et il a encore le temps de voir. Son secret de longue vie tient au fait qu’il n’a rien à prouver, rien à démontrer.
Philippe ALMÉRAS
Auteur de deux thèses de doctorat sur Céline : L’évolution du langage romanesque de Louis-Ferdinand Céline (Université de Californie [Santa Barbara], 1971) et Les idées de Céline (Université de Paris VII, 1987). Cette thèse a été éditée par la BLFC (1987), puis rééditée par Berg International (1992) et Dualpha (2004). Auteur d’une biographie, Céline. Entre haines et passion (Robert Laffont, 1994 ; rééd. Dualpha, 2002) et d’un Dictionnaire Céline. Une œuvre, une vie (Plon, 2004). Autres livres publiés sur le sujet : Je suis le bouc. Céline et l’antisémitisme (Denoël, 2000) ; Voyager avec Céline (Dualpha, 2003) et Sur Céline (Éditions de Paris, 2008). A également édité et préfacé Lettres des années noires (Berg International, 1994).
00:51 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : revues, littérature, littérature française, lettres françaises, céline |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 21 septembre 2008
Citation de Louis-Ferdinand Céline
Cassez vos télévisions

00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lettres françaises, littérature françaises, céline, télévision, bêtise, manipulations médiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 septembre 2008
Jünger et l'Allemagne secrète

Jünger et l'Allemagne secrète
Antonio GIGLIO
La polémique qui s'est déclenchée à propos d'Ernst Jünger, remet à l'avant-plan, une fois de plus, les fantasmes nés de la guerre civile européenne et du passé qui ne passe pas, mais, pire encore, les fantasmes plus insidieux générés par l'incompréhension totale de nos contemporains face à l'histoire politique et culturelle de ce siècle. A Jünger qui est aujourd'hui, à 100 ans, le plus grand écrivain européen vivant, on a reproché d'être, dans le fond, un complice des nazis. Pour clarifier cette question, il nous apparaît opportun de récapituler, depuis le début, l'histoire des activités politiques et culturelles de Jünger, le héros de la Première Guerre mondiale, un des rares soldats de l'armée impériale, avec Rommel, à avoir reçu la plus haute décoration militaire allemande, l'Ordre “Pour le Mérite”. Le thème des premières œuvres littéraires de Jünger est l'expérience de la guerre, dont témoigne notamment son célèbre roman Orages d'acier. Ces livres de guerre lui ont permis de devenir en peu de temps l'un des écrivains les plus lus et les plus fameux de l'Allemagne. En outre, Jünger est rapidement devenu l'un des chefs de file du nouveau nationalisme, suscité par les conditions de paix très dures imposées à l'Allemagne. Il réussit à forger une série de mythes politiques représentant la synthèse ultra-révolutionnaire de tout ce que la droite allemande avait produit à cette époque.
L'écrivain évoluait entre les bureaux d'études de l'armée, les groupes paramilitaires et nationaux-révolutionnaires, et réussissait à fusionner plusieurs projets politiques: celui du philologue Wilamowitz visant la création d'un Etat régi par un Ordre ascétique ou une caste sélectionnée d'hommes de culture et de science, celui de Spengler visant le contrôle et la domination des nouvelles formes technologiques en train de transformer le monde, celui du poète Stefan George chantant une nouvelle aristocratie, celui de Moeller van den Bruck axé sur la nécessité de rénover de fond en comble le “conservatisme” ou plutôt sur la nécessité de lancer une “révolution conservatrice”, formule inventée par le poète Hugo von Hoffmannsthal et traduite par Jünger en termes ultra-nationalistes et guerriers. Pourtant, Jünger, influencé par la furie iconoclaste de Nietzsche, propose à l'époque de détruire totalement la société bourgeoise, ce qui lui permet d'utiliser aussi les mythes politiques de la gauche, dont l'idée bolchévique suggérée par Lénine, soit la mobilisation totale et militaire de l'Etat, utilisée auparavant en Allemagne par le Général Erich Ludendorff; chez Jünger, cette mobilisation totale deviendra la mobilisation totale de tout ce qui est allemand. Enfin, il utilise le mythe du travailleur-soldat, déjà loué par Trotsky; Jünger l'adopte et le propose, transformé par la pensée du philosophe Hugo Fischer. Cette synthèse de Lénine, Trotsky et Fischer deviendra Le Travailleur, au moment même où Jünger est l'allié du national-bolchévique Ernst Niekisch. Il faut encore noter que la pensée philosophique et politique de Heidegger a été profondément influencée par ce célébrissime essai de Jünger, qui moule audacieusement en une puissante unité philosophique la technique, le nihilisme et la volonté de puissance.
Parallèlement, l'écrivain se propose d'unifier tous les mouvements nationalistes allemands; c'est cette intention qui explique sa tentative initialement favorable à Hitler; il suffit de penser à la dédicace rédigée de son livre de 1925, Feuer und Blut (= Feu et Sang) à l'intention du “Führer national” Adolf Hitler, même si l'année précédente, il avait désapprouvé la décision des nazis d'adopter des méthodes légales et craint une trahison nationale-socialiste à l'égard de la pureté des idéaux nationaux-révolutionnaires. Quoi qu'il en soit, en 1927, Hitler propose à Jünger un siège au Parlement, mais l'écrivain ne l'accepte pas parce qu'il refuse le parlementarisme et toute forme de parti. Après 1933, Jünger se retire complètement de la politique parce qu'il est trop élitaire, aristocratique et révolutionnaire pour accepter qu'un mouvement de masse s'accapare de ses idées; par ailleurs, il se sent trop impliqué dans bon nombre d'idées nationalistes pour pouvoir critiquer ouvertement le nouveau régime. En 1939, cependant, Jünger semble vouloir intervenir directement, de manière critique, dans le régime nazi, en publiant son roman Sur les falaises de marbre. Selon un philosophe allemand contemporain, Hans Blumenberg, Jünger a rassemblé dans ce roman toutes les allusions aux événements de l'époque dans un scénario mythique, surtout après l'élimination des opposants à Hitler lors de la “nuit des longs couteaux”, décidant ainsi de n'opposer plus qu'une résistance animée par la pure force de l'esprit. Un spécialiste plus connu du nazisme, George L. Mosse affirme que Jünger, dans ce roman, rejette les idées de sa jeunesse et retourne au protestantisme. En réalité, les choses sont beaucoup plus complexes.
De fait, Jünger, en 1938, dans la seconde version de son livre Le cœur aventureux, fait allusion pour la première fois au mystérieux Ordre des Maurétaniens, une élite mystique de mages savants et guerriers, qui deviendra le protagoniste collectif du roman Sur les falaises de marbre, et, par la suite, de tous les autres romans de l'auteur. En premier lieu, nous devons souligner que Jünger et les révolutionnaires nationalistes de sa génération sont obsédés par le mythe politique d'un Ordre qui régit l'Etat et guide les masses. Les Maurétaniens sont à mi-chemin entre les Templiers et les Chevaliers Teutoniques, ils sont l'incarnation de ce mythe.
Donc, en 1938, Jünger écrit qu'au lieu de rester coincé dans ses chères études, il va s'introduire dans le milieu des Maurétaniens, qu'il définit comme des polytechniciens subalternes du pouvoir, parmi lesquels il nomme Goebbels et Heydrich, un des chefs de la SS. Ce n'est dès lors pas un hasard si Carl Schmitt écrit, dans son journal, que les Maurétaniens sont une allégorie des SS. Jünger, en outre, ajoute textuellement qu'«une équipe sélectionnée des nôtres est au travail dans les lieux secrets du plus secret Thibet». Effectivement, à cette époque, existait une organisation culturelle liée à la SS et dénommé l'Ahnenerbe (= l'Héritage des Ancêtres), qui organisait entre autres choses des expéditions plus ou moins secrètes au Thibet, et était reçue par le Dalaï Lama en personne. Par ailleurs, il faut signaler que cette structure avait été mise sur pied, au départ, par un ami de Jünger, Friedrich Hielscher, le chef spirituel des jeunes nationalistes allemands, avant d'être incluse par Himmler dans les institutions SS. Mais quand paraît le roman-pamphlet Sur les falaises de marbre, certains nazis, ignorant ces faits, réclament la tête de Jünger, qui sera défendu par le “Maurétanien” Goebbels, et ensuite par Hitler lui-même, qui, ne l'oublions pas, avait confessé à Rauschning, stupéfait et attéré, avoir fondé un Ordre mystérieux. Nous sommes donc en présence d'un mystère historiographique et politique du 20ième siècle.
Le roman de Jünger est probablement le témoignagne d'un conflit politique et culturel qui se déroulait à l'intérieur du noyau dirigeant national-socialiste, et aussi, sans doute, à l'intérieur même de cet Ordre mystérieux, pour savoir comment imposer et diriger la politique intérieure et extérieure du IIIième Reich. Jünger, qui plus est, considère que l'un des protagonistes du roman, le Maurétanien Braquemart, est semblable à Goebbels, et que la figure démoniaque et destructive du Forestier peut être ramenée à Staline. Ensuite, en 1940, il attribue la victoire fulgurante des troupes allemandes en France à la Figure du Travailleur, décrite dans son livre Der Arbeiter. En 1942, il fait rééditer son essai sur la mobilisation totale, au moment même où Hitler mobilise totalement et désespérément tout ce qui est allemand. Ce conflit interne entre les Maurétaniens, dans lequel Jünger entendait bel et bien intervenir en publiant son roman-pamphlet, s'est avivé pendant la durée du conflit, à cause des conséquences catastrophiques de la guerre voulue par Hitler et non par les autres membres de l'Ordre des Maurétaniens. Voilà pourquoi Jünger et son ami Hielscher en sont arrivés à comploter contre le Führer: ils voulaient désespérément éviter le destin tragique qui allait frapper l'Allemagne, ou au moins l'atténuer.
Jünger, en effet, fut l'un des organisateurs de la tentative de coup d'Etat du 20 juillet 1944, qui aurait dû avoir lieu après l'attentat contre Hitler. A Paris, où il est officier d'état-major dans le Haut Commandement des troupes d'occupation, centre du complot contre Hitler, Jünger écrit l'essai La Paix qui est, en fait, le texte politique essentiel de ce complot, et dont le manuscrit avait été lu et approuvé par Rommel, le seul officier supérieur capable de mettre un terme à la guerre sur le front occidental et à affronter la guerre civile. Mais le complot échoue, Rommel est contraint au suicide parce qu'il est condamné à mort. Le Maurétanien Hielscher est arrêté à son tour. Jünger semble vouloir nous dire que le Prince Sunmyra, un des auteurs malchanceux de l'attentat contre le Forestier dans le roman-pamphlet, peut être comparé au Colonel von Stauffenberg, l'auteur malchanceux de l'attentat contre Hitler. Claus von Stauffenberg, héros de la “Résistance allemande”, était un disciple de Stefan George, donc un représentant de ces Maurétaniens qui s'étaient donné le devoir de préserver l'Allemagne secrète. Et Hitler ne pouvait pas condamner à mort l'Allemagne secrète, incarnée dans l'œuvre et la personne de Jünger.
Antonio GIGLIO.
(article extrait de l'Italia settimanale, n°13/1995; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : lettres, lettres allemandes, allemagne, seconde guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, résistance, anti-nazisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 septembre 2008
J. Evola: Jünger et l'irruption de l'élémentaire dans l'espace bourgeois
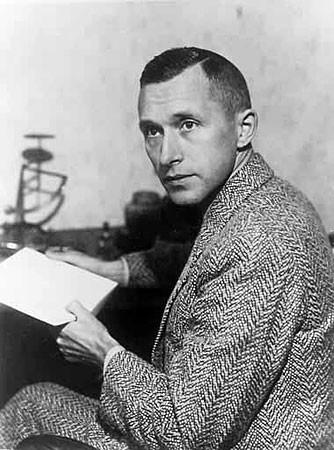
Julius EVOLA:
Jünger et l'irruption de l'élémentaire dans l'espace bourgeois
Il est visible et il nous paraît évident qu'à travers l'économie se sont réveillées des forces «élémentaires», qui, en de nombreux domaines, échappent au contrôle du bourgeois et, ainsi, deviennent le substrat d'une nouvelle unité, collective cette fois.
Ce constat nous amène effectivement à certains aspects de la crise du monde bourgeois et à les étudier; selon Jünger, il faut tourner notre attention vers quelques traits caractéristiques du bourgeois qui correspondent à son idéal de sécurité commode et d'exclusion de toute force élémentaire hors de sa vie.
Le concept d'élémentaire joue un rôle central dans le livre de Jünger. Comme chez d'autres auteurs allemands, le terme «élémentaire» n'est pas utilisé chez Jünger dans le sens de “primitif”; il désigne bien plutôt les puissances les plus profondes de la réalité qui échappent aux structures intellectuelles et moralistes et qui sont caractérisées par une transcendance, positive ou négative selon l'individu: c'est comme si l'on parlait des forces élémentaires de la nature. Dans le monde intérieur, il existe des puissance qui peuvent faire irruption dans la vie, tant la vie personnelle que la vie collective, en venant d'une strate psychique plus profonde. Quand Jünger parle de l'exclusion de l'élémentaire dans le monde bourgeois, il est évident qu'il s'associe à la polémique développée par plusieurs courants d'idées contemporains, depuis l'irrationalisme, l'intuitionnisme, la religion de la vie (ou vitaliste) jusqu'à la psychanalyse et à l'existentialisme; il s'insurge contre la vision rationaliste-moraliste de l'homme, prédominante hier encore. Mais nous allons voir que la position de Jünger est originale dans ce contexte, car il conçoit des formes actives, lucides, non régressives des rapports de l'homme à l'élémentaire, ce qui le distingue de l'orientation problématique, propre à la grande majorité des courants que nous venons de mentionner.
La préoccupation constante du monde bourgeois est donc «de fermer hermétiquement l'espace vital à tout irruption de l'élémentaire», de «se créer une ceinture de sécurité face à l'élémentaire». De ce fait, la sécurité dans la vie est donc l'exigence de ce monde, que devra consolider et légitimer le culte de la raison: une raison «pour laquelle tout ce qui est élémentaire équivaut à l'absurde et à l'insensé». Inclure l'élémentaire dans l'existence, avec tous les problèmes et les risques que cela peut impliquer, voilà ce qui apparaît inconcevable au bourgeois; pour lui, c'est une aberration qu'il faut prévenir par le truchement de techniques pédagogiques adéquates. Jünger écrit: «Le bourgeois ne se sent jamais assez hardi pour se mesurer au destin en luttant et en s'exposant aux dangers, parce que l'élémentaire réside en dehors de son monde idéal; pour lui, l'élémentaire est l'irrationnel voire l'immoral. Il cherchera donc à le tenir toujours à distance, que celui-ci lui apparaisse sous le mode de la puissance ou de la passion, ou se manifeste dans les forces de la nature, dans le feu, l'eau, la terre ou l'air. De ce point de vue, les grandes villes du début du siècle apparaissaient comme les citadelles de la sécurité, comme le triomphe des murs qui, à ce moment-là, cessaient d'être les murs antiques des enceintes fortifiées et se manifestaient désormais comme pierres, asphalte et vitres encerclant la vie, similaires à la structure des rayons d'une ruche, pénétrant jusqu'à la trame la plus intime de la vie. Dans ce sens, toute conquête de la technique est un triomphe de la commodité et toute apparition de l'élémentaire est régulée par l'économie».
Pour Jünger, le caractère anomal de l'ère bourgeoise ne réside pas tant dans la recherche de la commodité «que dans ce trait spécifique qui s'associe à ces tendances: c'est-à-dire dans le fait que l'élémentaire se présente comme l'absurde et, partant, que les murs d'enceinte de l'ordre bourgeois se présentent simultanément comme les murs d'enceinte de la rationalité». Tel est donc bien le point d'ancrage de la polémique anti-bourgeoise de Jünger. Il distingue bien la rationalité du culte de la raison et conteste l'idée qui veut qu'un ordre et une mise en forme rigoureuse de la vie soient possibles et concevables seulement selon le schéma rationaliste, partant d'une imperméabilisation de l'existence face à l'élémentaire. Parmi les tactiques utilisées par le bourgeois, il y a celle qui consiste à «présenter toute attaque contre le culte de la raison comme une attaque contre la raison en elle-même, afin de pouvoir bannir cette attaque dans l'aire de l'irrationnel». En vérité, toute attaque peut s'identifier à une autre, mais seulement selon la vision bourgeoise, c'est-à-dire seulement sur base de «la conception spécifiquement bourgeoise de la raison, caractérisée par une “inconciliabilité” avec l'élémentaire». Cette antithèse ne peut être retenue comme valide par un nouveau type humain: du reste, cette antithèse est dépassée de fait par des figures «comme, par exemple, celles du croyant, du guerrier, de l'artiste, du navigateur, du chasseur, du travailleur et, aussi, finalement, du délinquant»; pour toutes ces figures, à l'exception de la dernière, le bourgeois nourrit une aversion plus ou moins ouverte, parce que «pour ainsi dire, elles portent déjà à l'intérieur même des cités, par leurs apparences, l'odeur du danger, parce que déjà leur simple présence représentent une instance dirigée contre le culte de la raison».
Mais «pour le guerrier la bataille est un événement dans lequel se réalise un ordre suprême, pour le poète les conflits les plus tragiques sont des situations où le sens de la vie peut se condenser en un mode particulièrement net»; la délinquence elle-même peut être expliquée par une rationalité lucide; quant au croyant, «il participe à la sphère plus vaste d'une vie pleine de signification. Soit par le malheur ou le danger ou le miracle, le destin l'englobe directement dans un tissu d'événements plus puissants. Les dieux aiment se manifester dans les éléments, dans les astres enflammés et dans la foudre, dans les ronces que la flamme ne consume pas». L'élément décisif qu'il s'agit surtout de reconnaître ici est que «l'homme peut demeurer en rapport avec l'élément(aire) sur un plan supérieur ou sur un plan inférieur et qu'en conséquence, multiples sont les plans sur lesquels tant la sécurité que le danger retournent dans l'ordre. Au contraire, dans le bourgeois, on perçoit un homme qui ne reconnaît comme valeur suprême que la sécurité, et détermine sa conduite de vie sur base de cet idéal de sécurité». «Les conditions pour promouvoir cette sécurité, que le progrès cherche à réaliser, sont corollaires de la domination universelle de la raison bourgeoise, laquelle devrait non seulement limiter, mais, en bout de course, détruire, toutes les sources de danger. Et, comme à la lumière de cette raison, le danger est présenté comme étant l'irrationnel, on ôte à celui-ci tout droit de faire partie de la réalité. Il est fort important, dès lors, dans un tel mode de penser, de voir l'absurde dans tout danger: celui-ci semble éliminé dès le moment où, dans le miroir de la raison, il apparait comme une erreur».
«Dans les ordonnancements tant spirituels qu'objectifs du monde bourgeois, on peut constater tout cela», poursuit Jünger. «En grand, on peut le voir dans la tendance à concevoir l'Etat —lequel, normalement, se base pour l'essentiel sur la hiérarchie, en termes de société— comme une forme ayant pour principe fondamental l'égalité et se constituant par le truchement d'un acte de la raison. Cette vision révèle la volonté d'imposer une organisation complexe, un système de sécurité devant ventiler et atténuer toutes les formes de risques, non seulement dans le domaine de la politique intérieure et extérieure, mais aussi dans celui de la vie individuelle, ce qui constitue une tendance à dissoudre le destin par un calcul de probabilités. Cette vision révèle enfin, dans ses multiples et complexes tentatives de ramener la vie de l'âme à des rapports de cause à effet, dans sa volonté de transférer la vie de l'âme du domaine de l'imprévisible à celui du calculable, et puis de l'insérer dans la sphère “éclairée” de la conscience extérieure». Dans tous les domaines, la tendance est d'éviter les conflits et de démontrer leur “évitabilité”. Mais vu que les conflits surviennent malgré tout, pour le bourgeois, «l'important est de démontrer qu'ils sont une erreur que l'éducation et une pédagogie “éclairée” des esprits devront empêcher la répétition».
Mais un tel monde ne serait qu'un monde d'ombres, où l'idéologie des Lumières surévaluerait ses propres forces, en croyant qu'il puisse tenir vraiment debout. En réalité, «le danger est toujours présent; comme un élément de la nature, il cherche continuellement à briser la digue que l'ordre a construit pour l'enserrer; et, par l'effet des lois d'une mathématique occulte mais infaillible, il se fait d'autant plus menaçant et mortel que l'ordre cherche à l'exclure. En fait, le danger veut être non seulement un élément de cet ordre mais, en plus, le principe d'une sécurité supérieure, que jamais le bourgeois ne pourra connaître». En règle générale, si l'on peut exclure l'élémentaire dans un type donné d'existance, cette exclusion «doit être soumise à certaines lois, parce que l'élémentaire n'existe pas seulement dans le monde externe mais est aussi inséparable de la vie de chaque individu». L'homme vit dans l'“élémentarité” dans la mesure où il est un être naturel, un être mu spirituellement par des forces profondes. «Aucun syllogisme ne pourra jamais se substituer au battement du cœur ou à l'activité des reins; il n'existe aucune grandeur qui puisse naître de la seule raison, qui, de temps en temps, doit bien se soumettre aux passions, nobles ou ignobles». Enfin, se référant au monde économique, Jünger note que «s'il est beau le mode par lequel nous nous voyons imposer des calculs, et si l'unique résultat de ceux-ci doit être le bonheur, il restera toujours un résidu qui se soutraira à toute analyse et l'être humain aura le sentiment d'être appauvri, de vivre une désespérance croissante».
Mais l'élémentaire a une double source. «D'une part, il a sa source dans un monde qui est toujours dangereux, comme la mer recèle en elle le danger même quand elle n'est pas troublée par le moindre ventelet. D'autre part, il a d'autres sources dans l'âme humaine, qui a soif de jeu et d'aventure, d'amour et de haine, de triomphe et de chute, qui ressent tant le besoin du risque que de la sécurité; et donc, pour cette âme humaine, un Etat absolument sécurisé apparaît comme un Etat d'incomplétude». En prononçant d'aussi audacieuses paroles, Jünger se réfère implicitement à un type humain différent de celui véhiculé par le monde bourgeois, mais que ce monde génère malgré lui.
La domination des valeurs bourgeoises peut donc se mesurer «à la distance que l'élémentaire semble avoir prise en se retirant de l'existence». Jünger dit “semble”, parce que l'élémentaire se sert de multiples masques et trouve toujours un moyen de se nicher au centre même du monde bourgeois, pour en miner les ordonnancements rationalisants et émerger dès que survient une crise. Par exemple, Jünger rappelle comme déjà dans le passé, sous le signe de la Révolution française, quelles noces cruelles furent celles qui unirent la bourgeoisie et le pouvoir. Le dangereux et l'élémentaire se sont réaffirmés «face aux astuces les plus subtiles par lesquelles on a cherché à les circonvenir; ils s'introduisent de façon imprévue dans les rouages mêmes de ces astuces, en prennent les travestissements, ce qui fait que tout ce qui est civilisation [au sens bourgeois] présente un visage ambigu; nous connaissons tous les rapports qui existent entre les idéaux de fraternité universelle et les gibets, entre les droits de l'homme et les massacres». Non que ce soit le bourgeois lui-même qui veuille imposer de telles circonstances contradictoires: car quand il parle de rationalité et de moralité, il se prend terriblement au sérieux: «tout cela est plutôt un terrible rire sarcastique qu'adresse la nature aux masques se présentant sous le visage de la moralité, une exultation frénétique du sang dirigée contre l'intellect, après que se soit achevé le prélude des beaux discours». En revanche, ce qui mérite d'être remarqué, c'est «le jeu ingénieux des concepts par lequel le bourgeois cherche à faire ressortir ces vertus et à ôter aux mots tout ce qu'ils ont de dur et de nécessaire, afin que transparaisse seulement une moralité que tous sont tenus de reconnaître». Par exemple, cette attitude est bien visible sur le plan international, «quand on cherche à présenter la conquête d'une colonie comme étant une pénétration pacifique ou comme une opération civilisatrice, ou l'incorporation d'une province appartenant à un pays voisin comme un effet de la libre auto-décision des peuples, ou, enfin, les rapines perpétrées par les vainqueurs comme des réparations». Il est évident qu'à ces exemples avancés par Jünger on pourrait facilement ajouter des faits plus récents. Parmi les cas les plus typiques, nous pourrions ajouter les «nouvelles croisades», les tribunaux de vainqueurs, les «aides aux pays sous-développés», etc.
Dans ce même ordre d'idées, est exact ce que dit Jünger quand il relève que c'est justement à l'époque où se sont officiellement et bruyamment propagées les valeurs bourgeoises de “civilisation” que l'on a assisté à des événements que l'on n'aurait plus cru possibles dans un monde éclairé: des phénomènes de violence et de cruauté, de délinquence organisée, de déchaînements d'instincts, de massacres. Tous ces événements représentent «la réduction à l'absurde de l'utopie bourgeoise de la sécurité». En guise de bon exemple, Jünger signale les conséquences qu'a déjà eues le prohibitionnisme aux Etats-Unis: il constitue une tentative moralisatrice, promise par une littérature faite d'utopisme social, et qui semble avoir été conçue comme une mesure de sécurité; elle n'a cependant réussi qu'à attiser des forces élémentaires du plus bas niveau. Ainsi, l'Etat, en suivant rigidement le principe bourgeois, se réfère à des catégories abstraites, rationnelles et moralisantes, et exclut l'élémentaire; mais, en réalité, cet Etat fait en sorte que cet élémentaire s'active en dehors du cadre qu'il installe. «Le moral et le rationnel n'étant pas des liens primordiaux mais seulement des liens propres à l'esprit abstrait, dit Jünger, toute autorité ou tout pouvoir qui veulent se baser sur eux, ne seront qu'autorité ou pouvoir apparents, et, simultanément, la sécurité bourgeoise ne tardera pas à manifester son caractère utopique et éphémère». Il serait bien difficile de contester la réalité de cette dialectique, surtout dans la période qui a suivi la rédaction du Travailleur. C'est effectivement à cette dialectique que se rapportent, d'une part, l'un des facteurs principaux de la crise du monde bourgeois, et, d'autre part, cette autre face, informe, obscure et dangereuse des structures sociétaires modernes, ordonnées et régulées seulement en surface, mais privées tant d'un sens supérieur que de racines dans les strates psychiques les plus profondes.
Déjà au moment de la rédaction du Travailleur, après la première guerre mondiale, il était clair qu'un phénomène analogue de contre-coup allait se produire quand on allait appliquer de tels principes, notamment celui qui se profile derrière le concept bourgeois de liberté abstraite: dans la mesure où l'on reconnaît au principe de la démocratrie nationale une validité universelle, sans opérer la moindre discrimination, on aboutit automatiquement à un état d'anarchie mondiale, suscitant de nouvelles causes de crise au sein de l'ordre ancien, telle la révolte des peuples colonisés et de toutes les forces auxquelles, en Europe et ailleurs, le principe d'auto-détermination des peuples a donné une souveraineté politique même quand il s'agissait de tribus ou de populations, explique Jünger, «dont le nom n'était pas connu de l'histoire politique mais seulement, à la rigueur, des manuels d'ethnologie. Cet état de choses a pour conséquence naturelle la pénétration dans l'espace politique de courants purement élémentaires, de forces appartenant moins à l'histoire qu'à l'histoire naturelle». Aujourd'hui, ce constat est encore plus exact qu'hier.
Pour nous, il est cependant plus important d'examiner la crise du système dans ses aspects spirituels. Jünger parle surtout de formes de défense et de compensation qui se sont déjà manifestées en marge de la société bourgeoise, avec le phénomène du romantisme. «Il y a des périodes où les relations de l'homme avec l'élémentaire se manifestent sous l'aspect de propensions au romantisme, lesquelles constituent déjà en soi un point de fracture. Selon les circonstances cette fracture se fera visible: on se perdra dans le lointain (l'exotique), dans l'ivresse, la folie, la misère ou la mort. Ce sont là toutes des formes de fuite où l'homme isolé, après avoir cherché en vain une voie de sortie dans tout l'espace du monde spirituel ou matériel, met bas les armes. Mais, en tant que telle, la capitulation, peut aussi revêtir les apparences d'une attaque, comme quand un navire de guerre, en sombrant, tire encore une ultime bordée à l'aveuglette».
«Nous avons su reconnaître la valeur de la sentinelle tombée sur sa position perdue, continue Jünger. Nombreuses sont les tragédies auxquelles se lient de grands noms, mais il y a aussi beaucoup de tragédies anonymes, où des groupes entiers, des strates sociales entières, qui subissent une raréfaction de l'air nécessaire à la vie, comme s'ils avaient été pris par un vent de gaz toxiques». Ce que Jünger ajoute ensuite a une base autobiographique et reflète ses propres expériences de jeunesse, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler: «Le bourgeois a presque réussi à persuader le cœur aventureux que le danger n'existe pas, qu'une loi économique gouverne le monde et l'histoire. Mais les jeunes gens qui dans la nuit et le brouillard abandonnent la maison de leur père ont le sentiment intime de devoir aller très loin à la recherche du danger, au-delà de l'océan, en Amérique, à la Légion Etrangère, dans des pays où poussent les arbustes qui donnent le poivre. Mais surgissent aussi des figures qui n'auront pas le courage de s'exprimer dans ce langage propre et supérieur, comme celle du poète qui se sent pareil au pétrel dont les ailes puissantes, créées pour la tempête, ne deviennent, hélas, plus qu'un objet de curiosité inopportune dans un milieu étranger, sans vent, ou comme celle du guerrier né, qui semble n'être qu'un bon à rien, parce que la vie du marchand le remplit de dégoût».
Pour Jünger, le point décisif de fracture a eu lieu pendant la première guerre mondiale. «Dans la joie, les volontaires l'ont saluée (écrit Jünger en se souvenant visiblement de ce qu'il a lui-même vécu) parce qu'elle leur procurait un sentiment de libération des cœurs et que, d'un trait, se révélait à eux une vie nouvelle, plus dangereuse. Dans cette joie, se cachait aussi, tapie, une protestation révolutionnaire contre les valeurs anciennes, tombées irrémédiablement en désuétude. A partir de ce moment-là, dans tous les courants de pensée, dans tous les sentiments et dans tous les événements, s'est infusé une couleur nouvelle, élémentaire». L'important, ici, est de voir comment, par la force même des choses, un nouveau mode d'être a commencé à se différencier. Jünger relève aussi le rôle qu'ont joué dans la jeunesse combattante, entraînée dans la complexité de cette guerre, les enthousiasmes, les idéaux et les valeurs du patriotisme conventionnel lié au monde bourgeois. Mais, bien vite, il est apparu clairement que cette guerre réclamait des réserves de forces bien différentes de celles nourries à ces sources bourgeoises: et cette différence est celle qui distingue les sentiments d'enthousiasme des troupes quittant les gares, d'une part, et «leur action entre les cratères, sous le fer et le feu d'une bataille de matériel», d'autre part. Alors, dans cette épreuve du feu, disparait le contexte qui justifiait la protestation romantique. Cette protestation-là, écrit Jünger, «est condamnée au nihilisme, là où elle est fuite, simple polémique contre un monde qui sombre, or en tant que telle, elle reste conditionnée par lui. Elle ne devient force que quand elle donne lieu à un type spécial d'héroïsme». Là s'annonce le thème central du Travailleur: traverser une zone de destruction sans être soi-même détruit. La même expérience aura des effets totalement opposés chez des hommes d'une même génération: «les uns se sont sentis déchirés par elle, les autres ont participé à un vécu jamais expérimenté auparavant, grâce à l'extrême proximité de la mort, avec le feu et le sang». La discordance découle de l'ambigüité d'avoir eu comme uniques béquilles les valeurs bourgeoises qui se basaient sur l'individu et sur l'exclusion de l'élémentaire, et d'avoir été capables de vivre une nouvelle liberté. S'il avait été déchiré, brisé, par la guerre, Jünger aurait pu se référer aux mots qu'Erich Maria Remarque a mis en exergue de son fameux livre A l'Ouest rien de nouveau: «Ce livre ne veut ni accuser ni démontrer une thèse; il veut seulement dire quelle fut une génération, déchirée par la guerre même quand les obus l'ont épargnée». Mais comme Jünger est de ceux qui savent intimement qu'ils ont vécu une expérience unique, il voit en ses compagnons de combat ceux qui anticipativement ont constitué le «type»: c'est-à-dire un homme qui se tient debout parce qu'il veut se rendre capable d'un rapport actif avec l'élémentaire, et, parallèlement, développer des formes supérieures de lucidité, de conscience et de maîtrise de soi, parce qu'il veut se dés-individualiser et accepter un réalisme absolu, parce qu'il connaît le plaisir des prestations absolues, de la plénitude maximale de l'action, assortie d'un minimum de “pourquoi?” et de “dans quel but?”. C'est là que «les lignes de la force pure et celles de la mathématique se rencontrent»; dans l'aire d'une conscience accrue, «il est possible de potentialiser les moyens et les énergies premières de la vie, dans un sens inattendu, jamais encore expérimenté».
«Dans les centres occultes de la force, par laquelle on domine la sphère de la mort, on rencontre une humanité nouvelle, qui se forme par le biais d'exigences nouvelles», écrit Jünger. «Dans un tel paysage, on ne peut plus apercevoir l'individu qu'avec beaucoup de difficultés; le feu a calciné tout ce qui n'a pas un caractère objectif». Les processus en plein développement sont tels que toute tentative de la raccorder encore au romantisme et à l'idéalisme de l'individu finissent par sombrer irrémédiablement dans l'absurde. Pour dépasser victorieusement «quelques centaines de mètres où règne la mort mécanique», on n'a nul besoin des valeurs abstraites, morales ou spirituelles, de la libre volonté, de la culture, de l'enthousiasme ou de l'ivresse aveugle qui méprise le danger. Pour cela, il faut une énergie nouvelle et précise, tandis que «la force combattive du milieu dans son ensemble assume un caractère moins individuel que fonctionnel». En outre, on découvre des correspondances entre le point de destruction et l'apogée spirituelle d'une existence; c'est là que se déchaînent les prémisses de la personne absolue. Les rapports avec la mort se transforment et «la destruction peut surprendre l'homme singulier dans ces instants précieux où on lui demande un maximum d'engagement vital et spirituel». Alors, «à la fin, on peut aussi reconnaître la liberté la plus élevée». Tout cela devient, finalement, un part naturelle, voulue d'avance, d'un nouveau style de vie. Finalement se présentent «des figures d'une suprême discipline du cœur et des nerfs, indices d'une froideur quasi métallique, extrême et lucide, où la conscience héroïque se montre capable d'utiliser le corps comme un pur instrument, en lui imposant une série d'actions complexes, au-delà de l'instinct de conservation. Entre les flammes d'un avion touché, dans les chambres d'air d'un submersible qui coule, on accomplit encore un travail qui, au sens propre, transcende la sphère de la vie et dont jamais aucun communiqué ne signalera». Les deux termes qui s'unissent dans ce «type» sont donc l'élémentaire en acte, en soi et en dehors de soi, d'une part, et la discipline, l'extrême rationalité, l'extrême objectivité, c'est-à-dire un contrôle abstrait et absolu de l'activation totale de son être propre, d'autre part.
C'est ainsi, d'après Jünger, que déjà au cours de la première guerre mondiale, s'annonçait l'avènement d'une nouvelle «forme intérieure», et nous avons déjà eu l'occasion de dire qu'en elle, il voyait ce qui allait devenir décisif pour l'humanité en devenir, c'est-à-dire les culminations exceptionnelles, à l'image des extériorisations guerrières. La crise finale du monde bourgeois et de toutes les valeurs anciennes, pour Jünger, découle de la civilisation de la technique et de la machine, et de toutes les formes d'élémentarité qui leur sont consubstantielles. Et substantiellement identique serait le type d'homme qui, spirituellement, n'est pas le vaincu mais le vainqueur, que ce soit sur les champs de bataille modernes ou dans un monde absolument technicisé. Substantiellement identique serait le type de dépassement et de formation intérieure qui serait requis dans les deux cas. C'est ainsi que s'ébauche la figure de l'homme que Jünger nomme le “Travailleur”, qu'une continuité idéale unirait «au soldat vrai, invaincu, de la Grande Guerre».
Julius EVOLA.
(Chapitre extrait de L'«Operaio» nel pensiero di Ernst Jünger, éd. Volpe, Rome, 1974; trad. franç.: Robert Steuckers).
Julius EVOLA
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, lettres allemandes, allemagne, lettres, italie, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 17 septembre 2008
Citation de Chateaubriand
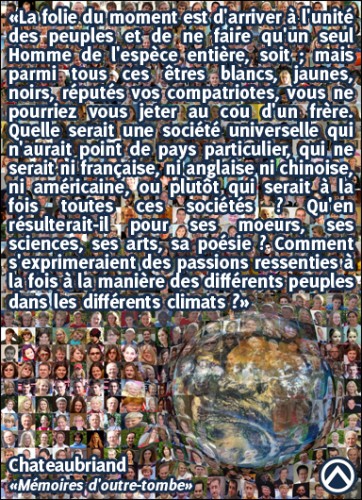
00:27 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature française, lettres françaises, contre-révolution, réaction, 19ème siècle, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
E. Jünger: 70 s'efface, IV

70 s'efface, IV
Karlheinz SCHAUDER
Il a largement dépassé le grand âge de Goethe: Ernst Jünger, le Patriarche de Wilflingen, vient de fêter ses 100 ans le 29 mars 1995. L'écrivain se sent comme l'Ahasver de la légende et s'étonne d'avoir atteint cet âge après toutes ses “tribulations”. Lui, l'auteur d'une œuvre exemplaire dans la littérature contemporaine, respectée par ses adversaires, remarque, à ce propos: «Depuis des années, l'âge avance, se place à l'avant-scène, se mue en une qualité que je n'avais pas prévue. Je suis frappé, comme toujours, par le nombre impressionnant de perspectives différentes par lesquelles je suis passé, depuis que je suis capable de penser. Cela a l'avantage de donner plus de poids à mes assertions, mais je n'en suis pas responsable».
Cette phrase se trouve dans le quatrième volume des Journaux qu'écrit Jünger depuis son 70ième anniversaire sous le titre de Siebzig verweht, traduit en français par Soixante-dix s'efface. Ce quatrième volume constitue, une fois de plus, une collection impressionnante de notules personnelles, rédigées entre janvier 1986 et décembre 1990. Avec les sens toujours en éveil, avec une force expressive intacte, Jünger enregistre ainsi toutes ses rencontres et ses conversations, ses lectures et ses réflexions. Une fois de plus, on est fasciné de voir comment cet écrivain et ce contemporain parvient à tirer l'essentiel d'une journée, à y goûter: «Parmi mes bonnes œuvres, il y a le fait que j'incite beaucoup de mes contemporains à tenir un journal. Quelle qu'en soit la teneur, il demeurera une prestation qui aura une valeur personnelle et documentaire. Ensuite, cette rédaction satisfait une pulsion: notre cheminement est balisé. Le sacré peut advenir; l'homme est seul avec lui-même. Il est bon qu'un Journal commence tôt dans la vie; mieux: qu'il se poursuive jusqu'à la fin, jusqu'à proximité de la mort».
En ce siècle, quelques écrivains et philosophes ont choisi d'écrire des notes quotidiennes, pour refléter leur temps et transmettre une pensée vraiment vivante. Ce sont particulièrement Léon Bloy et André Gide, Julien Green et Paul Léautaud qui ont veillé à ce que le Journal ne soit pas une simple habitude privée, mais un genre littéraire, permettant de communiquer des impressions ou des idées, créant un espace où l'on peut raconter et rêver. Chez Ernst Jünger également, les notes quotidiennes occupent une place essentielle dans l'œuvre complète. Lorsqu'il écrit ses Journaux, il ne néglige pas les autres formes de création littéraire, mais hisse tout simplement ses notes au rang d'une forme littéraire significative.
Dans ses notes de voyage et ses souvenirs, ses anecdotes et ses considérations, il s'exprime tout à la fois comme écrivain et comme penseur. Cette démarche n'autorise aucune dissipation ni aucun bavardage, comme c'est parfois le cas chez Thomas Mann. Les notes sont séparées par des dates ou des astérisques; souvent pendant plusieurs jours, voire pendant toute une semaine, on ne trouve rien. Sans nul doute, Jünger stylise et rédige ces notes pour qu'elles soient publiées ultérieurement. Il choisit et sélectionne celles qui lui paraissent les plus significatives, les plus chargées de sens, les plus précieuses. Ce qu'il veut communiquer est dit avec précision et concision. Certes, ces qualités-là ôtent quelque lambeaux de spontanéité et d'authenticité à l'écriture immédiate. La construction des phrases est objective et distanciée, souvent certains thèmes s'y répètent, ou un ton docte s'y insinue.
Les impressions de l'environnement le plus proche, du paysage des alentours de Wilflingen occupent un vaste espace dans ces annotations. Le très vieil écrivain vit intensément au rythme de la nature, note les observations qu'il glâne dans son jardin ou au cours de ses promenades. Il consigne les transformations saisonnières que subissent plantes et animaux, s'occupe d'ornithologie et de botanique, et surtout d'entomologie. Jünger est d'ailleurs devenu un entomologiste célèbre qui s'est fait un nom dans l'univers scientifique, si bien que quelques espèces portent son nom. C'est avec joie qu'il commente les envois d'insectes que des amis du monde entier lui expédient. C'est pour se livrer aux «chasses subtiles» que le nonagénaire entreprend encore de longs voyages vers les pays exotiques: en Malaisie par exemple où il a pu observer la comète de Halley qu'il avait vu pour la première fois il y a 76 ans avec ses parents, ses frères et ses sœurs; enfin, à Sumatra, dans les Seychelles et à l'Ile Maurice.
L'envie de voyager de l'écrivain, sa curiosité envers le monde, sont demeurées intactes. Sans cesse, il prend des vacances en compagnie de sa femme Liselotte, qu'il appelle affectueusement «Petit Taureau», et séjourne dans les pays européens, où il visite les bouquinistes et flâne dans les musées. Ou il circule en France, est reçu par les Chevaliers du Taste-Vin, visite en compagnie de Rolf Hochhuth les grottes de Lascaux et revient, en bout de course, dans l'appartement de Paris. L'octroi de prix ou de doctorats honoris causa le conduit à Palerme, à Rome ou à Bilbao, ce qui lui rappelle de nombreux souvenirs, ravive en lui des impressions anciennes. Jünger rencontre à Berne ou à Munich des amis et des collègues, participe aux jubilés et aux fêtes villageoises de Wilflingen. Dans la gestion quasi ménagère de son œuvre, Jünger consigne dans ses Journaux le meilleur de son courrier et les messages de remerciement. En dépit de tous les honneurs qu'on lui accorde, il conserve une distance par rapport à la gloire: «Les étapes de la gloire et leur mi-temps: depuis le moment où l'on arrive dans le dictionnaire jusqu'au moment où on en est radié. Un chapitre en soi: le rapport entre la gloire et l'après-gloire, riche en déceptions et en surprises, sans intérêt pour la personne concernée».
Outre les impressions de voyage, l'auteur honore les moments qu'il a vécu avec ses contemporains et ses compagnons de route: il nous évoque ainsi une visite du dramaturge allemand Heiner Müller, une virée avec Ionesco, une correspondance avec Wolf Jobst Siedler ou avec Rainer Hackel, d'anciennes rencontres avec Ernst Niekisch et Ernst von Salomon, des souvenirs d'Alfred Kubin et de Valeriu Marcu. Le nonagénaire relit ses anciennes lettres, se souvient de son père, de sa première femme, se rappelle avec chagrin de son frère Friedrich Georg, qui, lui aussi, fut un grand écrivain, et avec douleur de son fils Ernstel, tombé au champ d'honneur en Italie pendant la seconde guerre mondiale. Quand Jünger rumine tous ses souvenirs douloureux, il ne pense presque jamais à sa propre mort, mais surtout à la présence des disparus. Les défunts sont tout particulièrement présents dans les rêves du vieil homme.
Jünger accorde aux rêves une grande importance: ce n'est d'ailleurs pas un hasard si ce quatrième volume de Soixante-Dix s'efface commence et se termine par la description d'un rêve. Dans un cas précis, Jünger raconte pendant quatorze pages en détails et avec minutie une de ses visions nocturnes. A côté du monde bizarre des rêves, il nous décrit une manifestation de l'inconscient, qu'il désigne comme “troisième voie”. Les Journaux offrent ainsi matière à réflechir pour les psychanalystes. Pour les jeux et joutes d'idées pendant l'éveil, la lecture est indispensable; on ne peut y renoncer et Jünger écrit: «Même si la journée d'hier a été fatigante, j'ai encore lu, la nuit tombée, quelques pages du Journal de Renard. Je ne peux imaginer un jour sans lecture et je me demande souvent si, au fond, je n'ai pas vécu la vie d'un lecteur. Le monde des livres serait ainsi le monde réel, et le vécu n'en serait que la confirmation —et cet espoir serait toujours déçu. Ce qui pourrait avoir pour effet que les auteurs présentent la matière sur un plan supérieur et que cette matière s'inscrusterait mieux que le tissu des hasards biographiques. Nous ne voyons que le dos du gobelin. Voilà pourquoi je m'y retrouve mieux dans un bon roman que dans ma propre biographie».
Jünger se préoccupe ensuite, dans ce quatrième volume de Soixante-Dix s'efface, des célèbres cas juridiques de Pitaval, se penche encore sur Montaigne, Léon Bloy et Léautaud, relit les œuvres de Tourgueniev, Dostoïevski et Tolstoï. Il note encore le texte d'antiques sagesses d'Egypte, des proverbes chinois dans ses chroniques quotidiennes et fait référence à des versets de l'Ancien et du Nouveau Testament. Pour ce qui concerne la littérature contemporaine, il a été séduit par un roman de Gabriel Garcia Márquez et sait apprécier les poèmes de Helena Paz, la fille d'Octavio Paz.
En guise d'anticipation à la publication prochaine de sa correspondance, Jünger reprend de nombreux extraits de lettres dans son Journal. Il cite des parties de lettres qui lui ont été adressées, note des salutations originales issues de cartes postales, nous révèle des réponses à ses traducteurs Henri Plard et Pierre Morel, qu'il consulte toujours en cas de litige. Avec des remarques bien étayées, il commente la préface qu'a rédigée Julien Hervier pour l'édition française du Travailleur, ou il reproduit le texte d'un interview téléphoné qu'il a accordé au Figaro. Il nous parle du travail qu'il a effectué dans le texte des Ciseaux, où il tente de nous léguer une théodicée, et introduit dans son Journal un passage qu'il a ôté du texte définitif. Il s'occupe de subtilités grammaticales et stylistiques avec une telle intensité que cette précision lui apparaît comme un phénomène de vieillissement! Autrement, il n'a que de petits tracas, constate-t-il: le principal, c'est qu'ils ne se répercutent pas sur sa prose.
En tant qu'anarque —c'est ainsi qu'il s'“auto-désigne”— il a l'impression de vivre davantage dans les livres que dans “notre misérable réalité”. Les rencontres immédiates avec la réalité, avec les événements politiques et culturels, sont quasiment absentes de cette partie du Journal, elles ne sont pas transposées dans l'écriture. Ainsi, les visites répétées à Wilflingen du Chancelier fédéral et du Président Mitterrand ou du Premier Ministre espagnol Gonzales. Ainsi, ses vols en hélicoptère vers Bonn, à l'invitation du Chancelier ou sa participation aux fêtes du jubilé du Traité d'amitié franco-allemand à Paris. Quand on a dépassé 100 ans, les événements du jour n'ont plus trop d'importance, car on a déjà vécu tout et le contraire de tout. Pourtant, deux événements l'ont touché: la fête en l'honneur de son 95ième anniversaire dans le Neuer Schloß de Stuttgart et le nuit de la réunification allemande en novembre 1989.
Le Journal de Jünger n'est nullement un “journal intime”, qui, en première instance, sert à exprimer les sentiments du moi qui écrit. Tout, dans les notices de ce Journal, semble être parfaitement maîtrisé, soupesé; la prose admirablement ciselée de ce monologue mis en écriture montre que le Journal de Jünger, en fait, est un moyen de prendre distance et non pas de rester trop proche du vécu. Il s'agit des visions et des expériences d'un homme qui, sans mélancolie, se meut dans la sphère du très grand âge, avec froideur, comme s'il n'était pas concerné. La propre vie et la propre œuvre de l'auteur lui servent à relier et à rapprocher les événements immédiats et lointains, le proche et l'éloigné, le rêve et l'imprimé. Les remarques philosophiques, culturelles, sociologiques et critiques de Jünger, les idées qu'il exprime sur l'histoire et la civilisation ne sont nullement des plaintes pessimistes. Il se borne à enregistrer les évolutions et les bouleversements, il décrit la destruction de la nature due à l'avancée de la technique. Sur notre situation globale, il écrit: «Ce que notre situation a de particulier et peut-être d'unique, c'est que nous sommes plongés non pas seulement dans une révolution mondiale mais aussi et surtout dans une révolution tellurique. Ainsi culmine la résistance qui s'oppose tant à l'artiste qu'au philosophe. Leur œuvre sera soit insuffisante soit provisoire. L'insuffisant sera détruit par les événements, mais le provisoire pourra se révéler si significatif que les événements ne le rattraperont pas».
Malgré des observations contrariantes et des détails effrayants, Jünger cherche la loi secrète, l'ordre caché, qui régit tout cela. Qu'il formule des observations sur une couleur ou sur une spirale, qu'il examine un insecte ou décrit une floraison, il s'efforcera toujours de déchiffrer l'«écriture imagée immédiate», de se rapprocher de la plénitude et de l'harmonie du tout cosmique. Il demeure animé par une volonté inconditionnelle de sens et ne se montrera jamais prêt à abandonner la foi en ce sens. Un jour, il s'est demandé: «Qu'est-ce qui est le plus important pour un écrivain? La redécouverte de l'impassable dans le temps passé: l'Etre dans l'existence».
Pour Jünger, l'écrivain est une personne morale qui s'est extraite de la quotidienneté sociale, qui, par la force de son imagination, peut reconnaître les rapports entre les choses. Ce quatrième volume de Soixante-Dix s'efface est lui aussi un outil idéal et sublime pour pénétrer, avec son «regard stéréoscopique», dans le monde pour le révéler, pour pénétrer dans sa pensée qui est un “voir” dans l'espace et dans les profondeurs. Cette collection de notices et de témoignages, de souvenirs et de lettres est un document littéraire de tout premier rang, une chambre aux trésors où l'on trouve les plans et les analyses les plus fines sur notre temps. Une lecture indispensable, captivante, fécondante.
Karlheinz SCHAUDER.
(recension tirée de Criticón, n°146/1995; adresse: Criticón Verlag, Knöbelstrasse 36/0, D-80.538 München; abonnement: DM 64; étudiants: DM 42; trad. franç. : Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres allemandes, lettres, allemagne, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 septembre 2008
Réflexions sur la figure esthétique et littéraire du dandy

Réflexions sur la figure esthétique et littéraire du “dandy”
Intervention de Robert Steuckers au séminaire de “SYNERGON-Deutschland”, Basse-Saxe, 6 mai 2001
Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais formuler trois remarques préliminaires:
◊ 1. J’ai hésité à accepter votre invitation à parler de la figure du dandy, car ce type de problématique n’est pas mon sujet de préoccupation privilégié.
◊ 2. J’ai finalement accepté parce que j’ai redécouvert un essai aussi magistral que clair d’Otto Mann, paru en Allemagne il y de nombreuses années (i. e. : Dandysmus als konservative Lebensform) (*). Cet essai mériterait d’être à nouveau réédité, avec de bons commentaires.
◊ 3. Ma troisième remarque est d’ordre méthodologique et définitionnel. Avant de parler du “dandy”, et de rappeler à ce sujet l’excellent travail d’Otto Mann, il faut énumérer les différentes définitions du “dandy”, qui ont cours, et qui sont contradictoires. Ces définitions sont pour la plupart erronées, ou superficielles et insuffisantes. D’aucuns définissent le dandy comme un “pur phénomène de mode”, comme un personnage élégant, sans plus, soucieux de se vêtir selon les dernières modes vestimentaires. D’autres le définissent comme un personnage superficiel, qui aime la belle vie et pérégrine, oisif, de cabaret en cabaret. Françoise Dolto avait brossé un tableau psychologique du dandy. D’autres encore soulignent, quasi exclusivement, la dimension homosexuelle de certains dandies, tel Oscar Wilde. Plus rarement on assimile le dandy à une sorte d’avatar de Don Juan, qui meuble son ennui en collectionnant les conquêtes féminines. Ces définitions ne sont pas celles d’Otto Mann, que nous faisons nôtres.
L’archétype: George Bryan Brummell
Notre perspective, à la suite de l’essai d’Otto Mann, est d’attribuer au dandy une dimension culturelle plus profonde que toutes ses superficialités “modieuses”, épicuriennes, hédonistes, homosexuelles ou donjuanesques. Pour Otto Mann, le modèle, l’archétype du dandy, reste George Bryan Brummell, figure du début du 19ième siècle qui demeurait équilibrée. Brummell, contrairement à certains pseudo-dandies ultérieurs, est un homme discret, qui ne cherche pas à se faire remarquer par des excentricités vestimentaires ou comportementales. Brummell évite les couleurs criardes, ne porte pas de bijoux, ne se livre pas à des jeux sociaux de pur artifice. Brummell est distant, sérieux, digne; il n’essaie pas de faire de l’effet, comme le feront, plus tard, des figures aussi différentes qu’Oscar Wilde, que Stefan George ou Henry de Montherlant. Chez lui, les tendances spirituelles dominent. Brummell entretient la société, raconte, narre, manie l’ironie et même la moquerie. Pour parler comme Nietzsche ou Heidegger, nous dirions qu’il se hisse au-dessus de l’«humain, trop humain» ou de la banalité quotidienne (Alltäglichkeit).
Brummell, dandy de la première génération, incarne une forme culturelle, une façon d’être, que notre société contemporaine devrait accepter comme valable, voire comme seule valable, mais qu’elle ne génère plus, ou plus suffisamment. Raison pour laquelle le dandy s’oppose à cette société. Les principaux motifs qui sous-tendent son opposition sont les suivants : 1) la société apparaît comme superficielle et marquée de lacunes et d’insuffisances; 2) le dandy, en tant que forme culturelle, qu’incarnation d’une façon d’être, se pose comme supérieur à cette société lacunaire et médiocre; 3) le dandy à la Brummell ne commet aucun acte exagéré, ne commet aucun scandale (par exemple de nature sexuelle), ne commet pas de crime, n’a pas d’engagement politique (contrairement aux dandies de la deuxième génération comme un Lord Byron). Brummell lui-même ne gardera pas cette attitude jusqu’à la fin de ses jours, car il sera criblé de dettes, mourra misérablement à Caen dans un hospice. Il avait, à un certain moment, tourné le dos au fragile équilibre que réclame la posture initiale du dandy, qu’il avait été le premier à incarner.
Un idéal de culture, d’équilibre et d’excellence
S’il n’y a dans son comportement et sa façon d’être aucune exagération, aucune originalité flamboyante, pourquoi la figure du dandy nous apparaît-elle quand même importante, du moins intéressante? Parce qu’elle incarne un idéal, qui est en quelque sorte, mutatis mutandis, celui de la paiedeia grecque ou de l’humanitas romaine. Chez Evola et chez Jünger, nous avons la nostalgie de la magnanimitas latine, de l’hochmüote des chevaliers germaniques des 12ième et 13ième siècles, avatars romains ou médiévaux d’un modèle proto-historique perse, mis en exergue par Gobineau d’abord, par Henry Corbin ensuite. Le dandy est l’incarnation de cet idéal de culture, d’équilibre et d’excellence dans une période plus triviale de l’histoire, où le bourgeois calculateur et inculte, et l’énergumène militant, de type hébertiste ou jacobin, a pris le pas sur l’aristocrate, le chevalier, le moine et le paysan.
A la fin du 18ième siècle, avec la révolution française, ces vertus, issues du plus vieux fond proto-historique de l’humanité européenne, sont complètement remises en question. D’abord par l’idéologie des Lumières et son corrolaire, l’égalitarisme militant, qui veut effacer toutes les traces visibles et invisibles de cet idéal d’excellence. Ensuite, par le Sturm und Drang et le romantisme, qui, par réaction, basculent parfois dans un sentimentalisme incapacitant, parce qu’expression, lui aussi, d’un déséquilibre. Les modèles immémoriaux, parfois estompés et diffus, les attitudes archétypales survivantes disparaissent. C’est en Angleterre qu’on en prend conscience très vite, dès la fin du 17ième, avant même les grands bouleversements de la fin du 18ième : Addison et Steele dans les colonnes du Spectator et du Tatler, constatent qu’il est nécessaire et urgent de conserver et de maintenir un système d’éducation, une culture générale, capables de garantir l’autonomie de l’homme. Une valeur que les médias actuels ne promeuvent pas, preuve discrète que nous avons bel et bien sombré dans un monde orwellien, qui se donne un visage de “bon apôtre démocratique”, inoffensif et “tolérant”, mais traque impitoyablement toutes les espaces et résidus d’autonomie de nos contemporains. Addison et Steele, dans leurs articles successifs, nous ont légué une vision implicite de l’histoire culturelle et intellectuelle de l’Europe.
L’idéal de Goethe
Le plus haut idéal culturel que l’Europe ait connu est bien entendu celui de la paideia grecque antique. Elle a été réduite à néant par le christianisme primitif, mais, dès le 14ième siècle, on sent, dans toute l’Europe, une volonté de faire renaître les idéaux antiques. Le dandy, et, bien avant son émergence dans le paysage culturel européen, les deux journalistes anglais Steele et Addison, entendent incarner cette nostalgie de la paideia, où l’autonomie de chacun est respectée. Ils tentent en fait de réaliser concrètement dans la société l’objectif de Goethe: inciter leurs contemporains à se forger et se façonner une personnalité, qui sera modérée dans ses besoins, satisfaite de peu, mais surtout capable, par cette ascèse tranquille, d’accéder à l’universel, d’être un modèle pour tous, sans trahir son humus originel (Ausbildung seiner selbst zur universalen und selbstgenugsamen Persönlichkeit). Cet idéal goethéen, partagée anticipativement par les deux publicistes anglais puis incarné par Brummell, n’est pas passé après les vicissitudes de la révolution française, de la révolution industrielle et des révolutions scientifiques de tous acabits. Sous les coups de cette modernité, irrespectueuse des Anciens, l’Europe se retrouve privée de toute culture substantielle, de toute épine dorsale éthique. On en mesure pleinement les conséquences aujourd’hui, avec la déliquescence de l’enseignement.
A partir de 1789, et tout au long du 19ième siècle, le niveau culturel ne cesse de s’effondrer. Le déclin culturel commence au sommet de la pyramide sociale, désormais occupé par la bourgeoisie triomphante qui, contrairement aux classes dominantes des époques antérieures, n’a pas d’assise morale (sittlich) valable pour maintenir un dégré élevé de civilisation; elle n’a pas de fondement religieux, ni de réelle éthique professionnelle, contrairement aux artisans et aux gens de métier, jadis encadrés dans leurs gildes ou corporations (Zünfte). La seule réalisation de cette bourgeoisie est l’accumulation méprisable de numéraire, ce qui nous permet de parler, comme René Guénon, d’un “règne de la quantité”, d’où est bannie toute qualité. Dans les classes défavorisées, au bas de l’échelle sociale, tout élément de culture est éradiqué, tout simplement parce que chez les pseudo-élites, il n’y a déjà plus de modèle culturel; le peuple, aliéné, précarisé, prolétarisé, n’est plus une matrice de valeurs précises, ethniquement déterminées, du moins une matrice capable de générer une contre-culture offensive, qui réduirait rapidement à néant ce que Thomas Carlyle appelait la “cash flow mentality”. En conclusion, nous assistons au déploiement d’une barbarie nantie, à haut niveau économique (eine ökonomisch gehobene Barbarei), mais à niveau culturel nul. On ne peut pas être riche à la mode du bourgeois et, simultanément, raffiné et intelligent. Cette une vérité patente : personne de cultivé n’a envie de se retrouver à table, ou dans un salon, avec des milliardaires de la trempe d’un Bill Gates ou d’un Albert Frère, ni avec un banquier ou un fabricant de moteurs d’automobile ou de frigidaires. Le véritable homme d’esprit, qui se serait égaré dans le voisinage de tels sinistres personnages, devrait sans cesse réprimer des baillements en subissant le vomissement continu de leurs bavardages ineptes, ou, pour ceux qui ont le tempérament plus volcanique, réprimer l’envie d’écraser une assiette bien grasse, ou une tarte à la façon du Gloupier, sur le faciès blet de ces nullités. Le monde serait plus pur —et sûrement plus beau— sans la présence de telles créatures.
La mission de l’artiste selon Baudelaire
Pour le dandy, il faut réinjecter de l’esthétique dans cette barbarie. En Angleterre, John Ruskin (1819-1899), les Pré-Réphaélites avec Dante Gabriel Rossetti et William Morris, vont s’y employer. Ruskin élaborera des projets architecturaux, destinés à embellir les villes enlaidies par l’industrialisation anarchique de l’époque manchesterienne, qui déboucheront notamment sur la construction de “cités-jardins” (Garden Cities). Les architectes belges et allemands de l’Art Nouveau ou Jugendstil, dont Henry Vandervelde et Victor Horta, prendront le relais. A côté de ces réalisations concrètes —parce que l’architecture permet plus aisément de passer au concret— le fossé ne cesse de se creuser entre l’artiste et la société. Le dandy se rapproche de l’artiste. En France, Baudelaire pose, dans ses écrits théoriques, l’artiste comme le nouvel “aristocrate”, dont l’attitude doit être empreinte de froideur distante, dont les sentiments ne doivent jamais s’exciter ni s’irriter outre mesure, dont l’ironie doit être la qualité principale, de même que la capacité à raconter des anecdotes plaisantes. Le dandy artiste prend ses distances par rapport à tous les dadas conventionnels et habituels de la société. Ces positions de Baudelaire se résument dans les paroles d’un personnage d’Ernst Jünger, dans le roman Héliopolis : «Je suis devenu le dandy, qui prend pour important ce qui ne l’est pas, qui se moque de ce qui est important » («Ich wurde zum Dandy, der das Unwichtige wichtig nahm, das Wichtige belächelte»). Le dandy de Baudelaire, à l’instar de Brummell, n’est donc pas un personnage scandaleux et sulfureux à la Oscar Wilde, mais un observateur froid (ou, pour paraphraser Raymond Aron, un “spectateur désengagé”), qui voit le monde comme un simple théâtre, souvent insipide où des personnages sans réelle substance s’agitent et gesticulent. Le dandy baudelérien a quelque peu le goût de la provocation, mais celle-ci reste cantonnée, dans la plupart des cas, à l’ironie.
Les exagérations ultérieures, souvent considérées à tort comme expressions du dandysme, ne correspondent pas aux attitudes de Brummell, Baudelaire ou Jünger. Ainsi, un Stefan George, malgré le grand intérêt de son œuvre poétique, pousse l’esthétisme trop loin, à notre avis, pour verser dans ce qu’Otto Mann appelle l’«esthéticisme», caricature de toute véritable esthétique.Pour Stefan George, c’est un peu la rançon à payer à une époque où la “perte de tout juste milieu” devient la règle (Hans Sedlmayr a explicité clairement dans un livre célèbre sur l’art contemporain, Verlust der Mitte, cette perte du “juste milieu”). Sedlmayr mettait clairement en exergue cette volonté de rechercher le “piquant”. Stefan George le trouvera dans ses mises en scène néo-antiques. Oscar Wilde ne mettra rien d’autre en scène que lui-même, en se proclamant “réformateur esthétique”. L’art, dans sa perspective, n’est plus un espace de contestation destiné à investir totalement, à terme, le réel social, mais devient le seule réalité vraie. La sphère économique, sociale et politique se retrouve dévalorisée; Wilde lui dénie toute substantialité, réalité, concrétude. Si Brummell conservait un goût tout de sobriété, s’il gardait la tête sur les épaules, Oscar Wilde se posait d’emblée comme un demi-dieu, portait des vêtements extravagants, aux couleurs criardes, un peu comme les Incroyables et les Merveilleuses au temps de la révolution française. Provocateur, il a aussi amorcé un processus de mauvaise “féminisation/dévirilisation”, en se promenant dans les rues avec des fleurs à la main. A l’heure des actuelles “gay prides”, on peut le considérer comme un précurseur. Ses poses constituent tout un théâtre, assez éloigné, finalement, de ce sentiment tranquille de supériorité, de dignité virile, de “nil admirari”, du premier Brummell.
Auto-satisfaction et sur-dimensionnement du “moi”
Pour Otto Mann, cette citation de Wilde est emblématique : « Les dieux m’ont presque tout donné. J’avais du génie, un nom illustre, une position sociale élevée, la gloire, l’éclat, l’audace intellectuelle ; j’ai fait de l’art une philosophie et de la philosophie un art; j’ai appris aux hommes à penser autrement et j’ai donné aux choses d’autres couleurs... Tout ce que j’ai touché s’est drapé dans de nouveaux effets de beauté; à la vérité, je me suis attribué, à juste titre, le faux comme domaine et j’ai démontré que le faux, tout comme le vrai, n’est qu’une simple forme d’existence postulée par l’intellect. J’ai traité l’art comme la vérité suprême, et la vie comme une branche de la poésie et de la littérature. J’ai éveillé la fantaisie en mon siècle, si bien qu’il a créé, autour de moi, des mythes et des légendes. J’ai résumé tous les systèmes philosophiques en un seul épigramme. Et à côté de tout cela, j’avais encore d’autres atouts». L’auto-satisfaction, le sur-dimensionnement du “moi” sont patents, vont jusqu’à la mystification.
Ces exagérations iront croissant, même dans l’orbite de cette virilité stoïque, chère à Montherlant. Celui-ci, à son tour, exagère dans les poses qu’il prend, en pratiquant une tauromachie fort ostentatoire ou en se faisant photographier, paré du masque d’un empereur romain. Le risque est de voir des adeptes minables verser dans un “lookisme” tapageur et de mauvais goût, de formaliser à l’extrême ces attitudes ou ces postures du poète ou de l’écrivain. En aucun cas, elles n’apportent une solution au phénomène de la décadence. En matière de dandysme, la seule issue est de revenir calmement à Brummell lui-même, avant qu’il ne sombre dans les déboires financiers. Car ce retour au premier Brummell équivaut, si l’on se souvient des exhortations antérieures d’Addison et Steele, à une forme plus moderne, plus civile et peut-être plus triviale de paideia ou d’humanitas. Mais, trivialité ou non, ces valeurs seraient ainsi maintenues, continueraient à exister et à façonner les esprits. Ce mixte de bon sens et d’esthétique dandy permettrait de dégager un objectif politique pratique : défendre l’école au sens classique du terme, augmenter sa capacité à transmettreles legs de l’antiquité hellénique et romaine, prévoir une pédagogie nouvelle et efficace, qui serait un mixte d’idéalisme à la Schiller, de méthodes traditionnelles et de méthodes inspirées par Pestalozzi.
Retour à la religion ou “conscience malheureuse”?
La figure du dandy doit donc être replacée dans le contexte du 18ième siècle, où les idéaux et les modèles classiques de l’Europe traditionnelle s’érodent et disparaissent sous les coups d’une modernité équarissante et arasante. Les substances religieuses, chrétiennes ou pré-chrétiennes sous vernis chrétien, se vident et s’épuisent. Les Modernes prennent le pas sur les Anciens. Ce processus conduit forcément à une crise existentielle au sein de l’écoumène civilisationnel européen. Deux pistes s’offrent à ceux qui tentent d’échapper à ce triste destin : 1) Le retour à la religion, ou à la tradition, piste importante mais qui n’est pas notre propos aujourd’hui, tant elle représente un continent de la pensée, fort vaste, méritant un séminaire complet à elle seule. 2) Cultiver ce que les romantiques appelaient la Weltschmerz, la douleur que suscitait ce monde désenchanté, ce qui revient à camper sur une position critique permanente à l’endroit des manifestations de la modernité, à développer une conscience malheureuse, génératrice d’une culture volontairement en marge, mais où l’esprit politiquepeut puiser des thématiques offensives et contestatrices.
Pour le dandy et le romantique, qui oscille entre le retour à la religion et le sentiment de Weltschmerz, cette dernière est surtout ressentie de l’intérieur. C’est dans l’intériorité du poète ou de l’artiste que ce sentiment va mûrir, s’accroître, se développer. Jusqu’au point de devenir dur, de dompter le regard et d’éviter ainsi les langueurs ou les colères suscitées par la conscience malheureuse. En bout de course, le dandy doit devenir un observateur froid et impartial, qui a dominé ses sentiments et ses émotions. Si le sang a bouillonné face aux “horreurs économiques”, il doit rapidement se refroidir, conduire à l’impassibilité, pour pouvoir les affronter efficacement. Le dandy, qui a subi ce processus, atteint ainsi une double impassibilité : rien d’extérieur ne peut plus l’ébranler; mais aucune émotion intérieure non plus. Pierre Drieu La Rochelle ne parviendra jamais à un tel équilibre, ce qui donne une touche très particulière et très séduisante à son œuvre, tout simplement parce qu’elle nous dévoile ce processus, en train de se réaliser, vaille que vaille, avec des ressacs, des enlisements et des avancées. Drieu souffre du monde, s’essaie aux avant-gardes, est séduit par la discipline et les aspects “métalliques” du fascisme “immense et rouge”, en marche à son époque, accepte mentalement la même discipline chez les communistes et les staliniens, mais n’arrive pas vraiment à devenir un “observateur froid et impartial” (Benjamin Constant). L’œuvre de Drieu La Rochelle est justement immortelle parce qu’elle révèle cette tension permanente, cette crainte de retomber dans les ornières d’une émotion inféconde, cette joie de voir des sorties vigoureuses hors des torpeurs modernes, comme le fascisme, ou la gouaille d’un Doriot.
Blinder le mental et le caractère
En résumé, le processus de deconstruction des idéaux de la paideia antique, et de déliquescence des substantialités religieuses immémoriales, qui s’amorce à la fin du 18ième siècle, équivaut à une crise existentielle généralisée à tous les pays occidentaux. La réponse de l’intelligence à cette crise est double : ou bien elle appelle un retour à la religion ou bien elle suscite, au fond des âmes, une douleur profondément ancrée, la fameuse Weltschmerz des romantiques. La Weltschmerz se ressent dans l’intériorité profonde de l’homme qui fait face à cette crise, mais c’est aussi dans son intériorité qu’il travaille silencieusement à dépasser cette douleur, à en faire le matériel premier pour forger la réponse et l’alternative à cette épouvantable déperdition de substantialité, surplombée par un économicisme délétère. Il faut donc se blinder le mental et le caractère, face aux affres qu’implique la déperdition de substantialité, sans pour autant inventer de toutes pièces des Ersätze plus ou moins boîteux à la substantialité de jadis. Baudelaire et Wilde pensent, tous deux à leur manière, que l’art va offrir une alternative, plus souple et plus mouvante que les anciennes substantialités, ce qui est quasiment exact sur toute la ligne, mais, dans ce cas, l’art ne doit pas être entendu comme simple esthétisme. Le blindage du mental et du caractère doit servir, in fine, à combattre l’économicisme ambiant, à lutter contre ceux qui l’incarnent, l’acceptent et mettent leurs énergies à son service. Ce blindage doit servir de socle moral et psychologique dur aux idéaux de combat politique et métapolique. Ce blindage doit être la carapace de ce qu’Evola appelait l’«homme différencié», celui qui “chevauche le tigre”, qui erre, imperturbé et imperturbable, “au milieu des ruines”, ou que Jünger désignait sous le vocable d’«anarque». “L’homme différencié qui chevauche le tigre au milieu des ruines” ou “l’anarque” sont posés d’emblée comme des observateurs froids, impartiaux, impassibles. Ces hommes différenciés, blindés, se sont hissés au-dessus de deux catégories d’obstacles : les obstacles extérieurs et les obstacles générés par leur propre intériorité. C’est-à-dire les barrages dressés par les “hommes de moindre valeur” et les alanguissements de l’âme en détresse.
Figures tchandaliennes de la décadence
La crise existentielle, qui débute vers le milieu du 18ième siècle, débouche donc sur un nihilisme, très judicieusement défini par Nietzsche comme un “épuisement de la vie”, comme “une dévalorisation des plus hautes valeurs”, qui s’exprime souvent par une agitation frénétique sans capacité de jouir royalement de l’otium, agitation qui accélère le processus d’épuisement. La mise en schémas de l’existence est l’indice patent que nos “sociétés”ne forment plus des “corps”, mais constituent, dit Nietzsche, des “conglomérats de Tchandalas”, chez qui s’accumulent les maladies nerveuses et psychiques, signe que la puissance défensive des fortes natures n’est plus qu’un souvenir. C’est justement cette “puissance défensive” que l’homme “différencié” doit, au bout de sa démarche, de sa quête dans les arcanes des traditions, reconstituer en lui. Nietzsche énumère très clairement les vices du Tchandala, figure emblématique de la décadence européenne, issue de la crise existentielle et du nihilisme: le Tchandala est affecté de pathologies diverses, sur fond d’une augmentation de la criminalité, de célibat généralisée et de stérilité voulue, d’hystérie, d’affaiblissement constant de la volonté, d’alcoolisme (et de toxicomanies diverses ajouterions-nous), de doute systématique, d’une destruction méthodique et acharnée des résidus de force. Parmi les figures tchandaliennes de cette décadence et de ce nihilisme, Nietzsche compte ceux qu’il appelle les “nomades étatiques” (Staatsnomaden) que sont les fonctionnaires, sans patrie réelle, serviteurs du “monstre froid”, au mental mis en schémas et, subséquemment, générateurs de toujours davantage de schémas, dont l’existence parasitaire engendre, par leur effroyable pesanteur en progression constante, le déclin des familles, dans un environnement fait de diversités contradictoires et émiettées, où l’on trouve
- le “disciplinage” (Züchtung) des caractères pour servir les abstractions du monstre froid,
- la lubricité généralisée comme forme de nervosité et comme expression d’un besoin insatiable et compensatoire de stimuli et d’excitations,
- les névroses en tous genres,
- les fascinations morbides pour les mécanismes et pour les enchaînements, limités, de sèches causalités sans levain,
- le présentisme politique (Augenblickdienerei) où ne dominent plus, souverainement, ni longue mémoire ni perspectives profondes ni sens naturel et instinctif du bon droit,
- le sensibilisme pathologique,
- les doutes inféconds procédant d’un effroi morbide face aux forces impassables qui ont fait et feront encore l’histoire-puissance,
- une peur d’arraisonner le réel, de saisir les choses tangibles de ce monde.
Victor Segalen en Océanie, Ernst Jünger en Afrique
Dans ce complexe de froideur, d’immobilisme agité, de frénésies infécondes, de névroses, une première réponse au nihilisme est d’exalter et de concrétiser le principe de l’aventure, où le contestataire quittera le monde bourgeois tissé d’artifices, pour s’en aller vers des espaces vierges, intacts, authentiques, ouverts, mystérieux. Gauguin part pour les îles du Pacifique. Victor Segalen, à sa suite, chante l’Océanie primordiale et la Chine impériale qui se meurt sous les coups de l’occidentalisme. Segalen demeure breton, opère ce qu’il appelait le “retour à l’os ancestral”, dénonce l’envahissement de Tahiti par les “romances américaines”, ces “parasites immondes”, rédige un “Essai sur l’exotisme” et “Une esthétique du divers”. Le rejet des brics et brocs sans passé profond ont valu à Segalen un ostracisme injustifié dans sa patrie : il reste un auteur à redécouvrir, dans la perspective qui est nôtre.
Le jeune Jünger, encore adolescent, rêve de l’Afrique, du continent où vivent les éléphants et d’autres animaux fabuleux, où les espaces et les paysages ne sont pas meurtris par l’industrialisation, où la nature et les peuples indigènes ont conservé une formidable virginité, permettant encore tous les possibles. Le jeune Jünger s’engage dans la Légion Etrangère pour concrétiser ce rêve, pour pouvoir débarquer dans ce continent nouveau, perclus de mystères et de vitalité. 1914 lui donnera, à lui et à toute sa génération, l’occasion de sortir d’une existence alanguissante. Dans la même veine, Drieu La Rochelle parlera de l’élan de Charleroi. Et plus tard, Malraux, de “Voie Royale”. A “gauche” (pour autant que cette dichotomie politicienne ait un sens), on parlera plutôt d’ “engagement”, où ce même enthousiasme se retrouvera surtout lors de la Guerre d’Espagne, où Hemingway, Orwell, Koestler, Simone Weil s’engageront dans le camp des Républicains, et Campbell dans le camp des Nationalistes, qui fut aussi, comme on le sait, chanté par Robert Brasillach. L’aventure et l’engagement, dans l’uniforme du soldat ou des milices phalangistes, dans les rangs des brigades internationales ou des partisans, sont perçus comme antidotes à l’hyperformalisme d’une vie civile sans couleurs. “I was tired of civilian life, therefore I joined the IRA”), est-il dit dans un chant nationaliste irlandais, qui, dans son contexte particulier, proclame, avec une musique primesautière, cette grande envolée existentialiste du début du 20ième siècle avec toute la désinvolture, la verdeur, le rythme et la gouaille de la Verte Eirinn.
Ivresses? Drogues? Amoralisme?
Mais si l’engagement politique ou militaire procure, à ceux que le formalisme d’une vie civile, sans plus aucun relief ni équilibre traditionnel, ennuie, le supplément d’âme recherché, le rejet de tout formalisme peut conduire à d’autres attitudes, moins positives. Le dandy, qui quitte la pose équilibrée de Brummell ou la critique bien ciselée de Baudelaire, va vouloir expérimenter toujours davantage d’excitations, pour le seul plaisir stérile d’en éprouver. La drogue, la toxicomanie, la consommation exagérée d’alcools vont constituer des échappatoires possibles: la figure romanesque créée par Huysmans, Des Esseintes, fuira dans les liqueurs. Thomas De Quincey évoquera les “mangeurs d’opium” (“The Opiumeaters”). Baudelaire lui-même goûtera l’opium et le haschisch. Ce basculement dans les toxicomanies s’explique par la fermeture du monde, après la colonisation de l’Afrique et d’autres espaces jugés vierges; l’aventure réelle, dangereuse, n’y est plus possible. La guerre, expérimentée par Jünger, quasi en même temps que les “drogues et les ivresses”, cesse d’attirer car la figure du guerrier devient un anachronisme quand les guerres se professionnalisent, se mécanisent et se technicisent à outrance.
Autre échappatoire sans aucune positivité : l’amoralisme et l’anti-moralisme. Oscar Wilde fréquentera des bars louches, exhibera de manière très ostentatoire son homosexualité. Son personnage Dorian Gray devient criminel, afin de transgresser toujours davantage ce qui a déjà été transgressé, avec une sorte d’hybris pitoyable. On se souviendra de la fin pénible de Montherlant et on gardera en mémoire l’héritage douteux que véhicule encore aujourd’hui son exécuteur testamentaire, Gabriel Matzneff, dont le style littéraire est certes fort brillant mais dans le sillage duquel de bien tristes scénarios se déroulent, montés en catimini, dans des cercles fermés et d’autant plus pervers et ridicules que la révolution sexuelle des années 60 permet tout de même de goûter sans moralisme étriqué à beaucoup de voluptés gaillardes et goliardes. Ces drogues, transgressions et sexomanies bouffonnes constituent autant d’apories, de culs-de-sac existentiels où aboutissent lamentablement quelques détraqués, en quête d’un “supplément d’âme”, qu’ils veulent “transgresseur”, mais qui, pour l’observateur ironique, n’est rien d’autre que le triste indice d’une vie ratée, d’une absence de grand élan véritable, de frustrations sexuelles dues à des défauts ou des infirmités physiques. Décidément, ne “chevauche pas le Tirgre” qui veut et on ne voit pas très bien quel “Tigre” il y a à chevaucher dans les salons où le vieux beau Matzneff laisse quelques miettes de ses agapes sexuelles à ses admirateurs un peu torves...
Ascèse religieuse
L’alternative véritable, face au monde bourgeois, des “petits jobs” et des “petits calculs”, moqués par Hannah Arendt, dans un monde désormais fermé, où aventures et découvertes ne sont plus que répétitions, où la guerre est “high tech” et non plus chevaleresque, réside dans l’ascèse religieuse, dans un certain retour au monachisme de méditation, dans le recours aux traditions (Evola, Guénon, Schuon). Drieu la Rochelle évoque cette piste dans son “Journal”, après ses déceptions politiques, et rend compte de sa lecture de Guénon. Les frères Schuon sont exemplaires à ce titre : Frithjof part à la Légion Etrangère, arpente le Sahara, fait connaissance avec les soufis et les marabouts du désert ou de l’Atlas, adhère à une mystique soufie islamisée, part ensuite dans les réserves de Sioux aux Etats-Unis, laisse une œuvre picturale étonnante et époustouflante. Son frère, nommé le “Père Galle”, arpente les réserve améridiennes d’Amérique du Nord, traduit les évangiles en langue sioux, se retire dans une trappe wallonne, y dresse des jeunes chevaux à la mode indienne, y rencontre Hergé et se lie d’amitié avec lui. Des existences qui prouvent que l’aventure et l’évasion totale hors du monde frelaté de l’occidentisme (Zinoviev) demeure possible et féconde.
Car la rébellion est légitime, si elle ne bascule pas dans les apories ou ne débouche pas sur un satanisme de mauvais aloi, comme dans certaines sectes néo-païennes, plus ou moins inspirées par les faits et gestes d’un Alistair Crowley. Ce dérapage s’explique : la rébellion, faute de cause, devient hélas service à Satan, lorsque le mal en soi —ou ce qui passe pour le “mal en soi”— est devenu l’excitation existentielle considérée comme la plus osée. Dans un monde désenchanté, comme le nôtre, livré aux plaisirs stupides et passifs fournis par les médias, ce satanisme, avec son cortège sinistre de gesticulations absurdes et infécondes, séduit des esprits faibles, comme ceux qui traînent, par puritanisme mal digéré et mal surmonté, dans les salons où agit Matzneff et “passivent” ses voyeurs d’admirateurs. Ce n’est en tout cas pas l’attitude que souhaitait généraliser Brummell.
Robert STEUCKERS,
Forest/Flotzenberg, Vlotho im Weserbergland, mai 2001.
Note:
(*) : Otto MANN, “Dandysmus als konservative Lebensform” in: Gerd-Klaus KALTENBRUNNER (Hrsg.), Konservatismus International, Seewald Verlag, Stuttgart, 1973, ISBN 3-51200327-3, pp.156-170.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, lettres allemandes, lettres anglaises, synergies européennes, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 12 septembre 2008
Hermann Hesse: Le jeu des perles de verre
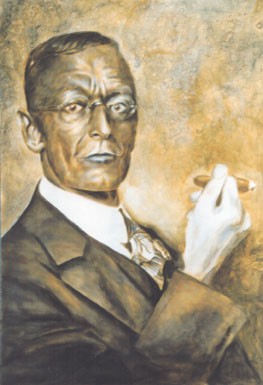
Laurent SCHANG :
HERMANN HESSE (1877-1962): «Le jeu des perles de verre»
Essai de biographie du Magister Ludi Joseph Valet accompagné de ses écrits posthumes
Mis en chantier à l'avènement du IIIième Reich mais édité dans sa version finale en 1943, Le jeu des perles de verre est de l'aveu même de Hermann Hesse le chef-d'œuvre de sa carrière d'écrivain.
Situé à une époque mal définie, estimée à 2500 ans après J.C., «2000 ans après la fondation de l'Ordre de Saint-Benoît et postérieurement à la mort de Pie XV», dans un monde utopique, la Castalie, province pédagogiaque réservée au seul talent et à l'expression élitiste du savoir, le “jeu des perles de verre” est la pierre philosophale qui ouvre l'humanité à un nouveau champ de perception. Alignement de perles multicolores sur un boulier rustique, le Jeu consiste en un système élaboré de combinaisons savantes maniées par une caste d'élus, synthèse suprême des arts et des sciences dont les clefs sont autant d'ouvertures à la catharsis et l'intégration dans le “Grand Tout” chanté par Hermann Hesse. Du monde castalien il dira: «Je n'eus pas besoin de l'inventer ni de le construire: sans que je m'en rendisse compte, il était préfiguré en moi depuis longtemps. Et du même coup j'avais trouvé ce que je cherchais: un lieu où respirer librement» (correspondance-lettre à Rudolf Pannwitz, 1955).
A travers le personnage central du roman, Joseph Valet, Hermann Hesse invite le lecteur à le suivre dans son initiation de jeune promu aux plus hautes responsabilités de l'Ordre, jusque son accession à la dernière marche: Maître du Jeu des Perles de Verre. Doté des meilleures dispositions, brillant intellectuel, humaniste raisonné, désintéressé et charismatique, Valet, au terme de sa progression dans les échelons castaliens, se détournera pourtant du pouvoir suprême pour ne plus se consacrer qu'à la méditation solitaire en simple précepteur.
Le jeu des perles de verre est l'occasion pour Hermann Hesse de rappeler les principes essentiels de sa conception de la place de l'Homme dans l'univers, qui le rapproche incontestablement des Ernst Jünger et autres Knut Hamsun, à savoir l'inopérance du pur intellect, le primat de l'âme et de l'irrationnel, la critique de toute collectivité et de l'étatisation des sociétés, l'éternel dilemme nature/culture. Sa quête de la réconciliation du piétisme mystique de son enfance et du rationalisme éclairé de l'Aufklärung s'effectuant sous les auspices des textes bouddhiques, de Lao Tse et de Nietzsche.
Un “Tolstoï” allemand?
Considéré par ses contemporains comme le Tolstoï allemand, précurseur de Kerouac et des écologistes, admiré de Mann, Gide et Rolland, Hermann Hesse, rebelle aristocrate et solitaire retiré dans le Tessin suisse dès avant 1914, a laissé à la postérité une œuvre dense, riche, à l'écriture musicale et au style ciselé où court de pages en pages la critique fondamentale de la société moderne qu'exprime avec le plus d'acuité le renforcement jusque dans les structures sociales les plus privées de la prégnance de l'Etat. De sa méfiance envers une démocratie, «cet Etat inconsistant, vide d'esprit et issu du vide et de l'épuisement qui ont suivi la guerre mondiale», dont il ne perçoit la déviance totalitaire —à l'instar de son compatriote Ernst von Salomon— qu'en tant que son expression la plus aboutie, prendra progressivement forme la Castalie.
Mais l'exemplarité du Jeu ne provient pas tant de son alternative que de la profonde sincérité de Hesse, qui dans son scepticisme rigoureux, se défie de son propre idéalisme et conserve à l'égard de sa création une position distante, n'omettant pas, après exposition des qualités de l'institution de Celle-les-Bois, d'en mentionner les tares inhérentes à tout corps administrativement constitué, mécanique bureaucratique parfaitement huilée qui, fonctionnant en roue libre, court le risque fatal de s'enliser dans sa routine scientifique, poussiéreuse et déshumanisante.
Moins sombre que George Orwell et Aldous Huxley mais davantage perspicace que Thomas More, Hesse, en orientaliste distingué, ne sépare jamais le yin du yang. Son Jeu des perles de verre vient ainsi parachever une vie de labeur littéraire où perce une image originale de la société occidentale, pour laquelle ses mots ne sont jamais assez durs: «La “société”, laquelle n'a plus qu'un semblant d'existence depuis que notre humanité s'est ou bien transformée en une masse uniforme et sans visage, ou bien fragmentée en des milliers d'individus isolés que rien ne rattache plus les uns aux autres, .sauf la peur de l'avenir et le regret du passé».
“Réfractaire au “tu dois”» selon la formule de Linda Lê, lecteur de Schopenhauer, Dostoïevski mais aussi Spengler, Klages ou encore Keyserling, le chemin vers les étoiles de Hermann Hesse est celui de la quête de toute une vie d'une spiritualité différente, éloignée de tous les dogmes incapacitants, ultime résonance d'un Age d'Or oublié. «...Je n'accorde qu'une place restreinte au temporel dans le compartiment supérieur de mes pensées», «il m'est impossible de vivre sans témoigner de la vénération à quelque chose, sans consacrer ma vie à un dieu», «Je n'ai jamais vécu sans religion et ne pourrais vivre un seul jour sans religion mais je m'en suis tiré pendant toute ma vie sans Eglise» (Mein Glaube).
Apoliteia
De nature rebelle, sa détestation de la bourgeoise Allemagne wilhelminienne le confirme dans sa soif de solitude et sa conscience d'artiste, si magistralement rendues dans sa nouvelle Le Choucas, extraite du recueil Souvenirs d'un Européen, où l'oiseau n'est autre que son double animalier: «Il vivait seul, n'appartenait à aucune communauté, n'obeissait à aucune coutume, à aucun ordre, à aucune loi (...) Bouffon pour les uns, obscur avertissement pour les autres (...)». Imprégné de l'idée du cycle naturel et cosmique, il se fait prophète, un demi-siecle avant Guénon et Evola, du Kali-Yuga, équivalent indien de l'Apocalypse dont il pressent tous les signes annonciateurs dans la décadence de l'Occident. En 1926, Hesse, répondant à une sollicitation de l'Ostwart-Jahrbuch, leur écrit: «J'estime que notre tâche est de consommer notre ruine et non pas de proposer pour modèles des œuvres et des discours dans lesquels nous tenterions de sauver quelque reste de la culture agonisante (...). Notre devoir est de disparaître dans les profondeurs, de nous en remettre à la nécessité et non pas d'en tirer des commentaires ingénieux. La façon dont Nietzsche, des dizaines d'années avant tous, a suivi le rude et solitaire chemin de l'abîme constitue un véritable exploit».
Apoliteia convaincu, opposant au titre d'“écrivain engagé” alors si abondamment représenté de par l'Europe (citons pour l'exemple Mann, Drieu, Malraux, Aragon, Shaw et Brecht) celui d'“auteur dégagé”, c'est dans le Moyen-Age, un Moyen-Age enchanteur et mythologique, et l'Orient, un Orient de lecture et de méditation, que Hesse puise l'essence de son art, et son attitude, toute de hauteur d'esprit et d'humilité, pourrait se résumer par ce livre de Romain Rolland: Au-dessus de la mêlée.
Ses ouvrages, du premier, Peter Camenzind, écrit en 1903, évocation de la communion intime de l'homme et de la nature accueillante une fois libérée du poids de la civilisation, à Siddharta en 1922, où Hesse expose toute sa passion pour l'hindouisme, sont un pas supplémentaire franchi dans l'élaboration progressive de sa foi profonde et intime. Anticipant sur le personnalisme d'Emmanuel Mounier, Hesse, dans une lettre envoyée à un admirateur, précise: «Chacun de vous doit tirer au clair la nature de sa propre personnalité, de ses dons, de ses possibilités et de ses particularités, il doit consacrer sa vie à se perfectionner moralement et à devenir ce qu'il est. Si nous accomplissons cette tâche, nous servons en même temps la cause de l'humanité (...) l'“indiviclualisme”, si souvent décrié, devient le serviteur de la communauté et perd le caractère odieux de l'égoïsme». Son roman le plus fameux, Le Loup des Steppes (l927), tirera toute sa substance de cette profession de foi.
Sollicité de toutes parts, collaborant a moultes revues littéraires, partageant son temps entre l'écriture et la peinture, c'est dans l'art et la culture que Hesse discernera finalement la dernière, et peut-être la seule trace de Dieu sur Terre, expression la plus pure et parfaite de la part de génie qui réside en tout homme, dès lors que celui-ci est à même de se développer en harmonie avec l'Univers, Alpha et Omega de son maître-roman, Le Jeu des perles de verre.
Laurent SCHANG.
indices bibliographiques:
- Le Jeu des Perles de Verre, Calmann-Lévy, 1996.
- Lettres (1900-1962), Calmann-Lévy, 1981.
- Souvenirs d'un Européen, Livre de Poche, 1994.
00:08 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres allemandes, allemagne, hermann hesse |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 28 août 2008
Brève note sur Heimito von Doderer

Brève note sur Heimito von Doderer
Né le 5 septembre 1896, sous le nom de Franz Carl Heimito, Chevalier von Doderer, à Hadersdorf-Weidlingau et mort à Vienne le 23 décembre 1966, Heimito von Doderer fut un écrivain autrichien, fils d'un architecte et entrepreneur de travaux de construction. Il a servi comme aspirant dans un régiment de dragons pendant la première guerre mondiale. Il a été prisonnier pendant quatre ans en Russie [ndt: plus exactement, en Sibérie]. En 1920, il revient en Autriche, où il étudie l'histoire à Vienne, notamment sous la férule du Chevalier Heinrich von Srbik [ndt: et obtient son diplôme en 1925]. Sous la forte influence d'Albert Paris Gütersloh, il tente de s'initier au difficile métier d'écrivain. Il a commencé, ainsi, mais sans grand succès, par publier des poèmes, de brèves nouvelles et des romans. En 1933, il adhère à la NSDAP, qui est interdite en Autriche à l'époque, mais la quitte en 1938. Cette année-là, il accède enfin à une plus vaste notoriété grâce au roman Ein Mord den jeder begeht. En 1940, après sa conversion, il est accepté au sein de l'Eglise catholique. Pendant la seconde guerre mondiale, il sert en tant qu'officier de la force aérienne. Finalement, il acquiert la gloire par la publication de deux grands romans à thématique sociale, Die Strudlhofstiege (1951) et Die Dämonen (1956).
La prose de Doderer se caractérise par une langue imagée, totalement inédite. Une série de motifs revient sans cesse dans son écriture, dont une critique systématique du progrès technique et de la civilisation moderne des grandes métropoles; Doderer rejette aussi tous les linéaments de l'ère des masses, qui empêchent, dit-il, le déploiement optimal de l'individualité personnelle. Il écrit, à ce propos: «Celui qui appartient aux "masses", a d'ores et déjà perdu la liberté et peut s'installer où il veut».
Une adhésion à la plénitude complète du réel
[ndt: Le style littéraire de Doderer est largement influencé par Marcel Proust et Robert Musil, dans la mesure où, tout entier, il part, lui aussi, à la "recherche du temps perdu"; chez lui, cette recherche vise à retrouver les innombrables fractions de bonheur de l'Autriche-Hongrie d'avant 1914, en replongeant dans l'histoire sociale des hommes et des familles. Pour Doderer, le chaos de la société moderne exprime la crise de l'universalité, raison pour laquelle la tâche de l'écrivain doit être d'esquisser une nouvelle universalité, qui n'est évidemment pas un universalisme idéologique à côté d'autres universalismes idéologiques, mais une adhésion à la plénitude complète du réel, comme on l'éprouvait généralement sans détours dans l'ancien empire danubien austro-hongrois. L'homme universel n'est pas un modèle abstrait, taillé sur mesure une fois pour toutes, mais un être qui se manifeste sous des "variations multiples". En revanche, plongé dans le carcan étroit d'une "réalité seconde", faite de restrictions mutilantes de nature idéologique, il perd et son universalité et ses variations pour n'être plus qu'un instrument au service des pires barbaries politisées de l'histoire. Heimito von Doderer dénonce l'idiotie immanente de toutes les positions doctrinaires, quelles qu'elles soient. En cela, Doderer est disciple de Hoffmansthal, qui disait: «L'idiotie, comme l'indique l'étymologie de ce mot étranger, n'est rien d'autre que l'auto-limitation de l'homme par lui-même». Une telle posture implique de revaloriser les communautés humaines, avec leurs échelles variables de formes sociales et de classes, contre l'uniformité grise des sociétés totalitaires, plaide simultanément pour une restauration des qualités humaines contre les affres de la quantité (Musil, Guénon). Universalité, variété et qualité impliquent de ce fait de respecter et de conserver le jeu des interpénétrations créatrices entre les éléments contradictoires du réel prolixe pour unir l'esprit conservateur et l'esprit émancipateur dans une quête permanente de la "totalité" (Ganzheit) ou, comme on le dit plus justement aujourd'hui en philosophie, l'"holicité" - RS].
Dans les ouvrages de Doderer, nous trouvons donc trois concepts centraux, présentés sous des facettes diverses: celui d'"aperception" (Apperzeption), celui de "seconde réalité" (zweite Wirklichkeit) et celui du "devenir-homme" (Menschwerdung). Celui qui refuse de percevoir la réalité (telle qu'elle est), c'est-à-dire la réalité première, dit Doderer, fait éclore en lui, justement par ce refus de l'aperception, une seconde réalité, sous la forme d'une représentation fixiste (fixe Vorstellung) ou d'une idée-corset ou idée-cangue (Zwangsidee), ce qui correspond à une image du donné viciée par l'idéologie. Doderer considère que l'Etat totalitaire constitue une "seconde réalité" de ce type, de même que ces volontés révolutionnaires et fébriles de vouloir tout changer, que le primat accordé névrotiquement à la politique, que les complexes d'ordre sexuel, que les névroses et que l'attachement forcené à certains systèmes et ordres.
La vie telle qu'elle est
Une bonne partie des personnages de l'univers romanesque de Doderer sont en lutte contre les formes de "seconde réalité". Les dépasser n'est possible que par un processus de "devenir-homme", soit par le fait que l'homme revient ainsi à sa véritable destination, en s'ouvrant, de manière inconditionnelle, à la première réalité, la seule vraie, qui, pour Doderer, est la vie civile naturelle, sans fard et sans excitations artificielles. Dans ce contexte, Doderer se réclame "de la vie telle qu'elle est" et nous enjoint de l'accepter. Il faut dès lors se détourner des fixismes idéologiques —qu'il désigne comme les "hémorroïdes de l'esprit"— des convictions et des idéaux qui sont soi-disant sublimes, pour s'adonner à l'aperception pleine et entière du réel. Cette aperception est essentiellement conservante —ici, Doderer articule clairement sa position— car celui qui adopte cette position ne souhaite pas voir modifier ce qu'il aime réceptionner par "aperception" et se trouve autour de lui. Raison pour laquelle Doderer dit: «L'attitude fondamentale de l'homme apercevant est conservatrice».
Dr. Ulrich E. ZELLENBERG.
(extrait de "Lexikon des Konservatismus" - Caspar v. Schrenck-Notzing /Hrsg. - Leopold Stocker Verlag, Graz, 1996 - ISBN 3-7020-0760-1; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, littérature, allemagne, autriche, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 22 août 2008
Brèves réflexions sur l'oeuvre de H. G. Wells
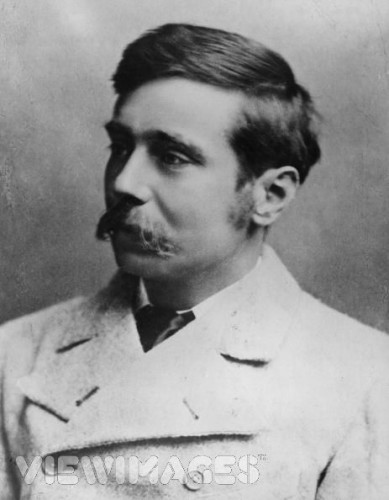
Werner OLLES:
Brèves réflexions sur l’oeuvre de H. G. Wells
Incontestablement, Herbert George Wells est l’un des plus intéressants écrivains du 20ème siècle, à facettes multiples. Son oeuvre complète comprend près de cent volumes et va de la théorie (en biologie, en histoire contemporaine, en philosophie et en politique) à ces romans et récits devenus si célèbres dans le monde entier. Toutes ces créations littéraires sont des exemples de perfection en matière de littérature fantastique et utopique: de véritables classiques de la narration contemporaine. Wells est entré dans l’histoire intellectuelle de notre monde comme le père fondateur de la littérature de science-fiction et comme l’un des plus géniaux écrivains de ce genre.
H. G. Wells est né le 21 septembre 1866 dans la petite ville de Bromley dans le Comté de Kent en Angleterre. Son père était jardinier; plus tard, ses économies lui permirent d’ouvrir un petit commerce d’étoffes mais sa carrière de commerçant ne fut guère brillante. Le foyer parental était petit bourgeois, bigot, ce qui limitait les perspectives du jeune Wells. De cette époque de jeunesse date également son antipathie profonde à l’encontre du catholicisme qu’il abhorrait véritablement, l’accusant d’être une pensée pré-bourgeoise. La haine intense qu’il cultivait pour le culte “romain”, accusé d’être contre-révolutionnaire et médiéval, hostile à la modernité, l’amena même à plaider, pendant la seconde guerre mondiale, pour une destruction complète de Rome par les bombardiers alliés. Cette violente position anti-catholique le mettait pourtant en porte-à-faux par rapport à de nombreux intellectuels et écrivains anglais de son époque mais ne le dérangeait pas outre mesure: beaucoup d’écrivains anglicans en effet, comme Graham Greene, Evelyn Waugh, G. K. Chersterton ou Julien Green se convertirent au catholicisme.
Déjà dans ses premiers ouvrages, comme “La machine à remonter le temps”, un récit fantastique où un inventeur s’envole vers le futur, il se percevait lui-même en héros. De manière parfaitement prosaïque, il décrit un petit paradis où débarque son “voyageur à travers le temps”; y vivent les “Eloïs”, des créatures affables qui vivent en dehors de tous soucis. Mais bien vite, l’inventeur et voyageur remarque que cette société, en apparence si paisible, est pourtant soumise à la terreur le plus brutale. Les “Eloïs”, en effet, sont rançonnés et exploités par les Morloks, des monstres souterrains qui les massacrent sans pitié.
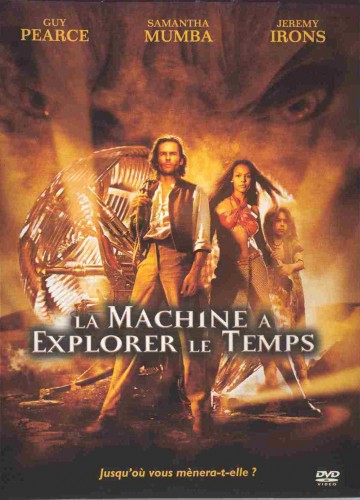
Dans “L’Ile du Dr. Moreau”, le héros est un scientifique expulsé d’Angleterre qui mène des expériences dans une île du Pacifique Sud, afin de transformer des animaux en demi-êtres à la suite d’opérations chirurgicales précises. Moreau, vivisectionniste démoniaque, est simultanément un Prométhée et un dieu punisseur. Les parallèles avec le récit de la Genèse sont flagrants: l’homme est toujours menacé de glisser à nouveau vers l’état de la bête et, à l’instar des créatures fabriquées par Moreau, les hommes, eux aussi, sont condamnés à la souffrance.
Wells s’était engagé dans la “Fabian Society”, une association de socialistes britanniques mais ce ne fut que pour une courte durée. Ses rêves sociaux-révolutionnaires se sont assez rapidement évanouis et il se tourne alors vers la métaphysique. Dans “La guerre des mondes”, il décrit comment des extra-terrestres réduisent l’Angleterre en cendres. Dans les années 30, Orson Welles fit de ce récit un reportage radiophonique qui semblait si vrai que des dizaines de milliers d’Américains prirent la fuite, en panique devant cette invasion imminente de Martiens. Dans “Les géants arrivent”, il pose la question: les hommes, comme jadis les dinosaures, sont-ils condamnés à disparaître?
A la fin de sa vie, l’évolution de la politique et le développement des technologies firent de lui un pessimiste (voir son essai: “L’esprit est-il au bout de ses possibilités?”). H. G. Wells meurt le 13 août 1946 à l’âge de 79 ans à Londres.
Werner OLLES.
(article paru dans “Junge Freiheit”, Berlin, n°33/2006; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : lettres, angleterre, lettres anglaises, science-fiction, utopie, dystopie, scientisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 21 août 2008
Le grand bouleau est tombé... Hommage à A. Soljénitsyne
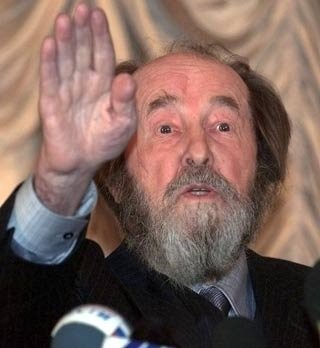
“De Brave Hendrik” / ’t Pallieterke:
Le grand bouleau est tombé...
Hommage à Alexandre Soljénitsyne (1918-2008)
Le bouleau est un type d’arbre à l’écorce blanche argentée, dont le bois est fort clair et très dur. En Sibérie et dans de nombreuses régions de l’immense plaine russe, avec ses marécages gelés et enneigés, cet arbre est familier, appartient au paysage. La barbe et les cheveux gris de Soljénitsyne, écrivain, chrétien orthodoxe que Staline n’était pas parvenu à éliminer, rappelaient, depuis quelques années déjà, les couleurs de cet arbre si emblématique, qui jaillit partout de la terre russe.
Sa vie connut un premier bouleversement en 1945, lorsque, dans une lettre à un camarade, il décrit “l’homme à la moustache” (= Staline) comme incompétent sur le plan militaire. Soljénitsyne était alors en Prusse orientale et participait aux combats pour prendre la ville de Königsberg (que l’on appelle aujourd’hui Kaliningrad, dans l’enclave russe sur les rives de la Baltique). Il est arrêté: une routine sous la terreur soviétique de l’époque. Il ne sera libéré que huit ans plus tard, en 1953, à l’époque où la paranoïa du dictateur atteignait des proportions à peine imaginables, tandis que sa santé diminuait à vue d’oeil. Staline ne voyait alors dans son entourage que complots juifs ou américains; de 1953 à 1956, Soljénitsyne, professeur de mathématiques de son état, réside, libre mais banni, au Kazakhstan. En 1956, on le réhabilite et en 1962, il amorce véritablement sa carrière d’écrivain en publiant dans la revue “Novi Mir” une nouvelle, “Une journée dans la vie d’Ivan Denissovitch”. Mais c’est en 1968 que ce dissident acquiert la notoriété internationale, à cinquante ans, quand sortent de presse “Le pavillon des cancéreux” et “Le premier cercle”; il a réussi à faire passer clandestinement ses manuscrits à l’étranger; rapidement, ils sont connus dans le monde entier, par des traductions qui révèlent l’atrocité de son vécu de bagnard dans l’Archipel du goulag. En 1970, il est le deuxième Russe (le premier fut Ivan Bounine) à recevoir le Prix Nobel de littérature.
Celui qui veut comprendre et apprendre un maximum de choses sur la littérature russe dans l’espace linguistique néerlandophone, doit lire les écrits du grand slaviste Karel van het Reve (1921-1999), car celui-ci, mieux que quiconque, a pu, dans ses nombreux livres et essais, décrypter les mystères russes. Mais sa “Geschiedenis van de Russissche literatuur” (1) s’arrête malheureusement à Anton Tchekhov. Pour mieux comprendre la dissidence et l’intelligentsia russes, il me paraît toutefois utile de relire les travaux de ce slaviste, dont les titres sont éloquents: “Met twee potten pindakaas naar Moskou” (1970; “Avec deux pots de crème de cacahouète à Moscou”), “Lenin heeft echt bestaan” (1972; “Lénine a vraiment existé”) et “Freud, Stalin en Dostojevski” (1982; “Freud, Staline et Dostoïevski”). Dans un ouvrage posthume, paru en 2003, et intitulé “Ik heb nooit iets gelezen” (= “Je n’ai jamais rien lu”), ce grand connaisseur de la Russie, au regard froid et objectif mais néanmoins très original, émet force assertions qui témoignent de sa connaissance profonde des lettres russes. De son essai “De ondergang van het morgenland” (1990; “Le déclin de l’Orient”), je ne glanerai qu’une seule et unique phrase: “Selon le régime, en 1917, c’est la classe ouvrière, que l’on appelle également le prolétariat, qui est arrivée au pouvoir, alliée, comme on le prétend officiellement, aux paysans. C’est là une déclaration dont nous n’avons pas à nous préoccuper, si nous entendons demeurer sérieux. Surtout, ces paysans, que l’ont a tirés et hissés dans la mythologie révolutionnaire, font piètre figure, prêtent à rire (jaune): le régime a justement exterminé une bonne part du paysannat. Pour ce qui concerne les ouvriers, il est bien clair que ce groupe au sein de la population n’a quasiment rien à dire dans un régime communiste, et sûrement beaucoup moins que sous Nicolas II ou sous Lubbers et Kok aux Pays-Bas”.
Un changement qui doit surgir de l’intérieur même du pays...
Soljénitsyne n’était pas homme à se laisser jeter de la poudre aux yeux; prophète slavophile, il a progressivement appris à détester les faiblesses spirituelles et le matérialisme de l’Occident, pour comprendre, au bout de ses réflexions, que l’effondrement de l’Union Soviétique ne pouvait pas venir d’une force importée mais devait surgir de l’intérieur même du pays. La révolution, comme on le sait trop bien, dévore ses propres enfants. Le régime soviétique, lui, avec la “glasnost”, a commencé à accepter et à exhiber ses propres faiblesses, si bien que les credos marxistes ont fini par chanceler et le régime par chavirer. Déjà en 1975, la revue “Kontinent”, épaisse comme un livre, qui était un forum indépendant d’écrivains russes et est-européens, avait amorcé un débat sur l’idéologie en URSS en se référant à la “Lettre aux dirigeants de l’Union Soviétique” de Soljénitsyne, en la commentant à fond, avec des arguments de haut niveau. Un poète fidèle au régime avait même déclaré, à propos de ce débat: “Nous avons fusillé la Russie, cette paysanne au gros postérieur, pour que le ‘Messie communisme’ puisse marcher sur son cadavre et ainsi, y pénétrer”.
Pour donner un exemple du ton de Soljénitsyne, impavide et inébranlable, courageux et solide, j’aime citer une réponse claire qu’il adressa un jour à son compatriote Sakharov, une réponse qui garde toute sa validité aujourd’hui: “Nous devrions plutôt trouver une issue à tout ce capharnaüm omniprésent de termes tels impérialisme, chauvinisme intolérant, nationalisme arrogant et patriotisme timide (c’est-à-dire vouloir rendre avec amour service à son propre peuple, posture intellectuelle combinée avec des regrets sincères pour les péchés qu’il a commis; cette définition s’adresse également à Sakharov)”. Et il y a cette citation plus humaine encore: “Cette hypocrisie ne suffit-elle pas? Comme un électrode rouge, elle a laminé nos âmes pendant cinquante-cinq ans...”.
Les meilleurs livres de Soljénitsyne sont sans doute ceux qui sont le moins connus: je pense surtout à “Lénine à Zurich” (1975) et “Les erreurs de l’Occident” (1980). Quoi qu’il en soit, cet homme a surtout eu le grand mérite d’avoir, à temps et sans cesse, ouvert nos yeux, à nous ressortissants du riche Occident, alors qu’ils étaient aveuglés ou trompés; de nous avoir apporté son témoignage sur son époque et sa patrie (l’Orient ou la “Petite Mère Russie”) dans ses livres tout ruisselants d’authenticité; de nous avoir ainsi libérés des griffes du communisme, idéologie catastrophique et inhumaine.
Il a pu être enterré solennellement dans le sol de sa patrie russe et non pas en Suisse ou en cette lointaine Amérique, ses terres d’exil. Personne ne l’aurait cru, n’aurait osé le prévoir, il y a vingt ou trente ans.
“De brave Hendrik”,
(article paru dans “ ’t Pallieterke”, Anvers, 13 août 2008, trad. franç. : Robert Steuckers).
Note:
(1) paru à Amsterdam chez van Oorschot, cinquième édition revue et corrigée, 1990.
00:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres russes, littérature russe, urss, communisme, russie, soljénitsyne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 20 août 2008
Refuser le mensonge: hommage à A. Soljénitsyne
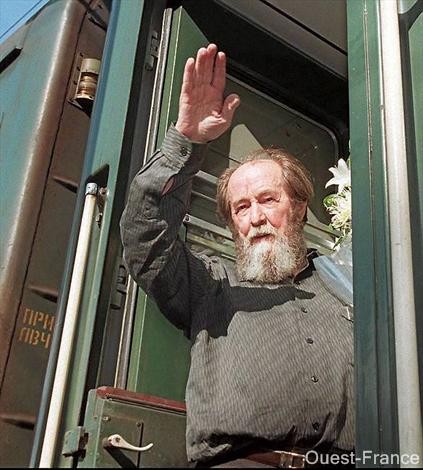
J.K.: ’t Pallieterke :
Refuser le mensonge: hommage à Soljénitsyne
“C’est justement ici que se trouve la clef, celle que nous négligeons le plus, la clef la plus simple, la plus accessible pour accéder à notre libération: ne pas participer nous-mêmes au mensonge! Le mensonge peut avoir tout recouvert, peut régner sur tout, ce sera au plus petit niveau que nous résisterons: qu’ils règnent et dominent, mais sans ma collaboration!”.
Ces phrases sont tirées d’un essai de Soljénitsyne, intitulé “Ne vis pas avec le mensonge!”. Elles caractérisent parfaitement l’écrivain russe, décédé début août 2008. Il avait été le plus célèbre des dissidents et Prix Nobel de littérature. Il n’a pas participé au mensonge, effectivement, ce qui lui permit de donner une impulsion à la résistance contre le régime soviétique, impulsion qui, à terme, a conduit à l’effondrement de l’Etat totalitaire alors que, jadis, il avait semblé si invincible.
“Ce fut Alexandre Soljénitsyne qui ouvrit les yeux du monde sur la réalité du système soviétique. C’est pourquoi, son vécu a une dimension universelle”, a déclaré le président français Sarközy après avoir appris la mort de l’écrivain. Les réactions officielles post mortem n’ont généralement rien de bien substantiel. Quoi qu’il en soit, en France, le pays de Sarközy, l’oeuvre littéraire de Soljénitsyne avait provoqué un gigantesque retournement des esprits. Gramsci, marxiste italien, savait que toute société est dirigée par ceux qui influencent la pensée. En France, dans le sillage de mai 68, fourmillaient les “compagnons de route”, souvent des intellectuels bien intentionnés, qui voyaient dans l’Etat soviétique la réalisation du paradis sur la Terre. La publication de “L’Archipel Goulag”, oeuvre littéraire monumentale où Soljénitsyne règle ses comptes avec le régime de terreur communiste, ouvre les yeux à de nombreux intellectuels français. C’est le début de la fin pour le communisme, en France et en dehors des frontières de l’Hexagone. Plus que n’importe quel autre écrivain, Soljénitsyne dévoila la vérité quant à l’oppression subie par son peuple sous la dictature communiste. Parce qu’il ne voulait pas participer au mensonge.
Qui connait encore Soljénitsyne?
La biographie de Soljénitsyne a été révélée dans ses grandes lignes dans notre presse flamande. Soldat de l’Armée Rouge, il est fait prisonnier par sa propre hiérarchie et déporté en Sibérie parce qu’il avait émis des critiques contre Staline dans une lettre à un ami; il fut condamné à huit années de camp de travail et ensuite à cinq années de bannissement intérieur. Auteur d’ouvrages critiques à l’endroit du régime, il oeuvre dans un premier temps avec l’accord de Khrouchtchev, leader du parti, qui espère tirer un profit personnel en autorisant certaines critiques contre Staline. Plus tard, contre l’avis des autorités soviétiques, Soljénitsyne obtint le Prix Nobel de littérature; il n’ira pas lui-même le chercher de crainte de ne pouvoir rentrer en Russie; il sera malgré tout banni du pays après la publication en Occident de “L’Archipel Goulag”. Pendant des années, il vivra reclus aux Etats-Unis, dans une propriété enneigée et plantée de pins dont les allures lui rappellaient la Russie. Réhabilité après la chute du communisme, il revient en Russie en 1994, où il se posera, une fois de plus, comme un critique non conformiste, hostile aux pouvoirs établis.
La presse flamande n’a pas raconté beaucoup d’autres choses à la suite de son décès. “La Libre Belgique” en a fait son grand titre, exactement comme “Le Monde” à Paris et d’autres quotidiens de qualité ailleurs en Europe. Chez nous, seulement de brefs articulets, quelques analyses toutes de platitude dans les pages intérieures des journaux. Rik van Cauwelaert fit exception dans les colonnes de l’hebdomadaire “Knack”, où un éditorial bien ficelé fut entièrement consacré à Soljénitsyne.
D’où question: nos journalistes ne connaissent-ils plus Soljénitsyne? L’ont-ils jamais lu? Ou bien, l’appellation de “fossoyeur du régime soviétique”, dont on l’a si souvent gratifié, les effraie-t-elle? La Flandre a démontré, la semaine dernière, sa petitesse.
Pourtant, il n’en a pas toujours été ainsi dans nos régions. “Le premier cercle” contenait, en page 202 de son édition néerlandaise, un phrase caractéristique: “Il y a toujours eu l'une de ces idées pour fermer la bouche à ceux qui voulaient crier la vérité ou monter sur la brèche pour la justice”. “Le pavillon des cancéreux”, “Lénine à Zurich”, “La Russie sous l’avalanche”, “La fille d’amour et l’innocent”, “Flamme au vent”, “Pour le bien de la cause”, “Août 1914”, “Une journée dans la vie d’Ivan Denissovitch”, “L’Archipel Goulag”, “Le chêne et le veau”, “Lettre ouverte aux dirigeants de l’Union Soviétique”, “Discours américains”, etc., tous furent rapidement traduits en néerlandais et connurent de réels succès éditoriaux. Les éditions successives se bousculaient à un rythme constant.
Aujourd’hui, on ne peut plus acheter neuf qu’”Une journée dans la vie d’Ivan Denissovitch” en librairie. Même “L’Archipel Goulag” est épuisé.
Le mensonge en lui-même
Partout dans le monde, l’intérêt pour l’auteur et ses idées s’est rapidement estompé après son bannissement à l’Ouest. Pour les clans de la gauche, Soljénitsyne resta suspect, alors que, pourtant, l’Amérique libérale, à son tour, était devenue la cible de ses critiques. La prise du pouvoir par les communistes, il l’a toujours considérée comme une “importation occidentale” (Marx était allemand) qui, par voie de conséquence, s’opposait diamétralement aux ressorts de l’âme russe. Le capitalisme était pour lui une horreur. Mais après la chute du communisme, il ne ménagea pas ses critiques à l’encontre de Gorbatchev et surtout d’Eltsine, qui, selon lui, vendaient le pays aux plus offrants et le transformaient en un marécage sordide où dominait une culture glauque, décadente, sans contenu réel.
En 1999, Soljénitsyne écrit “L’effondrement de la Russie”, une synthèse de toutes les idées qui ont émaillé son oeuvre. Il règle ses comptes avec l’idéologie de la privatisation et déplore le déclin du patriotisme. La nouvelle norme est hélas devenue la suivante, elle se résume en une question: “Qu’est-ce que cela rapporte?”. Pour Soljénitsyne, le patriotisme est un sentiment organique, “la conviction que l’Etat vous protège dans les moments difficiles”. La patrie jouait un grand rôle pour Soljénitsyne. Mais Dieu aussi. Et Dieu disparaît également, ou alors on n’écrit plus son nom qu’avec un “d” minuscule.
La ligne de démarcation
Il est clair que Soljénitsyne ne visait pas le succès auprès des détenteurs du pouvoir. Mais les intellectuels contemporains, ceux qui se targuent d’être dans le vent, n’aiment pas davantage ce conservateur fondamental, avec sa tête et son visage comme taillés dans du bois de chêne. “Il est dépassé”: tel est sans doute le commentaire le plus courant et le plus aimable qu’on a entendu à son propos. La plupart le rejetait en ne tenant compte que de la caricature que l’on avait faite de lui.
Il a survécu à l’Union Soviétique mais est revenu dans une Russie où toutes les non valeurs, comme la corruption, le matérialisme, la superficialité et la décadence étaient omniprésents.
Dans une recension remarquable, aux arguments solides comme l’acier, Hubert Smeets, dans les colonnes du “NRC-Handelsblad” (15 janvier 1999), évoque Wayne Allensworth qui était, dans les années Clinton, analyste auprès du “Foreign Broadcast Information Service”, une officine gouvernementale américaine qui suit la presse non anglophone du monde entier. Wayne Allensworth y défendait Soljénitsyne contre tous les critiques américains et étrangers. Selon Allensworth, en effet, Soljénitsyne était logique avec lui-même, suivait toujours sa même piste: la lutte contre LE mensonge, “contre la croyance en la possibilité qu’aurait l’homme de transformer sa propre nature, de manipuler l’univers et de créer un paradis sur la Terre”. C’est dans ce grand mensonge-là que se retrouvent, tous ensemble, les communistes, les capitalistes, les révolutionnaires et les libéraux.
“Ce que les Occidentaux, convaincus de la supériorité du capitalisme, devraient comprendre, c’est que Soljénitsyne ne perçoit pas les racines de la misère économique et écologique de la Russie dans le socialisme en soi, mais dans le manque d’humilité de l’humanité moderne”.
Pour Allensworth, on ne peut dès lors pas considérer Soljénitsyne comme un slavophile, simple héritier et imitateur des slavophiles russes du 19ème siècle, ni comme un idéologue “Blut-und-Boden” (à la mode allemande) mais comme un personnaliste contemporain, se situant dans la tradition d’Edmund Burke, James Burnham ou Christopher Lash.
Concluons en citant Soljénitsyne lui-même: “La ligne de démarcation entre le bien et le mal ne passe pas entre les Etats, les classes ou les partis, mais à l’intérieur même de chaque coeur d’homme”. Le coeur de Soljénitsyne, lui, s’est arrêté de battre à 89 ans.
J. K.
(article paru dans “’t Pallieterke”, Anvers, 13 août 2008; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:20 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres russes, littérature russe, russie, soljénitsyne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 juillet 2008
Sur "La Stratégie des Ténèbres" de J. Parvulesco

Sur "La stratégie des Ténèbres" de Jean PARVULESCO
Un roman dangereux - un livre pour tous et pour personne
N'a-t- il pas été dit que Tout est Pur aux Purs? (Le RP Jean-René de Valsan à Liana Carducci)
Si je dirigeais un service politique ou une faculté de théologie —mais des plus confidentielles— parmi les textes et les livres auxquels je soumettrais mes hommes, car ce sont les livres qui nous soumettent et non l'inverse, je leur donnerais à méditer le dernier roman de Jean Parvulesco, La Stratégie des Ténèbres.
Roman d'espionnage, roman politico-stratégique, songe cinématographique, œuvre de haute magie et de hardiesse théologique tout à la fois… Mais ne me l'avait-il pas dit : C'est un roman dangereux… Oui, en effet, dangereux, mais, ceux qui veulent s'approcher du Salut, de la grande salvation, doivent aussi s'approcher du Danger. Toujours. Il n'est pas d'autre voie.
Dernier roman et assurément l'un des plus grands, sinon peut-être le meilleur. En effet, avec cet opus, Parvulesco monte au faîte de son art; l'ouvrage rejoint à mon avis son autre chef d'œuvre qu'était et que reste le songe de combat, L'Etoile de L'Empire Invisible.
Dans La stratégie des Ténèbres, le rythme de l'action et de l'écriture porte véritablement l'œuvre, les séquences nous entraînent les unes après les autres vers une horreur et un dévoilement aussi décisif qu'hallucinatoire, hallucinatoire car il s'agit de sortir du cauchemar dans lequel vit la France et, par delà, notre misérable condition humaine actuelle, bref on aura compris qu'il s'agit d'une vision salvatrice, peut-être de celle qui sauve, car si savoir, c'est pouvoir, savoir, c'est aussi avoir vu.
Le rythme donc, mais d'ailleurs tout l'ouvrage semble avoir été écrit pour le cinématographe… Ah ! Je rêve d'un réalisateur qui accepterait d'adapter La stratégie des Ténèbres! Cet élément fondamental et essentiel de l'univers parvulesquien, comme souvent, est omniprésent dans l'œuvre, sur l'œuvre et au-delà de l'œuvre. C'est son écriture, qui le sous-tend mais aussi la comédienne Armande Béjan et son adaptation de la figure de Jeanne d'Arc, personnage qui hante le cinéma depuis Carl Theodor Dreyer en passant par Robert Bresson.
Le cinéma donc : souvenez-vous des ambiances melvilliennes de L'Etoile de L'Empire invisible quand Jean Parvulesco décrivait des zones banlieusardes d'un autre âge, sillonnées par des Citroën DS noires plus ou moins clandestines qui venaient s'y réfugier, des zones qui flanquaient sérieusement la trouille puisqu'elles interpellaient la longue disparition de nous-mêmes… que d'autres espaces, d'autres lieux; tout autant vénusiens que géopolitiques et eurasiens qui venaient suractiver et contre-attaquer jusqu'à la rupture même et l'éradication de la Balance; de tout Balance of Power…
Mais revenons à La Stratégie des Ténèbres, réussite du rythme et du découpage, où l'action se resserre, en France certes, mais aussi à l'extérieur du territoire. On retrouve, l'univers des Villas parisiennes, de Neuilly ou de Saint-Cloud, de ces Villas qui atteignent l'orée des Bois, du Bois de Boulogne notamment, ces villas où se jouent si souvent tout et rien, et c'est là une position des plus troublantes, ce “tout et rien”… De ces réceptions mondaines, plus ou moins sorties de l'univers d'Eric Rohmer et donc de la vie parisienne elle-même; qui entremêle si bien cinéma et réalité, pour le meilleur et pour le pire.
Les héros du roman vont devoir contrer l'œuvre du Mal Absolu qui court sur le Territoire et qui ressere son emprise toujours plus fort, toujours au plus mal, le mal de la Malemort. J'aimerais dire combien les scènes qui entourent la fugue mystique de la comédienne Armande Bejan sont d'une grande, d'une très grande réussite, notamment quant à l'entrée en scène du Mal; et c'est un lecteur de Raoul de Warren et de Lovecraft qui vous le dit; c'est dire si je pèse mes mots. L'apparition du diable, d'un Satan sodomiste , abominablement repoussant et puant, suintant à travers les pages même du livre, est un coup de maître, non teinté d'une certaine dose d'humour, car à ce moment-là du livre on peut encore rire (surtout quand, comme moi, on croit reconnaître le jean-foutre qui a servi de modèle, ainsi que sa jeune victime; dont la vie deviendra une non-vie à partir du moment de sa contre-initiation rectale, furibarde et diabolique, une errance d'écorce morte sera alors le lot du jeune Damanski…).
A propos de peur montante et environnante, c'est avec un talent, qui rejoint celui de Raoul de Warren, que Parvulesco nous plonge par la suite dans une inquiétude des plus vivaces quant au cœur du mal, qui ronge et qui grandit et notamment les campagnes du Pays de France… Il me vient des frissons face à une apparition maléfique d'une sarabande de sorcières hideuses; témoignage de la transe du Mal et de ses suppôts disséminés.
Mais après l'inquiétude et l'angoisse, le décor ainsi planté, c'est bel et bien l'horreur la plus noire, la plus abjecte, la plus totale qui vit et qui se joue —et contre laquelle vont décider de s'activer des hommes qui savent, que derrière la mise en place de la sexualité la plus déviante, la plus abjecte et inhumaine (contre laquelle Parvulesco développe toujours —et je dirais “contre-offensivement”; car l'homme n'est pas un bigot et connaît bien la Chair, une sexualité surhumaine, incandescente qui, dans les épanchements les plus sensuels et charnels, découvre le mystère de l'Incendium Amoris); car il s'agit bien des pires perversions, de la mutilation, de la destruction tortionnaire et totale des corps de jeunes filles voire de jeunes enfants, perversion filmée, vomissant du chaos de monstrueux snuff-movies.
Perversions, mutilations et destructions “filmées”, disais-je: comprend-on donc bien l'enjeu de ce qui se joue là, du combat absolument irréductible et du signe qui nous est jeté, entre notre propre devenir et le devenir même d'un cinéma toujours plus nécrosé… Je ne veux en dire plus ici, mais je rappelle simplement que c'est par son film L'Argent que Robert Bresson a terminé son œuvre, à moins que ce ne soit l'argent et la mort, tous deux, ensemble, qui l'aient achevé…
Dans cette situation, les héros du roman vont passer à l'action; ce qui va les amener à toute une série d'opérations risquées afin de lutter contre ce mal absolument maléfique. Et c'est ici que Parvulesco apparaît comme un écrivain qui prend ses responsabilités à la différence de bien des baudruches qui flagornent ou qui se coupent totalement de notre contemporéanéité; funeste erreur pour un romancier. Ainsi, il incorpore le motif littéraire d'une sexualité à rebours de toute sexualité, d'une morbidité rampante et galopante dont témoigne ces pratiques monstrueuses, qui ne viennent pas de nulle part, car… nulle part c'est tout de même quelque part.
Le Néant et le Non-Etre sont donc localisables dans la géographie sacrée et dans la géopolitique mystique des romans de Jean Parvulesco, mais cette fois-ci, c'est le lieu du mal qu'il désigne.
L'auteur montre à travers l'action de ses héros que les abominations qui ensanglantent le territoire ainsi qu'une certaine jeunesse, sacrifiée dans les pires conditions et pour les pires conditions à venir, et ce, à travers des réseaux des plus criminels, proviennent d'une action pensée et voulue par les forces du Néantissement, du Vomito Nero le plus noir.
Quelles sont-elles? Je ne veux ni ne peux le dire ici, mais, que l'on sache qu'Alexandre Malar et ses compagnons François d'Espart et le fameux Tony Richmont vont avoir recours à l'aide, à l'appui et au soutien méta-stratégique de Jean le Chardonnais, dont l'identité dogmatique a reçu sa vivification indo-christianique sur les Hauts Plateaux himalayens.
Ce Jean le Chardonnais, le bien nommé, anime le Mouvement Social Européen d'Empire, le MSEE, qui devra venir en aide au Département Evaluation Stratégie (DES) que nos compagnons représentent avec l'appui, solitaire, du Président de la République.
Il faudrait encore signaler les présences de ces contre-feux méta-théologiques que sont le RP Valsan, jésuite des plus hétérodoxes, prêt à allumer le brasier d'une nouvelle théologie de la Chair aimante et irradiante, ainsi que l'influence et le corps d'enjeu que signale la présence de Raymond Abellio, lui aussi, foyer contre-stratégique dans la lutte contre le mystère d'Iniquité qui rampe et qui, en ces Temps, entend cesser sa reptation pour se dresser. Face à lui , il trouvera un autre Mystère, celui de l'Incendium Amoris et de ses fidèles, les Fidèles d'Amour (*).
Et ces Fidèles d'Amour, qu'il faut savoir toujours reconnaître dans la réalité triviale qui nous entoure, qui nous encercle toujours plus, sont ceux qui forment le groupe rejoint par Alexandre Malar; ces Fidèles d'Amour seront transfigurés par le combat contre l'«Homme noir à la tête d'insecte», épicentre ontique du Mal Absolu; ces Fidèles d'Amour, ne sont-ils pas les incarnations hohenstaufiques d'un certain Catholicisme marial et dantesque au service de «La Révolution Eurasiatique du Grand Renouveau Final», dont les bannières invisibles se gonflent du vent divin issu des Hauts Plateaux de l'Himalaya?
Fidèles d'amours vous disais-je!Le vent souffle, où il veut.
Max STEENS
(Bruxelles, juillet 2003).
(*) (ndlr) Et ceux qui savent, parmi nous, reconnaîtront le leitmotiv cardinal de l'action, à la fois ouverte et souterraine, de René Baert, martyrisé par les Iniques, et de Marc. Eemans, condamné par les mêmes Iniques à l'errance éveillée, à un ostracisme cruellement dosé, où on l'a forcé à voir comment on tuait l'esprit de Dante et de Frédéric II de Hohenstaufen, auquel il a consacré un manuscrit, toujours inédit, mais qui attend son heure, pour lancer sa charge contre les hordes hurlantes du Non-Etre.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, jean parvulesco |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 25 juillet 2008
Tolkien over financierders
Tolkien over financierders

“De ware vergelijking is: “democratie” = regering door wereldfinancierders… Het hoofdkenmerk van moderne regeringen is dat wij niet weten wie regeert, zowel de facto als de jure. Wij zien de politicus en niet zijn beschermheer; nog minder de beschermheer van de beschermheer of wat het belangrijkste van allemaal is: de bankier van de beschermheer. Getroond boven allen, op een manier zonder gelijke in heel het verleden, is de versluierde profeet van de financiën. Hij beheerst alle levende mensen door een soort van magie en levert orakels in een taal niet begrepen door de mensen”.
J.R.R. Tolkien,
Candour Magazine, 13 July 1956, p. 12
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, angleterre, lettres, citation, economie, finances, ploutocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 18 juillet 2008
Saint-Exupéry: donner un sens à l'homme
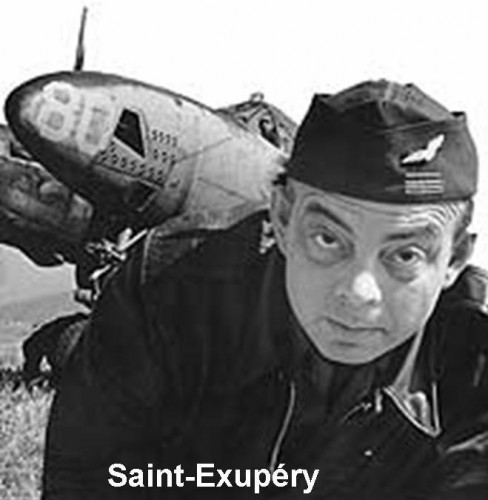
Klaus HORNUNG :
Antoine de Saint-Exupéry: donner un sens à l’homme
Où est donc passé le temps, désormais lointain, où les ouvrages de Saint-Exupéry remplissaient les vitrines des libraires et que leurs tirages atteignaient les centaines de milliers d’exemplaires, notamment la trilogie des romans d’aviation: “Courrier Sud”, “Vol de nuit”, “Terre des hommes” ; et aussi “Pilote de guerre”. “Le Petit Prince”, édité en français en 1946 et seulement en 1952 en allemand, avec son tirage de plus de quatre millions d’exemplaires, trouve encore des lecteurs aujourd’hui, surtout dans les maisons où souffle encore l’esprit de la “Bildungsbürgertum”, de la bourgeoisie lettrée et cultivée, et chez les adolescents. “ La Citadelle ” (1948) paraît en Allemagne en 1951 et est demeuré une lecture incontournable pour ceux qui aiment la réflexion et pour les conservateurs éthiques parmi nos contemporains. La figure centrale de cette oeuvre, le Grand Caïd (*), le Prince des sables sahariens, a reçu quelques fois le sobriquet de “Zarathoustra du désert”.
Saint-Ex’, comme l’appelaient ses amis, appartenait à la génération dite de l’ « éveil spirituel » qu’ont connu nos voisins français après la Grande Guerre. Cette génération comptait notamment Jacques Maritain, Georges Bernanos, François Mauriac, Gabriel Marcel, André Malraux et Emmanuel Mounier. Ce fut un courant intellectuel fort fertile, interrompu seulement par le nihilisme sans consistance du mouvement de mai 68. Aujourd’hui, deux générations après Saint-Exupéry, né le 29 juin 1900, le caractère indépassable de son œuvre et de sa pensée réémerge à la conscience de quelques-uns de nos contemporains.
Marqué par les bouleversements de son époque, Saint-Exupéry appartient à la grande tradition de l’humanisme occidental, à cette chaîne qui part de Platon pour aboutir à Pascal et à Kierkegaard, en passant par Saint Augustin ; il est, lui aussi, un de ces grands chercheurs de Dieu en Occident, même si l’on peut considérer que sa pensée ne débouche jamais sur les certitudes et la tranquillité des églises traditionnelles. Sa biographie indique la juxtaposition de deux attitudes divergentes: d’une part, il y a l’homme extraverti, qui est pilote ou reporter, qui relate ses impressions du Moscou de Staline ou de la guerre civile espagnole dans les années 30, et, d’autre part, il y a l’homme introverti, proche de la mélancolie, qui produit des méditations et des maximes à la façon des grands moralistes de son pays.
Sans poésie, sans couleur, sans amour et sans foi
Au moment où éclate la seconde guerre mondiale en septembre 1939, le pilote de l’aéropostale, déjà mondialement connu, qui amenait le courrier en Afrique occidentale et en Amérique du Sud, est mobilisé dans la force aérienne française. Son unité, après l’armistice, est repliée sur Alger. Pendant l’automne de l’année 1940, il revient en métropole. Il visite Paris occupé en compagnie de Pierre Drieu la Rochelle , pour se faire une idée de la situation nouvelle.
En décembre 1940, il se rend en bateau à New York, où il écrit « Pilote de Guerre », qui deviendra bien vite un best-seller aux Etats-Unis et en France, du moins jusqu’à son interdiction par les autorités d’occupation. Le départ de Saint-Exupéry pour les Etats-Unis fut sans conteste une décision patriotique contre l’occupation allemande et, plus encore, contre le totalitarisme national-socialiste.
En mai 1943, Saint-Exupéry se remet à voler, d’abord dans une escadrille américaine, équipée de Lightning et basée en Afrique du Nord, puis dans une escadrille de la « France Libre », basée en Sardaigne puis en Corse. Âgé de 44 ans, le 31 juillet 1944, il ne revient pas de son dernier vol de reconnaissance.
A Alger, il écrit, fin 1942, sa fameuse « Lettre aux Français », qui montre bien qu’il ne se considérait pas comme un simple « partisan » du gaullisme. A ce moment-là du conflit, alors que Vichy est déjà politiquement mort, il en appelle à la réconciliation des deux Frances, celle du Général de Gaulle et celle du Maréchal Pétain. Il ne s’agit pas de se poser en juge de la situation, écrivait-il, mais de dépasser les clivages politiques et intellectuels de la nation, ceux posés par les royalistes et les conservateurs, par tous les autres jusqu’aux socialistes et aux communistes, par tous les partis et cénacles cherchant à obtenir des postes politiques après la guerre. L’ennemi commun, pour Saint-Exupéry, s’incarnait dans les deux systèmes totalitaires : le marxisme, qui entendait rabaisser l’homme au statut de producteur et de consommateur et voyait dans la distribution du produit social le problème politique central ; et le nazisme « qui enferme hermétiquement les non-conformistes dans un camp de concentration », qui considère les masses comme un « troupeau de bétail à sa disposition », qui élimine le grand art par la diffusion de « chromos de couleurs » et ruine la culture humaine.
Dans sa « Lettre à un général », paru en juillet 1943 à Tunis, Saint-Exupéry affiche une fois de plus son indépendance d’esprit, lorsqu’il dit déceler du « totalitarisme » également dans la coalition anti-hitlérienne et le dénonce ouvertement : dans le monde industriel occidental, l’humanité « des robots et des termites » se répand, oscillant entre la chaîne de production et le jeu de skat ou de cartes aux moments de loisir.
Saint-Exupéry avait en horreur cette tendance de l’homme à la « vie grégaire », à cette existence vouée à l’éphémère, se réduisant à se préoccuper de « frigidaires, de bilans et de mots croisés », « sans poésie, sans couleurs, sans amour et sans foi » : c’est en effet un monde de décadence qui soumet, via la radio, les robots « propagandifiés » de l’ère moderne. Par des remarques d’une très grande pertinence, Saint-Exupéry critiquait le système capitaliste, pour la façon dont il s’était développé au 19ième siècle, générant ouvertement le « doute spirituel ». Ses critiques s’adressent également au système des « valeurs cartésiennes » qui induit une seule forme de raison rationaliste, étroite et unilatérale, se développant au détriment de toute véritable vie spirituelle. Celle-ci ne commence que « si l’on reconnaît un être unique par-dessus la matière et par le truchement de l’amour et que l’on prend, pour cette être, une responsabilité ».
Deux ans avant la fin de la guerre, le penseur et moraliste Saint-Exupéry, dans son uniforme de pilote, se demandait pourquoi l’on combattait, finalement, et quelles allures prendrait l’avenir. Il se demandait si, après la guerre, tout tournerait autour de la « question de l’estomac », autour de l’aide alimentaire américaine comme en 1918-19. Le vieux continent connaîtra-t-il, sous la pression du communisme soviétique avançant vers l’Europe centrale, une crise de cent ans sous le signe d’une « épilepsie révolutionnaire » ? Ou bien une myriade de néo-marxismes se combattront-ils les uns les autres, comme il l’avait vu pendant la guerre civile espagnole ? Cette Europe retrouvera-t-elle un « courant puissant de renouveau spirituel » ou bien « trente-six sectes émergeront-elles comme des champignons pour se scinder immédiatement », ? Saint-Exupéry dénonçait ainsi anticipativement ce monde dépourvu d’orientation que le Pape Benoit XVI, aujourd’hui, désigne sous le terme de « dictature du relativisme ».
Des communautés dans les oasis et près des sources
La quintessence de sa pensée, Saint-Exupéry nous la livre dans son ouvrage posthume, « La Citadelle ». Il avait vécu très concrètement le désert, lors de ses longs vols et de ses nombreux atterrissages forcés, comme un espace de dangers imprévisibles ou comme un lieu d’où vient le salut. Il avait connu sa dimension menaçante tout comme les points d’ancrage que sont ses oasis avec leur culture humaine. Le désert, dans cette œuvre littéraire et philosophique, devient l’équivalent de la vie de l’individu et de la communauté des hommes, pour les défis lancés à l’homme par un monde ennemi de la Vie , un monde où il faut se maintenir grâce à des vertus comme la bravoure et le sens de la responsabilité, à l’instar du soldat dans le fort isolé en plein dans ce désert, où, en ultime instance, il s’agit de construire des villes et des communautés viables, dans les oasis et près des sources.
Un scepticisme conservateur contre le monde moderne des masses
« La Citadelle » équivaut, sur le plan méditatif, à l’existence de l’homme en communauté et au sein d’un Etat. A la tête de cette « Citadelle » se trouve le Caïd, avatar du philosophe-roi de Platon, qui mène le combat éternel contre le relâchement et le déclin, qui appelle à ce combat, qui l’organise. Il a besoin de la communauté de beaucoup. Saint-Exupéry le décrit, ce Grand Caïd, non comme un dictateur mais comme un Prince empreint de sagesse, comme un père rigoureux, moins César qu’Octave/Auguste. A la vérité, Antoine de Saint-Exupéry est proche du scepticisme des conservateurs face au monde moderne des masses et de leurs formes démocratiques dégénérescentes. Ces formes nous conduisent assez facilement au danger qui nous guette, celui de l’entropie et de l’anarchie. Les masses verront alors un sauveur en la personne du prochain dictateur, exactement selon le schéma cyclique de l’histoire et de la vie politique que nous avait révélé Platon ; la prétendue « libération » de l’individu débouche rapidement sur le déclin et l’effondrement de la culture et de l’homme. La direction politique ne peut donc se limiter à viser des objectifs matériels ou à gérer des processus prosaïques : elle doit essentiellement travailler à consolider la culture et la religion.
Le mot d’ordre récurrent de Saint-Exupéry dans ses méditations, réflexions et maximes est le suivant : « Donner un sens à l’homme », un objectif qui le hisse au-dessus de son « moi », afin qu’il puisse résister aux éternels dangers de l’appauvrissement intérieur, du relâchement et de l’abandon de tous liens (Arnold Gehlen disait : l’ Abschnallen »), tant au niveau de l’individu qu’à celui de la communauté.
Klaus HORNUNG.
(article paru dans « Junge Freiheit », Berlin, n°27/2008 ; trad. Franç. : Robert Steuckers).
(*) Dans la version originale française, Antoine de Saint-Exupéry évoque non pas un « Grand Caïd », mais « le Chef ». La version allemande d’après-guerre ne retient évidemment pas ce terme de « Chef », trop connoté, et préfère le terme berbère « Kaid » alors qu’il aurait peut-être fallu dire le «Kadi », comme Abd-El-Krim fut honoré de ce titre. Nous avons préféré reprendre le terme « Caïd », car, aujourd’hui, parler comme Saint-Exupéry risquerait d’être mal interprété par les tenants de la « rectitude politique », comme on dit au Québec, et nous risquerions de récolter, une fois de plus, force noms d’oiseau et de quolibets.
A relire :Jean-Claude IBERT, « Saint-Exupéry », coll. « Classiques du XXe siècle », Editions Universitaires, Paris, 1960.
00:07 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres françaises, lettres, aviation, aéropostale, seconde guerre mondiale, petit prince |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 juin 2008
L'hallucination du monde d'après Antonin Artaud

L'hallucination du monde d'après Antonin Artaud
Si notre fin de siècle est si avide de commémorations d'événements de toutes natures, c'est bien la preuve que, gavée de progrès technologique, incapable de la moindre innovation politique et sociale, la société moderne s'enfonce dans un marasme irrémédiable qu'elle aura beau jeu de travestir en une improbable incarnation de la Fin de l'histoire. Pourtant, c'est presque en vain que l'on cherchera parmi ces innombrables remémorations un éventuel hommage rendu à l'occasion du centième anniversaire de la naissance ou du cinquantenaire de la mort d'Antonin Artaud (1896-1948). Mais il faut croire que l'œuvre atypique et inclassable du poète-acteur-dramaturge ne peut faire les frais de cette insidieuse tendance largement répandue dans le marigot gouvernemental qui consiste à ne regarder le monde qu'au travers des œillères manichéennes à bipolarité droite/gauche, alpha et oméga de toute pensée moderne; preuve s'il en était que nous avons depuis longtemps atteint les grandes profondeurs abyssales de l'inculture et de la démagogie politicienne. Cette impossibilité du recyclage de l'œuvre du «crucifié de la modernité » (cf. Xavier Rihoit, in Le Choc, n°11) tient pour beaucoup dans le fait qu'il est un des rares auteurs à véritablement répondre à la volonté nietzschéenne de «briser les fenêtres et sauter au dehors» des institutions de la société «où le long suicide de tous s'appelle la vie».
Antonin Artaud, né à Marseille en 1896 était de cette génération conçue pour le grand sacrifice de la première guerre, période charnière entre un 19ème siècle qui s'était clos sur le constat de «la mort de Dieu » et un 20ème siècle, né dans la violence et le sang d'une civilisation européenne à l'agonie. Mais s'il fut rapidement démobilisé pour raisons médicales (les premiers troubles nerveux, issus d'une méningite contractée à l'âge de cinq ans ou d'une syphilis héréditaire, coïncident avec le début de la guerre), il n'échappa pas pour autant, par le biais de la maladie, au lot de souffrances physiques et morales dévolu à ceux de sa classe d'âge, à ceci près que, dans son cas, le combat dura toute sa vie, avec pour seule trêve le refuge dans l'opium.
Des simulacres sans force que l'Europe prend pour des pensées…
De son état de maladie permanente, de l'irrépressible décadence de son corps naît une extrême sensibilité aux manifestations de la Puissance vitale de l'esprit exprimée par la culture ainsi qu'une révolte radicale contre ses caricatures car «jamais, quand c'est la vie elle-même qui s'en va, on n'a autant parlé de civilisation et de culture. Et il y a un étrange parallélisme entre cet effondrement généralisé de la vie qui est à la base de la démoralisation actuelle et le souci d'une culture qui n'a jamais coïncidé avec la vie, et qui est faite pour régenter la vie». C'est tout le simulacre de la fausse culture européenne qui est en cause et qu'il faut reformer, conformément aux aspirations profondes d'une volonté de retour aux sources de la vie: «Une tête d'Européen d'aujourd'hui est une cave où bougent des simulacres sans forces que l'Europe prend pour ses pensées».
Pour retrouver sa nature profonde, pour se sentir vivre dans ses pensées, la vie repousse l'esprit d'analyse où l'Europe s'est égarée. Comme cette tâche incombera à une jeunesse plus idéale que réelle, il écrit aux recteurs des académies de l'Education Nationale, vrais faux prophètes de la nouvelle idole jadis dénoncée par Nietzsche: «Assez de jeu de langue, d'artifice, de syntaxe, de jongleries, de formules, il y a à trouver maintenant la grande Loi du cœur, la Loi qui ne soit pas une loi, une prison mais un guide pour l'Esprit perdu dans son propre labyrinthe. A travers le crible de vos diplômes, passe une jeunesse efflanquée, perdue. Vous êtes la plaie d'un monde, Messieurs, et c'est tant mieux pour ce monde mais qu'il se pense un peu moins la tête de l'humanité». Dans les filigranes de la pensée d'Artaud, c'est bien sûr encore Nietzsche que l'on retrouve dans son rejet de la piètre érudition des pharisiens de la pensée. Car la réalité du monde est que «toute vraie culture s'appuie sur la race et sur le sang. Le sang [...] garde un antique secret de race, et avant que la race se perde, je pense qu'il faut lui demander la force de cet antique secret».
Le “Théâtre de la Cruauté”
C'est par le théâtre qu'Artaud expérimentera sa vision d'une culture vraie. Il est engagé dans la troupe de Charles Dullin, avant de fonder avec Roger Vitrac et Robert Aron le Théâtre Alfred Jarry en 1927. Dans le même temps, il mènera une carrière cinématographique qui lui fera privilégier les rôles d'illuminés fanatiques comme celui de Marat dans Napoléon et de Savonarole dans Lucrèce Borgia d'Abel Gance et surtout celui du moine Frère Massieu dans La passion de Jeanne d'Arc de Carl Theodor Dreyer. Mais le théâtre est encore l'occasion pour un Artaud influencé par le théâtre oriental et le théâtre antique, de redéfinir et de perfectionner un art véritable, débarrassé de tout esthétisme gratuit, du psychologisme creux de la réalité quotidienne, de la suprématie de la parole pour redevenir la pure manifestation de la vie elle-même dans sa dimension la plus sacrée, où la parole, les cris, les sons sont recherchés d'abord pour leur qualité vibratoire et retrouvent le pouvoir de l'incantation, où les personnages ne sont plus considérés comme des hommes mais comme «des êtres qui sont chacun comme des grandes forces qui s'incarnent». Ce théâtre sera baptisé “Théâtre de la Cruauté”, la cruauté signifiant, ici, «rigueur, application et décision implacable, détermination irréversible, absolue».
Une révolution personnelle
En des temps historiquement troublés, la référence révolutionnaire devient obligatoire pour tous ceux qui penchent du côté de la vie intense mais elle prendra tout son sens dans la volonté vitale d'Artaud. Un temps rallié au premier mouvement surréaliste et à ses tentatives spiritualistes, il opposera rapidement sa révolution personnelle, conçue comme un véritable retour sur soi-même au ralliement des André Breton et Louis Aragon au bolchevisme et à la révolution matérialiste qu'il accusera plus tard de donner naissance à une idolâtrie de nature religieuse «parce qu'elle introduit une mystique de l'esprit». Mais la liberté inconditionnelle d'Artaud ne s'embarrasse d'aucun préjugé idéologique et c'est dans le même état d'esprit qu'il rejettera avec le matérialisme, la république, la démocratie, le socialisme, le communisme, le marxisme, etc. ... et toutes les formules creuses gravées au fronton des palais institutionnels mais sans pour autant s'exclure du monde car: «Il y a une manière d'entrer dans le temps, sans se vendre aux puissances du temps, sans prostituer ses forces d'action aux mots d'ordre de propagande... Il y a des idoles d'abêtissement qui servent au jargon de propagande. La propagande est la prostitution de l'action, et [...] les intellectuels qui font de la littérature de propagande sont des cadavres perdus pour la force de leur propre action ».
A la recherche de sa propre révolution, Artaud, qui connaissait déjà l'œuvre du métaphysicien «traditionaliste» René Guénon va se plonger de plus en plus dans l'étude des textes sacrés des cultures orientales et aryennes et s'embarquera pour le Mexique, à la recherche d'une civilisation authentique, constatant à la suite d'Oswald Spengler, l'irrémédiable décadence de l'Occident. Cet aspect de la décadence, il l'avait déjà mis en scène par la figure historique de l'empereur d'une Rome déliquescente, Héliogabale, dans ses débordements chaotiques de prostitution du Rite et de sacralisation de l'obscène. Mais il n'y a «rien de gratuit dans la magnificence d'Héliogabale, ni dans cette merveilleuse ardeur au désordre qui n'est que l'apparition d'une idée métaphysique et supérieure de l'ordre, c'est à dire de l'unité».
L'anarchiste couronné
A Jean Paulhan, son éditeur qui s'inquiétait de la véracité historique des faits décrits par Artaud, il répondit «vrai ou non, le personnage d'Héliogabale vit, je crois, jusque dans ses profondeurs, que ce soient celles d'Héliogabale personnage historique ou celles d'un personnage qui est moi». C'est donc Artaud qui est le véritable «anarchiste couronné», contempteur de la décadence et de l'unité perdue du monde et qui vient annoncer sa définition de l'anarchiste: «C'est celui qui aime tellement l'ordre qu'il n'en accepte pas de parodie».
Automythographie
En fait, si le théâtre doit être pour Artaud la représentation de la réalité, la réalité est également un théâtre où Artaud va toute sa vie durant s'efforcer de mettre en scène Artaud, ce qui lui vaudra d'être qualifié d'homme-théâtre par Jean-Louis Barrault. La totalité de son œuvre est d'essence autobiographique —Camille Dumoulié dans son essai intitulé simplement Antonin Artaud parle d'automythographie— et est ainsi résumée par l'auteur: «Entre le réel et moi, il y a moi, et ma déformation personnelle des fantômes de la réalité».
Antonin Artaud, littéralement possédé par son état de fureur permanente est celui qui aura poussé au plus haut point la logique de la subjectivité, liberté d'esprit totale garante d'une vision du monde entièrement débarrassée des conformismes, conventions et idéologies qui réduisent l'homme à être un simple rouage de l'Etat, pour retrouver l'Intuition de sa Puissance vitale. Maître de son propre monde et dieu de sa propre foi, cette âme écorchée vive plutôt que simplement désincarnée payera pourtant le prix fort de sa quête par neuf années d'internement en maison psychiatrique. En 1948, deux années après sa libération —mais en ces temps on libérait les Antonin Artaud des asiles d'aliénés seulement pour y enfermer les Ezra Pound et les Knut Hamsun— il allait s'éteindre, juste après une ultime vocifération contre l'homme civilisé, justement symbolisé par l'Amérique qui a cru vaincre la nature mais s'est entièrement soumis et enchaîné à la technologie. Ce qui reste aujourd'hui de «l'étendard calciné de la jeunesse » (selon Breton) est l'essentiel; ainsi pour Roger Blin, un des compagnons de ses derniers instants «je ne connais Artaud que par sa trajectoire en moi, qui n'aura pas de fin » et pour le biographe Dumoulié «le legs d'Artaud n'est ni un savoir, ni une méthode, mais une puissance de contagion qui voue le corps et l'esprit au travail d'une perpétuelle genèse».
Frédéric SCHRAMME.
Bibliographie :
Antonin Artaud :
◊ Le théâtre et son double, folio, essais, n°14.
◊ Messages révolutionnaires, folio, essais, n°20.
◊ Pour en finir avec le jugement de Dieu, document sonore.
◊ Œuvres complètes, Gallimard.
◊ Camille Dumoulié: Antonin Artaud, coll. “Les contemporains”, Seuil.
00:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, art dramatique, théâtre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 26 juin 2008
Entretien avec Jean Dutourd
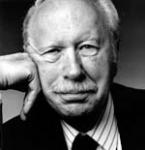
Entretien avec Jean Dutourd,
Membre de l'Académie française
Membre de l'Académie française, Officier de la Légion d'honneur, Commandeur de l'ordre national du mérite, Officier des Arts et Lettres, Jean Dutourd est redouté pour ses propos anticonformistes, et, généralement, admiré pour sa liberté de ton. Il a bien voulu nous accorder un entretien dans lequel il se livre en partie, cela à l'occasion de la parution de ses mémoires.
Q.: Aujourd'hui, quelle est la situation de la culture française ?
JD: Comme toujours en péril. Un peu moins qu'il y a cent ans, quand même.
Q.: Quels sont les principaux périls que rencontre notre culture ?
JD: Les mêmes que rencontre toute culture: la paresse intellectuelle, laquelle marche du même pas que l'indifférence pour la patrie.
Q.: Et l'américanisation, dans tout cela ?
JD: L'Europe se renie depuis trente ou quarante ans. On a le sentiment que toute son ambition est de devenir une colonie américaine, avec ce que cela signifie de docilité politique, d'adoration idiote, de mimétisme. Le comble du chic en Europe est de copier servilement la métropole, c'est-à-dire New York. Lorsque la France cessera de se conduire comme une colonie, jusqu'à parler petit-nègre, elle redeviendra ce qu'elle était naguère.
Q.: C'est-à-dire ?
JD: Le contraire de ce qu'elle est aujourd'hui. Qu'elle rêve d'imaginer qu'elle sera de nouveau gaie et insouciante, comme en 1860 ou 1913!
Q.: Avec l'Europe que l'on nous prépare, pensez-vous que la France puisse disparaître ?
JD: Je crois que la France a été, au cours de son histoire exposée à des périls ou des tentations pires. Ce n'est pas "croire au miracle" que de croire à la persévérance du génie français, lequel, en mille ans, a démontré plusieurs fois qu'il était insubmersible.
Q.: Avez-vous l'impression que les Français veulent le rester ?
JD: Pour le moment, non, mais, il faut se garder de confondre la France et les Français. Ceux-ci sont une peuplade changeante, tantôt sublime, tantôt abjecte... La France est une œuvre d'art dont l'accomplissement a pris mille ans. Les Français changent de génération en génération, mais Notre-Dame ne bouge pas, ni le Louvre, ni même la Tour Eiffel.
Q.: On a pourtant l'impression que certains politiques veulent que la France disparaisse au sein de l'Europe...
JD: On a surtout l'impression que les hommes politiques sont épouvantés par l'idée de prendre des responsabilités, de s'engager dans des voies irréversibles, de regarder le destin en face, et, lorsqu'il le faut, s'opposer a lui. L'Europe est un excellent alibi pour ces gens-là. Elle leur donne le pouvoir sans les obligations du pouvoir. Comme disait Péguy des politiciens de son temps :"lls ne veulent pas se salir les mains, mais ils n'ont pas de mains".
Q.: A quand remonte le fait que nos dirigeants politiques refusent les responsabilités, qui pourtant leur incombent ?
JD: Je crois que cela remonte à l'entre-deux guerres? La France était fatiguée de la guerre de 14 —et il y avait lieu de l'être. Elle en était sortie exsangue. A ce moment-là nos politiques ont étés atteints d'une espèce de crise de volonté. Toutefois, à cette époque, les vieilles armatures existaient encore et on ne voyait pas les âmes nues (ou le manque d'âmes). Tout s'est effondré en 1940.
Q.: Pensez-vous que les imbéciles soient nuisibles ?
JD: La terre est peuplée d'une infinité d'imbéciles, lesquels choisissent dans leur sein quelques-uns d'entre eux pour les conduire, ce qui explique la plupart des tragédies ou "drames nationaux" dont l'histoire des démocraties est jalonnée. Au principe de ces drames, on trouve à peu près infailliblement la bêtise, c'est-à-dire les vues courtes des dirigeants, leur absence d'imagination et de prévoyance, leur défaut d'audace allant jusqu'à la pusillanimité, leurs chimères puériles, toute chose qui ne déplaise pas au peuple souverain...
Q.: C'est plutôt tragique, ce que vous nous dites là...
JD: Lorsque la tragédie s'abat sur la nation, elle n'apporte pas avec elle que de la désolation et des souffrances, mais aussi une espèce de contentement mystérieux. La tragédie est la justification de la bêtise, sa sublimation; elle la sanctifie, elle la transforme en légende...
Q.: Etes-vous d'accord avec Maurras, lorsqu'il affirme que "vivre, c'est réagir" ?
JD: Bien sûr, mais cette pensée n'est pas une des plus originales de Maurras...
Q.: Vous gardez donc espoir ?
JD: Forcément, je ne peux pas faire autrement, je suis homme de lettres. Alors, j'ai besoin qu'il existe toujours des Français afin qu'on lise mes livres après que je sois mort.
Q.: N'avez-vous pas l'impression que votre discours soit "ringard" ?
JD: Léautaud avait une phrase magnifique, que je me suis empressé d'adopter dès que je l'ai découverte: "On dit que je suis un homme d'un autre âge, tant mieux, c'est plus chic". Dans la France actuelle, qui mange du pain industriel et du poulet à la dioxine, qui baragouine un sabir vaguement américain, qui ne connaît plus rien de son passé et de ses grands écrivains, qui est pleine de voleurs et d'assassins, je crois qu'il est essentiel d'être ringard, attardé, vieille lune, bref, disciple de Mallarmé et de Flaubert.
Q.: Quel est le message que vous souhaitez donner aux jeunes ?
JD: J'attendrai qu'ils aient un peu vieilli et lu quelques bouquins avant de le leur transmettre.
Q.: Vous étes toujours monarchiste ?
JD: Plus que jamais. C'est le seul régime commode que les hommes aient jamais trouvé.
(propos recueillis par © Xavier Cheneseau).
L'invité en quelques dates:
1944-1947 - Il est administrateur adjoint de Libération.
1947-1950 - Jean Dutourd est directeur de deux programmes de la BBC à Londres.
1957-1959 - Il est Président du syndicat des écrivains français.
1950-1966 - Il est conseiller littéraire aux Editions Gallimard.
1963-1970 - Jean Dutourd est critique dramatique de France-soir.
1978 - Jean Dutourd est élu à l'Académie française.
L'invité en quelques livres:
1946 - Le complexe de César (Prix Stendhal)
1948 - Le déjeuner du Lundi
1949 - L'Arbre, Une tête de chien (Prix Courteline)
1950 - Le petit Don Juan
1952 - Au bon beurre (Prix Interallié)
1955 - Doucin
1956 - Les taxis de la Marne
1958 - Le fond et la forme
1959 - Les dupes, L'Ame sensible
1961 - Le fond et la forme (tome II), Rivarol
1963 - Les horreurs de l'amour
1964 - Le demi-Solde, La fin des peaux-rouges
1965 - Le fond et la forme (tome lll)
1967 - Pluche ou l'Amour de l'art, Petit journal
1971 - Le paradoxe du critique, Le crépuscule des loups
1972 - Le printemps de la vie
1973 - Carnet d'un émigré
1975 - 2024
1977 - Cinq ans chez les sauvages
1977 - Mascareigne
1978 - Les matinées de Chaillot
1978 - Les choses comme elles sont
1980 - Le bonheur et autres idées, Mémoire de Mary Watson
1982 - De la France considérée comme une maladie
1983 - Henri ou l'éducation nationale
1983 - Le socialisme à tête de linotte
1984 - Le septennat des vaches maigres
1985 - La gauche la plus bête du monde
1986 - Contre les dégoûts de la vie, Le spectre de la rose
1987 - Le séminaire de Bordeaux
1989 - Ça bouge dans le prêt à porter
1990 - Conversation avec le Général, Les Pensées, Loin d'Edimbourg
1991 - Portraits de femmes
1992 - Vers de circonstance
1993 - L'assassin
1996 - Le feld-maréchal von Bonaparte
1999 - Que vive le Peuple Serbe (ouvrage collectif)
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, entretiens, académie française, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 24 juin 2008
Céline musicien
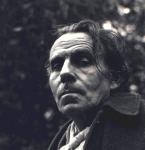
Céline musicien
Chez Nizet est paru Céline musicien de Michael Donley. L'éditeur écrit: «La petite musique de Céline? Quelque chose qui va de soi, serait-on tenté de dire. De nos jours, aucun lecteur informé n'ignore la façon hautement poétique dont l'écrivain a su maîtriser les aspects sonores et rythmiques du français, surtout du français parlé. Pourtant, on a tendance à oublier que Céline emploie le mot "musique" non seulement pour désigner le style de ses livres, mais aussi en se référant à ce qu'il essaie de capter: "la musique intérieure", "la musique de l'âme". De fait, la musique —cette "catalyse de toute grâce", comme il l'a définie— est la matrice de son œuvre entière. Mais qu'est-ce que la musique? En essayant de répondre à cette question, l'auteur démontre que la petite musique de Céline —loin d'un maniérisme syntaxique ou d'un bricolage cosmétique— n'est autre que la mise à jour du véritable contenu de ses livres» (JdB).
Michael DONLEY, Céline musicien, 2000, Librairie Nizet, F-37.510 Saint-Genouph, 338 pages, 190 FF.
00:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, livres, céline, musique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 17 juin 2008
Dostoïevski et la problématique Est-Ouest

DOSTOÏEVSKI ET LA PROBLÉMATIQUE EST-OUEST
Source :
Walter Schubart (1897-1941), extrait de Europa und die Seele des Ostens (1938), in revue Vouloir n°129/131, janv. 1996. Tr. fr. : L'Europe et l'âme de l'Orient, tr. D. Moyrand et N. Nicolsky, Albin Michel, 1949. [N.B. : il existe également une traduction italienne de ce livre : L'Europa e l'anima dell'oriente (tr. Guido Gentilli, Ed. di Comunità, Milano, 1947. Recension : Rivista di filosofia, n°2/1948, p. 200-201) ; une espagnole : Europa y el alma de oriente (Edic. Studium de Cultura, Madrid, 1946) ; une anglaise : Russia and Western Man (tr. A. von Zeppelin, F. Ungar Publishing Co., NY, 1950). On pourra aussi se reporter pour une étude sur cet auteur à : A. Vitale, Il destino dell'Europa e la rinascita della Russia. Note su Walter Schubart, in Futuro Presente n°7 (1995), p. 81-90].
Dostoïevski est l'écrivain de la maladie de l'âme russe, qui était encore rampante en son temps et qui a attendu le bolchevisme pour éclater au grand jour. Dostoïevski n'est plus campé sur un sol ferme, comme l'étaient les slavophiles. La sérénité plaisante, jouissant d'immenses espaces, de l'ancienne vie russe lui est étrangère. Il ne vit et ne décrit pas la Russie moscovite, comme Griboïedov ou Ostrovski - même s'il est originaire de Moscou - mais l'époque de Saint-Pétersbourg dans l'histoire russe, au moment où deux approches sentimentales du monde entrent en collision sur le sol russe, au moment où l'Asie et l'Europe se rencontrent dans le cœur de l'homme russe. Ses héros sont des représentants de l'intelligentsia pétrinienne, dont les âmes déchirées sont le théâtre où s'affrontent et s’entre-déchirent dans une lutte mortelle le vieil esprit oriental et le nouvel esprit occidental. De là, l'énergie débridée et dramatique de ses romans qui, dans leur construction, leur structure et leur dynamique sont en fait des tragédies. On ne discerne rien en eux de l’ampleur épique, et on n'a nullement l'impression de pénétrer dans l'immédiateté d'un monde bien clos.
Une profonde césure le sépare des autres écrivains russes, qui ont vécu avant lui ou qui sont ses contemporains : Pouchkine, Tourgueniev, Tolstoï, Gontcharov. Jamais Dostoïevski n'aurait pu créer un Oblomov. Ensuite, il est très éloigné de cette "littérature des propriétaires terriens" qui s'enracine profondément dans le sol de la Russie et dans l'essence de la russéité et qui fait ressortir ses personnages exceptionnels et captivants d'un arrière-plan qui est cette vie harmonieuse, sans discontinuité apparente, propre des familles nobles russes (Dostoïevski appartient pourtant à la noblesse héréditaire, tout comme Tolstoï). Dostoïevski n'avait pas un regard pour le monde de la tradition. Il sentait et annonçait une future révolution de l'esprit, dont ses contemporains ne devinaient rien. Il voyait le combat planétaire entre l'esprit prométhéen et l'esprit oriental.
CAESAR ET IMPERIUM
Les 2 idées les plus pourries et les plus pervertissantes que l'Europe prométhéenne avait suscitées étaient l'idéal de la "forte personnalité" et l'idéal de l'État dominateur. Ce sont les 2 motifs latins du Caesar et de l'Imperium. Dostoïevski s'en prend au premier de ces motifs dans Crime et châtiment, au second, dans Les Démons [connu aussi sous le titre français Les Possédés]. La doctrine fallacieuse des "hommes forts", avec son corollaire, les droits spéciaux qu'ils s'arrogent - au nom d'un droit dynastique, ou comme le Prince de Machiavel ou le Surhomme nietzschéen, toutes figures qui dominent l'imagination des Européens de l'Ouest - est affrontée dans Crime et châtiment, roman qui va consacrer la célébrité de Dostoïevski jusqu'à la fin des temps.
Raskolnikov suit un mot d'ordre : tout est permis. Il s'enthousiasme pour l'humanité dominatrice et il veut se prouver à lui-même et au monde qu'il "n'est pas un misérable poux comme tous les autres". Il tue une usurière, parce qu'il "veut être Napoléon". Mais la voie du crime ne le hisse pas pour autant sur les sommets de la divinisation de l'homme, mais dans la cellule isolée du pénitent contrit, où il acquiert "une nouvelle vision de la vie". Il doit reconnaître que l'homme n'est pas Dieu et, en posant ce constat en pleine crise de contrition, il reconnaît l'existence de Dieu. Il avait voulu prouver l'existence du Surhomme et finit par se prouver, à lui-même et par son propre acte criminel, l'existence de Dieu. "Même le fort est un misérable poux comme tous les autres". Le cri qui appelle le châtiment rédempteur est plus fort que les séductions de la vanité, la sacralité de la renaissance rend plus heureux que l'ivresse de la violence et du pouvoir. Le divin dompte l'homme sodomite qui est en lui.
PÉCHÉ D'ORGUEIL
Raskolnikov commet le péché originel de l’orgueil et de la morgue, de la volonté de puissance, qui induit l'homme à se séparer de ses frères et à se hisser au-dessus d'eux (le nom du héros est bien choisi, car Raskol signifie séparation, césure, brisure). C'est le délit prométhéen, le péché de l'Europe. Raskolnikov est le type du Russe qui est saisi par le poison occidental et qui s'en débarrasse et s'en nettoie par une chrétienté renouvelée. L'Europe est le Diable, la tentatrice des Russes. Crime et châtiment est un réquisitoire terrible, déstabilisant, contre les idéaux de domination de l'Ouest, comme personne auparavant n'avait osé en prononcer ou en écrire. La question : César ou Christ ? Telle est la thématique du roman. La meute des tièdes ne sait rien, ni de l'un ni de l'autre.
Car les tièdes ne veulent être que bourgeois, et le bourgeois est l'homme qui est également incapable de commettre un acte délictueux ou de réaliser une action sublime, également incapable d'être criminel ou d'être victime innocente. Mais toutes les grandes et fortes natures luttent pendant toute leur existence pour répondre à cette seule question : César ou Christ ? La réponse de Dostoïevski, la future réponse de l'Est c'est : le Christ, rien que le Christ, et non pas César ! Il faut sortir de cette fierté isolée, il faut se débarrasser de cette folie à toujours vouloir être "autonome", il faut accepter l'humilité, le don de soi, le rôle de la victime !
Raskolnikov est un pécheur qui trouve la grâce, qui retrouve le chemin vers "l’idéal de la Madonne". Mais cette voie qui va du crime à la renaissance en passant par le repentir n'est qu'une voie possible, parmi d'autres. L'autre conduit du crime à l'auto-destruction en passant par une fierté qui refuse de plier, de se briser. C'est la voie qu'emprunte Svidrigaïlov. Il est une sorte d'alter ego de Raskolnikov, mais il reste un vulgaire criminel, incapable de repentir, qui persiste dans sa fierté et son défi. En lui, Raskolnikov perçoit le mal, le mal qui est aussi en lui mais qu'il va extirper. C'est entre ces deux attitudes que l'homme doit choisir. Entre la voie de l'humilité et celle de l'auto-destruction, entre le repentir et le suicide. Le mal, qui ne peut accéder au repentir, se tue lui-même. C'est l'esprit de la destruction qui se retourne finalement contre ceux qui l'incarnent et le portent en eux. Voilà bien l'idée-force de Dostoïevski !
Stavrogine, Kirillov et Verkhovenski empruntent la même voie que Svidrigaïlov. Kirillov se suicide pour prouver au monde qu'il ne craint pas la mort. C'est la seule épreuve que le monde peut encore lui soumettre, car ce monde n'est plus lié à lui par aucun fil intérieur. "Celui qui ose se tuer est Dieu", pense-t-il. Ainsi, il pose une équation entre Dieu et l'esprit de destruction. C'est le destin de ceux qui poursuivent la chimère de l'Homme-Dieu. Ils se tuent ou on les tue. César aussi fut tué, et cette mort est définitive ; il n'y a pas de résurrection hors du tombeau. Dostoïevski perçoit le fondement même de l'idéal de la "forte personnalité" et reconnaît que celle-ci sacrifie l'amour vivant. Culte des héros ou idéal de fraternité, paganité égoïste ou renaissance dans le Christ, l'Europe ou la Russie : c'est ainsi que Dostoïevski pose la question du destin.
SE REPENTIR OU SE SUICIDER
Dans son personnage de Raskolnikov, Dostoïevski a créé la tragédie personnelle de celui qui rompt avec Dieu, dans Les Démons, il décrit la tragédie sociale que provoque cette rupture. Au bout du chemin vers le Surhomme, nous trouvons le repenti ou le suicidé. Tel est le sens de Crime et châtiment. Au bout du chemin vers le socialisme athée, nous trouverons la dissolution de la société ou le retour au christianisme : tel est le sens des Démons. Dans le premier de ces romans, Dostoïevski lutte contre la figure de l'homme dominateur, dans le second, contre l'idéal de l'État dominateur. Dans le premier de ces livres, il réfute Nietzsche, dans le second, il réfute Marx. Il ne connaissait pourtant l’œuvre ni de l'un ni de l'autre, mais il les connaissait au fond implicitement tous 2 comme des possibles de l'âme, comme des types spirituels.
Et, ce qui est le plus extraordinaire, Dostoïevski a vu le rapport intérieur qui unissait ces 2 types. Il était nettement meilleur visionnaire que l'homme contemporain, dont le regard est troublé, ne se pose que sur les phénomènes superficiels, devine ou voit des contradictions, là où il y a en fait des parentés. Comme Nietzsche, Marx cherche - et chez lui, c'est sans nul doute un héritage de la foi judaïque - ce qui doit remplacer Dieu et faire advenir le Ciel sur la Terre. Marx aussi fait de l'homme d’aujourd’hui un simple moyen pour forger l’homme de demain. Seul l'homme du futur, qui doit être créé par recours à la violence, justifie l'homme actuel, livré au hasard, à lui-même, l'homme qui n'a pas été voulu par l'homme, qui précédé la figure de demain. Mais Marx envisage une autre anthropologie que celle de Nietzsche : il mise sur un être social en devenir et non pas sur des individualités accomplies et isolées. C'est donc une prédisposition différente qui conduit chez lui à ce besoin d'absolu, qu'il possède en lui, tout comme Nietzsche, et qui le mène sur une autre voie.
CONTRE NIETZSCHE ET CONTRE MARX
Mais tous 2 font perdre à l'homme sa liberté, sa valeur propre, sa signification absolue. Tous 2 veulent remplacer le divin par l'exercice d'une coercition, dans la mesure où il veulent fabriquer un nouveau divin. La doctrine du surhomme veut un dieu tellurique, le socialisme un ciel terrestre autant de religions apparentes qui s'oppose au christianisme, qui trahissent l'idée de fraternité et la remplace par un idéal de violence. Les points de départ de ces confessions sans dieu sont différents, mais leur point d'aboutissement est le même. Marx vise l'État idéal où tous seront égaux et pareils, Nietzsche vise le despotisme du surhomme. Mais il n'y a pas d'égalité sans un desposte qui puisse la garantir, et il n'existe pas de despotisme qui ne conduise pas à l'égalité des opprimés. Le surhomme et l'homme-masse croissent sur le même terreau. La doctrine du surhomme et le socialisme, c'est finalement la même chose, mais vue sous des angles différents Nietzsche et Marx sont tous 2 - et à égalité - les précurseurs intellectuels de la dictature, de la décadence de l'éthique et du déclin de la liberté. Entre eux existe cette parenté qui unit aussi Raskolnikov et les héros des démons. Dans le vécu intérieur de Dostoïevski, tous 2 retournent à l'unité de leur origine.
Dostoïevski a vu qu'avec le socialisme et la doctrine du surhomme, les grands mouvements d'opposition à la religion émergeaient, qu'ils se reconnaissaient dans une pure immanence, qu'ils tentaient d'étancher une terrible soif de métaphysique en nous abreuvant de valeurs éphémères. Car ce sont les doctrines et les courants de pensée d'un âge intermédiaire. Par elles, cet esprit rationnel, froid, tellurique, propre de l'Occident, vient à couler dans cette ardente propension de l'Orient à la foi : mélange fatal. Une fois de plus, c'est l’Europe qui est la tentatrice, le diable pour les Russes. Comme dans Crime et châtiment, où c'est l'individu qui est saisi par l'esprit de l'Occident, dans Les Démons, c'est la société russe toute entière qui en est victime. Nous avons donc d'une part le conflit de la russéité avec l'idée occidentale au niveau de l'individu, et d'autre part, au niveau de la société.
Les deux romans suggèrent une même résolution de cette tension : la victoire de l'esprit russe-chrétien sur l'esprit prométhéen-européen. "C'est par l'Orient que la Terre retrouvera son rayonnement" (cette vision de la victoire finale du Christ a été reprise 2 générations plus tard par Alexandre Blok dans son poème révolutionnaire Les Douze). Dostoïevski lui-même s'était laissé prendre aux mirages de l'Occident et avait payé cet engouement d’un long bannissement en Sibérie. Plus tard il s'est repenti et a reconnu la perversité fondamentale de ces doctrines occidentales ; c'est ainsi qu'il a pu les dépasser. La russéité dans son entièreté souffre du même destin dans Les Démons. Tandis que les représentants criminels de l'esprit occidental - le mal qui jamais ne se repentit - connaissent une fin cruelle, le peuple, resté russe, est sauvé par sa foi et retourne, plein de repentir, vers le message de Jésus.
Dans Les Démons, Dostoïevski maudit, comme plus tard dans la légende du Grand Inquisiteur, l'unification des hommes par coercition, la "fourmilière mise au diapason", le "palais de cristal", la tentative aussi folle que présomptueuse, de réaliser le bonheur terrestre par la violence, la coercition, et sans faire appel à la grâce divine. "C'est de la folie de vouloir forger une ère et une humanité nouvelles en coupant 100 millions de têtes". Il décèle l'élément césarien dans le socialisme révolutionnaire, chez cette intelligentsia russe qui semble tant aimer la liberté. "Le socialisme français" - le seul que connaissait Dostoïevski - "est la poursuite fidèle et conséquente d'une idée qui nous vient de la Rome antique et qui s'est maintenue dans le catholicisme" (cf. Journal d'un écrivain). Les Romains et les Russes sont des ennemis éternels !
Dostoïevski voit dans le socialisme une forme particulière de la révolte contre Dieu. C'est pourquoi, lui, l'ancien forçat de Sibérie, ne se met pas du côté des révolutionnaires. Son refus de la révolution n'est pas d'essence bourgeoise, elle est d'essence chrétienne. Il est un adversaire de la révolution parce qu'il aime la liberté et Dieu. Il croit et il décrit sa foi dans Les Démons : après la révolution désacralisante, adviendra une révolution porteuse de sacré qui répandra une nouvelle fois dans le monde l'esprit de l'Est. C'est ce message que nous transmet Dostoïevski par la bouche de son personnage Chatov : "Je crois que le retour du Christ aura lieu en Russie". Il prévoyait que la Russie, après la folie des démons, accéderait à une nouvelle forme de socialisme qui lui conviendrait. Qu'entendait-il par là ?
La dernière notice de son Journal nous l'apprend : "La foi du peuple en l'Église tel est le socialisme russe" : en l'Église intériorisée, qui n'a nul besoin de dépasser les différences sociales extérieures, parce qu'elle mesure l'homme selon les critères de "l’Empire intérieur", parce qu'elle nous place tous à égalité devant Dieu, en l'Église comme fraternité spirituelle, comme communauté des "re-nés" dans sa plus grande extension : la fraternisation mondiale dans le Christ : voilà la forme sociale par excellence de la russéité et rien d’autre, voilà l'expression sociale de ce sentiment de totalité, de cette pan-humanité d'esprit oriental qui est destinée à lutter jusqu'à la mort contre les idées occidentales du césarisme et de l'impérialisme. L'écrivain classique qui a exprimé et illustré cette lutte, c'est Dostoïevski.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, eurasisme, géopolitique, slavistique, dostoïevski |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 juin 2008
Les châteaux en Espagne de Rémi Soulié

Les châteaux en Espagne de Rémi Soulié
Entretien
A quelques jours de la parution de son nouvel essai, Le vrai-mentir d'Aragon, Aragon et la France, aux éditions du Bon Albert, Rémi Soulié a accepté de nous entretenir de son précédent ouvrage, publié chez L'Age d'Homme, Les Châteaux de glace de Dominique de Roux
«De Roux a renouvelé notre façon de lire. Là encore, c'est révolutionnaire»
Pourquoi, aujourd'hui, écrire sur Dominique de Roux? Son nom, qui reste sulfureux (on se souvient du mot: «A force d'être traité de fasciste, j'ai envie de me présenter ainsi: moi, Dominique de Roux, déjà pendu à Nuremberg»), n'a laissé aucun chef-d'œuvre impérissable. Ses livres sont pour la plupart des collages d'idées anarchiques, anarchiquement assemblées pour former une pâte de textes indigestes jetée sans autre souci à la figure d'un lecteur qui n'est pas habitué à être reçu ainsi. Mis à part une poignée d'irréguliers, personne ne le réclame. Seuls quelques éditeurs hors du sérail ont relevé le pari de publier les fulgurances et les formules bancales de ce styliste épileptique, qui se voulut tour à tour et en même temps géométaphysicien, poète dissident du monde, impérialiste pacifique infiltré à la solde d'une Internationale révolutionnaire gaulliste qui n'exista jamais ailleurs que dans son esprit enfiévré. Sa vie brusquement écourtée ressemble à l'image finale de ce film de Werner Herzog, Aguirre, où l'on voit Klaus Kinski dériver seul sur un radeau au milieu dune multitude de petits singes jaunes à têtes noires, debout dans son armure rouillée de conquistador renégat, défiant Dieu, le regard halluciné, dévoré par son rêve d'empire d'au-delà de la jungle amazonienne, avec la caméra qui s'éloigne. Pourquoi en effet, quand on s'appelle Rémi Soulié, écrire une biographie de Dominique de Roux, sinon pour tout ce qui vient d'être dit ?
Dès la première page des Châteaux de glace le ton est donné: «Rêvons un peu à une France vomissant ses tièdes et ses mous! Plus de sociaux-démocrates ni de démocrates-chrétiens, plus de libéraux sociaux ni de sociaux libéraux! La politique enfin restaurée en mystique par quelques royalistes, des gaullistes métaphysiques aussi et des révolutionnaires intacts à la Fajardie! "Heureux comme Dieu en France", cette neuvième béatitude sortirait de la morgue où la science épigraphique congèle les anciennes sentences!» Soulié, maurrassien c'est sûr, n'aime pas son époque, aux songes creux et à la bouche pleine de gargouillis («droits de l'homme», «citoyenneté», «démocratie»...), et encore moins sa littérature. La gauche, hier insurgée, s'abîme dans la social-démocratie. La droite a trahi de Gaulle —c'était quand? Les écrivains se regardent le nombril et les éditeurs jouent les barbouzes. Lui voudrait un écrivain qui soit à la fois un idéologue et un aventurier, de droite et un peu à gauche, un militant et un esthète, Lawrence et Rimbaud, Monfreid et Malraux. Sa rencontre avec de Roux était fatale.
Ecrire une biographie c'est aussi, c'est surtout, écrire sur soi-même, retracer les étapes d'une vie étrangère pour mieux comprendre son propre cheminement intérieur. Rémi Soulié a donc mis ses pas dans ceux du Don Quichotte aveyronnais, ce qui nous vaut de jolis passages, rencontré des témoins, nourri une abondante correspondance avec ses proches. Son livre est riche de citations, et dans sa relation intime avec de Roux, il lui parle autant qu'il nous parle de lui. Raison pour laquelle Soulié ne craint pas de se montrer par endroit hermétique, voire ésotérique.
De Roux, la littérature et la droite. C'eût été un parfait sous-titre si Rémi Soulié avait jugé bon d'en ajouter un. Encore faut-il, avec un aussi subtil dialecticien, s'entendre sur les mots. De quelle droite parlons-nous ? En politique, de Roux honnissait le nationalisme et la propriété privée. En France, ce voyageur infatigable se considérait en territoire ennemi. Côté littérature, de Roux méprisait les hussards, qu'il qualifiait dédaigneusement de «chevaux-légers de la bourgeoisie». La Droite selon Dominique de Roux, Droite avec un grand "D" (comme Evola l'écrivait du reste, et Soulié ne manque pas de faire le lien), est partout où domine le tragique, donc le sens du sacré, dans la marche de l'Histoire. Héroïsme et folie sont valeurs de droite, qui définissent en littérature le Grand Art. Sont de droite Claudel, Heidegger, Gombrowicz, Lawrence, Jünger, Benn, Céline, Artaud, Biely, Blanchot, Cummings, Pound, Genet, Nizan, Yeats, Joyce, Ungaretti, Gadda, Michaux. Une droite reconnue par lui seul, qu'il réinvente et redessine au gré de ses illuminations.
«Je soupçonne Dominique de Roux d'avoir lâché la corde avant terme pour ne pas assister à l'ultime désastre. Prophète comme il l'était, il aura préféré la vision béatifique à la société du spectacle.» Certains doutent de sa mort et préfèrent croire qu'il dort, roi du monde pétrifié dans la roche, sous un glacier, attendant son heure. D'autres pencheraient plutôt pour un repli stratégique dans une faille tellurique, quelque part entre Thulé et l'île de Pâques. Plus disert, Rémi Soulié conclut par l'impérieuse nécessité de sa relecture. «Dominique de Roux (...) desperado sudiste digne de notre piété.»
Entretien.
Q: Rémi Soulié, on sort de votre essai, Les Châteaux de glace de Dominique de Roux, converti. Il émane de chacune de ses pages une attraction mystérieuse que j'attribuerai autant aux révélations que vous nous apportez sur ce personnage extraordinaire que fut Dominique de Roux qu'à l'inexplicable envoûtement de votre style, touché par une sorte de grâce qui le transfigure. Parfois, je me suis surpris à lire des paragraphes pour leur seule poésie, incapable «au réveil» de me souvenir de ce qu'ils disaient. Ce livre est celui d'un mystique. Au reste, son titre est déjà porteur d'un sens initiatique, comme s'il fallait entrer dans son œuvre comme on part en pèlerinage.
Rémi Soulié: Dans Immédiatement, Dominique de Roux évoque sa grand-mère et son «château de glaces». J'ai donc choisi ce titre parce que c'était une formule de Dominique de Roux lui-même, quelle renvoyait métaphoriquement à une demeure familiale —et je me suis attaché à montrer ce que de Roux devait aux vacances passées en Aveyron, pendant son enfance— mais aussi parce que le château et la glace sont lourds de sens: ils évoquent à la fois l'enracinement profond, aristocratique, dans l'histoire de France, dans l'ancienne France, un «palais des glaces» où se réfléchissent une image de soi fragmentée, une identité plurielle, et, enfin, la mort. Dominique de Roux était hanté par la mort. Etait-ce pressentiment d'une fin prématurée, tropisme romantique ? Sans doute les deux à la fois, et sans doute plus encore.
Q.: Dominique de Roux écrivain révolutionnaire -écrivain ET révolutionnaire, il ne viendrait plus aujourd'hui à l'idée de personne d'en douter. Mais dans quel camp était-il ? Droite-gauche-gaulliste-anar de droite ?
R.S.: Certainement pas révolutionnaire de gauche. Cela n'aurait aucun sens. Son intérêt pour la Chine de Mao était esthétique, poétique —en ceci, il n'est pas très éloigné de Sollers, mutatis mutandis. Révolutionnaire de droite supposerait de sa part une adhésion doctrinale à un système particulier également, or, même si l'on trouve dans son œuvre, surtout dans le Contre Servan-Schreiber, un jeu intellectuel sur le lexique maurrassien, Dominique de Roux ne saurait être réductible à une seule pensée politique. Il fut un homme d'action, certes, au service de la France gaullienne, en Angola, mais son gaullisme était mystique, non politique, selon la distinction de Péguy. Je vois en de Roux un poète de l'action, comme le colonel Lawrence ou Mishima. Il était attaché, sans doute, à une «certaine idée de la France», mais à une idée poétique, littéraire. Son anticommunisme, néanmoins, est évident. La catégorie d'anar de droite, si intéressante soit-elle, François Richard la bien montré, est un peu un fourre-tout. On y «case» les irréductibles, ceux qui sont allergiques aux conneries puritaines de la bigoterie contemporaine et éternelle, à la figure increvable du «bourgeois», celle que Baudelaire, Flaubert, Bloy, Barbey ont décrit. Un Dictionnaire des idées reçues serait d'ailleurs impubliable de nos jours. Les hérauts socialistes et éminemment bourgeois de la liberté nous en empêcheraient. De Roux, en définitive, était bien révolutionnaire, parce que c'était un écrivain, et que tous les écrivains dignes de ce nom le sont. Pound, Borgès, Jouve, Céline, Gombrowicz, c'est aussi lui, c'est souvent d'abord lui.
Q.: Dominique de Roux nous a quitté il y a un quart de siècle. Selon vous, qui le connaissiez bien, qui peut prétendre aujourd'hui avoir pris sa place ? Ce qui m'amène à vous poser une deuxième question: quel apport à la littérature française fut le sien ?
R.S.: Personne n'a pris sa place, car personne ne prend jamais la place d'un écrivain —surtout un autre écrivain. Dominique de Roux a néanmoins des admirateurs, par exemple certains jeunes collaborateurs de la revue Immédiatement, placée sous son patronage. Marc-Edouard Nabe est un excellent connaisseur de de Roux. De Roux a marqué l'histoire littéraire française, comme écrivain et comme éditeur. Les Dossiers H de L'Age d'Homme, dirigés par Jacqueline de Roux, sa femme, n'existeraient pas sans les Cahiers de l'Herne. Les auteurs dont je parlais précédemment sont entrés dans notre bibliothèque grâce à lui. Il a renouvelé notre façon de lire. Là encore, c'est révolutionnaire.
Q.: Au fond, que représente-t-il pour vous ?
R.S.: C'est un intercesseur, pour reprendre le mot de Barrès. Il donne des leçons de style, de courage, de vitesse, de passion, d'absolu, de colère; de Roux est un esprit libre, un homme seul qui a suivi sa vocation. C'est un «littéraire intégral», un homme pour qui la littérature était une vision du monde.
Q.: Le romancier Dominique de Roux m'a toujours intrigué...
R.S.: Quoi qu'il écrive, Dominique de Roux était un styliste doué, d'emblée maître de son écriture et de son univers. Il est donc difficile, et sans doute réducteur, de compartimenter son œuvre. Plus que pour d'autres écrivains, la question du genre, à mon avis, ne se pose pas vraiment chez lui. Je suis sensible à tous ses «romans» de Mademoiselle Anicet au Cinquième Empire en passant par Harmonika-Zug et Maison jaune. Avec Mademoiselle Anicet, il a montré qu'il pouvait écrire, très jeune, un roman de facture classique, «à la française», comme Une curieuse solitude de Sollers, avec lequel un parallèle s'impose à nouveau; à l'autre bout de l'œuvre, Le Cinquième Empire se lit comme un poème, lui aussi parfaitement maîtrisé. La beauté du Portugal éternel, mythique, celui du Roi caché, transparaît dans l'évocation dune situation exceptionnelle de crise. L'écriture de Dominique de Roux est limpide, et il a assimilé Rimbaud.
Q.: Avant de lire Les Châteaux de glace votre nom m'était inconnu. Force est de constater que votre livre se montre d'une grande discrétion à ce sujet. Rien ne filtre, ni sur vous ni sur vos antécédents. Quelques mots de votre part seraient les bienvenus à présent.
R.S.: J'ai trente-deux ans. Avant ce Dominique de Roux, j'ai publié un traité sur la promenade (*); j'avais alors une activité d'enseignant-chercheur en littérature française, à l'Université de Toulouse. J'ai collaboré à différentes revues, publié plusieurs articles, universitaires ou non.
Q.: Et quels sont vos projets désormais ?
R.S.: Je corrige en ce moment les épreuves d'un essai sur Aragon, à paraître en janvier 2001 aux Editions du Bon Albert: Le vrai-mentir d'Aragon, Aragon et la France. J'espère également publier dans les mois à venir une étude sur Jean Boudou, immense écrivain occitan, traduit en français, qui est l'égal de Jean Genet ou Mishima, pas moins! Je me suis attaché à le lire avec les lunettes de Freud et de Lacan —une écriture de la perversion, en bordure de la psychose. Je n'ai pas la religion de la psychanalyse, loin s'en faut, mais pour qui sait lire, surtout l'œuvre de Lacan, l'éclairage analytique, philosophiquement, est passionnant. Je publie en janvier 2001 une nouvelle, dans un recueil collectif, aux côtés de Georges-Olivier Châteaureynaud, Homeric, Victor Martin, Marie-Hélène Lafon et Denitza Bantcheva.
(propos recueillis par Laurent SCHANG).
(*) De la promenade, Editions du Bon Albert, 1997.
00:30 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique de roux, france, lettres, entretiens |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 12 juin 2008
Entretien avec Jacques d'Arribehaude

Entretien avec Jacques d'Arribehaude, un «Français libre»
Q.: Dans Un Français libre (L'Age d'Homme, 2000), vous menez, sous le couvert d'un journal intime, une quête qui n'est autre que l'antique gnôthi seauton hellénique: la recherche et l'étude de soi. Qui êtes-vous donc? Français ou Gascon? Moderne ou d'Ancien Régime? Du XVIIe ou du XIIe siècle?
Né au pied des Pyrénées à l'extrême sud-ouest de la France, d'une mère basque et d'un père gascon, je suis Français d'éducation, de tradition et de culture, mais ouvert depuis toujours au grand large, à l'esprit d'aventure et de recherche de nos grands ancêtres navigateurs et conquérants. J'appartiens une famille dont les archives remontent au XIIe siècle par mon père, avec des attaches en Béarn, Gascogne et Navarre. On trouve mes ascendants sur les Sceaux gascons de la Tour de Londres sous Edouard III, puis sur les rôles d'armes de Gaston Phébus du Béarn au XIVe siècle, mais dans un déclin constant durant les guerres de Religion et les désordres de la Fronde au XVIIe siècle. Sous la Révolution, Jean d'Arribehaude, beau-frère de Raymond de Seze, défenseur de Louis XVI à la Convention, renonce à ses seigneuries de Lasserre, d'Orgas et autres lieux pour échapper à la guillotine, et la ruine du patrimoine familial achève de se consommer au fil des générations. Mon enfance n'en est pas moins marquée par la forte empreinte des instituteurs au lendemain (très illusoirement victorieux) de la grande guerre 14-18, ces «hussards de la République» qui mettaient tout leur cœur à exalter la nation comme un modèle insurpassable de civilisation pour la terre entière. Le désastre sans précédent de 1940 (j'avais tout juste 15 ans), m'éloigne à tout jamais du régime qui l'a provoqué, qui m'inspire dès lors le plus définitif dégoût.
Q.: Très jeune, vous avez vécu quelques expériences peu banales: voir défiler les Prussiens de la Totenkopf, traverser les Pyrénées, croupir dans une geôle hispanique, découvrir les clans d' Alger, goûter à toutes sortes de propagandes et même, naviguer ("Il est nécessaire de naviguer"). N'est-ce pas beaucoup pour un jeune homme encore tout frotté de littérature? Quel était donc son état d'esprit le 8 mai 1945?
Que faire, quand on a dix-sept ans, que l'on n'accepte pas l'humiliation d'une telle défaite, que l'on baille au lycée de Bayonne aux trois-quarts occupé par l'administration de la Kommandantur et de la Gestapo, et qu'il y a quelque part une France qui se déclare encore libre, sinon vouloir à tout prix la rejoindre? Cela me vaudra de connaître la prison de Badajoz au fond de l'Espagne, d'où la Croix-Rouge me tire à grand peine, puis le spectacle des querelles politiques d'Alger, jusqu'à mon embarquement sur un pétrolier battant pavillon US, et dont un équipage français remplace un équipage américain défaillant et rapatrié sur New York, mais toujours armé de canonniers américains. Je figure, en qualité d'écrivain de bord —interprète faisant fonction de commissaire— au carré des officiers, ne regrettant guère d'avoir été déclaré «inapte au service armé» par la 1ère Division Française Libre que j'avais fini par rejoindre en Libye, ni la Direction du service Géographique de l'Armée, qui voulait me retenir comme dessinateur à Alger. Le spectacle de l'Italie dévastée, de la corruption qui sévit partout sur fond d'épuration, de misère et de prétendu retour à la morale m'est odieux. J'oublie mes déceptions en découvrant, dans les ruines d'une librairie italienne, Le voyage au bout de la nuit où le génie imprécateur de Céline contre la guerre confirme ce que je ressens devant le bourrage de crâne universel. La «France libre» dont je rêvais et dont j'ai suivi au fur et à mesure les querelles de clans et mesquines péripéties n'est que le retour des hommes et du régime dont l'incompétence et la nullité nous ont conduit au désastre. Je ne puis que le vomir et remettre tout en question. J'ai vécu au bout du compte dans l'Italie éventrée de 44-45, la Grèce et la Yougoslavie exsangues et déchirées, la fin malheureuse de l'engrenage suicidaire de 1914 au seul profit d'un communisme aussi criminel que le nazisme, et du mercantilisme américain dont la façade démocratique recouvre une exploitation éhontée de la planète. On ne m'y reprendra plus.
Q.: Quels furent vos maîtres?
Je dévore Céline dont la force comique fortifie ma lucidité et apaise ma colère dans le sentiment de ne pas être seul au monde à refuser l'imposture de ce temps. Je revois mon ancien professeur Louis Laffite qui, sous le nom de Jean-Louis Curtis, commence à se faire un nom en littérature, et qui m'encourage à écrire. Jusqu'à sa mort, il y a quelques années, il soutiendra mes efforts dans ce sens et j'aurais maintes fois l'occasion d'apprécier son talent, son humour, et la solidité de son amitié. Dès l'enfance, j'ai la passion de la lecture et vais selon une humeur très vagabonde des Mémoires d'un âne à La Condition humaine en passant par Les trois mousquetaires, L'île au Trésor, Robinson Crusoë, Croc-Blanc, Guerre et Paix, Les Mille et une Nuits de Mardrus (lus par surprise à la bibliothèque municipale) et Gil Blas. L'été de mes 16 ans, en 41, grand emballement pour Autant en emporte le vent et le personnage de Rhett Butler, dont le refus d'être dupe, le joyeux cynisme et la séduction s'offrent en modèle idéal à ma naïve adolescence. Il me faut l'épreuve de la guerre et de la maladie pour élargir ce modeste horizon. C'est au sanatorium de Leysin, où je suis admis sur le Fonds Européen de Secours aux étudiants, en Suisse, que je me plonge durablement dans Balzac, Stendhal, Flaubert, mais aussi Saint Simon, aussi bien que dans les grands romanciers américains et russes et en particulier Dostoïevski. De là date aussi mon goût pour les correspondances et journaux intimes, au plus près de la vie, telle que la restitue dans son intensité, l'extraordinaire vision de Saint Simon.
Q.: Vous avez fréquenté le monde des Lettres, approché Céline à Meudon, Roland Laudenbach rue du Bac, et même un certain André Malraux. Qui étaient ces trois hommes si différents? Et "La Table ronde", cette maison mythique, quel était donc son esprit?
Accoutumé dès le départ à la solitude, c'est à Roland et Denise Tual, rencontrés au Festival du film maudit à Biarritz en 1949, que je dois la rencontre de Malraux, de Cocteau, de René Clair, de Roger Nimier, de Roland Laudenbach et autres figures de l'époque, sans que je puisse dire avoir vraiment et durablement fréquenté le monde des lettres. De Malraux, j'ai surtout retenu la volonté qui me semblait exemplaire de «transformer en conscience l'expérience la plus large possible», qui m'incita à prendre du champ en m'exilant près de trois ans dans ce qui était alors le territoire du Tchad dans l'Afrique Equatoriale Française, comme agent de l'unique société chargée de l'exploitation du coton. Malraux se souvint de moi et m'accorda sa sympathie lorsque je lui adressai Semelles de vent, et intervint plus tard quand je tentai d'entrer à l'ORTF, où le désordre de 1968 me permit finalement de pénétrer de façon durable. "La Table Ronde" se distinguait alors par l'anticonformisme de ses publications, un éloignement ironique à l'égard de l'idéologie dominante et l'engagement à sens unique prôné par Sartre qui nous semblait le comble du grotesque, de la nuisance imbécile, et de l'aveuglement artistique. J'y rencontrai, auprès de Laudenbach, Alexandre Astruc, Jacques Laurent, et publiai, avant Semelles de vent, La grande vadrouille, bien accueilli par la critique, mais sans succès commercial, et dont Laudenbach eut le tort de vendre le titre —sans que je puisse m'y opposer— à une production cinématographique sans le moindre rapport avec l'ouvrage.
Q.: La lecture de Proust ne vous a pas illuminé. Dieux merci, je ne suis pas le seul à avoir bâillé d'ennui! Rassurez-moi, donnez-moi des arguments contre le snobisme proustien!
Je dois à la lecture d'avoir échappé à plusieurs reprises au découragement et à la dépression. C'est le cas avec La recherche du temps perdu, quelles que soient mes réserves sur les vaines contorsions de Proust pour transposer et déguiser la réalité de son personnage. Il a beau prendre un soin infini à masquer l'origine presque exclusivement juive du «monde» auquel il a accès par l'intermédiaire d'une madame Strauss ou de Caillavet, d'un Gramont de mère Rothschild, ou de princes moldo-valaques à généalogie douteuse, pourquoi ne pas dire carrément que les grands noms dont il se pâme ne sont plus que le reflet de la souveraineté triomphante de Mammon, accommodée au snobisme éperdu et niais des élites républicaines dont il fait partie. Malgré cela, et en dépit de tout ce qu'il peut y avoir d'artificiel et de faux dans la société qu'il dépeint, sa difficulté d'être lui inspire des pages déchirantes sur la souffrance, l'amour malheureux, «l'enchantement des mauvais souvenirs», et son œuvre s'impose par la création de personnages atteignant la force de types universels, qu'il s'agisse de Charlus, de madame Verdurin, Norpois, Cotard, Nissim Bernard, Bloch, etc. La sacralisation contemporaine de mœurs considérées naguère comme honteuses et la révérence obligée devant tout ce qui semble relever particulièrement de la «sensibilité juive» ajoute sans doute à l'universelle renommée de Proust, et l'encombre d'une vague de snobisme et d'exaltation parfaitement insupportable, mais on oublie de souligner la verve comique qui nourrit souvent les meilleures pages de son œuvre, et que le personnage de Bloch dans son évolution révèle admirablement l'identité profonde et mal acceptée du narrateur dans tout le grotesque de son pathos verbal, de son arrivisme mondain, et de ses pathétiques affectations. Au total, un grand écrivain, qui ne saurait être négligé, mais dont la vision analytique et critique de la société est plus partiale et limitée qu'il semble le croire, et très en deçà du fantastique, prophétique et souverain constat de l'œuvre de Céline quelques années plus tard. Marcel Proust, nanti de la République (éminente notabilité du père dans les hautes sphères de la maçonnerie et des riches alliances juives), confond ainsi pieusement, dans Le Temps retrouvé, l'effondrement des Empires centraux avec «la victoire de la civilisation sur la Barbarie» (sic). Le conformisme niais de cet aveuglement sur la tragédie de l'Europe et l'incapacité démocratique à concevoir une paix durable relativise la pertinence de son ironie sur le patriotisme de ses salonnards familiers et les propos héroïques de la Verdurin trempant son croissant matinal dans un café au lait qui échappe aux restrictions de l'heure. Nous sommes loin de la dénonciation autrement puissante et impressionnante du Voyage et du grand souffle célinien balayant les clichés de «cette immense entreprise à se foutre du peuple» !
Q.: Dans votre journal, vous avouez une sympathie coupable pour la mythologie germanique. Quand on est né vers 1925, qu'on appartient manifestement à une caste d'exploiteurs du peuple (et même si on a porté le bon uniforme, celui des vainqueurs), ce genre de déclaration vous rend hautement suspect. Expliquez-vous!
J'ai noté dans mon Français libre l'impression profonde, tous drapeaux confondus, de la rengaine nostalgique de la Wehrmacht Lili Marlene durant la guerre. L'affirmation provocante du Sanders de Nimier —«Plus l'Apocalypse s'est rapprochés de l'Allemagne et plus elle est devenue ma patrie!»— était la mienne alors même que je vivais la victoire de notre croisade de la liberté sous pavillon US à bord du pétrolier «Eagle». La sottise et l'énormité mensongère de la propagande m'exaspéraient. A l'étalage massif et sempiternel des exclusives horreurs nazies je ne pouvais m'empêcher de mettre en parallèle toutes les images qu'on nous cachait, et dont il n'existe aucune trace, de l'anéantissement systématique de Dresde et de villes entières, de populations errantes, exténuées, massacrées, ou mourant de faim et de misère sur les routes dévastées. Quelles qu'aient été les aberrations de Hitler, ce désastre était aussi celui de l'Europe et donc le nôtre. A cette impression se mêlait ma compassion pour les vaincus au terme d'une lutte héroïque contre le monde entier, et pour les causes perdues.
Mon goût des légendes, inhérent aux contes du pays basque transmis dès l'enfance par ma grand-mère, m'inclinait naturellement aussi à une sorte de familiarité fraternelle avec la mythologie germanique et l'exaltation wagnérienne de Lohengrin sur fond d'honneur, de loyauté et d'amour transcendant. Ce genre d'impression n'était pas destiné à m'ouvrir le meilleur accueil et l'on eût trouvé plus naturel de me voir tirer parti de mon engagement sous ce que vous appelez très justement «le bon uniforme», dont je me souciais comme d'une guigne. Mais la solitude était le prix de ma liberté et j'acceptais dès le départ qu'il en soit ainsi.
Q.: Vous aggravez votre cas en déclarant à Mauriac en 1951: «il y a une étude à faire sur l'aide américaine, dans le sens où l'on peut considérer la démocratie américaine comme le ferment le plus empoisonné, le plus stupidement pervers et le plus efficace du désordre mondial». Seriez-vous —je n'ose y croire— hostile au principe même de l'ingérence humanitaire?????
J'ai participé à l'ouvrage collectif Nos amis les Serbes, publié à l'Age d'Homme, pour protester contre l'infamie de la guerre de l'Otan dans les Balkans et la criminelle stupidité de notre alignement sur les Etats-Unis dans ce qui relève de leur seul intérêt avec la création et l'entretien ruineux d'un abcès incurable, étranger à notre culture et à notre civilisation au cœur de l'Europe. De la même manière, notre strict intérêt était de refuser toute intervention dans la guerre du Golfe et d'en laisser la charge et les dépenses aux Etats-Unis, uniques bénéficiaires. C'est assez dire que je suis résolument contre toute «ingérence humanitaire» qui n'est que le masque grossier de combinaisons sordides et parfaitement étrangères aux intérêts de l'Europe.
Q.: Vous n'êtes tout de même pas de droite? Je vous demande cela car j'ai lu quelques phrases ambiguës sur les empires centraux et la monarchie. A nouveau, rassurez-nous!
On classe volontiers parmi les «anarchistes de droite» tous ceux qui n'adhérent pas au conformisme de la pensée unique et de l'idéologie dominante qui s'affiche aussi bien à gauche que dans la droite honteuse depuis le triomphe des «Lumières». C'est ainsi que je figure dans l'essai de François Richard, paru il y a quelques années dans la collection "Que sais-je?" (n° 2580). Je ne récuse nullement cette appellation, mais qui se soucie aujourd'hui de savoir si Dante, Shakespeare ou Cervantès, ont pu être de droite ou de gauche? Sans la moindre prétention, je me contente de croire que celui qui tente de témoigner pour son temps dans l'isolement d'une création artistique échappe à toute classification sommaire. Je constate en tout cas que nombre d'écrivains des années trente parmi les meilleurs, Chardonne, Montherlant, Drieu, Morand, Jouhandeau et quelques autres, sans parler bien entendu de Céline, arbitrairement classés à droite, et qui ont payé pour cela, n'en faisaient pas moins les délices de Mitterrand, qui avait le bon goût de ne pas cacher sa paradoxale prédilection. Mitterrand, icône de la gauche officielle, était au fond tranquillement fidèle à sa jeunesse monarchiste, et mérite considération et sympathie pour tout ce que nos médias lui ont haineusement reproché à la fin de sa vie (ferme refus de «repentance», émouvante et brillante improvisation, au Parlement de Berlin, sur le «courage des vaincus», etc.). Les premiers mots dont je me souviens ont été ceux d'une berceuse basque toujours populaire en faveur de don Carlos, "el Rey neto", soutenu par la tradition navarraise contre la farce constitutionnelle de l'oligarchie prétendument progressiste attachée au règne factice d'Isabel. Curieusement, Marx a exprimé son estime et sa préférence pour l'insurrection carliste, dont les "fueros" populaires, nobles et paysans étroitement mêlés et solidaires, offraient l'image d'une démocratie autrement juste et authentique que le simulacre bourgeois hérité de nos mystifications révolutionnaires. C'est à cette image, bien évidemment de droite pour nos éminents penseurs professionnels, que je me suis toujours voulu fidèle.(propos recueillis par Patrick Canavan).
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretiens, conservatisme, france libre, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 juin 2008
Chatov, personnage de Dostoïevski

Robert Steuckers:
Chatov, personnage de Dostoïevski
Dans l'œuvre de Dostoïevski, plus particulièrement dans Les Possédés, le personnage de Chatov, selon la plupart des exégètes, serait le porte-parole de l'écrivain lui-même et de l'idéologie nationaliste/racialiste russe. Le slaviste allemand Reinhard Lauth conteste cette interprétation classique, qui fait de Dostoïevski un idéologue génial de la "slavophilie" voire du panslavisme. Sur quoi repose ce soupçon et/ou cette affirmation ? Telle est la question que se pose Lauth. Pour nier le fait de la slavophilie de Dostoïevski, Lauth nous révèle, dans un chapitre de son livre consacré à "Dostoïevski et son siècle", l'essentiel de cette idéologie nationale russe sous-tendue par une conception du "peuple", dérivée de la matrice herdérienne mais rendue terriblement originale par l'apport d'une religiosité orthodoxe slave.
La Russie "corps de Dieu" face à l'Occident cupide
L'idéologie populo-centrée défendue par le personnage Chatov apparaît dans le chapitre intitulé "La Nuit" des Possédés. Chatov dialogue avec le Prince Stavroguine, devenu presque athée, au contact de la civilisation occidentale. Chatov affirme que le peuple est la plus haute des réalités, notamment le peuple russe qui, à l'époque où il pose ses affirmations, serait le seul peuple réellement vivant. En Europe occidentale, l'Église de Rome n'a pas résisté à la "troisième tentation du Christ dans le désert", c’est-à-dire à la "tentation d'acquérir un maximum de puissance terrestre". Cette cupidité a fait perdre à l'Occident son âme et a disloqué la cohésion des peuples qui l'habitent. En Russie, pays non affecté par les miasmes "romains", le peuple est toujours le "corps de Dieu" et Dieu est l'âme du peuple, l'esprit qui anime et valorise le corps-peuple.
L'idéologie de Chatov, écrit Lauth, se trouve en quelque sorte à une croisée de chemins : entre un christianisme orthodoxe et une sorte de "feuerbachisme" qui interprète le christianisme comme une sublimation de l'esprit du peuple, exactement comme Feuerbach avait interprété la Trinité chrétienne comme une sublimation de la famille sociologique. Dieu ne serait-il plus qu'une projection du Peuple, l'extériorisation d'un "collectif" repérable empiriquement ?
La puissance de l'esprit qui anime le peuple détermine son existence historique. Cet esprit est une force affirmatrice de l’Être et, partant, d'existence, qui nie la mort. Puissance religieuse, cet esprit s'exprime dans la morale, l'esthétique, etc. Il est recherche de Dieu et, par rapport à lui, science et raison ne sont que des forces de 2nd rang, qui ne sont jamais parvenues, dans l'histoire, à constituer un peuple.
Le Volksgeist est Dieu
Chaque peuple cherche un esprit divin qui lui est spécifique. Chaque peuple génère son Dieu particulier qu'il considère comme seul vrai et juste. Et tant qu'un peuple vénère son Dieu particulier et rejette avec force, implacablement, tous les autres dieux du monde, il demeure vivant et sain. Une pluralité de peuples ne peut se partager un seul et même Dieu, dit Chatov, car le Volksgeist est Dieu. S'ils possédaient le même Dieu, ils seraient un seul et unique peuple, composé de plusieurs tribus. Ou, pire, ils seraient des peuples en déclin, devenus incapables d'affirmer avec force leur Dieu, des peuples dont les Dieux viendraient, sous les coups insidieux d'une décadence délétère, à se confondre en une soupe insipide de valeurs dévoyées, et dont l'esprit aurait capitulé devant toute tâche historique pour adopter un esprit étranger ou, dans le meilleur des cas, pour recréer un Dieu nouveau.
Chaque peuple déploie ses propres conceptions du bien et du mal. Et si certains peuples ont élaboré des conceptions universalistes et des religions mondialisables, ils se réservent toujours, dans ce programme, le 1er rôle. Quand un peuple perd cette idée de détenir seul l'unique vérité du monde ou quand il doute du rôle premier qu'il a à jouer dans l'histoire, il dégénère en "matériel ethnographique".
Slavophilie et panslavisme
Cette vision du peuple "théophore" (= porteur de Dieu ou, si l'on veut être plus juste en désignant l'idéologie de Chatov, porteur d'un Dieu) reflète les idées de Danilevski, celles exprimées dans son ouvrage principal La Russie et l'Europe, paru en 1869. Danilevski inaugure une nouvelle slavophilie, postérieure à la slavophilie des Kireïevski, Khomiakov et Axakov, décédés entre 1856 et 1860. Avec Danilevski la slavophilie fusionne partiellement avec le panslavisme. L'auteur de La Russie et l'Europe allie des idées du temps (les influences de Pogodine, Herzen et Bakounine y sont présentes) à une typologie des cultures historiques qui annonce Spengler. Dans l'orbite des slavophiles/panslavistes, l'originalité de Danilevski réside précisément dans cette "organologie" qui pose une doctrine des types de cultures, postulant qu'il n'existe pas de développement culturel unique de l'humanité, comme Hegel avait tenté de le démontrer. Pour Danilevski, comme plus tard pour Spengler et Toynbee, il n'existe que des cultures vivant chacune un développement (ou un déclin) séparé. Pour Danilevski, les peuples qui n'appartiennent pas à une culture bien spécifique sont soit des "agents négatifs de l'histoire" comme les Huns soit du "matériel ethnographique" comme les Finnois ou les Celtes voire même des "réserves de puissance historique". Dans ce dernier cas, il s'agit de peuples qui, longtemps, demeurent à l'écart de l'histoire et qui, soudain, font irruption sur le théâtre des événements et fondent des cultures nouvelles et originales.
Celui qui n'a pas de peuple, n'a pas de Dieu
Toute culture vit une vie organique : elle croît, atteint son apogée (période relativement courte), épuise ses forces vitales et sombre finalement dans la sénilité. Seules subsistent alors la science rationnelle, la technique et un art technicisé qui seront transposés dans et repris par une culture ultérieure. Danilevski, en tant que nationaliste russe, affirmait que les Slaves représentaient une culture jeune et montante face à une culture germano-romaine atteinte de sénilité (postulat hérité des vieux slavophiles Odoïevski et Kireïevski). Les Slaves sont un peuple "élu", pense Danilevski, qui triomphera prochainement dans l'histoire.
Chatov, le personnage de Dostoïevski, lui, va plus loin. Il accepte le pluralisme des peuples affirmé par Danilevski mais prétend qu'il n'existe qu'une seule et unique vérité. Donc il ne peut y avoir dans l'histoire qu'un seul et unique peuple porteur de cette vérité. En l'occurrence, pour les slavophiles et les panslavistes, c'est le peuple russe. Ce peuple russe porte en lui la vérité révélée par Dieu, la vérité de Jésus Christ telle quelle, non falsifiée. Face à lui, les autres peuples sont porteurs d'idoles. Si ces autres peuples se disent chrétiens, ils portent la caricature d'un Christ "ré-idolisé". Conclusion de cette foi : celui qui n'appartient pas au peuple russe ne peut croire au vrai Dieu et celui qui, en Russie, n'a pas de peuple, n'a pas de Dieu.
Messianisme de Chatov, pluralisme de Danilevski
Le messianisme slave de Chatov diffère donc fondamentalement, sur ce plan du moins, de l'idéologie danilevskienne. En effet, Danilevski s'oppose résolument à toute forme d'universalisme ; son système, par suite, refuse l'idée d'une mission universelle des Slaves car une mission de ce type n'existe ni en acte ni en puissance. Simplement, pour Danilevski, les Slaves inaugureront une ère nouvelle, débarrassée de tous les miasmes d'obsolescence que véhicule la civilisation germano-romaine (occidentale-catholique).
Lauth repère les conséquences de cette distinction : Dostoïevski identifiait le peuple russe aux Chrétiens orthodoxes, si bien qu'un Russe ethnique non orthodoxe ou athée n'était pas "russe" à ses yeux, tandis qu'un non slave "orthodoxe" (un Roumain ou un Grec) était "russe". Pour Dostoïevski, l'essentiel, c'est la religion. Pour Danilevski, c'est la substance ethnique, la synthése bio-culturelle. Mais cette substance, en géné-rant un type de culture, se transmet partiel-lement à d'autres substrats ethniques, si bien qu'en fin de compte, c'est l'adhésion au type de Culture, synthèse entre la sphère bio-culturelle originelle et la transmis-sion/assimilation à d'autres peuples, qui est déterminante.
Les personnages de l'univers dostoïevskien se divisent en personnages substantiels et en nullités. Les personnages substantiels peuvent aussi bien incarner le bien que le mal tandis que les nullités n'incarnent rien, puisqu'elles sont nulles. Chatov n'est pas une nullité ; il incarne donc une substance, un type humain chargé de potentialités. Mais ce type incarné par Chatov n'est pas nécessairement la représentation du bien, selon la conviction intime de Dostoïevski. Chatov avance l'idée du primat de la religion sur le politique mais, en dernière instance, il politise le religieux à outrance. De ce privilège accordé indirectement au politique, naît un exclusivisme nationalitaire, à fortes connotations messianiques, qui ne correspond pas à l'idéal Dostoïevskien de fraternité et de solidarisme, pierre angulaire de la foi orthodoxe.
"Chatov" = Dostoïevski ?
Le "déviationnisme" de Chatov a des raisons sociales : la slavophilie, puis le panslavisme, ont été, sur le plan théorique, passe-temps des membres oisifs des classes dirigeantes russes. Or ces classes dirigeantes sont coupées du peuple et ne font qu'interpréter erronément ses desiderata, ses pulsions, sa foi. Coupés du peuple, les dirigeants théoriciens, inventant tour à tour la slavophilie ou le panslavisme, sont en réalité des incroyants, des philosophes en chambre qui ânonnent des slogans en dehors de toute expérience existentielle concrète.
Pour Lauth, réfuter la thèse qui pose l'équation "Chatov = Dostoïevski" signifie soustraire l'univers dostoïevskien aux spéculations des nationalistes de tous horizons (surtout les Russes et tes Allemands qui, à la suite de Niekisch et de Moeller van den Bruck, "dostoïevskisent" quelques fois leur nationalisme). Néanmoins, malgré l'impossibilité de poser abruptement l'équation "Chatov = Dostoïevski", on ne saurait nier une certaine dose de nationalisme russe/slave chez l’auteur des Fréres Karamazov, même si, dans son optique, cet enthousiasme nationaliste doit se limiter aux "jeunes nations" qui, lorsqu'elles auront atteint l'âge mûr, devront adopter et pratiquer des idées plus réfléchies.
Le livre de Lauth, recueil d'articles sur Dostoïevski parus entre 1949 et 1984, n'aborde pas que l'influence des slavophiles et de Danilevski ; il nous fait découvrir, entre autres choses :
- l'apport de Tchadaïev, qui avait amorcé, dans la Russie du XIXe, la fameuse discussion sur l'opportunité ou l'inopportunité de s'ouvrir au catholicisme romain,
- l'apport de Soloviev dans la genèse de la parabole du Grand Inquisiteur,
- la critique de Dostoïevski à l'encontre de Fichte* et Rousseau.
Au total, le recueil que nous offre Lauth constitue un tour d'horizon particulièrement intéressant pour comprendre la réalité russe pré-bolchévique, à travers l'œuvre du plus grand de ses écrivains.
* : cf. Hegel, Critique de la Doctrine de la Science de Fichte de Reinhard Lauth (2005) et Fichte, la science de la liberté de Xavier Tilliette (2004), tous 2 chez Vrin
00:10 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : russie, dostoïevski, révolution conservatrice, lettres, slavistique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 30 mai 2008
E. Jünger, lecteur de Léon Bloy

Alexander PSCHERA:
Ernst Jünger, lecteur de Léon Bloy
Les sept marins du “renversement copernicien” sont un symbole, qu’Ernst Jünger met en exergue dans la préface des six volumes de ses “Journaux”, intitulés “Strahlungen”. Les notes de ces “Journaux”, rédigées pendant l’hiver 1933/1934 “sur la petite île de Saint-Maurice dans l’Océan Glacial Arctique” signalent, d’après Jünger, que “l’auteur se retire du monde”, retrait caractéristique de l’ère moderne. Le moi moderne est parti à la découverte de lui-même, explique Jünger, conduisant à des observations de plus en plus précises, à une conscience plus forte, à la solitude et à la douleur. Aucun des marins ne survivra à l’hiver arctique. Nous avons énuméré là quelques caractéristiques majeures des “Journaux” de Jünger. Celui-ci rappelle simultanément les pierres angulaires de l’œuvre et de l’univers d’un très grand écrivain français, qu’il a intensément pratiqué entre 1939 et 1945: Léon Bloy.
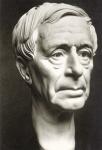
Léon Henri Marie Bloy est né le 11 juillet 1846 à Périgueux. Il est mort le 3 novembre 1917 à Bourg-la-Reine. Il se qualifiait lui-même de “Pèlerin de l’Absolu”. Converti au catholicisme sous l’impulsion de Barbey d’Aurevilly en 1869, il devient journaliste, critique littéraire et écrivain et va mener un combat constant et vital contre la modernité sécularisée, contre la bêtise, l’hypocrisie et le relativisme, contre l’indifférence que génère un ordre matérialiste. Bloy remet radicalement en question tout ce qui fait les assises de l’individu, de la société et de l’Etat, ce qui le conduit, bien évidemment, à la marginalisation dans une société à laquelle il s’oppose entièrement.
Pour Bloy, Dieu n’était pas mort, il s’était “retiré”
Conséquences de la radicalité de ses propos, de son œuvre et de sa langue furent la pauvreté extrême, l’isolement, le mépris et la haine. Sa langue surtout car Bloy est un polémiste virulent, à côté de beaucoup d’autres. Son Journal, qui compte plusieurs volumes, couvre les années de 1892 à 1917; sa correspondance est prolixe et bigarrée; ses nombreux essais, dont “Sueur de sang” (1893), “Exégèses des lieux communs” (1902), “Le sang du pauvre” (1909), “Jeanne d’Arc et l’Allemagne” (1915) et surtout ses deux romans, “Le désespéré” (1887) et “La femme pauvre” (1897) forment, tous ensemble, une œuvre vouée à la transgression, que l’on ne peut évaluer selon les critères conventionnels. La pensée et la langue, la connaissance et l’intuition, l’amour et la haine, l’élévation et la déchéance constituent, dans les œuvres de Bloy, une unité indissoluble. Il enfonce ainsi un pieu fait d’absolu dans le corps en voie de putréfaction de la civilisation occidentale. Ainsi, Bloy se pose, à côté de Nietzsche, auquel il ressemble physiquement, comme l’un de ces hommes qui secouent et ébranlent fondamentalement la modernité.
L’impact de Bloy ne peut toutefois se comparer à celui de Nietzsche. Il y a une raison à cela. Tandis que Nietzsche dit: “Dieu est mort”, Bloy affirme “Dieu se retire”. Nietzsche en appelle à un homme nouveau qui se dressera contre Dieu; Bloy réclame la rénovation de l’homme ancien dans une communauté radicale avec Dieu. Nous nous situons ici véritablement —disons le simplement pour amorcer le débat— à la croisée des chemins de la modernité. Aux limites d’une époque, dans le maëlström, une rénovation s’annonce en effet, qu’et Nietzsche et Bloy perçoivent, mais ils en tirent des prophéties fondamentalement différentes. Chez Nietzsche, ce qui atteint son sommet, c’est la libération de l’homme par lui-même, qui se dégage ainsi des ordonnancements du monde occidental, démarche qui correspond à pousser les Lumières jusqu’au bout; chez Bloy, au contraire, nous trouvons l’opposition la plus radicale aux Lumières, assortie d’une définition eschatologique de l’existence humaine. Nietzsche a fait école, parce que sa pensée restait toujours liée aux Lumières, même par le biais d’une dialectique négative. Pour paraphraser une formule de Jünger: Nietzsche présente le côté face de la médaille, celle que façonne la conscience.
Bloy a été banni, côté pile. Il est demeuré jusqu’à aujourd’hui un auteur ésotérique. Ses textes, nous rappelle Jünger, sont “hiéroglyphiques”. Ils sont “des œuvres, pour lesquelles, nous lecteurs, ne sommes mûrs qu’aujourd’hui seulement”. “Elles ressemblent à des banderoles, dont les inscriptions dévoilent l’apparence d’un monde de feu”. Mais malgré leurs différences Nietzsche et Bloy constituent, comme Charybde et Scylla, la porte qui donne accès au 20ième siècle. Impossible de se décider pour l’un ou pour l’autre: nous devons voguer entre les deux, comme l’histoire nous l’a montré. Bloy et Nietzsche sont les véritables Dioscures du maëlström. Peu d’observateurs et d’analystes les ont perçus tels. Et,dans ce petit nombre, on compte le catholique Carl Schmitt et le protestant Ernst Jünger.
Si nous posons cette polarité Nietzsche/Bloy, nous considérons derechef que l’importance de Bloy dépasse largement celle d’un “rénovateur du catholicisme”, posture à laquelle on le réduit trop souvent. Dans sa préface à ses propres “Strahlungen” ainsi que dans bon nombre de notices de ses “Journaux”, Ernst Jünger cite Bloy très souvent en même temps que la Bible. Car il a lu Bloy et la Bible en parallèle, comme le montrent, par exemple, les notices des 2 et 4 octobre 1942 et du 20 avril 1943. C’est à partir de Bloy que Jünger part explorer “le Livre d’entre les Livres”, ce “manuel de tous les savoirs, qui a accompagné d’innombrables hommes dans ce monde de terreurs”, comme il nous l’écrit dans la préface des “Strahlungen”. Bloy a donné à Jünger des “suggestions méthodologiques” pour cette nouvelle théologie, qui doit advenir, pour une “exégèse au sens du 20ième siècle”.
Mais Jünger place également Bloy dans la catégorie des “augures des profondeurs du maëlström”, parmi lesquels il compte aussi Poe, Melville, Hölderlin, Tocqueville, Dostoïevski, Burckhardt, Nietzsche, Rimbaud, Conrad et Kierkegaard. Tous ces auteurs, Jünger les appelle aussi des “séismographes”, dans la mesure où ils sont des écrivains qui connaissent “l’autre face”, qui sentent arriver l’ère des titans et les catastrophes à venir ou qui les saisissent par la force de l’esprit. Dans “Le Mur du Temps”, Jünger nous rappelle que ces hommes énoncent clairement leur vision du temps, de l’histoire et du destin. Trop souvent, dit Jünger, ces “augures” s’effondrent, à la suite de l’audace qu’ils ont montrée; ce fut surtout le cas de Nietzsche, “qu’il est de bon ton de lapider aujourd’hui”; ensuite ce fut aussi celui de Hamann qui, souvent, “ne se comprenait plus lui-même”. On peut deviner que Jünger, à son tour, se comptait parmi les représentants de cette tradition: “Après le séisme, on s’en prend aux séismographes” —modèle explicatif qui peut parfaitement valoir pour la réception de l’œuvre de Jünger lui-même.
Le chemin qui a mené Jünger à Bloy ne fut guère facile. Jünger le reconnait: “Je devais surmonter une réticence (...) —mais aujourd’hui il faut accepter la vérité, d’où qu’elle se présente. Elle nous tombe dessus, à l’instar de la lumière, et non pas toujours à l’endroit le plus agréable”. Qu’est-ce donc que cet “endroit désagréable”, qui suscite la réticence de Jünger? Dans sa notice du 30 octobre 1944, rédigée à Kirchhorst, Jünger écrit: “Continué Léon Bloy. Sa véritable valeur, c’est de représenter l’être humain, dans son infamie, mais aussi dans sa gloire”. Pour comprendre plus en détail cette notice d’octobre 1944, il faut se référer à celle du 7 juillet 1939, qui apparaît dans toute sa dimension drastique: “Bloy est un cristal jumelé de diamant et de boue. Son mot le plus fréquent: ordure. Son héros Marchenoir dit de lui-même qu’il entrera au paradis avec une couronne tressée d’excréments humains. Madame Chapuis n’est plus bonne qu’à épousseter les niches funéraires d’un hôpital de lépreux. Dans un jardin parisien, qu’il décrit, règne une telle puanteur qu’un derviche cagneux, qui est devenu l’équarisseur des chameaux morts de la peste, serait atteint de la folie de persécution. Madame Poulot porte sous sa chemise noire un buste qui ressemble à un morceau de veau roulé dans la crasse et qu’une meute de chiens a abandonné après l’avoir rapidement compissé. Et ainsi de suite. Dans les intervalles, nous rencontrons des sentences aussi parfaites et vraies que celle-ci: ‘La fête de l’homme, c’est de voir mourir ce qui ne paraît pas mortel’ “.
Bloy descend en profondeur dans le maëlström, les yeux grand ouverts. Cela nous rappelle la marche de Jünger, en plein éveil et clairvoyance, à travers le “Foyer de la mort”, dans “Jardins et routes”. Ce qui m’apparaît décisif, c’est que Bloy, lui aussi, indique une voie pour sortir du tourbillon, qu’il ressort, lui aussi, toujours du maëlström: “Bloy est pareil à un arbre qui, plongeant sa racine dans les cloaques, porterait à sa cime des fleurs sublimes” (notice du 28 octobre 1944). Cette image d’une ascension hors des bassesses de la matière, qui s’élance vers le sublime de l’esprit, nous la retrouvons dans la notice du 23 mai 1945, rédigée à la suite d’une lecture du texte de Bloy, “Le salut par les juifs”: “Cette lecture ressemble à la montée que l’on entreprend dans un ravin de montagne, où vêtements et peau sont déchiquetés par les épines. Elle trouve sa récompense sur l’arête; ce sont quelques phrases, quelques fleurons qui appartiennent à une flore autrement éteinte, mais inestimable pour la vie supérieure”.
“On doit prendre la vérité où on la trouve”
Dans la pensée de Bloy, Jünger ne trouve pas seulement une véhémence de propos qui détruit toutes les pesanteurs de l’ici-bas, mais aussi les prémisses d’un renouveau, d’une “Kehre”, soit d’un retournement, des premières manifestations d’une époque spirituelle au-delà du “Mur du temps”, quand les forces titanesques seront immobilisées et matées, quand l’homme et la Terre seront à nouveau réconciliés. Nous ne pouvons entamer, ici, une réflexion quant à savoir si Jünger comprend la pensée sotériologique de Bloy de manière “métaphorique”, comme tend à le faire penser Martin Meyer dans son énorme ouvrage sur Jünger, ou s’il voit en Bloy la dissolution du nihilisme annoncé par Nietzsche —cette thèse pourrait être confirmée par la dernière citation que nous venons de faire où l’image de l’épine et de la peau indique un ancrage dans la tradition chrétienne. Mais une chose est certaine: Bloy a été, à côté de Nietzsche, celui qui a contribué à forger la philosophie de l’histoire de Jünger. “Les créneaux de sa tour touchent l’atmosphère du sublime. Cette position est à mettre en rapport avec son désir de la mort, qu’il exprime souvent de manière fort puissante: c’est un désir de voir représenter la pierre des sages, issue des écumes les plus basses, des lies les plus sombres: un désir de grande distillation”.
Alexander PSCHERA.
(article tiré de “Junge Freiheit” n°09/2005; trad. franç. : Robert Steuckers).
Alexandre Pschera est docteur en philologie germanique. Il travaille actuellement sur plusieurs projets “jüngeriens”.
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, allemagne, france, catholicisme, conservatisme, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


