jeudi, 27 novembre 2008
Pour la définition d'une doctrine solidariste

Pour la définition d’une doctrine solidariste [1]
Dans le contexte de crise et de décomposition du modèle capitaliste, Emmanuel Leroy, ancien conseiller régional, pose dans cet article, les bases d’une réflexion politique, économique et sociale pour notre famille politique. Altermédia qui est un lieu de débat et d’échanges, le publie en espérant que vos réflexions éclairées ou vos critiques justes permettront de faire progresser la réflexion collective.
Par Emmanuel Leroy
La crise dans laquelle nous venons d’entrer démontre à nouveau l’extraordinaire désarroi dans lequel se trouve plongé le camp national dès lors qu’il est question de problèmes économiques ou sociaux. A de rares exceptions près, c’est le silence ou la dénonciation stérile de comportements scandaleux qui prévalent, sans qu’une solution alternative ne soit jamais avancée.
La crise boursière de 2008 n’a pas donné lieu dans notre camp, sauf rares exceptions, à des analyses empreintes d’une réflexion de fond sur les causes de celle-ci et les remèdes à y apporter. Devant cette carence, une évidence s’impose : quel discours tenir face à un possible effondrement de la légitimité du Système ? Et quelle alternative proposer au peuple qui ne soit ni trotsko-marxiste ni libérale ? La réponse à ces deux questions a déjà été esquissée dans le passé. Nous proposons d’aller plus loin pour offrir une alternative radicale au Système, afin non seulement de tenter de l’abolir, mais surtout d’éviter tout retour possible du mercantilisme et de ses poisons.
A l’époque de la révolution industrielle au XIXème siècle, la République a cherché à concilier deux exigences fondamentales : la liberté individuelle et la justice sociale. L’idée de solidarité, notamment avec Léon Bourgeois, apparût alors comme le moyen d’esquisser une troisième voie entre l’individualisme libéral et le socialisme collectiviste. D’une certaine manière, la France jusqu’aux années 70 avait su trouver une espèce d’équilibre entre socialisme et libéralisme mais l’accélération de la mondialisation à partir des années 80 a fait voler en éclat ce subtil équilibre au profit des oligarchies financières transnationales.
La logique du Système est implacable : après avoir porté les coups de boutoir contre la nation (solidarité verticale), viennent maintenant les attaques contre le social (solidarité horizontale), derniers remparts contre la déferlante de l’indifférencié et du règne sans partage de l’argent.
Le solidarisme est la seule réponse possible à opposer au jeu dialectique des deux internationales, libérale et trotsko-libertaire, qui se livrent devant nous à un jeu de pseudo-opposition, afin de mieux faire disparaître les peuples et les remplacer par une humanité esclave aux ordres du Système.
L’intérêt de la notion de solidarisme est loin d’être purement historique: elle constitue une référence cardinale à tout débat sur la protection sociale et à la répartition des richesses dans la société post-industrielle du XXIème siècle. Or, une des raisons majeures pour lesquelles le camp national n’est pas audible en dehors des questions liées à l’immigration, c’est qu’il n’a pas été capable d’apporter aux Français des réponses claires sur ses conceptions économiques et sociales.
A l’heure où le Système semble entrer dans une crise d’une ampleur sans précédent, ceux qui sauront concilier les intérêts de la nation et la défense des travailleurs sans briser la liberté des individus seront les vainqueurs de demain.
Renaissance du solidarisme en 2008
L’économie et le social n’ont jamais été au sein de la « droite nationale » des domaines qui ont suscité engouement et passion. Les tenants de cette doctrine, en partie influencés par les idées de Maurras (politique d’abord), n’ont pour les questions économiques et sociales qu’une vision distanciée où l’empirisme et le réalisme l’emportent sur les aspects doctrinaux (l’intendance suivra). Cette situation découle probablement du fait que nous sommes les héritiers de différents courants idéologiques où libéralisme et socialisme étaient présents. A l’issue de la seconde guerre mondiale, les camps politiques en Europe occidentale se sont artificiellement scindés en deux grands courants opposant une « droite » libérale et conservatrice à une « gauche » socialiste ou marxiste censée représenter les forces du progrès. Cette division artificielle était censée reproduire l’opposition entre « pays occidentaux libres » et « pays communistes opprimés ». Le courant national était à cette époque complètement marginalisé, en partie du fait de la propagande « résistantialiste » qui a réussi à établir comme une vérité que ses principaux leaders s’étaient mis sans exclusive au service de la France de Vichy ou de la collaboration la plus étroite avec l’occupant (cela sans tenir compte des nombreux royalistes et autres nationaux qui s’étaient engagés dès 1940 dans la résistance). Cette stigmatisation a conduit à la marginalisation quasi-totale des idées nationales/nationalistes jusqu’au début des années 80 qui ont vu l’émergence du FN. La première moitié de cette décennie a été l’occasion véritablement historique de réunir sous l’autorité de JMLP l’ensemble des courants identitaires français. Chacune de ces chapelles idéologiques avait bien sa propre conception doctrinale ou philosophique mais les différences de points de vue ou les querelles étaient obérées par la primauté du leader du FN et par le primat qui était réservé à la question de l’immigration. L’analyse de l’ensemble des scrutins auxquels a participé le FN jusqu’aux années 95 montre à l’évidence que ses électeurs se déterminaient essentiellement sur le refus de l’immigration massive imposée par le Système. En effet, sur les questions économiques, le positionnement du FN n’apparaissait pas de manière claire et JMLP était à l’époque influencé par les idées libérales d’outre-atlantique. Sous l’influence de différents courants internes (solidarisme, christianisme social, anciens cadres du GRECE) le programme du FN entame dès la fin des années 80 une inflexion sociale très marquée et même si ce message est encore peu et mal relayé auprès de l’opinion, il constitue une rupture essentielle dans ce que l’on pourrait appeler « l’idéologie économique » du FN avec les idées libérales qu’il semblait auparavant professer. C’est cette mutation, qui intervient à un moment-clé de la vie politique française à un moment où la gauche, socialiste et communiste, s’est complètement ralliée à l’idéologie marchande du Système (dès 1983), qui devait permettre la progression significative des scores électoraux du FN jusqu’à la crise funeste de 1998. Malheureusement, les fruits de cette évolution, qui pouvaient conduire le camp national aux portes du pouvoir, ont été gâchés par la scission.
L’un des éléments-clés d’un possible retournement de l’opinion à l’occasion de la crise financière de 2008 est la perte de légitimité que le Système va inéluctablement subir lorsque les conséquences sociales vont se faire sentir plus crûment. Mais il sera nécessaire à ce moment d’offrir une alternative économique et sociale crédible, sans laquelle nous risquons d’être perçus comme des espèces de sous-Besancenot. Cela implique d’adopter résolument un positionnement anti-Système -qui sera en résonance avec le refus de la constitution européenne exprimé par les Français lors du référendum de 2005- et qui ne se borne pas seulement à une dénonciation des effets pervers de la mondialisation, mais qui énonce également une politique claire et limpide sur nos conceptions économiques et sociales. La meilleure illustration que l’on pourrait donner de notre vacuité en matière économique est l’absence de réponse cohérente sur les questions économiques et sociales, et plus particulièrement sur les causes de cette crise. Il est certes difficile de répondre de manière lapidaire à une crise dont la complexité s’apparente à celle du noeud gordien mais, de manière succincte, voilà l’énoncé d’une position solidariste sur cette question :
1. la classe politico-médiatique de Sarkozy à Besancenot) est collectivement responsable du désastre (conception matérialiste et économique du monde).
2. Nous punirons les responsables de cette escroquerie gigantesque, financiers ou hommes politiques, qui l’ont provoquée, encouragée ou servie.
3. Nous restaurerons une politique nationale où la notion de solidarité entre citoyens sera inscrite dans la Constitution et où seront proscrits les comportements anti-nationaux (délocalisations, privatisation des services publics…).
4. Nous instituerons une politique économique et sociale où sera rétablie la souveraineté monétaire, restauré l’usage du franc et respectés les principes de préférence nationale et européenne.
5. Seront dénoncés les traités qui subordonnent toute décision nationale à l’avis des autorités de Bruxelles.
L’objet de cette note n’est pas de formuler un programme économique et social complet, mais plutôt de lancer un débat sur ce que pourrait être un solidarisme moderne. L’idée de fond est que la gauche, du fait de son orientation internationaliste, a rallié l’idéologie du Système et qu’ayant ainsi renié ses convictions et ses engagements, elle a trahi non seulement la classe ouvrière mais aussi les classes moyennes qu’elle avait su séduire dans les années 80. En agissant ainsi, elle a laissé ouverte la voie du social que seul le camp national peut légitimement emprunter. Je partage l’analyse d’Alain Soral sur ce sujet et soutiens notamment ses positions sur la gauche du travail et la droite des valeurs, comme dialectique permettant de dépasser l’affrontement droite/gauche et susceptible de restaurer les solidarités nationales en dépassant le concept de luttes des classes.
C’est sur cette capacité à récupérer les électeurs séduits par les sirènes sarkozystes et à rallier les électeurs de gauche que se jouera l’avenir de la France.
Une des difficultés majeures qui peut se présenter est celle d’un discours « social » qui pourrait effrayer une partie de notre électorat traditionnel (artisans, commerçants, patrons de PME, indépendants). Pour éviter cet écueil, il convient à mon avis de sortir des sentiers battus et d’imposer de nouvelles définitions dans le vocabulaire politique français. En effet le champ sémantique utilisé par les politiques ou les médias d’aujourd’hui dans le domaine social reprend peu ou prou les termes utilisés par la gauche socialiste ou marxiste du XIXème siècle. Certes le terme de « prolétaire exploité » n’est plus guère usité mais celui de « patrons exploiteurs » l’est encore et parfois à juste titre et cette perception de « patron de droit divin » est encore bien ancrée à gauche et c’est sur cette perception, en partie erronée, qu’il convient d’intervenir. Il faudrait ici introduire une distinction fondamentale entre petits et grands patrons, qui ne participent pas du même monde, ne jouent pas dans la même cour et souvent ne poursuivent pas les mêmes objectifs. N’oublions pas que l’ensemble des artisans, commerçants, petits patrons et indépendants représente environ 3 millions de personnes en France, qui produisent l’équivalent d’environ 60% du PIB quand seulement 500 grandes entreprises produisent les 40% restant. Il est clair que le Système s’appuie principalement sur les 500 patrons de ces grandes entreprises -intrication des intérêts financiers, médiatiques et politiques- beaucoup plus que sur les 3 millions d’indépendants à qui on ne demande que l’approbation tacite et qui ne sont nullement représentés sur le plan syndical. Donc, le maintien des positions du camp national au sein de cet électorat est essentiel et il devrait même se trouver amélioré si l’on parvient à introduire cette césure dans l’esprit des Français entre ce que l’on pourrait appeler les patrons responsables et les patrons commis.
Le patron responsable c’est celui qui a investi ses propres fonds pour la création ou le rachat de son entreprise ; c’est celui qui travaille avec ses employés, souvent plus durement qu’eux ; c’est celui qui risque l’infamie et la perte de ses biens personnels en cas d’échec et non pas l’attribution de stocks options et de « golden parachutes » ; c’est aussi et surtout celui qui a une claire responsabilité de ses engagements vis-à-vis de ses employés et qui ne licencie que lorsqu’il y est acculé et jamais pour des questions de profits immédiats à la demande des actionnaires. Ce patron a un rôle social essentiel dès lors que la richesse qu’il produit bénéficie également à ses salariés et à la collectivité.
Le patron commis est un pur produit du Système. Patron d’une banque ou d’une grande entreprise, multinationale ou non, il est souvent formé par les grandes institutions de la république (ENA, Polytechnique, Grandes Ecoles) et il est ensuite coopté par ses pairs avant d’intégrer son futur champ d’action. Avant l’accélération de la mondialisation, il pouvait être commis par l’Etat dans une de ces grandes entreprises nationalisées à statut public ou mixte dont la France s’était fait une spécialité (Renault, EDF-GDF, Charbonnages de France, SNCF, etc.) aujourd’hui où la puissance régalienne recule devant les diktats de la finance internationale, il est commis par les actionnaires (banques, fonds de pensions, investisseurs institutionnels), mais dans tous les cas de figure, il ne s’agit pas d’un patron au sens traditionnel du terme dans la mesure où non seulement il n’a pas investi un sou dans l’entreprise mais il doit au surplus rendre des comptes à ceux qui l’ont fait roi, et ces derniers aujourd’hui ne poursuivent qu’un unique but : la rentabilité maximale et rapide de leurs investissements. De ce fait la fonction sociale de solidarité avec les salariés de ces pseudo chefs d’entreprises disparaît au profit exclusif de leurs mandants avec le cortège inéluctable de délocalisations, licenciements, fermetures d’usines, etc. qui en découle.C’est donc contre ces patrons commis que le camp national devrait engager une vigoureuse campagne de dénonciation et non pas laisser à l’extrême gauche le bénéfice de ces actions qui a permis à ses leaders d’atteindre en cumul environ 10% des voix lors de la dernière élection présidentielle. Cela implique des actions de terrains, de manifestations de solidarité avec les ouvriers licenciés et de dénonciations systématiques des abus constatés.
Le terme de solidarisme peut parfaitement s’intégrer à une nouvelle articulation du discours social du camp national. Le solidarisme peut se définir comme un système économique et social qui profite à tous dans la mesure où les sommes investies et redistribuées restent sur le territoire où elles sont produites, et bénéficient à l’ensemble de la collectivité sous la forme d’achats de biens ou de services, de salaires et d’impôts. On pourrait lui opposer le terme de capitalisme déraciné ou de capitalisme irresponsable où le capital investi a pour unique fonction d’être rentabilisé le plus rapidement possible au bénéfice exclusif des investisseurs. Le patron responsable fait du solidarisme dans la mesure où ses investissements et la création de richesses qui en découlent profitent à la collectivité. Le patron commis fait du capitalisme irresponsable dans la mesure où les profits qu’il réalise doivent toujours être réalisés au plus bas coût possible et visent prioritairement à payer toujours plus les actionnaires au détriment des salariés et de la collectivité.
Ce discours doit être approfondi dans la dénonciation de la micro-classe oligarchique qui se partage aujourd’hui l’essentiel du pouvoir. Cette nouvelle classe de privilégiés est composée aujourd’hui, outre des hommes politiques nationaux du Système et des dirigeants des principaux médias, mais aussi des grands patrons banquiers ou présidents de multinationales. Le point commun négatif de ces stipendiés du Système est qu’ils travaillent unis contre les intérêts du peuple et au bénéfice exclusif de la finance internationale (cf. le sauvetage des banques à l’aide de nouveaux emprunts que les Français devront rembourser). La théorie de Marx sur la bourgeoisie exploitant le prolétariat pourrait être remise à l’ordre du jour, en intégrant l’idée que désormais une immense classe de néo-prolétaires, incluant les anciennes classes moyennes, est en train de voir le jour et qu’elle se trouve opposée à une oligarchie sans frontière appuyant son pouvoir sur la puissance financière et la religion des droits de l’homme.
L’articulation de ce discours vise à faire comprendre aux électeurs de gauche, qu’il existe une économie « sociale » et solidaire, incluant la notion de profit pour tous, avec laquelle on peut s’entendre et un capitalisme international qui est leur pire ennemi et qui engendre, entre autres maux, le phénomène de l’immigration, qui a pour principal objectif, dans l’esprit de ses promoteurs, de faire peser les salaires des Français à la baisse pour augmenter les profits de l’oligarchie financière internationale.
L’économie est une chose trop sérieuse pour être laissée aux banquiers. Il est clair que cette option s’inscrit en rupture totale avec l’idéologie libre-échangiste du Système. Maurice Allais, seul prix Nobel d’économie français, préfère employer le terme de laisser-fairisme dans la mesure où le libre-échangisme serait parfaitement applicable dans de grands ensembles régionaux bénéficiant d’un niveau de vie comparable et subissant des contraintes sociales de même nature. Mais si les critiques de Maurice Allais contre les excès du Système sont intéressantes, cet auteur n’en reste pas moins un libéral et n’accepte pas la notion d’économie orientée et régulée nécessaire dans une conception solidariste.
Comment définir une économie solidariste, organique et enracinée ?
C’est avant tout une économie au service du peuple et non pour le bénéfice exclusif d’une oligarchie. De ce fait, elle est automatiquement subordonnée au pouvoir politique qui l’oriente mais ne la dirige pas, sauf dans certains secteurs cruciaux. Elle suit les orientations (incitations fiscales, exemptions ou réductions d’impôts, zones franches, interdictions, limites, restrictions) que lui pose l’Etat. De ce fait, elle agit librement dans un cadre donné en fonction de deux impératifs :
1. assurer le bien-être de la population ;
2. assurer les exigences stratégiques de l’Etat.
Tant que l’économie n’est pas en crise et que ces deux impératifs sont satisfaits, l’Etat n’intervient pas. Dès lors qu’un dysfonctionnement intervient, extérieur ou intérieur (prix du baril de pétrole, pénuries alimentaires, hausse du prix des matières premières ou stratégiques etc.) l’Etat use de son pouvoir régalien pour imposer les mesures qu’il juge nécessaires (baisse ou hausse des prix ou des salaires, inflation ou déflation, augmentation des droits de douanes, contrôle des changes, etc.). En conséquence, et contrairement aux exigences du Système Global, il est vital pour un Etat qui désire conserver son indépendance et sa liberté d’agir, de se désendetter et de pouvoir disposer d’une banque centrale sous son contrôle direct afin de pouvoir jouer à sa guise sur la circulation monétaire dans le pays.
Une économie solidariste doit reposer sur le principe de la libre concurrence mais en respectant les valeurs et les traditions des peuples où elle est appliquée. Contrairement à ce que pense les libéraux, tout n’est pas à vendre ou à acheter. En conséquence l’Etat doit réglementer les secteurs où il souhaite détenir le monopole (transports publics, énergie, défense, télécommunications, médias). Il est même souhaitable que ces secteurs restent sous le contrôle étroit et exclusif de l’Etat, notamment les télécommunications et les médias, du fait de leur utilisation potentielle comme armes stratégiques de désinformation.
Afin d’éviter un assoupissement du système inhérent à toute fonction publique et à toute administration centralisée dépourvue de concurrence, il est souhaitable d’instaurer dans ces administrations un système de rémunération au mérite (comportant des limites), géré par une commission mixte de fonctionnaires de tous grades et d’experts indépendants extérieurs à l’administration.
Pour protéger cette économie de tout choc intérieur ou extérieur, il convient de fixer un certain nombre de principes simples :
1. tout ce que peut fabriquer ou produire le pays, sans coûts excessifs, et qui fournit de l’emploi à des salariés ou est considéré comme d’intérêt stratégique par l’Etat, doit être protégé par des droits de douane, variables selon la nature de la menace, ou être nationalisé.
2. La monnaie nationale n’est pas une marchandise et il faut restaurer le système qui la place hors du champ des spéculateurs internationaux.
3. L’Etat doit s’arroger le droit d’interdire toute société ou organisation étrangère dont l’activité peut être néfaste (sur les plans politique, économique ou culturel) pour le pays.
4. L’impôt doit être juste et équitable et toucher proportionnellement toute les classes sociales (sauf les plus démunies) en évitant de frapper trop fort les hauts revenus ce qui risquerait de faire fuir les élites.
5. L’Etat doit se donner les moyens, même à prix exorbitant et donc non compétitif, de fabriquer ce qu’il estime nécessaire pour son indépendance et dont la perte de savoir-faire lui serait extrêmement préjudiciable. (cf. industrie spatiale).
6. Une économie solidariste doit favoriser le principe de fonctionnement des cercles concentriques : il faut qu’une région consomme prioritairement ce qu’elle produit. Si un produit n’est pas disponible dans la région concernée, c’est à la région la plus voisine de l’approvisionner. Si aucune région du pays ne produit le bien recherché, il sera importé, de préférence d’un pays avec lequel existe des accords bilatéraux d’échanges.
7. Une économie continentale ouverte sur les deux océans doit mettre en place le principe de l’autarcie des grands espaces. Le continent Eurasien, de Brest à Vladivostok, possède largement en son sein de quoi satisfaire tous ses besoins essentiels. Pour les rares denrées (café, chocolat…) ou matières premières qu’elle ne posséderait pas, ou alors en quantité insuffisante, des accords de commerce internationaux avec les pays producteurs permettront de pallier la pénurie.
Ces principes d’économie organique ne sont que de simples mesures de bon sens et ils étaient pratiqués naturellement par tous les Etats du monde avant que la maladie libérale et sa dérive libérale-totalitaire ne se répandent sur la surface de la terre. Ils pourraient être remis en place dans un débat comme alternative positive au système marchand mis en place par ceux qui visent à travers lui à s’assurer le contrôle de la planète.
Notre particularité, c’est la logique de la troisième voie, celle qui réussit la synthèse entre le national et le social. Mais pour ce faire, il ne faut pas heurter de front ceux qui en sont restés à une logique dialectique simpliste de type gauche/droite, à savoir socialisme contre libéralisme. La meilleure définition possible pour un solidarisme moderne c’est : « Au travail, sa place, toute sa place ! Au capital, sa place, rien que sa place ! »
Emmanuel Leroy
Article printed from AMI France: http://fr.altermedia.info
URL to article: http://fr.altermedia.info/general/pour-la-definition-dune-doctrine-solidariste_17815.html
URLs in this post:
[1] Image: http://fr.altermedia.info/images/solidarite1.jpg
00:31 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, solidarisme, socialisme, anti-libéralisme, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 26 novembre 2008
http://terceravia.wordpress.com
09:36 Publié dans Blog | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, politique, socialisme, solidarisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 21 novembre 2008
L'Europe comme "troisième force"

ARCHIVES DE "SYNERGIES EUROPEENNES" - 1990
L'Europe comme «troisième force»
par Luc Nannens
Malgré les proclamations atlantistes, malgré l'engouement des droites libérales pour le reaganisme, malgré l'oubli général des grands projets d'unification continentale, depuis la fin des années 70, de plus en plus de voix réclament l'européisation de l'Europe. Nos deux publications, Orientations et Vouloir, se sont faites l'écho de ces revendications, dans la mesure de leurs très faibles moyens. Rapellons à nos nouveaux lecteurs que nous avons presque été les seuls à évoquer les thèses du social-démocrate allemand Peter Bender, auteur en 1981, de Das Ende des ideologischen Zeitalter. Die Europäisierung Europas (= La fin de l'ère des idéologies. L'Européisation de l'Europe). L'européisme hostile aux deux blocs apparaît encore et toujours comme un résidu des fascismes et de l'«Internationale SS», des rêves de Drieu la Rochelle ou de Léon Degrelle, de Quisling ou de Serrano Suñer (cf. Herbert Taege in Vouloir n°48-49, pp. 11 à 13). C'est le reproche qu'on adresse à l'européisme d'un Sir Oswald Mosley, d'un Jean Thiriart et de son mouvement Jeune Europe, ou parfois à l'européisme d'Alain de Benoist, de Guillaume Faye, du GRECE et de nos propres publications. Il existe toutefois une tradition sociale-démocrate et chrétienne-démocrate de gauche qui s'aligne à peu près sur les mêmes principes de base tout en les justifiant très différemment, à l'aide d'autres «dérivations» (pour reprendre à bon escient un vocabulaire parétien). Gesine Schwan, professeur à la Freie Universität Berlin, dans un bref essai intitulé «Europa als Dritte Kraft» (= L'Europe comme troisième force), brosse un tableau de cette tradition parallèle à l'européisme fascisant, tout en n'évoquant rien de ces européistes fascisants, qui, pourtant, étaient souvent des transfuges de la sociale-démocratie (De Man, Déat) ou du pacifisme (De Brinon, Tollenaere), comme l'explique sans a priori l'historien allemand contemporain Hans Werner Neulen (in Europa und das III. Reich, Universitas, München, 1987).
Dans
«Europa als Dritte Kraft»,
in Peter HAUNGS, Europäisierung Europas?, Baden-Baden, Nomos Verlagsgesellschaft, 1989, 160 S., DM 38, ISBN 3-7890-1804-X,
Gesine Schwan fait commencer le néo-européisme dès 1946, quand la coopération globale entre l'URSS et les Etats-Unis tourne petit à petit à l'échec. L'Europe sent alors confusément qu'elle risque d'être broyée en cas d'affrontement de ces deux super-gros. Des esprits indépendants, mus aussi par le désir de rejeter le libéralisme extrême des Américains et le bolchévisme stalinien des Soviétiques avec toutes leurs conséquences, commencent à parler d'«européisation» de l'Europe, ce qui vise à une plus grande unité et une plus grande indépendance du continent vis-à-vis des blocs. La question se pose alors de savoir où s'arrête cette Europe de «troisième voie»? A la frontière polono-soviétique? A l'Oural? Au détroit de Béring et aux confins de la Mandchourie?
Mais l'essai de Gesine Schwan comprend un survol historique des conceptions continentales élaborées depuis la première moitié du XIXième siècle. Essai qui met l'accent sur le rôle chaque fois imparti à la Russie dans ces plans et ébauches. Au début du XIXième, ni la Russie ni l'Amérique, en tant que telles, n'apparaissaient comme des dangers pour l'Europe. Le danger majeur était représenté par les idées de la Révolution Française. L'Amérique les incarnait, après les avoir améliorés, et la Russie représentait le principe légitimiste et monarchiste. Les démocrates étaient philo-américains; les légitimistes étaient russophiles. Mais Washington et Petersbourg, bien qu'opposés sur le plan des principes de gouvernement, étaient alliés contre l'Espagne dans le conflit pour la Floride et contre l'Angleterre parce qu'elle était la plus grande puissance de l'époque. Russes et Américains pratiquent alors une Realpolitik pure, sans prétendre universaliser leurs propres principes de gouvernement. L'Europe est tantôt identifiée à l'Angleterre tantôt contre-modèle: foyer de corruption et de servilité pour les Américains; foyer d'athéisme, d'égoïsme, d'individualisme pour les Russes.
L'Europe du XIXième est donc traversée par plusieurs antagonismes entrecroisés: les antagonismes Angleterre/Continent, Europe/Amérique, Russie/Angleterre, Russie + Amérique/Angleterre, Russie/Europe... A ces antagonismes s'en superposent d'autres: la césure latinité-romanité/germanité qui se traduit, chez un historien catholique, romanophile et euro-œcuméniste comme le Baron Johann Christoph von Aretin (1772-1824) en une hostilité au pôle protestant, nationaliste et prussien; ensuite la césure chrétienté/islam, concrétisé par l'opposition austro-hongroise et surtout russe à l'Empire Ottoman. Chez Friedrich Gentz se dessine une opposition globale aux diverses formes de l'idéologie bourgeoise: au nationalisme jacobin et à l'internationalisme libéral américain. Contre cet Occident libéral doit se dresser une Europe à mi-chemin entre le nationalisme et l'internationalisme. Le premier auteur, selon Gesine Schwan, à prôner la constitution d'un bloc européen contre les Etats-Unis est le professeur danois, conseiller d'Etat, C.F. von Schmidt-Phiseldeck (1770-1832). Après avoir lu le célèbre rapport de Tocqueville sur la démocratie en Amérique, où l'aristocrate normand perçoit les volontés hégémoniques des Etats-Unis et de la Russie, les Européens commencent à sentir le double danger qui les guette. Outre Tocqueville, d'aucuns, comme Michelet et Henri Martin, craignent l'alliance des slavophiles, hostiles à l'Europe de l'Ouest décadente et individualiste, et du messianisme panslaviste moins rétif à l'égard des acquis de la modernité technique.
La seconde moitié du XIXième est marquée d'une inquiétude: l'Europe n'est plus le seul centre de puissance dans le monde. Pour échapper à cette amorce de déclin, les européistes de l'époque prônent une réorganisation du continent, où il n'y aurait plus juxtaposition d'unités fermées sur elles-mêmes mais réseau de liens et de rapports fédérateurs multiples, conduisant à une unité de fait du «grand espace» européen. C'est la grande idée de l'Autrichien Konstantin Frantz qui voyait l'Empire austro-hongrois, une Mitteleuropa avant la lettre, comme un tremplin vers une Europe soudée et à l'abri des politiques américaine et russe. K. Frantz et son collègue Joseph Edmund Jörg étaient des conservateurs soucieux de retrouver l'équilibre de la Pentarchie des années 1815-1830 quand règnait une harmonie entre la Russie, l'Angleterre, la France, la Prusse et l'Autriche-Hongrie. Les principes fédérateurs de feu le Saint-Empire devaient, dans l'Europe future, provoquer un dépassement des chauvinismes nationaux et des utopismes démocratiques. Quant à Jörg, son conservatisme est plus prononcé: il envisage une Europe arbitrée par le Pape et régie par un corporatisme stabilisateur.
Face aux projets conservateurs de Frantz et Jörg, le radical-démocrate Julius Fröbel, inspiré par les idées de 1848, constate que l'Europe est située entre les Etats-Unis et la Russie et que cette détermination géographique doit induire l'éclosion d'un ordre social à mi-chemin entre l'autocratisme tsariste et le libéralisme outrancier de l'Amérique. Malheureusement, la définition de cet ordre social reste vague chez Fröbel, plus vague que chez le corporatiste Jörg. Fröbel écrit: «1. En Russie, on gouverne trop; 2. En Amérique, on gouverne trop peu; 3. En Europe, d'une part, on gouverne trop à mauvais escient et, d'autre part, trop peu à mauvais escient». Conclusion: le socialisme est une force morale qui doit s'imposer entre le monarchisme et le républicanisme et donner à l'Europe son originalité dans le monde à venir.
Frantz et Jörg envisageaient une Europe conservatrice, corporatiste sur le plan social, soucieuse de combattre les injustices léguées par le libéralisme rationaliste de la Révolution française. Leur Europe est donc une Europe germano-slave hostile à une France perçue comme matrice de la déliquescence moderne. Fröbel, au contraire, voit une France évoluant vers un socialisme solide et envisage un pôle germano-français contre l'autocratisme tsariste. Pour Gesine Schwan, l'échec des projets européens vient du fait que les idées généreuses du socialisme de 48 ont été partiellement réalisées à l'échelon national et non à l'échelon continental, notamment dans l'Allemagne bismarckienne, entraînant une fermeture des Etats les uns aux autres, ce qui a débouché sur le désastre de 1914.
A la suite de la première guerre mondiale, des hécatombes de Verdun et de la Somme, l'Europe connaît une vague de pacifisme où l'on ébauche des plans d'unification du continent. Le plus célèbre de ces plans, nous rappelle Gesine Schwan, fut celui du Comte Richard Coudenhove-Kalergi, fondateur en 1923 de l'Union Paneuropéenne. Cette idée eut un grand retentissement, notamment dans le memorandum pour l'Europe d'Aristide Briand déposé le 17 mai 1930. Briand visait une limitation des souverainetés nationales et la création progressive d'une unité économique. La raison pour laquelle son mémorandum n'a été reçu que froidement, c'est que le contexte des années 20 et 30 est nettement moins irénique que celui du XIXième. Les Etats-Unis ont pris pied en Europe: leurs prêts permettent des reconstructions tout en fragilisant l'indépendance économique des pays emprunteurs. La Russie a troqué son autoritarisme monarchiste contre le bolchévisme: d'où les conservateurs ne considèrent plus que la Russie fait partie de l'Europe, inversant leurs positions russophiles du XIXième; les socialistes de gauche en revanche estiment qu'elle est devenue un modèle, alors qu'ils liguaient jadis leurs efforts contre le tsarisme. Les socialistes modérés, dans la tradition de Bernstein, rejoignent les conservateurs, conservant la russophobie de la social-démocratie d'avant 14.
Trois traditions européistes sont dès lors en cours: la tradition conservatrice héritère de Jörg et Frantz, la tradition sociale-démocrate pro-occidentale et, enfin, la tradition austro-marxiste qui considère que la Russie fait toujours partie de l'Europe. La tradition sociale-démocrate met l'accent sur la démocratie parlementaire, s'oppose à l'Union Soviétique et envisage de s'appuyer sur les Etats-Unis. Elle est donc atlantiste avant la lettre. La tradition austro-marxiste met davantage l'accent sur l'anticapitalisme que sur l'anti-stalinisme, tout en défendant une forme de parlementarisme. Son principal théoricien, Otto Bauer, formule à partir de 1919 des projets d'ordre économique socialiste. Cet ordre sera planiste et la décision sera entre les mains d'une pluralité de commission et de conseils qui choisiront entre diverses planifications possibles. Avant d'accèder à cette phase idéale et finale, la dictature du prolétariat organisera la transition. Dix-sept ans plus tard, en 1936, Bauer souhaite la victoire de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie sur l'Allemagne «fasciste», afin d'unir tous les prolétariats européens dans une Europe reposant sur des principes sociaux radicalement différents de ceux préconisés à droite par un Coudenhoven-Kalergi. Mais la faiblesse de l'austro-marxisme de Bauer réside dans son optimisme rousseauiste, progressiste et universaliste, idéologie aux assises intellectuelles dépassées, qui se refuse à percevoir les antagonismes réels, difficilement surmontables, entre les «grands espaces» européen, américain et soviétique.
Gesine Schwan escamote un peu trop facilement les synthèses fascisantes, soi-disant dérivées des projets conservateurs de Jörg et Frantz et modernisés par Friedrich Naumann (pourtant membre du Parti démocrate, situé sur l'échiquier politique à mi-chemin entre la sociale-démocratie et les libéraux) et Arthur Moeller van den Bruck. L'escamotage de Schwan relève des scrupules usuels que l'on rencontre en Allemagne aujourd'hui. Des scrupules que l'on retrouve à bien moindre échelle dans la gauche française; en effet, la revue Hérodote d'Yves Lacoste publiait en 1979 (n°14-15) l'article d'un certain Karl von Bochum (est-ce un pseudonyme?), intitulé «Aux origines de la Communauté Européenne». Cet article démontrait que les pères fondateurs de la CEE avaient copieusement puisé dans le corpus doctrinal des «européistes fascisants», lesquels avaient eu bien plus d'impact dans le grand public et dans la presse que les austro-marxistes disciples d'Otto Bauer. Et plus d'impact aussi que les conservateurs de la résistance anti-nazie que Gesine Schwan évoque en détaillant les diverses écoles qui la constituait: le Cercle de Goerdeler et le Kreisauer Kreis (Cercle de Kreisau).
Le Cercle de Goerdeler, animé par Goerdeler lui-même et Ulrich von Hassell, a commencé par accepter le fait accompli des victoires hitlériennes, en parlant du «rôle dirigeant» du Reich dans l'Europe future, avant de planifier une Fédération Européenne à partir de 1942. Cette évolution correspond curieusement à celle de la «dissidence SS», analysée par Taege et Neulen (cfr. supra). Dans le Kreisauer Kreis, où militent le Comte Helmut James von Moltke et Adam von Trott zu Solz, s'est développée une vision chrétienne et personnaliste de l'Europe, et ont également germé des conceptions auto-gestionnaires anti-capitalistes, assorties d'une critique acerbe des résultats désastreux du capitalisme en général et de l'individualisme américain. Moltke et Trott restent sceptiques quant à la démocratie parlementaire car elle débouche trop souvent sur le lobbyisme. Il serait intéressant de faire un parallèle entre le gaullisme des années 60 et les idées du Kreisauer Kreis, notamment quand on sait que la revue Ordre Nouveau d'avant-guerre avait entretenu des rapports avec les personnalistes allemands de la Konservative Revolution.
Austro-marxistes, sociaux-démocrates (dans une moindre mesure), personnalistes conservateurs, etc, ont pour point commun de vouloir une équidistance (terme qui sera repris par le gaullisme des années 60) vis-à-vis des deux super-gros. Aux Etats-Unis, dans l'immédiat après-guerre, on souhaite une unification européenne parce que cela favorisera la répartition des fonds du plan Marshall. Cette attitude positive se modifiera au gré des circonstances. L'URSS stalinienne, elle, refuse toute unification et entend rester fidèle au système des Etats nationaux d'avant-guerre, se posant de la sorte en-deça de l'austro-marxisme sur le plan théorique. Les partis communistes occidentaux (France, Italie) lui emboîteront le pas.
Gesine Schwan perçoit très bien les contradictions des projets socialistes pour l'Europe. L'Europe doit être un tampon entre l'URSS et les Etats-Unis, affirmait cet européisme socialiste, mais pour être un «tampon», il faut avoir de la force... Et cette force n'était plus. Elle ne pouvait revenir qu'avec les capitaux américains. Par ailleurs, les sociaux-démocrates, dans leur déclaration de principe, renonçaient à la politique de puissance traditionnelle, qu'ils considéraient comme un mal du passé. Comment pouvait-on agir sans détenir de la puissance? Cette quadrature du cercle, les socialistes, dont Léon Blum, ont cru la résoudre en n'évoquant plus une Europe-tampon mais une Europe qui ferait le «pont» entre les deux systèmes antagonistes. Gesine Schwan souligne très justement que si l'idée d'un tampon arrivait trop tôt dans une Europe en ruines, elle était néanmoins le seul projet concret et réaliste pour lequel il convenait de mobiliser ses efforts. Quant au concept d'Europe-pont, il reposait sur le vague, sur des phrases creuses, sur l'indécision. La sociale-démocratie devait servir de modèle au monde entier, sans avoir ni la puissance financière ni la puissance militaire ni l'appareil décisionnaire du stalinisme. Quand survient le coup de Prague en 1948, l'idée d'une grande Europe sociale-démocrate s'écroule et les partis socialistes bersteiniens doivent composer avec le libéralisme et les consortiums américains: c'est le programme de Bad-Godesberg en Allemagne et le social-atlantisme de Spaak en Belgique.
Malgré ce constat de l'impuissance des modèles socialistes et du passéisme devenu au fil des décennies rédhibitoire des projets conservateurs —un constat qui sonne juste— Gesine Schwan, à cause de son escamotage, ne réussit pas à nous donner un survol complet des projets d'unification européenne. Peut-on ignorer l'idée d'une restauration du jus publicum europaeum chez Carl Schmitt, le concept d'une indépendance alimentaire chez Herbert Backe, l'idée d'une Europe soustraite aux étalons or, sterling et dollar chez Zischka et Delaisi, le projet d'un espace économique chez Oesterheld, d'un espace géo-stratégique chez Haushofer, d'un nouvel ordre juridique chez Best, etc. etc. Pourtant, il y a curieusement un auteur conservateur-révolutionnaire incontournable que Gesine Schwan cite: Hans Freyer, pour son histoire de l'Europe. Le point fort de son texte reste donc une classification assez claire des écoles entre 1800 et 1914. Pour compléter ce point fort, on lira avec profit un ouvrage collectif édité par Helmut Berding (Wirtschaftliche und politische Integration in Europa im 19. und 20. Jahrhundert, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 1984; recension in Orientations, n°7, pp. 42 à 45).
L.N.
00:11 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, géopolitique, stratégie, social-démocratie, socialisme, démocratie chrétienne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 11 novembre 2008
Le clivage gauche/droite dans l'histoire politique belge (1830-1900)

Frédéric KISTERS:
Le clivage Gauche/Droite dans l'histoire politique belge (1830-1900).
"La distinction entre gauche et droite est d'ordre polémique et électoral, elle ne détermine pas des catégories politiques essentielles. En effet, la classification en droite et gauche est assez récente, contemporaine de l'apparition de la conscience idéologique au siècle dernier. En plus, elle est essentiellement européenne et même localisée aux pays latins, bien qu'elle ait été reprise, il y a quelques temps par les pays anglo-saxon (...)
En effet, les notions de gauche comme de droite sont des agrégats de logique et de sophismes volontiers dogmatiques, qui servent de raisonnement à ceux qui ne raisonnent pas. En effet, une fois que l'on a choisi le camps de la droite ou de la gauche, on se trouve "casé ' dans une routine qui fait que l'on ne sera plus sensible qu'aux arguments de sa famille."
FREUND (Julien), L'essence du politique, 3e éd., Paris, Sirey, 1986 (ler éd. 1965), p. 825.
L'UNIONISME
Comme le lecteur l'aura subodoré en lisant l'exergue, notre propos sera de montrer, au travars de l'exemple belge, l'ineptie du classement gauche/droite, qui doit sans doute son succès séculaire à sa simplicité.
La distinction entre droite et gauche remonte aux assemblées d'Etats de l'Ancien Régime, dans lesquelles les ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, siégeaient à la droite du souverain, tandis que les représentants du Tiers Etat s'asseyaient à sa gauche. Le 28 août 1789, les députés de la Convention qui se prononçaient sur la question du veto royal des lois se répartirent en deux groupes afin de faciliter le décompte des voix: à droite se positionnèrent les partisans d'un veto absolu (les conservateurs); à gauche, se placèrent les adeptes du veto suspensif (les progressistes). Depuis, cette répartition spatiale est devenue un concept politique... dont il semble impossible de donner un définition satisfaisante, universelle et intemporelle, car le classement gauche/droite varie d'un pays ou d'une époque à l'autre.
En 1795, la France avait annexé les Pays-Bas autrichiens, l'évêché de Liège, le duché de Bouillon et le comté de Chiny. Nous demeurâmes français jusqu'en 1814. Après, les grandes puissances qui avaient vaincu Napoléon, désireuses d'affaiblir la France, offrirent nos neuf départements au roi des Pays-Bas, Guillaume d'Orange, créant ainsi un glaci entre le royaume recouvré par Louis XVIII et les Allemagnes. Quinze ans plus tard, les Belges chassèrent manu militari leur nouveau maître. Pour la première fois, l'on put écrire le nom "Belgique" sur les cartes de géographiel.
Or les vieilles monarchies ne craignaient rien moins qu'une nouvelle révolution. Elles voulaient préserver l'ordre établi en 1815 après la défaite de Napoléon Ier. Quelques régiments eussent balayé nos brouillons bourgeois révolutionnaires, mais aucune des grandes puissances ne voulaient compromettre la paix et l'équilibre de l'Europe. La Belgique existerait donc, n'en déplaise à Guillaume d'Orange. Néanmoins, l'apparition au milieu de l'Europe d'une petite république leur répugnaient. Ils n'avaient pas écrasé l'Ogre pour laisser la place à un Petit Poucet ! Il fallait donc un roi pour ce nouveau trône, n'importe lequel pourvu qu'il régnât, fût-ce sans gouverner. Après quelques tergiversations, le consensus se fit autour de la personne du prince Léopold de Saxe Cobourg Gotha.
La révolution belge avait été rendue possible par une convergence des oppositions au roi Guillaume Ier: les libéraux aspiraient à un gouvernement constitutionnel plus libre, basé sur le suffrage censitaire; les catholiques ne se reconnaissaient pas dans un roi qui menait une politique de centralisation et de laicisation. Les catholiques, autrefois farouchement opposés au libéralisme, évoluèrent vers une attitude plus pragmatique et conciliante. En concédant le principe de constitutionalité, ils consentirent à un grand sacrifice.
Notre Constitution était un amalgame original de la "Grondwet" néerlandaise (40%), de la Charte constitutionnelle de la France (35%), de droit constitutionnel anglais (5%), additionné de quelques éléments nouveaux (10%: le Sénat non héréditaire, la liberté de l'enseignement, les rapports de l'Eglise et de l'Etat, la liberté d'association).
Dans son encyclique "Mirari Vos", le pape Grégoire XVI condamna le modèle belge. Il ne s'attaquait pas au principe d'Etat constitutionnel, qui relevait du temporel, mais au contenu de la Constitution qui instaurait la séparation de l'Eglise et de l'Etat, garantissait les libertés de conscience, de presse et d'opinion, principes qui se conciliaient difficilement avec le dogme et l'Index. Les différents courants catholiques réagirent de manière variable, mais aucune des attitudes adoptées ne menaçait le concensus:
- les ultras rejetèrent l'unionisme, mails obéirent à la Constitution puisqu'en bons traditionalistes ils devaient respecter l'autorité et la loi, même en maugréant;
- les catholiques libéraux ne croyaient pas ou ne voulaient pas croire que la condamnation papale les touchât puisque les résultats de l'unionisme étaient favorables à l'Eglise.
Quant aux libéraux, ils étaient presque comblés par le nouveau régime.
Peu apres l'indépendance de la Belgique, il n'existait pas encore de partis organisés, mais l'on distinguait deux grands groupes de députés aux contours fort imprécis il est vrai, les catholiques (les "conservateurs") et les libéraux (la "gauche progressiste"). Toutefois, aucune ligne de fracture nette et profonde ne séparait les deux mouvances.
Du fait du régime électoral censitaire2, la composition du Parlement était remarquablement homogène, les représentants de la nation étaient issus de la classe la plus aisée de la population belge. Au Sénat, presque tous les élus, dont une large majorité était noble, se déclaraient favorables aux intérêts de l'Eglise et de la grande propriété foncière3. A la Chambre, le nombre de propriétaires fonciers et de représentants de l'industrie domestique excédaient largement celui des membres de la nouvelle bourgeoisie industrielle. La bourgeoisie intellectuelle (professions libérales) s'était introduite en nombre dans l'assemblée. La présence de nombreux hauts fonctionnaires et magistrats dans l'hémicycle renforçait encore la cohésion.
Non seulement les parlementaires appartenaient à la même classe sociale et partageaient des intérêts économiques communs, mais, de plus, ils s'exprimaient tous en français, et, de ce fait, baignaient dans une culture commune.
Quant à la religion, elle ne constituait pas encore un facteur de division, car les radicaux anticléricaux ne formaient qu'une infime minorité. Les libéraux avaient adopté à l'égard de l'Eglise une attitude très conciliante; la plupart d'entre-eux, qu'ils fussent croyants, déistes ou athées, reconnaissaient l'utilité sociale d'une religion qui était un facteur d'ordre: elle apaisait les pauvres et leur inculquait le respect de l'autorité et de la morale.
Un dernier facteur parfaisait la cohésion de l'ensemble: l'existence d'un ennemi commun, les orangistes, partisans du roi Guillaume d'Orange et du rattachement de la Belgique aux Pays-Bas, qui se recrutaient dans la bourgeoisie industrielle des grandes villes comme Anvers et Gand. La menace hollandaise incitait les députés à maintenir leur rangs serrés. L'ennemi nous unit.
Le roi Léopold Ier, qui par son éducation et ses idées demeurait un roi d'Ancien Régime, abhorrait la Constitution qu'on lui avait imposée. Il favorisa la formation de gouvernement d'union alliant catholiques et libéraux modérés. Les gouvernements unionistes qui se succédèrent de 18~1 à 1847 se préoccupèrent surtout d'asseoir et de consolider le nouvel ordre établi. Il s'agissait d'un gouvernement de notables.
Parler de gauche et droite à propos de cette période n'a donc guère de sens. Les événements de 1839 montre qu'un classement pro et anti-gouvernement serait plus adéquat.
Lors des élections de 1839, les orangistes, les catholiques progressistes et les radicaux s'allièrent contre les catholiques conservateurs et les libéraux doctrinaires. Les progressistes, orangistes ou non, provenaient surtout de la bourgeoisie industrielle, financière ou intellectuelle, tandis que la plupart des unionistes jouissaient d'importants revenus fonciers. La coalition anti-gouvernementale fut laminée.
La reconnaissance de l'Etat belge par Guillaume enleva aux orangistes toute raison et moyen de poursuivre leur lutte; la plupart rejoignirent la mouvance libérale dont ils partageaient, entre-autre, l'anti-cléricalisme. Mais l'opposition progressiste fut muselée durant des lustres.
La disparition de l'ennemi orangiste et le peu de succès des radicaux permit une bipolarisation de la vie politique belge entre catholiques et libéraux.
LA NOUVELLE GENERATION LIBERALE
L'unionisme portait en lui-même les germes de sa destruction; l'antagonisme entre libéraux et cléricaux se révéla fatal. En effet, la montée en puissance de l'Eglise provoqua l'appréhension de certains bourgeois et le parti libéral s'érigea alors en défenseur du Tiers Etat contre le clergé et la noblesse. Profitant des mesures favorables à son essor prises par les gouvernements unionistes, l'Eglise avait rapidement accru son patrimoine et le nombre d'écclésiastiques était passé de 4791 à 11 968 de 1829 à 1846. La presque entièreté de l'enseignement était sous sa coupe.
Au début des années 1840, émergea une nouvelle génération de politiciens libéraux, moins conservateurs que leurs aînés. Nouvelle par l'âge d'abord: la plupart de leurs représentants n'avaient pas trente ans, ils avaient donc peu ou pas connu le régime hollandais. Ils étaient issus de la petite bourgeoisie, des classes moyennes et appartenaient à l'élite intellectuelle: la plupart, contrairement aux premiers conventionnels, avaient accompli des études secondaires ou universitaires. Beaucoup exerçaient une profession libérale (avocat, médecin), d'autres étaient ingénieurs, journalistes, professeurs, négociants, petits industriels ou fonctionnaires subalternes. Ils étaient animés par un optimisme irrésistible; ils croyaient au progrès et à la perfectibilité de l'homme. Démocrates, ils prônaient le suffrage universel ou du moins l'extension du droit de vote. D e par leur position sociale, ils étaient plus proches du peuple et de ses problèmes. Certains d'entre-eux ne jouissaient pas du droit de vote, car leur revenus n'atteignaient pas le cens.
Mais, les réformes qu'ils proposaient paraissent aujourd'hui bien timides au regard de la condition ouvrière du l9è siècle. Pour l'améliorer, ils réclamaient la réglementation du travail des femmes et des enfants, l'impôt progressif, la suppression du livret d'ouvrier, la liberté de coalition, le développement de sociétés d'épargne, coopératives et assurances. En effet, ils ne désiraient aucunement bouleverser les structures établies; ils croyaient aux vertus du capitalisme et du libre-échange. Pour eux, c'était l'ignorance et non les structures sociales ou économiques, qui était la cause de la pauvreté des masses. Quant à la moralité, elle était liée au niveau d'éducation, ce qui était raisonnable était nécessairement moral. Donc, il ne fallait pas modifier la société mais éduquer le peuple. En conséquence, ils voulaient établir un enseignement obligatoire, gratuit et laic. Cette volonté, alliée à la conviction que sciences modernes et dogme de l'Eglise s'excluaient, engendra la "Guerre scolaire".
LA NAISSANCE DU PREMIER PARTI
Le 14 juin 1846, sous la présidence de DEFACQZ, conseiller à la Cour de Cassation et grand maître du Grand Orient de Belgique, les libéraux fondèrent le premier parti de l'histoire de Belgique. Il regroupait aussi bien des doctrinaires que des radicaux ou d'anciens orangistes. Il se posait comme le parti de gauche, réformateur, soutenu par la bourgeoisie anti-cléricale, l'adversaire de la droite catholique.
Toutefois, il ne faut pas oublier que, malgré les dissensions entre catholiques et laics, la classe politique demeurait solidaire au niveau de la politique économique: le libéralisme dominait sans partage.
La formation du parti libéral n'excluait pas l'existence en son sein d'une tendance "doctrinaire" et d'une tendance "radicale" qui mettait l'accent sur l'idéal égalitaire hérité des Lumières mais ne renonçait pas pour autant aux valeurs liée à la propriété.Les élections de 1847 ouvrirent la longue ère de domination libérale (1847-1874). Notons qu'à cette époque, nombre de députés dits "libéraux" n'étaient pas affiliés au parti.
Durant cette période, le classement gauche/droite, selon un axe allant du plus réformateur au plus conservateur, se justifie. D'un côté à l'autre de l'hémicycle, nous pouvons aligner les radicaux, les libéraux modérés, les libéraux doctrinaires, les catholiques libéraux, les catholiques conservateurs et les ultramontains.
Le gouvernement Rogier-Frère Orban, formé le 12 août 1847, se composait entièrement de d'élus libéraux4.
LES TROUBLES DE 1848.
Vers 1848, un nouvelle vague révolutionnaire agita l'Europe. Afin que les troubles ne s'étendissent pas dans notre paisible royaume, le nouveau gouvernement libéral abaissa le cens électoral à son minimum constitutionnel, de ce fait le nombre d'électeurs passa ainsi de 47 000 à 79 000 pour une population d'environ 4 500 000 habitants et le cens différentiel entre les campagnes et les villes disparaissait. Dans la foulée, les fontionnaires furent rendus inéligibles. Sous la pression conjuguée de la vague révolutionnaire et de la crise économique, il étendit le champ d'action de l'Etat au domaine économique, ce qui allait pourtant à l'encontre du credo libéral; le Parlement vota des "crédits pour la subsistance" et "pour le maintien du travail", créa la Banque Nationale de Belgique (1850). La loi du 3 avril 1851 définit le cadre légal dans lequel les sociétés de secours mutuels pouvaient oeuvrer.
Vraisemblablement suite aux troubles révolutionnaires et à l'inquiétude qu'ils avaient engendrés, les catholiques bénéficièrent d'un certain regain aux élections partielles de 1850 et 1852 (à l'époque on renouvelait les députés par moitié tous les deux ans). Le roi profita de l'occasion pour appuyer une demière tentative de constitution d'un gouvernement unioniste qui échoua. La bipolarisation de la vie politique était confirmée.
GUERRE SCOLAIRE
La constitution belge contenait deux principes apparemment contradictoires et ne prévoyait aucune hiérarchie entre ces deux valeurs: la liberté de culte et la liberté de conscience. L'Eglise belge avait toléré les libertés constitutionnelles tant que le gouvernement avait favorisé son culte. Avec l'accession au pouvoir des libéraux, la période d'entente s'achevait. Le laicisme de plus en plus intransigeant des libéraux effraya les catholiques, comme la morgue des ultramontains alarma les libéraux. Le fossé s'approfondissait. Peu à peu, sous l'effet des attaques laiques, nombre de catholiques rejetèrent le principe d'un Etat constitutionnel et aspirèrent à un retour aux valeurs de l'Ancien Régime.
De leur c8té, les libres-exaministes, malgré leur maître-mot "tolérance", admettaient difficilement l'adhésion à une religion. Selon eux, les religions niaient le principe supérieur de la liberté de conscience puisqu'elles imposaient des dogmes exclusifs. En fait, les libéraux doctrinaires défendaient le principe de tolérance dans la mesure où les critiques de l'adversaire se basait sur la Raison et la Science et ne remettait pas en cause les fondements éthico-politiques de la société libérale.
Le laicisme pouvait être plus ou moins virulents, les plus durs voulant exclure tous les prêtres de l'enseignement, les modérés désirant en conserver quelques uns comme professeurs de religion. La lutte se concentra autour de l'enseignement.
Durant l'ère libérale, la tension entre les deux p81e politique alla crescendo. En 1842, une loi sur l'enseignement avait imposé à chaque commune l'entretien d'une ou plusieurs écoles primaire, mais elle leur avait laissé la faculté d'adopter une école privée, et donc le plus souvent catholique. Un autre texte créa, en 1850, 50 écoles moyennes et 10 athénées, mettant ainsi fin, du moins ~n théori, au quasi-monopole de l'Eglise sur l'enseignement moyen. Enfin, la loi VAN HUMBEECK (1879), qui avait pour objectif la laicisation de l'enseignement, engendra ce que l'on a nommé "la guerre scolaire". Les catholiques usèrent de moyens de pression religieux: les sacrements étaient refusés au professeurs des écoles officielles, aux élèves et à leurs parents, les curés haranguaient les paroissiens du haut de leurs chaires... Ils créèrent de nombreuses nouvelles écoles grâce au fonds récolté lors de quêtes. Par contre, le financement de la politique libérale nécessita la levée de nouveaux imp8ts, ce qui forcément fit des mécontents. En 1884, les catholiques remportèrent les élections. Cette victoire marqua une rupture entre l'Eglise et la bourgeoisie libérale qui cessa de fréquenter les lieux de culte.
FIN DE SIECLE TROUBLEE POUR LES IDEES SIMPLES
Dans la seconde moitié du l9e siècle, trois mouvements, minoritaires mais très actifs, troublèrent l'impeccable ordonnancement gauche/droite.
a) Entre 1875 et 1884, les ultramontains constituèrent le principal groupe de pression catholique. Ils voulaient transformer le mouvement catholique en un parti confessionnel, organisé et centralisé, alors que les catholiques libéraux rejetaient l'idée de parti et refusaient le mandat impératif, c'est-à-dire la soumission des élus à un pacte, au contraire des libéraux dont les élus étaient tenus de respecter le programme commun. Leur idéal était un retour à la société d'Ancien Régime; les plus extrémistes voulaient créer un Etat catholique dans lequel le Parlement aurait fait place à une représentation par ordre.
Les ultramontains déployaient une grande activité dans le domaine de la charité patronale, ainsi naquit, en 1867, la "Fédération des sociétés ouvrières catholiques belges" qui rassemblait les oeuvres de charité ouvrière catholique. Les ultramontains voulaient créer à l'aide de cette fédération, une organisation hiérarchisée d'ordres ou corporation qui aurait barré la route à la progression de l'individualisme libéral, la hiérarchie des ordres transcendants les oppositions de classes et de partis.
La guerre scolaire (1879-1884) et l'accession de Léon XIII à la dignité papale facilitèrent le rapprochement des ultramontains et des catholiques-libéraux, qui fondèrent ensemble un parti confessionnel capable de contrebalancer la formation laique. Après 1885, les ultramontains, naguère élément moteur du renouveau catholique, disparurent presque entièrement de la vie politique belge. Ils conservèrent néanmoins une certaine influence au sein des organisations caritatives ouvrières.
Par de nombreux aspects de leur idéologie, les ultramontains peuvent être classés à l'extrêmedroite, mais d'après leurs activités sociales et leur volonté de transformation de la société, même si cette mutation est un retour à d'anciennes valeurs, il faudrait les classer à gauche.
b) L'extension progressive du droit de vote amena au flamingantisme des électeurs non francisés issus de la classe moyenne. Peu après 1860, le mouvement flamand, jusqu'alors essentiellement intellectuel et littéraire, trouva sa première expression politique dans le Meetingspartij, une dissidence de la mouvance radicale qui s'implanta surtout à Anvers dont la classe moyenne était restée majoritairement néerlandophone. Le parti se disloqua en 1868, victime de la bipolarisation croissante de la politique belge entre libéraux et catholiques. La scission consommée, plus aucun parti ne représentait le flamingantisme, mais on trouvait de ses adeptes aussi bien au sein du parti libéral qu'au parti catholique. Les flamingants "libéraux" rendaient l'Eglise responsable de l'infériorité culturelle flamande et désiraient émanciper la Flandre grâce à la libre-pensée et à l'enseignement; tandis que les flamingants "catholiques", souvent moins virulents, estimaient au contraire que la religion catholique faisait partie intégrante de la culture flamande, au même titre que sa langue. Il fallut attendre l'entre-deux-guerres pour que le nationalisme flamand retrouvât une concrétisation sous forme de parti. Mais, entre-temps, il avait remporté quelques succès notables5.
c) Le troisième trouble-fête allait mettre fin au bipolarisme. Au départ, les revendications ouvrières furent surtout relayées par les radicaux. En effet, la première génération d'ouvriers était constituée de ruraux déracinés, de travailleurs non-qualifiés, le plus souvent illettrés. Le prolétariat de 1840 était atomisé; il fallut quelques décennies pour qu'il se structure.
Entre 1850 et 1880, les conditions de vie de la classe ouvrière se dégradèrent. Les industriels disposaient d'une main d'oeuvre abondante et peu qualifiée; ils répondaient à chaque baisse de la demande par des licenciements ou des baisses de salaire, celui-ci pouvant descendre endessous du minimum vital. Les journées duraient de 12 à 14 heures. Le travail des femmes et des enfants se généralisa, on les employait jusque dans les mines, pour un salaire équivalent au tiers de celui des hommes. Vu la modestie de leurs revenus, les familles de travailleurs avaient besoin de ce maigre appoint pour survivre, mais l'extension de l'emploi des femmes et des enfants favorisait la baisse des gages alloués aux adultes mâles. Grâce au "truck System", les patrons récupéraient une bonne part des salaires octroyés aux familles ouvrières, qui dépensaient environ 80 % de leurs revenus à la nourriture et vivaient entassés dans des logements exigus, sans la moindre notion d'hygiène. L'homme ne fut jamais autant exploité qu'au siècle du Progrès; les serfs et esclaves des époques précédentes jouissaient d'un niveau de vie plus élevé.
Vers 1880, la population ouvrière dépassa la population occupée dans l'agriculture. Entre 1873 et 1895, l'économie capitaliste connu une longue crise, l'amélioration de l'équipement industriel se poursuivait, la production de certains produits augmentait, mais les profits, les prix et les salaires stagnaient ou baissaient. Le chômage crût, ce qui accentua les tensions sociales.
En 1884, deux phénomènes favorisèrent l'émergence d'un parti socialiste en Belgique:
- la victoire catholique aux législatives provoqua en réaction une agitation anti-cléricale;
- les grèves de l'hiver 1884-1885 virent naître un ensemble d'associations de solidarité (syndicats, coopératives d'achat, caisses de soutien, mutualités...).
Les 5 et 6 avril 1885, 59 organisations ouvrières fusionnèrent avec le parti ouvrier socialiste belge (principalement implanté en Flandre) pour former le Parti ouvrier de Belgique (POB).
La bipolarisation catholiques/libéraux prenait fin. En effet, le POB était bien un parti anticlérical, mais il ne s'adressait pas au même public, il s'opposait aux conceptions économiques et sociales des deux autres partis bourgeois et, surtout, avait des visées révolutionnaires.
RECOMPOSITION DU PAYSAGE POLITIQUE A LA FIN DU SIECLE
1894 est une année charnière sous plus d'un aspect. C'est l'année de la rédaction de la Charte de Quaregnon6 (5/26 mars) et de l'instauration du suffrage universel tempéré par le vote plural7.
Après la publication de l'encyclique Rerum Novarum et l'adoption du suffrage universel tempéré par le vote plural (1894), le parti catholique devint peu à peu un parti oeucuménique. Rejetant le l'individualisme libéral comme la lutte des classes, il développa une théorie corporatiste. Les corporations, inspirées du système d'Ancien Régime, devaient regrouper ouvriers et patrons au sein d'un même corps, sous le patronage de l'Eglise et des notables. Soucieux de maintenir sous sa coupe un maximum d'ouvriers, devenus électeurs, il développa un ensemble d'oeuvres sociales, mutuelles, caisses de crédit et de syndicats pour concurrencer le POB.
Chacun des trois partis, quoique les libéraux dans une moindre mesure, avaient développé un ensemble d'associations permettant d'encadrer ses sympathisants dans tous les aspects vie quotidienne (loisirs, travail, éducation...). En ce sens, le système belge est totalitaire. Comme l'objectif de ces trois piliers de la société est sa pérennisation, les politiciens éludent les véritables problèmes, ils les écartent par des compromis provisoires, renoncent à toute adaptation structurelle. Ils distraient l'électorat en créant de fausses problématiques ou en grossissant des problèmes secondaires.
A la fin du siècle, un parti confessionnel inter-classe faisait donc face à deux formations laiques chacun défenseur d'une classe sociale; en même temps, un parti prolétarien combattaient les deux mouvements bourgeois.
En 1884, le nouveau-venu, le POB se classa naturellement à l'extrême-gauche; le parti libéral devenait de ce fait un mouvement de centre-gauche... Après la Première Guerre mondiale, le il se mua en un mouvement social-démocrate qui n'avait plus rien de révolutionnaire; ses revendications s'atténuèrent jusqu'à l'atonie. Une guerre plus tard, le parti catholique prit le nom de "Parti Social Chrétien" signifiant ainsi son recentrage, un centre que l'on situe d'ailleurs assez difficilement puisque l'on trouve dans cette formation des membres du Mouvement Ouvrier chrétien aussi rouges que nos socialistes comtemporains, aux côtés d'hyper-libéraux néanmoins catholiques. Les partis catholiques belges possèdent le don d'ubiquité. Enfin, le Parti Réformateur Libéral, qui a glissé à droite au cours du siècle, demeure le dernier parti de classe comme le démontre l'étude de son électorat.
Ce repositionnement s'explique par le changement du référent qui sous-tend le classement gauche/droite. Depuis la Révolution française, les analystes politiques opposaient les progressistes, réformateurs ou révolutionnaires (la gauche) aux conservateurs (la droite). En 1886, les révolutionnaires du POB furent rangés suivant cet axiome à l'extrême-gauche. Suivant un principe identique, on plaça les ultramontains à l'extrême-droite malgré que leurs actions sociales allassent plus loin que celles des radicaux puisqu'ils appelaient à un changement de la structure de la société.
Actuellement, le référent qui détermine la distinction entre gauche et droite est le niveau d'intervention de l'Etat dans l'économique; ainsi retrouvons nous à droite les libéraux partisans du retrait plus ou moins prononcé de l'Etat et à gauche les socialistes soi-disant protecteurs des acquis sociaux (à nouveau nous constatons une inversion de valeurs, voilà un parti de renouveau qui vire au conservatisme). En ce sens le terme d'extrême-gauche s'appliquerait aux tenants de vastes nationalisations ou d'une économie dirigiste, tandis que "extreme-droite" dé~ignerait les hypers-libéraux. Dans ce cas, le Front National (belge) mériterait son qualificatif d'extrême-droite, mais il faudrait verser le Parti Communautaire National-Européen (PCN) dans la catégorie extrême-gauche, quoique les journalistes et les "anti-fascistes" fissent fi de la différence.
La confusion naît du fait que l'on utilise un critère économique pour distinguer des attitudes politiques.
D'autres référents interviennent sur un mode mineur. L'autoritarisme est habituellement attribué à la droite qui a peu confiance en a nature humaine et désire donc l'encadrer. La gauche qui croit en la "bonté naturelle " ou la perfectibilité de l'homme, s'affirme plus libertaire. Pourtant, il existe encore des libéraux qui défendent ces valeurs. Si l'on donnait une importance primordiale à ce référant, les communistes deviendraient des extrémistes de droite! Enfin, la dextre postule le primat de l'individu sur le collectif, contre les hommes de gauche qui parlent plus souvent qu'à leur tour de "solidarité" et "d'intérêt général". Pourtant, peu d'auteurs classent les fascistes, grand défenseurs des valeurs communautaires, à l'extrêmegauche...
Il appert que le classement gauche/droite n'est pertinent que dans une société où il n'existe pas d'opposi~ion fondamentale au régime. Il ne s'applique qu'aux partis gouvemementaux à l'intérieur du syst~me. C'est un concept endogène. La seule discrimination valable semble celle qui sépare les ennemis d'un système de ceux qui en vivent. Toutefois, il existe une position intermédiaire, ou plutôt de transition, entre ces deux attitudes: telles formations, comme le Vlaams Blok ou, jadis, les écolos, s'institu~ionalisent peu à peu; en sens conaaire, d'au~es mouvements quittent l'orbe du système dont ils sont issus (Rex, par exemple, provient du parti catholique).
L'histoire politique belge a débuté par une période d'indifférenciation de 17 ans: l'unionisme. De 1846 à 1860, la bipolarisation entre conservateurs catholiques et réformateurs libéraux atteignit sa perfection, nonobstant quelques mouvements, tels que les orangistes, le Meetingspartij, ou les ul~amontains qui brisaient la perspective classique. Nous vivons depuis 1945 une sorte d'unionisme: les partis gouvernementaux, ainsi que d'autres plus petits comme la VU et les écologistes qui pa~icipent déjà aux pouvoirs locaux, partagent une pensée commune (le libéralisme au sens large, le primat de l'économie sur le politique, les DH, le renoncement au projet à long terme) et des intérets et objectifs communs
(maintenir le statu quo). Chacun constate une convergence programmatique de la droite et de la gauche, les socialistes appliquent des recettes libérales, dénationalisent, et les partis de droite, en France corr~ne en Wallonie (Gol singe Chirac), adoptent un discours social et mettent en avant leur "volonté de changement" (thème de gauche). Pa~allèlement, de nombreux partis ou mouvements actuels nient l'essence du politique en défendant les intérêts particuliers de classes d'âge (WOW, Plus ou Jeunes), de classe économique (PIB, libéraux), ou régionaux (Happart, VU...) contre ceux de la Cité.
Ces deux tendances ne sont qu'apparemment contradictoires; elles révèlent l'ambiguité du système: d'une part, nous voyons une classe dirigeante de plus en plus fermée, solidaire mais égoïste, d'autre part se développent des discours qui émiettent les oppositions potentielles en multiples courants rivaux: jeunes contre vieux, ouvriers con~e patrons, Flamands contre Wallons... Rema~q~z que chacun de ces antagonismes est fondé sur une revendication commune ~ Janus sème la zizanie, le citoyen élit son ennemi, l'ennemi le domine.
OUVRAGES UTILISES
MAsLLE (Xavier), Histoire politique de la Belgique. Facteurs et acteurs de changement, sruxelles~ CRISP, 1992 (édition complétée), 428 p.
wrrTE (E.), cRAEYsEcKx (F.), La Belgique politique de 1830 d nos jours, sruxelles~ Labor, 1987 (ler éd. en néerlandais 1985), XIII-639 p.
LORY (J.), Libéralisme et instruction primaire 1842-1879. Introduction d l'étude de la lutte scolaire en Belgique, Louvain, 1979, 2 t. LXXXI-839 p. (Université de Louvain. Recueil de travaux d'histoire et philologie, 6e série, fascicules 17-18)
HAAG (H.), Les origines du catholicisme libéral, sruxelles~ 1950, 300 p.
GILISSEN (J.), Le régime représentatif en Belgique,
ERsA
PIRENNE (H.), Histoire de Belgique, sruxelles~ (1950), t. IV
1 Jusqu'au début du l9e siècle, le mot "belgique" fut employé comme adjectif. On parlait de "Gaule belgique", "provinces belgiques"...
2 Le cens était, en 1831, de 20 à 30 florins d'impôts directs pour les campagnes et de 50 à 80 pour les villes. Il n'y avait que 55 000 électeurs pour 4 079 000 habitants, c est-adire proportionnellement plus que dans les autres Etats européens.
3 Pour être éligibles au Sénat, il fallait payer 1000 florins d'impôts directs. De ce fait, le nombre d'éligibles se réduisait à six ou sept cents grands propriétaires, presque tous nobles.
4 En 1847, la Chambre comptait 55 libéraux et 53 catholiques, en 1848, 85 libéraux
5 1873: le néerlandais est accepté en droit pénal; 1878: usage du néerlandais dans l'administration flamande; 1880; le néerlandais devient la langue de l'enseignement moyen officiel et de quelques disciplines; 1898: une loi établit l'équivalence des deux langues sur le plan juridique.
6 Ce texte très court était la base idéologique dans laquelle tous les socialistes de l'époque se reconnaissaient. Il comprenait quatre points:
- la source des richesses est le travail;
- la richesse doit être équitablement partagée selon l'utilité sociale;
- la société ne doit plus être partagée entre une classe de propriétaires oisifs et une classe de travailleurs obligé de céder à la première une partie du fruit de son travail;
- il faut assurer l'usage libre et gratuit des moyens de production.
7 Les socialistes avaient provoqué une série de grèves pour forcer le Parlement, dans lequel ils n'avaient aucun représentant, de voter le suffrage universel. Après de longs débats et tergiversations, les parlementaires adoptèrent un système hybride:
- tous les citoyens mâles, âgé de 25 ans, domiciliés depuis un an dans une commune, obtenait le droit de vote;
- une deuxième voix était accordée aux pères de famille de 35 ans occupant un habitation représentant 5 francs d'impôts; aux propriétaires d'un immeuble de 2000 F ou d'une rente de 1000 francs;
- deux voix supplémentaires étaient octroyées aux "capacitaires", détenteurs d'un diplôme d'humanité ou universitaire.
Le maximum de voix par électeurs fut fixé à trois (il eût été possible de jouir de 5 voix).
Le nombre des électeurs passait de 136 775 à 1370 687 dont 850 000 électeurs à une voix, 290 000 à deux voix, et 220 000 à trois voix (dont 40 000 capacitaires, parmi lesquels 20 000 ecclésiastiques) pour une population 6 342 000.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : belgique, dix-neuvième siècle, gauche, droite, socialisme, unionisme, europe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 07 octobre 2008
Kurt Schumacher, socialiste prussien

Kurt Schumacher, socialiste prussien
«Aujourd'hui, la sociale-démocratie voit comme grand objectif national l'unité allemande dans la paix et la liberté. Elle s'opposera à toute tentative de fondre des parties du territoire national allemand dans d'autres peuples et combattra tous ceux qui préfèreront de telles solutions à l'unité allemande. Nous voulons la Communauté. Mais toute communauté commence pour nous par une Communauté avec les habitants de la zone soviétique d'occupation et de la Sarre». Ces paroles fortes de Kurt Schumacher ont eu valeur de programme pour la SPD, qui se positionnait comme le “parti de la réunification”. Elles sont extraites d'un long discours de Schumacher, président de la SPD dans l'immédiat après-guerre, prononcé à Dortmund en 1952, lors d'un congrès destiné à donner les mots-d'ordre aux militants de base. Mais que reste-t-il de ce nationalisme social et intransigeant en 1989/90? Rien. Absolument rien. Les soixante-huitards du pouvoir actuel, liquidateurs de la SPD, avaient encore plaidé en 1989, à la veille de la chute du Mur, pour que l'on abroge les phrases réclamant explicitement le retour à l'unité allemande dans le préambule de la loi fondamentale de la RFA. Cet aveuglement et cette trahison font qu'ils courent le risque, aujourd'hui, d'être balayés par l'histoire. Mais le premier Président des sociaux-démocrates de notre après-guerre, Kurt Schumacher, demeurera dans les mémoires, précisément parce qu'il a été clairvoyant, nationaliste et intransigeant. Son œuvre a été patriotique et le peuple allemand doit lui en être reconnaissant.
Un mutilé de 1914-1918
Comme l'immense majorité des jeunes Allemands, Schumacher, après avoir passé son Abitur [équivalent du “bac”], s'engage dans l'armée en août 1914. Il était né le 13 octobre 1895 à Kulm en Prusse occidentale. Envoyé sur le front de l'Est, contre les Russes, le jeune homme, qui ne cache pas ses sympathies socialistes, demande à servir en première ligne, pour contribuer personnellement à arrêter le “danger tsariste”, que dénonçaient la SPD et August Bebel. Mais l'euphorie de l'été 1914 sera de courte durée pour Kurt Schumacher; elle finira tragiquement. Le 2 décembre 1914, le volontaire Schumacher est très grièvement blessé lors de la bataille de Lodz. Il faut lui amputer le bras droit. En 1915, après avoir transité dans de nombreux hôpitaux de campagne, il est démobilisé, avec la Croix de Fer de 2ième classe au revers de son Waffenrock. Il se console en étudiant le droit, l'économie et les sciences politiques à Halle, Leipzig et Berlin. 1918 est, pour lui, l'année d'une terrible césure; au printemps, il s'était affilié à la MSPD, une aile de la sociale-démocratie qui entendait “construire la communauté nationale dans la responsabilité” et visait un réformisme socialiste à forte structuration étatique. Quand éclate la “révolution de novembre”, il devient membre du “Conseil des Ouvriers et des Soldats” du Grand-Berlin. Il y représentait la voie parlementaire au sein du Reichsbund der Kriegsbeschädigten [= Fédération Impériale des mutilés de guerre].
Les bouleversements de la “révolution de novembre” obligent le jeune Schumacher à abandonner l'idée de faire une carrière de fonctionnaire et à se jeter corps et âme dans la politique. Il s'installe dans le Wurtemberg en décembre 1920, pour servir son parti pendant quatre ans à la rédaction de la Schwäbische Tagwacht de Stuttgart. En 1924, il est élu à la Diète du Land de Wurtemberg, où il gagne rapidement ses lauriers de chef de l'opposition sociale-démocrate. En 1930, Chef de la SPD du Wurtemberg et de sa milice, le Reichsbanner, il entre au Reichstag comme député. Mais il est jeune, et le présidium des députés socialistes, composé de vieillards têtus et bornés, le relègue sur les arrière-bancs. Ce n'est que le 23 février 1932 que le militant Schumacher va pouvoir donner de la voix et déployer sa rhétorique tranchante et virulente, et étaler son nationalisme; Goebbels venait de diffamer gravement la sociale-démocratie en la désignant comme le “parti des déserteurs”. Schumacher, le mutilé de guerre, a bondi à la tribune, prêt à prononcer un discours au vitriol, où il a rappelé que les socialistes avaient payé l'impôt du sang et perdu leurs biens au même titre que les autres citoyens pendant la guerre et que leur politique n'était pas moins “nationale” que celle de Goebbels. Schumacher donne ensuite la liste des députés socialistes mutilés, décorés et anciens combattants. Une liste plus longue que celle des nationaux-socialistes... Ensuite, plus dur, il traite Goebbels de “petit mal-foutu, rédacteur de mauvais feuilletons” et l'agitation nationale-socialiste d'“appel constant au cochon qui sommeille dans l'intériorité de tout homme”. Inutile de dire qu'il devint ainsi la bête noire des nazis.
Cette polémique, l'engagement de Schumacher pour l'unité allemande de 1945 à 1952, reposaient sur une vision bien précise du socialisme, qui était un “socialisme prussien”. Dans sa thèse de doctorat, présentée en 1926, et intitulée Der Kampf um den Staatsgedanken in der deutschen Sozialdemokratie [La lutte pour l'idée d'Etat dans la sociale-démocratie allemande], Schumacher, ressortissant de Prusse occidentale, se montre rigoureusement “étatiste” et réclame l'avènement d'une nouvelle doctrine de l'Etat. Il écrit: «La spécificité toute particulière de la germanité, reliée au rôle tout particulier de la sociale-démocratie, montre bien que nous manquons cruellement d'une doctrine socialiste de l'Etat». Sans ambiguités, Schumacher ne cache pas ses sympathies pour “l'organisation étatique prussienne”, héritage d'une vision lassallienne de l'Etat, qui accordait le primat à cette instance parce qu'elle était un instrument d'intervention dans les forces économiques du libre marché et du capitalisme, alors qu'elle était démonisée et combattue par les marxistes.
Quand les nationaux-socialistes prennent le pouvoir en 1933, la carrière de Schumacher prend fin abruptement. Délibérément, il refuse d'émigrer et, à partir de juillet 1933, commence son long périple dans les camps de concentration: Heuberg, Kuhberg et surtout Dachau, où les souffrances du coprs et de l'esprit s'accumulent. Son internement durera dix ans. Ce n'est qu'en 1943 que le mutilé de 1914, manchot mais intact intellectuellement, peut quitter Dachau et revenir à la vie civile. Comme il ne peut plus mettre les pieds à Stuttgart, il s'installe à Hannovre avec sa sœur et son beau-frère. C'est de son bureau dans cette ville qu'il amorcera la reconstruction de la SPD dans les zones d'occupation occidentales. Malgré une santé déficiente, il parvient en quelques semaines ou en quelques mois à devenir le fer de lance de la SPD ressuscitée. Ce retour étonnant, il le doit à son charisme, à ses talents de chef et à sa rhétorique hâchée, dure, sans compromis. Schumacher sait parler et organiser, son passé de souffrances, d'abnégation, qui ne l'ont pas abattu, font de lui l'incarnation de la prusséité protestante et lui attirent des centaines de milliers de sympathisants et des millions d'électeurs, des anciens sociaux-démocrates, des soldats revenus du Front, des anciens des jeunesses hitlériennes... Les jeunes, qui n'ont connu que le national-socialisme, sont fascinés par son credo à la fois nationaliste et social-démocrate. Ensuite, dans un discours, Schumacher leur promet que “la plupart des soldats allemands rentreront dans une nouvelle patrie et en deviendront rapidement les piliers porteurs”.
Après avoir conclu un accord avec son homologue de la zone soviétique, Grotewohl, Schumacher devient le représentant de la SPD-Ouest (en octobre 1945), accède à la dignité de Président du parti en mai 1946, et reste jusqu'à sa mort en 1952 le chef de l'opposition sociale-démocrate au Bundestag. Dans cette carrière, il a eu bien des mérites. Par son influence et sa faculté de persuader ses camarades, il a mis un terme à la politique de “bolchevisation” entreprise par les Soviétiques et leurs complices allemands. Celle-ci n'a réussi qu'à l'Est de l'Elbe. Schumacher a opposé une résistance farouche à toutes les tentatives des “communistes unitaires” d'installer des structures de la SED (est-allemande) à l'Ouest et à Berlin-Ouest.
Maxime de la politique: l'unité
Toute en résistant aux pressions des communistes et de leurs alliés, Schumacher modernise le parti, lui impose une politique et un programme de rénovation, l'ouvre aux classes moyennes. Schumacher rompt avec la dogmatique marxiste et ses justifications sonnent encore assez justes aujourd'hui: «C'est égal, si quelqu'un devient aujourd'hui social-démocrate parce qu'il est un adepte des analyses économiques marxistes, ou s'il vient à nous pour des motifs philosophiques ou éthiques ou s'il adhère à notre socialisme parce qu'il croit aux principes évangéliques du Sermont sur la Montagne. Chacun a les mêmes droits dans le parti d'affirmer sa personnalité spirituelle ou intellectuelle, d'annoncer ses motivations». Mais Schumacher ne tombait pas dans le libéralisme: il restait inébranlablement fidèle aux théories de la macro-planification en économie et à une socialisation partielle. Cette fidélité provenait de sa conception lassallienne de l'Etat qu'il articulait dans le contexte de la reconstruction allemande et de l'alternative socialo-communiste que proposaient les dirigeants de la zone soviétique d'occupation.
Mais le message le plus important de Schumacher a été le suivant: l'insistance sur la réunification. Il a imposé aux chefs de la sociale-démocratie, il a communiqué au peuple de part et d'autre du Rideau de Fer, l'idée que la réunification devait demeurer la “mesure de toute chose” en politique allemande. «Au contraire d'Adenauer, il n'a jamais cessé de plaider pour la réunification, de mobiliser les efforts de son parti pour l'unité. Il en a fait la maxisme supérieure de la politique allemande», écrit l'historien Rainer Zitelmann (in Adenauers Gegner. Streiter für die Einheit, Straube, Erlangen, 1991).
Le 20 août 1952, Kurt Schumacher, le patriote de la sociale-démocratie allemande, meurt après une longue et pénible maladie. Mais le message qu'il a laissé avant de mourir en 1952 reste plus actuel que jamais: «Il faut donner au peuple allemand une nouvelle conscience nationale, à égale distance entre l'arrogance du passé et la tendance actuelle, de voir dans tous les souhaits des Alliés, la révélation d'un sentiment européen. Seul un peuple qui s'affirme lui-même pour ce qu'il est peut devenir un membre à part entière d'une communauté plus vaste».
Christian HARZ.
(Article paru dans Junge Freiheit, n°41/1995; trad. franç. : Robert Steuckers).
00:20 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, socialisme, spd, allemagne, prusse, unité allemande, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 01 octobre 2008
Movimiento de juventud e ideologia nacional revolucionaria bajo la republica de Weimar
MOVIMIENTO DE JUVENTUD E IDEOLOGIA NACIONAL REVOLUCIONARIA BAJO LA REPUBLICA DE WEIMAR
Desde los años 1924/25 hasta las elecciones legislativas de Septiembre de 1930 que proyectaron bruscamente al primer plano al partido nacional socialista, el militantismo nacionalista estaba representado principalmente en Alemania por los grupos paramilitares (Wherverbände) herederos de los cuerpos francos, y por las ligas de juventud (Bund) (1). Bajo el efecto de la crisis económica los elementos más radicales de esos grupos y de las ligas evolucionaron hacia el nacional socialismo revolucionario (tendencia Strasser) o el nacional bolchevismo, mientras que los otros (es decir la mayoría de los miembros y jefes de las ligas) buscaron acomodamiento en el sistema creando nuevos partidos como el Partido del Estado Alemán (surgido de la fusión del Partido Demócrata y de la Joven Orden Alemana de Arthut Mahraun) y el Partido popular Conservador (formado por los social cristianos y elementos surgidos del partido de extrema derecha DNVP) intentando en vano hacer de ellos instrumentos validos de la renovación de Alemania.
EL SOCIALISMO BUNDISCH
Los miembros de las ligas de juventud optaban por el socialismo bündisch, variante del "socialismo alemán" al cual se unieron numerosos medios socio profesionales y grupos políticos de la Alemania de Weimar. El socialismo Bündisch estaba bastante cercano al "socialismo soldadesco" que profesaban sus mayores de los grupos paramilitares. En ambos casos, el socialismo era lo mas importante en el grupo, no solo en el Bund o en el grupo militarizado sino también en el Volksgemeinschaft (la comunidad del pueblo) al que sirve el Bund y en el que esta inserto (2). Mientras que el socialismo soldadesco de los mayores se basaba en la experiencia de la guerra y la camaradería del frente, el socialismo bündisch de los mas jovenes se apoyaba en la experiencia de las excursiones a través de Alemania, en contacto con el pueblo alemán, sobre la experiencia comunitaria de la liga y la camaradería vivida en su seno. Con la crisis y la radicalización creciente de la juventud de las ligas el socialismo bündisch se transforma en un socialismo nacional revolucionario favorable a la nacionalización total o parcial de los medios de producción y a la autarquía alemana y centro europea.
EL DESAFIO HITLERIANO
Tras el acceso de Hitler al poder, las principales ligas de juventud (excepción hecha de los moderados, sobre todo del importantisimo "Deutsche Freischar") se unieron en marzo de 1923 en la Grossdeutsche Jugenbund bajo el patronazgo del almirante Von Trotha, próximo al presidente Hinderburg. Esperaban así escapar a la sincronización (Gleiehschaltung), es decir, a su disolución e integración en la Juventud Hitleriana. Por su parte, las ligas mas duras, las mas volkisch (para las que Volk era sinónimo de raza) y al mismo tiempo las críticas con respecto al hitlerismo (al que juzgaban desde un punto de vista nacional bolchevique) se reagruparon en una bündisch para el servicio de defensa del trabajo y las fronteras) bajo la presidencia de un troskista del nacional socialismo, el Dr. Kleo Pleyer (3).
Pese a todos sus esfuerzos las ligas de juventud fueron disueltas tras el verano de 1933. Sus miembros entraron entonces masivamente en la juventud hitleriana y en el Deutsche Jungvolk que reagrupaba a los elementos mas jovenes de la HJ para continuar sus actividades y promover el espíritu bündisch. Los mayores, (próximos a Friedrich Heilcher) entraron en las SS y la Ahnenerbe (Herencia de los antepasados, sector de las SS especializado en la investigación científica, particularmente la histórica y prehistórica). Otros, (los estraserianos bajo la dirección de Heinz Gruber) prefirieron entrar en el Frente del Trabajo a fin de acentuar la orientación socialista. Finalmente, el Dr. Werner Haverbeck intenta reagrupar en una organización, la Reichsbund Volstum und Heimat, asociación satélite del KdF (Kraft durch Freude, Fuerza por la alegría) a la juventud de espíritu bündisch, organización está que llegará a contar con un millón de miembros (4).
COMIENZA LA REPRESION
Bajo la presión de Baldur von Schirach, jefe de la juventud hitleriana, que temía ver su autoridad sobre la juventud alemana contestada, se abate la represión sobre los antiguos líderes bündisch, algunos fueron excluidos de la HJ (Werner Lass)(5), otros fueron arrestados (Heinz Gruber)(6), (Robert Oelbermann)(7) o forzados al exilio ( Eberhard Koebel (8), Fritz Borinski (9), Hans Ebeling (10), Karl Otto Paetel (11) etc ), otros finalmente fueron asesinados (Karl Lamermann) (12) durante la noche de los cuchillos largos. El Reichbunde de Haverbeck fue disuelto.
Pese a cuatro prohibiciones sucesivas (en 1933, 1934, el 6 de febrero de 1936 y el 13 de mayo de 1937) y la incorporación obligatoria de los jovenes alemanes en la juventud hitleriana decidida en 1936 y aplicada de hecho en 1939, algunas ligas continuaron sus actividades en Alemania en la clandestinidad. Ese fue el caso de la DJ.1.11. fundada por Tusk en 1931 (13) unida a Karl Otto Paetel y Otto Strasser ambos igualmente en el exilio (Helmut Hirsch, miembro de la DJ.1.11. fue condenado a muerte el 4 de junio de 1937 y colgado en Plötzensee); fue también el caso del "Nerother Wandervögel" (14) y del Jungnationaler Bund Deutsche Jungenschaft (15) desmantelado en 1937 y cuyos jefes serán torpemente condenados en el proceso de Essen.
Si algunas ligas pudieron sobrevivir en la clandestinidad otros grupos nuevos aparecieron, bandas de adolescentes que rechazaban la integración en la HJ y la militarización de la HJ (16). Algunas de esas bandas imitaban los modos occidentales y prefiguraban ya las bandas de la postguerra, otras profesaban un cristianismo moralizador y constituían la supervivencia de las organizaciones de juventud cristianas, otras renovaban el ideal romántico del Wandervögel. Entre esos nuevos grupos el más conocido fue sin duda "Die Weisse Rose"" de la que algunos de sus miembros habían pertenecido a las ligas de juventud. Los jovenes bündisch y sus émulos no fueron los únicos en resistir al "fascismo" hitleriano, hay que citar también la resistencia de los jóvenes comunistas en el medio obrero y de los jovenes católicos en Renania y Baviera. Mientras que los primeros se apoyan sobre la infrastructura clandestina del partido comunista alemán, los segundos lo hacen sobre el concordato firmado en 1933 entre Hitler y el Papa.
EL IDEAL BUNDISCH EN EL EXILIO
El ideal bündisch progresivamente sofocado en Alemania se mantiene en el exilio extranjero. Otto Strasser suscita la creación de un "ring bundischer Jugend" que se integra en su Deutsche Front gegen das Hitler system (Frente alemán contra el sistema hitleriano). En París, una revista antifascista controlada por los comunistas ve la luz bajo el título de "Frei Deutsche Jugend" (este nombre había designado entre 1913 y 1923 a una fracción del movimiento de juventud independiente y designara tras la segunda guerra mundial a la organización juvenil de la RDA). Karl Otto Paetel editaba primero en Estocolmo, luego en Bruselas y finalmente en París las "Schriften der Jungen Nation" y las Blatter des sozialistichen Nation" (difundidas en Alemania por las hermanas Silieva, miembros de la DJ.1.11. de Berlín). En Bélgica, Hans Ebeling y Theo Hespers fundan en 1935 el "Arbeitgemeimschaft Bundischer Jugend" al que se adhieren Paetel, Tusk, la revista "Frei Deutsche Jugend", etc... y que da nacimiento al "Deutsche Jugend Front". Este frente de la juventud estaba ligado a grupos neerlandeses, belgas y británicos. Había nacido de la voluntad de reagrupar a toda la juventud alemana de oposición. Pero esta tentativa fracasa a causa de las maniobras comunistas y de la falta de cohesión de esos jovenes opositores. Ebeling y Hespers que no desfallecían crearon entonces la revista "Kameradschatf" de 1937 a 1940.
HANS EBELING Y THEO HESPERS
El facsimil de la revista "Kameradschatf" (Camaradería) constituye un importante testimonio sobre la resistencia de la juventud bündisch al estado hitleriano y del proyecto de estado y sociedad que estaba opuesto al fascismo. Esta revista de lengua alemana editada en Bélgica era distribuida clandestinamente en Alemania. Sus fundadores Hans Ebeling y Theo Hespers eran dos antiguos jefes de las ligas de juventud en el exilio. El primero, nacido en 1897 en Krefeld había tomado parte en la primera guerra mundial (de la que salió con el grado de teniente); en los combates de 1920 (Renania), en las filas de la Reichwehr provisional y en la resistencia contra las tropas de ocupación francesas en el Ruhr. Poco después se une al "Jungnationaler Bund" del que se separó en 1924 para fundar la "Jungnationaler Bund Deutsche Jungenschaft" mas activista y radical que evoluciona pronto hacia el nacional bolchevismo. A partir de finales de 1929 y hasta Enero de 1933 Ebeling dirige con el profesor Lenz la revista "Der Vorkampfer" (17). Theo Hespers, nacido en 1903 entra a los catorce años en la organización de juventud católica "Quickborn" a la que pertenece hasta 1927. Participa también en la resistencia pasiva contra la ocupación franco belga del Rhur. Se adherirá seguidamente a la "Vitus heller Bewegung" (18) y dirigirá la "Pfadfinderschaft Westmark" que constituirá junto con la liga de Ebeling, la de Werner (Freischar Schill) y la joven liga prusiana de Jupp Hoven, el "Comité de lucha de los grupos nacional revolucionarios de la marca occidental en Renania".
EL "BUND", ALTERNATIVA A LOS PARTIDOS Y AL PARTIDO UNICO
"Kameradschatf" era la tribuna de los jóvenes opositores al hitlerismo. Los jóvenes nacionales", "jovenes socialistas", "jóvenes católicos" y "jóvenes protestantes" se expresaban en Kameradschatf y en ella se afirmaban bündisch, nacionalistas volkisch y gran alemanes, cristianos, demócratas y socialistas.
Para ellos, el Bund constituía un modelo político, modelo de una "democracia a la alemana" fundada sobre el duo Fuhrer Gefolgschaft (el fuhrer carismático al servicio de la idea, libremente elegido y sometido a la permanente aprobación del grupo, siendo solo un "primus inter pares"). Oposición al Bund a los fallidos partidos de la democracia weimeriana y al partido único de la dictadura hitleriana. El Bund era también un modelo social fundado sobre la Camaradería (Kameradschatf) opuesta a la Schadenfreude hitleriana, un modelo de integración del individuo y de socialización fundada sobre el entusiasmo, un modelo de educación política y el modelo mismo de la comunidad de combate revolucionaria formada por la juventud activista alemana, enemiga de Weimar y después del hitlerismo.
Para los colaboradores de "Kameradschatf" que insistían particularmente sobre el papel jugado por el Bund en materia de educación política y para los que el hombre bündisch era el hombre político por excelencia enteramente dedicado al servicio del Estado del pueblo, el estado hitleriano aparecía como una dictadura de elementos pequeño burgueses apolíticos (asociados a una Reichwehr politizada pero tímida ante toda responsabilidad política). la liquidación política, a veces incluso física, bajo el III Reich del activismo nacionalista (grupos paramilitares y ligas de juventud) considerado como peligroso para los nuevos señores de Alemania, les parecía a este respecto revelador (19).
REDEFINIR LA VOLKGEMEINSCHAFT
Los nacionalistas volkisch tomaban la defensa del pueblo y del Volkstum pero rechazaban el imperialismo neo alemán de los hitlerianos, en el espíritu de los colaboradores de "Kameradschatf" el nacionalismo volkisch se consagra a defender la independencia y el Volkstum de todos los pueblos. Defendían igualmente a los Volkgenos contra la explotación capitalista que aun perduraba y contra el arbitrio del Estado hitleriano, predicaban la constitución de un verdadero Volksgemeinschaft (comunidad del pueblo) sin relación con la susodicha volkgemeinschaft producto de la dictadura policial y de la masificación hitleriana, la constitución de esta "verdadera" volkgemeinschaft necesitaba a sus ojos un nuevo orden socio económico (socialista) que pusiese fin al orden de clases nacido del capitalismo y una reorientación espiritual (volkisch) de esencia cristiana que combatiría el desarrollo materialista de la época (20).
Como Otto Strasser, oponían la tradición gran alemana fundada sobre el rechazo dualismo austro prusiano, en el que se situaban, al pangermanismo.
Rechazaban la economía capitalista fundada sobre el provecho así como la economía de guerra y la "anarquía burocrática" (simbiosis esta que realizaba a la perfección la Alemania hitleriana) las cuales pretendían substituir por un Plan (alemán primero y europeo después). Preconizaban en el marco de ese plan una economía destinada a satisfacer las necesidades del pueblo, la nacionalización de las industrias clave que rompiera el poderío del gran capital y el reparto de las grandes propiedades agrícolas y finalmente la constitución de cooperativas en todos los ámbitos de las actividad económica.
LA TRADICION LIBERTARIA DEL WANDERVOGEL
La redacción de Kameradschatf se declaraba heredera de dos tradiciones:
1) la del movimiento de juventud independiente, sobre todo de la "Juventud alemana libre" nacida del reencuentro del Hohe Meissner de 1913.
Contra el mundo paternalista (Vatenvelt) el movimiento de juventud había afirmado su fidelidad a los padres originales, a los ancestros (Vorvater) (21). Contra la tutela de las instituciones (escuela, iglesia, familia) y la sociedad burguesa reivindica la independencia y acoge en su seno jovenes líderes. Contra el estado Wilhelmiano y el chauvinismo burgués afirma su amor al Volk (22). Contra la gran ciudad el movimiento de juventud había propuesto el "Wandern", la excursión a través del país alemán (La Alemania profunda) y el contacto del Volk alemán auténtico. Contra la religión revelada el movimiento juvenil intenta despertar una religiosidad germánica. Contra el tabaquismo y el alcoholismo que condena, contra la degeneración física, exalta la fuerza física y la belleza nórdica (pintada por el dibujante Fidus) practicando la gimnasia y el nudismo.
Finalmente, tras la prueba de la gran guerra el movimiento de juventud había desembocado en las ligas surgidas en 1924/25 de la fusión de los grupos scouts disidentes y del Wandervögel y la juventud alemana libre (1919).
LA TRADICION DE LOS CUERPOS FRANCOS
2) La de los cuerpos francos que en 1919 formaron la Reichwehr provisional antes de convertirse en enemigos de este ejercito salido de las cláusulas militares de Versalles (que revivieron las tradiciones nobiliarias del ejercito imperial poniendo así termino a la democratización del Ejercito y sobre todo del cuerpo de oficiales, provocado por la gran guerra y sus consecuencias) y la de los grupos paramilitares nacional revolucionarios que suceden a los cuerpos francos y que hacen frente a la Reacción encarnada por los industriales y terratenientes, los generales de la Reichwehr y los políticos de la derecha.
Pese a la originalidad del enfoque dado por la revista (interpretación que se acercaba en ciertos aspectos a la "teoría del totalitarismo"), "Kameradschatf" retomaba contra el hitlerismo ciertas críticas formuladas anteriormente por sus predecesores de los cuerpos francos de los grupos paramilitares con respecto a Weimar (y sobre todo de la Reichwehr asociada al poder hitleriano).
LOS VINCULOS DE LA "BUNDISCHE" EN EL EXILIO CON LOS "INCONFORMISTAS" Y LOS PLANISTAS FRANCESES
Además de esa filiación evidente entre el movimiento de juventud alemán, los Cuerpos Francos, grupos paramilitares y Kameradschatf, se constaba un extraño parentesco entre las ideas de la juventud bündisch tal y como se expresaba en "Kameradschatf" y la de los jovenes no conformistas franceses de los años treinta que se adherían a las palabras de orden patrióticas y federalistas, personalistas y comunitarias, planistas y corporativistas.
Habían existido contactos entre los representantes de las ligas de juventud alemanas y grupos no conformistas franceses Harro Schulze Boyssen (antiguo militante de la "Orden Joven Alemana" que más tarde debía jugar un importante papel en la "orquesta roja", director de "Planner", el equivalente alemán de la revista francesa "Plans" dirigida por Philippe Lamour, fue con Otto Abetz uno de los delegados alemanes en el frente único de la juventud europea, creada por iniciativa de los grupos franceses "Plans" y "Ordre Nouveau" (23). Por su parte, Ordre Nouveau mantiene contactos bastante estrechos con Otto Strasser, el grupo constituido por la revista "Die Tat" y sobre todo la revista "Der Gegner" (El adversario) (a la que Louis Dupeux consagra un capitulo de su tesis sobre el nacional bolchevismo) animado por Harro Schulza Boyssen y Fred Schmid, fundador y jefe de la Liga "El cuerpo gris" escisión de la "Deutsche Freischar" (24). Pero los contactos personales no bastan para explicar una tal convergencia: lo que acercaba a los mejores elementos de la juventud alemana y la francesa era el común rechazo del liberalismo y del totalitarismo y una aspiración común a una evolución espiritual (o si se prefiere cultural) política y socio económica.
Thierry Mudry.
NOTAS
1) Durante los cuatro o cinco años de la breve prosperidad de Weimar y sobre todo entre 1925 y 1927, el primer plano en materia de activismo ultra nacionalista está unido a las ligas o asociaciones paramilitares (Wehrverbande). Estas ligas surgían generalmente de los cuerpos Francos de la inmediata postguerra, aunque cada vez en mayor grado reclutaban sus miembros en el movimiento de juventud "burgués" (Louis Dupeux. Estrategia comunista y dinámica conservadora. Ensayo sobre los diferentes sentidos de la expresión "nacional bolchevismo" en Alemania bajo la república de Weimar (1919/33). Libreria Honoré Champion, París 1976, pag 294/5.)
2) "El Bund es el vigor del vinculo comunitario opuesto al individualismo anarquizante del antiguo Wandervögel, el acento es puesto sobre el grupo (lo que permitirá hablar de un socialismo bündisch) pero también sobre la jerarquía, la selección de los miembros y la libre designación de los "jefes". Es, a fin de cuentas la educación de una élite destinada a dirigir y a servir a Alemania al término de una revolución cultural; es la imagen misma en miniatura de esta nueva Alemania" (L. Dupeux, idem pag 335).
3) Ver Hans Chritian Brandenburg, Die Geschichte der J. Verlag Wissenchaft n. Politik, Köln 1982. pag 137 y 139.
4) Ver Hans Ch. Brandemborg. idem. pag 194/5.
5) Werner Lass: fundador y jefe de la "Freischar Schill" organización secreta de los Erdgenossen los conjurados .
6) Heinz Gruber: fundador y jefe de la Schwenze Jungmanschaft, disidente social revolucionario de la Juventud Hitleriana y parte integrante del Frente Negro de Otto Strasser.
7) Robert Oelbermann: fundador y jefe del "Nerother Wandervögel".
8) Eberhard Koebel (Tusk fundador y jefe de la DJ.1.11. disidente de la importante "Deutsche Freischar".
9) Fritz Borinski: uno de los dirigentes de la Deutsche Freischar, social demócrata.
10) Hans Ebeling: fundador y jefe del "Jungnationaler Bund Deutsche Jungenschaft".
11) Karl Otto Paetel: fundador y jefe del "Gruppe Sozialrevolutionarer Nacionalisten".
12) Karl Lamermann. dirigente de la Deutsche Freischar.
13) Sobre la DJ.1.11. y Tusk conviene leer a Hans Kraul. "Der jungenschafer ohne Fortune. Eberhard Koebel (Tusk) erlebt und biographisch erarbeitt von einem Weiner Gefahrten", Dipa Verlag, Frankfurt am Main 1985. , y a Helmut Gran "DJ.1.11.: Struktur und Wandel eines subkulturelles jugendlichen Miliens in vier Jahrzehnten", Dipa Verlag, Frfrt., 1976. Estas dos obras han sido recesadas en Vouloir nº 28/29. Mayo de 1986.
14) Sobre el "Nerother Wandervögel" hay que leer a Stefan Krolle, "Bundische Umtriebe. Die Geschichte des Nerother Wandervögels vor und unter dem NS Staat, Ein Jugendbund zwischen Konformität und Widerstand, Lit Verlag, Munster 1985.
15) Ver mas adelante.
16) Sobre estos nuevos grupos ver: Fritz Theilen. "Edelweisspiraten". Fischen Taschenbuch Verlag. Frankfurt an Main 1984.
17) Hans Ebeling participa en campañas de otros dirigentes bündisch (Werner Lass y Karl Otto Paetel sobre todo) en los encuentros de Freusburg (Agosto de 1927) y de Ommen en Holanda (Agosto de 1928) destinados a preparar la fundación de una liga mundial por la paz. Esos encuentros internacionales tras los cuales los jovenes jefes bündisch establecieron contactos con representantes de la extrema izquierda y los pueblos colonizados, aceleraron la radicalización de las ligas de juventud (señalemos que Hans Ebeling, Werner Lass y Karl Otto Paetel se convirtieron seguidamente en figuras del nacional bolchevismo) y determinaron a Ebeling a fundar con el profesor Lenz en Enero de 1930 la revista "Der Vorkampfer" de orientación ultranacionalista y anti capitalista (El Vorkampfer adaptaba elementos de análisis marxista, anti imperialista y prosovietico.
18) El movimiento de Vitus Meller al que pertenecía Theo Espers, era el único movimiento nacional bolchevique cristiano (los otros eran indiferentes en materia religiosa o practicaban un ateismo agresivo o se pronunciaban por un neo paganismo germánico) implantado en el medio católico (aún como muestra L. Dupeux el nacional bolchevismo era un fenómeno mayoritariamente "protestante" nada extraño ya que se vinculaba a la tradición de Arminius, Witukind y Lutero lo que no impedía a la católica Renania, región frontera sensible a las tesis nacional alemanas, ser con Berlín y Franconia una plaza fuerte del nacional bolchevismo).
19) "Kameradschatf" consagra con amplios artículos a los procesos contra el "Jungnationaler Bund, Deutsche Jungenschaft" y contra Niekisch y los "camaradas Eberhard".
20) Los nacional socialistas revolucionarios de Otto Strasser y los nacionalistas social revolucionarios de K.O. Paetel defendían el mismo punto de vista (en el aspecto espiritual mas pagano germánico que cristiano).
21) Ver: J. Pierre Faye. Lenguajes Totalitarios Hermann, París 1973, pag 22. Hay traducción española en Taurus.
22) Para G. Mosse, el movimiento de juventud independiente era indiscutiblemente "volkisch" pero su nacionalismo se oponía al nacionalismo wilhelmiano oficial imperialista y chauvinista. Su nacionalismo fundado sobre el Volk y no sobre el Estado, en lugar de ser agresivo y expansivo era intensivo e introvertido (G. Mosse, The Crissis of German Ideology, Schoken Books, N.Y. 1981. pag 179.
23) Ver: J. Louis Laubet del Bayle. Los no conformistas de los años treinta. Seuil, París 1969 pag 98.
24) J. L. Loubet del Bayle. idem. pag 113.
00:05 Publié dans Mouvements de jeunesse | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, révolution conservatrice, nationalisme révolutionnaire, jeunesse, contestation, socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 23 août 2008
G. Schröder sur la Guerre du Caucase et les relations euro-russes

L’ex-Chancelier Gerhard Schröder sur la Guerre du Caucase et les relations euro-russes
Résumé de l’entretien qu’il a accordé au “Spiegel”, n°34/2008
Q.: Monsieur Schröder, qui est responsable de la guerre dans le Caucase?
GSch: Le conflit possède sans nul doute ses racines historiques, car ila déjà connu plusieurs expressions au cours de l’histoire. Mais l’élément déchencheur dans les hostilités actuelles est l’entrée des troupes géorgiennes en Ossétie du Sud. Voilà ce qu’il ne faut pas chercher à dissimuler.
Voilà la première réponse de l’ancien Chancelier fédéral Schröder aux journalistes du “Spiegel”, cette semaine. Le ton est donné. Il est vif, succinct, dépourvu d’ambigüités. Schröder rappelle également dans cet entretien, plusieurs vérités bonnes à entendre et qui recèlent bien des similitudes avec notre discours, que nous tenons depuis bientôt trois décennies:
- qu’il n’a jamais jugé intelligente la politique de Washington de faire encadrer l’armée géorgienne par des conseillers militaires américains;
- qu’il est bizarre que ces conseillers n’ait pas eu vent des projets russes; “ils sont soit dénués de qualités professionnelles ou alors ils ont été trompés sur toute la ligne”, ajoute-t-il;
- qu’il ne faut pas oublier que le déploiement de fusées américaines en Pologne et en Tchéquie a hérissé les Russes; ndlr: imagine-t-on l’effet qu’aurait fait l’installation de fusées en Géorgie?
- que l’Occident a commis des erreurs très graves dans sa politique à l’endroit de la Russie.
- qu’il ne partage pas l’idée répandue en Occident d’un “danger russe” et que la perception de la Russie à l’Ouest n’a pas grand chose à voir avec la réalité;
- qu’il existe une dépendance mutuelle entre l’Ouest (du moins l’Europe de l’Ouest, ndlr) et la Russie; qu’il n’y a pas un seul problème global qui puisse être réglé sans le concours de la Russie; qu’il n’y a pas moyen, en Europe de l’Ouest, de se passer du pétrole et du gaz russes et, en Russie, de se passer des commandes européennes;
- qu’il n’y a aucune raison d’abandonner le principe du “partenariat stratégique” germano-russe pour satisfaire la politique de Saakachvili;
- qu’il n’y aura pas de retour au “status quo ante” en Abkhazie et en Ossétie du Sud, non pas parce la Russie y a pratiqué, contre Saakachvili, une politique du “gros bâton”, mais parce que la population ne le veut pas;
- qu’il ne souhaite pas l’envoi de soldats allemands en Géorgie pour une mission de pacification;
- que Merkel et Steinmeier ont eu raison de ne pas s’enthousiasmer, de manifester leur scepticisme, lors du sommet de l’OTAN en avril dernier à Bucarest, face à la candidature géorgienne, contrairement à l’avis des Américains et de certains pays est-européens;
- que si la Géorgie avait fait partie de l’OTAN, l’Allemagne et l’Europe entière se seraient retrouvées aux côtés d’un aventurier politique (“ein Hasardeur”);
- que l’Ukraine et la Géorgie doivent d’abord régler leurs problèmes intérieurs avant de songer à rejoindre des regroupements d’Etats comme l’OTAN ou l’UE;
- que le coup de force de Saakachvili aura eu au moins l’effet bénéfique de postposer pendant plusieurs années au moins l’adhésion effective de la Géorgie à l’OTAN;
- qu’il ne partage pas les propos tenus, lors des événements de Géorgie, par le secrétaire général de l’OTAN;
- qu’il n’est pas un “Géorgien” dans le sens où le veut la déclaration du candidat républicain à la présidence des Etats-Unis, McCain, qui avait proclamé: “Nous sommes tous des Géorgiens!”;
- qu’après avoir lu les dernières tirades du belliciste néocon Robert Kagan à propos de l’entrée des troupes russes en Ossétie du Sud, évoquant un “tournant dans l’histoire” et “le retour des conflits entre grandes puissances pour raisons territoriales”, il reste profondément perplexe; que Kagan appartenait déjà au club de “ces messieurs” (sic) qui ont poussé à la guerre en Irak, guerre dont les conséquences ne sont intéressantes ni pour l’Amérique ni pour l’Europe; et que, par conséquent, personne ne doit plus écouter les “bons conseils” de ce Kagan;
- que la fin de la domination unipolaire de l’Amérique approche (allusion à son récent essai publié par l’hedomadaire “Die Zeit” de Hambourg); que les démocrates autour d’Obama s’en rendent compte, comme d’ailleurs tous les républicains raisonnables; que l’Amérique est contrainte d’accepter la multipolarité dans le monde, qu’il n’y a plus moyen désormais d’agir sur le monde autrement qu’en termes de multipolarité; que les républicains devront se soumettre à cette évidence et agir en cherchant des alliés et en tenant compte de l’avis des instances internationales (ndlr: contrairement à l’équipe de Bush jr.); sinon, l’Amérique gagnera sans doute encore des guerres mais perdra toujours la paix; en clair, Schröder annonce la faillite de l’option néocon;
- que l’unification des esprits en Europe, sur le plan de la politique extérieure, a connu un réel ressac depuis 2005 (ndlr: c’est-à-dire depuis la disparition factuelle de l’Axe Paris-Berlin-Moscou), notamment à cause de l’intégration de nouveaux Etats (ndlr : agités par une certaine russophobie);
- que l’Europe ne jouera un rôle sur l’échiquier international, entre l’Amérique et l’Asie, que si elle développe des relations étroites avec la Russie et les maintient sur le long terme; qu’en ce sens, lui Schröder, perçoit la Russie comme partie intégrante de l’Europe plutôt que comme partie intégrante de toute autre constellation;
- que l’équipe dirigeante de la Russie actuelle pense de la même façon mais que sa marge de manoeuvre est plus grande: la Russie peut jouer une carte asiatique mais non l’Europe;
- qu’il s’insurge contre toute diabolisation de la Russie dans les médias; que ni le “Spiegel” ni les autres organes de presse en Allemagne et en Europe ne doivent participer à la diffusion d’informations erronées voire carrément fausses (ndlr: c’est-à-dire, pour nous, à ne pas reproduire les clichés des agences du soft power américain);
- qu’il est le président du comité des actionnaires de “Nord Stream” (le complexe des oléoducs et gazoducs amenant vers la Baltique les hydrocarbures de Russie); que ce complexe est géré par un ensemble d’entreprises allemandes, néerlandaises et russes dont l’objectif est de construire un réseau de gazoducs et d’oléoducs sous la Baltique pour approvisionner l’Europe et l’Allemagne parce que cet approvisionnement garantit le bon fonctionnement de nos économies, donc de nos sociétés.
Des propos qui ont le mérite de la clarté. Et auxquels nous n’avons rien à ajouter! Puisque c’est ce que nous avons toujours dit, depuis la création des revues “Orientations” (1980) et “Vouloir” (1983), “Nouvelles de Synergies Européennes” (1994) et “Au fil de l’épée” (1999), dont le relais est repris, entre autres, par ce blog (2007).
(résumé de Robert Steuckers).
21:08 Publié dans Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, russie, europe, spd, socialisme, allemagne, etats-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 18 août 2008
Hommage à E. Delvo

Hommage à Edgard Delvo pour son 90ième anniversaire
Edgard Delvo: une quête sans repos de la justice sociale
Peter LEMMENS
Dans le paysage intellectuel flamand, on rencontre peu de personnages de ce format, peu de personnalités qui, mues par une pulsion intérieure, partent en quête de la vérité sans jamais plus s'arrêter. Ce sont généralement des personnalités qui se mettent en travers de toutes les valeurs et de toutes les idoles conventionnelles, de tous les systèmes jugés éternels et de tous les concepts abstraits; elles suivent l'ordre de leur conscience en dépit de tout et de tous, elles s'avancent sur leur propre chemin. Au beau milieu d'une réalité qui ne cesse de changer, elles sont souvent obligées de redéterminer leurs positions, avec le risque de ne plus être comprises par leur entourage, doté de capacités intellectuelles moindres.
Parmi ces rares personnalités en Flandre: Edgard Delvo. L'idée directrice, pour laquelle il a voué sa vie entière, est l'idée de justice sociale. A partir de cette idée, Delvo a toujours cherché à donner des fondements idéologiques solides à sa pensée et à son action. Il était essentiel pour lui de faire concorder doctrine et action. Toujours, Delvo est parti du réel, hic et nunc, et su que ce réel formait toujours l'ultime pierre angulaire sur laquelle reposait l'expérience personnelle, aussi riche soit-elle.
Au beau milieu de ce XXième siècle effervescent, cette option pour un réel toujours mouvant l'a contraint à arpenter des chemins très différents les uns des autres et à mener une existence des plus hasardeuses...
Edgard Delvo est né le 20 juin 1905 à Gand dans une famille d'ouvriers pauvres et socialistes. Son milieu familial le prédisposait donc à devenir, très jeune, un ouvrier, comme son père et son grand-père. Mais la nature l'a doté d'une intelligence assez vive. Avec l'aide d'une bourse pour élève doué, il peut aller au-delà de l'école primaire et, comme on le disait à l'époque, «faire ses moyennes». Plongé dès le foyer familial dans une ambiance socialiste, son enthousiasme pour cette idéologie ouvrière fut ravivé par l'homme de poigne, le génie du verbe, du socialisme gantois, Edouard Anseele. Plus tard, Delvo témoignera et dira que c'est surtout les dimensions humaines d'Anseele qui l'ont séduit et attiré. L'étape suivante dans l'évolution du jeune Delvo se déroule rapidement: au départ de ses prédispositions naturelles pour le travail intellectuel, Delvo, à partir de l'âge de 16 ans, approfondit ses connaissances du marxisme et devient un socialiste bien écolé et formé.
Après avoir obtenu son diplôme d'instituteur, il s'en va travailler dans l'“imprimerie populaire” (Volksdrukkerij), une entreprise appartenant au parti socialiste, qui fonctionnait pourtant pratiquement comme une pure entreprise capitaliste. Delvo s'est alors rapidement aperçu que bien que le socialisme se réclame de la doctrine marxiste (détruire le capitalisme par la lutte des classes et libérer le travailleur par le biais de la dictature du prolétariat), le socialisme belge, en pratique, visait la création, par la voie du réformisme, d'un capitalisme ouvrier, où les travailleurs seraient ipso facto transformés en de “petits bourgeois” de seconde zone. Il y avait donc une profonde césure entre la théorie socialiste et la pratique. Delvo en déduit immédiatement que les théories marxistes ne correspondent pas à la réalité sociale, comme il peut s'en apercevoir de visu dans sa propre entreprise socialiste.
Mais il est encore trop tôt pour tirer toutes les conclusions de ce constat. Le jeune homme Delvo doit encore accumuler de l'expérience. Mais la direction de la Volksdrukkerij lui donne rapidement l'occasion d'élargir ses horizons: il reçoit l'autorisation de suivre les cours de l'Université d'Etat de Gand à titre d'étudiant libre. Reconnaissant, Delvo, en autodidacte, acquiert un vaste savoir dans une quantité de sciences sociales et humaines, telles la psychologie, la pédagogie, la sociologie et aussi l'économie.
En même temps, Delvo s'engage à fond dans le mouvement de jeunesse socialiste. En toute connaissance de cause, il n'opte pas pour la Jonge Wacht (la “Jeune Garde”), très inféodée au parti, mais pour la SAJ (Socialistische Arbeidersjeugd; Jeunesse Ouvrière Socialiste), qui s'inspirait davantage des Wandervögel allemands et prônait, dans ses programmes, une sphère indépendante de la jeunesse dans la société, l'épanouissement culturel de ses membres, un vécu communautaire socialiste et une sorte de retour à la nature.
Delvo accumule du savoir à l'Université, son intelligence vive est rapidement remarquée par les dirigeants du parti: dès 1928, il occupe le poste de secrétaire flamand de la Centrale d'Education Ouvrière. C'est la première fois qu'un homme aussi jeune —23 ans— est appelé à diriger l'écolage des cadres socialistes en Flandre. Une tâche dont Delvo s'acquittera parfaitement, au point d'être hissé au poste de Secrétaire général quatre ans plus tard.
Par son expérience quotidienne de la réalité sociale et en approfondissant sans cesse ses idées, Delvo finit par avoir des problèmes de conscience; la doctrine marxiste lui apparaît de moins en moins idoine à servir de fondement idéologique à ses sentiments et ses aspirations socialistes. Heureusement, il trouve un livre qui lui permet de sortir de cette impasse: Psychologie van het socialisme (traduit en français sous le titre d'Au-delà du marxisme), ouvrage publié en 1926 par Henri De Man. Ce livre lui ouvre des perspectives entièrement nouvelles; remotive son engagement socialiste et étaye ses idées.
D'après De Man, le socialisme n'était rien d'autre que l'expression d'une idée éternelle de justice sociale, ancrée en l'homme, qui lui permettait d'agir selon sa propre conscience, en tant qu'être responsable, guidé par la raison, et de rechercher justement cette justice sociale. De cette façon, le socialisme apparaissait comme lié indissolublement à une vision humaniste globale. C'est la raison pour laquelle De Man a saisi la nécessité de dégager le socialisme de la doctrine marxiste et d'opposer au marxisme un socialisme à fondement éthique. Au lieu de considérer la question ouvrière et le socialisme comme des phénomènes déterminés par l'histoire et la matière, De Man et ses adeptes en viennent à la percevoir comme une problématique essentiellement d'ordre psychologique. Il ne s'agissait plus de réaliser l'émancipation ouvrière par le biais de la lutte des classes et de la dictature du prolétariat; ni de reprendre à son compte les valeurs et la culture du monde bourgeois et capitaliste, comme le socialisme politique l'avait fait en pratique. Non: l'émancipation ouvrière devait être réalisée en donnant au travailleur une valeur propre, en créant pour lui un système de valeurs qui lui soit spécifique. Il s'agissait donc de faire advenir un nouveau type humain, qui n'aurait plus rien à voir avec les vertus bourgeoises, mais développerait ses propres valeurs et ses propres normes, une culture nouvelle, comme bases d'une société socialiste. Le socialisme ne visait donc pas la pure et simple matérialité (rôle du “socialisme-beafsteak”), mais se posait essentiellement comme un souci éthique, culturel et spirituel. Il ne s'agissait plus d'acquérir toujours davantage de biens matériels, mais de mettre au centre de l'éthique des travailleurs la joie au travail.
A la suite de leur vision humaniste intégrale et de leur désir de généraliser la justice sociale, leur souci socialiste ne pouvait plus se limiter à une seule classe sociale, mais devait nécessairement s'élargir à toute la réalité ambiante, où vivaient les hommes de chair et de sang: c'est-à-dire embrasser l'ensemble de la “communauté populaire”. Dès qu'ils eurent opéré leur “renversement copernicien”, De Man et Delvo, sur base de leur postulat d'élargissement, commencèrent à s'intéresser au nationalisme. Cela amena De Man à publier en 1931 une brochure, Nationalisme en Socialisme, où il accorde une valeur positive au “nationalisme de libération”, concept que nous considérerions comme synonyme de notre “nationalisme populaire” (volksnationalisme). Mais contrairement à son maître-à-penser, Henri De Man, qui, ultérieurement, s'égarera dans les eaux du “nationalisme d'Etat” (staatsnationalisme), Delvo va approfondir ce concept au cours des années 30, ce qui le conduira à dire que tout sentiment socialiste véritable doit être indissolublement lié à une conscience nationale-populaire (et vice-versa). Sentiment socialiste et conscience nationale convergent tous deux vers un seul et unique but: la construction de la communauté populaire (volksgemeenschap).
Delvo est également devenu un protagoniste enthousiaste et convaincu du planisme de De Man. La vision planiste impliquait que toute la vie économique devait contribuer à un équilibre entre les besoins de la consommation et les capacités de production, où il fallait tabler et utiliser toute la créativité qui résidait en l'homme. Pour les planistes, cet équilibre et ce pari pour la créativité humaine n'étaient possibles que si l'on avançait une vision beaucoup plus nuancée de la propriété que les marxistes. Au lieu de nationaliser purement et simplement les moyens de production et la propriété, il fallait, disaient-ils, partir des diverses formes de propriété et voir si elles apportaient des avantages ou des inconvénients au peuple en tant que communauté. Sur base de ce tri, les planistes finirent par juger que les monopoles et les puissances d'argent devaient être freinées dans leurs initiatives et leur expansion, tandis que les initiatives privées qui donnaient des avantages au peuple devaient être stimulées. L'idéal consistait donc à construire une économie mixte avec secteurs nationalisé et privé. Mais il était essentiel, dans la vision planiste, que l'autorité et non la propriété soit transférée à l'Etat. Le contrôle de la gestion de la propriété a donc été considéré comme prioritaire par rapport à la possession de l'entreprise.
Pour réaliser un tel “Plan”, il fallait, pensaient les planistes, réformer de fond en comble la démocratie, afin de dégager l'Etat de l'emprise des puissances d'argent et des groupes de pression. Pour accéder au stade de cette planification rationnelle, le système démocratique manquait d'une réelle direction, d'auto-discipline et surtout de responsabilité personnelle. Les planistes formulent une série de propositions, afin d'incorporer ces “vertus” dans le système démocratique et de rendre ainsi la démocratie plus forte. Le résultat aurait du être, pour De Man, Delvo et les planistes belges, le “socialisme démocratique”. Bien entendu, les adversaires de ce planisme socialiste et démocratique n'ont pas hésité à accuser De Man et Delvo de plaider pour une “démocratie autoritaire”. Ce reproche était injuste: les deux hommes sont restés des démocrates convaincus; ils se reconnaissaient pleinement dans le principe des élections libres et du contrôle parlementaire, mais ils voulaient biffer les dysfonctionnement et les débordements du système, afin de le sauver et non pas de le torpiller définitivement.
En 1934, De Man et ses collaborateurs réussissent à mettre le parti socialiste officiellement sur la ligne du planisme et du “socialisme démocratique”. Cela ne signifie pas, évidemment, que les instances du parti ont été convaincues de la justesse des thèses planistes au point de s'y convertir; plus exactement, elles ont dû avouer leurs impuissance à résoudre la crises économiques des années 30 à l'aide des recettes marxistes, devenues au fil du temps, étrangères au monde et inefficaces. Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du parti, l'opposition au projet planiste s'est rapidement organisée pour barrer la route à toute amorce de réalisation des idées de De Man et de Delvo. Les adversaires du planisme ont, en fin de compte, réussi à empêcher toute réforme graduelle et rationnelle de la démocratie belge.
Vers la fin des années 30, certains nationalistes flamands commencent à manifester un vif intérêt pour les aspirations socialistes de De Man et de Delvo. Et ceux-ci commencent, pour leur part, à s'intéresser de plus près au nationalisme flamand. Une fraction des intellectuels nationalistes et une fraction des intellectuels socialistes se rapprochaient. A la tête des socialistes rénovateurs et d'esprit ouvert, Edgard Delvo. En 1939, il entre en contact avec le nationaliste flamand Viktor Leemans et avec le “national-solidariste” Joris Van Severen. Ces rencontres permettent à ces hommes venus d'horizons fort différents de constater qu'au fond ils sont très proches les uns des autres. Ils envisagent de fonder une revue, à laquelle ils collaboreraient tous et où ils confronteraient leurs points de vue dans un but constructif, mais la guerre éclate et ce projet ne peut pas se concrétiser.
Quand les Allemands entrent en Belgique le 10 mai 1940, le régime démocratique et la machine de propagande française suscite au sein de la population belge une psychose de terreur, en décrivant l'armée allemande comme une horde de barbares massacrant tout sur son passage, poussant des centaines de milliers de réfugiés sur les routes et les exposant aux risques de la guerre. Delvo prend cette propagande au mot et décide de combattre l'Allemagne et se présente comme volontaire, d'abord dans un bureau de recrutement de l'armée belge, puis de l'armée française. Mais Delvo ne rencontre que le chaos. Après l'effondrement des armées alliées, il s'aperçoit de la fausseté des propagandes belge et française, constate que les atrocités radiodiffusées ont été inventées de toutes pièces. Cette révélation le dégoûte des régimes démocratiques et il perd toute foi en eux.
Delvo décide de réaliser ses aspirations socialistes-démocratiques dans le cadre de l'“Ordre Nouveau”, plus précisément dans le giron du parti nationaliste flamand, le VNV. Deux éléments l'ont pousser à cette option. D'abord, ce fut Viktor Leemans qui le contacta en premier lieu à son retour de France. Plus fondamentalement, c'est un projet du VNV qui le séduit: celui de se transformer en un vaste mouvement d'unité flamande. Cette tentative de dépassement des étroits contingentements politiques de l'avant-guerre et de construction d'un vaste mouvement populaire surplombant les clivages politiciens en Flandre était, pour Delvo, l'occasion rêvée de concrétiser ses visions socialistes et nationales-populaires. Delvo est immédiatement introduit dans le “Conseil de Direction” du VNV, où il devient responsable de la formation des militants et membres, de l'école des cadres et de la propagande. Le fait que de telles responsabilités aient été déléguées à un dirigeant important du parti socialiste d'avant-guerre prouve que le VNV prenait effectivement cette opération au sérieux. Mais le projet de mouvement unitaire ne débouche pas sur les résultats escomptés. D'abord, la base, contrairement à la direction, ne souhaite pas dépasser aussi rapidement les clivages idéologiques d'avant-guerre et ne propose pas de nouvelle synthèse. Ensuite, les circonstances de la guerre n'autorisaient pas la réalisation d'un tel projet; les Allemands accordaient la priorité aux opérations de guerre, avant toutes autres considérations. En cas de nécessité, ils sacrifiaient d'abord les objectifs de nature idéologique.
Cette réticence allemande a conduit Delvo à plaider en faveur d'une collaboration inconditionnelle avec l'Allemagne. Car, à ses yeux, à ce moment-là de la guerre, seule une victoire définitive du Reich national-socialiste permettrait aux Flamands de réaliser chez eux les aspirations socialistes et nationales-populaires, théorisées par Delvo. C'est en voulant joindre les actes à la parole que Delvo s'est présenté un jour comme volontaire pour combattre sur le Front russe, après l'entrée des troupes de Hitler en URSS. Mais Staf De Clercq, chef du VNV, a estimé que la présence de Delvo était plus utile en Flandre que dans les plaines de Russie; il a donc refusé l'engagement de Delvo et l'a obligé à rester au pays.
En avril 1942, Delvo devient le chef de l'UTMI/UHGA (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels), une organisation syndicale calquée sur le modèle du “Front du Travail” allemand et destinée à devenir un mouvement syndical unitaire en Belgique selon les modèles préconisés par l'“Ordre Nouveau”. Delvo reçoit donc entre les mains un instrument potentiellement puissant, lui permettant de réaliser à terme ses objectifs socialistes et nationaux-populaires. La guerre l'oblige à se limiter et à n'ébaucher qu'idéellement la société qu'il appelait de ses vœux.
Quand les dernières troupes allemandes évacuent la Belgique, Delvo se replie en Allemagne, bien décidé à s'engager jusqu'au bout pour ses idéaux. Il trouve tout de suite une place dans le gouvernement flamand en exil, le Vlaamse Landsleiding, où l'on tente, selon Delvo, de faire l'unité de toutes les tendances de la collaboration flamande encore prêtes à combattre aux côtés de l'Allemagne, dans l'espoir de réaliser leurs idées nationalistes, nationales-socialistes ou autres. Delvo devient le “plénipotentiaire” des Affaires Sociales et élabore un programme social, bien dans la ligne de ce qu'il avait suggéré dès le départ au VNV.
Après l'effondrement définitif du IIIième Reich, Delvo connaîtra des années fort sombres. En 1945, un tribunal militaire belge le condamne à mort par contumace. Sans cesse repéré et poursuivi, il n'avait plus qu'une solution: errer à travers l'Allemagne sous plusieurs fausses identités, séparé de sa femme et de ses enfants. Il exerça toutes sortes de petits boulots pour gagner maigrement sa vie. En 1965, il est frappé d'un infarctus, est dans l'incapacité de travailler et obligé de se livrer aux autorités allemandes. Mais comme il est persécuté pour des raisons politiques, les autorités allemandes le relâchent immédiatement et refusent de le livrer à la Belgique. En 1972, sa condamnation est ramenée à 20 ans de prison, si bien qu'il pourra rentrer au pays après 30 ans d'exil. En 1974, il est de retour en Flandre, mais sous le statut d'apatride.
Delvo a survécu à toutes ses années de misère, de difficultés matérielles, physiques et émotionnelles, parce qu'il a approfondi ses idées et ses réflexions, a lu, a continué à se former politiquement et philosophiquement. Le feu sacré qui brûlait dans le cœur du jeune militant socialiste de 1920 ne s'est finalement jamais éteint. Dès son retour, avec l'appui de la grande presse flamande (notamment le quotidien De Standaard), de la très sérieuse maison d'édition De Nederlandse Boekhandel, des milieux nationalistes de droite et de gauche (Voorpost, VUJO, etc.) et de l'hebdomadaire anversois 't Pallieterke, il tente une dernière fois d'éveiller l'intérêt des intellectuels flamands pour son socialisme populaire et national. Il publie coup sur coup trois ouvrages théoriques et autobiographiques. Delvo était convaincu, à son retour d'exil, que ses conceptions avaient gardé un certain degré d'actualité, tout en comprenant parfaitement que les circonstances avaient changé de fond en comble. Il est dès lors curieux de constater qu'un homme comme Delvo, qui a toujours mis l'accent sur la nécessité de bien coupler pensée et action et de se référer à la réalité actuelle, a limité ses ouvrages d'après-guerre à un regard rétrospectif sur l'histoire et ne nous a pas livré une analyse de la réalité nouvelle.
Mais Delvo, dans la seconde moitié des années 70 a été un conférencier fort demandé, surtout dans les milieux nationalistes flamands. Mais lorsque l'on relit aujourd'hui les textes de ces interviews et de ces conférences, on a le sentiment, un peu amer, que ce retour de Delvo dans le milieu nationaliste ou, du moins, chez les nationalistes qui avaient la volonté de suggérer un projet de société nouvelle, a finalement été peu fécond et que les formations nationalistes flamandes qui l'ont invité et écouté, n'ont pas mis à profit ses enseignements.
Cette année, Edgard Delvo a fêté son 90ième anniversaire. Il est devenu aveugle, mais son esprit est resté intact, toujours animé par ce formidable feu sacré. Il reste à l'écoute des grands débats par la radio, la télévision, des cassettes audio, des conversations, mais sa cécité l'empêche quand même de juger notre réalité trop changeante, trop effervescente, dans toutes ses nuances. La troisième révolution industrielle a modifié en profondeur la société dans laquelle nous vivons. Par la diminution du temps de travail, par l'attention croissante que portent nos contemporains à leurs loisirs, par le changement des mentalités, le concept de “travail” a perdu bon nombre de ses significations d'antan. La mécanisation et la robotisation croissantes ont produit une nouvelle armée de chômeurs et une nouvelle société duale. Tout cela, et beaucoup d'autres choses encore, font que toute la problématique sociale doit être totalement repensée. Indubitablement, bon nombre d'idées, de méthodes et de structures que Delvo a analysées ont succombé aujourd'hui. Mais l'essentiel de la pensée de Delvo, c'est-à-dire sa volonté de lutter pour une véritable justice sociale et pour un ancrage du sentiment socialiste dans l'humus national, doit demeurer pour nous un leitmotiv. Dans notre travail de re-penser la société, la question sociale et le statut de l'ouvrier, ce fil conducteur est indispensable pour aboutir à une NOUVELLE SYNTHESE.
Peter LEMMENS.
(adaptation française: Robert Steuckers)
Bibliographie:
- Edgard DELVO, In dienst der arbeidersopvoeding. Handboek voor medewerkers van de Opvoedingscentrale, Deurne, 1937, 244 p.
- E.D., De Belgische arbeidersbeweging. Geschiedkundige studie, Deurne, 1938, 47 p.
- E.D., Hedendaagsch humanistisch streven: democratisch socialisme en zijn beteekenis voor de BWP, Antwerpen, 1939, X-91 p.
- E.D., Arbeiders, mijn Kameraden! Ons geleidt de nieuwe tijd, Brussel, [1940], 31 p.
- E.D., Arbeid en arbeider in de volksche orde, Brugge, 1941, 42 p.
- E.D., Sociale collaboratie. Pleidooi voor een volksnationale sociale politiek, Antwerpen, 1975, 266 p.
- E.D., De mens wikt. Terugblik op een wisselvallig leven, Antwerpen, 1978, 189 p.
- E.D., Democratie in stormtij. Democratisch socialisme in de crisisjaren dertig, Antwerpen, 1983, 205 p.
00:07 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, socialisme, flandre, belgique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 17 août 2008
Entretien avec E. Delvo

Entretien avec Edgar DELVO, ancien secrétaire de la Centrale d'Education Ouvrière du POB (Parti Ouvrier Belge)
Propos recueillis par Robert Steuckers
Monsieur Delvo, vous êtes consubstantiellement socialiste; vous êtes né dans une famille socialiste, vous avez été totalement imbriqué dans la vie du mouvement socialiste jusqu'en 1945. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur votre famille et votre jeunesse?
Je suis né à Gand le 20 juin1905, dans une famille et un quartier ouvriers. Pour les gens de très modeste condition, c'était des temps difficiles: nos contemporains, et a fortiori les jeunes gens, ne s'imaginent plus combien pénibles étaient les circonstances de la vie quotidienne, même pour les bourgeois. La notion de “temps libre” n'existait pas: tout était orienté vers le labeur, vers les corvées de tous les jours. Impossible, dans un tel contexte, d'imaginer une forme ou une autre d'épanouissement ludique ou culturel. Mon père était un ouvrier métallurgiste, un ouvrier qualifié qui aimait son métier et y mettait tout son cœur. Il était certes mieux payé que les simples manœuvres, mais, comme tout le monde, il avait grand'peine à joindre les deux bouts. Mon grand-père, que j'ai bien connu, était une célébrité dans les cafés de Gand et des environs, non pas parce qu'il aimait trop la bière, mais parce qu'il ne gagnait pas assez d'argent pour nourrir décemment sa ribambelle d'enfants. Il travaillait dix heures par jour et, le soir, il vendait encore de la sciure de bois et du sable pour répandre sur le sol des auberges et des bistrots. Mon père était l'aîné d'une famille de six enfants: sa qualité d'aîné lui donnait quelques privilèges; c'est sur lui que se fondaient les espoirs de la famille. Le principal de ces privilèges était de recevoir une tartine complémentaire après le coucher. Ensuite, il a reçu l'autorisation d'apprendre à lire, alors que l'obligation scolaire n'existait pas encore dans le Royaume de Belgique, et que mon grand-père était analphabète.
Savoir lire donnait des avantages énormes: on pouvait apprendre rapidement, on pouvait lire les journaux, à cette époque où il n'y avait ni radio ni télévision. La seule distraction que s'accordait les gens était de jouer au lotto à la lumière d'une chandelle: mais de telles récréations étaient exceptionnelles, un luxe rare. Mon père a été un homme heureux, il était fier de ses talents. Il avait une conscience socialiste, tout comme mon grand-père. Ils avaient abandonné l'église. Mon grand-père avait été profondément choqué par l'anti-socialisme et l'anti-syndicalisme de son curé, qui refusait de prendre en compte la misère ouvrière. Cette arrogance avait fait naître un sentiment d'aigreur profonde dans les familles ouvrières: «nous ne valons rien aux yeux des curés». Pourtant, mon père était fier de son travail: il façonnait des moules en argile pour couler des pièces. Il m'amenait le dimanche pour voir son œuvre et il me communiquait sa fierté. Pour nous le travail bien fait était une valeur inestimable et nous ne comprenions pas pourquoi les gens d'église le méprisaient. Mon père pourtant ne cultivait pas de ressentiment et n'était certainement pas un fanatique de la lutte des classes: quand il y avait une grève, il se retirait à la maison et élaborait des plans pour de nouveaux moules.
A douze ans, j'ai pu fréquenter l'“école moyenne”, alors qu'il n'y avait toujours pas d'obligation scolaire. J'emmagasinait facilement les matières, je travaillais bien, mais je n'oubliais pas non plus que j'étais un enfant de la rue, un enfant qui avait grandi au sein d'une communauté de voisins, solidaires et chaleureux. Malgré la misère ambiante, j'ai vécu une enfance insouciante. Mes parents, qui étaient doux et bienveillants, m'avaient accordé ce qu'ils n'avaient pas eu, eux: du “temps libre”. Mais leur tolérance avait des limites fixées à l'avance: il fallait toujours que nous gardions une attitude digne. Paradoxalement, ces socialistes avaient quitté l'église mais vivaient toujours selon les canons de la charité chrétienne. Ils refusaient simplement, mais absolument, la hiérarchie catholique. Pour eux, l'église était l'ennemie du peuple; elle choisissait toujours le camps des nantis et des puissants. Mes parents n'étaient pas actifs dans le mouvement socialiste, mais lisaient le journal socialiste de Gand, Vooruit (= «En avant», équivalent flamand du journal social-démocrate allemand Vorwärts). C'est ainsi qu'ils se tenaient au courant des événements du monde. L'idéologie de Vooruit était marxiste mais modérée, déjà réformiste. Mais les querelles idéologiques importaient peu: Vooruit avait le mérite de donner toute sa place au socialisme spontané du peuple.
Quand les voisins me demandaient ce que je voulais devenir plus tard, quand j'aurai quitté l'école, je répondais que je voulais devenir instituteur, maître d'école. Je le disais parce que c'était la profession que les gens de mon quartier m'attribuaient d'office: «tu es malin, tu deviendras instituteur». Je fus un des rares fils d'ouvrier à pouvoir accéder en quatrième; le directeur, un francolâtre fanatique qui haïssait tout ce qui était populaire et flamand, m'y avait accepté à contre-cœur. Cet extrémiste inventait mille chicanes pour les élèves flamands de condition modeste. J'ai donc conservé un mauvais souvenir de cette école, que je fréquentais grâce à une bourse. Mais j'ai tenu bon et j'ai fait ma cinquième et ma sixième; c'était au début de la première guerre mondiale; les temps étaient très difficiles. Nous étions à l'arrière du front allemand, en zone militaire et nous ne pouvions pas nous rendre à Bruxelles. Mes parents ne pouvaient plus me payer des chaussures: il a bien fallu que j'aille à l'école en sabots de bois, de beaux petits sabots qu'on m'avait décorés avec amour. J'étais géné. Mon francolâtre de directeur a fait une vie: il ne voulait pas que les élèves viennent en sabots à l'école. Ce fut un prétexte pour démontrer bruyamment son arrogance de classe. Cet incident m'a appris une chose: pour l'ouvrier, ce n'est pas l'argent qu'il gagne qui est important, c'est que l'on respecte sa dignitié.
J'ai donc eu de bons parents, qui m'ont éduqué dans la douceur, avec souci de l'avenir, malgré les difficultés. Il m'ont laissé beaucoup de liberté, à condition que je ne suscite pas de plaintes, que j'aie un comportement exemplaire. Ils m'ont aussi transmis le sens de la communauté. A l'école moyenne, j'étais le condisciple d'un fils de fabricant de liqueur assez aisé, qui recevait des jouets merveilleux, notamment un coffret pour faire de la chimie amusante. Ce garçon ne pouvait pas nous fréquenter, son père le lui interdisait: il restait seul dans un coin avec ses éprouvettes, alors qu'il aurait bien donné tous ses jouets pour partir en randonnée avec nous. L'esprit de communauté est donc supérieur à l'individualisme bourgeois et à l'arrogance de classe: un grande leçon de mon enfance.
Comment s'est passé pour vous la première guerre mondiale?
A Gand, nous étions à l'arrière immédiat du front, dans ce que les Allemands appelaient l'Etappengebiet. Pour survivre, il ne nous restait plus que la débrouille, le marché noir, ramasser des escarbilles de charbons, retourner au troc. La Croix-Rouge américaine et le Plan Hoover permettaient aux enfants pauvres de recevoir le matin du cacao et un petit pain, et le midi, une soupe avec du lard, que l'on nous servait dans les bâtiments du théâtre.
Nous avons vu passé les uhlans dans notre quartier. Plus tard, des prisonniers russes étaient contraints à des travaux de terrassement pour le Canal Gand-Terneuzen. Nous échangions des denrées avec ces prisonniers et nous les réconfortions. Le plus mauvais souvenir de la guerre, a été les réquisitions. Les Allemands ne réquisitionnaient pas les hommes qui avaient du travail. Mais les gens ne le savaient pas. La police gantoise venait demander si on travaillait, les gens ne disaient rien, croyant qu'on allait imposer leurs maigres revenus. Bon nombre de réquisitions se sont effectuées sur de tels quiproquos. Nous avons été frappés par la terrible discipline qui régnait dans l'armée allemande: les officiers giflaient ou bastonnaient leurs soldats en public quand ils avaient commis des pécadilles.
Quand êtes-vous devenu un militant socialiste?
C'est venu tout seul. Quand j'étais à l'“école normale” pour devenir instituteur, un professeur de néerlandais lisait Multatuli (1), la littérature pacifiste. C'était un socialiste. Il est venu chez moi pour me proposer de devenir correcteur dans l'imprimerie socialiste qui s'était réorganisée et entendait devenir une entreprise commerciale comme les autres, en ne se limitant plus à imprimer des tracts ou des pamphlets socialistes. J'ai d'abord refusé car je voulais achever mes études. Plus tard, j'y suis allé et je suis devenu automatiquement membre du parti: cela allait de soi; on travaillait dans une entreprise socialiste, on était donc militant socialiste. La politique de commercialisation m'a d'abord séduit parce que l'atmosphère n'était pas politisée à outrance. Ce fut pour moi, à seize ans, l'occasion de lire des livres plus sérieux et de me pencher sur l'idéologie socialiste. J'ai lu Marx, non pas pour adhérer à un catéchisme, mais pour prendre le pouls du socialisme à un moment de son histoire. Je n'en suis pas resté à Marx. J'ai voulu connaître le socialisme dans toutes ses moutures, même avant qu'il ne porte le nom de “socialisme”: chez les premiers chrétiens, chez les socialistes utopiques, chez les Indiens d'Amérique. J'ai voulu tout connaître de l'esprit de charité, de justice.
Les typographes étaient des ouvriers, mais ils étaient lettrés. Ils savaient communiquer le fruit de leurs lectures. Dans l'imprimerie socialiste, j'ai appris aussi à vivre dans un mouvement politique qui prévoyait toute une série de structures d'accueil pour ses membres et sympathisants. Les jeunes avaient le choix: ou bien militer à la Jonge Wacht (JW; = Jeune Garde) ou bien adhérer à la Socialistische Arbeiderjeugd (SAJ; = Jeunesse ouvrière socialiste). Ces deux structures étaient bien différentes l'une de l'autre. Dans la JW se regroupaient les activistes, toujours présents dans les meetings et dans les bistrots, où ils fumaient et buvaient comme les adultes. Les garçons de la SAJ voulaient quitter cette ambiance et retourner à la nature, camper, organiser des randonnées à pied ou à bicyclette. Les JW fréquentaient les dancings. Les SAJ remettaient les vieilles danses populaires à l'honneur. La jeunesse socialiste était donc séparée par deux esprits bien différents. Les SAJ, dont j'étais, avaient un esprit Wandervogel, c'étaient des amis de la nature; ils voulaient réintégrer l'homme dans la nature. Nous avions l'impression d'aller plus loin, plus en profondeur. Bon nombre de garçons de la JW voulaient d'emblée faire une carrière politique. Les SAJ n'avaient pas cette préoccupation.
Petit à petit, l'imprimerie populaire (Volksdrukkerij) est devenue une entreprise purement capitaliste. La solidarité entre les membres du personnel s'est d'abord estompée puis a disparu. Les linotypistes se sentaient supérieurs aux typographes, qui estimaient valoir plus que les relieurs, qui, eux, n'adressaient pas la parole aux femmes de ménage.
Je suis ensuite devenu le chef de la SAJ de Gand. C'est à ce titre que j'ai rencontré pour la première fois Edouard Anseele (père), dit “Eedje Anseele”, un tribun socialiste fort populaire, qui avait le sens de la communauté et qui cherchait de jeunes idéalistes, notamment dans les rangs des SAJ, pour remplir de nouvelles fonctions dans le parti. Il m'a demandé si je connaissais la “coopérative”. J'avais lu beaucoup de livres et d'articles sur les coopératives, notamment un ouvrage important pour toute mon évolution future, La République coopérative du Français Ernest Poisson. Edouard Anseele voulait que je dirige une revue d'esprit “coopérativiste”. Son objectif était de relancer le mouvement coopératif afin de concurrencer le secteur capitaliste en offrant des marchandises à meilleur prix, en sautant au-dessus du maximum d'intermédiaires, notamment en affrétant une flotte marchande “rouge”. Mais comme le parti, à cette époque, était encore belge-unitaire, le projet coopératif n'a pas trop bien marché, car, rapidement, un clivage a surgi entre Wallons et Flamands. Les Wallons ont refusé l'orientation “coopérativiste”, au profit d'un syndicalisme plus anarchisant, de l'action directe, de la syndicalisation extrême et des grèves dures. Les Flamands, notamment les Gantois, rêvaient de la “République coopérative” d'Ernest Poisson.
J'ai toujours admiré Edouard Anseele (le père) car c'était un homme qui avait le sens de la décision, c'était un chef populaire, charismatique, incontesté. Ce leader populaire bénéficiait de la ferveur de son peuple. Son enterrement atteste cette dévotion des petites gens de sa ville. A la suite des conseils d'Anseele, j'ai voulu créer une culture nouvelle, solidaire et socialiste, bien organisée et bien insinuée dans le tissu social. Gand était le modèle de ce socialisme où toutes les branches du mouvement socialiste coopéraient en synergie. A Anvers, la fédération ne travaillait pas de la même façon: au contraire, on contingentait, le plus hermétiquement possible, les différentes instances du mouvement socialiste. Beaucoup de Gantois ont animé le mouvement socialiste avec succès, même en dehors de leur ville et dans les hautes sphères du parti. Anvers n'a pas donné de leader charismatique au mouvement socialiste belge et flamand. Huysmans et De Man, tous deux Anversois, n'ont pas réussi a capté la ferveur des masses socialistes. De Man était animé de très bonnes intentions, comprenait quels étaient les ratés du parti, mais il est toujours demeuré un solitaire qui communiquait difficilement avec les petites gens. J'ai assisté à la réconciliation entre De Man et Anseele, mes deux héros, l'un sur le terrain, l'autre dans le monde sublime des théories.
Comment avez-vous vécu l'immédiat après-guerre?
En dépit de mon évolution future vers le nationalisme, le croquemitaine, pour moi, c'était le malheureux Borms, incarcéré pour collaboration en 1919. Bien entendu, nous ne le connaissions pas. Nous croyions ce que disait de lui la propagande de l'Etat belge. Notre mouvement socialiste suivait à la lettre la “Trêve du Havre”, où le gouvernement belge réfugié en Normandie avait accepté pour la première fois en son sein des ministres socialistes, qui n'avaient peut-être pas reçu de portefeuille mais à qui on avait promis d'accorder le suffrage universel. Ce qui fut fait.
Quand avez-vous rencontré De Man pour la première fois?
De Man n'était pas né dans un milieu ouvrier comme moi. C'était un bourgeois d'Anvers. Dans notre mouvement, cette origine lui a causé des problèmes, pour une raison fort simple, qu'on comprend assez difficilement aujourd'hui: les ouvriers vivaient dans la nécessité, dans une nécessité extrême, et étaient prêts à suivre tous ceux qui leur promettaient ce qu'ils attendaient. Les bourgeois, eux, pouvaient se permettre d'avoir des principes, dégagés des affres de la nécessité. Les livres de De Man ont participé au renouveau du socialisme, mais, au départ, nous les lisions presque en cachette dans nos groupes de la SAJ. Sa réputation était mauvaise: il ne cessait de dire que le parti ne faisait rien d'essentiel pour le peuple, ce qui ne faisait évidemment pas plaisir aux gars qui trimaient sur le terrain. Pour De Man, la misère des ouvriers n'était pas seulement matérielle mais aussi culturelle; en affirmant cette vérité, il se distanciait automatiquement du marxisme, alors qu'il se désignait encore comme marxiste. Un jour, pourtant, la fédération gantoise avaient restauré des orgues pour offrir des soirées musicales aux ouvriers: De Man a critiqué cette initiative, au grand mécontentement des militants, qui avaient côtisé et collecté. Coupé du peuple, De Man n'évoquait qu'une culture purement intellectuelle, où les orgues ne trouvaient pas leur place. En dépit de ces travers bien humains, De Man m'a énormément appris. Ses ouvrages étaient fascinants, tant ils modernisaient notre vision socialiste de la politique et de l'économie.
Quand je l'ai vu pour la première fois, en 1930, j'étais déjà secrétaire de la Centrale d'Education Ouvrière. Je l'ai invité à Bruxelles pour prononcer une conférence, à la tribune où étaient également venus Norman Angel, Harold Laski, Pietro Nenni, le Suisse Lucien Dubreuil et les Français Gaston Bergery, Lucien Laurat et Francis Delaisi. De Man est venu nous parler du “socialisme et du nationalisme”. Son analyse était très pertinente: il distinguait le socialisme du marxisme et le nationalisme agressif du nationalisme défensif. Une idée a commencé à germer en moi: l'idéal à atteindre c'était l'unité du peuple tout entier, organisateur d'un appareil étatique.
Plus tard, De Man est venu à Gand. Je l'ai accompagné dans le train. Mais, sur place, nos militants l'ont boudé. Néanmoins, j'ai pu avoir une première longue conversation avec l'inventeur du planisme. De Man refusait la pensée en termes de systèmes. Il évoquait l'homme réel, avec ses défauts et ses qualités. Il parlait de l'“être” et du “devenir” et optait bien entendu pour le deuxième de ces termes: nous, militants socialistes, activistes politiques, étions des hommes “en chemin”, vers un but. Cette idée de devenir lui permettait de dire que Marx avait été le théoricien du “socialisme qui avait été”: la loi du devenir postulait que l'on évolue, que l'on adapte l'idée aux impératifs du temps. L'humanisme véritable ne consistait pas à répéter une doctrine figée mais à se mouler dans les méandres du devenir et des mutations sociales. A la suite de ces conversations et de mes lectures, j'ai expliqué le teneur de son Plan à nos militants. Même si cette matière est ardue, d'une haute densité philosophique, nos militants ont compris intuitivement que le Plan, théorisé par De Man, recelait des potentialités immenses pour la classe ouvrière et qu'il n'était pas de la démagogie.
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, belgique, flandre, socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 août 2008
E. Delvo: Henri De Man, mon mâitre à penser

Henri De Man, mon “maître-à-penser”
Edgard DELVO/E.d.V.
En mai 1940, l'homme politique socialiste flamand Edgard Delvo, 35 ans, se présente comme volontaire dans un bureau de recrutement de l'armée française, pour s'engager dans la lutte contre les “barbares allemands”. Mais un mois plus tard, il devient membre du Conseil de Direction (Raad van Leiding) du VNV (Vlaams Nationaal Verbond), le parti nationaliste flamand dirigé à l'époque par Staf De Clercq. Delvo est prêt en 1941 à s'engager pour le front russe, mais, en 1942, il est appelé à la tête de l'UTMI/UHGA (Union des Travailleurs Manuels et Intellectuels; Unie van Hand- en Geestesarbeiders), le syndicat unifié, pendant belge du Front du Travail allemand. En septembre 1944, il fuit la Belgique, se réfugie en Allemagne et participe au Landsleiding (le gouvernement flamand en exil). Condamné à mort par contumace par un Tribunal militaire belge, Delvo vit trente ans en exil en Allemagne, dont vingt sous une fausse identité. A l'âge de 71 ans, revenu en Flandre, il publie un livre de mémoires Sociale Collaboratie (Collaboration sociale), où il retrace les grandes lignes de son socialisme national-populaire (volksnationaal socialisme) et confie aussi ses souvenirs à E.d.V., chroniqueur historique de l'hebdomadaire satirique flamand ‘t Pallieterke (Anvers). Nous en publions un court extrait, où Delvo évoque la figure de Henri De Man, théoricien rénovateur du socialisme européen, très contesté au sein de son propre parti.
La plupart des jeunes militants socialistes de la génération de Delvo ne connaissaient même pas le nom de Henri De Man. «Dans les conférences et les cours du mouvement ouvrier belge, on ne le mentionnait pas. Ce n'est que dans un petit cénacle de notre groupe des Jeunesses Ouvrières (AJ; Arbeidersjeugd) que son nom avait bonne réputation et, pour moi personnellement, ses écrits constituaient un message de salut». Voilà ce que nous déclare Delvo qui ajoute que ses amis et lui comprenaient parfaitement qu'il valait mieux ne rien laisser transparaître de leur admiration pour De Man. Il était préférable, disaient-ils, de ne même pas prononcer son nom en dehors des cercles culturels de la jeunesse socialiste. La meilleure et la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était d'étudier ses idées de la manière la plus approfondie et d'en parler le moins possible avec les vieux camarades du parti, et certainement pas «avec les dirigeants».
Première rencontre
Henri De Man vivait encore en Allemagne quand Delvo et ses amis le lisait en cachette. Quelques années avant la prise du pouvoir par Hitler en 1933, Delvo reçoit l'ordre d'accompagner son maître vénéré à Gand et de présenter De Man aux socialistes de la ville. De Bruxelles à Gand, De Man et Delvo occupent à eux seuls un compartiment dans le train. Mais ils n'ont pas fait plus ample connaissance. Henri De Man avait vingt de plus que son admirateur; il n'a pas posé à son jeune camarade les questions conventionnelles que l'on pose pour montrer de un intérêt réel ou feint à son interlocuteur. De Man n'interroge donc pas Delvo sur sa jeunesse, son travail, sa façon de penser, ses dififcultés, ses espoirs... Nulle question de ce type. «Ce n'était apparemment pas son habitude de feindre de l'intérêt quand cet intérêt n'existait pas». Delvo était là comme un passant. «Mais n'allez pas croire que De Man était méprisant ou garder ostentativement ses distances. Au contraire. Il n'y avait rien d'affecté ou de blessant dans son attitude. Si je n'avais pas su que je me trouvais en présence de mon idole intellectuelle, je n'aurais rien remarqué de particulier à sa présence tranquille, à cet homme qui fumait confortablement sa pipe et laissait libre cours au vagabondage de ses idées».
Nationalisme et socialisme
En cours de route, les deux hommes ont échangé quelques mots sans signification, mais au moment où le train s'est approché de la gare de Gand-Saint-Pierre, De Man s'est brusquement animé: son intérêt s'éveillait pour la ville où il avait passé ses années d'étudiant et vécu ses premières expériences dans le mouvement socialiste. Il s'est appuyé sur la fenêtre du compartiment et quand nous sommes entrés dans la gare, il a dit: «Il y a bien longtemps! On va voir si on ne m'a pas déjà oublié». Delvo relate cette soirée gantoise: «Non, on ne l'avait pas oublié et, apparemment, on ne lui avait rien pardonné non plus. Pour ce qui concerne le nombre de militants présents, nous n'avions pas à nous plaindre; on s'attendait à une conférence compliquée qui n'attirait évidemment pas la masse. Un théoricien n'est pas une star du football ou un coureur cycliste victorieux. Nous pouvions aussi être satisfait du niveau intellectuel des assistants; le cercle d'étude socialiste qui avait organisé la conférence avait visé les intellectuels. Les dirigeants du parti, eux, ne s'étaient pas montrés. La vieille querelle durait-elle encore? Ou bien l'absence des dirigeants socialistes était-elle plutôt due à leur indifférence à l'égard de la thématique annoncée, “nationalisme et socialisme”, soit un problème auquel le POB n'a jamais voulu consacrer l'attention voulue?
«Je ne sais pas si Henri De Man a été déçu ou non de l'absence des dirigeants ouvriers de Gand lors de sa conférence; quoi qu'il en soit il ne l'a pas fait remarqué pendant le voyage de retour. A l'arrivée à Bruxelles-Nord, notre séparation a été brève et sans façons, comme notre tout première rencontre: une forte poignée de main».
Amis?
Selon Delvo, De Man était «tout naturel, sans contrainte dans son comportement, nullement vaniteux». Il le décrit comme «une personnalité tranquille, maîtresse d'elle-même, avec laquelle on se sentait à l'aise, bien qu'on aurait donné beaucoup pour savoir ce qui se passait derrière ce front haut et dans les sentiments de ce homme remarquable, qui ne laissait rien entrevoir de ses attirances et de ses répulsions».
Delvo, qui avait vingt-cinq ans quand il a rencontré De Man pour la première fois, n'a pas modifié fondamentalement ses premières impressions du théoricien. On a reproché à De Man «une indifférence blessante à l'endroit de ses semblables»; pour Delvo, ce n'était qu'«une inattention pour son environnement, une évasion totale ou un plongeon profond dans le monde de ses idées».
De Man, écrit Delvo, ne se donnait jamais la peine de susciter des effets dans son entourage. Il se comportait comme le dictait sa propre intériorité: «il restait toujours naturel et simple dans ses relations et dans son style de vie; il ne se pavanait pas, n'en mettait jamais plein la vue à ses proches, il ne faisait pas semblant, ne commettait jamais de fanfaronnades». De Man était un exemple pour l'attitude existentielle qu'il prônait lui-même: plus être que paraître, accorder moins d'importance à l'avoir qu'à l'être.
C'est précisément cet Henri De Man-là qui n'avait pas d'amis au sens profond de ce mot, écrit Delvo. Mais il semblait n'avoir nul besoin d'amis, «bien que beaucoup de personnes appartenant à son cercle de pensée souhaitaient que les sentiments de proximité qu'il suscitait en eux, reçoivent une réponse de sa part».
Assainir la démocratie
En 1933, De Man se fixe à Bruxelles. A partir de cette année-là, Delvo aura avec lui «des contacts extrêmement précieux et féconds». Delvo ajoute que De Man n'avait pas quitté l'Allemagne «sous pression», au moment où Hitler a accédé au pouvoir, «comme on l'a dit trop souvent par erreur». D'après Delvo, De Man aurait pu conserver sa chaire sans problème à Francfort, s'il l'avait voulu. «Combien de professeurs allemands compromis politiquement aux yeux des nouveaux détenteurs du pouvoir, pour leurs activités du temps de la République de Weimar, sont restés en Allemagne en dépit du changement de régime, en adaptant tout simplement leurs matières et leurs cours aux circonstances nouvelles, tout comme, ultérieurement, ils se sont réadaptés une seconde fois après 1944, en empruntant une direction nouvelle, dans le cadre du programme démocratique de “rééducation” du peuple allemand».
De Man, en revanche, a quitté le Troisième Reich volontairement et librement, parce qu'il «n'était pas prêt à s'adapter à un régime dont il rejetait les fondements». Il a préféré mettre son expérience au service «du mouvement socialiste et de la lutte contre la crise dans son propre pays». Mais Delvo nous rappelle n'est pas simplement rentré en Belgique pour défendre une démocratie menacée et exposée aux coups de la dégénérescence. Non: De Man envisageait une réforme en profondeur de la démocratie belge, son assainissement». De Man croyait à la possibilité de telles réformes. Il voulait protéger la Belgique de «toute expérimentation totalitaire et dictatoriale».
Hendrik De Man, dit Delvo, «n'a jamais cessé de nous dire que toute démocratie sans responsabilité et sans autorité personnelles, sans auto-discipline et sans direction consciente, ne résisterait pas aux manipulations démagogiques et à l'auto-destruction». Il a opté pour une «démocratie puissante, vitale et “autoritaire”» contre toutes les formes de dictature. Mais, en même temps, De Man concentrait toute son attention aux efforts entrepris par Hitler «pour susciter une solidarité nationale plus cohérente par plus de justice sociale». De Man considérait que «les réalisations sociales du Troisième Reich comme une contribution importante à l'unification spirituelle et psychique, condition préalable à ce sursaut soudain et étonnant du peuple allemand».
Peu après son retour en Belgique, Henri De Man devient vice-président du POB/BWP. Cette nomination avait été préparée lors de conversations avec le “patron’, Emile Vandervelde. Dans ces années de crise, tous les espoirs, dans le sérail du POB, reposaient sur Henri De Man. Les socialistes belges du POB ne désiraient plus s'adresser exclusivement et principalement aux ouvriers. En réalisant son fameux “Plan du Travail”, le POB entendait libérer toutes les catégories de la population «de l'emprise des forces économiques et financières monopolistiques».
Delvo, fidèle collaborateur à la revue de De Man, Leiding, adepte convaincu de son socialisme éthique, défenseur passionné des point de vue de son maître-à-penser, contribua à diffuser largement, par la plume et la parole, les thèses de l'auteur d'Au-delà du marxisme. Pendant des années, Delvo est resté en rapports étroits avec De Man. Malgré cela, il n'ose toujours pas dire aujourd'hui, «qu'il a bien connu De Man».
«Réformateur du monde»
Pour comprendre la nature de leur relation et pour comprendre la personnalité de De Man, citons ces mots que Delvo consigne dans ses mémoires: «Henri De Man a voulu faire beaucoup de choses pour les gens, mais il n'a pas pu le faire avec les gens». De Man «était profondément convaincu que les gens avaient besoin de lui». Il s'est toujours senti dans la peau d'un «réformateur du monde». Il voulait littéralement compénétrer les gens de ses idées, qu'il avait bien entendu formulées pour leur bien. Il voulait aller de l'avant et diriger, mais, personnellement, il ne ressentait nullement le besoin d'appartenir à l'humanité! «Il n'a jamais été un homme de communauté», au contraire de son élève Delvo, qui ajoute: «il acceptait le soutien et la collaboration de ceux qui étaient prêts à l'aider, et voyait en eux des hommes partageant les mêmes idées et les mêmes sentiments, des compagnons de combat, et non des amis».
Et Spaak?
«Pas même Paul-Henri Spaak», nous dit Delvo, «qui a tout de même, avec De Man, été considéré comme le représentant le plus influent du “socialisme national” dans notre pays, et qui a été pour lui, un soutien indispensable quand il s'est heurté, inévitablement, au vieux président du parti, Emile Vandervelde, qui possédait encore à cette époque une grande autorité; je le répète, même Paul-Henri Spaak, n'a jamais été son ami. Non, personne n'avait accès à l'intériorité de De Man, n'avait droit à une part de sa vie sentimentale. C'était un homme que l'on appréciait et que l'on respectait, pas un homme à qui on se liait d'amitié».
Spaak et De Man, selon Delvo, «étaient liés dans un combat commun, basé sur une vision commune». Mais De Man avait derrière lui un «long processus de maturation». Spaak, au contraire, était devenu un “socialiste national” en répudiant brusquement son passé à “Action Socialiste”, où violence et extrémisme s'était souvent conjugués. C'est vrai: le retournement soudain dans la pensée politique de Spaak s'est opéré quand il est devenu ministre «de manière inespérée et inattendue»; toutefois, Delvo pense qu'il s'agit bien d'une conversion soudaine, mais sincère, et non d'un “simple calcul”. Delvo croit pouvoir comprendre cette conversion; il sait qu'il n'est pas le seul jeune “demaniste” qui «à ce moment, savait que Spaak, depuis quelques temps, sous l'influence des conceptions de De Man, avait soumis son internationalisme prolétarien à une sévère critique» et était devenu un adepte du “socialisme national”.
De Man et Spaak ont-ils été “amis”? «Ils ont été liés politiquement», sans aucun doute. «Mais amis?»: «Non» répond Delvo. Mais ce n'est certainement pas Spaak qui a été le responsable de cette “incommunicabilité”. Tout simplement, De Man n'accordait aucune valeur à l'amitié. Dans ses rapports humains, il ne visait qu'une chose: faire partager à ses interlocuteurs et à ses camarades les mêmes visions de la société et de la politique. Tous les efforts intellectuels de De Man tendaient à améliorer le sort de l'humanité, mais il perdait presque toujours de vue les «hommes vivants», y compris ceux qui évoluaient dans son environnement immédiat. Delvo a très bien perçu cet aspect de la personnalité de De Man: «Celui qui espérait des avantages personnels, entendait assurer son avenir, faisait bien de se ranger derrière la bannière de Spaak, qui ne décevait jamais ses amis et répondait toujours à leurs attentes». Mais ceux qui suivaient De Man pour ses idées ne récoltait qu'un “bénéfice intellectuel”. Aujourd'hui encore, Delvo pense que c'était là le “meilleur choix”. Et si Delvo a opté pour une autre voie que celle de De Man pendant la seconde guerre mondiale, il reste reconnaissant au théoricien du planisme.
Magnanimité?
Pendant l'été 1940, après la publication de son manifeste —qui fit tant de vagues, parce qu'il réclamait la dissolution du parti socialiste et appelait à coopérer avec l'occupant allemand— De Man reçut la visite de nombreux dirigeants socialistes et surtout syndicalistes, à qui il a promis son soutien, bien qu'il était parfaitement convaincu «qu'ils le renieraient plus de trois fois avant que le coq ne chante une seule fois, si la fortune des armes venait à changer de camp».
En recevant ces socialistes et ces syndicalistes, De Man a-t-il agit par magnanimité? Ou parce qu'il se souvenait de leur lutte commune au sein du mouvement socialiste belge? Pas du tout, nous répond Delvo. Si De Man a reçu pendant l'été 1940 ses anciens camarades du parti qui venaient lui demander conseil, «sans dire un seul mot à propos de l'attitude hostile qu'ils lui avaient manifestée quelques temps auparavant, sans prononcer le moindre blâme pour le fait qu'ils avaient déserté et abandonné leurs camarades», cela n'a rien à voir avec la sentimentalité ou la vertu du pardon: De Man a reçu ses anciens camarades parce qu'ils avaient besoin de lui, de ses conseils, et qu'il était de son devoir de les aider, au-delà de tout sentiment de sympathie ou d'antipathie, de vénération ou de mépris. Parce que De Man avait décidé de remplir la mission qu'il s'était assignée à ce moment-là de notre histoire: rassembler la population belge derrière son Roi.
Leo Magits
Delvo n'aime pas qu'on lui pose trop de questions sur l'«homme» Henri De Man, pour la simple et bonne raison, dit-il, qu'il ne peut le faire, qu'il n'en a pas le droit. Mais il souhaite expressément nous dire ceci: lorsque De Man «avait pris une décision, lorsque quelque chose était bon et nécessaire selon son propre jugement, aucune considération ne pouvait plus l'empêcher d'agir selon son idée. Devant ce qu'il considérait être son devoir, tout devait fléchir et il oubliait tout, y compris ses propres enfants».
Lorsque Delvo devint en 1932 secrétaire général de la Centrale d'Education Ouvrière, en prenant la succession de Max Buset, il a fallu nommer un nouveau secrétaire flamand. Parmi les candidats: Leo Magits, émigré en 1918 aux Pays-Bas, où il fut actif dans le Syndicat International. Delvo ne connaissait pas Magits personnellement, mais avait lu sa brochure Vlaams socialisme [= Socialisme flamand]. Lorsque les deux hommes font connaissance à Bruxelles, deux choses sautent aux yeux de Delvo: «l'attachement absolu de Magits à la démocratie» et «sa vision du nationalisme qui se profilait avantageusement, par rapport à la vision de De Man sur cette question», dans le sens où Magits opérait une distinction beaucoup plus nette entre les concepts de “nation” et d'“Etat”, ne réduisait pas le nationalisme à une simple question de langue; de plus, son analyse des valeurs qu'apporte le fait national dans le mouvement ouvrier, permet des déductions bien plus positives et fécondes que l'œuvre de De Man. Magits avait le mérite de ne pas sous-estimer la valeur de la prise de conscience nationale chez les ouvriers, dans la mission culturelle que doit s'assigner tout véritable mouvement socialiste.
Sous la double impulsion de De Man et de Magits, Delvo va évoluer intellectuellement, et finir par théoriser ce qu'il a appelé le “volksnationaal socialisme”, le socialisme national-populaire.
E. de V.
(extrait de la très longue étude de l'auteur, parue dans 't Pallieterke en 1976; cet épisode a été publié le 21 octobre 1976; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théorie politique, politique, belgique, flandre, socialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 12 août 2008
De la contestation mondiale bobo-docile et du souverainisme de libération
De la contestation mondiale bobo-docile et du souverainisme de libération
http://rebellion.hautetfort.com/
"Si le mouvement national contemporain ne veut pas se contenter de rééditer les anciennes tragédies amères de notre histoire passée, il doit se montrer capable de s’élever au niveau des exigences de l’heure présente". James Connolly (1868-1916), fondateur de l’Irish Republican Socialist Party
"Donnez-moi un point d’appui et un levier et je soulèverai la Terre." Archimède
"Pensez-vous tous ce que vous êtes supposés penser ?"
"Ce que nous devons conquérir, la souveraineté du pays, nous devons l’enlever à quelqu’un qui s’appelle le monopole. Le pouvoir révolutionnaire, ou la souveraineté politique, est l’instrument de la conquête économique pour que la souveraineté nationale soit pleinement réalisée". Ernesto Guevara.
Qu’est-ce que la mondialisation ? L’intégration croissante des économies dans le monde, au moyen des courants d’échanges et des flux financiers. Elle se définit par les transferts internationaux de main-d’oeuvre et de connaissances, et les phénomènes culturels et politiques que ceux-ci engendrent. Les principales caractéristiques en sont : la concentration de la production et du capital sous forme de monopoles ; la fusion du capital bancaire et industriel ; l’exportation massive des capitaux ; la formation d’unions transnationales monopolistes se partageant le monde ; la fin du partage territorial du monde entre les puissances capitalistes.
La mondialisation actuellement en oeuvre est une forme avancée de l’impérialisme capitaliste apparu au début du XXe siècle. Étant donné ses conséquences constatables et prévisibles (mort des cultures, disparition des particularismes, avènement du positivisme néo-kantien bêtifiant, anéantissement de la pensée critique, massification, dressage cognitif, crises économiques et guerres récurrentes, désintégration des religions occidentales et moralisme morbide subséquent, etc.), la mondialisation apparaît, à sa limite, comme un "holocauste mondial", ainsi que l’a définie Jean Baudrillard.
Du côté de la résistance organisée et spectaculaire - les mouvements altermondialistes et antiglobalisation qui défilent dans les médias - règne la confusion la plus grande. L’ambiguïté de la critique qu’ils adressent à la mondialisation et la limite des solutions qu’ils proposent se révèlent patentes si on les passe au tamis d’une critique impartiale. Pétris de bonnes intentions (remarquons à leur actif un notable appel à voter non au référendum sur le Traité européen), les altermondialistes sont aussi, au fond, les meilleurs alliés de la mondialisation capitaliste.
La diversion altermondialiste
D’abord, les altermondialistes sont des gestionnaires, et non des critiques radicaux. José Bové s’en vante : "A Seattle, dit-il, personne ne brandit le drapeau rouge de la révolution chinoise, ni le portrait du Che, ni la victoire révolutionnaire dans un pays devant bouleverser les autres ; c’est bien fini et c’est porteur d’espoir".
Les altermondialistes vitupèrent en effet le capitalisme, mais n’ont en fait nulle intention de le renverser. Ils désirent seulement l’amender. La taxe Tobin, le prélèvement qu’ils veulent instaurer sur les transactions spéculatives, ne s’attaque en réalité qu’à une infime partie de la spéculation et cache le fait que la crise du capitalisme ne porte pas uniquement sur la spéculation mais sur l’ensemble du capitalisme. La crise générale du capitalisme a pour trait distinctif l’accentuation extrême de toutes les contradictions de la société capitaliste. Et ces contradictions sont aujourd’hui portées à un point d’incandescence jamais atteint.
La campagne pour la suppression des paradis fiscaux, autre thème de campagne des altermondialistes, vise quant à elle à moraliser le capitalisme. Mais, à nouveau, la spéculation et les trafics financiers ne sont nullement la cause de la crise. Ils sont seulement la conséquence directe de l’impasse où est acculé le mode de production actuel. Aucune mesure de ce type n’empêchera jamais la crise de se poursuivre ni d’étendre ses ravages.
Au lieu de proposer une alternative efficace, les altermondialistes militent pour un système de redistribution à l’intérieur du capitalisme : les pays riches doivent partager leur richesse avec les pays pauvres, les patrons avec ceux qu’ils exploitent, etc. Ils espèrent ainsi qu’un capitalisme revu et corrigé sera porteur de justice, perpétuant l’utopie d’un capitalisme viable, à orienter dans un sens favorable. Pourtant, il n’y a pas de société "juste" dans le cadre du capitalisme dont l’essence conflictuelle nourrit des antagonismes en cascade. La seule réponse historique valable est de le dépasser, d’abolir le salariat en développant les luttes contre l’exploitation de la force de travail et les rapports capitalistes de production.
Les altermondialistes croient au soft-capitalisme, au capitalisme à visage humain, comme s’ils avaient lu l’oeuvre de Karl Marx avec les lunettes de plage d’Alain Minc. À l’instar de José Bové, avatar actuel de Proudhon, la plupart d’entre eux voudraient retourner au capitalisme de papa, celui des petits producteurs. Leur rêve est de freiner la concentration monopolistique par des institutions internationales qui superviseraient l’économie mondiale. Mais ils oublient que c’est la libre concurrence, constitutive du capitalisme, qui a depuis plus d’un siècle donné naissance aux monopoles mondiaux. C’est la libre concurrence qui a produit le monopole. C’est la libre concurrence du XIXe siècle qui a accouché de la dictature de deux cents multinationales du XXe siècle. Combattre la dictature des multinationales sans combattre en même temps la libre concurrence et le libre marché capitaliste qui les engendrent est un non-sens.
Comme le monopole, la mondialisation est contenue en germe dans le capitalisme : le capitalisme la porte en lui, c’est son produit inéluctable, sa déduction. Les multinationales, les délocalisations, comme les inégalités sociales et la flexibilité, sont les effets naturels de sa logique, le déroulement d’un processus autodynamique irréversible tant que l’on ne se décide pas à le subsumer.
Poussés par le besoin incessant de trouver des débouchés toujours nouveaux, les marchands ont envahi le monde entier. L’exploitation du marché mondial a du coup donné un caractère cosmopolite à la production et à la consommation de tous les pays. Déplorer le coeur sur la main "l’horreur économique" comme Viviane Forrester, scander "no logo" comme Noami Klein , hurler "le monde n’est pas une marchandise" ou manifester sous les murailles des forteresses de Big Brother pour que le monde capitaliste reparte du bon pied, ce n’est pas prendre le problème à la racine : c’est le décentrer. Couper les mauvaises herbes sans désherber, c’est leur permettre de repousser.
Le capitalisme est, par nature, une économie poussant à la mondialisation et à la marchandisation. Or tout est marchandisation en puissance, et puisque Dieu est provisoirement mort, il n’y a plus aucune limite humaine connue à l’expansion universelle de la marchandisation si on la laisse suivre son cours. Les marchands ont tout le temps devant eux, et ce ne sont pas les comités d’éthique officiels qui les empêcheront d’agir. Comme ces institutions spectaculaires nourrissent une pensée théologique coupée du terreau social, les marchands ont raison de prendre patience, car la théologie s’écroule toujours un moment donné de l’histoire, lorsque l’infrastructure la rend caduque.
Pour s’opposer concrètement à la marchandisation du monde, il ne suffit donc pas de minauder sur quelques-unes des conséquences annexes du Système, il faut dénoncer celui-ci dans son ensemble et en son fondement. Il importe en premier lieu de commencer par lui donner un nom, car "ce qui est censé être atteint, combattu, contesté et réfuté", comme disait Carl Schmitt, doit être nommé afin de viser la cible en son coeur : ici, il s’agit du mode de production capitaliste. Et il faut également proposer une alternative radicale, car nuancer, c’est considérer que la mécanique mérite de fonctionner, qu’il suffit de l’adapter et d’y incorporer de menus arrangements régulateurs : c’est au fond rester keynésien et marcher main dans la main avec MM. Attali et Fukuyama. "La compréhension de ce monde ne peut se fonder que sur la contestation, et cette contestation n’a de vérité qu’en tant que contestation de la totalité", écrivait Guy Debord.
Au temps où on évoquait (déjà) les États-Unis d’Europe, un révolutionnaire célèbre avait (déjà) remarqué que les gauchistes - ancêtres des altermondialistes - étaient les meilleurs alliés des opportunistes. Les gauchistes partagent en effet la vision de ceux qui veulent perpétuer le Système à la solde duquel ils vivent. Si l’ex-animateur du Mouvement du 22-Mars, Daniel Cohn-Bendit est devenu le meilleur allié de l’ancien cofondateur du mouvement atlantiste Occident, Alain Madelin, formant ainsi le noyau du libéral-libertarisme, ce n’est pas à cause d’une conjonction astrale fortuite : c’est parce que leurs destins convergents étaient inscrits dès l’origine dans leurs gènes idéologiques. Nous revivons cycliquement cette situation, aujourd’hui avec les altermondialistes, qui ne sont en somme que des antimondialistes de papier.
Les altermondialistes au service de l’oppression
Face la mondialisation du capital, on assiste à une mondialisation des résistances et des luttes. Seulement il ne s’agit pas de courants authentiquement antimondialistes - telle était leur dénomination première, et le changement de terminologie, opéré à leur instigation, est lumineux -, car ils militent de facto pour une "autre mondialisation", comme l’assure et l’assume François Houtart, directeur la revue Alternatives Sud. Susan George, présidente de l’Observatoire de la mondialisation se détermine, elle, en faveur d’une "mondialisation coopérative". Les chefs de file de l’altermondialisme médiatique se veulent ainsi des mondialistes. L’un des livres de Bové s’intitule Paysan du monde. Les altermondialistes revendiquent simplement l’avènement d’un mondialisme plus humain.
Du coup, et ce n’est pas un hasard, les voici réclamant l’avènement de la mondialisation des Droits de l’homme. Lorsque José Bové se rend Cuba, la première pensée qui lui traverse l’esprit, c’est qu’il y a "beaucoup de policiers dans les rues" et "des queues devant les magasins". Ce distrait vient d’oublier les quarante années d’embargo américain. Il aurait pu dire : "La mortalité due à la maternité est dix-sept fois plus basse à Cuba que la moyenne mondiale". Mais il est passé à côté, car il raisonne en métaphysicien, articulant des catégories fixes d’usage obligatoire dans un Système que de telles notions ont pour unique mission de soutenir. Il n’a pas compris que les Droits de l’homme sont devenus l’idéologie par laquelle les pays riches s’ingèrent dans les affaires des pays pauvres (hochet kouchnerien à vocation exterministe, depuis le Vietnam jusqu’à l’Irak, en attendant mieux). Et qu’au final, les Droits de l’homme sont devenus le cheval de Troie des oppresseurs d’aujourd’hui.
Comme l’a démontré Noam Chomsky, c’est en se fondant sur ces principes universels datant de la révolution bourgeoise que les États-Unis ont déclaré toutes leurs guerres depuis cinquante ans. Preuve éclatante de leur manque de logique, MM. Bové et ses amis ne se sont pas demandé qui ferait régner ces Droits précieux sur le monde, ni quelle puissance idéalement autonome parviendrait à lutter contre les diverses influences économiques et politiques pour les appliquer avec impartialité. Ni par qui serait élue cette autorité mondiale suprême. Ni comment elle gouvernerait. Ni quel parti ou quelle tendance de parti la dirigerait. Ni avec quelles forces armées elle se ferait respecter.
La tendance despotique de ce Léviathan serait, de plus, consubstantielle à son existence, puisque l’expérience a prouvé que plus un organisme est éloigné des individus qu’il encadre, plus son déficit démocratique est levé. On peut donc s’étonner que des anarchistes et des gauchistes soutiennent l’édification d’un tel monument d’oppression.
L’utopie des altermondialistes est donc totale. Ils croient en la vertu opératoire de la parole magique : "Monde, ouvre-toi !" , et le trésor des 40 voleurs nous sera acquis. Or le monde est un rapport de forces entre puissances économiques, et il ne suffit pas de vouloir avec détermination, ni de crier à tue-tête que les États-Unis, fer de lance de l’impérialisme, réduisent leur puissance pour que celle-ci décline dans les faits. Croire le contraire relève de la naïveté. Être naïf, c’est se payer le luxe d’être inopérant. Et tout mouvement inopérant encourage nolens volens la persistance du système qu’il prétend combattre.
La nation, comme foyer de guérilla
De glissement en compromis, d’accommodement en complicité objective, les altermondialistes reprennent ainsi dans leurs discours les arguments qui soutiennent le plus puissamment les intérêts des capitalistes. C’est-à-dire qu’ils s’inoculent à haute dose - et inoculent à ceux qui les écoutent - le virus qui justifie l’oppression, en retour.
Le mépris qu’ils affichent pour le fait national, auquel ils substituent un antiracisme formel, sentimental et terroriste, est à ce titre révélateur. Si les peuples désorientés par l’évolution actuelle et le dynamitage des frontières se jettent parfois dans les bras de partis qui semblent ici et là leur proposer un barrage provisoire au mondialisme, ce n’est pas, comme le prétendent les belles âmes de l’altermondialisme, parce qu’ils sombrent dans le fascisme, notion datée et dépassée. C’est d’abord parce que ces populations vivent au quotidien des situations dramatiques et déchirantes, et que nul ne leur propose un avenir digne d’être vécu, les altermondialistes moins que les autres, avec leur programme gauchiste de tabula rasa. C’est sur cette base qu’il faut édifier une réflexion.
A contrario, il est bien sûr parfaitement ridicule de prôner le raidissement identitaire comme solution-miracle. "Le repli sur la tradition, frelaté d’humilité et de présomption, n’est capable de rien par lui-même, sinon de fuite et d’aveuglement devant l’instant historial" écrivait Martin Heidegger. Le désir de rejouer le passé est vain, car "l’histoire ne repasse pas les plats", ainsi que le disait plaisamment Céline. Tout autre est l’affirmation d’une communauté nationale populaire vivante, une communauté de culture et de destin qui entend conserver son indépendance, sa volonté de puissance, sa capacité d’agir sur son avenir en puisant dans un héritage partagé, et qui offrirait la possibilité d’un contrôle populaire réel et conscient sur le pouvoir et l’expression libre des aspirations et des besoins.
La nation, catégorie historique du capitalisme ascendant, demeure en effet, contre de nombreuses prévisions, une réalité à l’époque du capitalisme déclinant. Elle devient même, selon la conception de Fidel Castro, un "bastion", un pôle de résistance révolutionnaire. La défense d’une communauté attaquée dans sa substance s’avère d’autant plus révolutionnaire que l’agression provient d’un système coupeur de têtes et aliénant. Le world-capitalisme a en effet intérêt à trouver devant lui des peuples désagrégés, des traditions mortes, des hommes fébriles et sans attache, disposés à engloutir son évangile standardisé. Ce qui freine la consommation de ses produits mondiaux, ce qui est susceptible de ralentir l’expansion de ses chansons mondiales formatées, de ses films mondiaux compactés, de sa littérature mondiale normalisée, doit disparaître, ou finir digéré dans ses circuits, ce qui revient au même. Le capitalisme est uniformisateur et l’arasement préalable des esprits encourage son entreprise uniformisatrice. Il ravage l’original, les particularismes, sauf ceux qui vont momentanément dans le sens qui lui profite.
Or la communauté, aspiration profonde des hommes, voit dans la forme nationale son actualité la plus aboutie. Passant pour les altermondialistes comme un résidu passéiste, une province pourrissante, un paradoxe historique au temps du cosmopolitisme triomphant, la nation conserve sa justification historique, a minima par le "plébiscite de tous les jours" qu’évoque Ernest Renan. Le patriotisme est un des sentiments les plus profonds, consacré par des siècles et des millénaires. Aujourd’hui, la nation conserve donc un contenu réel, qui, même s’il est épars et dilapidé, est à retrouver et à se réapproprier : "Délivré du fétichisme et des rites formels, le sentiment national n’est-il pas l’amour d’un sol imprégné de présence humaine, l’amour d’une unité spirituelle lentement élaborée par les travaux et les loisirs, les coutumes et la vie quotidienne d’un peuple entier ? ", disait Henri Lefebvre. L’étude du contenu national doit être au cour du programme d’un projet de renaissance.
Évidemment, la démocratie formelle n’a réalisé jusqu’ici qu’une pseudo-communauté abstraite qui frustre la plus grande partie du peuple, à commencer par les couches populaires (classe ouvrière et classes moyennes) sur qui pèse le fardeau le plus lourd. Car le Parlement, fût-il le plus démocratique, là où la propriété des capitalistes et leur pouvoir sont maintenus, reste une machine à réprimer la majorité par une minorité ; la liberté y est d’abord celle de soudoyer l’opinion publique, de faire pression sur elle avec toute la force de la money. La nation telle qu’elle doit être envisagée dans le cadre d’une pensée radicale ne peut qu’aller de pair avec le progrès social et l’alliance internationale avec les forces qui partagent cette ambition subversive totale. L’identité nationale doit être conçue comme une réorganisation sociale sur la base d’une forme élaborée de propriété commune, sous peine de nous ramener à un passé désuet, qui nous conduirait immanquablement au point où nous en sommes.
La nation doit être le cadre de l’émancipation, de l’épanouissement, et non une entité oppressive. C’est seulement comme instrument du progrès qu’elle conserve sa mission historique. Conception qui faisait dire à Lénine : "Nous sommes partisans de la défense de la patrie depuis le 25 octobre 1917 (prise du pouvoir par les bolcheviks en Russie). C’est précisément pour renforcer la liaison avec le socialisme international, qu’il est de notre devoir de défendre la patrie socialiste."
La souveraineté nationale - non pas le souverainisme libéral ou le national-libéralisme, des oxymores dont il faut apprendre à se dépolluer - constitue ainsi, dans le meilleur des cas (exemple frappant du Venezuela bolivarien de Hugo Chávez), un pôle vivant de résistance à l’homogénéisation, une structure servant d’appui à la contestation globale, un foyer possible de guérilla au sens guévarien du terme. Si elle s’intègre dans une lutte émancipatrice au plan national (engagement dans un processus anticapitaliste) et international (retournement des alliances, nouvelle forme d’internationalisme rationnel, et non abstrait ou mystique, c’est-à-dire avec des allés objectifs et partisans), elle ne peut plus être considérée comme un vulgaire sédatif aux luttes sociales, comme elle le fut un temps (le nationalisme bourgeois désunissant les ouvriers pour les placer sous la houlette de la bourgeoisie). Elle devient au contraire l’avant-garde de la radicalité. Sans l’autonomie et l’unité rendues à chaque nation, l’union internationale des résistants au Système (une fraternité, une collaboration et des alliances nouvelles qui ne sont pas à confondre avec la mélasse mondialiste) ne saurait d’ailleurs s’accomplir. C’est lorsqu’un peuple est bien national qu’il peut être le mieux international.
La nation ainsi comprise est tout l’inverse des duperies formalistes à fuir à tout prix : niaiserie sentimentale, chauvinisme étriqué version Coupe du monde, cocardisme sarkozyste à choix multiple, roublardise mystificatrice d’un Déroulède germanopratin digéreant mal l’oeuvre de Charles Péguy, crispation irraisonnée sur les mythes fondateurs, etc. Elle devient l’une des pièces agissantes du renversement du Système. Dans des conditions historiques différentes, Sultan Galiev pour les musulmans, Li Da-zhao pour les Chinois ont en leur temps théorisé une notion approchante, considérant que le peuple musulman, d’un côté, chinois de l’autre, pouvaient, par déplacement dialectique provisoire, être dans leur ensemble considérés comme une classe opprimée en prise avec le Système à renverser. Chaque nation entrant en résistance frontale, pour autant qu’elle s’identifie avec l’émancipation générale, devient ainsi de nouveau historiquement justifiée. On a peut-être une chance de voir alors se produire l’encerclement des villes de l’Empire par les campagnes, les bases arrières et les focos.
Pour un nouveau différentialisme et un souverainisme de libération
Les particularités culturelles, les richesses nationales, individuelles et naturelles sont des armes que le mot d’ordre de world-culture, claironné par les altermondialistes-mondialistes, lors de leurs rassemblements champêtres, désamorce. Plus que quiconque, les artistes - parlons-en - devraient se préoccuper de marquer leurs différences, d’imposer des styles nouveaux et des concepts baroques, d’instiller des idées réactives, de dynamiter les formes étroites dans lesquelles on veut les faire entrer. Eux les premiers devraient se méfier d’instinct de la gadoue musicale qu’on leur propose comme horizon indépassable. Eux les premiers devraient imposer de nouvelles formes poétiques et un style adapté à la lutte contre l’homogénéisation totalitaire qui tend à les émasculer. Leur ouvre est écrasée sous les impératifs de production. La créativité a disparu devant la productivité. Qu’ils se donnent enfin les moyens d’être eux-mêmes : "Que chacun découvre pour la prendre en charge, en usant de ses moyens (la langue, les ouvres, le style) sa différence, écrivait encore Henri Lefebvre, au temps de son Manifeste différentialiste, ajoutant : "Qu’il la situe et l’accentue". Car exister, c’est agir. Et créer.
Dans d’autres domaines, il s’agirait également de repenser la modélisation de la dialectique, le renversement des tabous historiques et idéologiques, la défétichisation des concepts usés jusqu’à la corne par des philosophes ordonnés au Système (ou, pour certains l’ordonnant), de remettre en chantier une théorie de la subjectivité qui ne soit pas subjectiviste, etc. Un laboratoire d’élaboration conceptuelle serait le bienvenu (appelons-le Projet Archimède, du nom du grand scientifique grec de Sicile qui cherchait un point d’appui et un levier pour soulever le monde), sorte de fight-club de la théorie qui se donnerait comme objectif la critique impitoyable de l’existant dans sa totalité. Il faut retrouver l’idée de mouvement, en lui incluant bien sûr une logique de la stabilité qui sied à toute défense identitaire.
Face aux hyperpuissances d’homogénéisation, il est grand temps que l’antimondialisation réelle et efficace présente un front uni et international des différences, un bloc historique constitué par une armada pirate se lançant à l’abordage des vaisseaux de l’Empire.
Avant de réclamer une autre forme de mondialisation, une mondialisation toujours plus ouverte, c’est-à-dire de poursuivre, sur un mode de contestation bobo-docile, la mondialisation capitaliste par d’autres moyens en bradant dès aujourd’hui le monde aux multinationales comme si elles étaient au service de l’Internationale prolétarienne, les mouvements d’altermondialisation-mondialistes-contre-le-capitalisme-sauf-s’il-est-humain doivent prendre conscience que chaque peuple, chaque langue, chaque ethnie, chaque individu, chaque particularité est un reflet de l’universel, un éclat d’humanité. Pour l’avoir oublié, nous sommes entrés dans la norme de la société du "on", où se déploie le Règne de la Quantité annoncé par René Guénon, un monde de grisaille suant la "nullité politique" décrite par Hegel, qui n’est plus régulé que par la seule loi de la valeur capitaliste, l’habitude, l’hébétude et la résignation. Il est temps d’y remettre de la couleur et du mouvement, et, ce faisant, trouver les formes possibles du dépassement de la contradiction actuelle et aider à la prise de conscience de la dialectique de l’histoire présente.
Cette invitation aux particularités ne doit pas se faire de manière parodique ni mimétique, comme nous y invite le Système, mais en Vérité, comme parle l’Évangile, la vérité "révolutionnaire" de Gramsci et celle qui "rend libre" de saint Jean. C’est-à-dire comme un moment essentiel d’un projet de révolution maximale, ayant pour objectif d’inventer un nouveau style de vie. "Tout simplement, je veux une nouvelle civilisation", disait Ezra Pound. C’est bien le moins auquel nous puissions prétendre.
Ce n’est qu’en procédant par étapes que l’on pourra intensifier infiniment la différenciation de l’humanité dans le sens de l’enrichissement et de la diversification de la vie spirituelle, des courants, des aspirations et des nuances idéologiques. Dès à présent, l’internationalisme véritable, au lieu d’être l’idiot utile du capitalisme, doit s’opposer à toutes les tentatives d’homogénéisation mondiale et tendre à défendre sur le mode symphonique les particularismes nationaux, en tant qu’ils peuvent se constituer en fractions d’un souverainisme de libération, mais aussi les particularismes régionaux et individuels. Tel doit être le véritable projet des adversaires du mondialisme. Le reste n’est que bavardage, compromission et désertion en rase campagne.
Que cent fleurs s’épanouissent !
Paul-Eric Blanrue
00:05 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, socialisme, liberté populaire, libération nationale, révolte, rébellion, nationalisme révolutionnaire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 août 2008
M. Déat: Ein Plansozialist in der Kollaboration

Marcel Déat: ein Plansozialist in der Kollaboration
Analyse: Reinhold BRENDER, Kollaboration in Frankreich im Zweiten Weltkrieg. Marcel Déat und das Rassemblement National Populaire, Oldenbourg, München, 1992, 228 S., DM 78, ISBN 3-486-55895-1.
Marcel Déat endete seine politische Karriere als “Faschist”. Aber als “Faschist” war er nicht typisch. Philosoph und Soziolog, Lehrer in einem Pariser Eliten-Gymnasium, Theoretiker der neuen Strömungen in der Soziologie, war auch Déat ein sozialistischer Aktivist. Sehr früh stellte er fest, daß der konventionnelle Sozialismus Frankreichs in einer Sackgasse geirrt war. Parteien, Verbände und Gewerkschaften hatten sich, wie schon Michels feststellte, verbonzt, verbürgerlicht und verkalkt. Mit seinem philosophischen Klarblick versuchte Déat in den Jahren 30, den Sozialismus zu erneuern. Der “néo-socialisme” wurde eine neue Partei (1933-1936), die leider politisch scheiterte.
Quelle der Inspiration war für Déat der “Planismus” des belgischen Sozialistenleiter Hendrik De Man. Nach einer ganzen Reihe hochintellektueller Seminare in Kloster von Pontigny, lehnte doch die Gewerkschaft SFIO den neosozialistischen Planismus ab. Déat wurde tief enttäuscht, sowie seiner Genosse De Man in Brüssel. Da liegt der Hauptgrund ihres späteren kollaborationistischen Engagements. Beide Altkämpfer der europäischen Sozialdemokratie versuchten dann ihre erneuerenden Ideen mit den deutschen Nationalsozialisten zu verwirklichen. Auch das scheiterte. Déat engagierte sich auch für den Frieden. Genauso wie Hendrik De Man, wollte Déat keinen neuen Krieg in Europa. Deshalb entwickelte er eine “außenpolitische Konzessionsbereitschaft”, die mit einer “Innenpolitischen Neuorientierung” gepaart wurde.
Diese “innenpolitische Neuorientierung” mußte in den Augen des sozialistischen Patrioten Déat die französische Nation stärken. Die déatistische Zeitschrift Redressement schlug folgende Politik vor: sich von antikapitalistischen Tendenzen in Italien und Deutschland inspirieren, damit die französische Wirtschaft ohne zerstörende und unnötige Klassenstreitereien genesen und sich weiter entwickeln konnte. Mit einer starken Wirtschaft, einer sozialen Sicherheit und dem innenpolitischen Frieden konnte auch einen europäischen Krieg vermeiden werden. Nach 1940, schlug Déat die Gründung einer Einheitspartei vor, um das Programm des Vorkriegsneosozialismus zu realisieren. Er stoß bei anderen kollaborationnistichen Verbänden auf Widerstand. Nichtdestoweniger gründete er seinen “Rassemblement National-Populaire”, wo die meisten Kaderleute aus den Gewerkschaften kamen. Der Engagement für die deutschfreundliche Kollaboration bedeutete keinesfalls ein Schwung nach rechts.
Im Gegenteil schlugen Déats Kameraden Albertini und Zoretti eine “Orientierung nach links” und den Aufbau eines “sozialistischen Frankreichs” vor. Brenders Studie enthält auch eine Übersicht der Ideologie des RNPs: Integration in das “neue Europa”, neue innereuropäischen solidären Perspektiven in der Außenpolitik, eine Re-Organisation der Wirtschaft, die Kreation eines “neuen Menschen” (ausgesprochen ein Ideal von links!), die Einführung in Frankreich der Idee einer Volksgemeinschaft (“communauté populaire”). Brender analysiert auch die Schwächen des französischen “Faschismus”, vergleicht die Kollaboration in Frankreich und im übrigen Europa, erklärt wie das NS-Deutschland die Kollaboration konzipierte. Im Anhang findet der Leser eine Tabelle der Kollaborationsparteien und eine Karte zur geographischen Verbreitung der Kollaborationsparteien in Frankreich 1940-1944.
Fazit: die Lektüre dieses streng wissenschaftlichen Buches erlaubt uns, die Kollaboration von links zu verstehen. Die Zusammenarbeit mit den NS-deutschen Besatzer ist nicht nur Sache der konservativen, katholischen oder rechten Kräfte (Pétain und sein Vichy-Regime oder die altkatholischen Elemente im wallonischen Rexismus, usw.), wie es die konformistische antifa-Geschichtsschreibung ständig wiederholt, sondern auch der progressistischen Linken. Die Enttäuschungen der Vorkriegszeit, wo die jungen Kräfte des französischen Sozialismus von den korrupten Bonzen nicht au sérieux genommen wurden, haben in diesem bitteren Engagement zur deutschen Seite eine erhebliche Rolle gespielt. Brender erklärt uns meisterlich dieses Prozeß. Nebenbei sei auch erwähnt, daß De Gaulle teilweise von der Soziologie Déats beeinflußt wurde und daß Déats Genosse Albertini eine schöne Karriere im Nachkriegsfrankreich gemacht hat. Er leitete den “Institut Occidental” und ist heutzutage noch die Hauptreferenz für die französischen Universitäts-Studenten, die die Geschichte des Wirtschaftsdenken studieren. Albertini klassifizierte nämlich die Strömungen des Wirtschaftsdenkens in orthodoxen Strömungen (Liberalen, Manchester-Liberalen, Marxisten, sozial-demokratische Keynes-Anhänger) und heterodoxen Strömungen (Vitalisten, Ökonomen, die von der Lebensphilosophie beeinflußt wurden, die deutsche “historische Schulen”, Institutionalisten, Schumpeter-Schüler). Nonkonformisten und Vorfechter jeder Form eines Dritten Weges sind in diesem Sinn “Heterodoxen”. “Heterodoxen” lehnen den abstrakten Ökonomismus ab und behaupten, die Wirtschaft sei nicht nur von wirtschaftlichen Kategorien geprägt sondern hängt auch von historischen Kontexten und Traditionen ab. Albertini ist Déats Erbe auf höchstem Niveau in der französichen Politologie (Robert STEUCKERS).
00:08 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, histoire, socialisme, plan, collaboration, guerre, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 05 août 2008
Silvio Gesell: Der "Marx" der Anarchisten
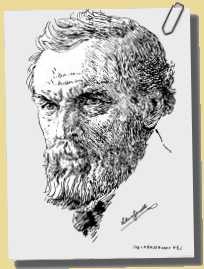
Silvio Gesell: der “Marx” der Anarchisten
Analyse: Klaus SCHMITT/Günter BARTSCH (Hrsg.), Silvio Gesell, “Marx” der Anarchisten. Texte zur Befreiung der Marktwirtschaft vom Kapitalismus und der Kinder und Mütter vom patriarchalischen Bodenunrecht, Karin Kramer Verlag, Berlin, 1989, 303 S., ISBN 3-87956-165-6.
Silvio Gesell war ein nonkonformistischer Ökonom. Er nahm zusammen mit Figuren sowie Niekisch, Mühsam und Landauer an der Räteregierung Bayerns teil. Der gebürtige Sankt-Vikter entwickelte in seinem wichtigsten Buch “Die natürliche Ordnung” ein Projekt der Umverteilung des Bodens, damit ein Jeder selbständig-autonom in totaler Unabhängigkeit von abstrakten Strukturen leben konnte. Günter Bartsch nennt ihn ein “Akrat”, d.h. ein Mensch, der frei von jeder Bevormündung ist, sei diese politischer, religiöser oder verwaltungsartiger Natur. Für Klaus Schmitt, der Gesell für die deutsche nonkonforme Linke wiederentdeckt (aber nicht kritiklos), ist der räterepublikanische Akrat ein der schärfsten Kritiker der “Macht Mammons”. Diese Allmacht wollte Gesell mit der Einführung eines “Schwundgeldes” bzw. einer “Freigeld-Lehre” zerschmettern. Unter “Schwundgeld” verstand er ein Geld, das man nicht thesaurisieren konnte und für das keine Zinsen gezahlt wurden. Im Gegenteil war für Gesell die Hortung von Geldwerten die Hauptsünde. Geld, das nicht in Sachen (Maschinen, Geräte, Technik, Erziehung, Boden, Vieh, usw.) investiert wird, mußte durch moralischen und ökonomischen Zwang an Wert verlieren. Solche Ideen entwickelten auch der Vater des kanadischen und angelsächsichen Distributismus, C. H. Douglas, und der Dichter Ezra Pound, der in den amerikanischen Regierung ein Instrument des Teufels Mammon sah. Douglas entwickelte distributistische Bauern-Projekte in Kanada, die teilweise noch heute existieren. Pound drückte seinen Dichterhaß gegen Geld- und Bankwesen, indem er die italienischen “Saló-Republik” am Ende des Krieges unterstütze. Pound versuchte, seine amerikanische Landgenossen zu überzeugen, keinen Krieg gegen Mussolini und das spätfaschistischen Italien zu führen. Nach 1945, wurde er in den VSA zwölf Jahre lang in einer Irrenanstalt eingesperrt. Er kam trotzdem aus dieser Hölle ungebrochen zurück und ging bei seiner Dochter Mary de Rachewiltz in Südtirol wohnen, wo er 1972 starb.
Neben seiner ökonomischen Lehre über das Schwund- und Freigeld, theorisierte Gesell einen Anarchofeminismus, wobei er besonders die Kinder und die Frauen gegen männliche Ausbeutung schützen wollte. Diese Interpretation des matriarchalischen Archetyp implizierte eine ziemlich scharfe Kritik des Vaterrechts, der in seinen Augen die Position der Kinder in der Gesellschaft besonders labil machte. Insofern war Gesell ein Vorfechter der Kinderrechte. Praktish bedeutete dieser Anarchofeminismus die Einführung einer “Mutterrente”. «Gesell und sein Anhänger wollten den gesamten Boden den Müttern zueignen und ihnen bzw. ihren Kinder die Bodenrente bis zum 18. Lebensjahr der Kinder als “Mutter-” bzw. “Kinderrente” zukommen lassen. Ein “Bund der Mütter” soll den gesamten nationalen und in ferner Zukunft den gesamten Boden unseres Planeten verwalten und (...) an den oder die Meistbietenden verpachten. Nach diesem Verfahren hätte jeder einzelne Mensch und jede einzelne Gruppe (z. B. eine Genossenschaft) die gleichen Chancen wie alle anderen, Boden nutzen zu können, ohne von privaten oder staatlichen Parasiten ausgebeutet zu werden» (S. 124). Wissenschaftliche Benennung dieses Systems nach Gesell hieß “physiokratische Mutterschaft”.
Neben den langen Aufsätzen von Bartsch und Schmitt enthält das Buch auch Texte von Gustav Landauer (“Sehr wertvolle Vorschläge”) und Erich Mühsam (“Ein Wegbahner. Nachruf zum Tode Gesells 1930”).
Fazit: Das Buch hilft uns, die Komplexität und Verwicklung von Ideen zu verstehen, die in der Räterepublik anwesend waren. Ist Niekisch wiederentdeckt und breit kommentiert, so ist seine Nähe zu Personen wie Landauer, Mühsam und Gesell kaum erforscht. Auch interressant wäre es, die Beziehungspunkte zwischen Gesell, Douglas und Pound zu analysieren und zu vergleichen. Letztlich wäre es auch, die Lehren Gesells mit den national-revolutionären Theorien eines Henning Eichbergs in den Jahren 60 und 70 und mit dem Gedankengut, das eine Zeitschrift wie Wir Selbst verbreitet hat. Eichberg hat ja auch immer den Akzent auf das Mütterliche gelegt. Er sprach eher von einem mütterlich-schützende Mutterland statt von einem patriarchalisch-repressive Vaterland. Ähnlichkeiten, die der Ideen-Historiker nicht vernachlässigen kann (Robert STEUCKERS).
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : politique, anarchisme, marxisme, socialisme, révolution |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 04 août 2008
Jacques Pirenne: oligarchies de politiciens professionnels
Sur ce texte ancien de Jacques PIRENNE :
Voici une petite analyse intéressante de l'historien Jacques PIRENNE (fils de Henri) dans le tome 6 de son livre "LES GRANDS COURANTS DE L'HISTOIRE UNIVERSELLE" pp. 708-709, imprimé par les "ÉDITIONS DE LA BACONNIÈRE , NEUCHATEL" et publié par ALBIN MICHEL en 1955.
Cette analyse concerne la période de l'avant seconde guerre mondiale. Vous observerez que sa conclusion "sent le belge" (la stabilité par le compromis) et, à la lueur du temps, montre bien le chemin parcouru par les partis dits "démocatiques".
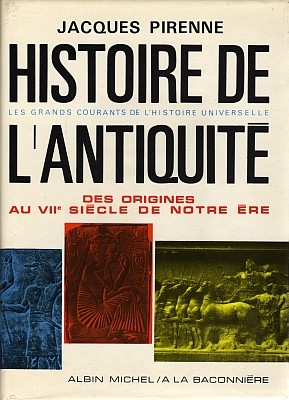
Jacques PIRENNE :
La vie politique est prise en mains par une oligarchie de politiciens professionnels
Le parlementarisme fondé sur l'opinion, avait été le fait, à l'origine, de petites minorités: Le corps électoral s'est progressivement accru, au fur et à mesure que s'est étendue l'instruction et qu'a augmenté le niveau de vie, c'est-à-dire l'indépendance matérielle de la masse. Après 1918, le suffrage universel est devenu partout une réalité. Le parlementarisme s'est adapté à ce régime nouveau dans lequel l'immense majorité des électeurs ignore tout des problèmes qui se posent au pays. Tout naturellement les partis ont visé à les embrigader en les groupant selon leurs intérêts matériels. Le socialisme, parti de classe, a encadré la masse; en défendant ses intérêts, il lui a imposé en même temps une discipline et un dogme.
En face du socialisme, le parti catholique a, lui aussi, créé des organisations professionnelles diverses, en superposant aux intérêts de classe l'idéal religieux. Seul le parti libéral, respectueux, de par son essence, de la liberté individuelle, ne s'est pas organisé. Partout, de ce fait, il s'est trouvé réduit à n'être qu'un parti minoritaire.
Dans les régimes totalitaires, un parti unique impose ses chefs et son dogme à la population tout entière. Dans les pays parlementaires, chaque parti impose sa direction à la fraction de l'opinion politique qu'il représente et encadre. Le droit de vote du citoyen se trouve ainsi réduit à accepter en bloc le programme et les hommes que lui propose tel ou tel parti. Ainsi le suffrage universel a-t-il eu pour conséquence de créer une oligarchie politique formée par les dirigeants des divers partis, lesquels ne constituent qu'une très petite minorité du corps électoral.
Seule la Suisse , par l'usage du référendum, a conservé au citoyen une liberté qui lui permet d'exercer une action directe sur la législation. Dans tous les autres pays parlementaires, cette oligarchie politique tend de plus en plus à se transformer en une classe spéciale. La politique devient une profession. Le mandataire est rétribué. L'extension constante des attributions de l'Etat ne cesse d'augmenter l'influence des hommes politiques. Le dirigisme économique leur livre de larges secteurs de la vie économique, leur ouvrant ainsi quantité de possibilités de profits. Pour faire partie de cette minorité dirigeante de la politique, il faut se plier à une stricte discipline, franchir des échelons qui, des organisations de parti, mènent aux mandats municipaux, provinciaux ou législatifs. Le parti fait un bloc; il donne ses Consignes ; il a ses intérêts, qu'il place avant ceux de l'État. En marge du parlement, les partis constituent un rouage irresponsable, mais tout-puissant, de la vie politique. Ils dominent le parlement, voire même le gouvernement, dont tous les ministres appartiennent à leurs organisations.
Ainsi le personnel politique se transforme en une oligarchie, comme le personnel des grands groupements capitalistes. Entre ces deux oligarchies des rapports se nouent; des services s'échangent.
Il en résulte une profonde transformation du régime parlementaire, de plus en plus dominé par les intérêts de classes ou de groupes que représentent les partis. Le rôle de l'élite intellectuelle y devient de plus en plus réduit, et la valeur des mandataires politiques, dont la plus grande partie ne joue plus au parlement que le rôle de figurants, tend à baisser.
Les partis constituent dorénavant les cadres des régimes parlementaires. Et tout naturellement, comme toujours lorsqu'une société possède des cadres politiques ou sociaux, ces cadres ont tendance à constituer des oligarchies privilégiées.
Comme la source de la puissance de ces oligarchies réside dans la possession du pouvoir, les partis luttent tout naturellement pour disposer du pouvoir en faisant et en défaisant des coalitions, de sorte que l'État se trouve ballotté d'un parti à l'autre.
L'autorité du gouvernement diminue tandis que celle des partis augmente; or, l'interventionnisme de l'État ne cesse d'étendre les attributions du gouvernement. Les partis, ou plutôt les petites oligarchies qui les dirigent et qui, à tour de rôle, se partagent les portefeuilles, étendent ainsi de plus en plus leur mainmise sur l'État et sur le pays.
Tel quel, cependant, le régime parlementaire demeure un régime d'opinion. En dehors des partis, en effet, se maintient une masse flottante d'électeurs qui se portent, lors des élections, vers l'un ou l'autre parti selon les tendances du moment. Si bien que malgré leur rigidité, les partis restent influencés par l'opinion. En outre, la succession des partis au gouvernement maintient l'équilibre entre les intérêts divers qu'ils représentent. Les crises ministérielles empêchent ainsi des crises sociales. Elles jouent le rôle de soupapes de sûreté. L'instabilité apparente du pouvoir, dans les régimes parlementaires, est la raison de la stabilité du régime lui-même. L'évolution démocratique des pays parlementaires a rallié tous les partis à une politique de réformisme social qui, à travers les crises ministérielles, s'est adaptée aux intérêts de tous les groupes sociaux.
00:09 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, belgique, europe, partitocratie, socialisme, partis, parti unique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 23 mai 2008
R. Michels: un socialisme au-delà des oligarchies

Roberto Michels : un socialisme au-delà des oligarchies
Source : Alessandro CAMPI, revue Vouloir n°50/51 (nov. 1988). (texte issu de Diorama Letterario, Florence ; tr. fr. R. Steuckers).
1. Roberto Michels,un homme, une carrière
Roberto Michels, le grand sociologue italo-allemand, principal représentant, avec Vilfredo Pareto et Gaetano Mosca, de l'école "élitiste" italienne. Michels est né à Cologne en 1876, dans une famille de riches commerçants d'ascendance allemande, flamande et française. Après des études commencées au Lycée français de Berlin et poursuivies en Angleterre, en France et à Munich en Bavière, il obtient son doctorat à Halle en 1900, sous l'égide de Droysen, en présentant une thèse sur l'argumentation historique. Dès sa prime jeunesse, il milite activement au sein du parti socialiste, ce qui lui attire l'hostilité des autorités académiques et rend difficile son insertion dans les milieux universitaires. En 1901, grâce à l'appui de Max Weber, il obtient son 1er poste de professeur à l'Université de Marbourg.
Ses contacts avec les milieux socialistes belges, italiens et français sont nombreux et étroits. Entre 1904 et 1908, il collabore au mensuel français Le Mouvement socialiste et participe, en qualité de délégué, à divers congrès sociaux-démocrates. Cette période est décisive pour lui, car il rencontre Georges Sorel, Edouard Berth et les syndicalistes révolutionnaires italiens Arturo Labriola et Enrico Leone. Sous son influence, s'amorce le processus de révision du marxisme théorique ainsi que la critique du réformisme des dirigeants socialistes. La conception activiste, volontariste et antiparlementaire que Michels a du socialisme ne se concilie pas avec l'involution parlementariste et bureaucratique du mouvement social-démocrate. Ce hiatus le porte à abandonner graduellement la politique active et à intensifier ses recherches scientifiques. A partir de 1905, Max Weber l'invite à collaborer à la prestigieuse revue Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik. En 1907, il obtient une chaire à l'Université de Turin où il entre en contact avec Mosca, avec l'économiste Einaudi et avec l’anthropologue Lombroso. Dans ce climat universitaire fécond prend corps le projet de son œuvre fondamentale, Zur Soziologie des Parteiwesens. Pendant la guerre de Tripoli, Michels prend position en faveur des projets impériaux de l'Italie et contre l'expansionnisme allemand. De cette façon, commence son rapprochement avec le mouvement nationaliste italien ; ses rapports avec Max Weber se détériorent irrémédiablement.
Pendant la période italienne, un travail fécond
Au début de la Ière Guerre Mondiale, en 1914, il s'installe à l'Université de Bâle en Suisse. C'est la période où Michels resserre ses liens avec Pareto et avec l'économiste Maffeo Pantaleoni. En 1922, il salue avec sympathie la victoire de Mussolini et du fascisme. Il retourne définitivement en Italie en 1928 pour assumer la chaire d'Économie Générale auprès de la Faculté des Sciences Politiques de l'Université de Pérouse (Perugia). En même temps, il enseigne à l'Institut Cesare Alfieri de Florence. À cette époque, il donne de nombreuses conférences et cours en Italie et ailleurs en Europe. Ses articles paraissent dans la fameuse Encyclopaedia of the Social Sciences (1931). Il meurt à Rome à l'âge de 60 ans, le 2 mai 1936.
Homme d'une très vaste culture, éduqué dans un milieu cosmopolite, observateur attentif des mouvements politiques et sociaux européens à la charnière des XIXe et XXe siècles, Michels fut, outre un historien du socialisme européen, un critique de la démocratie parlementaire et un analyste des types d'organisation sociale, un théoricien du syndicalisme révolutionnaire et du nationalisme, ainsi qu'un historien de l'économie et de l'impérialisme italien. Ses intérêts le portèrent également à étudier le fascisme, les phénomènes de l'émigration, la pensée corporatiste et les origines du capitalisme. À sa manière, il a continué à approfondir la psychologie politique créée par Gustave Le Bon et s'est intéressé, à ce titre, au comportement des masses ouvrières politisées. Il a également abordé des thèmes qui, à son époque, étaient plutôt excentriques et hétérodoxes, comme l'étude des relations entre morale sexuelle et classes sociales, des liens entre l'activité laborieuse et l'esprit de la race, de la noblesse européenne, du comportement des intellectuels et a brossé un 1er tableau du mouvement féministe. N'oublions pas, dans cette énumération, de mentionner ses études statistiques, tant en économie qu'en démographie, notamment à propos du contrôle des naissances et d'autres questions connexes.
2. La redécouverte d'une œuvre
Comme je viens de le signaler, son livre le plus important et le plus connu est intitulé Zur Soziologie des Parteiwesens in der modernen Demokratie ; il a été publié une 1ère fois en 1911 et une 2nde fois en 1925 (cette édition étant l'édition définitive). Il s'agit d'une étude systématique, consacrée aux rapports entre la démocratie et les partis, à la sélection des classes politiques, aux relations entre les minorités actives et les masses et au "leadership". La bibliographie de Michels comprend 30 livres et près de 700 articles et essais, dont beaucoup mériteraient d’être réédités (1). Son livre principal a été traduit en anglais, en espagnol, en français, en italien, etc.
Malgré l'ampleur thématique, la profondeur et l’actualité de bon nombre d'analyses de Michels, son œuvre n'a pas joui du succès qu'elle mérite. Dans beaucoup de pays européens, on la cite mal à propos et les ouvrages critiques valables manquent. En compensation, plusieurs études de bonne tenue sont parues aux États-Unis, spécialement sur l'apport de Michels à la théorie du parti politique et à la définition du fascisme (2). Sa sympathie pour le mouvement de Mussolini est, évidemment, un des motifs qui ont conduit à l'ostracisation de son œuvre au cours de notre après-guerre. C'est un destin qu'il a partagé avec d'autres intellectuels, comme Giovanni Gentile (3). Autre motif : la diffusion en Europe de méthodes sociologiques américaines, lesquelles sont empiriques, descriptives, statistiques ou critiques / utopiques et ne prêtent guère d'attention à l'analyse des concepts et aux dimensions historiques et institutionnelles des phénomènes sociaux. Le style scientifique de Michels, qui est réaliste/réalitaire, anti-idéologique, démystifiant et dynamique, a été injustement considéré comme dépassé, comme l'expression anachronique d'une attitude éminemment conservatrice (4).
Un retour de Michels s'annonce
Récemment, toutefois, la situation a commencé à changer, surtout en Italie, pays que Michels considérait comme sa "nouvelle patrie". En 1966, on y publie, avec une étude préliminaire de Juan Linz, une traduction de Zur Soziologie des Parteiwesens (5). En 1979 paraît une sélection d'essais sous la direction du spécialiste américain James Gregor (6). Une anthologie d'écrits relatifs à la sociologie paraît en 1980 (7). Deux ans plus tard, l'Université de Pérouse organise un colloque sur le thème de "Michels entre la politique et la sociologie" avec la participation des plus éminents sociologues italiens (8). A l'occasion du 50ème anniversaire de sa mort, d'autres publications ont été incluses dans les programmes des éditeurs. Les éditions UTET ont annoncé une vaste collection d' "écrits politiques". Giuffré a prévu, dans sa prestigieuse collection Arcana Imperii, une anthologie dirigée par Ettore Albertoni & G. Sola, qui portera le titre de Dottrine et istituzioni politiche. Ce même éditeur envisage également une traduction italienne de Sozialismus und Faschismus in Italien, œuvre parue initialement en 1925.
Une contribution récente à la redécouverte de Michels se trouve dans le livre du professeur israëlien Zeev Sternhell, consacré à la genèse de l'idéologie fasciste en France (9). Selon Sternhell, Michels, comme Sorel, Lagardelle et De Man, incarne le courant "révisionniste", qui, entre 1900 et 1930, apporte une contribution décisive à la démolition des fondements mécanistes et déterministes du marxisme théorique, et à la critique de l'économisme et du réductionnisme matérialiste. Michels favorise ainsi la diffusion d'une conception de l'action politique fondée sur l'idée de nation et non de classe, couplée à une éthique forte et à une vision libre de la dynamique historique et sociale. D’après de nombreux auteurs, c'est là que résident les fondements où a mûri le fascisme avec son programme d'organisation corporative, de justice sociale, d'encadrement hiérarchique des institutions politiques et de limitation des corruptions dues au parlementarisme et au pluralisme partitocratique.
Michels a été en contact avec les personnalités politiques et intellectuelles les plus éminentes de son époque, comme Brentano, Sombart, Mussolini, Pareto, Mosca, Lagardelle, Sorel, Schmoller, Niceforo, etc. Il nous manque encore pourtant une bonne biographie. Il serait très intéressant de publier ses lettres et son journal ; ces 2 éléments contribueraient à illuminer une période extrêmement significative de la culture européenne de ces 100 dernières années.
3. La phase syndicaliste
Dans la pensée de Michels, on peut distinguer 2 phases. La 1ère coïncide avec l'abandon de l'orthodoxie marxiste initiale et avec une approche du syndicalisme révolutionnaire et du révisionnisme théorique. La 2nde, la plus féconde du point de vue scientifique, coïncide avec la découverte de la théorie de Mosca sur la "classe politique" et de celle de Pareto sur l'inévitable "circulation des élites". Nous allons, dans la suite de cet article, examiner brièvement, mais avec toute l'attention voulue, ces 2 phases.
Après qu'il ait publié de nombreux articles de presse et prononcé de nombreuses allocutions lors de congrès et de débats politiques, les 1ères études importantes de Michels paraissent entre 1905 et 1908 dans la revue Archiv (cf. supra) dirigée par Max Weber. Particulièrement significatifs sont les articles consacrés à "La social-démocratie, ses militants et ses structures" et aux "Associations. Recherches critiques", parus en langue allemande, respectivement en 1906 et en 1907. Michels y analyse l’hégémonie de la social-démocratie allemande sur les mouvements ouvriers internationaux et y envisage la possibilité d'une unification idéologique entre les diverses composantes du socialisme européen. Ce faisant, il met simultanément en exergue les contradictions théoriques et pratiques du parti ouvrier allemand : d'un côté, la rhétorique révolutionnaire et la reconnaissance de la grève générale comme forme privilégiée de lutte, et, d'un autre côté, la tactique parlementaire, le légalisme, l'opportunisme et la vocation aux compromis. Michels critique le "prudencialisme" des chefs sociaux-démocrates, sans pour autant favoriser le spontanéisme populaire ou les formes d'auto-gestion ouvrière de la lutte syndicaliste. Selon Michels, l'action révolutionnaire doit être dirigée et organisée et, de ce point de vue, les intellectuels détiennent une fonction décisive. Car décisif est le travail pédagogique d'unifier le parti politique. Le mouvement ouvrier se présente comme une riche constellation d’intérêts économiques et de visions idéalistes qui doit être synthétisée dans un projet politique commun.
Dans son 1er livre, Il proletariato e la borghesia nel movimento socialista, publié en italien en 1907, Michels perçoit parfaitement les dangers de dégénérescence, d'oligarchisation et de bureaucratisation, intrinsèques aux structures des partis et des syndicats. Dans cette 1ère phase de sa pensée, Michels envisage une "possibilité" [involutive] qui doit être conjurée par un recours à l'action directe du syndicalisme. Pour lui, l'involution virtuelle du socialisme politique ne révèle pas encore son véritable sens qui est d’être une inexorable fatalité sociologique.
4. La phase sociologique
En 1911, paraît, comme nous venons de le signaler, sa "somme" importante sur le parti politique (10), l'œuvre qui indique son passage définitif du syndicalisme révolutionnaire à la sociologie politique. L'influence de Mosca sur sa méthode historique et positive a été déterminante. À partir d'une étude sur la social-démocratie allemande, comme cas particulier, Michels en arrive à énoncer une loi sociale générale, une règle du comportement politique. Michels a découvert que, dans toute organisation, il y a nécessairement des chefs préparés à l'action et des élites de professionnels compétents ; il a découvert également la nécessité d'une "minorité créatrice" qui se propulse à la tête de la dynamique historique ; il a découvert la difficulté qu'il y a à concilier, dans le cadre de la démocratie parlementaire, compétence technique et représentativité. La thèse générale de Michels est la suivante : "Dans toute organisation humaine à caractère instrumental (Zweckorganisation), les risques d'oligarchisation sont toujours immanents" (11). Il dénonce ensuite l'insuffisance définitive du marxisme : "Les marxistes possèdent certes une grande doctrine économique et un système historique et philosophique fascinant ; mais, dès que l'on entre dans le champ de la psychologie, le marxisme révèle des lacunes conceptuelles énormes, même aux niveaux les plus élémentaires". Son livre est riche en thèses et en arguments. Jugeons-en sur pièces :
1) La lutte politique démocratique a nécessairement un caractère démagogique. En apparence, tous les partis combattent pour le bien de l'humanité, pour l’intérêt général et pour l'abolition définitive des inégalités. Mais, au-delà de la rhétorique sur le bien commun, sur les droits de l'homme et sur la justice sociale, on sent poindre une volonté de conquérir le pouvoir et se profiler le désir impétueux de s’imposer à l'État, dans l’intérêt de la minorité organisée que l'on représente. A ce propos, Michels énonce une "loi d'expansion", selon laquelle tout parti tend à se convertir en État, à s'étendre au-delà de la sphère sociale qui lui était initialement assignée ou qu'il avait conquise grâce à son programme fondamental" (12).
2) Les masses sont incapables de s'auto-gouverner. Leurs décisions ne répondent jamais à des critères rationnels et elles sont influencées par leurs émotions, par des hasards d'ordres divers, par la fascination charismatique qu'exerce un chef bien déterminé et influent, qui se détache de la masse pour en assumer la direction de manière dictatoriale. À la suite de l’avènement de la société de masse et de la croissance des grands centres industriels, toute possibilité de réinstaurer une démocratie directe est désormais définitivement éteinte. La société moderne ne peut fonctionner sans dirigeants et sans représentants. En ce qui concerne ces derniers, Michels écrit : "Une représentation durable signifie, dans tous les cas, une domination des représentants sur les représentés" (13). De l'avis de Michels, ce jugement ne signifie pas le rejet de la représentation, mais bien la nécessité de trouver des mécanismes qui pourront transformer les relations entre les classes politiques et la société civile, de la manière la plus organique possible. Aujourd'hui, le véritable problème de la science politique consiste à choisir des formes nouvelles 1) de représentation et 2) de transmission des volontés et des intérêts politiques, qui se fondent sur des critères organiques, dans un esprit de solidarité et de collaboration, orientés dans un sens pragmatique et non inspirés de ces mythes d'extraction mécaniciste, qui ne visent que le pouvoir des partis et non le gouvernement efficace du pays.
La compétence, c'est le pouvoir
3) La foi politique a pris le relais de la foi religieuse à l’ère contemporaine. Michels écrit : "Au milieu des ruines de la culture traditionnelle des masses, la stèle triomphante du besoin de religion est restée debout, intacte" (14). C'est là une anticipation intelligente de l'interprétation contemporaine du caractère messianique et religieux/séculier, si caractéristique de la politique de masse moderne, comme c'est notamment le cas dans les régimes totalitaires.
4) "La compétence est pouvoir", "la spécialisation signifie autorité". Ces 2 expressions récapitulent pour Michels l'essence du "leadership". En conséquence, la thèse selon laquelle le pouvoir et l'autorité se déterminent par rapport aux masses, ou dans le cadre des conflits politiques avec les autres partis, est insoutenable. D’après Michels, ce sont, dans tous les cas, des minorités préparées, aguerries et puissantes qui entrent en lutte pour prendre la direction d'un parti et pour gouverner un pays.
5) Analysant 2 phénomènes historiques comme le césarisme et le bonapartisme, Michels dévoile les relations de parenté entre démocratie et tyrannie et se penche sur l'origine démocratique de certaines formes de dictature. "Le césarisme, écrit-il, est encore de la démocratie ou, du moins, peut en revendiquer le nom, parce qu'il tire sa source directement de la volonté populaire" (15). Et il ajoute : "Le bonapartisme est la théorisation de la volonté individuelle, jaillie au départ de la volonté collective, mais émancipée de celle-ci, avec le temps, pour devenir à son tour souveraine" (16).
Légitimité et "loi d'airain des oligarchies"
6) Carl Schmitt, dans son livre classique Legalität und Legitimität (1932), a développé une analyse profonde autour de la "plus-value politique additionnelle" qu'assume celui qui détient légalement le levier du pouvoir politique; il s'agit d'une espèce de supplément de pouvoir. Michels a eu une intuition semblable en écrivant: "Les leaders, disposant des instruments du pouvoir et, de ce fait, du pouvoir lui-même, ont pour eux l'avantage d'apparaître toujours sous la lumière de la légalité".
7) Le livre principal de Michels contient beaucoup d'autres observations sociologiques : sur les différenciations de compétences ; sur les goûts et les comportements, lesquels, en tant que conséquences de l'industrialisation, ont touché les ouvriers et brisé l'unité de classe; sur les mutations sociales comme l'embourgeoisement des chefs et le rapprochement entre les niveaux de vie du prolétariat et de la petite bourgeoisie ; sur la possibilité de prévoir et de limiter le pouvoir des oligarchies au moyen du procédé technique qu'est le référendum et par le recours à l'instrument théorique et pratique du syndicalisme.
8) La 6ème partie du livre est centrale et dédiée explicitement à la tendance oligarchique des organisations. Michels énonce la plus célèbre de ses lois sociales, celle qui évoque la "perversion" que subissent toutes les organisations : avec l'accroissement du nombre des fonctions et des membres, l’organisation, "de moyen pour atteindre un but, devient fin en soi. L'organe finit par prévaloir sur l'organisme". C'est là la "loi de l'oligarchie" dont il résulte que l'oligarchie est la "forme établie d'avance de la convivialité humaine dans les organisations de grande dimension".
9) Le livre de Michels contient, dans sa conclusion, une volonté de lutte qui, partiellement, rappelle la vision historique tragique de Max Weber et de Georg Simmel ; c'est une volonté d'approfondir le choc inévitable entre la vie et ses formes constituées, entre la liberté et la cristallisation des institutions sociales, lesquelles caractérisent la vie moderne.
5. L'Histoire
Avec la publication en langue italienne du livre intitulé L'imperialismo italiano. Studio politico e demo-grafico (1914), le "retournement" de Michels est définitif. Avec la parution de cette œuvre, s'écroule un mythe, celui de l'internationalisme et de l’universalisme humanitariste. Dans l'œuvre de Michels, le nationalisme apparaît comme le nouveau moteur idéal de l'action politique, comme un sentiment capable de mobiliser les masses et d'en favoriser l’intégration dans les structures de l'État. L'analyse sociologique du sentiment national sera approfondie dans un volume ultérieur, d'abord paru en allemand (1929), et puis en italien (1933), sous le titre de Prolegomeni sul patriottismo.
A partir de 1913, paraissent en Italie plusieurs études importantes en économie : Saggi economici sulle classi popolari (1913), La teoria di Marx sulla poverta crescente e le sue origini (1920). L'approche que tente Michels en économie est de nature rigoureusement historique. Selon lui, il est plus important de tenir compte de l'utilité pratique d'une théorie économique que de ses corrections spéculatives purement formelles. L'interprétation de Michels est pragmatique et concrète. Il critique l’inconsistance de l' "homo oeconomicus" libéral, parce qu'à son avis, il n'existe pas de sujets économiques abstraits, mais des acteurs concrets, porteurs d’intérêts spécifiques. Il critique ensuite l'interprétation du marxisme, laquelle pose l'existence d'un conflit insurmontable au sein des sociétés. Michels reconnaît par là la fonction régulatrice et équilibrante de l'État et la nécessité d'une collaboration étroite entre les diverses catégories sociales. Pour cette raison, le modèle corporatif lui apparaît constituer une solution. Sa valorisation du corporatisme est contenue dans l'opuscule Note storiche sui sistemi sindicali corporativi publié en langue italienne en 1933.
6. Le fascisme
Dans cette phase-là de son œuvre, son activité d'historien, il la consigne dans des livres, écrits d'abord en allemand, puis traduits en italien : Socialismo e fascismo in ltalia (2 vol., 1925) ; Psicologia degli uomini significativi. Studi caratteriologici (1927), Movimenti anricapitalistici di massa (1927) ; puis dans des écrits rédigés directement en italien : Francia contemporeana (1926) et Storia critica del movimento socialista italiano (1926). Parmi les personnalités "significatives" dont il trace la biographie, figurent Bebel, De Amicis, Lombroso, Schmoller, Weber, Pareto, Sombart et W. Müller. En 1926, Michels donne une série de leçons à l'Université de Rome ; elles seront rassemblées un an plus tard en un volume, rédigé en italien : Corso di sociologia politica, une bonne introduction à cette discipline qui s’avère encore utile aujourd'hui. Dans ce travail, il retrace les grandes lignes de sa vision élitiste des processus politiques, émet une théorisation de l'institution qu'est devenue le "Duce" et développe une nouvelle théorie des minorités. Le "Duce", qui tire sa puissance directement du peuple, étend sa légitimité à l'ensemble du régime politique. Cette idée constitue, en toute vraisemblance, un parallèle sociologique de la théorie élaborée simultanément en Allemagne par les théoriciens nationaux-socialistes du dit "Führerprinzip".
Cette relative originalité de Michels n'a pas été suffisamment mise en évidence par les critiques, qui se sont limités à le considérer seulement comme un génial continuateur de Mosca et de Pareto. En 1928, dans la Rivista internazionale di Filosofia del Diritto, paraît un essai important de Michels : Saggio di classificazione dei partiti politici. Par la suite, de nombreux écrits italiens furent réunis en 2 volumes : Studi sulla democrazia e l'autorità (1933) et Nuovi studi sulla classe politica (1936). L'adhésion explicite de Michels au fascisme s'est exprimée dans un ouvrage écrit d'abord en allemand (L'Italia oggi) en 1930, année où il s'inscrit au PNF (Parti National Fasciste). Dans ces pages, Michels fait l'éloge du régime de Mussolini, parce qu'il a contribué de manière décisive à la modernisation du pays.
7. Conclusions
La plus grande partie des notules relatives à la vie de Michels sont contenues dans son essai autobiographique, rédigé en allemand (Una corrente sindicalista sotteranea nel socialismo tedesco fra il 1903 e il 1907) et publié en 1932 ; cet essai demeure encore et toujours utile pour reconstruire les diverses phases de son existence, ainsi que repérer les différentes initiatives politiques et culturelles qu'il a entrepris ; on découvre ainsi son itinéraire qui va de la sociale-démocratie allemande au fascisme, de l'idéologie marxiste au réalisme machiavélien à l'italienne, des illusions du révolutionarisme à son credo conservateur. En résumé, il s'agit là d'une œuvre vaste, de grand intérêt. Nous espérons, en guise de conclusion à cette brève introduction, qu’elle contribuera à faire redécouvrir ce grand sociologue et à valoriser de façon équilibrée son travail.
Notes :
- Une bibliographie des travaux de Michels à été publiée en 1937 par les Annali de la faculté de Jurisprudence de l'Université de Pérouse.
- Par ex. D. Beetham, "From Socialism to Fascism : The Relation Between Theory and Practice in the Work of R. Michels" in: Political Studies, XXV, nn. 1 & 2. Cf. aussi G. Hands, "R. Michels and the Study of Political Parties" in : British Journal of Political Science, 1971, n. 2.
- Sur ce thème, W. Röhrich, R. Michels vom sozialistisch-syndikalistischen zum faschistischen Credo, Berlin, 1972. Cf. également R. Messeri, "R. Michels : crisi della democrazia parlamentare e fascismo" dans l'ouvrage collectif Il fascismo nell'analisi socioligica, Bologna, 1975.
- Remarquablement intéressantes sont les études de E. Ripepe (Gli elitisti italiani, Pisa, 1974) et de P.P. Portinaro, "R. Michels e Pareto. La formazione e la crisi della sociologia" in : Annali della Fondazione Luigi Einaudi, Torino, XI, 1977.
- Roberto Michels, Les partis politiques, Essai sur les tendances oligarchiques des démocraties, Flammarion, Paris, 1971.
- A. James Gregor, Roberto Michels e l'ideologia del fascismo, Roma, 1979. À la suite d'une longue introduction, on trouvera dans ce volume un vaste choix de textes de Michels.
- Roberto Michels, Antologia di scritti sociologici, Bologna, 1980.
- Les contributions à ce colloque ont été rassemblées par G.B. Furiozzi dans le volume Roberto Michels Ira politica e sociologia, ETS, Pisa, 1985.
- Z. Sternhell, Ni droite ni gauche, Seuil, 1983.
- À propos de la contribution de Michels à la "stasiologie" (science des partis politiques), voir G. Femàndez de la Mora, La partitocracia, Instituto de Estudios Politicos, Madrid, 1977, pp. 31-42. À propos de l'influence de Michels sur Ortega y Gasset, voir I. Sanchez-Camara, La teoria de la minoria selecta en el pensamiento de Ortega y Gasset, Madrid, 1986, pp. 124-128.
- Michels, Les partis politiques..., op.cit.
- (13)(14)(15)(16) Ibidem.
00:20 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : socialisme, politique, fascisme, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 07 mai 2008
Georges Sorel: socialisme et violence
Georges Sorel : Socialisme et violence
Source : Ange Sampieru, revue Orientations n°11 (juil. 1989).
Pour la plupart de nos contemporains, l'évocation de Georges Sorel revient le plus souvent à l'analyse du théoricien de la violence. Son ouvrage le plus célèbre, Réflexions sur la violence (1908), constitue une contribution irremplaçable au mythe révolutionnaire. On sait l'importance que constitue pour ce penseur exceptionnel le concept de "mythe". Le mythe révolutionnaire sorélien est inspiré d'une vision polémologique des rapports sociaux. La violence informe l'action révolutionnaire et l'investit d'une conception réaliste de l'histoire. Comme moyen d'agir sur le présent, le mythe prolétarien est un outil au service de la révolution anti-bourgeoise. C'est aussi un outil conceptuel qui doit d'abord s'opposer à la fois à l'utopie socialiste et au conservatisme libéral. Ce discours très original, activiste par excellence, donne une place privilégiée à l'œuvre de Sorel dans notre conception du socialisme.
Avant d'aborder l'analyse proprement dite du mythe de la violence comme idée-force chez Sorel, il est utile de présenter l'homme et son œuvre. C'est à partir de cette connaissance de l'environnement idéologique que nous pourrons, dans une 2nde partie, présenter les caractères de cette "violence" en tant que mythe et des conséquences qui en découlent sur notre propre position.
*** I. Sorel : l'homme et l'œuvre ***
Georges Sorel (1847-1922) commence sa carrière en 1889. C'est l'époque des 1ères traductions françaises des œuvres de Marx. Déjà, on peur trouver en librairie Le Capital et Socialisme utopique et socialisme scientifique ; il faudra en effet attendre 1895 pour que paraisse le fameux Manifeste du parti communiste. En France, il est un fait que le marxisme constitue en 1889 un mouvement idéologique, beaucoup plus qu'un parti révolutionnaire. Et c'est en 1893 que Sorel se convertit au marxisme. Ce rapprochement de Sorel marquera toute son œuvre. Il n'impliquera aucun attachement aveugle aux valeurs marxistes. Le personnage est trop indépendant pour inscrire ses réflexions dans un système total. Mais au fait, qui est Sorel ? Le personnage a été l’objet de nombreuses analyses aussi brillantes que contradictoires. Pour les uns, Sorel est un penseur attaché à l'école rationaliste. Pour d'autres encore, il serait un chantre remarquable de l'irrationnel. Dans ses opinions politiques, il apparaît à certains comme un conservateur révolutionnaire (une espèce rare à son époque) ; pour d'autres, il est un néo-marxiste. Et les ouvrages abondent qui veulent prouver définitivement le bien-fondé de l'une ou l'autre opinion. Pour notre part, nous ne rentrerons pas dans ce débat.
Nous suivrons une analyse chronologique, découpée en phases successives, mais où chaque strate soutient pour une part la pensée suivante. Il est indéniable que Sorel, par ex., a été séduit à un moment de son évolution par la nouveauté radicale des textes marxistes. Comment un intellectuel de son époque, ouvert aux idées neuves, en rapport épistolaire avec de nombreux intellectuels européens de toutes tendances (citons pour mémoire Roberto Michels, Benedetto Croce) n'aurait-il pas été attiré par un discours révolutionnaire proposant une lecture "scientifique" de l'histoire et de la misère. Mais il ne faut pas pour autant croire au "marxisme", orthodoxe ou non, de Sorel. De la même façon, nous ne croyons pas au soi-disant "fascisme" de Sorel, qu'il est difficile de rattacher à l'idée contemporaine (historique) que l'on s'en fait aujourd'hui où 66 années se sont écoulées depuis la prise du pouvoir par Mussolini. L'œuvre de Sorel est beaucoup plus complexe.
Selon Paolo Pastori (Rivoluzione e continuita in Proudhon e Sorel, Giuffre, Roma, 1980, 244 p.), l'œuvre de Sorel constitue "une alternative au conservatisme réactionnaire et au progressisme révolutionnaire". Ce dernier ajoute que la pensée sorélienne est un dépassement des oppositions traditionnelles de la pensée moderne entre, d'une part, les théories du droit naturel et, d'autre part, les théories subjectives du droit, du rationalisme absolu et du volontarisme. La finalité politique de l'idéologie est une révolution "pluraliste", qui restaure une société ouverte, seule à même de contrer la menace par l'entropie sociale du capitalisme. La modernité n’est pas niée, elle est intégrée dans un ensemble communautaire organique. Plus proche de Proudhon que de Marx, Sorel adhère aux fondements idéologiques du penseur socialiste français. C’est-à-dire :
- Une conception plurielle de la raison. Le marxisme est un rationalisme moniste et absolu qui, comme le capitalisme, inscrit un projet social desséchant.
- Une vision pluridimensionnelle de l'homme. Le marxisme est un réductionnisme dangereux pour l'homme (à cause de son déterminisme économique) et la société (mécanique de la lutte des classes). La prise en compte d'une dialectique sociale qui refuse le dualisme classe ouvrière/entrepreneurs capitalistes et reconnaît un jeu plus riche de rapports sociaux.
- Un projet de synthèse sociale, où le sens de l'équilibre (en devenir) des classes sociales souligne la dialectique autorité/liberté, individu/communauté, passé/présent.
Sorel et Proudhon : un rapport de continuité
Il y a sans aucun doute chez Sorel et Proudhon un rapport de continuité. Sorel est un élève de Proudhon, qui actualise sa réflexion, au cours des différentes phases de ses recherches. Pour Pastori, Sorel est d'abord : un conservateur libéral (1889-1892), puis un marxiste de "stricte obédience" (1893-1896) ; cette 2nde phase débouche sur une période de révision du marxisme déterministe et scientiste, pour aboutir en 1905-1908 à un retour à la pensée de Marx, qui sera définitivement abandonné en 1910-1911. Cette dernière phase constitue pour Sorel un point de retour à la pensée de Proudhon. Nous apprendrons donc à mieux connaître Sorel si nous voulons bien nous atteler à la tâche d'une étude sérieuse de l'auteur de La Guerre et la paix et de La capacité politique des classes ouvrières...
Proudhon est un penseur révolutionnaire dans ce XIXe siècle de la raison bourgeoise. Attaché à l'idée, il ne peut être considéré comme un "rationaliste" au sens commun du terme. Proudhon distingue plusieurs catégories du concept de raison : la raison humaine, la raison naturelle, la raison pratique, d'une part et, d'autre part, la raison publique et la raison particulière. La raison humaine est la faculté supérieure de concevoir "l'idéal qui est l'expression du libre pouvoir créateur des groupes historiques et des personnes". Face à la raison raisonnante de la pensée bourgeoise et du marxisme à prétention scientifique, Proudhon revendique avec force l'espace de liberté de la pensée historique des groupes sociaux, et même de l’homme conçu comme un être de culture non-conditionné par des déterminisnes absolus.
Cette 1ère raison est limitée à son tour par la raison dite, dans le langage proudhonien, "raison naturelle" ou "raison des choses". Elle est nécessité objective, qui retient dans certaines limites indépassables, les aspirations démiurgiques de l’homme. La raison pratique est la synthèse finale des 2 précédentes. C'est à travers elle que l'on peut appréhender la confrontation de 2 raisons, celle de l'homme libre non-déterminé par un mécanisme de la matière, et celle du réel qui est la frontière des pouvoirs créatifs humains. Proudhon s'inspire d'une conception pragmatique. La 2nde catégorie se décompose en raison publique ou générale, et raison particulière, reproduction de "l’instance de l'universalité" (la nécessité) et celle de la particularité (la liberté). La non-coïncidence des raisons évoquées implique une critique radicale des systèmes de pensée "absolutistes" en termes contemporains, des pensées totalitaires (marxisme, jacobinisme et rousseauisme démocratique). Proudhon, militant anti-totalitaire, privilégie la raison particulière. Ce "rationalisme pluraliste" informe alors la conception socio-politique de Proudhon.
La dialectique sérielle de Proudhon
La théorie des séries est un élément nécessaire pour comprendre sa pensée. Proudhon distingue dans tout processus 2 moments séparés : le 1er moment est la division-individuation (constitution de séries simples), le 2nd, celui de la recomposition de l'unité-totalité (constitution de séries composées). Proudhon affirme aussi l'indépendance des ordres de séries et l'impossibilité d'une science universelle (De la création de l'ordre dans l'humanité). Paolo Pastori parle de la "dialectique sérielle" de Proudhon, qu'il oppose à la dialectique hégélienne, et rapproche de la dialectique crocienne des instincts. Cette dialectique sérielle confirme Proudhon dans son refus de toute analyse réductionniste. L'existence sociale ne se ramène pas a un référent unique, universel et déterminant. La sociologie proudhonienne, que Sorel reprendra à son compte, est une "sociologie de la composition" (division du travail et organisation, reconnaissance des économies rurales et industrielles, fonctions centrales et décentralisation).
Cet aspect de la pensée Proudhon/Sorel est opposé aux tendances à l'unidimensionnalité de la société capitaliste. L'économie libérale qui est sa forme historique, confond ensuite liberté et libre concurrence, créant "une nouvelle féodalité anti-organique et anti-politique". Proudhon n'est pas ennemi de l'initiative individuelle. Il soumet celle-ci à sa théorie des séries. À savoir : le moment subjectif de l'initiative individuelle, et celui, objectif, de la soumission aux fins collectives du peuple.
L'apologie concomitante du monde rural constitue, chez les socialistes français, une véritable critique de "la réduction économiste de la réalité humaine" (Idée générale de la Révolution). Mais cette apologie ne doit pas être confondue avec un quelconque attachement réactionnaire au monde paysan. L'idéologie socialiste de Proudhon défend la production agricole sans lui coller des valeurs de droite, telles que le fit l'État français entre 1940 et 1944. La terre et l'industrie sont 2 facteurs de travail et de production reliées par un système englobant de fédérations. Et la révolution est "le refus de la réduction d'un ordre social pluridimensionnel à la seule finalité économique" (P. Pastori, op. cit.).
La révolution n'est pas un simple mouvement de destruction et de contestation d'une classe (la Révolution française est le mouvement de la bourgeoisie trop à l'étroit dans une société traditionnelle où les valeurs dominantes sont celles de l'aristocratie - valeurs sociales - et de l'État monarchique - valeurs du politique). Contre cette idée dévoyée de la révolution, les socialistes français (Proudhon et Sorel) ont une conception révolutionnaire de l'équilibre. La synthèse par le haut (le dépassement) de valeurs en apparence seulement contradictoires : individualité et communauté, propriété privée et intérêt public.
En ce qui concerne, par ex., la propriété, le socialisme s'oppose à la fois à son élimination radicale (communisme) et à son maintien en l'état. La bourgeoisie nie la signification sociale de la propriété. La propriété socialiste la reconnaît. D'où, chez ces penseurs, une valorisation constante de la JUSTICE, valeur pivot de la nouvelle société envisagée. Et, chez Proudhon, puis Sorel, le développement d'un discours fédéraliste, antiéconomique et anti-bourgeois (les socialistes parlementaires sont compris dans cette dernière catégorie).
Séduisante discipline marxiste et rigorisme déterministe
On doit remarquer que Sorel reste dans une position critique vis-à-vis de l'œuvre de Proudhon, qu'il accuse de tendances à un "esprit de système". "L'ontologisation" de la Justice est le fondement philosophique de l'apologie de l'équilibre. Au-delà de cette critique, Sorel reste néanmoins un élève fidèle du proudhonisme. Il rejoint Proudhon dans sa réflexion sur la liberté, qui est le nœud gordien de l'éthique socialiste. Il y a chez Sorel un attachement souvent proche de l'inconscience aux valeurs "libertaires" du "socialisme utopique". Cette méfiance et cette inconscience expliquent, pour une part, l'adhésion au socialisme "déterministe" de Sorel. Face à l'individualisme bourgeois, Sorel se tourne vers un socialisme radical, un socialisme de combat. Le marxisme représente alors chez Sorel un germe d'ordre face au chaos créé par le capitalisme de la bourgeoisie. Le monde de la production sous-tend alors cette révolution culturelle réclamée par Sorel. Sorel est partisan d'une raison pratico-politique, doublée d'une conception historiciste.
À partir de 1896, Sorel suit une évolution qui l'éloigne de cette raison déterministe. Sa critique philosophique du positivisme s'étend à un discours politique où la "raison absolue" tient le rôle souverain. Il y a, écrit P. Pastori, "une rupture radicale avec le rigide schéma matérialiste du marxisme orthodoxe". Et, en 1898, Sorel revient plus sérieusement vers Proudhon : il écrit alors L'avenir socialiste des syndicats. La révolution qui instaure la dictature du prolétariat est rejetée par Sorel. Il accuse ce projet de masquer la dictature des intellectuels. Derrière la conception finaliste et proprement "apocalyptique" de la révolution prolétarienne, entendue au sens marxiste, on reconnaît sans peine une tyrannie économico-intellectuelle, une idéocratie despotique. Et Sorel propose au prolétariat un 1er acte révolutionnaire : rejeter définitivement la dictature des intellectuels, qui reproduit la discipline externe du capitalisme. À la place, il faut instaurer une discipline interne, que Sorel qualifiera de "morale". Enfin, en 1903, Sorel, selon l'opinion de Pastori, rejoint une fois pour toutes Proudhon, quittant les terrains dangereux du marxisme orthodoxe. Il écrit alors son Introduction à l'économie moderne.
Sur 2 points surtout, Sorel est proudhonien : il faut conserver la propriété privée, qui est une garantie sérieuse de la liberté des citoyens. Cette propriété sociale est réelle face à la forme bourgeoise de "propriété abstraite" où le propriétaire du moyen de production n'est pas le producteur. 2nd point : restaurer l'idéal qui animait l'antiquité romaine d'une "compénétration harmonieuse des intérêts individuels, familiaux et sociaux". Sorel propose aussi un ordre juridique bien loin de tout "rationalisme politique". Il réclame l'apparition de nouvelles "autorités sociales". Enfin, il donne à l’État un rôle de médiateur et une fonction d'initiative.
Le mythe : outil spirituel de mobilisation
Sorel développe d'autre part une théorie des mythes sociaux. Le mythe est la synthèse nécessaire entre la raison et "ce qui n'est pas rationnel". Le mythe est une traduction symbolique du réel, qui autorise et favorise une mobilisation totale des masses. En ce sens, le mythe est le contraire du rationalisme intellectuel, par ex. celui des marxistes. Sans contester cette "raison des choses" dont parlait Proudhon et les "pesanteurs objectives" qui en découlent, Sorel retient le mythe comme outil spirituel de mobilisation. L'ordre social et ses dépendances idéologiques (comme le droit) sont fondés sur une conception commune du monde, une vision du social et du politique qui ne se réduisent pas à un pur discours rationnel. L'ordre est le résultat conjoint de cet ensemble d'images (le mythe) et d'une volonté populaire (la mobilisation).
Cette position sera à nouveau l'objet d'une révision provoquée par la "révolution dreyfusienne" de 1905-1908. Pour Pastori, il y a un retour à une conception "dichotomique" : Sorel est partagé entre la relation continue raison/irrationnel et la rupture révolutionnaire comme explosion totale et irrationnelle. On trouve ce partage dans ses écrits réunis sous le titre de Réflexions sur la violence. Sorel distingue la grève générale syndicaliste (création d'un nouvel ordre) et la grève générale politique (nous préférons dire : politico-partitocratique), c-à-d. exploitée et dirigée par les politicards sociaux-parlementaires. La révolution est un élan créateur, que la grève informe et qui consiste en une critique totale de l'ordre existant. La figure du héros révolutionnaire se dégage : le syndicaliste est le guerrier vertueux de cette révolution, mû par des valeurs de sacrifice, du désir de surpassement. Sorel analyse certaines institutions traditionnelles comme exemplaires d'une structure révolutionnaire : ainsi l'Église catholique, à la fois acteur séculier et dont les membres sont voués à un absolu. Idéalisme transcendant et action directe et permanente sur l'histoire sont les 2 qualités d'un parti de la révolution. En 1910, Sorel écrit de l’Église qu'elle est une élite.
C'est aussi l'époque où Sorel réfléchit sur les questions du droit romain et des institutions historiques qui composèrent l'ordre social antique. À savoir et principalement le patriarcat. Il distingue 3 sources de l'esprit juridique : la guerre, la famille, la propriété. La guerre est une des dimensions de la dialectique des relations sociales. Et la révolution doit utiliser à son profit cette pluralité des relations sociales, non point au nom d'un finalisme catastrophique (révolution finale du marxisme orthodoxe), mais pour le rétablissement de cette "justice supplétive", fondement de l'ordre juridique. Sorel exclut de tout compromis le domaine des relations avec la partie de la bourgeoisie qui "réduit tout à l’utile économique". D'où une certaine fascination pour la révolution bolchévique, qui n'est pas le résidu d'un quelconque attachement idéologique au marxisme, mais une reconnaissance de la révolution totale en actes. Peut-être est-ce aussi un désir de bien démarquer sa pensée de ce social-réformisme qu'il exécrait par dessus tout (Sorel parle du "socialisme hyper-juridique de nos docteurs en haute politique réformiste", in Introduction à l'économie moderne, cité par Marc Rives : À propos de Sorel et Proudhon in Cahiers G. Sorel n°1, 1983).
*** II. Socialisme et violence ***
Sorel est un grand penseur non pas tant pour ses œuvres que par l'originalité de ses réflexions et la "marginalité" de ses positions. Qui fut Sorel ? Un traditionaliste, un marxiste, un dreyfusard, un champion du syndicalisme révolutionnaire, un nationalisme volontariste ou un léniniste de cœur et d'esprit ? Certains hommes sont rétifs à toute classification. Les étiquettes ne parviennent pas à les maintenir dans une case et les maîtres en rangement ont des difficultés insurmontables à "normaliser" ce type d'hommes. Certains chercheurs se sont pourtant essayés à mieux cerner Sorel. Citons pour mémoire : Georges Sorel, Der revolutionäre Konservatismus de Michael Freund (Klostermann, 1972) ; Notre maître G. Sorel de Pierre Andreu (1982) ; enfin : Georges Sorel : het einde van een mythe, J. de Kadt (1938).
Pour Claude Polin, la question est claire : un homme qui fut tout à tour un admirateur de Marx, Péguy, Lénine et Le Play, Proudhon, Nietzsche, Renan, James, Maurras et Bergson, Hegel et Mussolini, etc. fut-il "brouillon" ? Sa réponse est tout aussi directe : il s'agit là d'un chaos apparent qui cache une logique hors des sentiers battus par la pensée universitaire. Sorel est l'homme des intuitions. Il est en même temps celui du refus total des systèmes de pensée, que beaucoup de ses contemporains voulaient imposer comme "horizons indépassables de leur temps" (exemples du comtisme et du marxisme). Cette liberté de pensée, ce désir de ne pas enfermer sa réflexion sur le monde et la société dans un cadre idéologique figé et mécanique, Sorel l’a exprimé dans un de ces ouvrages les plus forts : Réflexions sur la violence (1906).
Dans son ouvrage sur la "droite révolutionnaire", suivi de Ni droite, ni gauche, l'historien Z. Sternhell intitule un de ses chapitres : "La révolution des moralistes". Sorel est donné dans ce chapitre comme l'un des représentants les plus remarquables de ce courant "moraliste". Face au révisionnisme libéral de Bernstein et de Jaurès, attachés aux valeurs libérales traditionnelles (à propos de ces valeurs, Lafargue parlait de "grues métaphysiques", cité par Sternhell p.81), les "moralistes" sont les hommes du refus de tout compromis déshonorant : compromis avec les valeurs de la société bourgeoise, compromis avec le matérialisme sous toutes ses formes, c-à-d. : marxiste, bourgeois (on retrouve ce même sentiment dans d'autres groupements européens de notre époqu e: Congrès de Hoppenheim (1928), Congrès du Parti Ouvrier Belge (manifeste du 3 juillet 1940), où De Man évoque une révolution spirituelle et éthique devant les congressistes). Ce "socialisme éthique", on le retrouve à l'origine de ce mythe de la violence.
Violence, prolétariat et grève générale
Il est tout d'abord utile de ne pas confondre la "violence" sorélienne avec les formes physiques d'agressivité que nos sociétés modernes nous exposent. La notion de violence chez Sorel se conjugue avec 2 autres notions toutes aussi essentielles : celle de "prolétariat" (le monopoleur de cette violence) et celle de "grève générale", qui est l'arme de la révolution. Il y a en effet une liaison intime entre la grève générale et l'exercice de la violence. La grève générale est l'expression privilégiée et unique dans l'histoire contemporaine de la violence du prolétariat. C'est, écrit Sorel, un "acte de guerre", semblable à celui d'une armée en campagne. La grève générale est un acte de guerre, ce qui implique qu'elle en possède les mêmes caractéristiques. Notamment qu'elle se produit sans haine et sans esprit de vengeance. Sorel écrit : "En guerre, on ne tue pas les vaincus".
L'emploi effectif et actualisé de la violence physique n'est pas consubstantiel à la violence de la grève générale. Cette violence est une sorte de "démonstration militaire" de la force prolétarienne. La mort d'autrui n'est qu'un accident de la violence, ce n'est pas son essence. Sorel oppose la violence militaire bourgeoise et la violence guerrière prolétarienne limitée (les travaux des historiens démographes démontrent tout au contraire le caractère beaucoup plus sacrificateur et sanglant des guerres non-conventionnelles, dites "guerres atomiques", par rapport aux guerres traditionnelles). La violence de Sorel est donc une attitude, une attitude de détermination face à l'adversaire. La violence est une idée qui favorise la mobilisation et l'action qui en découle. Sorel écrit aussi : "Nous avons à agir".
Cette optique explique aussi le mépris sorélien de la classe des intellectuels, incapables de toute action offensive, ignorant du terrain des luttes. A contrario, on peut remarquer que ces mêmes intellectuels, qui refusent le contact de la réalité avec le réel, sont des dirigeants sanguinaires. Leur "violence" d'intellectuels au pouvoir (Sorel pense peut-être à la révolution de 1791 et à la répression de 1870) est erratique, cruelle, terroriste. La violence qu'ils exercent est pathologique. Elle traduit leur impuissance à réunir les masses autour de leurs valeurs. La violence sorélienne est tout à l'opposé de cette violence - on pense à la violence des jacobins de 1791, à la violence léniniste de la NEP contre les paysans d'Ukraine, etc. - parce qu'elle a pleine conscience de sa dignité, de sa générosité. Sorel se réfère à une violence guerrière qui, comme chez Clausewitz, est la marque d'une volonté. La violence est une manifestation de détermination, de fermeté dans ses objectifs et son idéal.
Cette idée de "violence créatrice" débouche sur un mythe historique chez Sorel : la grève générale. La violence volontariste est une idée qui doit se poser comme acte historique. L'idée anime une volonté et le mythe médiatise le rapport entre le réel (la grève générale) et l'idée. Le mythe, écrit Sorel, est la réalisation d'espoirs en actions, non pas au service d'une doctrine, parce que les doctrines et les systèmes sont des spéculations intellectuelles hors du champ de faction et de l'intérêt des prolétaires. La violence est la doctrine en actes, elle est volonté pure et non représentation pensée. L'idée de la grève générale est "une organisation d'images", un instinct collectif et un sentiment général qui manifeste la guerre du socialisme moderne contre la société bourgeoise. Et Sorel revient à cette notion d'intuition, qui n'est pas réductible à un classement clair, précis, bref mécanique, d'idées alignées et normalisées. La violence est, chez Sorel, proche de l'idée bergsonienne. Polin écrit : "Dans la violence, le mythe devient ce qu'il est". La notion de confusion entre le devenir et l'intuition joue le même rôle chez nos 2 auteurs.
Le syndicalisme révolutionnaire s'oppose au social-réformisme
La violence est enfin la matrice d'un socialisme prolétarien. Le socialisme de Sorel né de cette violence n'est pas un social-réformisme. Sorel fait confiance au syndicalisme révolutionnaire pour bâtir ce socialisme. Le syndicat est ce faisceau des forces vives du prolétariat. Le socialisme de Sorel refuse le socialisme du rêve ou de l'éloquence parlementaire, celui des partis et des intellectuels qui les mènent à des songeries creuses. Citons encore Sorel : "Le syndicat : tout l'avenir du socialisme réside dans le développement autonome des syndicats ouvriers" (Matériaux pour une théorie du prolétariat). Et Polin note avec justesse que le syndicat est dans l'idée sorélienne le "Cogito du prolétariat".
Sorel considère le syndicat comme la cheville de la révolution. Les groupements naturels du prolétariat sont les syndicats. Ils sont le creuset de sa volonté manifestée de libération. Le syndicat, qui exclut les intellectuels et les parlementaires, est une communauté de combat authentique. Sorel dit d'ailleurs aux marxistes que le vrai marxiste est celui qui comprend que le marxisme est inutile aux masses ouvrières. Le syndicat agit par lui-même, pour ceux qui sont ses membres. Il ne suit pas les programmes des partis et des professionnels de la pensée. Ces derniers, que Sorel appelle "les docteurs de la petite science", eurent à l'égard de ce jugement une réaction corporatiste dont Sorel se moqua. Sorel renvoie dos à dos les intellectuels des partis bourgeois et les intellectuels qui se prétendent prolétaires. Il dénonce leur nature proprement parasitaire. L'utopie de leurs discours est réactionnaire. L'intellectuel bloque le mouvement révolutionnaire et aliène la pensée des travailleurs. La révolution est pensée en actes. La révolution des intellectuels est pure image.
Mais il ne faut pas pour autant confondre "action violente" et "action pour action". Sorel, précise Polin, n'est pas un penseur nihiliste. L'agitation n'est pas la révolution. La violence ne se limite pas à une série de secousses. La violence engendre des actions que Sorel nomme "actions épiques". L'épopée révolutionnaire n'est pas négativiste, elle est une néguentropie sociale. La violence est la forme la plus haute de l'action, parce qu'elle a pour finalité de CRÉER. En ce sens, elle est responsabilisation des acteurs, noblesse des combattants, dépassement de soi-même. Elle éveille "le sentiment du sublime", et "fait apparaître au premier rang l'orgueil de l'homme libre" (Réflexions…). On peut rapprocher cet aspect créateur, proprement faustien de la violence, des valeurs nouvelles du "philosophe au marteau" de Sils-Maria.
La violence est un moyen de créer, elle n'est pas une fin en soi. Cette créativité l'investit d'une valeur sans pareil. Et elle est au service du socialisme puisque celui-ci veut, selon le mot fameux de Marx, transformer le monde et non plus seulement le comprendre. Le socialisme est une idée neuve pense Sorel. Il a cette jeunesse qui refuse les programmes et les idées claires et distinctes. Enserré dans un discours, il perd toute vitalité. Il devient vieux, identique à ses adversaires. Le socialisme est une idée en actes, c'est un produit spontané. Il est évident que ce socialisme-là n'a que peu de rapport avec les partis sociaux-démocrates actuellement existants dans les "démocraties occidentales". Le seul commun dénominateur est ce nom de "socialisme". Quant au reste...
Un socialisme étranger au monde des sophistes, des économistes et des calculateurs
Nous avons rappelé l'hypothèse de Sternhell selon laquelle Sorel est un penseur de la "Révolution moraliste". Polin le rappelle, Sorel est un "pessimiste par tempérament". Ainsi pour lui, le progrès traduit avant tout une notion bourgeoise. Il est contre Hegel et pense que "la nature humaine cherche toujours à s'échapper vers la décadence". L'homme est soumis à la loi éternelle du combat. Il doit éviter les obstacles que lui oppose la nature et sa nature elle-même (veulerie, lâcheté, médiocrité, etc.). Le grand danger de l'entropie guette l'homme. Sorel écrit : "Il est vraisemblable que les collectivités soient attirées vers un magma assez compliqué et dont la base serait le désordre". La violence révèle alors cette énergie créatrice qui combat l'entropie.
Sorel est un philosophe de l'énergie. L'homme, pense Sorel, se satisfait d'un sentiment de lutte. Dans cette optique, l'effort est plus que positif, recherché comme une fin en soi. La violence donne à l'homme une énergie salvatrice qui le retient d'être médiocre (Polin compare l'énergie sorélienne exprimée par la violence au thumos stoïcien). L'homme, par la violence émergée de son individualité créatrice, rejoint ultimement la morale. La violence est la forme permanente de la morale. La morale est donc une lutte contre l'entropie appauvrissante. On peut encore se référer à Nietzsche. La nouvelle table de morale du philosophe allemand est proche des valeurs de lutte et de dépassement que Sorel réclame des ouvriers.
Morale égale chez Sorel à sacrifice de soi, abnégation, héroïsme, désintéressement, effort. L'ouvrier est le guerrier romain, le conquérant du XXe siècle ; il doit posséder les qualités morales qui l'ennoblissent et lui assurent sa supériorité face à la bourgeoisie. Sorel parle avec sympathie de cette race d'hommes "qui considère la vie comme une lutte et non comme un plaisir". Ses maîtres-mots sont : énergie personnelle, énergie créatrice, énergie agissante. Ce type d'homme est élève du guerrier grec. Il refuse le monde des intellectuels qui l'affaiblit. Comme E. Burke, il est étranger au monde des sophistes, des économistes et des calculateurs. Et Sorel va plus loin quand il écrit : "Le sublime est mort dans la bourgeoisie" et ce sublime est l'apanage de la violence dans l'histoire. C'est la source de la morale révolutionnaire. Le syndicat renoue avec un monde de la morale, donc du sublime et de l'héroïsme. C'est un lieu, une école de moralisation collective. Le syndicat est autonome et sa morale est une conception du monde totale.
Mais Sorel est un apôtre de la violence parce qu'il croit dans la figure nouvelle du Travailleur. Sorel identifie pour nous le travail. Il récuse la dichotomie guerre/travail d'Auguste Comte. Le travail est une œuvre créatrice qui ne se plie pas au fond aux calculs sordides des capitalistes. Le travail est désintéressé. Comme la violence. La grève générale est aussi un acte libre de toute recherche de profits matériels. De même, Polin ressent la notion du travail comme une lutte à part entière. Le travail est, dans l'intuition de Sorel, un acte prométhéen. Le travail n'est pas seulement action de transformation sur les choses, il rétro-agit sur soi-même et la collectivité tout entière. La violence ennoblit la conscience du travail ; en d'autres termes, elle donne forme à l'œuvre de création et de transformation.
Le travail, qui n'est pas un simple "facteur de production" comme le prétendent les penseurs (?) et les économistes de l'école libérale, ni une source de profit pour le travailleur et de plus-values pour les entrepreneurs comme le croient les marxistes stricto sensu, est une forme sublimée de création. Il est bien évident que la violence sorélienne est une qualité qui est propre au monde des producteurs ; la réduction de la violence à une domination de l'homme par l'homme est le contraire de cette violence prolétarienne de Sorel. Sorel ajoute même qu'au cœur du travail lui-même, on trouve la violence comme moteur intime. Les notions sont ainsi reliées entre elles : Travail, Violence, Morale. Et le socialisme est ensuite le résultat de cette "vertu qui naît" (Réflexions...). Le travail est une lutte, où le producteur est soulevé par une violence absolue, et dont découle l’acte créateur historiquement.
La violence, antidote aux bassesses d'âme
Pour Sorel, il est évident que cette émergence du socialisme de la violence se fera au détriment du vieux monde bourgeois. Si la violence est une notion positive parce que créatrice, il faut qu'elle s'attende à des oppositions farouches. Sorel se propose de délimiter le territoire du conflit et de situer l'ennemi en face. La civilisation, c'est l'ennemi n°1 du socialisme naissant, ennemi qui s'appuie sur 2 autres instances du vieux monde : la démocratie et l'État. Les troupes qui défendent ces citadelles sont variées et quelquefois ennemies en apparence : c'est le camp de la bourgeoisie (libéraux, radicaux, partisans du capitalisme pur et dur, droite conservatrice) et des pseudo-socialistes (les membres responsables des partis réformistes, la "gauche" démocratique, les progressistes de toutes tendances).
Derrière ces abstractions (démocratie, civilisation, État), Sorel combat inlassablement les mêmes valeurs communes aux idéologies de la médiocrité. Il y a chez Sorel le sens de la guerre culturelle, du combat des valeurs. Il ne croit pas aux étiquettes que le discours bourgeois aime attribuer aux acteurs de son jeu. Les mots dans le jeu politique ne sont souvent que des apparences. Sorel cherche à fouiller les racines des discours. Être "socialiste" ne signifie rien si on n'est pas conscient d'une conception du monde en rupture avec la société marchande. Paresse, bassesse, hypocrisie, incompétence, veulerie, sont des traits communs aux partis officiels.
La violence sorélienne est en effet très consciente de l'enjeu réel et historique de la lutte. Les non-valeurs, qui asservissent les producteurs et lui ôtent toute liberté, sont concentrées dans la conception économique de l'homme, que les maurrassiens ont appelé "l'économisme". Les principes de cet économisme sont au nombre de 2 : la croyance au progrès matériel, la réduction de l'homme à des valeurs matérialistes. L'homme bénéficie en même temps que le confort matériel d’un "confort" intellectuel. L’homme est un énorme estomac, destiné à la soumission sociale et politique. La société de consommation est alors le plus grand camp de normalisation intellectuelle. On peut penser que la violence sorélienne aurait été en en état de rupture avec le monde occidental, et tout ce que ce monde charrie derrière lui. De la même façon, il aurait du mal à se reconnaître dans certaines critiques progressistes de la société de consommation, dont le fondement réside dans une exigence encore plus grande de confort. La philosophie du bonheur est anti-sorélienne et Marcuse serait considéré par Sorel comme un cas typique d'utopisme bourgeois. L'homme qui réclame la fin du travail, qui refuse la lutte, qui conteste la guerre sociale, cet homme que nos philosophes des années 70 appellent de tous leurs vœux, n'a que de très lointains rapports avec le producteur à la mentalité guerrière des Réflexions sur la violence.
Les illusions du progrès
Quant au "progrès", Sorel a senti le besoin de lui consacrer un ouvrage entier tant il lui a semblé que ce concept était un fleuron de la mentalité bourgeoise. Il s'agit des Illusions du progrès. L'illusion suprême d'un paradis terrestre retrouvé à la fin des temps provoque chez Sorel une réaction épidermique. Le pessimisme sorélien est la conclusion d'un constat : l'homme ne change pas fondamentalement. Sorel approuve les actes de progrès matériels mais il s'agit chez lui d'une admiration pour la "créativité" dont ces actes sont les manifestations. De la même façon, il croit au prolétariat non pas comme Marx croyait à la "classe élue de l'histoire" mais parce qu'il constate que la bourgeoisie n'a plus l'énergie de mener la lutte éternelle.
L'histoire est pour Sorel une succession d'énergies manifestées dans des groupes restreints. Le capitaine d'industrie est une figure positive. Ce n'est plus qu'une idée à son époque. En outre, les valeurs marchandes sont des valeurs de dégénérescence. Partir en guerre contre la société moderne (entendez marchande) est un point commun de Sorel et de Maurras. La haine du bourgeois, écrit Polin, est un point de rencontre entre l'Action Française et Sorel. C'est une classe sans volonté, sans honneur, sans dignité. Le régime démocratique lui convient parce qu'il conserve, non parce qu'il est source de création. Sorel parle durement de la bourgeoisie puisqu'il constate chez elle "une dégradation du sentiment de l'honneur".
Cette démocratie, Sorel la vitupère, il écrit : " (la démocratie) est le charlatanisme de chefs ambitieux et avides" (Réflexions…). Peu importe que cette démocratie soit conservatrice ou populaire, elle conserve et favorise la même décadence. Les socialistes démocrates sont des "politiciens épiciers, démagogues, charlatans, industriels de l’intellect". En outre, non contents de maintenir le peuple sous un régime oppressif (où sont les libertés des ouvriers travaillant 16 heures/jour, 6 jours/7 ?). La démocratie établit le règne de l’argent. C’est une tyrannie, une tyrannie ploutocratique, dirigée par des hommes d’argent, qui veulent préserver leurs intérêts propres. Sorel écrit : "Il est probable que leurs intérêts sont les seuls mobiles de leurs actions". Quant aux responsables de l'Internationale Ouvrière, Sorel les dénonce comme des apprentis dictateurs. Leur objectif est l'instauration d'une "dictature démagogique".
Sorel ne veut pas d'un socialisme d'État. Il manifeste dans sa critique de l'État des tendances anarchisantes, fort peu compatibles avec la dictature d'État du prolétariat désirée par les marxistes. L'État (même socialiste) est un "État postiche", porteur d'une "merveilleuse servitude". L'État démocratique s'achève dans l'histoire avec les massacres de septembre. Et ce que C. Polin appelle, comme Sorel, "le cortège idéologique" de la démocratie (droits de l'homme, humanitarisme, charité, pacifisme, etc.) ne change rien au caractère oppressif de ce régime. Sorel est l’auteur d'une phrase célèbre sur la démocratie : "La démocratie est la dictature de l'incapacité" (Réflexions…). Deux mots nous frappent : la dictature, l'incapacité.
La critique anti-démocratique de Sorel ne doit pas être confondue avec l'idéologie réactionnaire du courant autoritaire ni avec le discours conservateur de l'Ordre-pour-l'Ordre. D'ailleurs, on voit bien chez Sorel un rejet des 2 camps : le camp de la bourgeoisie, où la lâcheté domine, et celui du social-réformisme mené par la corruption. Sorel croit en la lutte des classes. Ce qui le rend irréductible aux étiquettes conservatrices et social-démocrates. La violence qui manifeste cette lutte des classes est aussi un facteur d'énergie en action. Comme Pareto, il croit que la lutte des classes accouche de nouvelles élites sur les cadavres des classes déchues. La paix sociale est pour Sorel l'état d'entropie sociale absolu. Pourtant, Sorel ne peut être marxiste parce qu'il n'adhère pas à la vision finaliste du monde de Marx. La lutte est une activité normale de l'humanité. Elle n'a pas de sens, si ce n'est celui de faire circuler les élites dans l'histoire. En résumé, la violence est porteuse d'un projet de création en devenir infini, porteuse d'une conception morale de la vie, source d'une organisation des producteurs.
*** III. Conclusions ***
Dans son introduction aux Réflexions, Sorel écrit : "Je ne suis ni professeur, ni vulgarisateur, ni aspirant chef de parti ; je suis un autodidacte qui présente à quelques personnes les cahiers qui ont servi pour sa propre instruction". Les Réflexions constituent donc un ensemble de constatations pratiques. Sorel le répète : il ne veut pas faire une œuvre universitaire. C'est plutôt une pédagogie à l'usage des syndicalistes libres, qui sont prêts à recevoir un message révolutionnaire.
La violence sorélienne est la dimension purement morale et créatrice du socialisme de Sorel. Le message de Sorel est que le socialisme n'est pas un programme politique, ni non plus un parti politique. Le socialisme est une révolution morale ; en d’autres termes, le socialisme est d'abord un bouleversement des mentalités. On pourrait parler à la limite de "révolution spirituelle". Et la violence informe ce brutal changement dans les âmes. Le socialisme sans la violence n’est pas le socialisme. Seule l'utilisation de la violence assure une révolution positive. Sorel ne reconnaît pas dans les événements de la Révolution française une violence créatrice. Il rejette tout ce qui vise à détruire pour le plaisir de détruire. La violence donne au socialisme la marque de sa noblesse. Elle constitue une valeur essentielle de l’organisation progressive et indépendante des producteurs.
Il est certain que, pour nous, le socialisme n’est pas un discours rigide. Nous ne voulons pas reconnaître dans la social-démocratie un régime ou une idéologie socialiste. Le socialisme n’est pas un ersatz bâtard du libéralisme occidental. Les régimes occidentaux qui se réclament aujourd'hui du socialisme sont, à l'exception peut-être de l'Autriche en matière de politique internationale, des compromis honteux, ou "heureux", de social-libéralisme (à ce sujet, lire dans Le Monde Diplomatique de février 1984, l'article intitulé "Un socialisme français aux couleurs du libéralisme"). Sorel avait pressenti cette involution vers un discours mixte, où socialisme et libéralisme feraient "bon ménage"...
Le socialisme de Sorel n'est pas un compromis. Il se présente comme une révolution culturelle. Son objectif n'est pas de gérer le capitalisme par un nouveau partage du pouvoir (quelles différences entre un technocrate de gauche et de droite ?) mais de poser les vraies valeurs de la révolution. La violence est un garant de la fidélité aux valeurs révolutionnaires. Il ne s'agit pas de casser des vitrines des grands magasins ni de pratiquer une violence terroriste. La vraie violence consiste à renverser les tabous. Il faut dénoncer les blocages intellectuels de l'Occident. Il ne faut pas hésiter à remettre en cause le système. Voilà la vraie violence de Sorel : autonomie intellectuelle... Alors, Sorel, une alternative radicale ?...
00:11 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, socialisme, violence |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 01 mai 2008
Warum 1.Mai-Kampftag?

Warum 1.Mai-Kampftag?
Zu Beginn des Zeitalters der Industrialisierung war die Situation für das arbeitende Volk wenig erfreulich. Die Unternehmer und das Kapital bestimmten die Bedingungen, zu denen gearbeitet werden durfte. Es gab keinen bezahlten Urlaub, keine Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, keinen Kündigungsschutz, keine tarifliche Bezahlung, keine geregelten Arbeitszeiten, keine Absicherung für den Fall der Arbeitslosigkeit, keinen Arbeitsschutz. Stattdessen Unterbezahlung, Arbeitszeiten bis zu 18 Stunden, Kinderarbeit und ein elendes Dasein in Baracken und Mietskasernen. Je weiter die Industrialisierung fortschritt, desto mehr nahm auch die soziale Verelendung des arbeitenden Volkes zu. Ein typisches Merkmal des Kapitalismus. Nur langsam und unterdrückt durch gewaltsame Abschreckungsmethoden der Betriebe formierten sich Interessenvertretungen, um diese unsozialen Verhältnisse zu ändern. Aber wie jede Bewegung, die vom Volk ausgeht, war auch diese nicht zu stoppen. Auf einem internationalen Arbeiterkongreß im Jahre 1889 in Paris wurde beschlossen, daß an einem bestimmten Tag in vielen Ländern und in vielen Städten das arbeitende Volk auf die Straße gehen soll mit der Forderung einer Arbeitszeitverkürzung. Dies sollte der 1.Mai 1890 sein. Von einer jährlichen Wiederholung war zunächst keine Rede. Die Mobilisierung für den 1.Mai 1890 stieß auch im Deutschen Kaiserreich auf große Begeisterung. Nicht allerdings bei der SPD, die aus Furcht vor einer Verlängerung des "Sozialistengesetzes" vom geplanten Generalstreik abriet. Die SPD, die sich bis heute so gerne als Arbeiterpartei darstellt, hatte damals also ihre eigenen Interessen über die Interessen des arbeitenden Volkes gestellt. Nicht zum letzten Mal. Auch die Unternehmer bereiteten sich auf den 1.Mai vor. Sie gründeten am 1.April 1890 in der Hamburger Börse den Arbeitgeberverband. Ziel war die Zerschlagung des Streiks und die Aussperrung der Streikenden. Doch auch die Unternehmer konnten die Entwicklung für sozialere Arbeits- und Lebensverhältnisse nicht aufhalten.
Hamburg als Schwerpunkt des Arbeitskampfes
Schon in der Mobilisierungsphase wurde deutlich, daß Hamburg zu einem der Schwerpunkte des Widerstandes werden würde. Hamburg lag mit 133 Mobilisierungsveranstaltungen an der Spitze, wobei 33 dieser Veranstaltungen sogar mehr als 10.000 Besucher gehabt haben sollen. Am ersten Kampftag des arbeitenden Volkes streikten in Deutschland rund 100.000 Arbeiter und nahmen stattdessen an Demonstrationen teil. Davon rund 20.000 – 30.000 alleine in Hamburg. Die Arbeitgeber reagierten mit Aussperrung von fast 20.000 Hamburgern. Die Streiks und Aussperrungen wurden über 10 Wochen aufrecht erhalten. Daß die Arbeitnehmer so lange durchhalten konnten, lag an der gewaltigen finanziellen Streikunterstützung. Um den Arbeitskampf in Hamburg – wo die meisten Arbeiter betroffen waren – durchzufechten, wurden aus Solidarität in allen anderen Städten die Streiks frühzeitig beendet und die restlichen Streikgelder nach Hamburg geschickt.
Es sollte jedoch noch bis in die 30er Jahre dauern, ehe sich die Arbeits- und Lebensverhältnisse des arbeitenden Volkes grundlegend besserten. Soziale Errungenschaften von damals auf der Grundlage der Bismarckschen Gesetze wurden nach dem Zweiten Weltkrieg in der BRD übernommen. Jedoch in einem System, wo das vom Volk erwirtschaftete Geld von den etablierten Versagerparteien in alle Welt verschleudert wird, lassen sich auch die besten sozialen Absicherungen langfristig nicht finanzieren.
Niedergang der erkämpften Rechte und Absicherungen
Mit wachsender Mißwirtschaft, Überfremdung und Internationalisierung wurden soziale Errungenschaften systematisch wieder abgebaut. Auf Geheiß der immer globaler werdenden Wirtschaft haben die Politiker mittlerweile unsere Hoheitsrechte an EU und Welthandelsorganisation abgetreten, dem weltweiten Freihandel Tür und Tor geöffnet und nationale Schutzmechanismen für soziale Arbeitsbedingungen ausgehebelt. Die Überreste der bodenständigen deutschen Wirtschaft sind einer hemmungslosen Konkurrenz aus aller Welt ausgesetzt, die Grundversorgung des Volkes vom Wasser über Strom bis zur Infrastruktur wird in die Klauen profitgieriger Multikonzerne hineinprivatisiert, wer keine lebenserhaltende Vollbeschäftigung findet wird in kürzester Zeit zum Sozialfall und kann nur noch zwischen totaler Verelendung oder Minijob-Versklavung wählen. Immer mehr ausländische Konzerne machen sich in Deutschland breit, die Arbeitnehmer nicht mehr nach deutschen Arbeitsgesetzen sondern zu ihren eigenen Bedingungen beschäftigen. Kurzum: Wir haben heute schon fast wieder die unsozialen, ausbeuterischen Verhältnisse erreicht wie zu Beginn des Zeitalters der Industrialisierung! Allerdings verschlimmert um die globale Komponente, denn die Kapitalisten und ihre Marionetten in der Politik haben sich im Gegensatz zu damals inzwischen von den Nationalstaaten gelöst und überstaatlich organisiert, um ihre Macht über die Völker noch unkontrollierbarer auszubauen.
Eine andere Welt ist möglich: Mit nationalem Sozialismus!
Nur ein nationaler Sozialismus kann eine andere Welt möglich machen: Eine Welt der freien Völker und der souveränen Volkswirtschaften. Nur eine nationale und sozialistische Volkswirtschaft kann das Kapital zugunsten des Volkes bändigen und soziale Arbeitsbedingungen schaffen. Nur ein nationales und sozialistisches Gesellschaftsmodell kann gewährleisten, daß alle Deutschen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft die gleichen Zukunftschancen in einer klassenlosen Volksgemeinschaft haben, wo nicht Geld und Stände zählen, sondern Fleiß und Begabung.
Die Rechte des arbeitenden Volkes werden von diesem System, der EU und allen globalen Zwangsbündnissen mit Füßen getreten! Das lassen wir uns nicht gefallen! In der Tradition des 1.Mai-Kampftages fordern wir Arbeit und soziale Gerechtigkeit für alle Deutschen!
Gemeinsam gegen Globalisierung! Gemeinsam für ein freies, soziales und nationales Deutschland!
00:04 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : socialisme, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook





