« Le courage de changer ce qu’il est possible de changer, la force de supporter ce qu’il est impossible de changer et surtout l’intelligence pour discerner l’un de l’autre. »
Saint François d’Assise.
Je t’écris cette lettre, tu la liras peut-être si tu en as le temps.
Mince alors ! En traçant ces lignes, je me rends compte que je commence mon courrier comme débute la chanson « le déserteur » de Boris Vian. Pourtant, crois-moi, je n’ai nullement envie de déserter notre vieille maison commune le PS, même si aujourd’hui elle m’apparaît ressembler au « grand corps à la renverse » dont parlait Sartre. Mais Sartre s’étant trompé sur tout, l’espoir nous est donc permis…ouf ! J’ai d’autant moins envie de fuir notre Parti que je t’adresse une série de propositions qui, je pense, pourraient peut-être nous permettre de retrouver nos racines.
Permets-moi d’insister, ce qui va suivre ne concerne que le PS bruxellois, je ne connais pas assez la situation en Wallonie pour me prononcer à son sujet. Je ne peux cependant m’empêcher d’évoquer la situation de la social-démocratie en Europe, car selon une formule classique en politique belge « tout est dans tout et inversement. »
Cher Elio, le dossier publié récemment par « le Vif » provoque de nombreuses interrogations, des doutes, des remous, décille les yeux. Pourtant, il ne fait que la synthèse de ce que j’observe depuis longtemps. Nombreux sont ceux que je rencontre qui estiment que l’article, pourtant déjà très interpellant, est bien en dessous de la réalité. Tous me disent leur malaise devant l’évolution de la fédération à la fois quant au mode de fonctionnement interne, plus particulièrement, quant à son évolution idéologique au niveau de la défense des valeurs constituant la colonne vertébrale du Parti et, de façon symptomatique la laïcité.

Merry Hermanus
CE QUE L’ON N’A PAS VOULU VOIR !
Démographie et Géographie sont des éléments évidents, déterminants, simples à observer, s’imposant de facto à tout décideur politique ou économique, pourtant nombreux sont ceux à Bruxelles qui ne prennent conscience « des terrifiants pépins de la réalité » qu’avec un étonnant retard. Pourtant, si une chose est bien faite en région bruxelloise, ce sont les statistiques. Certains, depuis longtemps croisent les données fournies par Actiris, la région, le ministère de l’intérieur, la Santé etc. Ce qui se produit depuis dix ans à Bruxelles est une véritable explosion démographique, laquelle se poursuit encore aujourd’hui. Les conséquences sont multiples, souvent catastrophiques vu l’absence de perspectives et de prévisions. Or, beaucoup de ces désagréments étaient évitables. Mais force est de constater que malgré notre présence quasi permanente à la tête de la région depuis 1988, rien n’a été entrepris, rien n’a été anticipé ! Il est inutile d’accabler les individus mais il faut rappeler que Picqué, disposant d’un charisme exceptionnel et d’une présence au pouvoir d’une durée tout aussi exceptionnelle, n’a rigoureusement rien fait, se contentant de commander une multitude de plans aussi divers que variés…et coûteux ! Rudi ss, en six mois de présence, malgré un environnement insidieusement hostile à la tête de l’exécutif, sans tambours ni trompettes a été plus efficace que Picqué en vingt ans.
POURQUOI CETTE NON GESTION ?
Indépendamment de facteurs personnels liés à la personne du ou des ministres présidents qui se sont succédé, se contentant de durer plutôt que de gouverner et prévoir, la vraie question est de savoir si la région de Bruxelles est institutionnellement gouvernable.
L’invraisemblable usine à gaz mise au point par Dehaene et Moureaux ne pouvait fonctionner que sur base d’une loyauté régionale réciproque entre Néerlandophones et Francophones. Or, les ministres flamands ont dès le début été très clairs, leur loyauté était d’abord et avant tout flamande. Certains de ces ministres ont été d’une particulière franchise en ce domaine, franchise assez rare en politique pour être soulignée. A de très nombreuses reprises, Brigitte Grouwels, ministre CVP a lourdement insisté pour souligner son lien indéfectible à la Flandre et le fait que Bruxelles n’avait qu’à se soumettre ! Que dire alors de son attitude en conseil des ministres. D’autres, plus hypocrites, ont eu la même attitude. Comment dans ces conditions tenter la moindre gouvernance avec un exécutif composé de huit ministres, dont trois Néerlandophones dont chacun peut bloquer en totalité le fonctionnement d’une tuyauterie crachoteuse. Le gouvernement est donc constamment coincé entre des exigences ou des blocages flamands et les élucubrations stupides de l’un ou l’autre ministre comme Smet n’hésitant pas à forcer la décision pour obtenir l’érection d’une piscine sur le canal, mobilisant ainsi vingt-cinq millions d’euros ! On y échappera de justesse. Une analyse fine des ordres du jour du gouvernement suffirait à démontrer la triste vacuité de son fonctionnement.
A cela s’ajoutent les aléas du mille-feuilles institutionnel bruxellois. La région compte un peu plus d’un million cent cinquante mille habitants, elle se découpe en dix-neuf communes, dix-neuf CPAS, plusieurs dizaines de sociétés de logement sociaux, un parlement de quatre-vingt-neuf députés ( sur l’élection desquels je reviendrai ) une VGC, une COCOM, une COCOF, une multitude d’O.I.P économiques ou sociaux… et j’en oublie. La région pourrait gagner pas mal d’argent en faisant breveter son puzzle institutionnel, en le commercialisant comme ce fut le cas du Monopoly en 1930 ; certain qu’il y aurait là une niche à exploiter ! Tout observateur objectif ne peut que conclure que l’usine à gaz est bonne pour la casse, plus rien ne fonctionne correctement, tout le monde le sait, tout le monde le constate…mais nombreux sont ceux qui en vivent. L’exemple du cadre linguistique de la région est emblématique, cassé pas moins de trois fois en suivant par le Conseil d’Etat, il fut chaque fois représenté quasi tel quel par le gouvernement bruxellois dans la mesure où les Flamands exigent une part de 29,77% des emplois alors que cela ne correspondait nullement aux comptages des dossiers effectués en vertu de la loi ! Comment dans ces conditions exiger le dynamisme de la fonction publique régionale. Mais voilà, la petite classe politique bruxelloise vit… et fort bien, de ce fouillis d’institutions disparates mais juteuses. Comment demander à cette foule d’élus de toutes sortes, communaux, sociaux, régionaux, mandataires de généreux OIP de se faire hara-kiri ? Impensable ! Mais en attendant…
LA PAUPÉRISATION.
Il y a un étonnant parallèle à faire entre le bourgeonnement, l’incroyable foisonnement institutionnel de Bruxelles et l’évolution des revenus dans la région. Les courbes sont parfaitement inverses, plus les institutions régionales se multiplient, se diversifient, plus la courbe des revenus des habitants de la région s’effondre ! La part bruxelloise dans le PIB national s’est effondrée. L’analyse des statistiques, quel que soit le domaine, démontre une paupérisation qui se lit à l’œil nu dans les différents quartiers de la région. Les Bruxellois sont de plus en plus pauvres, les problèmes sociaux s’accumulent, s’aggravant année après année, se multipliant sans cesse. Depuis la fin des années septante, la classe moyenne payant l’impôt a voté avec ses pieds, quittant la région. Elle a été remplacée par une population d’infra-salariés, d’assistés sociaux à l’avenir professionnel de plus en plus problématique. On objecte toujours à cela le taux de création d’emploi, le plus élevé du pays… ce qui est exact. Mais les Bruxellois n’en bénéficient pas ! Il y a près de sept cent cinquante mille emplois à Bruxelles, plus de deux cent mille sont occupés par des Flamands et plus de cent cinquante mille par des Wallons. Ces navetteurs génèrent des coûts considérables pour la région… mais payent leurs impôts dans la commune de leur domicile. Si on recourt à une analyse plus fine, il apparaît que les cadres supérieurs sont majoritairement des navetteurs. Pour nettoyer les bureaux, il reste des Bruxellois !
Les derniers chiffres du baromètre social bruxellois synthétisent parfaitement ces questions. On y découvre que près d’un tiers des Bruxellois vit sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 1085 euros par mois. La moyenne belge se situe entre 14 et 16 %. Donc à Bruxelles, c’est près de trois fois plus de gens qui se trouvent sous ce seuil fatidique. Or, ces statistiques prennent en compte : les revenus, le travail, l’instruction, la santé, le logement et la participation sociale. Si le PIB à Bruxelles est de 61.899 euros pour 26.183 en Wallonie et 35.922 en Flandre, ce n’est que parce que 50 % de emplois sont occupés par des navetteurs. Enfin, et cela n’étonnera personne, 23,50 % des Bruxellois perçoivent une allocation ou un revenu de remplacement ; ce chiffre est en progression de 1,6 % par rapport à 2013. Le pire est que cette chute vertigineuse des revenus bruxellois se poursuit sans discontinuer depuis les années septante. Jamais on n’a pu observer le moindre redressement. Une véritable descente aux enfers…Mais qui n’émeut personne. Les exécutifs se succèdent, les ministres se suivent tout sourire, les programmes électoraux s’effeuillent, les promesses se multiplient… s’envolent… mais la seule courbe de croissance est celle de la misère ! Une question doit se poser, cette région telle qu’elle est institutionnellement constituée est-elle gouvernable ? Est-elle viable ? La réponse, évidente pour tous, est clairement non !
Cette situation n’a pas seulement un impact social, elle y a aussi d’importantes conséquences urbanistiques. La région est structurée, façonnée, dessinée, et cela se comprend, pour faire face à cette arrivée journalière de ce flot de Flamands et de Wallons ; charge considérable pour Bruxelles, sans commune mesure avec les contreparties chichement concédées à la région par le fédéral qui plus est, les oriente souvent sans tenir compte des intérêts bruxellois. Il n’est pas rare que des mandataires bruxellois s’entendent dire par des auteurs de projet désignés souverainement par le pouvoir fédéral : « il faut que vous bruxellois commenciez à vous adapter ! » Ah ! bon s’adapter mais à quoi ! Oserai-je le penser…à une administration d’occupation !
Posons-nous la question de savoir pourquoi il n’y a pas à Bruxelles de péage comme à Londres ou à Stockholm ? Ce sont de splendides réussites. La région de Bruxelles est le cas typique où cela devrait être appliqué ! Eh bien non ! Cela déplaît. Pardi, on l’aurait juré. Ni les Flamands, ni les Wallons n’en veulent !
Comment ne pas évoquer certains aménagements aberrants. Mais dans la mesure où le pouvoir à Bruxelles est parcellisé, il n’y a pas de dialogue, le rapport de force étant toujours défavorable aux bruxellois.
Quand la ville de Bruxelles décide de faire un piétonnier, l’impact sur toute la région est évident… mais dans les autres communes pourtant largement influencées par cette décision, on fait autre chose, on regarde ailleurs ! Le bourgmestre de Bruxelles n’a pas de véritables interlocuteurs.
Les chiffres du chômage, même flattés, ne laissent aucun doute, non seulement sur la paupérisation mais, et c’est beaucoup plus grave, sur sa perpétuation, sa constante augmentation. Le taux de chômage est le plus élevé à Bruxelles, pour ce qui concerne le chômage des jeunes il atteint l’effroyable record de 30 %, 40 s’il faut croire les chiffres du VOKA. Ne soyons pas dupes, les baisses dont il est question récemment sont le fruit des dernière mesures gouvernementales, sur lesquelles je n’ai pas le cœur de m’appesantir… il « saignerait ! » Je n’évoque pas le chômage des femmes dans ces mêmes quartiers, il dépasse les 45 %.

On le sait, en démocratie il y a deux légitimités. D’abord celle des urnes, le suffrage universel. A Bruxelles, ces principes fondamentaux sont clairement violés, le nombre de voix pour élire un Néerlandophone est nettement inférieur à celui nécessaire pour élire un Francophone. Résultat, parmi les élus flamands certains le sont avec quelques centaines, voire quelques dizaines de voix… et deviennent ministres alors qu’ils ne sont les élus que d’un nombre infime d’électeurs de la région. Peut-on encore parler de légitimité ? Les élus flamands au parlement bruxellois ont moins de légitimité démocratique que le gagnant d’un concours de la télé-réalité. Mais il est un autre critère de légitimité, celui-ci beaucoup plus subtil, c’est celui de la réussite dans l’action. Or, on l’a vu, la région est sinistrée au plan social, la courbe est descendante depuis les années septante, le tissus urbain se dégrade sans discontinuer, la mobilité est chaotique, l’engorgement est généralisé et fait rire l’Europe, la paupérisation galopante, l’enseignement sinistré, l’insécurité croissante etc. De cette légitimité là aucun politique bruxellois ayant siégé dans l’exécutif ne peut se prévaloir. Peut-on en vouloir aux citoyens qui se désintéressent, se détournent de la vie politique, rejoignent la horde grandissante clamant le « tous pourris, tous incapables. »
Ne serait-ce l’étonnante médiocrité parfois jusqu’au pathologique des rares représentants de l’extrême droite, le triomphe serait lui assuré. Un journaliste de « Libération » a, il y a quelques temps osé faire publiquement ces constatations … quels cris, quel scandale… c’était pourtant la triste vérité.
Bien sûr on dessine sur le sol des voiries, des pistes cyclables, les communes élaborent des plans de circulation aberrants, les bobos seront comblés, il y a les stupides journées sans voiture. L’idéal de certains n’est-il pas de faire de Bruxelles une réserve d’indiens, d’indiens pauvres, assistés socialement, ficelés électoralement, habillés de lin écru, mangeant des légumes bio, déféquant dans des toilettes sèches, se déplaçant à vélo, n’utilisant pas de GSM, végétaliens et surtout ne se reproduisant pas… on viendra les voir en car comme les Flamands le font déjà qui visitent avec un guide, prudence quand même, le quartier maritime de Molenbeek ou Matonge ! « Pensez donc, beste vrienden, à une heure de Gand, à quarante-cinq minutes d’Anvers, l’exotisme, le pittoresque chaleureux, bruyant de l’Afrique à Matonge ; le frisson de l’inquiétante Casbah à Molenbeek, l’étrangeté des femmes voilées, les hommes barbus en djellaba…comme là-bas dis…, tout un monde. N’oubliez pas de bien vous laver les mains en rentrant à Gand ou à Anvers…dans ces coins de Bruxelles, on ne sait pas ce qu’on peut y rencontrer ! Ebola, malaria, maladies tropicales, djihadistes » Ah ! Un détail, oh ! une toute petite chose, ils vivront de quoi ces « indiens » Bruxellois… oui au fait, de quoi vivront-ils ? A moins que les visiteurs les plus audacieux ne leur lancent , « à ces sujets de zoo humain, » quelques trognons de maïs…quelques chèques repas…les voir manger pourrait être drôle non !
ET LE PS !
Le malaise est perceptible partout. D’abord il y a le doute, peut-être le mensonge lourd, irrémissible ; chacun sait que le leadership est assumé par quelqu’un qu’on accuse, à tort ou à raison, de ne pas réellement habiter à Bruxelles, qui donc ne respecterait pas un aspect essentiel de la vie politique, à savoir, subir ce que vivent ceux qu’on est sensé représenter, défendre. Ce doute a déjà été lourd de conséquence, il le sera encore demain ! La relation avec le citoyen en est dès l’abord viciée. Il s’agit là d’une faute impardonnable, inconcevable. Elle n’est possible que parce que les militants, force d’impulsion, de proposition mais aussi de contrôle, n’existent plus.
Pendant des décennies, les listes électorales étaient établies sur base de pools. C’était connu de tous, les tricheries ne manquaient pas, les uns bourraient les urnes, les autres modifiaient les scores. Néanmoins, les formes étaient respectées, la démocratie restait un objectif…parfois lointain, j’en conviens ! On ne pouvait pas tout se permettre ! Ensuite vinrent les comités des sages puis s’abattit l’obscurité totale, le rideau de plomb ; une étonnante alchimie préside maintenant à l’élaboration des listes d’élus ; il n’est plus question de comité des sages mais d’un comité secret, c’est là qu’on agite le shaker d’où sortira le breuvage qui sera servi aux électeurs. Les résultats sont connus d’avance, la bouillabaisse comprenant une dose massive de Belges issus de l’immigration, logique vu la démographie de la population et de filles ou de fils de…ainsi naît sur les navrants décombres d’une idéologie une nouvelle aristocratie, dont les fiefs sont constitués d’une masse d’électeurs d’origine étrangère, un cheptel sur lequel on règne sans vergogne. Moderne féodalité… totale rupture avec une idéologie à l’allure d’astre mort ! La presse avait relevé lors des dernières élections cette présence massive des fils et filles de, mais les journalistes ne les avaient pas tous repérés, certains liens de parenté étant plus discrets ou mieux dissimulés, dans certains cas le nom de la mère était connu mais pas celui du père, de plus il fallait en outre tenir compte des compagnons, compagnes, nièces ou neveux. Qui osera encore dire qu’à Bruxelles le PS n’aime pas la famille, étonnant que la présidente fédérale n’ait pas été invitée au dernier synode de Rome consacré à l’avenir des familles, cette parole experte a manqué ! Il faut être de bon compte, les dynasties politiques ont toujours existé, y compris au PS, il suffit d’établir les liens entre les familles Spaak et Janson. C’est par son caractère massif que le phénomène à Bruxelles est devenu remarquable et grignote le fonctionnement à long terme du parti qui, de fait, devient ce que l’on connaît bien en Afrique, une addition de clans. Amusante, révélatrice d’ailleurs cette importation des mœurs politiques subsahariennes. Les conséquences sont multiples, à commencer par le fait que des candidats potentiels de grande qualité, n’étant ni d’origine maghrébine, n’ayant aucun lien de parenté avec l’un ou l’autre des leaders de la fédération, estiment qu’ils n’ont pas la moindre chance d’être à une place où ils auraient une petite chance d’être élus ! Ceux-là partent, disparaissent ; ils planquent comme hauts fonctionnaires mais ils manquent cruellement à notre action politique. Anne Sylvie Mouzon, excellente parlementaire avait l’habitude de dire que sur l’ensemble du groupe socialiste seuls quatre ou cinq individualités étaient actives ! Les autres, bof…
J’évoquais une nouvelle aristocratie, en ce sens l’interview de Catherine Moureaux dans « Le vif » est emblématique tant ses réponses sont d’une stupéfiante naïveté, à les lire on éprouve un sentiment de compassion pour cette jeune femme s’exprimant avec tous les tics de langage communs à la haute bourgeoisie, nimbée de l’autorité naturelle de ceux qui parlent sans jamais être contredits, nés pour être obéis, nés pour gouverner le destin de la plèbe. Pour tenter d’exister politiquement, elle feint dans l’article de croire que les cinq mille et quelques voix obtenues lors des dernières élections, l’ont été grâce à son seul mérite…la pauvre, le réveil pourrait être dur ! Très dur ! Quinze jours plus tard, « Le Vif » nous apprend que le fils Uyttendael « prend le bus », il y côtoie le peuple…de l’héroïsme quoi ! Est-ce vraiment là « la gôche ! » A lire ces interviews une profonde tristesse m’envahit tant ces deux jeunes gens m’apparaissent déjà oublieux du bonheur d’être eux-mêmes.
Autre conséquence, le nombre d’affiliés a fondu comme neige au soleil. Les chiffres sont secrets…un comble dans un parti de gauche, certains permanents retraités parlent et évoquent les vingt-cinq mille membres de 1974 et le fait qu’ils seraient moins de trois mille cinq-cents en 2015. Les militants ont disparu, évaporés. Il faut dire que le fonctionnement de la fédération fut des plus curieux pendant plus d’une décennie alors que partout l’élection du président fédéral se faisait au suffrage universel, seul à Bruxelles il était élu par le congrès où deux sections sur dix-sept, Anderlecht et Molenbeek, faisaient à elles seules la majorité…dès lors tout était simple, il suffisait de « ménager et… nourrir » Picqué et l’ordre, comme à Varsovie en 1830, pouvaient régner.
Le départ des militants a conduit un grand changement dans les campagnes électorales, plus rien ne fonctionne sur base du bénévolat, tout se paye, tout se rémunère, les collages, les distributions toutes boîtes. Ce n’est pas anecdotique mais lourdement symbolique. Logique aussi dans de telles conditions que la rupture soit consommée entre les organisations de l’action commune, plus besoin de syndicat, de mutuelle, d’organisation de jeunesse…tout le monde suit seul son chemin !
STRATÉGIES DYNASTIQUES ET COMMUNAUTARISME, LES DEUX MAMELLES DU PS BRUXELLOIS.
Les militants se sont évanouis mais il reste l’essentiel… des électeurs. J’y reviendrai. Au niveau du parti la structure est donc devenue la suivante : une bonne base électorale, des élus majoritairement issus de l’immigration, sans oublier la crème, cerise sur le gâteau, une dose de plus en plus importante de fils, filles, compagnons, compagnes, nièces ou neveux de… La classe intermédiaire des militants a disparu, elle s’est volatilisée, donc plus de contrôle, plus de contestation, plus de compte à rendre. Les congrès ne sont qu’une chambre d’enregistrement, garnie de nombreux membres de cabinet à qui le choix n’est pas donné, ils ont l’ordre d’être présents ! Pas de discussion, doigt sur la couture du pantalon, sinon… Qui pourrait au PS bruxellois impulser une autre politique, remettre en cause les décisions, où est l’opposition ; sans opposition pas de démocratie ! La preuve est faite.
Je note d’ailleurs que les instituts de sondages se trompent la plupart du temps en ce qui concerne le PS bruxellois car ils évaluent avec difficulté le poids de l’électorat issu de l’immigration, ils ne le connaissent que très mal, n’ont aucune idée des liens sociologiques, de la fidélité de la masse de nos électeurs d’origine étrangère, d’où une sous-évaluation systématique de nos résultats. Si un jour cet électorat devait disparaître ou s’étioler, nul doute que le PS se trouverait réduit à des chiffres très semblables à ceux du CDH. D’où le malaise en matière de laïcité, l’abdication quant à certaines attitudes, ce contact nauséabond avec les mosquées, la veule soumission quant aux exigences visant les femmes, les horaires des piscines, la nourriture etc. Mais attention, le vote socialiste n’implique pas de la part de cet électorat communautaire une adhésion ou même la simple connaissance de nos valeurs ! On a raté la transmission… tragique dans une famille. Avec stupeur, les derniers militants ont constaté qu’au PS bruxellois tout en matière de laïcité est négociable. J’y reviendrai !
Il n’y a donc plus de classe intermédiaire entre l’électorat et les élus ; les forces vives du parti, ses militants, ont disparu, reste une caste d’élus, rejetons dynastiques et la masse de ceux qu’un chercheur de la KUL d’origine maghrébine appelait récemment dans « Le Soir » « le bétail à voix, » qu’il estimait sous-représenté… j’ose supposer que ce chercheur flamand ne songeait pas à Bruxelles ! La disparition des militants conduit à d’étonnantes surprises. Ainsi voit-on surgir sur les listes électorales de parfaits inconnus, quasi absents de leur section locale, à peine affiliés, et encore pas toujours, (on se rappellera du fasciste turc sur une liste communale du PS, ce cas n’était ni accidentel ni unique ) totalement absents de la vie politique locale, n’ayant aucune présence sur le terrain, mais qui réussissent des scores de rêve et parfois sont élus dépassant une bonne partie des autres candidats sur la liste. Il suffit pour s’en convaincre de reprendre les listes fédérales ou régionales du PS à Bruxelles, de regarder les scores et de mettre ceux-ci en rapport avec le militantisme dans les sections. Victor Hugo disait : « il y a du champignon dans l’homme politique, il pousse en une nuit. » Cela n’a jamais été plus vrai qu’à Bruxelles. Dans de nombreux cas, personne au sein de la section locale ne connaît ce recordman ou cette recordwoman. La raison du succès est simple, ce candidat ou cette candidate a appuyé sur un bouton, un seul… le bouton miracle, le bouton communautaire. Pas besoin de faire beaucoup d’efforts, il suffit à l’électeur de déchiffrer le patronyme, imparable boussole électorale bruxelloise. Dans de telles conditions doit-on encore défendre la laïcité ? Peut-on encore imaginer résister aux exigences religieuses d’un autre âge ?
L’essentiel aujourd’hui au PS, ce sont les liens de parenté et les circuits communautaires, le militantisme n’a plus sa place… quant à la réflexion, les idées ! Il n’y a plus que très peu de rapport entre les campagnes électorales faites par les candidats et les valeurs fondatrices du PS. Le tramway, ligne directe vers le mandat implique une filiation dynastique ou un lien communautaire, sans cela pas de mandat, c’est le cul-de-sac. Les « tuyaux » d’accès au pouvoir ont changé…et comment ! A Bruxelles, les campagnes ne sont plus que communautaires, le programme ne compte que pour la presse et les adversaires, un nombre considérable de candidats s’en fichent complètement. Alors que pendant des années tu as insisté pour que nous évitions le communautarisme, aujourd’hui, c’est la dominante principale. Les tracts en arabe, en turc en albanais sont légions, plus personne ne s’en offusque à la fédération bruxelloise. Les temps ont changé, les militants se sont évanouis, nos valeurs sont chaque jour écornées. L’un des élus phare de l’une des importantes communautés de la région, occupant des responsabilités politiques majeures, n’hésite plus à dire « toutes les campagnes doivent être communautaires, Laanan et Madrane n’ont rien compris s’ils ne le font pas. » Au-delà de la question fondamentale de la transmission et de l’adhésion à nos valeurs, se pose indéniablement la question de la sauvegarde des principes de laïcité pour lesquelles nos prédécesseurs ont lutté pendant tant d’années contre l’hégémonie religieuse. Qu’on n’oublie pas qu’il nous a fallu des dizaines et des dizaines d’années d’âpres combats pour laïciser notre vie publique, échapper à l’oppression cléricale.
Comment dès lors concevoir que dans certaines écoles de la région la totalité de la viande servie soit hallal, le fournisseur répondant lors de l’appel d’offre : « ainsi il n’y a plus de problème ! »
Comment accepter que certaines piscines communales se soient soumises ( le plus souvent hypocritement ) à l’établissement d’horaires séparés par sexe !
Comment expliquer que la région de Bruxelles soit la seule qui n’ait pas osé bannir l’abattage rituel et laisse se poursuivre ces monstruosités.
Comment admettre que dans une grande commune de la région, l’ouvrier communal qui sert les repas scolaires à chaque cuillerée servie, fasse suivre celle-ci de la formule en arabe : amdulila ( grâce à Dieu ) !
 Comment accepter que dans nombres d’établissements scolaires il ne soit plus possible d’enseigner les principes du darwinisme, ni bien sûr d’évoquer le génocide des Juifs ! Les directions ne peuvent réagir, le pouvoir organisateur voulant surtout éviter les remous !
Comment accepter que dans nombres d’établissements scolaires il ne soit plus possible d’enseigner les principes du darwinisme, ni bien sûr d’évoquer le génocide des Juifs ! Les directions ne peuvent réagir, le pouvoir organisateur voulant surtout éviter les remous !
Il y a quinze ans, un enseignant de l’athénée royal de Laeken donnant une interview dans le « Vlan » avait évoqué son incapacité d’enseigner les notions du darwinisme à ses élèves. Cet article fit beaucoup de bruit, cet enseignant fut traité de raciste quasi de nazi. Or, il disait vrai, de nos jours ce genre d’incidents est courant. Mais l’omerta règne, il y a des choses dont on ne peut pas parler. Je n’évoque pas ici les étranges réactions de certains professeurs musulmans lors des assassinats de Paris au début de cette année, ni le fait que le cours de religion se dispense systématiquement en arabe alors qu’il devrait l’être en français ! Ni le fait que certaines enseignantes de la religion islamique refusent de serrer la main de leurs collègues masculins rappelant que selon elles, la main recèle cinq zones érogènes !
Comment ainsi accepter sans réagir l’irruption du moyen-âge dans notre sphère publique ! A Bruxelles, c’est tous les jours, non pas retour vers le futur, mais retour vers le passé et quel passé ! On a l’impression d’entrer dans l’avenir à reculons.
Comment admettre que les élèves musulmans manquent systématiquement les derniers cours de l’année scolaire si les parents ont décidé de partir en vacances, je n’évoque même pas les jours de fêtes religieuses où dans certaines communes les classes sont vides, le cours étant ajourné d’autorité ! Sans réaction des autorités, bien au contraire des consignes sont données aux enseignants de ne pas donner cours, « d’occuper » les trois ou quatre présents.
Pourquoi camoufle-t-on les incidents qui émaillent les récréations au cours desquelles des gosses sont pris à partie lorsqu’ils mangent du jambon ou ne font pas le jeûne du Ramadan !
On pourrait poursuivre cette liste indéfiniment. Le relativisme culturel, lourdement prôné, accepte aujourd’hui le voile, demain il fera accepter l’excision au nom de la même effarante régression à la fois lâche et ignoble unissant la haine des valeurs issues de 1789 et un sordide cynisme de boutiquier électoral. On le voit, c’est dans le silence, à l’abri d’un discours intimidant que l’on serre le garrot qui cran après cran étrangle la laïcité, installe concession après concession, petits aménagements après petits aménagements, petites lâchetés après petites lâchetés… à haut rendement électoral, une société où le fait religieux envahit, pollue, domine à nouveau le domaine public.
COMMENT RÉAGIT LE PS BRUXELLOIS.
Aujourd’hui, il est évident qu’il est prisonnier de son électorat dont les gros bataillons, qui osera le nier, sont issus de l’immigration. Tout ne fut pas négatif dans cette évolution. Il est remarquable que le PS ait su tisser des liens de confiance avec ces communautés alors que d’autres formations politiques, qui s’en mordent aujourd’hui les doigts, les méprisaient ouvertement.
Impossible dans ce contexte de ne pas évoquer Moureaux et les vingt ans pendant lesquels il a dirigé Molenbeek qu’il a transformé en laboratoire de la porosité du retour du religieux dans notre région. Ses réactions et son évolution sont emblématiques de l’évolution, de l’attitude du PS dont il fut pendant la même période le président fédéral.
Débarquant à Molenbeek en 1982, il mène la campagne communale sur le thème du « stop à l’immigration. » De nombreux tracts ont été conservés, étonnantes et encombrantes archives. Il débat à la même époque sur La RTBF matinale, il y est opposé à Albert Faust, secrétaire général du SETCA de Bruxelles Halle Vilvorde et s’oppose obstinément au vote des étrangers aux élections communales alors qu’Albert Faust lutte avec la FGTB pour l’obtenir. La RTBF dispose toujours de la cassette, on peut la réécouter… un régal d’anachronisme, une grande leçon sur l’adaptabilité du monde politique aux dures réalités électorales. En 1986, écrivant dans un journal communal consacré à l’enseignement, il évoque la nécessaire assimilation des citoyens d’origines étrangères. Au cours de la même période, il évoque plusieurs fois ses regrets que l’on ait reconnu l’Islam en qualité de religion subsidiée. De nos jours, même le terme « intégration » est devenu un gros mot ! Quelle adaptation ! Certains ne le prononcent que la bouche en cul de poule, se tordant les lèvres ayant hâte de se les désinfecter. N’est-on pas étonné de la timidité avec laquelle le gouvernement bruxellois envisage le parcours d’intégration qui devrait être mis en place. On l’évoque en catimini, entre deux portes, avec la prudence que l’on met à manipuler de la dynamite. Il ne s’agit pas ici de fustiger Moureaux, sans doute a-t-il plus d’excuses que beaucoup d’autres, n’ayant jamais eu, de par son milieu, aucune connaissance des milieux les moins favorisés. On le sait le marxisme lui fut injecté par voie ancillaire ! Pour la première fois de son existence grâce aux émigrés, il découvrait extatique, enfin comblé, à Molenbeek, ceux qu’ils ne connaissaient qu’au travers de ses lectures. Il allait enfin se sentir utile et renouer avec la grande tradition des ouvroirs des dames patronnesses… aider ses pauvres. Rendons lui cette justice, il a considérablement rénové sa commune, lourdement investi dans l’urbanisme mais il n’a pas investi dans les cerveaux ! On va le voir, c’est le sien qui s’est adapté, modelé… soumis. Il s’est appuyé sur les mosquées pour que celles-ci encadrent les jeunes, qu’il n’y ait surtout plus d’émeutes… pas de problème, les grands frères seront généreusement subsidiés… sans le moindre contrôle sur le terrain. Moureaux pensait du haut de ses origines sociales, de sa prestigieuse fonction académique, de ses multiples charges ministérielles et politiques que les mosquées seraient de fidèles courroies de transmission de sa volonté. Et…patatras, c’est lui qui a été roulé dans la farine par les barbus. Il ne s’est pas rendu compte, prisonnier de son orgueil de classe qu’il devenait « l’idiot utile » des forces les plus obscurantistes, moyenâgeuses, de sa commune. C’est lui, le professeur émérite de critique historique qui, au fil des ans, est devenu l’inattendu relai des revendications les plus obscurantistes. Le harki c’était lui, amusant non ! La politique qu’il a mise en œuvre est étonnante par son classicisme. Ce fut celle du colonialisme qui s’est appuyée sur les chefs coutumiers pour que les indigènes ne s’agitent pas. C’est une politique strictement maurassienne dans laquelle la religion est avant tout un encadrement social. Pour tout dire, c’est une politique conservatrice au sens strict du terme, curieuses pratique pour ce marxiste auto proclamé ! En définitive son marxisme mal assimilé n’est-il pas pour paraphraser Jean Cau que « le gant retourné du christianisme ? » Ce n’est qu’au fil du temps et du remplacement de la population belge de souche de sa commune par des émigrés qu’il comprit le rôle électoral que cette population allait jouer à Bruxelles. Il faut lui rendre cette justice d’autant plus qu’il poussera jusqu’au bout le don de sa personne, allant même jusqu’au sacrifice suprême, moderne Abraham, puisque maintenant il « immole » sa fille Catherine, il la livre, innocente enfant, à ce peuple émigré, pauvre, fragilisé, mais exigeant un total don de soi, en ce compris le rejet des valeurs de la laïcité.
Ainsi la fédération s’est de plus en plus appuyée sur les mosquées et donc forcément sur les milieux musulmans les plus rétrogrades. Cela explique la disparition d’un certain nombre d’élues féminines d’origine maghrébine, ces femmes les premières élues de ce milieu, étaient toutes des femmes libérées des contraintes religieuses, ayant un langage direct, ferme à l’égard du poids du religieux. Aujourd’hui, elles sont remplacées par des élues beaucoup plus « lisses, soumises » On sait qu’elles ne causeront aucun problème avec leur communauté ou avec ceux qui s’y arrogent le rôle de représentant desdites communautés. La seule qui ait résisté c’est Fadila Laanan, précisément parce qu’elle était soutenue à un autre niveau du parti. Moureaux n’écrivait-il pas à son sujet « cette personne n’a pas été désignée en qualité de ministre par la fédération. » Quelle est aujourd’hui sa relation avec la nouvelle direction fédérale… On le sait les sourires cachent les poignards ! Quel tort a Fadila ? Simple, elle est issue de l’immigration, c’est une femme libre, éduquée, fière de sa culture, fière de ses origines, non liée aux groupes religieux et elle défend la laïcité, et, suprême audace s’en réclame… elle fait une place aux femmes là où depuis des décennies les extrémistes islamistes les empêchaient de travailler ! Elle ne plaît pas aux barbus… ça c’est certain !

L’ENSEIGNEMENT.
S’il est un domaine vital pour l’avenir d’une société, c’est bien l’enseignement. Or, à quoi a-t-on assisté à Bruxelles ? Ni plus ni moins à un effondrement total du niveau des écoles de l’enseignement public, il n’aura fallu qu’à peine deux décennies. L’enfer étant pavé des meilleures intentions, les pouvoirs organisateurs ont dans la plupart des cas voulu forcer la mixité. C’était nécessaire et utile. Mais cela se fit sans le moindre discernement, la moindre analyse de fond, le moindre suivi. Il était absolument nécessaire d’établir une vraie mixité, de lutter contre les discriminations, le racisme, qu’il ne s’agit pas ici de nier. Notre enseignement fut victime d’un égalitarisme forcé alors qu’il aurait été nécessaire de lire Aristote lorsqu’il soulignait « que la véritable justice est de traiter inégalement les choses inégales. » N’est-il pas démontré par l’histoire que forcer l’égalitarisme conduit toujours au drame ! Le résultat est que dans différentes communes, les classes sont composées pour 80 ou 90 pourcents d’enfants issus de l’immigration. Ceux-ci ne parlent pas français au sein du foyer familial, ils ne regardent que la TV dans leur langue maternelle. Peut-on le leur reprocher ? Significatives les réponses données par les enfants lorsqu’on les questionne sur leur nationalité, les neuf dixième répondent qu’ils sont Turcs, Albanais, Marocains, Algériens, seule une infime minorité répond qu’ils sont Belges alors même que la majorité l’est ! Imagine-t-on un seul instant les difficultés qu’affrontent au jour le jour les enseignants, leur découragement, leur révolte face à un pouvoir organisateur n’ayant tenu aucun compte des affres quotidiennes de la réalité. Or, qui sont les premières victimes de cette situation ? Ce sont bien sûr les enfants issus de l’immigration. Leur progression scolaire ne peut qu’être lente, les chances d’avenir réduites. Les brillantes réussites d’enfants d’émigrés ayant accompli leur scolarité il y a quinze ou vingt ans deviendront des exceptions car le malheur veut que leurs enfants se retrouveront dans des classes vouées à un grand retard du fait de la ghettoïsation des écoles. Réussir des études, accéder à un emploi de qualité est beaucoup plus difficile aujourd’hui qu’hier. Les statistiques publiées par « Le Soir » le démontrent sans contestation possible. Cela aussi, il est interdit de le dire, interdit même de le constater. Si par malheur vous le faites soit on vous traite de menteur soit vous êtes voués à l’enfer de la faschosphère !
Je le répète, j’insiste les premières victimes de cette situation, ce sont précisément les enfants d’émigrés, même ceux de la deuxième ou troisième génération, leur capacité d’intégration, de réussite sont largement diminuées. Est-il nécessaire d’ajouter que les émigrés et leurs enfants n’ont aucune responsabilité dans cette horrible situation, quoi de plus normal pour quelqu’un qui débarque en terre étrangère que de tenter de s’insérer dans un environnement où il retrouve ses semblables. Il est d’ailleurs démontré que les émigrés ou Belges issus de l’émigration s’ils « réussissent » professionnellement quittent au plus vite certains quartiers ou font des mains et des pieds pour éviter que leurs enfants fréquentent certaines écoles. Comment dès lors s’étonner des trente pourcents « officiels » du chômage des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans. Au mois de mai, un nombre important de mamans maghrébines de Montpellier ont manifesté pour que les établissements scolaires de leur quartier retrouvent une vraie mixité, à savoir que reviennent dans les écoles de la municipalité quelques enfants Français de souche !!! Curieux qu’on en ait si peu parlé à Bruxelles. Très récemment Picqué s’exprimant à la section d’Anderlecht n’hésitait pas à souligner, avec le cynisme distancié le caractérisant qui est à la fois sa marque de fabrique et lui tient lieu de colonne vertébrale idéologique, que ses enfants fréquentaient l’enseignement catholique. Il est vrai que Picqué n’a jamais été socialiste, il a appris à LE parler, voilà tout ! Certains des présents se rappelaient le reportage de RTL où l’on pouvait voir son épouse dormir sur le trottoir du collège Saint Michel pour avoir le privilège d’y inscrire ses fils ! Comment mieux reconnaître que l’enseignement à Bruxelles est l’un de ces immenses territoires perdus de la laïcité, perdus pour la gauche ! Où est l’époque où, pour se présenter sur une liste électorale socialiste, il fallait que ses enfants fréquentent l’enseignement officiel ! Il faut oser dire que dans certaines écoles on forme… de futurs chômeurs ; les bonnes paroles, les discours lénifiants du politiquement correct n’y changeront rien. Seule une politique volontariste, immédiate, brutale, visant à largement revaloriser le statut des enseignants et à imposer, oui à imposer, une vraie mixité serait de nature à rencontrer les besoins d’avenir de notre région ; sans oser évoquer le bonheur des enfants qui sont confiés aux établissements publics de notre région. Les premiers bénéficiaires d’une telle réforme seraient les enfants d’émigrés. Pour les plus fortunés, pas de problème, ils iront dans « les zones protégées » de certains établissements catholiques… ils feront comme Picqué !
S’INTÉGRER MAIS À QUOI ?
 J’avais été impressionné, il y a bien des années d’entendre un Commissaire européen me dire que si l’Union européenne avait pu s’étendre à Bruxelles, c’était dû au fait que la Belgique n’était pas une nation, que Bruxelles n’avait pas d’identité nationale, d’où l’étonnante permissivité à l’égard de la tentaculaire administration européenne. Une telle porosité n’eût été possible dans un pays sourcilleux en matière de souveraineté. Ce Commissaire ignorait sans doute que Bruxelles continue à assumer le rôle qui fut le sien dans l’histoire depuis la période bourguignonne, à savoir être un centre administratif, fonction intimement liée, sinon imposée par sa situation géographique. Il en sera de même sous l’occupation espagnole, autrichienne et française. Il n’est pas inutile de rappeler que sous l’occupation allemande de 1940 à 1944, Bruxelles était le centre des forces d’occupation pour la Belgique et le Nord de la France. Toujours ce même rôle de centre administratif, toujours pas d’attache nationale propre. « La Nation belge » fut le titre d’un journal bruxellois au XIXème siècle, ce ne fut jamais une réalité politique même si on a essayé de le faire croire ; s’il n’y a jamais eu de nation belge, il y eut encore moins d’identité bruxelloise. N’en déplaise à certains chantres du tout nouveau DEFI, il n’y a jamais eu de spécificité bruxelloise.
J’avais été impressionné, il y a bien des années d’entendre un Commissaire européen me dire que si l’Union européenne avait pu s’étendre à Bruxelles, c’était dû au fait que la Belgique n’était pas une nation, que Bruxelles n’avait pas d’identité nationale, d’où l’étonnante permissivité à l’égard de la tentaculaire administration européenne. Une telle porosité n’eût été possible dans un pays sourcilleux en matière de souveraineté. Ce Commissaire ignorait sans doute que Bruxelles continue à assumer le rôle qui fut le sien dans l’histoire depuis la période bourguignonne, à savoir être un centre administratif, fonction intimement liée, sinon imposée par sa situation géographique. Il en sera de même sous l’occupation espagnole, autrichienne et française. Il n’est pas inutile de rappeler que sous l’occupation allemande de 1940 à 1944, Bruxelles était le centre des forces d’occupation pour la Belgique et le Nord de la France. Toujours ce même rôle de centre administratif, toujours pas d’attache nationale propre. « La Nation belge » fut le titre d’un journal bruxellois au XIXème siècle, ce ne fut jamais une réalité politique même si on a essayé de le faire croire ; s’il n’y a jamais eu de nation belge, il y eut encore moins d’identité bruxelloise. N’en déplaise à certains chantres du tout nouveau DEFI, il n’y a jamais eu de spécificité bruxelloise.
Historiquement, c’est sans contestation possible une ville dont la population est flamande, mais l’élite du centre administratif parlait une autre langue, Français, Espagnol, Allemand. Je ne reprendrai pas ici les propos, souvent injustes et odieux de Baudelaire sur les Belges et en particulier les Bruxellois mais il faut reconnaître que cette région fut toujours un étonnant magma réunissant des élites « d’occupation » inévitablement accompagnées de fidèles « collaborateurs » et une population parlant un sabir à base essentiellement flamande. Il ne fait aucun doute qu’avec l’installation massive des administrations de l’UE, et de tant d’autres organisations multilatérales, Bruxelles soumise au déterminisme de sa géographie, poursuit son rôle de centre administratif. Or, un émigré, ou un enfant d’émigré, débarque avec sa culture, sa langue, sa religion, ses habitudes alimentaires. Ce sont des éléments structurants dont souvent il est à juste titre fier, qu’il ne veut pas larguer comme on se sépare d’un vieux vêtement ! C’est parfaitement légitime. Dans les années cinquante, un boxeur français d’origine tunisienne Halimi, poids coq, avait gagné un combat contre un pugiliste anglais. Porté en triomphe par ses soigneurs, il répondait au micro que lui tendait Loïc Van Le : « j’ai vengé Jeanne d’Arc. » Voilà donc une intégration réussie, ce boxeur, avait noué ses racines à celles de la France, à son histoire, il la faisait sienne.
Peut-il en être de même à Bruxelles ? Impensable ! Il n’y a ni « récit, ni roman national », il n’y a pas de racines historiques glorifiées, fondatrices. Quel jeune Bruxellois connaît le combat du municipaliste T’Serclaes. Les Comtes d’Egmont et Horne n’étaient pas Bruxellois, de plus ils appartenaient d’abord et avant tout à « l’internationale » de la noblesse. Il ne faut pas compter sur les cours d’histoire dispensés au niveau scolaire pour y suppléer, ceux-ci faisant fi des liens chronologiques, entendent faire connaître l’histoire par thèmes ; puzzle effrayant dont les élèves ne retiennent que des bribes sans continuité ; ce costume d’Arlequin décousu, impossible pour les malheureux étudiants de le recoudre, ajoutez une pédagogie générale de plus en plus obscure, caramélique… Croire après cela qu’on va leur enseigner l’histoire de ce pays, de cette région n’est qu’une sinistre plaisanterie ! Ce n’est pas le spectacle de la plantation du Meyboom ou le défilé de l’Ommegang qui me feront changer d’avis. A quelles nouvelles racines l’immigré peut-il nouer les siennes ? De fait à Bruxelles, elles sont inexistantes. Sur quel nœud de l’histoire la greffe peut-elle prendre ? L’effondrement de la qualité de notre enseignement, l’absence de cohésion nationale ou même régionale, l’absence de conscience identitaire ne pouvaient que renforcer le communautarisme, l’accentuer, l’enkyster. Car, ne nous y trompons pas, l’émigré, lui nous vient avec son identité nationale forte, avec sa religion qu’il ne sépare pas de la vie publique ; sa culture comprend indissolublement liées l’identité nationale et l’identité religieuse ; au Maroc, le chef de l’Etat n’est-il pas aussi le commandeur des croyants ! Et l’on aurait voulu que par un coup de baguette magique cet étranger fasse sienne les mœurs politiques, les us et coutumes, les civilités qu’il a fallu des siècles pour bâtir ! Il serait grotesque de lui parler d’identité bruxelloise. Impossible de lui demander de s’intégrer au vide ! Que reste-t-il alors ? Une seule chose mais essentielle : des valeurs !
 Sans être une nation, sans être un état, sans identité régionale, il n’est pas exagéré de dire que ce qui structure les Bruxellois, ce sont des valeurs ; du point de vue schématique, celles-ci se réfèrent au socle des droits de l’homme et du citoyen, ce legs inestimable, admirable de la révolution française. Ces valeurs, ce sont les éléments que l’on a en commun, ce sont les liens qui unissent les Bruxellois, les fondements permettant de gérer le présent, de préparer l’avenir tout en sachant ce qu’il a fallu de luttes pour qu’elles voient le jour et surtout combien elles sont fragiles. Ces valeurs sont constitutives du contrat qui lie le citoyen à la puissance publique, qu’elle soit régionale ou fédérale, c’est le respect de la Justice, des institutions, le respect de la loi, en un mot, de tout ce qui fait le vivre ensemble. Or précisément, on constate depuis une quinzaine d’année le recul d’éléments essentiels de ces valeurs. « De petits aménagements » en « petites concessions » les frontières de la laïcité deviennent floues ; ce qui était parfaitement clair il y a quinze ans devient sujet à discussions. Des valeurs, comme l’égalité homme-femme qui nous semblaient acquises pour l’éternité, vacillent, sont discutées. Attention, si vous vous montrez rigide, implacable dans la défense de ces valeurs, vous serez traité de laïcard, un terme utilisé par le président fédéral bruxellois lui-même pour fustiger ceux qui mettaient en cause le voile, les horaires de piscine séparés ou l’invasion du halal. Intéressant de savoir que ce terme a été inventé par l’extrême droite française entre les deux guerres pour attaquer la gauche du front populaire. Se faire traiter de laïcard est un moindre mal car on bascule vite sur des éléments de langages plus brutaux comme fascistes, racistes etc. Mise en œuvre de la vieille technique stalinienne qui veut que si « tu n’es pas à 100% d’accord avec moi, tu es à 100% contre moi. » Venant de marxistes en peau de lapin… c’est du plus haut comique. Curieux zigzag de l’histoire !
Sans être une nation, sans être un état, sans identité régionale, il n’est pas exagéré de dire que ce qui structure les Bruxellois, ce sont des valeurs ; du point de vue schématique, celles-ci se réfèrent au socle des droits de l’homme et du citoyen, ce legs inestimable, admirable de la révolution française. Ces valeurs, ce sont les éléments que l’on a en commun, ce sont les liens qui unissent les Bruxellois, les fondements permettant de gérer le présent, de préparer l’avenir tout en sachant ce qu’il a fallu de luttes pour qu’elles voient le jour et surtout combien elles sont fragiles. Ces valeurs sont constitutives du contrat qui lie le citoyen à la puissance publique, qu’elle soit régionale ou fédérale, c’est le respect de la Justice, des institutions, le respect de la loi, en un mot, de tout ce qui fait le vivre ensemble. Or précisément, on constate depuis une quinzaine d’année le recul d’éléments essentiels de ces valeurs. « De petits aménagements » en « petites concessions » les frontières de la laïcité deviennent floues ; ce qui était parfaitement clair il y a quinze ans devient sujet à discussions. Des valeurs, comme l’égalité homme-femme qui nous semblaient acquises pour l’éternité, vacillent, sont discutées. Attention, si vous vous montrez rigide, implacable dans la défense de ces valeurs, vous serez traité de laïcard, un terme utilisé par le président fédéral bruxellois lui-même pour fustiger ceux qui mettaient en cause le voile, les horaires de piscine séparés ou l’invasion du halal. Intéressant de savoir que ce terme a été inventé par l’extrême droite française entre les deux guerres pour attaquer la gauche du front populaire. Se faire traiter de laïcard est un moindre mal car on bascule vite sur des éléments de langages plus brutaux comme fascistes, racistes etc. Mise en œuvre de la vieille technique stalinienne qui veut que si « tu n’es pas à 100% d’accord avec moi, tu es à 100% contre moi. » Venant de marxistes en peau de lapin… c’est du plus haut comique. Curieux zigzag de l’histoire !
En 2004, lors de l’élaboration du programme électoral de la fédération tous les amendements visant à mettre en évidence l’égalité homme-femme ont été repoussées violemment par le président fédéral lui-même. Fulminant, éructant, hurlant, on ne pouvait pas en parler : « cela risquait de heurter la population la plus fragilisée de Bruxelles ! » Ah ! Bon… donc un élément aussi fondamental que l’égalité absolue homme-femme devait être tu ! Pour des raisons électorales… Voilà, le piège se refermait, nous socialistes devenions prisonniers de notre électorat précisément parce que nous n’avions pas été capables de transmettre nos valeurs. Nous cessions d’être une force de propositions, de progrès, nous nous soumettions à la sensibilité d’un électorat qui aurait dû épouser la nôtre, pour parler clair qui aurait dû accepter nos valeurs… et les défendre. Parce que dans la structure du parti, on avait accepté qu’il n’y ait plus de militants, que l’électorat suffisait pour autant que soient élus ceux choisis par les « Dieux, » en un mot que les plans de carrière de certains soient assurés, on baissait pavillon sur ce qui faisait notre âme ! Notre slogan occulte devenait : « des valeurs non ! des électeurs oui ! ». D’aucuns rétorquent que cette thèse est fausse, nos valeurs seraient largement partagées par nos électeurs car les élus d’origine étrangère ont toujours, sans la moindre difficulté voté les textes portant sur des avancées en matière d’éthique telle l’euthanasie. Parfaitement exact. Mais raisonnement simpliste, qui se refuse, comme souvent à gauche, à voir la réalité. Sur ce genre de questions les élus d’origine maghrébine ou turque s’en fichent totalement, cela ne les concerne pas ; sur ces questions essentielles, ils vivent dans leur culture, ils respectent leurs valeurs et n’adhèrent aucunement aux nôtres, tout simplement cela ne les concerne pas ! C’est bon pour l’autre monde, celui où l’on tente de perpétuer ce que furent les valeurs humanistes de progrès. Peut-on leur en faire grief ? Certes non, c’est nous, en particulier le puissant PS qui avons été incapables de transmettre les nôtres, le PS s’est « soumis », ou s’est cru habile et… on c’est dépouillé de ce qui faisait notre essence. Peut-être aurait-il fallu se souvenir que la ruse ultime du diable est de faire croire qu’il n’existe pas ! Pensant tirer profit d’un corps électoral qu’on pensait fruste, naïf, innocent, on lui concède nos valeurs…cela relève de la comédie de boulevard et non de la politique. Dans les journaux de la fin du XIXème siècle, il y avait un jeu dénommé « Chercher le Kroumir », les Kroumirs étant une tribu tunisienne accusée par les Français de faire des incursions en Algérie, prétexte colonial typique pour imposer un protectorat sur ce pays. Dans un dessin de paysage, on devait deviner la silhouette dissimulée du « méchant » Kroumir. Je pense qu’on devrait relancer ce jeu à Bruxelles dont le thème serait « chercher le cocu » le pauvre cornard étant celui qui soutient un parti socialiste qui a jeté par-dessus bord son histoire, ses valeurs et tout le reste ! Voilà ce que ressentent aujourd’hui de nombreux affiliés de longue date du PS. Pour ceux-là le vote socialiste sera difficile, comme les sondages les uns après les autres le démontrent, le transfert se fait vers le PTB…et le DEFI.
Je fus stupéfait de lire au tout début de l’année dans « Libération » que Houellebecq répondant à une interview, précisait qu’il avait eu l’idée de son dernier livre « Soumission » on en connaît le thème, c’est l’élection en qualité de président de la république française d’un musulman modéré, en se baladant dans les rues de Bruxelles. Amusant aussi d’entendre Amin Maalouf le talentueux écrivant libanais raconter sur France Inter qu’il y avait beaucoup moins d’intégristes au Maroc qu’au sein de l’immigration européenne ; ainsi il évoquait que, se trouvant sur une plage du Maghreb, il y observait une famille de musulmans de stricte obédience, femmes entièrement voilées sur la plage, se rapprochant il constata que c’était des Belges… cela le faisait beaucoup rire.
Il est de bon ton dans les instances dirigeantes du PS bruxellois d’estimer que toutes les cultures se valent, que ce serait faire preuve de racisme que de réagir à certaines pratiques. Ainsi la présidente fédérale monte-t-elle tout de suite aux barricades criant haut et fort qu’elle n’a jamais condamné les pratiques barbares liées à la nourriture Halal, la presse ayant osé émettre quelques doutes. Elle est nettement moins réactive quand un élu refuse de reconnaître le génocide arménien, à peine audible, d’une voix fluette, entre deux portes, pour une fois le sourire tarifé en berne, elle précise que l’intéressé devra se présenter devant une commission. Elio, tu sais mieux que moi la façon dont tu as dû t’investir dans cette crise symptomatique. Elle ne fut dénouée que grâce à toi, beaucoup le savent. Un élu de Molenbeek traite un journaliste « d’ordure sioniste » ou ce même élu affirme qu’il se sent proche du Hamas (organisation classée dans la liste des groupes terroristes par l’ONU ), elle déclare dans le même souffle à la télévision que cet élu est « un homme bien ! » Il est vrai qu’à Molenbeek des consignes verbales étaient données aux policiers non musulmans de ne pas manger devant leurs collègues appartenant à ce culte pendant le ramadan afin d’éviter tout incident. Je ne doute pas que ce soit aussi le cas ailleurs mais peut-être y est-on encore plus discret ? On pourrait multiplier à l’infini les exemples de recul portant sur des valeurs qui furent toujours les nôtres et pour lesquelles, je le répète nos prédécesseurs se sont battus pendant des dizaines et des dizaines d’années.
DEMAIN LES VALEURS DE LA GAUCHE.
Cela fait déjà pas mal de temps que l’encéphalogramme de la gauche et de la social-démocratie est plat. Le vide idéologique est abyssal. Tout souffle a disparu. Il règne dans le mouvement socialiste comme une odeur de décomposition, fût-elle institutionnelle, elle agresse nos narines. Mais a-t-on encore besoin d’idéologie ? Pathétique de constater que Moureaux n’hésite pas à se raccrocher au philosophe français Badiou, dernier maoïste n’hésitant pas à envisager un monde sans démocratie ! Cela en dit long sur une certaine dérive idéologique ou le rouge se mâtine de brun ! Pourtant Badiou n’est pas barbu !
Peut-être un jour, si l’ex-bourgmestre de Molenbeek n’a plus d’espoir dynastique, criera-t-il lui aussi avec Aragon « feu sur les ours savants de la social-démocratie. » Tout est possible avec les vieilles gloires sorties des rails. Je ne sais s’il faut pleurer ou rire. L’éclatement de la gauche, son évaporation dans l’Europe pose un problème général, une dimension nouvelle, car cette gauche, si malmenée, reste malgré tous ses défauts, le seul, l’ultime rempart contre le capitalisme fou, contre la financiarisation de la société, contre l’asservissement total des peuples au culte de Mammon.
J’en reviens à Bruxelles, au pitoyable PS Bruxellois. Faut-il croire qu’il est devenu cette chose boiteuse, sans lyrisme, sans espoir, mélange de bureaucratie, de sordide népotisme, de clientélisme, de médiocrités arrivées ? Non, je ne peux le croire. Pourtant, je renifle sous les flonflons des rhétoriques de circonstances comme une odeur de cadavre, de fin d’un système, fragrances des lâches abandons… Quelque chose disparaît sous nos yeux ! Il est vrai que le PS ne fait plus rêver, tu te rappelles Elio de ce slogan : « changer la vie ! » Bon sang, que c’est loin. Mais le pire serait la trahison de nos valeurs, l’abandon progressif, hypocrite de ce qui fût notre apport essentiel à notre culture, à notre mode de vie. Je ne vois que des avantages à la présence dans notre région de cultures multiples, c’est une richesse indéniable mais je ne vois que des dangers si l’une de ces cultures veut imposer ses normes, revenir sur nos acquis sociétaux ou politiques, imposer ses normes alimentaires, revenir sur l’absolue égalité homme-femme, revenir sur l’impact du religieux dans la sphère politique etc. En d’autres termes, pourquoi pas le remplacement d’une part de notre population ! Substitution de nos droits, de nos valeurs non ! jamais ! A Bruxelles, c’est ce qui est en train de se jouer. C’est cela l’enjeu essentiel.
Allons nous abdiquer ou allons-nous être capables de nous libérer du poids d’un électorat qui n’a pas (encore) assimilé nos valeurs et qui ne comprend pas que certaines des siennes sont incompatibles avec ce qui fait notre civilisation ?

Y A-T-IL UN AVENIR ?
Il ne fait pas de doute qu’au niveau institutionnel la région telle qu’elle est limitée n’a aucun avenir. Elle ne deviendra jamais un Singapour européen, elle est vouée à la paupérisation et à la ghettoïsation. Tous le savent, tous l’admettent…en privé, y compris celui qui fut si longtemps ministre président et qui n’a jamais caché lors de contacts personnels qu’il ne croyait nullement dans la pérennité de cet espace étriqué, pauvre. Notre sort sera scellé ailleurs lors du grand pow wow politique exigé par nos voisins du Nord !
Personne d’ailleurs ne demandera l’avis de la population.
Pourtant, ils existent les habitants de notre région. Pour les évoquer, il me paraît essentiel de d’abord rendre hommage aux émigrés. Ceux qui les vouent aux gémonies feraient bien de se demander ce que serait leur attitude dans un pays étranger dont ils savent qu’ils n’y sont pas les bienvenus, dont ils ne connaissent pas la langue, dont les mœurs administratifs sont aux antipodes de ce qu’ils ont connu, dont l’accès à l’emploi est complexe et de plus en plus aléatoire. Et malgré tous ces obstacles, malgré les discriminations, le racisme, certaines réussites sont splendides, exemplaires. Réussites qui ne sont pas suffisamment mises en évidence. Quand Lévi-Strauss évoque l’universalité des hommes et leurs différences, c’est d’abord l’universalité qui m’importe ! C’est cela qu’il faut avoir à l’esprit quand on évoque la problématique liée aux émigrés ou leurs descendants.
Cependant, s’il m’apparaît qu’affirmer que globalement l’intégration est un échec est totalement faux, il n’en est pas moins vrai que celle-ci sera plus difficile que précédemment. L’effondrement de la qualité de l’enseignement, les classes ghetthoïsées ne favorisent plus ces succès. On assiste à un nivellement par le bas tout à fait évident dans certaines communes, ou dans certains quartiers ; la lutte pour intégrer des écoles qualifiées de meilleures le démontre de façon claire.
Que reste-t-il donc à ce peuple d’émigrés ? que reste-t-il à cette masse de jeunes sous qualifiés n’ayant que peu de chance d’intégrer le monde du travail ? Ils sont Belges et subissent la violence des discriminations à l’emploi, au faciès, le racisme ordinaire, encore accru par la crainte justifiée du terrorisme ; au Maroc, en Algérie ou ailleurs ils ne sont plus acceptés comme des autochtones ! Ils sont donc dépourvus d’identité dans une région qui n’en a pas… il leur reste donc pour seul élément structurant la religion, celle-ci n’est pas seulement un rapport à la transcendance mais aussi un cadre global de vie d’une des grandes civilisations mondiales. Comment s’étonner des dérives que l’on observe aujourd’hui, impensables il y a encore une quinzaine d’années. La gauche a cru que le fait religieux, sa coloration du politique, appartenait définitivement au passé. L’époque où le curé en chaire les jours d’élections expliquait à ses ouailles comment et pour qui voter appartenait au folklore électoral. Tout le monde sait à Bruxelles que les imams eux perpétuent cette sainte tradition. Pire, ce sont des élus PS qui supplient ou flattent les responsables des mosquées pour obtenir les mots d’ordre que nous avons reprochés aux curés pendant plus d’un siècle !
Le monde des émigrés et les Belges musulmans nous démontrent qu’ignorer, comme la gauche a tenté de le faire, le facteur religieux fut une lourde faute…
le retour vers le passé nous saute à la gorge… avec notre complicité électoralement intéressée.
Tous les démographes le prévoient, Bruxelles sera majoritairement musulmane d’ici une quinzaine d’année. Les facteurs géographiques, la contention insensée de Bruxelles dans des limites économiques et sociales invivables, la démographie dans la population immigrée, imposeraient des décisions majeures, rapides. Je n’ai aucun doute que le gouvernement régional sera incapable de les prendre ! D’ailleurs, la question se pose de savoir si dans le contexte institutionnel actuel, il y a encore quelque chose à espérer. Une autre politique est-elle possible ? Plus modestement, une politique est-elle possible ? Ou bien faut-il se contenter de poursuivre la politique brillamment menée par Picqué, la morbide politique du chien crevé au fil de l’eau. Dans ce cas, toutes choses restantes égales l’avenir du PS bruxellois sera assuré par le « couple » Catherine Moureaux et Uyttendael, ils régneront sur un magma d’électeurs d’origine étrangère, dirigeront la fédération avec pour slogan le Bisounours du Vivre Ensemble et inviteront les derniers affiliés à venir se ressourcer dans un salon de dégustation halal- bio, nirvana absolu du politiquement correct ! Quand aux valeurs du PS ! Quelles Valeurs ? Qui parle encore de valeurs ? Elles ont été remplacées comme notre électorat.
Les conséquences étaient prévisibles. Il y a une vingtaine d’années, une institution bruxelloise lors d’une inauguration avait prévu des distributions de crème glacée gratuite pour les enfants du quartier. L’assaut fut vite incontrôlable. Certains policiers voulaient chasser les enfants, ceux-ci se mirent à hurler « vive Bajrami, il va venir nous aider, c’est notre héros ! » Bajrami était un gangster célèbre à l’époque. Aujourd’hui, seuls quelques ilotes osent nier que Bin Laden est considéré comme un héros dans une certaine fraction de notre population. Est-il nécessaire de rappeler les connexions à Molenbeek de l’assassin du musée juif. N’est-ce pas à Molenbeek que le terroriste du Thalys aurait obtenu ses armes ? Les contacts entre les terroristes et cette commune sont aujourd’hui une évidence mondiale. Mohammed Mehra, après avoir tué trois militaires français, assassina des enfants Juifs parce que Juifs ; il était né en France, avait suivi les cours d’une école publique pendant plus de dix ans. Les terroristes de Londres, étaient anglais, nés et scolarisés en Angleterre. Une accumulation de tels faits mériterait la plus grande attention. Pour ne pas évoquer l’antisémitisme d’importation répandu dans toute la population d’origine émigrée qui s’apprend avec le naturel de la langue maternelle avec j’ose l’écrire pour certains un silence complice, une compréhension ignoble car s’il y avait à Bruxelles quatre cent mille Juifs et vingt-cinq mille Maghrébins, ceux-là qui se taisent et acceptent, les mêmes, se transformeraient en thuriféraires de l’Etat d’Israël jusque dans ses pires actes. Je conserve la photo d’un élu socialiste Flamand qui, participant à une manifestation à Anvers, hurlait, éructant, le visage tordu de haine, les lèvres ourlées de bave blanche « les Juifs dans le gaz ! » Cet élu assume aujourd’hui au nom de son parti d’importantes responsabilités au parlement régional… sans conteste une intégration réussie ! Un partage de nos valeurs ! Ah ! mais attention, nos valeurs ont peut-être changé ? L’antisémitisme en fait-elle partie ? Personne n’ayant cru bon de nous en avertir.
La gauche refuse de voir le réel, c’est une constante, s’il ne cadre pas avec ses fantasmes, prisonnière d’un humanisme généreux mais impuissant, isolant le réel de l’imaginaire, elle croit éviter les drames en ignorant les faits… l’insécurité n’existait pas, seuls les petits vieux éprouvaient un sentiment d’insécurité…tout autre chose n’est-ce pas ? En ignorant les faits, elle sera considérée comme complice des faillites de l’autorité publique. On le lui reprochera avec raison pendant longtemps.
En terme de respect de nos valeurs, de défense de la laïcité, à Bruxelles c’est Munich tous les jours !
Ceux qui aujourd’hui gouvernent la fédération auraient avantage à visionner un vidéo d’un congrès du parti Baas au Caire au début des années soixante. On y voit Nasser raconter qu’il a rencontré un Imam, celui-ci lui avait demandé que les femmes se voilent, Nasser, rigolant, lui avait répondu, qu’il n’avait que se voiler lui-même, toute la salle explosait de rire en applaudissant. A la même époque, sur les plages d’Egypte, on pouvait voir des femmes en bikini ! Quel recul ! Nasser était-il un « bon » musulman ? Combien de jeunes filles ou de femmes traversant certains quartiers se font elles insultées car elles n’arborent pas les vêtements qui agréent certains musulmans ? Un film en a fait la terrible démonstration, ce qui n’a pas empêché les bonnes âmes du politiquement correct de nier ces faits pourtant vérifiables chaque jour dans notre ville.
EXISTE-T-IL DES SOLUTIONS ?
J’ose à peine esquisser quelques pistes, conscient que les gardiens du temple, chiens de garde de la ligne du parti, ou ce qu’ils qualifient de tel, hurleront… mais bon, pourquoi te cacher que je m’en fiche royalement.
Au plan de la technique électorale, si on veut un équilibre entre les diverses composantes de la population bruxelloise, il est indispensable de limiter les votes de préférence à 3. Simple à réaliser… seulement un peu de courage !
Au plan des valeurs, pourquoi ne pas imaginer une charte que signerait chaque candidat s’engageant à respecter les valeurs essentielles des Droits de l’Homme et du Citoyen, en particulier l’égalité absolue homme-femme. Est-ce si compliqué ?
Au plan de la fédération bruxelloise, une charte devrait également être signée par les adhérents reprenant l’ensemble des valeurs sur lesquelles le PS a été fondé.
Au plan de l’enseignement, dans la lutte contre les ghettos scolaires, il est nécessaire de faire sauter les critères géographiques et mettre en place les mécanismes d’une vraie mixité dans toutes les écoles libres et publiques.
Au plan de l’apprentissage des éléments essentiels de notre culture et du respect de la culture des émigrés, organiser des cours relatifs à la culture des enfants émigrés, mettre en place des cours sur l’histoire des religions, sur ce qu’est la laïcité, des cours de citoyenneté qui ne se contenteront pas d’apprendre aux enfants le fonctionnement des feux de circulation ou la propreté bucco-dentaire. Des cours de citoyenneté et de langues devraient être organisés à l’intention des parents.
Au plan des repas scolaires, il n’y a aucune justification à fournir des repas conformes aux prescrits religieux, par contre les enfants doivent avoir le choix de menu de substitution ( végétariens ) ou autres.
Au plan des cours de natation et de gymnastique (niveau du primaire), ceux-ci doivent rester mixtes.
Au plan du logement, mettre fin aux règles absurdes qui conduisent aux ghettos, là aussi doit être imposée une mixité ethnique, sociale et économique
Au plan de l’octroi de la nationalité, celle-ci devrait s’accompagner d’une véritable adhésion à nos valeurs essentielles, sous forme d’un engagement formel et motivé. Il doit en aller de même pour l’octroi du statut de réfugié. Pourquoi ne pas oser une large réflexion sur les effets et conséquences de la double nationalité ! Symptomatique d’entendre récemment un député bruxellois d’origine maghrébine se plaindre des effets de la double nationalité qui d’après lui faisait de ceux qui en bénéficiaient des citoyens de « seconde zone. » Ben voyons ! De quoi s’agissait-il ? Un Belgo-Marocain ayant été arrêté au Maroc, ce député et quelques autres exigeaient que la Belgique en tant qu’Etat fasse pression pour le tirer de ce mauvais pas. Le gouvernement répondit que l’intéressé étant Marocain, il lui était impossible de réagir. C’est ce refus d’intervenir qui faisait dire à ce député que les bénéficiaires de la double nationalité étaient des citoyens de « seconde catégorie » ! Curieuse réaction en miroir ! Cela implique qu’on soit Belge quand cela présente un intérêt quelconque et qu’on est Marocain à d’autres moments. On ne pouvait mieux démontrer les ambiguïtés de la double nationalité. Attention, attention vade retro Satanas, mettre en évidence de tels raisonnements vous classe immédiatement dans le camp des pires racistes.
AVENIR ET PROGRÈS, RACINES DE NOS VALEURS.
J’ai déjà évoqué le trouble profond de la social-démocratie dans le monde, les élections qui se succèdent confirment l’effroyable ressac de notre représentation, quasi disparition du Pasok en Grèce, Hongrie, effondrement et division en Grande-Bretagne, phénomène identique en Pologne… dans l’attente de l’inévitable drame qui se profile en France. Lisant l’historienne française Mona Ozouf, je suis impressionné quand elle constate que si la gauche recule partout c’est notamment parce qu’elle a abandonné deux de ses piliers essentiels, les concepts d’avenir et de progrès. Ces notions sont les socles ontologiques sur lesquels se sont construits les idéaux socialistes. Il est donc permis à Régis Debray, tout en se revendiquant de gauche, d’écrire que pour la première fois, il n’y a plus d’après ni au ciel ni sur la terre. Incroyablement actuelle la définition du progrès par Michelet « Le progrès n’est pas du tout une ligne droite et suivie, c’est une ligne en spirale qui a des courbes, des retours énormes sur elle-même, des interruptions si fortes qu’il ne recommence qu’avec peine et lentement. » On croirait qu’il parle de ce que l’on connaît en ce moment ! Aujourd’hui, les annonceurs de catastrophes tiennent le haut du pavé, dominent l’aire médiatique, c’est clairement la profession qui fait florès. Nous sommes dominés par une eschatologie mortifère. C’est d’ailleurs philosophiquement passionnant car l’espérance en terme chrétien est donc remplacé par l’annonce d’un enfer climatique dont nous serions responsables. Le messianisme marxiste faisant croire aux lendemains qui chantent est battu sur toute la ligne. Après avoir espéré dans l’avenir… c’est l’enfer qu’on nous décrit. Pour le Progrès, c’est pareil, alors qu’il a servi de main courante à toute la philosophie socialiste, le voici avalé, englouti dans un pessimisme général, une méfiance à l’égard de la science. Qu’il suffise de songer aux efforts qu’il faut déployer pour soutenir les campagnes de vaccination.

A ce triste panorama s’ajoute la disparition du croquemitaine communiste, lui aussi a sombré étouffé par sa bureaucratie, sa médiocrité et ses mensonges. Or, les Etats communistes étaient essentiels à la social-démocratie, avec leur disparition, le « bâton derrière la porte » a été brisé. Le communisme ne fait plus peur, que dire alors de son avatar socialiste. Il n’est plus possible de soutenir qu’il faut nous céder « un peu » car si ce n’est pas nous… « ce seront les communistes ! » La chute d’une autre « Goldman Sachs » effraye beaucoup plus ! Ce changement de perspective a tout bouleversé, ce n’était pas la fin de l’histoire comme voulait le faire croire Fukuyama, c’était le début d’une autre histoire mais nous socialistes n’avons rien vu, nous contentant de porter les oripeaux d’un monde disparu. Dans cette histoire là, d’aucuns voudraient que nous n’ayons plus notre place. Nous croyions entrer dans l’Union européenne et nous devenions des personnages d’un sinistre « Socialist park ! »
On pourrait croire que ces dernières considérations m’éloignent de la problématique bruxelloise, il n’en est rien ! Car, s’il se joue sur les grandes scènes de l’histoire l’acte tant redouté d’un énorme basculement dans les gouffres de la droite, à Bruxelles, minuscule laboratoire de l’affaissement de nos valeurs, se déroule un vaudeville mal ficelé où le PS bruxellois n’est plus que la caricature de ce qu’il fût. Impossible d’éviter à Bruxelles que le comique supplante le tragique ! L’esprit dynastique, clanique et communautaire ayant pris la place des principes qui nous ont construits, ce n’est pas « Mr. Smith va au Sénat » mais la fille de la famille Beulemans devient députée régionale, normal, son papa était ministre. Seule question, celle-là toute personnelle, étant de savoir si cela vaut encore la peine de s’indigner, de contester, de se battre. Faut-il pour se justifier citer Hugo, tiens un type qui croyait dur comme fer dans l’avenir et le progrès, « ceux qui vivent sont ceux qui luttent. » Le grenier de ma mémoire est trop encombré des glorieux souvenirs des combats de la gauche pour que soit jugulé mon inépuisable réservoir de ressentiments. Je ne veux pas être l’un de ces nombreux déçus qui pourraient chanter « j’avais rêvé un autre rêve. » La gauche ne fait plus rêver… tu le sais Elio quand on ne rêve plus… On meurt !
Non ! Notre devoir est de surmonter les renonciations du désenchantement mortel, d’être capables de construire un autre rêve inscrivant les hommes dans un monde plus juste, plus humain dont les valeurs de la gauche resteront le socle ! La gauche, je n’ose pas parler de la gauche bruxelloise, ferait bien de méditer ce qu’écrit le philosophe Michael Foessel quand il suggère que « le fait de ne pas être réconcilié avec son passé constitue peut-être le seul moyen d’avoir un avenir. »
Voilà, Cher Elio, Ite Missa est ! Impossible que tu lises un jour cette pauvre lettre, trop longue, beaucoup trop longue, maladroite, sur les pitoyables successions dynastiques et communautaires à Bruxelles, finalement dérisoires ; tu règleras les comptes lors de la prochaine négociation communautaire et basta ! Roulez jeunesse…
Mais que m’arrive-t-il ? Ecrivant ces dernières lignes la tête me tourne tant l’oxygène que je respire maintenant est vif, la grille de lecture imposée aux socialistes bruxellois s’est brisée, les miasmes méphitiques de la pensée unique évaporés, disparus, je vais pouvoir être moi-même. Personne ne me dictera plus ce que je dois dire ou penser ! Soulagé… un mot s’inscrit sur mes lèvres, précieux, irremplaçable, essentiel, vital… LIBRE… enfin !
Hermanus Auguste Merry,
Bruxelles, le 9 Novembre 2015
Sur un sujet similaire :
Caricature antisémite : « Le PS doit réagir, sinon il ne bougera plus sur rien » (Le Vif, 2013)
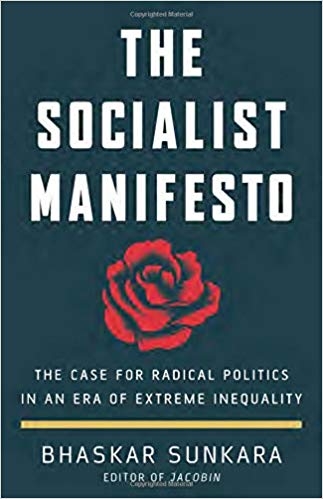 Through most of the book, the arguments are anchored in sturdy common sense, however much one might contest a point or emphasis here and there. On “Third World socialism,” for example, whether in China or Africa or the Americas, Sunkara is right that it turned Marxism on its head, so to speak: “revolutionaries embraced socialism as a path to modernity and national liberation. Adapting a theory that was built around advanced capitalism and an industrial proletariat, they struggled to find ‘substitute proletariats’—from peasants to junior military officers to deprived underclasses—to achieve these ends.” None of it was socialism in the Marxist sense, as coming from the breakdown (literal or not) of capitalism and signifying the liberation of humanity from alienated and exploitative production. It was a “socialism” subordinated to nationalistic ends.
Through most of the book, the arguments are anchored in sturdy common sense, however much one might contest a point or emphasis here and there. On “Third World socialism,” for example, whether in China or Africa or the Americas, Sunkara is right that it turned Marxism on its head, so to speak: “revolutionaries embraced socialism as a path to modernity and national liberation. Adapting a theory that was built around advanced capitalism and an industrial proletariat, they struggled to find ‘substitute proletariats’—from peasants to junior military officers to deprived underclasses—to achieve these ends.” None of it was socialism in the Marxist sense, as coming from the breakdown (literal or not) of capitalism and signifying the liberation of humanity from alienated and exploitative production. It was a “socialism” subordinated to nationalistic ends.



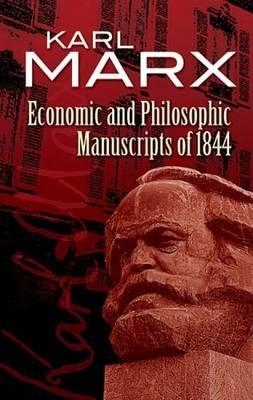 Et Marx commente et explique les passages cités :
Et Marx commente et explique les passages cités :
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg



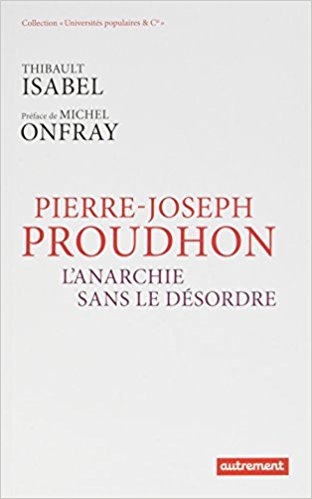
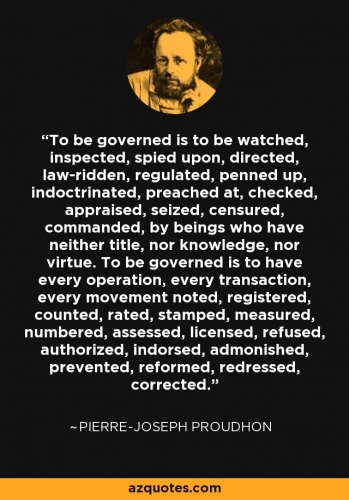



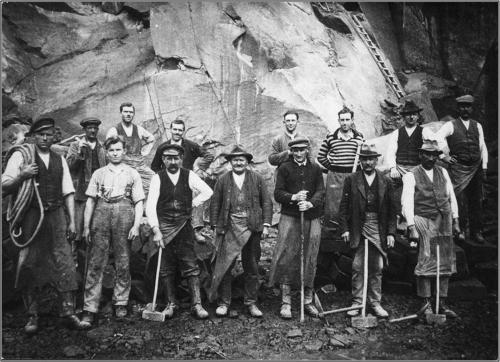


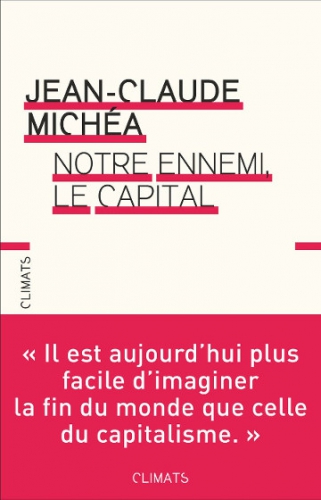
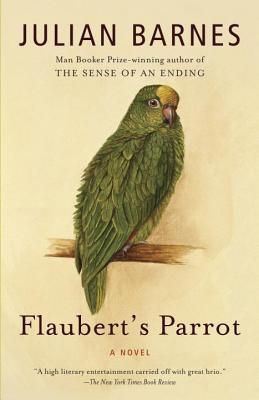 Here is what can be understood as a socialist (in Michéa’s sense of the word) comment by the Filipino writer Karlo Mikhail,
Here is what can be understood as a socialist (in Michéa’s sense of the word) comment by the Filipino writer Karlo Mikhail, 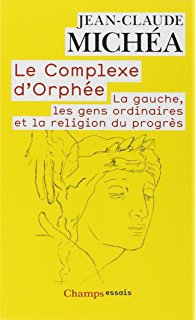 Michéa, like Marx, believes that development by internationalist capitalism acts as a centrifuge to separate the two extremes of those who possess capital from those who do not. Modern society offers increasingly fewer loyalties other than loyalty to the principle of individual competition in a free market. This is why all group adhesion and group loyalty, whether ethnic or geographic or of social class, is undermined or openly attacked by the proponents of progress. In the tradition of socialist conservatives going back to George Orwell, Michéa sees the simplification of language, the dumbing-down of society, and the failure of modern education as part of a pattern.
Michéa, like Marx, believes that development by internationalist capitalism acts as a centrifuge to separate the two extremes of those who possess capital from those who do not. Modern society offers increasingly fewer loyalties other than loyalty to the principle of individual competition in a free market. This is why all group adhesion and group loyalty, whether ethnic or geographic or of social class, is undermined or openly attacked by the proponents of progress. In the tradition of socialist conservatives going back to George Orwell, Michéa sees the simplification of language, the dumbing-down of society, and the failure of modern education as part of a pattern.
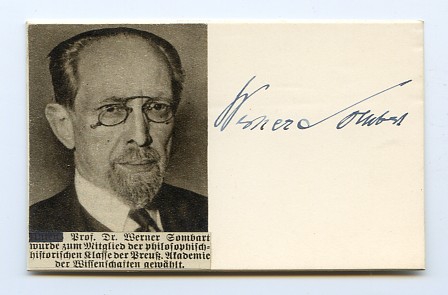
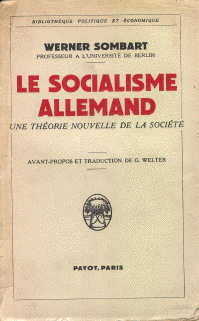
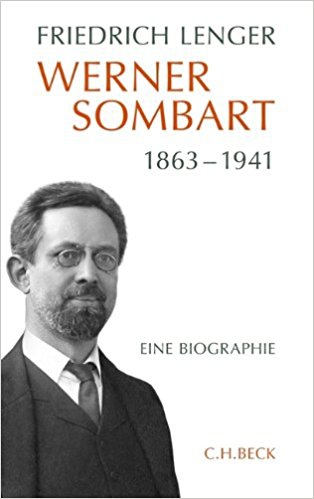
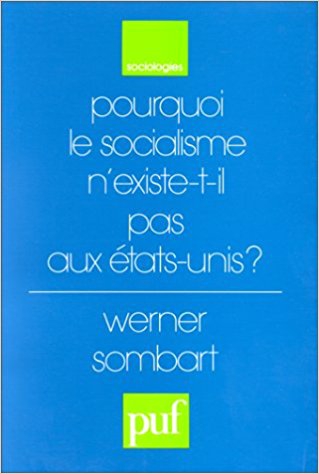



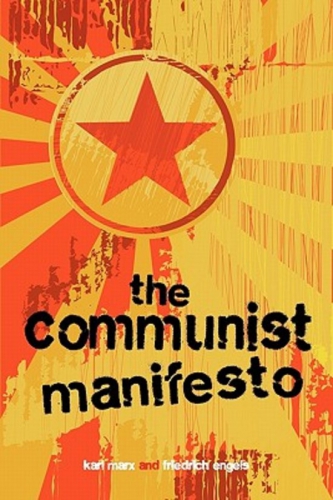 In English-speaking states at least, there is a muddled dichotomy in regard to the Left and Right, particularly among media pundits and academics. What is often termed “New Right” or “Right” there is the reanimation of Whig-Liberalism. If the English wanted to rescue genuine conservatism from the free-trade aberration and return to their origins, they could do no better than to consult the early twentieth-century philosopher Anthony Ludovici, who succinctly defined the historical dichotomy rather than the commonality between Toryism and Whig-Liberalism, when discussing the health and vigor of the rural population in contrast to the urban:
In English-speaking states at least, there is a muddled dichotomy in regard to the Left and Right, particularly among media pundits and academics. What is often termed “New Right” or “Right” there is the reanimation of Whig-Liberalism. If the English wanted to rescue genuine conservatism from the free-trade aberration and return to their origins, they could do no better than to consult the early twentieth-century philosopher Anthony Ludovici, who succinctly defined the historical dichotomy rather than the commonality between Toryism and Whig-Liberalism, when discussing the health and vigor of the rural population in contrast to the urban: Spengler, one of the seminal philosopher-historians of the “Conservative Revolutionary” movement that arose in Germany in the aftermath of the First World War, was intrinsically anti-capitalist. He and others saw in capitalism and the rise of the bourgeoisie the agency of destruction of the foundations of traditional order, as did Marx. The essential difference is that the Marxists regarded it as part of a historical progression, whereas the revolutionary conservatives regarded it as a symptom of decline. Of course, since academe is dominated by mediocrity and cockeyed theories, this viewpoint is not widely understood in (mis)educated circles.
Spengler, one of the seminal philosopher-historians of the “Conservative Revolutionary” movement that arose in Germany in the aftermath of the First World War, was intrinsically anti-capitalist. He and others saw in capitalism and the rise of the bourgeoisie the agency of destruction of the foundations of traditional order, as did Marx. The essential difference is that the Marxists regarded it as part of a historical progression, whereas the revolutionary conservatives regarded it as a symptom of decline. Of course, since academe is dominated by mediocrity and cockeyed theories, this viewpoint is not widely understood in (mis)educated circles.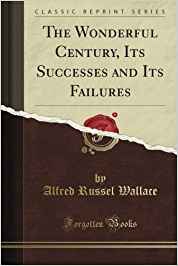 Not only is our century superior to any that have gone before it but . . . it may be best compared with the whole preceding historical period. It must therefore be held to constitute the beginning of a new era of human progress. . . . We men of the 19th Century have not been slow to praise it. The wise and the foolish, the learned and the unlearned, the poet and the pressman, the rich and the poor, alike swell the chorus of admiration for the marvellous inventions and discoveries of our own age, and especially for those innumerable applications of science which now form part of our daily life, and which remind us every hour or our immense superiority over our comparatively ignorant forefathers.[21]
Not only is our century superior to any that have gone before it but . . . it may be best compared with the whole preceding historical period. It must therefore be held to constitute the beginning of a new era of human progress. . . . We men of the 19th Century have not been slow to praise it. The wise and the foolish, the learned and the unlearned, the poet and the pressman, the rich and the poor, alike swell the chorus of admiration for the marvellous inventions and discoveries of our own age, and especially for those innumerable applications of science which now form part of our daily life, and which remind us every hour or our immense superiority over our comparatively ignorant forefathers.[21] Marx accurately describes the destruction of traditional society as intrinsic to capitalism, and goes on to describe what we today call “globalization.” Those who advocate free trade while calling themselves conservatives might like to consider why Marx supported free trade and described it as both “destructive” and as “revolutionary.” Marx saw it as the necessary ingredient of the dialectic process that is imposing universal standardization; this is likewise precisely the aim of Communism.
Marx accurately describes the destruction of traditional society as intrinsic to capitalism, and goes on to describe what we today call “globalization.” Those who advocate free trade while calling themselves conservatives might like to consider why Marx supported free trade and described it as both “destructive” and as “revolutionary.” Marx saw it as the necessary ingredient of the dialectic process that is imposing universal standardization; this is likewise precisely the aim of Communism.

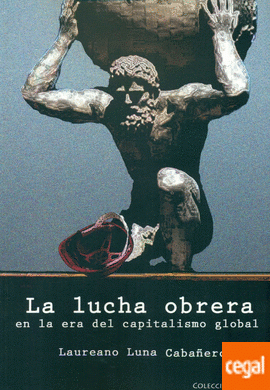 El proceso de tercermundización a través de la Globalización es ya evidente en España. En otros países es menos evidente pero se da igualmente: las condiciones laborales en la exitosa Alemania –que ha bajado sus índices de paro sin aumentar el número de horas trabajadas– son ya tercermundistas para una buena parte de los trabajadores. En Europa, si el proceso de Globalización no se detiene, más de cien millones de trabajadores van a quedar sometidos de nuevo a condiciones parecidas a las del capitalismo salvaje de hace dos siglos. Y, cuando la cultura social y laboral europea haya sido destruida, el capitalismo salvaje dominará sin oposición en el mundo entero.
El proceso de tercermundización a través de la Globalización es ya evidente en España. En otros países es menos evidente pero se da igualmente: las condiciones laborales en la exitosa Alemania –que ha bajado sus índices de paro sin aumentar el número de horas trabajadas– son ya tercermundistas para una buena parte de los trabajadores. En Europa, si el proceso de Globalización no se detiene, más de cien millones de trabajadores van a quedar sometidos de nuevo a condiciones parecidas a las del capitalismo salvaje de hace dos siglos. Y, cuando la cultura social y laboral europea haya sido destruida, el capitalismo salvaje dominará sin oposición en el mundo entero.
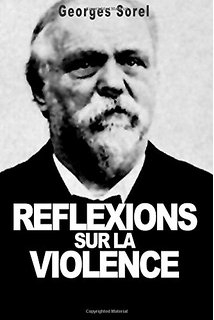
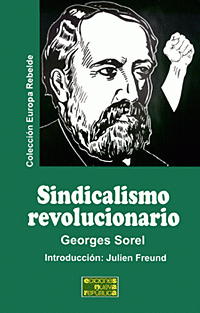 Sorels Einstehen für die Gewalt ergibt sich daraus, dass er den moralischen Zustand der bürgerlichen Gesellschaft haargenau getroffen hat: die bürgerliche Gesellschaft ist „aus den Fugen“. Der Bourgeois, ehemals ein energischer Kapitalist, ist zum schwächlichen Humanisten und Philanthropen degeneriert. Ihn zeichnen nicht mehr der Kampfgeist und der übersprühende Machtwille einer aufblühenden, sondern das Ruhebedürfnis und die Albernheit einer untergehenden Klasse aus: der Industriekapitän und der heroische Produzent von einst sind einer „gesittigten Aristokratie“ gewichen. Diese wünscht nur noch, in Frieden zu leben und sogar in Ruhe zu sterben.
Sorels Einstehen für die Gewalt ergibt sich daraus, dass er den moralischen Zustand der bürgerlichen Gesellschaft haargenau getroffen hat: die bürgerliche Gesellschaft ist „aus den Fugen“. Der Bourgeois, ehemals ein energischer Kapitalist, ist zum schwächlichen Humanisten und Philanthropen degeneriert. Ihn zeichnen nicht mehr der Kampfgeist und der übersprühende Machtwille einer aufblühenden, sondern das Ruhebedürfnis und die Albernheit einer untergehenden Klasse aus: der Industriekapitän und der heroische Produzent von einst sind einer „gesittigten Aristokratie“ gewichen. Diese wünscht nur noch, in Frieden zu leben und sogar in Ruhe zu sterben.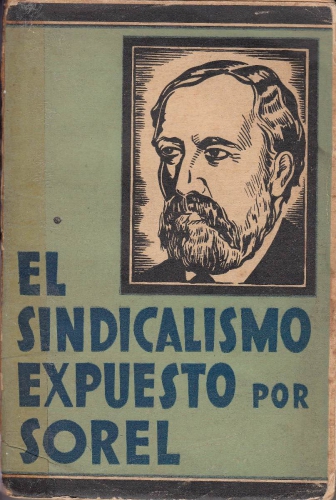

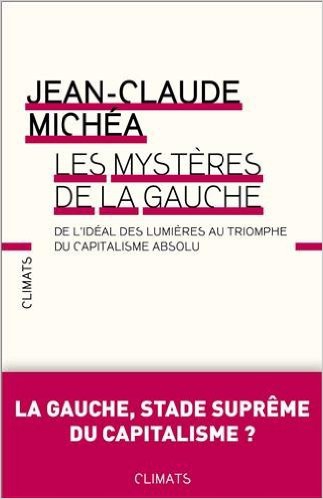



 Il 23 ottobre di cento anni fa Filippo Corridoni, giovane sindacalista rivoluzionario, già affermato agitatore politico, interventista, cadeva eroicamente all’età di 28 anni, dopo pochi mesi dall’entrata in guerra dell’Italia, nella cosiddetta «Trincea delle Frasche», nei pressi di San Martino del Carso. Il giovane soldato guidava un drappello di commilitoni cantando l’inno di Oberdan, avvicinandosi alle postazioni austriache. La sua «leggenda» fiorì immediatamente.
Il 23 ottobre di cento anni fa Filippo Corridoni, giovane sindacalista rivoluzionario, già affermato agitatore politico, interventista, cadeva eroicamente all’età di 28 anni, dopo pochi mesi dall’entrata in guerra dell’Italia, nella cosiddetta «Trincea delle Frasche», nei pressi di San Martino del Carso. Il giovane soldato guidava un drappello di commilitoni cantando l’inno di Oberdan, avvicinandosi alle postazioni austriache. La sua «leggenda» fiorì immediatamente. La morte di Corridoni, quindi, ha tutto il senso di un «sacrificio liberatorio» sotto due aspetti: la rivendicazione dell’indipendenza nazionale e l’affermazione dello «spirito nuovo» che muoveva i rivoltosi degli anni Dieci del Ventesimo secolo reclamanti nuove solidarietà in vista del «bene comune» della nazione che pretendevano finalmente sottratta, anche moralmente, all’egemonia della borghesia che aveva fatto il Risorgimento.
La morte di Corridoni, quindi, ha tutto il senso di un «sacrificio liberatorio» sotto due aspetti: la rivendicazione dell’indipendenza nazionale e l’affermazione dello «spirito nuovo» che muoveva i rivoltosi degli anni Dieci del Ventesimo secolo reclamanti nuove solidarietà in vista del «bene comune» della nazione che pretendevano finalmente sottratta, anche moralmente, all’egemonia della borghesia che aveva fatto il Risorgimento.
 2) Corbyn fait partie de cette “réaction de gauche”, comme Syriza, comme Podemos, même comme Sanders aux USA, de même qu’il y a une “réaction de droite”, comme le FN en France, les deux constituant les deux ailes d’une “réaction générale”... Mais “réaction” contre quoi ? “Contre de vrais dynamiques populaires qui s’expriment contre le Système, en faisant croire qu’ils (ces mouvements de ‘réaction’) les représentent alors qu’ils les canalisent et les contrôlent en vérité, parce qu’eux-mêmes (ces mouvements de ‘réaction’) sont en fait manipulés par la bourgeoisie et les oligarchies”, dit l’auteure en agitant sa pancarte “Trotski sinon rien” ; “Contre le Système, cette réaction de dynamique populaire passant par tout ce qui peut servir de véhicule pour ceux veulent exprimer leur position antiSystème”, dirions-nous en observant qu’il est préférable de ne pas faire compliqué quand on peut faire simple, d’autant plus que Trotski n’est plus parmi nous pour prendre les choses en mains.
2) Corbyn fait partie de cette “réaction de gauche”, comme Syriza, comme Podemos, même comme Sanders aux USA, de même qu’il y a une “réaction de droite”, comme le FN en France, les deux constituant les deux ailes d’une “réaction générale”... Mais “réaction” contre quoi ? “Contre de vrais dynamiques populaires qui s’expriment contre le Système, en faisant croire qu’ils (ces mouvements de ‘réaction’) les représentent alors qu’ils les canalisent et les contrôlent en vérité, parce qu’eux-mêmes (ces mouvements de ‘réaction’) sont en fait manipulés par la bourgeoisie et les oligarchies”, dit l’auteure en agitant sa pancarte “Trotski sinon rien” ; “Contre le Système, cette réaction de dynamique populaire passant par tout ce qui peut servir de véhicule pour ceux veulent exprimer leur position antiSystème”, dirions-nous en observant qu’il est préférable de ne pas faire compliqué quand on peut faire simple, d’autant plus que Trotski n’est plus parmi nous pour prendre les choses en mains.

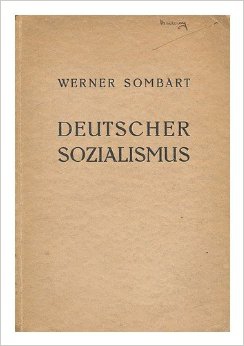 Wiewohl Sombart überhaupt den Einfluss eines säkularisierten Judentums für das Aufkommen von Kapitalismus und Sozialismus hoch anschlägt, so führt er doch nie beide kausal, d.h. schlechthin auf das Judentum zurück. Nur sei das spezifische Gepräge des modernen Kapitalismus wie des modernen Sozialismus „den Juden“ bzw. dem „jüdischen Geist“ zu verdanken, wobei Sombart übrigens letzteren – wie überhaupt alle „Volksgeister“ – von seiner leibseelischen Grundlage für ablösbar und sogar für übertragbar hält.
Wiewohl Sombart überhaupt den Einfluss eines säkularisierten Judentums für das Aufkommen von Kapitalismus und Sozialismus hoch anschlägt, so führt er doch nie beide kausal, d.h. schlechthin auf das Judentum zurück. Nur sei das spezifische Gepräge des modernen Kapitalismus wie des modernen Sozialismus „den Juden“ bzw. dem „jüdischen Geist“ zu verdanken, wobei Sombart übrigens letzteren – wie überhaupt alle „Volksgeister“ – von seiner leibseelischen Grundlage für ablösbar und sogar für übertragbar hält.


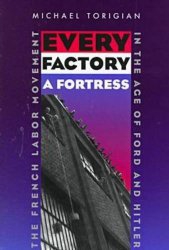


 The initial response of the communists was indifferent. PCF leader Maurice Thorez stated that there was “ no difference between bourgeois democracy and fascism. They are two forms of capitalism . . . Between cholera and the plague one does not choose.” On the 7th of February, the PCF rejected a socialist overture to form a united front against what was widely perceived as a Fascist coup attempt.
The initial response of the communists was indifferent. PCF leader Maurice Thorez stated that there was “ no difference between bourgeois democracy and fascism. They are two forms of capitalism . . . Between cholera and the plague one does not choose.” On the 7th of February, the PCF rejected a socialist overture to form a united front against what was widely perceived as a Fascist coup attempt. Worker support for the People’s Front government was further eroded in 1937 following the rise of the fascist Parti Sociale Français (PSF). Following the fatal shootings of six workers by policemen in an anti-fascist demonstration at Clichy on March 16th, which lead to a call for a half-day strike in protest of the killings, Blum threatened to resign if the strike went ahead, and then failing to do so, ordered the police to crackdown on the workers who allegedly instigated the violence at Clichy.
Worker support for the People’s Front government was further eroded in 1937 following the rise of the fascist Parti Sociale Français (PSF). Following the fatal shootings of six workers by policemen in an anti-fascist demonstration at Clichy on March 16th, which lead to a call for a half-day strike in protest of the killings, Blum threatened to resign if the strike went ahead, and then failing to do so, ordered the police to crackdown on the workers who allegedly instigated the violence at Clichy.


« Le courage de changer ce qu’il est possible de changer, la force de supporter ce qu’il est impossible de changer et surtout l’intelligence pour discerner l’un de l’autre. »
Saint François d’Assise.
Je t’écris cette lettre, tu la liras peut-être si tu en as le temps.
Mince alors ! En traçant ces lignes, je me rends compte que je commence mon courrier comme débute la chanson « le déserteur » de Boris Vian. Pourtant, crois-moi, je n’ai nullement envie de déserter notre vieille maison commune le PS, même si aujourd’hui elle m’apparaît ressembler au « grand corps à la renverse » dont parlait Sartre. Mais Sartre s’étant trompé sur tout, l’espoir nous est donc permis…ouf ! J’ai d’autant moins envie de fuir notre Parti que je t’adresse une série de propositions qui, je pense, pourraient peut-être nous permettre de retrouver nos racines.
Permets-moi d’insister, ce qui va suivre ne concerne que le PS bruxellois, je ne connais pas assez la situation en Wallonie pour me prononcer à son sujet. Je ne peux cependant m’empêcher d’évoquer la situation de la social-démocratie en Europe, car selon une formule classique en politique belge « tout est dans tout et inversement. »
Cher Elio, le dossier publié récemment par « le Vif » provoque de nombreuses interrogations, des doutes, des remous, décille les yeux. Pourtant, il ne fait que la synthèse de ce que j’observe depuis longtemps. Nombreux sont ceux que je rencontre qui estiment que l’article, pourtant déjà très interpellant, est bien en dessous de la réalité. Tous me disent leur malaise devant l’évolution de la fédération à la fois quant au mode de fonctionnement interne, plus particulièrement, quant à son évolution idéologique au niveau de la défense des valeurs constituant la colonne vertébrale du Parti et, de façon symptomatique la laïcité.
Merry Hermanus
CE QUE L’ON N’A PAS VOULU VOIR !
Démographie et Géographie sont des éléments évidents, déterminants, simples à observer, s’imposant de facto à tout décideur politique ou économique, pourtant nombreux sont ceux à Bruxelles qui ne prennent conscience « des terrifiants pépins de la réalité » qu’avec un étonnant retard. Pourtant, si une chose est bien faite en région bruxelloise, ce sont les statistiques. Certains, depuis longtemps croisent les données fournies par Actiris, la région, le ministère de l’intérieur, la Santé etc. Ce qui se produit depuis dix ans à Bruxelles est une véritable explosion démographique, laquelle se poursuit encore aujourd’hui. Les conséquences sont multiples, souvent catastrophiques vu l’absence de perspectives et de prévisions. Or, beaucoup de ces désagréments étaient évitables. Mais force est de constater que malgré notre présence quasi permanente à la tête de la région depuis 1988, rien n’a été entrepris, rien n’a été anticipé ! Il est inutile d’accabler les individus mais il faut rappeler que Picqué, disposant d’un charisme exceptionnel et d’une présence au pouvoir d’une durée tout aussi exceptionnelle, n’a rigoureusement rien fait, se contentant de commander une multitude de plans aussi divers que variés…et coûteux ! Rudi ss, en six mois de présence, malgré un environnement insidieusement hostile à la tête de l’exécutif, sans tambours ni trompettes a été plus efficace que Picqué en vingt ans.
POURQUOI CETTE NON GESTION ?
Indépendamment de facteurs personnels liés à la personne du ou des ministres présidents qui se sont succédé, se contentant de durer plutôt que de gouverner et prévoir, la vraie question est de savoir si la région de Bruxelles est institutionnellement gouvernable.
L’invraisemblable usine à gaz mise au point par Dehaene et Moureaux ne pouvait fonctionner que sur base d’une loyauté régionale réciproque entre Néerlandophones et Francophones. Or, les ministres flamands ont dès le début été très clairs, leur loyauté était d’abord et avant tout flamande. Certains de ces ministres ont été d’une particulière franchise en ce domaine, franchise assez rare en politique pour être soulignée. A de très nombreuses reprises, Brigitte Grouwels, ministre CVP a lourdement insisté pour souligner son lien indéfectible à la Flandre et le fait que Bruxelles n’avait qu’à se soumettre ! Que dire alors de son attitude en conseil des ministres. D’autres, plus hypocrites, ont eu la même attitude. Comment dans ces conditions tenter la moindre gouvernance avec un exécutif composé de huit ministres, dont trois Néerlandophones dont chacun peut bloquer en totalité le fonctionnement d’une tuyauterie crachoteuse. Le gouvernement est donc constamment coincé entre des exigences ou des blocages flamands et les élucubrations stupides de l’un ou l’autre ministre comme Smet n’hésitant pas à forcer la décision pour obtenir l’érection d’une piscine sur le canal, mobilisant ainsi vingt-cinq millions d’euros ! On y échappera de justesse. Une analyse fine des ordres du jour du gouvernement suffirait à démontrer la triste vacuité de son fonctionnement.
A cela s’ajoutent les aléas du mille-feuilles institutionnel bruxellois. La région compte un peu plus d’un million cent cinquante mille habitants, elle se découpe en dix-neuf communes, dix-neuf CPAS, plusieurs dizaines de sociétés de logement sociaux, un parlement de quatre-vingt-neuf députés ( sur l’élection desquels je reviendrai ) une VGC, une COCOM, une COCOF, une multitude d’O.I.P économiques ou sociaux… et j’en oublie. La région pourrait gagner pas mal d’argent en faisant breveter son puzzle institutionnel, en le commercialisant comme ce fut le cas du Monopoly en 1930 ; certain qu’il y aurait là une niche à exploiter ! Tout observateur objectif ne peut que conclure que l’usine à gaz est bonne pour la casse, plus rien ne fonctionne correctement, tout le monde le sait, tout le monde le constate…mais nombreux sont ceux qui en vivent. L’exemple du cadre linguistique de la région est emblématique, cassé pas moins de trois fois en suivant par le Conseil d’Etat, il fut chaque fois représenté quasi tel quel par le gouvernement bruxellois dans la mesure où les Flamands exigent une part de 29,77% des emplois alors que cela ne correspondait nullement aux comptages des dossiers effectués en vertu de la loi ! Comment dans ces conditions exiger le dynamisme de la fonction publique régionale. Mais voilà, la petite classe politique bruxelloise vit… et fort bien, de ce fouillis d’institutions disparates mais juteuses. Comment demander à cette foule d’élus de toutes sortes, communaux, sociaux, régionaux, mandataires de généreux OIP de se faire hara-kiri ? Impensable ! Mais en attendant…
LA PAUPÉRISATION.
Il y a un étonnant parallèle à faire entre le bourgeonnement, l’incroyable foisonnement institutionnel de Bruxelles et l’évolution des revenus dans la région. Les courbes sont parfaitement inverses, plus les institutions régionales se multiplient, se diversifient, plus la courbe des revenus des habitants de la région s’effondre ! La part bruxelloise dans le PIB national s’est effondrée. L’analyse des statistiques, quel que soit le domaine, démontre une paupérisation qui se lit à l’œil nu dans les différents quartiers de la région. Les Bruxellois sont de plus en plus pauvres, les problèmes sociaux s’accumulent, s’aggravant année après année, se multipliant sans cesse. Depuis la fin des années septante, la classe moyenne payant l’impôt a voté avec ses pieds, quittant la région. Elle a été remplacée par une population d’infra-salariés, d’assistés sociaux à l’avenir professionnel de plus en plus problématique. On objecte toujours à cela le taux de création d’emploi, le plus élevé du pays… ce qui est exact. Mais les Bruxellois n’en bénéficient pas ! Il y a près de sept cent cinquante mille emplois à Bruxelles, plus de deux cent mille sont occupés par des Flamands et plus de cent cinquante mille par des Wallons. Ces navetteurs génèrent des coûts considérables pour la région… mais payent leurs impôts dans la commune de leur domicile. Si on recourt à une analyse plus fine, il apparaît que les cadres supérieurs sont majoritairement des navetteurs. Pour nettoyer les bureaux, il reste des Bruxellois !
Les derniers chiffres du baromètre social bruxellois synthétisent parfaitement ces questions. On y découvre que près d’un tiers des Bruxellois vit sous le seuil de pauvreté, soit avec moins de 1085 euros par mois. La moyenne belge se situe entre 14 et 16 %. Donc à Bruxelles, c’est près de trois fois plus de gens qui se trouvent sous ce seuil fatidique. Or, ces statistiques prennent en compte : les revenus, le travail, l’instruction, la santé, le logement et la participation sociale. Si le PIB à Bruxelles est de 61.899 euros pour 26.183 en Wallonie et 35.922 en Flandre, ce n’est que parce que 50 % de emplois sont occupés par des navetteurs. Enfin, et cela n’étonnera personne, 23,50 % des Bruxellois perçoivent une allocation ou un revenu de remplacement ; ce chiffre est en progression de 1,6 % par rapport à 2013. Le pire est que cette chute vertigineuse des revenus bruxellois se poursuit sans discontinuer depuis les années septante. Jamais on n’a pu observer le moindre redressement. Une véritable descente aux enfers…Mais qui n’émeut personne. Les exécutifs se succèdent, les ministres se suivent tout sourire, les programmes électoraux s’effeuillent, les promesses se multiplient… s’envolent… mais la seule courbe de croissance est celle de la misère ! Une question doit se poser, cette région telle qu’elle est institutionnellement constituée est-elle gouvernable ? Est-elle viable ? La réponse, évidente pour tous, est clairement non !
Cette situation n’a pas seulement un impact social, elle y a aussi d’importantes conséquences urbanistiques. La région est structurée, façonnée, dessinée, et cela se comprend, pour faire face à cette arrivée journalière de ce flot de Flamands et de Wallons ; charge considérable pour Bruxelles, sans commune mesure avec les contreparties chichement concédées à la région par le fédéral qui plus est, les oriente souvent sans tenir compte des intérêts bruxellois. Il n’est pas rare que des mandataires bruxellois s’entendent dire par des auteurs de projet désignés souverainement par le pouvoir fédéral : « il faut que vous bruxellois commenciez à vous adapter ! » Ah ! bon s’adapter mais à quoi ! Oserai-je le penser…à une administration d’occupation !
Posons-nous la question de savoir pourquoi il n’y a pas à Bruxelles de péage comme à Londres ou à Stockholm ? Ce sont de splendides réussites. La région de Bruxelles est le cas typique où cela devrait être appliqué ! Eh bien non ! Cela déplaît. Pardi, on l’aurait juré. Ni les Flamands, ni les Wallons n’en veulent !
Comment ne pas évoquer certains aménagements aberrants. Mais dans la mesure où le pouvoir à Bruxelles est parcellisé, il n’y a pas de dialogue, le rapport de force étant toujours défavorable aux bruxellois.
Quand la ville de Bruxelles décide de faire un piétonnier, l’impact sur toute la région est évident… mais dans les autres communes pourtant largement influencées par cette décision, on fait autre chose, on regarde ailleurs ! Le bourgmestre de Bruxelles n’a pas de véritables interlocuteurs.
Les chiffres du chômage, même flattés, ne laissent aucun doute, non seulement sur la paupérisation mais, et c’est beaucoup plus grave, sur sa perpétuation, sa constante augmentation. Le taux de chômage est le plus élevé à Bruxelles, pour ce qui concerne le chômage des jeunes il atteint l’effroyable record de 30 %, 40 s’il faut croire les chiffres du VOKA. Ne soyons pas dupes, les baisses dont il est question récemment sont le fruit des dernière mesures gouvernementales, sur lesquelles je n’ai pas le cœur de m’appesantir… il « saignerait ! » Je n’évoque pas le chômage des femmes dans ces mêmes quartiers, il dépasse les 45 %.
On le sait, en démocratie il y a deux légitimités. D’abord celle des urnes, le suffrage universel. A Bruxelles, ces principes fondamentaux sont clairement violés, le nombre de voix pour élire un Néerlandophone est nettement inférieur à celui nécessaire pour élire un Francophone. Résultat, parmi les élus flamands certains le sont avec quelques centaines, voire quelques dizaines de voix… et deviennent ministres alors qu’ils ne sont les élus que d’un nombre infime d’électeurs de la région. Peut-on encore parler de légitimité ? Les élus flamands au parlement bruxellois ont moins de légitimité démocratique que le gagnant d’un concours de la télé-réalité. Mais il est un autre critère de légitimité, celui-ci beaucoup plus subtil, c’est celui de la réussite dans l’action. Or, on l’a vu, la région est sinistrée au plan social, la courbe est descendante depuis les années septante, le tissus urbain se dégrade sans discontinuer, la mobilité est chaotique, l’engorgement est généralisé et fait rire l’Europe, la paupérisation galopante, l’enseignement sinistré, l’insécurité croissante etc. De cette légitimité là aucun politique bruxellois ayant siégé dans l’exécutif ne peut se prévaloir. Peut-on en vouloir aux citoyens qui se désintéressent, se détournent de la vie politique, rejoignent la horde grandissante clamant le « tous pourris, tous incapables. »
Ne serait-ce l’étonnante médiocrité parfois jusqu’au pathologique des rares représentants de l’extrême droite, le triomphe serait lui assuré. Un journaliste de « Libération » a, il y a quelques temps osé faire publiquement ces constatations … quels cris, quel scandale… c’était pourtant la triste vérité.
Bien sûr on dessine sur le sol des voiries, des pistes cyclables, les communes élaborent des plans de circulation aberrants, les bobos seront comblés, il y a les stupides journées sans voiture. L’idéal de certains n’est-il pas de faire de Bruxelles une réserve d’indiens, d’indiens pauvres, assistés socialement, ficelés électoralement, habillés de lin écru, mangeant des légumes bio, déféquant dans des toilettes sèches, se déplaçant à vélo, n’utilisant pas de GSM, végétaliens et surtout ne se reproduisant pas… on viendra les voir en car comme les Flamands le font déjà qui visitent avec un guide, prudence quand même, le quartier maritime de Molenbeek ou Matonge ! « Pensez donc, beste vrienden, à une heure de Gand, à quarante-cinq minutes d’Anvers, l’exotisme, le pittoresque chaleureux, bruyant de l’Afrique à Matonge ; le frisson de l’inquiétante Casbah à Molenbeek, l’étrangeté des femmes voilées, les hommes barbus en djellaba…comme là-bas dis…, tout un monde. N’oubliez pas de bien vous laver les mains en rentrant à Gand ou à Anvers…dans ces coins de Bruxelles, on ne sait pas ce qu’on peut y rencontrer ! Ebola, malaria, maladies tropicales, djihadistes » Ah ! Un détail, oh ! une toute petite chose, ils vivront de quoi ces « indiens » Bruxellois… oui au fait, de quoi vivront-ils ? A moins que les visiteurs les plus audacieux ne leur lancent , « à ces sujets de zoo humain, » quelques trognons de maïs…quelques chèques repas…les voir manger pourrait être drôle non !
ET LE PS !
Le malaise est perceptible partout. D’abord il y a le doute, peut-être le mensonge lourd, irrémissible ; chacun sait que le leadership est assumé par quelqu’un qu’on accuse, à tort ou à raison, de ne pas réellement habiter à Bruxelles, qui donc ne respecterait pas un aspect essentiel de la vie politique, à savoir, subir ce que vivent ceux qu’on est sensé représenter, défendre. Ce doute a déjà été lourd de conséquence, il le sera encore demain ! La relation avec le citoyen en est dès l’abord viciée. Il s’agit là d’une faute impardonnable, inconcevable. Elle n’est possible que parce que les militants, force d’impulsion, de proposition mais aussi de contrôle, n’existent plus.
Pendant des décennies, les listes électorales étaient établies sur base de pools. C’était connu de tous, les tricheries ne manquaient pas, les uns bourraient les urnes, les autres modifiaient les scores. Néanmoins, les formes étaient respectées, la démocratie restait un objectif…parfois lointain, j’en conviens ! On ne pouvait pas tout se permettre ! Ensuite vinrent les comités des sages puis s’abattit l’obscurité totale, le rideau de plomb ; une étonnante alchimie préside maintenant à l’élaboration des listes d’élus ; il n’est plus question de comité des sages mais d’un comité secret, c’est là qu’on agite le shaker d’où sortira le breuvage qui sera servi aux électeurs. Les résultats sont connus d’avance, la bouillabaisse comprenant une dose massive de Belges issus de l’immigration, logique vu la démographie de la population et de filles ou de fils de…ainsi naît sur les navrants décombres d’une idéologie une nouvelle aristocratie, dont les fiefs sont constitués d’une masse d’électeurs d’origine étrangère, un cheptel sur lequel on règne sans vergogne. Moderne féodalité… totale rupture avec une idéologie à l’allure d’astre mort ! La presse avait relevé lors des dernières élections cette présence massive des fils et filles de, mais les journalistes ne les avaient pas tous repérés, certains liens de parenté étant plus discrets ou mieux dissimulés, dans certains cas le nom de la mère était connu mais pas celui du père, de plus il fallait en outre tenir compte des compagnons, compagnes, nièces ou neveux. Qui osera encore dire qu’à Bruxelles le PS n’aime pas la famille, étonnant que la présidente fédérale n’ait pas été invitée au dernier synode de Rome consacré à l’avenir des familles, cette parole experte a manqué ! Il faut être de bon compte, les dynasties politiques ont toujours existé, y compris au PS, il suffit d’établir les liens entre les familles Spaak et Janson. C’est par son caractère massif que le phénomène à Bruxelles est devenu remarquable et grignote le fonctionnement à long terme du parti qui, de fait, devient ce que l’on connaît bien en Afrique, une addition de clans. Amusante, révélatrice d’ailleurs cette importation des mœurs politiques subsahariennes. Les conséquences sont multiples, à commencer par le fait que des candidats potentiels de grande qualité, n’étant ni d’origine maghrébine, n’ayant aucun lien de parenté avec l’un ou l’autre des leaders de la fédération, estiment qu’ils n’ont pas la moindre chance d’être à une place où ils auraient une petite chance d’être élus ! Ceux-là partent, disparaissent ; ils planquent comme hauts fonctionnaires mais ils manquent cruellement à notre action politique. Anne Sylvie Mouzon, excellente parlementaire avait l’habitude de dire que sur l’ensemble du groupe socialiste seuls quatre ou cinq individualités étaient actives ! Les autres, bof…
J’évoquais une nouvelle aristocratie, en ce sens l’interview de Catherine Moureaux dans « Le vif » est emblématique tant ses réponses sont d’une stupéfiante naïveté, à les lire on éprouve un sentiment de compassion pour cette jeune femme s’exprimant avec tous les tics de langage communs à la haute bourgeoisie, nimbée de l’autorité naturelle de ceux qui parlent sans jamais être contredits, nés pour être obéis, nés pour gouverner le destin de la plèbe. Pour tenter d’exister politiquement, elle feint dans l’article de croire que les cinq mille et quelques voix obtenues lors des dernières élections, l’ont été grâce à son seul mérite…la pauvre, le réveil pourrait être dur ! Très dur ! Quinze jours plus tard, « Le Vif » nous apprend que le fils Uyttendael « prend le bus », il y côtoie le peuple…de l’héroïsme quoi ! Est-ce vraiment là « la gôche ! » A lire ces interviews une profonde tristesse m’envahit tant ces deux jeunes gens m’apparaissent déjà oublieux du bonheur d’être eux-mêmes.
Autre conséquence, le nombre d’affiliés a fondu comme neige au soleil. Les chiffres sont secrets…un comble dans un parti de gauche, certains permanents retraités parlent et évoquent les vingt-cinq mille membres de 1974 et le fait qu’ils seraient moins de trois mille cinq-cents en 2015. Les militants ont disparu, évaporés. Il faut dire que le fonctionnement de la fédération fut des plus curieux pendant plus d’une décennie alors que partout l’élection du président fédéral se faisait au suffrage universel, seul à Bruxelles il était élu par le congrès où deux sections sur dix-sept, Anderlecht et Molenbeek, faisaient à elles seules la majorité…dès lors tout était simple, il suffisait de « ménager et… nourrir » Picqué et l’ordre, comme à Varsovie en 1830, pouvaient régner.
Le départ des militants a conduit un grand changement dans les campagnes électorales, plus rien ne fonctionne sur base du bénévolat, tout se paye, tout se rémunère, les collages, les distributions toutes boîtes. Ce n’est pas anecdotique mais lourdement symbolique. Logique aussi dans de telles conditions que la rupture soit consommée entre les organisations de l’action commune, plus besoin de syndicat, de mutuelle, d’organisation de jeunesse…tout le monde suit seul son chemin !
STRATÉGIES DYNASTIQUES ET COMMUNAUTARISME, LES DEUX MAMELLES DU PS BRUXELLOIS.
Les militants se sont évanouis mais il reste l’essentiel… des électeurs. J’y reviendrai. Au niveau du parti la structure est donc devenue la suivante : une bonne base électorale, des élus majoritairement issus de l’immigration, sans oublier la crème, cerise sur le gâteau, une dose de plus en plus importante de fils, filles, compagnons, compagnes, nièces ou neveux de… La classe intermédiaire des militants a disparu, elle s’est volatilisée, donc plus de contrôle, plus de contestation, plus de compte à rendre. Les congrès ne sont qu’une chambre d’enregistrement, garnie de nombreux membres de cabinet à qui le choix n’est pas donné, ils ont l’ordre d’être présents ! Pas de discussion, doigt sur la couture du pantalon, sinon… Qui pourrait au PS bruxellois impulser une autre politique, remettre en cause les décisions, où est l’opposition ; sans opposition pas de démocratie ! La preuve est faite.
Je note d’ailleurs que les instituts de sondages se trompent la plupart du temps en ce qui concerne le PS bruxellois car ils évaluent avec difficulté le poids de l’électorat issu de l’immigration, ils ne le connaissent que très mal, n’ont aucune idée des liens sociologiques, de la fidélité de la masse de nos électeurs d’origine étrangère, d’où une sous-évaluation systématique de nos résultats. Si un jour cet électorat devait disparaître ou s’étioler, nul doute que le PS se trouverait réduit à des chiffres très semblables à ceux du CDH. D’où le malaise en matière de laïcité, l’abdication quant à certaines attitudes, ce contact nauséabond avec les mosquées, la veule soumission quant aux exigences visant les femmes, les horaires des piscines, la nourriture etc. Mais attention, le vote socialiste n’implique pas de la part de cet électorat communautaire une adhésion ou même la simple connaissance de nos valeurs ! On a raté la transmission… tragique dans une famille. Avec stupeur, les derniers militants ont constaté qu’au PS bruxellois tout en matière de laïcité est négociable. J’y reviendrai !
Il n’y a donc plus de classe intermédiaire entre l’électorat et les élus ; les forces vives du parti, ses militants, ont disparu, reste une caste d’élus, rejetons dynastiques et la masse de ceux qu’un chercheur de la KUL d’origine maghrébine appelait récemment dans « Le Soir » « le bétail à voix, » qu’il estimait sous-représenté… j’ose supposer que ce chercheur flamand ne songeait pas à Bruxelles ! La disparition des militants conduit à d’étonnantes surprises. Ainsi voit-on surgir sur les listes électorales de parfaits inconnus, quasi absents de leur section locale, à peine affiliés, et encore pas toujours, (on se rappellera du fasciste turc sur une liste communale du PS, ce cas n’était ni accidentel ni unique ) totalement absents de la vie politique locale, n’ayant aucune présence sur le terrain, mais qui réussissent des scores de rêve et parfois sont élus dépassant une bonne partie des autres candidats sur la liste. Il suffit pour s’en convaincre de reprendre les listes fédérales ou régionales du PS à Bruxelles, de regarder les scores et de mettre ceux-ci en rapport avec le militantisme dans les sections. Victor Hugo disait : « il y a du champignon dans l’homme politique, il pousse en une nuit. » Cela n’a jamais été plus vrai qu’à Bruxelles. Dans de nombreux cas, personne au sein de la section locale ne connaît ce recordman ou cette recordwoman. La raison du succès est simple, ce candidat ou cette candidate a appuyé sur un bouton, un seul… le bouton miracle, le bouton communautaire. Pas besoin de faire beaucoup d’efforts, il suffit à l’électeur de déchiffrer le patronyme, imparable boussole électorale bruxelloise. Dans de telles conditions doit-on encore défendre la laïcité ? Peut-on encore imaginer résister aux exigences religieuses d’un autre âge ?
L’essentiel aujourd’hui au PS, ce sont les liens de parenté et les circuits communautaires, le militantisme n’a plus sa place… quant à la réflexion, les idées ! Il n’y a plus que très peu de rapport entre les campagnes électorales faites par les candidats et les valeurs fondatrices du PS. Le tramway, ligne directe vers le mandat implique une filiation dynastique ou un lien communautaire, sans cela pas de mandat, c’est le cul-de-sac. Les « tuyaux » d’accès au pouvoir ont changé…et comment ! A Bruxelles, les campagnes ne sont plus que communautaires, le programme ne compte que pour la presse et les adversaires, un nombre considérable de candidats s’en fichent complètement. Alors que pendant des années tu as insisté pour que nous évitions le communautarisme, aujourd’hui, c’est la dominante principale. Les tracts en arabe, en turc en albanais sont légions, plus personne ne s’en offusque à la fédération bruxelloise. Les temps ont changé, les militants se sont évanouis, nos valeurs sont chaque jour écornées. L’un des élus phare de l’une des importantes communautés de la région, occupant des responsabilités politiques majeures, n’hésite plus à dire « toutes les campagnes doivent être communautaires, Laanan et Madrane n’ont rien compris s’ils ne le font pas. » Au-delà de la question fondamentale de la transmission et de l’adhésion à nos valeurs, se pose indéniablement la question de la sauvegarde des principes de laïcité pour lesquelles nos prédécesseurs ont lutté pendant tant d’années contre l’hégémonie religieuse. Qu’on n’oublie pas qu’il nous a fallu des dizaines et des dizaines d’années d’âpres combats pour laïciser notre vie publique, échapper à l’oppression cléricale.
Comment dès lors concevoir que dans certaines écoles de la région la totalité de la viande servie soit hallal, le fournisseur répondant lors de l’appel d’offre : « ainsi il n’y a plus de problème ! »
Comment accepter que certaines piscines communales se soient soumises ( le plus souvent hypocritement ) à l’établissement d’horaires séparés par sexe !
Comment expliquer que la région de Bruxelles soit la seule qui n’ait pas osé bannir l’abattage rituel et laisse se poursuivre ces monstruosités.
Comment admettre que dans une grande commune de la région, l’ouvrier communal qui sert les repas scolaires à chaque cuillerée servie, fasse suivre celle-ci de la formule en arabe : amdulila ( grâce à Dieu ) !
Il y a quinze ans, un enseignant de l’athénée royal de Laeken donnant une interview dans le « Vlan » avait évoqué son incapacité d’enseigner les notions du darwinisme à ses élèves. Cet article fit beaucoup de bruit, cet enseignant fut traité de raciste quasi de nazi. Or, il disait vrai, de nos jours ce genre d’incidents est courant. Mais l’omerta règne, il y a des choses dont on ne peut pas parler. Je n’évoque pas ici les étranges réactions de certains professeurs musulmans lors des assassinats de Paris au début de cette année, ni le fait que le cours de religion se dispense systématiquement en arabe alors qu’il devrait l’être en français ! Ni le fait que certaines enseignantes de la religion islamique refusent de serrer la main de leurs collègues masculins rappelant que selon elles, la main recèle cinq zones érogènes !
Comment ainsi accepter sans réagir l’irruption du moyen-âge dans notre sphère publique ! A Bruxelles, c’est tous les jours, non pas retour vers le futur, mais retour vers le passé et quel passé ! On a l’impression d’entrer dans l’avenir à reculons.
Comment admettre que les élèves musulmans manquent systématiquement les derniers cours de l’année scolaire si les parents ont décidé de partir en vacances, je n’évoque même pas les jours de fêtes religieuses où dans certaines communes les classes sont vides, le cours étant ajourné d’autorité ! Sans réaction des autorités, bien au contraire des consignes sont données aux enseignants de ne pas donner cours, « d’occuper » les trois ou quatre présents.
Pourquoi camoufle-t-on les incidents qui émaillent les récréations au cours desquelles des gosses sont pris à partie lorsqu’ils mangent du jambon ou ne font pas le jeûne du Ramadan !
On pourrait poursuivre cette liste indéfiniment. Le relativisme culturel, lourdement prôné, accepte aujourd’hui le voile, demain il fera accepter l’excision au nom de la même effarante régression à la fois lâche et ignoble unissant la haine des valeurs issues de 1789 et un sordide cynisme de boutiquier électoral. On le voit, c’est dans le silence, à l’abri d’un discours intimidant que l’on serre le garrot qui cran après cran étrangle la laïcité, installe concession après concession, petits aménagements après petits aménagements, petites lâchetés après petites lâchetés… à haut rendement électoral, une société où le fait religieux envahit, pollue, domine à nouveau le domaine public.
COMMENT RÉAGIT LE PS BRUXELLOIS.
Aujourd’hui, il est évident qu’il est prisonnier de son électorat dont les gros bataillons, qui osera le nier, sont issus de l’immigration. Tout ne fut pas négatif dans cette évolution. Il est remarquable que le PS ait su tisser des liens de confiance avec ces communautés alors que d’autres formations politiques, qui s’en mordent aujourd’hui les doigts, les méprisaient ouvertement.
Impossible dans ce contexte de ne pas évoquer Moureaux et les vingt ans pendant lesquels il a dirigé Molenbeek qu’il a transformé en laboratoire de la porosité du retour du religieux dans notre région. Ses réactions et son évolution sont emblématiques de l’évolution, de l’attitude du PS dont il fut pendant la même période le président fédéral.
Débarquant à Molenbeek en 1982, il mène la campagne communale sur le thème du « stop à l’immigration. » De nombreux tracts ont été conservés, étonnantes et encombrantes archives. Il débat à la même époque sur La RTBF matinale, il y est opposé à Albert Faust, secrétaire général du SETCA de Bruxelles Halle Vilvorde et s’oppose obstinément au vote des étrangers aux élections communales alors qu’Albert Faust lutte avec la FGTB pour l’obtenir. La RTBF dispose toujours de la cassette, on peut la réécouter… un régal d’anachronisme, une grande leçon sur l’adaptabilité du monde politique aux dures réalités électorales. En 1986, écrivant dans un journal communal consacré à l’enseignement, il évoque la nécessaire assimilation des citoyens d’origines étrangères. Au cours de la même période, il évoque plusieurs fois ses regrets que l’on ait reconnu l’Islam en qualité de religion subsidiée. De nos jours, même le terme « intégration » est devenu un gros mot ! Quelle adaptation ! Certains ne le prononcent que la bouche en cul de poule, se tordant les lèvres ayant hâte de se les désinfecter. N’est-on pas étonné de la timidité avec laquelle le gouvernement bruxellois envisage le parcours d’intégration qui devrait être mis en place. On l’évoque en catimini, entre deux portes, avec la prudence que l’on met à manipuler de la dynamite. Il ne s’agit pas ici de fustiger Moureaux, sans doute a-t-il plus d’excuses que beaucoup d’autres, n’ayant jamais eu, de par son milieu, aucune connaissance des milieux les moins favorisés. On le sait le marxisme lui fut injecté par voie ancillaire ! Pour la première fois de son existence grâce aux émigrés, il découvrait extatique, enfin comblé, à Molenbeek, ceux qu’ils ne connaissaient qu’au travers de ses lectures. Il allait enfin se sentir utile et renouer avec la grande tradition des ouvroirs des dames patronnesses… aider ses pauvres. Rendons lui cette justice, il a considérablement rénové sa commune, lourdement investi dans l’urbanisme mais il n’a pas investi dans les cerveaux ! On va le voir, c’est le sien qui s’est adapté, modelé… soumis. Il s’est appuyé sur les mosquées pour que celles-ci encadrent les jeunes, qu’il n’y ait surtout plus d’émeutes… pas de problème, les grands frères seront généreusement subsidiés… sans le moindre contrôle sur le terrain. Moureaux pensait du haut de ses origines sociales, de sa prestigieuse fonction académique, de ses multiples charges ministérielles et politiques que les mosquées seraient de fidèles courroies de transmission de sa volonté. Et…patatras, c’est lui qui a été roulé dans la farine par les barbus. Il ne s’est pas rendu compte, prisonnier de son orgueil de classe qu’il devenait « l’idiot utile » des forces les plus obscurantistes, moyenâgeuses, de sa commune. C’est lui, le professeur émérite de critique historique qui, au fil des ans, est devenu l’inattendu relai des revendications les plus obscurantistes. Le harki c’était lui, amusant non ! La politique qu’il a mise en œuvre est étonnante par son classicisme. Ce fut celle du colonialisme qui s’est appuyée sur les chefs coutumiers pour que les indigènes ne s’agitent pas. C’est une politique strictement maurassienne dans laquelle la religion est avant tout un encadrement social. Pour tout dire, c’est une politique conservatrice au sens strict du terme, curieuses pratique pour ce marxiste auto proclamé ! En définitive son marxisme mal assimilé n’est-il pas pour paraphraser Jean Cau que « le gant retourné du christianisme ? » Ce n’est qu’au fil du temps et du remplacement de la population belge de souche de sa commune par des émigrés qu’il comprit le rôle électoral que cette population allait jouer à Bruxelles. Il faut lui rendre cette justice d’autant plus qu’il poussera jusqu’au bout le don de sa personne, allant même jusqu’au sacrifice suprême, moderne Abraham, puisque maintenant il « immole » sa fille Catherine, il la livre, innocente enfant, à ce peuple émigré, pauvre, fragilisé, mais exigeant un total don de soi, en ce compris le rejet des valeurs de la laïcité.
Ainsi la fédération s’est de plus en plus appuyée sur les mosquées et donc forcément sur les milieux musulmans les plus rétrogrades. Cela explique la disparition d’un certain nombre d’élues féminines d’origine maghrébine, ces femmes les premières élues de ce milieu, étaient toutes des femmes libérées des contraintes religieuses, ayant un langage direct, ferme à l’égard du poids du religieux. Aujourd’hui, elles sont remplacées par des élues beaucoup plus « lisses, soumises » On sait qu’elles ne causeront aucun problème avec leur communauté ou avec ceux qui s’y arrogent le rôle de représentant desdites communautés. La seule qui ait résisté c’est Fadila Laanan, précisément parce qu’elle était soutenue à un autre niveau du parti. Moureaux n’écrivait-il pas à son sujet « cette personne n’a pas été désignée en qualité de ministre par la fédération. » Quelle est aujourd’hui sa relation avec la nouvelle direction fédérale… On le sait les sourires cachent les poignards ! Quel tort a Fadila ? Simple, elle est issue de l’immigration, c’est une femme libre, éduquée, fière de sa culture, fière de ses origines, non liée aux groupes religieux et elle défend la laïcité, et, suprême audace s’en réclame… elle fait une place aux femmes là où depuis des décennies les extrémistes islamistes les empêchaient de travailler ! Elle ne plaît pas aux barbus… ça c’est certain !
L’ENSEIGNEMENT.
S’il est un domaine vital pour l’avenir d’une société, c’est bien l’enseignement. Or, à quoi a-t-on assisté à Bruxelles ? Ni plus ni moins à un effondrement total du niveau des écoles de l’enseignement public, il n’aura fallu qu’à peine deux décennies. L’enfer étant pavé des meilleures intentions, les pouvoirs organisateurs ont dans la plupart des cas voulu forcer la mixité. C’était nécessaire et utile. Mais cela se fit sans le moindre discernement, la moindre analyse de fond, le moindre suivi. Il était absolument nécessaire d’établir une vraie mixité, de lutter contre les discriminations, le racisme, qu’il ne s’agit pas ici de nier. Notre enseignement fut victime d’un égalitarisme forcé alors qu’il aurait été nécessaire de lire Aristote lorsqu’il soulignait « que la véritable justice est de traiter inégalement les choses inégales. » N’est-il pas démontré par l’histoire que forcer l’égalitarisme conduit toujours au drame ! Le résultat est que dans différentes communes, les classes sont composées pour 80 ou 90 pourcents d’enfants issus de l’immigration. Ceux-ci ne parlent pas français au sein du foyer familial, ils ne regardent que la TV dans leur langue maternelle. Peut-on le leur reprocher ? Significatives les réponses données par les enfants lorsqu’on les questionne sur leur nationalité, les neuf dixième répondent qu’ils sont Turcs, Albanais, Marocains, Algériens, seule une infime minorité répond qu’ils sont Belges alors même que la majorité l’est ! Imagine-t-on un seul instant les difficultés qu’affrontent au jour le jour les enseignants, leur découragement, leur révolte face à un pouvoir organisateur n’ayant tenu aucun compte des affres quotidiennes de la réalité. Or, qui sont les premières victimes de cette situation ? Ce sont bien sûr les enfants issus de l’immigration. Leur progression scolaire ne peut qu’être lente, les chances d’avenir réduites. Les brillantes réussites d’enfants d’émigrés ayant accompli leur scolarité il y a quinze ou vingt ans deviendront des exceptions car le malheur veut que leurs enfants se retrouveront dans des classes vouées à un grand retard du fait de la ghettoïsation des écoles. Réussir des études, accéder à un emploi de qualité est beaucoup plus difficile aujourd’hui qu’hier. Les statistiques publiées par « Le Soir » le démontrent sans contestation possible. Cela aussi, il est interdit de le dire, interdit même de le constater. Si par malheur vous le faites soit on vous traite de menteur soit vous êtes voués à l’enfer de la faschosphère !
Je le répète, j’insiste les premières victimes de cette situation, ce sont précisément les enfants d’émigrés, même ceux de la deuxième ou troisième génération, leur capacité d’intégration, de réussite sont largement diminuées. Est-il nécessaire d’ajouter que les émigrés et leurs enfants n’ont aucune responsabilité dans cette horrible situation, quoi de plus normal pour quelqu’un qui débarque en terre étrangère que de tenter de s’insérer dans un environnement où il retrouve ses semblables. Il est d’ailleurs démontré que les émigrés ou Belges issus de l’émigration s’ils « réussissent » professionnellement quittent au plus vite certains quartiers ou font des mains et des pieds pour éviter que leurs enfants fréquentent certaines écoles. Comment dès lors s’étonner des trente pourcents « officiels » du chômage des jeunes âgés de dix-huit à vingt-cinq ans. Au mois de mai, un nombre important de mamans maghrébines de Montpellier ont manifesté pour que les établissements scolaires de leur quartier retrouvent une vraie mixité, à savoir que reviennent dans les écoles de la municipalité quelques enfants Français de souche !!! Curieux qu’on en ait si peu parlé à Bruxelles. Très récemment Picqué s’exprimant à la section d’Anderlecht n’hésitait pas à souligner, avec le cynisme distancié le caractérisant qui est à la fois sa marque de fabrique et lui tient lieu de colonne vertébrale idéologique, que ses enfants fréquentaient l’enseignement catholique. Il est vrai que Picqué n’a jamais été socialiste, il a appris à LE parler, voilà tout ! Certains des présents se rappelaient le reportage de RTL où l’on pouvait voir son épouse dormir sur le trottoir du collège Saint Michel pour avoir le privilège d’y inscrire ses fils ! Comment mieux reconnaître que l’enseignement à Bruxelles est l’un de ces immenses territoires perdus de la laïcité, perdus pour la gauche ! Où est l’époque où, pour se présenter sur une liste électorale socialiste, il fallait que ses enfants fréquentent l’enseignement officiel ! Il faut oser dire que dans certaines écoles on forme… de futurs chômeurs ; les bonnes paroles, les discours lénifiants du politiquement correct n’y changeront rien. Seule une politique volontariste, immédiate, brutale, visant à largement revaloriser le statut des enseignants et à imposer, oui à imposer, une vraie mixité serait de nature à rencontrer les besoins d’avenir de notre région ; sans oser évoquer le bonheur des enfants qui sont confiés aux établissements publics de notre région. Les premiers bénéficiaires d’une telle réforme seraient les enfants d’émigrés. Pour les plus fortunés, pas de problème, ils iront dans « les zones protégées » de certains établissements catholiques… ils feront comme Picqué !
S’INTÉGRER MAIS À QUOI ?
Historiquement, c’est sans contestation possible une ville dont la population est flamande, mais l’élite du centre administratif parlait une autre langue, Français, Espagnol, Allemand. Je ne reprendrai pas ici les propos, souvent injustes et odieux de Baudelaire sur les Belges et en particulier les Bruxellois mais il faut reconnaître que cette région fut toujours un étonnant magma réunissant des élites « d’occupation » inévitablement accompagnées de fidèles « collaborateurs » et une population parlant un sabir à base essentiellement flamande. Il ne fait aucun doute qu’avec l’installation massive des administrations de l’UE, et de tant d’autres organisations multilatérales, Bruxelles soumise au déterminisme de sa géographie, poursuit son rôle de centre administratif. Or, un émigré, ou un enfant d’émigré, débarque avec sa culture, sa langue, sa religion, ses habitudes alimentaires. Ce sont des éléments structurants dont souvent il est à juste titre fier, qu’il ne veut pas larguer comme on se sépare d’un vieux vêtement ! C’est parfaitement légitime. Dans les années cinquante, un boxeur français d’origine tunisienne Halimi, poids coq, avait gagné un combat contre un pugiliste anglais. Porté en triomphe par ses soigneurs, il répondait au micro que lui tendait Loïc Van Le : « j’ai vengé Jeanne d’Arc. » Voilà donc une intégration réussie, ce boxeur, avait noué ses racines à celles de la France, à son histoire, il la faisait sienne.
Peut-il en être de même à Bruxelles ? Impensable ! Il n’y a ni « récit, ni roman national », il n’y a pas de racines historiques glorifiées, fondatrices. Quel jeune Bruxellois connaît le combat du municipaliste T’Serclaes. Les Comtes d’Egmont et Horne n’étaient pas Bruxellois, de plus ils appartenaient d’abord et avant tout à « l’internationale » de la noblesse. Il ne faut pas compter sur les cours d’histoire dispensés au niveau scolaire pour y suppléer, ceux-ci faisant fi des liens chronologiques, entendent faire connaître l’histoire par thèmes ; puzzle effrayant dont les élèves ne retiennent que des bribes sans continuité ; ce costume d’Arlequin décousu, impossible pour les malheureux étudiants de le recoudre, ajoutez une pédagogie générale de plus en plus obscure, caramélique… Croire après cela qu’on va leur enseigner l’histoire de ce pays, de cette région n’est qu’une sinistre plaisanterie ! Ce n’est pas le spectacle de la plantation du Meyboom ou le défilé de l’Ommegang qui me feront changer d’avis. A quelles nouvelles racines l’immigré peut-il nouer les siennes ? De fait à Bruxelles, elles sont inexistantes. Sur quel nœud de l’histoire la greffe peut-elle prendre ? L’effondrement de la qualité de notre enseignement, l’absence de cohésion nationale ou même régionale, l’absence de conscience identitaire ne pouvaient que renforcer le communautarisme, l’accentuer, l’enkyster. Car, ne nous y trompons pas, l’émigré, lui nous vient avec son identité nationale forte, avec sa religion qu’il ne sépare pas de la vie publique ; sa culture comprend indissolublement liées l’identité nationale et l’identité religieuse ; au Maroc, le chef de l’Etat n’est-il pas aussi le commandeur des croyants ! Et l’on aurait voulu que par un coup de baguette magique cet étranger fasse sienne les mœurs politiques, les us et coutumes, les civilités qu’il a fallu des siècles pour bâtir ! Il serait grotesque de lui parler d’identité bruxelloise. Impossible de lui demander de s’intégrer au vide ! Que reste-t-il alors ? Une seule chose mais essentielle : des valeurs !
En 2004, lors de l’élaboration du programme électoral de la fédération tous les amendements visant à mettre en évidence l’égalité homme-femme ont été repoussées violemment par le président fédéral lui-même. Fulminant, éructant, hurlant, on ne pouvait pas en parler : « cela risquait de heurter la population la plus fragilisée de Bruxelles ! » Ah ! Bon… donc un élément aussi fondamental que l’égalité absolue homme-femme devait être tu ! Pour des raisons électorales… Voilà, le piège se refermait, nous socialistes devenions prisonniers de notre électorat précisément parce que nous n’avions pas été capables de transmettre nos valeurs. Nous cessions d’être une force de propositions, de progrès, nous nous soumettions à la sensibilité d’un électorat qui aurait dû épouser la nôtre, pour parler clair qui aurait dû accepter nos valeurs… et les défendre. Parce que dans la structure du parti, on avait accepté qu’il n’y ait plus de militants, que l’électorat suffisait pour autant que soient élus ceux choisis par les « Dieux, » en un mot que les plans de carrière de certains soient assurés, on baissait pavillon sur ce qui faisait notre âme ! Notre slogan occulte devenait : « des valeurs non ! des électeurs oui ! ». D’aucuns rétorquent que cette thèse est fausse, nos valeurs seraient largement partagées par nos électeurs car les élus d’origine étrangère ont toujours, sans la moindre difficulté voté les textes portant sur des avancées en matière d’éthique telle l’euthanasie. Parfaitement exact. Mais raisonnement simpliste, qui se refuse, comme souvent à gauche, à voir la réalité. Sur ce genre de questions les élus d’origine maghrébine ou turque s’en fichent totalement, cela ne les concerne pas ; sur ces questions essentielles, ils vivent dans leur culture, ils respectent leurs valeurs et n’adhèrent aucunement aux nôtres, tout simplement cela ne les concerne pas ! C’est bon pour l’autre monde, celui où l’on tente de perpétuer ce que furent les valeurs humanistes de progrès. Peut-on leur en faire grief ? Certes non, c’est nous, en particulier le puissant PS qui avons été incapables de transmettre les nôtres, le PS s’est « soumis », ou s’est cru habile et… on c’est dépouillé de ce qui faisait notre essence. Peut-être aurait-il fallu se souvenir que la ruse ultime du diable est de faire croire qu’il n’existe pas ! Pensant tirer profit d’un corps électoral qu’on pensait fruste, naïf, innocent, on lui concède nos valeurs…cela relève de la comédie de boulevard et non de la politique. Dans les journaux de la fin du XIXème siècle, il y avait un jeu dénommé « Chercher le Kroumir », les Kroumirs étant une tribu tunisienne accusée par les Français de faire des incursions en Algérie, prétexte colonial typique pour imposer un protectorat sur ce pays. Dans un dessin de paysage, on devait deviner la silhouette dissimulée du « méchant » Kroumir. Je pense qu’on devrait relancer ce jeu à Bruxelles dont le thème serait « chercher le cocu » le pauvre cornard étant celui qui soutient un parti socialiste qui a jeté par-dessus bord son histoire, ses valeurs et tout le reste ! Voilà ce que ressentent aujourd’hui de nombreux affiliés de longue date du PS. Pour ceux-là le vote socialiste sera difficile, comme les sondages les uns après les autres le démontrent, le transfert se fait vers le PTB…et le DEFI.
Je fus stupéfait de lire au tout début de l’année dans « Libération » que Houellebecq répondant à une interview, précisait qu’il avait eu l’idée de son dernier livre « Soumission » on en connaît le thème, c’est l’élection en qualité de président de la république française d’un musulman modéré, en se baladant dans les rues de Bruxelles. Amusant aussi d’entendre Amin Maalouf le talentueux écrivant libanais raconter sur France Inter qu’il y avait beaucoup moins d’intégristes au Maroc qu’au sein de l’immigration européenne ; ainsi il évoquait que, se trouvant sur une plage du Maghreb, il y observait une famille de musulmans de stricte obédience, femmes entièrement voilées sur la plage, se rapprochant il constata que c’était des Belges… cela le faisait beaucoup rire.
Il est de bon ton dans les instances dirigeantes du PS bruxellois d’estimer que toutes les cultures se valent, que ce serait faire preuve de racisme que de réagir à certaines pratiques. Ainsi la présidente fédérale monte-t-elle tout de suite aux barricades criant haut et fort qu’elle n’a jamais condamné les pratiques barbares liées à la nourriture Halal, la presse ayant osé émettre quelques doutes. Elle est nettement moins réactive quand un élu refuse de reconnaître le génocide arménien, à peine audible, d’une voix fluette, entre deux portes, pour une fois le sourire tarifé en berne, elle précise que l’intéressé devra se présenter devant une commission. Elio, tu sais mieux que moi la façon dont tu as dû t’investir dans cette crise symptomatique. Elle ne fut dénouée que grâce à toi, beaucoup le savent. Un élu de Molenbeek traite un journaliste « d’ordure sioniste » ou ce même élu affirme qu’il se sent proche du Hamas (organisation classée dans la liste des groupes terroristes par l’ONU ), elle déclare dans le même souffle à la télévision que cet élu est « un homme bien ! » Il est vrai qu’à Molenbeek des consignes verbales étaient données aux policiers non musulmans de ne pas manger devant leurs collègues appartenant à ce culte pendant le ramadan afin d’éviter tout incident. Je ne doute pas que ce soit aussi le cas ailleurs mais peut-être y est-on encore plus discret ? On pourrait multiplier à l’infini les exemples de recul portant sur des valeurs qui furent toujours les nôtres et pour lesquelles, je le répète nos prédécesseurs se sont battus pendant des dizaines et des dizaines d’années.
DEMAIN LES VALEURS DE LA GAUCHE.
Cela fait déjà pas mal de temps que l’encéphalogramme de la gauche et de la social-démocratie est plat. Le vide idéologique est abyssal. Tout souffle a disparu. Il règne dans le mouvement socialiste comme une odeur de décomposition, fût-elle institutionnelle, elle agresse nos narines. Mais a-t-on encore besoin d’idéologie ? Pathétique de constater que Moureaux n’hésite pas à se raccrocher au philosophe français Badiou, dernier maoïste n’hésitant pas à envisager un monde sans démocratie ! Cela en dit long sur une certaine dérive idéologique ou le rouge se mâtine de brun ! Pourtant Badiou n’est pas barbu !
Peut-être un jour, si l’ex-bourgmestre de Molenbeek n’a plus d’espoir dynastique, criera-t-il lui aussi avec Aragon « feu sur les ours savants de la social-démocratie. » Tout est possible avec les vieilles gloires sorties des rails. Je ne sais s’il faut pleurer ou rire. L’éclatement de la gauche, son évaporation dans l’Europe pose un problème général, une dimension nouvelle, car cette gauche, si malmenée, reste malgré tous ses défauts, le seul, l’ultime rempart contre le capitalisme fou, contre la financiarisation de la société, contre l’asservissement total des peuples au culte de Mammon.
J’en reviens à Bruxelles, au pitoyable PS Bruxellois. Faut-il croire qu’il est devenu cette chose boiteuse, sans lyrisme, sans espoir, mélange de bureaucratie, de sordide népotisme, de clientélisme, de médiocrités arrivées ? Non, je ne peux le croire. Pourtant, je renifle sous les flonflons des rhétoriques de circonstances comme une odeur de cadavre, de fin d’un système, fragrances des lâches abandons… Quelque chose disparaît sous nos yeux ! Il est vrai que le PS ne fait plus rêver, tu te rappelles Elio de ce slogan : « changer la vie ! » Bon sang, que c’est loin. Mais le pire serait la trahison de nos valeurs, l’abandon progressif, hypocrite de ce qui fût notre apport essentiel à notre culture, à notre mode de vie. Je ne vois que des avantages à la présence dans notre région de cultures multiples, c’est une richesse indéniable mais je ne vois que des dangers si l’une de ces cultures veut imposer ses normes, revenir sur nos acquis sociétaux ou politiques, imposer ses normes alimentaires, revenir sur l’absolue égalité homme-femme, revenir sur l’impact du religieux dans la sphère politique etc. En d’autres termes, pourquoi pas le remplacement d’une part de notre population ! Substitution de nos droits, de nos valeurs non ! jamais ! A Bruxelles, c’est ce qui est en train de se jouer. C’est cela l’enjeu essentiel.
Allons nous abdiquer ou allons-nous être capables de nous libérer du poids d’un électorat qui n’a pas (encore) assimilé nos valeurs et qui ne comprend pas que certaines des siennes sont incompatibles avec ce qui fait notre civilisation ?
Y A-T-IL UN AVENIR ?
Il ne fait pas de doute qu’au niveau institutionnel la région telle qu’elle est limitée n’a aucun avenir. Elle ne deviendra jamais un Singapour européen, elle est vouée à la paupérisation et à la ghettoïsation. Tous le savent, tous l’admettent…en privé, y compris celui qui fut si longtemps ministre président et qui n’a jamais caché lors de contacts personnels qu’il ne croyait nullement dans la pérennité de cet espace étriqué, pauvre. Notre sort sera scellé ailleurs lors du grand pow wow politique exigé par nos voisins du Nord !
Personne d’ailleurs ne demandera l’avis de la population.
Pourtant, ils existent les habitants de notre région. Pour les évoquer, il me paraît essentiel de d’abord rendre hommage aux émigrés. Ceux qui les vouent aux gémonies feraient bien de se demander ce que serait leur attitude dans un pays étranger dont ils savent qu’ils n’y sont pas les bienvenus, dont ils ne connaissent pas la langue, dont les mœurs administratifs sont aux antipodes de ce qu’ils ont connu, dont l’accès à l’emploi est complexe et de plus en plus aléatoire. Et malgré tous ces obstacles, malgré les discriminations, le racisme, certaines réussites sont splendides, exemplaires. Réussites qui ne sont pas suffisamment mises en évidence. Quand Lévi-Strauss évoque l’universalité des hommes et leurs différences, c’est d’abord l’universalité qui m’importe ! C’est cela qu’il faut avoir à l’esprit quand on évoque la problématique liée aux émigrés ou leurs descendants.
Cependant, s’il m’apparaît qu’affirmer que globalement l’intégration est un échec est totalement faux, il n’en est pas moins vrai que celle-ci sera plus difficile que précédemment. L’effondrement de la qualité de l’enseignement, les classes ghetthoïsées ne favorisent plus ces succès. On assiste à un nivellement par le bas tout à fait évident dans certaines communes, ou dans certains quartiers ; la lutte pour intégrer des écoles qualifiées de meilleures le démontre de façon claire.
Que reste-t-il donc à ce peuple d’émigrés ? que reste-t-il à cette masse de jeunes sous qualifiés n’ayant que peu de chance d’intégrer le monde du travail ? Ils sont Belges et subissent la violence des discriminations à l’emploi, au faciès, le racisme ordinaire, encore accru par la crainte justifiée du terrorisme ; au Maroc, en Algérie ou ailleurs ils ne sont plus acceptés comme des autochtones ! Ils sont donc dépourvus d’identité dans une région qui n’en a pas… il leur reste donc pour seul élément structurant la religion, celle-ci n’est pas seulement un rapport à la transcendance mais aussi un cadre global de vie d’une des grandes civilisations mondiales. Comment s’étonner des dérives que l’on observe aujourd’hui, impensables il y a encore une quinzaine d’années. La gauche a cru que le fait religieux, sa coloration du politique, appartenait définitivement au passé. L’époque où le curé en chaire les jours d’élections expliquait à ses ouailles comment et pour qui voter appartenait au folklore électoral. Tout le monde sait à Bruxelles que les imams eux perpétuent cette sainte tradition. Pire, ce sont des élus PS qui supplient ou flattent les responsables des mosquées pour obtenir les mots d’ordre que nous avons reprochés aux curés pendant plus d’un siècle !
Le monde des émigrés et les Belges musulmans nous démontrent qu’ignorer, comme la gauche a tenté de le faire, le facteur religieux fut une lourde faute…
le retour vers le passé nous saute à la gorge… avec notre complicité électoralement intéressée.
Tous les démographes le prévoient, Bruxelles sera majoritairement musulmane d’ici une quinzaine d’année. Les facteurs géographiques, la contention insensée de Bruxelles dans des limites économiques et sociales invivables, la démographie dans la population immigrée, imposeraient des décisions majeures, rapides. Je n’ai aucun doute que le gouvernement régional sera incapable de les prendre ! D’ailleurs, la question se pose de savoir si dans le contexte institutionnel actuel, il y a encore quelque chose à espérer. Une autre politique est-elle possible ? Plus modestement, une politique est-elle possible ? Ou bien faut-il se contenter de poursuivre la politique brillamment menée par Picqué, la morbide politique du chien crevé au fil de l’eau. Dans ce cas, toutes choses restantes égales l’avenir du PS bruxellois sera assuré par le « couple » Catherine Moureaux et Uyttendael, ils régneront sur un magma d’électeurs d’origine étrangère, dirigeront la fédération avec pour slogan le Bisounours du Vivre Ensemble et inviteront les derniers affiliés à venir se ressourcer dans un salon de dégustation halal- bio, nirvana absolu du politiquement correct ! Quand aux valeurs du PS ! Quelles Valeurs ? Qui parle encore de valeurs ? Elles ont été remplacées comme notre électorat.
Les conséquences étaient prévisibles. Il y a une vingtaine d’années, une institution bruxelloise lors d’une inauguration avait prévu des distributions de crème glacée gratuite pour les enfants du quartier. L’assaut fut vite incontrôlable. Certains policiers voulaient chasser les enfants, ceux-ci se mirent à hurler « vive Bajrami, il va venir nous aider, c’est notre héros ! » Bajrami était un gangster célèbre à l’époque. Aujourd’hui, seuls quelques ilotes osent nier que Bin Laden est considéré comme un héros dans une certaine fraction de notre population. Est-il nécessaire de rappeler les connexions à Molenbeek de l’assassin du musée juif. N’est-ce pas à Molenbeek que le terroriste du Thalys aurait obtenu ses armes ? Les contacts entre les terroristes et cette commune sont aujourd’hui une évidence mondiale. Mohammed Mehra, après avoir tué trois militaires français, assassina des enfants Juifs parce que Juifs ; il était né en France, avait suivi les cours d’une école publique pendant plus de dix ans. Les terroristes de Londres, étaient anglais, nés et scolarisés en Angleterre. Une accumulation de tels faits mériterait la plus grande attention. Pour ne pas évoquer l’antisémitisme d’importation répandu dans toute la population d’origine émigrée qui s’apprend avec le naturel de la langue maternelle avec j’ose l’écrire pour certains un silence complice, une compréhension ignoble car s’il y avait à Bruxelles quatre cent mille Juifs et vingt-cinq mille Maghrébins, ceux-là qui se taisent et acceptent, les mêmes, se transformeraient en thuriféraires de l’Etat d’Israël jusque dans ses pires actes. Je conserve la photo d’un élu socialiste Flamand qui, participant à une manifestation à Anvers, hurlait, éructant, le visage tordu de haine, les lèvres ourlées de bave blanche « les Juifs dans le gaz ! » Cet élu assume aujourd’hui au nom de son parti d’importantes responsabilités au parlement régional… sans conteste une intégration réussie ! Un partage de nos valeurs ! Ah ! mais attention, nos valeurs ont peut-être changé ? L’antisémitisme en fait-elle partie ? Personne n’ayant cru bon de nous en avertir.
La gauche refuse de voir le réel, c’est une constante, s’il ne cadre pas avec ses fantasmes, prisonnière d’un humanisme généreux mais impuissant, isolant le réel de l’imaginaire, elle croit éviter les drames en ignorant les faits… l’insécurité n’existait pas, seuls les petits vieux éprouvaient un sentiment d’insécurité…tout autre chose n’est-ce pas ? En ignorant les faits, elle sera considérée comme complice des faillites de l’autorité publique. On le lui reprochera avec raison pendant longtemps.
En terme de respect de nos valeurs, de défense de la laïcité, à Bruxelles c’est Munich tous les jours !
Ceux qui aujourd’hui gouvernent la fédération auraient avantage à visionner un vidéo d’un congrès du parti Baas au Caire au début des années soixante. On y voit Nasser raconter qu’il a rencontré un Imam, celui-ci lui avait demandé que les femmes se voilent, Nasser, rigolant, lui avait répondu, qu’il n’avait que se voiler lui-même, toute la salle explosait de rire en applaudissant. A la même époque, sur les plages d’Egypte, on pouvait voir des femmes en bikini ! Quel recul ! Nasser était-il un « bon » musulman ? Combien de jeunes filles ou de femmes traversant certains quartiers se font elles insultées car elles n’arborent pas les vêtements qui agréent certains musulmans ? Un film en a fait la terrible démonstration, ce qui n’a pas empêché les bonnes âmes du politiquement correct de nier ces faits pourtant vérifiables chaque jour dans notre ville.
EXISTE-T-IL DES SOLUTIONS ?
J’ose à peine esquisser quelques pistes, conscient que les gardiens du temple, chiens de garde de la ligne du parti, ou ce qu’ils qualifient de tel, hurleront… mais bon, pourquoi te cacher que je m’en fiche royalement.
Au plan de la technique électorale, si on veut un équilibre entre les diverses composantes de la population bruxelloise, il est indispensable de limiter les votes de préférence à 3. Simple à réaliser… seulement un peu de courage !
Au plan des valeurs, pourquoi ne pas imaginer une charte que signerait chaque candidat s’engageant à respecter les valeurs essentielles des Droits de l’Homme et du Citoyen, en particulier l’égalité absolue homme-femme. Est-ce si compliqué ?
Au plan de la fédération bruxelloise, une charte devrait également être signée par les adhérents reprenant l’ensemble des valeurs sur lesquelles le PS a été fondé.
Au plan de l’enseignement, dans la lutte contre les ghettos scolaires, il est nécessaire de faire sauter les critères géographiques et mettre en place les mécanismes d’une vraie mixité dans toutes les écoles libres et publiques.
Au plan de l’apprentissage des éléments essentiels de notre culture et du respect de la culture des émigrés, organiser des cours relatifs à la culture des enfants émigrés, mettre en place des cours sur l’histoire des religions, sur ce qu’est la laïcité, des cours de citoyenneté qui ne se contenteront pas d’apprendre aux enfants le fonctionnement des feux de circulation ou la propreté bucco-dentaire. Des cours de citoyenneté et de langues devraient être organisés à l’intention des parents.
Au plan des repas scolaires, il n’y a aucune justification à fournir des repas conformes aux prescrits religieux, par contre les enfants doivent avoir le choix de menu de substitution ( végétariens ) ou autres.
Au plan des cours de natation et de gymnastique (niveau du primaire), ceux-ci doivent rester mixtes.
Au plan du logement, mettre fin aux règles absurdes qui conduisent aux ghettos, là aussi doit être imposée une mixité ethnique, sociale et économique
Au plan de l’octroi de la nationalité, celle-ci devrait s’accompagner d’une véritable adhésion à nos valeurs essentielles, sous forme d’un engagement formel et motivé. Il doit en aller de même pour l’octroi du statut de réfugié. Pourquoi ne pas oser une large réflexion sur les effets et conséquences de la double nationalité ! Symptomatique d’entendre récemment un député bruxellois d’origine maghrébine se plaindre des effets de la double nationalité qui d’après lui faisait de ceux qui en bénéficiaient des citoyens de « seconde zone. » Ben voyons ! De quoi s’agissait-il ? Un Belgo-Marocain ayant été arrêté au Maroc, ce député et quelques autres exigeaient que la Belgique en tant qu’Etat fasse pression pour le tirer de ce mauvais pas. Le gouvernement répondit que l’intéressé étant Marocain, il lui était impossible de réagir. C’est ce refus d’intervenir qui faisait dire à ce député que les bénéficiaires de la double nationalité étaient des citoyens de « seconde catégorie » ! Curieuse réaction en miroir ! Cela implique qu’on soit Belge quand cela présente un intérêt quelconque et qu’on est Marocain à d’autres moments. On ne pouvait mieux démontrer les ambiguïtés de la double nationalité. Attention, attention vade retro Satanas, mettre en évidence de tels raisonnements vous classe immédiatement dans le camp des pires racistes.
AVENIR ET PROGRÈS, RACINES DE NOS VALEURS.
J’ai déjà évoqué le trouble profond de la social-démocratie dans le monde, les élections qui se succèdent confirment l’effroyable ressac de notre représentation, quasi disparition du Pasok en Grèce, Hongrie, effondrement et division en Grande-Bretagne, phénomène identique en Pologne… dans l’attente de l’inévitable drame qui se profile en France. Lisant l’historienne française Mona Ozouf, je suis impressionné quand elle constate que si la gauche recule partout c’est notamment parce qu’elle a abandonné deux de ses piliers essentiels, les concepts d’avenir et de progrès. Ces notions sont les socles ontologiques sur lesquels se sont construits les idéaux socialistes. Il est donc permis à Régis Debray, tout en se revendiquant de gauche, d’écrire que pour la première fois, il n’y a plus d’après ni au ciel ni sur la terre. Incroyablement actuelle la définition du progrès par Michelet « Le progrès n’est pas du tout une ligne droite et suivie, c’est une ligne en spirale qui a des courbes, des retours énormes sur elle-même, des interruptions si fortes qu’il ne recommence qu’avec peine et lentement. » On croirait qu’il parle de ce que l’on connaît en ce moment ! Aujourd’hui, les annonceurs de catastrophes tiennent le haut du pavé, dominent l’aire médiatique, c’est clairement la profession qui fait florès. Nous sommes dominés par une eschatologie mortifère. C’est d’ailleurs philosophiquement passionnant car l’espérance en terme chrétien est donc remplacé par l’annonce d’un enfer climatique dont nous serions responsables. Le messianisme marxiste faisant croire aux lendemains qui chantent est battu sur toute la ligne. Après avoir espéré dans l’avenir… c’est l’enfer qu’on nous décrit. Pour le Progrès, c’est pareil, alors qu’il a servi de main courante à toute la philosophie socialiste, le voici avalé, englouti dans un pessimisme général, une méfiance à l’égard de la science. Qu’il suffise de songer aux efforts qu’il faut déployer pour soutenir les campagnes de vaccination.
A ce triste panorama s’ajoute la disparition du croquemitaine communiste, lui aussi a sombré étouffé par sa bureaucratie, sa médiocrité et ses mensonges. Or, les Etats communistes étaient essentiels à la social-démocratie, avec leur disparition, le « bâton derrière la porte » a été brisé. Le communisme ne fait plus peur, que dire alors de son avatar socialiste. Il n’est plus possible de soutenir qu’il faut nous céder « un peu » car si ce n’est pas nous… « ce seront les communistes ! » La chute d’une autre « Goldman Sachs » effraye beaucoup plus ! Ce changement de perspective a tout bouleversé, ce n’était pas la fin de l’histoire comme voulait le faire croire Fukuyama, c’était le début d’une autre histoire mais nous socialistes n’avons rien vu, nous contentant de porter les oripeaux d’un monde disparu. Dans cette histoire là, d’aucuns voudraient que nous n’ayons plus notre place. Nous croyions entrer dans l’Union européenne et nous devenions des personnages d’un sinistre « Socialist park ! »
On pourrait croire que ces dernières considérations m’éloignent de la problématique bruxelloise, il n’en est rien ! Car, s’il se joue sur les grandes scènes de l’histoire l’acte tant redouté d’un énorme basculement dans les gouffres de la droite, à Bruxelles, minuscule laboratoire de l’affaissement de nos valeurs, se déroule un vaudeville mal ficelé où le PS bruxellois n’est plus que la caricature de ce qu’il fût. Impossible d’éviter à Bruxelles que le comique supplante le tragique ! L’esprit dynastique, clanique et communautaire ayant pris la place des principes qui nous ont construits, ce n’est pas « Mr. Smith va au Sénat » mais la fille de la famille Beulemans devient députée régionale, normal, son papa était ministre. Seule question, celle-là toute personnelle, étant de savoir si cela vaut encore la peine de s’indigner, de contester, de se battre. Faut-il pour se justifier citer Hugo, tiens un type qui croyait dur comme fer dans l’avenir et le progrès, « ceux qui vivent sont ceux qui luttent. » Le grenier de ma mémoire est trop encombré des glorieux souvenirs des combats de la gauche pour que soit jugulé mon inépuisable réservoir de ressentiments. Je ne veux pas être l’un de ces nombreux déçus qui pourraient chanter « j’avais rêvé un autre rêve. » La gauche ne fait plus rêver… tu le sais Elio quand on ne rêve plus… On meurt !
Non ! Notre devoir est de surmonter les renonciations du désenchantement mortel, d’être capables de construire un autre rêve inscrivant les hommes dans un monde plus juste, plus humain dont les valeurs de la gauche resteront le socle ! La gauche, je n’ose pas parler de la gauche bruxelloise, ferait bien de méditer ce qu’écrit le philosophe Michael Foessel quand il suggère que « le fait de ne pas être réconcilié avec son passé constitue peut-être le seul moyen d’avoir un avenir. »
Voilà, Cher Elio, Ite Missa est ! Impossible que tu lises un jour cette pauvre lettre, trop longue, beaucoup trop longue, maladroite, sur les pitoyables successions dynastiques et communautaires à Bruxelles, finalement dérisoires ; tu règleras les comptes lors de la prochaine négociation communautaire et basta ! Roulez jeunesse…
Mais que m’arrive-t-il ? Ecrivant ces dernières lignes la tête me tourne tant l’oxygène que je respire maintenant est vif, la grille de lecture imposée aux socialistes bruxellois s’est brisée, les miasmes méphitiques de la pensée unique évaporés, disparus, je vais pouvoir être moi-même. Personne ne me dictera plus ce que je dois dire ou penser ! Soulagé… un mot s’inscrit sur mes lèvres, précieux, irremplaçable, essentiel, vital… LIBRE… enfin !
Hermanus Auguste Merry,
Bruxelles, le 9 Novembre 2015
Sur un sujet similaire :
Caricature antisémite : « Le PS doit réagir, sinon il ne bougera plus sur rien » (Le Vif, 2013)
Merry Hermanus: «Le vote multiple a des effets pervers» (Le Soir, 2015)