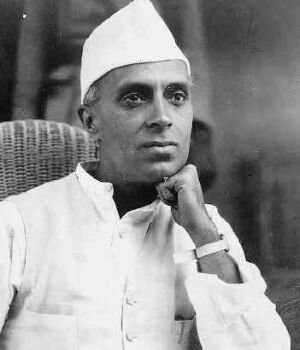Afghanistan : une guerre programmée depuis 210 ans
Conférence prononcée par Robert Steuckers le 24 novembre 2001 à la tribune du "Cercle Hermès" de Metz, à la tribune du MNJ le 26 janvier 2002 et à la tribune commune de "Terre & Peuple"-Wallonie et de "Synergies Européennes"-Bruxelles le 21 février 2002
Depuis que les troupes américaines et occidentales ont débarqué en Afghanistan, dans le cadre de la guerre anti-terroristes décrétée par Bush à la suite des attentats du 11 septembre 2001, un regard sur l'histoire de l'Afghanistan au cours de ces deux derniers siècles s'avère impératif; de même, joindre ce regard à une perspective plus vaste, englobant les théâtres et les dynamiques périphériques, permettrait de juger plus précisément, à l'aune de l'histoire, les manœuvres américaines en cours. Il nous induit à constater que cette guerre dure en fait depuis au moins 210 ans. Pourquoi ce chiffre de 210 ans? Parce que les principes, qui la guident, ont été consignés dans un mémorandum anglais en 1791, mémorandum qui n'a pas perdu de sa validité dans les stratégies appliquées de nos jours par les puissances maritimes. Seule l'amnésie historique, qui est le lot de l'Europe actuelle, qui nous est imposée par des politiques aberrantes de l'enseignement, qui est le produit du refus d'enseigner l'histoire correctement, explique que la teneur de ce mémorandum n'est pas inscrite dans la tête des diplomates et des fonctionnaires européens. Ils en ignorent généralement le contenu et sont, de ce fait, condamnés à ignorer le moteur de la dynamique à l'œuvre aujourd'hui.
Louis XVI : l'homme à abattre
Quel est le contexte qui a conduit à la rédaction de ce fameux mémorandum? La date clef qui explique le pourquoi de sa rédaction est 1783. En cette année-là, à l'Est, les armées de Catherine de Russie prennent la Crimée et le port de Sébastopol, grâce à la stratégie élaborée par le Ministre Potemkine et le Maréchal Souvorov (cf. : Gérard Chaliand, Anthologie mondiale de la stratégie - Des origines au nucléaire, Laffont, coll. "Bouquins", 1990). A partir de cette année 1783, la Crimée devient entièrement russe et, plus tard, à la suite du Traité de Jassy en 1792, il n'y aura plus aucune troupe ottomane sur la rive septentrionale de la Mer Noire. A l'Ouest, en 1783, la Marine Royale française écrase la Royal Navy anglaise à Yorktown, face aux côtes américaines. La flotte de Louis XVI, bien équipée et bien commandée, réorganisée selon des critères de réelle efficacité, domine l'Atlantique. Son action en faveur des insurgés américains a pour résultat politique de détacher les treize colonies rebelles de la Couronne anglaise. A partir de ce moment-là, le sort de l'artisan intelligent de cette victoire, le Roi Louis XVI, est scellé. Il devient l'homme à abattre. Exactement comme Saddam Hussein ou Milosevic aujourd'hui. Paul et Pierrette Girault de Coursac, dans Guerres d'Amérique et libertés des mers (cf. infra), ont décrit avec une minutie toute scientifique les mécanismes du complot vengeur de l'Angleterre contre le Roi de France qui a développé une politique intelligente, dont les deux piliers sont 1) la paix sur le continent, concrétisée par l'alliance avec l'Empire autrichien, dépositaire de la légitimité impériale romano-germanique, et 2) la construction d'une flotte appelée à dominer les océans (à ce propos, se rappeler des expéditions de La Pérouse; cf. Yves Cazaux, Dans le sillage de Bougainville et de Lapérouse, Albin Michel, 1995).
L'Angleterre de la fin du 18ième siècle, battue à Yorktown, menacée par les Russes en Méditerranée orientale, va vouloir inverser la vapeur et conserver le monopole des mers. Elle commence par lancer un débat de nature juridique: la mer est-elle res nullius ou res omnius, une chose n'appartenant à personne, ou une chose appartenant à tous? Si elle est res nullius, on peut la prendre et la faire sienne; si elle est res omnius, on ne peut prétendre au monopole et il faut la partager avec les autres puissances. L'Angleterre va évidemment arguer que la mer est res nullius. Sur terre, l'Angleterre continue à appliquer sa politique habituelle, mise au point au 17ième siècle, celle de la "Balance of Powers", de l'équilibre des puissances. En quoi cela consiste-t-il? A s'allier à la seconde puissance pour abattre la première. En 1783, cette pratique pose problème car il y a désormais alliance de facto entre la France et l'Autriche: on ne peut plus les opposer l'une à l'autre comme au temps de la Guerre de Succession d'Espagne. C'est d'ailleurs la première fois depuis l'alliance calamiteuse entre François I et le Sultan turc que les deux pays marchent de concert. Depuis le mariage de Louis XVI et de Marie-Antoinette de Habsbourg-Lorraine, il est donc impossible d'opposer les deux puissances traditionnellement ennemies du continent. Cette union continentale ne laisse rien augurer de bon pour les Anglais, car, profitant de la paix avec la France, Joseph II, Empereur germanique, frère de Marie-Antoinette, veut exploiter sa façade maritime en Mer du Nord, dégager l'Escaut de l'étau hollandais et rouvrir le port d'Anvers. Joseph II s'inspire des projets formulés quasiment un siècle plus tôt par le Comte de Bouchoven de Bergeyck, soucieux de développer la Compagnie d'Ostende, avec l'aide du gouverneur espagnol des Pays-Bas, Maximilien-Emmanuel de Bavière. La tentative de Joseph II de forcer le barrage hollandais sur l'Escaut se termine en tragi-comédie: un canon hollandais tire un boulet qui atterrit au fond de la marmite des cuisines du bateau impérial. On parlera de "Guerre de la Marmite". L'Escaut reste fermé. L'Angleterre respire.
Organiser la révolution et le chaos en France
Comme cette politique de "Balance of Powers" s'avère impossible vu l'alliance de Joseph II et de Louis XVI, une nouvelle stratégie est mise au point: organiser une révolution en France, qui débouchera sur une guerre civile et affaiblira le pays, l'empêchant du même coup de financer sa politique maritime et de poursuivre son développement industriel. En 1789, cette révolution, fomentée depuis Londres, éclate et précipite la France dans le désastre. Olivier Blanc, Paul et Pierrette Girault de Coursac sont les historiens qui ont explicité en détail les mécanismes de ce processus (cf. : Olivier Blanc, Les hommes de Londres - Histoire secrète de la Terreur, Albin Michel, 1989; Paul et Pierrette Girault de Coursac, Guerre d'Amérique et liberté des mers 1718-1783, F.X. de Guibert/O.E.I.L., Paris, 1991). En 1791, les Anglais obtiennent indirectement ce qu'ils veulent : la République néglige la marine, ne lui vote plus de crédits suffisants, pour faire la guerre sur le continent et rompre, par voie de conséquence, l'harmonie franco-impériale, prélude à une unité diplomatique européenne sur tous les théâtres de conflit, qui avait régné dans les vingt années précédant la révolution française.
Trois stratégies à suivre
A Londres, on pense que la France, agitée par des avocats convulsionnaires, est plongée pour longtemps dans le marasme et la discorde civile. Reste la Russie à éliminer. Un mémorandum anonyme est remis, la même année, à Pitt; il s'intitule "Russian Armament" et contient toutes les recettes simples et efficaces pour abattre la seconde menace, née, elle aussi, en 1783, qui pèse sur la domination potentielle des mers par l'Angleterre. Ce mémorandum contient en fait trois stratégies à suivre à tout moment : 1) Contenir la Russie sur la rive nord de la Mer Noire et l'empêcher de faire de la Crimée une base maritime capable de porter la puissance navale russe en direction du Bosphore et au-delà; cette stratégie est appliquée aujourd'hui, par l'alliance turco-américaine et par les tentatives de satelliser la Géorgie de Chevarnadze. 2) S'allier à la Turquie, fort affaiblie depuis les coups très durs que lui avait portés le Prince Eugène de Savoie entre 1683 et 1719. La Turquie, incapable désormais de développer une dynamique propre, devait devenir, pour le bénéfice de l'Angleterre, un verrou infranchissable pour la flotte russe de la Mer Noire. La Turquie n'est donc plus un "rouleau compresseur" à utiliser pour détruire le Saint Empire, comme le voulait François I; ni ne peut constituer un "tremplin" vers la Méditerranée orientale et vers l'Océan Indien, pour une puissance continentale qui serait soit la Russie, si elle parvenait à porter ses forces en avant vers les Détroits (vieux rêve depuis que l'infortunée épouse du Basileus, tombé l'épée à la main à Constantinople en 1453 face aux Ottomans, avait demandé aux Russes de devenir la "Troisième Rome" et de prendre le relais de la défunte Byzance); soit l'Autriche si elle avait pu consolider sa puissance au cours du 19ième siècle; soit l'Allemagne de Guillaume II, qui, par l'alliance effective qu'elle scelle avec la Sublime Porte, voulait faire du territoire turco-anatolien et de son prolongement mésopotamien un "tremplin" du cœur de l'Europe vers le Golfe Persique et, partant, vers l'Océan Indien (ce qui suscita la fameuse "Question d'Orient" et constitua le motif principal de la Première Guerre Mondiale; rappelons que la "Question d'Orient" englobait autant les Balkans que la Mésopotamie, les deux principaux théâtres de conflit à nos portes; les deux zones sont étroitement liées sur le plan géopolitique et géostratégique). 3) Eloigner toutes les puissances européennes de la Méditerranée orientale, afin qu'elles ne puissent s'emparer ni de Chypre ni de la Palestine ni de l'isthme égyptien, où l'on envisage déjà de creuser un canal en direction de la Mer Rouge.
La réouverture de l'Escaut
En 1793, la situation a cependant complètement changé en France. La République ne s'enlise pas dans les discussions stériles et la dissension civile, mais tombe dans la Terreur, où les sans-culottes jouent un rôle équivalent à celui des talibans aujourd'hui. En 1794, après la bataille de Fleurus remportée par Jourdan le 25 juin, les armées révolutionnaires françaises s'emparent définitivement des Pays-Bas autrichiens, prennent, avec Pichegru, le Brabant et le port d'Anvers, de même que le Rhin, de Coblence —ville prise par Jourdan en même temps que Cologne— à son embouchure dans la Mer du Nord. Ils réouvrent l'Escaut à la navigation et entrent en Hollande. Le delta des trois fleuves (Escaut / Meuse / Rhin), qui fait face aux côtes anglaises et à l'estuaire de la Tamise, se trouve désormais aux mains d'une puissance de grande profondeur stratégique (l'Hexagone). La situation nouvelle, après les soubresauts chaotiques de la révolution, est extrêmement dangereuse pour l'Angleterre, qui se souvient que les corsaires hollandais, sous la conduite de l'Amiral de Ruyter, avaient battu trois fois la flotte anglaise et remonté l'estuaire de la Tamise pour incendier Londres (1672-73) (1). En partant d'Anvers, il faut une nuit pour atteindre l'estuaire de la Tamise, ce qui ne laisse pas le temps aux Anglais de réagir, de se porter en avant pour détruire la flotte ennemie au milieu de la Mer du Nord: d'où leur politique systématique de détacher les pays du Bénélux et le Danemark de l'influence française ou allemande, et d'empêcher une fusion des Pays-Bas septentrionaux et méridionaux, car ceux-ci, unis, s'avèreraient rapidement trop puissants, vu l'union de la sidérurgie et du charbon wallons à la flotte hollandaise (a fortiori quand un empire colonial est en train de se constituer en Indonésie, à la charnière des océans Pacifique et Indien).
Lord Castlereagh proposa à Vienne en 1815 la consolidation et la satellisation du Danemark pour verrouiller la Baltique et fermer la Mer du Nord aux Russes, la création du Royaume-Uni des Pays-Bas (car on ne perçoit pas encore sa puissance potentielle et on ne prévoit pas sa future présence en Indonésie), la création du Piémont-Sardaigne, Etat-tampon entre la France et l'Autriche, et marionnette de l'Angleterre en Méditerranée occidentale; Homer Lea théorisera cette politique danoise et néerlandaise de l'Angleterre en 1912 (cf. infra) en l'explicitant par une cartographie très claire, qui reste à l'ordre du jour.
Nelson : Aboukir et Trafalgar
Les victoires de la nouvelle république, fortifiées à la suite d'une terreur bestiale, sanguinaire et abjecte, notamment en Vendée, provoquent un retournement d'alliance: d'instigatrice des menées "dissensionnistes" de la révolution, l'Angleterre devient son ennemie implacable et s'allie aux adversaires prussiens et autrichiens de la révolution (stratégie mise au point par Castlereagh, sur ordre de Pitt). Résultat : un espace de chaos émerge entre Seine et Rhin. Dans les années 1798-99, Nelson va successivement chasser la marine française de la Méditerranée, car elle est affaiblie par les mesures de restriction votées par les assemblées révolutionnaires irresponsables, alors que l'Angleterre avait largement profité du chaos révolutionnaire français pour consolider sa flotte. Par la bataille d'Aboukir, Nelson isole l'armée de Bonaparte en Egypte, puis, les Anglais, avec l'aide des Turcs et en mettant au point des techniques de débarquement, finissent par chasser les Français du bassin oriental de la Méditerranée; à Trafalgar, Nelson confisque aux Français la maîtrise de la Méditerranée occidentale.
Géostratégiquement, notre continent, à la suite de ces deux batailles navales, est encerclé par le Sud, grâce à la triple alliance tacite de la flotte anglaise, de l'Empire ottoman et de la Perse. La thalassocratie joue à fond la carte turco-islamique pour empêcher la structuration de l'Europe continentale: une carte que Londres joue encore aujourd'hui. Dans l'immédiat, Bonaparte abandonne à regret toute visée sur l'Egypte, tout en concoctant des plans de retour jusqu'en 1808. Par la force des choses, sa politique devient strictement continentale; car, s'il avait parfaitement compris l'importance de l'Egypte, position clef sur la route des Indes, et s'il avait pleine conscience de l'atout qu'étaient les Indes pour les Anglais, il ne s'est pas rendu compte que la maîtrise de la mer implique ipso facto une domination du continent, lequel, sans la possibilité de se porter vers le large, est condamné à un lent étouffement. La présence d'escadres suffisamment armées en Méditerranée ne rendait pas la conquête militaire —coûteuse— du territoire égyptien obligatoire.
Dialectique Terre/Mer
Depuis cette époque napoléonienne, notre pensée politique, sur le continent, devient effectivement, pour l'essentiel, une pensée de la Terre, comme l'attestent bon nombre de textes de la première décennie du 19ième siècle, les écrits de Carl Schmitt et ceux de Rudolf Pannwitz (cf. : Robert Steuckers, «Rudolf Pannwitz : "Mort de la Terre", Imperium Europæum et conservation créatrice», in : Nouvelles de Synergies Européennes, n°19, avril 1996; Robert Steuckers, «L'Europe entre déracinement et réhabilitation des lieux : de Schmitt à Deleuze», in : Nouvelles de Synergies Européennes, n°27, avril-mai 1997; Robert Steuckers, «Les visions d'Europe à l'époque napoléonienne - Aux sources de l'européisme contemporain», in : Nouvelles de Synergies Européennes, n°45, mars-mai 2000). C'est contre cette limitation volontaire, contre cette "thalassophobie", que s'insurgeront des hommes comme Friedrich Ratzel (cf. : Robert Steuckers, «Friedrich Ratzel (1844-1904): anthropogéographie et géographie politique», in: Vouloir, n°9, printemps 1997) et l'Amiral von Tirpitz. Le Blocus continental, si bien décrit par Bertrand de Jouvenel (cf. : Bertrand de Jouvenel, Napoléon et l'économie dirigée - Le blocus continental, Ed. de la Toison d'Or, Bruxelles, 1942), a des aspects positifs et des aspects négatifs. Il permet un développement interne de l'industrie et de l'agriculture européenne. Mais, par ailleurs, il condamne le continent à une forme dangereuse de "sur place", où aucune stratégie de mobilité globale n'est envisagée. A l'ère de la globalisation —et elle a commencée dès la découverte des Amériques, comme l'a expliqué Braudel— cette timidité face à la mobilité sur mer est une tare dangereuse, selon Ratzel.
Le plan du Tsar Paul I
En 1801, il y a tout juste 200 ans, l'Angleterre doit faire face à une alliance entre le Tsar Paul I et Napoléon. L'objectif des deux hommes est triple: 1) Ils veulent s'emparer des Indes et les Français, qui se souviennent de leurs déboires dans ce sous-continent, tentent de récupérer les atouts qu'ils y avaient eus. 2) Ils veulent bousculer la Perse, alors alliée des Anglais, grâce aux talents d'un très jeune officier, le fameux Malcolm, qui, enfant, avait appris à parler persan à la perfection, et qui fut nommé capitaine à 13 ans et général à 18. 3) Ils cherchent les moyens capables de réaliser le Plan d'invasion de Paul I: acheminer les troupes françaises via le Danube et la Mer Noire (et nous trouvons exactement les mêmes enjeux qu'aujourd'hui!), tandis que les troupes russes, composées essentiellement de cavaliers et de cosaques, marcheraient à travers le Turkestan vers la Perse et l'Inde. Dans les conditions techniques de l'époque, ce plan s'est avéré irréalisable, parce qu'il n'y avait pas encore de voies de communication valables. Le Tsar conclut qu'il faut en réaliser (en germe, nous avons le projet du Transsibérien, qui sera réalisé un siècle plus tard, au grand dam des Britanniques).
En 1804, malgré qu'elle ne soit plus l'alliée de la France napoléonienne, la Russie marque des points dans le Caucase, amorce de ses avancées ultérieures vers le cœur de l'Asie centrale. Ces campagnes russes doivent être remises aujourd'hui dans une perspective historique bien plus vaste, d'une profondeur temporelle immémoriale: elles visent, en réalité, à parfaire la mission historique des peuples indo-européens, et à rééditer les exploits des cavaliers indo-iraniens ou proto-iraniens qui s'étaient répandu dans toute l'Asie centrale vers 1600 av. J. C. Les momies blanches du Sinkiang chinois prouvent cette présence importante et dominante des peuples indo-européens (dont les Proto-Tokhariens) au cœur du continent asiatique. Ils ont fort probablement poussé jusqu'au Pacifique. Les Russes, du temps de Catherine II et de Paul I, ont parfaitement conscience d'être les héritiers de ces peuples et savent intimement que leur présence attestée en Asie centrale avant les peuples mongols ou turcs donne à toute l'Europe une sorte de droit d'aînesse dans ces territoires. L'antériorité de la conquête et du peuplement proto-iraniens en Asie centrale ôte toute légitimité à un contrôle mongol ou turc de la région, du moins si on raisonne sainement, c'est-à-dire si on raisonne avec longue mémoire, si on forge ses projets sur base de la plus profonde profondeur temporelle. Des Proto-Iraniens à Alexandre le Grand et à Brejnev, qui donne l'ordre à ses troupes de pénétrer en Afghanistan, la continuité est établie.
La ligne Balkhach/Aral/Caspienne/Volga
L'analyse cartographique de Colin MacEvedy, auteur de nombreux atlas historiques, montre que lorsqu'un peuple non européen se rend maître de la ligne Lac Balkhach, Mer d'Aral, Mer Caspienne, cours de la Volga, il tient l'Europe à sa merci. Effectivement, qui tient cette ligne, que Brzezinski appelle la "Silk Road", est maître de l'Eurasie tout entière, de la fameuse "Route de la Soie" et de la Terre du Milieu (Heartland). Quand ce n'est pas un peuple européen qui tient fermement cette ligne, comme le firent les Huns et les Turcs, l'Europe entre irrémédiablement en déclin. Les Huns s'en sont rendu maîtres puis ont débouché, après avoir franchi la Volga, dans la plaine de Pannonie (la future Hongrie) et n'ont pu être bloqués qu'en Champagne. Les Avars, puis les Magyars (arrêtés à Lechfeld en 955), ont suivi exactement la même route, passant au-dessus de la rive septentrionale de la Mer Noire. De même, les Turcs seldjoukides, passant, eux, par la rive méridionale, prendront toute l'Anatolie, détruiront l'Empire byzantin, remonteront le Danube vers la plaine hongroise pour tenter de conquérir l'Europe et se retrouveront deux fois devant Vienne.
En 1838, les Britanniques prévoient que les Russes, s'ils continuent sur leur lancée, vont arriver en Inde et établir une frontière commune avec les possessions britanniques dans le sous-continent indien. D'où, bons connaisseurs des dynamiques et des communications dans la région, ils forgent la stratégie qui consiste à occuper la Route de la Soie sur son embranchement méridional et sur sa portion qui va de Herat à Peshawar, point de passage obligatoire de toutes les caravanes, comme, aujourd'hui, de tous les futurs oléoducs, enjeux réels de l'invasion récente de l'Afghanistan par l'armée américaine. On constate donc que le but de guerre de 1838 ne s'est réalisé qu'aujourd'hui seulement !
Un Afghanistan jusqu'ici imprenable
Sur le plan stratégique, il s'agissait, pour les Anglais de l'époque, de 1) protéger l'Inde par une plus vaste profondeur territoriale, sous la forme d'un glacis afghano-himalayen, sinon l'Inde risquait, à terme, de n'être qu'un simple réseau de comptoirs littoraux, plus difficilement défendable contre une puissance bénéficiant d'un vaste hinterland centre-asiatique (les Anglais tirent les leçons de la conquête de l'Inde par les Moghols islamisés); et 2) de contenir la Russie selon les principes énoncés en 1791 pour la Mer Noire, cette fois le long de la ligne Herat-Peshawar (cf. à ce propos, Karl Marx & Friedrich Engels, Du colonialisme en Asie - Inde, Perse, Afghanistan, Mille et une nuits, n°372, 2002). Les opérations anglaises en Afghanistan se solderont en 1842 par un désastre total, seule une poignée de survivants reviendront à Peshawar, sur une armée de 17.000 hommes. La victoire des tribus afghanes contre les Anglais en 1842 sauvera l'indépendance du pays. Jusque aujourd'hui, en effet, mise à part la tentative soviétique de 1979 à Gorbatchev, l'Afghanistan restera imprenable, donc indépendant. Un destin dont peu de pays musulmans ont pu bénéficier.
De 1852 à 1854 a lieu la Guerre de Crimée. L'alliance de l'Angleterre, de la France et de la Turquie conteste les positions russes en Crimée, exactement selon les critères avancés par l'Angleterre depuis 1783. En 1856, au terme de cette guerre, perdue par la Russie sur son propre terrain, le Traité de Paris limite la présence russe en Mer Noire, ou la rend inopérante, et lui interdit l'accès aux Détroits. En 1878, les armées russes, appuyées par des centaines de milliers de volontaires balkaniques, serbes, roumains et bulgares, libèrent les Balkans de la présence turque et avancent jusqu'aux portes de Constantinople, qu'elles s'apprêtent à libérer du joug ottoman. Le Basileus byzantin a failli être vengé. Mais l'Angleterre intervient à temps pour éviter l'effondrement définitif de la menace ottomane qui avait pesé sur l'Europe depuis la défaite serbe sur le Champ des Merles en 1389. Tous ces événements historiques vont contribuer à faire énoncer clairement les concepts de la géopolitique moderne.
Mackinder et Lea : deux géopolitologues toujours actuels
En effet, en 1904, Halford John MacKinder prononce son fameux discours sur le "pivot" de l'histoire mondiale, soit la "Terre du Milieu" ou "Heartland", correspondant à l'Asie centrale et à la Sibérie occidentale. Les états-majors britanniques sont alarmés: le Transsibérien vient d'être inauguré, donnant à l'armée russe la capacité de se mouvoir beaucoup plus vite sur la terre. Le handicap des armées de Paul I et de Napoléon, incapables de marcher de concert vers la Perse et les Indes en 1801, est désormais surmonté. En 1912, Homer Lea, géopolitologue et stratège américain, favorable à une alliance indéfectible avec l'Empire britannique, énonce, dans The Day of the Saxons, les principes généraux de l'organisation militaire de l'espace situé entre Le Caire et Calcutta. Dans le chapitre consacré à l'Iran et à l'Afghanistan, Homer Lea explique qu'aucune puissance —en l'occurrence, il s'agit de la Russie— ne peut franchir la ligne Téhéran-Kaboul et se porter trop loin en direction de l'Océan Indien. De 1917 à 1921, le grand souci des stratèges britanniques sera de tirer profit des désordres de la révolution bolchevique pour éloigner le pouvoir effectif, en place à Moscou, des rives de la Mer Noire, du Caucase et de l'Océan Indien.
Les préliminaires de cette révolution bolchevique, qui ont lieu immédiatement après le discours prémonitoire de MacKinder en 1904 sur le pivot géographique de l'histoire et sur les "dangers" du Transsibérien pour l'impérialisme britannique, commencent dès 1905 par des désordres de rue, suivis d'un massacre qui ébranle l'Empire et permet de décrire le Tsar comme un monstre (qui redeviendra bon en 1914, comme par l'effet d'un coup de baguette magique!). Selon toute vraisemblance, les services britanniques tentent de procéder de la même façon en Russie, dans la première décennie du 20ième siècle, qu'en France à la fin du 18ième: susciter une révolution qui plongera le pays dans un désordre de longue durée, qui ne lui permettra plus de faire des investissements structurels majeurs, notamment des travaux d'aménagement territorial, comme des lignes de chemin de fer ou des canaux, ou dans une flotte capable de dominer le large. Les deux types de projets politiques que combattent toujours les Anglo-Saxons sont justement 1) les aménagements territoriaux, qui structurent les puissances continentales et diminuent ipso facto les atouts d'une flotte et de la mobilité maritime, et qui permettent l'autarcie commerciale; 2) la construction de flottes concurrentes. La France de 1783, la Russie de 1904 et l'Allemagne de Guillaume II développaient toutes trois des projets de cette nature: elles se plaçaient par conséquent dans le collimateur de Londres.
De 1905 à 1917
Pour détruire la puissance russe, bien équipée, dotée de réserves immenses en matières premières, l'Angleterre va utiliser le Japon, qui était alors une puissance émergeante, depuis la proclamation de l'ère Meiji en 1868. Londres et une banque new-yorkaise —la même qui financera Lénine à ses débuts— vont prêter les sommes nécessaires aux Japonais pour qu'ils arment une flotte capable d'attirer dans le Pacifique la flotte russe de la Baltique et de la détruire. C'est ce qui arrivera à Tshouchima (pour les tenants et aboutissants de cet épisode, cf. notre article sur le Japon : Robert Steuckers, «La lutte du Japon contre les impérialismes occidentaux», in : Nouvelles de Synergies Européennes, n°32, janvier-février 1998).
En 1917, on croit que la Russie va être plongée dans un désordre permanent pendant de longues décennies. On pense 1) détacher l'Ukraine de la Russie ou, du moins, détruire l'atout céréalier de cette région d'Europe, grenier à blé concurrent de la Corn Belt américaine; 2) on spécule sur l'effondrement définitif du système industriel russe; 3) on prend prétexte du caractère inacceptable de la révolution et de l'idéologie bolcheviques pour ne pas tenir les promesses de guerre faites à la Russie pour l'entraîner dans le carnage de 1914; devenue bolchevique, la Russie n'a plus droit à aucune conquête territoriale au-delà du Caucase au détriment de la Turquie; ne reçoit pas d'accès aux Détroits; on ne lui fait aucune concession dans les Balkans et dans le Delta du Danube (les principes du mémorandum de 1791 et du Traité de Paris de 1856 sont appliqués dans le nouveau contexte de la soviétisation de la Russie).
En 1918-19, les troupes britanniques et américaines occupent Mourmansk et asphyxient la Russie au Nord; Britanniques et Turcs, réconciliés, occupent le flanc méridional du Caucase, en s'appuyant notamment sur des indépendantistes islamiques azéris turcophiles (exactement comme aujourd'hui) et en combattant les Arméniens, déjà si durement étrillés, parce qu'ils sont traditionnellement russophiles (ce scénario est réitéré de nos jours); plus tard, Enver Pacha, ancien chef de l'état-major turc pendant la première guerre mondiale, organise, au profit de la stratégie globale des Britanniques, des incidents dans la zone-clef de l'Asie centrale, la Vallée de la Ferghana.
De la "Question d'Orient" à la révolte arabe
L'aventure d'Enver Pacha dans la Vallée de la Ferghana, qui s'est terminée tragiquement, constitue une application de ce que l'on appelle désormais la "stratégie lawrencienne" (cf.: Jean Le Cudennec, «Le point sur la guerre américaine en Afghanistan : le modèle "lawrencien"», in : Raids, n°189, février 2002). Comme son nom l'indique, elle désigne la stratégie qui consiste à lever des "tribus" hostiles à l'ennemi sur le propre territoire de celui-ci, comme Lawrence d'Arabie avait mobilisé les tribus arabes contre les Turcs, entre 1916 et 1918. Déboulant du fin fonds du désert, fondant sur les troupes turques en Mésopotamie et le long de la vallée du Jourdain, la révolte arabe, orchestrée par les services britanniques, annihile, par le fait même de son existence, la fonction de "tremplin" vers le Golfe Persique et l'Océan Indien que le binôme germano-turc accordait au territoire anatolien et mésopotamien de l'Empire ottoman. L'objectif majeur de la Grande Guerre est atteint : la grande puissance européenne, qui avait le rôle du challengeur le plus dangereux, et son espace complémentaire balkano-anatolo-mésopotamien (Ergänzungsraum), n'auront aucune "fenêtre" sur la Mer du Milieu (l'Océan Indien), qui, quadrillé par une flotte puissante, permet de tenir en échec la "Terre du Milieu" (le "Heartland" de MacKinder).
Après les traités de la banlieue parisienne, les Alliés procèdent au démantèlement du bloc ottoman, désormais divisé en une Anatolie turcophone et sunnite, et une mosaïque arabe balkanisée à dessein, où se juxtaposent des chiites dans le Sud de l'Irak, des Alaouites en Syrie, des chrétiens araméens, orthodoxes, de rite arménien ou autre, nestoriens, etc. et de larges masses sunnites, dont des wahhabites dans la péninsule arabique; le personnage central de la nouvelle république turque devient Moustafa Kemal Atatürk, aujourd'hui en passe de devenir un héros du cinéma américain (cf. : Michael Wiesberg, «Pourquoi le lobby israélo-américain s'engage-t-il à fond pour la Turquie? Parce que la Turquie donne accès aux pétroles du Caucase», in : Au fil de l'épée, Recueil n°3, octobre 1999).
Les atouts de l'idéologie d'Atatürk
Atatürk est un atout considérable pour les puissances thalassocratiques: il crée une nouvelle fierté turque, un nouveau nationalisme laïc, bien assorti d'un solide machisme militaire, sans que cette idéologie vigoureuse et virile, qui sied aux héritiers des Janissaires, ne mette les plans britanniques en danger; Atatürk limite en effet les ambitions turques à la seule Anatolie: Ankara n'envisage plus de reprendre pied dans les Balkans, de porter ses énergies vers la Palestine et l'Egypte, de dominer la Mésopotamie, avec sa fenêtre sur l'Océan Indien, de participer à l'exploitation des gisements pétroliers nouvellement découverts dans les régions kurdes de Kirkouk et de Mossoul, de contester la présence britannique à Chypre; le "turcocentrisme" de l'idéologie kémaliste veut un développement séparé des Turcs et des Arabes et refuse toute forme d'Etat, de khanat ou de califat regroupant à la fois des Turcs et des Arabes; dans une telle optique, la reconstitution de l'ancien Empire ottoman se voit d'emblée rejetée et les Arabes, livrés à la domination anglaise. On laisse se développer toutefois, en marge du strict laïcisme kémaliste, une autre idéologie, celle du panturquisme ou pantouranisme, qu'on instrumentalisera, si besoin s'en faut, contre la Russie, dans le Caucase et en Asie centrale. De même, le turcocentrisme peut s'avérer utile si les Arabes se montrent récalcitrants, ruent dans les brancards et manifestent leurs sympathies pour l'Axe, comme en Irak en 1941, ou optent pour une alliance pro-soviétique, comme dans les années 50 et 60 (Egypte, Irak, Syrie). Dans tous ces cas, la Turquie aurait pu ou pourra jouer le rôle du père fouettard.
Le rôle de l'Etat d'Israël
Israël, dans le jeu triangulaire qui allie ce nouveau pays, né en 1948, aux Etats-Unis (qui prennent le relais de l'Angleterre), et à la Turquie —dont la fonction de "verrou" se voit consolidée— a pour rôle de contrôler le Canal de Suez si l'Egypte ne se montre pas suffisamment docile. Au sud du désert du Néguev, Israël possède en outre une fenêtre sur la Mer Rouge, à Akaba, permettant, le cas échéant, de pallier toute fermeture éventuelle du Canal de Suez en créant la possibilité matérielle d'acheminer des troupes et des matériels via un système de chemin de fer ou de routes entre la côte méditerranéenne et le Golfe d'Akaba (distance somme toute assez courte; la même stratégie logistique a été utilisée du Golfe à la Caspienne, à travers l'Iran occupé, dès 1941; le matériel américain destiné à l'armée soviétique est passé sur cette voie, bien plus longue que la distance Méditerranée-Akaba et traversant de surcroît d'importants massifs montagneux).
Dans ce contexte, très effervescent, où ont eu lieu toutes les confrontations importantes d'après 1945, voyons maintenant quelle est, plus spécifiquement, la situation de l'Afghanistan.
Entre l'année 1918, ou du moins après l'échec définitif des opérations envisagées par Enver Pacha et ses commanditaires, et l'année 1979, moment où arrivent les troupes soviétiques, l'Afghanistan est au frigo, vit en marge de l'histoire. En 1978 et 1979, années où l'Iran est agité par la révolution islamiste de Khomeiny, l'URSS tente de réaliser le vieux rêve de Paul I: foncer vers les rives de l'Océan Indien, procéder au "grand bond vers le Sud" (comme le qualifiera Vladimir Jirinovski dans un célèbre mémorandum géopolitique, qui suscita un scandale médiatique planétaire).
Guerre indirecte et "counter-insurgency"
Les Etats-Unis, héritiers de la stratégie anglaise dans la région, ne vont pas tarder à réagir. Le Président démocrate, Jimmy Carter, perd les élections de fin 1980, et Reagan, un faucon, arrive au pouvoir en 1981. Le nouveau président républicain dénonce la coexistence pacifique et rejette toute politique d'apaisement, fait usage d'un langage apocalyptique, avec abus du terme "Armageddon". Ce vocabulaire apocalyptique, auquel nous sommes désormais habitués, revient à l'avant-plan dans les médias, au début du premier mandat de Reagan: on parle à nouveau de "Grand Satan" pour désigner la puissance adverse et son idéologie communiste. Sur le plan stratégique, la parade reaganienne est simple: c'est d'organiser en Afghanistan une guerre indirecte, par personnes interposées, plus exactement, par l'intermédiaire d'insurgés locaux, hostiles au pouvoir central ou principal qui se trouve, lui, aux mains de l'ennemi diabolisé. Cette stratégie s'appelle la "counter-insurgency" et est l'héritière actuelle des sans-culottes manipulés contre Louis XVI, des Vendéens excités contre la Convention —parce qu'elle a fini par tenir Anvers— et puis ignoblement trahis (affaire de Quiberon), des insurgés espagnols contre Napoléon, des guérilleros philippins armés contre les Japonais, etc.
En Afghanistan, la "counter-insurgency" se déroule en trois étapes: on arme d'abord les "moudjahiddins", qui opèrent en alliant anti-communisme, islamisme et nationalisme afghan, pendant toute la période de l'occupation soviétique. Le harcèlement des troupes soviétiques par ces combattants bien enracinés dans le territoire et les traditions de l'Afghanistan a été systématique, mais sans les armements de pointe, notamment les missiles "Stinger" fournis par les Etats-Unis et financés par la drogue, ces guerriers n'auraient jamais tenu le coup.
Seconde étape : entre 1989 et 1995/96, nous assistons en Afghanistan à une sorte de modus vivendi. Les troupes soviétiques se sont retirées, la Russie a cessé d'adhérer à l'idéologie communiste et de la professer. De ce fait, la diabolisation, le discours sur le "Grand Satan" n'est plus guère instrumentalisable, du moins dans la version établie au temps de Reagan. La troisième étape commence avec l'arrivée sur la scène afghane des talibans, moudjahiddins plus radicaux dans leur islam de facture wahhabite. Il s'agit d'organiser une "counter-insurgency" contre un gouvernement central afghan russophile, qui entend conserver la neutralité traditionnelle de l'Afghanistan, acquise depuis la terrible défaite subie par les troupes britanniques en 1842, neutralité qui avait permis au pays de rester à l'écart des deux guerres mondiales.
Ben Laden, l'ISI et Leila Helms
Les talibans déploient leur action avec le concours de l'Arabie Saoudite, dont est issu leur maître à penser, Oussama Ben Laden, du Pakistan et de son solide service secret, l'ISI, et des services américains agissant sous l'impulsion de Leila Helms. Les Saoudiens fournissent les fonds et l'idéologie, l'ISI pakistanais assure la logistique et les bases de repli sur les territoires peuplés par l'ethnie pachtoune. Les deux experts français Brisard et Dasquié (cf. Jean-Charles Brisard & Guillaume Dasquié, Ben Laden - La vérité interdite, Denoël, coll. "Impacts", 2001) explicitent clairement le rôle joué par Leila Helms dans leur ouvrage magistral, bien diffusé et immédiatement traduit en allemand (cette simultanéité laisse espérer une cohésion franco-allemande, critique à l'égard de l'unilatéralisme américain). Toutefois, dans ce jeu, chacun des acteurs poursuit ses propres objectifs. Dans le livre de Brisard et Dasquié, le double jeu de Ben Laden est admirablement décortiqué; par ailleurs Bauer et Raufer (cf. : Alain Bauer & Xavier Raufer, La guerre ne fait que commencer - Réseaux, financements, armements, attentats… les scénarios de demain, J. C. Lattès, 2002) soulignent le risque d'une exportation dans les banlieues françaises (et ailleurs en Europe) d'une effervescence anti-européenne, conduisant à terme à la dislocation totale de nos sociétés.
Le pétrole et le coton
Les objectifs immédiats des Etats-Unis, tant dans l'opération consistant à appuyer les talibans de manière inconditionnelle, que dans l'opération ultérieure actuelle, visant à les chasser du pouvoir à Kaboul sont de deux ordres; le premier est avoué, tant il est patent: il s'agit de gérer correctement l'acheminement du pétrole de la Caspienne et de l'Asie centrale via les futurs oléoducs transafghans. Le second est généralement inavoué : il s'agit de gérer la production du coton en Asie centrale, de faire main basse, au profit des grands trusts américains du coton, de cette matière première essentielle pour l'habillement de milliards d'êtres humains sur la planète. L'exploitation conjointe des nappes pétrolifères et des champs de culture du coton pourrait transformer cette grande région en un nouvel Eldorado.
Les deux anacondas
La gestion optimale de l'opération militaire, prélude à une gigantesque opération économique, est désormais possible, à moindres frais, grâce à la couverture de satellites que possèdent désormais les Américains. Haushofer, le géopolitologue allemand, disait que les flottes des thalassocraties parvenaient à étouffer tout développement optimal des grandes puissances continentales, à occuper des bandes littorales de comptoirs soustraites à toute autorité politique venue de l'intérieur des terres, à priver ces dernières de débouchés sur les océans. Haushofer utilisait une image expressive pour désigner cet état de choses : l'anaconda qui enserre sa proie, c'est-à-dire les continents eurasien et sud-américain. Si les flottes anglo-saxonnes des premières décennies du 20ième siècle, consolidées par le traité foncièrement inégal que fut ce Traité de Washington de 1922, sont le premier anaconda, il en existe désormais un nouveau, maître de l'espace, autre res nullius à l'instar des mers au 18ième siècle. Le réseau des satellites observateurs américains constitue le second anaconda, enserrant la terre tout entière.
Le réseau des satellites consolide un autre atout que se sont donné les puissances anglo-saxonnes depuis la seconde guerre mondiale : les flottes de bombardiers lourds. Il faut se rappeler la métaphore de Swift, dans les fameux Voyages de Gulliver, où un peuple, vivant sur une île flottant dans les airs, écrase ses ennemis selon trois stratégies: le lancement de gros blocs de roche sur les installations et les habitations du peuple ennemi, le maintien en état stationnaire de leur île volante au-dessus du territoire ennemi afin de priver celui-ci de la lumière du soleil, ou la destruction totale du pays ennemi en faisant atterrir lourdement l'île volante sur une ville ou sur la capitale afin de la détruire totalement. Indubitablement, ce récit imaginaire de Swift, répété à tous les Anglais pendant des générations, a donné l'idée qu'une supériorité militaire aérienne totale, capable d'écraser complètement le pays ennemi, était indispensable pour dominer définitivement le monde. Toutefois la théorisation du bombardement de terreur par l'aviation vient du général italien Douhet (cf. : Gérard Chaliand, Anthologie mondiale de la stratégie - Des origines au nucléaire, Laffont, 1990). Elle sera mise en application par les "Bomber Commands" britannique et américain pendant la seconde guerre mondiale, mais au prix de plus de 200.000 morts, rien que dans les forces aériennes. Aujourd'hui, la couverture spatiale, les progrès de l'avionique en général et la précision des missiles permettent une utilisation moins coûteuse en hommes de l'arme aérienne (de l' air power). C'est ainsi qu'on envisage des opérations de grande envergure avec "zéro mort", côté américain, côté "Empire du Bien", et un maximum de cadavres et de désolation, côté adverse, côté "Axe du Mal".
Face à la situation afghane actuelle, qui est le résultat d'une politique délibérée, forgée depuis près de deux siècles, avec une constance étonnante, quels sont les déboires, les possibilités, les risques qui existent pour l'Europe, quelle est notre situation objective?
Les déboires de l'Europe :
◊1. Nous avons perdu sur le Danube, car un complot de même origine a visé l'élimination physique ou politique de quatre hommes, très différents les uns des autres quant à leur carte d'identité idéologique : Ceaucescu, Milosevic, Haider et Kohl (voire Stoiber). A la suite d'une guerre médiatique et de manipulations d'images (avec les faux charniers de Timisoara), le dictateur communiste roumain est éliminé. On a pu penser, comme nous-mêmes, à la liquidation d'une mauvaise farce, mais ce serait oublier que ce personnage balkanique haut en couleur avait réussi vaille que vaille à organiser les "cataractes" du Danube, à faire bâtir deux ponts reliant les rives roumaine et bulgare du grand fleuve et à creuser le canal "Danube - Mer Noire" (62,5 km de long, afin d'éviter la navigation dans les méandres du delta). Notons que le creusement de ce canal avait mécontenté les Soviétiques qui ont un droit d'accès au delta, mais non pas à un canal construit par le peuple roumain. Même si l'arbitraire du régime de Ceaucescu peut être jugé a posteriori pénible et archaïque, force est de constater que sa disparition n'a pas apporté un ordre clair au pays, capable de poursuivre un projet danubien cohérent ou de générer des fonds suffisants pour financer de tels travaux.
Milosevic, le Danube et l'Axe Dorien
Les campagnes médiatiques visant à diaboliser Milosevic ont deux raisons géopolitiques majeures : créer sur le cours du Danube, à hauteur de Belgrade, point stratégique important comme l'attestent les rudes combats austro-ottomans pour s'emparer de cette place, une zone soustraite à toute activité normale, via les embargos. L'embargo ne sert pas à punir des "méchants", comme veulent nous le faire croire les médias aux ordres, mais à créer artificiellement des vides dans l'espace, à soustraire à la dynamique spatiale et économique des zones visées, potentiellement puissantes, afin de gêner des puissances concurrentes plus fortes. La Serbie, de dimensions fort modestes, n'est pas un concurrent des Etats-Unis; par conséquent son élimination n'a pas été le véritable but en soi; l'objectif visé était manifestement autre; dès lors, il s'est agi d'affaiblir des puissances plus importantes.
Dans la région, ce ne peut être que l'Europe en général et son cœur germanique en particulier. Enfin, le vide créé en Serbie par la politique d'embargo, empêche tout consortium euro-serbe, toute fédération balkanique ou tout resserrement de liens entre petites puissances balkaniques (comme la Grèce et la Serbie), empêche d'organiser définitivement le corridor Belgrade - Salonique, excellente "fenêtre" de l'Europe centrale sur la Méditerranée orientale, que nous avions appelé naguère l'"Axe Dorien".
Haider et Kohl : dénominateur commun : le Danube
Les campagnes de diffamation contre Jörg Haider relèvent d'une même volonté de troubler l'organisation du trafic danubien. Les tentatives, heureusement avortées, d'organiser un boycott contre l'Autriche, auraient installé une deuxième zone "neutralisée", un deuxième vide, sur le cours du grand fleuve qui est vraiment l'artère vitale de l'Europe. Enfin, le Chancelier allemand Helmut Kohl, qui a réalisé le plus ancien rêve européen d'aménagement territorial, soit le creusement du Canal Rhin - Main - Danube, a été promptement évacué de la scène allemande à la suite d'une campagne de presse l'accusant de corruptions diverses (mais bien bénignes à côté de celles auxquelles les féaux de l'OTAN se sont livrées au cours des décennies écoulées). Son successeur, à la tête des partis de l'Union chrétienne-démocrate (CDU/CSU), le Bavarois Stoiber, a subi, à son tour, des campagnes de diffamations infondées, qui l'ont empêché d'accéder aux commandes de la RFA —du moins jusqu'à nouvel ordre.
◊2. Nous avons perdu dans le Caucase. L'Azerbaïdjan est complètement inféodé à la Turquie, fait la guerre aux Arméniens au Nagorni-Karabakh, s'aligne sur les positions anti-russes de l'Otan, coince l'Arménie résiduaire (ex-république soviétique) entre la Turquie et lui-même, ne permettant pas des communications optimales entre la Russie, l'Arménie et l'Iran (ou le Kurdistan potentiel). En Tchétchénie et au Daghestan, les troubles suscités par des fondamentalistes financés par l'Arabie Saoudite —également soutenus par les services turcs travaillant pour les Etats-Unis— empêchent l'exploitation des oléoducs et réduisent l'influence russe au nord de la chaîne du Caucase. Plus récemment, la Géorgie de Chevarnadze, en dépit de la solidarité orthodoxe qu'elle devrait avoir avec la Russie et l'Arménie, vient de s'aligner sur la Turquie et les Etats-Unis. Ces trois faisceaux d'événements contribuent à empêcher l'organisation des communications en Mer Noire, dans le Caucase et dans la Caspienne.
Du "containment" de l'Iran
◊3. Nous avons perdu sur la ligne Herat - Ladakh, dans le Cachemire. Le verrouillage pakistanais des hauteurs himalayennes au Cachemire sert à empêcher l'établissement de toute frontière commune entre la Russie (ou une république post-soviétique qui resterait fidèle à une alliance russe) et l'Inde. La présence américaine à Herat, par fractions de l'Alliance du Nord interposées, permet aussi de placer un premier pion dans le containment de l'Iran. Celui-ci est désormais coincé entre une Turquie totalement dépendante des Etats-Unis et un glacis afghan dominé par ces derniers. Il reste à éliminer l'Irak pour parfaire l'encerclement de l'Iran, prélude à son lent étouffement ou à son invasion (comme pendant l'été de 1941).
◊4. Nous avons perdu dans les mers intérieures. Les deux mers intérieures qui sont le théâtre de conflits de grande ampleur depuis plus d'une décennie sont l'Adriatique et le Golfe Persique. Ces deux mers intérieures, comme j'ai déjà eu maintes fois l'occasion de le démontrer, sont les deux espaces maritimes (avec la Mer Noire) qui s'enfoncent le plus profondément dans l'intérieur des terres immergées de la masse continentale eurasienne. La Guerre du Golfe (et celles qui s'annoncent dans de brefs délais), de même que les complots américains qui ont amené à la chute du Shah (cf.: Houchang Nahavandi, La révolution iranienne - Vérité et mensonges, L'Age d'Homme, Lausanne, 1999), visent non seulement à contrôler l'embouchure des deux grands fleuves mésopotamiens, artères du Croissant Fertile, soit le Chatt El Arab, et à contenir l'Iran sur la rive orientale du Golfe.
La révolution islamiste d'Iran a eu la même fonction que la révolution sans-culotte en France ou la révolution bolchevique en Russie : créer le chaos, abattre un régime raisonnable en passe de réaliser de grands travaux d'infrastructure et d'aménagement territorial, et, dès que le nouveau régime révolutionnaire se stabilise, l'attaquer de front et appeler à la croisade contre lui, sous prétexte qu'il incarnerait une nouveauté perverse et diabolique.
Quant à l'idée de verrouiller l'Adriatique, elle apparaît évidente dès que l'Allemagne et l'Autriche, par l'intermédiaire d'une petite puissance qui leur est traditionnellement fidèle, comme la Croatie, accèdent à nouveau à la Méditerranée via les ports du Nord de l'Adriatique. Ce verrouillage aura lieu exactement comme au temps de la domination ottomane (éphémère) sur ces mêmes eaux, à hauteur du Détroit d'Otrante, dominé par l'Albanie.
Formuler une stratégie claire
Face à cette quadruple défaite européenne, il convient de formuler une stratégie claire, un programme d'action général pour l'Europe (qu'il sera très difficile de coordonner au départ, les Européens ayant la sale habitude de tirer toujours à hue et à dia et de travailler dans le désordre). Ce programme d'action contient les points suivants:
◊ Les Européens doivent montrer une unité inflexible dans les Balkans, s'opposer de concert à toute présence américaine et turque dans la péninsule sud-orientale de notre continent. Cette politique doit également viser à neutraliser, dans les Balkans eux-mêmes et dans les diasporas albanaises disséminées dans toute l'Europe, les réseaux criminels (prostitution, trafic de drogues, vol d'automobiles), liés aux structures albanaises anti-serbes et anti-macédoniennes, ainsi qu'au binôme mafias-armée de Turquie et à certains services américains. La cohésion diplomatique européenne dans les Balkans passe dès lors par un double travail: en politique extérieure —faire front à toute réimplantation de la Turquie dans les Balkans— et en politique intérieure —faire front à toute installation de mafias issues de ces pays et jouant un double rôle, celui de déstabiliser nos sociétés civiles et celui de servir de cinquièmes colonnes éventuelles.
◊ Les Européens doivent travailler de concert à ôter toute marge de manœuvre à la Turquie dans ses manigances anti-européennes. Cette politique implique
1) d'évacuer de Chypre toutes les unités militaires et les administrations civiles turques et de permettre à toutes les familles grecques expulsées lors de l'agression de l'été 1974 de rentrer dans leurs villages ancestraux; d'évacuer vers la Turquie tous les "nouveaux" Cypriotes turcs, non présents sur le territoire annexé avant l'invasion de 1974;
2) d'obliger la Turquie à renoncer à toute revendication dans l'Egée, car la conquête de l'Ionie s'est faite à la suite d'un génocide inacceptable à l'encontre de la population grecque, consécutif d'un autre génocide, tout aussi impitoyable, dirigé contre les Arméniens; la Turquie n'a pas le droit de revendiquer la moindre parcelle de terrain ou les moindres eaux territoriales dans l'Egée; la Grèce, et derrière elle une Europe consciente de ses racines, a, en revanche, le droit inaliénable de revendiquer le retour de l'Ionie à la mère patrie européenne; la Turquie dans ce contexte, doit faire amende honorable et s'excuser auprès des communautés chrétiennes orthodoxes du monde entier pour avoir massacré jadis le Patriarche de Smyrne, d'une manière particulièrement effroyable (le cas échéant payer des réparations sur son budget militaire);
3) d'obliger la Turquie à cesser toute agitation auprès des musulmans de Bulgarie;
4) d'obliger la Turquie à cesser toute manœuvre contre l'Arménie, avec la complicité de l'Azerbaïdjan; de même, à cesser tout soutien aux terroristes tchétchènes;
5) l'Europe, dans ce contexte, doit se poser comme protectrice des minorités orthodoxes en Turquie; au début du siècle, celles-ci constituaient au moins 25% de la population sous la souveraineté ottomane; elles ne sont plus que 1% aujourd'hui; cette élimination graduelle d'un quart de la population interdit à la Turquie de faire partie de l'UE;
6) d'obliger la Turquie à évacuer toutes ses troupes disséminées en Bosnie et au Kosovo;
7) de faire usage des droits de veto des Etats européens au sein de l'OTAN, au moins tant que les problèmes de Chypre et d'Arménie ne sont pas résolus; dans la même logique, refuser toute forme d'adhésion de la Turquie à l'UE.
(à suivre)

 Une tendance regrettable de l’auteur à essentialiser dans la durée certaines catégories historiques et politiques utilisées est décelable. C’est le cas pour la notion de « Russie historique », c’est-à-dire envisagée dans son extension territoriale maximale avec une obsession des façades maritimes baltique et méridionale, ceci avec l’idée sous-jacente que tout territoire « réuni » au noyau initial moscovite est voué à le rester éternellement. De même, « l’espace géopolitique russe » est considéré dans sa plus grande extension, en incluant le glacis des pays du Pacte de Varsovie. A aucun moment, l’auteur n’envisage de mettre en doute le bien fondé de ces catégories et la légitimité éventuelle des tendances centrifuges de la part des populations non russes. Au contraire, elle affiche une nostalgie impériale décomplexée qui dépasse largement le cadre des frontières de la Fédération de Russie. Tout cela sonne comme un air de déjà-vu et entendu, que ce soient le fameux discours de Vladimir Poutine du 9 mai 2005, les déclarations dont sont régulièrement coutumiers les officiels russes ou le nouveau manuel d’histoire de Vladislav Sourkhov.
Une tendance regrettable de l’auteur à essentialiser dans la durée certaines catégories historiques et politiques utilisées est décelable. C’est le cas pour la notion de « Russie historique », c’est-à-dire envisagée dans son extension territoriale maximale avec une obsession des façades maritimes baltique et méridionale, ceci avec l’idée sous-jacente que tout territoire « réuni » au noyau initial moscovite est voué à le rester éternellement. De même, « l’espace géopolitique russe » est considéré dans sa plus grande extension, en incluant le glacis des pays du Pacte de Varsovie. A aucun moment, l’auteur n’envisage de mettre en doute le bien fondé de ces catégories et la légitimité éventuelle des tendances centrifuges de la part des populations non russes. Au contraire, elle affiche une nostalgie impériale décomplexée qui dépasse largement le cadre des frontières de la Fédération de Russie. Tout cela sonne comme un air de déjà-vu et entendu, que ce soient le fameux discours de Vladimir Poutine du 9 mai 2005, les déclarations dont sont régulièrement coutumiers les officiels russes ou le nouveau manuel d’histoire de Vladislav Sourkhov.




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg