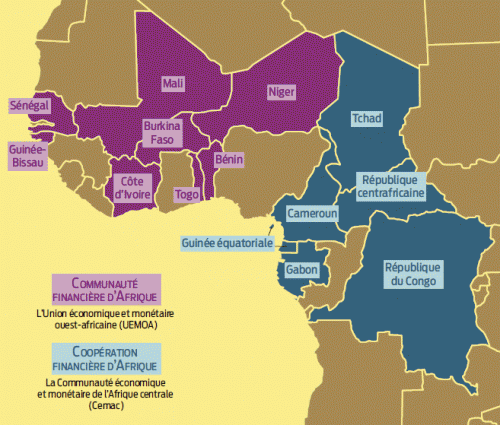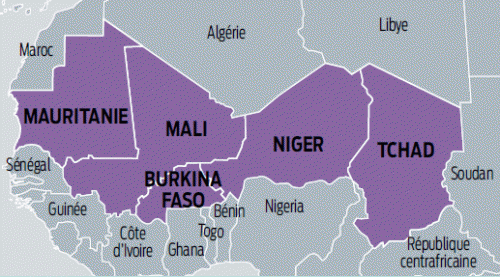mardi, 20 février 2024
Washington "avertit" l'Afrique: seulement des bases américaines et pas de place pour la Chine
Washington "avertit" l'Afrique: seulement des bases américaines et pas de place pour la Chine
Enrico Toselli
Source: https://electomagazine.it/washington-avverte-lafrica-solo-basi-americane-e-nessuno-spazio-per-la-cina/
Danger, Chine, danger pour la paix mondiale ! L'avertissement a été lancé par les bons Américains qui ont mis en garde le Gabon et la Guinée équatoriale contre l'acceptation de bases militaires de Pékin. En effet, les équilibres actuels visant à garantir la pax americana seraient rompus. On ne peut peut-être pas définir ce qu'est exactement la paix, mais les guerres atlantistes ne sont pas de vraies guerres, ce sont des exportations de démocratie avec quelques effets secondaires. Comme les plus de 30.000 Palestiniens assassinés par les tendres bouchers de Netanyahou.
Ainsi, en Afrique, comme en Asie et en Europe, les seules bases militaires autorisées sont les bases yankees. Parce que les bombes américaines sont bonnes et justes. Et bonnes pour la "démocratie".
Alors, au nom de la paix et de la démocratie, on menace les pays qui osent faire des choix différents. Qui acceptent d'être courtisés, et bien payés, par les méchants de Pékin au lieu de devoir payer pour être protégés par les troupes des gentils.
Bien entendu, les désinformateurs atlantistes s'alignent parfaitement sur le discours de Washington. Pourquoi les Chinois devraient-ils avoir des bases sur la côte atlantique ? C'est comme si les États-Unis avaient des bases militaires en Asie ! Ah bon ? Peu importe, mais ils le peuvent. Ce sont des bases démocratiques. En Irak, en Syrie, au Liban, les gouvernements respectifs n'en veulent pas, mais les gentils ne peuvent pas écouter les choix des autres pays. Et celui qui ne veut pas des bases américaines est mauvais et doit être puni et corrigé. De peur qu'ils ne choisissent d'accueillir des Russes et des Chinois. Donc, malgré eux, les Américains sont obligés d'occuper des pays théoriquement souverains. Ils le font pour notre bien, ça va sans dire. Et malheur à eux s'ils protestent.
20:33 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, afrique, affaires africaines, états-unis, africom, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 20 novembre 2023
Le cœur du Sud
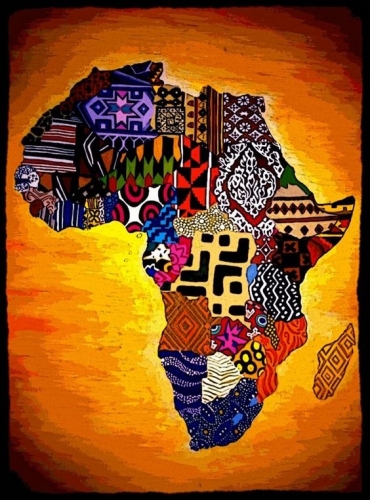
Le cœur du Sud
Leonid Savin
Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/southern-heartland
Récemment, la coopération avec les pays africains a suscité un intérêt croissant au niveau mondial. L'affaiblissement de l'autorité de l'Occident sur le continent peut être l'une des raisons de cette réorientation vers le Sud et l'Est. De multiples facteurs économiques, politiques, stratégiques et géopolitiques contribuent également à cette réorientation.
Ne vous laissez pas tromper par les cartes de la projection de Mercator : l'Afrique est nettement plus grande que l'Europe en termes de taille réelle. C'est un immense continent qui couvre plus de 20 % de la masse continentale de la Terre et qui compte 54 nations indépendantes. Il s'agit de vastes zones qui peuvent être utilisées pour l'agriculture, les gisements de ressources naturelles et le soutien politique, comme le vote aux Nations unies.
Ce continent a beaucoup souffert du colonialisme européen. Bien que l'Afrique ait donné naissance à de nombreuses civilisations anciennes et à des États puissants, tels que l'Égypte ancienne et l'Empire éthiopien (l'Abyssinie), les peuples du continent ont toujours souffert de l'oppression et de la domination extérieure. D'abord directement, puis indirectement. Tout le 20ème siècle a été consacré aux tentatives de nombreux pays de ce continent pour se libérer de la dépendance coloniale. Et la poursuite de cette lutte (déjà contre les chaînes du néocolonialisme) se poursuit encore aujourd'hui.
Il n'est pas nécessaire de vous rappeler que l'Eurasie possède une zone appelée "Heartland", l'axe géographique de l'histoire. Ces deux termes ont été introduits par le géographe britannique Halford J. Mackinder. Pour une raison ou une autre, beaucoup de gens oublient qu'il parlait également d'un second Heartland, l'île mondiale. Par île mondiale, il entendait l'Eurasie et l'Afrique, reliées par la péninsule arabique. Contrairement au Heartland eurasien, il a proposé de l'appeler Heartland méridional en raison de sa place sur le continent africain. Il est certain qu'il a surtout parlé de la nécessité de contrôler le Heartland nord pour dominer l'Eurasie et, en fin de compte, l'île mondiale.
Et compte tenu de la manière dont les stratèges anglo-saxons élaborent leur politique étrangère, suivent leurs doctrines et leurs idées fixes, on comprend mieux pourquoi les États-Unis s'intéressent tant à l'Afrique. Le Southern Heartland pour être exact. Parce qu'en géopolitique mondiale, ces deux Heartlands ont des corrélations.
Selon Mackinder, le Southern Heartland s'étend du Soudan à la pointe ouest de la Gambie sur la côte atlantique et couvre la partie de l'Afrique située en dessous du Sahara jusqu'aux forêts tropicales qui s'étendent au niveau de l'équateur. L'extrémité nord-est du Heartland sud est constituée par l'Éthiopie et la Somalie, qui ont accès au Yémen, et il existe un passage à travers les steppes arabes vers le Heartland nord. Mackinder évoque certaines similitudes entre les deux massifs désignés en ce qui concerne la facilité des liaisons de transport, les réseaux fluviaux et les terres fertiles.
Il souligne notamment l'importance de la Syrie et de la Palestine historiques en tant que lien entre l'Afrique et l'Eurasie. Dans le contexte des conflits actuels en Syrie et dans la bande de Gaza, ainsi que des efforts déployés par les États-Unis pour maintenir leur contrôle sur la souveraineté libanaise et pour utiliser Israël comme mandataire en Asie occidentale, cela indique que Washington s'appuie toujours sur la formule Mackinder pour définir sa stratégie dans la région.
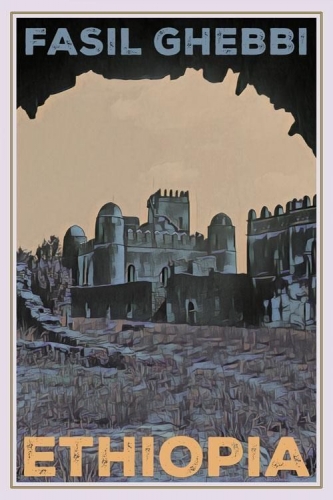
Examinons maintenant la situation politique actuelle dans le South Heartland. En commençant par la partie orientale, nous découvrons des États confrontés à une crise ou à un conflit. Le Soudan, avec l'implication directe des États-Unis, a été divisé en deux parties, dont l'une est aujourd'hui en pleine guerre civile. Le Sud-Soudan a également connu des conflits et des affrontements interethniques. Le conflit dans le nord de l'Éthiopie a duré de 1961 à 1991 et a conduit à la formation de l'Érythrée. Cependant, après la reconnaissance de l'indépendance de ce pays en 1993, la guerre entre les deux États a éclaté. Plus récemment, en Éthiopie, un conflit interne a éclaté dans la province du Tigré. Les responsables de la Fédération ont accusé les États-Unis de soutenir les rebelles et les séparatistes. La Somalie a été confrontée à plusieurs conflits, ce qui a entraîné un état critique de son économie. Le dollar américain y est utilisé comme monnaie, ce qui indique clairement une dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Seul Djibouti, après s'être libéré de la France, a réussi à devenir autosuffisant dans une certaine mesure. Cependant, il abrite des bases militaires des États-Unis, de la France, de l'Italie, du Japon et, plus récemment, de la Chine. Leur approche équilibrée des relations internationales a deux significations.
Ensuite, si vous vous déplacez vers l'ouest, dans le Heartland méridional se trouvent le Tchad, le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Le Tchad est en proie à des militants islamiques et l'une des opérations menées contre eux en 2021 a coûté la vie au président du pays. En octobre 2022, des émeutes ont eu lieu dans tout le pays. Au début de cette année, le gouvernement a nationalisé les actifs de la filiale d'Exxon Mobil. En outre, l'uranium est extrait dans le pays avec la participation de la société française Ogapo S.A., qui possède également des actifs au Niger, au Nigeria, au Gabon et en Namibie. Actuellement, la France est toujours présente dans le pays et du personnel militaire français a récemment été transféré du Niger vers le Mali.
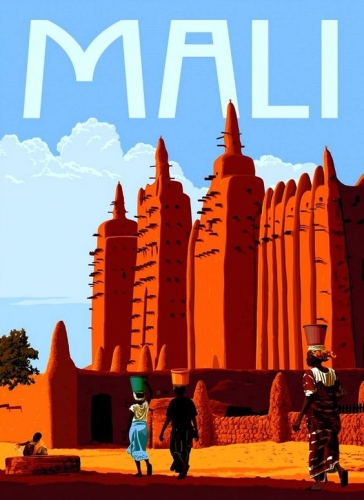
Le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont récemment convenu de créer une Alliance des États du Sahel. Cette décision fait suite à des coups d'État militaires et à la quasi-expulsion des Français de ces pays. Malgré la menace des pays de la CEDEAO (à l'exception de ceux qui se sont retirés) de déployer des troupes au Niger, ils se sont finalement abstenus de le faire.
La Guinée, qui a un accès à l'océan et a connu un coup d'État militaire en 2021, a rejoint la nouvelle Alliance du Sahel.
Au Sénégal, pays voisin, le sentiment de rejet du colonialisme et de la France est également très fort. Le premier dirigeant de cette nation, Léopold Sedar Senghor, était l'un des défenseurs de la négritude, une philosophie politique qui soulignait le développement unique des peuples africains.
Nous constatons donc des problèmes fréquents dans le cœur méridional, et l'influence occidentale se manifeste par un néocolonialisme évident et une série d'installations militaires.
Les récentes prises de pouvoir par les militaires ont mis l'accent sur la libération nationale, et il est possible que cette tendance persiste en raison des forces extérieures qui s'efforcent de gérer les crises et de soutenir les gouvernements locaux.
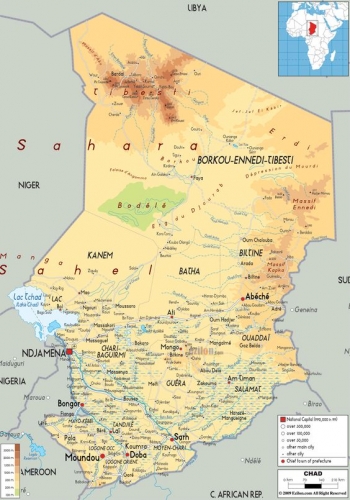
Mais le Rimland (zone côtière) de l'Afrique au nord est également directement lié au South Heartland. Par exemple, l'aide de la Libye a partiellement assuré la sécurité du Niger et du Tchad jusqu'en 2011. Cependant, une rébellion menée de l'extérieur a détruit la Jamahiriya libyenne, entraînant une guerre civile. L'effet domino a causé des problèmes avec les islamistes au Tchad et au Niger, mais aussi en Tunisie et en Égypte. L'Algérie a adopté une ligne politique stratégiquement correcte et continue de coopérer étroitement avec la Russie. Dans le même temps, les relations avec l'Espagne, qui recevait du gaz naturel de ce pays, se sont détériorées.
Dans le nord-ouest, il existe un triangle de contradictions entre la Mauritanie, le Maroc et l'Algérie sur le statut du Sahara occidental. L'Algérie soutient le Front Polisario, mais le Maroc contrôle le Sahara occidental, où se trouvent les plus grandes réserves de phosphate. Les habitants du Sahara occidental estiment que le phosphate leur appartient et qualifient d'illégales l'exploitation et la vente de ce minerai par le Maroc. D'ailleurs, Donald Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental en 2020 en échange de l'établissement de relations diplomatiques entre le Maroc et Israël. Tous ces facteurs affectent les pays situés en dessous du Sahara.
Si nous considérons la région située sous le Southern Heartland lui-même, la République centrafricaine se trouve plus près de l'équateur. À proximité se trouve l'un des géants du continent, la République démocratique du Congo, qui représente un grand potentiel. L'Angola, pays voisin, a également connu un développement rapide, même après le départ du Portugal. Aujourd'hui, la Chine investit dans le développement des infrastructures et de l'industrie dans ce pays. Dans l'ensemble, Pékin cherche à établir des centres de transport pour son projet "Belt and Road" et à s'assurer un accès aux ressources naturelles des pays africains.
La Russie est également une invitée de marque en Afrique. Cela s'explique principalement par l'héritage favorable de l'implication de notre nation dans l'élaboration du destin politique et économique de divers pays africains.
L'Afrique du Sud interagit avec la Russie dans le cadre des BRICS depuis de nombreuses années. À partir du 1er janvier 2024, le club s'élargira à l'Éthiopie, située en Afrique.
L'environnement politique en Afrique est en train de changer. Les perspectives extérieures changent et une pensée indépendante se développe, en fonction de la négritude, du panafricanisme, du socialisme africain et de l'humanisme africain. Une nouvelle tendance, l'afropolitanisme, est apparue et crée une identité transcontinentale. Il est clair que ce mode de pensée renvoie aux conditions nécessaires pour que l'Afrique devienne un acteur unique dans un monde aux puissances multiples.
19:21 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, affaires africaines, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 27 octobre 2023
Un baril de poudre: la Libye, l'"Occident" et le flot de demandeurs d'asile

Un baril de poudre: la Libye, l'"Occident" et le flot de demandeurs d'asile
Par Alexander Markovics
L'avertissement de Kadhafi à l'Europe
"Maintenant, écoutez-moi, peuple de l'OTAN ! Vous êtes en train de bombarder le mur qui a stoppé l'immigration africaine vers l'Europe, y compris les terroristes d'Al-Qaïda, ce mur était la Libye. Vous êtes en train de le détruire. Vous êtes des idiots et vous brûlerez en enfer pour les milliers d'immigrants venus d'Afrique et pour votre soutien à Al-Qaïda". (Muammar al-Gadaffi, président libyen 1969 - 2011)
Marée de l'asile : 700.000 personnes veulent passer de la Libye à l'UE
Ces paroles du leader de la révolution libyenne, Kadhafi, se sont avérées exactes. Depuis l'intervention militaire occidentale de 2011, la Libye est en proie au chaos. Des groupes armés se font la guerre et se partagent le pays, et l'EI s'est même implanté dans certaines régions. Une nouvelle guerre civile de 2014 à 2020 a finalement abouti à la division du pays: alors qu'à l'ouest du pays, centré sur Tripoli, les forces proches des Frères musulmans donnent le ton et sont soutenues par la Turquie, le général Khalifa Haftar, d'orientation nationaliste et laïque, qui bénéficie notamment du soutien de la Russie, règne sur l'est du pays. La tentative d'instaurer un gouvernement d'unité nationale a jusqu'à présent échoué en raison de la rivalité entre les deux camps. La Libye semble se désintégrer de plus en plus dans les zones tribales d'avant le règne de Kadhafi. Il manque encore un homme qui, comme Mouammar Kadhafi, pourrait unifier les tribus.

Seul le second fils de ce dernier, Saïf-al-Islam, est considéré par les observateurs comme un candidat potentiel pour cette tâche - mais il doit craindre pour sa vie, car l'Occident s'en prendra à lui. Tout cela se passe dans un pays cinq fois plus grand que l'Allemagne, avec six frontières extérieures et une population d'à peine sept millions d'habitants. Environ 700.000 d'entre eux sont, en juillet 2023, des étrangers, dont une grande partie ne veulent utiliser la Libye que pour transiter vers l'Europe.
Le chaos en Libye : violence, trafic d'êtres humains, pauvreté
Aujourd'hui, le quotidien libyen est marqué par la violence, la traite des êtres humains, la pauvreté et la défaillance de l'État. Les fonctionnaires, par exemple, ne reçoivent pas leur salaire pendant des mois, les factures d'électricité et de gaz ne sont pas payées par de nombreux Libyens parce que personne ne les paie, et l'infrastructure se détériore. Le dernier exemple en date du déclin du pays est l'effondrement du barrage de Derna, qui a fait jusqu'à 20.000 morts. Mais en même temps, cet État d'Afrique du Nord est aussi une porte sur la Méditerranée et donc sur l'Europe. Par nécessité, de nombreux anciens employés de l'État ont profité de cette occasion pour se lancer dans le commerce de la traite des êtres humains, beaucoup plus lucratif pour eux.
C'est précisément ce chaos qui a rendu possible la crise des réfugiés de 2015, car l'île de Lampedusa se trouve non loin des côtes libyennes et constitue ainsi la voie d'accès à l'UE pour les masses africaines en détresse. Alors que sous Kadhafi, la Libye coopérait avec le gouvernement italien pour empêcher l'immigration vers l'Europe, toutes les digues ont cédé et le flot des demandeurs d'asile s'est déversé sur l'Europe depuis.
La route de la Méditerranée centrale: porte d'entrée en Europe, terrain de jeu des passeurs et des ONG allemandes
La route de la Méditerranée centrale est un facteur important dans ce contexte. Elle est considérée par les passeurs et les candidats à l'émigration comme la voie la plus sûre vers l'Europe - entre janvier et mi-juin 2023, "seulement" 662 personnes y ont trouvé la mort, et 368 autres sont portées disparues. Une traversée de la ville portuaire de Tobrouk vers les côtes italiennes coûte entre 460 et 1840 euros, selon que l'on souhaite utiliser un canot pneumatique surpeuplé ou un navire marchand pour la traversée, comme l'a révélé la Deutsche Welle dans un reportage de juillet 2023. Par le biais de médias sociaux tels que Tiktok, ils diffusent des vidéos de conditions prétendument paradisiaques en Europe, incitant ainsi des personnes de toute l'Afrique et du Moyen-Orient à émigrer. Associés à l'absence de pouvoir central étatique et aux passeurs de l'association allemande "Seenothilfe" déguisés en ONG, ils agissent comme des outils d'immigration massive vers l'Europe. Mais comment arrêter cette ruée vers l'Europe ?
En utilisant l'héritage de Silvio Berlusconi pour sortir de la crise migratoire ? L'approche de Giorgia Meloni
La Première ministre italienne Giorgia Meloni poursuit une solution possible au problème: début septembre, elle a reçu à Rome le gouvernement de l'ouest de la Libye reconnu par l'UE. Elle renoue ainsi avec l'héritage du "Cavaliere" Silvio Berlusconi qui, dans la tradition de la "Mare Nostrums" romaine, voulait à son tour lier étroitement à l'Italie les pays d'Afrique du Nord riverains de la Méditerranée, et en particulier l'ancienne colonie libyenne. Berlusconi a ainsi pu non seulement obtenir des sources d'énergie bon marché pour l'Italie, mais aussi réduire drastiquement l'immigration vers l'Europe. Meloni a une idée similaire en tête, même s'il faut malheureusement mentionner que cette atlantiste acharnée ne s'oppose qu'à l'immigration illégale, mais veut en revanche permettre davantage de routes migratoires légales vers l'Italie, y compris via l'Afrique du Nord. Elle veut que la Libye renforce les patrouilles le long de ses côtes, en échange de quoi elle a offert plus de bateaux et des formations pour leurs équipages. De même, face au conflit entre l'Occident et la Russie, elle cherche à obtenir de l'énergie supplémentaire d'Afrique du Nord et à faire de l'Italie la plaque tournante énergétique de l'Europe en matière de pétrole et de gaz. Bien sûr, elle n'a à sa disposition que la moitié occidentale de la Libye, qui souffre d'une instabilité chronique. Sans une autorité centrale en Libye, cette tâche est vouée à l'échec.
19:50 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libye, méditerranée, afrique du nord, immigration, afrique, affaires africaines, italie, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 24 septembre 2023
La métaphysique de combat de Kémi Seba

La métaphysique de combat de Kémi Seba
par Georges FELTIN-TRACOL
« Et si […] le salut de notre peuple aux quatre coins du monde passait tout simplement par l’éloignement définitif de l’Occident, ce de manière physique, psychique, métaphysique, afin de redevenir nous-mêmes ? » « Et si c’était cela, la décolonisation réelle ? ». Celui qui prône cette rupture radicale s’appelle Kémi Séba dans son nouvel essai, Philosophie de la panafricanité fondamentale (Éditions Fiat Lux, 2023, 198 p., 20 €).
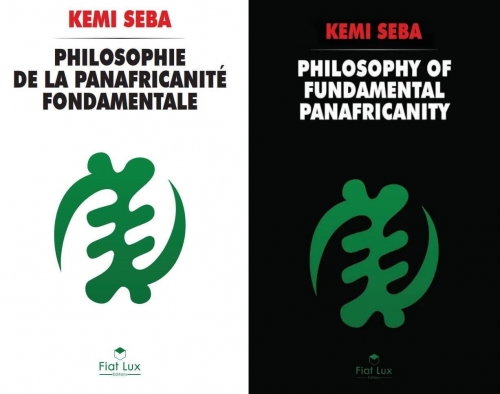
Né à Strasbourg en 1981, Stellio Capo Chichi s’intéresse très tôt au kémitisme qui exalte la civilisation égyptienne selon un tropisme négrocentré. Il s’inscrit dans une vision du monde ouvertement traditionnelle. Il oppose d’ailleurs le traditionalisme, « ensemble de modalités constituant une voie initiatique menant les êtres qui la suivent à la compréhension de la métaphysique, autrement dit : - la connaissance de l’Être suprême, - la connaissance du monde invisible, - le respect de la hiérarchie spirituelle, - l’homme avec la nature » à la coutume qui en serait son « altération ». « Maladie de l’ère moderne », « la coutume symbolise la quintessence du cérémonialisme (des manifestations clinquantes prétendument spirituelles, surtout réalisées pour nourrir l’ego ethno-culturel) ».
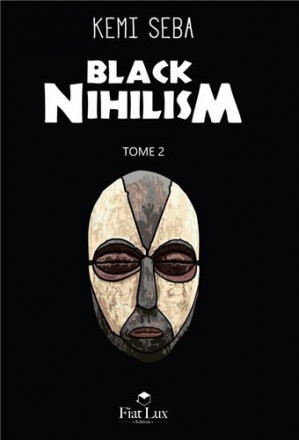 Son interprétation des cycles historiques met en confrontation directe les Noirs qui appartiennent aux « populations primordiales » au monde moderne, manifestation implacable de l’actuel Âge de Fer. Les Blancs en sont le principal vecteur. L’auteur évoque leurs terribles ancêtres, les impitoyables Yamnayas, qui détruisirent de hautes civilisations noires, capables de se rendre en Amérique centrale. En s’établissant dans le monde entier, « les contre-valeurs occidentales sont devenues des valeurs universelles, normatives ». Kémi Séba entend au contraire libérer les siens de cette emprise. Si « le terme “ panafricanité “ […] renvoie à une unité des Africains et afrodescendants qui n’est pas à construire mais qui est, en soi, si l’on revient à la racine de nos êtres, un état de fait partout dans le monde », il adopte un raisonnement global qui concerne aussi bien les Africains et les Afro-Américains que les peuples noirs d’Asie (Aeta des Philippines, Andamanais du golfe du Bengale, Senang de Malaisie, Dravidiens du Sud indien et même Aïnous du Japon) et d’Océanie (les Salomoniens et les Aborigènes d’Australie). Ainsi en appelle-t-il à « l’unité métaphysique des peuples noirs » d’autant que « la matrice de l’humanité était le peuple négro-africain ». Il sait que son point de vue unitaire « fera forcément grincer des dents les ethnistes belliqueux, les tribalistes mentalement miséreux et autres fondamentalistes religieux haineux ». Sa conception du fait africain, voire de sa dimension intrinsèquement noire, ne correspond donc pas aux analyses de Bernard Lugan qui qualifie le panafricanisme d’utopie politique.
Son interprétation des cycles historiques met en confrontation directe les Noirs qui appartiennent aux « populations primordiales » au monde moderne, manifestation implacable de l’actuel Âge de Fer. Les Blancs en sont le principal vecteur. L’auteur évoque leurs terribles ancêtres, les impitoyables Yamnayas, qui détruisirent de hautes civilisations noires, capables de se rendre en Amérique centrale. En s’établissant dans le monde entier, « les contre-valeurs occidentales sont devenues des valeurs universelles, normatives ». Kémi Séba entend au contraire libérer les siens de cette emprise. Si « le terme “ panafricanité “ […] renvoie à une unité des Africains et afrodescendants qui n’est pas à construire mais qui est, en soi, si l’on revient à la racine de nos êtres, un état de fait partout dans le monde », il adopte un raisonnement global qui concerne aussi bien les Africains et les Afro-Américains que les peuples noirs d’Asie (Aeta des Philippines, Andamanais du golfe du Bengale, Senang de Malaisie, Dravidiens du Sud indien et même Aïnous du Japon) et d’Océanie (les Salomoniens et les Aborigènes d’Australie). Ainsi en appelle-t-il à « l’unité métaphysique des peuples noirs » d’autant que « la matrice de l’humanité était le peuple négro-africain ». Il sait que son point de vue unitaire « fera forcément grincer des dents les ethnistes belliqueux, les tribalistes mentalement miséreux et autres fondamentalistes religieux haineux ». Sa conception du fait africain, voire de sa dimension intrinsèquement noire, ne correspond donc pas aux analyses de Bernard Lugan qui qualifie le panafricanisme d’utopie politique.
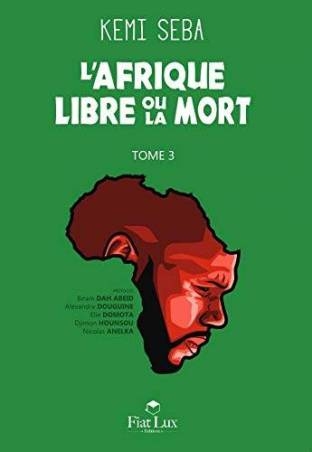 La métaphysique de l’histoire de Kémi Séba s’inspire de la théorie théosophique de l’histoire. Les théosophes, vilipendés par René Guénon, estiment que chaque cycle historique engendre sa propre « race-racine ». Dans le cadre du New Age des décennies 1990 – 2000, des occultistes occidentaux pensaient que la présence noire était antérieure à l’irruption de l’homme blanc. Ils estimèrent en outre que les Noirs de l’Âge de Bronze traditionnel étaient si violents qu’ils paient maintenant les conséquences (l’esclavage, par exemple) via leur karma collectif au cycle suivant : l’Âge de Fer.
La métaphysique de l’histoire de Kémi Séba s’inspire de la théorie théosophique de l’histoire. Les théosophes, vilipendés par René Guénon, estiment que chaque cycle historique engendre sa propre « race-racine ». Dans le cadre du New Age des décennies 1990 – 2000, des occultistes occidentaux pensaient que la présence noire était antérieure à l’irruption de l’homme blanc. Ils estimèrent en outre que les Noirs de l’Âge de Bronze traditionnel étaient si violents qu’ils paient maintenant les conséquences (l’esclavage, par exemple) via leur karma collectif au cycle suivant : l’Âge de Fer.
Kémi Séba reprend aussi à son compte la thèse de la psychiatre afrocentriste Frances Cress Welsing (1935 – 2016) qui assure que « les Blancs seraient […] le fruit des populations noires originelles dont la peau aurait connu une maladie provoquant une dépigmentation sévère », d’où leur profonde négrophobie. Élucubrations isolées ? On lisait dans L’Express du 14 octobre 2021 sous la plume d’un certain Bruno D. Cot qu’« il y a encore 10.000 ans, nous étions noirs aux yeux clairs ». L’« Afropéen » serait par conséquent un Noir présent dès l’origine sur le sol européen. Pourquoi alors s’opposer aux migrants venus du Sud de la Méditerranée ? On remarquera que Kémi Séba n’aborde pas les peuples asiatiques jaunes et amérindiens rouges.


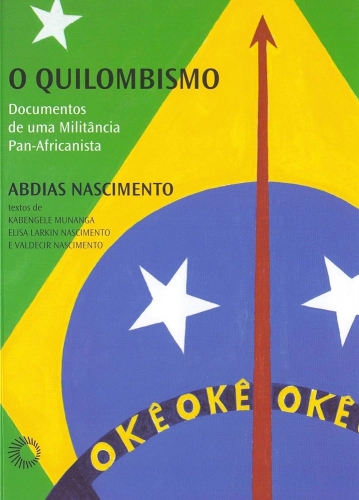
De haut en bas: Frances Cress Welsing, Abdias do Nascimento et son ouvrage principal sur le "quilombismo".
L’auteur promeut le quilombisme du Brésilien Abdias do Nascimento (1914 – 2011) qui, dans sa jeunesse, s’engagea dans le mouvement intégraliste. Le quilombisme désigne « l’organisation communautaire, le redéploiement de la culture afro-brésilienne, en revalorisant l’endogamie communautaire, le solidarisme noir économique, la connaissance de soi ». Chaque groupe noir devrait former son propre quilombo. Ensuite, « tous les quilombos d’Amérique du Nord ou du Sud, d’Europe de l’Ouest ou de l’Est, du Proche-Orient, du Moyen-Orient, du Maghreb, d’Asie, d’Océanie devront être dans la dynamique de la panafricanité fondamentale, reliés au trône de notre peuple sur Terre qu’est le continent africain en vue de former un État fédéral ». En effet, le dessein final « est que puisse, à la place des 54 États et de toutes les diasporas noires, s’instituer un État fédéral de tous les peuples noirs qui s’intitulerait les “ Quilombos-Unis de Kemet “ (Kmt étant le véritable nom de l’homme noir) ».
Conséquent, Kémi Séba ne désire aucun « front de la Tradition ». Il convient en revanche que « nous devons parfois passer des alliances avec des entités pour qui nous pouvons éprouver de l’hostilité mais qui, pour X ou Y raison, ont le même ennemi que nous ». Ethno-différencialiste cohérent, le président de l’ONG Urgences panafricanistes affronte « le Système à tuer les peuples ». Ses objectifs tactiques peuvent se recouper de manière ponctuelle avec les initiatives des Européens identitaires et nationalistes-révolutionnaires les plus radicaux. Contrairement à ce que profèrent ces détracteurs qui le dépeignent en « suprémaciste noir », Kémi Séba est d’abord et avant tout un « primordialiste noir » d’Afrique.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 84, mise en ligne le 19 septembre 2023 sur Radio Méridien Zéro.
11:57 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : kémi seba, panafricanité, panafricanisme, afrique, affaires africaines, actualité, définition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 20 septembre 2023
La nouvelle carte de l'Afrique
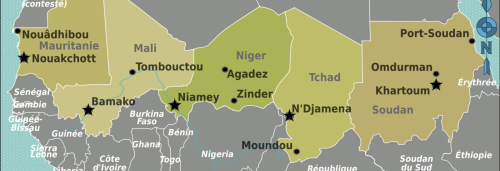
La nouvelle carte de l'Afrique
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/la-nuova-mappa-dellafrica/
L'Alliance du Sahel est née. Une entente militaire et politique entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger.
Peu en ont parlé. Mais c'est un fait... révolutionnaire.
La géographie de l'Afrique change. Rapidement. Et les cartes encore utilisées aujourd'hui, qui reproduisent en fait celles de la période coloniale, risquent de finir bientôt remisées au grenier.
L'équilibre de l'Afrique du Nord-Ouest, et de l'Afrique centrale, semble en effet figé. Arrêté au moment du colonialisme, notamment français, qui avait profondément mise en friche ces terres. Sans jamais vraiment lâcher prise.
En fait, la domination coloniale directe avait simplement été remplacée par un contrôle non moins étroit des ressources économiques, de la monnaie et des réserves d'or des pays issus du seul processus apparent de décolonisation. Elle a même maintenu une présence militaire directe. Cette présence a été renforcée par la volonté affichée de coopérer à la lutte contre le djihadisme islamique.
Le gouvernement est resté, nominalement, entre les mains de dirigeants locaux - parler d'élites serait absurde - hétéro-dirigés depuis Paris. Et, presque toujours, auto-référents et profondément corrompus. Incapables, à de rares exceptions près, de donner un sens national à des pays qui s'étaient constitués uniquement sur la base des frontières des anciens gouvernorats coloniaux. Sans aucun respect pour les différences ethniques, culturelles et religieuses des peuples.
Ces pays africains nous ont habitués, pendant des décennies, à de fortes tensions tribales. Et à une instabilité politique chronique, seulement partiellement masquée par des régimes personnalistes. Et, souvent, familiaux, comme celui, vieux de quarante ans, des Bongo au Gabon.
Tout cela, cependant, n'a jamais porté atteinte aux intérêts coloniaux. Et surtout sur ceux de la France, qui a continué à se nourrir sur le dos de ses anciennes (si l'on peut dire) colonies. À tel point qu'il n'est pas exagéré de dire qu'une grande partie de la richesse française provient de son empire africain.
Aujourd'hui, cependant, la situation est complètement différente. Cette nouvelle alliance sahélienne fragilise la CEDEAO, qui a toujours été un outil docile entre les mains de l'Élysée. Et elle ouvre des horizons totalement nouveaux.
Mais il n'y a pas que le conflit, pour l'instant latent, entre les alliés (subalternes) de la France et les rebelles. Toute l'Afrique semble être devenue une poudrière. Et les tentatives de l'Elysée pour détendre les relations tendues avec l'Algérie n'ont guère abouti. Cette dernière ayant publiquement déclaré son soutien au Niger et à la nouvelle Alliance.
Au contraire, cela a eu un effet boomerang. L'aliénation des relations avec le Maroc. Comme en témoigne le double camouflet infligé par Rabat à Macron. Le Maroc a d'abord refusé l'aide française lors du récent et tragique tremblement de terre. Il a ensuite refusé publiquement la visite officielle du président français et sa rencontre avec le roi Mohammed VI.

Et puis le coup d'État au Gabon. Et celui, plus tard démenti mais manifestement tenté, au Congo. Où se jouent d'étranges jeux internationaux.
Car s'il est vrai que Moscou soutient la révolte des États du Sahel - avec également une présence de plus en plus évidente des SMP russes, dont la célèbre Wagner - même Washington ne semble pas mécontent de certains changements en Afrique centrale. A commencer, précisément, par le Gabon.
Une attitude qui révèle comment les Etats-Unis ont l'objectif mal dissimulé de remplacer Paris dans le contrôle d'une certaine région africaine.
L'Afrique est le nouveau théâtre privilégié du Grand Jeu. Un jeu entre puissances qui ne respecte aucun schéma préétabli. Pas d'alliances ou d'alignements formels. Un jeu dont il est très difficile, aujourd'hui, d'identifier clairement les lignes et les frontières.
Une certitude. La carte de l'Afrique évolue rapidement. Et la France est sur le point d'être expulsée du continent qu'elle considérait, hier encore, comme sa propriété.
20:05 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, afrique, affaires africaines, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 06 septembre 2023
Gabon. Le dictateur déchu et les États-Unis

Gabon. Le dictateur déchu et les États-Unis
Source: https://www.piccolenote.it/mondo/gabon-il-dittatore-deposto-e-gli-usa
Le général qui a mené le coup d'État au Gabon, Brice Nguema, s'est élu président par intérim du pays, affirmant qu'il y aura bientôt de nouvelles élections, une nouvelle constitution et les autres choses qui sont habituellement promises dans de tels cas. Dans d'autres notes, nous avons souligné, comme d'autres, que le coup d'État posait de nouveaux problèmes à la Françafrique et mettait fin à une dynastie de plus de dix ans, celle des Bongo, père et fils.
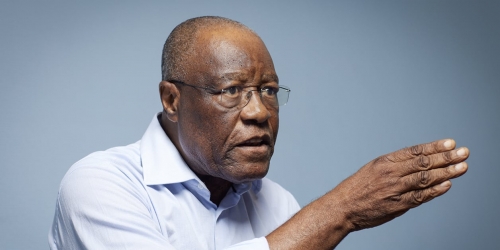
Mais le chef de l'opposition unie, Albert Ondo Ossa (photo), qui a été battu lors des récentes élections remportées frauduleusement par Ali Bongo et annulées par les putschistes immédiatement après la publication des résultats, a déclaré qu'il s'agissait en fait d'une "révolution de palais, pas d'un coup d'État".
Il a expliqué à Al Jazeera que le général est un cousin d'Ali Bongo et qu'il a fait carrière avec lui, comme d'autres des putschistes actuels. "Je pense que la famille Bongo s'est débarrassée d'un de ses membres, qui faisait de l'ombre à la famille, parce qu'elle voulait que le pouvoir Bongo se perpétue en empêchant Albert Ondo Ossa d'accéder au pouvoir", a-t-il conclu.
Le dictateur déchu : l'homme des Etats-Unis en Afrique
Bref, une simple succession familiale, mais forcée. Une analyse qui n'est peut-être pas tout à fait lucide, car les putschistes ont agi après la défaite électorale - d'Ossa qui le reléguait de toute façon hors du pouvoir - et qui pourrait être entachée d'intérêt personnel, c'est-à-dire de pressions exercées sur la junte pour obtenir de l'espace. Mais il semble qu'il y ait un fond de vérité.
En fait, Fabio Carminati dans Avvenire raconte une histoire similaire, en ajoutant un détail : "Ainsi, dans la réalité africaine à l'envers, il peut arriver que la fille du président gabonais déchu Ali Bongo Ondimba, la députée Malika Bongo Pereira, félicite sur Facebook les putschistes qui ont renversé son père le jour même du coup d'État, le 30 août".
Plusieurs médias, tout en notant les similitudes avec le récent coup d'État au Niger, ont également établi des distinctions entre les deux. A Niamey, il y a eu une véritable percée, à Libreville, cela reste à voir. Mais il faut garder à l'esprit que même une révolution de palais peut ouvrir des espaces à la société civile, auparavant fermés, ou donner lieu à une politique étrangère moins sujette aux intérêts étrangers indus.
Ainsi, comme nous l'avons écrit dans les notes précédentes, l'avenir du Gabon reste incertain. Mais il y a encore quelque chose à découvrir sur le passé, et cela concerne les relations de l'autarque déchu, ou du dictateur selon le cas, avec le monde.

S'il est vrai que le Gabon a entretenu des relations étroites avec l'ancien maître colonial français, qui les a utilisées pour ses propres intérêts, Alì Bongo a également eu d'autres protecteurs munificents, dont il devait évidemment servir les intérêts. Un article publié dans Monthly Review, un site inconnu du plus grand nombre mais qui se réfère à la documentation courante (et vérifiée), fait état de ces amis.
Dans cet article, il est question de la relation entre Ali Bongo et le président américain Barack Obama : "Le lien entre Obama et Bongo était si étroit que Foreign Policy a qualifié le dirigeant gabonais d'"homme d'Obama en Afrique"".
"Avec l'aide d'Obama, poursuit le site, Bongo a tenté de se présenter comme un réformateur modernisateur. Il s'est rendu à plusieurs reprises à Davos, en Suisse, pour assister au Forum économique mondial, où il a été nommé "contributeur à l'agenda". Toujours à Davos, il s'est engagé à accélérer la quatrième révolution industrielle en Afrique en développant des systèmes lucratifs d'identification et de paiement numériques au sein de la population plus que pauvre de son pays" [telle est l'hyperréalité du mondialisme, ndlr].
La biographie de M. Bongo sur le site web du WEF le qualifie de "porte-parole de l'Afrique pour la biodiversité" [...]. L'homme de la renaissance [africaine] autoproclamé a réussi à s'entendre avec Obama, à plaisanter avec Klaus Schwab et à toucher la chair de Bill Gates".
Le changement de régime en Libye et le prix de l'OTAN
Il n'y a pas que des plaisanteries et des attestations. Lorsque les États-Unis se sont lancés dans l'opération de changement de régime en Libye en 2011, "ironiquement justifiée comme un exercice de "promotion de la démocratie", grâce au soutien de Washington, le Gabon a été admis au Conseil de sécurité de l'ONU, où il a adhéré à toutes les résolutions américaines, qui ont d'abord imposé des sanctions contre la Libye et ensuite une zone d'exclusion aérienne" au-dessus de son ciel.
"L'esprit de coopération de M. Bongo lui a valu une visite à M. Obama à Washington quatre mois plus tard. Là, dans la résidence personnelle du président, il est devenu le premier dirigeant africain à demander à Kadhafi de quitter le pouvoir". Inutile de rappeler les désastres de cette intervention, dont nous payons encore aujourd'hui le prix en termes d'instabilité et de terreur qui sévissent en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne.
"[...] À peine un mois après sa réélection, qu'il a remportée en 2016 lors d'un scrutin controversé, Bongo a été rappelé aux États-Unis, cette fois par le Conseil atlantique parrainé par l'OTAN, pour recevoir le Global Citizen Award lors du gala de grande classe qui s'est tenu en 2016 à New York."
"Mais comme les doutes sur la fraude électorale persistaient dans le pays - étant donné que dans une région, il avait remporté 95% des voix avec un taux de participation de près de 100 % des électeurs - il a été contraint d'annuler le voyage."
"'L'Atlantic Council respecte la décision du président gabonais Bongo de renoncer à recevoir le Global Citizen Award en raison des priorités auxquelles il est confronté dans son pays', a annoncé le think tank dans un communiqué absurde publié sur son site internet."
Depuis quelques jours, les médias se déchaînent sur Alì Bongo et son régime, oubliant de dire qui sont ses nombreux amis internationaux qui le soutiennent depuis si longtemps, ceux que dans un appel dramatique le susnommé a appelé à "faire du bruit".
Quelqu'un devrait lui suggérer d'éviter de telles initiatives. Il risque d'inquiéter ses anciens amis qui, tombés en disgrâce, se sont empressés de le renier de peur que leur auguste nom soit juxtaposé au sien.
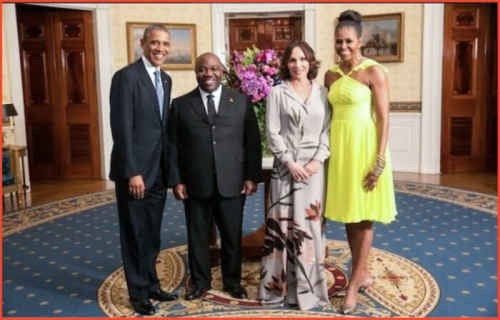
Sur la photo, le président Barack Obama et la première dame Michelle Obama avec Ali Bongo Ondimba, président du Gabon, à la Maison Blanche en août 2014.
20:25 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, ali bongo, afrique, affaires africaines, gabon, états-unis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les relations entre l'Italie et la Libye à l'époque Andreotti-Kadhafi

Les relations entre l'Italie et la Libye à l'époque Andreotti-Kadhafi
S'appuyant sur les documents d'archives de l'homme politique romain conservés à l'Institut Luigi Sturzo, le livre, que nous recensons ici, décrit les relations entre Rome et le dirigeant libyen arrivé au pouvoir en 1969.
par Andrea Scarano
Source: https://www.barbadillo.it/110864-i-rapporti-tra-italia-e-libia-nella-stagione-andreotti-gheddafi/
Une analyse systématique des relations bilatérales entre États suppose un examen approfondi des facteurs qui influencent leurs principales lignes d'évolution dans le temps.
Les évaluations politiques, les besoins géostratégiques, les différends remontant au passé colonial et les intérêts économiques largement liés à la question de l'approvisionnement énergétique constituent le cœur du livre Andreotti, Gheddafi e le relazioni italo-libiche, publié en 2018 par la maison d'édition Studium et édité par Massimo Bucarelli et Luca Micheletta avec la contribution d'autres auteurs.
Se concentrant sur la documentation d'archives de l'homme politique romain conservée à l'Institut Luigi Sturzo, le volume décrit ses relations avec le leader libyen arrivé au pouvoir en 1969, identifiant entre des personnalités de tempérament opposé un point commun dans la foi monothéiste.

Les États-Unis et l'"obsession" libyenne
Dans un contexte d'instabilité croissante de l'espace méditerranéen (installation de missiles Pershing et Cruise sur la base militaire de Comiso, objet de récriminations à plusieurs reprises de la part de Kadhafi, qui ne cache pas son hostilité aux accords de Camp David, au dialogue entre l'Egypte et Israël, ce qui lui donne la volonté de se rapprocher "tactiquement" de l'URSS), la détérioration des relations entre les exécutifs de Washington et de Tripoli est déclenchée par l'aggravation du différend sur la souveraineté du golfe de Syrte.
L'embargo commercial et pétrolier a été le prologue de la décision de Reagan - soutenue par le consensus de la grande majorité de l'opinion publique, mais longtemps "incubée" en raison de désaccords internes au sein de son administration - de résoudre la question par la force, en soumettant les villes ennemies à des bombardements aériens au plus fort de l'opération El Dorado Canyon (1986), "justifiée" par des attentats terroristes antérieurs impliquant des citoyens américains sur le sol européen.
Inquiète d'éventuelles représailles contre les bases américaines sur son territoire (ce qui s'est ponctuellement produit à Lampedusa sans conséquences fâcheuses), l'Italie s'est limitée - conformément au comportement des pays membres de l'Alliance atlantique et de la CEE, à l'exception évidente de la Grande-Bretagne - à approuver des sanctions diplomatiques, alors que l'image de Washington était fortement ternie par le scandale Iran-Contras.
Bien que les auteurs reconnaissent la difficulté d'en établir la substance réelle, un canal diplomatique a été activé par l'ambassadeur américain auprès du Saint-Siège, William Wilson, qui a ensuite été contraint à la démission par le Département d'Etat. Convaincu que les désaccords et l'interruption des négociations provenaient du fait que l'intéressé s'adressait directement au Conseil national de sécurité, Andreotti - qui avait proposé une définition du litige à la Cour internationale de justice de La Haye, rejetée par les Américains - nota en privé la volonté de confrontation de Kadhafi, imprévisible mais pas "fanatique", contrairement à l'image qu'en donnaient les médias.
L'affaire provoqua des frictions entre la Secrétairerie d'Etat et le leader démocrate-chrétien, conscient que Reagan ne voulait pas, délibérément, explorer une solution multilatérale à la crise (ce n'est pas par hasard qu'il boycotta la tentative maltaise d'organiser une conférence des Etats riverains de la Méditerranée centrale), mais plutôt affirmer la priorité de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme - un phénomène abordé sans trop d'hésitation en Libye - en les plaçant dans le cadre d'une véritable urgence nationale.
Les relations italo-libyennes
L'examen de la politique italienne à l'égard de la Libye à partir des années 1970 reflète avant tout la nécessité de la recherche constante - bien que problématique - d'un point de convergence entre la solidarité atlantique et la sauvegarde des équilibres en Méditerranée, ces derniers étant étroitement liés à la question israélo-palestinienne.
Malgré les expulsions massives et la confiscation à grande échelle des biens de l'importante communauté italienne, les caractéristiques de la politique dite de la "double voie" apparaissent comme une propension à maintenir ouverte la confrontation avec un interlocuteur gênant, dans le sillage de la ligne substantiellement pro-arabe adoptée par Moro.
Alors que la Rai, déterminée à reprendre par étapes forcées le contrôle de l'industrie énergétique nationale, obligeait les compagnies étrangères - de concert avec les autres pays membres de l'OPEP - à accepter l'augmentation du prix de référence du pétrole, la ratification des accords de coopération économique, scientifique et technologique répondait, du côté italien, à la nécessité d'obtenir des conditions avantageuses en matière d'approvisionnement, en garantissant à l'ENI le maintien des concessions qu'elle détenait et en lui permettant de se prévaloir de la production directe à l'étranger. Le différend sur les mécanismes de compensation, dans le secteur pétrolier, des crédits dus aux entreprises italiennes, périodiquement suspendus par le régime lors de fréquentes périodes économiques défavorables, a longtemps fait l'objet de débats.

Persuadé d'avoir affaire au "moindre mal" d'un pays non aligné, Andreotti fut confronté dès ses débuts de Premier ministre à l'attitude du colonel, plus enclin à l'ouverture par commodité que par conviction sincère et capable d'alterner flatteries et menaces, comme lorsqu'il conditionna la conclusion de certains accords pétroliers à la fourniture d'armes et d'autres équipements militaires.
Révélateurs de l'énorme difficulté d'archiver définitivement les scories du passé, les contentieux qui s'éternisent depuis des décennies confirment combien le chemin vers la normalisation des relations achevée par le traité d'amitié, de partenariat et de coopération d'août 2008 a été semé d'embûches.
Les demandes répétées de Tripoli pour la réparation des dommages matériels et moraux produits par l'Italie depuis 1911 - y compris ceux causés par les vieilles bombes de la Seconde Guerre mondiale, pour lesquelles Rome s'est engagée à coopérer au déminage - doivent être encadrées dans la stratégie visant à obtenir une règle de droit international condamnant le colonialisme; loin de boycotter sérieusement la recherche de coopération, le rais aurait ainsi satisfait ses ambitions de s'ériger en champion du mouvement panarabe dans les pays d'Afrique du Nord.
Si des indemnités symboliques avaient déjà été prévues au titre de l'aide à la reconstruction dans l'ancien accord de coopération économique de 1956, la thèse selon laquelle les réparations résultant d'une domination coloniale illégitime ne constituaient pas un motif de transfert de ressources au profit des pays en développement était soutenue par l'universitaire Guido Napoletano, chargé par la Farnesina d'étudier la question sous l'angle du droit international.
En revanche, l'épineuse affaire des réfugiés italiens rapatriés de Libye, qui, ayant obtenu ce statut légal en 1974, ont d'abord eu l'illusion de pouvoir être indemnisés par le colonel, plutôt prêt à attaquer une communauté surprise par le fait qu'une querelle idéologique désormais dépassée puisse s'enraciner avec virulence même en Italie, avec des accusations méprisantes de colonialisme et de fascisme, a été complètement occultée. Des réglementations inadéquates et des critères de procédure lourds, des estimations à la baisse des biens confisqués par les experts des différents ministères italiens et des indemnisations incomplètes en raison de l'inflation galopante ont facilité l'amnésie des gouvernements et de l'opinion publique.
Des divergences importantes et des sensibilités différentes ont caractérisé les positions des principaux acteurs politiques: en tant que Premier ministre, Bettino Craxi a souvent mis l'accent sur l'aspect politique du terrorisme, minimisant le rôle éventuel de Kadhafi dans le processus de paix au Moyen-Orient, également pour maintenir une majorité solide dans laquelle les partis fortement caractérisés par un sens pro-atlantique (républicains et libéraux) revendiquaient une visibilité; Andreotti, pour sa part, a utilisé des tons plus critiques à l'égard des États-Unis, réitérant la nécessité de ne pas pousser l'OLP vers des positions extrémistes.

Les épisodes du détournement du bateau de croisière Achille Lauro et de la crise de Sigonella qui s'en est suivie ont été largement minimisés: les tensions ont été largement dramatisées par Spadolini, à l'époque ministre de la Défense prenant parti pour les États-Unis et Israël, mais elles n'ont pas produit - malgré les clameurs des médias - de clivages destinés à durer, confirmant plutôt une approche différente sur la manière de se comporter à l'égard des pays arabes.
Les turbulences provoquées par certaines situations de crise (comme l'échec de la mission multinationale au Liban, à laquelle l'Italie avait également participé malgré les protestations de Kadhafi) et l'implication plus ou moins directe de membres des services libyens, d'abord dans les attentats terroristes palestiniens de Rome et de Vienne, puis dans ceux de Lockerbie et de Tenerè, ont déterminé l'isolement progressif de la Libye.
Malgré le blocage des relations avec l'Italie et la diffusion par les services anglo-américains d'informations selon lesquelles le régime (qui s'est ensuite rangé du côté de l'Occident pendant la guerre du Golfe) produisait des armes chimiques, Rome a favorisé la mise en place de structures de coopération telles que l'Initiative pour la Méditerranée occidentale. Ces tentatives devaient s'avérer éphémères puisque deux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sanctionnaient en 1992 le gel du trafic aérien, l'interdiction des ventes d'armes et l'expulsion des citoyens impliqués dans des actes de terrorisme, tandis que le rais tentait d'exploiter la médiation italienne avec la Grande-Bretagne et les États-Unis dans l'affaire de Lockerbie pour redonner de la vigueur aux relations bilatérales et tenter de se réintégrer dans la communauté internationale.
La Libye et le Saint-Siège : un pont pour la paix en Méditerranée
Andreotti s'est également taillé un rôle non négligeable dans le difficile et progressif processus de dialogue qui s'est concrétisé en 1997 par la reconnaissance de relations diplomatiques entre la Libye et le Saint-Siège.

Les auteurs reconstituent les liens d'amitié profonde avec le cardinal Sergio Pignedoli (photo), président du Secrétariat du Vatican pour les non-chrétiens, créateur des premières rencontres qui ont eu lieu à Tripoli entre des représentants de l'islam et du christianisme, ainsi que les phases de l'enlèvement du franciscain Giovanni Martinelli, libéré par la suite à Malte ; le rôle stratégique de l'île en tant que "pont de paix en Méditerranée" a en outre été parrainé par la Libye et surtout par l'Italie, sûre de l'importance de sa position géographique dans une perspective antisoviétique.
L'action, probablement destinée à solliciter l'intervention du Vatican pour condamner les opérations que les Etats-Unis préparaient, n'était pas dirigée contre le gouvernement italien (l'ambassadeur Reitano a averti la Farnesina de l'intention de Kadhafi d'utiliser l'affaire pour retarder la restitution des passeports), mais contre des religieux individuels accusés de recueillir des informations pour le compte de services secrets étrangers non identifiés.
Le chemin de révision profonde du fondamentalisme islamique initié par le colonel et son désaveu progressif du califat ont encouragé les initiatives d'Andreotti et de Raffaello Fellah (homme d'affaires et réfugié juif de Libye), qui ont convergé dans le projet "Trialogue", une association d'éminents représentants des trois religions monothéistes engagés dans la lutte contre les conflits au Moyen-Orient.
Bien structuré et riche en idées, l'ouvrage approfondit les mérites et les limites de l'action politique d'Andreotti (et en arrière-plan de toute la classe dirigeante de la Première République) sans trop céder à des tendances hagiographiques assez en vogue aujourd'hui, mais il est parfois alourdi par la superposition de thèmes analysés en même temps dans les différentes monographies. Le lien identifié entre les deux protagonistes, fondé sur une sensibilité commune au dialogue interreligieux avant le dialogue politique, apparaît faible, car il manque de débouchés immédiats et concrets.
Andrea Scarano
19:49 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, italie, libye, afrique du nord, europe, afrique, affaires africaines, kadhafi, méditerranée, politique internationale, giulio andreotti |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 05 septembre 2023
Le Niger renverse le néocolonialisme français

Le Niger renverse le néocolonialisme français
Brecht Jonkers
Source: https://crescent.icit-digital.org/articles/niger-overthrows-french-neo-colonialism
Le renversement du gouvernement de Mohamed Bazoum au Niger, soutenu par la France, le 26 juillet, peut peut-être être comparé à la défaite de l'apartheid en Afrique du Sud il y a près de 30 ans. Bazoum n'était pas seulement président du Niger, mais aussi président de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), dont l'agenda est néolibéral. Sa cote de désapprobation auprès de la population nigérienne était très élevée.
Cela ne signifiait pas qu'il jouait un rôle particulier dans la constellation politique ouest-africaine. À bien des égards, Bazoum peut être considéré comme un représentant typique du courant politique dominant dans de nombreuses anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest.
Les critiques à l'encontre de son gouvernement portaient sur l'augmentation du coût de la vie, la persistance d'un niveau élevé de pauvreté et une incompétence flagrante. L'incapacité des dirigeants successifs de Niamey à réprimer l'insurrection wahhabite-takfiri menée par des groupes tels que Daesh et Al-Qaïda n'a fait qu'accroître le mécontentement de la population.
Lorsque le chef d'état-major Salifou Modi s'est rendu au Mali voisin en mars dernier et a convenu de mesures antiterroristes conjointes, Bazoum l'a rapidement limogé. Les mouvements anti-impérialistes antérieurs, en particulier le sentiment anti-français, ayant pris le dessus au Mali et au Burkina Faso, le Niger est devenu l'un des derniers piliers explicitement "pro-français" de la région, un pilier que la France, mais aussi les États-Unis, ont utilisé avec empressement dans la mascarade actuelle connue sous le nom de "guerre contre le terrorisme".

Près de 1100 soldats américains et une véritable base de la CIA étaient stationnés au Niger au moment du coup d'État du 26 juillet. Cela a rendu la plupart des Nigériens furieux à un point tel que le nouveau commandant de la Garde présidentielle, le général Abdourahamane Tchiani, a dû intervenir.
Bazoum a été déposé et emprisonné. Le pouvoir au Niger a été confié à un nouveau gouvernement de transition, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP).
Comme on pouvait s'y attendre, les grands médias occidentaux se sont déchaînés pour condamner la "prise de pouvoir militaire" au Niger. Ils ont tenté de pimenter les choses en soulignant le "rôle de Wagner et de la Russie" dans la fomentation de l'instabilité au Sahel, et en mettant en garde contre une "nouvelle instabilité" dans la région. La question est de savoir si une région ciblée par des insurgés wahhabites depuis des années, faisant plusieurs milliers de victimes civiles sous l'œil vigilant du "soutien militaire" de la France et des États-Unis, pourra jamais être qualifiée de "stable" ou de pacifique. Mais même cela n'est pas le cœur du problème.
La persistance du néocolonialisme français
Une grande partie de l'Afrique de l'Ouest en a assez du néocolonialisme français, du projet de "Françafrique" et du système monétaire du franc CFA qui lie les monnaies locales au franc français (et ensuite à l'euro) et à l'influence du Trésor français. Le Mali est malade de l'exploitation massive de son or par la France. Paris a accumulé 2 500 tonnes de réserves d'or sans une seule mine d'or en France alors que le Mali, avec environ 860 mines d'or opérationnelles, ne dispose que de 881 tonnes de réserves d'or. De même, le nouveau gouvernement de Niamey critique vivement la façon dont la France a profité de l'abondance d'uranium au Niger. Le "yellow cake" est très recherché par le marché français de l'énergie qui dépend du nucléaire pour plus de 71% de ses besoins.
L'histoire sanglante de la France en Afrique, y compris l'héritage impérialiste permanent, a perduré sur le continent même après l'"indépendance". Le néocolonialisme occidental, en particulier français, est tellement flagrant et connu que même les médias occidentaux ne peuvent pas le nier ou l'occulter. Ils avancent de vagues excuses telles que "la Russie n'est pas meilleure", "l'amélioration se profile à l'horizon" et, argument souvent entendu, "ce n'est pas la bonne méthode". "Ce terme signifie ici l'intervention de l'armée (ou des deux) ou le ralliement des masses dans les rues.

Pour les experts européens, les habitants de la région du Sahel devraient simplement suivre la voie "civilisée" en copiant l'Europe. Ils devraient élire un homme politique qui négociera un avenir meilleur pour son pays, sans répercussions négatives pour les intérêts commerciaux occidentaux, bien entendu.
Condamner les développements révolutionnaires dans des pays comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso et le Niger comme de simples "coups d'État militaires", simplement parce que l'action directe de destitution de l'élite précédente a été entreprise par le personnel des forces armées, est une interprétation simpliste et naïve des événements.
Elle témoigne d'un manque de compréhension de la situation politique et de l'histoire récente de la région du Sahel en particulier, ainsi que du népotisme profondément ancré et de la stabilité fermement excluante et contrôlée par l'étranger de l'élite dirigeante qui a existé dans ces pays.
Se plaindre que "la transition du pouvoir devrait se faire démocratiquement" ne tient pas compte du fait qu'une transition démocratique était pratiquement impossible dans tous les pays susmentionnés. Les cliques au pouvoir dans des pays comme le Niger et le Burkina Faso ressemblent beaucoup à une forme d'aristocratie moderne, dans laquelle la possibilité de gravir les échelons dépend souvent de vos connaissances et des mains que vous graissez, plutôt que de ce que vous êtes ou de ce que vous pouvez faire.
La maxime "c'est un grand club, et vous n'en faites pas partie" s'applique à l'élite politique de ces pays, tout comme aux États-Unis. Aux États-Unis, les outsiders politiques n'ont aucune chance de "percer" dans le système, à moins de se vendre complètement. Et même ceux qui sont présentés comme des "outsiders", tels que Barack Obama et Alexandria Ocasio-Cortez, s'avèrent être soit des initiés de bas niveau depuis le début, soit ont été astroturfés et préparés depuis le début pour donner un semblant de revitalisation tout en gardant intact le cœur pourri du système.

La situation dans une grande partie du Sahel est assez similaire. De toutes les anciennes puissances coloniales, c'est la France qui a adopté l'approche la plus pratique. À bien des égards, la France n'a jamais quitté ses anciennes colonies. Les bases militaires françaises parsèment toujours le paysage ; la France s'empare des réserves d'or et les stocke en Europe, et Paris contrôle la monnaie de ces pays par le biais du franc CFA, ne leur laissant aucune souveraineté financière.
La "transition démocratique" n'était tout simplement pas possible. Il n'y avait pratiquement aucune capacité à voter pour une alternative. Le système politique était rigide et truqué, sans parler du fait qu'il était très statique et qu'il offrait peu de possibilités de mobilité sociale verticale (c'est-à-dire une chance de "monter en grade" ou de "s'imposer" en partant du bas de l'échelle).
L'agitation autour du changement au Niger
L'Occident a fait grand cas de la prise de pouvoir militaire au Niger, et plus tôt au Mali et au Burkina Faso. On peut se demander pourquoi le coup d'État militaire en Égypte (sur le même continent africain), qui a entraîné le massacre de milliers de civils innocents, n'a suscité que peu ou pas d'intérêt. En Afrique, la mémoire de Thomas Sankara est encore fraîche dans l'esprit de nombreuses personnes. Il n'est donc pas surprenant que les Nigériens soient venus en très grand nombre pour soutenir le renversement de Bazoum.
Certes, leur accession au pouvoir ne s'est pas faite de manière "traditionnelle", occidentale, libérale et "démocratique". Mais la question peut être posée : est-ce particulièrement pertinent ? Le fait est qu'il n'existe pas de test décisif universellement applicable pour la légitimité d'un gouvernement dans le monde entier, même si les médias grand public et les élites politiques occidentales voudraient nous faire croire le contraire.
Il est étrange que la distance spatiale et la souveraineté culturelle ne soient pas traitées avec la même préoccupation légitime que la "distance" temporelle dans la politique contemporaine. Personne ne semble se soucier du manque de légitimité démocratique de figures historiques occidentales sacrées telles que Napoléon, Otto von Bismarck ou la reine Victoria, pour ne citer que trois personnages de l'histoire européenne relativement récente. Aucun d'entre eux n'a été élu selon les principes de la démocratie libérale et aucun ne s'est soucié de sauver les apparences. Mais cela ne semble pas avoir d'importance parce que "c'était une autre époque".
Il est vrai que les normes varient selon les époques, mais les crimes de la reine Victoria sont bien plus fondamentaux qu'un simple manque de représentation démocratique (la colonisation et l'asservissement de 23 % de la population mondiale étant un concurrent majeur). Toutefois, les experts politiques et les idéologues occidentaux contemporains semblent être beaucoup moins indulgents lorsqu'il s'agit de différences fondamentales dans la culture, l'histoire politique, la situation économique ou toute autre forme d'identité spécifique des différents pays.

Les normes occidentales ne sont pas universelles
Ils ne se donnent même pas la peine d'expliquer pourquoi les autres sont censés s'attendre à un système politique presque identique dans des pays tels que les États-Unis, le Niger, le Venezuela, l'Iran ou la Russie. On peut supposer que l'opinion publique s'attend à une telle similitude politique comme une nécessité dogmatique, au sujet de laquelle aucune question n'est censée être posée. Si quelqu'un exigeait que tous les pays du monde partagent la même identité culturelle ou les mêmes croyances religieuses, il serait déclaré fou. Pourtant, exiger une telle quasi-uniformité et une suprématie unipolaire en termes de dimension politique est soi-disant considéré comme logique.
Cette attitude ridicule ne s'arrête pas là. L'impérialisme est hypocrite, unipolaire et expansionniste. L'insistance à copier les systèmes et valeurs "démocratiques" libéraux de l'Occident ne s'applique apparemment qu'aux opposants à la suprématie mondiale de l'Occident. Les alliés de l'Occident peuvent faire ce qu'ils veulent, comme le montrent les cas d'États et d'entités non démocratiques tels que l'Arabie saoudite et "Israël".
Pour en revenir au sujet qui nous occupe, il n'y a jamais eu de menace d'invasion de la CEDEAO ou d'intervention de l'OTAN lorsque le banquier du Fonds monétaire international Alassane Ouattara a violemment renversé le gouvernement de Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire en 2010. Au contraire, la France et l'Ukraine ont participé militairement au renversement du gouvernement ivoirien, et la CEDEAO a fait pression pour que Ouattara soit reconnu comme président.
Le chouchou du cartel du FMI règne depuis lors sur la Côte d'Ivoire. Le fait qu'il ait réussi à se représenter et à remporter un troisième mandat lors d'une élection très controversée, bien que la constitution du pays ne le permette pas, ne semble pas déranger les élites de la CEDEAO, de la France ou des États-Unis. En retour, Ouattara s'est montré un atout fiable pour la France, en promettant que la Côte d'Ivoire enverrait des troupes pour attaquer le Niger si la CEDEAO décidait de poursuivre ses plans d'invasion.

Dans le même ordre d'idées, il n'y a pratiquement aucune condamnation étrangère, que ce soit par la CEDEAO ou par l'Occident "démocratique", du président sénégalais Macky Sall, malgré sa décision d'interdire le deuxième parti du pays, le parti socialiste panafricain PASTEF, et d'emprisonner son dirigeant, Ousmane Sonko (photo). La répression meurtrière des manifestants de l'opposition qui a suivi, au cours de laquelle plusieurs personnes ont été tuées par la police, n'a pas non plus semblé déplaire au camp "pro-démocratie". À l'instar de son collègue ivoirien, M. Sall a également promis que les troupes sénégalaises participeraient à la lutte contre le gouvernement révolutionnaire du Niger.
Les discours sur la "démocratie" et les "droits de l'homme" dans les médias occidentaux, en particulier en ce qui concerne l'Afrique ou le monde islamique, ne sont que de la poudre aux yeux. Les élites néolibérales ne se soucient pas de la démocratie ou des droits de l'homme, leur principale préoccupation est le pillage et le profit.
Voler l'uranium du Niger
Le Niger est le septième producteur mondial d'uranium, responsable d'environ 5 % de la production mondiale de ce matériau nécessaire au fonctionnement des centrales nucléaires. L'essentiel de l'uranium nigérien est extrait par la société française Orano, dont l'État français est le principal actionnaire. Paris a donc un intérêt immédiat et très important dans l'économie du Niger, en particulier dans les mines à ciel ouvert d'Arlit, dans le nord-ouest du pays. Orano est également directement impliqué dans le développement d'une nouvelle mine à Imouraren, qui contiendrait l'une des plus grandes réserves d'uranium au monde.
L'exploitation de l'uranium par des sociétés françaises a lieu au Niger depuis 1968 et constitue un véritable trésor pour les marchés occidentaux. Il n'existe aucun droit du travail ni aucune réglementation environnementale. "En Occident, vous avez besoin d'une étagère remplie d'autorisations et de certificats. Au Niger, vous donnez à quelqu'un une bêche et deux dollars par jour, et vous exploitez l'uranium", écrivait le journaliste Danny Forston en 2010. La France a bien sûr promis à son ancienne colonie un avenir radieux grâce à ce nouveau "partenariat" entre Niamey et Paris.
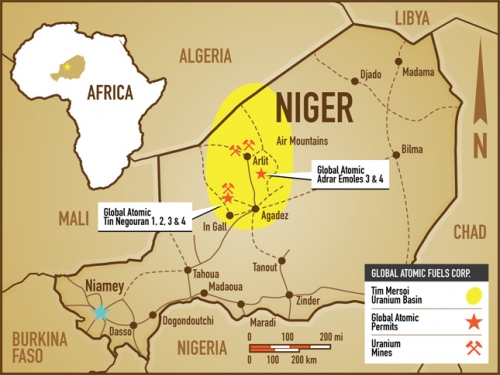
Depuis lors, on estime que 150.000 tonnes d'uranium ont été extraites du Niger par la seule société Orano (anciennement Areva). La mine d'Akuta a été fermée en 2021 en raison de l'épuisement complet du minerai. L'organisation caritative britannique Oxfam estime qu'un tiers des lampes en France fonctionnent grâce à l'énergie produite par l'uranium nigérien.
Les relations entre le Niger et Orano sont d'autant plus compliquées que l'entreprise publique bénéficie du soutien total de l'État français, avec toutes les implications militaires et de renseignement que cela implique. Il en résulte des "accords" très inégaux en faveur de l'entreprise, marqués par des exonérations fiscales extrêmement rentables.
L'exploration incontrôlée et non réglementée de l'uranium autour d'Arlit a entre-temps provoqué un désastre humanitaire et écologique. Plusieurs études menées dès 2003 par la Commission de recherche et d'information indépendantes sur les radiations (CRIIAD), basée en France, ont révélé que les niveaux de radioactivité de l'eau potable consommée par les travailleurs des mines locales dépassaient parfois jusqu'à cent fois les seuils de sécurité de l'Organisation mondiale de la santé. Une étude menée par Greenpeace en 2009 a révélé des résultats similaires, ainsi qu'une pollution toxique, dans cinq des six puits d'eau examinés. Un porte-parole d'Orano a qualifié ces résultats de "contamination naturelle".
Les conséquences médicales alarmantes d'une exposition quotidienne à un niveau de radiation 300 fois supérieur à la normale, détaillées dans un rapport d'enquête publié en 2017 par African Arguments, sont minimisées ou complètement ignorées par les prestataires de soins médicaux, ce qui n'est pas surprenant étant donné que la majorité des soins médicaux à Arlit sont fournis par l'entreprise Orano elle-même et que les professionnels de la santé sont ses employés.
Bien entendu, les gouvernements qui se sont succédé au Niger depuis 1968 portent également une grande responsabilité dans ces abus. C'est là que le néocolonialisme entre en jeu. Le Niger a été, du moins avant les récents événements révolutionnaires, un élément clé du projet néocolonial de la "Françafrique", dans lequel Paris a conservé un contrôle majeur sur ses anciennes colonies en Afrique. Dès le début de l'indépendance du Niger, des centaines de "conseillers" français sont restés à tous les niveaux du gouvernement. L'armée était composée exclusivement d'anciens membres des milices coloniales, et les officiers étaient souvent des Français qui avaient obtenu la nationalité nigérienne dans ce but précis.
Au total, 1500 soldats français et 1100 soldats américains sont toujours présents au Niger, bien que le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP) ait officiellement mis fin aux cinq accords militaires conclus avec la France et ordonné le départ de toutes les troupes françaises pour le début du mois de septembre. Ces accords ont souvent été conclus sous la forte pression de Paris.

Effet domino au Sahel
Il est clair que les récents développements ont pris la France complètement au dépourvu, 60 ans d'exploitation impitoyable de l'Afrique de l'Ouest semblant s'effondrer en l'espace de quelques années seulement. Mujtaba Rahman, directeur général pour l'Europe de la société de conseil Eurasia Group, est même allé jusqu'à qualifier les développements anticoloniaux au Niger, qui ont suivi les changements antérieurs au Burkina Faso et au Mali, de "théorie des dominos évidente pour le XXIe siècle".
Il convient de noter que le départ des troupes françaises du Niger ferait du Tchad le seul pays de la région stratégiquement importante du Sahel à maintenir une présence militaire française, bien que de plus petits contingents de troupes françaises soient toujours présents au-delà du Sahel, dans les États membres de la CEDEAO que sont la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Sénégal.
Il reste à voir comment la situation au Sahel et dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest évoluera. Il est peu probable que la France prenne ces pertes avec élégance. L'élite française est pleinement consciente de sa dépendance totale à l'égard de l'Afrique et de l'exploitation parasitaire qu'elle en fait.
L'ancien président français Jacques Chirac avait déclaré que "sans l'Afrique, la France glissera vers le rang de troisième puissance [mondiale]", faisant écho aux paroles inquiétantes de son prédécesseur François Mitterrand selon lesquelles "sans l'Afrique, la France n'aura pas sa place au XXIe siècle".
La France peut avoir "besoin" de l'Afrique pour continuer à se faire passer pour une puissance mondiale. Mais le fait est que l'Afrique n'a pas besoin, et apparemment ne veut pas ou ne désire pas plus de liens avec la France dans l'ordre mondial multipolaire émergent.
Brecht Jonkers
20:36 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, france, afrique, affaires africaines, niger, sahel |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 02 septembre 2023
La fantôme de Sankara

Le fantôme de Sankara
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/il-fantasma-di-sankara/
Un fantôme erre dans le monde. Un fantôme inquiet, qui erre entre le Maghreb et les terres au sud du Sahara. Mais qui se manifeste aussi de plus en plus au Nord. En Europe.
C'est le fantôme de Thomas Sankara. Celui qui a donné son nom au Burkina Faso. Car avant, ce pays s'appelait simplement la Haute-Volta. Le nom que les colonialistes français avaient donné à cette terre. Et Burkina Faso signifie, dans la langue des Mossi, le "Pays des hommes debout". Un nom qui, à lui seul, illustre le programme que Sankara a tenté de mettre en œuvre entre 1980 et 1988. Certains le qualifient aujourd'hui de tiers-mondiste et de socialiste. En réalité, il s'agissait d'une tentative d'arracher le pays aux griffes de l'exploitation néocoloniale française. Et celle des multinationales occidentales.
Une tentative courageuse, payée de sa vie.
Un coup d'État hétéro-dirigé, puis l'assassinat. Et la "pratique Sankara" semblait définitivement archivée.
Mais, aujourd'hui, son fantôme est revenu hanter les terres abandonnées de l'Afrique subsaharienne.
Toute la ceinture du Sahel, l'ancienne (c'est le cas de le dire) Afrique française, est en ébullition. En fait, en révolte ouverte. Coups d'État militaires au Mali, au Burkina Faso, au Niger... et maintenant au Gabon. Le Tchad tremble. Au Nigeria, le vent de la guerre civile endémique souffle. Et même le Sénégal, jusqu'ici fidèle, commence à frémir.
Le plus grand soulèvement africain depuis l'époque coloniale est en cours. Il ne s'agit pas, comme une certaine presse voudrait nous le faire croire, de simples coups d'État. Il s'agit d'enjeux internes, de luttes tribales et familiales pour le pouvoir. Les soldats qui brandissent le drapeau de la révolte bénéficient partout d'un fort soutien populaire. Et ce sont, à ce jour, des soulèvements pacifiques. Sans effusion de sang. Mais toujours suivis de grandes manifestations populaires contre la présence française. Et contre la présence américaine...
Pour Paris, c'est un désastre. Et c'est aussi un désastre pour le reste de l'Europe, en particulier pour l'Allemagne. Par un inévitable retour de bâton.
De ces régions d'Afrique proviennent du pétrole, de l'or. De l'uranium. Des métaux précieux de toutes sortes. Pour ne citer qu'un exemple, le Gabon est le premier producteur mondial de manganèse. Sans lequel il est impossible de produire de l'acier.
Mais de ces immenses richesses, il ne reste presque rien dans les pays africains. Et ce peu va dans les mains des marionnettes qui gouvernent, manipulées par Paris et les multinationales.
Des hommes comme le président gabonais Ali Bongo. dont la famille est au pouvoir sans interruption depuis plus de cinquante ans.
Et voilà que l'Union européenne, y compris le ministère italien des affaires étrangères, a le culot de parler, ou plutôt de glapir, à propos d'un coup d'État qui a renversé un gouvernement "légitime et démocratique". Sic !
Sankara avait été le premier à tenter de briser cette chaîne qui asservit la ceinture du Sahel. Qui l'exploite. Et qui fait vivre plus de 80% de la population dans la misère et la dégradation, dans la faim.
C'était trop tôt. Le cadre international trop différent. Et hostile. Sankara a payé son pari de sa vie.
Mais il reste, dans les mémoires, comme le Bolivar de l'Afrique subsaharienne.
Aujourd'hui, la situation est pourtant totalement différente.
Et son fantôme est en train de devenir un cauchemar. Pour beaucoup, à Paris, à Washington et dans d'autres chancelleries occidentales.
20:57 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : thomas sankara, afrique, affaires africaines, burkina faso, sahel |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
"Pour aller loin, il faut marcher ensemble". La Chine et l'Afrique dans la vision de Xi Jinping

"Pour aller loin, il faut marcher ensemble". La Chine et l'Afrique dans la vision de Xi Jinping
Luca Bagatin
Source: https://electomagazine.it/per-andare-lontano-andiamo-insieme-cina-e-africa-nella-visione-di-xi-jinping/
Lors du 15ème sommet des BRICS à Johannesburg, qui s'est tenu du 22 au 24 août, le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a affirmé deux concepts importants.
Le premier : "Nous (les pays des BRICS) choisissons nos voies de développement de manière indépendante, défendons ensemble notre droit au développement et marchons en tandem vers la modernisation. Cela représente la direction du progrès de la société humaine et aura un impact profond sur le processus de développement du monde".
Le second : "Les règles internationales doivent être écrites et respectées conjointement par tous les pays sur la base des objectifs et des principes de la Charte des Nations unies, plutôt que d'être dictées par ceux qui ont les muscles les plus forts ou la voix la plus forte. Il est encore plus inacceptable de s'organiser pour former des groupes exclusifs et d'ériger leurs règles en normes internationales".
Soulignant ainsi que la tâche des BRICS est, entre autres, de "soutenir l'équité et la justice et d'améliorer la gouvernance mondiale".
Le président Xi a également fait l'éloge du continent africain, avec lequel la Chine entretient des relations de longue date, en déclarant qu'il est "un réservoir de sagesse simple mais profonde", rappelant un proverbe africain qui dit : "Si vous voulez aller vite, allez-y seul ; si vous voulez aller loin, allons-y ensemble".
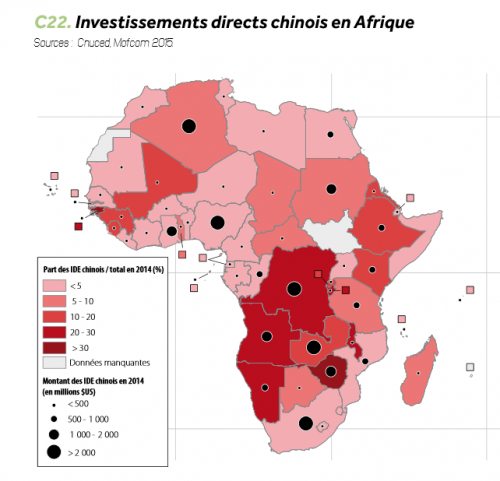
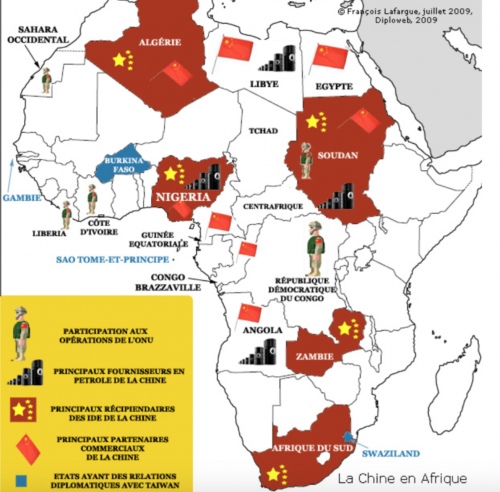
Les relations entre la Chine et l'Afrique remontent en fait aux années 60, à l'époque du Grand Timonier Mao-Tse Tung, qui, par l'intermédiaire du Premier ministre et ministre des affaires étrangères de l'époque, Zhou Enlai, a commencé à nouer des relations avec tous les pays africains qui cherchaient à se libérer du colonialisme occidental et à émanciper le tiers monde des impérialismes opposés des États-Unis et de l'Union soviétique.
Dès cette époque, Zhou Enlai énonce les principes cardinaux de la politique étrangère chinoise, fondée sur l'entraide: le bénéfice mutuel par la coopération commune, la non-agression et le respect de la souveraineté nationale. Ainsi, dès cette époque, la République populaire de Chine a commencé à construire des infrastructures en Afrique, à apporter une aide médicale et éducative et à garantir des prêts à faible taux d'intérêt.
Une stratégie poursuivie, après Mao et Zhou Enlai, par tous leurs successeurs et qui est à la base de la profonde amitié entre la Chine et l'Afrique.
Des réalités qui ont en commun d'avoir été la proie du colonialisme occidental, mais qui, cela vaut particulièrement pour la Chine, ont su se libérer de cette sujétion et s'émanciper à travers le socialisme et des formes de coopération pacifique.
Les études de la sinologue italienne Alessandra Colarizi et de l'universitaire américaine Deborah Brautigam sur les relations Chine-Afrique sont très intéressantes.

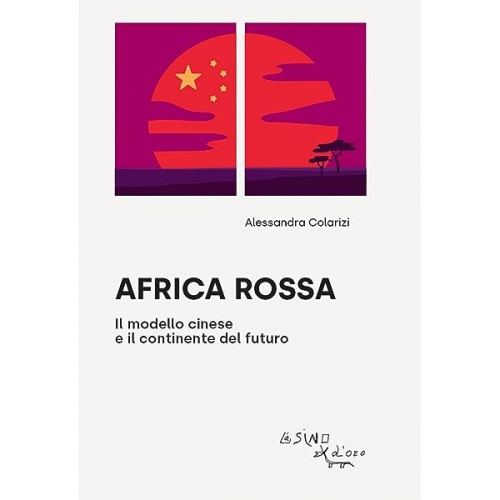

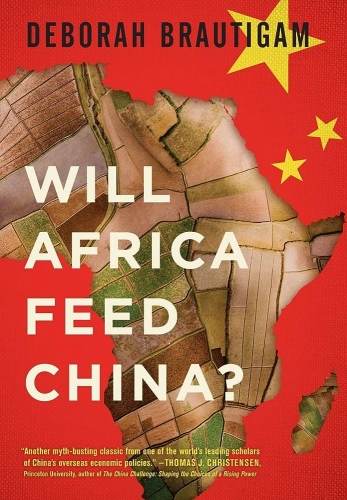
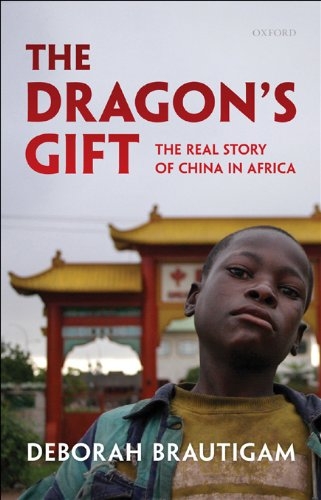
20:48 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : brics, afrique, chine, affaires africaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 29 août 2023
États de la Corne de l'Afrique
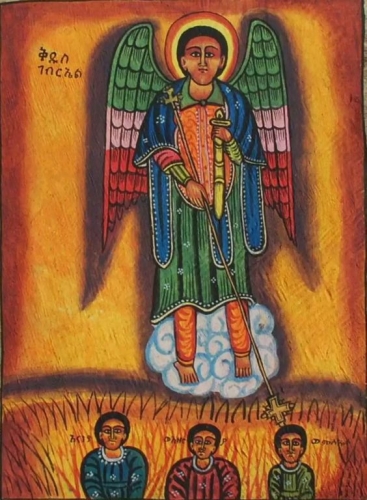
États de la Corne de l'Afrique
Suleiman Walhad
Source: https://katehon.com/ru/article/gosudarstva-afrikanskogo-roga
Pourquoi ils sont importants pour le monde
La mer Rouge, le détroit de Bab el Mandeb, le golfe d'Aden et la mer de Somalie constituent les principales voies maritimes utilisées par les nations les plus puissantes. Le Nil fournit la majeure partie de l'eau douce de l'Afrique du Nord-Est.
La région est l'un des principaux fournisseurs de viande de la péninsule arabique, en particulier pendant la saison du Hadj, au cours de laquelle des millions de bovins sont envoyés à l'abattoir dans le cadre de l'un des rituels les plus importants de l'islam.
Le long littoral de la région s'étend sur quelque 4 770 kilomètres, du sud de la mer Rouge à Ras Quiamboni, l'extrémité sud de la Somalie dans l'océan Indien, et recèle un potentiel considérable en matière d'économie bleue, ce qui ajoute à la valeur et à l'importance de la région pour les principales puissances régionales et mondiales.
Sans surprise, cinq des six pays qui seront admis au sein des BRICS en 2024 sont liés à la région : l'Éthiopie, l'Égypte, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et l'Iran. Tous se caractérisent par d'importantes ressources, qu'elles soient actuellement exploitées ou en cours de développement dans un avenir pas si lointain. La richesse actuelle de l'ensemble de la région et des cinq pays mentionnés comprend, entre autres, du pétrole et du gaz, un vaste marché et une base manufacturière importante. Le potentiel de la région se cache également, comme nous l'avons vu précédemment, dans les vastes étendues de l'économie bleue: les plages blanches accueilleront le tourisme international, la pêche, les minéraux et les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne, solaire, géothermique et hydroélectrique. En outre, un tiers des réserves mondiales d'uranium ont été découvertes dans la région.
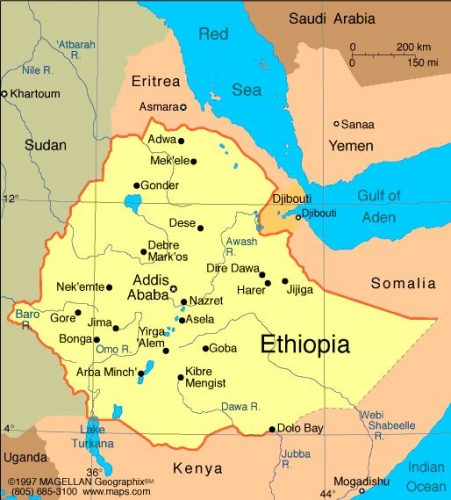
La Corne de l'Afrique dispose également de vastes terres cultivables et de beaucoup d'eau douce sous forme de précipitations, de rivières et de lacs. Des cultures locales telles que le café, le teff (une céréale sans gluten), l'enseta (un type de banane) et d'autres sont développées dans la région. Parmi les avantages de la région, citons une population jeune et nombreuse et une grande variété d'oiseaux, de faune et de flore. La région exporte une quantité importante d'encens vers de nombreux marchés, y compris le Vatican.
Avec tous ces atouts et ressources, un climat varié et une superficie d'environ 1,9 million de kilomètres carrés, la région de la Corne de l'Afrique est vraiment importante pour le monde et les dirigeants doivent utiliser cette richesse pour un développement autonome au lieu de chercher de l'aide auprès des ONG et des organisations des Nations unies qui, malgré leur présence dans ces pays depuis plus de trente ans, n'ont pas amélioré d'un iota la situation dans la région. En fait, beaucoup pensent que leur présence est à l'origine de la plupart des conflits dans ces pays.

Il y a quelques années, les pays de la région ont commencé à se rapprocher, mais l'opposition des parties intéressées par le maintien des conflits s'est manifestée, ce qui a causé davantage de problèmes, principalement liés à la concurrence ethnique pour le pouvoir. En effet, d'autres blocs commerciaux tels que la Communauté de l'Afrique de l'Est semblent avoir persuadé certains pays de la Corne de l'Afrique d'abandonner leurs alliés naturels et de rejoindre la paix swahilie. La Somalie avait déjà commis l'erreur d'adhérer à la Ligue arabe, à laquelle elle n'appartient pas. Il semble que le pays soit sur le point de commettre à nouveau une erreur similaire en rejoignant un autre groupe avec lequel il n'a pas grand-chose en commun. La cohésion naturelle des États de la Corne de l'Afrique (Somalie, Éthiopie, Érythrée et Djibouti), ou "pays SEED", s'en trouve affectée. Ces quatre pays ont des populations similaires, des racines historiques similaires et une coopération traditionnelle entre les hautes terres et les basses terres.
L'économie de la région devrait croître à mesure que sa population augmente et que les investissements de son importante diaspora et d'autres parties prenantes augmentent. On s'attend également à ce que la nécessité d'une présence dans la région contraigne les pays à revenu élevé et moyen à tirer parti des possibilités offertes par la région dans la plupart des activités économiques, qu'il s'agisse de l'éducation, de la santé, de l'industrie manufacturière, du commerce, des services portuaires et, bien sûr, du tourisme.

Un domaine à ne pas négliger est le développement de l'économie et de la technologie numériques, dans lequel les jeunes de la région sont appelés à jouer un rôle important. Notez que l'économie somalienne est pratiquement dépourvue d'argent liquide et qu'au fil des ans, d'autres pays de la région devraient suivre cet exemple. Les riches ressources minérales de la région comprennent de nombreux éléments nécessaires aux nouvelles technologies, tels que le cuivre, le lithium, le cobalt et les terres rares. La région possède également d'importantes réserves d'or, d'uranium, de platine et d'autres minéraux. Cela devrait placer la région au premier rang des investissements, à condition que les dirigeants de la région soient capables de gérer les conflits tribaux et ethniques, et que les dirigeants soient capables de travailler ensemble plutôt que l'un contre l'autre en premier lieu.
Cette collaboration permettrait à la région d'entretenir des relations internationales, économiques, commerciales et politiques communes avec d'autres régions et pays du monde. Cela devrait permettre à chaque pays de gérer plus facilement son espace, son économie et sa population, et donc de favoriser un développement durable et inclusif. Cela permettrait sans aucun doute d'éliminer ou au moins de minimiser la concurrence ethnique pour le pouvoir. Les luttes de pouvoir ethniques du type "c'est mon tour maintenant" seraient éliminées des mélodrames politiques de la région.
20:57 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, géopolitique, afrique, affaires africaines, corne de l'afrique, éthiopie, somalie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 28 août 2023
Niger : ethnosociologie et géopolitique

Niger : ethnosociologie et géopolitique
Katehon
Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/niger-etnosociologia-e-geopolitica?fbclid=IwAR2hEeAj_1QidUMPVA4qPeBK7gDoVd2Jew5vw9PFStj43yc1GH1tnBKiQV8
L'une des grandes questions mondiales des prochaines semaines est la possible intervention de la France et de ses alliés au Niger. Cette invasion, si elle a lieu, se fera sous la bannière de la CEDEAO, la communauté économique ouest-africaine dominée par des éléments pro-français. L'État du Niger lui-même est étroitement lié à de nombreux pays, de sorte que les conséquences d'une invasion pourraient entraîner une réaction en chaîne dans la région.
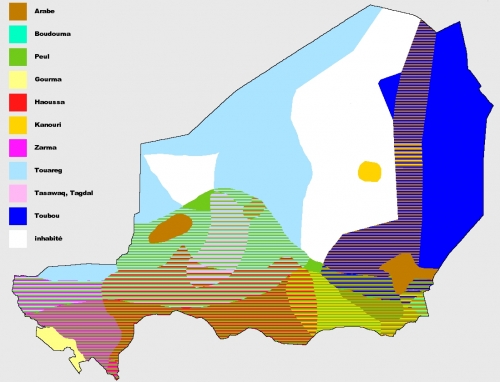
Ethnosociologie du Niger
L'État du Niger a une histoire et une structure ethnique et géopolitique complexes. Sa population est composée de plusieurs groupes ethniques: les Berbères touaregs au nord, les Haoussa de la branche nilo-saharienne mélangés aux Fulbe nilo-congolais au sud-est, et les Jerma, également de la branche nilo-saharienne, les Songhai, qui jouent un rôle important. Les ethnies nomades du nord du Niger - Kanuri, Tihishit et Tasawak - appartiennent au même groupe nilo-saharien.
Pendant la période coloniale, le territoire a été brutalement conquis par la France et incorporé à l'Afrique occidentale française. Mais bien avant les colonisateurs français, des entités politiques distinctes et même des empires existaient sur le territoire.
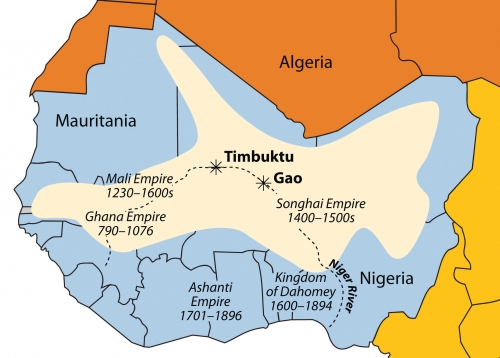
Les Songhaïs : les Jerma
Les peuples de langue Songhaï (dont le Jerma fait partie) ont créé l'Empire Songhaï aux 15ème et 16ème siècles, qui s'est étendu aux États du Mali, du Niger et du Nigeria. L'empire Songhaï a succédé à l'empire du Mali et est devenu l'hégémon de l'Afrique de l'Ouest pendant un certain temps.
L'État Songhaï s'est construit dans le bassin du fleuve Niger (cours supérieur et moyen), à partir duquel il s'est étendu dans les deux directions, d'abord au nord et au sud, puis, après Gao, à l'ouest et à l'est.
Les sultans du Maroc ont conquis l'empire Songhaï en 1591. Par la suite, le Songhaï est devenu l'une des principautés régionales, au même titre que de nombreuses autres.
L'empire Songhaï était fondé sur une stratification rigide et formalisée des castes, qui a survécu à l'ère coloniale et a été maintenue par les Jerma, les Dendi et d'autres peuples jusqu'à aujourd'hui.
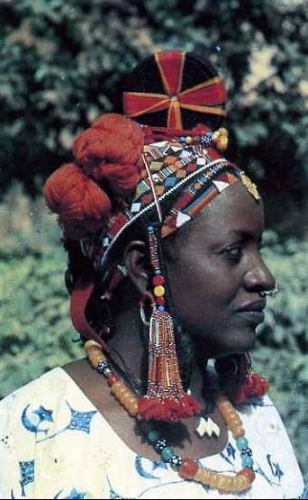
Les sociétés des peuples Songhai se composaient de trois castes strictement endogames. La première comprenait les personnes libres - les chefs (Zarmakoi des Jerma), les propriétaires de troupeaux (éleveurs) et les propriétaires de terres (agriculteurs). La strate supérieure de ce groupe endogame, lui-même subdivisé en une série de clans et de sous-castes endogames, était constituée des descendants de Sonni Ali, aujourd'hui considérés comme un type particulier de prêtres et de faiseurs de miracles (sohanche). Le deuxième groupe était constitué des employés (artisans, forgerons, musiciens, poètes). Enfin, le troisième groupe était celui des esclaves.
Les esclaves étaient une catégorie héréditaire et les descendants des esclaves devenaient esclaves à leur tour. Cependant, après quatre générations, les esclaves pouvaient prétendre au statut de personne libre. Dans le même temps, la caste dépendante ne pouvait pas changer de statut.
La différenciation des castes chez les Songhai est associée à un patriarcat prononcé et stable, ce qui constitue une différence significative par rapport à la stratification des castes chez les Berbères, qui présente certains parallèles avec les Songhai, mais conserve des liens avec d'anciens modèles matriarcaux qui, dans le cas des tribus Songhai (Jerma, etc.), sont totalement absents. La proximité avec les Berbères pourrait conduire à l'échange de certains éléments culturels, mais le patriarcat nilo-saharien original des Songhai est un trait distinctif de leur peuple.
Il est révélateur que la structure des huttes Jerma - rondes et à toit pointu - reproduise entièrement la forme des maisons nilotiques, ce qui démontre non pas tant l'origine orientale des Songhai que l'unité du type culturel. Parallèlement, la société Jerma est désormais sédentaire et la majorité de la population se consacre à la culture des céréales, à l'entretien des arbres fruitiers et à l'horticulture, avec une pratique de l'élevage largement développée.
Les membres de la classe supérieure des Jerma considèrent qu'il est de leur devoir de posséder un cheval, signe de leur appartenance à l'aristocratie militaire. Les Jerma sont belliqueux et ont de tout temps mené des raids contre les peuples voisins, s'emparant du bétail et réduisant les captifs en esclavage pour les utiliser dans l'agriculture ou les vendre sur les marchés d'esclaves. Le commerce des esclaves était une institution économique traditionnelle chez les Songhai, ainsi que chez les Berbères et les Arabes voisins.
Le peuple Jerma a joué un rôle important dans l'histoire de l'État du Niger moderne. Par exemple, le premier président du Niger après l'indépendance était le Jerma Amani Diori (1916-1989). En 1974, il a été renversé par un coup d'État militaire par un autre Jerma, Seyni Kuntche (1931-1987), qui est devenu président du Niger et l'est resté jusqu'à sa mort.

Salou Djibo (photo, ci-dessus), qui a mené un coup d'État en 2010, était également un Jerma.
Aujourd'hui, les Songhaïs - Jerma et autres - ne représentent que 21 % de la population du Niger. Néanmoins, ils contrôlent les principaux processus politiques.

Les Haoussas
Les Haoussas, comme les Jerma, appartiennent à la famille des langues nilo-sahariennes. Historiquement, les Haoussas sont étroitement liés au groupe ethnique nomade nigéro-congolais, les Fulbe (ou Fulani), largement répandus en Afrique de l'Ouest, qui ont été une force précoce et majeure dans la propagation de l'Islam parmi les peuples négroïdes.
Le territoire habité par les Haoussas en Afrique de l'Ouest est parfois appelé "Hausaland". Dans l'Antiquité, les Haoussas disposaient d'un réseau de cités-états développées, liées par la langue, la culture et le commerce. La majeure partie du Hausaland se trouve aujourd'hui au Nigeria, mais un pourcentage important de Haoussas constitue la population du Niger voisin.
Les légendes haoussas font remonter leurs origines au plateau de l'Aire, dans le centre du Niger. Plusieurs groupes ethnographiques de Haoussas s'appellent eux-mêmes par le nom d'états qui ont existé ou existent (sous forme traditionnelle). Ainsi, les Haoussas du Niger comprennent les Gobirawa (cité-État de Gobir, le souverain traditionnel est le Sarkin de Gobira, qui vit sur le territoire du Nigeria), les Katsinawa ou Maradawa (État de Katsina, le souverain est le Sarkin de Katsina, exilé par les Fulbe à Maradi), les Damagarawa (sultanat de Damagaram), les Daurawa (État de Daura), les Konnawa (ville de Birnin-Konnie), les Aderawa, les Mauri et d'autres encore.
Au début du 19ème siècle, la plupart des cités-états du Hausaland ont été conquises par une armée islamiste Fulbe ("Jihad Fulani") dirigée par Usman dan Fodio et incorporées au califat de Sokoto. Les cités-états de Maradi et de Damagaram étaient situées en territoire nigérien. Après les conquêtes d'Usman dan Fodio, les Haoussas ont commencé à se déplacer en masse sur le territoire de l'actuel Niger.
Les Haoussas sont un peuple sédentaire qui se consacre à l'agriculture, à l'artisanat et au commerce. Aujourd'hui, les Haoussas constituent la majorité de la population nigérienne (55%). Ils vivent dans le sud du pays, le long de la frontière avec le Nigeria, de Dogonduchi à l'ouest à Zinder à l'est. Les Haoussas sont également nombreux dans les régions de Tahoua et de Niamey.

Le président du Niger, Mahamadou Issoufou (photo, ci-dessus), qui a gouverné de 2011 à 2021, était d'origine haoussa.

Les Fulbe
Autre grand peuple d'Afrique de l'Ouest, les Fulbe, au Niger, sont étroitement mêlés aux Haoussas et la plupart des Fulbe nigérians parlent la langue haoussa. Dans les sociétés haoussa-fulbe, le groupe ethnique Fulbe tend à former une noblesse, le Toronkawa (au Nigeria).
Socialement et culturellement, les Fulbe ne font qu'un avec les Haoussas. Cela dit, la plupart des Fulbe sont répartis sur une vaste zone de l'Afrique de l'Ouest, allant de la Mauritanie, de la Gambie, du Sénégal et de la Guinée au Cameroun et au Soudan.
Traditionnellement, la société Fulbe comprend trois castes : les dirigeants, les Rimbbe ; les intellectuels, gardiens de l'héritage culturel, les Ninbbe ; et les esclaves, les Jayabbe.
Les Fulbe sont des nomades et des pasteurs qui considèrent l'intérieur aride de l'Afrique de l'Ouest comme leur territoire, indépendamment des frontières nationales. Certains Fulbe vivent aujourd'hui dans des zones urbaines.
Ils représentent 8,5 % de la population du pays.

Le premier président Fulbe du Niger fut Mamadou Tandja (photo, ci-dessus) (1938-2020).
Les Touaregs
L'ouest du Niger et, plus généralement, le nord de l'État sont traditionnellement habités par des membres d'un autre peuple non nigérien, les Touaregs.
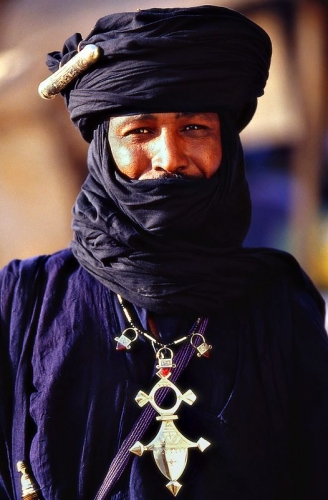

Les Touaregs sont nomades et vivent dans tout le Sahara : la moitié nord dans le sud-ouest de la Libye et le sud-est de l'Algérie, et la moitié sud dans l'ouest du Niger, l'est du Mali et le nord du Burkina Faso. Le territoire occupé par les Touaregs est comparable à celui d'un grand État africain. Les Touaregs sont l'un des peuples berbères les plus archaïques, qui a conservé les coutumes et les traditions les plus anciennes. En particulier, aujourd'hui encore, les Touaregs interdisent aux hommes d'exposer leur visage. Les femmes touaregs ne se couvrent pas le visage. Les femmes jouissent d'une position privilégiée dans la société touareg ; le système de parenté est matrilinéaire et matrilocal. De nombreuses décisions importantes dans la société sont prises par la mère du chef (aminokal), qui jouit d'une grande autorité. Malgré la propagation de l'islam et la pratique de la polygamie, le mariage touareg est strictement monogame.
Les Touaregs ont conservé l'ancienne langue berbère, le tamashek, et un système d'écriture particulier, le tifinag, basé sur l'ancienne écriture libyenne.
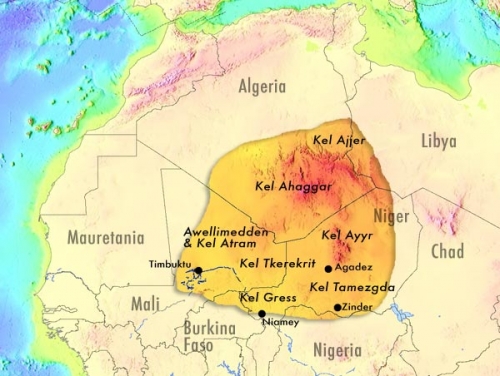
En raison de leur mode de vie essentiellement nomade et pastoral et de leurs modèles sociopolitiques non verticaux, les Touaregs n'ont jamais eu leur propre État, mais ont activement résisté à l'intégration dans d'autres systèmes politiques existants. Les Touaregs ont traditionnellement dominé les sociétés sédentaires adjacentes aux zones touaregs, les attaquant régulièrement, leur imposant un tribut et les réduisant en esclavage (les Touaregs ont une caste spéciale d'esclaves, les forgerons Inclans et Ineden, qui sont ethniquement différents des Touaregs eux-mêmes et qui sont composés de Noirs). Une partie des Touaregs pratique la culture à la houe. Les Touaregs se caractérisent également par l'habitude d'élever des chèvres, une caractéristique des anciennes cultures matriarcales.
Lors de la création de l'Afrique occidentale française, ce sont les Touaregs qui ont opposé la résistance la plus farouche aux Français, ce qui a culminé avec la rébellion touarègue de 1916-1917. Les Touaregs n'ont pu être persuadés de reconnaître l'autorité française qu'en soudoyant les chefs de certaines tribus influentes.
Après l'indépendance des pays du Maghreb et de l'Afrique centrale, où les Touaregs représentaient un pourcentage important de la population, le modèle traditionnel de l'équilibre ethno-sociologique au Sahara et le rôle des Touaregs dans cet équilibre ont commencé à changer rapidement. Le mode de vie des Touaregs s'en est trouvé affecté, l'intensité de leur influence a diminué et les structures séculaires des relations avec les peuples voisins ont été perturbées.
Peu à peu, des concepts de nationalisme touareg sont apparus. Il s'appuie sur des précédents historiques. Ainsi, au Niger, les Touaregs ont créé le sultanat d'Agadez en 1449. En 1500, il est conquis par l'empire Songhaï, mais retrouve son indépendance en 1591. Le sultanat est florissant au 17ème siècle. Les Français l'ont conquis en 1900, mais les Touaregs ont résisté pendant quatre ans et n'ont jamais reconnu la légitimité de la domination française.
Dans les régions occidentales du Niger, les Touaregs sont traditionnellement forts et représentent une grande partie de la population.
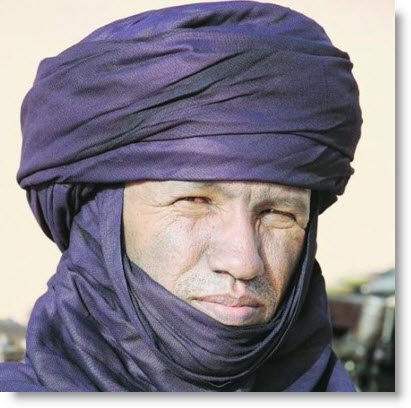
Dans les années 1990, les Forces armées touarègues du désert du Sahara ont été créées au Niger. Ce groupe s'est rebellé en 1990 et a poursuivi ses actions militaires contre le gouvernement jusqu'en 1995, après quoi une trêve a été conclue. Les Touaregs ont repris leur lutte contre le gouvernement nigérien en 2007 sous la forme du Mouvement nigérian pour la justice, auquel se sont joints des groupes antigouvernementaux du peuple Fulbe (famille nigéro-congolaise) et des nomades Toubou (famille nilo-saharienne). Le chef du Mouvement nigérian pour la justice est un Touareg, Agali Ag Alambo (photo, ci-dessus).
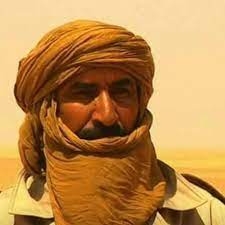
Entre 2007 et 2009, des troubles touaregs ont éclaté non seulement au Niger, mais aussi au Mali voisin, car les Touaregs habitent également les territoires contigus de ces deux États. Par conséquent, la rébellion armée touareg au Niger a également impliqué les Touaregs maliens, en particulier l'un des hommes politiques et chefs de guerre les plus influents, Ibrahim ag Bahanga (photo, ci-dessus).
En 2012, les Touaregs ont profité du coup d'État au Mali pour proclamer la création de l'État indépendant de l'Azawad sur le territoire du même nom. La capitale de cette région est Tombouctou. Les Touaregs ont par la suite assoupli leurs exigences, acceptant l'autonomie et de larges pouvoirs au sein du Mali. C'est au Mali que le nationalisme touareg s'est manifesté le plus clairement, car les Touaregs constituent la principale population du nord du pays, mais en termes politiques, ils ne sont pas bien représentés au niveau de l'État.
Au Niger actuel, les Touaregs représentent 9% de la population et vivent principalement dans le nord du pays, dans la région d'Agadez (du nom de l'ancien État) et dans la vallée du Niger. Il est important de noter que les Touaregs du Niger forment une seule et même communauté avec les Touaregs du Mali, de l'Algérie et de la Libye voisins.

La géopolitique du Niger
En 2021, Mohamed Bazoum (photo, ci-dessus), un homme politique entièrement dévoué aux Français, d'origine arabe et originaire du Fezzan, proche de l'ancien président Mahamadou Issouf, auquel il a succédé, devient président du Niger.

Le 26 juillet 2023, Mohamed Bazoum est renversé par les forces armées nigériennes dirigées par le général de brigade Abdurahmane Tchiani (photo, ci-dessus), issu d'une ethnie haoussa.
Les rebelles capturent Mohamed Bazoum et l'accusent de corruption et de favoriser la France coloniale. En même temps, les rebelles ont proclamé une voie de rapprochement avec les régimes antifrançais et anticoloniaux du Mali et du Burkina Faso, orientés vers un monde multipolaire et favorables à un rapprochement avec la Russie.
Pour la France, le Niger est une source importante d'uranium. Paris est extrêmement préoccupé par sa sécurité énergétique, qui a été maintenue depuis un demi-siècle aux dépens de ce pays le plus pauvre d'Afrique. Au centre de la zone naturelle du Sahel, les régions septentrionales du Niger revêtent une importance géostratégique. C'est notamment une route caravanière pour le transport de l'or, de la drogue, des armes, de la main d'œuvre illégale et des groupes terroristes qui déstabilisent l'ensemble de l'Afrique. Par exemple, la drogue arrive en Europe via le Niger et les régions du nord du Mali, où les Français empêchent les autorités locales d'entrer depuis 2013. Dans la même région, Agadez accueille une base militaire américaine dotée d'un aérodrome pouvant accueillir des avions de transport militaire.
Ni les États-Unis ni la France n'ont l'intention de retirer leurs troupes du Niger. Du moins, aucune déclaration officielle n'a été faite en ce sens. Toutefois, l'expérience du Mali voisin suggère que la présence des militaires français pourrait être remise en question après la consolidation du nouveau gouvernement.
La possibilité d'une intervention militaire de la France et de ses alliés au Niger demeure.

Outre le rétablissement du président "légitime" Bazoum, la situation sécuritaire pourrait servir de prétexte à une intervention. Après le renversement du président pro-français, les djihadistes de l'État islamique, interdits en Russie, sont devenus plus actifs au Niger. Dans le même temps, l'ancien chef rebelle touareg Rissa Ag Boula (photo, ci-dessus) a annoncé la création du "Conseil de résistance pour la République" (CRR) et le début de la lutte contre l'armée nigérienne. Les rebelles touaregs se sont manifestés ces dernières années tant en Algérie qu'au Mali, ce qui a coïncidé avec la détérioration des relations de ces pays avec la France.
L'intervention militaire de la France et de ses alliés, si elle a lieu, s'accompagnera de tentatives de déstabilisation de la zone sahélienne en utilisant les facteurs touaregs et djihadistes. Les groupes peuls et touaregs servent actuellement de base aux mouvements extrémistes dans la région, notamment l'État islamique au Grand Sahara, une branche d'ISIS interdite en Russie, et une coalition de groupes loyaux à Al-Qaïda (JNIM), également interdite en Russie, dirigée par l'ancien nationaliste touareg Iyad Ag-Ghali. Cependant, même en l'absence d'intervention, des forces extérieures pourraient chercher à fomenter l'instabilité au Niger, avec le risque d'une escalade des tensions dans l'ensemble du Sahel, où les mêmes populations et les mêmes groupes transfrontaliers opèrent.
L'intervention de l'OTAN en Libye en 2011 n'a pas seulement porté atteinte à l'intégrité territoriale du pays pendant une décennie, en le transformant en un bastion de l'extrémisme et de la criminalité. Les Touaregs déplacés de Libye par les forces de Mouammar Kadhafi sont devenus la force derrière le soulèvement dans le nord du Mali en 2012, qui a ensuite été rejoint par les djihadistes. La déstabilisation de la Libye a fini par déstabiliser le Sahel et les actions de la France contre les djihadistes ont renforcé les groupes séparatistes locaux, qui pullulent au Mali et au Niger. En cas de tentatives de déstabilisation et d'ingérence dans les affaires du Niger, auxquelles s'opposent les puissances régionales que sont le Mali, le Burkina Faso et l'Algérie, il faut s'attendre à ce que le conflit dégénère en une guerre majeure au Sahel. Cela affectera à son tour la situation dans toute l'Afrique de l'Ouest et du Nord.
En théorie, la menace peut être éliminée si le Niger se tourne vers de nouveaux partenaires. De toute évidence, il pourrait s'agir de la Russie et de la PMC "Wagner", qui ont fait leurs preuves en RCA et au Mali. Cependant, la Turquie tente également de s'implanter activement dans la région. Ankara développe des liens avec des pays qui soutiennent le Niger face à une éventuelle intervention - le Mali et le Burkina Faso - et s'est déjà opposée à une intervention au Niger. Il est à noter que le Burkina Faso est un important consommateur de produits militaires turcs.
20:00 Publié dans Actualité, Ethnologie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, niger, afrique, affaires africaines, politique internationale, haoussas, touaregs, fulbe, songhai, ethnologie, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 13 août 2023
La rébellion africaine contre l'Occident

La rébellion africaine contre l'Occident
Markku Siira
Source: https://markkusiira.com/2023/08/08/afrikan-kapina-lantta-vastaan/
Comme l'a révélé le sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg, l'Afrique redevient un continent important et une arène pour les jeux géopolitiques. La Russie, elle aussi, abandonne son eurocentrisme d'antan et, comme si elle respectait l'héritage soviétique, se tourne à nouveau vers l'Afrique.
La longue relation de la Russie avec les pays africains n'a pas été oubliée. En 1960, l'Union soviétique a fondé l'Université de l'amitié entre les peuples, qui offrait un enseignement supérieur aux étudiants des pays qui avaient obtenu leur indépendance de la domination coloniale. Le bastion académique soviétique de la "puissance douce" devait former la nouvelle élite africaine.
Aujourd'hui, nous assistons enfin à une situation dans laquelle les puissances occidentales de l'ère coloniale sont repoussées hors d'Afrique par les Africains eux-mêmes. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger sont aujourd'hui en première ligne des critiques occidentales, mais d'autres pays devraient suivre au fur et à mesure que le temps passe et que l'influence de l'Occident dans la région continue de s'éroder.
L'Afrique, toujours considérée comme un puits sans fond pour l'enrichissement personnel de l'élite dirigeante occidentale, sera-t-elle enfin capable de décider de son propre destin et d'utiliser ses propres ressources naturelles pour développer la civilisation africaine ? La vision de Mouammar Kadhafi d'une Afrique forte et indépendante se réalisera-t-elle ?

Comme l'a dit le capitaine Ibrahim Traoré (photo), 35 ans, qui a pris le pouvoir au Burkina Faso par un coup d'État militaire, sa génération s'est demandé comment l'Afrique, avec tant de richesses, est devenue le continent le plus pauvre du monde, dont les dirigeants sont obligés d'aller mendier à l'étranger ?
Traoré connaît probablement la réponse à sa question rhétorique, car l'état actuel des choses est en fin de compte la faute des cercles financiers internationaux et des familles puissantes qui ont cherché à tout posséder sur la planète, quelles qu'en soient les conséquences.
Les officiers militaires qui ont déposé les régimes fantoches "démocratiques" soutenus par l'Occident dans divers pays ont invoqué les mêmes raisons pour justifier leurs coups d'État. Ils ont agi parce qu'ils étaient préoccupés par la montée du terrorisme et le sous-développement social et économique chronique de leur pays d'origine.
Le Sahel, par exemple, est l'une des régions les plus riches du monde en termes de ressources naturelles telles que le pétrole, l'or et l'uranium, mais c'est aussi l'une des plus pauvres sur le plan économique. Le Niger est un autre exemple frappant : il est l'un des principaux exportateurs d'uranium au monde, mais il se classe régulièrement au bas de l'indice de développement humain en termes d'espérance de vie, d'éducation et de niveau de vie.
Aux yeux des nouveaux dirigeants de ces anciennes colonies et de leurs partisans, la France porte une grande responsabilité dans cette situation. Ce coin d'Afrique, anciennement connu sous le nom colonial de Françafrique, a continué à exercer son influence sur ses anciens postes avancés, remplaçant la domination coloniale directe par des formes plus subtiles de contrôle néocolonial - avant tout, la monnaie.
Bien que la décolonisation de l'Afrique ait conduit à l'adoption de monnaies nationales par les pays africains, la France a réussi à persuader la plupart de ses anciens sujets d'Afrique centrale et occidentale de conserver une monnaie coloniale, le franc CFA ("CFA" signifie à l'origine Colonies françaises d'Afrique, puis Communautés financières d'Afrique).
Lorsque plusieurs pays ont tenté d'abandonner le système CFA, la France a fait tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher le passage aux monnaies nationales. Les relations entre la France et ses vassaux en Afrique étaient basées sur l'intimidation, les campagnes de déstabilisation, les coups d'État et même les assassinats par le pays européen anciennement colonisateur. Les mêmes tactiques ont bien sûr été utilisées en Afrique par d'autres pays occidentaux, tels que la Grande-Bretagne et les États-Unis.
À la lumière de l'histoire, il ne faut pas s'étonner que les dernières juntes militaires africaines aient choisi la France comme principale cible de leur colère. L'"impérialisme monétaire" occidental a empêché le développement des économies africaines et les a maintenues sous le contrôle d'une élite égoïste dominée par la France et d'autres puissances occidentales.

Comme pour souligner ce passé, au Mali, le chef militaire actuel, Assimi Goïta (photo), a expulsé l'armée française, rompu les relations diplomatiques et même interdit le français comme langue officielle. Au Burkina Faso, le jeune leader révolutionnaire Ibrahim Traoré a également expulsé les troupes françaises et interdit plusieurs exportations.
Cette jeune génération en colère pourra-t-elle achever le processus de décolonisation entamé dans les années 50 et 60 en Afrique francophone ? Outre l'indépendance politique (et le retrait des bases militaires occidentales), la souveraineté économique serait également nécessaire.
Les régimes militaires bénéficient encore d'un soutien populaire, car ceux qui ont été élus lors d'élections "démocratiques" se sont révélés être des marionnettes occidentales corrompues qui ont cherché à maintenir le statu quo et l'absence de souveraineté tout en s'enrichissant.
La nouvelle liberté ne sera pas facile à obtenir. Déjà, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) - une alliance politique et économique de quinze pays africains soutenue et financée par l'Occident - menace d'intervenir au Niger, éventuellement par la force ; en effet, les armes économiques de l'arsenal occidental ont déjà été déployées et des sanctions ont été imposées au Niger. La célèbre figure de proue de l'élite occidentale, Victoria Nuland, s'est également rendue au Niger.
Pour sa part, le régime militaire nigérien a averti que toute intervention militaire étrangère dans le pays conduirait à un "bain de sang". Les régimes militaires du Mali et du Burkina Faso ont tous deux exprimé leur soutien au nouveau gouvernement nigérien.
Le coup d'État au Niger menace également le projet de construction d'un gazoduc de 13 milliards de dollars reliant les gisements de gaz du Nigeria voisin à l'Europe, qui passerait directement par le Niger. Avec la décision prise l'année dernière par l'Union européenne de couper le gaz russe, ce projet est probablement plus urgent que jamais.
L'Occident prend donc note des liens de la Russie avec les régimes militaires et Poutine a déjà été accusé de ce nouveau rebondissement. Assiste-t-on à une nouvelle "guerre régionale par procuration" en Afrique, où la Russie et la société de mercenaires Wagner, par exemple, soutiendraient le Niger (ainsi que le Burkina Faso et le Mali), tandis que l'Occident inciterait les pays de la Cedeao à faire la guerre aux rebelles ? L'alliance militaire de l'OTAN sera-t-elle impliquée ?

Bien que le drapeau russe ait été brandi dans les rues du Mali, du Burkina Faso ou du Niger - comme une sorte de symbole de l'anti-occidentalisme - les événements récents trouvent leur origine dans les injustices historiques et la volonté locale de changer de cap. Ainsi, l'intimidation et la complaisance de l'Occident ne risquent pas d'aller bien loin, mais ne feront que renforcer la détermination à rompre avec les anciens maîtres coloniaux.
Lorsque les politiques agressives de l'Occident ne seront plus acceptées en Afrique, cela créera-t-il les conditions d'une nouvelle vague de souverainisme ? Alors que les contours du nouvel ordre économique mondial se dessinent, l'Afrique, avec ses marchés dynamiques, ses vastes richesses naturelles et ses nouveaux dirigeants critiques à l'égard de l'Occident, doit également être prise en compte.
20:04 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : afrique, sahel, affaires africaines, actualité, politique internationale, mali, niger, burkina faso, françafrique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 août 2023
Jeu de risque africain: déstabilisation et pénétration

Jeu de risque africain: déstabilisation et pénétration
Jeu de 6 entre les marchands d'hommes, les djihadistes, la Russie, la Chine, les Etats-Unis et les pays européens
par Guido Salerno Aletta
Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/26097-guido-salerno-aletta-risiko-africano-destabilizzazione-e-penetrazione.html
L'Afrique est un continent de plus en plus sollicité, riche en matières premières convoitées par tous, mais extrêmement pauvre.
Il faut d'abord dresser la carte des intérêts, économiques et géopolitiques, en commençant par ceux des trafiquants d'êtres humains qui alimentent le trafic des migrants désespérés, qui les paient pour fuir des situations de grande pauvreté dans l'espoir de trouver de meilleures conditions de vie en Europe.
Commençons par la déstabilisation de l'Europe, où depuis des années, des centaines de milliers de désespérés arrivent des régions les plus pauvres du Sud, ainsi que des zones de guerre. Il s'agit d'un intérêt géopolitique qui rassemble de nombreux acteurs sur la scène mondiale: ils apportent un désarroi économique et social, ils créent des problèmes d'intégration. Le problème est humanitaire, bien sûr, mais derrière, il y a ceux qui ont intérêt à alimenter les tensions nées de flux d'immigration incontrôlés.
Les ONG, qui sauvent ceux qui sont embarqués sur des bateaux de fortune puis abandonnés à la dérive en Méditerranée, ne peuvent pas grand-chose pour ceux qui se traînent sur des milliers de kilomètres le long des routes terrestres qui vont du Golfe de Guinée aux ports d'embarquement sur la côté méditerranéenne: il y a les nombreux pays africains d'où partent les multitudes de migrants, ceux qui ne sont traversés que par ces multitudes, les pays européens de premier accueil, et ceux qui sont convoités comme destination finale.
L'Italie est un pays de premier accueil, lui-même un pays de transit temporaire, car la plupart des migrants veulent partir le plus vite possible, pour aller en France ou en Allemagne, sinon en Angleterre, rejoindre des parents ou des amis qui y sont déjà installés.
Tout le monde connaît les conditions de vie à Vintimille, aux frontières de la France, où des milliers de clandestins sont stationnés dans l'attente de passer la frontière, sans cesse repoussés par la gendarmerie. Mais c'est la même chose à Calais, le port français sur la Manche, où depuis des années des milliers de clandestins se regroupent dans une sorte de jungle pour rejoindre la Grande-Bretagne.
Et puis il y a les pays du Maghreb, ceux de la rive sud de la Méditerranée, qui ne sont que traversés par le flux des migrants : ils leur créent beaucoup de problèmes à cause de cette hospitalité temporaire qu'ils leur offrent, en espérant qu'ils repartiront le plus vite possible. Le Maroc comme l'Algérie, la Tunisie comme la Libye, sont les plus touchés par ce phénomène.
Nous nous limitons à cette route méditerranéenne, sans considérer celle des Balkans ou celle qui passe par la Turquie et la Grèce, pays de transit, qui font face au flux de réfugiés syriens en particulier.
Pour ce qui est de l'Italie, il suffit de regarder les données sur l'origine des migrants arrivés en 2023 : en première place, la Côte d'Ivoire avec 12 % des arrivées, puis la Guinée avec 11 %, l'Égypte avec 9 %, le Bangladesh avec 8 %, le Pakistan et la Tunisie avec 7 %, le Burkina Faso avec 6 %, la Syrie avec 5 %, le Cameroun et le Mali avec 3 %. Au total, les migrants des pays subsahariens pèsent 35 %.
Si l'on veut schématiser d'un point de vue géographique, il y a donc trois catégories de pays qui sont concernées par la route méditerranéenne des migrants : ceux du Maghreb, Tunisie et Libye en tête, où ils arrivent pour embarquer et finalement arriver en Europe, à travers des ports sûrs comme ceux de l'Italie ; ceux du Sahel, la bande subsaharienne, qui représente plutôt une bande de territoire qui n'est traversée que par ceux qui viennent de plus au sud, comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire ou la Guinée. En pratique, le Niger est un pays clé pour les routes des migrants, puisqu'ils y passent tous en direction de la Libye et de l'Algérie.
En clair, les migrants sont d'abord un business, tant pour ceux qui organisent leur trafic pour les amener à destination, que pour les organisations qui gèrent leur sauvetage en mer puis leur assistance dans les différents pays. Mais ils sont aussi un instrument de déstabilisation, d'abord pour les pays africains de transit, puis pour les pays européens de premier accueil, et enfin pour les pays européens de destination finale.
Le Premier ministre Giorgia Meloni vient de présider à la Farnesina une conférence internationale sur le thème "Développement et migrations", à laquelle elle a invité le président tunisien Saied et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, et à laquelle ont participé un grand nombre de pays européens et africains intéressés par les flux de transit et d'accueil, dont l'un des principaux points d'attention était précisément la lutte contre le trafic illégal de migrants.
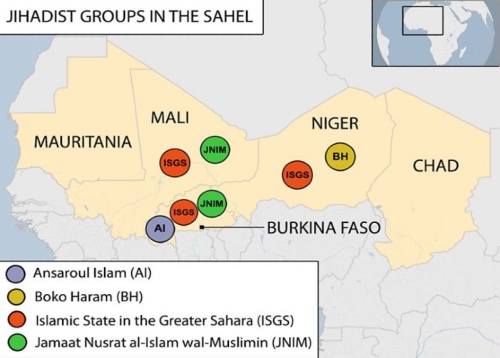
Il existe un deuxième instrument de déstabilisation, cette fois de l'Afrique: les mouvements djihadistes.
C'est un sujet retors, car on ne sait jamais vraiment qui est derrière: il ne peut s'agir d'un phénomène spontané, puisqu'il est instrumentalisé d'une part pour affaiblir les gouvernements africains et d'autre part pour leur offrir un soutien afin de les contrer. En pratique, ils représentent des formes d'agrégation sociale sur une base religieuse qui sapent l'autorité des structures de pouvoir officielles : ils représentent une alternative islamiste et communautaire qui érode la légitimité de la structure politique traditionnelle.
Le califat africain, qui s'est répandu comme une traînée de poudre, est désormais un phénomène endémique: des pays entiers ne sont plus viables, du Sud-Soudan à la Somalie, pour n'en citer que quelques-uns.
La déstabilisation de l'Afrique par le soutien occulte au djihadisme est un moyen d'empêcher d'autres puissances de s'implanter dans ces pays: comme la tactique des Indiens d'empoisonner les puits, ou celle des Tartares de se replier en brûlant la steppe derrière eux. Aucun ennemi ne peut alors prendre possession de ces zones.
Il y a un autre aspect: la lutte contre les organisations djihadistes peut être un moyen par lequel les États étrangers offrent aujourd'hui une protection aux régimes africains en place. Protection armée, bien sûr, en envoyant leurs propres troupes: la France l'a fait dans plus d'un cas, avec très peu de succès au Mali et au Burkina Faso, ou l'Italie en participant à une mission internationale d'observation et de lutte contre le trafic de migrants au Niger.
On sait comment la société militaire Wagner a largement profité des échecs signalés par la France dans la lutte contre le djihadisme: accusant indirectement les anciens colonisateurs d'instrumentaliser la lutte contre le djihadisme pour maintenir leurs troupes dans ces pays, la Russie prend le relais.
La lutte contre la déstabilisation apportée par les organisations djihadistes est utilisée à des fins géopolitiques.
Comme si cela ne suffisait pas, on profite de ce changement de main pour s'approprier les immenses ressources minières des pays africains.
C'est ainsi qu'elle paie la protection militaire offerte par les Russes de Wagner ou le coût des infrastructures d'intérêt général construites par la Chine sur ses fonds propres, des routes aux chemins de fer en passant par les ports.
Inutile d'ajouter que la Russie propose également aux pays africains de leur vendre à des prix avantageux des céréales dont leurs populations ont cruellement besoin et que leurs gouvernements respectifs n'ont pas les moyens d'acheter au prix du marché.
Tel est l'affrontement géopolitique en cours en Afrique: violent et sanglant, comme toujours.
17:12 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, afrique, affaires africaines, migrations, djihadisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 10 août 2023
L'Ukraine, le Niger et la révolution multipolaire en cours

L'Ukraine, le Niger et la révolution multipolaire en cours
par Antonio Castronovi
Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/26106-antonio-castronovi-l-ucraina-il-niger-e-la-rivoluzione-multipolare-in-atto.html
La décision courageuse de la Russie de rejeter la tentative de l'OTAN de faire de l'Ukraine un avant-poste atlantique afin de la déstabiliser, et donc d'accepter le niveau de confrontation militaire imposé par le refus de l'OTAN de négocier les conditions de la sécurité mutuelle en Europe, a ouvert de nouveaux scénarios jusqu'alors impensables dans le monde. Le choc entre les prétentions unipolaires et impérialistes du bloc occidental et la résistance politique, économique et militaire de la Russie a renforcé dans le monde les aspirations des peuples, des pays et des régions qui aspirent à leur propre souveraineté et à leur autodétermination et qui souhaitent se libérer du contrôle colonial et de l'asservissement par l'Occident. L'axe russo-chinois sur le continent eurasien se renforce et la zone des pays des trois continents qui veulent rejoindre les BRICS s'étend, à ce jour ils sont une trentaine.
Le conflit entre l'OTAN et la RUSSIE en Ukraine ouvre ainsi la porte à une véritable révolution mondiale anticoloniale et multipolaire dont l'épicentre se situe en Afrique, notamment dans l'espace centrafricain qui voit disparaître une à une les emprises coloniales françaises.
Après la République centrafricaine, le Mali, le Burkina Faso, etc., les supports de la tutelle coloniale française disparaissent les uns après les autres. Le dernier bastion de la présence française, le Niger, a sauté ces jours-ci. Les réactions de panique de l'establishment occidental donnent la mesure du changement de climat en Afrique. On ne craint plus la réaction punitive économique et militaire qui pourrait venir de la France ou des pays encore sous le joug colonial. Le Mali, le Burkina Faso, la Guinée et l'Algérie sont prêts à défendre le Niger même par les armes contre une intervention militaire extérieure. C'est ainsi qu'émergent la fierté et la dignité d'une jeune classe dirigeante africaine anticoloniale qui a repris l'héritage de Lumumba, de Sankara et du socialisme panafricain et qui tisse des relations de coopération économique et commerciale avec la Russie et la Chine, sans les conditions draconiennes - le licou - imposées par le FMI et la Banque mondiale avec la pratique des prêts usuraires qui créent la dette et une dépendance supplémentaire. Le geste de Poutine d'effacer une dette de 20 milliards de dollars des pays africains et de donner des céréales à ceux qui en ont le plus besoin a déclenché des réactions hystériques dans les gouvernements occidentaux, où le ministre italien des affaires étrangères Tajani s'est distingué par sa maladresse, mais il a surtout suscité l'enthousiasme et un esprit de révolte anticoloniale dans les populations africaines qui remplissent les places en vantant la Russie et Poutine.
Tous les gouvernements africains, sauf trois, étaient présents au sommet russo-africain de Saint-Pétersbourg, prouvant ainsi que l'Afrique ne craint plus les punitions et les réactions du maître blanc. L'aire idéologique qui est restée déconcertée et muette face à cette vague de soulèvement anticolonial en Afrique, c'est sans doute celle de la gauche européenne dans ses différentes variantes : non seulement la gauche russophobe et pro-atlantique, mais aussi la gauche dite pacifiste mais anti-poutine, celle qui n'a jamais renoncé au mantra agresseur-agressé, qui n'avait rien compris à la nature de l'affrontement ouvert en Ukraine, et qui a aujourd'hui du mal à accepter l'enthousiasme et la solidarité africaine avec la Russie. Mais c'est là un vieux défaut et une tare d'origine aussi du marxisme occidental, qui n'a jamais lié la lutte anticapitaliste à la lutte anticoloniale, qui n'avait pas compris la leçon de Lénine hier, qui n'avait pas compris la nature de la révolution chinoise comme révolution anticoloniale, et qui ne comprend pas aujourd'hui la valeur de la révolution mondiale en cours en tant que révolution multipolaire qui a son moteur en Russie et en Chine et son centre en Afrique, mais qui a déjà déplacé l'équilibre géopolitique au Moyen-Orient. Déjà, l'Occident n'est plus le berceau de la révolution socialiste. Peut-être ne l'a-t-il jamais été. Comme l'a dit Domenico Losurdo, il ne l'a peut-être jamais été parce qu'il a refusé la rencontre avec la révolution anticoloniale, considérée comme distincte de la perspective socialiste. Une erreur stratégique et théorique que les classes populaires européennes paient encore aujourd'hui.
19:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, niger, multipolarité, afrique, affaires africaines, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le terrorisme en Afrique : l'arme actuelle de l'OTAN pour attaquer la Russie

Le terrorisme en Afrique: l'arme actuelle de l'OTAN pour attaquer la Russie
Lucas Leiroz
Source: https://novaresistencia.org/2023/08/03/terrorismo-na-africa-a-atual-arma-da-otan-para-agredir-a-russia/
Il existe un continuum d'événements depuis l'intervention russe en Syrie et le coup d'État en Ukraine, qui culmine avec le détournement actuel des armes de l'OTAN vers les terroristes en Afrique.
En 2014, suite aux politiques de dé-russification mises en place par le Maïdan, une guerre civile a éclaté dans ce qui était alors l'est de l'Ukraine - qui fait aujourd'hui partie de la Fédération de Russie - aboutissant à la séparation de Donetsk et de Lougansk. Dans ce conflit civil, plusieurs militants salafistes de l'État islamique se sont alliés aux forces ukrainiennes, comme l'ont rapporté les services de renseignement russes et comme l'ont admis les agences de presse occidentales et les autorités européennes.
L'objectif était alors de tenter d'amener la Russie à concentrer ses efforts sur le Donbass et de l'empêcher de lancer une intervention d'envergure en Syrie. Mais le plan a échoué. La Russie est restée inerte en Ukraine jusqu'en 2022, puis est intervenue efficacement en Syrie en 2015, annihilant l'ISIS et le réduisant à quelques milices sans grande puissance de feu.
Vaincus en Syrie, les terroristes d'ISIS se sont dispersés dans diverses régions et l'Afrique a été l'une des destinations les plus souvent choisies. Territoire riche en ressources naturelles, avec plusieurs pays en proie au chaos institutionnel et une politique de sécurité faible, le continent africain est devenu la cible des milices extrémistes. Nombre de ces groupes étaient effectivement issus des rangs de l'État islamique au Moyen-Orient, mais un grand nombre d'entre eux étaient des terroristes locaux recrutés par des organisations qui avaient simplement adopté le "label" de l'État islamique.
C'est ainsi qu'a commencé une course au terrorisme en Afrique. J'ai écrit à ce sujet tout au long des années 2020 et 2021. À l'époque, j'ai expliqué sans détour comment les organisations terroristes "abandonnaient" le Moyen-Orient et pariaient sur la possibilité d'un califat africain. Jusqu'alors, je m'étais concentré sur l'analyse du cas du Mozambique, où les terroristes ont fini par dominer de vastes pans de territoire, y compris des installations minières. Je souligne cette publication que j'ai réalisée pour le média d'État chinois CGTN en 2021 (https://news.cgtn.com/news/2021-04-01/Sino-Russian-cooper...), exposant comment la Russie et la Chine pourraient conjointement stopper la progression du terrorisme au Mozambique.
Le temps a passé et certaines choses ont changé sur la scène africaine. Les États locaux ont commencé à comprendre que pour stopper le terrorisme, ils devaient investir dans la même stratégie que les Syriens: la coopération militaire avec la Russie. Depuis 2018, le groupe Wagner opère régulièrement en Afrique, à la fois pour combattre directement et pour former les forces locales. Ces activités se sont intensifiées ces dernières années et ont ouvert l'horizon du contre-terrorisme africain.
Cette prise de conscience a stimulé la coopération au-delà de la sphère militaire, atteignant un biais politique pertinent. À partir du Mali, une série de révolutions pro-russes et anti-françaises ont commencé à émerger en Afrique, principalement dans la région extrêmement stratégique du Sahel - une bande horizontale de 700 km de largeur, reliant l'Atlantique à l'océan Indien et le Sahara à la savane, désignée par les experts comme le "Heartland" de l'Afrique.

Jusqu'à présent, pour l'Occident, la présence militaire de la Russie en Afrique, bien que malveillante, n'était pas d'une grande importance stratégique, l'OTAN s'attachant à alimenter les conflits ailleurs. Le lancement de l'opération militaire spéciale l'année dernière a toutefois allumé une nouvelle balise stratégique pour l'Occident en Afrique.
Compte tenu de l'épuisement des forces armées ukrainiennes et de l'impossibilité d'impliquer directement les troupes de l'OTAN dans le conflit, l'Occident se préoccupe désormais de la manière de continuer à distraire et à épuiser la Russie tout en se préparant à son véritable objectif : la confrontation militaire avec la Chine - qui est considérée comme une cible faible si elle ne reçoit pas d'aide de la part de la Russie.
En ce sens, en plus de fomenter la violence en Eurasie, l'Occident encourage désormais l'émergence de guerres par procuration contre la Russie dans le Sahel africain, où il s'attend également à une plus grande participation de la France, puisque Paris contrôlait la région jusqu'à ce que les gouvernements locaux demandent l'aide de la Russie.
Pour l'Occident, ce plan repose sur trois valeurs stratégiques essentielles :
- Faire reculer la Russie et, dans une moindre mesure, la Chine (qui possède des entreprises dans toute l'Afrique) ;
- Créer une terre brûlée en Afrique, quelle que soit l'issue des confrontations, ce qui mettrait un terme aux possibilités de développement de l'Afrique dans un monde multipolaire ;
- Occuper par des forces supplétives la région du Sahel, le "Heartland" qui permet de dominer le reste du continent africain.
C'est pourquoi, depuis l'année dernière, plusieurs dirigeants africains ont signalé la présence d'armes de l'OTAN sur leur territoire. Ces armes sont transportées à l'étranger sous prétexte d'aider Kiev, mais dans la pratique, elles arrivent dans des centres de distribution et sont acheminées vers plusieurs destinations différentes, toutes conformes aux intérêts stratégiques américains.
L'Afrique est la nouvelle cible. C'est ce qu'a dénoncé M. Traore, le président du Burkina Faso, dans son discours en Russie. L'OTAN fournit des terroristes africains pour faire éclore des guerres par procuration au Sahel. Preuve de ce que j'ai dit en avril dernier, les dérives de l'armement de l'OTAN ne sont pas seulement le résultat de la corruption ukrainienne, mais d'une volonté délibérée de l'OTAN d'armer les terroristes sur d'autres flancs.
En fin de compte, une fois de plus, l'Occident s'appuie sur le terrorisme pour attaquer la Russie. Et cela ne tend pas à avoir des résultats différents de ceux observés jusqu'à présent, mais il est dommage de savoir que tant que tout ne sera pas résolu militairement, de nombreuses vies africaines seront sacrifiées.
17:39 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, actualité, politique internationale, affaires africaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 août 2023
Géopolitique de l'Afrique: le Sahel, cœur de l'Afrique
Géopolitique de l'Afrique: le Sahel, cœur de l'Afrique
Raphael Machado
Source: https://www.geopolitika.ru/pt-br/article/geopolitica-da-africa-o-sahel-como-heartland-africano
De nombreuses pages sur la grande toile et plus d'un compte rendu qui n'avaient rien écrit sur le Sahel ou n'avaient commenté les récents processus politiques africains se sont tout récemment engouffrés dans la brèche.
Il en résulte des explications très faibles qui ignorent la géopolitique du Sahel, la place de l'Afrique dans les récents conflits internationaux et qui se concentrent uniquement sur l'une ou l'autre question économique (une limitation dérivée de l'origine marxiste de ces analyses soudaines, mais au moins elles ne sont pas comme d'autres analyses marxistes qui qualifient les révoltes africaines des 20ème et 21ème siècles de "nationalistes bourgeoises").

Le Sahel, le cœur de l'Afrique.
Pour y remédier, je vous recommande l'analyse de Lucas Leiroz hier qui contextualise le phénomène général à la lumière de la promotion du chaos par l'Occident à travers l'instrumentalisation du terrorisme, ainsi que la confrontation de la Russie à cette menace à travers les interventions du Groupe Wagner.
J'ajouterai quelques réflexions.
L'Afrique fait partie de l'île du monde, selon la géopolitique de Mackinder, c'est-à-dire la supermasse de terres comprenant l'Europe, l'Asie et l'Afrique, cette dernière correspondant au flanc sud du supercontinent. Si l'on considère la thèse de Mackinder sur le Heartland, une idée importante de la géopolitique atlantiste, qui vise à empêcher l'accès e cette "Terre du Milieu" aux ressources africaines.
Dans un premier temps, cela se ferait non pas en Afrique, mais en Europe de l'Est, par la fragmentation des frontières de la zone pivot. Mais dans la mesure où le contrôle soviétique dans le Heartland ne s'avérait pas fragile, la thalassocratie devait soumettre la tellurocratie à travers le Rimland, selon les termes de Spykman, c'est-à-dire à travers toute la bande territoriale côtière impliquant l'Europe, l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Inde, l'Asie du Sud-Est, et remontant la côte sino-coréenne à partir de la mer.
Ainsi, même si le Heartland est consolidé, le contrôle du Rimland par une puissance hostile comme les États-Unis suffirait à asphyxier l'État central-continental en question. Il est important de garder cela à l'esprit car c'est la logique géopolitique fondamentale de la présence yankee en Europe (avec la Grande-Bretagne en tant qu'aérodrome), de la guerre du Viêt Nam et du printemps arabe.
Le Sahara apparaît en bout de course chez Mackinder comme faisant partie d'une "ceinture de déserts" dont le contrôle permet d'établir une forme de "barrière naturelle". Pour l'atlantisme, il représente un espace dont le contrôle facilite celui du Rimland. Pour la Russie, il s'agit d'un espace par lequel il est possible de réduire la pression sur le Rhin.
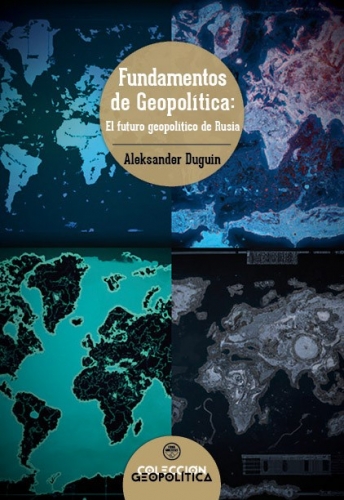
Dans le livre intitulé Les Fondements de la géopolitique de Douguine, les pays du Sahara apparaissent dans le cadre de la défense de l'Eurasie comme une frontière sud en cas d'alliance entre la Russie et les forces arabo-musulmanes.
Or, toute la région conflictuelle en question, qui s'étend du Sahel au delta du fleuve Congo en passant par l'Afrique de l'Ouest, est caractérisée comme un "Shatterbelt" par Saul Cohen, c'est-à-dire comme une zone chaotique de fragmentation, difficile à stabiliser et dans laquelle les puissances ont du mal à appliquer une ligne de conduite en raison des conflits ethniques, religieux, etc. qui, dans la pratique, est aussi le résultat des projets néocolonialistes français depuis Vidal de la Blache, qui visaient à imposer des frontières à l'Afrique selon des critères européens.
Cependant, la création d'une alliance Mali-Guinée-Burkina-Niger, avec le soutien de l'Algérie, et d'une branche allant de la RCA à la RDC, avec le soutien de la Russie, pourrait faire sortir cette région de la catégorie des "Shatterbelt" et en faire une région stratégique pour la défense de l'Eurasie par le contrôle du Sahara, ainsi que pour le contrôle de l'African Heartland, identifié par feu Mackinder comme correspondant à toute la zone africaine située en dessous du désert.
Il est également important de noter que, bien que les fleuves Niger et Congo, par exemple, soient étendus, leur navigabilité est limitée par plusieurs chutes d'eau, ce qui entrave les efforts atlantistes visant à contrôler la région depuis la mer.
En résumé, la Russie se projette dans le Sahel dans une démarche qui sert à la fois ses intérêts et ceux de l'Afrique. Les intérêts russes sont servis par la défense du flanc sud de l'Eurasie (d'où l'article de Lucas Leiroz sur la promotion du terrorisme au Sahel par l'Occident en tant que menace pour la Russie; https://novaresistencia.org/2023/08/03/terrorismo-na-afri... ) et par la réponse au conflit dans le Rimland ; les intérêts africains sont servis par la stabilisation de la région contestée (correspondant approximativement à la France-Afrique), qui permet à des États régionaux intégrés de contrôler le Heartland africain (en alliance avec la Russie).
Un autre élément possible entre en jeu ici, à savoir le contrôle du Sahel et la déconstruction de l'Afrique en tant que mécanismes permettant d'accélérer l'effondrement de l'OTAN, faisant perdre à la thalassocratie son avant-poste occidental par une pression méridionale s'ajoutant à la non-conformité européenne elle-même.
Des sujets comme l'uranium, l'or, le pétrole, etc. sont pertinents, mais ils sont plus de l'ordre des "prix" que de l'essence de la géopolitique.
18:30 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, affaires africaines, géopolitique, poltique internationale, sahel |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 03 août 2023
Eurasianisme et panafricanisme : des défis civilisationnels communs et des réponses à y apporter

Eurasianisme et panafricanisme: des défis civilisationnels communs et des réponses à y apporter
Alexander Bovdunov
Source: https://katehon.com/ru/article/evraziystvo-i-panafrikanizm-obshchnost-civilizacionnyh-vyzovov-i-otvetov?fbclid=IwAR0qgkvo2mBVXgdfCohhicNVk1eA8ijLxHNBvEkY8qKBBYuLRNWoOJFg7Hk
Un point de vue russe, suite aux derniers remous qui viennent de secouer l'Afrique sahélienne.
Malgré les différences externes entre les eurasistes et les panafricanistes, il existe de sérieuses similitudes structurelles entre ces idéologies.
L'intégration eurasienne est l'une des principales priorités géopolitiques de la Russie, tandis que l'intégration africaine est une priorité pour les pays africains. Ces deux concepts ont pris forme au sein de leurs courants idéologiques respectifs: l'eurasisme et le panafricanisme. Malgré les différences externes entre les eurasistes et les panafricanistes, il existe de sérieuses similitudes structurelles entre ces idéologies, qui peuvent être résumées dans le schéma "défi-réponse" d'Arnold Toynbee. En substance, nous parlons de problèmes civilisationnels similaires propres à des civilisations non occidentales confrontées aux problèmes de l'occidentalisation, de la modernisation, de la mémoire historique et du projet d'un avenir enraciné dans la tradition.
Le défi de l'Occident. La réponse : une civilisation indépendante
Les eurasistes et les panafricanistes sont des intellectuels qui ont connu l'Occident, qui s'y sont retrouvés en vertu de circonstances différentes, mais qui ont fait un choix différent, en faveur du non-Occident, de la souveraineté civilisationnelle de leur région, en refusant à la civilisation occidentale son universalité.
Les eurasistes sont des intellectuels russes, y compris des aristocrates comme N. S. Troubetskoï, qui, avant la révolution de 1917, avaient des positions libérales ou libérales-nationalistes. En exil à l'Ouest, ils ont considérablement radicalisé leur vision du monde et sont devenus des adeptes convaincus de la tradition slavophile. Cependant, ils ont opposé l'Occident non pas au monde slave, mais à l'Eurasie en tant que lieu de développement, établissant le discours de l'unicité et de l'altérité de la Russie par rapport aux cultures de l'Occident et de l'Orient. L'eurasisme combine deux idées clés : l'unicité de la civilisation eurasienne et la nécessité d'une unité de l'espace géopolitique eurasien (politique et économique).

Les premiers panafricanistes étaient des intellectuels africains et afro-américains qui ont étudié et grandi en Occident à l'époque de la domination coloniale occidentale en Afrique. Ils comprenaient également des membres de l'aristocratie locale qui étaient directement liés par le sang à l'ancienne tradition de l'État précolonial - par exemple, Tovalu Ouenu, un dandy parisien issu de l'aristocratie du royaume du Dahomey qui a fondé la Ligue générale pour la défense de la race noire (LUDRN) en 1924.
En partie à cause du facteur États-Unis et du Liberia, colonie américaine de facto et point d'entrée des États-Unis sur le continent, certaines idées libérales insérées dans le panafricanisme n'ont pas non plus été immédiatement supprimées. Toutefois, le discours anticolonialiste général était conforme aux positions des eurasistes. Finalement, les panafricanistes ont également commencé à parler de l'indépendance et de l'unification de l'Afrique, qui est devenue une idée clé chez des auteurs tels que Cheikh Anta Diop, Léopold Senghor et d'autres, et la base des projets politiques de dirigeants tels que Modibo Keita, Sekou Toure, Kwame Nkrumah, Toma Sankara ou Mouammar Kadhafi.
Le défi de la modernité. La réponse est : la tradition
Les Eurasistes de Russie ont été les premiers, parmi l'émigration russe, à prêter attention aux écrits du fondateur du traditionalisme, René Guénon, et à les relire. Ils étaient eux-mêmes favorables à un retour de la Russie aux racines de sa tradition orthodoxe, dans le respect des traditions des autres peuples. Ce courant a trouvé son prolongement le plus adéquat dans le néo-eurasisme d'Alexandre Douguine, qui a développé l'opposition à l'Occident des premiers Eurasistes pour en faire l'opposition paradigmatique entre Modernité et Tradition.

On peut en dire autant du panafricanisme contemporain, lui aussi affectivement marqué par la philosophie traditionaliste. Il s'agit tout d'abord des idées de Kemi Seba (photo), président de l'ONG Urgences Panafricanistes. Cependant, les idées de la Renaissance africaine, articulées par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, comportent également une attitude critique à l'égard de la modernité :
"Ce qui est unique dans la Renaissance africaine exprimée dans les écrits de Thabo Mbeki, c'est qu'elle souligne l'importance d'ancrer la pratique quotidienne (y compris la science) dans les réalités et la philosophie africaines. Il reconnaît l'incapacité de la modernité à fonctionner au profit de tous les Africains, comme en témoigne la poursuite de l'asservissement de l'Afrique... Ni le capitalisme, ni le marxisme, ni leurs dérivés n'ont apporté la liberté ou l'unité à l'Afrique. Dans une large mesure, l'invitation à participer à la Renaissance africaine est aussi une invitation à revitaliser l'Afrique à travers ses langues et ses philosophies", écrivent les chercheurs zimbabwéens Mark Malisa et Philippa Nengeze.

Certains courants de l'eurasisme et les panafricanistes ont longtemps tenté de trouver une voie vers la souveraineté civilisationnelle en faisant appel aux idéologies modernes (libéralisme, communisme, nationalisme), mais ont fini par rejeter le modernisme et son paradigme politique en général.
"Alors que les premiers panafricanistes croyaient initialement que l'avenir de l'Afrique résidait dans l'adoption du capitalisme, du christianisme ou même du marxisme, au début du 21ème siècle, en particulier avec l'appel à une renaissance africaine, il y a eu une reconnaissance implicite et explicite du fait que les instruments et les structures de la modernité n'ont pas réussi à changer radicalement les conditions de vie des Africains pour le mieux", notent les chercheurs africains.

Le défi des empires. La réponse : l'intégration continentale
La forme la plus élevée d'organisation politique dans le monde de la Tradition était les empires - les royaumes des royaumes. Les anciennes formations impériales telles que l'Empire du Mali, du Bénin, du Monomotapa (Zimbabwe) constituent une source de fierté pour les Africains et ont inspiré les panafricanistes. La conscience impériale (opposée à l'impérialisme moderne occidental) et les empires, soit en tant que structures fonctionnelles, soit en tant qu'objets de la mémoire collective qui stimulent l'imagination politique, sont une ressource cruciale de l'idéologie souveraine qui mobilise l'opposition au colonialisme.
Par exemple, Modibo Keita, l'un des fondateurs de l'État du Mali, a justifié l'adoption du nom d'un ancien empire pour un nouvel État postcolonial : "Mali est un nom célèbre qui appartient à toute l'Afrique de l'Ouest ; un symbole de puissance, de capacité d'organisation politique, administrative, économique et culturelle de l'homme noir. C'est un mot qui laisse déjà dans les cœurs et les âmes l'empreinte mystique du grand espoir de l'avenir : la Nation africaine...".

N'étant pas un artefact du passé mais un véritable sujet politique, l'empire africain - l'Éthiopie - a inspiré les premiers panafricanistes en tant qu'exemple de résistance aux colonisateurs. Cependant, les panafricanistes n'ont pas cherché à restaurer les anciens empires dans leur forme antérieure, mais plutôt à construire une nouvelle union qui inclurait l'ensemble du grand espace africain sur la base de la paix et de la fraternité mutuelle plutôt que de l'assujettissement et de l'asservissement.
La pensée politique des Eurasistes s'est organisée dans une attitude similaire à l'image de l'empire révolu. Ils s'inspiraient du passé historique commun et étaient fiers de la construction de l'État par leurs ancêtres, mais ils n'étaient pas favorables à la recréation de l'Empire russe sous ses anciennes formes, mais à la construction d'une nouvelle entité d'intégration étatique sur la base des principes du nationalisme pan-eurasien. Cette position eurasienne peut être exprimée dans les propos du président russe V.V. Poutine sur le défunt empire soviétique. Les mots de Poutine sur l'empire soviétique disparu : "Celui qui ne regrette pas l'effondrement de l'URSS n'a pas de cœur. Et celui qui veut lui redonner sa forme d'antan n'a pas de tête".
La symétrie entre l'eurasisme et le panafricanisme est un argument supplémentaire en faveur du fait que les deux idéologies sont destinées à coopérer et à se soutenir. Confrontés à des défis similaires, les Russes et les Africains suivent des voies similaires pour surmonter l'Occident, la modernité et leur passé en créant de nouvelles formes politiques sur la base de la tradition. L'étude des idées des uns et des autres peut considérablement enrichir le discours eurasien et panafricaniste et stimuler l'imagination politique des deux idéologies.
18:09 Publié dans Actualité, Eurasisme | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : actualité, panafricanisme, eurasisme, afrique, affaires africaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 16 juillet 2023
Somaliland: Visite en territoire non reconnu

Somaliland: Visite en territoire non reconnu
par Georges FELTIN-TRACOL
Les vacances estivales approchent avec son duel annuel entre les vacanciers du mois de juillet et ceux du mois d’août. N’entrons pas dans ce dilemme cornélien. Délaissons plutôt les destinations convenues de Tahiti, de l’Amérique du Nord, de la Costa Brava, de la Croatie, de la Côte d’Azur ou des Aurès. Choisissons l’exotisme, détournons-nous de l’ancienne Seine - Saint-Denis et visitons un territoire inconnu des cercles diplomatiques.

Il se situe dans la Corne de l’Afrique, un espace agité de mille convulsions. Or cet État-fantôme constitue pour l’heure un pôle de stabilité politique, économique et sociale relative: la République du Somaliland avec pour capitale: Hargeisa. D’une superficie variant de 137.600 à 284.120 km² et de quatre à plus de cinq millions et demi d’habitants, dont 65% pratiquent encore le nomadisme, la partie septentrionale voisine de Djibouti et de l’Éthiopie quitte la Somalie en mai 1991. Dix ans plus tard, un référendum confirme à 97,10% son indépendance.
La scission somalilandaise procède en partie du renversement en janvier 1991 du président autocrate Mohamed Siad Barre et de la guerre civile toujours en cours aujourd’hui qui en résulte. Mais cette rupture a des causes historiques plus profondes. Le Mouvement national somali réclame l’indépendance dès les années 1980 en dépit d’une répression violente. Les Somali peuplent une grande partie de la Corne africaine. Leurs structures sociales s’articulent autour des tribus et des clans. S’y intègrent de puissantes confréries musulmanes. Les rivalités y sont fréquentes.

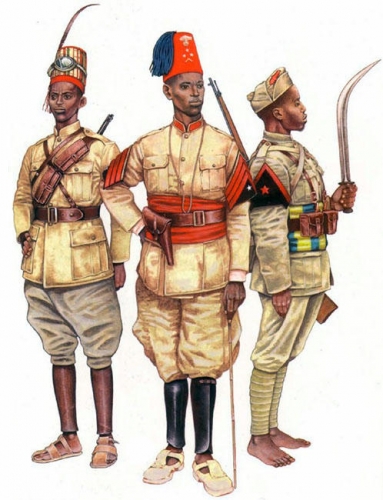
À la fin du XIXe siècle, trois puissances européennes profitent de ces désunions internes pour s’implanter localement. Si la majorité des Somali passe sous le contrôle de Rome qui en fait un protectorat dès 1889, puis une colonie – Somalia italiana – en 1905, Paris occupe les alentours de Djibouti et organise la Côte française des Somali. Quant aux Britanniques, ils s’emparent du Nord et du Jubaland et y établissent un autre protectorat : le British Somaliland. En 1940, les forces italiennes parviennent à conquérir ce British Somaliland.

La décolonisation arrive en 1960. Le Somaliland accède à l’indépendance le 26 juin. La Somalie italienne s’affranchit le 1er juillet. Le lendemain, Somaliland et Somalia fusionnent pour former la République de Somalie. Djibouti ne devient indépendant qu’en 1977. La présence européenne dans la région n’a guère été calme. Entre 1900 et 1920, Londres a lancé une série de campagnes militaires contre des chefs tribaux ou claniques insurgés. L’un des plus célèbres de ces rebelles indigènes commande les « Derviches ».


Surnommé le « Mollah fou », Mohamed Abdullah Hassan (vers 1856 – 1920) (illustration) combat autant les Italiens que les Britanniques au nom du Djihad. Dans des conditions éprouvantes, les soldats de Sa Gracieuse Majesté créent une unité spécialisée utilisant des dromadaires, le Somaliland Camel Corps. Ces tensions extrêmes s’inscrivent dans la vaste agitation régionale due au soulèvement mahdiste soudanais de Mohamed Ahmad ibn Abdallah Al-Mahdi entre 1881 et 1900.
Son émancipation permet au Somaliland de bénéficier d’une quiétude certaine. Bien que reposant sur la charia, le régime présidentiel pratique un certain multipartisme. La chambre basse somalilandaise compte trois formations politiques : le parti Kulmaye de la paix, de l’unité et du développement d’orientation sociale-libérale, le Parti national du Somaliland plutôt populiste et national-musulman, et les sociaux-démocrates du Parti de la Justice et de la Providence. Le pays a déjà connu cinq chefs d’État.
La République fédérale de Somalie continue cependant à revendiquer le Somaliland et reçoit le soutien officiel de la soi-disant « communauté internationale ». C’est plus compliqué en réalité, car si aucune ambassade étrangère n’est présente au Somaliland, divers États coopèrent avec les autorités somalilandaises. Par exemple, l’Éthiopie, qui ne dispose plus de littoral, a fait du port somalilandais de Berbera son débouché maritime (photo). Son consulat a d’ailleurs le rang d’ambassade informelle.

L’Union dite européenne, l’Afrique du Sud, Djibouti, Taïwan et le Royaume-Uni n’hésitent plus à travailler avec cet État-fantôme. Londres sait que le Pays de Galles compte une importante communauté d’origine somalilandaise. Les Brexiters nationaux-mondialistes d’UKIP ont même exigé que le gouvernement britannique reconnaisse le Somaliland.
L’Éthiopie, Djibouti, le Kenya et l’Afrique du Sud acceptent le passeport somalilandais. Mieux, en février 2017, les Émirats arabes unis s’engagent auprès du gouvernement somalilandais à moderniser les infrastructures portuaires de Berbera. En échange, les Émiratis disposent à proximité d’une base militaire. L’État d’Israël s’intéresse aussi à cet État situé en face d’un Yémen en pleine décrépitude.
Le Somaliland fait désormais figure de « Suisse régionale ». La Somalie perdure dans la précarité institutionnelle et sécuritaire. L’Éthiopie traverse une période de guerre civile féroce. Quant à Djibouti, sa stabilité repose surtout sur le maintien sur son sol de forces françaises, étatsuniennes, chinoises, allemandes, italiennes, japonaises et espagnoles. La réussite somalilandaise a suscité en août 1995 le réveil autonomiste de la province somalienne voisine du Puntland. La région frontalière de Maakhir cherche à se rapprocher du Puntland aux dépens de Hargeisa. Des velléités indépendantistes, autonomistes ou régionalistes parcourent les six régions du Somaliland, en particulier l’Awdal à l’Ouest, le Soul, le Sanaag et l’Ayn à l’Est. Le Puntland et l'État autonome somalien de Khatumo revendiquent, en partie ou non, ces trois territoires, d’où des frictions frontalières fréquentes.
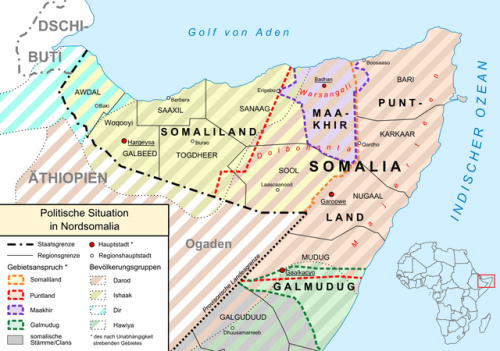
Pourquoi le Somaliland n’a-t-il toujours pas d’existence diplomatique reconnue ? Son existence effective contrevient au dogme occidental, répété par l’Union africaine, de l’intangibilité des frontières étatiques. Ce dogme ne cesse de pervertir les relations internationales. Or le Somaliland paraît bien plus fiable que des narco-États africains en faillite totale. Il serait donc temps que les chancelleries le comprennent et l’acceptent enfin.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 82, mise en ligne le 11 juillet 2023 sur Radio Méridien Zéro.
12:04 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, somaliland, afrique, affaires africaines, politique internationale, corne de l'afrique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 02 juillet 2023
La Russie conservera son influence en Afrique

La Russie conservera son influence en Afrique
Source: https://katehon.com/ru/article/rossiya-sohranit-silovye-rychagi-v-afrike
30.06.2023
Les tentatives occidentales de semer la panique échouent
La mutinerie du 24 juin et les événements qui ont suivi ne concernent pas seulement l'avenir de la Russie, mais aussi celui d'un certain nombre d'autres pays. Les structures de la SMP Wagner vont être réaffectées et reformées. Malgré l'accord de non poursuite, la structure n'existera plus sous sa forme précédente. L'État n'a plus confiance en elle. Toutefois, la question se pose de savoir comment le fonctionnement de la société militaire privée sera compensé en dehors de la Russie.
La sécurité en Afrique
Les formations que les médias ont attribuées à la SMP Wagner, ont joué un rôle positif dans la lutte contre les terroristes en Syrie et le renforcement de la sécurité des alliés africains de la Russie. Il s'agit en premier lieu de la République centrafricaine, où les instructeurs russes du Commonwealth of Officers for International Security (CISO) ont pu vaincre les rebelles qui tentaient de s'emparer de la capitale du pays et pu étendre la zone de contrôle du gouvernement central à 90% du pays, ce qui n'avait jamais été fait auparavant. Il y a actuellement 1890 instructeurs russes en RCA. Plus tôt, les autorités centrafricaines ont soumis une demande pour 3000 personnes supplémentaires.
Le nombre d'instructeurs russes au Mali est estimé à 300. Ces deux pays sont importants pour les intérêts russes. Ces pays africains disposent de riches réserves d'or (Mali), de diamants, d'uranium et de pétrole (RCA). Tous deux montrent une volonté de s'engager aux côtés de la Russie dans la lutte contre le colonialisme et pour un monde multipolaire; dans les deux cas, la Russie peut (et a) démontré son efficacité dans la lutte contre le terrorisme et les groupes rebelles.
En outre, c'est la structure de la SMP Wagner qui a précédemment soutenu l'armée du maréchal Khalifa Haftar en Libye, tenté de prendre pied au Mozambique, opéré au Soudan et manifesté de l'intérêt pour d'autres pays africains.

"Un vide de pouvoir" ?
Si la rébellion de la SMP Wagner, et la restructuration subséquente de cette formation, affectent la gestion des opérations au Mali et en RCA, les conséquences se feront sentir sur l'ensemble de la politique russe en Afrique. Les experts occidentaux estiment que la situation est favorable à l'expansion de l'influence américaine au sud du Sahara. Les dirigeants africains seront contraints de se tourner vers les États-Unis, la France et le Royaume-Uni pour obtenir de l'aide contre les terroristes et les insurgés. Il n'est pas impossible que la Turquie, où il existe une SMP islamique, le SADAT, tente d'occuper de nouvelles positions.
Les médias occidentaux anticipent une "vacance du pouvoir" qui pourrait émerger en Afrique. Certains médias ont émis l'hypothèse que des SMP chinoises pourraient remplacer les Russes en Afrique. En réalité, il s'agit d'une provocation de l'Occident visant à opposer Moscou et Pékin. Les SMP chinoises ne fonctionnent pas comme les conseillers militaires russes. Ils ne peuvent être remplacés que par du personnel militaire régulier de la Russie elle-même, par des SMP rebaptisées et restructurées, ou par du personnel militaire régulier d'autres pays ayant l'expérience du travail avec des troupes dans la région. En premier lieu, les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France.
La Russie conserve son influence
Toutefois, selon le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, les instructeurs russes continueront à travailler au Mali et en RCA. A la veille du Forum Russie-Afrique prévu fin juillet, Moscou doit faire preuve de force, de capacité à résoudre ses crises internes (sinon on se demande comment elle peut résoudre les crises à l'extérieur) et en même temps maintenir le potentiel de puissance qui a assuré la projection de puissance et l'exportation de la sécurité en Afrique.
Il convient de noter que toutes les dispositions en vertu desquelles les militaires russes sont présents en Afrique sont prises et soutenues par l'État russe.
"Outre les relations avec les SMP, les gouvernements de la RCA et du Mali ont des contacts officiels avec les dirigeants russes. À leur demande, plusieurs centaines de soldats travaillent en RCA en tant qu'instructeurs. Ce travail se poursuivra", a déclaré Sergueï Lavrov dans une interview accordée à RT.
Cette information a également été confirmée par le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Selon lui, la Russie poursuivra sa coopération militaire avec la République centrafricaine et le nombre de conseillers militaires sera aussi important que nécessaire.

Le nombre de militaires russes travaillant en Afrique - via des SMP ou via l'État - ne dépasse pas quelques milliers de personnes. Cependant, l'effet politique positif de leurs activités est énorme. Par conséquent, si vous le souhaitez, d'autres SMP russes ou le ministère de la défense peuvent remplacer les "wagnériens", sans détourner des ressources importantes de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Il est possible qu'une entente soit trouvée avec les unités des SMP "sur le terrain" qui, se trouvant en Afrique, n'ont pu participer à l'insurrection. D'autant plus qu'elles utilisent officiellement d'autres dénominations.
Théoriquement, il pourrait y avoir des problèmes pour Khalifa Haftar en Libye, car Moscou, officiellement, n'a pas signé d'accords de soutien militaire avec lui et préfère communiquer avec tous les centres de pouvoir de ce pays, divisé depuis 2011, après l'intervention militaire de l'OTAN et le renversement de Mouammar Kadhafi.
Une chance pour le Belarus ?
Il est encore prématuré de dire si la Biélorussie, où le chef de la SMP Wagner s'est installé, aura la capacité et la volonté d'utiliser son savoir-faire, ses relations et son expérience pour agir sur le continent africain. Toutefois, le potentiel du Belarus en Afrique ne doit pas être sous-estimé. Le Belarus est actif sur le continent et entretient des liens étroits avec le Zimbabwe et le Soudan, auxquels il fournit des armes et des produits agricoles.
Lors de l'insurrection du 24 juillet, le président biélorusse Alexandre Loukachenko a montré que le Belarus était un exportateur de sécurité en Eurasie. Cela renforce la position de Minsk en Afrique et sur la scène mondiale en général. Théoriquement, le Belarus pourrait renforcer sa capacité et résoudre le problème d'une éventuelle vacance du pouvoir pour Moscou en intégrant ce que l'on appelait autrefois la SMP Wagner dans sa composante de force et sa stratégie pour le continent africain et en l'alignant sur Moscou au niveau de l'État de l'Union. Ce dernier point pourrait résoudre le problème de la responsabilité et de la contrôlabilité de l'unité.
11:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociétés militaires privées, milice wagner, russie, biélorussie, afrique, centrafrique, mali, europe, affaires européennes, affaires africaines, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 25 juin 2023
Mensonges à propos de l'Afrique: histoire non fictive de la traite des esclaves
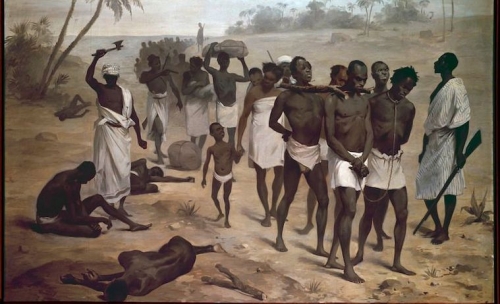
Mensonges à propos de l'Afrique: histoire non fictive de la traite des esclaves
Par Francesco Borgonovo
Source: https://www.ilprimatonazionale.it/cultura/bufale-africa-tratta-degli-schiavi-114859/
Cet article, qui démonte les canulars historiques qui circulent sur la traite des esclaves africains, a été publié dans Il Primato nazionale d'août 2018.
En 2016, la chaîne History Channel a réalisé un remake de la série télévisée Roots, qui a également été diffusée sur Rete 4 en mai dernier. La production mettait en scène des célébrités telles que Forest Whitaker, Anna Paquin, Laurence Fishburne et Jonathan Rhys Meyers. L'histoire est bien connue : Roots met en scène l'épopée de Kunta Kinte (interprété par Malachi Kirby), un guerrier africain mandingue réduit en esclavage et transporté en Virginie, où il finit par travailler dans une plantation. La nouvelle version de cette saga familiale noire est très bien filmée et franchement crue : l'horreur de l'esclavage y est montrée dans ses moindres détails. En effet, le but de la série est de rappeler les horribles souffrances que les Noirs américains ont dû subir de la part de l'homme blanc.
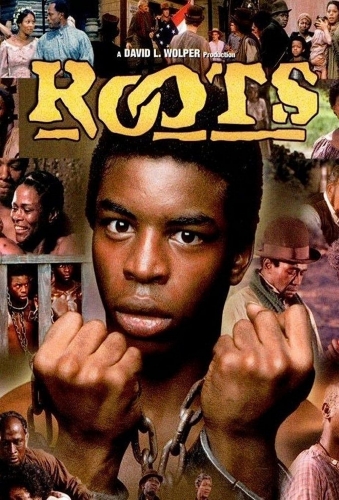
"L'esclavage n'a pas été éradiqué de cette planète", commente l'acteur LeVar Burton (qui a incarné Kunta Kinte dans les années 1970). "Il existe de nouvelles formes d'esclavage, de nouveaux murs, de nouvelles chaînes, de nouveaux corps jetés à la mer. C'est pourquoi nous avons décidé de présenter à nouveau l'histoire de Roots". L'esclavage est un thème qui a fait fureur ces dernières années, notamment depuis la première candidature de Barack Obama à l'élection présidentielle.
L'antiracisme américain
Le climat intellectuel en Occident est fertile: des mouvements comme Black Lives Matter font rage aux États-Unis; l'explosion des flux migratoires à l'échelle mondiale a soulevé des discussions sans fin sur le racisme généralisé, et l'intelligentsia a réagi en proposant des films, des séries et des livres sur le sujet. Ces dernières années ont vu la sortie de films tels que The Birth of a Nation de Nate Parker, consacré à la rébellion de l'esclave Nat Turner.
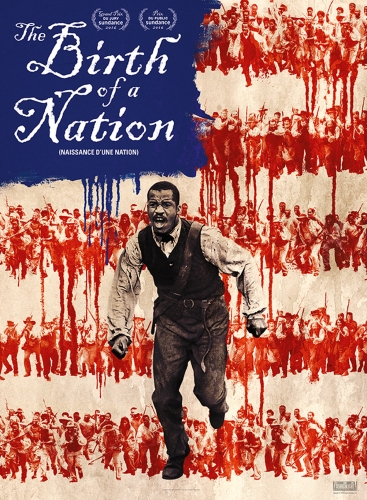
Peu avant, c'était au tour de Free State of Jones avec Matthew McConaughey, inspiré du livre de Victoria E. Bynum: il raconte l'histoire d'un hors-la-loi blanc qui, dans le Sud des États-Unis, s'oppose à l'esclavage et à la ségrégation. Mais dans la librairie, on trouve aussi les essais de Ta-Nehisi Coates sur le racisme, les bandes dessinées du super-héros Black Panther (dont a été tiré un autre long métrage célèbre) également scénarisées par Coates avec la même approche idéologique. Et puis le roman sur l'esclavage de Marlon James et un millier d'autres volumes du même acabit.
Le thème de l'esclavage
est un thème très populaire aujourd'hui et
populaire aujourd'hui et a été
traité dans divers films
et œuvres littéraires
Tous ces récits, cependant, manquent quelque chose. Il y a toujours un aspect de l'histoire qui est négligé, éclipsé ou simplement censuré pour ne pas contrarier la version officielle, qui doit être le suivant: les Occidentaux blancs sont racistes jusqu'à la moelle. Ils l'étaient à l'époque des colonies et le sont encore aujourd'hui, car ils discriminent les minorités et n'accueillent pas les immigrants: ils sont afrophobes, islamophobes, xénophobes, etc. Les documents historiques, cependant, racontent autre chose. Ils expliquent que l'esclavage et le racisme n'ont pas été l'apanage des seuls Blancs européens et américains, bien au contraire.
Le rôle de l'islam
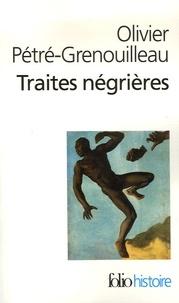 Selon l'historien français Olivier Pétré-Grenouilleau, auteur de l'ouvrage de fond Traites négrières (paru en Italie aux éditions Il Mulino), la traite des Noirs telle que nous la connaissons coïncide historiquement avec l'expansion musulmane autour du 7ème siècle de notre ère. "C'est un fait", écrit le professeur. "Personne ne peut dire si la traite aurait pu se développer plus tard, sans ce début, et le problème en lui-même n'a pas d'intérêt. Le monde musulman, en revanche, ne s'est certainement pas contenté de recruter des esclaves noirs. Tout au long de son histoire, il a aussi largement puisé dans les pays slaves, le Caucase et l'Asie centrale". À partir du 7ème siècle, "le djihad et l'établissement d'un empire musulman de plus en plus étendu ont entraîné une augmentation considérable de la main-d'œuvre servile".
Selon l'historien français Olivier Pétré-Grenouilleau, auteur de l'ouvrage de fond Traites négrières (paru en Italie aux éditions Il Mulino), la traite des Noirs telle que nous la connaissons coïncide historiquement avec l'expansion musulmane autour du 7ème siècle de notre ère. "C'est un fait", écrit le professeur. "Personne ne peut dire si la traite aurait pu se développer plus tard, sans ce début, et le problème en lui-même n'a pas d'intérêt. Le monde musulman, en revanche, ne s'est certainement pas contenté de recruter des esclaves noirs. Tout au long de son histoire, il a aussi largement puisé dans les pays slaves, le Caucase et l'Asie centrale". À partir du 7ème siècle, "le djihad et l'établissement d'un empire musulman de plus en plus étendu ont entraîné une augmentation considérable de la main-d'œuvre servile".
Cela s'est produit dans le monde islamique pour deux raisons: "La première est que l'esclavage y existait déjà en tant qu'institution commune et bien établie. La seconde est qu'il était devenu impossible de se procurer des esclaves à l'intérieur de l'empire". Ce sont donc les musulmans qui ont lancé le commerce mondialisé des esclaves noirs. Ne pouvant réduire en esclavage les hommes et les femmes vivant dans les territoires soumis à la loi islamique, ils avaient besoin d'étendre leur emprise le plus loin possible.
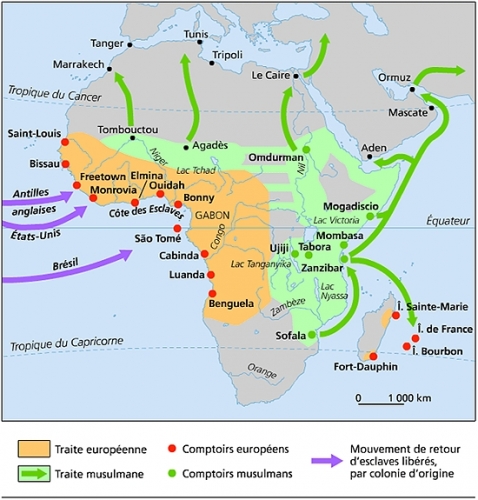
Les populations africaines progressivement soumises ont fait le reste (y compris celles déjà christianisées). Obligées de payer un tribut à l'empire musulman, même sous forme d'hommes, elles s'enfoncent de plus en plus profondément dans le continent noir pour se procurer de la marchandise humaine destinée à la traite. Il n'y a pas de quoi s'étonner : aujourd'hui encore, les prédicateurs de l'État islamique théorisent l'esclavage en s'appuyant sur des textes sacrés et menacent les infidèles occidentaux de les réduire à l'état de bêtes de somme.
Selon l'historien français
Olivier Pétré-Grenouilleau
la traite des Noirs
coïncide avec l'expansion
de l'islam au 7ème siècle
Un autre aspect est à prendre en considération: il concerne plus directement la naissance de la discrimination et du racisme. C'est avec l'expansion islamique et le développement de la traite que, comme le dit Pétré-Grenouilleau, "l'image de l'homme noir" change. Presque tous les peuples de l'Antiquité ont pratiqué l'esclavage, mais l'homme noir n'a jamais été considéré comme un être inférieur à tout point de vue en raison de sa couleur. Cependant, "les trajectoires vers le monde musulman et le racisme envers les Noirs se sont développés simultanément".
L'islam a pu créer une véritable civilisation universelle, comme l'explique l'historien Bernard Lewis. Les Arabes, en tant que souverains, se sont positionnés au centre de cet univers et ont commencé à définir les autres peuples en fonction de leur proximité. Les peuples à la peau foncée, les Noirs en particulier, se sont ainsi vu attribuer "une connotation d'infériorité". Des stéréotypes négatifs, on est passé au racisme pur et simple, puisqu'il est devenu courant de voir des Noirs réduits en esclavage dans l'empire musulman. Noir et esclave sont alors devenus synonymes. Il existe de nombreux textes, datant de différentes périodes (entre le 8ème et le 14ème siècle), dans lesquels les érudits islamiques décrivent les Africains à la peau foncée comme semblables à des animaux ou autrement inférieurs. Le grand historien Ibn Khaldoun, par exemple, a écrit que "les nations nègres sont en règle générale dociles à l'esclavage, parce que les Nègres ont peu de ce qui est essentiellement humain". Avec l'expansion de l'islam au cœur du continent africain, il est même devenu nécessaire de lancer une sorte de campagne contre cette conception des Noirs, même si les musulmans africains ont longtemps continué à être considérés comme différents des autres croyants disséminés sur le globe.
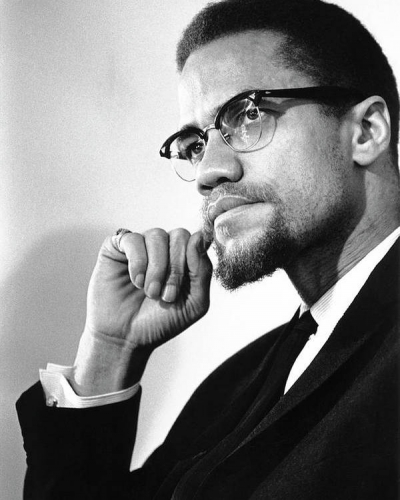
Les maladresses de Malcolm X
Il est donc assez curieux que l'islam se soit répandu dans les ghettos noirs d'Amérique en se présentant comme la religion des opprimés, comme la seule voie de rédemption pour les "nègres". C'est ainsi que Malcolm X et les autres représentants de la Nation of Islam, c'est-à-dire les activistes qui n'hésitaient pas à affirmer: "L'homme blanc est le diable". C'est Malcolm X qui s'est insurgé contre les écoles blanches qui ignoraient l'histoire de l'Afrique. "En détestant l'Afrique et les Africains", affirmait-il, "nous avons fini par nous détester nous-mêmes". Peut-être n'avait-il pas lu les textes d'Ibn Khaldoun...
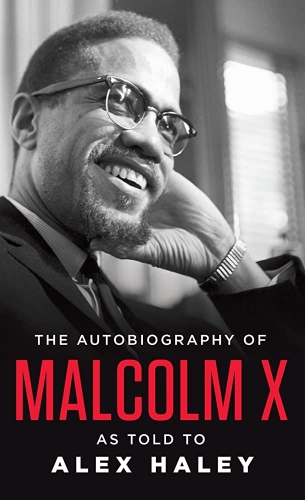
Aujourd'hui, l'Autobiographie de Malcolm X est publiée en Italie par Rizzoli et continue d'être réimprimée. Elle est présentée comme "l'histoire d'un leader charismatique à la pointe de la lutte contre les injustices qui divisent le Nord et le Sud", presque comme s'il s'agissait d'une sorte de dame de charité tiers-mondiste. Cette autobiographie a été écrite par Alex Haley, l'auteur de Roots. Ce dernier a longtemps fréquenté le X, et c'est dans cet environnement radical que la saga de Kunta Kinte a pris forme. Il s'agit, au sens plein, d'une opération idéologique, visant à créer un texte fondateur de la fierté noire et à exciter les esprits contre les Blancs, coupables d'avoir bâti une nation sur le racisme.
Le rôle des Africains
Tout le monde sait que dans les plantations de tabac, puis de coton, les esclaves ont été utilisés à grande échelle. Et il est certain que la "traite atlantique" a entraîné l'intensification du commerce d'êtres humains de l'Afrique vers les États-Unis. Mais les peuples africains, qui pratiquaient déjà ce commerce depuis l'époque de l'empire musulman, y ont largement contribué. Et ils l'ont fait non seulement en procurant des prisonniers pour les vendre aux Américains, mais aussi en les fournissant aux Européens pendant des siècles. C'est ce qu'a raconté, entre autres, le célèbre journaliste David Van Reybrouck dans son best-seller Congo.
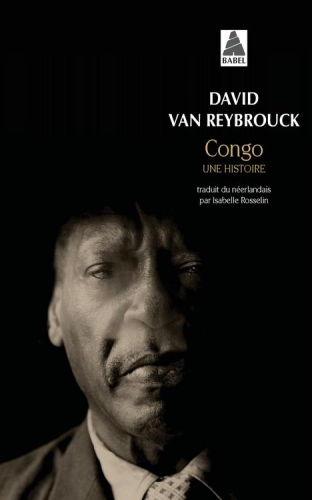
L'historien Matthew Restall, quant à lui, a documenté comment les Africains noirs - esclaves mais aussi libres - ont rejoint les Espagnols lors de l'invasion de l'Amérique latine et de l'extermination manu militari des indigènes.
Les mêmes populations
Les populations africaines ont elles-mêmes contribué
à la vente d'esclaves
pour être envoyés en Amérique
On ne sait pourquoi, mais cet aspect de l'histoire de l'esclavage est toujours passé sous silence, pour laisser la place aux méfaits des Blancs occidentaux. Ce sont ces derniers qui font la une des films et des séries télévisées en vogue aujourd'hui. C'est pourquoi il vaut la peine de connaître pleinement la réalité.
Lisez aussi : Il n'y a pas que les Européens : les Africains sont aussi responsables de la traite des esclaves
En ce qui concerne Roots, outre le climat idéologique dans lequel la saga a été écrite, il convient de rappeler quelques autres détails. À l'époque de sa sortie, le roman de Haley (qui a remporté le Pulitzer) a été présenté comme le résultat d'une recherche historique minutieuse. L'écrivain expliquait qu'il avait reconstitué l'arbre généalogique complet de Kunta Kinte et de ses descendants à partir d'une série d'histoires que lui avait racontées sa grand-mère. Or, au début des années 1990, un journaliste d'investigation du Village Voice, Philip Nobile, a démontré que le personnage de Kunta Kinte n'avait en fait jamais existé. Il s'agissait d'une invention littéraire. Haley avait écrit : "À ma connaissance et en toute bonne foi, je déclare que tous les récits de ma lignée contenus dans Roots proviennent de l'histoire orale, soigneusement transmise par ma famille africaine ou américaine, histoire que j'ai pu, dans de nombreux cas, confirmer de manière conventionnelle par des documents". Mais les documents trouvés dans ses archives ont prouvé le contraire. Et ce n'est pas tout. En 1978, Haley a été condamné pour plagiat: il avait copié quelque quatre-vingts passages du roman The African de Harold Courlander. Il s'en tire en payant une amende de 650.000 dollars. Mais tout cela n'a pas entamé son prestige. De telles nouvelles circulent sur le web (même la Repubblica en a parlé en 1993). Mais elles sont occultées par une myriade de tirades de célébration bon enfant. Il est probable que s'il avait écrit sur autre chose, Haley serait aujourd'hui considéré comme un demi-fou. Au lieu de cela, il est un héros, et son travail nous est toujours présenté comme historiquement exact.
Francesco Borgonovo.
12:54 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, esclavage, afrique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 18 juin 2023
Le Sénégal sous tension

Le Sénégal sous tension
par Georges FELTIN-TRACOL
En janvier 2023, Marine Le Pen effectuait une tournée en Afrique francophone. La présidente du groupe RN au Palais-Bourbon rencontra dans la plus grande discrétion le président du Sénégal, Macky Sall (photo). À cette occasion, la triple candidate à la présidentielle française estima que le Sénégal devrait recevoir au nom de toute l’Afrique un siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l’ONU.

Il s’agit d’une nouvelle proposition déconcertante qui témoigne de la prégnance d’une mentalité paternaliste néo-coloniale. La caste politicienne hexagonale continue à voir le Sénégal en prolongement de la «Françafrique». Certes, Saint-Louis a été une commune française. Le socialiste Blaise Diagne fut le premier Africain à exercer en 1931 – 1932 les fonctions de sous-secrétaire d’État aux Colonies. Léopold Sédar Senghor fut le premier Africain agrégé en grammaire française.
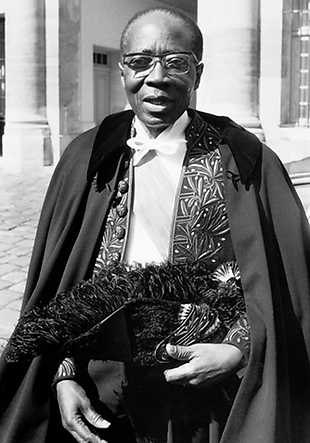
Vu de Paris, le Sénégal serait un bel exemple de stabilité démocratique sur le continent africain. La réalité est moins féerique. Le 17 décembre 1962, Dakar connaît une tentative de coup d’État. Le président Sédar Senghor (photo) conserve néanmoins le pouvoir et passe à un régime présidentiel si bien que depuis son indépendance en 1960, le Sénégal n’a eu que quatre chefs d’État: Sédar Senghor, Abdou Diouf, Abdoulaye Wade et Macky Sall. La constitution sénégalaise a été plusieurs fois révisée (suppression, puis restauration du Sénat, puis abolition de cette assemblée; fin du septennat au profit du quinquennat, retour au septennat, rétablissement du quinquennat; suspension de la charge de Premier ministre de 1962 à 1970, de 1983 à 1991 et de 2019 à 2022). On oublie en outre qu’entre 1982 et 2001, la région méridionale de la Casamance fut le théâtre d’une sécession armée orchestrée par le Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC) de l’abbé Augustin Diamacoune Senghor (photo).
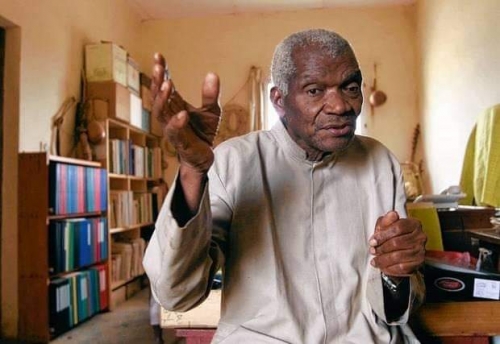
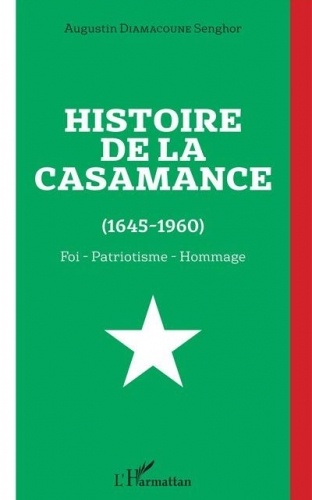
Depuis environ deux ans, la rue sénégalaise est le théâtre d’émeutes meurtrières sporadiques (une quinzaine de morts en février 2021, treize morts en avril 2021, une vingtaine de morts au début de ce mois de juin). Ces affrontements résultent d’une cristallisation des crises institutionnelle, politique, sociale et économique.
Une part non négligeable de la population, dont de nombreux jeunes paupérisés et/ou précarisés, exprime son mécontentement envers l’actuel président libéral. Élu en 2012, Macky Sall est reconduit le 24 février 2019 dès le premier tour avec 58,26 % des suffrages. Dans la perspective de la présidentielle de 2024, il aurait l’intention de se représenter pour un troisième mandat, ce qu’interdit la constitution. Mais le référendum constitutionnel du 20 mars 2016 a aboli le septennat au profit du quinquennat. Ses partisans considèrent que l’interdiction ne s’applique qu’à deux quinquennats consécutifs… Les experts en droit constitutionnel se divisent en revanche sur ce point très précis. Il y a un paradoxe. En 2012, Macky Sall contestait un troisième mandat pour Abdoulaye Wade qui renonça finalement à se représenter.

Les incidents tournent aussi autour des condamnations judiciaires d’Ousmane Sonko (photo) qui a, lui aussi, l’intention de briguer la magistrature suprême l’année prochaine. Né en 1974, cet ancien étudiant à Lyon – III sort major de sa promotion à l’ÉNA de Dakar en 2001. Il opte pour l’Inspection des impôts et des domaines. En 2005, il fonde et préside le Syndicat autonome des agents des impôts et des domaines. Le gouvernement le révoque en 2016 quand il commence à accuser les autorités de corruption. Il conspue les malversations du pouvoir et de ses obligés qui détourneraient les ressources naturelles du pays.

En 2014, Ousmane Sonko lance une nouvelle force politique appelée PASTEF (Patriotes africains du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité). D’orientation sociale-populiste, ce mouvement s’inscrit dans une forme de chavisme africain bien qu’un des précurseurs d’Hugo Chavez fut le Burkinabe Thomas Sankara. Dès 2015, sont ciblées l’influence française, l’OMC et la corruption.
Allié à d’autres formations politiques d’opposition au sein d’une coalition électorale, Ousmane Sonko remporte un seul siège en 2017. En 2019, il devient le troisième homme de la présidentielle avec 15,67 %. En 2022, il accède à la mairie de Ziguinchor en Casamance. La même année, aux législatives, son mouvement intègre l’alliance « Libérer le peuple », rafle 56 sièges sur 165 et empêche l’entente présidentielle d’obtenir la majorité absolue. Ousmane Sonko devient un candidat sérieux à la présidentielle à venir.
Mais le 1er juin dernier, la justice prononce contre lui deux ans de prison ferme pour « corruption de la jeunesse ». Quelques semaines auparavant, un autre tribunal le condamnait à deux mois d’emprisonnement, suite à des propos jugés diffamatoires envers le ministre du Tourisme accusé de corruption. La première sentence, la plus lourde, s’effectue par contumace, ce qui l’empêche de faire appel. Cette double condamnation le rend enfin inéligible, d’où la vive colère de ses soutiens.
Toujours promptes à défendre le premier opprimé médiatique venu, les grandes consciences occidentales se gardent bien de réagir ici. Détracteur du bankstérisme et du gendérisme, Ousmane Sonko est accusé du viol d’une employée d’un salon de massage d’une vingtaine d’années en février 2021. Il l’aurait ensuite menacée. Il justifie sa présence fréquente dans cet établissement pour des raisons de problèmes dorsaux. Porte-parole des « Gilets jaunes », mélenchoniste déçu et pourfendeur implacable du macronisme, de ses métastases et de ses miasmes, Juan Branco est l’un de ses avocats. Des esprits sûrement complotistes crient à une machination ourdie par le pouvoir de Dakar.

La contestation populaire pourrait s’amplifier et se généraliser au Sénégal dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois, surtout si le président sortant choisit de se représenter pour un nouveau mandat. Il deviendrait alors possible que cède un pilier du fameux « pré carré africain » de la République française.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 78, mise en ligne le 13 juin 2023 sur Radio Méridien Zéro.
12:08 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, sénégal, afrique, affaires africaines, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 mai 2023
Mayotte en ébullition

Mayotte en ébullition
par Georges FELTIN-TRACOL
Située au nord-est du canal du Mozambique entre Madagascar et le continent africain, à l’ouest de l’océan Indien, l’île de Mayotte bénéficie depuis quelques semaines d’une attention médiatique soutenue. La raison de ce regain d’intérêt se nomme l’opération Wuambushu, ce qui signifie en mahorais « reprise », voire « reprise en main ».

Approuvée lors d’un conseil de défense tenu à l’Élysée, cette opération doit démanteler plusieurs bidonvilles, appelés « bangas », restaurer l’ordre public et contenir les ravages d’une immigration illégale incontrôlée. L’île tropicale cumule toutes les pathologies sociales du moment. Les statistiques de l’INSEE expliquent que la moitié de la population mahoraise a moins de 17 ans, que 77 % des habitants de Mayotte vivent en dessous du seuil de pauvreté, que 67 % des 15 – 64 ans n’ont pas d’emplois, que 30 % des ménages ne disposent pas de l’eau courante et que 40 % des 60.000 logements sont indignes et sans électricité domestique. Désert médical, le territoire se sent abandonné de Paris. Ces conditions difficiles font de Mayotte le département le plus pauvre de France. Elles n’arrêtent pas les flots incessants d’immigrés clandestins plus pauvres encore. 48 % des 310.000 habitants sont d’origine étrangère. De nombreuses migrantes font exprès d’accoucher à Mayotte en sachant qu’elles seront ensuite non expulsables parce que leurs progénitures seront supposées françaises. Si de nombreuses maternités ferment dans la France périphérique, ce n’est pas le cas à Mayotte où elles sont complètes. Le système scolaire est lui aussi saturé avec des élèves étrangers illettrés qui ignorent tout d’une journée d’élève français. Il est fréquent que les classes de l’enseignement primaire accueillent des adolescents de 15 – 16 ans… L’INSEE estime par ailleurs que 55 % de la population de Mayotte parvient à maîtriser le français. S’ajoute enfin une tension permanente avec le voisin comorien.
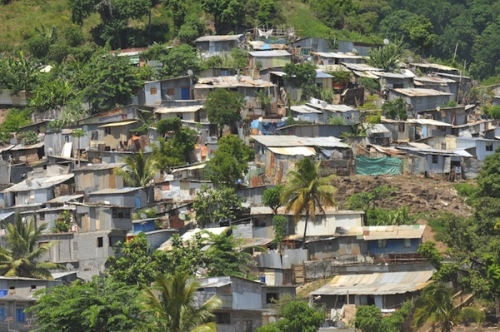
D’un point de vue géographique, ethnique et historique, Mayotte appartient à l’archipel des Comores. Possession française depuis le milieu du XIXe siècle, l’archipel réclame dans les années 1960 – 1970 son indépendance. En décembre 1974 se déroule un référendum d’autodétermination. Si trois îles (Grande-Comore, Mohéli et Anjouan) choisissent l’indépendance, Mayotte préfère à 63,8 % de rester un territoire français. En février 1976, un nouveau référendum confirme à 99,4 % et 82,8 % des inscrits l’attachement de l’île à la République française. Le gouvernement comorien revendique immédiatement Mayotte. Le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes s’oppose ici aux critères juridiques d’indivisibilité de l’État et d’intangibilité des frontières. L’ONU s’empare du cas de Mayotte et considère l’île comme une terre à décoloniser. Paris use alors de son droit de veto.
Jusqu’en 2011, Mayotte bénéficie d’un statut ultra-marin spécifique. Les Mahorais sont en majorité musulmans. La charia s’applique dans la vie quotidienne des autochtones. Les cadis (juges musulmans) sont des fonctionnaires d’État. La polygamie, ou pour le moins la bigamie, est autorisée et reconnue. La France soutient massivement l’économie locale balbutiante qui échoue à se développer, faute d’infrastructures suffisantes. En mars 2009, 95 % des Mahorais approuvent leur départementalisation. Deux ans plus tard, Mayotte devient le cent-unième département français. Le droit commun s’étend progressivement et interdit les mariages bigames sans toutefois annuler ceux qui existent déjà. Les aides sociales qui se déversent sur Mayotte aiguisent la convoitise des Comoriens (Anjouan est à 70 km des côtes mahoraises) dont le pays est un État en faillite rongé par une corruption endémique.

Mayotte dispose de beaux atouts touristiques si la pauvreté et l’immigration illégale ne favorisaient pas une insécurité générale. La violence y est permanente. La délinquance pullule. Le taux de cambriolage s’élève à 18%, soit quatre fois plus qu’en Métropole. Quand elles ne dressent pas des barrages sur les routes et rançonnent les automobilistes, les bandes armées de machettes attaquent les bus de ramassage scolaire. Gendarmes et policiers surveillent les entrées et les sorties des écoles, des collèges et des lycées. L’afflux massif de Comoriens et, maintenant, d’Africains de l’Est et de Malgaches perturbe un territoire économiquement et écologiquement fragile. De vastes bidonvilles se répandent dans un territoire de 374 km².

S’estimant chez eux et en butte aux méchants Blancs, des clandestins se mettent à chasser les Européens qu’ils rencontrent. Les Mahorais ripostent en protégeant leurs compatriotes métropolitains. Ils organisent aussi des groupes de vigilants. La détestation entre Mahorais et Comoriens est maximale. Les Mahorais soupçonnent le gouvernement comorien, dont maints membres sont franco-comoriens, de promouvoir une immigration de peuplement. Déjà, un tiers des étrangers serait né sur l’île. Dans quelques années, ils craignent que la France pose un nouveau référendum auquel participeraient sur l’injonction de l’ONU et des Comores tous les résidents de Mayotte, citoyens français ou pas. Les Mahorais rejettent ce grand remplacement insulaire.
Paris n’ignore rien de ces tensions. En 2022, il y aurait eu 25.300 reconduites à la frontière. Or les Comores revendiquent Mayotte et bloquent les expulsions. Le gouvernement comorien considère l’opération Wambushu comme une grave atteinte à la dignité humaine. Il menace de poursuivre la France devant la CPI pour crimes contre l’humanité… Emmanuel Macron sera-t-il inquiété, arrêté et jugé avant Vladimir Poutine ? Ce serait une situation cocasse d’autant que les Comores ont condamné la Russie en mars 2022.
Les associations droits-de-l’hommistes se félicitent de cette réaction. Elles applaudissent la décision du tribunal judiciaire rendue le 25 avril dernier qui suspend la destruction de bangas. Les locaux sont furieux.
La dégradation économique, sociale, migratoire et sécuritaire produit des conséquences politiques. Si la seconde circonscription qui occupe le centre et le sud de l’île est un bastion tenu par Les Républicains, la première circonscription fluctue beaucoup plus. En 2017, cette circonscription envoie au Palais-Bourbon un député La République en marche.

En juin 2022, le candidat macroniste ne recueille que 7,24 % des suffrages. La circonscription revient à Estelle Youssouffa qui bat à 66,6 % au second tour un sans-étiquette. Membre du fameux groupe parlementaire LIOT (Libertés, indépendants, outre-mer et territoires), cette figure mahoraise des « Gilets jaunes » en 2018 – 2019 perturbe un discours d’Emmanuel Macron en visite sur l’île. Poursuivie pour rébellion, elle est finalement relaxée en septembre 2021. Elle vient d’adhérer à l’UDI (Union des démocrates et indépendants) présidée par le sénateur des Hauts-de-Seine Hervé Marseille. Elle qui pourfend la colonisation comorienne de fait de Mayotte, exige la fin de toute coopération avec les Comores et se bat pour un meilleur accès à l’eau. Elle aurait pu rallier le CNIP (Centre national des indépendants et paysans).
Née en 1978 dans les Hauts-de-Seine, d’un père militaire mahorais et d’une mère métropolitaine infirmière, Estelle Youssouffa suit au Québec des études en questions militaires et stratégiques et devient journaliste pour LCI, TV5 Monde, BFM TV et la branche anglophone d’Al Jazeera. Victor Boiteau dresse son portrait en dernière page de Libération du 24 août 2022. On y apprend qu’« en 2011, elle est sélectionnée pour le programme Young Leaders de la French American Foundation » où elle y côtoie diverses personnalités prometteuses dont Édouard Philippe.
À titre personnel, on peut souhaiter le retrait de la France d’une partie non négligeable de son outre-mer qui accéderait enfin à une entière souveraineté. La réalité politique oblige néanmoins de prendre en compte la volonté farouche des Mahorais de demeurer français. Le responsable néo-maurrassien de la Restauration nationale, Pierre Pujo, défendait avec ardeur dans Aspects de la France le maintien de Mayotte dans le giron français. Le centralisme bureaucratique de la Grande-Comore indispose les deux autres îles qui se révoltent en 1997. Anjouan proclame son indépendance le 3 août. Le 5, c’est au tour de Mohéli. Très vite, Anjouan réclame son rattachement à la France. Membre éminent du Front national, Jean-Claude Martinez, en « alter-nationaliste » convaincu, y voit la genèse d’un nouvel ensemble français ultra-marin. La crise s’achève en 2001 avec la formation de l’Union fédérale des Comores. L’attraction de Mayotte s’accentue encore.

Une simple opération de police ne va pas résoudre les problèmes structurels de Mayotte. La remise en ordre effective nécessiterait la proclamation de l’état de siège, l’instauration d’un couvre-feu draconien, le déploiement d’unités de l’armée, la rupture des relations diplomatiques avec les Comores, la fin du versement des aides pour le développement, un engagement militaire aux Comores afin de constituer des zones de regroupement des expulsés de Mayotte et l’établissement d’un gouvernement provisoire pro-français. Celui-ci devrait alors imposer la politique obligatoire de l’enfant unique et solliciter le Planning familial qui aurait enfin une occasion justifiée d’exercer à bon escient ses méthodes anti-natalistes. Membre permanent du Conseil de sécurité et puissance nucléaire, la France peut se permettre cette politique du fait accompli. Elle devra simplement accepter les critiques de Washington, de Moscou, de Londres, de Pékin et de Riyad. Il faudra peut-être envisager la vive réaction de certains quartiers de Marseille, car la cité phocéenne est la première ville comorienne au monde. Le recours à l’état d’urgence réglerait cette agitation momentanée.
Pire que la Guyane et la Seine – Saint-Denis, la situation actuelle à Mayotte préfigure ce que vivra la Métropole dans deux à trois décennies. L’opération Wambushu n’est qu’un coup d’épée dans l’eau. S’affranchir de l’ignominieux État de droit serait la solution qui est, pour l’instant, impossible à réaliser par crainte de lamentables verrous psycho-historiques.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 72, mise en ligne le 2 mai 2023 sur Radio Méridien Zéro.
17:41 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mayotte, comores, afrique, affaires africaines, océan indien |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 07 avril 2023
Pourquoi lire Wilbur Smith?
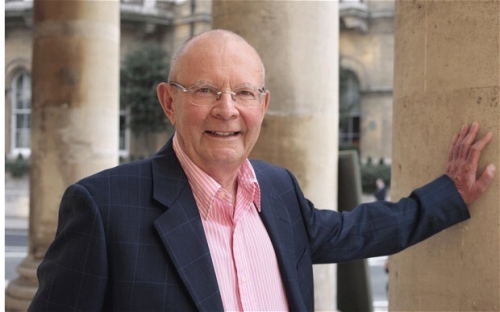
Pourquoi lire Wilbur Smith?
Source: https://www.bloccostudentesco.org/2023/02/17/bs-perche-leggere-wilbur-smith/
par Cippa
Si, comme moi, vous avez à peine vu l'Afrique en photo, vous devez vous fier à ceux qui y sont allés pour dire que Wilbur Smith la décrit minutieusement et vous la fait savourer dans ses romans. Il y est né et y a vécu jusqu'à sa mort récente et en a parlé dans ses romans, de l'Égypte ancienne au colonialisme européen. Ce sont des romans d'aventure, mais ils nous donnent une vision et une compréhension profondes de ce continent, qui est un monde vraiment étranger pour nous. Mes rencontres avec un homme qui a versé son sang sur cette terre m'ont confirmé que les sensations que l'on éprouve en lisant ces romans sont un avant-goût, un amuse-gueule des expériences réelles vécues là-bas par ceux qui n'y sont jamais allés. Pour ceux qui, comme lui, ont arrosé son sol de sang vermeil, ce sont des photographies d'un passé tumultueux.
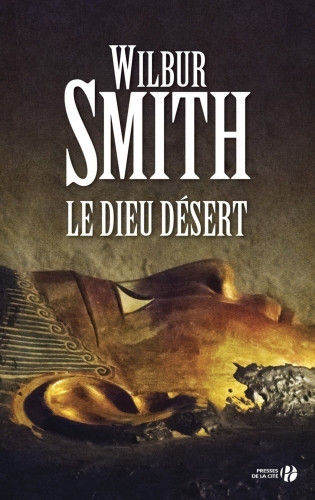
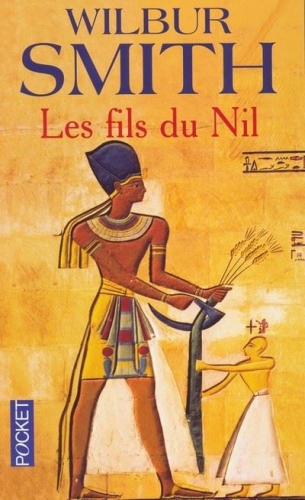
Connaître l'histoire de l'Afrique, c'est aussi connaître l'histoire de l'Europe pendant quelques siècles: l'histoire du colonialisme et des aventures qui y ont conduit nos ancêtres. Il ne s'agit pas de romans historiques, mais de traces du passé d'une réalité historique indéniable, de témoignages d'un Anglais né et élevé en Afrique du Sud dans les années 1900, qui a reconstruit un passé et une histoire récente que lui et ses ancêtres ont vécus de première main. À cet égard, je vous recommande les cycles Courteney et Ballantyne, deux familles anglaises parties en Afrique pour la sanglante chasse aux diamants et qui s'y sont installées au milieu de mille péripéties.
Le travail magistral de l'auteur réside également dans la caractérisation des personnages et de leurs relations : par exemple, la symbiose entre les Blancs et les peuples indigènes. Elle peut aider à surmonter certains mensonges du monde moderne sur l'homme blanc en Afrique ; il est nécessaire de comprendre pleinement le lien qui s'est créé entre deux personnes très différentes, qui ont pris une valeur nécessaire l'une envers l'autre afin d'affronter les risques de ce mystérieux et formidable Continent Noir. Il est très important, surtout dans notre environnement, de connaître ces réalités afin d'affronter en toute conscience les accusations qui sont portées contre nous.
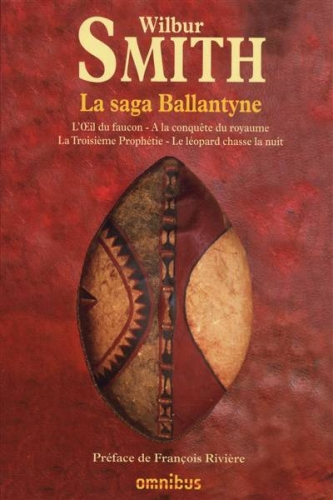
En conclusion, un roman d'aventures peut également être apprécié pour sa valeur en tant que littérature d'évasion. La lecture des romans de Wilbur Smith est un grand passe-temps : on est fasciné aussi bien par la narration chargée de pathos que par la description placide des moments calmes de la vie quotidienne, des navigations tumultueuses aux récits mystérieux d'une spiritualité et d'une magie si éloignées de nous. Par rapport à de nombreux textes peu profonds qui relèvent du genre, notamment dans la littérature de consommation qui s'est récemment dépeuplée pour des raisons évidentes, notre auteur fait voyager notre esprit avec efficacité et une habileté surprenante, nous gardant accrochés, chapitre après chapitre, à ses lignes.
23:15 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : wilbur smith, littérature, littérature anglaise, lettres, lettres anglaises, afrique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 26 mars 2023
La Tunisie contre le Grand Remplacement

La Tunisie contre le Grand Remplacement
par Georges FELTIN-TRACOL
Créée en novembre 1942 et dissoute en mai 1943, la Phalange africaine fut un mouvement éphémère qui défendait les acquis de la Révolution nationale en Afrique française du Nord. Elle participa à la bataille de Tunisie aux côtés de l’Afrika Korps. Huit décennies plus tard, son spectre hanterait-il les couloirs du palais présidentiel de Carthage ?
Le 21 février 2023, à l’occasion d’une réunion du Conseil de sécurité nationale, le président tunisien Kaïs Saïed a suscité un effroi planétaire occidentalo-centré. Il ordonnait des « mesures urgentes […] pour faire face à l’arrivée en Tunisie d’un grand nombre de migrants clandestins en provenance d’Afrique subsaharienne ». Par sa position géographique, son pays se situe à proximité de l’île italienne de Lampedusa et de l’Union dite européenne.
La combinaison infernale des politiques d’austérité économique du FMI, de pillage systématique des ressources naturelles par les Occidentaux (dont les Français) et de kleptocratie durablement installée déstabilisent des sociétés africaines déjà en proie à une surnatalité et aux violences ethno-tribales dans le cadre de frontières artificielles absurdes. Tous ces méfaits structurels incitent les Africains à tenter de se rendre en Europe et, par conséquent, à passer par la Tunisie plus sûre que la Libye en pleine guerre civile.
Le président Kaïs Saïed estime que ces flux migratoires clandestins « veulent changer la composition de la démographie tunisienne. C’est un complot pour s’attaquer à l’État, au peuple et à l’identité tunisienne ». Il ajoute qu’il s’agit « d’une entreprise criminelle ourdie à l’orée de ce siècle ». Ainsi considère-t-il qu’une menace grave pèse sur le « caractère arabe et musulman de la Tunisie ». Renaud Camus, sors de ce corps !

Les remarques présidentielles ont déclenché l’indignation de la médiasphère bien-pensante qui parle de « complotisme » et de « racisme ». Instance prédatrice bien connue, la Banque mondiale a rompu les négociations avec le gouvernement de Tunis dès le 7 mars dernier. Victimes des années d’incurie de Ben Ali (1987 – 2011) et de dix ans d’indécentes collusions parlementaires partitocratiques, les Tunisiens subissent maintenant une terrible crise économique. Frappé par une très forte inflation, le pays d’environ douze millions d’habitants compterait entre 21.000 et 57.000 clandestins africains.
Le dirigeant tunisien y voit une source inquiétante de criminalité et d’affrontements. Plaque tournante des migrations illégales, Sfax a connu de violents incidents entre sans-papiers et autochtones qui se préoccupent d’ailleurs de la multiplication des églises sur leur sol, maints Africains professant le christianisme. Au lendemain de la sortie présidentielle, les ambassades du Burkina Faso et du Congo commençaient à rapatrier au plus vite le plus grand nombre de leurs ressortissants respectifs présents en Tunisie de manière illégale. Le 4 mars, deux avions affrétés respectivement par le Mali et la Côte d’Ivoire raccompagnaient 133 Maliens vers Bamako et 145 Ivoiriens vers Abidjan. Les ONG droits-de-l’hommistes s’en scandalisent. Leurs critiques véhémentes n’impressionnent pas le chef d’État qui ose appliquer la remigration.
Les commentateurs remplacistes insistent alors volontiers sur les 69,50 % d’abstention pour le référendum constitutionnel du 25 juillet 2022. Ils soulignent toujours avec une rare malignité que les législatives des 17 décembre 2022 et 19 janvier 2023 se sont déroulées avec une participation moyenne de 11,31 %. Cette forte abstention témoigne surtout de la dépolitisation généralisée de la société tunisienne. Les jeux politiciens et les échéances électorales fatiguent les électeurs qui se tournent vers leur président. Celui-ci cumule en outre bien des défauts pour les bien-pensants. Ce fidèle partisan du nationalisme panarabe et de la tradition musulmane paie ses positions anti-sionistes constantes. Les Occidentaux lui reprochent son alignement sur l’Algérie en guerre froide avec le Maroc. En août 2022, le gouvernement algérien a versé à son voisin de l’Est 450 millions de dollars. Quelques semaines plus tard, la Tunisie recevait Brahim Ghali, le chef du Front Polisario.
Le 5 mars dernier, suite aux vives protestations de l’Union africaine qui assiste à l’effritement de son idéal panafricaniste, le gouvernement tunisien a pris quelques mesures supposées mieux encadrer l’immigration sauvage d’origine subsaharienne. Il accorde une carte de séjour d’un an, simplifie les procédures de rapatriement volontaire dans un cadre juridique concerné avec les ambassades et exonère le paiement des amendes dressées pour une présence illégale. Ces choix risquent d’exaspérer une population dont une minorité est noire et qui ne s’est jamais penchée sur son passé esclavagiste.

Enregistré en tant que 214e parti en décembre 2018, le Parti nationaliste tunisien ne doit pas être confondu avec la formation progressiste de l’homme d’affaires Faouzi Elloumi, le Parti national tunisien. Animé par Sofien Ben Sghaïr, le Parti nationaliste tunisien (logo, ci-dessus) dénonce « un plan européen annoncé pour installer les migrants africains subsahariens en Tunisie et les empêcher d’aller en Europe ». Bruxelles donne en effet plusieurs millions d’euros à Tunis afin d’éviter tout départ vers la péninsule italienne. Ce mouvement a lancé cet été sur Facebook une pétition exigeant des autorités l’expulsion immédiate des migrants en situation illégale et des immigrés délinquants, l’imposition de visas obligatoires aux Africains et l’abrogation de la loi liberticide du 23 octobre 2018 qui pénalise les actes, les propos et les discriminations liés à la race. Ce texte a néanmoins récolté plus d’un million de signatures.
Prônant la préférence tunisienne, le Parti nationaliste tunisien a vérifié au cours des dernières semaines dans les magasins et autres restaurants des grandes villes si les salariés noirs étaient en règle. Ces actions se comprennent dans le cadre d’une concurrence avec un très lointain héritier de la Brigade nord-africaine qui luttait contre les résistants du Limousin, un certain Parti national-socialiste des travailleurs de Tunisie dont le secrétaire général, Mohamed Al-Kahlawi, a reçu en octobre 2022 un haut-responsable du Front Polisario.
Dans la quatrième chronique du 5 octobre 2021 intitulée « Décisionnisme tunisien » (cf. http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2021/10/08/decisionnisme-tunisien.html ), votre serviteur évoquait déjà l’atypisme du président Kaïs Saïed défini dans L’Actualité à la hache (Éditions du Lore, 2021) comme « le croisement politique réussi des “ Gilets Jaunes “ français et du Mouvement Cinq Étoiles en Italie ». On pourrait ajouter que c’est un lointain cousin d’Éric Zemmour et de Henry de Lesquen. Son hostilité aux bavardages parlementaires, son refus patent du système des partis, son immense souci de préserver l’identité nationale arabe et mahométane du peuple tunisien et ses saillies contre les dogmes du « politiquement correct » en font, malgré les graves vicissitudes économiques contingentes, un très grand serviteur de sa patrie.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 66, mise en ligne le 21 mars 2023 sur Radio Méridien Zéro.
14:59 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : tunisie, afrique du nord, afrique, affaires africaines, immigration, migrants, actualité, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook