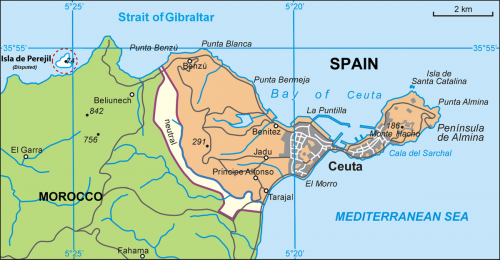mercredi, 15 février 2023
L'Atlantisme contre l'Afrique, coeur noir de l'Ile du Monde
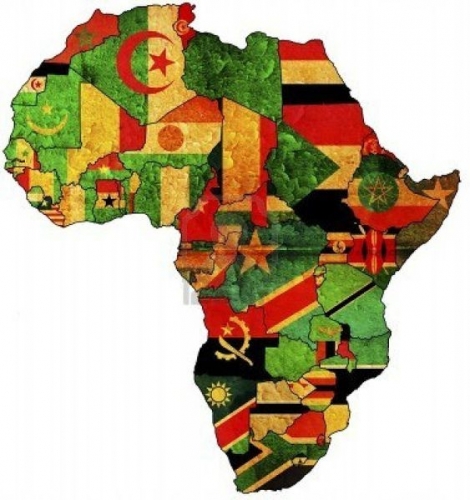
L'Atlantisme contre l'Afrique, coeur noir de l'Ile du Monde
Source: https://katehon.com/ru/article/atlantizm-protiv-chernogo-hartlenda-mirovogo-ostrova
L'influence de la Russie en Afrique s'est considérablement accrue ces derniers temps, et les autorités et la population locales en sont plutôt satisfaites.
L'Afrique est une région attrayante pour les puissances mondiales influentes. Avec l'Eurasie, selon le concept de Halford Mackinder, elle constitue la deuxième partie de l'île du monde. Malgré le fait que dans les années 1960, la plupart des pays africains ont obtenu leur indépendance, elle est restée une zone d'intérêt pour des États tels que les États-Unis et les pays de l'UE (en particulier la France).
La compétition pour l'influence sur le continent africain fait partie de la réalité géopolitique. La rivalité entre les puissances mondiales est indéniable; les États-Unis, la Russie, la Chine, la France et la Turquie ont leurs propres intérêts en Afrique. Examinons les intérêts respectifs de chacune des parties.
De vastes intérêts politiques et économiques sont au cœur de la politique africaine des États-Unis. Le rôle sécuritaire est également important, à savoir l'endiguement des organisations extrémistes telles qu'al-Shabab dans la Corne de l'Afrique, Boko Haram au Nigeria. Les États-Unis ont une base militaire au Camp Lemonier à Djibouti. L'administration Biden, à la suite de ses prédécesseurs, continue de développer sa politique envers l'Afrique, car elle sent la concurrence de la Chine.
L'ampleur de l'implication économique de la Chine en Afrique ne peut être sous-estimée. Quant à la présence politique et militaire, elle varie d'une région à l'autre. Par exemple, il existe un intérêt pour le projet "One Belt, One Road", lancé en 2013; le Forum régulier sur la coopération sino-africaine (FOCAC), qui est une approche plus formalisée et régulière du partenariat de haut niveau que celle poursuivie par les États-Unis.
Ensuite, considérez l'autre allié de la Chine qui a également une influence dans la région africaine : la Russie.
L'influence de la Russie sur le continent africain
L'approche de la Russie pour développer son influence est moins ambitieuse que celle de la Chine et des États-Unis. Pendant la guerre froide, l'URSS avait une forte influence dans la région, mais après l'effondrement de l'Union soviétique, sa politique à l'égard de l'Afrique est devenue plus modérée. Ces dernières années, cependant, le pays a considérablement accru sa présence à la suite du sommet Russie-Afrique de Sotchi 2019. La Russie s'efforce d'amener les États africains aux côtés du Conseil de sécurité de l'ONU.
Le commerce russe avec l'Afrique subsaharienne représente environ un quart du commerce américain et moins d'un dixième de celui de la Chine. Le pays ne figure pas parmi les dix premières sources d'investissements directs étrangers en Afrique, ne contribue pas de manière significative aux grandes initiatives de développement et a été critiqué pour son travail indépendant en matière d'aide humanitaire et de secours en cas de catastrophe, qui a été négligeable.
L'UE et l'Afrique
Ensuite, considérez l'étendue de la présence des pays de l'UE en Afrique, plus particulièrement la France, la Belgique et le Portugal. En 2020, l'UE a proposé une nouvelle stratégie pour l'Afrique comportant cinq piliers: "transition verte" et accès à l'énergie ; transformation numérique ; croissance durable et création d'emplois ; paix, sécurité et gouvernance ; et migration et mobilité. Bien que le COVID-19 ait forcé le report du sommet UE-Afrique initialement prévu pour octobre 2020, une version plus étoffée de la stratégie africaine sera probablement approuvée lors du sommet reprogrammé. De même, l'année 2020 a été choisie pour proclamer une alternative à l'"Accord de Cotonou", qui a réglementé le commerce et fourni un cadre pour le développement et les dialogues de gouvernance entre l'Afrique et l'UE depuis 2000. La nature hautement formalisée et institutionnalisée de l'UE se reflète dans une certaine mesure dans l'"Accord", et l'UE se présente comme un modèle à suivre pour renforcer l'intégration africaine et atteindre les objectifs de l'Union africaine.
Parmi les États européens, aucun n'a plus d'influence en Afrique que la France. Le pays fournit depuis longtemps des garanties de sécurité à ses anciennes colonies. Aujourd'hui, son opération Barkhane dans la région du Sahel représente sa plus grande présence militaire à l'étranger, avec près de cinq mille soldats engagés dans des opérations de contre-insurrection pour contenir les extrémistes radicaux et stabiliser le Mali et ses voisins. Plus de deux mille soldats français sont en outre stationnés dans d'autres parties du continent, dont une base permanente à Djibouti, qui reçoit parfois du personnel d'autres États européens. La France entretient des liens commerciaux importants avec l'Afrique francophone, au point de maintenir une participation à la politique monétaire de quatorze États africains (bien que les États d'Afrique de l'Ouest aient récemment décidé de se débarrasser de cet anachronisme).
Sous la direction du président Emmanuel Macron, la France a également fait des efforts importants pour renforcer les liens économiques avec les pays anglophones tels que le Nigeria et le Kenya. Mais l'influence française est un point de discorde constant pour les sociétés africaines francophones, et il existe une suspicion généralisée que les Français favorisent leurs propres intérêts au détriment de ceux de leurs partenaires commerciaux de l'élite africaine, ce qui pourrait être politiquement dangereux pour le pays.
Il convient également de noter que les États du Golfe et la Turquie ont également renforcé leur présence en Afrique. La Turquie, par exemple, a accru son influence en Somalie, où se trouve une installation militaire turque.

L'épicentre de la controverse
Comme de nombreux États ont une grande influence en Afrique, un certain nombre de controverses apparaissent. Selon la chercheuse Michelle Gavin: "L'administration Biden prévoit clairement des frictions avec la Chine en Afrique. Lors d'une audience d'approbation de la stratégie, l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield, a tenu à assurer aux sénateurs américains qu'elle et ses collègues étaient bien conscients des "objectifs de développement égoïstes et parasitaires" de la Chine, notamment en Afrique. Les États-Unis et la Chine continueront de s'affronter car le soutien africain aux normes internationales qu'ils promeuvent est en jeu et les positions des deux puissances s'opposent fortement sur un certain nombre de questions. La rivalité dans ces arènes est inévitable. Par conséquent, pour chaque partie, l'influence politique réelle dans les capitales africaines ne deviendra que plus désirable au fil du temps."
La Chine et la Russie vont poursuivre leur confrontation avec les États-Unis et les pays de l'UE. Par conséquent, en tant que membres du Conseil de sécurité de l'ONU (la Russie en est toujours membre, à l'exception du Conseil des droits de l'homme), ils continueront à lutter pour une sphère d'influence sur le continent africain. Par exemple, à la fin du mois de juillet, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, s'est rendu en Égypte, en République du Congo, en Ouganda et en Éthiopie. Le 22 juillet, la Russie, l'Ukraine, la Turquie et l'ONU ont convenu d'établir des couloirs de transport de céréales à travers la mer Noire. Il convient également de noter que l'Égypte est le plus grand importateur de blé au monde - elle achète 70 % de ses réserves de céréales à la Russie et à l'Ukraine.
Cependant, les États-Unis et l'UE n'apprécient pas vraiment l'influence croissante de la Russie en Afrique. L'attitude "erronée" de l'Afrique envers la Russie et la réticence du continent à se joindre à la pression des sanctions déplaisent définitivement à l'Occident, qui tente activement d'attirer la région dans l'orbite de ses intérêts géopolitiques. Les Etats-Unis sont particulièrement irrités, où un projet de loi spécial introduit au Congrès le 27 avril par le démocrate Gregory Meeks (photo), président de la commission des relations étrangères de la Chambre des représentants, a été adopté. Son but est de combattre les "activités malveillantes" de la Russie en Afrique.

Ainsi, étant donné que l'Afrique est peut-être la seule solution aux crises alimentaire et énergétique dans lesquelles le monde est plongé, placer le continent à l'épicentre d'un conflit entre différents acteurs aura un impact négatif non seulement sur les États africains, mais sur le globe entier. Il faut espérer que la nouvelle loi adoptée aux États-Unis ne sera pas à l'origine de ces problèmes.
Il convient de noter que l'influence de la Russie en Afrique a considérablement augmenté ces derniers temps, et que les autorités et la population locales ont une attitude plutôt positive à son égard. C'est une préoccupation majeure pour l'administration américaine. D'autant plus que la Russie continue à développer son influence et sa coopération avec d'autres pays en dépit des sanctions. Ce qui se passera ensuite est une question ouverte; nous devons garder un œil sur l'agenda actuel.
19:43 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, afrique, affaires africaines, russie, chine, france, états-unis, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 28 janvier 2023
La Libye et les intérêts géopolitiques de ses voisins

La Libye et les intérêts géopolitiques de ses voisins
par le Groupe de réflexion Katehon
Source: https://www.geopolitika.ru/it/article/la-libia-e-gli-interessi-geopolitici-dei-vicini
Depuis le renversement du gouvernement en 2011, la Libye est divisée. Tripoli et l'Occident ont tenté de contrôler la partie orientale du pays, un fief de l'"Armée nationale libyenne" (ANL) dirigée par le maréchal Khalifa Haftar. Par la suite, le double pouvoir a prévalu et le pays a cessé de fonctionner comme un seul État.
Le peuple et le parlement de la partie orientale ont opté pour une coopération avec l'"Armée nationale libyenne" dirigée par le maréchal Haftar. À l'ouest, dans la capitale Tripoli, le gouvernement d'accord national (CAN) soutenu par l'ONU et l'UE, dirigé par Fayiz Saradj, est au pouvoir. Son mandat a cependant déjà expiré.
D'autres pays ont réagi différemment aux événements en Libye. En 2011, la Grèce a soutenu l'opération militaire de l'OTAN contre Mouammar Kadhafi en mettant à la disposition des membres de l'Alliance atlantique des aérodromes militaires et une base navale. Cependant, l'armée grecque n'a pas été directement impliquée dans l'opération. En 2020, la Turquie a déployé ses troupes et des mercenaires syriens à sa solde en Libye, qui ont d'abord arrêté l'offensive de l'"Armée nationale libyenne" de Khalifa Haftar, puis l'ont repoussée de Tripoli à Syrte. Haftar n'a pu être sauvé que par Le Caire, qui a menacé Ankara d'envoyer ses troupes en Libye.
Les relations diplomatiques entre Le Caire et Ankara ont été rompues en 2013 après que le chef de l'armée égyptienne de l'époque, As-Sisi, a mené un coup d'État militaire contre le président égyptien Mohamed Morsi, soutenu par Erdogan (et les Frères musulmans, un groupe interdit en Russie).
Lors de la visite d'une délégation turque de haut niveau au Caire en 2021, la Turquie s'est trouvée désavantagée: d'une part, en raison du blocus du Qatar et, d'autre part, parce qu'Ankara n'avait pas été acceptée dans le forum sur le gaz, qui réunissait presque tous les pays de la Méditerranée orientale, dont l'Italie, l'Égypte, la Grèce, Israël, Chypre grecque, la Jordanie et la Palestine. Ce qu'Ankara n'a pas apprécié, c'est le renforcement de l'amitié entre Grecs et Egyptiens.
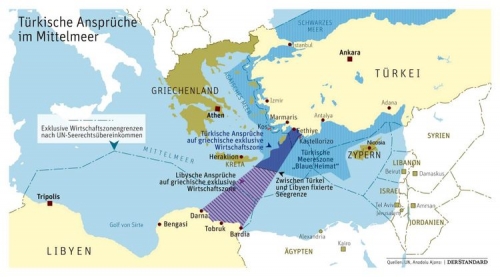
Les Turcs ont alors suggéré aux Égyptiens d'oublier toutes les vieilles rancunes et de se réconcilier. Le Caire se méfiait plutôt de cette suggestion. Les Égyptiens ont répondu en suggérant que les pays devaient d'abord surmonter leurs différences accumulées. La question qui nous occupe est la critique des dirigeants égyptiens par les médias turcs. Le Caire est également mécontent de l'accord de coopération militaire de 2019 signé avec l'ancien "gouvernement d'entente nationale" de Faiz Saraj, qui autorise les forces militaires turques à se trouver sur le territoire libyen, et du document sur la démarcation des frontières maritimes avec la Libye. Le Caire a également demandé à Ankara de cesser de s'ingérer dans les affaires intérieures des pays arabes et de ne pas accorder la citoyenneté turque aux Égyptiens vivant en Turquie.
Les Turcs ont ensuite satisfait à certaines de ces demandes, comme la modération des critiques de l'Egypte sur leurs chaînes de télévision. Néanmoins, la Turquie continue de pousser le concept de "patrie bleue", qui prévoit l'expansion de ses eaux territoriales dans la mer Égée, la Méditerranée et la mer Noire. À cette fin, Ankara a l'intention de conclure un accord similaire pour délimiter les frontières maritimes avec l'Égypte, ce qui pourrait transformer la Méditerranée en un "lac turc" à l'avenir, aux dépens du Caire. Ce n'est pas une coïncidence si de nombreux experts estiment que c'est précisément sur la piste libyenne que Le Caire et Ankara auront le plus de mal à négocier des concessions mutuelles. Il est peu probable que les Turcs et les Égyptiens acceptent de céder l'un à l'autre des positions importantes en Libye, qui revêtent une importance stratégique pour les deux pays.
Il est possible qu'une délégation de responsables libyens, dirigée par le président du parlement Aguila Saleh, se soit rendue au Caire à la mi-décembre pour concilier les positions de l'Égypte et de ses alliés libyens. Le programme de la visite comprenait des réunions avec le ministre égyptien des Affaires étrangères Sameh Shoukry, l'envoyé spécial des Nations Unies en Libye Abdoulaye Bathily et le secrétaire général de la Ligue arabe Ahmed Abu al-Ghaith. Au cours des réunions, Sameh a déclaré que l'actuel premier ministre libyen, Abdul Hamid Dbeiba, devra accomplir un certain nombre de tâches en vue des prochaines élections libyennes, dont la date n'a pas encore été fixée.
Cependant, ces tâches ne sont pas encore achevées, le Premier ministre les a en fait fait dérailler, mettant en péril la finalisation de ce que l'on appelle le cadre constitutionnel, c'est-à-dire la rédaction des dispositions constitutionnelles déterminant les modalités et les règles de participation aux élections. À un moment donné, c'est la raison pour laquelle les élections parlementaires et présidentielles prévues pour décembre 2021 n'ont jamais eu lieu.
Au début du mois de décembre de l'année dernière, la National Oil Corporation (NOC) de Libye a également invité les entreprises internationales avec lesquelles elle avait précédemment signé des accords d'exploration et de production de pétrole et de gaz à reprendre leurs activités dans le pays. L'organisation l'a déclaré dans un texte publié sur son site officiel. Le NOC a justifié cet appel par l'amélioration progressive de la situation sécuritaire. Pour sa part, le défunt "Gouvernement d'entente nationale" dirigé par Abdel Hamid Dbeiba a également appelé les investisseurs étrangers à revenir et à reprendre leurs activités dans les champs pétrolifères et gaziers. Les entreprises occidentales ont commencé à négocier les conditions de travail, mais jusqu'à présent, peu de progrès ont été constatés. L'année dernière, les chiffres globaux de production et d'expédition ont été généralement bons, avec des revenus totaux de 22 milliards de dollars. Mais en raison de l'instabilité politique, les perturbations pourraient se poursuivre dès 2023.
21:03 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, géopolitique, libye, turquie, égypte, méditerranée, afrique du nord, afrique, affaires africaines, monde arabe, monde arabo-musulman |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 17 janvier 2023
Les objectifs du Maroc pour sa nouvelle démarcation maritime

Les objectifs du Maroc pour sa nouvelle démarcation maritime
Ali El Aallaoui
Analyste et chercheur en géopolitique
Source: https://masticadoresdeletrasfocus.wordpress.com/2020/09/05/los-objetivos-marroquies-de-su-nueva-delimitacion-maritima-by-ali-el-aallaoui/
L'objectif des autorités marocaines est de redessiner à nouveau le paysage politique du Sahara occidental, et de faire croire qu'il s'agit d'une étape dans le conflit territorial issu d'une mauvaise gestion des relations hispano-marocaines.
C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que toutes les régions du monde ont une forte présence dans les mers en même temps. Comme par le passé, la mer reste un vecteur de puissance, un espace nécessaire et essentiel pour développer des ambitions économiques et politiques.
La possession de matières premières, qu'elles soient agricoles ou minérales, a toujours été un élément fondamental de la puissance. C'est la volonté de les acquérir qui est à l'origine des grandes découvertes de la fin du 15ème et du début du 16ème siècle. Au début du 20ème siècle, dix des douze plus grandes entreprises américaines exploitaient des ressources naturelles. Tous les pays riches du 19ème et du début du 20ème siècle disposaient d'importantes ressources naturelles.
Partant de ce constat, le Maroc veut à tout prix faire pression sur l'Espagne pour qu'elle accepte le fait accompli principalement au Sahara occidental, sachant que la situation dans ce territoire, qualifié de territoire non autonome par les Nations Unies en 1963, est dans l'impasse depuis des années.
Contexte et objectif géopolitique
En d'autres termes, d'un point de vue contextuel, le Maroc profite de la période de non paix et de non guerre au Sahara Occidental. Elle considère également l'actuel gouvernement espagnol comme plus faible et veut donc le pousser à négocier l'espace maritime du Sahara occidental afin de lui accorder une certaine souveraineté territoriale de facto. Cependant, il doit savoir que l'Espagne est la puissance administrante au Sahara Occidental en vertu du droit international et que le Maroc est la puissance occupante.
Les nouvelles lois marocaines définissant son nouveau domaine maritime fixent ses eaux territoriales à 12 miles, délimitent sa zone économique exclusive à 200 miles et décident d'étendre son plateau continental à 350 miles. Avec les règlements adoptés, le Maroc étend sa tutelle légale sur l'espace maritime qui comprend le Sahara occidental jusqu'à la ville de Lagüera et au nord-est jusqu'à Saidia, à la frontière avec l'Algérie.
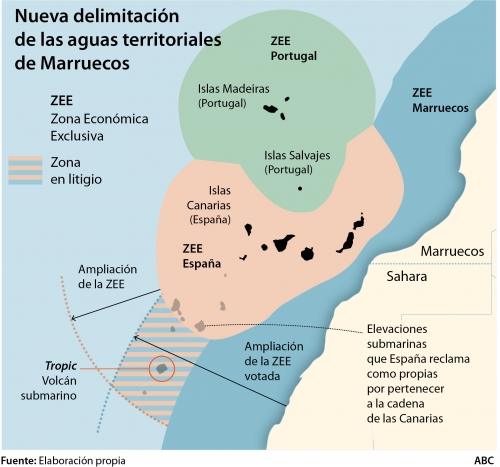
Dans cette perspective, l'objectif du Maroc est de retarder et de bloquer l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 21 décembre 2016 qui a séparé le Sahara de la sphère de compétence des relations entre le royaume alaouite et l'UE. Car la question de la souveraineté sur le Sahara est le défi le plus important auquel sont confrontés les futurs accords entre le Maroc et l'UE. Dans ce sens, l'intégration des produits du territoire sahraoui dans les accords d'association avec l'UE présentera bientôt au Maroc un nouveau défi en termes de souveraineté sur le Sahara occidental.
Objectif économique
Les intérêts économiques et stratégiques et l'épuisement des ressources naturelles sur terre conduisent les États à poursuivre cette tentative de monopolisation des espaces maritimes au-delà des mers territoriales, dans les limites du plateau continental, avec la volonté de contrôler non seulement la surface, mais aussi les ressources halieutiques et minérales des fonds marins et du sous-sol.
En outre, les ressources naturelles sont considérées comme augmentant l'intervention des États dans les affaires des autres. Les deux guerres du Golfe sont perçues comme étant largement liées à la priorité donnée à l'accès aux réserves de pétrole.
Les ressources naturelles du Sahara occidental sont abondantes et jouent un rôle important pour influencer la diplomatie marocaine envers ses partenaires principalement européens. Ce qui explique , l'importance géostratégique et économique du Sahara occidental pour le Maroc, et aussi pour l'Union européenne en termes de ressources, ceci explique l'accord signé entre l'UE et le Maroc en 2019 sans aucun respect des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne en 2016.
L'objectif stratégique du Maroc: maintenir le statu quo au Sahara occidental avec l'aide de l'Espagne
Le Maroc veut à tout prix rester sur le territoire sahraoui car il estime que le temps joue pour lui, que le développement de la région et l'évolution de la composition de la population rendront irréversible le rapport de force en sa faveur. C'est dans cette perspective que s'inscrit la nouvelle politique marocaine de délimitation maritime unilatérale.
Le principal intérêt du Maroc dans cette nouvelle approche est de prolonger le conflit au Sahara occidental sur le long terme, ou du moins de ne pas le résoudre avant longtemps. Ainsi, sans la coopération espagnole à cet égard, le Maroc ne peut pas appliquer sa politique coloniale au Sahara occidental car ses voisins, l'Algérie et la Mauritanie, s'opposent à ses revendications territoriales, sans parler du peuple sahraoui.
L'objectif des autorités marocaines est de redessiner à nouveau le paysage politique du Sahara occidental, et de faire croire qu'il s'agit d'une phase dans le conflit territorial et d'une mauvaise gestion des relations hispano-marocaines.
20:17 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, europe, afrique, affaires européennes, affaires africaines, espagne, maroc, sahara occidental, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 13 décembre 2022
Les "points chauds" de la planète : où pourrait éclater la prochaine guerre?

Les "points chauds" de la planète : où pourrait éclater la prochaine guerre?
Andrea Muratore
Source: https://insideover.ilgiornale.it/politica/scioperi-tensioni-ed-esercito-allertato-cosa-succede-davvero-nel-regno-unito.html
Ces dernières années, la guerre du Haut-Karabakh d'abord, puis le violent conflit en Ukraine ont enflammé des scénarios jugés critiques pour l'ordre international par les analystes et les décideurs. Les guerres préventives déclenchées par l'Azerbaïdjan et la Russie contre, respectivement, l'Arménie et l'Ukraine ont montré le retour du recours à la force comme moyen de résoudre les conflits entre États avec une véhémence jamais vue depuis la fin de la guerre froide.
La fin du bipolarisme et l'évanouissement rapide de l'utopie unipolaire du monde dirigé par les États-Unis ont conduit l'ordre mondial à se transformer en un grand désordre international, anarchique et sans règles précises. Cela a alimenté les poussées de tension dans le contexte d'une rupture de plus en plus progressive des freins et contrepoids qui délimitaient l'équilibre des pouvoirs. Le déclin du bipolarisme et les scénarios de guerre hybride et économique qui ont émergé dans divers contextes ont fait le reste, mettant essentiellement en contact les puissances dans diverses régions du monde. Conflits gelés ou de faible intensité sur le point de se réveiller, régions du monde âprement disputées entre puissances, points de contact entre anciens et nouveaux empires revenus s'affronter, zones à revendications politiques multiples : les zones de tension où la prochaine guerre pourrait éclater sont nombreuses.

Carte par Alberto Bellotto: les zones de tension dans le monde. Le théâtre finlandais et baltique rapproche la possibilité d'un conflit en Europe centrale et occidentale.
Syrie, Libye, Yémen : trois "bombes" non désamorcées
Le Grand Moyen-Orient et l'Afrique du Nord sont les premières zones à être soigneusement évaluées. Celle de Syrie, dont il a été question récemment dans ces colonnes, est la plus violente des guerres gelées sans issue définitive, même si formellement personne ne met plus en péril le maintien au pouvoir du régime alaouite de Bachar el-Assad. Le pays peine à retrouver son unité, et la reprise des opérations turques contre les Kurdes du Rojava nous a récemment rappelé à quel point ce pays tourmenté du Moyen-Orient présente définitivement des problèmes de stabilité.
Outre la Syrie, le Yémen et la Libye sont aussi des pays déchirés par leurs propres guerres civiles dont la priorité est aujourd'hui de sortir du bourbier qui les voit comme des zones de conflits et de guerres par procuration entre des mosaïques hétéroclites de puissances. Bien que n'étant pas à l'ordre du jour des conflits directs entre États, ces trois nations correspondent à autant de "trous noirs" géopolitiques et stratégiques, sources de tensions pour l'ordre international, à l'instar d'une autre zone souvent sous-estimée, le Sahel.
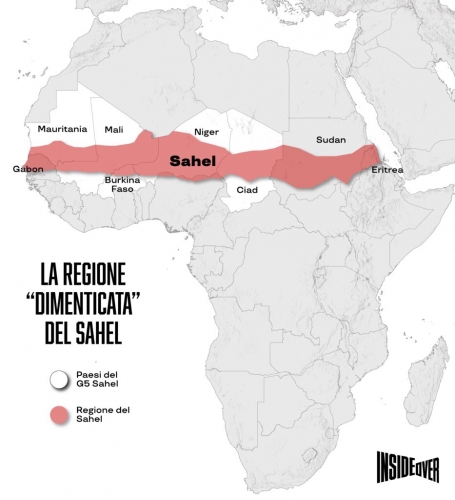
Carte par Alberto Bellotto. Erratum: à la place du mot "Gabon", il faut évidemment écrire "Sénégal".
Etats-Unis et Chine, le front du Pacifique
Bien entendu, les "trous noirs" peuvent être problématiques pour les litiges liés à d'éventuels effondrements d'États ou à l'infiltration de terroristes dans des pays à l'institutionnalisation réduite. Mais le vrai problème, aujourd'hui, reste les points de contact possibles entre les grandes puissances. Des espaces où le risque de confrontation entre blocs de pouvoir est direct.
La première pensée qui vient à l'esprit est évidemment la mer de Chine méridionale et le bras de fer entre la Chine et les États-Unis. Ces derniers mois, les exercices navals de Pékin dans le détroit de Taïwan et la visite de la présidente de la Chambre des représentants de Washington, Nancy Pelosi, sur l'île considérée comme une "province rebelle" par Pékin ont marqué les tensions et la rivalité politique entre les deux géants.
Depuis le début de l'année 2022, la Chine a complètement militarisé avec ses propres forces trois des nombreuses îles qu'elle a construites dans la mer de Chine méridionale contestée, les armant de systèmes de missiles de différents types, en premier lieu l'anti-navire Donfeng-21. Le Guardian rappelle que lors de l'effort décisif de la Chine en mars pour "armer" ses territoires artificiels, "le commandant américain pour l'Indo-Pacifique, l'amiral John C. Aquilino, a déclaré que les actions hostiles contrastaient fortement avec les assurances antérieures du président chinois Xi Jinping selon lesquelles Pékin ne transformerait pas les îles artificielles dans les eaux contestées en bases militaires".
Dans les îles Spratley, disputées avec plusieurs autres nations de la région, en premier lieu les Philippines et le Vietnam, la Chine utilise des bateaux de pêche comme élément de projection. En moyenne, ils jettent l'ancre dans l'archipel contesté de l'Indo-Pacifique pendant au moins neuf mois de l'année.
Washington répond par un système complexe de présence navale. Le commandement du Pacifique, qui gère également les opérations dans l'océan Indien, dispose de deux flottes, la troisième et la septième, avec les porte-avions Nimitz, Carl Vinson, Ronald Reagan et Theodore Roosevelt déployés à San Diego et l'Abraham Lincoln à Yokosuka, au Japon. En plus de Taïwan, armée jusqu'aux dents pour se défendre, Washington compte évidemment sur le Japon, le Vietnam, qu'ils ont redécouvert, et la base aérienne et navale de Guam pour contenir la Chine.

Carte par Alberto Bellotto
Cachemire et Kouriles, terres contestées
Toujours en Asie, il existe des contextes dans lesquels les différends territoriaux jouent le rôle principal et peuvent élever la barre de la confrontation entre puissances. L'agression de la Russie contre l'Ukraine et la mort tragique de Shinzo Abe, par exemple, ont rallumé les projecteurs sur la revendication du Japon concernant les îles Kouriles "arrachées" à Tokyo par l'Union soviétique après la brève guerre de Moscou contre l'Empire japonais en août 1945.
L'assassinat d'Abe a privé le Japon du seul homme d'État qui avait tenté une stratégie diplomatique pour s'approcher progressivement d'un règlement de la question avec la Russie. Le regain de tensions de ces derniers mois ajoute une zone de tension en Extrême-Orient.
La situation au Cachemire, disputé entre l'Inde et le Pakistan, dont New Delhi contrôle une partie importante, est encore plus problématique. L'Inde et le Pakistan ont tenté à plusieurs reprises d'entamer des dialogues pour résoudre le statut contesté de la région, qui fait l'objet de discussions depuis 1947, et se sont affrontés à quatre reprises dans le passé (1948, 1965, 1971 et 1998). Le véritable épicentre d'un conflit potentiellement dévastateur à l'échelle mondiale se trouve ici, où la tension est toujours à son comble entre deux puissances nucléaires.
La Baltique : la nouvelle "mer chaude"
L'Europe n'est pas exempte de la présence de tels "points chauds", et après le tournant du 24 février 2022, jour de l'invasion de l'Ukraine, le nouveau "lac" atlantique, la mer Baltique, est devenu le point de confrontation le plus critique entre le camp euro-atlantique et la Fédération de Russie.
La Baltique est la région où se trouve la ligne d'expansion de l'OTAN, destinée à s'étendre à la Suède et à la Finlande dans les années à venir. Elle est affectée par la présence ostensible de la Russie à Kaliningrad et dans la région de Saint-Pétersbourg, qui est lourdement dotée en personnel. Elle dispose de la plus grande flotte russe de la région et des forces armées des pays européens les plus hostiles à Moscou : l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et surtout la Pologne. Elle est centrale pour les infrastructures énergétiques: le cas du Nord Stream endommagé, dans cette perspective, l'enseigne.
Et justement, la Baltique pourrait être l'épicentre des tensions dans les années à venir. Un pivot européen d'un grand désordre mondial dans lequel les petites et moyennes turbulences se doublent de grands défis. Et qui pourrait semer les graines de nouveaux conflits dans les années à venir.
Donnez-nous une autre minute de votre temps !
Si vous avez aimé l'article que vous venez de lire, demandez-vous : si je ne l'avais pas lu ici, l'aurais-je lu ailleurs ? S'il n'y avait pas InsideOver, combien de guerres oubliées par les médias le resteraient ? Combien de réflexions sur le monde qui vous entoure ne seriez-vous pas capable de faire ? Nous travaillons chaque jour pour vous fournir des reportages de qualité et des rapports approfondis totalement gratuits. Mais le type de journalisme que nous faisons est tout sauf "bon marché". Si vous pensez que nous valons la peine d'être encouragés et soutenus, faites-le maintenant.
19:44 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, zones de turbulences, gépolitique, conflits, conflictualité, actualité, europe, asie, afrique, affaires africaines, affaires asiatiques, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 22 octobre 2022
La France en Libye: non seulement du pétrole mais aussi de l'uranium. Les raisons d'une guerre

La France en Libye: non seulement du pétrole mais aussi de l'uranium. Les raisons d'une guerre
Marco Valle
Source: https://it.insideover.com/economia/la-francia-in-libia-non-solo-petrolio-ma-anche-uranio-le-ragioni-di-una-guerra.html
En mars 2011, la France, avec le soutien des États-Unis et de la Grande-Bretagne, a commencé sa campagne militaire contre la Libye de Kadhafi. Une guerre à grande échelle à laquelle l'Italie de Silvio Berlusconi, jusqu'alors partenaire du rais libyen, a été contrainte (sous la pression du président Napolitano) de participer. Les résultats sont bien connus. Comme le rappelle Giampiero Cannella dans son excellent livre L'Italia non gioca a Risiko : "Enivrés par la propagande de la "révolte démocratique" contre le tyran, nous avons largué des tonnes de bombes sur un pays qui était un allié jusqu'à quelques mois auparavant, qui avait accordé à l'Italie une grande marge de manœuvre dans la recherche et l'exploitation des ressources énergétiques, et qui collaborait avec l'Italie dans la gestion des flux migratoires".
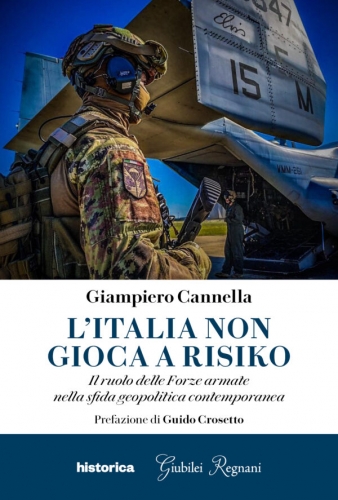
Le grand réalisateur de ce terrible gâchis toujours non résolu était le président français de l'époque, Nicolas Sarkozy. C'est lui, plus que quiconque, qui a voulu démolir le régime de Tripoli et c'est lui qui a donné le feu vert - par l'intermédiaire de ses agents sur le terrain - à l'assassinat de Kadhafi le 20 octobre 2011 à Syrte. Au fil du temps, les raisons de cet acharnement féroce sont, du moins en partie, devenues plus claires. Malgré la rhétorique humanitaire qui a ébloui les médias européens, les transalpins redoutaient l'hypothèse d'une monnaie panafricaine financée par les réserves d'or libyennes qui supplanterait le franc CFA dans leur zone d'influence, la fameuse "France-Afrique", et toléraient encore moins la présence massive et fructueuse d'ENI et du système italien dans le pays. En outre, comme l'ont montré les enquêtes de la justice parisienne, le peu scrupuleux Sarkozy avait collecté des sommes considérables auprès de Tripoli (jusqu'à 50 millions d'euros selon les hypothèses) pour la campagne présidentielle de 2007. Un financement embarrassant que le mari de Carla Bruni a toujours nié sans convaincre les juges qui enquêtent depuis des années sur le "pacte de corruption" entre le clan Sarkozy et le clan Kadhafi.
Mais il y a plus. Derrière cette guerre folle et le chaos interminable qui règne en Libye (11 ans de violence et d'affrontements...), d'autres chapitres restent à ouvrir et à comprendre. La France est privée d'uranium, le minerai stratégique qui garantit depuis 1974 le fonctionnement des 56 réacteurs alimentant 19 centrales nucléaires qui fournissent environ soixante-dix pour cent de l'électricité du pays, et la Libye, en plus du pétrole, cache dans son désert du sud d'importants gisements d'uranium encore vierges.
À y regarder de plus près, il n'y a rien de nouveau. Déjà en 1973, Kadhafi, revendiquant les anciennes frontières coloniales, est entré au Tchad et a occupé la bande d'Aozou, un terrain aride et dépeuplé mais riche en uranium. Un succès éphémère. En 1987, les forces tchadiennes, avec la contribution de la Légion étrangère française, ont mis en déroute les troupes libyennes et repris le contrôle du territoire qu'en 1994 la Cour internationale de justice a définitivement attribué au pays d'Afrique centrale.
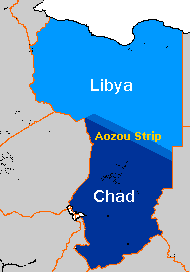
Mais, et c'est là le point central, juste au nord de la bande contestée, donc sous pleine souveraineté libyenne, les scientifiques ont découvert d'autres riches gisements du précieux métal radioactif. Un trésor inattendu, mais le rais n'a pas eu le temps de l'exploiter. Comme le confirme le funeste site web "NTI" de 2011 de l'organisation internationale "Nuclear Threat Initiative", qui fait autorité dans le domaine des études géopolitiques et de la sécurité mondiale et dont le conseil d'administration est composé d'experts internationaux. "À l'heure actuelle, il n'existe aucune preuve de l'existence d'installations d'extraction, de traitement et de conversion de l'uranium, d'usines de traitement du combustible ou de sites de retraitement en Libye. Si la Libye devait entreprendre l'extraction d'uranium à l'avenir, cela concernerait probablement les bassins de Mourzouk, Sarir Tibisti et Koufra".
C'est une trop belle opportunité pour la vorace industrie nucléaire française, qui est depuis longtemps en difficulté avec les fournisseurs africains traditionnels (le Niger in primis) qui en ont maintenant assez des conditions exorbitantes et inégales fixées il y a des décennies par Paris. D'où les doubles ou triples jeux français entre les différentes factions libyennes, les lourds investissements économiques, la reprise - comme l'indique le rapport du Centre supérieur de défense et d'études stratégiques "Influence géopolitique de la Libye dans le bassin méditerranéen" - d'une exploration minière très cossue mais efficace dans le sud du pays. Entre Mourzouk et Koufra. L'héritage radioactif de Sarkozy que Macron a récupéré et qu'il veut maintenant, à la lumière de la crise énergétique, optimiser au plus vite.
18:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, libye, afrique du nord, afrique, affaires africaines, tchad, uranium, france, italie, europe, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 31 août 2022
Analyse de la stratégie des Etats-Unis en Afrique: Washington peut-il rattraper la Chine?

Analyse de la stratégie des Etats-Unis en Afrique: Washington peut-il rattraper la Chine?
Leonid Savin
Source: https://www.geopolitika.ru/en/article/analysis-us-strategy-africa-can-washington-catch-china
Au début du mois d'août, la Maison Blanche a publié un mémorandum pour une stratégie en Afrique subsaharienne [i]. Il s'agit d'un document assez unique qui expose les objectifs et les méthodes des États-Unis dans la région. Ce faisant, le texte lui-même commence par une citation du secrétaire d'État Anthony Blinken, qui a déclaré en novembre 2021 que "l'Afrique façonnera l'avenir - et pas seulement l'avenir du peuple africain, mais celui du monde entier". Cela peut sembler plutôt inhabituel, puisque le département d'État publie habituellement ses propres stratégies.
Cette approche indique une action synchronisée de diverses agences. Le Département du commerce, le Pentagone et d'autres organismes, allant des gouvernements fédéraux aux gouvernements locaux, poursuivront également activement leurs objectifs. Les différents exemples cités dans le document montrent que ce travail est déjà en cours depuis des années.
La question est de savoir comment atteindre un nouveau niveau et consolider leur influence. Car dans tous les cas, Washington sera confronté à la nécessité de contrer d'autres acteurs actifs en Afrique. Il s'agit avant tout de la Chine et de la Russie, qui sont ouvertement présentées comme des défis et des problèmes pour les intérêts américains dans la région.
"La République populaire de Chine considère la région comme une arène importante pour défier l'ordre international fondé sur des règles, promouvoir ses propres intérêts commerciaux et géopolitiques étroits, miner la transparence et l'ouverture et affaiblir les relations des États-Unis avec les peuples et les gouvernements africains".
"La Russie considère la région comme un environnement fertile pour les entreprises militaires para-étatiques et privées, qui fomentent souvent l'instabilité pour des gains stratégiques et financiers. La Russie utilise ses liens sécuritaires et économiques ainsi que la désinformation pour saper l'opposition de principe des Africains à la poursuite de l'invasion russe en Ukraine et aux violations des droits de l'homme qui y sont liées", indique le rapport".
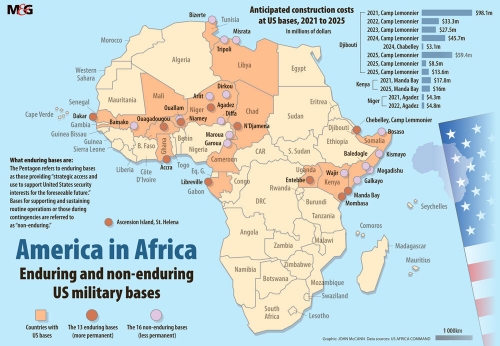
En somme, la stratégie énonce quatre objectifs pour faire avancer les priorités des États-Unis avec leurs partenaires régionaux au cours des cinq prochaines années. Elle indique que "les États-Unis utiliseront toutes leurs capacités diplomatiques, de développement et de défense, et renforceront leurs liens commerciaux en se concentrant sur les écosystèmes numériques et en se recentrant sur les pôles urbains pour soutenir ces objectifs :
- 1) Promouvoir l'ouverture et les sociétés ouvertes ;
- 2) fournir un dividende pour la démocratie et la sécurité ;
- 3) Promouvoir la reprise post-pandémique et les opportunités économiques ;
- 4) Soutenir la conservation, l'adaptation au changement climatique et une transition énergétique juste.
Examinons de plus près ces points. Le premier objectif est énoncé dans le style de l'Open Society Institute de George Soros. Il est possible que ses actifs soient également utilisés pour transformer les systèmes politiques des pays africains. Comme le parti démocrate américain et le programme de George Soros en général, la Maison Blanche estime qu'il y a trop de régimes autoritaires dans la région qui doivent être remplacés par des régimes plus fidèles aux États-Unis.
En clair, un coup d'État par le biais d'une révolution de couleur ou en corrompant les autorités en place. Bien que la Maison Blanche déclare extérieurement la nécessité de lutter contre la corruption, il est clair pour tout le monde que la politique étrangère américaine elle-même utilise activement des éléments de corruption, que l'on appelle pudiquement "lobbyisme".
Il est noté que "malgré un fort soutien populaire à la démocratie en Afrique subsaharienne - quelque 69% selon de récents sondages - la démocratie fait toujours défaut. Ces dernières années, l'Afrique a été en proie à une succession de coups d'État militaires et d'échecs démocratiques, ce qui pourrait entraîner une nouvelle détérioration des conditions de gouvernance et de sécurité, ainsi que des conséquences négatives pour les pays voisins.
En 2022, Freedom House a classé seulement huit pays d'Afrique subsaharienne comme libres - le nombre le plus bas depuis 1991. Ces échecs ont accru les possibilités d'influence étrangère indue et reflètent la montée en puissance de gouvernements qui utilisent les technologies de surveillance, diffusent des informations erronées, exploitent la corruption et commettent des violations des droits de l'homme en toute impunité.
Alors que les forces démocratiques ont récemment remporté les élections au Malawi et en Zambie, les dirigeants autocratiques des autres pays gardent un contrôle étroit du pouvoir. Le décalage entre les aspirations de la population et la fermeture de l'espace civique dans certains pays a entraîné une instabilité accrue et une vague de mouvements de protestation."
Cette citation mentionne "l'influence étrangère indue", qui peut également être attribuée à l'ingérence des États-Unis dans la région, à la fois directement et par le biais de proxies et de satellites européens.
En ce qui concerne les méthodes sur le premier point, le soutien aux réformes, la création de diverses fondations et initiatives, l'assistance juridique et la promotion des droits de l'homme sont mentionnés. Il est probable que cela se fasse en mettant l'accent sur le contrôle des ressources naturelles, ce qui est voilé derrière un verbiage tel "aider à atteindre la transparence dans l'utilisation de ses ressources naturelles, y compris les ressources énergétiques et les minéraux essentiels, pour un développement durable, tout en aidant à renforcer les chaînes d'approvisionnement qui sont diverses, ouvertes et prévisibles".
Il ne fait aucun doute que par lesdites chaînes d'approvisionnement, on entend une monopolisation par les États-Unis d'importants produits de base et matières premières provenant des pays africains. La façon dont les entreprises américaines obtiendront la marge est une autre question. Cela peut se faire par le biais d'actions, du paiement de services de conseil ou déguisé en prêts et crédits destinés à des projets pertinents.
Pour le moins, ce genre d'énergie de la part de Washington devrait rendre les gouvernements africains méfiants. D'autant plus qu'on ne leur a pas demandé ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin.
Le deuxième point est directement lié au premier. Voici une citation qui permet de comprendre parfaitement ce que les États-Unis veulent dire :
"Les États-Unis soutiendront les démocraties africaines en soutenant la société civile, notamment les activistes, les travailleurs et les dirigeants soucieux de réforme ; en donnant des moyens d'action aux groupes marginalisés tels que les personnes LGBTQ+ ; en se concentrant sur les voix des femmes et des jeunes dans les efforts de réforme ; et en protégeant les élections libres et équitables en tant que composantes nécessaires mais non suffisantes des démocraties dynamiques. Les États-Unis soutiendront l'ouverture et les opportunités démocratiques en s'appuyant sur l'Initiative présidentielle pour le renouveau démocratique, le Sommet pour la démocratie et l'Année de l'action.
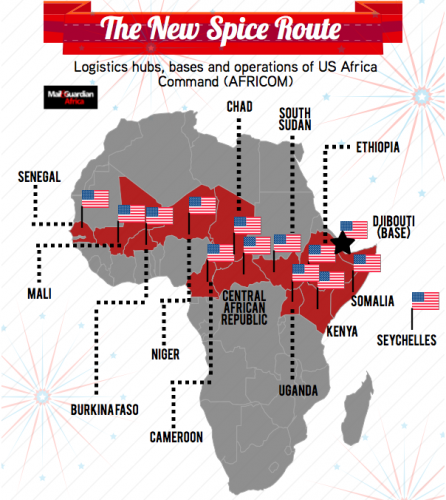
Les États-Unis concentreront leurs efforts diplomatiques, tireront parti de leurs programmes de développement et utiliseront leurs outils de défense pour renforcer et permettre à leurs partenaires de répondre aux causes des conflits dans toute la région.
"Nous nous concentrerons sur le renforcement de la capacité des partenaires africains à promouvoir la stabilité et la sécurité régionales en permettant à des institutions de sécurité gouvernementales plus professionnelles, plus compétentes et plus responsables d'assurer la sécurité interne".
"Nous investirons également dans les efforts locaux de prévention et de consolidation de la paix afin d'atténuer et de traiter les vulnérabilités, en utilisant la loi bipartisane sur l'instabilité mondiale dans les zones côtières d'Afrique de l'Ouest et au Mozambique".
Les États-Unis donneront la priorité aux ressources de lutte contre le terrorisme afin de réduire la menace que les groupes terroristes font peser sur les États-Unis eux-mêmes, leur population et leurs cibles diplomatiques et militaires, en ne dirigeant des capacités unilatérales que là où elles sont légitimes et où la menace est la plus aiguë.
"Nous travaillerons principalement avec, avec et par l'intermédiaire de nos partenaires africains, en coordination avec nos principaux alliés, de manière bilatérale et multilatérale, afin de poursuivre des objectifs communs de lutte contre le terrorisme et de promouvoir des approches civiles et non cinétiques lorsque cela est possible et efficace".
"Dans le cadre de cette approche, nous utiliserons des programmes spéciaux pour renforcer la capacité des agences partenaires locales de sécurité, de renseignement et de justice à identifier, perturber, désorganiser et partager des informations sur les terroristes et les réseaux qui les soutiennent".
Si Washington va soutenir les soi-disant "groupes marginalisés" représentant des tas de sodomites locaux ou influençant délibérément les récits sur les relations entre personnes de même sexe, cela va clairement vers l'ingérence dans les affaires intérieures des États.
Sur le plan de la sécurité, on se demande également qui et quoi l'armée américaine va soutenir.
Il convient de noter ici que le Pentagone fait désormais activement campagne pour que les entreprises privées de défense américaines investissent dans des technologies de pointe et des projets énergétiques pour l'armée africaine par le biais d'un fonds spécial, Prosper Africa, sous les auspices du gouvernement américain [ii].
Le Commandement pour l'Afrique du Pentagone, qui est responsable du continent, possède des bases et des installations dans un certain nombre de pays. Il existe également des cellules de la CIA dans la région, ainsi que des employés d'autres agences qui collectent et traitent divers types d'informations. Sans parler des représentants de sociétés militaires privées, au moins la tristement célèbre structure Eric Prince, qui, après les scandales en Irak, s'est engagée activement dans ses affaires rien qu'en Afrique.
Quant aux alliés des États-Unis, il existe déjà une initiative mondiale d'infrastructure et d'investissement au sein du G7, pour laquelle il était prévu d'allouer 600 milliards de dollars. Les États-Unis semblent pousser leurs partenaires à poursuivre leurs propres intérêts. Cette initiative est liée au projet Prosper Africa déjà mentionné, ainsi qu'à d'autres - Power Africa et Feed the Future. En outre, les États-Unis espèrent transformer numériquement l'Afrique grâce à leurs entreprises informatiques.
Sur le troisième point, Washington essaie de lancer des projets économiques spécifiques, bien que certains d'entre eux, encore une fois, s'inscrivent dans les deux premiers objectifs. Car la création de communautés économiques inclusives va de pair avec la diffusion de la démocratie (telle que la conçoivent les États-Unis). Le rétablissement après la pandémie du coronavirus et la sécurité alimentaire sont soulignés. Il est intéressant de noter que d'autres maladies répandues et dangereuses en Afrique subsaharienne ne sont pas du tout mentionnées dans la stratégie.
Nous pouvons en conclure que la mention des covidés est de nature routinière et qu'en réalité, les États-Unis ne se préoccupent pas du tout du système de santé des pays africains. Il faut dire que de nombreux États africains ont des taux de mortalité assez élevés et précoces, y compris la mortalité infantile. Mais la Maison Blanche se contente d'escamoter la question, promettant dans l'abstrait le bien-être futur.
Enfin, le quatrième point s'inscrit dans la lignée des précédents. Il s'agit du partenariat des États-Unis avec les gouvernements africains, la société civile et les communautés locales pour soutenir et gérer les écosystèmes naturels qui permettront de réduire les émissions de carbone et de contrôler le changement climatique. Les États-Unis ont deux programmes à cet effet : le Plan américain de conservation des forêts mondiales et le Programme régional pour l'environnement en Afrique centrale. Dans le même temps, Washington a l'intention de lancer un plan énergétique, bien qu'aucune précision ne soit donnée.
Il est à noter que la Chine est mentionnée quelques fois tandis que la Russie l'est sept fois. Il est clair que les Etats-Unis devront surtout faire face à la présence chinoise dans la région, car Pékin a depuis longtemps des projets d'infrastructure en Afrique, ainsi que des prêts qui ne sont pas encombrés de visées politiques manipulatrices et qui sont bien accueillis par les gouvernements locaux.
Bien sûr, en dehors des exhortations pathétiques énoncées dans la stratégie, il existe des intérêts américains objectifs et rationnels liés au fait que d'ici 2050, le nombre d'Africains devrait atteindre 25 % de la population mondiale. Cela signifie le plus grand marché de consommation et la plus grande force de travail. Si nous appliquons la loi des grands nombres, cela signifie la capacité intellectuelle et technologique.
L'Afrique possède également la deuxième plus grande superficie de forêt tropicale du monde et possède 30 % des minéraux les plus importants. En termes d'influence politique, l'Afrique subsaharienne dispose de 28 % des voix dans le système des Nations unies. La manipulation de ces votes semble cruciale pour Washington.
D'où cet intérêt stratégique pour les pays africains. Malgré l'instabilité de certains d'entre eux, les troubles politiques et l'incertitude, Washington veut mettre sa patte sur l'avenir du continent, alors qu'il a déjà été directement impliqué dans de nombreux projets destructeurs.
L'intérêt pour l'Afrique de la part de l'UE et des acteurs individuels de ce commonwealth, comme l'Allemagne et la France, est également remarquable. Paris a récemment perdu une partie de son influence, tandis que Berlin tente de promouvoir sa propre feuille de route, qui a les mêmes objectifs que ceux de Washington.
De manière révélatrice, la publication de la stratégie a coïncidé avec la tournée d'Anthony Blinken en Afrique du Sud, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Ses déclarations étaient clairement anti-russes. En particulier, il a parlé négativement des activités des sociétés militaires privées russes au Mali et en République centrafricaine, qui aident beaucoup les gouvernements à établir la paix et la stabilité.
En outre, le secrétaire d'État américain s'est rendu en Égypte, en Éthiopie, en Ouganda et en République du Congo en juillet. Cela témoigne du travail systématique de Washington dans la région. Mais si Moscou est évoquée dans le contexte de la crise en Ukraine et de l'interaction des forces de sécurité, Pékin est une question plus ample pour la Maison Blanche.
Le fait est que la Chine est depuis de nombreuses années le premier partenaire commercial de l'Afrique, où le chiffre d'affaires commercial atteint 200 milliards de dollars par an. Plus de 10.000 entreprises chinoises sont présentes dans les pays africains. En 2020, le Fonds de développement des infrastructures de l'initiative "la Ceinture et la Route" d'un milliard de dollars a été créé, et deux ans plus tôt, un programme d'aide de 60 milliards de dollars à l'Afrique a été approuvé [iii].

Depuis 2011. La Chine a été l'un des principaux donateurs et investisseurs dans les projets d'infrastructure en Afrique et il est peu probable que les États-Unis rattrapent et dépassent rapidement Pékin à cet égard.
En outre, la Chine a précédemment payé les dettes d'un certain nombre de pays africains dans le cadre d'engagements internationaux, ce qui a été perçu positivement à la fois par les élites politiques et les sociétés africaines, malgré la propagande anti-chinoise occidentale accusant Pékin de mener des politiques néocoloniales et de s'endetter. Il n'existe aucun souvenir historique négatif d'une présence chinoise en Afrique et le propre passé de la Chine offre un espoir de développement aux pays africains également.
La Chine a également un intérêt direct dans la stabilité à long terme de l'Afrique, car environ un tiers du pétrole entrant dans l'Empire du Milieu est extrait et exporté depuis des pays africains (Soudan, Angola et Nigeria). Et environ 20 % supplémentaires du coton qui entre en Chine sont également d'origine africaine. Sans parler des autres produits - des fruits et légumes aux minéraux. Pékin s'efforcera donc activement de maintenir son influence.
L'intérêt pour l'implantation de bases militaires tient précisément à ces raisons. La stratégie du "collier de perles" de la Chine repose sur la Corne de l'Afrique, puis se poursuit par voie terrestre dans le Heartland africain.
En termes de cyberinfrastructure, la Chine met en œuvre le projet Digital Silk Road en Afrique. Ce projet est en grande partie mené par ZTE, qui a déjà obtenu des contrats d'une valeur de 2,7 milliards de dollars grâce à des prêts [iv]. Ce n'est pas une nouvelle pour Washington. Divers groupes de réflexion américains proches du gouvernement parlent depuis longtemps de l'influence croissante de la Chine en Afrique [v].
Cela dit, les évaluations concernant les intérêts américains ont varié. Par exemple, la RAND Corporation a noté dans une étude sur le sujet que "la Chine n'est pas nécessairement une menace stratégique pour les intérêts américains" [vi]. Mais sous l'administration de Donald Trump, la rhétorique anti-chinoise aux États-Unis a augmenté. Et bien que les démocrates aient été assez critiques envers Trump sur de nombreuses questions de politique étrangère, la ligne de confrontation avec Pékin s'est poursuivie.
Les groupes de réflexion américains continuent de développer des solutions différentes à de nombreux dossiers, de Taïwan aux relations bilatérales. L'Afrique n'est pas oubliée non plus. Dans le même temps, les critiques à l'égard de Pékin sont reprises par les satellites européens des États-Unis. Certains médias mondialistes continuent de colporter des mythes anti-Chine et de faire l'éloge des Etats-Unis.
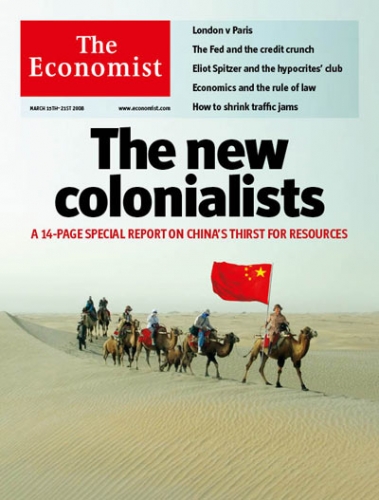
Par exemple, The Economist a écrit en mai 2022 que "la Chine fait preuve de plus d'audace dans ses relations avec l'Afrique. Xi Jinping et ses émissaires s'engagent régulièrement avec l'Afrique ; lors des sommets triennaux Chine-Afrique, les dirigeants chinois aiment promettre haut et fort de nouveaux fonds et programmes".
L'Amérique apporte une contribution précieuse à l'Afrique, mais de manière moins visible. Ses forces armées aident les gouvernements africains à lutter contre les groupes extrémistes. Elle a investi massivement dans l'amélioration de la santé publique en fournissant des vaccins contre le covid de fabrication occidentale qui fonctionnent mieux que les vaccins chinois (et sont gratuits).
En avril, l'administration a alloué plus de 200 millions de dollars d'aide à la Corne de l'Afrique en réponse à la crise alimentaire exacerbée par la guerre de la Russie en Ukraine. Il n'y a généralement rien de mal à faire connaître les efforts occidentaux pour soutenir la démocratie, qui reste la forme de gouvernement la plus populaire parmi les Africains. Et M. Biden devrait également se rendre en Afrique.
Une approche occidentale moins condescendante serait opportune. Les gouvernements africains n'attendent plus de la Chine des prêts énormes et des méga-projets. La condescendance de la Chine à l'égard de Vladimir Poutine et son approche punitive à l'égard de pays comme la Lituanie rappellent qu'elle aussi peut être une brute.
Depuis 20 ans, la Chine est le principal partenaire des gouvernements africains qui cherchent à transformer leurs économies. La plupart des politiciens africains et leurs citoyens ont apprécié les avantages découlant de cette relation. Mais se tourner vers la Chine a souvent été la seule option. L'Occident doit offrir une alternative" [vii].
En théorie, si l'Occident voulait établir son influence en Afrique, il devrait le faire. Mais le problème est que l'Occident ne peut offrir aucune alternative. La seule chose qu'il peut essayer de faire est d'investir davantage dans divers grands projets. Le fait est que si la Chine investit beaucoup, ce n'est pas beaucoup pour l'Afrique dans son ensemble, et il faut plus d'argent pour le développement des infrastructures [viii].
Mais il y a ici une question de conditions. L'Occident n'a pas l'habitude de donner de l'argent ou des prêts sans exigences politiques. De ce fait, les prêts chinois sont plus attractifs. En outre, il existe d'autres opportunités, comme la banque BRICS (où l'Afrique du Sud est l'un des membres de ce club) ou l'activité d'autres acteurs de la région, comme l'Iran et la Turquie.
Comprenant cela, les États-Unis ne sont pas susceptibles de concurrencer directement la Chine, mais ils essaieront d'occuper des niches vides et d'étendre leur présence là où ils ont une position crédible. Il est probable que parallèlement à cela, les États-Unis et leurs agents mèneront une guerre de l'information contre la Chine, vilipendant par tous les moyens possibles toute initiative de Pékin.
La probabilité d'utiliser la diaspora africaine vivant aux États-Unis est élevée. À tout le moins, cette option est indiquée dans la stratégie. Toutefois, même une action aussi limitée de Washington pourrait avoir des conséquences désagréables pour les pays africains, car elle limiterait leur souveraineté d'une manière ou d'une autre. Et l'enracinement de l'armée et des services de renseignement américains sous le prétexte de la sécurité menacera la stabilité de la région.
Notes:
[i] https://www.whitehouse.gov/briefing-room/press-briefings/2022/08/07/background-press-call-by-senior-administration-officials-previewing-the-u-s-strategy-toward-sub-saharan-africa/
[ii] https://www.prosperafrica.gov/
[iii] https://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2019/10/03/what-china-is-really-up-to-in-africa/?sh=5eb7ba1f5930
[iv] https://static1.squarespace.com/static/5652847de4b033f56d2bdc29/t/610844c1b59c8123f42a0c3e/1627931842061/PB+60+-+Tugendhat+and+Voo+-+China+Digital+Silk+Road+Africa.pdf
[v] https://www.csis.org/programs/africa-program/archives/china-africa
[vi] https://www.rand.org/pubs/research_briefs/RB9760.html
[vii] https://www.economist.com/special-report/2022-05-28
[viii] https://www.fpri.org/article/2022/01/chinese-economic-eng...
18:50 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afrique, affaires africaines, politique internationale, géopolitique, états-unis, chine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 02 juin 2022
L'Afrique, les pays BRICS et les républicains américains bloquent le traité mondial de l'OMS sur la pandémie!

L'Afrique, les pays BRICS et les républicains américains bloquent le traité mondial de l'OMS sur la pandémie!
Par Shabnam Palesa Mohamed
Source : https://unser-mitteleuropa.com/afrika-brics-staaten-und-us-republikaner-blockieren-globalen-who-pandemievertrag/
Comme pour la lutte contre le diktat mondial de Corona, de nombreux pays du Sud, et en particulier ceux d'Afrique, sont à nouveau à la pointe de la résistance. En effet, le très controversé traité mondial de l'OMS sur les pandémies, qui vise à mettre en place une dictature mondiale de la santé au-dessus du statut constitutionnel des États-nations souverains, est rejeté dans ces pays. Au Brésil et dans d'autres parties du monde, on se défend également. Le président brésilien Jair Bolsonaro a déjà annoncé qu'il ne soutiendrait pas le traité de l'OMS - nous en avons parlé.
Afrique, Brésil, Russie, Chine et autres
Dans une rare démonstration de puissance et de solidarité africaine, plusieurs États membresd'Afrique se sont opposés aux modifications proposées au Règlement sanitaire international (RSI) qui ont été discutées cette semaine à l'Assemblée mondiale de la santé 75 (AMS) - une mesure dont beaucoup pensent qu'elle pourrait ébranler la domination de l'Organisation mondiale de la santé.
Une source bien placée a fait savoir que "la résolution sur les modifications du RSI n'a pas été adoptée à l'AMS, car les pays africains craignaient que les consultations entre les États membres soient insuffisantes et que le processus soit précipité. Le Botswana a lu la déclaration au nom des 47 membres de l'AFRO et j'y étais personnellement présent".
Selon Reuters, "si l'Afrique continue à refuser son soutien, elle pourrait bloquer l'une des seules réformes concrètes attendues de la réunion, réduisant ainsi à néant l'espoir que les membres s'accordent sur des réformes visant à renforcer les règles de l'Organisation des Nations unies pour la santé, qui s'efforce de jouer un rôle central dans la gouvernance mondiale de la santé".
Le RSI vise à définir et à préciser les obligations des membres de l'OMS en matière d'urgences de santé publique et d'autres questions de santé. Le gouvernement des États-Unis a proposé 13 amendements controversés au RSI qui confèrent au directeur général de l'OMS, Tedros, le pouvoir unilatéral de déclarer des urgences sanitaires réelles ou potentielles et d'attendre une réponse dans les 48 heures.
Le projet de proposition, qui n'a pas encore fait l'objet d'une décision formelle, vise également à modifier l'article 59 du RSI et permettrait d'accélérer la mise en œuvre des futurs changements.
Les Africains hostiles
Il convient de rappeler que certains pays ont présenté à l'AMS des projets de résolution sur le RSI qui, selon la procédure de l'OMS, prennent au moins quatre mois pour être examinés. Ces pays sont l'Australie, la Bosnie-Herzégovine, la Colombie, l'Union européenne et ses États membres, le Japon, Monaco, la République de Corée, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et les États-Unis d'Amérique.
La délégation africaine #WHA75 a exprimé des réserves sur ces modifications du RSI et a déclaré que toutes les réformes devraient être abordées ultérieurement dans le cadre d'un "paquet holistique".
"La région africaine partage le point de vue selon lequel le processus ne devrait pas être précipité", a déclaré mardi à l'Assemblée Moses Keetile (photo), secrétaire d'Etat adjoint au ministère de la Santé du Botswana, au nom de la région africaine.

"Nous pensons qu'ils vont trop vite et que ce type de réforme ne peut pas être mené à la hâte", a déclaré un délégué africain inquiet à Genève. La représentation américaine à Genève n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.
BRIMI fait son apparition : Brésil, Russie, Iran, Malaisie et Inde
Le Brésil et la Russie font partie de l'initiative BRICS qui regroupe le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. L'Iran et la Malaisie auraient également exprimé des réserves sur les modifications proposées du RSI, tandis que la Russie et le Brésil semblent vouloir prendre des mesures importantes en matière de politique de santé internationale ou peut-être même quitter l'OMS. Entre-temps, l'Inde a fait part de ses préoccupations concernant des irrégularités dans les finances de l'OMS.
Un observateur de l'Assemblée mondiale de la santé issu de la société civile a fait savoir: "Juste pour votre information, l'équipe indienne a déclaré hier au Comité des finances qu'elle était très déçue que son audit ait été ignoré par l'OMS".
Calendrier, double emploi et gaspillage de ressources financières
Les discussions sur les modifications du RSI se déroulent parallèlement aux discussions sur un nouveau traité potentiel sur la pandémie (#PandemicAccord), ce qui suscite des inquiétudes quant aux doubles emplois et au gaspillage des ressources financières pour l'OMS.
Compte tenu de l'évolution de la situation, il semble que les amendements au RSI et le nouvel accord sur les pandémies, s'ils aboutissent, seront tous deux appliqués au monde en 2024, à moins que les pays ne décident de réduire le pouvoir de l'OMS et d'assumer la responsabilité de leur santé.
Cette date de 2024 a été soulignée par le groupe de travail sur les modifications du RSI : "Les délégués ont accueilli favorablement le rapport final du groupe de travail sur le renforcement de la préparation et de la réponse de l'OMS aux urgences sanitaires, qui proposait notamment une procédure pour d'éventuelles modifications du RSI (2005). Ils sont convenus de maintenir le groupe avec un mandat et un nom modifiés ("Groupe de travail sur les modifications du RSI" (WGIHR)) afin de travailler exclusivement sur l'examen des propositions de modifications du RSI. Les États membres ont également demandé au directeur général de convoquer un comité d'examen du RSI chargé de formuler des recommandations techniques sur les modifications proposées qui pourraient être présentées. Le groupe de travail proposera un ensemble de modifications ciblées pour examen par la soixante-dix-septième Assemblée de la santé".
"Plusieurs pays en développement ont exprimé le fait que l'OMS a trop de plates-formes de négociation et que cela n'est tout simplement pas gérable", a déclaré Nithin Ramakrishnan, conseiller du Third World Network.
Les sénateurs américains s'opposent à la surfacturation de l'OMS
Selon le Daily Caller, le sénateur républicain Ron Johnson (photo) "a présenté jeudi un projet de loi qui s'oppose à la surfacturation de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et assure au Sénat le contrôle du traité sur la pandémie.
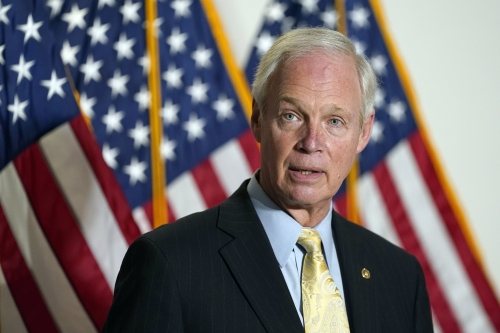
The Daily Caller a été le premier à recevoir la législation intitulée No WHO Pandemic Preparedness Treaty Without Senate Approval Act (Pas de traité de préparation à une pandémie de l'OMS sans l'approbation du Sénat), menée par Johnson et comptant 15 cosignataires. Le projet de loi mentionne la création par l'OMS d'un organe intergouvernemental de négociation (INB) et, s'il est adopté, exigerait que tout accord élaboré par l'INB soit soumis au Sénat sous la forme d'un contrat afin d'offrir une plus grande transparence à l'administration.
Les législateurs estiment qu'ils doivent engager la bataille pour empêcher l'OMS de créer une INB.
"L'Organisation mondiale de la santé, avec nos autorités sanitaires fédérales, a lamentablement échoué dans sa réponse au COVID-19. Leur échec ne devrait pas être récompensé par un nouveau traité international qui renforcerait leur pouvoir au détriment de la souveraineté américaine. Ce dont l'OMS a besoin, c'est de plus de responsabilité et de transparence", a déclaré Johnson au Daily Caller avant la présentation officielle du projet de loi.
"Ce projet de loi indique clairement à l'administration Biden que tout nouvel accord de l'OMS sur les pandémies doit être considéré comme un traité et soumis au Sénat pour ratification. La souveraineté des États-Unis n'est pas négociable", a poursuivi Johnson.
17:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : oms, actualité, afrique, affaires africaines, brics, républicains américains |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 24 mars 2022
Le Congo des Congolais : un désastre en devenir
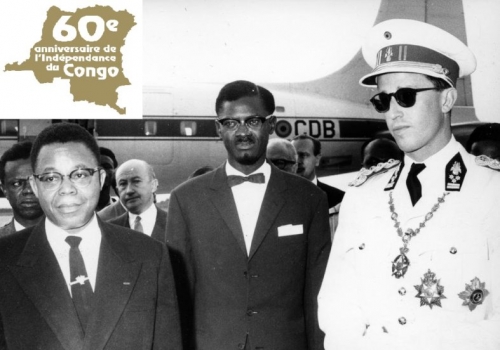
Le Congo des Congolais : un désastre en devenir
Marco Valle
Source: https://it.insideover.com/storia/il-congo-dei-congolesi-un-disastro-annunciato.html
Quelques mois avant l'indépendance, les autorités coloniales semblaient encore convaincues de la solidité de leur pouvoir au Congo (belge). C'était de la folie, et pourtant, en août 1959, un rapport officiel affirmait que "l'autonomie (et non pas l'indépendance ; nda) sera le résultat d'un développement contrôlé et progressif, à long terme". Dix mois plus tard, le Congo belge, en tant que tel, a disparu de la carte.
Que s'est-il passé ? Beaucoup de choses. Après la Seconde Guerre mondiale, dans l'indifférence des autorités endormies, un petit groupe de jeunes intellectuels congolais, pour la plupart formés dans les missions catholiques, a commencé à s'organiser, à s'unir. A faire de l'agitation. Des segments de plus en plus importants des classes urbaines africaines ont commencé à se rassembler (et à se diviser) autour de l'ancien séminariste Joseph Kasa Vubu - de l'ethnie Bakongoko - et de son groupe Abako, ou à suivre le cercle Conscience africaine de l'abbé Joseph Malula et de Joseph Ileo.
En 1956, Malula et Ileo publient un Manifeste dans lequel, répondant à l'hypothèse de van Bilsen, ils exposent une synthèse entre être européen et être africain au sein d'une future grande communauté belgo-congolaise. Kasa Vubu rejette catégoriquement les propositions gradualistes de ses rivaux et rédige son propre document, beaucoup plus radical, qui envisage la création rapide d'un Congo indépendant mais, surtout, fédéral, respectueux des groupes ethniques et pluraliste. Il s'agissait d'un débat important auquel Bruxelles n'a pas prêté attention. Pourquoi pas ? Giovanni Giovannini, un témoin de l'époque, répond brutalement : "Pourquoi le devrait-il ? Quels étaient les partisans de ces chefs de petites associations tribales : tous ces gens qui, de plus, dépendaient pour leur nourriture quotidienne du salaire de l'administration et qui pouvaient, par conséquent, être facilement rappelés à l'ordre par le chef du bureau, sans même avoir recours aux gendarmes?". En bref, les Belges se sont appuyés sur les tensions tribales, la fragmentation sociale, l'arriération des masses et, surtout, ont sous-estimé les anciens élèves des missions catholiques. Une erreur : les prêtres sont de bons enseignants.
Les résultats du 8 décembre 1957 se sont avérés surprenants. Pour citer à nouveau Giovannini, "contrairement aux prédictions des colons, 84,7% des électeurs de Léopoldville se sont rendus aux urnes. Les Abako ont remporté la majorité absolue : 78,2% des voix, 133 des 170 sièges du conseil mis à la disposition des Noirs. Ainsi, ce ne sont pas seulement les bakongoko qui ont voté pour Abako, mais aussi les bangalas, les balubas et autres des innombrables groupes ethniques ; c'était une prise de position en faveur du "contre-manifeste" d'Abako. Le nationalisme africain contre le colonialisme belge".

Mais Kasa Vubu (photo, ci-dessus) n'était pas le seul champion de l'indépendance. Avec le soutien décisif des partis belges, le Mouvement National Congolais prend forme en octobre 1958, dirigé par le catholique Ileo et le socialiste Cyrille Adula ; dans les intentions des promoteurs, le MNC devait être la réponse modernisatrice, centraliste et gradualiste à la faction ethnique, fédéraliste et extrémiste de Kasa Vubu. Afin d'équilibrer les courants internes, les deux dirigeants décident de coopter un sympathisant congolais du parti libéral au sein de la direction et choisissent le directeur adjoint apparemment modéré de la brasserie Polar, Patrice Lumumba (photo, ci-dessous). Personnage excentrique, confus et notoirement malhonnête, mais doté d'un charisme et d'un culot considérable, Lumumba prend rapidement la tête du parti et opère un changement politique radical. En l'espace de quelques mois, le "bon Patrice" est devenu le leader des indépendants, mais les Belges - obtusément convaincus qu'ils le contrôlent - ont continué à lui accorder toutes les facilités et à le favoriser contre Abako.
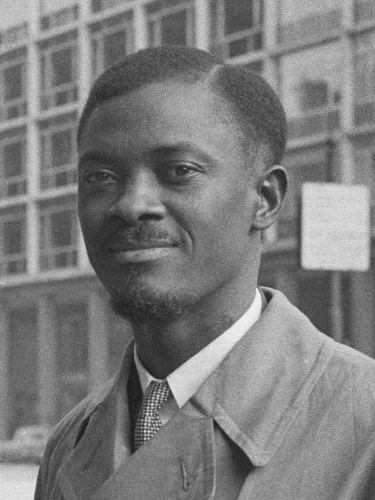
La situation a atteint son paroxysme le 4 janvier 1959. L'interdiction d'un rassemblement de Kasa Vubu a déclenché l'ire d'une foule qui a pris d'assaut les palais du pouvoir, les maisons et les magasins des Européens, les hôpitaux et les églises. Après trois jours de folie et 49 morts, le soulèvement est réprimé mais l'impact psychologique, tant pour les Blancs que pour les indigènes, est énorme. Tant au Congo qu'en Belgique, l'incertitude, le malaise et l'urgence étaient omniprésents : les facteurs centraux qui allaient influencer chaque étape politique de la crise, jusqu'à l'acte final.
Le 13 janvier, Baudouin stupéfie une nouvelle fois le monde politique par un message dans lequel il reconnaît le principe d'une indépendance accordée "sans retard fatal ni imprudence téméraire". Une démarche téméraire qui visait à relancer le projet d'un trône africain pour Léopold III - relançant la solution des "deux monarchies" - mais désormais irréaliste, hors du temps.
À son tour, le gouvernement, dirigé par Gaston Eyskens, tente de reprendre l'initiative et d'imposer une feuille de route pour une indépendance limitée. Mais le Congo est désormais hors de contrôle et, alors que les incidents se multiplient et que la désobéissance civile s'amplifie, le découragement prend le dessus et paralyse l'administration coloniale. Fin 59, les Belges se retrouvent dos au mur : la seule solution possible pour sortir de l'impasse et retrouver la suprématie est la force. Une hypothèse fortement demandée, comme mentionné ci-dessus, par le souverain mais inacceptable pour les politiciens. Faisant appel à un article de la Constitution de 1893 qui empêchait l'utilisation des troupes métropolitaines dans la colonie - un rappel de la méfiance de longue date du gouvernement à l'égard des entreprises de Léopold II - le gouvernement, en accord avec l'opposition socialiste, exclut toute option militaire. L'ombre de la guerre d'Algérie plane sur la Belgique.
C'était encore une autre erreur. Une intervention limitée mais efficace de l'armée nationale aurait bloqué les dérives maximalistes et contraint les dirigeants africains à modérer leur ton et leurs prétentions. Ayant éclipsé l'hypothèse armée, le pouvoir politique et financier n'a d'autre choix que de négocier avec les Congolais ; le 20 janvier 1960, il convoque à Bruxelles une "table ronde" avec les représentants des différents "partis" africains : radicaux, modérés, unitaires, fédéralistes. Un cirque, mais "malgré de nombreuses divisions, les délégués congolais ont réussi à présenter un front uni et à obtenir l'indépendance le 1er juillet. La réaction apparemment surprenante du gouvernement s'explique par la crainte d'une sécession des colons blancs et, plus généralement, par le souci de garder le contrôle des richesses du pays, même au prix d'une indépendance accordée à la hâte. Une constitution provisoire, rédigée par des juristes belges, tente de concilier les aspirations des partisans de l'unité avec celles des "fédéralistes".
Les élections de mai 1960 donnent la victoire au MNC, mais il ne remporte qu'un tiers des sièges. Lumumba accepte d'élire le fédéraliste Kasa Vubu à la présidence de la république, mais à condition qu'il devienne premier ministre et se réserve le droit d'imposer un pouvoir présidentiel fort une fois l'indépendance acquise. Un traité d'amitié belgo-congolais est signé le 29 juin et le Congo est proclamé indépendant le jour suivant.
17:38 Publié dans Belgicana, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, congo, congo belge, belgicana, afrique, affaires africaines, histoire africaine, colonialisme, indépendance congolaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 février 2022
La guerre au Mali, la raison des discussions Poutine-Macron

La guerre au Mali, la raison des discussions Poutine-Macron
John Helmer
Ex: http://aurorasito.altervista.org/?p=22543
Les dommages que les empires européens ont causés à l'Afrique, en particulier les Britanniques, les Français et les Italiens, ont toujours été mis en accusation publique à Moscou: depuis la politique des tsars russes à l'Union soviétique et au président Vladimir Poutine. C'est lors de la conférence des Alliés à Potsdam, en juillet 1945, que le dirigeant soviétique Josef Staline a pris la peine de dire au président américain Harry Truman, ainsi qu'au premier ministre britannique Winston Churchill, que l'Union soviétique voulait prendre en charge la tutelle de la Libye sous le protectorat de l'ONU, et ainsi assurer la protection des Libyens contre le retour de la domination coloniale italienne. Churchill voulait le retour des Italiens ; le département d'État de Truman voulait la même chose, mais ne semblait pas trahir publiquement la promesse faite par Washington en temps de guerre, à savoir que la Libye, où les armées alliées ont vaincu les armées italiennes et allemandes au prix de très nombreuses vies libyennes et de la destruction d'une quantité de biens libyens, deviendrait indépendante.
La politique soviétique en Afrique n'a pas empêché l'US Air Force de transformer la Libye en une base nucléaire contre l'URSS. Mais le 1er septembre 1969, lorsque Mouammar Kadhafi a destitué le roi de Libye, son gouvernement et la base aérienne de Wheelus, une force navale soviétique de soixante-dix navires, dont le porte-avions Moskva, a occupé la mer entre la Crète et la côte libyenne, protégeant Kadhafi de l'intervention américaine et britannique. Depuis la reprise de l'intervention nord-américaine, française et britannique en Libye en 2011, et l'assassinat de Kadhafi en octobre de la même année, M. Poutine a publiquement répété qu'il regrettait l'inaction du président de l'époque, Dmitri Medvedev, qui s'était opposé à ces deux événements. Ce qui a suivi en Libye, a répété M. Poutine, a conduit à des guerres désastreuses dans les États africains au sud de la Libye, notamment au Mali, et à un afflux de réfugiés africains de la Libye vers l'Europe.
Les organes de propagande anglo-américains et européens accusent désormais le Kremlin d'intervenir militairement au Mali et dans d'autres États africains avec les opérations du Groupe Wagner. Cette question est apparue directement lors des six heures d'entretien de M. Poutine avec le président Emmanuel Macron au Kremlin. Il en a été ouvertement question lors de la conférence de presse qui a suivi.
La guerre au Mali n'a pas été identifiée comme une question importante dans les déclarations à la presse préparées par Poutine ou Macron.
Au lieu de cela, lors de la séance de questions-réponses, un journaliste français a demandé à Poutine : "Quant au Mali, pouvez-vous dire que votre gouvernement n'est en aucun cas lié aux mercenaires du Mali ?" Poutine a répondu : "Tout d'abord à propos du Mali. Le président Macron a soulevé cette question à plusieurs reprises, nous en avons discuté avec lui et le président Macron connaît notre position. Le gouvernement russe, l'État russe n'ont rien à voir avec les entreprises qui travaillent au Mali. Pour autant que nous le sachions, les dirigeants maliens n'ont pas à se plaindre des activités commerciales de ces entreprises". "Suivant la logique qui peut être appliquée à l'OTAN, aux États membres actuels et aux membres potentiels, si le Mali a choisi de travailler avec nos entreprises, il a le droit de le faire. Mais je tiens à souligner, j'en parlerai au président Macron après cette conférence de presse, je tiens à souligner que l'État russe n'a rien à voir avec ces entreprises. C'est lié aux intérêts commerciaux de nos entreprises, qui coordonnent leurs activités avec les autorités locales. Nous allons y jeter un coup d'œil, mais nous n'avons rien à voir avec cela. C'est le premier point".
Macron n'a pas fait de commentaire.

Macron et Poutine ont de nouveau été invités par un journaliste français à aborder la question du Mali. "M. Macron, pourriez-vous également répondre à la question concernant la présence de PMC Wagner et si la Russie est impliquée de quelque manière que ce soit ?" Poutine a répondu: "J'ai déjà traité cette question. J'ai déjà précisé que l'État russe n'a rien à voir avec cela. Je dis cela de manière tout à fait responsable, sans aucune intention cachée. Les autorités locales les invitent au niveau de l'État, les remercient pour leur travail, etc."
Macron a déclaré: "En ce qui concerne le groupe Wagner, la réponse du président est très claire. La France ne reconnaît que les États et la lutte contre le terrorisme. Par conséquent, nous prenons des décisions en matière de lutte contre le terrorisme à l'égard des États souverains et en étroite coordination avec la région. Dans ce cas, nous consultons la CEDEAO et l'Union africaine".
Le lendemain des négociations du Kremlin, un article détaillé sur les opérations françaises au Mali et l'implication du groupe Wagner a été publié dans la publication moscovite Vzgljad ("Point de vue"). En raison de la qualité de l'analyse des arguments stratégiques et des sources, Vzgljad peut être interprété comme reflétant les évaluations des services de renseignement russes. Cette évaluation de la guerre au Mali, qui replace dans leur contexte les commentaires de Poutine et de Macron au Kremlin, a été rédigée par le journaliste de Vzgljad Evgenij Krutikov. Et il n'a cité aucune source.

Comme la Russie a humilié la France en Afrique, les combats dans le désert ont leurs propres caractéristiques
Evgenij Krutikov
Ces dernières années, l'Afrique occidentale est devenue une région où la France a rapidement perdu son ancienne influence. Mais là-bas, on entend parfois exprimer de la gratitude envers les citoyens russes, et cela rend Paris très nerveux. Pourquoi ce qui se passe place-t-il la France dans une position extrêmement inconfortable, et comment la Russie y est-elle parvenue ?
Outre la situation en Ukraine, la situation en Afrique de l'Ouest a également été évoquée lors de la rencontre entre Vladimir Poutine et Emmanuel Macron. Ce qui se passe à Paris est perçu de manière extrêmement douloureuse et, après tout, des citoyens russes y participent également. Une situation particulière s'est développée au Mali, où les nouveaux dirigeants militaires ont expulsé l'ambassadeur français après que Paris a commencé à la qualifier de "junte illégitime". Selon diverses sources, plusieurs centaines de Russes étaient arrivés au Mali, vraisemblablement par le biais de sociétés militaires privées.
Au cours de la rencontre, Vladimir Poutine a expliqué à Emmanuel Macron la situation de l'implication russe au Mali. Concernant le Mali, M. le Président [de la France] a soulevé cette question à plusieurs reprises, nous en avons discuté et il connaît notre position. Le gouvernement russe, l'État russe n'a rien à voir avec les entreprises opérant au Mali. Selon la logique générale relative à [la politique de] l'OTAN et des membres de l'alliance, si le Mali fait le choix de travailler avec nos entreprises, il a le droit de le faire. L'État russe n'a rien à voir avec cela", a souligné une nouvelle fois M. Poutine.
Dans ce contexte, la République centrafricaine (RCA) a une nouvelle fois évoqué le rôle positif des instructeurs militaires russes. La Russie a aidé les autorités de la RCA à rétablir l'ordre dans le pays en l'espace d'un an, alors que l'Occident n'a pas réussi à le faire pendant des décennies. C'est ce qu'a déclaré l'ambassadeur de la RCA auprès de la Fédération de Russie, Leon Dodon-Punagaza, comme le rapporte RIA-Novosti. Avec les Français, les Nord-Américains et les autres, combien d'années avons-nous été amis et qu'ont-ils fait ? De tels groupes militaires n'ont pas apporté la paix à la République centrafricaine depuis des années", a noté le diplomate. Il a remercié Moscou pour son aide et a noté que la situation dans la république avait été terrible. D'un point de vue militaire, la situation au Mali est radicalement différente de celle de la RCA. En Afrique centrale, il y avait un enchevêtrement de conflits internes. Au Mali et dans certains pays voisins (Burkina Faso, Niger), on assiste à une invasion de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda et à l'État islamique.
La majeure partie du territoire malien est semi-désertique (Sahel) ou désertique sableux ; les forêts tropicales n'occupent qu'une petite partie du pays, au sud. En conséquence, la population du Mali est composée d'une proportion inégale de deux groupes ethniques non apparentés : les Noirs (Mandika, Fulbe, Bambara et autres) dans le sud et le centre du pays, et les Touaregs dans le désert du nord. Plus de la moitié de la population malienne vit dans la partie sud du pays, tandis que les Touaregs (environ 10% de la population) occupent formellement une grande partie du Sahel et du désert. Les Touaregs ont longtemps réclamé l'indépendance, puis l'autonomie et enfin des révoltes armées. Mais ces dernières années, la menace extérieure commune, sous la forme de djihadistes venus du territoire voisin de la Libye détruite, a uni les groupes ethniques du Mali. Les chefs touaregs ont officiellement abandonné le conflit avec le gouvernement central du Mali et ont demandé de l'aide contre les djihadistes. Nous parlons donc exclusivement de la lutte contre le terrorisme dans sa tournure djihadiste classique. En outre, les Touaregs étaient extrêmement effrayés par le comportement des djihadistes : la destruction de célèbres monuments historiques à Tombouctou et les exécutions publiques selon la charia. Les combats se sont déroulés dans le semi-désert et le désert. Les détachements djihadistes utilisent des tactiques de raid classiques, se retirant périodiquement dans le Sahara libyen où il est presque impossible de les atteindre. De plus, les djihadistes tendent régulièrement des embuscades sur la seule route menant au Diré et à Tombouctou.

Dans une telle situation, il ne vaut pas la peine d'attendre un effet rapide ("le garde forestier russe est arrivé et a dispersé tout le monde"), comme ce fut le cas, par exemple, en RCA. Ces attentes sont gonflées par le comportement passif des Français et des petits contingents européens qui les ont rejoints dans le cadre des opérations Serval et Barkhane (par exemple, la Lettonie a héroïquement envoyé quatre soldats au Mali).
Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché avec les Français ? Lors de la première phase de l'opération Serval en janvier 2013, les Français utilisaient activement des avions de combat Mirage et Rafale pour bombarder tout ce qui bougeait dans le nord-est du Mali. Ils ont ensuite envoyé 500 parachutistes et toute l'armée malienne à Tombouctou. Les djihadistes n'ont pas pu résister et, en février, les Français ont occupé Tombouctou. Et là, ils ont construit une base, maintenant occupée par les Russes. C'est un succès incontestable, car les Maliens ne pouvaient pas faire face aux djihadistes par eux-mêmes. Il ne faut donc pas croire que les Français ont toujours été inactifs. De plus, les Français ont fait face à une forte résistance inattendue et ont décidé de se réorganiser. Ils ont eu la révélation que les barbus enturbannés de Libye étaient bien entraînés, qu'ils disposaient d'armes modernes et qu'ils étaient prêts à résister jusqu'au bout.
Lors de la " bataille pour la ville de Kona ", mi-janvier 2013, les Français ont perdu un hélicoptère et son équipage, abattus par des djihadistes. Cela a rendu les Français très tendus. Le résultat est la nouvelle opération "Barkhane". Selon l'idée de Paris, il s'agissait d'entourer le semi-désert d'un réseau de bases militaires au Tchad, au Mali, au Burkina Faso, en Mauritanie, au Sénégal et en Côte d'Ivoire et d'étrangler les djihadistes en les privant de ravitaillement. À partir de ce moment, le comportement des Français et des alliés (50 soldats sont envoyés par un autre guerrier nordique épique, l'Estonie ; plusieurs centaines sont envoyés par l'Allemagne) devient exceptionnellement passif.
L'objectif était d'utiliser des hélicoptères (britanniques et allemands) pour détruire les caravanes des djihadistes dans le désert et mener des opérations d'assaut ciblées. Mais il est vite apparu que les hélicoptères livrés au Mali n'étaient pas adaptés aux opérations dans le désert et que leur blindage était insatisfaisant, même pour les tirs d'armes légères depuis le sol. Les hélicoptères sont inutilisables, ce qui rend l'opération Barkhane inutile, car la pénétration dans le désert devient techniquement impossible. Au moindre contact avec le feu terrestre, les Français se cachent dans leurs bases. Le commandant de l'opération, le général Pierre de Villiers, a interrogé Paris sur l'élargissement de l'opération et le changement de tactique, mais n'a reçu aucun soutien et a démissionné. Le conflit entre un représentant de l'une des plus anciennes familles aristocratiques de France et le président Macron en est venu à ce que ce dernier renvoie de Villiers de l'armée.

En novembre 2019, les Français ont tenté de mener une opération d'envergure au carrefour de trois frontières - Mali, Burkina Faso et Niger. Mais dans une tempête de sable, les hélicoptères ont été perdus ; deux sont entrés en collision et 13 soldats français sont morts. Par la suite, l'opération Barkhane a été réduite à des opérations de routine. Les Français ont commencé à accuser ouvertement les FAMA, l'armée malienne, et non eux-mêmes, d'inaction. Dans le même temps, ils n'ont même pas levé le petit doigt pour renforcer la FAMA ; au contraire, ils l'ont traitée comme un auxiliaire. Et ce, malgré le fait que les Maliens avaient subi de lourdes pertes dans des batailles terrestres que les Français évitaient traditionnellement. Cela a irrité les Maliens et créé un contexte émotionnel négatif pour les Français, car leur comportement rappelait une relation coloniale et non un partenariat égalitaire.
Avec les Russes, c'est le contraire. Au départ, il avait été annoncé qu'ils ne participeraient pas aux combats mais qu'ils formeraient les Maliens. Les premiers instructeurs de l'ancienne base française de Tombouctou ont été engagés dans la formation du personnel. Mais dans le même temps, les estimations occidentales du nombre de Russes variaient considérablement. Par appréhension, leur nombre a été exagéré à 500. Selon des estimations plus modestes, ils seraient entre 200 et 300. Tout a commencé avec quatre instructeurs. Leurs photos ont été activement publiées dans les médias français. Sur le plan purement militaire, il s'agit pour l'instant d'établir un contrôle total de l'autoroute Bamako-Timbuktu (Tombouctou). C'est là qu'a eu lieu le premier affrontement, auquel, vraisemblablement, les Russes ont pris part. Un convoi de l'armée malienne est tombé dans une embuscade près de Bandiagara, dans le centre du pays. Il a été rapporté qu'un véhicule blindé de transport de troupes avait sauté par-dessus une mine, après quoi une fusillade a eu lieu et l'un des Russes aurait été blessé. On parle de plusieurs djihadistes tués au Mali, mais ce qui est absolument certain, c'est qu'il n'y avait pas de "prisonniers" parmi les Russes.
Des sources françaises insistent sur le fait que la nouvelle direction militaire du Mali mène délibérément une opération visant à chasser la France de la région et coordonne virtuellement cette ligne avec plusieurs pays voisins. Après l'expulsion démonstrative de l'ambassadeur de France de Bamako, voici ce qu'il en est à Paris. Aujourd'hui, le quartier général de l'opération militaire française (si on peut encore l'appeler ainsi) est transféré en Côte d'Ivoire, fidèle à Paris, dans la plus grande ville de ce pays : Abidjan. Les Français s'enlisent. D'une part, l'opération militaire en Afrique de l'Ouest a effectivement échoué. D'autre part, d'une certaine manière, il ne faut pas l'admettre. Mettre fin à l'opération Barkhane et s'envoler, c'est perdre la face et, de plus, admettre que les tactiques russes se sont avérées plus efficaces.
Pour être tout à fait honnête, il n'est toujours pas clair dans quelle mesure les Russes sont plus efficaces au Mali que les Français qui avancent péniblement dans les dunes depuis des décennies. Il ne sera possible de fournir des estimations précises qu'à la fin de cette année, lorsqu'il sera possible de former quelque chose de prêt au combat dans les FAMA, comme cela a été fait en RCA. Quoi qu'il en soit, la situation en Afrique de l'Ouest a radicalement changé, mais pas en faveur de la France, et ce avec l'aide de centaines de Russes (le fameux "garde forestier"). Si cette tendance se poursuit, les perspectives de sauver la face pour Paris seront de plus en plus minces".
Traduction par Alessandro Lattanzio
18:07 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, vladimir poutine, emmanuel macron, france, russie, mali, europe, afrique, affaires européennes, affaires africaines, sahel |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 04 février 2022
La dérive anti-française en Afrique, comment Paris risque de perdre le Sahel

La dérive anti-française en Afrique, comment Paris risque de perdre le Sahel
Mauro Indelicato
Ex: https://it.insideover.com/politica/la-deriva-anti-francese-in-africa-cosi-parigi-rischia-di-perdere-il-sahel.html
Ces derniers jours, le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian n'a pas mâché ses mots à l'égard de la junte militaire qui dirige le Mali depuis mai dernier. Selon le représentant de la diplomatie française, le gouvernement malien actuel est "illégitime" et prend des "mesures irresponsables". Bamako ne l'entend pas de cette oreille. Pour Assimi Goita, le général qui dirige le gouvernement depuis le dernier (d'une longue série) coup d'Etat en mai dernier, Le Drian s'est immiscé dans les affaires intérieures du Mali. Il décide donc d'expulser l'ambassadeur français Joël Meyer, ouvrant ainsi une crise diplomatique sans précédent. Cependant, l'épisode a des origines encore plus lointaines. Et cela ne concerne pas seulement le Mali, mais toute la région du Sahel.
D'où vient le sentiment anti-français
Le Mali, dans la zone francophone du Sahel, a toujours été un pays plutôt "rebelle" par rapport à Paris. En 1962, Bamako décide même d'imprimer sa propre monnaie au lieu du franc Cfa, celui qui est actuellement en vigueur dans la plupart des anciennes colonies françaises d'Afrique de l'Ouest. Le pays a réintégré le groupe en 1984, mais aujourd'hui encore, le débat sur la monnaie est source d'âpres controverses. Même l'un des imams les plus en vue de Bamako, le très populaire Mahmoud Dicko, a, ces dernières années, soulevé les foules en qualifiant le franc Cfa d'outil colonial. Mais c'est dans tous les pays d'Afrique subsaharienne que ces questions trouvent un large écho. Lors des élections sénégalaises de 2019, certains candidats ont proposé la sortie de Dakar de la monnaie unique de l'espace francophone. Au Burkina Faso, depuis 2014, après le coup d'État qui a déposé Compaoré, les effigies de Thomas Sankara sont réapparues et, avec elles, les accusations contre la France d'avoir orchestré l'assassinat du "Che Guevara noir" en 1987.

Au sud du Sahara, il y a un désir de regarder vers des horizons différents. À Bamako, comme dans les autres capitales de la région, les jeunes disposent de smartphones et sont inscrits sur les réseaux sociaux. Ils peuvent donc voir ce qui se passe à l'extérieur et critiquer sévèrement ce qui se passe à l'intérieur de leur pays. Le sentiment d'insécurité lié à la propagation de la pression djihadiste et la crise économique exacerbée par le coronavirus font le reste. Cela a alimenté un sentiment d'impatience à l'égard des classes dirigeantes actuelles et, par extension, de la France, accusée d'apprivoiser des politiciens et des présidents corrompus pour ses propres intérêts. Les versions africaines de l'anti-politique ont ainsi produit des sentiments anti-Paris et encouragé la "contagion" des coups d'État survenus au cours de ces deux dernières années. Entre tentatives et succès, il y a eu au moins sept coups d'État dans six pays différents (deux au Mali seulement) au Sahel depuis 2020. Les militaires sont soutenus par une grande partie de la population car ils sont considérés soit comme de véritables libérateurs, soit comme un moindre mal. Au Mali, comme au Niger, au Burkina Faso, au Tchad et dans d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, pour de nombreux citoyens, il est préférable de traiter avec un militaire qu'avec un politicien lié à la France.
La Russie et la Turquie tentent de prendre pied en Afrique
La décision du général Goita d'expulser l'ambassadeur français s'inscrit dans ce cadre. Ce n'était pas tant un test de force ou de caractère. Il s'agissait plutôt d'un signal politique clair. Bamako veut se détacher de Paris. Et les militaires, de leur côté, veulent jouer sur le sentiment anti-français qui s'est répandu dans tout le Sahel. Presque comme pour montrer que, désormais, les mots de l'Elysée adressés à la junte militaire doivent être mesurés. Aussi parce que Goita essaie de regarder ailleurs. La main de la Turquie est aussi partie prenant dans le feu des protestations au Mali. La popularité de l'imam Dicko montre que les revendications islamiques gagnent du terrain dans l'opinion publique. À l'heure où les signes d'une volonté de changement se multiplient, le poids des institutions religieuses locales ne cesse en effet de croître. Et ce n'est pas un mystère que là où il y a une forte poussée de l'islam politique, la faveur et la ferveur d'Ankara sont derrière. Mais la véritable nouveauté dans le tableau politique de Bamako est son rapprochement avec la Russie.

Au cours de l'été, la junte Goita a signé un accord avec la société d'entrepreneurs Wagner, qui est étroitement liée au Kremlin. Des images de véhicules russes en action à Bamako sont récemment apparues dans les médias français. Un peu comme ce qui se passe en République centrafricaine, un autre pays francophone dont le gouvernement a choisi d'accueillir sur son territoire des hommes et des véhicules de Wagner. Moscou, qui a fait un retour en force en Méditerranée au cours de la dernière décennie, étend désormais son champ d'action également au Sahel et en Afrique subsaharienne. Une inconnue non seulement pour la France, mais pour tout l'Occident. Au Mali, la mission Takuba, à laquelle participent également 200 soldats italiens, est en cours. L'opération, qui a pour but de combattre les groupes djihadistes bien implantés dans le nord du pays, voit la présence de plusieurs contingents européens. Y compris le contingent danois, qui, le 25 janvier, a été considéré comme "indésirable" par le gouvernement de Bamako. Ce choix a conduit aux déclarations de Le Drian et à une crise diplomatique entre le Mali et la France. Que va-t-il advenir de la mission maintenant ? L'UE, par la bouche du haut représentant pour la politique étrangère Josep Borrell, souhaite la maintenir "mais pas à tout prix". La Suède va peut-être retirer ses soldats. Mais Goita, a souligné le diplomate français Nicolas Normand dans les médias transalpins, n'a jamais demandé leur retrait.


Soldats suédois déployés au Mali.
Le choix de Macron
Le président français Emmanuel Macron est pris entre deux feux. D'une part, les opérations au Mali n'ont jamais suscité la popularité. Mais à quelques mois du vote pour les présidentielles françaises, même un retrait complet du pays (et, par extension, d'une grande partie du Sahel) n'aiderait pas à consolider sa réputation. Pour cette raison aussi, l'Elysée prend son temps. Il y a deux éléments qui calment la diplomatie française sur le long terme. D'une part, la conviction que ni la Russie ni la Turquie n'ont intérêt à prendre le relais de Paris. C'est une chose d'entrer furtivement dans la zone, c'en est une autre de gouverner le véritable bourbier économique et politique dans lequel le Sahel est tombé. D'autre part, les observateurs parient sur l'incapacité des nouvelles juntes militaires, tant au Mali que dans d'autres pays. Aucun des généraux qui ont accédé au pouvoir, raisonne l'Elysée, n'est capable à terme de répondre aux demandes de changement formulées par les populations de la région. Enfin, le Mali ne peut se passer de ses relations avec la France, et l'absence d'une demande formelle de mettre fin à l'opération Takuba en est la preuve. Sous la couverture des tiraillements politiques, il existe un dialogue qui ne peut être rompu complètement.
16:54 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, affaires européennes, europe, france, afrique, affaires africaines, géopolitique, politique internationale, mali |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 26 novembre 2021
Comment fonctionne la diplomatie africaine d'Israël

Comment fonctionne la diplomatie africaine d'Israël
Marco Valle
Source : https://it.insideover.com/guerra/come-funziona-la-diplomazia-africana-di-israele.html?fbclid=IwAR0zZXykgsxgEyyyulrjC13Ez9kT-3cQ8ONXQFPRlLjAvMOSAat0l_bLlUY
Pour Israël, l'Afrique est une vieille passion. Dès 1957, Jérusalem ouvre sa première ambassade dans le Ghana nouvellement indépendant ; en 1962, Félix Houphouet-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire et pilier de France Afrique, s'envole vers la terre de David où il noue une solide alliance avec Ben Gourion et Golda Meir, la brillante architecte de la politique étrangère israélienne. Dans les années qui suivent, elle noue des relations fructueuses avec le président kenyan Jomo Kenyatta, avec le Sénégal de Léopold Senghor, l'Éthiopie d'Haïlé Sélassié et le Congo de Mobutu. Une stratégie gagnante et, bien que s'inscrivant dans le contexte de la guerre froide, suffisamment autonome par rapport aux politiques américaines et éloignée (sinon parfois opposée) aux intérêts anglo-français.
La guerre de 1973 marque un recul dans les relations afro-israéliennes. Sous la pression de l'Arabie saoudite et de l'Organisation de l'unité africaine, les pays subsahariens (à l'exception de l'Afrique du Sud de l'apartheid) ont été contraints de rompre leurs relations (du moins formellement). Le fossé a commencé à se refermer avec les accords de Camp David de 1979 entre l'Égypte et Israël, puis les accords de paix d'Oslo signés en 1993 par Rabin et Arafat. À la lumière de ces événements, de plus en plus de capitales africaines (à commencer par Abidjan, Kinshasa et Yaoundé) ont commencé à normaliser leurs relations avec Jérusalem. Au cours de la dernière décennie, ce processus a été accéléré par l'activisme panafricain de Benjamin Netanyahu. Au cours de son long mandat (2009-2020), l'ancien Premier ministre s'est rendu à plusieurs reprises sur le continent, établissant des relations diplomatiques avec 39 des 54 pays africains. Il y a actuellement 13 ambassades israéliennes en Afrique : Kenya, Éthiopie, Angola, Afrique du Sud, Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte, Érythrée, Ghana, Nigeria, Rwanda, Sénégal et Sud-Soudan (le Soudan et l'Ouganda devraient bientôt s'ajouter à la liste, si les troubles internes le permettent). À son tour, le Maroc, après l'accord de décembre 2020, se prépare à établir des relations diplomatiques "complètes" d'ici 2022.

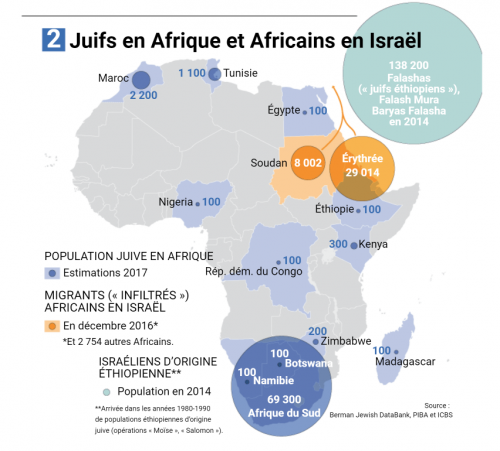
Le théâtre privilégié de l'expansion israélienne est la Corne de l'Afrique. Pas par hasard. Pour l'État juif, il est fondamental - compte tenu du caractère invasif de l'Iran en mer Rouge et dans l'océan Indien - de préserver la sécurité de la route maritime entre le détroit de Bab el Mandeb et Eilat et Suez. D'où son soutien discret mais substantiel à l'Éthiopie, à l'Érythrée et au Kenya et son intérêt marqué pour le Soudan. Les Israéliens sont également bien présents dans le quadrant ouest-africain (Sénégal, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Nigeria, Cameroun) ainsi qu'au Rwanda et en Afrique du Sud, avec de nombreuses entreprises actives dans l'agriculture, dans le domaine de l'énergie (l'énergie solaire en particulier), dans le secteur des technologies avancées et dans le commerce des pierres précieuses, principalement des diamants.
En plus des activités commerciales normales, il y a aussi le secteur militaire. Un réseau d'hommes d'affaires, de consultants de toutes sortes et d'entreprises a travaillé avec une détermination tranquille. Leurs noms ? Gaby Peretz, Didier Sabag, Orland Barak, Hubert Haddad, Eran Romano ou Igal Cohen, tous bien introduits dans les palais présidentiels africains et évidemment liés aux forces armées et aux services israéliens. Comme le confirme la participation toujours plus importante des entreprises à l'exposition Shield Africa d'Abidjan, Jérusalem offre aux différents pays du continent toutes sortes d'armes, des armes légères aux missiles et navires sophistiqués, mais surtout du renseignement, de l'écoute, de la cybersécurité et des blitz numériques. Les guerres du futur.
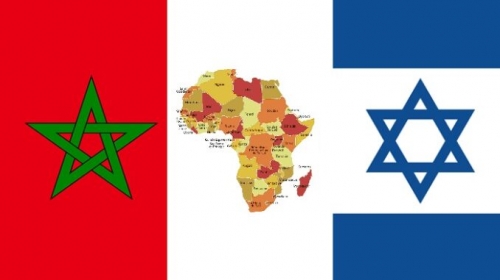
Ce secteur est dominé par Nso, fondé par Shalev Hulio, producteur des redoutables systèmes Pegasus et Verint, puis il y a le groupe Mer et le système Elibit, Sapne Ltd et (peut-être sous des pavillons de complaisance) une myriade de petites entreprises. Le personnel est composé de vétérans de l'Unité 8200, l'équivalent de l'Agence nationale de sécurité américaine, tels que Yair Coehen, ancien commandant de l'unité qui est maintenant à la tête d'Elibit System, ou Aharon Zeevi Farkas, également ancien chef de l'Unité 8200. Une activité extrêmement rentable, mais pas seulement. Les seniors du 8200 - une véritable usine de millionnaires de la haute technologie - sont présents en force, surtout en Côte d'Ivoire, en tant que consultants du ministère de la Défense : en plus d'assurer la sécurité interne de la république africaine, les "grandes oreilles" contrôlent, grâce à un accord officieux entre les gouvernements, également l'importante communauté libanaise, avec une attention particulière pour les sympathisants du Hezbollah, l'ennemi juré d'Israël. Les cyber-guerriers ne se retirent jamais....
11:49 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : israël, afrique, affaires africaines, politique internationale, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 novembre 2021
Entre l'Algérie et le Maroc : le différend franco-espagnol en Méditerranée occidentale

Entre l'Algérie et le Maroc : le différend franco-espagnol en Méditerranée occidentale
Par Vincenzo D'Esposito
Ex: http://osservatorioglobalizzazione.it/dossier/il-triangolo-mediterraneo/tra-algeria-e-marocco-la-contesa-franco-spagnola-nel-mediterraneo-occidentale/
Son rôle de porte de l'Atlantique a fait du Maghreb l'une des zones les plus intéressantes pour les puissances méditerranéennes. Cette zone a été subjuguée à plusieurs reprises par l'Empire ottoman, la France et l'Espagne. Ces deux derniers ont déployé leur concurrence politique et économique dans deux États en particulier : l'Algérie et le Maroc.
Le Maghreb et la France coloniale
L'État dont l'influence est la plus importante au Maghreb est la France qui a pénétré en Algérie dès la première moitié du 19ème siècle; les raisons qui ont poussé Paris à s'ingérer dans les affaires du Maghreb sont principalement des questions de sécurité. Les pirates barbaresques présents dans la région représentaient un danger constant pour le commerce dans la zone et, d'autre part, pour détourner les tensions internes à la monarchie française de l'époque, il fut décidé de prendre possession de la rive sud de la Méditerranée, en face de la Provence.

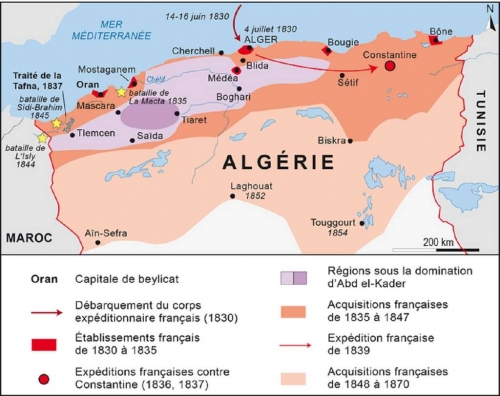
Depuis le 19ème siècle, Paris déplace de plus en plus de colons sur ce territoire dans le but d'assurer son contrôle et de pénétrer à l'intérieur des terres. Cela a conduit la France à la nécessité de consolider les frontières de la colonie tant à l'est, avec l'occupation de la Tunisie, qu'à l'ouest, avec l'entrée du Maroc. La décolonisation après la Seconde Guerre mondiale, qui s'est déroulée de manière traumatisante en raison de la volonté française d'intégrer les territoires coloniaux d'Afrique du Nord à la France métropolitaine, a laissé des traces dans les relations entre Paris et l'État nord-africain. Celles-ci sont restées volatiles en raison d'une amertume remontant au passé colonial et à la guerre d'Algérie. L'ancienne colonie voit Paris comme un ennemi historique auquel il ne faut pas se soumettre, tandis qu'Alger est perçu par l'Elysée comme un partenaire qui n'est pas totalement fiable.
La France a un intérêt pour l'Algérie en tant que jonction fondamentale pour atteindre le Sahel, qui est devenu central dans l'agenda français en raison des routes de migrants qui le traversent. Le maintien de bonnes relations avec l'État maghrébin permet à Paris de prendre des mesures plus fermes pour lutter contre le terrorisme et la traite des êtres humains. En outre, les énormes gisements d'hydrocarbures et de gaz d'Alger ont historiquement attiré l'attention de la plus grande compagnie pétrolière française, Total. Si l'on ajoute à cela le fait qu'une proportion importante de citoyens français a des liens directs avec les colons rapatriés après l'indépendance de l'Algérie, l'importance des relations avec cet État pour Paris apparaît très clairement.
Dans le cas du Maroc, les relations avec la France sont sensiblement différentes. Tout d'abord, par rapport à son voisin oriental, elle n'a jamais complètement perdu son administration locale, étant un protectorat avec son propre souverain pendant toute la période de la colonisation française. La colonisation française a également été beaucoup plus courte que celle de l'Algérie, laissant des cicatrices moins évidentes.
Bien que moins important économiquement que l'Algérie, reposant principalement sur le commerce du phosphate, le Maroc possède une base manufacturière croissante qui a attiré des entreprises françaises telles que Renault. Le rôle majeur que la France attribue au Maroc est de contribuer à la stabilité du Sahel et d'éviter un renforcement excessif de l'Algérie. Le soutien indirect apporté par la France à Rabat dans le dossier de l'annexion par le Maroc du Sahara occidental, dont le gouvernement, représenté par le Front Polisario, est en exil en Algérie, en est une illustration.

Mouvements espagnols au Maroc et en Algérie
De l'autre côté, on trouve l'Espagne, qui est entrée très tôt dans cette partie de l'Afrique, mais qui n'a commencé à la contrôler sérieusement qu'à partir de la seconde moitié du 19ème siècle, pour éviter un renforcement excessif de la France. Concentrant son contrôle au nord-ouest, dans la région du Rif marocain et du Sahara occidental, l'Espagne a des liens historiques avec le Maroc actuel.
Les relations entre Madrid et Rabat sont de première importance pour l'Espagne, qui contrôle toujours un certain nombre d'enclaves sur le sol africain, Ceuta et Melilla étant les plus connues. Ces liens ne sont toutefois pas facilités par la question des migrants et de la souveraineté espagnole sur ses enclaves nord-africaines, qui voit souvent les deux gouvernements s'opposer, bien que l'attitude de base soit la coopération.
Une autre question qui rend les relations entre les deux États difficiles est l'occupation marocaine du Sahara occidental, une ancienne colonie espagnole, alors que l'Espagne continue d'avoir des contacts avec les membres du Front Polisario. En témoigne, par exemple, le fait que le leader de ce mouvement, Brahim Ghali, s'est récemment rendu dans un hôpital espagnol pour y être soigné après avoir contracté le Covid-19, ce qui a suscité des protestations officielles de Rabat. Néanmoins, Madrid reste le principal partenaire économique du Maroc et son principal interlocuteur en Europe.
Contrairement à son voisin occidental, l'Algérie ne partage pas de liens coloniaux avec l'Espagne. Ce qui a poussé Alger et Madrid à collaborer, c'est la nécessité pour l'Espagne de diversifier ses sources d'approvisionnement en énergie, ainsi que la lutte contre l'immigration clandestine. Depuis le siècle dernier, des contacts commerciaux ont été établis entre les principales villes espagnoles de la côte méditerranéenne et l'Algérie, et l'Espagne est actuellement, avec la France, le principal pays de référence de l'État nord-africain dans l'Union européenne. Le rôle de l'Algérie, selon l'Espagne, n'est pas seulement d'approvisionner Madrid en combustibles fossiles et de repousser les migrants irréguliers, mais aussi de maintenir l'équilibre géopolitique en Afrique du Nord, en évitant un renforcement excessif du Maroc.
Quand la géographie l'emporte sur l'histoire
Sur la rive africaine de la Méditerranée occidentale, la France et l'Espagne sont les deux principales puissances européennes qui se disputent l'influence. Alors que Paris a longtemps pu compter sur les liens historiques et coloniaux qui unissent encore Alger et Rabat, Madrid a mené une politique fondée sur une lente pénétration commerciale.
La volonté française d'une plus grande présence au Maghreb est liée d'une part à l'affirmation du rôle prestigieux du pays, membre du G7 et du Conseil de sécurité de l'ONU, et d'autre part à la sécurisation du contrôle des routes migratoires et à la lutte contre les flux. Les objectifs de Paris comprennent également une présence significative dans les secteurs stratégiques de la région. Le poids du passé colonial limite toutefois considérablement la marge de manœuvre française en Algérie, tandis que le Maroc, bien que faisant partie de l'Afrique francophone, gravite depuis des années fermement dans la sphère d'influence espagnole. Par ailleurs, la laïcité excessive et délirante de la France et le droit d'asile accordé à de nombreux dissidents maghrébins constituent un obstacle dans les relations entre Paris, Alger et Rabat.
L'Espagne, pour sa part, entend profiter des tensions entre le Maroc et l'Algérie pour gagner des parts de marché dans ces deux États. Cela se fait d'une part en maintenant des relations très étroites avec le Maroc pour des raisons de sécurité intérieure, en bordant physiquement le pays par les enclaves espagnoles sur la côte africaine. D'autre part, Madrid soutient indirectement l'Algérie dans la question du Sahara occidental, bien que ces dernières années, l'orientation espagnole se tourne de plus en plus vers une solution politique de la question et non vers un référendum.
L'érosion de l'influence française dans cette zone est plus évidente que jamais, tandis que l'importance de l'Espagne dans les affaires politiques, économiques et de sécurité de la région s'accroît en raison de sa proximité avec le Maghreb. La géographie bat l'histoire.
A propos de l'auteur / Vincenzo D'Esposito
Diplômé en études internationales à l'université "L'Orientale" de Naples avec une thèse sur l'hydrohégémonie dans le bassin du Syr Darya. Il est actuellement inscrit au programme de maîtrise en développement durable, géopolitique des ressources et études arctiques au SIOI. Il a étudié et travaillé en Allemagne après avoir obtenu deux bourses Erasmus, qui l'ont conduit d'abord à étudier à Fribourg-en-Brisgau, puis à effectuer un stage à la Chambre de commerce italienne pour l'Allemagne. Passionné par l'Asie centrale et l'énergie, il collabore avec plusieurs groupes de réflexion en tant qu'analyste géopolitique.
12:03 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maroc, algérie, espagne, france, europe, afrique, afrique du nord, affaires européennes, affaires africaines, méditerranée, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 20 novembre 2021
La prochaine guerre des sables
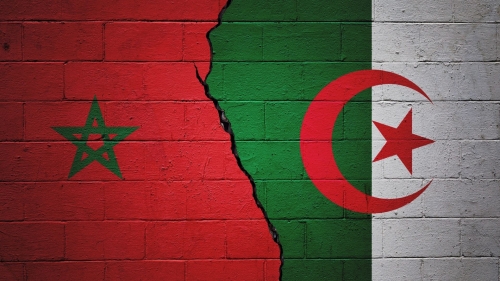
La prochaine guerre des sables
par Georges FELTIN-TRACOL
Le 17 février 1989 à Marrakech, Hassan II du Maroc, le Guide libyen Kadhafi et les présidents algérien Chadli Bendjedid, tunisien Ben Ali et mauritanien Sid'Ahmed Taya lançaient l’Union du Maghreb arabe (UMA). Cette nouvelle organisation internationale à vocation régionale entendait favoriser un espace économique commun, une union douanière et une zone de libre circulation des biens et des personnes. Cette imitation maghrébine du processus européen resta néanmoins inachevée, car ce projet ambitieux fut très tôt miné par la vieille rivalité entre le Maroc et l’Algérie.
Cinq ans plus tard, le 24 août 1994, suite à un attentat commis contre l’hôtel Atlas - Asni à Marrakech, le Maroc imposait le visa pour les Algériens. Soutien indéfectible du Front Polisario, l’Algérie répondait par la fermeture de sa frontière terrestre avec son voisin occidental. Les contentieux ne manquent plus entre Alger et Rabat.
Outre la question du Sahara occidental annexé par le Maroc, l’Algérie se méfie depuis soixante ans des revendications territoriales de son voisin. Dès la fin du protectorat français en 1956, l’Istiqlal, le parti indépendantiste, évoque un « Grand Maroc », soit un royaume qui engloberait non seulement le Sahara occidental à l’époque espagnol, mais aussi toute la Mauritanie, l’Ouest sahélien du Mali jusqu’aux portes de Tombouctou et l’Ouest algérien avec les régions de Tindouf, de Béchar, d’In Salah et de Figuig.
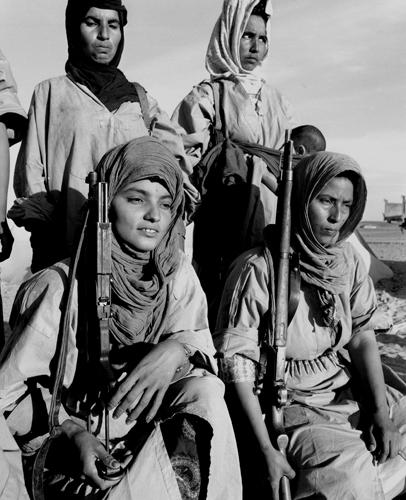
Ces dissensions frontalières suscitent d’ailleurs entre septembre 1963 et février 1964 un conflit armé entre le jeune État algérien et le royaume alaouite : la « Guerre des Sables ». Ni l’Égyptien Gamal Abdel Nasser, ni le président tunisien Habib Bourguiba ne parviennent à arrêter les combats. Le cessez-le-feu entre les belligérants revient finalement à la médiation conjointe de l’empereur éthiopien Hailé Sélassié et du président malien Modibo Keïta. Sur le terrain, l’armée royale marocaine a nettement triomphé de l’Armée de libération nationale. La victoire de Rabat contribue à affaiblir Ahmed Ben Bella et permet en 1965 le coup d’État de Houari Boumédiène. En janvier 1976, soldats algériens et marocains s’affrontent encore pendant deux jours à Amgala. Le 13 novembre 2020, l’armée marocaine intervient en force contre le Polisario afin de débloquer un axe routier près de Guerguerat. Il en découle une reprise d’intenses combats entre les Marocains et la rébellion sahraouie.
Depuis cet été 2021, on assiste à une escalade entre les deux États. Fragilisé par le Hirak, la forte contestation de la société civile lasse de subir la corruption et l’incompétence du FLN, de ses avatars politiciens et d’une clique militaire, ainsi que par les revendications autonomistes croissantes de la Kabylie, le gouvernement algérien rompt, le 24 août 2021, ses relations diplomatiques avec le Maroc. La mort, le 1er novembre dernier, de trois chauffeurs routiers qui effectuaient le trajet entre la Mauritanie et l’Algérie par des drones marocains crispent encore plus les relations bilatérales.
Les griefs de l’Algérie contre le Maroc sont variés. Alger dénonce la mainmise marocaine sur le Sahara occidental. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ramtane Lamamra, désigne le représentant du Maroc à l’ONU, Omar Hilale, comme un soutien actif au Mouvement pour l’autonomie de la Kabylie interdit, clandestin et classé comme terroriste. Les incendies de cet été qui ont ravagé les forêts algériennes seraient des actions subversives marocaines. Enfin, l’Algérie n’apprécie pas que son voisin ait rallié les « accords d’Abraham » et établi des relations diplomatiques avec l’État d’Israël. En septembre dernier, l’Algérie a aussi fermé son espace aérien à tout aéronef entrant et sortant du Maroc…

L’accord entre Israël et le Maroc n’est pas une surprise. En échange de cette reconnaissance, les États-Unis de Donald Trump valident les droits légitimes de Rabat sur le Sahara occidental. Une importante communauté juive a longtemps vécu au Maroc. Sous le protectorat français, le drapeau marocain portait parfois en son centre une étoile à six branches. Descendant du prophète Mahomet et « Commandeur des croyants », le roi du Maroc, apte à contenir les poussées islamistes, peut se permettre de telles initiatives. À la fin des années 1970, Hassan II fit condamner par ses oulémas et ses cadis les écrits de l’ayatollah Khomeiny jugés « hérétiques ». La dynastie marocaine entretient enfin de nombreux liens familiaux avec les principales tribus berbères si bien que le Maroc est un royaume de langue arabe avec un fort substrat ethnique berbérophone.
Tous ces faits agacent l’Algérie, adepte depuis l’indépendance d’un centralisme arabo-musulman à l’encontre des Kabyles et des Touaregs. Incapable de résoudre les crises économique et sociale, le gouvernement a interdit à compter du 1er novembre dernier l’usage du français dans les administrations et dans l’enseignement. Si le pouvoir algérien avait utilisé au cours des précédentes décennies une partie de l’argent des hydrocarbures à constituer un corps d’enseignants du premier degré dévoué à l’«algérianité» à l’instar des tristement célèbres «Hussards noirs» de la IIIe République française, une « assimilation » au modèle stato-national algérien aurait peut-être pu se réaliser. Mais c’était sans compter sur l’avidité matérielle illimitée de la caste et de ses factions.
Une nouvelle « guerre des sables » pourrait survenir dans les prochaines semaines, sinon dans les prochains mois. Fortement appuyée par la Russie et la Turquie, l’Algérie dispose dorénavant, avec l’Afrique du Sud et le Rwanda, de l’armée la plus puissante du continent africain. Une guerre à la fois cybernétique et conventionnelle telle qu’elle vient d’être pratiquée par l’Azerbaïdjan contre l’Artsakh et l’Arménie, montrerait sa supériorité technique et tactique sur les troupes marocaines. On a oublié qu’au début de ce siècle, des cénacles néo-conservateurs étatsuniens envisageaient l’adhésion de l’Algérie à l’OTAN…
Il faut par conséquent suivre avec la plus grande attention tout ce qui se trame au Maghreb. Plusieurs foyers d’instabilité (la Tunisie, la Libye, le Sahel malien et nigérien, et maintenant le Maroc) entourent l’Algérie. Une guerre entre l’Algérie et le Maroc aurait de graves répercussions en France, en Belgique et en Allemagne où vivent des communautés immigrées originaires de ces États. Rien n’empêcherait qu’elles y importent une violence exacerbée.
Plus que jamais, en proie à des turbulences historiques, la rive Sud de la Méditerranée est à surveiller avec la plus grande attention possible.
GF-T
- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 10, mise en ligne sur Radio Méridien Zéro du 16 novembre 2021.
13:58 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guerre des sables, maroc, algérie, afrique du nord, afrique, affaires africaines, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 novembre 2021
Erdogan continue de jeter de l'huile sur le feu du conflit libyen

Erdogan continue de jeter de l'huile sur le feu du conflit libyen
par Alessandro Sansoni
Ex: https://www.lavocedelpatriota.it/erdogan-continua-a-gettare-benzina-sul-fuoco-del-conflitto-libico/?fbclid=IwAR1eql9a2imoe7z0Pg2UZdKtsmv0T4YC7N6wHrH2SHZB18VPSJavJUz4JSc
Les reportages triomphalistes des médias nous ont empêchés d'y prêter toute l'attention nécessaire, mais un développement dangereux a émergé du G20 à Rome. Au cours du sommet, en effet, le président turc Recep Erdogan a déclaré officiellement, et en termes non équivoques, qu'Ankara refuse de retirer ses troupes de Libye. Cette déclaration intervient alors que l'ONU s'est engagée à organiser et à mener à bien le retrait de toutes les troupes étrangères présentes dans le pays, condition préalable indispensable à la célébration des élections censées ramener la paix dans le pays.
Par sa position, la Turquie jette de l'huile sur le feu et menace de porter à un niveau très élevé le conflit entre les factions qui se disputent le pouvoir en Libye, mettant ainsi en péril le processus électoral. Une situation qui aurait des répercussions graves et dangereuses pour l'Italie et l'ensemble de l'Union européenne.
Premier problème : le retrait des mercenaires
La Libye devrait organiser ses élections présidentielles tant attendues le 24 décembre, tandis que les élections législatives sont prévues pour le début de 2022.
L'espoir est de mettre ainsi fin à la longue période d'anarchie et de guerre civile dans laquelle le pays a plongé depuis la fin du régime de Mouammar Kadhafi en 2011, en sauvegardant éventuellement l'unité du territoire libyen, aujourd'hui effectivement divisé en une partie occidentale sous le contrôle du gouvernement de Tripoli et une partie orientale aux mains du général Khalifa Haftar et de son Armée nationale libyenne (ANL), engagés depuis des années dans un dur conflit non seulement avec les milices tripolitaines, mais aussi avec des groupes islamistes, alliés des Turcs. La situation est encore compliquée par le nombre élevé de mercenaires et de forces étrangères présents sur le terrain pour soutenir les deux prétendants.
C'est précisément pour cette raison que la feuille de route élaborée par les Nations unies prévoit, avant tout, l'élimination des groupes armés étrangers, qui doit être définie dans le cadre d'un format de négociation "5+5", dans lequel toutes les factions belligérantes sont présentes à la table des négociations, sous les auspices des Nations unies. Le 8 octobre, le Comité militaire conjoint "5+5" s'est réuni pendant trois jours au Palais des Nations à Genève et s'est conclu par la signature d'un plan d'action prévoyant un retrait progressif, équitable et coordonné de tous les mercenaires et forces étrangères de Libye.
La réunion de Genève s'est tenue conformément aux pistes définies dans l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 et aux résolutions connexes émises par le Conseil de sécurité des Nations unies. La réunion faisait partie intégrante des diverses négociations intra-libyennes promues par l'ONU, ainsi que des efforts déployés par la communauté internationale à travers la conférence de Berlin.
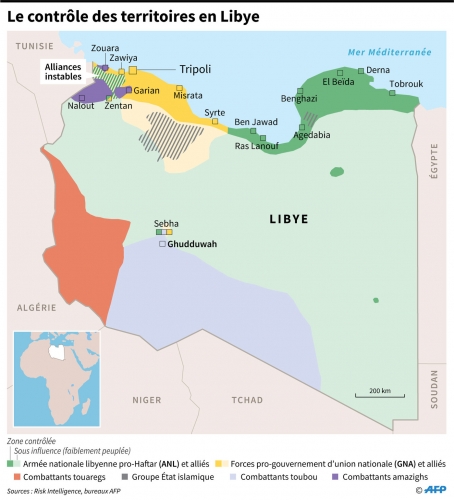
Début novembre, le Comité 5+5 a tenu une autre réunion, cette fois au Caire, toujours organisée par l'ONU, à laquelle ont également participé des représentants du Soudan, du Tchad et du Niger. À cette occasion, tous les pays voisins de la Libye ont exprimé leur volonté de coopérer au processus d'expulsion des combattants étrangers et des mercenaires, tandis que les délégués du Soudan, du Tchad et du Niger se sont engagés à coopérer pour assurer le retrait des hommes armés de leurs pays, en coordonnant leurs actions pour éviter qu'ils ne reviennent en Libye et ne déstabilisent les États voisins.
Cependant, le refus de la Turquie de s'aligner sur les accords généraux ouvre un problème gigantesque. En fait, près de la moitié des forces étrangères présentes en Libye sont liées à Ankara : selon le SOHR (Observatoire syrien des droits de l'homme), le nombre total de mercenaires syriens soutenus par la Turquie dans le pays d'Afrique du Nord est d'environ 7000, tandis que les Nations unies ont estimé la présence de 20.000 combattants étrangers sur le territoire libyen. Les sources de SOHR ont également confirmé qu'en dépit des tentatives de négociation de leur retrait début octobre, des miliciens islamistes vétérans du conflit syrien continuent d'être stationnés dans des bases turques en Libye, tandis qu'un nouveau contingent de 90 personnes en provenance de Syrie est arrivé en Libye transporté par des avions turcs.
G20 : la diplomatie à la turque
Lors du G20, Erdogan a non seulement confirmé son intention de ne pas démobiliser ses troupes en Libye, mais a également réaffirmé au président français Emmanuel Macron que la présence turque est légitimée par un accord de coopération militaire signé avec le gouvernement libyen.
"Nos soldats sont là en tant qu'instructeurs", a-t-il réitéré, niant que leurs activités puissent être assimilées à celles de mercenaires illégaux.
Or, ce n'est pas exactement le cas. Tout d'abord, ses propos peuvent s'appliquer au contingent militaire officiellement envoyé par l'armée turque début janvier 2020, et certainement pas aux mercenaires syriens qui continuent à être stationnés dans les bases militaires d'Ankara.
Par ailleurs, les accords conclus lors du sommet du 8 octobre à Genève font explicitement référence au retrait des "mercenaires, combattants étrangers et forces étrangères", les "forces étrangères" étant comprises comme incluant les troupes régulières et les instructeurs.
Enfin, les "instructeurs" turcs ont débarqué en Libye dans le cadre d'un accord signé par Ankara en novembre 2019 avec le gouvernement d'entente nationale (GNA) dirigé par Fayez al-Sarraj, un gouvernement intérimaire auquel a succédé en mars dernier le nouveau gouvernement d'union nationale dirigé par Abdul Hamid Dbeibah. Le point crucial, cependant, est qu'au moment où le traité a été signé, le mandat du GNA avait déjà expiré et donc, en tant que gouvernement intérimaire, il n'avait pas le droit de signer un tel traité de coopération militaire. C'est pour la même raison que tous les voisins de la Libye et de la Turquie ont désavoué le traité sur les frontières maritimes (et les zones économiques exclusives correspondantes) signé par Tripoli et Ankara au même moment. Ce dernier accord a considérablement étendu les revendications turques sur la Méditerranée et ses riches gisements de pétrole et de gaz.
C'est pour ces raisons que la présence militaire turque en Libye doit être considérée comme illégale au regard du droit international, car elle constitue un avant-poste des ambitions néo-impérialistes d'Erdogan. Ce n'est pas une coïncidence si Erdogan, pendant le G20, a annoncé son refus de participer au sommet sur la Libye à Paris (ce qui l'a fait couler), confirmant ainsi qu'il n'a aucune intention de soutenir les efforts internationaux visant à stabiliser le pays.
Nous avons notifié au président Macron, a déclaré Erdogan, notre refus de participer à une conférence à Paris à laquelle participent la Grèce, Israël et l'administration chypriote grecque. Pour nous, il s'agit d'une condition absolue. Si ces pays sont présents, cela n'a aucun sens pour nous d'envoyer des délégués".
À Rome, Erdogan a également eu une réunion séparée avec le Premier ministre Mario Draghi, mais celle-ci n'a donné aucun résultat concret. Aucun progrès n'a été enregistré dans les relations italo-turques, y compris en ce qui concerne le système de défense antimissile italo-français SAMP-T, pour lequel la Turquie avait précédemment manifesté son intérêt. Malgré l'annonce générale de développements futurs à cet égard, il est peu probable que la Turquie reprenne ce projet, à moins que ses relations avec Paris ne s'améliorent. Et Erdogan ne semble avoir aucune envie de poursuivre dans cette direction.
Tensions en Libye
Entre-temps, la situation politique en Libye devient de plus en plus précaire, surtout depuis que la Chambre des représentants (le parlement de Tobrouk) a remis en cause en septembre dernier, à l'instigation de Haftar, le gouvernement d'unité nationale.
D'un point de vue militaire, les tensions augmentent également, à tel point que ces derniers jours, les chefs de deux milices tripolines - Muammar Davi, chef de la Brigade 55, et Ahmad Sahab - ont été victimes d'attaques visant à les tuer.
À ce stade, il est difficile d'être sûr que les élections présidentielles auront lieu en décembre, tandis que les élections parlementaires ont déjà été reportées à 2022.
Le chantage d'Erdogan : géopolitique, énergie, flux migratoires
Si la Turquie a pu renforcer considérablement son influence en Libye, une part considérable de la responsabilité doit être attribuée aux gouvernements dirigés par Giuseppe Conte (surtout le second), caractérisés par un manque d'incisivité sur la question libyenne. Bénéficiant de facto d'une carte blanche, Ankara a pu, en quelques années seulement, débarquer des centaines de "conseillers militaires" dans le pays d'Afrique du Nord.
Avec le traité sur les frontières maritimes et la délimitation des zones économiques exclusives respectives, la Turquie a pris le contrôle du littoral de la Tripolitaine ainsi qu'une sorte de patronage sur les gisements de gaz et de pétrole de la Méditerranée centrale. Son influence politique sur le gouvernement d'accord national, puis sur le gouvernement d'unité nationale, est énorme.
La guerre civile entre Tripoli et Benghazi a permis à Ankara de fournir des troupes et des armes au camp ouest-libyen, de redéployer ses milices mercenaires précédemment actives en Syrie et d'obtenir la gestion du port et de l'aéroport de Misurata pour les 99 prochaines années.
Aujourd'hui, Erdogan, grâce à la forte influence qu'il est en mesure d'exercer sur l'un des plus grands producteurs de pétrole au monde, dispose d'une arme supplémentaire pour faire pression sur l'Europe, celle de l'approvisionnement énergétique, en plus de l'arme déjà largement utilisée du contrôle des flux migratoires, qu'il est désormais en mesure de réguler non seulement sur la route des Balkans, mais aussi sur celle de la Méditerranée centrale. La route la plus empruntée par les trafiquants d'êtres humains, selon les chiffres officiels, selon lesquels, au 22 octobre, 51.568 migrants sont déjà arrivés en Italie cette année, contre 26.683 en 2020.

Les demandes de Draghi à l'Union européenne d'allouer des fonds pour protéger "toutes les routes" sont du miel aux oreilles turques. Ils font en effet référence aux 6 milliards que Bruxelles a déjà versés à la Turquie pour gérer la route des Balkans et à ceux qu'elle versera encore. Il y a actuellement 3,7 millions de Syriens vivant sur le sol turc, auxquels il faut ajouter 300.000 Afghans. Une bombe à retardement qu'Ankara menace de faire exploser à tout moment si ses exigences ne sont pas satisfaites.
En bref, les crises humanitaires - de l'Afghanistan à la Syrie, auxquelles s'ajoute désormais la crise libyenne - sont devenues une occasion extraordinaire pour la Turquie d'obtenir des ressources de l'Europe et de la maintenir sous pression. C'est pourquoi le maintien d'un gouvernement pro-turc à Tripoli est si important pour Erdogan : il lui permet de jouer un jeu géopolitique complexe contre l'UE qui combine énergie et flux migratoires.
Reconstruire un équilibre en Méditerranée et redimensionner les ambitions turques en adoptant une attitude plus ferme à l'égard du nouveau sultan est le véritable défi que l'Italie doit relever, plutôt que de s'aventurer dans des aspirations improbables et irréalistes à diriger l'UE ou à renforcer les relations transatlantiques.
Alessandro Sansoni
Directeur du magazine mensuel CulturaIdentità
11:26 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, méditerranée, libye, turquie, erdogan, afrique du nord, afrique, affaires africaines, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 23 octobre 2021
Une Libye disparue et divisée
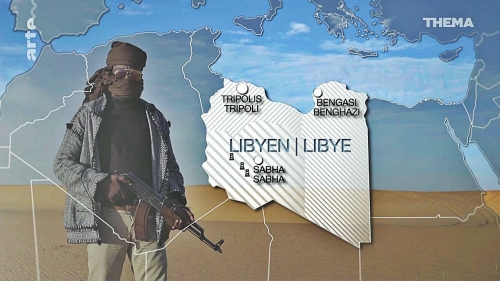
Une Libye disparue et divisée
par Alberto Negri
Source : Il quotidiano del sud & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/una-libia-sparita-e-spartita
La Libye a disparu et elle a été divisée. En ce dixième anniversaire de l'assassinat de Kadhafi à Syrte, la Libye n'a plus guère d'importance. Si ce n'est pour lancer des appels plus ou moins crédibles à la "stabilité", dont il a également été question hier lors de la conférence internationale de Tripoli.
Dans le vide politique qui a résulté de l'attaque occidentale en 2011, la Libye a disparu et elle a été divisée. En ce dixième anniversaire de l'assassinat de Kadhafi à Syrte, la Libye importe peu désormais. Si ce n'est pour lancer des appels plus ou moins crédibles à la "stabilité", dont il a également été question hier lors de la conférence internationale de Tripoli, la première du genre organisée en Libye, seule note positive de l'événement. La stabilité et la sécurité en Libye ne signifient en fait pas grand-chose pour nous: d'abord l'arrêt des vagues migratoires, le reste vient plus tard, des élections au retrait des troupes mercenaires dont la présence a été qualifiée hier d'"inquiétante" par le Premier ministre Dabaiba. Mais aucune conclusion n'a été tirée à Tripoli, ni sur les soldats et mercenaires turcs et russes, ni sur les élections présidentielles et législatives.
Pas un mot n'a été gaspillé sur les milliers d'êtres humains réduits en esclavage dans les camps libyens. Pourtant, les juges d'Agrigente qui ont porté plainte contre le navire de l'ONG Mediterranea - qui a refusé de remettre les migrants aux Libyens - ont été explicites: non seulement il est juste de ne pas communiquer avec les "garde-côtes libyens", mais une contradiction flagrante se dégage des conclusions de la justice. Quiconque finance et forme les "garde-côtes libyens", c'est-à-dire l'Italie, viole le droit international et se rend complice d'un comportement criminel.
La stabilité de la Libye n'a jamais vraiment été souhaitée par quiconque au cours de cette décennie, depuis le lynchage et l'assassinat de Mouhammar Kadhafi le 20 octobre à Syrte. Avec l'intervention aérienne de mars 2011, après la chute des raïs Ben Ali et Moubarak, la France et la Grande-Bretagne, avec le soutien des États-Unis, n'avaient pas l'intention d'exporter la démocratie mais de remplacer le régime de Tripoli par un gouvernement plus malléable et proche des intérêts de Paris et de Londres. M. Sarkozy, qui avait reçu de l'argent libyen pour sa campagne électorale de 2007, en voulait amèrement à M. Kadhafi, qui avait refusé d'acheter ses centrales nucléaires, tandis que le raïs libyen poursuivait ses accords énergétiques avec l'Italie et ENI.

La Grande-Bretagne et la France n'ont pas toléré le retour de la Libye, quoique d'une manière totalement différente de son passé colonial, dans la Quatrième Banque italienne, un événement sanctionné par le défilé pompeux du rais libyen à Rome le 30 août 2010. Des accords avaient été mis sur la table pour 55 milliards d'euros: plus du double de la loi budgétaire actuelle de Draghi.
 Ces éléments apparaissent également dans l'intéressant documentaire de la RAI intitulé "Il était une fois Kadhafi" (qui sera diffusé dans quelques semaines) où le général des services Roberto Jucci (tableau, ci-contre) témoigne abondamment de la manière dont il a bloqué les ordres d'Aldo Moro de renverser Kadhafi par un coup d'État en 1971. Le documentaire raconte également comment Jucci, inspiré par Andreotti, a répondu aux demandes de fournitures militaires de Kadhafi. Comme on le sait, ce sont Craxi et Andreotti qui ont sauvé le colonel libyen des sanctions américaines, y compris les raids aériens de 1986 ordonnés par Reagan.
Ces éléments apparaissent également dans l'intéressant documentaire de la RAI intitulé "Il était une fois Kadhafi" (qui sera diffusé dans quelques semaines) où le général des services Roberto Jucci (tableau, ci-contre) témoigne abondamment de la manière dont il a bloqué les ordres d'Aldo Moro de renverser Kadhafi par un coup d'État en 1971. Le documentaire raconte également comment Jucci, inspiré par Andreotti, a répondu aux demandes de fournitures militaires de Kadhafi. Comme on le sait, ce sont Craxi et Andreotti qui ont sauvé le colonel libyen des sanctions américaines, y compris les raids aériens de 1986 ordonnés par Reagan.
C'est pourquoi la décision de l'Italie de se joindre aux raids de l'OTAN contre Kadhafi n'a pas été prise pour des raisons humanitaires mais simplement parce que les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France nous faisaient du chantage et menaçaient même de bombarder les usines ENI. L'Italie subit alors sa plus grande défaite depuis la Seconde Guerre mondiale et perd toute crédibilité résiduelle sur la rive sud. La décennie qui vient de s'écouler depuis l'explosion du printemps arabe n'a pas été suffisante pour retrouver un rôle en Méditerranée, un rôle qu'Aldo Moro avait déjà fortement défendu dans les années 1960 et 1970. L'Italie ne peut qu'espérer que les puissances se battent entre elles et se heurtent dans les espaces restants. C'est ce qui se passe, par exemple, dans le cas de la Turquie: après l'accord militaire du 30 septembre entre la France et la Grèce, Rome cherche le soutien d'Ankara dans l'exploration offshore des zones économiques spéciales qui coupent désormais la Méditerranée en tranches.
Nous gardons un profil bas dans le jeu libyen, sous la pression de Paris et face à la tentative française de convoquer une autre conférence libyenne le 12 novembre. Et espérer un candidat présidentiel proche des intérêts italiens. Aux noms controversés de Seif Islam Gaddafi et Khalifa Haftar, on peut préférer l'actuel premier ministre Dabaiba, qui a rencontré Di Maio hier.
Mais le plus déconcertant en ce dixième anniversaire de la mort de Kadhafi, c'est la réévaluation historique larvée de ce dernier par les mêmes médias et journaux qui ont applaudi les raids occidentaux qui ont plongé le pays dans le chaos. En Libye, les Américains ont vu l'assassinat d'un ambassadeur envoyé pour traiter avec la guérilla islamique à Benghazi par Hillary Clinton et sa "stratégie du chaos" démentielle (11 septembre 2012). La France a imprudemment manœuvré avec Haftar contre le gouvernement Sarraj, soutenue par l'Italie et l'ONU, la Grande-Bretagne a systématiquement saboté les tentatives de stabilisation, avec pour résultat qu'aujourd'hui nous avons la Turquie en Tripolitaine et des mercenaires et pilotes russes en Cyrénaïque. Et la liste des erreurs tragiques commises en Libye, que nous dressons ici, est suffisante pour aujourd'hui.
11:51 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libye, afrique du nord, afrique, affaires africaines, méditerranée, italie, monde arabe, monde arabo-musulman, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 11 octobre 2021
L'Alliance turco-libyenne, un défi pour la sécurité de l'Italie et de l'Europe

L'Alliance turco-libyenne, un défi pour la sécurité de l'Italie et de l'Europe
par Alessandro Sansoni
SOURCE : https://www.lavocedelpatriota.it/lalleanza-turco-libica-una-sfida-alla-sicurezza-dellitalia-e-delleuropa/
L'évolution du cadre politique libyen risque de faire de l'Italie (et de l'Union européenne) l'otage des jeux de pouvoir à Tripoli. Le pays d'Afrique du Nord est en proie à une nouvelle crise politique, dont l'issue pourrait encore renforcer l'influence turque, et Ankara a déjà démontré sa capacité à tenir l'Europe en échec avec la menace de lâcher des migrants. Cette situation pourrait bientôt être aggravée par une crise énergétique.
La Libye à nouveau en proie au chaos (politique) : le gouvernement d'unité nationale contesté
À l'heure actuelle, en Libye, malgré les récentes négociations épuisantes, aucun accord réel n'a encore été conclu entre les factions belligérantes et les institutions qui les représentent. Début 2021, les autorités de Tripoli (le gouvernement d'entente nationale dirigé par Fayez al-Sarraj) et le Parlement de Tobrouk (présidé par Abdullah al-Thani et soutenu par le général Khalifa Haftar) avaient officiellement remis le pouvoir à une institution intérimaire, le gouvernement d'unité nationale (GUN), créée dans le but d'organiser enfin les élections tant attendues. Abdul Hamid Dbeibeh est élu Premier ministre du GUN, tandis que Mohammed al-Manfi se voit confier la direction du Conseil présidentiel.
Malheureusement, malgré ce qui a été convenu à Genève, le Forum pour le dialogue politique libyen, promu par les Nations unies, n'a pas réussi à obtenir des résultats significatifs et à stabiliser le pays. Le choix d'une ville suisse, et non libyenne, pour mener les négociations et la forte intervention de puissances étrangères dans les négociations avaient dès le départ mis à rude épreuve la légitimité du nouveau gouvernement.
En théorie, les élections parlementaires et présidentielles devaient se tenir en décembre, mais la confrontation politique entre les différentes factions s'est intensifiée au fil des mois, tandis qu'un climat général de méfiance entoure le gouvernement intérimaire. En conséquence, les élections, prévues pour le 24 décembre, ont déjà été reportées à janvier.
Le 21 septembre, la Chambre des représentants, la plus haute instance législative de Libye, présidée par Aguila Saleh, a contesté le gouvernement de Dbeibeh. Abdullah Bliheg, porte-parole de la Chambre des représentants, a déclaré que 89 des 113 députés présents ont voté en faveur de la motion de censure contre le gouvernement d'unité nationale lors d'une session à huis clos, en présence de Saleh et de ses deux députés.
Le Parlement a notamment justifié le vote de défiance en accusant le GNU d'effectuer des opérations financières douteuses et de conclure des contrats qui entraînent une augmentation considérable de la dette publique au point de mettre en danger la souveraineté même du pays. Les députés ont accusé les membres du gouvernement de détournement de fonds et de préjudice fiscal et d'avoir dépassé les limites de leur mandat.
Le président de la Chambre des représentants, Aguila Saleh, a souligné que l'exécutif dépensait des sommes importantes, alors que le budget n'a pas encore été approuvé. Selon ses calculs, le Premier ministre Dbeibeh a déjà dépensé entre 40 et 50 milliards de dinars.
En outre, la loi électorale présidentielle approuvée par le Parlement de Tobrouk a été rejetée par le Haut Conseil d'État, qui siège à Tripoli. En fait, le pays continue d'être divisé entre l'est et l'ouest, de sorte que si la Cyrénaïque, toujours sous le contrôle de l'Armée nationale libyenne de Khalifa Haftar, se prépare à organiser des élections selon ses propres règles, la Tripolitaine, toujours aux mains de divers groupes militaires, dont certains sont clairement islamistes, se prépare à faire de même. Même les candidatures officielles proposées à l'organisme électoral sont différentes et, en fait, la partie occidentale a déclaré Haftar inéligible.
Le contraste entre les différentes institutions libyennes et les dépenses financières douteuses du GUN alimentent la confusion, entravent la préparation des élections et compliquent les relations économiques et politiques avec l'Italie. La tension est désormais si forte que la possibilité d'un retour à la confrontation militaire et d'une nouvelle vague de migrants vers l'Europe qui en résulterait se concrétise de plus en plus.
Une Libye pro-turque
Un autre facteur de déstabilisation de la Libye est l'influence croissante de la Turquie dans les sphères politiques et militaires.
L'un des objectifs déclarés du Forum inter-libyen était le retrait des troupes étrangères du pays avant les élections. Ces derniers jours (6-8 octobre), le "Comité militaire conjoint 5+5", qui comprend des délégués des deux parties belligérantes, s'est réuni à Genève pour discuter de cette question : une clause de l'accord de cessez-le-feu du 23 octobre 2020 prévoyait le retrait des combattants étrangers dans un délai de 90 jours, mais il en reste environ 20.000 dans le pays.
D'autre part, malgré les engagements officiels pris par tous les principaux acteurs étrangers présents en Libye, le ministère turc de la défense a officiellement annoncé qu'il continuerait à coopérer militairement avec le gouvernement. De cette manière, Ankara sape le processus de paix et met concrètement en danger la consultation électorale.
En novembre 2019, le gouvernement d'entente nationale (GNA) d'al-Sarraj, alors en place, avait signé deux protocoles d'accord sur la coopération sécuritaire et militaire avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, en vertu desquels Ankara a pu justifier le renforcement de sa présence dans l'État nord-africain.

Il est intéressant de noter que la coopération avec la Turquie a été favorisée par le passé, et est actuellement poursuivie, par les institutions les plus fortement influencées par les Frères musulmans de par leur composition : à l'époque le GNA, aujourd'hui le GUN et le Haut Conseil d'État de Libye, clairement en faveur de l'osmanisation du pays.
Ce n'est pas un hasard si le ministre turc des Affaires étrangères, Mevlüt Çavuşoğlu, a récemment affirmé que l'accord avec la Libye avait été conclu à la demande explicite du précédent gouvernement d'entente nationale dirigé par Fayez al-Sarraj, raison pour laquelle la Turquie a l'intention de rester dans le pays.
Deux jours avant de faire cette déclaration, Çavuşoğlu avait accueilli à Ankara Khalid Almishri, président du Haut Conseil d'État libyen, un organe qui joue un rôle consultatif.
Almishri, de son propre aveu, représente les Frères musulmans au sein du Haut Conseil. En mai 2018, lors d'une interview avec la chaîne française arabophone France-24, il a explicitement déclaré qu'il était membre des Frères musulmans, qui sont classés comme organisation terroriste par plusieurs pays.
Le point est délicat. En pratique, l'une des plus hautes autorités libyennes serait officiellement un djihadiste à part entière. En tout cas, Almishri est parmi ceux qui ont le plus encouragé l'intervention turque en Libye.
En l'état actuel des choses, la présence des forces turques viole les dispositions des Nations unies et la feuille de route pour une solution pacifique au conflit libyen et est, en principe, incompatible avec les dispositions générales en matière de sécurité.
Cependant, la question est encore plus grave. La présence turque représente un grave danger. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, plusieurs milliers de mercenaires syriens sont encore stationnés dans les bases turques en Libye. Il y a quelques jours à peine, un groupe de 90 combattants appartenant à des groupes liés à la Turquie et opérant à Afrin, dans la zone contrôlée par Ankara, a été envoyé en Tripolitaine, pour être rejoint par un groupe de même taille retournant en Syrie.
Si, par une quelconque hypothèse, qui semble aujourd'hui franchement improbable, les factions et institutions opposées à l'est et à l'ouest du pays parvenaient à une sorte d'accord, formalisant une liste unique de candidats à la présidence et organisant des élections ensemble, avec un résultat accepté par tous, le vainqueur aurait les mains et les pieds liés à la Turquie, dont les troupes resteraient dans le pays. Même Haftar devrait s'entendre avec les Turcs pour gouverner l'ensemble du territoire et pas seulement la partie orientale.
Dans un tel cadre, le prochain gouvernement libyen sera nécessairement pro-turc. Il sera également pro-turc même si les élections n'ont pas lieu et que l'expérience du GUN reconnu internationalement se poursuit.
La crise migratoire
La Turquie a longtemps persisté dans ses attitudes provocatrices, faisant du chantage à l'Union européenne par le biais de la gestion des flux migratoires. Un comportement évident sur la route des Balkans, qu'Ankara répète également en Méditerranée centrale depuis qu'elle a intensifié sa présence en Libye.

Selon le Viminale, au cours des quatre premiers jours d'octobre seulement, 1430 migrants sont arrivés en Italie. En 2021, il y a eu 47.750 arrivées, soit environ le double des 24.333 arrivées de 2020. Par rapport à 2019, les débarquements ont été multipliés par six.
Ces chiffres sont appelés à augmenter en raison de la crise politique, économique et sociale qui touche non seulement la Libye, mais aussi la Tunisie, et qui pousse les gens à émigrer, encourageant ainsi la traite des êtres humains.
De même, le nombre de naufrages et de victimes est appelé à augmenter.
Il y a quelques jours, à Lampedusa, on comptait plus d'un millier de migrants illégaux dans un hotspot qui ne peut en accueillir que 250, après le débarquement record de 686 personnes en provenance de Libye sur un bateau de pêche de 15 mètres.
Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), plus de 25.200 personnes ont été interceptées en Méditerranée centrale cette année, soit deux fois plus que l'année dernière.
Dans un contexte qui risque de devenir complètement incontrôlable, l'insuffisance de l'action de la ministre de l'Intérieur, Luciana Lamorgese, qui a vu une augmentation anormale des débarquements depuis sa prise de fonction, est encore plus grave.
La question de l'énergie
Comme on le sait, la Libye est le principal fournisseur d'énergie de l'Italie (gaz et pétrole). ENI opère dans tout le pays d'Afrique du Nord et est l'acteur le plus important de l'industrie énergétique libyenne. Si Tripoli devait accroître sa dépendance politique vis-à-vis d'Ankara, le flux d'hydrocarbures entre les deux rives de la Méditerranée pourrait devenir une arme supplémentaire de chantage entre les mains de la Turquie.
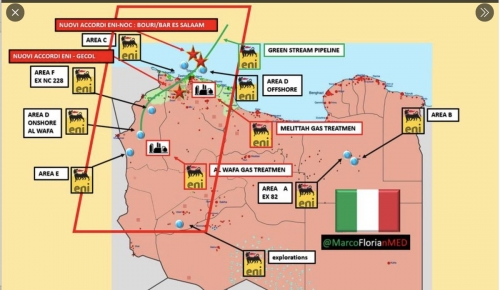
La même alternative représentée par le gazoduc transadriatique (TAP), dont le terminal des Pouilles est en service depuis un an et qui a déjà fourni à l'Italie et à l'Europe du Sud les 5 premiers milliards de mètres cubes de gaz naturel en provenance d'Azerbaïdjan, traverse toute l'Anatolie. Étant donné que Bakou est un proche allié d'Ankara, nous pouvons affirmer sans risque qu'une partie substantielle des sources d'énergie de l'Italie passe sous contrôle turc.
L'augmentation vertigineuse des prix des produits énergétiques au cours des dernières semaines rend le scénario encore plus inquiétant. Que se passerait-il si, de façon absurde, cet hiver, Erdogan menaçait l'Italie et l'UE, pour quelque raison que ce soit, de couper les approvisionnements en gaz ?
Et l'Italie ?
La résolution de la crise libyenne est d'un intérêt stratégique vital pour l'Italie.
Premièrement, les hostilités représentent un facteur de grave incertitude pour les intérêts économiques et énergétiques italiens en Libye.
Deuxièmement, la pacification de la Libye et un gouvernement solide et légitime sont indispensables à la gestion des flux migratoires.
Troisièmement, et enfin, la perte d'influence en Libye compromet le rôle géopolitique de l'Italie en Méditerranée, que l'orientation néo-ottomane de l'expansionnisme turc tend à supplanter, subvertissant le poids stratégique des deux pays.
Le temps est venu pour l'Italie de reconnaître la Turquie comme son concurrent le plus dangereux et non comme un allié potentiel à ménager.
En attendant, les relations entre Rome et Tripoli se poursuivent par des canaux parallèles plus ou moins productifs. Dans certains cas, elles laissent franchement perplexe.
Compte tenu du passé récent et des rebuffades que Paris subit depuis quelques mois en Afrique, les initiatives en tandem avec la France ne sont pas très efficaces. Ces derniers jours, le Premier ministre Mario Draghi et le président français Emmanuel Macron se sont rencontrés en marge du sommet européen de Brno, en Slovénie, et ont discuté de la situation en Libye.
A l'issue de la réunion, le gouvernement italien a publié une déclaration réitérant la "coordination étroite" entre l'Italie, la France et l'Allemagne pour la tenue d'une conférence sur la crise libyenne le 12 novembre à Paris. Le sommet a été décidé par Macron qui, cette fois-ci, contrairement au passé, a au moins pensé à consulter Rome avant de procéder à la convocation.
Quelques semaines auparavant, le ministre Lamorgese avait rencontré le vice-président du Conseil présidentiel libyen, Abdullah al-Lafi, pour discuter de la manière de développer la coopération et la coordination entre l'Italie et la Libye sur le dossier des migrants, mais sans grand résultat.
La rencontre à Tripoli entre Almishri, l'ambassadeur italien Giuseppe Buccino et l'envoyé spécial de la Farnesina pour la Libye, Nicola Orlando, qui a confirmé la volonté de maintenir un interlocuteur avec les Frères musulmans, a laissé perplexe.
Enfin, une rencontre bilatérale a eu lieu en septembre entre le ministre du Développement économique Giancarlo Giorgetti et le vice-président du Conseil présidentiel libyen Al-Lafi, en visite à Rome, au cours de laquelle les deux hommes ont abordé les questions liées à la coopération économique et industrielle, à commencer par les infrastructures et l'énergie. M. Giorgetti a souligné que l'Italie s'est engagée à promouvoir le processus de stabilisation et de réconciliation nationale en Libye et le redressement économique du pays, dans lequel les entreprises italiennes ont toujours joué un rôle de premier plan. Dans ce cas, la confrontation sur des questions concrètes et pragmatiques pourrait avoir des effets positifs.
Conclusions
Ces derniers jours, de nombreux commentateurs autorisés ont insisté sur la thèse selon laquelle l'Italie, grâce à la stature internationale de Mario Draghi et compte tenu des difficultés françaises et de la vacance du pouvoir dans l'Allemagne post-Merkel, pourrait être le grand protagoniste de la relance de l'Alliance transatlantique, qui est en crise évidente après le retrait d'Afghanistan et le lourd manque de respect diplomatique américain à l'égard de Paris à l'occasion de la fourniture de sous-marins à l'Australie. Le provincialisme de certains experts est déconcertant, d'autant plus qu'il ne semble pas être lié uniquement à des attitudes propagandistes en faveur de l'exécutif actuel, mais le résultat d'une véritable conviction. C'est un symptôme du manque de culture stratégique qui traverse les classes dirigeantes et l'opinion publique italiennes, qui oscillent craintivement entre la sous-estimation et la surestimation du potentiel de l'Italie. Il est vrai que l'Italie est un grand pays, mais elle devrait apprendre à concentrer ses efforts - et l'autorité (éventuelle) de l'actuel Premier ministre - pour qu'ils soient rentables, dans le scénario dans lequel elle joue effectivement un rôle et sur les pays étrangers voisins : la Méditerranée et l'Afrique du Nord. Ici, la Turquie est désormais un problème évident, et une confrontation étroite avec elle est nécessaire sur tous les fronts. C'est une folie que l'UE continue à financer Ankara, cédant à son chantage, pour pouvoir ensuite armer illégalement la situation déjà difficile en Libye.
Concentrons-nous sur ce point, l'Atlantique est loin.....
Alessandro Sansoni.
15:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : italie, libye, turquie, méditerranée, afrique, afrique du nord, aafaires africaine, s europe, affaires européennes, géopolitique, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 08 octobre 2021
Décisionnisme tunisien

Décisionnisme tunisien
par Georges FELTIN-TRACOL
Où va la Tunisie depuis le 25 juillet 2021 ? Ce jour-là, fête nationale du pays, le président de la République Kaïs Saïed annonce à la télévision la mise en œuvre immédiate de l’article 80 de la Constitution de 2014. Il décrète l’état d’exception, suspend les séances du Parlement et limoge le gouvernement de Hichem Mechichi dont il désapprouvait la politique.
Le président tunisien a pris cette mesure d’urgence alors que la Cour constitutionnelle chargée d’en valider l’application n’existe toujours pas. La nomination de ses membres s’empêtre depuis six ans dans les méandres des chicaneries politiciennes. Outre l’impéritie gouvernementale en matière sanitaire et le naufrage consécutif du système de santé, le chef de l’État veut nettoyer les écuries d’Augias.
Par la « Révolution de jasmin » qui chassa le président Ben Ali en 2011, la Tunisie serait devenue le parangon arabe, africain du nord et proche-oriental de la démocratie aux critères occidentaux cosmopolites. La décision présidentielle suscite la grande inquiétude de l’Allemagne et des États-Unis toujours prêts à défendre le pouvoir législatif, y compris vérolé par l’islamisme. Or, en une décennie presque perdue, le peuple tunisien a vécu une nette dégradation du niveau de vie, l’augmentation massive du chômage et l’explosion de la corruption. La partitocratie (plus de soixante-dix partis !) favorise cette dernière qui transforme le Parlement en bac à sable pour garnements indisciplinés et en carrefour idoine pour de juteux profits. Le président Saïed a ordonné la levée de l’immunité parlementaire de certains députés et lancé des poursuites contre plusieurs magistrats.
Par son choix audacieux salué par la rue tunisienne exaspérée, le chef d’État n’hésite pas à heurter le principal parti politique du pays, les islamistes conservateurs d’Ennahda (« Renaissance » en français). Créée en 1981 et légalisée en 2011, cette formation issue des Frères musulmans de Tunisie a longtemps été le fer de lance de l’opposition à Ben Ali. Son chef, Rached Ghannouchi jusqu’à présent président de l’Assemblée des représentants du peuple, a vécu de nombreuses années en Grande-Bretagne. Il y bénéficiait du statut de réfugié politique. Ghannouchi serait-il un agent d’influence de la « Global Britain » dans une région habituellement convoitée par la France, l’Italie, l’Égypte et la Turquie ?
Âgé de 63 ans, Kaïs Saïed accède à la présidence avec 72,71 % des voix au second tour en 2019 face à l’homme d’affaires Nabil Karoui. Ce juriste rigoureux, par ailleurs enseignant universitaire, dirige de 1995 à 2019 l’Association tunisienne de droit constitutionnel. Il se fait connaître du public au moment de la rédaction de la Constitution de 2014 en étant un invité régulier à la télévision et à la radio. S’exprimant en arabe classique et non en dialecte tunisien, il attire la curiosité, puis la sympathie du public qui apprécie ses critiques contre les politiciens corrompus. Libre de tout engagement partisan, le futur président mène une campagne électorale modique, seulement aidé par des volontaires motivés et ses anciens étudiants. Ses manières rigides et son mode de vie ascétique plaisent beaucoup aux électeurs.
Sa volonté de contenir les petits jeux politiciens agace ses détracteurs. Certains l’accusent d’islamo-conservatisme. Favorable à la peine de mort, Kaïs Saïed n’apprécie pas l’idéologie LGBTQA+++. Ce non-islamiste estime néanmoins que l’islam informe la société et les mentalités tunisiennes. Ainsi se montre-t-il hostile à toute égalité entre les hommes et les femmes en matière d’héritage. Très influencé par le récit panarabe nassérien, il tient en politique étrangère des positions souverainistes. Cet anti-sioniste refuse toute relation diplomatique avec l’État d’Israël.

D’autres contradicteurs le décrivent cependant en gauchiste masqué. Kaïs Saïed n’apprécie pas l’actuel texte constitutionnel qui établit un régime semi-présidentiel à forte prépondérance parlementaire. Pendant la campagne présidentielle, il propose une démocratie directe avec le recours fréquent au référendum. Cette mesure a aussi été défendue par les « Gilets jaunes » en France avec le RIC (référendum d’initiative citoyenne) et par un nouveau parti en Allemagne, Die Basis ou Basisdemokratische Partei Deutschland, soit le « Parti de la démocratie de base d’Allemagne ». Sur l’une de ses affiches pour les législatives de septembre 2021, on peut lire : « Pour le référendum. Trouver avec les autres la meilleure voie. »
À la démocratie directe, le président tunisien prône aussi la possibilité de révoquer les élus à tout moment, et un parlement élu au suffrage universel indirect dans des circonscriptions régionales. Les députés proviendraient des conseils régionaux eux-mêmes constitués de délégués extraits des conseils locaux (ou communaux). Dans ce système politique révolutionnaire, seul le chef de l’État, impartial car détaché de toute coterie partisane, serait élu au suffrage universel direct.
Cette conception institutionnelle serait-elle une référence implicite à Carl Schmitt ? Signant un article mis en ligne le 20 novembre 2019 sur un blogue hébergé par Médiapart et intitulé « Tunisie. Puissions-nous, de la Révolution culturelle de Kaïs Saïed, être préservés ! », Salah Horchani accuse Kaïs Saïed de « schmittisme ». Il dégaine même l’argument ultime : « Carl Schmitt et Kaïs Saïed, écrit-il, ont les mêmes initiales, à peu près. Tout cela donne une origine nazie à la refonte constitutionnelle que Kaïs Saïed nous a projetée. » Dans une réponse en date du 11 décembre 2019 sur le site Leaders.com.tn « Non, Kaïs Saïed n’est pas schmittien », Mohamed Chérif Ferjani considère au contraire le président tunisien comme un redoutable populiste.
Ces deux auteurs oublient que plutôt que suivre les leçons du rédacteur de la Théorie de la Constitution guère connu dans le monde arabe, Kaïs Saïed s’inspire du voisin libyen et du Livre vert de Mouammar Kadhafi qui développe la « troisième théorie universelle ». Dans le cadre de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, le Congrès général du peuple repose en principe sur des milliers de Congrès populaires de base avec une révocation possible des délégués. Souvent traduit en français par « État des masses », Jamahiriya correspond surtout à l’ochlocratie.
Depuis deux mois, la Tunisie semble suspendue. Aucun chef de gouvernement n’a été nommé. Les responsables des ministères régaliens exercent à titre provisoire. Kaïs Saïed paraît abasourdi devant l’ampleur de la tâche. Il tarde à donner des orientations claires. Il envisagerait de dissoudre le Parlement, de convoquer des élections générales et de modifier la constitution dans un sens plus présidentialiste. Sous sa férule, la Tunisie passerait-elle progressivement de la démocratie représentative des partis, paravent commode aux compromis ploutocratiques, à une « démarchie » participative charismatique ? Les chancelleries occidentales n’ont pas fini de se faire du souci.
GF-T
- Entre l’enregistrement de cette chronique et sa diffusion, le président tunisien a enfin nommé, le 29 septembre dernier, au poste de chef du gouvernement Najla Bouden, une géologue spécialiste des questions pétrolières. C’est la première fois qu’une femme occupe cette fonction au Maghreb et dans le monde arabe.

- « Vigie d’un monde en ébullition », n° 4, mise en ligne sur Radio Méridien Zéro, le 5 octobre 2021.
14:08 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, tunisie, kaïs saïed, afrique, affaires africaines, afrique du nord, monde arabe, monde arabo-musulman, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 28 septembre 2021
Le port de Hambourg devient chinois. Le dernier cadeau de Frau Merkel à Pékin

Le port de Hambourg devient chinois. Le dernier cadeau de Frau Merkel à Pékin
Marco Valle
Ex: https://blog.ilgiornale.it/valle/2021/09/27/il-porto-damburgo-diventa-cinese-lultimo-regalo-di-frau-merkel-a-pechino/#disqus_thread
La République populaire de Chine a résisté à la pandémie mondiale sans trop de dommages (du moins en apparence) et poursuit son expansion économique, politique et militaire. Partout, vraiment partout. Même sur les mers. Pour la première fois de sa longue histoire - à l'exception de l'intermède du quinzième siècle avec les expéditions de l'amiral Zheng Hen - elle a créé une grande marine militaire et marchande, se transformant ainsi en une puissance maritime. Un objectif ambitieux et sans précédent, comme le rappelle Edward Sing Yue Chan, qui fait "partie intégrante du 'rêve chinois' de renouveau national". C'est l'un des principaux objectifs du président depuis son arrivée au pouvoir, comme il l'a réitéré en 2017 dans un discours aux commandants de la marine" (Limes, n° 10/ 2020).
L'essor thalassocratique et naval de la Chine repose sur un réseau efficace d'alliances et d'influence étendu de l'Asie du Sud à l'océan Indien. C'est la stratégie du "collier de perles", un long cordon de comptoirs et de relais dans lequel Pékin a englobé le Sri Lanka, la Birmanie, le Bangladesh, les Maldives, le Pakistan et, depuis 2017, Djibouti en Afrique, la première base militaire du Dragon hors du territoire national. Officiellement, cette installation (la première garnison militaire permanente de la République à l'étranger) est un point d'appui pour les navires et les équipages engagés dans des missions de lutte contre la piraterie.

Depuis 2008, Pékin a déplacé plus de 70 unités, dont des destroyers, des frégates et des navires de ravitaillement, et maintient une force opérationnelle navale permanente devant Aden. En réalité, la base répond à des logiques plus larges. L'installation a une capacité d'accueil de dix mille personnes et représente une porte d'entrée sécurisée au cœur du continent ainsi qu'un bouclier efficace pour les innombrables intérêts chinois dans la petite république.
En 2018, les Chinois, juste devant leur base, ont inauguré un port multifonctionnel, le terminal à conteneurs de Doraleh, et une usine pétrolière (tous deux gérés par l'entreprise publique China Merchants Group) ; un an plus tard, le Djibouti Damerjog Industrial Development (DDID), une zone franche de 43 kilomètres carrés gérée exclusivement par trois entreprises chinoises (coût de 3,5 milliards de dollars), a été créé. Sous la direction de la Chine en janvier 2021 (virus ou pas...), Djibouti a clôturé l'accord entre Air Djibouti, Ethiopian Airlines et l'autorité portuaire nationale (DPFZA) pour la construction d'un nouvel aéroport, futur hub africain pour les marchandises chinoises (déchargées, bien sûr, par des navires chinois au port chinois de Doraleh).
Les Chinois possèdent désormais 77 % de la dette nationale, qu'ils utilisent pour programmer et rythmer le plan de développement Vision 2035, l'avenir de ce fragment de la Corne de l'Afrique. L'objectif, comme l'indique un document de la Banque de Chine, "est de transformer le pays, qui n'est plus un centre logistique régional, en un centre financier et un carrefour commercial mondial". En bref, un nouveau Dubaï en jaune.
L'investissement de Gibutan est en synergie avec l'enclave industrielle exempte de taxes dans la zone du canal de Suez - la zone économique et commerciale Chine-Égypte-Suez - et avec la gestion par Cosco (China Ocean Shipping Co., troisième compagnie maritime mondiale après Maersk et Msc) du terminal à conteneurs du canal de Suez, une plateforme entièrement chinoise. Un choix ciblé: depuis 2001, le volume de marchandises traversant le canal a fait de la Méditerranée le principal débouché de 19 % du trafic mondial; 56 % des marchandises empruntant la voie d'eau atteignent le cœur de l'Europe. Le calcul est simple.
Suez et Djibouti sont deux pièces centrales d'un grand projet. Laissez-nous vous expliquer. Les ports maritimes sont l'objectif prioritaire de Pékin: selon une étude du Centre for Strategic & International Studies, 46 ports africains ont été financés, conçus (et sont en cours de construction) ou gérés par des entités chinoises. Cet investissement vise à garantir un traitement prioritaire aux navires à moindre coût, assurant ainsi un avantage concurrentiel aux transporteurs chinois: acheminer des volumes croissants de marchandises vers les marchés européens dans les plus brefs délais. Il s'agit notamment des projets d'extension du port commercial de Lamu, au Kenya (pour un coût de 500 millions de dollars), et de la construction du port de Bagamoyo, en Tanzanie, avec un investissement estimé à 11 milliards de dollars et la coparticipation de la Tanzanie, de la Chine et d'Oman: situé à seulement 50 kilomètres au nord de Dar es Salaam et opérationnel à partir de 2022, Bagamoyo deviendra le plus grand port d'Afrique de l'Est.

À son tour, la conquête douce de l'Afrique est imbriquée dans l'initiative Belt and Road (BRI), la "nouvelle route de la soie", une formidable offensive politique et commerciale qui concerne actuellement plus de 80 nations et s'apprête à investir toute l'Europe. C'est un projet articulé avec des investissements massifs et une planification efficace avec un objectif clair: nos économies, nos souverainetés.
Le point de départ est 2010, lorsque Cosco rachète le Pirée, le principal port de la Grèce, à un prix avantageux. L'Union européenne et l'Allemagne, trop occupées à vampiriser la Grèce, s'en sont moquées et ont donné leur accord. La concession aux Chinois de deux jetées était prévue pour 35 ans, et Cosco devait payer un milliard d'euros au total. Mais la valeur économique de l'opération devait être de 4,3 milliards au total, compte tenu des accords de répartition des bénéfices et des investissements que l'entreprise publique du Dragon s'est engagée à réaliser. L'appétit venant en mangeant, Cosco a racheté cet été 67% de l'ensemble de l'Autorité portuaire, prenant ainsi possession jusqu'en 2052 de la totalité de la structure, opérant depuis lors en tant qu'opérateur de terminal mais aussi en tant que concessionnaire, client et fournisseur de lui-même. Le Pirée est ainsi devenu la première véritable brique BRI européenne, une porte d'entrée de l'expansion commerciale et industrielle asiatique en Europe, avec des investissements massifs dans les terminaux mais aussi dans la logistique, la réparation navale et le tourisme.


Le résultat ? Une excellente affaire, comme le confirment les chiffres: en 2009, le Pirée a traité moins de 700.000 Teu (unité de mesure des conteneurs de 20 pieds). En 2014, il en a traité 3,6 millions, en 2019, il est passé à 4,9 millions. "En 2010, souligne Alessandro Panaro, directeur de l'Observatoire du trafic maritime de Srm Intesa Sanpaolo, le Pirée n'était pas du tout compétitif, Valence faisait quatre fois ses conteneurs, Tanger Med en faisait déjà deux millions, Port Saïd trois et demi tandis que le port grec n'arrivait pas à en faire un. Depuis l'arrivée du colosse chinois, il est devenu le deuxième port de la Méditerranée et déplace aujourd'hui plus de cinq millions de Teu". Selon un rapport du Srm, en 2020, l'ensemble du système portuaire italien a transporté un peu moins de 10,7 millions de Teu...
Après le Pirée - désormais le pivot de la pénétration jaune en Europe, pour se connecter par train à Belgrade et Budapest - la Cosco a acquis d'importantes participations dans les ports de Kumport (Turquie), Ashod (Israël), Tangeri (Maroc), Cherchell (Algérie), Salonicco (Grèce), Valence et Bilbao (Espagne), Gyynia (Pologne), Rotterdam (Pays-Bas), Zeebrugge et Anvers (Belgique), Vado Ligure (Italie), acquérant ainsi le contrôle de 10% du mouvement conteneurisé du Vieux Continent ; un autre géant public basé à Pékin, China Merchant Port, détient une part minoritaire de Marseille et opère en tant qu'opérateur de terminaux ferroviaires à Venlo, Moerdijk et Amsterdam aux Pays-Bas, Willebroek en Belgique et Duisburg en Allemagne. C'est le plus grand port intermodal (fluvial) du monde, capable de traiter vingt mille navires et vingt-cinq mille trains par an, une cathédrale de la logistique intégrée.

Mais ce n'est pas tout. Ces jours-ci, Cosco a conclu (dernier cadeau d'Angela Merkel à Pékin ?) l'accord pour le troisième port le plus important de l'UE, Hambourg: la société, par l'intermédiaire de sa filiale Grand Dragon, a conclu l'accord avec l'opérateur de terminal allemand Hhla pour reprendre 35% d'un des trois terminaux, le Tollerort (Ctt), au prix de 65 millions d'euros, en plus de reprendre 35 millions de dettes de Ctt avec Hhla. Bien qu'il s'agisse de la plus petite installation du port allemand, elle transporte environ 9,2 millions de TEU chaque année. Pas mal pour une entreprise qui émane directement de l'organe administratif suprême, le Conseil d'État, et donc du Parti communiste chinois.
La nouvelle a évidemment animé le débat électoral allemand (contribuant à l'effondrement de la CDU) et inquiété les bureaucrates de Bruxelles. L'accélération à Hambourg a pris au dépourvu la commissaire chargée de la lutte contre les ententes, Margrethe Vestager, qui a présenté au printemps dernier un "bouclier" communautaire pour défendre les entreprises européennes contre les rachats par des acteurs étrangers subventionnés par leur État d'origine, et a obtenu son approbation. Sur le papier, le signal envoyé à Pékin est clair : les entreprises qui reçoivent plus de 50 millions d'euros de subventions étrangères et qui cherchent à acquérir des actifs dans l'UE d'une valeur supérieure à 500 millions d'euros ou à participer à des marchés publics d'une valeur minimale de 250 millions d'euros devront notifier la transaction à Bruxelles et obtenir son approbation.
"Lorsque vous ouvrez votre maison à des invités, vous attendez d'eux qu'ils respectent les règles de la maison. Cela doit également s'appliquer au marché intérieur", a souligné Mme Vestager. Nous attendons maintenant que la loi soit approuvée par le Conseil et le Parlement de l'UE. Avant qu'il ne soit trop tard.
11:46 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hambourg, le pirée, europe, affaires européennes, allemagne, grèce, afrique, djibouti, chine, affaires africaines, ports, installations portuaires |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 11 septembre 2021
Ethnologie et ontologie des peuples de l'Afrique de l'Ouest

Ethnologie et ontologie des peuples de l'Afrique de l'Ouest
Alexandre Douguine
Ex: https://katehon.com/ru/
Une branche de la famille nigéro-congolaise est constituée par le peuple mandé. Les langues de cette famille linguistique diffèrent sensiblement des autres langues nigéro-congolaises par des paramètres fondamentaux, c'est pourquoi les linguistes les considèrent comme les premières à se séparer du tronc principal, avec les langues Ijo et Dogon. Les différences entre le mandé et la structure même de la famille nigéro-congolaise sont si grandes qu'il existe des classifications qui séparent les langues mandé et les attribuent à une famille distincte.
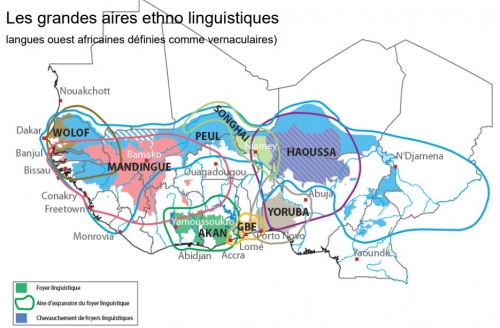
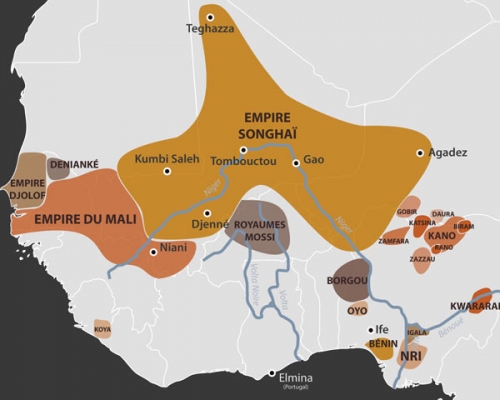
Les peuples mandés ont des origines très anciennes et ont été les fondateurs et la classe dirigeante des anciens empires d'Afrique de l'Ouest. On considèere que le foyer ancestral des peuples mandés est la région du Mandé, dans le sud-est du Mali actuel, d'où diverses tribus se sont répandues dans toutes les directions, formant des types de sociétés distinctes liées par la similitude de la langue et de la culture, mais avec une identité séparée et souvent assez distincte.
Les langues mandées sont divisées en trois grandes branches - occidentale, orientale et bobo, chacune comprenant des groupes entiers ainsi que des langues individuelles.
La plus importante est la branche occidentale, qui comprend quatre sous-branches : la sous-branche centrale, comprenant le Mandé (Mali, Guinée, Côte d'Ivoire, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Burkina Faso, Sierra Leone, Liberia), le Mokole, le Wai Kono, le Jogo-Jeri (Côte d'Ivoire), le Soso-Yalonka (Guinée); ensuite la sous-branche du sud-ouest, qui comprend les langues Mende, Loko, Bandi, Zialo, Loma et Kpelle (Sierra Leone, Guinée, Liberia); enfin, la sous-branche du nord-ouest, qui comprend le groupe Soninke-Bobo (Mali, Sénégal, Burkina Faso) et le groupe Samobo (Mali, Burkina Faso).

Les langues du groupe mandé sont les plus parlées de cette famille (qui porte le même nom), et ont le statut de langues nationales (idiomes) au Mali et en Guinée. Les langues de ce groupe sont parlées par les Malinké (Mali), les Bambara (Mali), les Mandinka (Gambie, Sénégal), les Dioula (Côte d'Ivoire, Burkina Faso), les Mau (Côte d'Ivoire), les Bolon (Burkina Faso), etc. Ces peuples vivent dans la région du Mandé, d'où est probablement originaire le peuple mandé, l'ancêtre de toutes les autres branches et groupes.

La branche nord-ouest comprend la langue parlée par le peuple Soninké, dont les ancêtres constituaient la classe dirigeante des anciennes cités-états (de la civilisation dite de Dhar Tichitt) et des empires (principalement le Ghana).


Ruines de la civilisation de Dhar Tichitt
La branche orientale se compose de deux sous-branches: la sous-branche orientale se composant également de deux sous-branches: la branche orientale, constituée du groupe Samo (Burkina Faso), du groupe Bisa (Nigeria, Bénin, Togo, Burkina Faso), du groupe Busa Kyaenga (Nigeria, Bénin), et la branche méridionale, constituée du groupe Tura-Qaenga (Nigeria, Bénin).
Les groupes du sud comprennent le groupe Tura-Dan Mano (Liberia, Côte d'Ivoire).
Dans l'ensemble, ces peuples ont une culture similaire, qui présente toutefois un certain nombre de différences fondamentales. Une composante variable est la présence dans ces sociétés d'une classe supérieure de clans dynastiques et d'une aristocratie guerrière, avec des répercussions de cet agencement social au niveau religieux avec des cultes solaires et stellaires et des représentations patriarcales. Chez certains peuples mandés, cette strate verticale et cette hiérarchie de castes persistent même lorsqu'ils passent d'un état d'ordre impérial à un mode de vie agraire (moins souvent nomade) (c'est le cas de presque tous les peuples du groupe mandé, soninké, etc.); d'autres (par exemple les Mende, Kpelle, Loma, Bisa, Dan, Mano, Samo, Bobo) sont dépourvus de cet ordre hiérarchique (ce qui s'accompagne parfois de la préservation des cultes solaires, et parfois nous n'y découvrons plus que la religion des esprits et des ancêtres).
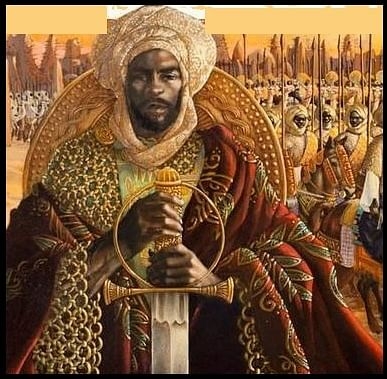
Cette différence peut avoir deux explications: soit l'horizon mandé s'est formé à l'origine dans le contexte de polités différenciées (ce que l'on peut supposer étant donné l'ancienneté de civilisations urbaines comme celle de Dhar Tichitt) et ensuite ses branches individuelles ont subi une simplification (jusqu'à la perte de la composante solaire et ouranienne), soit le processus a été inverse et les cultures agraires matriarcales ont été intégrées dans des polités stratifiées complexes, où à l'origine les porteurs du pouvoir dynastique et des religions célestes appartenaient à d'autres peuples, dont les Mandé eux-mêmes, ont été transférés. Ainsi, les tribus mandé, où l'on ne trouve ni castes ni références directes aux divinités paternelles célestes, peuvent être considérées à la fois comme les plus archaïques, devenues extérieures aux processus ethno-sociologiques de type impérial, et les plus "modernes", c'est-à-dire ayant perdu les couches supérieures de leur identité originelle (si l'on admet que cette identité était intrinsèquement structurée de manière verticale). Le plus souvent, un différentiel de caste significatif prévaut encore dans les sociétés mandéennes, bien que dans le même temps, les structures du matriarcat sous-jacent soient également soulignées de manière très contrastée.
Fulbe : tribus et politiques
Les Fulbe (également appelés Fula, Fulani, Peul, etc.) sont un peuple largement répandu sur les territoires de l'Afrique occidentale et centrale. Ils constituent la communauté la plus importante parmi les autres locuteurs de la branche atlantique des langues nigéro-congolaises. Les tribus Fulbe sont répandues de la côte atlantique de l'Afrique jusqu'au Nil.

Les Fulbes pratiquaient traditionnellement l'élevage et parcouraient des distances considérables avec leurs troupeaux. Il est probable qu'ils ont adopté le style de vie nomade des Berbères, mais qu'ils ont ensuite fait de l'élevage leur principale occupation, fondant tout leur mode de vie sur cette pratique. Selon une autre version, les Fulbes sont un peuple mixte, formé à partir des tribus nomades (très probablement berbères) d'Afrique du Nord et des peuples du groupe nigéro-congolais. Il existe des différences culturelles et même phénotypiques importantes dans la structure de la branche des peuples de langue atlantique eux-mêmes. Les Fulbe sont donc des nomades et des pasteurs. En même temps, leur peau est souvent plus claire que celle des autres nigéro-congolais, et les traits de leur visage présentent des caractéristiques europoïdes, semblables à celles des Berbères et des peuples tchadiens (comme les Haoussas).


Dans le mode de vie et la mythologie des Fulbe, nous constatons également des similitudes spécifiques avec l'horizon afro-asiatique. Bien que les Fulbe soient majoritairement musulmans, leurs sociétés, même après un millénaire de domination islamique, montrent des signes évidents de matriarcat: la position des femmes est nettement plus libre que celle des autres tribus Fulbe environnantes.
La langue fulbe était considérée par les linguistes du début du XXe siècle comme appartenant aux langues hamitiques, et l'affinité avec les langues nigéro-congolaises était le résultat de contacts culturels secondaires. Bien que cette théorie ait été réfutée depuis par des méthodes strictement linguistiques, la volonté de voir les Fulba comme relevant d'un horizon afro-asiatique est frappante, tant ils en sont proches typologiquement.
Comme pour la plupart des peuples d'Afrique de l'Ouest liés à l'histoire politique de cette région, il existe trois castes dans la société Fulba, qui sont endogames: les dirigeants (Imams) - Rimbbe, les artisans et pasteurs libres - Ninbbe et les esclaves - jayabbeh.
Cette hiérarchie suggère qu'ils sont une partie organique du même horizon auquel appartiennent les Berbères, les Tchadiens et les peuples de la branche mandingue, qui ont dans leur histoire présentent des organisations strictement verticales depuis l'Antiquité.

Les Fulbes forment souvent des sociétés mixtes avec les Berbères et les Tchadiens (surtout les Haoussas), occupant une position égale à celle des Africains dans ces structures stratifiées. Il existe un continuum culturel entre les Berbères, les Tchadiens (principalement Haoussa) et les Fulbe, ce qui se reflète dans l'émergence de sociétés telles que les Hausa-Fulani au Nigeria, où les deux peuples forment une unité sociale, se fondant facilement l'un dans l'autre.
Historiquement, cela se manifeste également par le fait que les Peuls ont été les premiers peuples nigéro-congolais à se convertir à l'Islam sous l'influence des Berbères et des Arabes. Certains auteurs pensent que les Fulbe sont originaires du Moyen-Orient, c'est-à-dire qu'ils sont la branche la plus occidentale de l'horizon afro-congolais, ayant perdu leur langue en raison du mélange avec les Nigero-Congolais.
Dans une perspective plus limitée, cependant, la patrie des Fulbe, comme les autres peuples du groupe atlantique, était le fleuve Sénégal. De là, les tribus Fulbe se sont dispersées dans le Sahel et la savane, loin à l'est. Jusqu'à aujourd'hui, les Fulbe mènent principalement un mode de vie semi-nomade et s'adonnent occasionnellement à l'agriculture, qu'ils méprisent généralement comme tous les nomades. Le peuple Teculer parle également une langue proche du Fulbe.

Selon certaines estimations, il y a plus de 30 millions de Fulbe et de personnes parlant le Fulbe dans l'Afrique d'aujourd'hui, et avec les peuples Yoruba, Igbe et Haoussa, ils constituent le plus grand groupe de tribus africaines. Les Fulbe représentent le plus grand pourcentage de la population au Sénégal, en Gambie, au Mali, au Niger et en Haute-Volta. Dans certains cas, ils se sont mélangés à d'autres peuples, comme c'est le cas au Niger, où un nombre important de Fulbes parlent le haoussa (qui appartient au groupe tchadien). Les Fulbes sont également nombreux en Mauritanie, au Ghana, en Guinée, au Nigeria, en Sierra Leone, au Bénin, au Burkina Faso, en Guinée Bissau, au Liberia, en Côte d'Ivoire, au Cameroun et en République centrafricaine. On trouve des groupes distincts de Fulbe au Tchad, au Soudan et même en Éthiopie.
L'État de Takrur est l'une des premières polities fulbe à être documentée. Ses origines remontent au neuvième siècle de notre ère. Selon une version, les Fulbe sont arrivés sur le territoire en provenance de l'Est et se sont installés dans le cours inférieur du fleuve Sénégal sur la côte atlantique ; selon une autre version, ils se sont formés à la suite d'une interaction entre les Berbères, qui avaient leurs premières polities dans le Sahara, et les Serer locaux (groupe linguistique atlantique). À partir de cette époque, le nord de l'actuel État du Sénégal, sur la frontière avec la Mauritanie, est devenu un centre de commerce et les Fulbe ont commencé à jouer le rôle de classe dirigeante.
La première dynastie Takrur qui a existé avant l'émergence de l'Empire ghanéen serait celle des Dia Ogo. Il est rapporté dans les mythes des peuples sénégalais. La dynastie a été fondée par des étrangers venus du nord-est qui étaient forgerons et sorciers. Leur identité ethnique ne peut être établie avec certitude; diverses versions les rattachent aux peuples de la branche atlantique (Fulbe et Serer) et de la branche mandé (Malinke). Sous le règne de la dynastie Dia Ogo se trouvait une autre ancienne polarité du Sénégal : le royaume de Namandiru.

Pendant l'ère de l'Empire du Ghana et jusqu'à la montée de l'Empire du Mali, la deuxième dynastie a régné sur le Manna des Soninke (branche mandé). Dans les années 1030, le souverain Takrur de cette dynastie, War Jabi (? - 1041), s'est officiellement converti à l'islam et a introduit la charia dans son État. Il s'agit de la première conversion précoce à l'Islam des souverains des peuples nigéro-congolais, alors que les souverains berbères s'étaient convertis à l'Islam bien plus tôt.
La population Takrur a été connue plus tard sous le nom de peuple Tukuler (en français: Toucouleurs).
Les Toucouleurs étaient orientés vers les puissances islamiques, dont le centre était situé dans le nord de l'Afrique ou dans la péninsule ibérique. Ainsi, les souverains Takrur et d'autres tribus Fulbe ont participé activement à l'écrasement de l'Empire du Ghana au sein de l'armée almoravide. Après la chute du Ghana, Takrur est devenu un royaume totalement indépendant.
Plus tard, l'État de Takrur est passé sous la domination de l'Empire malinka, fondé par le peuple malinka. La prochaine dynastie Tondion arrive au pouvoir, issue du peuple Serer qui constituait la majorité de la population de Takrur à un stade précoce. Ses dirigeants reviennent aux croyances traditionnelles africaines.
Au XVIe siècle, un autre État fulbe, Futa Toro, émerge au Sénégal. Elle a été conquise à l'empire Jolof (qui sera décrit plus loin) par le commandant Koley Tengella (1512 - 1537), d'origine mixte (Fulbe et Mandinke), qui a fondé la dynastie Denianke. La dynastie des Denianke est restée au pouvoir jusqu'en 1776.
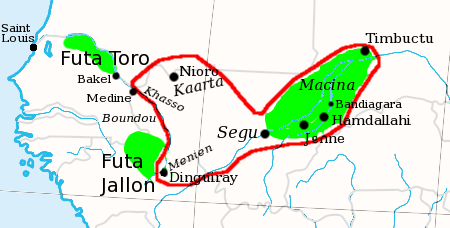
Empire toucouleur.
De la seconde moitié du 18ème siècle au début du 19ème siècle, les tribus islamiques Toucouleurs ont mené une série d'"attaques djihadistes" sur le territoire sénégalais contre des tribus (y compris des tribus Fulbe) qui ne s'étaient pas converties à l'Islam. C'est ainsi qu'en 1776, les islamistes ont renversé la dynastie des Denyanke et établi un régime islamique au Fouta Toro.
À la même époque, dans les années 1770, les musulmans fulbe ont créé un autre État, Futa Jallon, dans ce qui est aujourd'hui la Guinée. Comme Futa Toro, il est dirigé par des chefs d'ordres soufis. En 1804 - 1809, le Fulbe Ousman dan Fodio (1754 - 1817) soumet les Haoussa et établit le califat de Sokoto, qui soumet les cités-états haoussa et contre les attaques de l'empire du Borno. En 1809, les Fulbes créent l'émirat vassal de l'Adamawa, avec Yola comme capitale, dont les terres comprennent des parties du Nigeria, du Cameroun et de petites zones de l'ouest du Tchad et de la République centrafricaine. Le califat de Sokoto est communément appelé l'empire Fulbe.
Dans les années 1920, les Fulbe ont fondé un autre État, le sultanat de Masina au Mali (l'actuelle région de Mopti), dont la capitale était la ville de Hambullahi. Le fondateur du sultanat de Masina est le Fulbe Sekou Amadou (c.1776 - 1845).
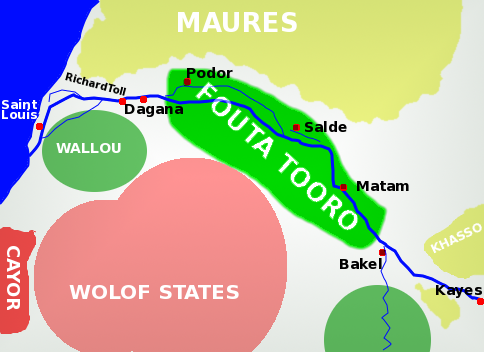
Au milieu du XIXe siècle, l'État de Fouta Tooro, successeur géopolitique de l'État Takrour au Sénégal, soumet Tombouctou et le sultanat de Masina.
Une figure marquante de l'histoire fulbe est le cheikh soufi Omar Tall (1794-1864), également connu sous le nom d'Omar Hajj. Il est considéré comme le fondateur de l'empire toucouleur ou de l'État de Tijaniya. Omar Haj a visité les lieux saints musulmans dans sa jeunesse et a établi des relations étroites avec le deuxième souverain du sultanat de Sokoto, le fils d'Osman dan Fodio, Mohammed Bello (1781 - 1837), ainsi qu'avec le souverain de Masina Sekou Amadou (1776 -- 1845).

Omar Hajj (photo) a été initié à la tarikat Tijaniyya et est devenu l'un de ses kutbs (pôles) faisant autorité, étant sanctionné pendant le hajj pour diriger toutes les branches de la tarikat en Afrique occidentale. Il rassembla autour de lui les tribus militantes toucouleurs et mit sur pied une armée efficace et disciplinée qui, en peu de temps, réussit à conquérir d'importants territoires, à soumettre les États de Ségou et de Kaarta (Bamabara), les polities mandingues, et entra également en guerre contre d'autres États peuls islamiques, notamment Masina.
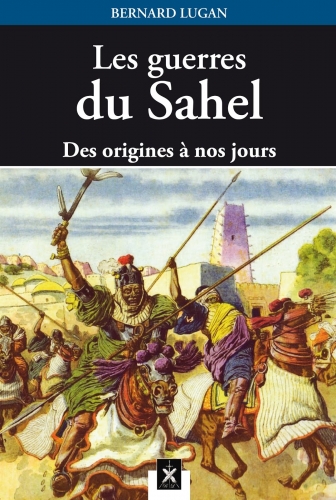
Le plateau de Bandiagara a été choisi comme centre de l'État de Tijaniya. Omar Hajj a présenté un projet d'"unité transcendantale des peuples du Soudan occidental", qu'il proposait d'unir autour de la religion islamique et de la métaphysique soufie. Dans sa structure, ce modèle d'empire soufi est très proche des idées des tariqats soufis d'Afrique du Nord, du Maroc à l'Égypte, et s'accorde avec les Sénoussistes de Cyrénaïque. En 1890, les Français et les Bambara s'emparent des territoires de l'empire toucouleur et les ajoutent à leurs possessions coloniales.
En 1893, un autre État djihadiste fulbe, le Fouta Tooro, passe sous la domination française. En 1896, les Français ont conquis le principal territoire du Fouta Djallon dans le sud du Sénégal.
En 1901, l'émirat d'Adamawa est divisé entre les Britanniques et les Allemands, qui envahissent le Cameroun. Le dernier État peul à tomber sous la domination britannique en 1903 fut le califat de Sokoto.
L'empire du Mali
Au cours de la période comprise entre le XIe et le XVIe siècle de notre ère, plusieurs nouveaux États importants, tels que le Mali et le Songhai, sont apparus dans différentes parties de l'ancien empire du Ghana. En revanche, à mesure que le Ghana décline, le Mali accroît sa puissance et devient progressivement une force géopolitique majeure en Afrique de l'Ouest.
L'empire du Mali a été fondé par le peuple malinké de l'ethnie mandingue. Le nom Mali est dérivé de l'ethnonyme malinké. Le peuple le plus proche des Malinkés, avec une structure sociale strictement identique, est le peuple Bambara. Elle est également proche des peuples Dioula, Diahanke, Soso, Dialonke et Bwa. Le peuple malinké a influencé les cultures des Dogon (famille distincte), des Senufo (groupe linguistique atlantique), des Mosi (langues gur), etc.


Folklore, masques et architecture au pays des Dogons (Mali).
L'histoire des Malinke remonte aux premières périodes de l'État du Wagadu, lorsque deux groupes de chasseurs, sous la direction des ancêtres légendaires Kontron et Sonin, se sont retirés dans la région de Mandé, où ils ont établi leurs propres règles de chasse. Ces deux groupes ont ensuite été connus sous le nom de tribus malinké et bambara. Progressivement, ils sont passés à un mode de vie sédentaire et à des pratiques agraires.
Après la défaite du Ghana par les Almoravides au XIIe siècle, la polarité de Kanyaga (Mali actuel), fondée par le peuple Soso (ou Susu) qui dépendait auparavant des Soninkés, a été consolidée. La dynastie de cet État tire son origine de la caste des forgerons, considérée comme inférieure dans les autres sociétés, mais qui avait des fonctions sacerdotales chez les Soso. L'ancêtre de la famille royale était le mythique sorcier-forgeron Kante. Les rois Soso ont rejeté l'islam plus longtemps que les autres peuples Mandé voisins, ont suivi les anciennes traditions et étaient considérés comme de puissants sorciers et faiseurs de miracles. En 1180, ils soumettent les Soninkés, qui étaient auparavant leurs suzerains, en leur faisant payer un tribut. En 1203, les Soso ont capturé la capitale ghanéenne de Kumbi Saleh. Sous le règne du souverain Kanyagi Sumanguru Kwant (vers 1200 - vers 1235), les Soso étendent leur pouvoir au Mandé également.
Le souverain (manse) d'une des principautés du pays Mandé avec un centre dans le village Niani Sundyatta Keita (c.1217 - c.1255), à qui l'on prédisait de devenir un grand roi, s'est révolté contre Kanyaga, et la coalition établie des tribus Malinke (en particulier, le souverain de la cité-état Kangaba) et Soninke en 1235 a vaincu Soso à la bataille de Kirin.
Après avoir vaincu les Soso, Sundyatta Keita s'empare de la capitale ghanéenne Kumbi Saleh en 1240, et devient ainsi le successeur géopolitique du pouvoir Soninke. Sundyatta Keita fait de Niani, où il règne, la capitale du Mali.
Les récits des exploits de ce monarque légendaire constituent l'épopée de Sundiata. Il est fort probable que sous ce roi, qui, dans l'épopée, apparaît comme un puissant magicien capable non seulement de conquérir militairement mais aussi d'accomplir des miracles, la lignée dynastique ait adopté l'Islam.
Sous le règne des descendants de Sundyatta Keita, le Mali soumet un certain nombre de polités régionales telles que Takrur, Songhai, etc. et établit également un contrôle sur les tribus nomades berbères.
L'un des piliers de l'économie de l'empire du Mali, comme de l'empire ghanéen antérieur, était les mines d'or d'Afrique de l'Ouest, qui sont devenues la source de prospérité de la dynastie régnante. La succession du miracle du "serpent noir" s'est poursuivie dans cet Empire également.
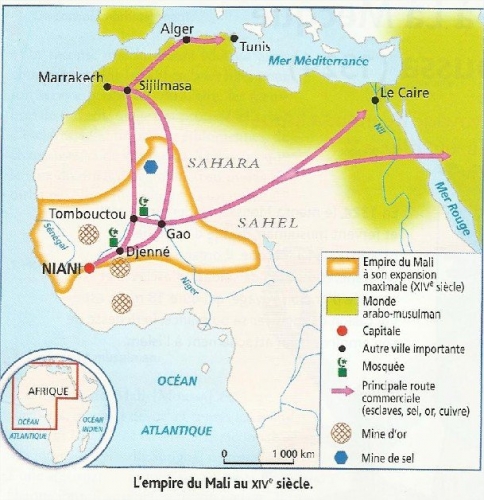
Si nous nous tournons vers une carte sur laquelle nous plaçons les États d'Afrique de l'Ouest de la fin du XIIe siècle et du début du XIIIe siècle, nous constatons que l'Empire du Mali occupe une position centrale dans toute la constellation des polités limitrophes qui sont d'une manière ou d'une autre associées au Mali et ont été en partie sous son influence. À quelques exceptions près, ces polities sont situées à proximité les unes des autres, créant un continuum politique où chaque segment représente une société hiérarchique stratifiée, c'est-à-dire un État - un empire, un royaume ou une principauté.
Cela montre l'énorme influence de la structure impériale sur toutes les sociétés ouest-africaines, qui sont sous l'influence déterminante du Logos politique vertical. Dans cette configuration, les peuples mandés sont au centre de tout ce système, représentant les peuples associés aux formes les plus anciennes d'organisation politique (ère Dhar Tichitt) ainsi qu'aux empires les plus tardifs et les plus importants d'Afrique de l'Ouest, le Ghana (Soninke) et le Mali (Malinke).
Ainsi, soit les peuples mandéens portent eux-mêmes un Logos patriarcal au cœur de leur identité, soit ils ont été, plus que d'autres, et plus tôt que les autres peuples nigéro-congolais touchés par des influences apolliniennes. Cette influence est clairement perceptible dans la structure même des espaces adjacents de tous côtés à l'Empire du Mali. En s'éloignant du pôle mandé, la concentration des sociétés hiérarchiques commence à s'affaiblir. C'est pourquoi, en Afrique de l'Ouest, dans la zone de l'Empire du Ghana et du Mali, il faut chercher le pôle originel de l'État apollinien, bien que la structure même de la religion et des traditions des Mandés, c'est-à-dire des fondateurs de l'Empire du Mali et de certaines polities adjacentes, ne soit pas aussi ouvertement apollinienne que celle des peuples nilo-sahariens, et comporte une composante matriarcale substantielle et lourde. Tout l'horizon du mandé, inséparable de sociétés clairement stratifiées, doit donc être considéré comme un phénomène complexe et multicouche dès ses origines.
Il est révélateur qu'à côté des polities des peuples du Mandé dans la zone d'influence de l'Empire du Mali et de ses espaces adjacents, on trouve d'autres peuples ouest-africains de la famille nigéro-congolaise appartenant à la branche atlantique (Fulbe, Wolof, Serer), à la branche de la Haute et Basse Volta (peuples Gur et Kwa), ainsi que les Yoruba, Igbo, etc. Et là où cette organisation politique existe, nous trouvons également des sociétés stratifiées correspondantes organisées selon des lignes hiérarchiques. En s'éloignant de ce pôle ouest-africain - à l'est et au sud - vers les peuples Adamawa-Ubangi et l'oikumene bantou, cette ligne verticale s'affaiblit également, et par conséquent les sociétés perdent la couche dynastique-aristocratique et ses niveaux correspondants de théologie solaire et ouranienne.
Guinée : Mande vs Peul
Un autre État où règne le peuple Fulbe (également appelé Peul) est la Guinée, située sur la côte atlantique entre la Guinée Bissau et la Sierra Leone, et bordant le Mali à l'est. La capitale de la Guinée est Conakry.
Les Fulbes sont arrivés au XVIe siècle dans ce territoire, qui faisait autrefois partie des empires ghanéen et malien, alors qu'auparavant, il était principalement habité par les peuples mandés des groupes malinké, yalunk et soso. Les Fulbes, comme nous l'avons vu, se sont tournés vers la pratique du "djihadisme" et ont commencé au 18ème siècle une série de raids, attaquant l'Empire Jolof (Sénégal) et d'autres tribus (principalement le Mandé) ainsi que les tribus Fulbe qui ont conservé l'ancienne foi. C'est ainsi que fut créé l'État de Futa Jallon. Les principaux territoires de cet État sont situés dans la chaîne de montagnes et les Fulbes, qui se sont installés dans ces régions - contrairement à la plupart des autres branches - se sont convertis à la vie sédentaire.
Auparavant, ces territoires étaient habités par les peuples mandés - principalement les Soso et les Yalunka. Les Yalunka (un peuple proche des Soso) se sont convertis à l'Islam en même temps que les Fulbe, mais leur version était fondamentalement différente de la version djihadiste fulbe des XVIIIe et XIXe siècles, à tel point que lorsque les Fulbe ont commencé à imposer leur modèle de charia avec des éléments salafistes, les musulmans Yalunka ont rejeté l'Islam complètement, et ont été convertis de force à nouveau après avoir perdu la guerre contre les Fulbe.
À partir de la fin du XIXe siècle, le Fouta Djallon fit partie de la Guinée française.
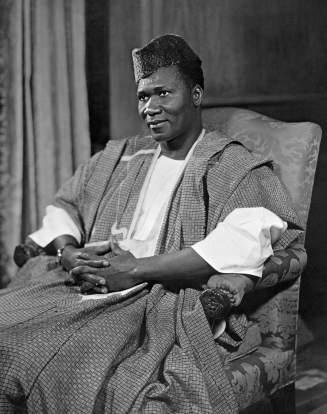
Après l'indépendance, Ahmed Sékou Touré (1922 - 1984) (photo), originaire du peuple malinké, est devenu le premier président de la Guinée. Ahmed Sékou Touré était un partisan de la décolonisation totale et menait une politique violemment anti-française. Passionné de socialisme, il se rapproche de l'URSS et réalise une série de transformations socialistes dans le pays. Par la suite, il a quelque peu réorienté sa politique à l'égard des États-Unis.
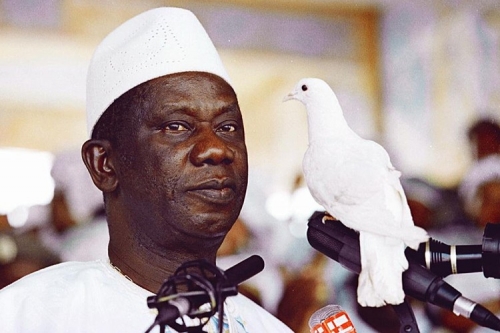
Après la mort d'Ahmed Sékou Touré, le colonel Lansana Conté (1934 - 2008) (photo), un Soso également issu de l'ethnie mandingue, prend le pouvoir en Guinée par un coup d'État militaire. L'appartenance ethnique du dirigeant déterminait l'équilibre du pouvoir en politique. Soso, Yalunka et Malinke soutiennent Conté, tandis que les Fulbe (Peul) sont dans l'opposition. C'est également la logique qui sous-tend les purges dans l'appareil d'État, chaque Peul étant soupçonné de faire partie de l'opposition et considéré comme un conspirateur potentiel. Les représentants du Soso (plus largement du Mandé), en revanche, étaient considérés comme loyaux et formaient l'épine dorsale du cadre politique et militaire du pays.
Conté a instauré un régime autoritaire, qui s'est effondré immédiatement après sa mort lorsqu'un autre coup d'État militaire a eu lieu. À la tête de la junte militaire se trouvait cette fois le colonel Moussa Camara du peuple Kpelle (également un groupe mandé) (photo). Les Peuls se retrouvent à nouveau en opposition et l'élite est recrutée chez les Kpelle.
En 2009, les Peuls ont entamé une série de manifestations et Moussa Camara a ordonné leur répression violente, ce qui a entraîné un bain de sang et des violences contre les Fulbe.
Moussa Kamara lui-même a été à son tour gravement blessé lors d'une tentative d'assassinat en 2009 par un agent de sécurité, Abubakar Tumba Diakité.
Le régime militaire a pris fin en 2010, et le pouvoir est passé au président Alpha Condé, issu du peuple malinka, lors des premières élections multipartites en Guinée. Il subit une tentative d'assassinat en 2011.

Alors que les Fulbe constituent la majorité de la population guinéenne, le pouvoir politique est conservé par les membres du groupe mandé (Malinke, Soso, Kpelle), qui constituaient la principale population du pays avant l'arrivée massive de djihadistes fulbe au 18ème siècle. Lors des élections de 2015, l'ancien Premier ministre Chello Daylen Diallo, issu du peuple peul, s'est présenté, mais c'est finalement le candidat mandé, Alpha Condé (photo, ci-dessus), qui a de nouveau gagné.
Le 5 septembre 2021, Alpha Condé, en Guinée, connaît un coup d'État militaire mené par le colonel Mamadi Dumbuya, également ressortissant du peuple mandé.
Nous suivrons les événements dans cette région du monde.
15:42 Publié dans Actualité, Ethnologie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, histoire, afrique, afrique occidentale, affaires africaines, guinée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 août 2021
Éthiopie - Un drame sanglant se déroule dans la Corne de l'Afrique

Éthiopie : le conflit continue
Éthiopie:
Un drame sanglant se déroule dans la Corne de l'Afrique
Ex: https://katehon.com/ru/article/efiopiya-konflikt-prodolzhaetsya
Les affrontements armés entre les forces gouvernementales et le Front de libération du peuple du Tigré (TPLF) ont commencé en novembre de l'année dernière. Le même mois, la province a été occupée par la Force de défense nationale éthiopienne, les troupes de l'État éthiopien d'Amhara et la Force de défense érythréenne, qui s'était alliée au gouvernement fédéral. La victoire semblait acquise, mais le TPLF s'est allié à des groupes d'opposition tigréens, à des vétérans militaires et à des volontaires. En conséquence, les forces de défense du Tigré (TDF), motivées à cause des violences commises par les forces de la coalition gouvernementale, ont vaincu l'armée éthiopienne à la fin du mois de juin de cette année. L'opération Allula a permis à la SOT de reprendre la majeure partie du Tigré en quelques jours. Des milliers de soldats gouvernementaux ont été faits prisonniers et le gouvernement fédéral a été contraint de déclarer un cessez-le-feu unilatéral - admettant ainsi sa défaite. L'armée éthiopienne a effectivement cessé d'exister.

Fin juin également, le Parti de la prospérité éthiopien, dirigé par le Premier ministre sortant Abiy Ahmed, a remporté la victoire, obtenant 410 des 436 sièges du Parlement. Environ un cinquième du pays n'a pas participé, ce qui a réduit la légitimité sur laquelle on pouvait compter pour mettre en œuvre des réformes économiques et centraliser la gouvernance.
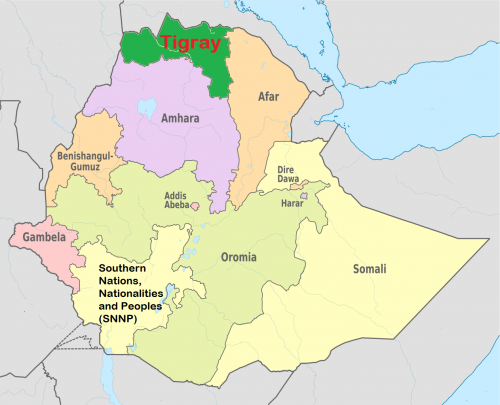
Le gouvernement fédéral, ne disposant plus de moyens militaires, a commencé un blocus du Tigré. Les troupes en retraite ont pillé les infrastructures, notamment les banques et les télécommunications, tandis qu'Addis-Abeba a cessé de fournir les services de base. Selon l'ONU, quelque 4 millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire, et environ 400.000 personnes sont en situation de détresse. Depuis, le gouvernement fédéral a été accusé de manière crédible d'utiliser le blocus alimentaire comme arme de guerre, et le Conseil de sécurité des Nations unies a évoqué le risque de famine. Les États-Unis et l'Union européenne ont fait pression sur le gouvernement éthiopien en privé et en public. En décembre 2020, l'UE a suspendu une parte de subvention se montant à quelque 109 millions de dollars. Les États-Unis ont imposé des sanctions en matière de voyages à certains responsables gouvernementaux éthiopiens et érythréens, aux forces Amhara et aux membres du TPLF, et ont suspendu les mesures de sécurité et l'aide financière. La suspension du financement du développement multilatéral, dont l'Éthiopie a cruellement besoin, a également été évoquée. La Russie et la Chine ont fait preuve de plus de retenue mais n'ont pas opposé leur veto aux initiatives occidentales aux Nations unies.
Selon les statistiques, environ 90% des habitants du Tigré sont des chrétiens orthodoxes. Par conséquent, des narratifs circulent, évoquant un génocide pour des motifs religieux.
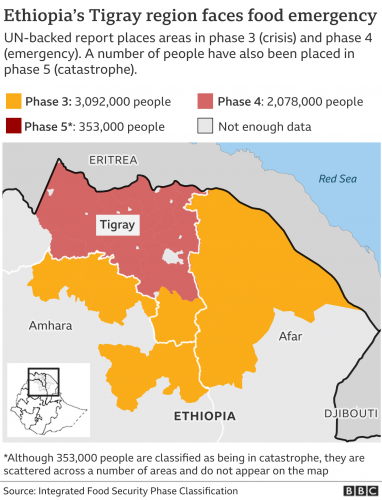
Dans le même temps, le Premier ministre Abiy Ahmed a fait de la surenchère dans sa rhétorique contre le TPLF, le décrivant comme une organisation terroriste qui recrute des enfants soldats. En outre, des accusations ont été portées contre les Tigréens qui ne soutenaient pas les actions des troupes fédérales, ce qui a été immédiatement suivi de rafles massives dans les zones urbaines.
Le SOT a répondu en envahissant les zones du Tigré tenues par les Amhara et l'État voisin d'Afar, menaçant ainsi la principale liaison ferroviaire de l'Éthiopie avec Djibouti. Abiy, pour sa part, a appelé les États éthiopiens à fournir des troupes. Oromia, Sidama, Southern Nations, Nationalities and Peoples, Somali Region, Benishangul-Gumuz, Gambella et Harari les ont tous proposés, selon les chiffres officiels. La mobilisation des troupes des États régionaux d'Éthiopie met en évidence la faiblesse du gouvernement fédéral, mais elle pourrait aussi être le point de départ d'une guerre civile plus large, car le pays compte de nombreuses lignes de fracture au sein de ses unités administratives et de sa société.
Avant le conflit de novembre 2020, des violences ont éclaté dans plusieurs États - Oromia, Tigré, Amhara, Somalie et Nations du Sud - où il existe des divisions politiques internes ou des insurrections actives. Parallèlement, les bénéfices inégaux de l'agriculture à grande échelle, du développement des infrastructures et de l'accaparement des terres sont à l'origine de mécontentements et de déplacements depuis des décennies. Les tensions au sein de la population sont en hausse, avec des taux d'inflation allant de 20 à 30 %.
Le pays est donc dans une situation très précaire. Abiy a abandonné le système politique que lui ont légué ses prédécesseurs, que l'on peut définir comme étant un "ethno-fédéralisme".

Abiy Ahmed a peu de marge de manœuvre. De leur côté, les SOT ont refusé de négocier tant que les forces non tigréennes n'auront pas complètement abandonné la zone administrative du Tigré (Tigray). Ils utilisent maintenant leur avantage militaire pour tenter de lever le siège du Tigré et menacent de riposter en coupant les liaisons de transport avec Djibouti. Les Djiboutiens seraient en train de déplacer des troupes pour sécuriser le trafic ferroviaire, mais jusqu'à présent seulement jusqu'à leur frontière. Cela met en évidence la possibilité d'une participation régionale plus large. Il existe également un potentiel de participation soudanaise. Les forces soudanaises ont occupé des terres agricoles le long de la frontière éthiopienne à El Fashag à la mi-décembre de l'année dernière, dans la même zone par laquelle la SOT tente de briser le blocus actuel du Tigré. L'Érythrée se maintient dans le nord du Tigré. Il est également rapporté que le président somalien Farmajo a fourni des troupes, un fait que ses adversaires politiques utilisent maintenant habilement contre lui pendant la campagne électorale ratée.
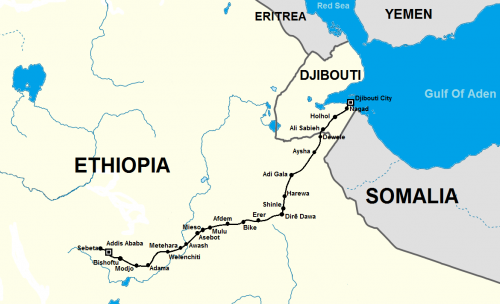

Paradoxalement, ni l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD) dans la Corne de l'Afrique ou l'Union africaine n'offrent aucune solution immédiate. L'Union africaine a nommé trois envoyés de haut niveau pour servir de médiateurs, mais les efforts diplomatiques de l'Éthiopie ont détourné l'énergie de l'Union africaine vers les enquêtes sur les violations des droits de l'homme au lieu d'une action politique plus décisive et immédiate. L'IGAD a fait preuve de faiblesse ou d'indécision face aux précédents conflits régionaux et a jusqu'à présent été soumise à l'"Union africaine". Il est clair que ces deux organisations seront considérées par le TPLF comme des agents de l'Éthiopie, ce qui les rendra impropres à toute médiation.

15:17 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, afrique, affaires africaines, corne de l'afrique, éthiopie, tigrée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 12 juillet 2021
Un empire colonial oublié...
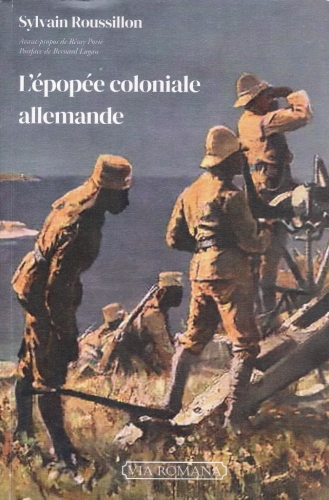
Un empire colonial oublié...
par Georges Feltin-Tracol
Ex: http://www.europemaxima.com
Les vacances estivales approchent. L’instant est favorable pour suggérer quelques lectures agréables et instructives. Certes, le livre présenté aujourd’hui va mécontenter Assa Traoré et tous les universitaires de l’Hexagone qui ne jurent plus que par l’islamo-gauchisme intersectionnel décolonial inclusif à fort tropisme suprémaciste féministe – trans – saphique.
À la suite de Bernard Lugan qui rédige d’ailleurs la postface et de Rémy Porte, rédacteur de l’avant-propos, Sylvain Roussillon vient de publier chez Via Romana L’épopée coloniale allemande (272 p., 25 €). Les curieux de l’histoire non conformiste le connaissent bien puisqu’il a signé en 2012 chez le même éditeur Les Brigades internationales de Franco et a republié ces derniers temps aux Éditions du Toucan – L’Artilleur L’autre guerre d’indépendance américaine : 1812, le conflit méconnu.
Les Français ignorent qu’à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, le tout jeune État allemand détient des possessions ultra-marines en Afrique avec le Togoland, le Kamerun, le Ruanda–Urundi, le Tanganyika, le Sud-Ouest africain, en Asie avec la ville chinoise de Kiao-Tchéou, et en Océanie avecla partie septentrionale de la Papouasie – Nouvelle-Guinée, les îles Mariannes, Marshall, Carolines ainsi que Nauru.
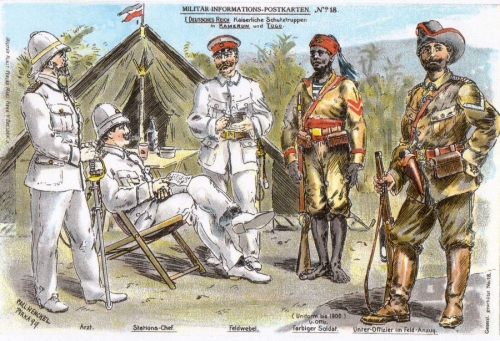
Longtemps hostile à l’aventure coloniale, le chancelier Bismarck comprend l’insistance des commerçants à trouver des débouchés divers et devine l’avantage géopolitique de maîtriser des territoires extra-européens. Cependant, cet élan ne date pas de la décennie 1870 ! L’auteur revientsur la « préhistoire » de la colonisation germanique outre-mer. Au XVIe siècle, une famille de banquiers, les Welser, cherche à s’implanter à l’Ouest du Venezuela. Le duché de Courlande tente d’investir l’île antillaise de Tobago. Entre 1669 et 1680 existent entre les Guyanes et le Brésil les « Indes hanauriennes » de langue allemande. On trouve aussi le long du littoral africain des comptoirs liés aux entités du Saint-Empire romain germanique.
Si L’épopée coloniale allemande évoque les différentes manières de s’emparer de nouveaux territoires, l’ouvrage mentionne aussi leur perte au cours de la Première Guerre mondiale. Les cas ne sont jamais uniformes. Malgré l’isolement, le manque certain de ravitaillement et la supériorité numérique croissante de leurs ennemis anglo-saxons, portugais et japonais, les colons allemands du Kamerun, du Sud-Ouest africain et de l’Afrique orientale résistent avec une rare ténacité. Ainsi Sylvain Roussillon rapporte-t-il les exploits de Paul Emil von Lettow – Vorbeck qui tient tête à l’Empire britannique jusqu’au 29 novembre 1918. Dans le Pacifique s’activent des équipages « corsaires » sous l’étendard à croix de fer !

Le 26 mai 2021, le gouvernement allemand a reconnu la responsabilité de l’Allemagne dans les massacres de masse en Namibie au moment de la révolte des Héréros et des Namas entre 1904 et1908. L’auteur aborde cette tragédie en l’inscrivant dans son contexte et sans verser dans l’anachronisme tendancieux en vogue chez les incultes. Dommage que l’Australie, la Nouvelle-Zélande et la Grande-Bretagne ne s’excusent pas auprès des descendants des colons allemands détenus dansdes conditions d’internement effroyables. Londres ne se repent pas de la persécution des Acadiens, des Irlandais et des Boers. Quant à la République française – et non la France, nuance ! -, peut-être responsable du génocide au Ruanda en 1994, elle devrait se préoccuper en priorité du génocide vendéen et enfin indemniser les héritiers, directs ou non, des victimes par une allocation mensuelle versée sur sept générations de 1793 euros.
Rédigée avec brio dans une langue claire, vivante et précise, L’épopée coloniale allemande synthétise et dépasse les travaux de Bernard Lugan et de Rémy Porte. Cet ouvrage en appelle d’autres explorant la colonisation belge, espagnole, italienne, néerlandaise, voire danoise. Il mériterait de recevoir un prix tant son sujet va à contre-courant de l’étouffante narration officielle historiquement correcte.
• « Chronique hebdomadaire du Village planétaire », n°221, mise en ligne sur TVLibertés, le 1er juillet 2021.
Source Europe Maxima cliquez là
00:19 Publié dans Histoire, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, livre, afrique, affaires africaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 01 juillet 2021
Leo Frobenius : les mythes d’Atlantis, le panthéon sacré et la culture yoruba
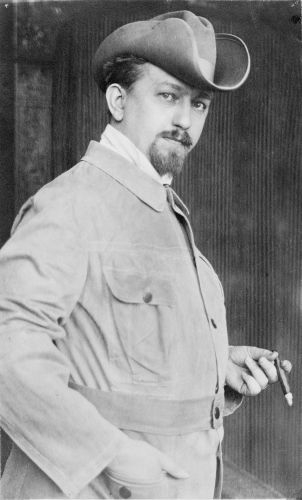
Leo Frobenius : les mythes d’Atlantis, le panthéon sacré et la culture yoruba
Manlio Triggiani
SOURCE : https://www.barbadillo.it/99465-segnalibro-leo-frobenius-...
L'homme s'est toujours interrogé sur la naissance du monde et de sa propre civilisation. Mircea Eliade a placé la cosmogonie (la naissance du monde) et les mythes aux origines de la civilisation comme un aspect pertinent dans les communautés humaines. Le chercheur roumain a identifié un aspect fondamental: au centre de toutes les civilisations n'ont pas manqué les mythes qui ont traduit des histoires réelles qui se sont produites dans un imaginaire qui a donné la force à l'identité et la tradition des peuples. Le mythe de l'Atlantide est un mythe qui est périodiquement revenu au premier plan de l'imagination occidentale, presque comme pour raconter et découvrir le lieu d'origine du monde. Le premier à en parler fut Platon dans deux dialogues: Critias et Timée. Platon explique les origines de ce mythe: Poséidon avait une île, l'Atlantide, où il destinait ses enfants à donner vie à une civilisation prospère basée sur le sacré. Mais bientôt, la décadence est arrivée et le sacré n'a plus eu l'importance qu'il avait autrefois.
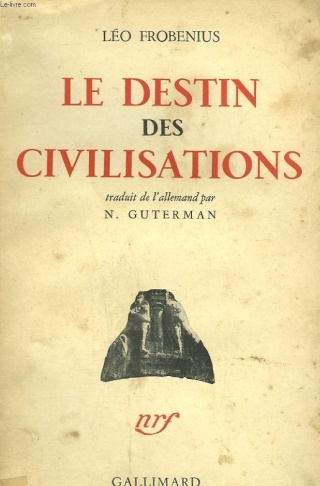 Zeus, de colère, envoya des tremblements de terre et des inondations qui, en un jour et une nuit, firent sombrer l'île et mourir tous ses habitants. Dans l'imaginaire, l'Atlantide est restée - surtout dans la littérature - un lieu de merveilles, un lieu mythique. En réalité, le discours sur l'Atlantide a repris après la découverte de l'Amérique par le navigateur génois Christophe Colomb. On a émis l'hypothèse d'une origine atlante des populations amérindiennes. Depuis lors, les hypothèses se sont multipliées. En 1882, l'écrivain américain Ignatius Donnelly a publié un livre qui a fait sensation car il affirmait, sans aucune preuve concrète, que tout le savoir du monde provenait de cette île qui avait disparu dans l'abîme à la suite d'une catastrophe. Peu de temps après, un jeune érudit passionné par les civilisations anciennes, amoureux de l'Afrique, a commencé à étudier et à diffuser leurs théories. Il s'appelait Leo Viktor Karl August Frobenius (1873-1938) ; il avait étudié les livres de Friedrich Ratzel, fondateur de l’anthropologie géographique, une branche de la géopolitique allemande. Frobenius a élaboré la théorie des "cercles culturels", une vision globale qui fournit des hypothèses sur le mouvement des peuples à différentes périodes historiques, au cours des millénaires. Cet anthropologue prussien était le petit-fils de Heinrich Bodinus, directeur du parc zoologique de Berlin et ami de nombreux explorateurs de l'époque. Dès son enfance, le petit Leo a été fortement influencé et intéressé par ce type de recherche. Il a notamment lu les mémoires de voyage et d'étude de Stanley, Wissmann, Peters, Livingstone, etc. En grandissant, il s'est mis à visiter les musées ethnographiques de Brême, Leipzig, Hambourg et Bâle. Sa thèse sur le thème de l’Afrique n'a pas été acceptée par les universités de Bâle et de Fribourg car elle était considérée comme n'ayant aucune base scientifique.
Zeus, de colère, envoya des tremblements de terre et des inondations qui, en un jour et une nuit, firent sombrer l'île et mourir tous ses habitants. Dans l'imaginaire, l'Atlantide est restée - surtout dans la littérature - un lieu de merveilles, un lieu mythique. En réalité, le discours sur l'Atlantide a repris après la découverte de l'Amérique par le navigateur génois Christophe Colomb. On a émis l'hypothèse d'une origine atlante des populations amérindiennes. Depuis lors, les hypothèses se sont multipliées. En 1882, l'écrivain américain Ignatius Donnelly a publié un livre qui a fait sensation car il affirmait, sans aucune preuve concrète, que tout le savoir du monde provenait de cette île qui avait disparu dans l'abîme à la suite d'une catastrophe. Peu de temps après, un jeune érudit passionné par les civilisations anciennes, amoureux de l'Afrique, a commencé à étudier et à diffuser leurs théories. Il s'appelait Leo Viktor Karl August Frobenius (1873-1938) ; il avait étudié les livres de Friedrich Ratzel, fondateur de l’anthropologie géographique, une branche de la géopolitique allemande. Frobenius a élaboré la théorie des "cercles culturels", une vision globale qui fournit des hypothèses sur le mouvement des peuples à différentes périodes historiques, au cours des millénaires. Cet anthropologue prussien était le petit-fils de Heinrich Bodinus, directeur du parc zoologique de Berlin et ami de nombreux explorateurs de l'époque. Dès son enfance, le petit Leo a été fortement influencé et intéressé par ce type de recherche. Il a notamment lu les mémoires de voyage et d'étude de Stanley, Wissmann, Peters, Livingstone, etc. En grandissant, il s'est mis à visiter les musées ethnographiques de Brême, Leipzig, Hambourg et Bâle. Sa thèse sur le thème de l’Afrique n'a pas été acceptée par les universités de Bâle et de Fribourg car elle était considérée comme n'ayant aucune base scientifique.
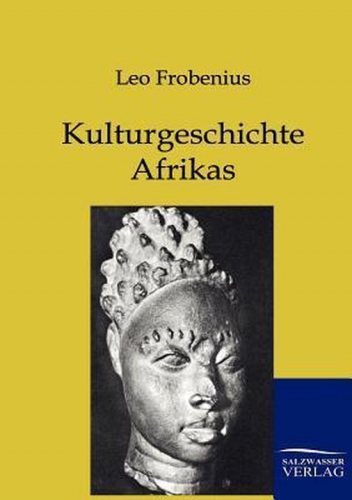 En 1904, il parvient à organiser une expédition au Congo, dans la région du Kasaï, à l'époque propriété personnelle de Léopold II de Saxe-Cobourg-Gotha, roi des Belges. Il a ensuite organisé une douzaine de missions. Entre 1910 et 1912, il visite le Nigeria et le Cameroun. Dans le sud-ouest du Nigeria, il a séjourné longtemps à Ile-Ife, la capitale religieuse de l'ancien royaume du Bénin et le centre de la culture Yoruba. Il entre en contact avec le peuple Yoruba, rencontre quelques sages et est initié à la religion tribale. Il a ainsi eu l'occasion de connaître le sacré selon la civilisation Yoruba. Frobenius a remarqué que les références religieuses et mythologiques de la structure sacrée de ces populations rappelaient, dans un certain sens, celles d'autres populations de l'Antiquité. Son hypothèse d'étude, qui fit sensation et fut diffusée dans le monde entier malgré le fait que Frobenius n'était pas membre de l'Académie, était la suivante: dans les temps anciens, une civilisation occidentale préclassique aurait pu avoir des contacts avec l'Afrique de l'Ouest. Il n'y avait aucune preuve de ces contacts, ce n'était qu'une hypothèse, mais il est certain que le niveau de civilisation des Yoruba était nettement supérieur à celui des autres communautés africaines. Une observation réelle qui a été corroborée par la suite par d'autres chercheurs. Frobenius a appelé ce contact "résidu atlante"; d'autres chercheurs l'ont rebaptisé "résidu blanc".
En 1904, il parvient à organiser une expédition au Congo, dans la région du Kasaï, à l'époque propriété personnelle de Léopold II de Saxe-Cobourg-Gotha, roi des Belges. Il a ensuite organisé une douzaine de missions. Entre 1910 et 1912, il visite le Nigeria et le Cameroun. Dans le sud-ouest du Nigeria, il a séjourné longtemps à Ile-Ife, la capitale religieuse de l'ancien royaume du Bénin et le centre de la culture Yoruba. Il entre en contact avec le peuple Yoruba, rencontre quelques sages et est initié à la religion tribale. Il a ainsi eu l'occasion de connaître le sacré selon la civilisation Yoruba. Frobenius a remarqué que les références religieuses et mythologiques de la structure sacrée de ces populations rappelaient, dans un certain sens, celles d'autres populations de l'Antiquité. Son hypothèse d'étude, qui fit sensation et fut diffusée dans le monde entier malgré le fait que Frobenius n'était pas membre de l'Académie, était la suivante: dans les temps anciens, une civilisation occidentale préclassique aurait pu avoir des contacts avec l'Afrique de l'Ouest. Il n'y avait aucune preuve de ces contacts, ce n'était qu'une hypothèse, mais il est certain que le niveau de civilisation des Yoruba était nettement supérieur à celui des autres communautés africaines. Une observation réelle qui a été corroborée par la suite par d'autres chercheurs. Frobenius a appelé ce contact "résidu atlante"; d'autres chercheurs l'ont rebaptisé "résidu blanc".
Frobenius, curieux, était un enfant de son temps et un fervent partisan de l'Allemagne impériale et coloniale de l'ère wilhelminienne. Il soutenait que, parmi les populations africaines, certaines avaient un haut niveau de créativité et de spiritualité. Toutes ces théories, ces études et la certitude qu'il y aurait eu un contact dans les temps primitifs entre les peuples atlantes et ceux de l'Afrique de l'Ouest, Frobenius l'a rapporté dans un livre, Die atlantische Goetterlehre (La doctrine sacrée atlante). Le livre est maintenant réédité en italien avec le titre I miti di Atlantide. Un livre intéressant car il traite et étudie la mythologie, la structure sociale des Yoruba, la vie religieuse et le panthéon des dieux de cette civilisation.
Leo Frobenius, I miti di Atlantidi, Editions Iduna, pp. 235, 20 euro. Introduction de Maurizio Pasquero.
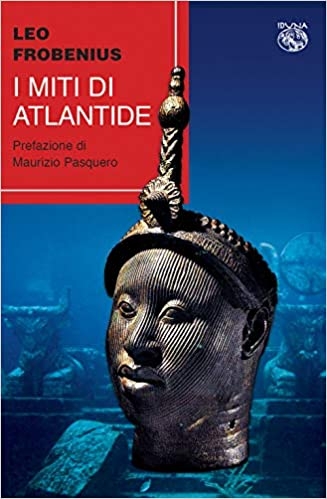
12:36 Publié dans anthropologie, Ethnologie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : leo frobenius, anthropologie, ethnologie, afrique, civilisations africaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 17 juin 2021
Les tendances géopolitiques convergent sur tous les continents - La force de la réinitialisation

Les tendances géopolitiques convergent sur tous les continents
La force de la réinitialisation
Par Gaston Pardo
Lorsque le général Dwight D. Eisenhower était président des États-Unis, il a prononcé un discours devant le Congrès américain le 5 janvier 1957. Un discours de grande importance internationale qui a été examiné à l'époque par les gouvernements de nombreux pays. La partie essentielle de ce discours était l'affirmation qu'il existait un vide de pouvoir au Moyen-Orient, résultant de l'affaiblissement de l'autorité britannique dans cette région, que les États-Unis devaient combler.
Cette question avait une portée à la fois théorique et pratique. L'évolution de la politique comme doctrine de gouvernement et des relations internationales qui régissent la géopolitique est toujours en accord avec le développement de la science dans la mesure où elle est l'application des liens qui existent entre les hommes et les communautés sociales, de la pensée d'une époque.
C'est pourquoi il est utile de se pencher sur le programme des deux partis politiques actifs aux États-Unis et sur ses répercussions dans notre XXIe siècle.
Le parti républicain est historiquement le parti de la bourgeoisie industrielle qui a tenu tête aux propriétaires de coton et n'est aujourd'hui pas plus avancé que le parti démocrate.
Le RP propose la planification de l'agriculture sur une longue période. Il soutient également que l'État ne doit pas intervenir dans les conflits entre travailleurs et employeurs ou dans les conventions collectives. Le RP est favorable à la puissance militaire américaine et à son expansion planétaire, tendant vers l'égalité de tous les citoyens, à condition que les élites financières et militaires restent intouchables.
Pour sa part, le parti démocrate, représentant des minorités nationales et d'une partie des électeurs des États du Sud et du Nord-Est (zone qui a donné son triomphe à Joe Biden), s'occupe de l'endiguement de la discrimination raciale, du problème de la guerre et de la paix, de la délinquance juvénile. Le PD propose la défense des droits civils et la lutte pour le désarmement, bien que les démocrates du Sud aient été des lyncheurs de Noirs.
Cette structure de pouvoir dépend des fluctuations électorales qui favorisent parfois l'un et désavantagent occasionnellement l'autre. Mais le vide auquel les deux partis sont maintenant confrontés dans leur politique intérieure et étrangère est déterminé par les conflits raciaux qui sont apparus sur la scène mondiale comme une empreinte indélébile de notre époque. C'est l'un des facteurs du manque de contrôle que l'administration Eisenhower reprochait au Royaume-Uni il y a plus de 60 ans.
Le renseignement militaire et ce qui a été laissé derrière
Le scientifique espagnol Josep Baqués, spécialiste du renseignement militaire, annonce dans son essai Reflexiones sobre el Net Assessment como herramienta analítica qu'il s'efforce de faire face avec succès à des situations complexes. Cette méthode a été mise en œuvre par l'administration Nixon. On se souvient que Nixon était vice-président de l'administration Eisenhower. La méthode est analysée aujourd'hui sur le site de l'Université de Grenade : Gesi.
Le quatrième des dix points de la méthode est la fixation d'un objectif qui peut être la défense du statu quo mais aussi la recherche de l'hégémonie (au niveau régional ou mondial) lorsqu'elle est considérée comme la condition pour dissuader les puissances révisionnistes. Le point 10 indique que l'évaluation nette est fondamentalement inductive et qu'elle est peu sensible aux cadres théoriques de la géopolitique et des relations internationales. Examinons son résultat dans plusieurs situations géopolitiques modernes où la stratégie mise en place tend à "éviter la défaite".


Le "lion africain" yankee est à la recherche de nouvelles proies, selon un travail journalistique de Manlio Dinucci, publié dans le Réseau Voltaire (04.06.21) :
Face à l'échec de la mise en œuvre d'AfriCom sur le sol africain, le Pentagone a choisi de rassembler les forces américaines pour l'Afrique et l'Europe sous un commandement unique, basé à Wiesbaden, en Allemagne. Les États-Unis disposeraient de ces troupes pour imposer une nouvelle division territoriale en Afrique que les pays de l'Union européenne devront accepter et reconnaître. En d'autres termes, le commandement militaire américain basé à Wiesbaden décidera de la politique étrangère de l'Union européenne.
Le Grand Timonier, le chef d'orchestre de la post-modernité transatlantique, Joe Biden, éprouve une réelle inquiétude face aux dérives manifestes du mouvement que le pays axe du Système s'est proposé d'enclencher. Les manœuvres militaires et le retrait des États-Unis de l'Afrique vers l'Asie de l'Est. Pour l'environnement chinois.
La Turquie dans la Corne de l'Afrique
Ana Pouvreau nous dit: "Le président turc Recep Tayyip Erdoğan prévoit de faire de son pays une grande puissance à partir de 2023, date du centenaire de la République turque. La Corne de l'Afrique, stratégiquement située dans les corridors où se rencontrent les flux maritimes reliant l'Afrique, l'Asie et l'Europe, constitue un objectif majeur pour promouvoir cette aspiration. La Turquie ré-émerge après avoir suivi pendant dix ans la ligne du timonier ottoman : Recep Tayyip Erdoğan avec une mention spéciale pour son ancien ministre des Affaires étrangères de 2009 à 2014, Ahmet Davutoglu, dont la politique étrangère, qualifiée de néo-ottomane, a influencé les espaces qui, par le passé, étaient situés sous la domination de l'empire ottoman".

Dans la Corne de l'Afrique, au nord-est de ce continent voisin de la péninsule arabique, bénéficiant d'une position stratégique à proximité de Bab el-Mandeb, la Turquie saisit toutes les occasions d'étendre son influence par des contributions humanitaires, économiques et sécuritaires.
Leonid Savin étudie la nouvelle stratégie du Pentagone dans un article publié en italien dans geopolitica.ru (06.06.19) : Sa nouvelle publication en juin 2021 est significative car le déchaînement géopolitique auquel nous assistons en Afrique du Nord, en Europe centrale et orientale et en Extrême-Orient a sans aucun doute une signification convergente.
L'auteur russe indique que "le Pentagone a officiellement présenté sa nouvelle stratégie pour la région indo-pacifique. Bien que nombre de ces documents aient été publiés récemment, par exemple, dans la stratégie cybernétique, il a été noté que le directeur du Pentagone a annoncé l'institutionnalisation d'un autre domaine d'intérêt".
La notion même de région indo-pacifique est relativement nouvelle et le terme n'a commencé à apparaître dans les documents doctrinaux que l'année dernière (2018 - Note de l'auteur). Comme on peut le lire dans le préambule de la stratégie, elle reste le "théâtre prioritaire" du ministère américain de la défense (cf. dedefensa.org (30.05.21)
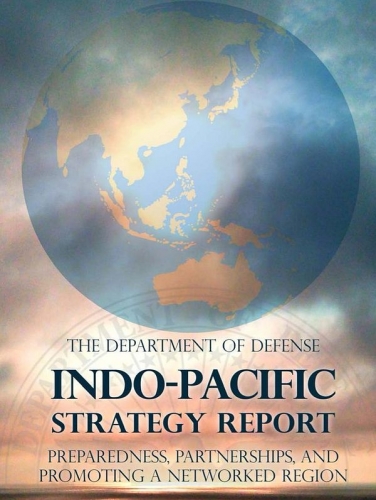
Les États-Unis ont annoncé, dans diverses déclarations, qu'ils oubliaient toute possibilité de défense directe de Taïwan. Ils préfèrent préparer des plans de guérilla des groupes taïwanais, pour agir lorsque les troupes chinoises auront envahi Taïwan. La technique du Stay-Behind est entrée en jeu en Europe à la fin des années 1940, lorsqu'une offensive soviétique était redoutée mais n'a pas eu lieu.
Une série de mesures annoncées par les États-Unis montrent que leurs militaires ont imposé une nouvelle politique militaire de défection et d'action clandestine contre les Chinois, en évitant autant que possible les risques d'une confrontation directe parce qu'ils (les militaires américains) sont convaincus qu'ils (les militaires américains) perdront. L'affaire est menée directement par le Pentagone, Biden passant sa main dans ce genre de domaine (sécurité nationale).
Dans un article consacré à ce sujet, RT.com met en évidence le caractère dystopique de la position américaine, qui alterne les déclarations bellicistes qui alimentent le simulacre d'une stratégie de force en même temps que la description de cette stratégie consistant à préférer la tentative d'opérations de guérilla clandestine laissée aux mains des Taïwanais pour agir là où c'est possible, sans oublier la vague promesse de mener des actions de guérilla dans la périphérie terrestre chinoise. Par conséquent, ils associeront une rhétorique agressive à une description opérationnelle des tactiques de guérilla, en évitant toute confrontation ouverte avec les forces américaines : "Les États-Unis ont commencé à organiser depuis 2018 l'institution du nouveau commandement américain pour l'Indo-Pacifique (USINDOPACOM) et, au sommet de l'ASEAN en août de la même année, le secrétaire d'État Mike Pompeo s'est engagé à fournir 300 millions de dollars pour renforcer la sécurité régionale et contrer les menaces transnationales".
Le 20 mai, le Parlement européen a gelé la ratification de l'accord d'investissement UE-Chine, conclu en décembre par la Commission européenne après sept ans de négociations. La résolution en ce sens a été approuvée à une écrasante majorité (599 voix pour, 30 contre et 58 abstentions).
Officiellement, il s'agit d'une réponse aux sanctions chinoises contre les membres du Parlement européen, sanctions que Pékin a adoptées lorsque des responsables chinois ont fait l'objet de sanctions européennes après avoir été accusés de violer les droits de l'homme, en particulier ceux de la population ouïghoure, accusations que la Chine rejette. Le Parlement européen affirme maintenant que les sanctions chinoises sont illégales parce qu'elles violent le droit international, tandis que les sanctions européennes sont légales parce qu'elles sont fondées sur la défense des droits de l'homme, reconnus par l'ONU.

Mais que se cache-t-il réellement derrière le paravent de la "défense des droits de l'homme en Chine" ? La stratégie, initiée et orchestrée par les États-Unis, visant à intégrer les pays européens dans une coalition contre la Russie et la Chine. Le levier fondamental de cette opération est le fait que 21 des 27 pays de l'Union européenne sont également membres de l'OTAN, qui, à son tour, suit les ordres des États-Unis.
En première ligne contre la Chine, comme contre la Russie, se trouvent les pays d'Europe de l'Est, qui sont tous deux membres de l'OTAN et de l'Union européenne. Plus liés à Washington qu'à Bruxelles, ces pays accroissent l'influence des États-Unis sur la politique étrangère de l'UE.
Mais tous les membres de l'OTAN ne sont pas au même niveau. Sous la table, l'Allemagne et la France s'entendent avec les États-Unis en fonction de leurs intérêts respectifs tandis que l'Italie obéit en silence, même si cette obéissance nuit à ses intérêts nationaux. C'est ce qui permet au secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, de déclarer, comme il l'a fait le 21 mai après sa rencontre avec le président français Emmanuel Macron, que "Nous soutiendrons l'ordre international fondé sur des règles face à la poussée autoritaire de pays comme la Russie et la Chine".
Le Réseau Voltaire (11.06.21) rapporte que "African Lion", le plus grand exercice militaire en Afrique, planifié et dirigé par l'armée américaine, a commencé. "African Lion" comprend des actions terrestres, aériennes et navales au Maroc, en Tunisie, au Sénégal et dans les mers adjacentes - de l'Afrique du Nord à l'Afrique de l'Ouest et de la Méditerranée à l'Atlantique - avec la participation de 8 000 militaires (dont la moitié de soldats américains) et d'environ 200 véhicules blindés, canons automoteurs, avions et navires de guerre. Ce "lion africain" devrait coûter 24 millions de dollars et aura des implications importantes. Avec un plan politique élaboré et décidé à Washington, le "Lion d'Afrique" de cette année se déroule pour la première fois au Sahara occidental, c'est-à-dire sur le territoire de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), reconnue par plus de 80 États membres de l'ONU, mais dont le Maroc nie et combat l'existence par tous les moyens.

Rabat estime qu'en réalisant le "Lion d'Afrique" au Sahara Occidental, Washington réaffirmait sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara Occidental. En conséquence, le gouvernement marocain a invité l'Algérie et l'Espagne à renoncer à ce qu'il présente comme "leur hostilité envers l'intégrité territoriale du Maroc". L'Espagne, que le Maroc accuse de soutenir le Front Polisario (le mouvement de libération qui gouverne la RASD), ne participe pas cette année au "Lion africain", tandis que Washington réitère son soutien total au Maroc, le définissant même comme son "plus grand allié non-OTAN et partenaire des États-Unis".
Pour la première fois, "African Lion" se déroule cette année sous une nouvelle structure de commandement américaine. En novembre dernier, les troupes américaines en Europe et les forces américaines en Afrique ont été regroupées sous un seul commandement : l'"US Army Europe and Africa", dont le commandant, le général Chris Cavoli, explique la raison de cette décision comme suit : "Les problèmes de sécurité en Europe et en Afrique sont étroitement liés et, s'ils ne sont pas maîtrisés, ils peuvent rapidement déborder d'une région à l'autre."
L'armée américaine a donc décidé de combiner son commandement européen et son commandement africain afin de "déplacer dynamiquement des forces d'un théâtre à l'autre, améliorant ainsi notre temps de réponse aux urgences régionales". Dans ce cadre, l'exercice "African Lion 21" est intégré à "Defender Europe 21", auquel participent 28.000 soldats et plus de 2000 véhicules lourds. Il s'agit en fait d'une série de manœuvres militaires coordonnées qui se déroulent de l'Europe du Nord à l'Afrique de l'Ouest. L'objectif officiel ? Pour contrer une diffuse "activité maléfique en Afrique du Nord et en Europe du Sud et une agression militaire adverse", avec des références évidentes à la Russie et à la Chine.
L'Italie participe à "African Lion 21" - comme elle participe aussi à "Defender Europe 21" - non seulement en fournissant des hommes et des moyens militaires mais aussi son territoire comme base stratégique. L'exercice qui se déroule en Afrique est dirigé - depuis la province italienne de Vicenza - par la Task Force de l'armée américaine en Europe du Sud, tandis que les forces participantes reçoivent, via le port italien de Livourne, de grandes quantités de matériel de guerre en provenance de Camp Darby.
La participation de l'Italie à l'"African Lion 21" s'inscrit dans le cadre de l'engagement militaire croissant de l'Italie en Afrique. Un exemple de cela est la mission militaire italienne au Niger, qui est officiellement effectuée " dans le cadre d'un effort conjoint européen et américain pour la stabilité de la zone et pour s'opposer aux trafics illégaux et aux menaces à la sécurité "... mais qui en réalité vise à contrôler l'une des zones les plus riches en matières premières stratégiques (principalement le pétrole, l'uranium et le coltan), dont l'exploitation est aux mains des transnationales américaines et européennes, dont l'oligopole est mis en danger par la présence économique chinoise, entre autres facteurs.
Les Wsws face à la vérité officielle
Barry Grey, analyste du site web socialiste mondial a dénoncé (14.06.21) que les leaders démocrates soutiennent les accusations d'"antisémitisme" en réponse aux critiques de la représentante démocrate Ilhan Omar sur les crimes de guerre israéliens à Gaza.
Cette première semaine de juin a vu un nouvel exemple du soutien du parti démocrate aux atrocités israéliennes perpétrées contre la population palestinienne de la Cisjordanie et de Gaza occupées.
Quelques semaines seulement après que les forces de défense israéliennes ont bombardé pendant 11 jours les habitants sans défense de Gaza, une enclave côtière appauvrie de deux millions de personnes soumise à un blocus de 14 ans par l'État israélien, la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et son équipe de direction ont fustigé la représentante Ilhan Omar pour avoir critiqué les "atrocités impensables" commises par Israël et les États-Unis.

Lundi dernier, la représentante Omar, l'une des deux musulmanes élues au Congrès en 2018, a posté un tweet citant une question qu'elle a posée au secrétaire d'État Antony Blinken lors d'une audition devant la commission des affaires étrangères de la Chambre : "Nous devons avoir le même niveau de responsabilité et de justice pour toutes les victimes de crimes contre l'humanité. Nous avons vu des atrocités commises par les États-Unis, le Hamas, Israël, l'Afghanistan et les Talibans. Ainsi, tant que nous sommes sur le sujet des lacunes dans l'exercice du pouvoir, l'administration américaine vit de la dissimulation. Si un vide est exposé, il est rempli au prix de laisser un autre espace vide.
Le sens de la stratégie
La marche des soldats américains aux côtés des Italiens et des autres pays de l'OTAN "en Afrique du Nord, qui s'est terminée par l'annonce que les forces anglophones marcheraient sur la Chine, a signifié l'inauguration d'une stratégie militaire consistant à engager les populations locales dans les lignes de feu qui s'ouvriront finalement en Asie et en Europe de l'Est contre la Chine et la Russie.
Pendant ce temps, en Afrique du Nord, les Etats-Unis maintiennent le pacte d'adhésion inauguré dans le Caucase pour laisser le libre passage dans les pays du Turkestan aux populations turkmènes qui vivent du nord de l'Iran à l'Afghanistan. Les États-Unis ont proposé de retirer leurs troupes du territoire afghan. La même chose s'est produite en Afrique : les États-Unis font parader leurs soldats avec les contingents européens de l'OTAN dans un territoire où il y a un conflit entre le Maroc et l'Espagne au sujet du domaine sahraoui.
Les courtes manœuvres militaires étaient un message aux pays impliqués dans le conflit pour savoir qui est responsable. Mais il est clair que le Pentagone entend réaliser en Afrique du Nord une opération géostratégique et géopolitique de grande envergure en faveur de l'Islam pour laquelle il a le soutien des grandes puissances.
Les États-Unis informent immédiatement qu'en cas d'attaque chinoise sur Taïwan, les Américains limiteront leur effort de guerre au soutien de la guérilla taïwanaise, évitant ainsi une confrontation directe avec la Chine.
10:12 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, géopolitique, politique internationale, afrique, affaires africaines, africom |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 16 juin 2021
Le corridor LAPSSET est la dernière route de la soie de la Chine en Afrique de l'Est
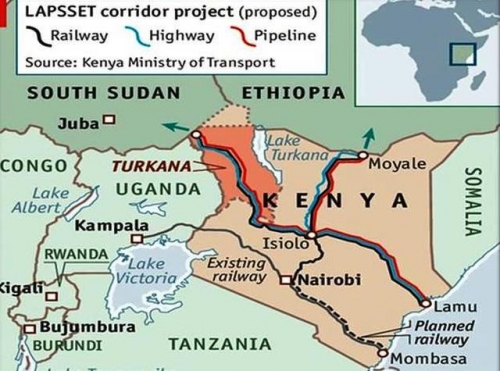
Le corridor LAPSSET est la dernière route de la soie de la Chine en Afrique de l'Est
Andrew Korybko
Ex: http://www.elespiadigital.com/index.php/noticias/geoestrategia/34249-2021-05-30-09-39-47
Le corridor de transport Lamu Port-South Sudan-Éthiopie (LAPSSET), situé dans le port du même nom au nord-est du Kenya, a reçu ses premiers navires jeudi dernier. Le projet n'est pas encore totalement achevé, mais il est enfin opérationnel. La Chine est responsable de sa construction et la considère comme un investissement majeur de l'initiative "Belt & Road" (BRI) en Afrique de l'Est. Le corridor LAPSSET reliera ces trois pays et contribuera à décongestionner le corridor Nairobi-Mombasa. À ce propos, la Chine a achevé il y a quelques années, en 2017, la voie ferrée à écartement standard (SGR) du Kenya, qui relie la capitale au principal port du pays hôte.
Toutefois, les plans de l'initiative pour l'Afrique de l'Est de la Chine ne se limitent pas à ces deux projets d'infrastructure. La Chine a également achevé en 2018 le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti entre la capitale éthiopienne et sa porte voisine de la mer Rouge. En outre, la Chine a conclu en début de semaine un accord avec l'Ouganda pour réhabiliter une voie ferrée centenaire entre sa capitale, Kampala, et la frontière kenyane. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une extension officielle du SGR comme prévu à l'origine, il servira de facto le même objectif, à savoir faciliter les exportations de l'Ouganda vers le reste du monde via le port de Mombasa.
En résumé, la Chine relie progressivement de plus en plus les pays d'Afrique de l'Est. Trois d'entre eux, le Kenya, le Sud-Soudan et l'Ouganda, font partie de la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), un bloc commercial régional qui aspire à s'intégrer plus étroitement dans le cadre de l'UEE dans un avenir proche. L'Éthiopie ne fait pas partie de ce bloc, mais les quatre pays forment l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui comprend également l'Érythrée, la Somalie et le Soudan. Ainsi, on peut dire que les récents efforts de la Chine en matière de Route de la Soie sont axés sur la région élargie de l'IGAD plutôt que sur la seule EAC.

Cette partie de l'Afrique est considérée par de nombreux observateurs comme l'une des plus prometteuses et des plus stables économiquement, à quelques exceptions près comme le Sud-Soudan et la Somalie. Malgré cela, ces deux pays se sont récemment stabilisés, chacun à leur manière, grâce à des compromis politiques entre les parties belligérantes. LAPSSET contribuera certainement à offrir davantage de possibilités de développement et d'emploi aux premiers, tandis que le second est un pays péninsulaire qui a déjà de nombreuses possibilités de commercer avec le reste du monde. Toutefois, en se concentrant sur le LAPSSET, elle sert également d'autres objectifs stratégiques que la simple fourniture au Sud-Soudan d'un corridor vers la mer.
L'Éthiopie est le géant régional avec la deuxième plus grande population du continent. Son potentiel de développement est pratiquement infini et il enregistrait auparavant des niveaux de croissance parmi les plus élevés au monde, jusqu'à ce que le COVID-19 provoque la crise économique mondiale actuelle. Il est compréhensible qu'un pays doté d'un tel potentiel souhaite diversifier ses routes commerciales et ne pas dépendre d'un seul corridor. Cela explique le pragmatisme qui sous-tend le projet LAPSSET, car il sert cet objectif en complétant l'autre porte d'accès à la mer Rouge construite par la Chine en Éthiopie, à savoir le chemin de fer Addis-Abeba-Djibouti.
Les projets d'infrastructure de l'IGAD soutenus par la Chine finiront par créer une version régionale de la vision de Pékin d'une communauté de destin commun, l'un des principes philosophiques fondamentaux de la BRI. L'intégration régionale est l'une des grandes tendances du 21e siècle, mais elle nécessite des investissements en capital importants dans la plupart des cas dans l'hémisphère sud, ainsi qu'une expertise adéquate pour y construire les infrastructures nécessaires. La Chine fournit des prêts inconditionnels et une main-d'œuvre hautement qualifiée pour y parvenir, assumant ainsi sa responsabilité envers le Sud en tant que plus grande nation en développement du monde.
L'IGAD pouvant être considérée comme une extension de la région de l'océan Indien (IOR) en raison de sa géographie, on peut dire que ces investissements chinois jouent un rôle crucial dans l'intégration de cet espace de plus en plus stratégique au sein duquel de nombreux observateurs prédisent une convergence des tendances. La coopération Sud-Sud par le biais de LAPSSET et de ses projets frères régionaux est un excellent exemple du nouveau modèle de développement international de la Chine. Elle traite ses partenaires comme des égaux et non comme des subordonnés comme le font les États-Unis, accorde des prêts sans conditions, contrairement aux prêts conditionnels des États-Unis, et aboutit à des résultats gagnant-gagnant plutôt qu'à des jeux à somme nulle.
00:55 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : géopolitique, actualité, routes de la soie, chine, afrique, affaires africaines, afrique de l'est, océan indien, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 juin 2021
La Libye, un jeu stratégique

La Libye, un jeu stratégique
par Alberto Negri
Source : Il Manifesto & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/libia-una-partita-strategica
Chaque fois qu'un dirigeant italien rencontre un dirigeant libyen, il y a de la moquerie en l'air, qu'elle soit voulue ou non. Pourtant, la Libye pourrait devenir notre plus grand fournisseur de gaz.
Cela s'est encore passé hier à Rome lors de la rencontre très attendue entre le Premier ministre Mario Draghi et Abdul Hamid Dbeibah, sa première visite officielle en Italie depuis sa prise de fonction, moins de deux mois après celle de Premier ministre à Tripoli.
On parle d'arrêter les migrants mais que voit-on ? Depuis des semaines, des dizaines de bateaux partent de Zuara, et personne ne les arrête avant qu'ils ne partent : il y a pourtant les garde-côtes libyens, que nous finançons généreusement, une mission européenne Irini au large des côtes libyennes, des drones, des satellites, des radars, bref, une série de dispositifs qui devraient permettre d'empêcher les départs.
Ensuite, il y a la question des camps de réfugiés, qui sont devenus des lager. Les Libyens, en paroles, disent qu'ils veulent les démanteler. Mais avant tout, ils devraient changer leurs lois. La Libye n'adhère pas aux conventions internationales sur les réfugiés, ni à la Convention de Genève ni aux conventions ultérieures. En un mot, toute personne qui entre sur le territoire libyen est considérée comme un immigrant illégal, donc privée de droits et peut être traitée comme on le souhaite, comme un criminel.
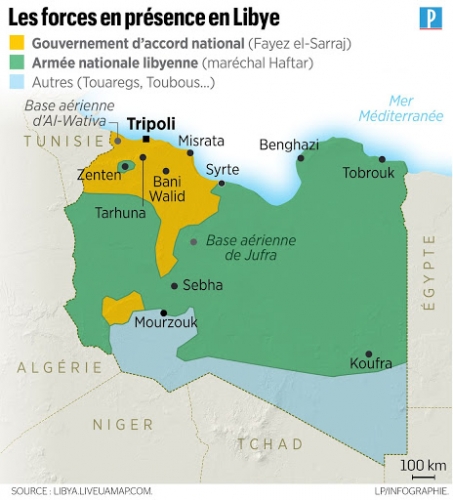
Cela dit, la réunion d'hier ne portait pas seulement sur les migrants mais aussi sur la reprise économique. Et même ici, il y a de la de dérision dans l'air : la Libye produit du gaz et du pétrole et pourrait en vendre beaucoup plus si les Libyens s'entendaient entre eux au lieu de prendre les armes et de se livrer au banditisme et au harcèlement, s'ils décidaient de faire fonctionner les choses. Mais pour ce faire, il faudrait un État qui, depuis la chute de Kadhafi en 2011, n'a pas encore pu être reconstruit. Le pays est divisé entre la Tripolitaine et la Cyrénaïque, la première sous le protectorat d'Erdogan, la seconde commandée par le général Khalifa Haftar avec le soutien de la Russie, de l'Égypte et des Émirats. Sans parler de la vaste région du Fezzan où les tribus jouent leur propre jeu autonome. En réalité, comme chacun le sait, l'actuel gouvernement d'unité nationale expirera avec les élections de décembre, où les vrais gros bonnets de la politique et des milices libyennes entreront en lice. Comme nous pouvons le constater, nous sommes loin de la stabilité, et le même gouvernement qui est s'est présenté hier à Rome est une entité précaire.
Mais nous devons être réalistes et faire avec ce que nous avons. Et surtout avec une Libye où les influences extérieures sont prépondérantes : ni le dirigeant turc Erdogan ni Poutine n'ont l'intention de renoncer à leurs positions stratégiques. La Turquie a gagné la guerre contre Haftar et l'Italie n'a apporté aucun soutien militaire au gouvernement de Sarraj à Tripoli, tandis que la Russie est entrée sur la côte nord-africaine où elle a l'ambition d'étendre sa présence militaire. L'Italie, incapable de défendre ses intérêts nationaux et stratégiques, ne peut donc compter que sur le soutien européen et américain, mais sans se faire trop d'illusions, car le passé récent démontre abondamment que les intérêts occidentaux et italiens ne convergent pas toujours. Aujourd'hui, par exemple, la France de Macron est solidaire du gouvernement Draghi, mais pendant des années, c'est précisément en Libye qu'elle a systématiquement saboté les initiatives diplomatiques de Rome.

N'oublions pas que l'attaque de la France contre la Libye de Kadhafi en 2011, soutenue par les États-Unis et la Grande-Bretagne, a signifié la plus grande défaite de l'Italie depuis la Seconde Guerre mondiale et la perte de 50 milliards d'accords économiques avec le dirigeant libyen, que nous avions reçu en grande pompe à Rome à peine six mois plus tôt.
Avec Dbeibah hier, il y avait plusieurs ministres libyens, celui des Affaires étrangères, ceux de l'Intérieur, des Transports et de l'Économie. Un forum d'affaires s'est tenu à la Farnesina auquel ont participé, outre Di Maio et la délégation de Tripoli, un grand nombre d'entreprises italiennes : Snam, Saipem, Terna, Ansaldo Energia, Fincantieri, PSC Group, Italtel, Leonardo, WeBuild, Gruppo Ospedaliero San Donato, CNH Industrial et ENI. La réactivation de certains macro-investissements italiens en Libye, comme la construction de l'autoroute de la paix prévue dans les accords signés par Silvio Berlusconi et Mouammar Kadhafi en 2008, ou le dossier de l'énergie, est en cours de discussion. La Libye est reliée à l'Italie par le gazoduc Greenstream, dont l'ENI aimerait doubler ou tripler la capacité si possible. Dans un avenir proche, l'Italie pourrait compter sur Tripoli pour plus d'un tiers de ses approvisionnements en gaz.
Il s'agit d'un jeu stratégique ; nos concurrents, mais aussi nos partenaires occidentaux, feront tout pour y mettre leur nez.
17:38 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : libye, afrique, affaires africaines, italie, géopolitique, politique internationale, afrique du nord, méditerranée |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook