dimanche, 17 avril 2011
Heidegger spricht !
Heidegger spricht !
00:05 Publié dans Entretiens, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : heidegger, philosophie, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 février 2011
L'eredità falsata di Martin Heidegger
L’eredità falsata di Martin Heidegger
 Che Heidegger, con tutto il suo bagaglio filosofico intatto, sia stato catturato dalle sinistre ormai da qualche decennio e venga tenuto prigioniero nelle bibliografie e nelle monografie democratico-giacobine, è ormai un fatto risaputo. Da quando il marxismo si è dimostrato un ferro vecchio inutilizzabile, abbiamo assistito a un accorrere in folla dalle parti dell’ideologia nazionalpopolare europea, per sottrargli idee, concetti, approcci di pensiero, nomi e cognomi. Sulle orme lasciate da Heidegger, in particolare, hanno pestato in parecchi. E sempre con l’aria di aver fatto una scoperta. Su questa appropriazione indebita, in Italia e all’estero, non pochi ci si sono costruite carriere e cattedre di gran lustro.
Che Heidegger, con tutto il suo bagaglio filosofico intatto, sia stato catturato dalle sinistre ormai da qualche decennio e venga tenuto prigioniero nelle bibliografie e nelle monografie democratico-giacobine, è ormai un fatto risaputo. Da quando il marxismo si è dimostrato un ferro vecchio inutilizzabile, abbiamo assistito a un accorrere in folla dalle parti dell’ideologia nazionalpopolare europea, per sottrargli idee, concetti, approcci di pensiero, nomi e cognomi. Sulle orme lasciate da Heidegger, in particolare, hanno pestato in parecchi. E sempre con l’aria di aver fatto una scoperta. Su questa appropriazione indebita, in Italia e all’estero, non pochi ci si sono costruite carriere e cattedre di gran lustro.
Il gioco è semplice: basta far finta che Heidegger non sia mai stato davvero nazionalsocialista… in fondo, dopo appena un anno dette le dimissioni da rettore, sì o no?… rimase iscritto al Partito nazista fino al 1945, d’accordo, non ha mai detto una parola di condanna su Auschwitz… è vero anche questo… ma insomma… basta non dirlo troppo ad alta voce… poi si ripete fino alla nausea che il suo pensiero è stato travisato, ecco, è stato strumentalizzato, ma certo… è così evidente… ma per fortuna che ora ci pensano loro, gli intellettuali di sinistra, a dare la giusta lettura… ed ecco che un filosofo della tradizione, della ferrea identità di popolo, del volontarismo vitalistico, uno schietto pangermanista, uno che nelle lezioni su Nietzsche invocava «un nuovo ordine partendo dalle radici», tracciando una bella linea retta da Eraclito al Führer, ecco che dunque il filosofo della Führung diventa all’istante un santino del “pensiero debole”, dell’esistenzialismo universalista, una specie di curatore d’anime mezzo new age e mezzo dialettico… Si tratta di un gioco di prestigio per virtuosi, soltanto i migliori tra gli intellettuali di sinistra sono in grado di rivoltare Heidegger, ma anche Nietzsche o Schmitt, ma anche Marinetti o Gehlen o Jünger o Eliade… e tirarne fuori ottime figure di giacobini mondialisti…
A smascherare questi procedimenti della manipolazione professionale, nel 1988 giunse improvviso un libro di Victor Farìas intitolato Heidegger e il nazismo, pubblicato in Italia da Bollati Boringhieri. Fu una bomba inattesa. Suscitò sbandamento e panico nel campo della sinistra intelligente: Heidegger, dopo centinaia di pagine di uno studio basato su fonti primarie, veniva riconsegnato di brutto al suo destino di pensatore della reazione anti-modernista europea, dimostrando testi alla mano che si trattava di un filosofo accesamente antisemita, nazionalista, forgiatore di una profonda identità tra uomo europeo del XX secolo e uomo dorico dell’antichità. Insomma, un nazista. Uno studioso che parlava di metafisica greca pensando all’esserci storico dei tedeschi degli anni Venti-Trenta, e che elaborava la moderna filosofia ontologica individuandone una concreta realizzazione nelle SA.
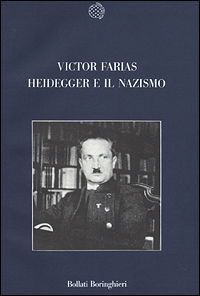 Da allora, Farìas – che è stato allievo di Heidegger e di Fink – è diventato la bestia nera di tutti quei mandarini rossi che intasano università, riviste scientifiche, case editrici, forum e circuiti culturali, ma che per campare si erano inventati un Heidegger quasi-marxista. Se Marcuse si era ridotto a una caricatura, si poteva sempre ricorrere a un Heidegger ben limato… Su questa faccenda l’intellighenzia progressista si è da tempo spaccata in due. Da una parte i devoti di Heidegger, in fuga dalle macerie del marxismo; dall’altra parte i demolitori di Heidegger, custodi di una più intransigente ortodossia antifascista. Per dare un’idea, potremmmo dire: sinistra post-marxista e sinistra liberale ai ferri corti intorno alle spoglie di Heidegger.
Da allora, Farìas – che è stato allievo di Heidegger e di Fink – è diventato la bestia nera di tutti quei mandarini rossi che intasano università, riviste scientifiche, case editrici, forum e circuiti culturali, ma che per campare si erano inventati un Heidegger quasi-marxista. Se Marcuse si era ridotto a una caricatura, si poteva sempre ricorrere a un Heidegger ben limato… Su questa faccenda l’intellighenzia progressista si è da tempo spaccata in due. Da una parte i devoti di Heidegger, in fuga dalle macerie del marxismo; dall’altra parte i demolitori di Heidegger, custodi di una più intransigente ortodossia antifascista. Per dare un’idea, potremmmo dire: sinistra post-marxista e sinistra liberale ai ferri corti intorno alle spoglie di Heidegger.
In queste faide umilianti, tra l’altro, notiamo il tracollo finale di un modo di fare sub-cultura e di essere alla guida della macchina intellettuale, che si riassume nella bancarotta ormai irreversibile del progressismo. Falsificazione, fanatismo, faziosità, delazione, intimidazione… queste le attitudini scientifiche con cui i “filosofi” post-moderni, come nani confusi di fronte a qualcuno molto più grande di loro, arraffano oppure rigettano le posizioni di quello che è stato definito il maggior intellettuale del Novecento. Qualcuno glielo dica: si stanno occupando di un personaggio che non li riguarda in nessun caso.
Oggi Farìas ne fa un’altra delle sue e scarica nuove bordate di militanza democratica, pubblicando un esplicito L’eredità di Heidegger nel neonazismo, nel neofascismo e nel fondamentalismo islamico (Edizioni Medusa). Si prevedono nuovi travasi di bile tra le truppe intellettuali della sinistra heideggeriana, in fase di crescente spaesamento e comandate con qualche difficoltà, qui da noi, da maestri del pensiero del rango di un Gianni Vattimo.
 Il discorso di Farìas, ancora una volta, non potrebbe essere più chiaro: Heidegger era nazista dalla testa ai piedi. Lo era perchè amico delle SA, perchè iscritto alla NSDAP fino all’ultimo giorno, perché pubblico elogiatore di Hitler, perché si identificò nel Terzo Reich e nelle sue guerre, perchè ha relativizzato pesantemente la Shoah, ma anche perchè tutto il suo pensiero, i suoi scritti, le sue lezioni universitarie, i suoi stessi concetti e argomenti sono riconoscibili per nazisti, sia prima che – addirittura – dopo il 1945. Poi Farìas va oltre, vuole strafare e, alla maniera dei persecutori “democratici”, quelli che vogliono imporre con le buone o con le cattive il Pensiero Unico, sui due piedi crea il mostro: Heidegger padre spirituale anche del neonazismo e del fondamentalismo islamico. Heidegger padre di tutti gli incubi dell’era globale. Prende Ernst Nolte – non uno qualsiasi, ma probabilmente il massimo storico vivente… ma col difetto di non appartenere alle cosche di sinistra – e lo diffama come agente neonazista. Direte: è uno scherzo? No, non è uno scherzo. Farìas fa sul serio: «Nolte di fatto apre le porte a un neonazismo che conferma tutti i modelli sociali autoritari… Nolte afferma che Heidegger intendeva il nazismo come “socialismo tedesco”… nel suo sforzo di riabilitare Heidegger utile a riabilitare un neonazismo… nella Repubblica Federale tedesca del 1987, Nolte interpreta le lezioni su Hölderlin (1934-1935) assumendo come evidente e accettabile l’ultranazionalismo dell’esegesi heideggeriana…».
Il discorso di Farìas, ancora una volta, non potrebbe essere più chiaro: Heidegger era nazista dalla testa ai piedi. Lo era perchè amico delle SA, perchè iscritto alla NSDAP fino all’ultimo giorno, perché pubblico elogiatore di Hitler, perché si identificò nel Terzo Reich e nelle sue guerre, perchè ha relativizzato pesantemente la Shoah, ma anche perchè tutto il suo pensiero, i suoi scritti, le sue lezioni universitarie, i suoi stessi concetti e argomenti sono riconoscibili per nazisti, sia prima che – addirittura – dopo il 1945. Poi Farìas va oltre, vuole strafare e, alla maniera dei persecutori “democratici”, quelli che vogliono imporre con le buone o con le cattive il Pensiero Unico, sui due piedi crea il mostro: Heidegger padre spirituale anche del neonazismo e del fondamentalismo islamico. Heidegger padre di tutti gli incubi dell’era globale. Prende Ernst Nolte – non uno qualsiasi, ma probabilmente il massimo storico vivente… ma col difetto di non appartenere alle cosche di sinistra – e lo diffama come agente neonazista. Direte: è uno scherzo? No, non è uno scherzo. Farìas fa sul serio: «Nolte di fatto apre le porte a un neonazismo che conferma tutti i modelli sociali autoritari… Nolte afferma che Heidegger intendeva il nazismo come “socialismo tedesco”… nel suo sforzo di riabilitare Heidegger utile a riabilitare un neonazismo… nella Repubblica Federale tedesca del 1987, Nolte interpreta le lezioni su Hölderlin (1934-1935) assumendo come evidente e accettabile l’ultranazionalismo dell’esegesi heideggeriana…».
Farìas, che è una punta di diamante della lobby mondialista liberal-libertaria di matrice cattolica, odia Nolte, che è un nazionalconservatore, di un odio da Inquisizione. Non elabora la possibilità che vi sia qualcuno che non la pensa come lui. E ne ha per tutti. Vede un mondo di neonazisti. Dalla “Nuova Destra” tedesca – un tranquillo ambiente di intellettuali alla Stefan George, dove si fa cultura di nicchia – al figlio di Heidegger, Hermann, accusato di voler insinuare un pernicioso “neo-heideggerismo”… fino a certi contatti culturali tra frange della destra e della sinistra tedesche: e, ad esempio, il loro anti-americanismo, attinto da Heidegger, diventa subito un sinistro “nazionalbolscevismo”. Attacca a testa bassa la “Nouvelle Droite” francese e infama de Benoist o Guillaume Faye tacciandoli coi soliti stereotipi di pericolosità neopagana e fascistoide: e sin qui nulla di nuovo. Ma subito li mette in collegamento con certe derive da lui astutamente individuate nel pensiero “corretto”: dice che Lacan o Baudrillart erano vicini a Céline e alla Rivoluzione Conservatrice, rivela che Foucault ammirava la «spiritualità politica» dei khomeinisti iraniani, giudica Steuckers un nocivo teorico “eurocentrista” e stende un verbale delle riviste cui collabora (comprendendoci anche quelle di Marco Tarchi…), poi descrive il nuovo ecologismo (e ci mette dentro anche quello di Eduardo Zarelli…) come un nido di eredi di Klages e del Blut und Boden… e ribatte ancora che l’heideggerismo del GRECE è stato un vaso d’infusione per il peggiore degli abomini, il razzismo: «de Benoist, come Heidegger, basa le gerarchie che fondano la discriminazione non come i razzisti “volgari” e zoologisti, bensì nello “spirito”…». Da questo poderoso concentrato di aria fritta, Farìas trae le sue conclusioni, rivelando al mondo l’esistenza di una perversa congiura metapolitica, al di là della destra e della sinistra: «Così, non sorprende che in Francia il matrimonio – impensabile fino a poco tempo fa – tra il sotterraneo fascismo heideggeriano e il neomarxismo militante sia oggi una realtà».
Subito dopo, Farìas si volge da un’altra parte del suo vasto spettro di nemici e ne individua uno tra i più temibili: l’islamismo heideggeriano. E ci informa che tra un tale Sayyd Qutb morto nel ‘66 e Heidegger esisteva una grande somiglianza di concezioni anti-americane… e che l’iraniano Ahmadinejad non sarebbe altro che «un militante “heideggeriano”». Infine si dice convinto che esista una nazi-connection mondiale che unifica tutti questi ambienti al «neofascismo militarista di Chàvez», dipinto come un Caudillo antisemita, a lungo ammaestrato dal defunto politologo péronista-revisionista Norberto Ceresole, a sua volta heideggeriano di ferro e perno ideologico del complotto neonazista… Insomma, è come leggere I Protocolli dei Savi di Sion… ma all’incontrario… e con l’uguale spessore scientifico pari a zero.
Farìas è uno dei più zelanti poliziotti a difesa del Pensiero Unico. Recita alla perfezione la parte del sacerdote che veglia sull’ortodossia totalitaria e che denuncia l’eretico, indicando la forca sulla quale farlo salire. Farìas lavora come pochi per le ragioni del mondialismo censendo pensieri, parole ed opere di quanti si ostinino ancora a usare la loro testa. Segnala ambienti, rivela retroscena, denuncia frasi che a forza sottolinea come pericolose, addita libri, uomini, associazioni come letali focolai di camuffamento neonazista sub specie heideggeriana. Uno afflitto da una simile sindrome, lo direste uno studioso… o piuttosto un delatore?
Noi imparziali e inattuali vogliamo dire la nostra: Farìas fa bene quando contribuisce a rettificare le cose, tornando a collocare Heidegger in modo documentato nella tradizione di pensiero che gli compete, quella anti-progressista e radicalmente identitaria. Del resto, Farìas è soltanto più rumoroso di altri: infatti, anche prima di lui, svariati studiosi, da Hugo Ott a Philippe Lacoue-Labarthe a Bernd Martin, per citarne solo alcuni, già tra l’87 e l’88, rimisero Heidegger al suo posto, dimostrandone i nessi biografici e filosofici col Nazionalsocialismo, senza per questo mandarne al capestro la memoria. E nessuno di loro intese recitare la parte fanatica del militante antifascista a tutti costi e fuori tempo massimo. Farìas fa infatti cattiva letteratura quando, da propagandista schierato e da terrorista intellettuale, fa sibilare la frusta dell’inquisitore “democratico”, evocando ad ogni passo la reazione in agguato, il neofascismo che dilaga, il Quarto Reich alle porte… e altri simili spropositi.
* * *
Tratto da Linea del 30 gennaio 2009.
00:05 Publié dans Histoire, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : histoire, allemagne, philosophie, heidegger, manipulations médiatiques, biographie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 27 décembre 2010
?Existio una Konservative Revolution en Espana?
00:05 Publié dans Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, espagne, ortega y gasset, heidegger, idéologie, conservatisme, droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 12 septembre 2010
Heidegger: la thématisation de l'être et ses énigmes
Archives de SYNERGIES EUROPENNES - 1996
HEIDEGGER : La thématisation de l'être et ses énigmes
Sens de la question
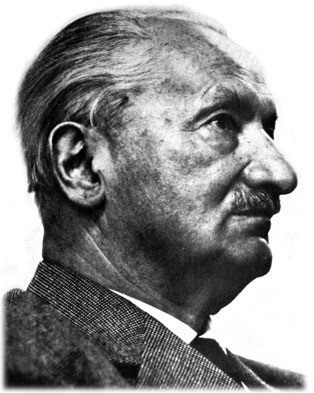 Nous avons tous entendu un jour ou l'autre que Heidegger, le métaphysicien, avait reposé le problème de l'Etre. Très bien, mais que signifie cette phrase et dans quelle mesure nous perrnet-elle de nous orienter?
Nous avons tous entendu un jour ou l'autre que Heidegger, le métaphysicien, avait reposé le problème de l'Etre. Très bien, mais que signifie cette phrase et dans quelle mesure nous perrnet-elle de nous orienter?
La culture contemporaine favorise les mystifications. La philosophie de Heidegger reste ainsi abandonnée aux associations prévisibles, à l'avidité des théologiens estampillés, aux apologies et aux dénonciations faciles. Les diatribes du jeune Carnap possèdent quelque chose d'aristocratique par comparaison avec les jugements sommaires de notre époque. L'inquisiteur Levinas, par exemple, a trouvé que les incursions étymologiques et les métaphores rupestres de Heidegger dénonceraient une pensée liée au Sol et au Sang, étrangère aux aspirations de ces tribus de nomades philanthropiques qui vaguaient, dépourvues de tout, par le désert. Expert en lamentations, Levinas déplore également que le philosophe s'inspire de la poésie de Holderlin et non pas, par exemple, des Lamentations de Job. Heidegger, par conséquent, un antisémite larvé. Admettons. Et alors?
D'autres esprits critiques proches de la Nouvelle Droite, comme par exemple Pierre Chassard dans son ~u-delà des choses (1992), nous avertissent que cet Etre heideggérien cohabite avec un universalisme suspect, que la distance de l'Etre par rapport aux choses réelles et sa parenté avec le Néant font de lui le pendant du Dieu de l'Exode, que les textes pertinents accusent l'influence de Maïmonide... Heidegger, donc, un philosémite subreptice. Admettons. Et alors?
Le caractère alternatif ou périphérique d'une culture ne nous dispense pas d'un minimum de sérieux. Il est temps que nous commencions à accéder à la pensée de Heidegger en tant que pensée philosophique, la jugeant de ce point de vue, et non selon ses affinités avec les idéologies des Systèmes dominants ou de leurs rivaux contestataires. C'est là la question générique.
Consentons à un usage ambigu de l'expression "I'Etre", puisque aussi bien il s'agira d'une ambiguïté nécessaire et provisoire. La Philosophie que nous pouvons qualifier de "classique", avec Parménide tout d'abord, puis Platon, Aristote et la Scolastique, a commis une thématisation de l'Etre qui disparait avec la Modernité: de Descartes à Fichte, nul philosophe (qu'il soit rationaliste, empiriste, criticiste ou idéaliste) ne croit que la solution des vrais problèmes philosophiques dépende de certaines précisions, intuitions ou thèses sur l'Etre... Si toutefois l'Etre réapparaît dans l'idéalisme de Hegel comme Leitmotiv de quelques philosophèmes, ce n'est qu'avec Heidegger qu'est rétablie une thématisation comparable aux précédentes, et qui leur est probablement supérieure, tant par son obstination que par son caractère problématique.
C'est dans la compréhension du sens de l'Etre que réside le destin de l'Occident et l'histoire de la Philosophie se déroule conformément à l'élucidation ou à l'occultation de l'Etre. Que peut bien signifier une telle assertion? Les difficultés interprétatives soulevées par les textes de Heidegger sont bien connues. Je vais tenter ici une reconstruction des idées qu'il paraît suggérer - reconstruction qui doit être jugée non pas pour sa fidélité à la lettre ni pour sa fidélité à un "esprit" insaisissable (nous laissons cela à la Heideggerphilologie) mais pour son degré de fécondité explicative. C'est là la question spécifique. Notre explanandum est constitué par les solutions persistantes ou par l'absence non moins persistante de solution dans le traitement classique des problèmes ontologiques. Le chercheur contemporain, s'il est honnête, éprouve une série de désarrois devant des énigmes qui lui paraissent plus suscitées que découvertes. Par exemple:
a) Comme peuvent l'attester les élèves du Kindergarten néothomiste le plus proche, c'est dans la Différence Ontologique Etre/Étant que réside la clef de la Philosophie; mais une telle différence s'articule sur un mode inintelligible et nous conduit parfois à identifier l'Etre et le Néant. Pourquoi devrions-nous accepter ce jargon?
b) La Métaphysique (par exemple dans la première douzaine de Disputationes de Suarez) établit de fastidieuses équations entre transcendantaux pour nous informer que l'étant est un, etc.; information qui ne nous paraît pas trop excitante. A quoi vise-t-elle?
c) Depuis Platon on se demande "Qu'est-ce que l'Etre?" et l'on répond par telle ou telle catégorie de prédilection (Substance, Esprit, Matière). Mais il paraît absurde et capricieux de définir le plus général par seulement l'un de ses genres.
d) Fréquemment, depuis Aristote, la Métaphysique oscille entre une Ontologie du plus universel et une Théologie du plus singulier; on ne voit pas pour quelle raison on a pu unir des disciplines aussi disparates.
e) A peine l'Ontologie, qui prétend être la science de l'être en tant qu'être, nous introduit-elle à lui qu'elle nous signale avec impatience la porte de sortie (avec un écriteau "analogia entis" pour les sorties de secours) et qu'elle nous propose de diviser et subdiviser des entités spécifiques.
f~ L'Etre, de par son degré de généralité, ne paraît pas apte à abriter des contenus spécifiqu~s de telle sorte qu'il puisse inclure dans sa compréhension "le destin d'un peuple", ou quelque chose d'une pareille importance.
Cette liste sélectionne quelques sujets de perplexité. Une explication doit venir mitiger l'impression d'absurdité crasse que la Métaphysique produit aujourd'hui et l'inventaire précédent offre certains critères pour juger de l'hypothèse proposée. L'explication, contrairement à ce que l'on pourrait croire à première vue, ne sera pas simplement linguistique: il s'agit de discerner des structures ontologiques différentes qui sont parfois unifiées par de vieilles habitudes verbales.
Homonymie Ontologique Tran~cntégorielle: un Trépied
L'expression "I'Etre" n'est pas utilisée normalement comme une description définie, à la manière de "I'auteur du Quichotte". Les acceptions les plus fréquentes paraissent hésiter entre trois catégories:
1. une propriété, que nous désignerons par S
2... Ia classe E des objets qui satisfont cette propriété
3. Ies éléments de E, spécialement cet élément qui possède la propriété S d'une façon nécessaire et éternelle.
Le langage de tous les jours adjuge des termes de propriété au moyen du verbe avoir et des termes de classe au moyen du verbe être. Nous disons que Socrate est un sage ou qu'il a de la sagesse, mais nous ne disons pas qu'il est de la sagesse ou qu'il a un sage. En revanche, ce test linguistique est défaillant avec l'Etre: on dit sans problème de cohérence qu'il est un être ou qu'il a un être, qu'il est un étant ou qu'il a une entité. Nous pouvons supposer qu'ici il y a une distinction qui s'est obscurcie.
Les propriétés, par exemple la blancheur, définissent une classe, celle du blanc. Si nous distinguons la classe de la propriété qui la définit, il paraît naturel d'interpréter dans l'usage philosophique l"Etant" comme un terme qui se réfère à la classe (2) et l"'Etre" comme la désignation de (1). La priorité de la propriété qui définit sur la classe définie rend évident de quelle manière l'Étant se fonde sur l'Etre. Quand on dit que l'Etre "fait" que l'étant soit, on ne doit pas considérer un tel "faire" comme l'exercice d'une causalité. Il ne s'agit pas non plus du problème de l'Unité versus la Multiplicité, mais de la dépendance d'une classe - qui pourrait bien être unitaire - à l'égard de la propriété qui la détermine.
S'il y a plusieurs éléments dans cette classe E, qu'on appelle les "étants", ils peuvent se trouver dans dif~érentes relations de dépendance (par exemple, causalité, inhérence, composition), mais cette dépendance horizontale n'affecte ni n'annule la dépendance verticale à l'égard de S. Par exemple, un étant suprême, cause totale de tous les autres, etc., ne pourrait de ce fait équivaloir à la propriété. Lorsque l'on dit "Deus est ipsum esse" on semble tomber dans une erreur catégorielle, qui fait d'un élément d'une classe l'équivalent de la propriété qui définit cette classe. Il pourrait arriver qu'un élément de cette classe possède la propriété de façon nécessaire, sempiternelle, éminente, infinie etc., mais il apparaît qu'il continuerait à être différent de la propriété. Une propriété est infinie en tant qu'elle peut être le prédicat d'un nombre illimité d'objets. L'erreur se produit quand on assimile l'Etre et l'Acte, de telle sorte que l'Acte est compris comme une sorte de pensée universelle; à la suite de quoi on interprète l'Acte - par opposition à la Puissance - comme une Perfection. De là surgit un Etre comme infinie perfection et actualité, qui va comme un gant àl certaines représentations de la déité (voir les trois premières des vingt-quatre Thèses Thomistes). On déambule d'une catégorie à l'autre. De toute manière, les hésitations relatives à ces catégories expliquent que l'on puisse penser à une Onto-Théologie, à laquelle on faisait allusion en (d). Cette affirmation sera confirmée plus loin.
On a l'habitude de caractériser l'Ontologie comme une discipline de l'Etre, assimilant S et E. La distinction précédente dissipe l'inquiétude (e), quant aux deux voies que peut adopter une Ontologie: ou bien tenter de discriminer des régions et des relations à l'intérieur de la classe E des étants (ce qui paraît superficiel) ou bien élucider cette propriété fondatrice, ses relations avec d'autres propriétés et avec les divers étants (ce qui paraît profond). Il y a cependant une perturbation dans la diffusion pacifique du travail. Gilson a déclaré, dans son galimatias: "on peut penser qu'etre, c'est être un etre - mais aussi qu'etre un etre, c'est simplement etre". C'est-à-dire: nous pouvons privilégier dans notre spéculation les sujets de la propriété ou la propriété elle-même. Ainsi le galimatias disparaît, et le chemin s'ouvre aux vraies difficultés.
Jusqu'à présent l'idée était très simple. Mais si S est la propriété et E la classe des étants (c'est-à-dire des individus qui possèdent cette propriété), alors l'Etre sera-t-il un étant (non pas la classe E mais un élément de E)? Considérons attentivement la question et le dilemme. Si l'Etre n'est pas un étant, alors c'est qu'il manque de la propriété qui définit les étants, ce qui signifie : I 'Etre n 'est pas. C'est pourquoi bien souvent l'être est perçu comme un Néant, soit absolu, soit qualifié ("Néantd'Étant" - mais, pourrait-il y avoir un autre Néant?). Si l'on admet l'existence d'une classe complémentaire de l'Étant, le Néant, remplie de tout ce qui manque d'Etre, alors l'Etre sera un élément du Néant. Il paraît très curieux que le Néant ne soit pas quelque chose de plus ou moins similaire à l'ensemble vide. Nous savons que Hegel s'est trouvé dans une perplexité semblable, mais celle de Heidegger mérite plus d'attention.
Prenons l'autre terme du dilemme: la possibilité que S soit un étant. Alors une classe comprendrait la propriété qui la définit parmi ses éléments. Ce n'est pas à première vue impossible. D'une part il y a des propriétés qui se distinguent de leurs sujets: la proprieté "être un nombre pair" n'est ni paire, ni un nombre - la propriété qui définit la liste 2, 4, 6, 8... n'est pas l'un des nombres qui apparaissent dans cette liste. Mais d'autre part il y a des propriétés plus exotiques. Par exemple, la propriété "être pensable" est elle-même quelque chose de pensable: la propriété détermine la totalité de ce qui est pensable et elle est elle-même membre de cette totalité. Est-ce que la relation entre l'Etre et la classe des étants est de cette nature? Et nous voyons déjà que la question de l'Onto-Théologie se présente d'une manière moins capricieuse.
Si nous admettons avec beaucoup de libéralité ce type de propriétés et de classes exotiques, nous pouvons nous embrouiller dans des problèmes. Par exemple, on peut présumer que la classe des étants E, non seulement comprendrait l'Etre comme élément, mais aussi posséderait elle-même l'être. Ainsi E serait élément d'elle-même, et la totalité d'une collection ferait partie d'elle-même.
Assurément l'astuce des logiciens permet d'endiguer ces libéralités au moyen de divers traitements: ce qui n'empêche pas la persistance d'un symptôme alarmant. L'intuition primordiale qui guidait ces réflexions imposait une hiérarchie entre individus, classes et propriétés. Les propriétés sont universelles, les individus non: par conséquent, si l'Etre était un étant, il serait un universel et un individu. Et si parmi les éléments on admet des individus et des propriétés universelles, l'ordre rêvé se désagrège.
Ici le dilemme dé~ouche sur une confusion, un balbutiement sur la différence ontologique, affection facilement explicable vue l'hypothèse que nous avons introduite sur la thématisation de l'être et la possibilité de voir en lui une propriété. Ce qui conduit Heidegger plus d'une fois à voir dans l'Etre un Néant. Et qu'il ne s'agit pas là d'une idée accidentelle de Heidegger, on peut le vérifier en étudiant le "parricide" de l'Étranger d'Élée (Platon, Sophiste 241 d) et la polémique d'Aristote contre Melissô et Parménide (spécialement le texte de Physique I c.3, 186 a: 2531). Ainsi est satisfaite la requête (a). Il ne s'agit pas toujours d'un verbiage arbitraire au sujet de la Différence Ontologique, mais aussi d'une série de difi~lcultés pressel1ties sans que l'on possède l'instrument conceptuel pour les mettre en ordre.
Homonymie Ontologique Catégorielle ~ ventail de propriétés
Tant chez Aristote que chez Heidegger on rencontre une préoccupation liée à la pluralité des propriétés visées par le terme "l'Etre" (ne pas confondre avec l'analogia entis). L'expression "l'Etre" ne désignerait pas, comme on l'a supposé, une propriété, mais un éventail de propriétes. Ce fait dénote une homonymie catégorielle (puisque l'on se restreint à la catégorie des propriétés). L'interrogation sur l'Etre peut être comprise comme l'examen desdites propriétés et des relations qu'il pourrait y avoir entre elles. Sans vouloir être exhaustifs, nous pourrions consigner une série de propriétés compatibles et (au moyen de quelques raccords) coextensives entre elles:
- l'existence dans le temps présent
chose
- I'existence en général
- la possibilité d'existence
- I'identité
- la prédication
- I'affirmation
- la possibilité d'être pensé la possibilité d'être estimé en termes de volonté le fait d'être en relation de fondement, de cause ou d'effet avec quelque
- le fait d'être déterminé par quelque propriété
- le fait de posséder, pour un couple quelconque de propriétés contradictoires, I'une d'entre elles.
Cette deuxième homonymie explique les diverses formes dans lesquelles s'est développée une bonne part de la spéculation métaphysique traditionnelle, que ce soit dans le traitement des "transcendantaux" (un, vrai, bon), ou dans les explications sur son "objet" (étant nominal, étant participial, le "Meinbare" de Meinong, etc.). Les équations fastidieuses sont un effort pour explorer les distinctes propriétés auxquelles il a été fait confusément allusion. Les catégories (prédicaments) s'imposent comme la seule manière d'étudier les diverses prédications. Une oeuvre aussi influente que méconnue, celle de Josef Maréchal Le Point de Départ de la Métaphysique, se nourrit de l'assimilation des termes prédication, affirmation et existence (interprétée comme acte infini): le fait que nous puissions énoncer des jugements assertoriques ne serait explicable, selon Maréchal, que parce que nous supposons une synthèse de la copule de la prédication avec un acte infini: ici se révèlent certains thèmes de Malebranche, Fichte et peut-être Bradley, mais ce n'est que grâce à l'homonymie catégorielle qu'ils peuvent apparaître dans ce contexte métaphysique de façon assez naturelle.
Si Heidegger insis~e sur sa démonstration que l'Etre est essentiel au Langage, c'est qu'il pense à l'Etre comme faisant référence à la propriété de déterminer la prédication; s'il établit une relation avec le Temps, c'est que l'actualité de l'existence réclame le présent. La préférence des métaphysiciens qui placent au premier plan un certain type d'étants et à l'arrière-plan la généralité, se comprend s'ils croient voir chez certains étants une exemplification plus juste des propriétés qui dans tel ou tel système sont considérées comme remarquables. De telle sorte que l'interrogation "qu'est-ce que l'être?" acquiert un autre sens, libérée de son absurdité. Et s'il existe plusieurs propriétés implicites dans l'Etre, l'objet de l'ontologie est loin d'être simple et le recours à des divisions et subdivisions s'impose. Ainsi sont satisfaits, selon moi, les critères (b), (c) et (e) de notre liste.
Mais nous arrivons ici à une thèse cruciale pour la pensée heideggérienne: I'expansion de l'Etre en éventail nous permet de passer à une compréhension dialectique de ces propriétés (ceci renvoie au passage de Platon dans le Sophiste, 254 b sqq.). Etre, comme propriété centrale s'oppose à Devenir (Werden), à Apparence (Schein), à Penser (Denken) et à Devoir-Etre (Sollen) comme à des propriétés périphériques constituant une trame de propriétés.
Chaque fac,on de saisir une propriété centrale conditionnerait de manière radicale la façon de saisir une propriété périphérique proche. Ces propriétés sont à leur tour centrales par rapport à d'autres propriétés, et ainsi de suite. Une propriété centrale peut se comporter ou non comme un genre (un déterminable); sa centralité ne dépend pas de cela, mais d'un système de positions, tensions et compléments étendu non seulement au sens de la propriété mais aussi aux représentations qui l'enveloppent. "Devenir" signifie une succession continue de situations, mais représentée par le cours d'un fleuve, le bourgeonnement d'un arbre, la vague qui croît sans être une chose mais le déploiement d'une force qui se manifeste dans l'euphorie de l'aube. L'Art et la Poésie, créant un lien entre représentation et sens, peuvent donner accès à ces dimensions et placer les choses sujettes à l'expérience dans une perspective métaphysique - si tant est que la Métaphysique nous engage dans cette trame de propriétés. Ceci nous foumit la raison de cette étrange affirmation sur le destin d'un peuple et sa compréhension de l'Etre, sa façon d'aborder la question de l'Etre. Cette compréhension est portée par un langage naturel, qui est nécessairement collectif, et elle s'étend à travers lui au peuple qui le parle, et qui, de par cette compréhension athématique de l'Etre, se situe dans-le-monde d'une façon ou de l'autre. Ceci satisfait le réquisit (f).
L"'Interrogation Fondamentale de la Métaphysique"
La question (d) au sujet de l'Onto-Théologie n'était pas encore suf~lsamment résolue. Ainsi donc, si l'Etre instaure un ordre de fondements et de raisons suff1santes, il paraît adéquat d'instaurer un tel ordre dans la contingence générale de l'étant, introduisant par là une entité nécessaire. Mais si Heidegger feint de répéter la question de Leibniz "pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien?" il le fait seulement pour la rejeter, bien que d'une manière très diplomatique. Et il fait bien, car une question qui ~ne peut avoir de réponse est nulle et non avenue. J'omets de faire la démonstration exacte de cette nullité, mais j'en suggérerai les grandes lignes.
Appliquant le principe de raison suffisante nous imaginons deux situations contradictoires, toutes les deux possibles prises séparément: un monde vide ou un monde non vide. Chacune des deux situations paraît logiquement contingente, peut se présenter ou non, et la question fondamentale devrait conduire à donner raison de la contingence en général. Mais si la réponse est également contingente, on aurait seulement ajourné la question: comme avec le monde soutenu par un éléphant, qui devrait être soutenu par une tortue... etc.
Mais si la réponse n'était pas logiquement contingente et impliquait, par exemple "il existe une entité nécessaire" alors cette conclusion devrait être nécessaire et sa négation impossible. Est-ce là un résultat admissible? Non. De là suivraient deux inconvénients: l'un, qu'on disposerait alors d'un argument ontologique, car rendant superflue toute preuve à partir de la contingence; dans le fameux débat radial de Russell et Copleston en 1948 ce problème reste sousjacent, dominant ce qu'on voit à la surface. L'autre inconvénient est que du nécessaire ne peut s'ensuivre le contingent: la réponse ne peut donc donner raison de la contingence. C'est pourquoi l'Onto-Théologie implose quand elle tente d'expliquer la création a parte dei, dans la mesure où elle fait de Dieu un Créateur. Cette création (ou le fait qu'il y ait un Dieu créateur plutôt qu'un Dieu qui ne l'est pas) est une question logiquement contingente, comme l'existence même du monde. Si l'on introduit ici la Liberté divine, en réalité on ne fait que hisser un drapeau blanc, et ce principe de raison suffisante qui avait rendu de si précieux services se rend pieds et poings liés Le théologien propose un armistice: "Bâillonnons le principe de raison suffisante et parlons d'autre chose, de Dieu qui est amour, ou de la dignité de la personne humaine. " Le philosophe fait observer : "Comment? Dieu s'était introduit pour rationaliser le scandale de la contingence et puis, pour la compréhension de cet être nécessaire, on réintroduit en lui la contingence, l'affiublant du nom de Liberté." Spinoza en son Ethica (Pars I, prop. 17, 29 et 32) est plus conséquent que les Onto-Théologiens: ayant admis l'argument ontologique il nie qu'il puisse y avoir au monde quelque chose de contingent... Du nécessaire ne peut découler que le nécessaire.
En résumé: une réponse sensée à ce qu'on appelle la Question Fondamentale de la Métaphysique ne peut être ni une proposition nécessaire ni une proposition contingente. Mais une question qui empêche en principe toute réponse est une pseudoquestion - le résultat vaut indépendamment de toute théorie de vérification du sens et des critères similaires. Rien ne peut donc constituer une réponse à la question, qui s'annule par ce fait même, ce qu'il fallait démontrer. La démonstration exacte exige plus de précisions.
Il est clair que le chemin indiqué par Heidegger est différent, plus conforme à son style, difficile à abréger. Disons: la question peut s'autoabolir dans le questionnement "pourquoi un Pourquoi?". Nous trouverons seulement la propriété de l'Etre comme exigence de fondements des étants, et donation de ces fondements. Remplaçons alors la question abolie par la question sur la propriété centrale, et ce faisant nous retomberons sur nos pieds.
~eidegger et la Kulturphilosophie
Si de ce qui pre!cède on peut inférer des conséquences agréables ou désagréables au judéochristianisme et à ses institutions, c'est là une question qui intéresse plus le propagandiste que le philosophe. Ce qui est certain, c'est que Heidegger (considéré comme l'archétype du métaphysicien par des épigones insignifiants) déplace le centre de gravité de l'Ontologie vers ce qu'on peut appeler Philosophie de la Culture. J'ai proposé au début d'aborder Heidegger sous un angle philosophique et de juger sa pensée dans ce sens. Je vais risquer un jugement: si nous le comparons en tant que philosophe de la culture à Nietzsche, à Spengler, à Evola, il n'occupe pas la première place, nous sommes gênés par ses détours excessifs et le manque d'évidence des faits qu'il allègue. Si nous le considérons comme un philosophe de la ligne classique et théorique, nous sommes déconcertés par le peu de sensibilité de Heidegger à l'égard des problèmes métaphysiques. Depuis la cime de sa propre position, qu'il ne se donne jamais la peine d'expliciter, il se met à historiciser, émettant des opinions sur les penseurs qui l'ont précédé. Ce qui alimente la plèbe de la Philosophie, les professeurs sans idées qui tournent comme des vautours autour des grands morts. Heidegger se prête bien à une justification de la phrase de Nietzsche sur l'Histoire qui se convertit en fossoyeuse du présent. Dans nos institutions académiques - et dans une bonne partie de celles d'Europe, avoir été un philosophe est un honneur - vouloir parvenir à l'être, un opprobre.
Mais la Philosophie, après deux millénaires de lutte avec les mythologies judéochrétiennes et leurs sécularisations, est pour la première fois une nouvelle possibilité. C'est ici qu'il y a une splendeur de Heidegger. Sa grandeur est dans ce mode du philosopher à la frontière de la Science et de la Weltanschauung, sur cette mince ligne qui peut fasciner et confondre, induire au vertige ou empêcher la pensée. Heidegger nous éveille à de nouvelles possibilités épurées de toute tradition supposée. C'est cela que nous pouvons apprendre de Heidegger, non pas son jargon ou son désordre, son hostilité à l'égard de la science ou ses mauvaises argumentations. Ce ne sont pas ses thèses qui nous importent, mais les voies qui s'ouvrent en elles. Ce n'est pas tant la thématisation de l~tre qui nous intéresse, mais un retour de ce qui survint dans l'Hellade, le penser entre Mythos et Logos.
Carlos Dufour. Traduit de l'espagnol (argentin) par Bruno Dietsch.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, heidegger, existentialisme, allemagne, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 23 août 2010
Heidegger "The Nazi"
Heidegger “The Nazi”
Ex: http://www.counter-currents.com/
 Emmanuel Faye
Emmanuel Faye
Heidegger: The Introduction of Nazism into Philosophy in Light of the Unpublished Seminars of 1933-1935
Trans. Michael B. Smith, foreword Tom Rockmore
New Haven: Yale University Press, 2009
National Socialism was defeated on the field of battle, but it wasn’t defeated in the realm of thought.
Indeed, it’s undefeatable there because the only thing its enemies can do to counter its insidious ideas is to ban those thinkers, like Martin Heidegger, whose works might attract those wanting to know why National Socialism is undefeatable and why its world view continues to seduce the incredulous.
Or, at least, so thinks Emmanuel Faye in his recently translated Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie (Paris: Albin Michel, 2005).
Why, though, all this alarmed concern about a difficult, some say unreadable, philosopher of the last century?
The reason, Tom Rockmore says, is that he lent “philosophical cover to some of the darkest impulses that later led to Nazism, World War II, and the Holocaust.”
One.
The Scandal
Faye’s book is part of a larger publishing phenomenon — in all the major European languages — related to the alleged National Socialism of the great Freiburg philosopher.
Like many prominent German academics of his age, Heidegger joined Hitler’s NSDAP shortly after the National Revolution of 1933.
He was subsequently made rector of the University of Freiburg, partly on the basis of his party affiliation, and in a famous rectorial address — “The Self-Assertion of the German University” — proposed certain reforms that sought to free German universities from “Jewish and modernist influences,” reorienting it in this way to the needs and destiny of the newly liberated Volksgemeinschaft.
Heidegger’s role as a public advocate of National Socialist principles did not, however, last very long. Within a year of his appointment, he resigned the rectorship.
As he told the de-Nazification tribunal in 1945, his resignation was due to his frustration in preventing state interference in university affairs, a frustration that soon turned him away from all political engagements.
The story he told to the liberal inquisitors (which most Heideggerians accepted up to about 1988) was one in which a politically naive academic, swept up in the revolution’s excitement, had impulsively joined the party, only to become quickly disillusioned.
The story’s “dissimulations and falsehoods” were, indeed, good enough to spare him detention in a Yankee prison — unlike, say, Carl Schmitt who was incarcerated for two years after the war (though the only “Americans” Schmitt ever encountered there were German Jews in the conquerors’ uniform) — but not good enough to avoid a five-year ban on teaching.
In any case, it has always been known that Heidegger had at least a brief “flirtation” with “Nazism.”
Given the so-called “negligibility” of his National Socialism, he was able, after his ban, to resume his position as Germany’s leading philosopher. By the time of his death (1976), he had become the most influential philosopher in the Western world. His books have since been translated into all the European languages (and some non-European ones), his ideas have come to dominate contemporary continental thought, and they have even established a beachhead in the stultifying world of the Anglo-American academy, renowned for its indifference to philosophical issues.
Despite Heidegger’s enormous influence as “the century’s greatest philosopher,” he never quite shed the stigma of his early brush with National Socialism. This was especially the case after 1987 and 1988.
For in late 1987 a little known Chilean-Jewish scholar, Victor Farìas, produced the first book-length examination of Heidegger’s “brush” with National Socialist politics.
His Heidegger and Nazism was not a particularly well-researched work, and there was a good deal of speculation and error in it.
It nevertheless blew apart the story Heidegger had told his American inquisitors in 1945, revealing that he had been a party member between 1933 and 1945; that his National Socialism was something more than the flirtation of a politically naive philosopher; and that his affiliation with the Third Reich was anything but “fleeting, casual, or accidental but [rather] central to his philosophical enterprise.”
This “revelation” — that the greatest philosophical mind of the 20th century had been a devoted Hitlerite — provoked a worldwide scandal.
In the year following Farìas’ work, at least seven books appeared on the subject.
The most impressive of these was by Hugo Ott, a German historian, whose Martin Heidegger: A Political Life (1994) lent a good deal of historically-documented substance to Farìas’ charges.
In the decades since the appearance of Farìas’ and Ott’s work, a “slew” of books and articles (no one is counting any more) have continued to probe the dark recesses of Heidegger’s scandalous politics.
Almost every work in the vast literature devoted to Heideggerian philosophy must now, in testament to the impact of these studies, begin with some sort of “reckoning” with his “Nazism” — a reckoning that usually ends up erecting a wall between his philosophy and his politics.
In this context, Emmanuel Faye’s book is presently being touted as the “best researched and most damaging” work on Heidegger’s National Socialism — one that aims to tear down the wall compartmentalizing his politics and to brand him, once and for all, as an apologist for “the greatest crime of the 20th century.”
It’s fitting that Faye, an assistant professor of philosophy at the University of Paris-Nanterre, is French, for nowhere else have Heidegger’s ideas been as influential as in France.
Heidegger began appearing in French translation as early as the late 1930s. The publication in 1943 of Jean-Paul Sartre’s Being and Nothingness, based on a misreading of Heidegger, gave birth to “existentialism,” which dominated Western thought in the late 1940s and 1950s, helping thus to popularize certain Heideggerian ideas.
At the same time, French thinkers were the first to pursue the issue of Heidegger’s alleged National Socialism.
Karl Löwith, one of the philosopher’s former Jewish students exiled in France, argued in 1946 that Heidegger’s politics was inseparable from his philosophical thought. Others soon joined him in making similar arguments.
Though Löwith’s critique of Heidegger appeared in Les Temps Modernes, Sartre’s famous journal, the ensuing, often quite heated, French controversy was mainly restricted to scholarly journals. Faye’s father, Jean-Pierre Faye, also a philosopher, figured prominently in these debates during the 1960s.
It was, though, only with Farìas and Ott that the debate over Heidegger’s relationship to the Third Reich spread beyond the academic journals and touched the larger intellectual public.
This debate continues to this day.
Part of the difficulty in determining the exact degree and nature of Heidegger’s political commitment after 1933 is due to the fact that Heidegger’s thought bears on virtually every realm of contemporary European intellectual endeavor, on the right as well as the left, and that there’s been, as a consequence, a thoughtful unwillingness to see Heidegger’s National Socialism as anything other than contingent — and thus without philosophical implication.
This unwillingness has been compounded by the fact that the Heidegger archives at Marbach are under the control of Heidegger’s son, Hermann, who controls scholarly access to them, hindering, supposedly, an authoritative account of Heidegger’s thinking in the period 1933-1945.
Moreover, only eighty of the planned 120 volumes of Heidegger’s Gesamtausgabe have thus far appeared and, as Faye contends, these are not “complete,” for the family has allegedly prevented the more “compromising” works from being published.
The authority of Faye’s Heidegger — which endeavors to eliminate everything separating his politics from his philosophy — rests on two previously unavailable seminars reports from the key 1933-34 period, as well as certain documents, letters, and other evidence, which have appeared in little known or obscure German publications — evidence he sees as “proving” that Heidegger’s “Nazism” was anything but contingent — and that this “Nazism” was, in fact, not only inseparable from his thought, but formative of its core.
On this basis, along with Heidegger’s collaboration with certain NSDAP thinkers, Faye claims that the philosophy of the famous Swabian is so infused with National Socialist principles that it ought no longer to be treated as philosophy at all, but, instead, banned as “Nazi propaganda.”
Two.
Faye’s Argument
Heidegger’s seminars of 1933 and 1934, in Emmanuel Faye’s view, expose the “fiction” that separates Heidegger’s philosophy from his politics. For these seminars reveal a brown-shirted fanatic who threw himself into the National Revolution, hoping to become Hitler’s philosophical mentor.
At the same time, Faye argues that Heidegger’s work in the 1920s, particularly his magnum opus, Being and Time (1927), was already infected with pre-fascist ideas, just as his postwar work, however much it may have resorted to a slightly different terminology, would continue to propagate National Socialist principles.
Earlier, however, when the young Heidegger was establishing himself in the world of German academic philosophy (the 1920s), there is very little public evidence of racial or anti-Jewish bias in his work. To explain this, Faye quotes Heidegger to the effect that “he wasn’t going to say what he thought until after he became a full professor.” His reticence on these matters was especially necessary given that his “mentor,” Edmund Husserl, was Jewish and that he needed Husserl’s support to replace him at Freiburg.
(For those militant Judeophobes who might think this is somehow compromising, let me point out that Wilhelm Stapel [1882-1954], after also doing a doctorate in Husserlian phenomenology, was a Protestant, nationalist, and anti-Semitic associate of the Conservative Revolution who played an important early role in NSDAP politics.)
Faye nevertheless claims that Heidegger’s early ideas, especially those of Being and Time, were already disposed to themes and principles that were National Socialist in nature.
In Being and Time, for example, Heidegger rejects the Cartesian cogito, Kant’s transcendental analytic, Husserlian phenomenology — along with every other bloodless rationalism dominating Western thought since the 18th century — for the sake of an analysis based on “existentials” (i.e., on man’s being in the world).
Like other intellectual members of Hitler’s party, Heidegger disparaged all forms of universalist thought, dismissing not only notions of man as an individual, but notions of the human spirit as pure intellect and reason.
In repudiating universalist, humanist, and individualist thought associated with liberal modernity, Faye’s Heidegger is seen not as contesting the underlying principles of liberal modernity, which he, as a former Catholic traditionalist, thought responsible for the alienation, rootlessness, and meaninglessness of the contemporary world. Rather he is depicted as preparing the way for the “Nazi” notion of an organic national community (Volksgemeinschaft) based on racial and anti-Jewish criteria.
Revealingly, this is about as far as Faye goes in treating Heidegger’s early thought. In fact, there is very little philosophical analysis at all of Being and Time or any other work in his book. Every damning criticism he makes of Heidegger is based on Heidegger’s so-called affinity with National Socialist themes or ideas — or what a liberal defending a Communist would call guilt by association.
Worse, Faye lacks any historical understanding of National Socialism, failing to see it as part of a larger anti-liberal movement that had emerged before Hitler was even born and which influenced Heidegger long before he had heard of the Führer.
For our crusading anti-fascist professor, however, the anti-liberal, anti-individualist, and anti-modern contours of Heideggerian thought are simply Hitlerian — because of their later association with Hitler’s movement — unrelated to whatever earlier influences that may have affected the development of his thought. Q.E.D.
Faye, though, fails to make the case that Heidegger’s pre-1933 thought was “Nazi,” both because he’s indifferent to Heidegger’s philosophical argument in Being and Time, which he dismisses in a series of rhetorical strokes, and, secondarily, because he doesn’t understand the historical/cultural context in which Heidegger worked out his thought.
More generally, he claims Heidegger negated “the human truths that are the underlying principle of philosophy” simply because whatever doesn’t accord with Faye’s own liberal understanding of philosophy (which, incidentally, rationalizes the radical destructurations that have come with the “Disneyfication, MacDonaldization, and globalization” of our coffee-colored world) is treated as inherently suspect.
Only on the basis of the 1933-34 and ‘34-35 seminars does Faye have a case to make.
For the Winter term of 1933-34 Heidegger led a seminar “On the Essence and Concepts of Nature, History, and State.” If Faye’s account of the unpublished seminar report is accurate (and it’s hard to say given the endless exaggerations and distortions that run through his book), Heidegger outdid himself in presenting National Socialist doctrines as the philosophical basis for the new relationship that was to develop between the German people and their new state.
Like other National Socialists, Heidegger in this seminar views the “people” in völkisch terms presuming their “unity of blood and stock.”
Faye is particularly scandalized by the fact that Heidegger values the “people” (Volk) more than the “individual” and that the people, as an organic community of blood and spirit, excludes Jews and exalts its own particularity.
In this seminar, Heidegger goes even further, calling for a “Germanic state for the German nation,” extending his racial notion of the people to the political system, as he envisages the “will of the people” as finding embodiment in the will of the state’s leader (Führer).
Faye contends that people and state exist for Heidegger in the same relation as beings exist in relation to Being.
As such, Heidegger links ontology to politics, as the “question of all questions” (the “question of being”) is identified with the question of Germany’s political destiny.
Heidegger’s rejection of the humanist notion of the individual and of Enlightenment universalism in his treatment of Volk and Staat are, Faye thinks, synonymous with Hitlerism.
Though Faye’s argument here is more credible, it might also be pointed out that Heidegger’s privileging of the national community over the interests and freedoms of the individual has a long genealogy in German thought (unlike Anglo-American thought, which privileges the rational individual seeking to maximize his self-interest in the market).
The second seminar, in the Winter term of 1934-35, “On the State: Hegel,” again supports Faye’s case that Heidegger was essentially a “Nazi” propagandist and not a true philosopher. For in this seminar, he affirms the spirit of the new National Socialist state in Hegelian terms, spreading the “racist and human-life destroying conceptions that make up the foundations of Hitlerism.”
In both courses, Faye sees Heidegger associating and merging philosophy with National Socialism.
For this reason, his work ought not to be considered a philosophy at all, but rather a noxious political ideology.
Faye, in fact, cannot understand how Heidegger’s insidious project has managed to “procure a planetary public” or why he is so widely accepted as a great philosopher.
Apparently, Heidegger had the power to seduce the public — though on the basis of Faye’s account, it’s difficult to see how the political hack he describes could have pulled this off.
In any case, Faye warns that if Heidegger isn’t exposed for the political charlatan he is, terrible things are again possible. “Hitlerism and Nazism will continue to germinate through Heidegger’s writings at the risk of spawning new attempts at the complete destruction of thought and the extermination of humankind.”
Three.
Race and State

From the above, the reader might conclude that Faye’s Heidegger is a wreck of a book. And, in large part, it is, as I will discuss in the conclusion.
However, even the most disastrous wrecks (and this one bears the impressive moniker of Yale University Press) usually leave something to be salvaged. There are, as such, discussions on the subjects of “race” and “the state,” which I thought might interest TOQ readers.
A) Race
National Socialism, especially its Hitlerian distillation, was a racial nationalism.
Yet Heidegger, as even his enemies acknowledge, was contemptuous of what at the time was called “biologism.”
Biologism is the doctrine, still prevalent in white nationalist ranks, that understands human races in purely zoological and materialist terms, as if men were no different from the lower life forms — slabs of meat whose existence is a product of genetics alone.
Quite naturally, Heidegger’s anti-biologism was a problem for Faye, for how was it possible to claim that Heidegger was a “Nazi racist,” if he rejected this seemingly defining aspect of racial thought?
In an earlier piece (”Freedom’s Racial Imperative: A Heideggerian Argument for the Self-Assertion of Peoples of European Descent,” TOQ, vol. 6, no. 3), I reconstructed the racial dimension of Heidegger’s thought solely on the basis of his philosophy.
But Faye, who obviously doesn’t put the same credence in Heidegger’s thought, is forced, as an alternative, to historically investigate the different currents of NSDAP racial doctrine.
In his account (which should be taken as suggestive rather than authoritative), the party, in the year after the revolution, divided into two camps vis-à-vis racial matters: the camp of the Nordicists and that of the Germanists.
The Nordicists were led by Hans K. Günther, a former philologist, and had a “biologist” notion of race, based on evolutionary biology, which sought, through eugenics, to enhance the “Nordic blood” in the German population.
By contrast, the Germanists, led by the biologist Fritz Merkenschlager and supported especially by the less Nordic South Germans, held that blood implied spirit and that spirit played the greater role in determining a people’s character. (This ought not to be confused with Klages’ “psychologism.”)
The Germanists, as such, pointed out that Scandinavians were far more Nordic than Germans, yet their greater racial “purity” did not make them a greater people than the Germans, as Günther’s criteria would lead one to believe.
Rather, it was the Germans’ extraordinary Prussian spirit (this wonder of nature and Being) that made them a great nation.
This is not to say that the Germanists rejected the corporal or biological basis of their Volk — only that they believed their people’s blood could not be separated from their spirit without misunderstanding what makes them a people.
For the Germanists, then, race was not exclusively a matter of biological considerations alone, as Günther held, but rather a matter of blood and spirit.
(As an aside, I might mention that Julius Evola, whose idea of race represents, in my view, the highest point in the development of 20th-century racial thought, was much influenced by this debate, especially by Ludwig Ferdinand Clauss, whose raciology was a key component of the Germanist conception, emphasizing as it does the fact that one’s idea of race is ultimately determined by one’s conception of human being.)
Faye claims that, in a speech delivered in August 1933, Hitler emphasized the spiritual determinants of race, in language similar to Heidegger’s, and that he thus came down on the side of the Germanists.
The key point here is that, for Faye, the “völkisch racism” of the Germanists was no less “racist” than that of the biological racialists — implying that Heidegger’s Germanism was also as “racist.”
The Germanist conception, I might add, was especially well-suited to a “blubo” (a Blut-und-Boden nationalist) like Heidegger. Seeing man as Dasein (a being-there), situated not only in a specific life world (Umwelt), but in exchange with beings (Mitdasein) specific to his kind, his existence has meaning only in terms of the particularities native to his milieu, (which is why Heidegger rejected universalism and the individualist conception of man as a free-floating consciousness motivated strictly by reason or self-interest).
Darwinian conceptions of race for Heidegger, as they were for other Germanists in the NSDAP, represented another form of liberalism, based on individualistic and universalist notions of man that reduced him to a disembedded object — refusing to recognize those matters, which, even more than strictly biological differences, make one people unlike another.
Without this recognition, Germanists held that “the Prussian aristocracy was no different from apples on a tree.”
B) The State
As a National Socialist, Faye’s Heidegger was above all concerned with lending legitimacy to the new Führer state.
To this end, Heidegger turned to Carl Schmitt, another of those “Nazi” intellectuals, who, for reasons that are beyond Faye’s ken, is seen by many as a great political thinker.
In his seminar on Hegel, Heidegger, accordingly, begins with the 1933 third edition of Schmitt’s Concept of the Political (1927).
There Schmitt defines the concept of the state in terms of the political — and the political as those actions and motives that determine who the state’s “friends” and who its “enemies” are.
But though Heidegger begins with Schmitt, he nevertheless tries to go beyond his concept of the political.
Accepting that the “political” constitutes the essence of the state, Heidegger contends that Schmitt’s friend/enemy distinction is secondary to the actual historical self-affirmation of a people’s being that goes into founding a state true to the nation.
In Heidegger’s view, Schmitt’s concept presupposes a people’s historical self-affirmation and is thus not fundamental but derivative.
It is worth quoting Heidegger here:
There is only friend and enemy where there is self-affirmation. The affirmation of self [i.e., the Volk] taken in this sense requires a specific conception of the historical being of a people and of the state itself. Because the state is that self-affirmation of the historical being of a people and because the state can be called polis, the political consequently appears as the friend/enemy relation. But that relation is not the political.
Rather, it follows the prior self-affirmation.
For libertarians and anarchists in our ranks, Heidegger’s modification of Schmitt’s proposition is probably beside the point.
But for a statist like myself, who believes a future white homeland in North America is inconceivable without a strong centralized political system to defend it, Heidegger’s modification of the Schmittian concept is a welcome affirmation of the state, seeing it as a necessary stage in a people’s self-assertion.
Four.
Conclusion
From the above, it should be obvious that Faye’s Heidegger is not quite the definitive interpretation that his promoters make it out to be.
Specifically, there is little that is philosophical in his critique of Heidegger’s philosophy and, relying on his moralizing attitude rather than on a philosophical deconstruction of Heidegger’s work, he ends up failing to make the argument he seeks to make.
If Faye’s reading of the seminars of 1933-34 are correct, than Heidegger was quite obviously more of a National Socialist than he let on. But this was already known in 1987-88.
Faye also claims that Heidegger’s pioneering work of the 1920s anticipated the National Socialist ideas he developed in the seminars of 1933-34 and that his postwar work simply continued, in a modified guise, what had begun earlier. This claim, though, is rhetorically asserted rather than demonstrated.
Worse, Faye ends up contradicting what he sets out to accomplish. For his criticism of Heidegger is little more than an ad hominem attack, which assumes that the negative adjectives (”abhorrent,” “appalling,” “monstrous,” “dangerous,” etc) he uses to describe his subject are a substitute for either a proper philosophical critique or a historical analysis.
In thus failing to refute the philosophical basis of Heidegger’s National Socialism, his argument fails, in effect.
But even if his adjectives were just, it doesn’t change the fact that however “immoral” a philosopher may be, he is nevertheless still a philosopher. Faye here makes a “category mistake” that confuses the standards of philosophy with those of morality. Besides, Heidegger was right in terms of his morals.
Faye is also a poor example of the philosophical rationalism that he offers as an alternative to Heidegger’s allegedly “irrational” philosophy — a rationalism whose enlightenment has been evident in the great fortunes that Jews have made from it.
Finally, in insisting that Heidegger be banned because of his fascist politics, Faye commits the “sin” that virtuous anti-fascists always accuse their opponents of committing.
In a word, Faye’s Heidegger is something of a hatchet job that, ultimately, reflects more on its author’s peculiarities than on his subject.
Yet after saying this, let me confess that though Faye makes a shoddy argument that doesn’t prove what he thinks he proves, he is nevertheless probably right in seeing Heidegger as a “Nazi.” He simply doesn’t know how to make his case — or maybe he simply doesn’t want to spend the years it takes to “master” Heidegger’s thought.
Even more ironic is the scandal of Heidegger’s “Nazism” seen from outside Faye’s liberal paradigm. For in this optic, the scandal is not that Heidegger was a National Socialist — but rather that the most powerful philosophical intelligence of the last century believed in this most demonized of all modern ideologies.
But who sees or cares about this real scandal?
00:10 Publié dans Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : heidegger, national-socialisme, philosophie, livre, allemagne, révolution conservatrice, théorie politique, politologie, sciences politiques, anées 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 21 décembre 2009
L'autre signification de l'Etre
 Archives des SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
Archives des SYNERGIES EUROPEENNES - 1995
L'autre signification de l'Etre
Dr. Angelika WILLIG
De qui un homme comme Ernst Jünger se sent-il compris? Certainement pas par ses adversaires qui ne combattent en lui que sa seule projection élitaire et militariste. Mais il ne doit pas se sentir davantage compris de ses épigones, qui sont incapables de le suivre dans les méandres difficiles de sa pensée et qui, au contraire, cherchent la facilité en vouant un culte simpliste à leur idole. Que reste-t-il dès lors, sinon la “grande conversation des esprits” dont a parlé Nietzsche et qui, à travers les siècles, n'est animée que par des hommes isolés, importants et significatifs.
Il est très rare que de tels isolés engagent un dialogue. Ainsi, Ernst Jünger s'est adressé à Martin Heidegger, à l'occasion des 60 ans de ce philosophe de la Forêt Noire, en écrivant à son intention Über die Linie, un opuscule qui aborde “le grand thème de ces cent dernières années”: le nihilisme. Heidegger s'est senti tellement interpellé par ce texte qu'à son tour, il a consacré à l'écrivain un opuscule, également intitulé Über' die Linie, à l'occasion des 60 ans de l'auteur du Travailleur en 1955. Cette rencontre a été très prometteuse, on s'en doute. Mais elle n'a pas promis plus qu'elle ne pouvait tenir, surtout à ceux qui s'en faisaient des idées fausses. Et totalement fausse aurait été l'idée, par exemple, que Jünger et Heidegger avaient pris délibérément la résolution d'écrire à deux un manifeste commun, fondateur d'une “révolution conservatrice” à laquelle nous pourrions encore adhérer aujourd'hui. Telle n'était pas l'intention de Jünger et de Heidegger: ils sont trop intelligents et trop prudents pour oser de tels exercices.
Métaphysique
Jünger part du principe que le nihilisme constitue un défi pour l'individu. L'individu, ici, est bien l'individu et non pas une classe particulière, ou une race, un parti ou un mouvement. En d'autres termes: le nihilisme n'est pas un problème politique mais un problème métaphysique. C'est là la raison essentielle qui motive Jünger quand il s'adresse à Heidegger car celui-ci a vu que la question décisive réside dans la métaphysique et non pas dans l'économie, la biologie ou la psychologie. Dans ce domaine, Jünger est bien sur la même longueur d'onde que le philosophe de la Forêt Noire: tous deux acceptent le fait que l'évolution historique bute contre une limite et qu'il n'est plus possible d'aller au-delà. Telle est la signification de l'image de la “ligne”, que Heidegger reprend à son compte, sans doute en la transformant: tel est bien le diagnostic du nihilisme. Jünger nous en livre une description qui culmine dans cette phrase: . Le nihilisme est dès lors la perte de toute assise solide et de toute durée, sur lesquelles on pourrait encore construire ou reconstruire quelque chose.
On songe tout de suite aux “idées” et aux “valeurs”. Mais Jünger pense sans nul doute aux attaques en règle qui sont perpétrées contre une “base ultime”, une assise primordiale, que nous pourrions parfaitement interpréter dans un sens écologique aujourd'hui. Jünger nous parle du “moment où la rotation d'un moteur devient plus forte, plus significative, que la répétion, des millions de fois, des formules d'une prière”. Ce “moment”, qui pourrait bien durer cent ans ou plus, désigne l'illusion qui veut que toute perfection technique ne peut réussir que sur base de biens donnés par Dieu ou par la nature, biens dont nous dépendons existentiellement et surtout dont nous sommes nous-mêmes une partie. Le “néant” que la modernité nihiliste semble répandre autour d'elle, n'est donc pas néant, rien, mais est en vérité le sol, sur lequel nous nous trouvons, le pain que nous mangeons, et l'âme qui vit en nous. Si nous nous trouvons dans des “paysages arides, gris ou brûlés” (Jünger), il peut nous sembler que rien n'y poussera ni n'y fleurira jamais. Mais plus nos souvenirs des temps d'abondance s'amenuisent, plus forts seront le besoin et le désir de ce dont nous avons réellement besoin et de ce dont nous manquons. Heidegger ne songe à rien d'autre quand il définit la disparition, l'absence, par la présence, ou quand il voit dans la Verborgenheit (l'obscurité, l'occultement) une sorte de “dépôt de ce qui n'est pas encore dévoilé (dés-occulté)”. Car si nous considérons l'homme dans son existentialité, son Dasein, soit sa détermination par son environnement (Umwelt), alors son Etre (Sein) ne peut jamais être mis entièrement à disposition; dès lors, plus le danger le menace, plus grande est la chance d'une nouvelle appropriation. Heidegger appelle cela l'“autre commencement”.
Refus de la conception linéaire de l'histoire
Tous deux s'opposent donc à la conception linéaire de l'histoire, à la conception qui voit l'histoire comme une ligne droite, sur laquelle on ne peut qu'avancer ou reculer, partageant du même coup les esprits en “esprits progressistes” et en “esprits conservateurs”. Pour Heidegger comme pour Jünger la ligne est transversale. “Le franchissement de la ligne, le passage du point zéro”, écrit Jünger, “partage le jeu; elle indique le milieu, mais non pas la fin”. Comme dans un cercle, elle recommence sa trajectoire après une rotation, mais à un autre niveau. Heidegger parle ici de la nécessité d'un "retour” ou d'un “retournement” et non pas d'un “recul vers des temps déjà morts, rafraîchis à titre d'expérimentation par le truchement de formes bricolées”. Jünger, lui aussi, a toujours évité ce fourvoiement, ce que l'on ne peut pas dire de tous ses contemporains! “Le retour”, signifie pour Heidegger, le lieu ou la pensée et l'écriture “ont toujours déjà été d'une certaine façon”.
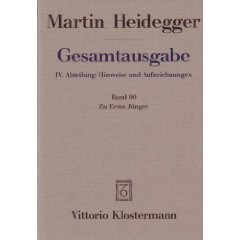 Heidegger estime aussi que “les idées s'embrasent” face à “cette image d'un sens unique”, impliquée par la ligne: c'est là que surgit la problématique du nihilisme —aujourd'hui nous parlerions plutôt de la problématique de la société de consommation ou de la société du throw away. Pourtant le philosophe émet une objection, qui est déjà perceptible dans une toute petite, mais très significative, transformation du titre: chez Jünger, ce titre est Über die Linie, et il veut désigner le franchissement de la ligne; chez Heidegger, c'est Über' die Linie. Il veut par l'adjonction de cette minuscule apostrophe expliciter à fond ce qu'est la zone, le lieu, de cette ligne. Ce qui chez Jünger est invite à l'action, demeure chez Heidegger contemplation. Il est clair que l'objet de la philosophie n'est pas de lancer des appels, mais d'analyser. Et Heidegger, bien qu'il critique fortement les positions de l'idéalisme platonicien, est assez philosophe pour ne pas laisser passer sans sourciller la volonté activiste de participation de l'écrivain, son vœu et sa volonté de dépasser aussi rapidement que possible le nihilisme.
Heidegger estime aussi que “les idées s'embrasent” face à “cette image d'un sens unique”, impliquée par la ligne: c'est là que surgit la problématique du nihilisme —aujourd'hui nous parlerions plutôt de la problématique de la société de consommation ou de la société du throw away. Pourtant le philosophe émet une objection, qui est déjà perceptible dans une toute petite, mais très significative, transformation du titre: chez Jünger, ce titre est Über die Linie, et il veut désigner le franchissement de la ligne; chez Heidegger, c'est Über' die Linie. Il veut par l'adjonction de cette minuscule apostrophe expliciter à fond ce qu'est la zone, le lieu, de cette ligne. Ce qui chez Jünger est invite à l'action, demeure chez Heidegger contemplation. Il est clair que l'objet de la philosophie n'est pas de lancer des appels, mais d'analyser. Et Heidegger, bien qu'il critique fortement les positions de l'idéalisme platonicien, est assez philosophe pour ne pas laisser passer sans sourciller la volonté activiste de participation de l'écrivain, son vœu et sa volonté de dépasser aussi rapidement que possible le nihilisme.
Sujet & Objet
Heidegger admoneste Jünger, et cette admonestation se justifie théoriquement. A juste titre, Heidegger pense: «L'homme non seulement se trouve dans la zone critique de la ligne, mais il est lui-même, non pas pour soi et certainement pas par soi seulement, cette zone et ainsi cette ligne. En aucun cas cette ligne est... telle qu'elle serait un tracé franchissable placé devant l'homme». En écrivant cette phrase, Heidegger se rapporte à une idée fondamentale de Sein und Zeit, jamais abandonnée, selon laquelle l'homme n'est pas un “sujet”, placé devant un “objet”, mais est soumis à une détermination existant déjà avant tout rapport sujet/objet. L', tel qu'évoqué ici, acquiert une signification si différente de celle que lui conférait la métaphysique traditionnelle, que Heidegger, dans son essai, biffe toujours le mot (Sein), afin qu'on ne puisse plus le lire dans le sens usuel.
Pour le philosophe, une telle précision dans les termes est absolument indispensable, mais, quand on lit l'écrivain, cette précision conduit à des mécompréhensions ou des quiproquos. Jünger, en effet, ne s'en tient pas à la terminologie forgée par Heidegger, mais raisonne avec des mots tels “valeur”, “concept”, “puissance”, “morale”, “décision” et reste de ce fait dans le “langage de la métaphysique” et surtout dans celui du “métaphycisien inversé” que fut Nietzsche. Pourtant, l'écrivain ne peut pas être jugé à l'aune d'une philosophie du sujet, manifestement dépassée. C'est cependant ce que Heidegger tente de faire. Mais son jugement pose problème quand on repère le passage où Jünger se rapproche le plus de cet “autre” dans sa formulation: . Une fois de plus, Heidegger, après avoir lu cette phrase, pose une question très précise: l'Etre peut-il être quelque chose pour soi? Et le philosophe de la Forêt Noire corrige: .
Jünger complète Heidegger
De telles remarques nous aident à mieux comprendre Heidegger, mais ne sont presque d'aucune utilité quand nous interprétons l'écriture de Jünger. Le philosophe nous dit bien que “de tels doutes ne peuvent nullement égratigner la force éclairante des images”, mais cela ne le conduit pas à un examen plus précis du langage de Jünger. Par coquetterie, Heidegger évoque la confusion et l'imprécision de Jünger mais reste, lui, ferme sur sa propre voie, dans sa propre logique de penser, et ne cherche pas à comprendre les autres possibles. Quand Heidegger constate: “Votre jugement sur la situation trans lineam et mon explication de linea sont liés l'un à l'autre”, il reste finalement assez laconique.
Quoi qu'il en soit, la position de Jünger complète la pensée de Heidegger. Nous avons dit, en début d'exposé, que le nihilisme était une attitude de l'individu: en effet, toute question métaphysique ne concerne que chaque individu personnellement. Aucun ordre socio-politique ne peut changer quoi que ce soit au fait que chacun d'entre nous soit exposé aux dangers du monde, soit soumis à l'angoisse que cette exposition, cette Ausgesetzheit, suscite. Voilà pourquoi cela ne fait pas une grosse différence —à ce sujet Jünger et Heidegger sont d'accord— si le nihilisme se présente à nous sous la forme ou l'expression d'une dictature fasciste, ou sous celle d'un socialisme réel ou d'une démocratie de masse. Dans de tels contextes, la démarche de Heidegger a été la suivante: Heidegger a travaillé sur l'isolement de l'homme avec une précision jusqu'alors inégalée, en utilisant tout spécialement les ressorts de la critique du langage; ensuite, sa philosophie a constitué une tentative de transposer l'angoissante dépendance du moi, soi-disant “libre”, dans une sorte de “sécurité” (Geborgenheit), site d'apaisement des tensions, site de sérénité, où s'épanouit enfin la vraie liberté. En opérant ce retournement, il nous semble, que Heidegger perçoit l'homme comme sur le point de disparaître, écrasé sous le poids d'un sombre destin planétaire, et donne l'impression de devenir fataliste.
Mais cela, Heidegger ne l'a pas voulu, et ne l'a pas dit de cette façon. Et c'est pourquoi, nous apprécions ce discours post-idéaliste de Jünger insistant sur la “force chevaleresque de l'individu”, sur sa “décision” et sur la volonté de l'homme libre de se maintenir envers et contre tout. Car si le moi n'est même plus autorisé à formuler des projets, il est contraint de résister à son propre “empêtrement”, résistance qui, seule, appelera le démarrage d'un nouveau mouvement historique.
“Le poète et le penseur habitent des sommets voisins”, a dit un jour Heidegger. Leurs demeures sont haut perchées mais séparées par un gouffre. C'est bien ce que nous avons pu constater en comparant les positions de Jünger et de Heidegger. Mais ne se pourrait-il pas que ce soit précisément ce gouffre qui fait tout l'intérêt de la rencontre Jünger/Heidegger. l'on délibère, dit Jünger dans Le recours aux forêts, un ouvrage très proche d'Über die Linie, .
Dr. Angelika WILLIG.
(article paru dans Junge Freiheit, n°12/1995; trad. franç.: Robert Steuckers).
00:09 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, ernst jünger, heidegger, métaphysique, révolution conservatrice, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 11 décembre 2009
Guillaume Faye: Pour en finir avec le nihilisme
 Archives de SYNERGIES EUROPEENNES
Archives de SYNERGIES EUROPEENNES
Guillaume FAYE:
POUR EN FINIR AVEC LE NIHILISME
I. METTRE LA PENSÉE EN ROUTE
Pour bon nombre de ses commentateurs, à l'exception notable de Jean-Michel Pahnier (1), Heidegger fut un métaphysicien donc l'ouvrage essentiel, Sein und Zeit (traduit en français par L'être et le temps), aurait tenté, en construisant une “phénoménologie de 1'òntologie” (2), de réfuter la tradition métaphysique par le langage métaphysique lui-mente et, partant, ne se serait pas exclu lui-même de la métaphysique. Dernier métaphysicien peut-être, mais métaphysicien quand même. Henri Arvon, de son été, écrit: “Le premier souci de Heidegger est moins l'établissement d'une ontologie formelle et matérielle que l'élaboration d'une ontologie fondamentale qui, à travers l'existence humaine, cherche à percer jusqu'à l'étre”. Il ajoute: “L'édifice doctrinal qu'il élève (..) constante une réponse de portée exceptionnelle à l'appréhension d'une époque éprise de rigueur scientifique qui, désespérée de voir s'estomper l'être, voudrait ramener celui-ci en pleine lumière” (3). Ce langage, en apparente si obscur, n'a certes pas servi Heidegger dans les milieux positivistes et rationalistes, qui ne voient en lui qu'un philosophe abscons ou, dans le meilleur des cas, un poète...
En fait, il semble bien qu'il y avait plusieurs lectures possibles de Heidegger. Dans Sein und Zeit, ouvrage où culmine la première étape de sa pensée, Heidegger nous dévoile les clés de son vocabulaire et l'orientation de sa réflexion. Mais, on le sait, celle étape a été suivie d'une seconde, à la suite d'un célèbre “tournant” (Kehre), qui a commencé de se manifester dans le courant des années trente. Notre lecture sera surtout rentrée sur ce “second” Heidegger, dont les préoccupations apparaissent dans tonte leur ampleur avec les écrits sur Hölderlin et sur Nietzsche. Toutefois, celle lecture ne sera pas purement “philosophique” - au sens classique de ce terme -, tant les horizons que nous dévoile Heidegger en appellent à tous les aspects de la vie et, mieux encore, à ce qu'il conviens de nommer notre destin. Heidegger, plus précisément, sera considéré par nous comme le penseur de la modernité. L'auteur des Holzwege s'est en effet attaché à penser l'essence des temps modernes, en partant du mot de Nietzsche: “Dieu est mort”. Or, la mort de Dieu, c'est la mort des valeurs. En sorte que l'on peut avancer que Heidegger termine la pensée métaphysique. La portée fondamentale de son oeuvre vient, en partie au moins, de ce qu'au XXème siècle, il a été le seul à poser et à répondre à la question capitale : “Quelle est l'essence des temps modernes?” (4). Qu'est-ce en effet que la “modernité”? D'où venons-nous? Que sommes nous advenus? Où pouvons-nous aller, nous, hommes et peuples du XXème siècle ? Telle nous semble être la problématique centrale posée par le “penseur-bûcheron”. Elle sente nous éclaire et nous permet d'expliquer quelques uns de ses thèmes et de ses idées que l'hypothèse métaphysique masque complètement.
Dans cette perspective, L'être et le temps, publié en 1927, ne constitue pas un ouvrage centrai ni définitif, mais un travail préliminaire, nécessaire à la compréhension de la suite de ouvre, une sorte de bilan introductif méthodologique à un “message” qui n'existait encore qu'à l'état de projet et de virtualité en 1927, alors que Heidegger n'avait que trente-neuf ans. En d'autres termes, L'être et le temps forme, non pas une somme de “phénoménologie existentielle”, somme 1'Université l'enseigne encore trop souvent (5), mais un exposé de concepts, de modes de pensée et d'un langage, qui ne prendront tout leur sens et leur portée qu'avec les ouvrages essentielles que sont, de notre point de vue, et dans un ordre d'importante croissante, les deux volumes consacrés à Nietzsche, publiés en 1961, le recueil intitulé Holzwege (“sentes de bûcheron”, traduit en français, en 1962, sous le titre Chemins qui ne mènent nulle part), paru en 1950, les textes divers, établis à partir de cours et de conférence, rassemblés en 1954 sous le titre Vorträge und Aufsätze (traduction en 1958, dans le volume Essais et conférences), enfin Die Frage nach der Technik, publié en 1962.
Dans L'être et le temps, livre qui fit grand bruit à l'époque, Heidegger pose les fondements de son langage et établit son champ conceptuel, les deux ne faisant d'ailleurs qu'un et constituant les deux faces d'un même outil intellectuel. Pour Heidegger, la pensée et le langage existent en effet en symbiose: qui saisit la clé de la langue peut de ce fait pénétrer dans son content ; la forme est déjà le fond. L'être et le temps nous initie dans au style heideggérien, qui se caractérise par trois traits principaux: le recours au langage poétique, l'utilisation de la philologie et de l'étymologie grecque, et le retour (le “retournement”, comme un laboureur retourne sa terre et de ce fait la redécouvre et la rend plus féconde) au sens originel de la langue allemande. Torturant, questionnant les mots, Heidegger s'offre comme un poète, dans l'acception hellénique du terme, c'est-à-dire comme un créateur de formes. L'effet de surprise et d'illumination, né du choc de ce langage étymologique” germano-grec et d'un style d'une modernité sans réserve, ne doit rien à une gratuité d'esthète: la langue heideggérienne est belle parce que dense; elle est signifiante parce que poétique, c'est-à-dire créatrice (6). Heidegger est de ceux qui, au détour d'un raisonnement difficile, l'interrompt pour l'illuminer d'une phrase telle que celle-ci: “Debout sur le roc, l'œuvre qu'est le tempe ouvre un monde et, en même temps, le réinstalle sur la terre qui, alors seulement, fait apparition comme le sol natal” (Chemins qui ne mènent nulle part, op. cit., p. 32). Voilà donc ce à quel nous accoutume L'être et le temps: à une parole aristocratique, qui ne se contente pas de nous expliquer une idée par la raison intellectuelle (Geist), mais entend nous la faine éprouver par la sensibilité poétique (Seele).
Le recours à l'étymologie indo-européenne, actualisée dans les langues grecque et allemande, n'est pas neutre: cette méthode renvoie à la volonté de Heidegger de réenraciner l'histoire moderne dans l'aurore grecque. Le verbe heideggérien, expérimenté dans L'être et le temps, est censé provoquer un “choc culturel” dans le lecteur.
Heidegger entend renouer avec un style et, au-delà, avec une vue du monde qui formerait le prélude a une régénération, sous une autre forme, d'un mode d'être et de périr “grec”, c'est-à-dire non-socratique et a-chrétien. Après Nietzsche, Heidegger se pensait comme un Dichter (poète, “in-dicateur”), annonçant un monde à venir, un monde virtuel, qui renouerait, sous une nouvelle forme “historienne”, avec ce qui constitue, pour nous Européens, notte aube : la vue du monde grecque, aujourd'hui paradoxalement “présente mais tombée dans l'oubli”. La Dichtung (le dict, la parole) de Heidegger nous provoque (provocare, en latin, signifie “appeler”) à “sortir de I'oubli”, à faire ressurgir au niveau de l'autoconscience, une vue du monde que nous avons héritée des Anciens et à l'asseoir au sein même du monde moderne. De cette rencontre, “quelque chose” naîtra.
En dehors de la présentation de la “parole grecque”, L' être et le temps présente un corps conceptuel qui restera inchangé tout au long de I'œuvre du penseur, et qui nous indique quel sens il nous faudra donner - et ne pas donner - à la “question de l'être” (Seinsfrage), qui est l'un des thèmes centraux de la pensée heideggérìenne. L'être et le temps expose que cette “question” est demeurée dans 1'oubli, qu'elle est tombée en déchéance (Verfall) depuis l'aube grecque de la pensée occidentale. Toute la métaphysique occidentale depuis Platon, Plotin, Aristote et Thomas d'Aquin, a envisagé la “question de l'être” comme un acquis. Elle a cru que l'être existait “en soi” et a cherché à révéler set “être en soi” comme une essence absolue en partant, selon l'induction platonicienne, de ses modalités “inférieures”, c'est-à-dire de l'étant. Ce faisant, l'étant, autrement dire le réel, demeure méconnu. “Il y a une invasion de l'étant non pensé en son essence”, écrit Heidegger. Le penseur se dégage ainsi de la vision du monde liée à la métaphysique monothéiste et impose une “anti-métaphysique” où la question de l'être est recentrée sur le Dasein, 1' “être-là” - renouant par là avec la conception des Grecs présocratiques pour qui, face au destin (Moïra), l'homme était la “loi du monde” (anthropos o nomos tou kosmou). Ainsi l'“oubli de l’être” est-il l'oubli de la réalité du monde, de “la différenciation ontologique, ce qui sépare l'étant de l'être”. La métaphysique platonicienne, puis chrétienne, est une “pensée déchue” qui se réfugie dans la philosophie des valeurs, qui élève une morale absolutiste, une idée au-dessus de l'être, autrement dit, qui dévalue la vie en “inventant”, au-dessus du réel, des catégories absolues, fallacieusement appelées “être”. Nietzsche, lui aussi, parte de la “séparation socratique de la pensée et de la vie”. Mais, grâce à la méthode phénoménologique, Heidegger va plus loin. Il démonte la mécanique de la métaphysique occidentale et prépare un dessein “scandaleux”, impensable pour l'humanisme traditionnel embué de “transcendantalisme moral”, consistant à valoriser le Dasein et à apporter de la spiritualité au sein de l'immanence du monde, selon le vieux projet inachevé du paganisme grec et présocratique.
L'être et le temps se contente donc de poser cette problématique. Nous voyons la preuve de la justesse de cette interprétation dans les explications fournies plus tard par Heidegger lui-même dans sa Lettre sur l’humanisme (op. cit.). Il nous semble donc impossible de ne voir, dans L'être et le temps, à l'instar d'Emmanuel Levinas (En découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger, Vrin, 1949), qu'une continuation de la pensée de Husserl ou qu'une tentative de “retrouver l'être” et d'établir une “métaphysique épurée”, comme l'imagine en général la tradition universitaire française. (On n'encense d'ailleurs bien souvent, dans l'Université, œuvres de Heidegger que pour en occulter radicalement la signification).
Plus que Husserl, qui ne lui a fourni que des outils conceptuels, utilisés d'ailleurs au rebours des principes du vertueux phénoménologue, le vrai “maître” de Heidegger est Nietzsche. Heidegger s'impose, non comme le “disciple”, mais comme le continuateur de Nietzsche, ce qui ne l'empêche d'ailleurs pas de faire une critique, parfois vive, de la pensée de l'auteur du Zarathoustra. Heidegger, en fait, reprend la question des valeurs là où Nietzsche I'avait laissée, mais il la “traite” avec des outils plus raffinés, qui sont précisément ceux dont L’ être et le temps a jeté les bases. Désormais, on ne pourra plus lire Nietzsche sans recourir ensuite à Heidegger, ni entendre Heidegger sans s'être d'abord familiarisé avec le projet de l'homme de Síls-Maria. (Le philosophe néochrétien Maurice Clavel ne s'y était d'ailleurs pas trompé).
Deux oeuvres de Heidegger sont ici surtout concernées: le livre sur Nietzsche, déjà cité, et surtout l'essai intitulé Nietzsche Wort “Gott ist tot” (traduit sous le titre Le mort de Nietzsche: “Dieu est mort”) (7), texte étable après la seconde Guerre mondiale à partir du content des cours sur Nietzsche prononcés à l'université de Fribourgen-Brisgau entre 1936 et 1940.
Arrêtons-nous d'abord à une métaphore empruntée à l'introduction du recuiel intitulé Holzwege (op. cit.). Heidegger y écrit énigmatiquement: “... Dans la forêt, il y a des chemins qui, le plus souvent, se perdent soudain, recouverts d'herbes, dans le non-frayé. On les appelle Holzwege (8). Chacun suit son propre chemin, mais dans la même forêt. Souvent, il semble que l'un ressemble à l'autre. Mais ce n'est qu'une apparente. Bucherons et gardes s'y connaissent en chemins. Ils savent ce que veut dire s'engager sur un Holzweg”. En effet, ceux qui se soucient de la forêt, ceux qui 1'habitent, ceux qui ont rebours à elle, ne s'égarent pas quand ils empruntent un tel sentier; celui-ci les conduit tout droit au lieu de leur travail. Par contre, tous ceux à qui la forêt est étrangeté, tous ceux pour qui elle est un obstacle, les marchands, par exemple, qui doivent la contourner en allant de ville en ville, ceux-là craignent par-dessus tout de s'engager sur un Holzweg, où ils ne pourraient que s'égarer. Cette métaphore de la forêt nous semble essentielle pour comprendre le processus d'élaboration de la conception du monde inaugurée par Nietzsche, continuée par Heidegger, et toujours ouverte aujourd'hui du faire même de son inachèvement. Nietzsche, dirons-nous, est celui qui a compris que l'on ne doit ni contourner la forêt ni la traverser de part en part, mais au contraire s'y perdre par une sente de bûcheron, afin de s'y retrouver dans la clairière où s'accomplit le “travail”, Heidegger nous disant, lui, quel sentier prendre.
II. L'APOGÉE DU NIHILISME
« Dio è morto. Muette est devenue la confiance dans les lois éternelles des dieux. Les statues sont maintenant des cadavres dont l’âme s'est enfuie, les hymnes sont des morts que la fin a quittes » (Hegel, Phénoménologie de l'esprit).
D'après Heidegger, l'œuvre de Nietzsche clôt la métaphysique occidentale. Le mot fondamental de Nietzsche, "Dieu est mort", nomine la destinée de vingt siècles d'histoire occidentale. Cette destinée doit être interprétée somme la lente et inexorable montée du nihilisme, c'est-à-dire la mort de toute valeur. On petit discuter sur la question de savoir si Heidegger a eu ou non raison de voir en Nietzsche le dernier des métaphysiciens (9).
Mais ce qui importe, c'est de reconnaître que la lecture heideggérienne de Nietzsche, la reconnaissance de la signification historienne de son oeuvre, sont les seules possibles.
Dans Le gai savoir, au paragr. 125, intitulé “Le forcené”, Nietzsche signe l'un de ses textes les plus importants. Il y reconnaît, le premier, l'événement considérable qui termine un processus entamé avec Platon: le meurtre de Dieu. “Où est allé Dieu? Je vais vous le dire, hurle le forcené. Nous l'avons tué”. Il poursuit: “Ne sentons nous toujours rien de la décomposition divine? Car les dieux aussi se décomposent (...) Quels jeux sacrés nous faudra-t-il désormais inventer ? La grandeur de cet acte n'est-elle pas trop grande pour nous? Ne sommes nous pas forcés de devenir nous-mêmes des dieux? (...) Il n'y eut jamais acte plus grandiose, et ceux qui pourront naître après nous appartiendront, à cause de cet acte, à une histoire plus élevée que ne le fut jamais tonte histoire”.
Nietzsche est ici l'annonciateur de cette autre histoire, qui peut s'interpréter comme la virtualité d'un surhumanité. Heidegger, lui, est le premier philosophe à pénétrer dans cette autre histoire, le premier, après la découverte du cadavre de Dieu, à en tirer les conséquences. “Je viens trop tôt, disait le forcené. Mon temps n'est pas encore advenu. Cet événement est encore en route. 11 n'est pas encore parvenu jusqu'aux oreilles des hommes”. La mort de Dieu doit ainsi se comprendre, non comme un “événement philosophique”, mais comme un phénomène historique qui pénètre l'ensemble des sociétés occidentales, un événement qui transformera la vie au sens le plus authentique du terme. La mort de Dieu, processus d'achèvement, d'arrivée à terme d'une vue du monde, doit s'interpréter comme “la fin du monde suprasensible, du domaine des idées et des idéaux”. Heidegger précise: “Depuis Platon, et plus exactement depuis l'interprétation hellénistique et chrétienne de la philosophie platonicienne, ce monde suprasensible est considéré comme le vrai monde, le monde proprement réel. Le monde sensible, au contraire, ne sera plus qu'un ici-bas, un monde changeant, donc purement apparent et irréel. L'ici-bas est une vallée de larmes. (...). Ainsi, le mot “Dieu est mort” signifie: le monde suprasensible est sans pouvoir efficient. Il ne prodigue aucune vie. La métaphysique, c'est-à-dire la philosophie occidentale comprise comme platonisme, est à son terme”.
La mort de Dieu désigne aussi l'impossibilité de croire aux idéaux absolus, que ceux-ci soient ou non liés à une “divinité”. Elle ne peut donc s'interpréter sous l'angle restreint d'un déclin des sentiments religieux. Elle sedia en fait la phase ultime du nihilisme. “Le nihilisme, le plus inquiétant de tous les hôtes, est devant la porte”, dit Heidegger. Le nihilisme marque la fin de la possibilité de toute valeur. L'humain est placé face au néant, privé “d'un monde suprasensible à pouvoir d'obligation”. “Le nihilisme est un mouvement historique. Il meut l'histoire à la manière d'un processus fondamental à peine reconnu dans la destinée des peuples d'Occident (...) Ni phénomène historique parmi d'autres, ni courant spirituel qui se rencontrerait à côté d'autres courants spirituels (...) le nihilisme est bien plutôt, pensé en son essence, le mouvement fondamental de l'histoire en Occident. Il manifeste une telle importance de profondeur que son déploiement ne saurait entraîner d’autre chose que des catastrophes mondiales. Le nihilisme est le mouvement universel des peuples de la terre engloutis dans la sphère de puissance des temps modernes (...) I1 appartient au caractère inquiétant de ce plus inquiétant des hôtes de ne pas pouvoir nommer sa propre origine (...) Il est la destination de notre propre histoire” (10). Heidegger reconnaît dans Nietzsche celui qui a mis au jour ce processus historique en acte depuis des millénaires: l'agonie des valeurs, la lente perte de sens des idéaux spirituels.
Il ne faut surtout pas croire, comme on l'enseigne dans nos facultés de philosophie, que Heidegger condamne le nihilisme. Heidegger semble au contraire se féliciter de cette remontre des temps modernes et du nihilisme, d'où seule pourra natter un nouveau projet. I1 accepte pleinement les temps modernes comme nihilistes: “Nietzsche se rend compte que, malgré la dévalorisation des plus hautes valeurs pour le monde, ce monde lui-même continue, et que, ainsi dépourvu de valeurs, il tend inévitablement à une nouvelle institution de valeurs (...) Pour fonder la nouvelle institution de valeurs en tant que mouvement contre les anciennes valeurs, Nietzsche donne également le nom de nihilisme (...) Ainsi, le terme de nihilisme désigne d'abord le processus de dévalorisation des anciennes valeurs, mais, en même temps aussi, le mouvement inconditionnel contre la dévalorisation (...) Nietzsche alors accepte le nihilisme et le professe comme inversion de la valeur de toutes les valeurs antérieures”. Nietzsche se place à la charnière de deux mouvements historiens, l'un en achèvement, l'autre virtuel. Il annonce l'apogée, donc le mouvement terminal du nihilisme, tandis que Heidegger, par son oeuvre, inaugure l'après-nihilisme.
Le nihilisme ne peut se limiter à l'affaissement de la foi chrétienne ou à la généralisation d'un vulgaire athéisme. Le christianisme lui-même, dans tonte l'explosion de sa foi triomphante, fut une phase du nihilisme. Ce dernier est l'engeance de la métaphysique platonicienne et chrétienne, où il résidait, virtuellement présent, dès sa fondation. Toute la métaphysique occidentale portait avec elle, sans s'en douter, le nihilisme. Ainsi, si l'opinion chrétienne (ou humaniste) ne prend pas conscience du nihilisme dont elle est porteuse - en tant que devenir (Werden) -, elle ne saisit pas non plus que ce principe nihiliste, qui constitue son essence, sera celui-là même qui permettra d'en finir avec la métaphysique chrétienne ou les valeurs athées de l'humanisme qui sont, au fond, une seul et même chose. Les “valeurs” christiano-platoniciennes, mortes-vivantes aujourd'hui, ont porte en élis leur propre principe de mort (11). Pourquoi ? Ecoutons la réponse de Heidegger: “Les valeurs suprêmes se dévalorisent déjà, dans la mesure où l'on commence à entrevoir que le monde idéal n'est guère susceptible d'être jamais réalisé dans le monde réel et sensible”. La conception du monde qui, en rupture avec l'aurore grecque, a séparé la pensée (noésis) de la nature vivante (physis), et celle-ci de l'action (poiésis), a virtuellement dévalorisé les principes qu'elle posait. Ces principes (Dieu, le Beau, le Vrai, le Bien), qui, de la théologie à l'humanisme socialiste, représentent des principes fixes et supérieurs, d'essence suprasensible, ont été depuis toujours condamnés à périr, dans la mesure même où ils se dé-réalisaient en se présentant comme des essences. Avec quelle jubilation, alors, ne doit-on pas constater ce mouvement historique du nihilisme, principe en acte contre lui-même, antidote posé par la vie contre la métaphysique et la morale qui, à leur insu, vont mourir de ce combat qu'elles ont voulu livrée contre le monde sensible! Ce monde sensible des passions et des guerres, ce “théâtre” de la “folie humaine” que Platon nous décrit comme une “caverne d'ombres” (aggalmata), finira par avoir raison des principes et des universaux, figés dans i'absolutisme de pseudo-valeurs qui n'ont pas su se conformer à la vie et qui, de ce fait, sont devenues, elles, des ombres.
Le nihilisme doit être ainsi considéré avec un sentiment à la fois triomphal et tragique. Il n'a rien d'une décadence. Il est la « loi même de notre histoire ». Même si nous savons que nous devons le dépasser, une telle entreprise surhumaniste a besoin que la mort de toutes les valeurs arrive à son terme. Heidegger s'engage déjà, en éclaireur - c'est-à-dire par la pensée, avant que n'advienne la phase “épochale” de l'action -, sur les sentes de l'après-nihilisme, alors que les temps modernes, toujours en apparence attachés aux principes traditionnels, accomplissent, dans les faits, la période ultime du nihilisme. Les principes et les valeurs, devenus résidus, sont bien morts puisqu'on n'y croit plus, mais personne n'ose encore aller enterrer le cadavre.
Heidegger s'oppose donc à l'humanisme traditionnel, non seulement sous la forme rationaliste et optimiste que les XVIIIème et XIXème siècles lui ont donnée, mais à jamais sous sa forme dogmatique d'affirmation de valeurs stabilisées. La norme des valeurs ne devrait pas relever d'une essence, mais de “l'inachèvement de l'existence humaine”, de son “dévoilement créateur”. C'est le Dasein humain qui doit se reconquérir comme mâitre des valeurs, indépendamment des “vérités” universelles exposées par les religions monothéistes et la métaphysique de Platon. A la suite de Nietzsche, Heidegger ne volt en fait, dans l'humanisme, que la présence d'une morale absolutiste où l'homme, pensé comme norme suprême, ne recèle aucune valeur mobilisatrice. Métaphysique déchue dans l'ici-bas, mais métaphysique tout de même, l'humanisme qui a cours en Europe depuis le XVIIIème siècle, avec sa cohorte de bons sentiments, marque le début de l'apogée du nihilisme. Cet humanisme, dit Heidegger, nous trompe, car il occulte le tragique de tonte existence; consolateur, il nie l'angoisse et, par la, rend impossible “le courage, l'audace et la lucidité”. “L'angoisse de l'audacieux, écrit Heidegger dans Qu'est-ce que la métaphysique?, ne souffre pas qu'on l'oppose à la joie, ni même à la jouissance facile d'une activité paisible”. Sentis un désirs d'éthique, issu d'une re-création volontaire de valeurs serait adapté à notre époque technique.
“L'homme de la technique, écrit Heidegger à Jean Beaufret, livré à l'être de masse (Massenwesen), ne peut plus être ramené à une continuité star et stable que s'il rassemble et coordonne la totalité de ses plans et de ses actes conformément aux exigences de cette technique”. Il faut rétablir un “tien éthique” entre l'aire humain pris dans son essence (Menschenwesen) et son monde, non plus selon des principes d'ordre universel et des absolus moraux, mais à partir d'une véritable “planification” de valeurs en rapport étroit avec le monde technique. Ces valeurs “éthiques” seront ouvertes, déplaçables, conformément aux qualités de l'existence humaine : l'inachèvement, qui caractérise le Dasein, et le dévoilement créateur de toute action, aujourd'hui porte par la technique.
“Comme Sein und Zeit s'élève contre l'humanisme, explique Heidegger, certains craignent que ce livre ne soit une défense de l'inhumain et une glorification de la brutalité barbare (...) Mais la pensée opposée aux valeurs n'affirme pas que toutes les valeurs habituellement professées comme telles, la “culture”, “l'art” (...) la “dignité humaine” et “Dieu” sont dépourvues de valeur. Il s'agit au contraire de comprendre enfin que c'est le faire même d'être qualifiées de valeurs qui dévalorise les objets de cette évaluation”. Autrement dit, en é-valuant les valeurs, on les ravale au rang de “logique”; on ne les vit plus. L'humanisme fait alors disparaître tonte valeur, selon un processus inauguré par les métaphysiciens: il proclame Dieu ou la dignité humaine comme valeur suprême incréé dans une hiérarchie rationnelle absolue, enferme l'humain dans un carcan et dévalorise tout sacré comme vécu. “Etre contre les valeurs, ajoute Heidegger, ne signifie pas être pour l'absence de valeurs et la nullité (Wertlosigkeit und Nichtigkeit) de l'étant, mais être contre la subjectivisation de l'étant qui ravale ce dernier au rang de single objet”.
Plutôt que de construire, par le logos, une morale reposant sur un systèm de valeurs comprises comme impératifs absolus, sans aucun “lien” avec l'“essence du monde”, il s'agit de planifier, d'organiser et de vivre une éthique volontariste. Le sacre et l'affectivité mobilisatrice du muyhos - opposée au logos des métaphysiciens - se retrouveront, parce que les valeurs implicites ne seront plus des mots, mais des comportements. Ceux-là devront s'enraciner dans un projet, en accord avec le monde et l'histoire. Un tel mouvement marquerait le passage de l'humanisme à ce que l'on pourrait qualifier de surhumanisme. Les valeurs seraient désormais vécues comme existence et non plus comme essence. Das Wesen des Daseins liegt in seiner Existenz, écrit Heidegger - phrase difficilement traduisible, car calquée sur le grue, mais que t'on peut rendre par “la spécificité fondamentale de l'être et du devenir humain, son essence, réside dans son existence” (12). Au plus profond de lui-même, l'humain est envol, transgression. L'homme est le transgresseur des normes: l'Existenz, ou, selon les conventions du traducteur, l'existence, traduit le concept latin exister, “vivre en se dégageant”. Les valeurs d'existence doivent être comprises, non plus comme des normes intellectuelles, mais comme des formes de vie (Lebensformen), jamais figées, perpétuellement évolutives, rigoureuses parce que volontairement instaurées et susceptibles à tout moment d'être dépassées. L'éthique de la transgression (de l'homme par lui-même) succède à la morale de la transcendance (de l'homme par des principes). Le terme nietzschéen de “surhurnanisme” peut alors se comprendre comme le moment “épochal” où l'homme se reconnaît, enfin, comme un transgressant. Et c'est dans cette perspective qu'il faut entendre le meurtre de Dieu, annoncé par le “forcené” du Gai savoir.
La mort de Dieu coïncide avec le “commencement du néant”, c'est-à-dire “l'absence d'un monde suprasensible à pouvoir d'obligation”. Partir Heidegger, l'autorité disparue de Dieu succède celle du rationalisme et de la morale. Mais ceux-qui ne savent donner de sens à 1'existence. Le christianisme, surtout dans sa version humaniste, dévoile alors - événement considérable - qu'il n'était qu'un athéisme déguisé. C'est le platonisme qui a fini par avoir .raison du sacré: en repoussant celui-ci hors de la nature, dans le lointain d'une métaphysique hautaine, il a épuisé ce sentiment de lien religieux que les peuples préechrétiens éprouvaient au contact du monde. “Le but d'une félicité éternelle dans l'au-delà, écrit Heidegger (13), se change en celui du bonheur pour tous, dans l’ici-bas”. Or, ce nihilisme recèle aussi la virtualité de son propre dépassement, puisque “1'acte créateur - autrefois, le propre du Dieu biblique -; devient la masque distinctive de l'activité humaine”. Ce ne fut pas le christianisme qui donna l'impulsion originelle au nihilisme: ce fut la vision du monde métaphysique platonicienne. Les historiens corroborent cette analyse: le platonisme constitua le “filtre” philosophique qui fit admettre un certain monothéisme biblique et conforma les structures mentales du christianisme occidental. “Le christianisme lui-même fut une conséquence et une forme du nihilisme”. Dans le christianisme, le suprasensible suit un processus de décomposition (Verwesung) et les “Idées, Dieu, l'Impératif Moral, le Progrès, le Bonheur pour tous, la Culture et la Civilisation perdent successivement leur pouvoir constructif pour tomber dans le nihilisme”. Le fait de poser ces valeurs en tant qu'abstractions, et le fait de poser Dieu comme valeur suprême les dévalorise déjà. Aussi, ne doit-on pas comprendre le nihilisme comme le résultat du seul monothéisme hébraïque (14), mais plutôt comme le refus de tout panthéisme manifesté par le platonisme comme par l’hébraïsme le sacré relégué loin du monde “naturel” et humain.
Heidegger essaie alors de répondre à la question de Nietzsche: quelles nouvelles tables de valeurs instituer? Mais avant de formuler une réponse, il lui a fallu préciser ce que nous devions entendre par cette tâche à entreprendre “1'inversion de la valeur de toutes les valeurs” (Umwertung aller Werte). Il ne s’agita pas en effet d'instituer de “nouvelles idoles”, de nouvelles valeurs abstraites. Le nihilisme actuel devra être accompli jusqu'à son terme pour que les nouvelles tables de valeurs naissent précisément là où les canons moraux contemporains voient le pire danger. Cette attitude est qualifiée par Nietzsche de pessimisme de la force. Nous entrons alors dans une période transitoire, ainsi décrite par Heidegger: “C'est le commencement d'une situation intermédiaire, où il devient manifeste que, d’une part, la réalisation des valeurs jusqu'ici reconnues comme suprêmes ne s'accomplit pas. Le monde semble dépourvu de toutes valeurs. D'autre part, cette prise de conscience dirige l'intelligente vers la source d'une nouvelle instauration de valeurs sans que, pour cela, le monde recouvre sa valeur”. Nous vivons ainsi dans l'interrègne, celui de la double conscience et de I'apogée du nihilisme les hommes de la première forme de conscience s'attachent toujours à leurs idéaux décomposés ; ceux de la sur conscience. héritiers lucides du nihilisme, annoncent une aube encore non advenue.
Cette aube sera-t-elle celle d'un nouveau dieu? L'originalité de Nietzsche est de répondre négativement. Dieu est mort: non seulement son trône est vide, mais l'idée même de trône est dévalorisée. Il ne s'agit pas tant de remplacer des valeurs que de trouver un autre lieu éthique où elles puissent s'exprimer. Ce lieu, on ne pourra le trouver que là où la métaphysique et la morale, là où le christianisme et l'humanisme voient une dévalorisation absolue. “Là”, c'est-à-dire au bout de ce que Nietzsche appelait le nihilisme complet, en ce lieu même où le néant est devenu absolu. Se contenter de “renouveler” les valeurs relève du nihilisme incomplet, ainsi comme par Heidegger: « Le nihilisme incomplet remplace les valeurs anciennes par des valeurs nouvelles, mais il continue à les placer au vieil endroit, qu'on réserve en quelque sorte comme région idéale du suprasensible. Un nihilisme complet, par contre, doit supprimer le lieu même des valeurs, le suprasensible en tant que région et, par conséquente, poser les valeurs autrement, c'est-à-dire inverser leur valeur », Ce nihilisme complet qui apparaîtra tel aux hommes de la conscience métaphysique et humaniste, sera déjà, pour ceux de la “sur conscience”, un anti-nihilisme. Ce qui, du point de vue de la première conscience, est néant, sera très exactement fondement de valeur pour la deuxième conscience. Mais où réside ce néant? Autrement dit, où résidera ce lieu de 1'inversion de la valeur des valeurs? Autrement dit encore, quel est le fondement du nouvel endroit des valeurs, qui est Aussi l'aboutissement du nihilisme complet? Répondre à cette question ne nous amènera pas non plus à parler de nouvelles valeurs. Lorsque, plus loin, nous les évoquerons, nous nous garderons de les nommer. Il s'agira bien plutôt d'inciter à les vivre, car, nous le verrons, ces valeurs-là ne sont pas intellectuellement nommables, puisqu'elles ne sont pas d'essence abstraites et suprasensibles.
Quel est donc l'endroit des nouvelles valeurs virtuelles? Avant de donner une réponse, il convient d'écouter la formulation que Heidegger a donné à cette question, non plus à la suite de Nietzsche, mais de Hölderlin.
Commentant l'hymne inachevé intitulé Mnémosyne, Heidegger en donne l'interprétation suivante dans Pour- Quoi des poètes ? “Long est le chemin de détresse de la nuit du monde. Celle-ci doit d'abord, longuement, accéder à son propre milieu”. (Cette nuit est celle de la progression historique du nihilisme). Il poursuit: “Au milieu de la nuit, la détresse du temps est la plus grande”. (Il s'agit de notre époque). “Alors l'époque indigente ne ressent même plus sa indigente”. (C'est là “l'oubli”, - (Vergessenheit) -, qui constitue la plus grande détresse de toutes les détresses). “La nuit du monde reste néanmoins à penser comme un destin qui nous advient endenté à du pessimisme et de l'optimisme, Peut-être la nuit du monde va-t-elle maintenant vers sa mi-nuit”. (C'est -a-dire vers le creux le plus profond, qui sera à la fois une cassure historique et un “départ”, - Aufbruch -, vers le post-nihilisme). “Peut-être cet âge va-t-il devenir pleinement temps de détresse”.
C’est donc à notre époque que se sine l'instant de la mi-nuit. De cet instant, s'il est reconnu, peut surgir la fondation de nouvelles valeurs. Hölderlin, comme Nietzsche, nous pose la question: où, à quelle croisée des chemins - pour reprendre le mythème de l'Oedipe de Sophocle à la poursuite de son destin -, en quel endroit historien de détresse absolue ou de nihilisme complet, trouverons-nous le chemin de la sortie? Où la nuit va-t-elle basculer vers le matin? Quelle est cette nuit du monde? La “minuit” recouvre ce que Nietzsche désigna pax fois, par antithèse, sous le nom de Grand Midi: la Volenté de puissance, et avec elle la Vie. Cette Vie qui cherchait précisément à fuir, au temps de sa jeunesse, de son non-accomplissement, le judéo-christianisrne. Cette vie, comme violente et comme volonté, qui explose dans les temps modernes : la non-valeur absolue, mais en mémé temps la table de nouvelles valeurs.
La métaphysique, anti-vitale sur le pian intellectuel, dès qu'elle posa des valeurs, fut soumise au devenir du vivant. Nietzsche et Heidegger comprennent ainsi ce processus de retournement dialectique: la métaphysique, bien que ses valeurs aient dévalorisé la Volonté de puissance et la vie, en constituait à sa insu une manifestation. Elle devait alors déboucher concrètement sur ce qu'elle refusait intellectuellement. La Volonté de puissance, comme nouvelle institution de valeurs, doit être comprise à la fois comme produit et comme inversion absolue de la métaphysique. Heidegger précise: “Le devenir, c'est, pour Nietzsche, la Volonté de puissance (...) qui est le trait fondamental de la vie (...) Le vivant se concentre en diverses formes, à chaque fois durables, de la Volonté de puissance”. Par suite, ces concentrations sont des “centrales de domination (...) La Volonté de puissance se dévoile comme ce qui pose des points de vue (...) Les valeurs sont les conditions de la Volonté de puissance, posées par la Volonté de puissance elle-même (...) La Volonté de puissance, en tant que principe reconnu est donc voulu, devient en même temps le principe d'une nouvelle institution de valeurs”. C'est la Volonté de puissance voulue, comme telle, conscience d'elle-même, qui constitue le nouveau fondement d'un mouvement historique de valorisation. Dans la mesure où cette Volonté de puissance coïncide avec le trait fondamental de la vie - le devenir risqué et changeant -, elle constitue pour la métaphysique un repoussoir intellectuel et correspond, dans la perspective christiano-humaniste, au néant. Cependant, cette même métaphysique, par sa recherche de valeurs essentialistes - indépassables et immuables - a charrié sans le vouloir la Volonté de Puissance, préparant inexorablement, selon ce processus du devenir vital qu'elle prétendait nier mais auquel elle se conformait, son destin, c'est-à-dire sa mort. La Volonté de puissance, ajouterons-nous, avant d'être voulue (condition pour de nouvelles tables de valeur), doit accéder à l'auto conscience. Or, nous le verrons plus loin, il ne suffit pas que la Volonté de puissance soit consciente pour qu'elle soit voulue. Depuis Heidegger, certains ont accédé à cette prise de conscience, mais ont reculé devant le stade du vouloir. Le chrétien, l'humaniste sincère, le socialiste moral, qui n'en sont qu'au “nihilisme incomplet”, n'ont pas atteint le niveau de conscience “historial” où ils reconnaîtraient la présence, en eux, comme dans les temps modernes sous une autre forme, de la Volonté de puissance.
Ainsi les anciennes valeurs manifestaient une Volonté de puissance inconsciente, qui les avait fondées, puis menées au nihilisme. Les “nouvelles institutions” de valeur seront radicalement autres, puisque, cette fois, elles procéderont d'une Volonté de puissance voulue et consciente. Cette nouvelle typologie de valeurs mènera-t-elle aussi à un nouveau nihilisme? C’est probable, et c'est ce qui fait la grandeur de l'Eternel retour de l'identique. Nietzsche et Heidegger, fidèles à la vue héraclitéenne du monde, ne prétendent pas se soustraire définitivement au nihilisme. Le devenir est perpétuel: après le nouveau “matin”, la conscience historiale trouvera le destin d'un autre “soir”, puis d'une nouvelle “nuit”. Mais nous ne pouvons en imaginer les modalités. Perpétuel est le processus de retournement dialectique (Umkehrung) des valeurs, non pas selon l'inapparente et peu paradoxale linéarité d'un cercle, mais à la manière inquiétante d'une spirale. (“Inquiétante”, car nous ne savons pas si la spirale est ascendante ou plongeante) (15).
Inquiétant aussi est le fondement voulu des nouvelles valeurs: la Volonté de puissance. Comme la Vie, elle s'ordonne constamment vers plus de puissance. Rien ne limite sa tension vers l'auto-croissance. Comme Oedipe, elle ira jusqu'au bout du destin. “Elle est ordre, écrit Heidegger, et, en tant qu'ordre, se donne le plein pouvoir pour dépasser dans la puissance tout niveau de puissance atteint (...) La Volonté de puissance est l'essence de la puissance (...) et l'essence de la Volonté de puissance est, en tant qu'essence de la volonté, le trait fondamental de l'ensemble du réel (...) La Volonté de puissance n'a pas sa fondement dans la sensation d'un manque: elle est elle-même le fondement de la vie la plus riche”.
La question qui se pose aux temps modernes, dès qu'une telle volonté est “historiquement” reconnue somme telle, est de savoir où elle réside. Où trouver cette Volonté de puissance qui marquera l'achèvement de la métaphysique, fondera une typologie de valeurs absolument contraire à celles de I'humanisme contemporain et sera, à ce titre, porteuse de sens? La réponse est simple. Ce sera là où réside le plus haut nihilisme, où la valorisation intellectuelle et métaphysique du monde a été poussée jusqu'à son terme, non seulement jusqu'a le nommer, mais jusqu'a se donner la possibilité de le détruire et de le métamorphoser matériellement: dans le règne scientifique de la puissance technique.
III. A LA RECHERCHE DE L'ESSENCE DE LA TECHNIQUE
Il ne faut donc plus chercher Dieu, ni substituer, à cette vaine quête des valeurs dans le suprasensible, une glorification de la raison ou de la morale, Ces chemins qu'emprunte l'humanisme ne nous ont mené qu'au nihilisme, et ils ne sauraient conduire plus loin les temps modernes. Notre époque est appelée par Heidegger à abandonner le “chemin des marchands” qui, “raisonnablement”, mène quelque part, c’est-à-dire vers ce que nous pouvons métaphoriquement qualifier de bourg, Le “chemin qui mène quelque part”, qui ne fait que contourner ou traverser, en l'ignorant, l'inquiétante forêt, nous ne savons que trop où il nous conduit: vers l’auberge du bourg où l'on se repose, où l'on dérobe à la vie quelques instants de bonheur, c'est à dire précisément vers le type (anti-)historique bourgeois. Nietzsche nous a dit, au contraire, qu'il fallait emprunter un de ses « chemins qui ne mènent nulle part » et qui sont aventureux, c'est-à-dire à la fois chargés de sacré et d'advenant - d'avenir -, un de ces Holzwege qui nous conduiront au cœur de la forêt, où nous attend, non pas le repos et le bonheur du bourgeois, mais notre travail. Nietzsche n'a pas indiqué quelle sente emprunter, parmi toutes celles qui sont possible Il a posé la question “Quelle valeur pour de nouvelles valeurs?” C'est-à-dire: quel type d’ « aventure » pour les temps modernes? Mais Nietzsche n'était pas, au stade de la culture européenne où il se trouvait, en état de répondre.
Heidegger, lui, inaugure la réponse. Il indique quelle sente emprunter et s'y engage lui-même. Mais le choc de sa réponse est si fort que peu, pour l'instant, ont su ou ont voulu en dévoiler et en reconnaître la portée.
Nous avons dit que la forêt appelait au travail, celai du bûcheron, dont la figure fascinante traverse l'oeuvre de Heidegger. A quoi renvoie le travail, en ces temps modernes ? Certainement pas à la vision réactionnaire, et donc nihiliste elle aussi, du modèle de l'artisan, mais à la technique moderne. Où trouver une nouvelle table des valeurs, interroge Nietzsche. Dans la technique moderne, répond Heidegger.
Pour comprendre comment la technique peut constituer un élément fondamental de réponse à la question des valeurs, Heidegger nous invite à méditer sur l'essence de la technique (“essence” étant entendue ici dans l'acception de “sens cache”). L'essence de la technique, précise-t-i1, n'a rien de technique. Nous, hommes des temps modernes, sommes “enchaînés” à la technique et, faussement, nous la croyons “neutre”. Alors nous demeurons aveugles face à la nature de notre civilisation technique: “Nous lui sommes livrés de la pire façon”. Nous ne saisissons de la technique moderne que son “aspect instrumental”, nous n'y voyons qu'un “ensemble de moyens réunis pour des fins”. Pour Heidegger, il s'agit là d'une conception vulgaire, “exacte mais non vraie” de la technique. Ce n'est donc pas la civilisation technique en elle-même que déplore Heidegger, mais cette perception que 1'on s'en fait, perception à cause de laquelle la technique nous aliène et nous “échappe”, en se retournant contre nous, en nous mécanisant et en nous réifiant. Il nous appartient donc de nous réapproprier la technique, d'en réinsérer la richesse dans notre monde. Et pour cela, une fois encore, il nous faut “retourner” aux Grecs.
Dans la Grèce antique, écrit Heidegger, téchnè ne désigne pas seulement le “faire” de l'artisan, mais aussi l'art au sens élevé du mot. La téchnè fait partie du pro-duire, de la poiésìs. Une “production technique” n'est pas seulement, alors, un processus instrumental et trivial. La pro-duction est l'acte par lequel le technicien-poète “fait voir au jour” (produire, producere : “faire venir”) un sens. La poiésis technique, que ce soit celle du savetier ou du sculpteur, se trouve en conformité avec la nature, avec la physis, qui, elle aussi, est une “production”. “La fleur, dit Heidegger, s'ouvre dans la floraison”. “Produire” signifies donc bien “faire venir” (veranlassen), “faire avancer du non-présent dans la présence” (hervorbringen). De son côté, la poiésis est marquée par la physis, en ce sens qu'en grec ancien, physein signifie aussi “se rendre présent”. La production technique doit donc aussi être interprétée comme l'art de cueillir, dans la matière, un non-sens pour le faire advenir en tant que sens: pro-duire, c'est recueillir, et aussi se recueillir. Enfin, pro-duire (her-vorbringen), revient à accomplir un acte qui présente (bringt vor) un “état caché” du monde et le dévoile. La production technique des Grecs doit donc s'entendre finalement comme dévoilement. “Les Grecs, écrit Heidegger, ont pour dévoilement le nom d'aléthéia, que les Romains ont traduit par veritas (...) Nous demandions ce qu'est la technique et sommes maintenant arrivés devant l'aléthéia, devant le dévoilement. En quoi l'essence de la technique a-t-elle affaire avec le dévoilement? Réponse: en tout. Car tout “produire” se fonde dans le dévoilement (...) Ainsi, la technique n'est pas seulement un moyen, elle est un mode de dévoilement, c'est-à-dire de la vérité” (Wahrheit).
Arrêtons-nous un instant. Heidegger nous invite à comprendre que les mots traduisent une vue du monde. Pour les anciens Grecs, le mot veritas, au sens universaliste de “certitude” que nous entendons aujourd'hui, était inconcevable. Le vrai, c'était, dans une perspective déjà “nominaliste”, le dévoilement par l’homme. L'aléthéia désigne ce qui est “tiré de l'oubli”. (Souvenons-nous du Léthé, le fleuve Oubli). Heidegger écrit: “La téchnè est un mode de l'alétheuein”. Il ajoute cette proposition fondamentale: “Elle dévoile ce qui ne se produit pas soi-même”. Qu'est-ce que cela veut dire? Alétheuein, verbe qui caractérise l'activité technique, signifie à la fois “faire apparaître comme vérité”, “être vrai” et “faire advenir au jour par dévoilement”. La technique est donc ici pensée comme vérité du-monde. Pour les Grecs, le monde n'est pas “vrai” hors de l'activité productrice. La “vérité du monde” ne réside pas dans son “essence”, mais dans l'acte pro-ductif de la technique qui crée et dévoile un sens. Nous saisissons alors ce que Heidegger entend par: “La technique dévoile ce qui ne se pro-duit pas soi-même”. De lui-même, le monde ne pro-duit, ne dévoile, ne révèle aucune valeur. Une telle vue du monde s'oppose radicalement à celle qui prévaudra plus tard et qui, à la suite de la métaphysique, mettra la valeur, le sens, la vérité, dans le monde en soi. L'activité technique sera alors dépouillée de sa connotation créatrice et poétique. Elle sombrera dans la pure instrumenta lité, et le mot “technique” ne sera plus synonyme d'art. La vérité, en passant de l'“art technique”, conçu par les Grecs comme dévoilement volontaire du monde, dont de sens, au “monde en soi” de la métaphysique occidentale, contribuera à la dévalorisation du réel - de l'étant - au profit du suprasensible, et à la vulgarisation du travail technique sur lequel pèsera la chappe de la mauvaise conscience.
Chez les Grecs, l'acte humain de production technique était seul porteur de vérité: il était seul “porteur de lumière” (lucem ferre). La technique était religieuse dans le paganisme grec: 1'àme et la spiritualité ne résidaient pas dans l'intellectualisme métaphysique, mais, plus fortement, au cœur du monde, dans le marbre « charnel » des temples ou dans l'évocation “érotique” de la statuaire. C'est que la technique était pensée, nous l'avons dit, comme profondément reliée à la nature, à la physis, source religieuse de tonte vie. L'acte technique était vécu comme une transposition du devenir-de-la-nature. Aujourd'hui encore, la floraison, les saisons, nous montrent qu'il n'y a pas d’ « être » naturel, mais un dévoilement et une production de formes (16). La technique est à la fois continuation de la nature et combat contre elle: d'où son caractère religieux. Elle s'envisage comme un mode de la nature et une meta-nature. La physis dévoile une forme, la poiésis de la technique dévoile de surcroît un sens. Le degré de “vérité”, par la technique, s'accroît. Il est frappant de constater à quel point cette conception du monde s’apparente à ce que nous enseigne la physique moderne sur 1'inanité de tonte “vérité du cosmos” ou sur l'illusion de pouvoir percer le secret d'une “essence du réel”, ce dernier n'étant lisible qu'en fonction de points-de-vue, de niveaux d'interprétations de projets techniques différents (17).
Heidegger nous insiste donc à tirer de l'oubli cette conception de la technique et à en revenir aux sources grecques, afin de comprendre à nouveau la vérité comme un acte de dévoilement du monde, de “désabritement (Entbergen) risqué”. Que les temps modernes se réinspirent de cette conception à la fois nominaliste et religieuse de la technique, et celle-ci pourra redevenir ce qu'elle fut à l'origine: poésie. Or, l'humanisme occidental, même à travers le rationalisme “scientiste”, aujourd'hui révolu, n'a évidemment jamais pensé de la sorte la technique. Dans le scientisme, cette dernière n'est perçue que comme un instrument du “progrès”, lequel s'apparente à la recherche humanitaire du bonheur - et notre époque se réfère toujours, plus ou moins consciemment, à certe conception dévalorisante de la nature, et donc de la technique. La nature comme réel (l'étant) est rejetée au profit d'un “monde” conçu comme loi, comme principe - métaphysique ou moral - trouvant la réalité de son essence indépendamment de la vie et de 1'action humaine. “L'Ancien Testament, qui rejette tonte philosophie, ne connaît pas la “nature”, remarque Daniel Bell (...) La religion biblique est basée sur la révélation, non sur la nature, et la morale sur la Halakha, c'est-à-dire sur la Loi” (18). Toute la conception “occidentale” de la technique, fondée sur cette lecture de la Bible, concevra à sa suite l'activité technique comme profane. On “subira” la technique; le travail technique sera conçu comme une souffrance, une obligation pénible (mais aussi rédemptrice), tandis que, dans la pensée grecque, ajoute Daniel Bell, “la nature (physis) est antérieure à la loi formelle (nomos). La nature est cachée et il faut la découvrir ; la loi doit prendre la nature pour guide”.
“Découvrir” la nature, la “dévoiler”, telle nous apparaît donc la mission de la technique. Mais “dévoiler” la nature, faire sortir de l'abri sa “vérité”, qu'est-ce que cela peut signifier, puisqu’aucune lui suprême, aucune vérité, aucun “bonheur” ne peuvent être mécaniquement découverts? La technique, en produisant à partir de la nature, va-t-elle en extraire quelque chose ? Quel sens la volonté technique va-t-elle créer et faine surgir? A ces questions, la notion de force va permettre de répondre.
Nous devons alors quitter les Grecs, et abandonner le domaine de la technè, pour entrer dans celui, beaucoup plus inquiétant, de la technique moderne, celle que Jünger avait appelé la technique planétaire. En effet, l'essence de la technique ne réside pas tout entière dans la «poiésis de la production dévoilant». Elle comporte les qualité de la téchnè, mais elle cache en elle bien plus encore. Et alors que les Grecs, dont la technique était quantitativement moindre que la nôtre, savaient la vivre, nous, hommes des temps modernes, qui détenons cette «technique motorisée», nous la profanons, nous la subissons comme un poids, nous passons à côté de sa richesse et de son mystère.
«C'est elle, précisément, la technique moderne, et elle seule, écrit Heidegger, qui est l'élément inquiétant qui nous pousse à demander ce qu'est la technique. On dit que la technique moderne est différente de toutes celles d'autrefois, parce qu'elle est fondée sur la science moderne, exacte, de la nature». Or, ajoute-t-il, «qu'est-ce que la technique moderne? Elle aussi est un dévoilement. Le dévoilement, cependant, qui régit la technique moderne ne se déploie pas en une pro-duction au sens de la poiésis. Le dévoilement qui régit la technique moderne est une pro-vocation (Heraus-fordern) par laquelle la nature est mise en mesure de livrer une énergie qui puisse, comme telle, être extraite (heraus-gefördert) et accumulée». Heidegger énonce ainsi l'idée d'un passage «historique» de la domestication de la «matière vivante» à la «matière-énergie». Le moulin à vent, l'éleveur ou l'agriculteur confient, par la technique, une production aux forces croissantes de la nature. Ils ne la pro-voquent pas, ne s'approprient pas son énergie. La technique moderne, au contraire, prend la nature dans «le mouvement aspirant d'un mode de culture (Bestellen) différent, qui requiert (stellt) la nature (…) Le «requérir» qui provoque les énergies naturelles est un avancement (ein Fördern). La technique moderne imprime à la nature un mouvement, dans lequel se lit le projet d'une volonté: l'énergie, dispersée à l'état naturel, est extraite, puis stockée, puis encore enfermée, pour se voir commise». Ainsi, la centrale électrique mise en place sur le Rhin. Ce dernier somme de livrer sa pression hydraulique, qui, à son tour, somme les turbines de tourner. «Le fleuve Rhin apparaît, lui aussi, comme quelque chose de commis. La centrale n'est pas construite dans le courant du Rhin comme le vieux pont de bois qui depuis des siècles unit une rive à l'autre. C'est bien plutôt le fleuve qui est muré dans la centrale d'énergie. Ce qu'il est aujourd'hui comme fleuve, il l'est de par l'essence de la centrale».
Afin de voir et de mesurer, ne fût-ce que de loin, l'élément qui domine ici, arrêtons-nous un instant sur l'opposition qui apparaît entre ces deux intitulés: «le Rhin mûré dans l'usine d'énergie» et «le Rhin», titre d'un hymne de Hölderlin. Heidegger signifie clairement ici que la technique moderne, parce qu'elle commet - plus que «domestique» - l'énergie naturelle, acquiert la prévalence sur la nature. Il s'agit là d'un événement d'une portée considérable, d'une rupture «historiale» (Zeit-Umbruch) que notre époque n'a pas encore comprise et admise. La force énergétique de la nature devient en effet de la volonté humaine. Inversement, la nature est transformée en technique. Le Rhin, comme l'électron, se confond avec la machine qui le commet. La technique ne «domestique» pas la matière-énergie naturelle, mais, bien plus, elle la fait advenir et se l'approprie jusqu’a se confondre avec elle. L'instrument mécanique se confond avec son objet «naturel». Dans la bombe atomique, ce qui, comme un soleil artificiel, explose, ce n'est pas l'uranium 235, mais bien l'hybride uranium-machine, cette machine qui finit par devenir l'énergie naturelle elle-même. Nous dirons alors que la technique moderne est devenue l'essence de la nature. Pour la première fois dans I'histoire, la poiésis (au sens d'action) s'est faite physis. La nature est rendue par la technique. Mais elle n'est pas rendue «transparente», car elle nous demeure toujours aussi obscurément mystérieuse. Elle n'est pas non plus «vaincue», comme le croit un scientisme vulgaire, car sa force est inépuisable. Elle est rendue plus présente. La présence de la nature «se rapproche» de nous et, avec elle, sa connotation sacrée. Paradoxe de la technique moderne: semblant nous «couper» de la nature, elle nous en rapproche, car elle nous rapproche de son énergie. En grec ancien, energeia voulait d'ailleurs dire «présence». L'énergie cachée dans la nature est «libérée, transformée, accumulée, répartie et commuée». La technique analysée comme un dévoilement qui provoque, est placée sous le signe de la «direction» et de l'assurance.
Mais ce «dévoilement de l'énergie», quelle est son essence? Que va receler, en son abîme, cette pro-vocation accomplie par la technique? Ce qui va apparaître, ce qui va sourdre, sous des déguisements divers, au cœur de cette «requête assurée» du monde naturel à laquelle se livre la technique moderne, n'est-ce pas ce qui, depuis des siècles, attendait d'apparaître, ce qui, à travers la métaphysique, s'était manifesté de manière refoulée et codée, ce que les Grecs eux-mêmes n'avaient pas su faire ad-venir à la présence, pour cause de limitation matérielle de leur propre téchnè? N'est-ce pas ce que Nietzsche avait découvert, exhumé de I'obscurité des siècles chrétiens, ce qu'il avait décelé dans la tragédie sous la forme mythique de Dionysos gouverné par Apollon, et qui, maintenant, pour la première fois dans 1'«ordre du temps» (tou chronou taxis), surgit physiquement et non plus symboliquement? N'est-ce pas la Volonté de puissance ?
Nous devons, dès à présent, nous demander comment la pensée de Heidegger en est arrivée à reconnaître, au cœur de la technique moderne, la Volonté de puissance. Répondre à cette question revient en effet à montrer ce qu'il ne faut pas entendre par «Volonté de puissance», à savoir une domination brutale ou une volonté d'asservissement. La technique, dit Heidegger, stabilise le monde qu'elle commet. Elle le place dans la position stable d'un fond (Bestand), d'un objet qui se tient «comme au garde à vous» face à l'ordre technique (Gegenstand). Hegel, en son temps, voyait dans la machine un «instrument indépendant», à l'instar d'un instrument artisanal. Heidegger, parlant de l'avion, en constate au contraire 1'«absolue dépendance» l'avion «tient son être uniquement d'une commission donne à du commissible». La nature se conçoit comme pourvoyeuse de capital. Ce qui signifie que, pour «donner du sens« et conférer de la valeur à la nature, voire du sacré, nous devons le faire selon des types de valeur radicalement nouveaux. Or, la nature a été désacralisée. Notre époque n'a pas su inventer une nouvelle forme de sacré, accordée à l'essence de la technique. La technique n'a pourtant rien d'une substance autonome. «Qui accomplit, demande Heidegger, l'interpellation pro-vocante, par laquelle ce qu'on appelle le réel est dévoilé somme fond? L'homme, manifestement». Mais l'homme, lui aussi, est objet de pro-vocation: «Ne fait-il pas aussi partie du fond, et d'une manière plus originelle que la nature ? La façon dont on parle couramment de «matériel humain» le laisserait penser (...) Le garde forestier est commis par l'industrie du bois. Il est commis à faire que la cellulose puisse être commise et celle-ci, de son côté, est provoquée par les demandes de papier pour les journaux et les magazines illustrés. Ceux-ci, à leur tour, interpellent l'opinion publique pour qu'elle absorbe les choses imprimées, afin qu'elle-même puisse être commise à une formation d'opinion dont on a reçu la commande. Mais justement, parce que l'homme est pro-voqué d'une façon plus originelle que les énergies naturelles, à savoir au commettre, il ne devient jamais pur fond».
L'homme est donc à la fois fond et non-fond. Comment cela est-il possible ? L'homme, à l'ère technique, serait-il coupé en deux, en même temps sujet et objet de la technique ? Mais s'agit-il du même homme? Rapprochons la dernière phrase citée de Heidegger de 1'énoneé suivant: «Le dévoilement (du réel parla technique) n'est pas le simple fait de l'homme (...) mais d'une parole à lui adressée, et cela d'une façon si décidée qu'il ne peut jamais être homme, si ce n’est comme celui auquel cette parole s'adresse (...) Il ne fait que répondre à un appel». Nous commençons alors d'entrevoir quelque chose d'« inhumain» pour l'opinion courante. Heidegger scinde l'humain en deux: en tant qu'objet d'un appel, d'une commission, 1'humain est un fond pour la technique. Mais il est aussi celai qui formule cet appel. La phrase «il ne peut jamais être homme si ce n'est comme celui auquel cette parole s'adresse» signifie: le propre de l'humain est d'obéir, et plus aujourd'hui qu'avant. Mais quelle est cette commission, cette parole, à laquelle il faut obéir? C'est le Surhumain, Et c'est ainsi qu'il faut lire la phrase de Heidegger : «La technique moderne, en tant que dévoilement qui commet, n'est pas un acte purement humain». L'humain, par la technique moderne, s'appelle lui-même à se dépasser, et se commet lui-même comme fond à commettre le réel. L'appel vient de sa nature, et c'est ce qui confère à la civilisation technique son ambivalence, son risque. Notre époque, dit Heidegger, rend l'homme esclave de lui-même par l'intermediaire de la technique et inaugure deux nouvelles classes d'hommes : les «commis », assimilés à un fond, et les personnalités commettantes. Dès lors, soit l'on «refuse» cet état de fait, et l'on régresse dans l'infra-humain; soit l'on se refuse simplement à l’admettre - attitude humaniste -, et la civilisation technique est réellement vécue comme esclavage, comme soumission à la «dictature de l'an-organique», soit encore, troisième voie, on l'accepte au prix d'un changement auto-conscient de l'humain et des valeur «humaines«, et à cette condition, la civilisation technique ne doit pas plus représenter un «esclavage» pour l'homme moderne que, dans le passé, la révolution néolithique n'en a impliqué un pour les peuples européens.
Bien entendu, c'est cette troisième hypothèse qui, nous le verrons, peut se déduire de la pensée de Heidegger. Mais avant d'aborder cette question, il nous faut chercher à percer la nature de ce que nous voyons surgir dans et par la technique moderne : cette «pro-vocation qui met l'homme en demeure de commettre le réel comme fond». Quelle est la nature de cette pro-vocation? Heidegger répond : «Cet appel provocant qui rassemble l'homme autour de la tâche de commettre somme fond ce qui se dévoile, nous l’appelons I'arraisonnement (Gestel)». Et c'est dans ce mot que réside l'essence de la technique moderne.
«L'arraisonnement, expose Heidegger, n'est rien de technique, il n'a rien d'une machine. Il est le mode suivant lequel le réel se dévoile comme fond». il n'est pas assimilable à un acte humain ni à un acte situé hors de l'humain. Sa place est du côté du Surhumain, c'est à dire d'un nouveau mode «historial» d'être-au-monde, accompli grâce à la technique moderne et dont les hommes de ce temps n'ont pas encore pris conscience. Cette «inconscience» est d'ailleurs la cause du malaise de la civilisation technique, qui ne pense l'humain, dans l'humanisme, qu'au travers des modalités d'être-au-monde de l'époque pré technique.
Avec l'arraisonnement, le Dasein change de nature. Pour comprendre le processus de l'arraisonnement, on doit observer que, dans le mot Gestell, on trouve l'idée de rassemblement: la volonté rassemble le fond humain et naturel des commis. Mais si le radical Ge indique cette idée de rassemblement, inspirée du terme jüngerien de Mobilmachung, Heidegger va plus loin que Jünger. L'arraisonnement par la technique est plus qu'une «mobilisation». Le verbe stellen nous indique l'idée d'arrêter quelqu'un ou quelque chose pour lui demander des comptes, pour lui faire rendre raison, pour l'obliger à rationem reddere. D'où, en français, le recours au terme d'«arraisonnement», grâce auquel on comprend parfaitement que la volonté technique prend d'assaut (aspect à la fois guerrier et dionysiaque) et metà la raison le réel (aspect apollinien). Jean Beaufret écrit d'ailleurs: «La technique arraisonne la nature, elle l'arrête et l'inspecte, et elle l'arraisonne, c'est-à-dire la met à la raison (...) Elle exige de tonte chose qu'elle rende raison. Au caractère impérieux et conquérant de la technique s'opposeront la modicité et la docilité de la «chose»...» Cet imperium surhumain, lisible dans l'arraisonnement, nous rapproche de la valeur qu'il recèle: la Volonté de puissance en acte. Aussi, previent Heidegger, la conception purement instrumentale, purement anthropologique de la technique devient-elle caduque dans son principe. La technique est en effet et bien devenue le lieu d'un appel: elle est ce «mode» par lequel et dans lequel l'humain est appelé, pro-voqué, commis par sa nature à devenir surhumain, c'est-à-dire à commettre à son tour, à «appeler» la nature et à se pro-voquer lui-même, ou plutôt à pro-voquer cette part de lui-même qui en est restée au niveau de l'humain.
Nous devons alors découvrir ce que recèle «l’appel pro-vocant» et où il va entraîner l'humain. Bien que la technique moderne doive utiliser la science exacte de la nature, elle n'a rien de commun avec «de la science naturelle appliquée», écrit Heidegger. Ce ne sont pas ici les lois de la nature qui sont utilisées, mais bien les lois des machines et des instruments. «Le réel, partout, devient fond, ajoute Heidegger (...) L'essence de la technique met l'homme sur le chemin du dévoilement (...) Mettre sur le chemin se dit, dans notre langue, «envoyer». Cet envoi (schicken) qui rassemble et qui, seul, peut mettre I'homme sur le chemin du dévoilement, nous le nommons destin (Geschiek). C'est à partir de lui que la substance en devenir (Wesen) de toute histoire se détermine».
Ainsi, l'essence de la technique, qui, répétons-le, n'a rien de technique par elle-même, non seulement n'apparaît pas forcément au moment «épochal» de la civilisation technique moderne, mais provient de racines historiques antérieures. L'essence de la technique est un devenir «historial», un destin, un devenir au monde collectif, et non pas seulement une réalité sociologique contemporaine et synchronique. Pour Heidegger, la poiesis de la production technique des Anciens constituait aussi un destin. C'est donc toute l'histoire des mentalités inconscientes et de l'être-au-monde d'une civilisation qui se trouve charriée par I'arraisonnement de la technique. Celui-ci était déjà en oeuvre avant «l'électrotechnique et la technique de I'atome», dans cet esprit de recherche décelable en Europe dès les mathématiciens grecs. Il n'adviendra cependant au dévoilement, à la prise de conscience qu'après 1'époque de la jeunesse de la civilisation moderne.
L'arraisonnement traduit alors une vue du monde en rupture complète avec la métaphysique. Le monde objectif n'existe pas. La nature n'est pas considérée dans sa nature mais seule compte, pour I'homme de la technique européenne, I'extraction d'une énergie qu'il transforme en puissance humaine. Contrairement à ce qui se dit couramment, la science est au service de la technique, et cette dernière constitue un destin historique, dont I'objet n'est pas la connaissance mais l'action. Par l'essence de la technique, se manifeste un trait «historial» de la civilisation européenne : dominer est plus important que connaître.
Heidegger ne succombe toutefois à aucun déterminisme historique. Le «destin» peut à tout moment se refuser. Nous ne lui sommes pas enchaînés. Heidegger promise: «Ce n'est jamais la fatalité d'une contrainte. Car l'homme, justement, ne devient libre que pour autant qu'il est inclus dans le domaine du destin et qu'ainsi, il devient un homme qui écoute, non un serf que l'on commande (ein H6render nidi/ aberein Hóriger) (...) L'arraisonnement nous apparaît dans un destin de dévoilement (...) Il est un élément libre du destin qui ne nous enferme aucunement dans une moindre contrainte, qui nous forcerait à nous jeter tête baissée dans la technique ou, ce qui reviendrait au mente, à nous révolter inutilement contre elle et à la condamner comme oeuvre diabolique».
Que l'on accepte - et c'est ce que propose Heidegger - ou que l'un refuse la technique, il faudra le faire consciemment, après avoir perçu son essence d'arraisonnement du monde et après l'avoir envisagée comme destin. Le refus ou l'acceptation seront alors des actes historiques accomplis par une conscience ««historiale» en situation (geschichtliches Dasein), une sur-conscience. Mais les adversaires primaires de la technique, tout somme ceux qui s'y précipitent tête baissée, sont incapables de parvenir à une telle conscience historique. Ils en sont incapables parce qu'ils ne sont pas libres. La «liberté», pour Heidegger, n'est «ni la licence ni l'arbitraire», ni «la soumission à de simples lois», mais «le domaine du destin», c'est-à-dire un choix volontaire éclairé par la perception du destin.
Perçue comme destin de dévoilement du monde, la technique devient un danger voulu et désiré comme tel : «La puissance de la technique fait partie du destin. Placé entre ces deux possibilités (accepter ou refuser le danger), l'homme est exposé à une menace partant du destin». Déjà, quand le Dieu des chrétiens avait été «dévoilé» par ceux qui le nommaient comme causa efficients du monde, il avait perdu son mystère et était devenu le Dieu des philosophes. Dès lors, le nihiliste commençait. Le dévoilement de la nature par l'arraisonnement semble autrement plus considérable pour la bonne raison que la nature, elle, est notre milieu, et que nous ne doutons pas d'elle comme des dieux.
«Le danger, poursuit Heidegger, se montre à nous de deux côtés différents (...) L'homme suit son chemin à l'extrême bord du précipice, il va vers le point où lui-même ne doit plus être pris que comme fond (...) Tout ce que l'un rencontre ne subsiste qu'en tant qu'il est le fait de l'homme (...) Il nous semble que partout l'homme ne se rencontre plus lui-même». Heidegger, qui s'inspire ici des vues de Werner Heisenberg, veut dire que «si l'homme ne rencontre plus rien à travers l'arraisonnement du monde, c'est qu'il ne se rencontre plus lui-même en vérité nulle part, c'est-à-dire qu'il ne rencontre plus nulle part son être-devenir (Wesen)». Quant au second danger, il tient au fait que l'arraisonnement, en nous plongeant dans l'immédiateté de la puissance mécanisée, risque, non seulement d'occulter le pro-duire (mode précédent de dévoilement du monde), mais aussi de s'occulter lui-même comme destin. La technique risque en effet de nous cacher ce que nous sommes et ce qu'elle est, de nous voiler qu'elle se donne comme destin et que nous pouvons exister en tant qu’êtres doués de destin.
Autrement dit, la technique moderne, dont l'essence est l'arraisonnement qui pro-voque le monde avec une puissance inouïe, peut nous faire perdre, dans ce tourbillon même, dans set «envoi» (schicken) par lequel nous sommes jetés sur la terre, la conscience de notre destin (Geschick). «L'homme se conforme d'une façon si décidée a la pro-vocation de l'arraisonnement qu'il ne perçoit pas celai ci comme un appel exigeant, qu'il ne se voit pas lui-même comme celui auquel cet appel s'adresse». La contrepartie de ce risque, impliqué par la liberté humaine, est que l'homme peut aussi prendre conscience de l'arraisonnement et l'assumer: «Il faut que ce soit justement l'essence de la technique qui abrite en elle la croissance de ce qui sauve».
L'arraisonnement, en effet, constitue à la fois 1'«extrême péril» et 1'«acte qui accorde». Heidegger, dans La question de la technique, précise: «L'arraisonnement pousse l'homme vers le danger qu'il abandonne son être libre ; (mais) e'est précisément dans cet extrême danger que se manifeste l'appartenance la plus intime, indestructible, de 1'homme à «ce qui accorde..» Il ajoute: «Contrairement à tonte attente, l'être de la technique recèle en lui la possibilité que ce qui sauve se lève à notre horizon (...) Aussi longtemps que nous nous represénterons la technique comme instrument, nous resterons pris dans la volonté de la maîtriser». Cet accord dont parte Heidegger, opposé diamétralement au «discord» qui sépare l'existence de la conscience, la pensée de la vie, les valeurs nommées des valeurs vécues, sera trouvé lorsque nous ne considérerons plus la technique comme une instrumentalité rationnelle, lorsque nous ne chercherons plus à la «dominer» au sens où le potier des temps anciens dominait son tour. Ce qu'il faut, c'est nous «donner» à la technique, en tant qu'elle s'avère porteuse de notre propre Volonté de puissance. C'est au sein même du dévoilement que la technique moderne opère sur le monde, qu'elle fondera sa propre justification éthique, qu'elle se posera comme vérité - au sens grec d'aléthéia.
La technique pourrait alors retrouver, selon un sens diffèrent de celui que lui donnaient les Grecs, la force de mobilisation de ce que l'on nomine improprement un art. En Grèce, on le sait, la technique était un dévoilement pro-ducteur. Aujourd'hui, pour reprendre un sens, elle doit devenir un dévoilement pro-vocant. Entre les deux, la matérialité de l'arraisonnement est apparie, mais le dévoilement, lui, reste identique. L'homme, en soulevant le voile du monde, retrouve, par ce geste que ne guide aucun pragmatisme, du sens. Le dévoilement nous jette, loin de la quotidienneté insipide et programmée della «technique confortable», vers l'aventure. Cette «aventure», nous n'en prendrons toute la mesure que lorsque nous aurons bien saisi, pour nous en stimuler ou nous en effrayer, en quelle époque nous vivons. Cette aventure sera celle des temps modernes, que la conscience occidentale n'a pas encore intégrés et qui n'en sont qu'à leur aurore, qu'à l'orée de leurs possibles.
IV. L'AURORE DES TEMPS MODERNES
Heidegger tient un double discours sur la métaphysique et la technique. C'est ce qui rend sa lecture difficile. La métaphysique apparaît d'abord comme étant l'histoire occidentale elle-même, atteinte à ce titre par la mors dont parlait Nietzsche, ce qui nous incite à penser que nous vivons une fin de l'histoire. Mais la métaphysique se présente aussi sous l'aspect d'un fleuve qui viendrait mourir dans l'océan de la technique moderne, et dont ce dernier procèderait. Quant à la technique, elle est pensée comme apogée de ce nihilisme que lui aurait légué la métaphysique mourante, mais aussi comme rupture radicale avec elle, et comme l'aube d'un «salut». Comment débrouiller cet écheveau?
Pour Heidegger, la métaphysique ne se confond pas avec l’œuvre de ce que l'on a coutume de norme les «métaphysiciens». La métaphysique englobe cette vue-du-monde, exprimée par l'ensemble des philosophes, qui pénétra les sociétés occidentale depuis Platon et les débuts du christianisme et selon laquelle le monde réel de la vie se doublerait d'un univers supérieur des essences qu'il serait donné à l'homme de pouvoir connaître. Cette vue-du-monde comporte un double destin, contradictoire: d'une part elle fut marquée, dès le départ, du sceau du nihilisme, c'est-à-dire de la dévalorisation de ses propres valeurs; mais ce nihilisme ne vint au jour que lentement. D'autre part, la vue-du-monde métaphysique fut porteuse, sans le savoir, de la Volonté de puissance: penser le monde sous le rapport de l'universalisme des essences, c'était manifester une prodigieuse volonté de l'arraisonner et de le dominer; toutefois, cette volonté ne parvenait au clair entendement que dans la mesure où l'homme ne s'avouait pas comme 1'élément dominateur et conférait cette qualité à Dieu ou à un tout autre que lui.
Avec 1'arrivée de la technique moderne, un «passage de relais» s'effectue. La technique moderne recueille l'héritage - déjà contradictoire - de la Volonté de puissance et du nihilisme. Elle marque en ce sens une rupture, puisque le nihilisme éprouve la technique de manière matérialiste, qu'il est vécu comme une détresse consciente, alors que la civilisation de l’âge métaphysique ne prenait pas consciente de la montée sourde de ce nihilisme, dont le processus était philosophique. En d'autres termes, la technique a hérité de la métaphysique, car la Volonté de puissance, dont cette dernière était grosse, a été l'élément provocateur de la science et de la technique moderne. Mais cette Volonté de puissance qui, par la technique, est passée du stade psychique au stade matériel, n'est toujours pas complètement consciente d'elle-même. Ou plutôt, elle commence seulement à le devenir, et c'est pourquoi nous vivons une époque de crise.
 Notre époque est celle de I'apogée du nihilisme, ce que Heidegger, empruntant à Hölderlin, nomme «la minuit du monde». Ce nihilisme provient d'abord de la déchéance de la métaphysique, commencée des Platon et qui a trouvé son achèvement dans la morale humaniste, le christianisme laic et d'autres avatars; c'est que Heidegger appelle l'athéisme. Ce nihilisme qui aboutit à la dévalorisation du monde et qui se confond avec I'époque du «dernier homme» annoncée par Zarathoustra, est, d'autre part, renforcé par le fait que la technique moderne a, elle aussi, hérité du nihilisme de la vue-du-monde métaphysique.
Notre époque est celle de I'apogée du nihilisme, ce que Heidegger, empruntant à Hölderlin, nomme «la minuit du monde». Ce nihilisme provient d'abord de la déchéance de la métaphysique, commencée des Platon et qui a trouvé son achèvement dans la morale humaniste, le christianisme laic et d'autres avatars; c'est que Heidegger appelle l'athéisme. Ce nihilisme qui aboutit à la dévalorisation du monde et qui se confond avec I'époque du «dernier homme» annoncée par Zarathoustra, est, d'autre part, renforcé par le fait que la technique moderne a, elle aussi, hérité du nihilisme de la vue-du-monde métaphysique.
C'est là où la lecture de Heidegger devient extrêmement complexe. Ce dernier exprime, par allégorie, l'idée suivante : la technique est la continuation de la métaphysique, car elle vise à satisfaire la même pulsion, la Volonté de puissance. Or, puisque le nihilisme vécu du monde technique est le successeur du nihilisme philosophique de la vue-du-monde métaphysique, c'est bien la Volonté de puissance elle-même, philosophique, puis matérialisée, qui est «responsable» de ce nihilisme. Comment, alors, cette Volonté de puissance peut-elle constituer un élément salvateur, comment peut-elle. après avoir porté le nihilisme, le combattre, dans un nouveau cycle «historial»? Heidegger répond: en devenant autoconsciente. La Volonté de puissance changerait alors de nature; de dévalorisante, elle deviendrait valorisante. C'est pourquoi, il ne faut voir chez Heidegger aucun rationalisme logique, mais une pensée a-logique, conforme à la vie, où l'on n'est jamais acculé à se prononcer contre (la métaphysique, le nihilisme, etc.), mais au-delà: post-nihiliste, post-chrétien etc. Heidegger renoue ainsi avec la pensée du devenir des présocratiques, selon cette parole de Hölderlin qui constitue une clé: «Mais là où est le danger; là aussi croit ce qui sauve». (Cette forme de pensée avait été incomplètement retrouvée par Hegel. Celui-ci, en effet, ne concevait le devenir que comme l'antécédent provisoire d'un arrêt de l'histoire par advenance de la raison à la conscience).
C'est donc bien par l'essence même de la technique, par l'arraisonnement, qui exprime la Volonté de puissance dont l'ascension dans 1'histoíre fut conjointe de celle du nihilisme, que ce dernier pourra se voir dépassé. La venue à la consciente de la Volonté de puissance, qui, seule, serait susceptible d'affirmer d'autres typologies de valeurs, ne peut s'accomplir que dans la civilisation de la fusée et de l'électron. Pourquoi? Parce que la Volonté de puissance trouve dans la technique moderne et planétaire un meilleur support que dans la métaphysique : vécue, éprouvée, elle est «au bord» de la conscience. La manifestation de l'Eternel retour de l'identique apparaît clairement: ce qui, à la fin du «monde grec», avait inauguré le nihilisme, c'est-à-dire le fait de «nommer les valeurs», de désigner l'ètre, le logos, est aussi appelé a devenir, mais sous une autre forme historiale, celle, apollinienne, de la conscience, ce qui inaugurera un autre cycle des valeurs, un «après-nihilisme».
Notre époque se caractérise donc par la séparation, le discord («nous sommes à l'ère de 1'assomption du discorde, avait coutume de dire Heidegger), entre une métaphysique déchue, privée du principe vital de Volonté de puissance, et une technique qui a recueilli cette dernière sans le savoir. La morale et la civilisation sont en contradiction. Les valeurs affirmées par l'ancienne conception du monde commune sont mortes par rapport à la nature profonde de la civilisation technique. Il existe deux moyens de résoudre cette contradiction : le premier, préconisé par Heidegger, est de faire assumer consciemment, par la civilisation technique, cette Volonté de puissance - comme un «orgueil». C'est par un projet «orgueilleux» de monde hyper technicisé et se voulant tel, et non par la régression vers une civilisation non technique, que l'Europe, pour Heidegger, redonnera un sens à son existence «historiale». Une spiritualité immanente prendra alors le relais d'une spiritualité transcendante devenue impossible parce qu'épuisée. Mais un autre chemin est également possible, en notre époque de rupture : celui d'un refus conscíent de la Volonté de puissance. Un certain nombre d'auteurs 1'expriment aujourd'hui fort bien dans le courant de ce qu'il est convenu d'appeler la «nouvelle gauche», notamment à propos du débat sur l'idéologie du travail, lorsque celui-ci est interprété intrinsèquement comme aliénation, alors que le marxisme classique ne posait comme aliénantes que les conditions (capitalistes) du travail. La technique est alors perçue comme le lieu de cette aliénation. On retrouve là une transposition du thème biblique du travail-punition.
On commence donc à percevoir que la technique moderne, même si son projet formulé est le «bonheur», exprime en son essence cette même Volonté de puissance que n'a jamais admise, depuis le mythe de la tour de Babel, la vue-du-monde biblique. C'est pourquoi les héritiers de cette vue-du-monde refusent si souvent la technique. Eux aussi ont vécu l'événement colossal qu'est la prise de consciente de la technique moderne comme réceptacle de la Volonté de puissance; eux aussi y ont vu une contradiction totale avec la conception du monde héritée de l' humanisme occidental et de la métaphysique platonicienne de la «recherche du souverain bien» (agathos). Si le stade de la sur-consciente peut conduire à vouloir la technique, il peut donc aussi amener à la refuser avec angoisse. Naît ainsi un nouveau clivage, issu de conceptions du monde opposées. La guerre des dieux, prédite par Nietzsche, est commencée.
La Volonté de puissance, lorsqu'elle s'exprimait dans la métaphysique, demeurait «innocente». Elle n'avait pas atteint la maturité de l'âge d'homme. Les temps modernes, au contraire, créent la première configuration «historiale» où, dans l'essence de la technique, le vieux rêve helléno-européen de désenchaîner Prométhée devient possible. Les temps modernes inaugurent, entre deux minorités conscientes, une guerre fondamentale: les humanistes universalistes, adeptes d'une opinion «chrétienne avancée» qui n'a plus rien de religieux, s'opposent au surhumanisme tel que Nietzsche I'avait inauguré. C'est la lutte du «vieux monde» contre les temps modernes ; des Occidentaux contre la «nouvelle Grèce de l'Hespérial»; de 1'idée de bonheur, que soutient le principe de raison, contro 1'idée de puissance comme spiritualité immanente. Il s'agit bien de la même guerre qui, sous une autre forme, opposa le monothéisme chrétien aux dieux grecs. Aujourd'hui, le retour d'Apollon s'accomplit sous une forme bien différente de celle des cultes pythiens, des superstitions delphiques ou même des beaux-arts. Apollon est (peut-être) de retour, mais pas sous une forme innocente et rassurante. Il est de retour au sein même de l'inquiétance de la technique moderne. Dans le tonnerre des moteurs, dans la sorcellerie des laboratoires et des cyclotrons, dans l'ascension profanatrice des fusées spatiales, se creuse le tombeau de la Raison.
Cette «déclaration de guerre», nul doute que Heidegger en eut une claire conscience. La fin du texte sur Le mot de Nietzsche «Dieu est Mort » s'achève ainsi: «La pensée ne commencera que lorsque nous aurons appris nette chose tant magnifiée depuis des siècles: la raison est la contradiction la plus acharnée de la pensée». Heidegger apparaît donc bien comme l'authentique fossoyeur (et le successeur) de la métaphysique. A la volonté de puissance noétique (nous, «esprit») de la métaphysique, il oppose le chemin vers une volonté de puissance poiétique. Parvenir à la spiritualisation consciente et organisée, apollinienne, de la volonté de puissance dionysiaque en oeuvre dans la technique, tel est très exactement le sens du chemin qu'il nous indique chemin qui «ne mène nulle part», en ce sens qu'il ne conduit à aucun repos, à aucune fin de l'histoire dans le «bonheur», mais débouche sur un combat en perpétuel devenir. Le. sens de la «civilisation hespériale» redevient grec dans l'acception héraclitéenne: le destin historique voulu comme guerre en éternel inachèvement.
Le combat entre les tenants de cette philosophie de l'existence et les «derniers hommes» de la morale et de la raison, tout aussi conscients Ies uns que les autres, ressemblera, paradoxalement, à un affrontement entre la religiosité et la non-religiosité. Les «hommes du bonheur» ne peuvent en effet que se choisir un destin non religieux: leurs normes humanistes et leurs universaux ont été une fois pour toutes dé spiritualisés. Ils se privent par ailleurs de la seule forme virtuelle de spiritualité moderne la Volonté de puissance en acte dans I'arraisonnement technique. Ils savent, bien qu'ils soient encore peu à le formuler, qu'une «technique sans volonté de puissance» n'est pas envisageable. Déjà, plusieurs tenants de l'Ecole de Francfort, ainsi qu'un Ivan Illich, ont formulé le refus, motivé et conscient, de la technique comme «tentation de puissance». Leurs thèses ne sont pas intellectuellement critiquables : ils font une lecture correcte de Nietzsche et de Heidegger. La «guerre» se passe, en fait, à un niveau beaucoup plus fondamental. Elle oppose des valeurs existentielles. Elle porte sur cette question capitale: comment vivre, et selon quel sens ?
Ainsi, le paysage des temps modernes s'éclaire. Trois types d'humanité coexistent. Viennent d'abord les hommes de la simple conscience, qui vivent encore innocemment la technique sans la percevoir en contradiction avec leur morale, et qui constituent un «fond» pour les deux autres types. Viennent ensuite les «derniers hommes», les humanistes qui ont pris conscience du nihilisme de leur vue-du-monde, mais qui n'entendent pas s'en défaire, car l'«après»» les terrorise. Ceux-là se réfugient dans une sorte de morale du plaisir. Leur «subversion» est paradoxalement placée sous le signe de la douceur bourgeoise. Ils n'ont pas abandonné leur quête de la raison, mais ils savent maintenant que toute raison est incompatible avec la technique, c'est-à-dire que la technique, au-delà de ses aspects superficiels, est porteuse de dé-raison. Dès lors, ils refusent tonte spiritualité qui équivaudrait à une glorification de la puissance, et, poussant le rationalisme jusqu'a son terme, redécouvrent la morale, après avoir constaté le divorce de la technique et de la raison. Enfin, on trouve les hommes du «troisième type»: ceux qui entendent soumettre les forces matérialistes de la technicité moderne à l'irrationalité «sage» - au sens grec de sophia, «clarté volontaire de l'entendement» - de nouvelles valeurs. Et c'est à la pensée de Heidegger qu'ils se rattachent..
Dans L 'époque des conceptions du monde, texte d'une conférence prononcée en 1938 sous le titre de Die Begriindung des neuzeitlichen Weltbildes dureh die Metaphysík («Le fondement de la conception du monde des temps modernes à travers la métaphysique»), Heidegger précise, comme nulle part ailleurs, son analyse de la modernité. Il y pose, en particulier, la question de l'essence des temps modernes.
Cinq phénomènes caractérisent les temps modernes. Le premier, nous l'avons vu, touche à l'envahissement de la «technique mécanisée comme prolongement de la métaphysique». On doit entendre par là, quoique Heidegger ne l'ait jamais formulé clairement, que la technique prolonge la métaphysique, dans la mesure où elle reprend à son compte la pulsion de la Volonté de puissance. Deuxième caractéristique des temps modernes: l'art (Kunst) cesse de se confondre avec la téchné pour «entrer dans l'horizon de l'esthétique» et de ce fait, s'objective Troisième caractéristique: le fait que l'activité humaine soit désormais comprise et accomplie en tant que «civilisation » (Kultur). La civilisation, écrit Heidegger, prend conscience d’elle-même, en tant que mitre des préoccupations détrônant les querelles religieuses». Quatrième caractéristique: le «dépouillement des dieux, (Entgötterung), par lequel, précise Heidegger, «d'un côté l'idée générale du monde (Weltbild) se christianise, et de l'autre, le christianisme transforme son idéal de vie en une vision du monde (la vision chrétienne du monde)». Le dépouillement des dieux, ajoute Heidegger, c'est l'état d'indécision par rapport à Dieu (...) Le christianisme est le principal responsable de son avènement (...) Quand les choses en viennent là, les dieux disparaissent.. Le vide qui en résulte est alors comblé par l'exploration historique et psychologique des mythes». Le christianisme, en d'autres termes, même s'il doit être abandonné et dépassé, a eu, dans notre destin, cette fonction fondamentale (et inconsciente) de donner à l'homme la possibilité de se doter d'une conception du monde planifiée et cohérente. Heidegger, plus qu'un antichrétien ou un non chrétien, s'affirme ici comme un post-chrétien, qui entend, à ce titre, en finir avec la tradition chrétienne afin de la dépasser.
La cinquième caractéristique des temps modernes est sans doute la plus fondamentale: elle constitue, précisément, ce qui, dans un mouvement dialectique de «contradiction-depassement», permettrait d'établir consciemment une conception du monde post-chrétienne. Il s'agit de la perception du monde à travers la science. Heidegger demande: «Sur quoi repose l'essence de la science moderne?» Il écrit aussi qu '«il est possible d'entrevoir l'essence propre de tous les temps modernes». Outre L'époque des conceptions du monde, un autre texte doit être interrogé pour formuler une réponse. C'est celai de la conférence Science et méditation, prononcée à Munich en 1953. Levons tout d'abord quelques équivoques. «Pas plus que l'art, la science ne se réduit à une activité culturelle de l'homme», dit Heidegger. Il ajoute: «La science est un mode, à vrai dire décisif, dans lequel tout ce qui est s'expose devant nous». Plus qu'un trait culturel, la science doit être interprétée comme le regard même, par lequel les temps modernes, et pas seulement «les scientifiques», s'approprient le monde et te font devenir comme réel. La perception scientifique du monde n'est pas «le monde perdra comme exactitude»: elle se confond avec la réalité du monde. Ainsi que le vit aussi Werner Heisenberg, le point de vue scientifique sur le monde, que partage, comme un destin sur lequel on ne revient pas, tonte notre civilisation, n'apporte aucune «certitude» sur une illusoire objectivité du réel; ce point de vue fait lui-même partie, tout simplement, de « notre monde». Autrement dit, la science moderne ne se caractérise pas, par rapport à la doctrina médiévale ou à l'épistémè grecque, par sa plus grande exactitude, mais par son projet. «L'essence de ce qu'on nomme aujourd'hui science, c'est la recherche», dit encore Heidegger, qui précise «L'essence de la recherche consiste en ce que la connaissance s'installe elle-même, en tant qu’investigation, dans un domaine de l'étant, la nature ou l' histoire (...) Le processus de la recherche s'accomplit par la projection d'un plan déterminé (...) d'un projet (Entwurf) de reconnaissance investigatrice».
Les sciences, par exemple, utilisent les mathématiques, qui pénètrent d'ailleurs aujourd'hui dans toutes tes activités sociales. Or, ta mathèmata, en grec, signifiait: «les choses connues d'avance». La science, en effet, anticipe à sa façon ce qu'elle découvrira dans la nature. Elle ne vise pas à en dé-celer les secrets; elle sait d'avance ce qu'elle y trouvera: non pas le «réel », mais un projet technique de mobilisation. L'aérodynamicien ne «recherche» pas les arcanes des flux aériens ; il ne vise même pas, à proprement parler, à les «comprendre», mais à formuler mathématiquement «quelque chose à propos d'eux», afin de parvenir à un objectif qu'il connaît déjà: faire manœuvrer de façon optimale un chasseur à réaction à haute vitesse. De même, les mathématiques ne «décrivent» rien de la nature, mais sont l'expression d'une visée humaine sur la nature. La science procède par «détermination anticipée» d'un projet de ce qui sera désormais la nature. La rigueur et l'exactitude ne se trouvent pas dans les sciences, ni dans le regard que celles-ci jettent sur la nature, mais dans la détermination du projet lui-même. La science peut alors se définir comme «recherche par le projet qui s'assure lui-même dans la rigueur de l'investigation». La méthode expérimentale découle, non de la «raison», mais de cette psychologie de la recherche combative. «Ni la doctrina médiévale, ni l'épistémè grecque ne sont des sciences au sens de recherche, il n'y a pas piace en elles pour une expérience scientifique», souligne Heidegger.
Plus précisément, Heidegger distingue trois «niveaux» historiques d'expérience «exploratrice». Le plus bas, celui des chrétiens, est l'argumentum ex verbo: «la discussion des paroles et doctrines des différentes autorités» a transformé les philosophies antiques, ouvertes (Platon et Aristote eux-mêmes n'étaient pas dogmatiques), en dogmes fermés et en dialectiques scolastiques, «La possession de la vérité a été proprement transportée dans la foi, c'est-à-dire dans le fait de tenir pour vrai la parole de l'Ecriture et le dogme de I'Eglise». La recherche se ramène alors à l'exégèse. L'humain est dépossédé de tout projet. Le deuxième palier de la recherche est celui de l'antiquité païenne, remis en honneur par Roger Bacon au XIVeme siècle: « La discussion des doctrines est remplacée par 1'observation des choses elles-mêmes (argutnentum ex re}, c'est-à-dire l'empeira aristotelicienne ». Enfin, le troisième stade de la recherche, celai de la science moderne, perd toute «humilité» devant les choses. La nature devient dans sa corporalité - le lieu du projet planifié, et non plus le but d'investigation pour la connaissance. La science moderne prend pour visée la technique, et non plus l'être de la nature.
La spécialisation scientifique n'est pas la conséquence, mais la raison du progrès de la recherche. C'est parce que la nature a été, des le départ, conçue comme «spécialisée » à l'image de la spécialisation du mouvement technique, que la recherche a été possible. La science moderne est elle-même déterminé par le «mouvement de l'exploration organisée» (der Betrieb). En procédant, métabiologiquement, par accumulation organisé de ses propres résultats, elle suit la vie de l'investigation progressante. De ce fait, le «procédé» acquiert la primauté sur l'étant, c'est a dire sur la nature et l’histoire.
« Ce déploiement de la recherche, prévient Heidegger, est {...) le signe lointain et encore incompris, indiquant que la science moderne commence à entrer dans la phase décisive de son avènement». Par le procédé scientifique, le réel tombe sous le coup de la sécurisation (Sicherstellung), c'est-à-dire de l'objectivation maximale. Pour Heidegger, le savant, le littérateur, le professeur, sont aujourd'hui relayes par le chercheur engagé dans des programmes. L'Université, en tant qu'institution fixe de recel du savoir, s'efface devant les centres de recherches dont les projets tombent sous le coup du devenir. «Le chercheur, écrit Heidegger, n'a plus besoin de bibliothèque, il est en routa. Et de fait, les «banques de données» ne sont plus des bibliothèques, puisqu'elles évoluent constamment, non pas à la façon de stocks remis à jour périodiquement, mais en tant qu'instruments cammis par un projet impérieux, qui les «saccage » et les re-compose sans cesse.
«L'organisation de l'exploitation scientifique», mobile, spécialisée, ne tolère pas les recherches hors programme. «projet et rigueur, procédé et organisation des diverses centres, constituent, dans leur interaction continuelle, l'essence de la science moderne». Nous pouvons alors parler d'objectivation de l'étant: la nature est «forcée», 1'histoire arrêtée», l‘« être de l'étant» perd tout attrait. Seul compte le fait que nature et histoire nous deviennent objets. «La vérité est devenue, précise Heidegger, certitude de la représentation». Depuis que Descartes osa douter de la nature et la déduire de son entendement, c'est-à-dire la subordonner à sa perception, la conception scientifique du monde est née.
Avec les temps modernes, le monde devient dont pour la première fois une «image conçue». «L'essence de l'homme change dans la mesure où l'homme devient sujet ». Le cosmos, la nature et l'histoire n'existent plus qu'en référence avec le «sujet central». L'étant (ou le monde) se transforme en un monde-conçue, plus exactement en une Weltbild, c'est-à-dire en une image conçue du monde ou, plus simplement, en une «conception du monde». Telle est la caractéristique «historiale» de notre époque, qui la sépare de toutes les précédentes. Heidegger écrit, en résumé: «Les locutions comme conception du monde des temps modernes et conception moderne du monde disent deux fois la même chose, et supposent ce qui n'a jamais été possible auparavant, à savoir une conception du monde médiévale et une conception du monde antique (...) Que le monde comme tel devienne une image conçue, voilà qui caractérise et distingue le règne des temps modernes.
L'étant et le monde n'existent aujourd'hui que pour autant qu'ils sont l'objet d'une visée, qu'ils sont «arrêtés pour l’homme dans la repréntation et la production». Pour le Moyen Age chrétien, au contraire, ils ne tiraient lette existence que du fait d'une «production divine»: le monde était l’ens creatum, «ce qui est créé». Pour les Grecs, le monde était le contenant de l’homme. L'homme grec est l'«entendeur de l'étant», «le monde de l’hellénité ne saurait devenir mage conçue», Heidegger ajoute: «L'homme est regarde par l'étant, par ce qui s'ou re a la mesure de la présente autour de lui rassemblée ».
La pensée de Heidegger nous force ainsi à sortir de la logique rationnelle. Heidegger entend à la fois revenir au monde grec et avaliser la Weltbild moderne - après avoir montré que cette dernière ne procède pas de l'hellénité, puisque l'homme grec se pensait « partie du monde» et ne se l'appropriait pas comme une «image» extérieur. Rappelons-nous que le déterminisme linéaire de la causalité n'entre pas dans la conception heideggerìenne da temps; ce monde envisagé comme visée, donc comme non-monde, marque en mense temps l'apogée d'un processus de dévalorisant nihiliste et une virtualité de re-valorisation.
Nous disions plus haut que c'était le christianisme, par l'intermédiaire de la métaphysique platonicienne, qui avait inauguré cette possibilité de représentation eidétique du monde: en effet, «pour Platon, écrit Heidegger, l’etantité de l’étant se détermine comme eidos (ad-spect, «vue »). Voilà la condition lointaine, historiale, souveraine, dans le retrait d'une secrète méditation, pour que le monde (Welt) ait pu devenir image conçue (Bild) ». Nous sommes les héritiers de cette repraesentatio. Re-presenter signifie ici: faire venir devant sol, en tant qu'obstant (entgegenstehendes). Le paradoxe peut alors se formuler ainsi: quoique nous entendions le dépasser, l'héritage platonicien doit être assumé. Dévalorisant une valeur, le monde, devenu « image» métaphysique, théologique, puis scientifique, en crée virtuellement une outre: le sujet, qui devient par là la «mesure de toutes choses ». Cotte re-création virtuelle d'une autre typologie de valeurs s'opère aussi bien dans le platonisme que dans le christianisme. Quoique Heidegger ne le précise pas, c'est la Volonté de puissance qu'il faut voir à l’œuvre à travers ce processus de représentation du monde. Celle-ci porte en elle un double mouvement: accouplée la métaphysique, elle produit, par dévalorisation du monde, le nihilisme. Mais, dès que l'époque technique s'inaugure, cette volonté de concevoir le monde, jusque-là intellectuelle, se dévoile crinale réalité : l'humain prend alors la mesure de sa force et peut se poser en valeur.
De nouvelles valeurs apparaissent par le fait que l'homme «se met lui-même en scène». De ce fait, deux possibilités se présentent ou bien, de ce nihilisme «sauverain», va surgir l'inauthentique, ou bien, procédant exactement du même processus, va pouvoir s'opérer un mouvement «historia.», radicalement opposé, de re-valorisation. De la situation de l'homme (Stellung) peuvent aussi bien naître l'humanisme dévalorisant que le surhumanisme re-valorisant, qui scellera un retour (mais sous une autre forme, celle précisément d'une « conception du monde») à l'hellénité.
Comment ce «monde devenu image conçue pour l'homme» peut-il donner lieu à deux phénomènes divergents, l'un de déclin, l'autre de renaissance? C'est que l'homme moderne, en se re-présentant le monde, l'amène devant lui, «se» le ramène (vor sieh hin und zu sich her Stellen). A partir de là, deux virtualités se dressent, parfaitement repérées par Heidegger dans cette proposition fondamentale: «Ce n'est que là où l'homme est déjà, par essence, sujet qu'est donnée la possibilité de l'aberration dans l'inessentiel, du subjectivisme au sens de l'individualisme». Telle est la première possibilité, celle qui, jusqu'a présent, l'a emporté. Le règne du sujet débouche sur le «subjectivisme» et le règne de l'homme sur l'humanisme moral et individuel. Mais écoutons la deuxième partie de la phrase: «C'est également là où l'homme reste sujet que la lutte contre l'individualisme et pour la communauté, en tant que champ et but de tout effort et de toute espèce d'utilité, a seulement un sens». Reprenons maintenant les deux hypothèses. Première possibilité: l'humanisme moral, qualifié de «repli dans l'anhistorial», utilise le règne de l'homme pour construire une «anthropologie esthético-morale» centrée sur l'idéal social individuel, la «théorie du monde» de la métaphysique s'étant changée, à partir des XVIIème et XVIIIème siècles, en «théorie de 1'homme» (19), exactement de la même façon que l'égalitarisme religieux s'était métamorphosé en égalitarisme social à la même période. Deuxième possibilité: toujours dans le cadre de ce «processus fondamental des temps modernes de conquête du monde en tant qu'image conçue», une autre conception du monde se fait jour, radicalement opposée, bien qu'héritée de la même prise de conscience «historiale». Contrairement à l'humanisme moral, qui conserve des valeurs métaphysiques désacralisées, elle pose des valeurs immanentes sacralisées, et brise le nihilisme.
Le contraste entre l'humanisme moral et ce que nous appelons le surhumanisme, est alors saisissant: Heidegger parle de «lutte entre visions du monde». Cette lutte «par laquelle les temps modernes entrent dans la phase décisive de leur avènement» et que Heidegger estime à son début, opposera en effet deux types d'hommes, qui donneront à la même question, au même appel du destin, deux réponses bien différentes. Heidegger, lapidairement, formule le dilemme: «Ce n'est pas parce que - et dans la mesure où - l'homme est devenu, de façon insigne et essentielle, sujet, que par la suite doit se poser pour lui la question expresse de savoir s'il veut et doit être un moi réduit à sa gratuité et lâché dans son arbitraire, ou bien un nous de la société; s'il veut et doit être seul ou bien faire partie d'une communauté». Les deux possibles sont donc «entrelacés». Dans le premier cas, l'individualisme, attitude «inauthentíque», se réfugiera dans la reconstruction de pseudo-valeurs, imitations des noumènes métaphysiques; l'homme, isolé dans l'individu, «existera comme humanité». Dans le deuxième cas, il existera comme «Etat, nation et peuple».
La nouvelle typologie des valeurs commence alors à se préciser. Le cadavre de Dieu peut être enterré, et les idoles, pour reprendre l'expression de Nietzsche, c'est-à-dire les idéaux dévalués de l'humanisme, «entrent dans leur époque crépusculaire». Les temps modernes peuvent éprouver du même coup, en tant que valeurs, et non plus seulement comme réalité sociétaire ou comme sous-valeurs déduites d'idéaux supra-sensibles, la destinée humaine sous sa forme la plus concrète: le devenir dans l'histoire des peuples vécus comme communautés de destin. L'humain est placé, au même titre que dans la tradition hellénique, mais sous un mode différent, au sommet de la pyramide des valeurs, alors que, dans l'humanisme, l'humain était toujours soumis à des abstractions: la morale, le bonheur individuel, les principes humanitaires, les normes du «bien» et du «mal» de la société bourgeoise, normes inauthentiques parce que dépourvues de sacré. Ces valeurs humaines ne se réclament d'aucun sens ultime. La communauté historique du peuple, affirmée par Heidegger comme nouvelle typologie de valeurs, ne trouve d'autre justification qu'elle-même. De cette manière s'opère un retour aux Grecs: dans la mesure où la communauté s'enracine dans l'éue-au-monde «physiologique» du peuple, la nature est retrouvée du même coup, la séparation entre la conscience et la nature, entre la pensée et la vie, se trouve surmontée. Les temps modernes, par la science et la technique qui les innervent et Ies pénétrant d'une Volonté de puissance effective, matérielle, sont susceptibles de conférer aux valeurs de la communauté historique du peuple Ieur auto-justification. Par la puissance matérielle mise à notre disposition, le «gigantisme», dit Heidegger, «fait son apparition». Ce gigantisme ne conduit pas nécessairement au quantitativisme ni, pour employer 1'expression de Georg Lukàcs, à la «réification». «On pense trop court, souligne Heidegger, quand on s'imagine avoir expliqué le phénomène du gigantisme à laide du seul mot d'américanisme. Car le gigantisme est bien plutôt ce par quoi le quantitatif devient une qualité propre, et ainsi un mode insigne du Grand (...) Le gigantisme devient 1'Incalculable». Autrement dit, c'est du nihilisme calculateur et de la finitude quantitative que surgit la valorisation in-calculable.
On peut dire de cette époque qu'elle est incontestablement «ombreuse», dans la mesure où te quantitativisme y provoque l'esprit de calcul et le matérialisme, mais aussi qu' « elle annonce autre chose, dont la connaissance nous est présentement refusée». Heidegger vilipende ici ceux qui en restent, comme son «disciple» Marcuse, au refus réactionnaire de la modernité technique : «Le repli sur la tradition, frelatée d'humilité et de présomption, n'est capable de rien par lui-même, sinon de fuite et d'aveuglement devant l'instant historial». Les valeurs de peuple et de communauté ne sont admissibles que si elles sont reliées au «gigantisme» que nous apporte la puissance scientifique et technique; elles n'apparaissent susceptibles de modifier les mentalités qu'au travers de la grandeur décelable dans la modernité. La «tradition», l'«enracinement», s'ils sont entendus en opposition avec celle modernité, s'ils se conçoivent indépendamment de la volonté de puissance technique, constitueront des pseudo-valeurs, porteuses d'un nihilisme absolu.
Le peuple et la modernité technique constituent ainsi deux sens de vie fondamentaux. La mort des anciennes valeurs, provoquée par l'objectivation métaphysique puis scientifique du monde. se trouve dépassée. Là où gisait la fin de tout espoir de redonner un sens à l'existence, dans « l’oubli de l'être», dans la dévalorisation quantitative (intellectuelle, puis matérielle) de toutes choses, en ce lieu même surgit ce que Heidegger nomine un questionnement créateur. Les peuples peuvent alors créer une valeur par ce même processus qui a anéanti l'ancienne typologie des valeurs: «l'objectivation de l’étant». Cette objectivation, poussée jusqu'a son paroxysme par I'arraisonnement technique, débouche - comme par exemple la physique nucléaire - sur la perfection du monde, non plus comme objet, mais comme rien. Ce rien ne se confond en aucune façon avec le «nul» du nihilisme: il change l'humain de sens, et confère au sujet agissant le monopole de la valeur. Devenu « rien», le monde retrouve son mystère, non «par lui-même», mais en tant que lieu inconnaissable d'un combat de l'homme contre lui-même, de la Volonté de puissance contre toute limitation de cotte puissance. Concrètement, il est alors donné aux peuples la possibilité d'accomplir leur destin «historial» par la Volonté de puissance scientifique et technique. Le sens de l'existence est retrouvé; Heidegger le propose à ceux qui auront la force et le courage de le supporter. Il écrit, annonçant en quelque sorte un «troisième homme» : «L'homme futur est transposé dans cet Entre-Deux (...) Ce n'est que là où la perfection des temps modernes les fait atteindre à la radicalité de leur propre grandeur, que l'histoire future se prépare». Reconnaître et assumer pour nous, en tant que peuples doués de Volonté de puissance, notre grandeur dans la grandeur de notre modernité : c'est accomplir le désenchaînement de Prométhée. Et pour que nul ne se trompe sur ses intentions, Heidegger cite, à la fin de son essai sur l'époque des conceptions du monde, ce poème de Hôlderlin intitulé Aux Allemands :
«Bien étroitement limité est le temps de notre vie
Nous voyons et comptons le nombre de nos ans
Mais les années des peuples,
Oeil morte les vit-il jamais ?»
V. VERS L 'AGE APOLLINIEN
«Comment quelqu'un peut-il se cacher devant ce qui ne sombre jamais?» (Héraclite, Fragments).
Parmi les nouvelles valeurs inaugurées à mots couverts par Heidegger, on trouve, nous l'avons vu, l'idée d'un dédoublement de l'humain entre une humanité connue comme fond au même titre que la phusis, et une « surhumanité», pour reprendre l'expression de Nietzsche, qui ne se différencierait absolument pas de la première sur le plan physique, anthropologique ou social, mais sur celui de la conscience et de la fonetion historique, et dont les représentants ne seraient commis par nul autre qu'eux-mêmes. Ces derniers seraient les «diseurs de parole», les ordonnateurs de la Volonté de puissance technique. Heidegger n'a évidemment jamais imaginé, sur le pian politique, les implications de ce nouvel état historique des valeurs. I1 ne cherche toutefois pas à en dissiper l'inquiétude - lui qui pense précisément le monde contre royaume de l'inquiétante, et I'homme comme l'inquiétant par excellence. Mais, d'autre part, il nous indique aussi d'autres chemins à suivre, en particulier ceux qui ont trait à sa conception de l'histoire. Le premier après Nietzsche, Heidegger a en effet proposé une conception non segmentaire de l'histoire, notamment dans son Introduction à la métaphysique. Cette conception débouche sur une «indication de valeur» : la recherche pour l'homme d'une communauté de destin impliquant la re-création de liens de nature spirituelle entre I'individu et son peuple, entre le Dasein et le Volk. C'est cette démarche intellectuelle que nous voudrions examiner maintenant.
L'existence (Dasein) nous fait «être dans le monde» (in der Welt sein) ; elle nous fait, par là, «sortir de nous mêmes». Le monde, en effet, n'est pas seulement déchiffrable comme «monde objet» (Dingwelt) ou comme monde utilitaire (le Zeugwelt des scientistes). Heidegger regarde le monde-pour-l'homme comme «monde-avec-soi» (Mitwelt). Exister, c'est être dans le monde, et donc d'abord vivre avec autrui (Dasein ist Insein-Mitsein). Mais comment être-avec-autrui ? Certainement pas en considérant autrui comme l'humanité. Dans L'être et le temps, le Mitsein s'accomplit dans le travail pour la communauté. Dans Les commentaires sur la poésie de Hölderlin, publiés en 1944, le Mitsein prend une connotation irrationnelle: il est fonde sur la «révélation affective» (Befindlichkeit). Celle-ci ne peut naître qu'entre des individus qu'unissent un même passé et un même projet historique. L'intelligence rationnelle apparaît donc inapte à réaliser le Dasein humain. Mais ce dernier, que seul peut combler la «révélation affective», se trouve face à un autre problème, tenant au fait que la «révélation affective», parce qu'elle est plus réaliste que la raison, nous met en face du tragique et nous fait prendre conscience de notre déréliction (Geworfenheit). Trois voies s'ouvrent alors: soit l’ivresse consolante de la facticité, et c'est le nihilisme du monde moderne; soit l'angoisse poignante de celui qui a cru et ne serait plus, parce qu'il a pris conscience de la réalité des choses; soit enfin l'attitude guerrière et volontaire du Dasein qui «se prend en charge», qui se saisit de lui-même comme projet (Entwurf).
Ce «projet» ne doit pas se comprendre comme une visée personnelle, mais comme la participation à un Dasein collectif et historique, nécessairement lié à un peuple. «Habiter» et «bâtir» constituent pour Heidegger deux fonctions-clés du Dasein, qui entend assumer son destin d'avoir été «jeté au monde» et qui decide d'échapper à la «déchéance» (Verfallen). Notre civilisation souffre de cette déchéance. Elle est soumise à la domination du « on» (Man)». An-historique, elle poursuit une nouveauté superficielle ; atteinte de néophilie pathologique, elle est rétive au devenir. La soif de sécurité n'est pas une antidote contre l'angoisse. Cette angoisse apporte à I'homme contemporain l'expérience du «nul», qui ne porte pas seulement sur le monde, mais sur lui-même. Il éprouve sa propre nullité. Heidegger estime que notre civilisation expérimente le néantissement (Nichtung). Mais il y a pire: étrangere à tout sentiment tragique, cette civilisation ne comprend pas l’angoisse qu'elle ressent. Au lieu de l'assumer et de la sublimer dans un projet, elle tente de la fuir. Nihiliste et humaniste, elle refuse le tragique et son «étrangeté inquiétante» (Unheimlichkeit). Elle se réfugie alors dans le pire des refuges : le petit familier, le bonheur de l'immédiateté individuelle. Le Dasein, appauvri, mutilé, ne meurt mémé plus d'angoisse ou de déréliction, mais il se recroqueville et s’évanouit. Le destin se résorbe dans la subjectivité de l'atomisation individuelle. Les peuples s'endorment, puis meurent. Cette déchéance repose sur une conception inauthentique de la temporalité (Zeitlichkeii), provoquée par la métaphysique déchue de l'humanisme. L'homme refuse d'erre ce qu'il est, un être-pour-la-mort (Sein zum Tode), et s'étourdit dans l'illusion d'un désir d'éternité qu'il croit trouver dans la mondanité quotidienne. Une telle conception du temps repose sur une vulgarisation de la temporalité, et sur des idées de «fin de la mort» et de fin linéaire de 1'histotre comparables à celles que I'on trouve dans les philosophies du «progrès». Tout projet historique de devenir est alors rejeté comme «angoissant», pare qu'il implique que l'homme regarde la mort en face.
 Rejetant la conception segmentaire du temps qui précipite l'homme vers le «repos» et la fin de tonte angoisse, Heidegger présente un autre type humain. Ce type caractérise l'homme qui, consentant à la mort, «prend une décision anticipante» résolue et va «au devant de la mort sans pour autant renoncer à son projet d'existence. L'existence (Dasein) est alors acceptés tragiquement mais sans équivoque comme souci (Sorge); l'activité humaine est assumée comme «vie soucieuse» (Fürsorge). L'authenticité de l'existence individuelle consiste à dépasser la mort individuelle, à admettre que l'avenir se confond avec l'advenir à soi, c'est-à-dire l'avancée vers sa propre mort. Or, seule la mobilisation du Dasein dans une communauté, dans un peuple, seul l'altruiste affectif trouvé par le don de soi à l'Autre est susceptible de surmonter le tragique de l'existence individuelle. Heidegger n'hésite d'ailleurs pas à parler d'«amour», mais en un sens autrement plus concret, plus réel que l'amour chrétien, où 1'on est seulement sommé d'aimer tout le monde - c'est-à-dire personne.
Rejetant la conception segmentaire du temps qui précipite l'homme vers le «repos» et la fin de tonte angoisse, Heidegger présente un autre type humain. Ce type caractérise l'homme qui, consentant à la mort, «prend une décision anticipante» résolue et va «au devant de la mort sans pour autant renoncer à son projet d'existence. L'existence (Dasein) est alors acceptés tragiquement mais sans équivoque comme souci (Sorge); l'activité humaine est assumée comme «vie soucieuse» (Fürsorge). L'authenticité de l'existence individuelle consiste à dépasser la mort individuelle, à admettre que l'avenir se confond avec l'advenir à soi, c'est-à-dire l'avancée vers sa propre mort. Or, seule la mobilisation du Dasein dans une communauté, dans un peuple, seul l'altruiste affectif trouvé par le don de soi à l'Autre est susceptible de surmonter le tragique de l'existence individuelle. Heidegger n'hésite d'ailleurs pas à parler d'«amour», mais en un sens autrement plus concret, plus réel que l'amour chrétien, où 1'on est seulement sommé d'aimer tout le monde - c'est-à-dire personne.
Le Dasein, chez Heidegger, est entraîné sur le fleuve du devenir. Toute illusion sur un arrêt des temps, sur une immobilisation des instants, sur une récompense finale, est dissipée. Bien supérieur au modèle chrétien d'existence, le Dasein n'a pas besoin du mythe mensonger de la victoire sur la mort pour agir. Il est d'une nouvelle façon pleinement et authentiquement humain, c'est-à-dire, par rapport à la conscience chrétienne qu'il dépasse comme la dépassait déjà en humanité la conscience grecque, qu'il se pose comme sur-humain.
La conception heideggérienne de la temporalité historique apparaît alors en toute clarté. L'homme-existant, le Dasein, totalise dans son présent t'«ayant-été» (Gewesenheit), qu'il assume, et !e «projet» (Entwurf) dont il participe en lien avec les siens. La conjonction du passé et du projet «ad-venir» rend présent le passé. Celui-ci, comme l'avenir, est rendu présent dans le maintenant. L'existence individuelle confond sa temporalité «subjective» avec l'histoire de sa communauté. La temporalité, qui est toujours vécue au niveau de la conscience individuelle, devient historicité. L 'avenir, la dimension ca pitale, incite le Dasein à faire retour au passé, rendant par là signifiant le maintenant qui se confond avec l'existence humaine. Heidegger qualifie lui-même cette conception du temps, que l'on trouve exposée notamment dans l'Introduction à la métaphysique, de «tridimensionnelle», par opposition aux conceptions uni- ou bidimensionnelles du temps linéaire, cyclique ou segmentaire. Cette conception est héritée, non pas de Nietzsche, mais de Sophocle et des poètes tragiques grecs, auprès desquels Nietzsche était d'ailleurs allé la puiser.
Pour Heidegger, Nietzsche a scellé la fin de la métaphysique, mais sa pensée elle-même appartienne encore à la métaphysique. «Que Nietzsche, écrit Heidegger, ait interprété et perçu sa pensée la plus abyssale à partir du dionysiaque tend à prouver qu'il a dû encore la penser métaphysiquement et qu'il ne pouvait la penser autrement. Mais (...) cette pensée la plus abyssale cache en elle quelque chose d'impensé, qui est en même temps fermé à la pensée métaphysique». Heidegger, nous l'avons dit, dépasse Nietzsche, exactement au sens où Zarathoustra appelait ses disciples, pour le suivre, à «dépasser jusqu'aux Grecs». Nietzsche ayant constitué l'intermède dionysiaque de la pensée occidentale, Heidegger inaugure l'ère apollinienne de ceste pensée, elle-même prélude annonciateur d'une ère apollinienne de l'action.
En quoi Heidegger ouvre-t-il la possibilité d'un âge apollinien - terme qui, reconnaissons - le, ne se trouve pas dans son œuvre? La position de Heidegger sur la métaphysique et la technique est trompeuse. Elle abuse les exégètes qui ne savent voir en lui qu'un adversaire de la technicité et un «chercheur de l'être». Le fait qu'il se lamente sur l'uniformité «diabolique» du monde moderne n'est pas, nous l'avons vu, contradictoire avec sa glorification de l'essence de la technique. C'est ainsi que, dans son essai sur Le dépassement de la métaphysique, il écrit: «L'usure de toutes les matières, y compris la matière première homme, au bénéfice de la production technique (...) est déterminé par le vide total où 1'étant, où les étoffes du réel, sont suspendues». Par ces mots, la civilisation de l'économie et de la marchandise se trouve analysée, bien plus profondément que ne le feront plus tard les «situationnistes», comme la «mise-en-ordre entendue comme la forme sous laquelle l'action sans but est mise en sécurité». L'étant, c'est-à-dire le monde réel, se trouvant dévalorisé au terme du processus métaphysique du nihilisme qui s'achève dans l'humanisme, il ne reste plus aux hommes qu'à l'organiser mécaniquement. La technique, envisagée comme technique-pour-l'économie, comme instrument d'ordre heureux, n'est plus que le moyen de «mise à sac de la terre». «Ce cercle de l'usure pour la consommation, écrit encore Heidegger, est l'unique processus qui caractérise l'histoire d'un monde devenu non-monde (Unwelt)». Ce monde de la dévalorisation du réel et du mésemploi de la technique, c'est-à-dire son emploi nihiliste humaniste, son emploi absurde comme l'instrument d'une métaphysique dévaluée (la recherche de la morale du bonheur), aboutit «à I'exclusion de ce facteur essentiel, les distinction de nations et de peuples». Heidegger ajoute: «De mémé que la distinction de la guerre et de la paix est devenue caduque, de même s'efface aussi la distinction du national et de l'international. Qui pense, aujourd'hui, en "Européen" n'a plus à craindre qu'on lui reproche d'être un internationaliste. Mais il est vrai aussi qu'il n'est plus un "nationaliste" puisqu'il n'a pas moins d'égard au bien des autres "nations" qu'au sien propre».
Cette usure de l'étant, selon Heidegger, doit s'entendre, non pas tant comme 1'àge de l'égalitarisme que comme le règne de l'uniformité: «Avant toutes les différences nationales, cette uniformité de l'étant entraine l'uniformité de la direction, pour laquelle toutes les formes politiques ne sont plus qu'un instrument de direction parmi d'autres. La réalité consistant dans l'uniformité d'un calcul traduisible par des plans, il faut que l'homme, lui aussi, entre dans cette uniformité s'il veut rester en contact avec le réel. Un homme sans "uni-forme", aujourd'hui, donne déjà une impression d'irréalité, tel un corps étranger dans notre monde. L'étant s'étend dans une absence de différence qui n'est plus maîtrisée que par une action et une organisation régies par le "principe de productivité". Ce dernier parait entraîner un ordre hiérarchique, mais, en réalité, il est fondé sur 1'absence de toute hiérarchie (...) vu que le but de la production n'est rien de plus que le vide uniforme (...) l'absence de différence qui accompagne l'usure totale provient d'une "volonté positive" de n'admettre aucune hiérarchie, conformément au primat du vide de toutes les visées».
Heidegger oppose donc la volonté positive de 1'àge nihiliste à la Volonté de puissance, qui, elle, est salut, parce qu'elle comporte un projet et un dessein hiérarchisant. La simple volonté qui gouverne, rationnellement, economiquement, notre monde appartient au domaine de l'inauthentique recherche d'une stabilité heureuse. La Volonté de puissance relève au contraire du devenir. Heidegger précise: «La terre apparaît comme le non-monde de l'errante. Du point de vue de l'histoire de l'être, elle est l’astre errante ». Or, c'est ici qu'il est aisé de se faire un contresens. Car Heidegger condamne et glorifie en mente temps la technique - de mente qu'il oppose la Volonté de puissance à la volonté positive, appelée aussi «volonté sans visée». Comparons, pour aliène comprendre, deux citations de Heidegger. La première est celle-ci: «Le bouleau ne dépasse jamais la ligne de son possible. Le peuple des abeilles habite dans son possible. La volonté seuls, de tour cotés s'installant dans la technique, secoue la terre et l'engage dans les grandes fatigues, dans l'usure de l'artificiel (...) Les pratiques qui organisent cette contrainte et la maintiennent dominante, naissent de l'essence de la technique qui n'est autre chose que la métaphysique en train de s'achever. L'uniformité complète de toutes les choses humaines de la terre, sous la domination de la volonté de volonté, fait ressortir le non-sens d'une action humaine posée comme absolue». Nous sommes parti, apparemment, devant une condamnation, un rejet de la technique. Et de fait, pour ceux qui, dans leur lecture, en restent à ce stade, il semble bien que Heidegger s'inquiète de cette époque de domination de la terre où, comme le disait Hegel dans la Phénoménologie de l'esprit, «la conscience absolue de soi même devient principe de la pensée». Mais voyons maintenant notre deuxième citation. Dans La question de la technique, Heidegger déclare : «La technique n'est pas ce qui est dangereux. Il n'y a rien de démoniaque dans la technique, mais il y a le mystère de son essence. C'est l'essence de la technique, en tant qu'elle est un destin de dévoilement, qui est le danger (...) La menace qui pèse sur l'homme ne provient pas des rnachines». L'idée, cette fois, est tout-à-fait différente. Le danger, entendu par Heidegger à la tois criminel un péril et une noblesse, provenaient en effet du processus historique de l'arraisonnement. C'est pourquoi Heidegger ajoute, citant Hölderlin: «Mais là où il y a le danger, là aussi croît ce qui sauve».
Ce qui «sauve» est donc aussi ce qui constance le «danger». L 'élément salvateur, tout comme l'élément menaçant réside dans l'essence de la technique, autrement dit dans la volonté de puissance devenue conscience voulue. «Là où il y a le danger...», c'est-à-dire au cœur du processus technique de l'arraisonnement de l'humain et de la terre, «là aussi...», c'est-à-dire en ce lieu même où se déchante la technique, «croit ce qui sauve», c'est à dire s'observe, en devenir virtuel, ce qui imposera des nouvelles valeurs. La Volonté de puissance, latente et «inconsciente» dans la technique, présente mais occultée dans l'arraisonnement, peut devenir auto-conscience et prendre en charge l'arraisonnement. A la volonté-sans-visée peut succéder la volonté douée de projet. Et puisque l'essence de la technique, l'arraisonnement, se confond avec le déclin de la métaphysique, cette essence a nécessairement hérité de ce qui gisait, de ce qui serpentait souterrainement dans la métaphysique occidentale, à savoir la Volonté de puissance. Le troisième âge sera alors celui où la Volonté de puissance pourra éclore, éclater au plein jour de la claire conscience. Occulte, métaphysicienne ou chrétienne, dans son premier âge, la Volonté de puissance ne s'exprimait que dans le logos. Dionysiaque dans son deuxième âge, celui de la technique moderne de l'époque nihiliste actuelle, elle peut désormais s'assumer comme tel, se reconnaître comme acte planifié de puissance, dans ce que nous avons appelé l'age apollinien. (Car Apollon est celui qui maîtrise, par l'ordonnance planifiée et rigoureuse de t'entendement, mais qui, en métro temps, donne sens et valeur, qui rend religieux le monde organisé).
Du nihilisme lui-même renaissent ainsi des valeurs. Comment la parole cité plus haut de Hölderlin, Heidegger écrit dans La question de la technique: «Sauver (retten) est reconduire dans l'essence (au sens de "nature profonde") afin de faire apparaître celle-ci pour la première fois, de la façon qui lui est propre. Si l'essence de la technique, l’arraisonnement, est le péril suprême (...) alors, il faut que ce soit justement l'essence de la technique qui abrite en elle la croissance de ce qui sauve».
Quelles valeurs la Volonté de puissance devenue consciente va-t-elle alors «présenter»? Pour répondre à cette question, Heidegger procède par allusions poétiques et mythiques. Enfermer les nouvelles valeurs dans une définition «rationnelle», ce serait en effet, par avance, les dé-florer, les tuer «dans l'œuf» et, déjà, jeter les bases d'un autre nihilisme. Aussi Heidegger se borne-t-il, retrouvant un geste de souveraineté immémoriale, à designer le chemin, en nous disant que la sente des nouvelles valeurs conduit vers une nouvelle Grèce, à laquelle il donne le beau nom d'Abend-Land, terme qu'on ne saurait traduire par «Occident» et que l'on a remarquablement rendu par le néologisme franco-grec d'«Hespérie» (du grec hespera «le soir»), dans lequel nonne le Leitmotiv de l'espérance. Dans le texte Pourquoi des poètes, Heidegger écrit: «Ceux qui risquent le plus... ils apportent aux mortels la trace». Ceux qui risquent : nous avons vu que le risque était de subire le chemin de l'arraisonnement technique en le rendant conscient de la Volonté de puissance. La trace c'est la sente forestière où nous pouvons choisir de nous enfoncer. Mais où mène cette trace? Qui donc y poursuivons-nous? Vers quel monde nous porte-t-elle ? Heidegger répond: «Ceux qui risquent le plus... ils apportent aux mortels la trace. La trace des dieux enfuis dans l'opacité de la nuit du monde».
VI . L'HESPERIAL
«Aucune méditation sur ce qui est aujourd'hui ne peut germer et se développer, à moins qu'elle n'enfonce ses racines dans le sol de notre existence historique par un dialogue avec les penseurs grecs (...) Ce qui à l'aube grecque a été pensé ou dit, vient sur nous. Pour éprouver cette présence de l'histoire, nous devons nous détacher de la représentation historique de l'histoire» (Heidegger, Science et méditation).
Aussi gênant que cela puisse paraître aux yeux de certains, c'est bien aux dieux grecs que pense Heidegger lorsqu'il évoque la « trace » de ce qui doit être retrouvé et que la Volonté de puissance doit pouvoir restituer comme valeurs aux Européens. C'est donc bel et bien une sorte de «paganisme» que Heidegger assigne aux temps modernes. Au monde désespéré de l'humanisme rationnel, il oppose l'ad-venance, au cœur de la civilisation technique moderne, du sacre (das Heilige). Il l'appelle de ses voeux en puisant dans les ouvres de Hölderlin et de Rilke, poètes de l'essence et du retour des dieux. Les textes sont clairs: le salut, pour Heidegger, procédera d'un recommencement grec, c'est-à-dire des retrouvailles, de l'accord, sous une forme historiale différente, du sacre et de la technique, exactement comme à l'aube des temps helléniques. Ainsi pourra s'accomplir l'Eternel retour de l'identique, que Nietzsche avait pressenti sans pouvoir lui conférer un contenu. Accoupler l'irrationnel du sacré et l'immanente matérielle de l'arraisonnement technique, la rationalité planifiée de la mobilisation de la terre et l'inspiration «romantique» que peut susciter la renaissance du sentiment religieux grec, voilà quelle visée Heidegger entend donner à la Volonté de puissance.
L'Hespérie, la «terre du couchant» (Abend-Land), marque alors ce que doit devenir l'Occident, ce vers quoi il doit se nier et se dépasser en se niant, pour reproduire, sous une autre forme, celle de l'immanence sacrée des valeurs terrestres et techniques, la vue du monde de cette aurore que constitua J'hellénisme pré-platonicien. Ainsi cette même Grèce qui, à la suite du platonisme, acclimata en Europe la métaphysique et le judéo-christianisme, est-elle destinée, dans notre présent, à en surmonter la mémoire. C'est en poursuivant, à la trace, les dieux grecs, que nous avions oubliés en tant que passe, mais qui sont appelés maintenant à surgir dans nutre avenir, métamorphosés, que nous régénèrerons notre histoire.
Dans Pourquoi des poètes, Heidegger cite l'Hymne des titans de Hölderlin :
«... et pourquoi des poètes en temps de détresse ?
«Mais ils sont, dis-tu, comme les prêtres sacrés de Bacchus
«Qui de pays en pays, errent dans la nuit sacrée».
Le poète, comme le penseur, au milieu de la nuit, à l'apogée du nihilisme et de l'oubli, annonce le matin. «Dieu est mort», disait Nietzsche. «Il faut retrouver les dieux», répond Heidegger, mais en donnant à ce terme un sens bien différent de celui qu'entendaient les Grecs. Les dieux, ici, signifient la ré-advenance du sacré, à la fois mythique et conscient, destiné à fonder une régénération de l'histoire. Heidegger est contraint de s'exprimer par allégorie puisque, à ce degré de la pensée, il sort du logos et donne à sa propre parole le statut de mythe fondateur: «Le dieu du cep (Dionysos) sauvegarde (...) le lieu férial de l'union des dieux et des hommes. Ce n'est que dans la région d'un tel lieu, si tant est qu'il y en ait un, que peuvent rester des traces des dieux enfuis, pour les hommes dépouillés de dieux (...) Les poètes ressentent la trace des dieux enfuis et tracent aux mortels, leurs frères, le chemin du revirement (...) voilà pourquoi, au temps de la nuit du monde, le poète dit le sacré (...) A nous autres d'apprendre à écouter le dire de ces poètes».
Cette régénération de l'histoire, à laquelle Hölderlin, à travers Heidegger, nous appelle, est risquée. Mais ce risque va de pair avec le caractère inquiétant (unheimlich) de l'humain. Or, pour les Grecs, l'humain n'est pas seulement inquiétant (deinon); il tend vers le surhumain, et c'est en cela qu'il est «le plus inquiétant» (to deinotaton). Heidegger cite le fragment 52 de Héraclite: «Le temps du monde est un enfant, jouant au tris-trac; d'un jeu d'enfant, il est le règne». Il le commente en les termes : «Au risque appartient le projet dans le péril». C'est que le retour des dieux ne doit pas se comprendre comme une «fuite vers les dieux de la Grèce antique», paganisme de pacotille dont se moque Heidegger, en l'assimilant à l'inanité contemporaine des «croyances religieuses». Ce «retour» sera le recommencement grec, la réconciliation entre la «science» et la «philosophie», entre la technique planétaire et la «poésie», entre l'instrumentalité et la spiritualité, entre la subjectivité aux prises avec la matière et le sacré. Cetre réconciliation, opérée au sens de la Volonté de puissance, nous remettra dans une situation destinale identique à celle de l'aurore fondatrice grecque (mais non dans une situation semblable, puisque, entre-temps, la conscience européenne a accédé au stade épochal de la conception du monde).
La trace des dieux enfuis, inquiétante poursuite, nous mène donc à un recommencement qui n'a rien d'un retour en arrière vers le passé connu, mais qui s'enfonce résolument vers ce qu'il y a de plus risqué dans la modernité. Dans une de ses conférences, Heidegger précise quel pourrait être l'augure de ce recommencement: utilisant le terme de volonté, il place celle-ci, par l'intermédiaire de la «science», comme «gardienne du destin du peuple», comme «volonté d'une mission spirituelle et historique de notre peuple». Ainsi, le recommencement grec peut-il inaugurer la présence (Anwesenheit) du sacré dans la conscience historique et l'advenance du peuple - et non plus de l'atome individuel - comme mode de la subjectivité. Le surgissement «hespérial» de cette «nouvelle Grèce» est pensé comme une rupture historique (Aufbruch), comme une sortie violente (Ausbruch) de la modernité inauthentique du nihilisme humaniste, mais aussi cormme irruption (Einbruch) de l'avenir risqué dans notre présent confortable où la science est voulue comme «instrument du bonheur». Cette irruption ne peut s'accomplir que sous les traits de la violence, d'un «brisement» (Zerbrechen) inquiétant et non paisible, et c'est ainsi qu'elle nous fera rentrer dans l'histoire dont nous sommes sortis. Portée par le fleuve du devenir, la conscience qui aura vécu ce recommencement grec, devra comprendre le monde comme «défrichement» (Umbruch), comme travail d'abattage.
Nous retrouvons ainsi la métaphore mythique de la forêt et le bûcheron. Déjà, nous avons dit que suivre le Holzweg nous mènerait dans la forêt, «au cœur de notre travail». Et c'est bien d'un travail de bûcheron qu'il s'agit. Le risque de l'histoire se compare au labeur des bûcherons: rompre (brechen) les arbres et survivre au danger de leur chute. Où nous mène la sente forestière? Elle nous mène à la cité des bûcherons, qui vit sous le signe de la «mixture» (Bruch). Rappelons-nous alors la sentence héraclitiennee panta rei (tout coule en rythme, tout coule en se brisant), dont la véritable signification n'est autre que: «Le monde s'écoule par ruptures successive».
Mais quel sera le premier travail du bûcheron, celui qui accompagnera le défrichement? Ce sera la dislocation (Auseinanderbrechen) du monde ancien. Cette destruction visera une certaine vision que nous avions de notre passé. Le recommencement grec suppose en effet d'abord la destruction d'un passé et le choix d'un autre. Mais ce «nouveau passé» ne saurait étre considéré dans une temporalité antécédente, située derrière nous, comme picuse «mémoire»; son caractère de nouveauté provient de ce qu'il surgit, par notre volonté, devant nous. « Devant », c'est-à-dire qu'il doit être compris sous le mode du «faire-surgir» (er-springen) (somme la «cité des bûcheron» surgit devant les pas de 1'aventureux marcheur forestier) et du «pro-venir» (geschehen). Ainsi seulement, le passé grec sera «histoire», c'est-à-dire provenance advenance (Geschichte).
Dans l'une de ses conférences, Heidegger déclare: «Le commencement est encore là. il n'est pas derrière nous somme ce qui a été il y a longtemps, mais il se tient devant nous. Le commencement a fait irruption (Einbruch) dans notre avenir, il dresse au loin, comme une disposition lointaine à travers nous, sa grandeur qu'il nous faut rejoindre (...) Nous nous voulons nous-mêmes. Car la force jeune du peuple, sa force la plus jeune qui est au-delà de nous, s'empare de la route, celle-là en a décidé déjà. La splendeur et la grandeur de ce départ qui est rupture, nous le comprenons pleinement si nous portons en nous le sang-froid profond et vaste que l'antique sagesse grecque a exprimé par cette parole: Toute grandeur est dans l'assaut».
La conscience contemporaine et ses philosophies ne sont pas encore parvenues à en finir avec l'humanisme. Son cadavre se décompose en humanitarisme. Mais le lancinant discours moral de notre temps, son conformisme carcéral, sonne comme un discours crépusculaire. Nous somme loin des claironnements optimistes des idéologies humanitaires du progrès. Les idéologies et les intellectuels, toujours attachés aux problématiques de l'idéal moral, sont à la fois conscients de s'y trouver enfermés et qu'en sortir leur serait insupportable (car cela es obligerait à suivre l'angoissante ruée de la philosophie nietzschéenne par-delà le bien et le mal). L'attachement à la morale humanitaire, en philosophie des valeurs comme en politique, prend alors tout son sens : celui d'une conscience malheureuse, déçue, geignante, spectatrice coléreuse et larmoyante de l'évaporation de ses utopies. En termes heideggériens, cette attitude de la conscience contemporaine peut être analysée somme une incapacité «historiale» à franchir un nouveau palier d'existence. Au contraire, écrit Heidegger, «l'homme dont l’essence est celle qui est voulue à partir de la Volonté de puissance, voilà le surhomme (Uebermensch), celui qui doit détenir l'irrésistible puissance (Uebermacht) pâtir accomplir sa souveraineté» (Chemins qui ne mènent nulle part, op. cit.). La conscience humaniste est condamnée à vivre avec son inessentielle (Unwesen), qui provient du fait qu'elle gît en déphase par rapport au devenir «historial» des temps modernes, lequel dévoile l'essence de la Volonté de puissance.
La nécessite se déploie, écrit encore Heidegger, d'aller au-delà de nomine ancien, de le surpasser (...) L'homme ancien voudrait continuer d'être 1'homme ancien ; en même temps, il est déjà le consentant de l'étant, de cette étant dont l'être commence à se manifester comme Volonté de puissance» (ibid.) - c'est-à-dire de ce monde rend conscience d'elle-même la Volonté de puissance comme principe de son devenir. L’homme ancien se subit lui-même ; il est comme atteint de schizophrénie. Refusant de renoncer à la modernité, il n'entend pas admettre pour autant l'installation de la Volonté de puissance. Sa position est intenable. La physique nucléaire ou I'ingénierie génétique heurtent sa conscience, mais il n'a ni la force ni la volonté de les abandonner. Alors, ces techniques le dirigent. Ils devient leur commis. Il se place lui-même plus bus que les machines et les techniques.
Heidegger installe donc dans une subjectivité entendue somme destin d'un peuple et d'une communauté le «lieu du vouloir du surhomme». Ces deux éléments, la Volonté de puissance et la définition de son lieu d'accomplissernent, ne sont toutefois jamais présentés en même temps, et c'est en comparant les textes que 1'on obtient la clé de la pensée de Heidegger : le nouveau lieu des valeurs sera l'ordre conscient d'une Volonté de puissance utilisant la science et la technique à travers un autre niveau «historial» de la conscient humaine.
La lutte pour le «règne de la terre» est désormais seul susceptible de fonder de nouvelles tables de valeurs et de redonner un sens sacré à l'existence de la conscience. Suprême ironie de l'histoire en reléguant le sacré hors du monde, la métaphysique a dévalué le lieu où elle posait et nommait ses valeurs - le supra-sensible. Du même coup, elle a, sans le vouloir, contribué à libérer dans le monde la Volonté de puissance et à faire revenir, avec une force virtuelle bien plus considérable qu'aux temps païens, le sacré à son lieu d'origine: la conscience humaine comme partie indétachable de la nature. Commentant ce processus, Heidegger peut écrire: «La terre devient le centre de toute position et de tout débat, objet d'un assaut permanent» - ce qui corrobore la prédiction faille dans le Gai savoir : «Le temps viendra où la lutte pour le règne de la terre sera menée, et elle le sera au nom de doctrines philosophiques fondamentales».
Le surhomme, l'homme de l'auto-conscience qui a objectivé le monde, ne devient surhomme que s'il veut cet acte comme tel, que s'il prend la responsabilité du meurtre de Dieu, que s'il l'assume «historialement». «Par cette mise à mort», précise Heidegger, «l'homme devient autre. Il devient celui qui supprime l'étant (das Seiende) au sens de 1'étant en soi (das Seiend)». Et il ajoute, ce qui n'est compréhensible que si l'on saisit la double signification, dialectique et «hístoriale», du nihilisme «L'essence du nihilisme réside en l’histoire (...) Si la métaphysique est le fond historial de l'histoire mondiale déterminée occidentalement et européennem ent, alors cette histoire est nihiliste en un sens tout nouveau (...) Ni les perspectives politiques, ni les perspectives économiques, ni les perspectives sociologiques, techniques ou scientifiques, pas mense les perspectives religieuses et métaphysiques, ne suffisent pour penser ce qui advient en ce siècle du monde (...) Dans quelle mesure l'homme est-il forcené? Il est for-cené, c'est-à-dire hors du sens. Car il est sorti du plan de i'homme ancien. Cet homme, de la sorte déplacé, n'a pour cette raison rien de commun avec le genre des voyous publics, avec ceux qui ne croient pas en Dieu».
Que ceux qui ont des oreilles entendent.
1 Jean-Michel Palmier, Les écrits politiques de Heiddeger, L’Herne, 1968.
2 C’est-à-dire une description phénoménale de la pensée de l’être.
3 Henri Arvon, La philosophie allemande, Seghers, 1970.
4 Lettre sur l'humanisme, Aubier, 1964. Heidegger précise, jetant un regard en arrière sur son œuvre, que son dessein n'est pas de «philosopher» au sens habituel du terme, mais, par un travail de la pensée qui n'a rien d'«intellectualiste», de répondre aux questions historiques touchant au sens de notre époque. La «question de l’être» ne doit donc pas se comprendre comme un problème philosophique, mais comme une question historique qui concerne l'ensemble de la civilisation «occidentale» devenue planétaire.
5 Hussert estimait que L 'être et le temps avait trahi la méthode phénoménologique, et reprochait à Heidegger de faire de I'anthropologie.
6 La poiésis grecque désigne à la fois ce que nous entendons par poésie et l'activité créatrice des «métiers» les plus divers..
7 La traduction figure dans Chemins qui ne mènent nulle part (Gallimard, 1962).
8 Il s'agit des sentes tracées par les bûcheron qui reviennent de la clairière de coupe. Elles ne traversent pas la forêt, mais constituent les Seuls sentiers conduisant «au cœur des boss».
9 Cf. la conférence Qui est le Zarathoustra de Nietzsche?, publiée dans le recarci Essais et conférences (Gallimard, 1958).
10 «Le plus inquiétant» (o deinotatos) : c'est ainsi que les poètes désignaient l'homme. Il faut entendre «le plus inquiétant de tous les hôtes de la terre», par opposition aux animaux qui, eux, n'ont rien d'inquiétant.
11 Dans le tome II de son Nietzche, Heidegger commente l'idée selon laquelle, si «le christianisme ne fut qu'un platonisme pour le peuple», de nos jours, les noumènes platoniciens n'étant plus portés par les mythèmes chrétiens, toute métaphysique «a perdu sa force historialement structurante.
12 Les valeurs «vécues comme existence» recouvrent ce que Ernst Jünger, dans Der Arbeiter (1932), désignait comme Lebenstand, «classe-de-vie». Le «travail» était alors appelé à devenir la classe-de-vie des temps moderne. Heidegger dépassera ce point de vue, mais conservera l'idée d'une intégration des valeurs à l'existence vécue. Il récusera toutefois le terme de «travail», préférant ne pas enfermer les valeurs vécues dans une dénomination unique. Nommer le «travail» comme classe-de-vie, n'est ce pas déjà, d'ailleurs, l'objectiver et le dévaloriser ?
13 Chemins qui ne mènent nulle part, op. cit.
14 Le monothéisme peut être aussi un paganisme non dualiste. C'est parce que le judéo-christianisme fut à la fois un monothéisme et un dualisme métaphysique qu'il dévalorisa le sacré et finir en morale.
15 On peut rapprocher cette conception heideggérienne de l'histoire de celle de la physique moderne: le temps «de la conscience humaine», néguentropique et porteur d'information, pourrait se comparer à une spirale ascendante, mais qui serait infléchie vers le bas par la spirale descendante du temps «physique», entropique et «désinformant». Voir, sui- cette question: Joël de Rosnay, Le macroscope (Seuil, 1975); Oliver Costa de Beauregard, La notion de temps (Hermann, 1963) et Le second principe de la s cience du temps (Seuil, 1963), où sont exposées les conceptions modernes du temps «non-segmentaire».
16 Cette idée de la «non-neutralité» de la technique se retrouve intégralement chez Jünger.
17 Cf., avec certaines réserves, le livre de Bernard d'Espagnat, A la recherche du réel (Gauthier-Villars, 1979), qui expose les idées modernes des physiciens sur la nature du «réel».
18 Les contradictions culturelles du capitalisme, PUF, 1979.
19 Notamment avec Descartes, puis avec Kant. Dans La Critique de la raison pure, de Kant, le primat du sujet est affirmé comme sujet percevant, ce qui fait suite à la conquète cartésienne de la subjective intellectuelle.
00:07 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, heidegger, nouvelle droite, guillaume faye |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 février 2009
Heidegger e l'Università
Heidegger e l’Università
 In tempi in cui torna a farsi prepotente il dibattito sull’educazione superiore, vale la pena di riprendere in mano un’opera minore del grande esistenzialista tedesco Martin Heidegger (1889 – 1976, in foto). Si tratta del suo discorso d’insediamento al rettorato: “Die Selbstbehauptung der deutschen Universität” – pubblicato in Italia dall’editrice “Il melangolo” col titolo “L’autoaffermazione dell’università tedesca” – il quale è stato più volte accusato dalle solite ‘anime pie’ di collusione col nazionalsocialismo. Tuttavia, come mettono bene in chiaro gli apparati critici inclusi nel volumetto, non ultima la prefazione del figlio Hermann Heidegger e il breve scritto “Il rettorato 1933/34” (“1933/34”) redatto dal filosofo nel 1945, non solo non vi è il minimo riferimento al nazionalsocialismo nel testo, ma addirittura questo discorso non fu affatto gradito dal Partito. D’altra parte l’indubbio valore filosofico del testo fu ammesso anche da filosofi di sinistra quali Karl Jaspers (1883 – 1969) e Karl Löwith (1897 – 1973): “L’autoaffermazione dell’università tedesca è un discorso di elevato tenore filosofico e di grandi pretese, un piccolo capolavoro nella formulazione e nella composizione. Alla luce della filosofia è un’opera straordinariamente ambigua… e chi lo ascolta alla fine non sa se deve prendere in mano la silloge dei presocratici curata da Diels o marciare con le S.A.”
In tempi in cui torna a farsi prepotente il dibattito sull’educazione superiore, vale la pena di riprendere in mano un’opera minore del grande esistenzialista tedesco Martin Heidegger (1889 – 1976, in foto). Si tratta del suo discorso d’insediamento al rettorato: “Die Selbstbehauptung der deutschen Universität” – pubblicato in Italia dall’editrice “Il melangolo” col titolo “L’autoaffermazione dell’università tedesca” – il quale è stato più volte accusato dalle solite ‘anime pie’ di collusione col nazionalsocialismo. Tuttavia, come mettono bene in chiaro gli apparati critici inclusi nel volumetto, non ultima la prefazione del figlio Hermann Heidegger e il breve scritto “Il rettorato 1933/34” (“1933/34”) redatto dal filosofo nel 1945, non solo non vi è il minimo riferimento al nazionalsocialismo nel testo, ma addirittura questo discorso non fu affatto gradito dal Partito. D’altra parte l’indubbio valore filosofico del testo fu ammesso anche da filosofi di sinistra quali Karl Jaspers (1883 – 1969) e Karl Löwith (1897 – 1973): “L’autoaffermazione dell’università tedesca è un discorso di elevato tenore filosofico e di grandi pretese, un piccolo capolavoro nella formulazione e nella composizione. Alla luce della filosofia è un’opera straordinariamente ambigua… e chi lo ascolta alla fine non sa se deve prendere in mano la silloge dei presocratici curata da Diels o marciare con le S.A.”In ogni caso, nonostante Martin Heidegger fosse pienamente inserito nell’ambiente della Destra tedesca anti-weimariana, legato da rapporti anche d’amicizia con Carl Schmitt (1888 – 1985) ed Ernst Jünger (1895 – 1998), e ambisse ad essere per Hitler ciò che Gentile fu per Mussolini, gli eventi presero presto una piega diversa. In primo luogo, Heidegger, come molti altri autori della konservative Revolution, non condivideva affatto le teorie razzialiste che costituiscono la maggiore e più radicale differenza tra fascismo e nazionalsocialismo. Inoltre mancò da parte dei nazionalsocialisti, a differenza del fascismo italiano con le riforme Gentile e Bottai, un progetto organico che promuovesse e garantisse il valore e l’autonomia del sistema d’istruzione e dell’università tedesca (per altro già molto solide di per sé). Questo discorso risulta comunque essere di particolare interesse, proprio perché, nel suo piccolo, contiene in nocciolo una teoria coerente dell’università nazionale e sociale.
 In esso, Heidegger rivendica innanzitutto l’autonomia dell’università come corpo studentesco e corpo docente uniti sotto la guida del rettore. Ai fini di quest’autonomia, è però necessario interrogare se stessi, meditare sul proprio stesso essere. “L’università tedesca è per noi l’istituzione che sulle fondamenta della scienza e mediante la scienza educa e forma nella disciplina i capi e custodi del destino del popolo tedesco. Volere l’essenza dell’università tedesca significa volere la scienza e cioè volere la missione spirituale del popolo tedesco, in quanto popolo giunto alla piena coscienza di sé nel suo stato”. Per meditare su se stessi e cogliere l’essenza di questa scienza, è opportuno risalire all’inizio stesso del pensiero occidentale: la filosofia greca, la quale era ben consapevole dell’impotenza del sapere davanti al destino, ragion per cui l’interrogarsi non è avulso dalla realtà, ma guarda saldamente davanti a sé.
In esso, Heidegger rivendica innanzitutto l’autonomia dell’università come corpo studentesco e corpo docente uniti sotto la guida del rettore. Ai fini di quest’autonomia, è però necessario interrogare se stessi, meditare sul proprio stesso essere. “L’università tedesca è per noi l’istituzione che sulle fondamenta della scienza e mediante la scienza educa e forma nella disciplina i capi e custodi del destino del popolo tedesco. Volere l’essenza dell’università tedesca significa volere la scienza e cioè volere la missione spirituale del popolo tedesco, in quanto popolo giunto alla piena coscienza di sé nel suo stato”. Per meditare su se stessi e cogliere l’essenza di questa scienza, è opportuno risalire all’inizio stesso del pensiero occidentale: la filosofia greca, la quale era ben consapevole dell’impotenza del sapere davanti al destino, ragion per cui l’interrogarsi non è avulso dalla realtà, ma guarda saldamente davanti a sé.“Dalla decisione del corpo studentesco tedesco, di fronteggiare il destino tedesco nella sua estrema indigenza, proviene una volontà diretta all’essenza dell’università”. Perciò, il concetto spesso travisato di ‘libertà accademica’ viene ricondotto a tre obblighi, uguali per necessità e rango: il primo rivolto alla comunità del popolo, consistente nel servizio del lavoro; il secondo rivolto all’onore e al destino della nazione, consistente nel servizio delle armi; il terzo rivolto alla missione specifica del popolo tedesco, consistente nel servizio del sapere. “L’università tedesca può acquistare potenza e forma solo se i tre servizi (…) si trovano cooriginariamente congiunti in un’unica forza”. A questo fine, “ogni capacità della volontà o del pensiero, tutte le forze del cuore e tutte le facoltà del corpo devono svilupparsi mediante la lotta, accrescersi nella lotta, e perseverare come lotta”, (intendendo questa in senso eracliteo).
Concludendo, emerge chiaramente come l’università, basata sull’unione del corpo studentesco e del corpo insegnante, debba essere autonoma nel perseguire gli obblighi che la rendono veramente capace di affrontare la scienza come missione spirituale della nazione, di fronte al destino.
lunedì 19 gennaio 2009
L’utopia di una scuola pubblica nella Grecia classica
 Il primo filosofo e uomo politico ad intraprendere iniziative relative all’allargamento dell’istruzione verso un pubblico sempre più vasto, secondo una tradizione riferita dallo storico Diodoro Siculo, sarebbe stato Caronda di Catania, il semimitico autore delle leggi di Turi nel VII sec. a.C.; il legislatore avrebbe fatto varare, fra gli altri, un provvedimento secondo il quale i figli di tutti i cittadini avrebbero dovuto imparare le lettere e che le spese della loro istruzione avrebbero dovuto essere pagate completamente dalla città. Aneddoti come questo aiutano certamente a cogliere un cambiamento circa le modalità dell’istruzione fra l’età classica e l’età ellenistica, e di un più generale approccio alla problematica pedagogica.
Il primo filosofo e uomo politico ad intraprendere iniziative relative all’allargamento dell’istruzione verso un pubblico sempre più vasto, secondo una tradizione riferita dallo storico Diodoro Siculo, sarebbe stato Caronda di Catania, il semimitico autore delle leggi di Turi nel VII sec. a.C.; il legislatore avrebbe fatto varare, fra gli altri, un provvedimento secondo il quale i figli di tutti i cittadini avrebbero dovuto imparare le lettere e che le spese della loro istruzione avrebbero dovuto essere pagate completamente dalla città. Aneddoti come questo aiutano certamente a cogliere un cambiamento circa le modalità dell’istruzione fra l’età classica e l’età ellenistica, e di un più generale approccio alla problematica pedagogica.Nella Grecia dell’età classica l’istruzione era una questione essenzialmente privata. Soltanto le famiglie che avessero avuto un’adeguata disponibilità economica sarebbero state in grado di impartire un’educazione ai propri figli, rivolgendosi comunque a maestri privati. In mancanza di una qualsiasi forma di monitoraggio pubblico (mancavano dei corsi di studio regolari intesi in senso moderno), l’educazione non mirava al conseguimento di un bagaglio di nozioni determinate, ma all’adesione completa ai valori della polis. All’interno di questo sistema, stabilire quanti possedessero le competenze necessarie per leggere un qualsiasi tipo di opera letteraria è difficile capirlo; l’ipotesi più probabile è che comunque questo bagaglio di competenze si restringesse alle classi egemoni, le uniche a possedere la disponibilità economica indispensabile, e che quindi riguardasse un numero ristretto di individui.
L’interesse verso l’allargamento dell’istruzione comincia ad avvertirsi alla metà del IV sec. a.C.

 La trattatistica politica successiva continua a confrontarsi con il problema dell’educazione, come riflesso delle esigenze delle nuove realtà statali createsi dopo la morte di Alessandro Magno (323 a.C., in foto). Nei regni dei diàdochi, infatti, caratterizzati da un alto tasso di burocratizzazione e da un conseguente aumento del numero dei documenti, gli analfabeti erano penalizzati rispetto a chi possedesse un alfabetismo anche solo funzionale. Il filosofo Aristotele dedica all’argomento la fine del VII e tutto l’VIII libro della Politica, purtroppo giunto a noi in forma incompleta. Quest’opera, nonostante un’impostazione teorica meno ambiziosa, pone l’educazione al centro delle preoccupazioni politiche di un governante: «nessuno potrà contestare che il legislatore debba adoperarsi al massimo grado per garantire l’istruzione dei giovani». Tutto ciò implica che l’istruzione sia garantita a tutti e pubblica: «non come accade oggi che ognuno si prende cura privatamente dei propri figli e fornisce loro, in privato, l’istruzione che preferisce». Quest’idea inizia a trovare accoglienza sempre più vasta presso altre scuole filosofiche ellenistiche, cui sono dedicati un ampio numero di trattati specialistici: il Perì paidèias (“Sull’educazione”) che Sozione annovera tra gli scritti di Aristippo, i Paudeutikòi nòmoi (“Le regole dell’educazione”) di Aristosseno e, non ultimi, il Perì tès Ellenikès paidèias (“Sull’educazione ellenica”) di Zenone, e il Perì agoghès (“Sul percorso educativo”) di Cleante.
La trattatistica politica successiva continua a confrontarsi con il problema dell’educazione, come riflesso delle esigenze delle nuove realtà statali createsi dopo la morte di Alessandro Magno (323 a.C., in foto). Nei regni dei diàdochi, infatti, caratterizzati da un alto tasso di burocratizzazione e da un conseguente aumento del numero dei documenti, gli analfabeti erano penalizzati rispetto a chi possedesse un alfabetismo anche solo funzionale. Il filosofo Aristotele dedica all’argomento la fine del VII e tutto l’VIII libro della Politica, purtroppo giunto a noi in forma incompleta. Quest’opera, nonostante un’impostazione teorica meno ambiziosa, pone l’educazione al centro delle preoccupazioni politiche di un governante: «nessuno potrà contestare che il legislatore debba adoperarsi al massimo grado per garantire l’istruzione dei giovani». Tutto ciò implica che l’istruzione sia garantita a tutti e pubblica: «non come accade oggi che ognuno si prende cura privatamente dei propri figli e fornisce loro, in privato, l’istruzione che preferisce». Quest’idea inizia a trovare accoglienza sempre più vasta presso altre scuole filosofiche ellenistiche, cui sono dedicati un ampio numero di trattati specialistici: il Perì paidèias (“Sull’educazione”) che Sozione annovera tra gli scritti di Aristippo, i Paudeutikòi nòmoi (“Le regole dell’educazione”) di Aristosseno e, non ultimi, il Perì tès Ellenikès paidèias (“Sull’educazione ellenica”) di Zenone, e il Perì agoghès (“Sul percorso educativo”) di Cleante.Tuttavia, nonostante l’interesse mostrato verso questo tipo di esigenze, avvertite da strati sempre più ampi della popolazione, l’accesso all’istruzione non raggiunse mai soluzioni di massa, come nei tempi attuali, ma fu patrimonio esclusivo di un’élite politico-militare di volta in volta al comando.
 Lo stesso avvenne ad Atene, madre legittima della genuina e autentica democrazia, in cui, sebbene l’alfabetismo fosse lievemente più diffuso che in altre poleis elleniche, una scuola pubblica capace di formare il cittadino politicamente capace non vide mai la propria nascita. Non a caso Socrate (in foto) – antidemocratico viscerale – lamentò più volte il mal costume proprio dei sofisti, i quali attiravano i rampolli delle più nobili schiatte della città al fine di essere remunerati in cambio di lezioni private. E la retorica sofistica era arma assai preziosa in un sistema assembleare e formalmente paritetico quale quello ateniese.
Lo stesso avvenne ad Atene, madre legittima della genuina e autentica democrazia, in cui, sebbene l’alfabetismo fosse lievemente più diffuso che in altre poleis elleniche, una scuola pubblica capace di formare il cittadino politicamente capace non vide mai la propria nascita. Non a caso Socrate (in foto) – antidemocratico viscerale – lamentò più volte il mal costume proprio dei sofisti, i quali attiravano i rampolli delle più nobili schiatte della città al fine di essere remunerati in cambio di lezioni private. E la retorica sofistica era arma assai preziosa in un sistema assembleare e formalmente paritetico quale quello ateniese.Anche nell’Atene democratica, dunque, l’istruzione – o meglio la “precettura” – fu esclusivo appannaggio delle classi abbienti ed egemoni, le reali, benché inconfessate, detentrici del potere politico.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, heidegger, révolution conservatrice, années 30, allemagne, national-socialisme, années 20 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 01 février 2009
L'homme, une matière première
L'homme, une matière première
Trouvé sur: http://polemia.com
Heidegger, comme les anciens Grecs, définit l’homme essentiellement comme « mortel », comme « être-pour-la-mort », c’est-à-dire ouvert en permanence à la perspective de mourir, contrairement à l’animal qui, lui, « ne meurt pas mais périt ». Il renoue ainsi avec notre tradition qui remonte au Christianisme, mais antérieurement encore, à Platon notamment (voir le « Phédon »).
Notre rapport avec la mort cependant, dans la société occidentale moderne, ne cesse de se détériorer. La vie moderne, axée sur la consommation et le plaisir immédiat, cherche à effacer la mort de nos consciences. Lorsqu’elle survient, comme c’est le cas avec nos morts au champ d’honneur en Afghanistan, c’est un vrai scandale !
Quatre métiers, quatre « vocations » (le mot allemand « Beruf » pour métier comporte cette idée d’un « appel » du destin ; « Ruf » veut dire appel), comportent dans leur essence un rapport privilégié avec la mort : la médecine, la justice, l’armée et la fonction ecclésiastique. Les « pompes funèbres » sont un service commercial et n’entrent donc pas ici en ligne de compte ! Le médecin lutte contre la mort et il lui est interdit, selon une tradition qui remonte à Hippocrate (5e siècle avant JC) de donner la mort ès qualité de médecin. Le juge par contre, depuis l’aube de la civilisation jusqu’à quelques années en Europe, est habilité à donner la mort dans un certain nombre de cas précis. Le soldat a pour vocation de mourir pour la patrie et de donner la mort à l’ennemi. Le prêtre est présent à la fin de la vie et aide le mourant à « effectuer le passage ». Ce sont les quatre fonctions en rapport avec la mort et qui correspondent aux quatre pôles du quadriparti, ce monde de l’être qui fonde l’authenticité de notre existence selon Heidegger. Le médecin représente le pôle de la terre (la « cause matérielle » d’Aristote), le juge représente le « ciel » (la cause formelle, le devoir-être), le prêtre la divinité (la cause finale) et le soldat le monde des hommes (la cause motrice).
Dans notre monde moderne, ce monde est bouleversé et remplacé par un « immonde » selon la frappante formule du philosophe Jean-François Mattéi (voir son livre : « La barbarie intérieure » (1)) Le juge est désormais privé de son pouvoir de donner la mort. Il est éliminé. Le prêtre n’est plus convoqué que par les croyants qui sont une minorité, il est marginalisé. Le soldat meurt encore mais c’est très mal vu. La dimension militaire est évacuée le plus possible des valeurs de notre société marchande. L’héroïsme n’est plus une valeur directrice dans l’imaginaire social comme il l’a toujours été des épopées d’Homère (8e siècle avant notre ère) jusqu’à, disons, le culte des héros de la Résistance.
Par contre, le médecin dont la vocation était de lutter contre la mort au point de lui interdire de donner la mort (le serment d’Hippocrate des anciens Grecs interdit au médecin de pratiquer l’avortement), est appelé à la donner de plus en plus ! Non seulement par l’avortement mais par la possibilité de l’euthanasie qui rassemble de plus en plus de partisans !
Nous voilà donc dans un « monde à l’envers » en quelque sorte où le juge ne peut plus tuer mais où le médecin tuera de plus en plus fréquemment. Le prêtre et le soldat, quant à eux, sont appelés à disparaître, si le « progrès » continue sa route ! A quoi peuvent servir les prêtres, à quoi peuvent servir les soldats dans une société matérialiste de consommation ? Quel sens peut encore avoir le don de sa vie à autrui dans un monde qui plaide pour l’extension illimitée de l’ego et du plaisir immédiat ? Cette inversion des fonctions sociales devrait conduire nos compatriotes à s’interroger. Mais le conditionnement médiatique ne va pas dans ce sens. De plus en plus de pressions se font jour pour légitimer le rôle de tueur donné au médecin alors qu’une indignation générale se fait jour s’il s’agit de redonner au juge le pouvoir de donner la mort.
Le temps est venu où la prédiction de Nietzsche dans son « Ainsi parlait Zarathoustra » se réalise : Nietzsche dit que le monde moderne est celui des « derniers hommes qui ont inventé le bonheur ». « Idéal, amour, étoile, qu’est cela ? disent les derniers hommes. (…) Un peu de poison pour rendre la vie agréable (la drogue), beaucoup de poison pour la finir agréablement ». La mort comme façon de vivre plus agréablement (sans enfant non désiré, sans souffrance de la maladie) est la mort vue de façon « moderne », c’est-à-dire utilitariste. La mort est ainsi arraisonnée par le dispositif utilitaire (le « Gestell » de Heidegger (2)) qui domine notre vie sans que nous en ayons vraiment conscience. L’homme est de moins en moins un « mortel » conscient de sa condition tragique de finitude sur cette terre. Il devient la plus importante des matières premières au service du système techno-économique. Il perd ainsi sa liberté et son essence humaine largement à son insu.
Mais la réduction de la mort à un acte médical est revendiquée comme un progrès de l’humanisme ! La disparition de l’héroïsme des valeurs sociales directrice (héroïsme pourtant revendiqué notamment par toutes les Républiques précédentes) est considérée comme un progrès : rien ne doit s’opposer aux caprices de l’ego dans sa poursuite de la puissance et du plaisir ! La sécularisation matérialiste de la société est un progrès des Lumières ! L’homme est un animal et la raison est là pour satisfaire ses pulsions dans un cadre sécurisé !
On considère encore normal d’envoyer à la mort des jeunes gens honnêtes qui risquent leur vie pour le bien commun : soldats, policiers, pompiers ! Mais on est horrifié à l’idée de condamner à mort un monstre qui a torturé et assassiné une enfant ! Dans un monde où l’on ne croit plus guère au sacré, on affirme que la vie du grand criminel est sacrée et que l’homme ne peut avoir le pouvoir légal de la lui enlever ! Mais le flic ou le soldat peuvent crever car « c’est leur métier » : ils ont signé un contrat en ce sens ! Le criminel n’a pas signé de tel « contrat professionnel » donc sa vie ne peut être mise en jeu même s’il met en jeu la vie des autres ! Cette « idéologie du contrat » qui seule permet la « mort utile » n’est pas autre chose que la justification de l’opération qui consiste à faire de l’homme une matière première du système social dominant. On passe bien des contrats avec les fournisseurs de pétrole ! On peut perdre sa vie ou sa dignité pourvu que ce soit conformément à un « contrat » (le mot « contrat » est d’ailleurs valorisé chez les mafieux : pour éliminer un gêneur !)
Telle est la sensibilité de l’immonde moderne ! Elle est « sensible », ce qui n’empêche pas celle-ci d’être perverse ! Robespierre aussi était « sensible » ! Il expliquait qu’il fallait exterminer tous les Vendéens par pitié ! Par pitié pour la République ! En donnant aux médecins le monopole de donner la mort à l’avenir, ne créé-t-on pas cependant une « guillotine rampante » ?
Il est à souhaiter qu’un jour la liberté et la dignité de l’homme soient restaurés. Cela suppose certainement de retrouver un rapport « normal », noble et non ig-noble avec la mort !
Yvan BLOT
12/01/09
(©)Polémia
19/01/09
(1) Jean-François Mattéi,« La barbarie intérieure », puf, 2004, 334p.
http://www.polemia.com/article.php?id=1195
(2)Le « Gestell » ou « dispositif utilitaire » qui règle le monde
http://www.polemia.com/article.php?id=1818
Yvan Blot
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, anthropologie, grèce antique, nietzsche, heidegger |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 décembre 2008
Benjamin, Heidegger et la naissance de la modernité

SYNERGIES EUROPÉENNES - VOULOIR (Bruxelles) - Juillet 1994
Pierre LE VIGAN:
Benjamin, Heidegger et la naissance de la modernité - Raison, Habitat, Expérience
"Tout est rappelé du passé, ce qui est à venir, qu'il soit attendu comme sempiternel" (Nietzsche).
Maurice de Gandillac rapporte qu'au XIIème siècle, les moines de Saint-Victor louent les marchands qui "explorent des rivages nouveaux", font connaitre de nouveaux produits et "rendent commun ce qui était privé" (1). Un siècle après, le franciscain Duns Scot justifie les bénéfices des négociants par leur rôle d'intermédiaire. Là se situe selon M. de Gandillac "l'essentielle coupure de la véritable modernité". Une double idée s'insinue: la société doit "progresser", l'aptitude à cette progression n'est pas générale. Il y aura ce qu'Augustin appelait des "damnés": les laissés pour compte du progrès. Cette idée de progression sélective est une des sources de la modernité.
L'autre est la soif de connaissance. Au 15ème siècle, Nicolas de Cues rêve de mesurer l'ensemble du réel, y compris les propriétés physiques et physiologiques de l'homme. Aux catégories de l'être et de l'existant, il substitue en somme celle de l'existible, la catégorie de tout ce qui peut, potentiellement, exister. Pour autant que l'utilité en soit démontrable. Dans le même temps, le mode d'apparaitre du monde devient identique à celui de Dieu, c'est-à-dire que l'univers apparait sans centre ni circonférence. Autrement dit, les conditions de la naissance de la subjectivité se mettent en place.
Selon Alain Touraine (2), cette dualité de la rationalisation et la subjectivisation est la définition même de la modernité. La modernité aurait assigné des tâches à deux "sujets": la raison et la conscience. La tâche de la première serait de comprendre le monde, celle de la seconde d'"humaniser l'homme". Le dérapage se serait produit au moment de la philosophie des Lumières qui aurait détruit ce dualisme "par orgueil" (en quelque sorte le pendant de la thèse de Furet sur le dérapage de la Révolution française entre 1789 - la "bonne" révolution - et 1793 - la "mauvaise"). D'où l'inclination de Touraine pour l'humanisme chrétien optimiste (selon lui Erasme, Marsile Ficin, ...) qu'il oppose à l'augustinisme pessimiste. D'où aussi son désaccord avec Louis Dumont situant plus en amont l'irréversibilité du mouvement conduisant à l'individualisme moderne. Reste l'accord sur la présence, aux sources de la modernité (c'est-à-dire de ce en quoi notre temps nous est propre), de la soif de connaissance, de l'utilisation de l'outil de la raison, de la recherche de la mesure, d'une forme nouvelle de la subjectivité individuelle et collective.
La valeur nouvelle de la notion de certitude marque la naissance de la modernité. C'est le signe des temps modernes. Heidegger s'y réfère dans l'interrogation suivante: "Mais qu'est-ce qui est plus étant, c'est-à-dire, d'après la pensée des Temps modernes, plus certain que la mort ?" (3). Or, la notion de certitude apparait avoir des affinités particulièrement fortes avec celles de raison et de sûreté. Sous deux aspects. D'une part, de ce qui est certain, on est sûr. Et ce qui est sûr (en lieu sûr) est sauf (sauvé). D'autre part, on n'est certain que de ce que l'on connait. Or, le principe de toute connaissance est la raison.
Selon Heidegger, le principe de raison est le fond du fond, la raison de tous les principes et donc "la raison de la raison". Etymologiquement, la "raison", c'est le "fond" (Grund), et aussi le "sol", l'"humus". Grund désigne le fond vers lequel nous descendons et auquel nous revenons, pour autant que le fond est ce sur quoi une chose repose, à quoi elle tient, d'où elle s'ensuit (4). Hegel distinguait le fond d'une chose et ce sur quoi elle repose. Si Heidegger semble ici user d'un des sens seulement du mot "fond", le second, ce n'est qu'apparence. Ces deux notions sont liées: pour aller "au fond des choses", il faut voir ce sur quoi elles reposent. Ainsi, on ne connait les choses que compte tenu de leur fondement. Le sens du terme "compte tenu" est clair: la raison (Grund) est aussi ratio. Elle est le compte de ce que l'on donne, et donc aussi de ce qu'il nous reste. Conclusion: la raison comme "compte", "calcul" suppose un jeu à somme nulle. Ce que je n'ai plus est à quelqu'un d'autre. Dit autrement: la raison suppose un monde fini (5).
Mouvement de quête, de recherche du fond, la raison ne se conçoit pas sans l'autonomie de la volonté. Il n'y a de raison que dans l'agir. "C'est la philosophie moderne (...), de Leibniz à Nietzsche, qui met en route la méditation de l'être comme agir, jusqu'à sa détermination ultime comme volonté de puissance", écrit Jean Beaufret (6).
De son coté, Husserl, s'interrogeant sur l'origine de la philosophie, la définit comme source de la raison. Or, on peut le considérer comme étant l'illustration fondatrice d'un néo-kantisme que Michel Clouscard situe justement "à l'origine de l'épistémologie de notre période culturelle" (7), et qui pose le principe d'identité de l'objet et du sujet de la connaissance. Kant voyait dans la révélation chrétienne l'auxilliaire de la raison. Husserl se rattache à ce point de vue quand il écrit, en 1935: "La vie de l'homme n'est autre chose qu'un chemin vers Dieu". Cette position fut aussi celle de Max Scheler. En somme, la philosophie serait née de Dieu et consisterait à y retourner. De là, l'importance de la généalogie.
Evidemment, la difficulté commence quand on constate que la pratique de celle-ci n'est pas unique. Dans l'approche d'Alain, l'esprit apparait "développement de l'idée réelle". Dans celle d'Hegel, "l'histoire de l'esprit est son acte", et le sens de l'acte est d'atteindre à la perfection et à l'universalité (8). Dans cette perspective, l'histoire de l'esprit, comme le notait justement Althusser, est "processus sans sujet (...). C'est le procès lui-même qui est sujet". Quand Husserl, pour sa part, définit le travail philosophique comme remontée aux sources de la raison (d'accord ici avec Dilthey), il en appelle à une méthode généalogique illustrée par Nietzsche. La remontée aux sources est en effet la méthode même de la généalogie. Mais celle-ci, plus que la simple génèse, comporte, dit Jean Beaufret, "une herméneutique plus essentielle". Elle s'occupe de ce qui, malgrè l'enchaînement des étapes, confère au produit le plus récent, donc le plus loin de l'origine, une étonnante proximité, néanmoins, de cette origine. Or, la génèse existentiale chez Husserl comme chez Heidegger consiste en un questionnement sur ce dont le phénomène en tant que tel est porteur. Dans cette optique, la généalogie ne peut être reconstitution de ce qui est déjà en germe, ni simple remontée à l'origine. Et c'est précisement en celà, grâce à cet écart par rapport à l'origine, que cette perspective permet l'historicité.
Si cet écart par rapport à l'origine se maintient jusque dans la quête de celle-ci, c'est dire que le primitif n'est pas l'originel. La pensée grecque comme mâtrice, ce que Jean Beaufret appelle "la percée radieuse du monde grec" est héritière d'un "avant" encore dérobé. Peut-être parce que, comme dit Hölderlin, la pudeur, c'est ce qui "retient d'aller jusqu'à la source". De ce fait, le propos de la démarche généalogique n'est pas de s'engager dans le retour à un "monde de la vie" originel. Plutôt faut-il être à l'écoute de la parole reçue par les grecs, et par eux transmise - parole qui n'est donc pas originelle. Encore est-il besoin de s'entendre sur les conditions de la transmission - le temps, et sur la nature de l'acte d'écoute - à savoir l'intention, et en somme sur la nature du "Je" et de la personne.
Kant aperçoit bien le rôle constitutif du temps dans la constitution du "Je", mais il en conclut que cela atteste de la séparation du monde de l'être et du monde de la pensée. Le temps est ainsi conçu comme une limitation de l'être qui l'empécherait d'atteindre la complétude du monde de la pensée. Résumant Kant, Pierre Trotignon écrit: "Marque de ma finitude, le temps est encore conçu comme une diminution d'être, comme une impossibilité pour notre existence d'être cet entendement intuitif à qui l'être se révélerait adéquatement"(9).
Le point de vue de Martin Heidegger sur la question du Je est fort différent. Il parait bien compris par Georges Steiner qui écrit: "Ce n'est pas sous le rapport du "Je suis" que nous saisissons la nature de l'être avec le plus de facilité et d'assurance (Heidegger se sépare ici fondamentalement de l'"égoisme" de Descartes et de la fusion du sujet et de l'objet chez Kant et Fichte). Ni en fonction du "tu es" (comme le voudraient certaines écoles modernes de phénoménologie dialectique)." Heidegger voit dans le temps une forme de l'intention qui permet le dévoilement de l'être, sans donner accès "à la totalité et à l'unité des êtres" (10). En d'autres termes, le temps est un chemin, ce qui ouvre une toute autre perspective que celle de Kant. Mais Heidegger dit aussi:"Tout est chemin". Ce qui est sans doute dire qu'il n'y a pas de but. Et définit une position nettement distincte de celle de Husserl.
Dieu n'est plus alors, comme dans la vision de l'humanisme chrétien, le couronnement de la Création - la plus haute des "valeurs" - ce qu'Heidegger interprète comme une "dégradation de l'essence de Dieu" (Lettre sur l'humanisme). Dieu est alors, toujours dans la vision heideggerienne, au fond de toute chose. Ainsi que Goethe l'exprime poétiquement:
"Si l'oeil n'était pas parent du soleil, comment pourrions-nous voir la lumière, si la force de Dieu ne vivait pas elle-même en nous, comment serions nous transportés par les choses divines ?"
De son coté, Max Scheler émet sur la question du "Je" et sur celle de "l'intention" deux propositions. L'une est que "l'idée de personne n'a rien à voir avec les idées de Je". L'autre est que "ce qui appartient à l'essence de la personne, c'est de n'exister et de ne vivre qu'en effectuant des actes de visée intentionnelles". Le problème, c'est que ces deux propositions sont rigoureusement incompatibles. Il est en effet exact que la personne se définit par l'articulation entre une fonction adaptatrice et une fonction de ressourcement, entre une identité "idem" (celle du caractère) et une identité "ipsé" (celle de l'être), cette dernière jouant une fonction de réserve. Il est ainsi vrai que le "Je" devient personne, c'est-à-dire être-dans-le-monde en faisant apparaître au jour sa part la moins authentique, la moins personnelle, et de fait la plus banale. Mais, de ce fait même, il n'est pas évident que le propre de l'homme soit de "n'exister et de vivre qu'en effectuant des actes de visée intentionnelles". Tout au contraire peut-on penser que l'intention est une des notions les plus faiblement fondées qui soient, impensable en tout état de cause hors de ce que Bourdieu nomme l'"habitus". Conséquence: la première proposition de M. Scheler sur le "Je" et "la personne" apparait pertinente, mais la seconde fausse et contradictoire.
Aussi faut-il resituer ce que peut être l'"écoute", une écoute non purement intentionnelle. L'écoute est d'abord écoute de la parole, et elle est aussi écoute qui recueille. D'où une double question: la parole et le recueil de la parole (en d'autres termes l'intérieur).
Heidegger définit la parole comme n'étant pas un discours (rationnel), mais un dire qui signifie. Aussi l'écoute de la parole n'est-elle ni immédiate, ni totale. Il y a écart entre le dit et le reçu. "Le signe est éternellement veuf du signifié", dit encore Gilbert Durand (11).
Le deuxième aspect soulevé est la question du recueil de la parole. Dans un texte intitulé Intérieur et expérience. Notes sur Loos, Roth et Wittgenstein (12), Massimo Cacciari pose la question: y a-t-il un espace du recueillement, et à quelles conditions ? Et il pose cette question très concrètement à partir de l'architecture et de l'urbanisme moderne. En effet, le projet tant des intérieurs "kitsch" ("mauvais gout" en yiddish) que de l'immeuble moderne qui les contient est "la pure visibilité". Or, ce qui est visible n'est pas forcément habitable. Un premier effet de la visibilité est de transformer la chose en monnaie, en objet "aliénable et manipulable", écrit Cacciari. Dans le cas d'une maison, la visibilité de celle-ci tue sa possibilité d'être un intérieur. L'architecture de verre et d'acier constitue une illustration contemporaine de ce refus du principe même d'intérieur.
Or, la question de la transparence est tout à fait nodale. Car la volonté de rendre tout transparent postule une équivalence entre l'humain et le logos. "Tout "secret" doit être parlé", résume Cacciari. Or, le verre, et la culture de la transparence - Glaskultur - met à nu l'expérience, et, le cas échéant, la misère de l'expérience. La misère la plus grande se trouve quand l'expérience se situe avant la narration, c'est-à-dire quand la narration n'est plus auto-constitution de l'identité (au sens de Ricoeur), mais simple accumulation de hasards. Alors, l'expérience - celle connue avant la narration - ne peut revenir que comme miracle, chez celui qui a habité le temps d'avant. Une attente de l'extraordinaire qui explique l'attirance des temps modernes pour les eschatologies (quoi de plus extra-ordinaire que le dernier récit ?).
Pour que le récit ne soit pas ce qui vient après l'expérience, il doit être inscrit dans le temps. Il doit ainsi être de l'ordre du relatif (puisqu'il relate) , et non de l'absolu. Cette inscription dans le temps nécessite que la Parole n'y soit pas l'objet d'une écoute im-médiate, mais au contraire distante. L'inscription dans le temps nécessite ainsi le ressourcement, donc le silence, ou du moins des silences.
Silence. Que l'homme ne soit ni toujours à l'écoute (le parlé), ni toujours le parlant. Giorgio Agamben précise: "Que l'homme ne soit pas toujours déjà le parlant, qu'il ait été et qu'il soit encore l'"in-fans", c'est cela l'expérience" (13). L'expérience d'avant le récit, cette expérience "frappée de mutisme", est celle qui peut, dans les silences, perdurer dans le recueillement, dans l'attente qui est attention, et qui est aussi ressourcement. Cette expérience d'avant le récit est le non-dicible qui pour cela même donne sa forme (tel un réceptacle) au dicible qu'est le récit. Et le lieu de cette expérience est le silence parce que "le silence est la mémoire de l'enfance" (Cacciari). Aussi l'illusion en ce domaine serait que l'expérience soit en-deçà de la vie, et le risque l'attente du miracle comme connaissance, et de la parousie ("l'arrivée") comme de ce qui sauve. Plutôt s'accordera-t-on avec René Char qui écrit: "L'éternité n'est guère plus longue que la vie".
De même que l'expérience perdure si elle s'incrit dans le temps, l'homme est pour autant qu'il s'inscrit dans l'espace, pour autant qu'il est un habitant. Ici encore, l'être précède le faire (précéder, c'est montrer le chemin); comme l'habiter précède le bâtir. "Bâtir n'est pas seulement un moyen de l'habitation. Bâtir est déjà de lui-même habiter" (14). L'homme habite dans la mesure où il prend soin d'un lieu; il bati parce que sa nature est d'être un habitant. "Wohnen, "demeurer en "est "la structure fondamentale du Dasein" (15). Alors, ce que l'homme bati prend sens. Heidegger prend l'exemple d'un pont. Un pont "rassemble, à sa manière, auprès de lui la terre et le ciel, les divins et les mortels" (16). A ces éléments, - le Quadriparti - le pont accorde une place. "Car, note Heidegger, seul ce qui est lui-même un lieu peut accorder une place". C'est ici le pont qui crée le lieu. Sans pont, pas de lieu. Et si le lieu est tel en tant qu'il est dans l'espace, c'est un espace aménagé, et aussi un espace "ménagé". Son aménagement n'est autre qu'un mode de son paraître. Lieu aménagé - et "à ménager" - le pont ne met pas seulement "en place" le Quadriparti. Il le garde. L'essence de l'acte de bâtir est ainsi: produire des choses qui soient des lieux, qui mettent en place, -"ménagent" une place-, et tiennent sous leur garde la terre et le ciel, les divins et les mortels. En somme, bâtir est répondre à l'appel du Quadriparti en attente de modes de paraître. Ainsi, bâtir est pro-duire (pro-ducere: mettre en avant), et au plus haut point. Et bâtir est: rassembler ou assembler. Assembler ce qui ne passe pas - le Quadriparti - avec ce qui passe - les oeuvres humaines, ainsi le pont, ou toute autre bâtisse. Alchimie qui est notre travail.
Difficulté: faire ce travail aux temps modernes. Le lieu n'existe en effet que par sa perception collective. La compréhension du lieu doit faire l'objet d'un accord. Or, les conditions de celui-ci sont rendus hasardeuses par un phénomène remarqué particulièrement par Georg Simmel: la multiplicité des rythmes dans la ville moderne. La conséquence de ce phénomène est l'obligation de l'exactitude. L'excentricité devient rare, la banalité et le conformisme la règle. Pour autant, cette homogénéisation des comportements n'aboutit pas à une perception collective des lieux, faute d'un horizon commun. Les conséquences de cet état de fait sont doubles.
D'une part, la communauté est ainsi "désoeuvrée" (Jean-Luc Nancy). L'homme est pris dans une "cage intemporelle" (Lewis Mumford), "sans héritage et sans projet", dit encore Georges Balandier (17). D'autre part, la ville moderne secrète le mimétisme. Le lebenwelt, le vécu du monde s'appauvrit. Comme le note Blanqui, "l'univers se répète sans fin et piaffe sur place". Aussi y a-t-il perte du goût et de l'expérience.
Pour Walter Benjamin, les questions fondamentales de l'authenticité, du sens du bonheur, de la tradition se posent à partir de l'observation des spécificités de l'âge bourgeois. "Le pouvoir et l'argent, observe Benjamin, sont devenus sous le capitalisme des grandeurs commensurables. Chaque quantité donnée d'argent doit être converti en un pouvoir bien défini, et l'on peut calculer la valeur d'achat de chaque pouvoir" (18). De cette coincidence nouvelle et essentielle entre deux données sociales auparavant disjointes dans leurs principes, il s'ensuit que le sacré diffusé par un pouvoir sublimé s'éclipse au profit de la "beauté" et que celle-ci elle-même devient reproductible et mesurable (19).
La technique n'est qu'un moyen de la reproductibilité et non la cause de cette recherche de reproductibilité. "Les composantes de l'authenticité se refusent à toute reproduction, non pas seulement à la reproduction mécanisée" (20). La cause de la recherche de reproductibilité, c'est la volonté de distinction par l'accumulation (d'objets, images, signes, ...). Et comme la modernité se caractérise par la construction d'images du monde (Heidegger), la profusion des images au moyen de leur reproductibilité alimente le règne de la marchandise. "Là où il n'y a pas les dieux règnent les spectres", écrit Novalis (21).
Mais la volonté de distinction n'est qu'un produit de l'individualisme et de l'invention de la volonté comme attribut individuel. J-F Lyotard (qui fait remonter l'invention de la volonté à Augustin), écrit: "Tout ce que Benjamin décrit comme "perte d'aura", esthétique du "choc", destruction du goût et de l'expérience, est l'effet de ce vouloir peu soucieux des règles. Les traditions, les statuts, les objets et les sites chargés du passé individuel et collectif, les légitimités reçues, les images du monde et de l'homme venues du classicisme, même quand ils sont conservés, le sont comme moyens pour la fin, qui est la gloire de la volonté" (22). Les grands mouvements sismiques de la sensibilité, et les structurations sur la longue période de la psychologie des peuples sont remplacés par le règne du nouveau - la néophilie. "'Plus de vagues, plutôt des vogues", disait Félix Guattari.
Trés logiquement, l'invention de la volonté précède de peu l'invention de l'autonomie de l'économie (23). A partir du moment où la personne apparait "pour-soi" (Hegel), c'est-à-dire comme l'unité conflictuelle d'un Je (moi-sujet) et d'un Moi (moi-objet), la volonté s'institue - et s'insinue - comme le moyen d'être au monde. Les biens deviennent alors autant d'indispensables "miroirs du moi".
De là, est inévitable l'invention de l'économie comme sphère autonome des activités humaines, consacrée à la fabrication de ces biens. L'essor de la technique accompagnant l'autonomie de l'économie, le règne de la marchandise advient, qui brise la perception collective du monde de la vie, et réduit - tendanciellement - ce dernier à une collection d'objets. Le "choc" du nouveau remplace l'acquisition de l'expérience. Or, il n'y a pas, remarque Benjamin, de bonheur sans expérience - et sans expérience collective. Et la tradition est l'éternel retour de cette expérience. "L'expérience du bonheur, dit Jürgen Habermas de Benjamin, qu'il appelle illumination profane, est liée à la préservation de la tradition".
La notion de tradition dans la pensée de Benjamin occupe une place comparable à celle de l'être chez Heidegger. Dans les deux cas l'idée d'un abîme joue un rôle essentiel. Cet abime se définit "par la séparation qui règne entre deux mondes, dont l'un des deux seulement est en toute rigueur celui de l'être"(24). Le point de vue heideggerien est que cette séparation nait avec Socrate et Platon, et se creuse avec ce que Beaufret nomme le "déclin même de la philosophie ou, si l'on veut, son virage stoïcien" (id.). L'opinion de Benjamin ne semble pas éloignée. Pour lui, la tradition remplit le rôle de réserve d'authenticité de l'être, même si, pas plus que chez Heidegger, on ne trouve chez lui de définition tranchée de l'authentique et de l'inauthentique. Ainsi, avec la mort de la tradition se perd la capacité de connaitre ce que Benjamin appelle le bonheur et qui est sans doute un autre nom de l'allégresse définie comme "la coincidence du désir et du réel" (Clément Rosset).
La modernité a commencé avec Faust. Elle finit avec ce que Forget et Polycarpe appellent l'homme-machinal. Ce qui ne parait pas très éloigné de l'homme réifié de Marx. Au 19ème siècle, l'idéal des temps est, note alors Stendhal, la capacité métamorphique: le bal le soir, la guerre le lendemain. (Bonaparte en fut une illustration étonnante: les soirées de la campagne d'Italie de 1796-97 étaient consacrées aux lettres à Joséphine et aux plans d'opérations militaires contre l'Autriche). Mais une fois détruit l'ancien ordre des choses (25), les temps modernes sont ceux du mimétisme et de l'alignement. La civilisation dont l'idéal est la mise au travail aboutit au chômage de l'être. Vient alors le stade de l'ahurissement de l'homme.
Pour le flaneur, fasciné par le marché, ayant "peur de s'arrêter" (Maxime Du Camp), la ville comme la femme apparaissent sous l'aspect d'un labyrinthe, "la patrie de celui qui hésite". "Le labyrinthe, écrit Benjamin, est le bon chemin pour celui qui arrive bien assez tôt au but. Ce but est le marché". Et encore: "Le chemin de celui qui appréhende de parvenir au but dessinera facilement un labyrinthe. Ainsi fait la pulsion sexuelle dans les épisodes qui précèdent sa libération" (26).
Benjamin n'est pas seulement un remarquable décripteur de la modernité. Très lucide quant à la profondeur des racines de l'ordre bourgeois, il inscrit ses recherches dans une conception novatrice du temps historique (surtout par rapport à une certaine culture marxiste): "Chasser toute évolution de l'image de l'histoire et présenter le devenir comme une constellation au sein de l'être grâce à un déchirement dialectique entre la sensation et la tradition; telle est aussi la tendance de ce travail" (27). Brecht, peu complaisant pour Benjamin, notait de son coté dans son Journal de travail (Août 1941): "Benjamin s'oppose à la conception de l'histoire comme déroulement linéaire, du progrès comme entreprise énergique menée à tête reposée, du travail comme source de moralité, de la classe ouvrière comme la protégée de la technique, etc. Il se moque de la phrase, si souvent entendue, qu'il puisse y avoir, "encore en ce siècle" quelque chose comme le fascisme (comme s'il n'était pas le fruit de tous les siècles)" (28). Dans cette conception du devenir, le détail et l'instant apparaissent "le cristal de l'évênement total". L'instant oscille entre le "toujours nouveau" et le "toujours identique".
Influencé par certains mystiques, notamment Weigel, Benjamin imagine que pour une humanité "délivrée", "chacun des instants qu'elle a vécus devient une citation à l'ordre du jour - et ce jour est justement le dernier" (29). Bien que se dégageant avec difficulté de l'idée de "délivrance" (qui implique une critique radicale du monde et est donc au fond anti-constructiviste et anti-révolutionnaire), il conclut ses "thèses sur la philosophie de l'histoire" en notant que l'ancien messianisme juif est moins "appel à l'avenir que commémoration d'un passé toujours présent", chaque seconde s'offrant à la libre discussion des hommes comme "une porte étroite".
Un jour de septembre 1940, Walter Benjamin tente de passer en Espagne, quittant cette France qu'il a tant aimé. L'affaire se présente mal, et l'échec serait sans doute l'arrestation par la Gestapo. Alors, Benjamin franchit une dernière fois "la porte étroite". Il se tue.
Nous n'oublions pas: l'Andenken, c'est la pensée fidèle et remémorante. C'est au courage devant la détresse, qui est la préoccupation - le souci - commun d'Heidegger et de Benjamin qu'il s'agit d'être fidèle.
Pierre LE VIGAN .
_______________________
(1) M. de Gandillac, Génèse de la modernité. Les douze siècles où se fit notre Europe. De "La cité de Dieu" à "La nouvelle Atlantide", CERF, 1992. Abstraction faite de son sous-titre "vendeur" Les douze siècles..., l'ouvrage est d'importance.
(2) A. Touraine, Critique de la modernité, Fayard, 1992.
(3) Chemins qui ne mènent nulle part, Idées-Gallimard, 1980, p.364.
(4) Le principe de raison, préface de Jean Beaufret, Tel-Gallimard, 1962, p.211, souligné par nous.
(5) Heidegger distingue bien sûr "raison" (fond, sol) de "Raison" au sens d'Intelligence. L'intelligence est nommée, en allemand comme en français, par un autre mot que raison. Le terme allemand Grund renvoie au motif des choses, à ce qui fait qu'elles "sont comme cela". La notion d'"intelligence" relève plus de la mesure et de la quantification que celle de "raison" au sens de motif: on est plus ou moins intelligent que quelqu'un, alors qu'un motif est "le bon motif" ou "un faux motif". Dans un cas, une logique de la graduation, dans l'autre, une logique binaire. Pour autant, les notions sont parentes: l'intelligence des choses n'est pas autre chose que la compréhension de ce qu'elles sont. La ratio est simultanément raison et Raison. Nous employons simplement ici "raison" au sens de "principe de raison", incluant les deux sens pré-cités. C'est parce que l'apparentement entre les deux notions est très fort que le "dire" les met "l'un avec l'autre".
(6) Dialogue avec Heidegger, Philosophie moderne, Minuit, 1973.
(7) L'être et le code. Le procès de production d'un ensemble précapitaliste, Mouton, 1972.
(8) Hegel est ici dans la lignée de Parménide d'Elée disant: "Même chose que le penser (de l'être) est ce par quoi s'accomplit ce penser".
(9) in Heidegger, PUF, 1965.
(10) Trotignon, op. cit.
(11) L'imagination symbolique, PUF, 1964.
(12) Critique, janvier-février 1985.
(13) Enfance et histoire, Payot, 1989.
(14) Martin Heidegger, Essais et conférences, Tel-Gallimard, 1980.
(15) Heidegger, "Bâtir, habiter, penser" .
(16) Essais et conférences, op. cit., p. 181.
(17) Balandier, Le détours. Pouvoir et modernité, Fayard, 1985.
(18) in Sens unique, précédé de Enfance berlinoise, et suivi de Paysages urbains, p. 258, Maurice Nadeau éditeur, 1988.
(19) W. Benjamin trouve chez Carl Schmitt l'idée, si importante dans ses propres travaux, que l'art est l'expression des tendances philosophiques et religieuses d'un époque. Sur l'influence du C. Schmitt, cf. Bernd Witte, W. Benjamin une biographie, CERF, 1988.
(20) W. Benjamin, Ecrits français, Gallimard, 1991, p. 142.
(21) Fragments, José Corti, 1992.
(22) Tombeau de l'intellectuel et autres papiers. Galilée, 1984.
(23) voir le chapitre consacré à cette "invention" in Yves Barel, La ville médiévale, système social, système urbain, PUG, 1977. Du même auteur, lire aussi un ouvrage stimulant: La société du vide, Seuil, 1984.
(24) Dialogue avec Heidegger, Philosophie moderne, Minuit, 1973, p. 16.
(25) cf. François Crouzet, la modernité commence en 1815, in Analyses de la SEDEIS, n°89, septembre 1992.
(26) cité par Catherine Perret, le concept de critique chez Walter Benjamin in numéro hors série sur Benjamin de la "Revue d'esthétique", Jean-Michel Place, novembre 1990. Voir aussi de C. Perret, Benjamin sans destin, La Différence, 1992.
(27) W. Benjamin, Paris, capitale du XIXème siècle, Le livre des passages, CERF, 1989, cité par G. Petitdemange, Citoyenneté et urbanité, p. 97, éd. Esprit, 1991.
(28) cité par Philippe Ivernel, article Benjamin de l'Encyclopédia Universalis.
(29) W. Benjamin, Essais 1 et 2, Denoël/Gonthier, 1983.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : heidegger, walter benjamin, modernité, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 juin 2008
Heidegger et son temps (2)
Conception de l'Homme et révolution conservatrice: Heidegger et son temps
par Robert Steuckers
Deuxième partie
"L'américanisme", poursuivait Rilke, produit des objets amorphes où rien de l'homme n’est décelable, où aucun espoir ni aucune méditation n’est passée. Ces réflexions poétiques rilkéennes sur les objets de notre civilisation ont été souvent considérées comme des vers écrits par pur esthétisme, comme de l'art pour l'art. Rien n’est plus faux. Rilke a aussi participé à la redécouverte de la religiosité européenne. Pour le Dieu de Rilke, il y a une aspiration à "habiter" en l'homme et dans la terre. Comme Maître Eckart, la lumineuse figure du Moyen Age rhénan, Rilke voulait voir le divin, la Gottheit naître dans l’intériorité même de l’homme. Dieu "devient" (wird) en nous. Il ne devient lui-même que dans et par l'homme. L'Adam de Rilke, modèle de sa conception anthropologique, accepte la vie difficile de l’après-Eden ; il dit "oui" à la mort qui clôt une existence où le travail signifie plus que le bonheur satisfaisant d’une existence répétitive. Aussi est-il possible, avec Jean-Michel Palmier [23], de comparer le Zarathoustra de Nietzsche au Travailleur de Jünger et à l'Ange de Rilke. Métaphysiquement, ils sont les mêmes. Ils indiquent le passage où l'intensité (l'être) surgit dans un monde où l' "amorphe" a tout banalisé.
L’évocation de ces quelques contemporains de Heidegger ne se veut nullement exhaustive. Il était cependant nécessaire de présenter ces auteurs pour avoir une idée des courants idéologiques qui ont formé l’arrière-plan sur lequel Sein und Zeit s'est élaboré. Dans ses arguments, la Révolution Conservatrice mêle en effet une aspiration à retrouver un monde stable, philosophiquement marqué d’un certain substantialisme, et une aspiration à détruire, à extirper révolutionnairement les derniers restes du monde substantialiste. On a parfois pu dire que le nazisme montant a repris à son compte quelques-uns des arguments de la Révolution Conservatrice. Toute propagande a toujours fait feu de tout bois. La Russie soviétique, par ex., a toléré, au début de son existence, toutes les formes de modernisme. Quelques années plus tard, il n'en restait plus rien. La situation fut analogue, en Allemagne, pour la Konservative Revolution. Hitler n’a pas hésité à utiliser à son profit tout argument dirigé contre le libéralisme ou le marxisme, mais, en fait, les éléments philosophiques ou idéologiques qui pouvaient contribuer à révolutionner la philosophie occidentale lui étaient profondément indifférents. Sa praxis politique restait liée à une Realpolitik d’inspiration impérialiste commune à tout le XIXe siècle finissant. Sa vision du monde n’était qu’un mélange confus de darwinisme primaire et de nietzschéisme banalisé [24].
 En Allemagne, les représentants de ce qu’il convient d’appeler le "réalisme héroïque" ont été principalement Josef Weinheber, Ernst Jünger et Gottfried Benn. Ces auteurs se sont mis à la recherche d’un nouvel "impératif catégorique", dégagé de tous les reliquats du bourgeoisisme de 2 derniers siècles. Radikal "unbürgerlich" : tel était pour eux le programme du XXe siècle. L'anti-bourgeoisisme avait pour but de tirer les peuples européens de leur "indolence" ontologique - cette indolence dans laquelle les actes des hommes sont incapables de s’accomplir de façon strictement "formelle", d’être en eux-mêmes et par eux-mêmes une "structure", une "forme" ou une "attitude" (Struktur, Gestalt, Haltung). Cela revenait à dire que le monde se "justifie" par l'esthétique et non par l'éthique. Dans cette perspective, même si l’attitude héroïque peut se comprendre comme dotée d’une valeur éthique, c’est surtout pour la beauté du geste qu’elle se trouve appréciée. Dès lors, toute "substantialité" se dissout. Le geste porte sa valeur en lui-même et ne se justifie plus au départ d'un système ou d’une ontologie. Le réalisme héroïque, selon Walter Hof [25], se définit comme un existentialisme esthétique ou comme un esthétisme existentiel. Le terme "esthétisme" a pourtant une mauvaise réputation. On croit trop souvent qu'il exprime une sorte de fuite hors du monde, "dans la tour d’ivoire de la beauté ésotérique". Mais en réalité, ce n'est pas hors du monde que veulent se placer les contemporains de Heidegger. Ils veulent au contraire percevoir le monde, mais exclusivement sous l'angle esthétique.
En Allemagne, les représentants de ce qu’il convient d’appeler le "réalisme héroïque" ont été principalement Josef Weinheber, Ernst Jünger et Gottfried Benn. Ces auteurs se sont mis à la recherche d’un nouvel "impératif catégorique", dégagé de tous les reliquats du bourgeoisisme de 2 derniers siècles. Radikal "unbürgerlich" : tel était pour eux le programme du XXe siècle. L'anti-bourgeoisisme avait pour but de tirer les peuples européens de leur "indolence" ontologique - cette indolence dans laquelle les actes des hommes sont incapables de s’accomplir de façon strictement "formelle", d’être en eux-mêmes et par eux-mêmes une "structure", une "forme" ou une "attitude" (Struktur, Gestalt, Haltung). Cela revenait à dire que le monde se "justifie" par l'esthétique et non par l'éthique. Dans cette perspective, même si l’attitude héroïque peut se comprendre comme dotée d’une valeur éthique, c’est surtout pour la beauté du geste qu’elle se trouve appréciée. Dès lors, toute "substantialité" se dissout. Le geste porte sa valeur en lui-même et ne se justifie plus au départ d'un système ou d’une ontologie. Le réalisme héroïque, selon Walter Hof [25], se définit comme un existentialisme esthétique ou comme un esthétisme existentiel. Le terme "esthétisme" a pourtant une mauvaise réputation. On croit trop souvent qu'il exprime une sorte de fuite hors du monde, "dans la tour d’ivoire de la beauté ésotérique". Mais en réalité, ce n'est pas hors du monde que veulent se placer les contemporains de Heidegger. Ils veulent au contraire percevoir le monde, mais exclusivement sous l'angle esthétique.
Josef Weinheber, Ernst Jünger et Gottfried Benn
Comment Weinheber, Jünger et Benn ont-ils, chacun, "arraisonné" l’existence ? Des 3, Josef Weinheber est le plus "conservateur". L'élan vers l’avant, le Durchbruch nach vorne, est jugé par lui trop dynamique et, partant, trop instable. L’intensité existentielle que déploie l’ "homme sur la brèche", l’unité totale avec le monde immanent qu’il acquiert en ces rares moments, lui semblent trop fugaces. L'art est pour lui la seule valeur indubitable, le seul impératif catégorique. L’art se saisit des choses, des douleurs, pour les transformer en "chants" (Lieder). Weinheber, dans son œuvre, chante la fierté du créateur solitaire, la tragique folie quelque peu titanique de l’idéaliste qui poursuit, sans espoir, ce qui lui restera inaccessible. La création, elle, dure. Comme Heidegger, Weinheber déplore la disparition du monde hellénique archaïque, l'éviction des dieux hors du monde, le dessèchement des forces démoniques, la chute de l’inauthentique où aucune "forme" n’est plus perceptible.
 Contrairement à Weinheber, le jeune Ernst Jünger, lui, ne déplore pas le nihilisme. Dans ses premiers écrits, aucune mélancolie ne transparaît - mais aucun sentiment de joie non plus. L'action des "aventuriers", des hommes qui vivent dangereusement en s’imposant une implacable discipline personnelle est, à ses yeux, un modèle. Le réalisme héroïque de Jünger peut s’énoncer en quelques maximes : faire face à l'épreuve, s'endurcir à la douleur, vivre dangereusement. En dictant de tels préceptes de conduite, Jünger montre sa volonté de poser les bases d’un nouveau nihilisme qui sera révolutionnaire et actif. À son sujet, Marcel Decombis écrit : "Le travail de destruction s’achève par la découverte d’une réalité capable de servir de base à l’édification d’un système. Il a eu pour effet de mettre en évidence l’existence des forces élémentaires, contenues aussi bien dans le monde physique que dans le cœur de l’homme..." [26]. Mais Jünger constate que les forces élémentaires de l’enthousiasme ne suffisent plus. La Ière Guerre mondiale a démontré qu’un simple servant de mitrailleuse pouvait décimer une troupe entière d’hommes héroïquement convaincus de leur cause. L’expérience militaire de Jünger lui a fait constater le rôle implacable de la machine. L’homme, cependant, ne peut plus reculer. Il faut aller de l’avant, obliger la machine à vivre, à son tour, l’aventure. L’idéal vitaliste doit s’incarner dans le militant politique moderne. La "substantialité" doit se re-découvrir dans le dynamisme déployé par les existences les plus fortes. Dans Der Arbeiter (1932), ouvrage que Walter Hof considère comme la "Bible" du réalisme héroïque, Ernst Jünger entend précisément tracer l’ébauche de l’homme de l’époque à venir. Cet homme doit incarner l’unité des contraires. L’ordre absolu de l’avenir dépassera les types d’ordre bourgeois en ceci qu’il n’exclura pas le risque ; il sera, dit Jünger, le fruit des nouvelles épousailles de la vie avec le danger. La tâche de l’homme nouveau ne sera pas de lutter contre le monde en marche, avec la nostalgie des stabilités perdues, mais d’être le Vabanquespieler, le "joueur qui risque le tout pour le tout", du nouvel âge. Jünger transpose ainsi, dans l’arène politico-idéologique, la philosophie de l’acte et de la décision.
Contrairement à Weinheber, le jeune Ernst Jünger, lui, ne déplore pas le nihilisme. Dans ses premiers écrits, aucune mélancolie ne transparaît - mais aucun sentiment de joie non plus. L'action des "aventuriers", des hommes qui vivent dangereusement en s’imposant une implacable discipline personnelle est, à ses yeux, un modèle. Le réalisme héroïque de Jünger peut s’énoncer en quelques maximes : faire face à l'épreuve, s'endurcir à la douleur, vivre dangereusement. En dictant de tels préceptes de conduite, Jünger montre sa volonté de poser les bases d’un nouveau nihilisme qui sera révolutionnaire et actif. À son sujet, Marcel Decombis écrit : "Le travail de destruction s’achève par la découverte d’une réalité capable de servir de base à l’édification d’un système. Il a eu pour effet de mettre en évidence l’existence des forces élémentaires, contenues aussi bien dans le monde physique que dans le cœur de l’homme..." [26]. Mais Jünger constate que les forces élémentaires de l’enthousiasme ne suffisent plus. La Ière Guerre mondiale a démontré qu’un simple servant de mitrailleuse pouvait décimer une troupe entière d’hommes héroïquement convaincus de leur cause. L’expérience militaire de Jünger lui a fait constater le rôle implacable de la machine. L’homme, cependant, ne peut plus reculer. Il faut aller de l’avant, obliger la machine à vivre, à son tour, l’aventure. L’idéal vitaliste doit s’incarner dans le militant politique moderne. La "substantialité" doit se re-découvrir dans le dynamisme déployé par les existences les plus fortes. Dans Der Arbeiter (1932), ouvrage que Walter Hof considère comme la "Bible" du réalisme héroïque, Ernst Jünger entend précisément tracer l’ébauche de l’homme de l’époque à venir. Cet homme doit incarner l’unité des contraires. L’ordre absolu de l’avenir dépassera les types d’ordre bourgeois en ceci qu’il n’exclura pas le risque ; il sera, dit Jünger, le fruit des nouvelles épousailles de la vie avec le danger. La tâche de l’homme nouveau ne sera pas de lutter contre le monde en marche, avec la nostalgie des stabilités perdues, mais d’être le Vabanquespieler, le "joueur qui risque le tout pour le tout", du nouvel âge. Jünger transpose ainsi, dans l’arène politico-idéologique, la philosophie de l’acte et de la décision.
 Jünger extériorise dans la politique son dépassement du nihilisme passif et du substantialisme, et ce dépassement réside dans l’action. Gottfried Benn, lui, choisit une voie intérieure (Weg nach Innen), une voie vers le spirituel et l’artistique. Inaccessible à la décadence, le monde des formes artistiques permet de penser et de vivre une restitutio du vieux monde précapitaliste et du cosmos antique. Ce monde peut être vécu grâce au travail qu’opère l’esprit constructivement par le moyen de l’art ; en tant qu’univers intérieurement re-créé, il doit transmettre au monde purement présent de l’extérieur l’idée d' "attitude maintenante" (Haltung), laquelle correspond à une impulsion de résistance, à un refus de fuite, que ce soit vers la sécurité ou vers l’action désespérée. L’image anthropologique qui ressort de l’œuvre de Benn est celle d’un homme qui reste stoïque au milieu des ruines. On connaît à ce propos le livre du penseur traditionaliste italien Julius Evola, Les hommes au milieu des ruines [27]. Écrit en 1960, cet ouvrage n’a pas été connu de Benn, qui, par contre, a préfacé en 1935 l’édition allemande d’un autre livre d'Évola, Révolte contre le monde moderne [28].
Jünger extériorise dans la politique son dépassement du nihilisme passif et du substantialisme, et ce dépassement réside dans l’action. Gottfried Benn, lui, choisit une voie intérieure (Weg nach Innen), une voie vers le spirituel et l’artistique. Inaccessible à la décadence, le monde des formes artistiques permet de penser et de vivre une restitutio du vieux monde précapitaliste et du cosmos antique. Ce monde peut être vécu grâce au travail qu’opère l’esprit constructivement par le moyen de l’art ; en tant qu’univers intérieurement re-créé, il doit transmettre au monde purement présent de l’extérieur l’idée d' "attitude maintenante" (Haltung), laquelle correspond à une impulsion de résistance, à un refus de fuite, que ce soit vers la sécurité ou vers l’action désespérée. L’image anthropologique qui ressort de l’œuvre de Benn est celle d’un homme qui reste stoïque au milieu des ruines. On connaît à ce propos le livre du penseur traditionaliste italien Julius Evola, Les hommes au milieu des ruines [27]. Écrit en 1960, cet ouvrage n’a pas été connu de Benn, qui, par contre, a préfacé en 1935 l’édition allemande d’un autre livre d'Évola, Révolte contre le monde moderne [28].
On constate, à lire cette préface, que le nihilisme désespéré de l’Allemand diffère fondamentalement de la confiance que, malgré tout, conserve l’Italien. Le rejet de tout substantialisme au profit des "formes" créés par l’artiste traduit d’ailleurs, chez Benn, un oubli du facteur "temps" que Heidegger avait découvert dans tout étant, dans tout phénomène. Benn, comme Évola, déplore l’usure que le temps impose à toutes choses. Ce qui le rend mélancolique ou pessimiste, c'est l’impossibilité de contrecarrer la fatale érosion des formes. Julius Évola, on le sait, s’est d’abord jeté dans l’aventure dadaïste, avant de rêver, dans Révolte contre le monde moderne, à une très problématique restauration des idéaux médiévaux. La révolte d’Évola, comme celle de Benn, est principalement dirigée contre le monde bourgeois. Mais cette révolte est ambiguë. Elle prône l’existence de 2 règnes : chez Benn, le règne de l’art et celui de la puissance ; chez Évola, le règne de la transcendance et celui de l’immanence. Chez l’un comme chez l’autre, cette ambiguïté reste toutefois postérieure à une saisie fougueusement polymorphe, typique de cette époque où l’esprit oscillait dans tous les sens. Les poètes des années 30 décidaient de se faire communistes, fascistes, nationalistes. Certains descendaient même dans la rue. Benn, lui, choisit simplement de rester artiste. Il exige, pour l’Allemagne, l’abandon des motifs épuisés de l’époque théiste et le report de toute la charge de nihilisme dans les forces constructives et formelles de l’esprit, afin d’instituer une sévère morale et une métaphysique de la forme. On repère ici, immédiatement, les similitudes et les dissemblances par rapport à Heidegger.
Au mépris de toute vraisemblance, certains adversaires acharnés de la Révolution Conservatrice n’ont pas hésité à prétendre que celle-ci avait, en quelque sorte, "préparé le terrain" au national-socialisme. Les mêmes ont fait reproche à Heidegger d’avoir accepté, en avril 1933, la responsabilité du rectorat de l’université de Fribourg - tout en se gardant bien d’évoquer le contexte dans lequel cette nomination est intervenue, et en passant sous silence, notamment, l'hostilité que le régime hitlérien, en la personne de ses philosophes "officiels", Ernst Krieck et Alfred Baeumler, n’ont cesse, dès 1934, de témoigner à l’auteur de Sein und Zeit. Ce dernier, on le sait, s’est expliqué de façon très précise sur cette question dans un célèbre entretien publié après sa mort par Der Spiegel [29]. Figure de proue de la Konservative Revolution, Heidegger partage en fait, dans une large mesure, le jugement critique de ce vaste mouvement d’idées à l’endroit du national-socialisme. Mais quel fut ce jugement critique ? C’est ce qu'il vaut la peine d’examiner.
le "fascisme" de la catholicité latine
Ce jugement, tout d’abord, n’est pas monolithique. La Konservative Revolution n’est pas un mouvement dans lequel une seule direction est jugée "bonne". Elle réunit plutôt, de façon informelle, un ensemble de penseurs qui ont constaté l'échec du type libéral et bourgeois de société et qui, se dispersant dans différentes directions, ont entrepris de rechercher des solutions de rechange. Les alternatives proposées varient selon les itinéraires individuels, les amitiés, les provenances idéologiques. Le national-socialisme, qui mit fin brutalement au foisonnement intellectuel du mouvement, est tantôt critiqué comme "plébéien", tantôt comme "réactionnaire" et "catholique".
Cette dernière opinion est exprimée not. par le "national-bolchevik" Ernst Niekisch. Sans aucune nuance, Niekisch se fait l’avocat de l’alliance germano-russe contre un Occident jugé en "décomposition", et prône la formation d’un bloc germano-slave ayant pour objectif la "liquidation" de l’héritage "roman". Dans le feu de la polémique, il écrit dans Widerstand (n° 3, 1930) : "Nous sommes la génération du tournant du monde... Si nous nous pénétrons de la conscience de ce tournant, nous aurons le courage de l’exceptionnel, de l’extraordinaire, de l’inouï... Le monde ne peut tourner sans que bien des choses ne volent en éclats..." [30].
Or, pour Niekisch, ce qui doit voler en éclats, c’est le "fascisme" de la catholicité latine, si ancrée en Bavière et en Autriche, ces terres qui ont vu naître Hitler. "Qui est nazi sera bientôt catholique..." : par ces mots, Niekisch veut dire qu’il considère comme romain, catholique et fasciste le fait de flatter les bas instincts des masses, de leur dispenser l’illusion de la facilité, de répandre, enfin, une véritable "croyance aux miracles", s’opposant en tous points à l'attitude de l’Homo politicus prussien et protestant. Pour Niekisch, le retour au "giron catholique" est un gâchis des énergies allemandes, une voie de garage, qui ne vaut pas mieux que la torpeur politique propagée par les idées illuministes et bourgeoises de l’Occident libéral. Chez lui, l’expression d' "Occident libéral" est presque synonyme de l'Alltäglichkeit heideggérienne. Le libéralisme ne veut rien de grand. Il est une idéologie d’esclaves, en ce sens qu'il endort les énergies et refoule tout grand sentiment. Le catholicisme fasciste allemand est une idéologie de la distraction, visant à réaliser un homme moyen, qui habitera des immeubles préfabriqués, roulera en Volkswagen et, après une période difficile, finira par mener une vie dégagée de tout souci. Pour Niekisch - comme pour certains historiens qui, aujourd’hui, font profession d’antifascisme, tel Reinhard Kühnl [31] - l’hitlérisme se borne à vouloir réaliser vite les idéaux de bonheur de l’humanitarisme libéral. De telles positions ont certes aujourd'hui de quoi étonner. Cependant, même si elles ne correspondent pas entièrement aux realia, on peut y voir éventuellement l'indication de tendances qui auraient peut-être pu se révéler effectivement.
À l'inverse, "l’extraordinaire", "l’inouï" dont parlait Niekisch dans l’article cité plus haut pourrait bien correspondre à l'existence authentique dont parle Heidegger. Le tournant du monde n’inaugurerait-il pas l’ère ou les hommes s’apercevraient de l’inanité des idéaux libéraux, et n’y verraient que de pâles émanations des principes substantialistes ? Il est certes hardi de comparer le langage polémique et simplifié d’un théoricien politique au langage philosophique si rigoureux (mais passionné tout de même) de Heidegger. Néanmoins, l'objet essentiel de la critique de Niekisch est bien la mortelle tiédeur de l'Alltäglichkeit. Et quant à la hargne parfois obsessionnelle de Niekisch envers la latinité catholique, avec sa valorisation corrélative de la liberté individuelle protestante, elle s’explique, au moins en partie, quand on met en parallèle la persistance, dans les idéologies politiques imprégnées de catholicisme (Maurras, Salazar, Franco, etc.), du vieux substantialisme, et l'édulcoration, par le luthéranisme et les idées de Herder, de ce même substantialisme dans la sphère protestante. Les slogans jetés dans le débat politique par Niekisch démontrent en tout cas l’originalité si pertinente de son antifascisme. Heidegger aurait-il en secret souscrit à des vues de ce genre ? Cela pourrait expliquer certains silences. Mais en fin de compte, c’est un exercice assez vain que de vouloir donner une étiquette partisane à Heidegger. L’auteur de Sein und Zeit a été un iconoclaste pour les philosophes qui entendaient en rester à la métaphysique occidentale classique. Niekisch, lui, a conjugué les paradoxes et interpellé tous les mouvements politiques. Il fut ce qu’on appellerait aujourd’hui un "extrémiste" tandis que Heidegger nous apprend à être sereinement radical. Soyons, donc, comme ce dernier, des radicaux sereins.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Notes :
- P. Bouts, Modernité et enracinement. Nécessaire Heidegger, in Artus n°7, 1981.
- JP Resweber, La pensée de Martin Heidegger, Privat, Toulouse, 1971.
- M. Heidegger, Holzwege, V. Klostermann, Frankfurt/M., 1949 (tr. fr. : Chemins qui ne mènent nulle part, 1962).
- M. Heidegger, Frühe Schriften, V. Klostermann, Frankfurt/M., 1972.
- Cf. Arion L. Kelkel et René Schérer, Husserl, PUF, 1971 ; Henri Arvon, La philosophie allemande, Seghers, 1970, pp. 139-149 et 160-169 ; Jean-Paul Resweber, op. cit., pp. 59-63.
- Pierre Trotignon, Heidegger, PUF, 1974, pp. 9-12.
- André Malet, Mythos et logos. La pensée de Rudolf Bultmann, Labor et Fides, Genève, 1962 et 1971, p. 277-311.
- A. Malet, op. cit., p. 305-306.
- Cf. Heidegger, Wegmarken, Klostermann, Frankfurt/M., 1967-1978 (et not. Vom Wesen des Grundes, p. 123-175).
- A. Malet, op. cit., p. 311.
- Heidegger, Albin Michel, 1981. Cf. aussi Lucien Goldmann, Lukàcs et Heidegger, Denoël, 1973.
- André Malet, op. cit., p. 75.
- Cf. E.W.F. Tomlin, R.G. Collingwood, Longmans, London, 1953 et 1961.
- Cf. R.G. Collingwood, The Idea of History (1946) et An Autobiography (1939) p.96-100, Oxford University Press.
- Cf. F. Guibal, ...Et combien de dieux nouveaux. Approches contemporaines I, Heidegger, Aubier-Montaigne, 1980.
- Wegmarken, op. cit. (cf. Phänomenologie und Théologie, pp. 45-79).
- Cf. V. Horia, Der neue Odysseus. Studie über den Verfall der Autorität in Criticon, IV, 25, sept-oct 1974, 233-236.
- Peter Gay, Weimar Culture. The Outsider as Insider, Penguin, Harmondsworth, 1968, p. 79-106.
- Walter Hof, Der Weg zum heroischen Realismus. Pessimismus und Nihilismus in der deutschen Literatur von Hamerling bis Benn, Lothar Rotsch, 1974.
- Introduction à la métaphysique, Gal., 1967, p. 49.
- Cf. Walter Hof, op. cit., p. 235. On consultera aussi Gerd-Klaus Kaltenbrunner (Hrsg.), Konservatismus International, Seewald, Stuttgart, 1973 (et plus particulièrement le texte d'Otto Mann, Dandysmus als konservative Lebensform, p. 156-170).
- Cf. Sigrid Hunke, Europas andere Religion. Die Ueberwindung der religiösen Krise, Econ, Düsseldorf, 1969.
- Les écrits politiques de Heidegger, L'Herne, 1968.
- Les historiens des idées se sont maintes fois penchés sur le problème de la vision du monde d’Adolf Hitler. Parmi quelques ouvrages récemment parus, signalons celui de William Carr, Adolf Hitler, Persönlichkeit und politisches Handeln, Kohlhammer, Stuttgart, 1980. Le 4ème chapitre de ce volume (Hitlers geistige Welt) évoque principalement l’influence des vulgates darwinistes qui avaient cours au début du siècle. Malheureusement, l’auteur applique trop souvent et à mauvais escient les stéréotypes freudiens. En français, on peut consulter l’étude du professeur Franco Cardini, de l’université de Florence : Le joueur de flûte enchantée (messianisme hitlérien, mythopoiétique national-socialiste et angoisse contemporaine), in Totalité, 12, été 1981.
- Walter Hof, op. cit., p. 240.
- E. Jünger, L’homme et l’œuvre jusqu’en 1936, Aubier-Montaigne, 1943.
- Les hommes au milieu des ruines, Sept Couleurs, 1972.
- Erhebung wider die moderne Welt, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart, 1935.
- Trad. fr. : M. Heidegger, Réponses et questions sur l’histoire et la politique, Mercure de France, 1977.
- Sur E. Niekisch, voir la monumentale étude de Louis Dupeux, Stratégie communiste et dynamique conservatrice. Essai sur les différents sens de l’expression "national-bolchevisme" en Allemagne, sous la République de Weimar (1919-1933), Honoré Champion, 1976. Plus récent et plus "militant" est le livre d’Uwe Sauermann, Ernst Niekisch zwischen allen Fronten, Herbig, München, 1980.
- Reinhard Kühnl, Formen bürgerlicher Herrschaft. Liberalismus-Faschismus, Rowohlt, Rein beckbei Hamburg, 1971. Cet ouvrage se fonde surtout sur la "littérature secondaire" et va rarement aux sources. Ce qui lui confère de l’intérêt, c’est l’intention de l’auteur.
00:10 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, allemagne, heidegger, existentialisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 01 juin 2008
Heidegger et son temps
CONCEPTION DE L’HOMME ET REVOLUTION CONSERVATRICE : HEIDEGGER ET SON TEMPS
Source : Robert STEUCKERS, revue Nouvelle Ecole n°37 (printemps 1982).

Dans l’œuvre de Heidegger, 2 types de vocabulaires se juxtaposent. D’une part, il y a celui, très concret, qui exalte la glèbe, le sol, la forêt, le travail du bûcheron, et, d’autre part, le plus apparemment rébarbatif des jargons philosophiques. Heidegger réalise donc ce tour de force d’être à la fois un doux poète bucolique et un philosophe universitaire excessivement rigoureux, auquel aucun concept n’échappe. Comment ces 2 attitudes ont-elles pu cohabiter dans un seul individu ? Y aurait-il 2 Heidegger ? L’article qui suit entend répondre à ces questions.
Il peut paraître banal de dire que Martin Heidegger est né le 26 septembre 1889 à Messkirch. C’est qu'une appréciable part de son œuvre sera déterminée par ce "quelque part". Heidegger reste, en effet, très attaché à son enracinement alémanique. L'enracinement, pour lui, est une des conditions essentielles de l'être-homme. "L'homme véridique ne sera pas enraciné par accident et provisoirement (en attendant mieux) ; il l’est essentiellement. L'homme qui perd ses racines se perd en même temps" [1]. Il ne serait pas arbitraire de résumer la pensée anthropologique de Heidegger en quelques mots : être homme, c'est bâtir (fonder) et habiter un monde (s'y enraciner). De fait, toute l’œuvre de Heidegger porte l’empreinte du terroir natal, de cette Souabe qui vit naître Schiller, Schelling, Hegel et Hölderlin. Le murmure, les palpitations de ce pays de forêts, silencieusement présents dans la philosophie heideggérienne, différencieront Heidegger de Sartre, le disciple parisien qui s'est efforcé d'utiliser à son profit le même outillage conceptuel. Sartre, a remarqué Jean-Paul Resweber, subira toujours l’influence anonyme ou frénétique des cités bourdonnantes, où il est impossible de saisir la densité et l’unité originelles des choses et de la nature [2].
le jeu de l’enracinement et de la désinstallation
La terre, lieu de notre séjour, est aussi le miroir de notre finitude, le signe d’un impossible dépassement. Elle rappelle à l'homme qu'il est irrémédiablement situé dans le monde de l’existant. Elle est le sol même sur lequel prend pied (Bodennehmen) notre liberté. L’acte libre, poursuit Resweber, n’est pas un pur jaillissement créateur ; le dépassement qu'il inaugure est, en fait, une reprise de notre être enraciné dans le monde, à la manière de possibilités nouvellement découvertes. Toute œuvre d’art est un resurgissement, une transfiguration de la terre ; celle-ci est l’élément primordial à partir duquel toute création (Schaffen) devient un "puiser" (Schöpfen). Dans L’origine de l’œuvre d’art (texte repris dans le recueil intitulé Holzwege) [3], Heidegger écrit que l’art fait jaillir la vérité. Si l’œuvre sauvegarde une vérité, c’est celle de l’étant : l’art est la "conclusion" de l’étant. Mais l’art ne se manifeste aussi que par la médiation de l’artiste, c-à-d. de l'homme. "L'existence humaine, ce lieu de ressourcement poétique, est essentiellement tragique, parce qu’elle est tendue entre un donné irréductible (la terre) et une exigence de dépassement jamais satisfaite, déchirée entre l'appel de la terre et celui du monde… L'homme humanise la terre avant de la dominer, et l'horizon qu'il déploie pour la pénétrer, c’est le monde. La réflexion philosophique est précisément la mise en dialogue de ces 2 pôles complémentaires de l’existence qui, dans une expérience unique, se découvre à la fois enracinée dans la terre et dépassée vers le monde" (Resweber, op. cit.).
C’est ce double jeu de l’enracinement et de la désinstallation que Heidegger nomme la transcendance. Le rôle de l’homme sera d’amener sa terre à l’éclosion d’un monde. Ce geste, cette tâche sont éminemment poétiques parce que le mystère profond de la terre reste toujours inépuisable et présent, parce qu'il s’exprime en mythes et en images, mais surtout parce que c’est l’homme, par son intelligence et son action, qui fait surgir (poïeïn) le monde. Avec un vocabulaire différent, on dira que l’homme est un être qui inaugure la dimension culturelle tout en restant lié à la nature. La tension qu’implique cette tâche de construire un monde est tragique, car jamais il n’y aura totale adéquation entre l’origine tellurique et le monde instauré par la geste humaine. La finitude que nous assigne la terre nous condamne à rester "inachevé". A nous d’accepter joyeusement cette destinée !
Si, pour Heidegger, l’enracinement dans le pays de la Forêt noire constitue la dimension spatiale primordiale, nous devons aussi nous intéresser au contexte historique de son œuvre de philosophe, réponse aux interrogations de ses contemporains. Heidegger - nous l’avons vu - est indubitablement l’homme d’un espace ; il est également l’homme d’une époque. Un grand nombre des questions que se posent les philosophes trouvent leur origine dans l’œuvre d’Aristote. Heidegger lui-même reconnaît cette dette [4]. Au Gymnasium de Constance et à celui de Fribourg, où il étudia de 1903 à 1909, le futur archevêque de Fribourg, le Dr Conrad Gröber, l’incita à lire la dissertation de Franz Brentano, Von der mannigfachen Bedeutung des Seienden nach Aristoteles, publiée en 1862 et consacrée aux multiples significations du mot "étant" chez Aristote. Cette 1ère initiation à la philosophie produisit, dans l’esprit du jeune étudiant, une interrogation encore imprécise : si l’étant a tant de significations, qu’est-ce qui en fait l’unité ? A partir de cette interrogation, Heidegger apprit à manier les concepts du langage philosophique et put percevoir toutes les potentialités de la méthode scolastique.
La période qui va de 1916 à 1927 constitue, dans la biographie de Heidegger, un silence de maturation. Rien, pendant ces 11 années, n’est très clair. On tâchera néanmoins de repérer quels furent les contacts personnels et intellectuels qui influeront sur l’élaboration de Sein und Zeit (L’être et le temps, 1927) d’abord, des cours, des essais et des conférences ensuite. C’est à cette époque, notamment, que Heidegger a travaillé avec Edmund Husserl (1859-1938), ce qui lui a permis d’acquérir complètement la discipline mentale et le vocabulaire de la phénoménologie. Cette discipline philosophique avait été investie, au XIXe siècle, d’un sens nouveau. Auparavant, elle désignait la simple description des phénomènes. Husserl, lui, eut la volonté de faire de la phénoménologie une science philosophique universelle. Le principe fondamental de cette "science" était ce que Husserl a appelé la réduction phénoménologique ou eïdétique. Cette réduction a pour but de concentrer l’attention du philosophe sur les expériences fondamentales qui n’ont jamais reçu d’interprétation, sur la description des vécus de conscience, sur la découverte des racines des idées logiques et sur la nécessité de rechercher les essences des choses. Husserl partira donc de ces idées logiques pour montrer leur enracinement dans la conscience vécue et, ensuite, découvrir dans l’ego transcendantal le fondement ultime du réel. L’influence de cette démarche philosophique se retrouvera dans le vocabulaire de Heidegger.
Husserl a commis le péché du géomètre
Pourtant, la 1ère œuvre magistrale de Heidegger, Sein und Zeit, marque un tournant radical par rapport à l’héritage husserlien. Heidegger reproche à son maître de réinstituer une métaphysique dégagée de tout vécu. L’ego transcendantal, à l’instar du modèle cartésien, se pense objectivement en face du monde. Ce face-à-face implique un arrachement du sujet au non-sens du monde. L’humanité réelle, seul sujet historique, devient l’ego trans-cendantal. Vicissitudes, événements, enracine-ments, histoire se voient donc dépouillés de tou-te validité. Pour échapper à cet idéalisme ratio-naliste, Heidegger propose une phénoménologie postulant qu’il n’y a pas, à la racine des phénomènes, une réalité dont ils dérivent. Il écrit : "Au-dessus de la réalité, il y a la possibilité. Comprendre la phénoménologie veut dire saisir ses possibilités". Ces possibilités présentes dans l’immanence, c’est ce que Heidegger appelle l’être de l’étant. Pour lui, ontologie et phénoménologie ne sont pas 2 disciplines différentes : il est impossible de sortir du plan des phénomènes, car ce serait s’exclure de la sphère de la révélation de l’être. En d’autres termes, refuser de tenir compte des phénomènes, c’est s’interdire l’accès à l’essentiel. Heidegger renverse la perspective de la philosophie traditionnelle : il voit l’essentiel dans l’intervention sur la trame des phénomènes et non dans une position de distance prise vis-à-vis d’eux.
Le moi transcendantal, chez Husserl, s’érige contre la phénoménalité des phénomènes, exactement comme dans la plupart des perspectives philosophiques classiques. II est la cause qui explique les phénomènes, le lieu à partir duquel ceux-ci sont dominés et justifiés. L’homme, dans une telle perspective, est un découvreur et non un créateur de sens. Sa position est contemplative et non active. Pour Heidegger, au contraire, la réflexion philosophique ne doit pas se borner à expliquer (à décrire ou à recenser) la réalité statique des phénomènes, mais elle doit en expliquer, par le moyen de l’herméneutique, les possibilités, c-à-d. ce qui, en eux, est susceptible de se développer, d’évoluer vers la production de nouveauté. On ne décrit complètement et avec assurance que ce qui est statique, figé, sûr. De ces choses statiques, les philosophes avaient déduit les essences. Hélas pour eux, les essences étaient rarement adéquates aux existences. De cette inadéquation naissent tant le pessimisme, qui s’en désole, que bon nombre de totalitarismes qui veulent, coûte que coûte, réaliser l’adéquation définitive. Heidegger pense que la possibilité est le mode d’être propre à l’existant parce qu’on ne peut reconnaître aucune entité métaphysique comme fondement de l’existence, et parce qu’il faut ré-enraciner l’être dans les phénomènes, dans la "facticité" [5]. Résolument, Heidegger affirme que c’est le néant qui sous-tend l’existence. Il ne remet rien à la place des anciens absolus métaphysiques.
Husserl, avec son moi transcendantal, a fini par commettre le péché du géomètre : la nature qu’il postule est préalablement posée, en dehors de toute limitation spatiale et temporelle, derrière l’écran des contingences et des particularités. Cette nature est comme créée ex nihilo. Où faut-il alors placer le travail de l’homme ? Le moi transcendantal travaille-t-il ? Le moi transcendantal produit-il ce que recèlent les possibilités ? Ces questions, Heidegger y répond dans son œuvre, en une sorte de dialogue inavoué avec Husserl.
Le monde de l'existence, ce chantier où œuvre l'homme, est, sans pour autant être nié, mis "entre parenthèses" par Husserl. L'herméneutique heideggérienne voudra, elle, décrire la facticité pour, ensuite, la retourner vers son sens ontologique, ce sens qui annonce l’être dans le monde. La description ne vise ici qu’à repérer ce qui peut être actualisé - ce qui peut se manifester dans le monde, ce que nous pouvons faire surgir. Le savoir a toujours été conçu comme un "voir" passif ; un tel point de départ trahit un platonisme tenace. Or Heidegger veut dépasser toute les attitudes passives qu'impliquent les enseignements des vieux philosophes. C’est pourquoi il juge que l'ego (le moi) transcendantal de Husserl reste, lui aussi, "un pur regard, assuré de son immortalité, glissant à travers l'éther du sens pur" [6]. Husserl n'a pas perçu que toute présence, jetée au regard de l’observateur, montre au philosophe attentif une temporalité dissimulée, oubliée ou déformée. Toute présence est à la fois spatiale (l’opposition de l’absence) et temporelle (son caractère d’instant). L’être et le temps sont liés dans la présence, et la reconnaissance de cette naïve évidence est la condition sine qua non pour échapper à l’illusion métaphysique.
Cette découverte de l’imbrication être-temps, Heidegger la doit à l’intérêt qu’il porte à la théologie depuis 1923. Cet intérêt a de multiples aspects. Sa rencontre avec l’œuvre de Rudolf Bultmann (1884-1976), philosophe connu pour s’être assigné la tâche de "dé-mythologiser" le Nouveau Testament en l’interprétant à la lumière de l’existentialisme, est, sur ce plan, capitale [7]. Bultmann a voulu dégager le message du Nouveau Testament en expliquant le contenu éthique des expressions mythiques employées dans la rédaction des textes évangéliques. Pour la Bible, l’homme est, d’une certaine manière (et de façon provisoire), historicité. Heidegger a scruté, avec la plus grande attention, la tradition chrétienne pour comprendre le rôle que joue la temporalité dans le phénomène humain. Il a médité Kierkegaard et, selon Bultmann, "ne s’est jamais caché d’avoir été influencé par le Nouveau Testament, spécialement par Paul, ainsi que par Augustin et particulièrement par Luther" [8]. "L’homme, écrit Bultmann, existant historiquement dans le souci de lui-même, sur le fond de l’angoisse, est chaque fois, dans l’instant de la décision, entre le passé et le futur : veut-il se perdre dans le monde du donné, du "on" ou veut-il atteindre son authenticité dans l’abandon de toute assurance et dans le don sans réserve au futur ?" (Kerygma und Mythos, I, 33).
Chez Paul, le terme kosmos ou monde n’est pas un état de choses cosmique, mais l’état et la situation de l’être humain, la façon dont celui-ci prend position envers le cosmos, la façon dont il en apprécie les biens. Chez Augustin, mundus signifie la totalité du créé, mais aussi, et surtout, habitatores mundi ou encore, plus péjorativement, dilectores mundi (ceux qui chérissent le monde), impii (les impies) ou carnales (les charnels) [9]. Au Moyen Age, Thomas d’Aquin reprendra cette distinction et fera du terme mundanus l’antonyme de spiritualis. Pourtant, malgré cette perception post-évangélique du monde, où celui-ci n’est pas appréhendé dans sa stabilité ontique, la tradition occidentale est restée prisonnière du vieux substantialisme immobiliste platonicien. Le protestantisme luthérien, toutefois, a eu le mérite de ré-actualiser le dynamisme propre à la saisie existentielle du Nouveau Testament. En ce sens, la révolution noologique amorcée par la Réforme constitue une 1ère étape dans la sortie hors de ce que Heidegger appelle l’oubli de l’être. L’homme ne vit authentiquement que s’il projette des possibilités, s’il s’extrait du monde de la banalité quotidienne.
L’existence, selon Heidegger, ne doit plus se comprendre à partir de l’étant, mais de l’être. Or, écrit André Malet [10], l’être n’est jamais une possession ; il est un destin historique qui rencontre l’homme d’une manière toujours nouvelle. L’homme est en définitive sa propre œuvre. En cela, Heidegger dépasse et refuse l’eschatologie vétérotestamentaire : il ne reconnaît pas la totale impuissance de l’homme à l’endroit de son ipséité.
chaque génération doit réécrire l’histoire
Pour l’historien grec Thucydide, l'élément permanent de l’histoire, c’est l’ambition et la recherche du pouvoir, dont le but est de donner des instructions utiles pour les décideurs à venir. Thucydide perçoit le mouvement de l’histoire comme analogue à celui du cosmos, de la nature. Plus tard, Giambattista Vico (1668-1744) a repris le thème antique du mouvement cyclique de l'histoire en le complétant : il y inclut l'idée d’une progression en spirale, grâce à laquelle la phase première du cycle I est autre que la phase première du cycle II. En Allemagne, Herder relativisera aussi l’histoire grâce au thème romantique du Volksgeist : chaque peuple, chaque époque a son éthique propre, ce qui implique en corollaire que ce ne sont ni la permanence ni l’éternité des choses qui importent, mais l’Erlebnis (le vécu).
 Au XXe siècle, enfin, Oswald Spengler systématisera cette perspective organique de l’histoire. Les civilisations, pour lui, seront isolées les unes des autres et leurs productions (scientifiques, mathématiques, philosophiques, théologiques, etc.) leur seront absolument propres. De Thucydide à Spengler, on a donc interprété l'histoire sur le modèle des faits naturels ; l’événement historique est considéré, selon cette perspective, comme une réalité finie, comme une chose. Nul ne songerait, bien évidemment, a nier la validité épistémologique de cette démarche. Mais Heidegger nous exhorte à ne pas en rester là. Il veut nous faire saisir l’événement historique comme un événement qui n’est jamais achevé. Dans la perspective antérieure, l’invasion des Gaules par César ou l'acte de rébellion de Luther étaient des faits définitivement morts. En fait, ils ne l’étaient que du strict point de vue spatio-temporel. Leur sens, lui, n’est nullement "mort". Il n'a pas été encore déployé dans toute son étendue ni toute sa profondeur. Ces sens subsistent à l’état de latence et restent susceptibles de se manifester dans notre existence. Les conséquences d’un événement constituent le futur de l’acte jadis posé tout autant que le présent qui appelle nos décisions pour forger l’avenir.
Au XXe siècle, enfin, Oswald Spengler systématisera cette perspective organique de l’histoire. Les civilisations, pour lui, seront isolées les unes des autres et leurs productions (scientifiques, mathématiques, philosophiques, théologiques, etc.) leur seront absolument propres. De Thucydide à Spengler, on a donc interprété l'histoire sur le modèle des faits naturels ; l’événement historique est considéré, selon cette perspective, comme une réalité finie, comme une chose. Nul ne songerait, bien évidemment, a nier la validité épistémologique de cette démarche. Mais Heidegger nous exhorte à ne pas en rester là. Il veut nous faire saisir l’événement historique comme un événement qui n’est jamais achevé. Dans la perspective antérieure, l’invasion des Gaules par César ou l'acte de rébellion de Luther étaient des faits définitivement morts. En fait, ils ne l’étaient que du strict point de vue spatio-temporel. Leur sens, lui, n’est nullement "mort". Il n'a pas été encore déployé dans toute son étendue ni toute sa profondeur. Ces sens subsistent à l’état de latence et restent susceptibles de se manifester dans notre existence. Les conséquences d’un événement constituent le futur de l’acte jadis posé tout autant que le présent qui appelle nos décisions pour forger l’avenir.
Bultmann écrit à ce propos : "Les phénomènes historiques ne sont pas ce qu’ils sont dans leur pur isolement individuel, mais seulement dans leur relation au futur pour lequel ils ont une importance". L'être se voit ainsi historicisé, et les hommes se retrouvent responsables de l'à-venir du passé. Les hommes, autrement dit, doivent décider hic et nunc de la signification de leur "avant" et de leur "après". (Malheureusement, la plupart des hommes s'attachent aux soucis du monde et, quand ils sont appelés à la décision, ils s'y refusent).
Faisant abstraction des idéologèmes misérabilistes et intéressés du christianisme, d’autres penseurs tels que Dilthey, Croce, Jaspers et Collingwood, se sont également efforcés de souligner l'originalité des faits historiques par rapport aux faits naturels, et, ipso facto, celle de l’histoire au regard des sciences de la nature. Heidegger a beaucoup réfléchi, en particulier, sur la tentative de Dilthey de définir les relations véritables entre la conscience humaine et les faits historiques. C’est de Dilthey, par ex., qu'il tire sa distinction fondamentale entre les vérités techniques (ontiques), propres aux sciences exactes et appliquées, et les intuitions authentiques, visées par les sciences historiques et humaines (Geisteswissenschaften). Sein und Zeit reprend d’ailleurs le contenu de la dispute philosophique entre Dilthey et Yorck von Wartenburg. Ce dernier reprochait à Dilthey de ne pas rejeter de manière suffisamment radicale une vision de l’histoire basée sur l’enchaînement causal. Heidegger insiste, lui aussi, sur la détermination temporelle de l’homme : l’identité humaine, dit-il, se découvre dans l’histoire. George Steiner, dans le bref ouvrage qu’il a consacré à Heidegger [11], rapproche cette position de celle du marxisme hégélien et révolutionnaire. De fait, comme le philosophe marxiste hongrois Georg Lukàcs, Heidegger insiste sur l’engagement des actes humains dans l’existence historique et concrète. Cette perspective conduit à adopter une attitude strictement immanentiste.
Pour le Britannique R.G. Collingwood (1889-1943), chaque génération doit réécrire l’histoire, chaque nouvel historien doit donner des réponses originales à de vieilles questions et réviser les problèmes eux-mêmes. Cette pensée est résolument anti-substantialiste. Elle pose la pensée comme effort réfléchi, comme réalisation d’une chose dont nous avons une conception préalable. La pensée, pour Collingwood, est intention et volonté. Elle doit être perçue comme une décision qui met en jeu tout l’être [12]. La plupart des conceptions de l’histoire jusqu’ici, fait fausse route. La raison de ces échecs réside dans une mauvaise compréhension de ce que on entendait autrefois par "science de la nature humaine" ou "sciences des affaires humaines". Au XVIIIe siècle, l’étude de la "nature humaine" s’est bornée à élaborer une série de types, s’apparentant ainsi à une recherche de caractère statique et analytique. Au XIXe siècle, l’étude des "affaires" humaines a provoqué la naissance des "sciences humaines", que Herbert Spencer appela plus justement social statics ; on catalogua alors toutes les forces irrationnelles à l’œuvre dans la société [13].
Mais la nature humaine, qui, selon Collingwood, est historique, ne peut s’appréhender à la manière d’un donné, par perception empirique. L’historien n’est jamais le témoin oculaire de l’événement qu’il souhaite connaître. La connaissance du passé ne peut être que médiat : Comment la connaissance historique est-elle alors possible ? La réponse de Collingwood est simple : l’historien doit ré-actualiser le passé dans son propre esprit [14]. Cette attitude a d’importantes conséquences. Lorsqu’un homme pense historique-ment, il a devant lui des documents ou des reliques du passé. Il doit re-découvrir la démarche qui a abouti à la création de ces documents. L’étude historique n’est possible que parce qu’il reste des survivances de l’époque où les documents ont été fabriqués ou rédigés. Dès lors, le passé qu’étudie un historien n’est jamais un passé complètement mort. L’histoire, écrit Collingwood, ne doit donc pas se préoccuper d’ "événements" mais de "processus". Se préoccuper de processus fait découvrir que les choses n’ont ni commencement ni fin, mais qu’elles "glissent" d’un stade à un autre. Ainsi, si le processus P1 se mue en processus P2, on ne pourra pas déceler de ligne séparant l’endroit, le moment où P1 finit et où P2 commence. P1 ne s’arrête pas, il se perpétue sous la forme de P2 - et P2 ne débute jamais, car il a été en gestation dans P1. L’historien qui vit dans le processus P2 devra savoir que P2 n’est pas un événement clos sur lui-même, pur et simple, mais un P2 mâtiné des survivances de P1.
Comme Collingwood, Heidegger sait que les gestes passés persistent, soit en tant que structures établies (avec le danger de sclérose), soit, après un échec, en tant que possibilités refoulées. Penser les événements historiques comme finis, comme confinés dans un "espace" temporel limité, revient, selon lui, à "objectiver" l’histoire à la manière dont les platoniciens et les scolastiques avaient "objectivé" la nature. Par opposition aux métaphysiciens, Heidegger entend donc expérimenter la vie dans son historicité, c-à-d. la vie non pas figée dans le "présent-constant", mais bien plutôt comme essentiellement "kaïrologique", ce qui signifie à la façon d’une mise en jeu, d’un engagement, d’une "folie". Ce jeu d’engagement et de "folie" constitue l’authenticité, dans la mesure même où il échappe aux petits aménagements de ceux qui souhaitent que le monde corresponde a leurs calculs. Les hommes qui souhaitent un tel monde sont déclarés inauthentiques. L’homme intégral ou celui qui vise l’intégralité est toujours menacé par les mystifications idéologiques et doit toujours demeurer vigilant pour se maintenir dans une attitude de liberté et d’ouverture véritables. Les mystifications idéologiques pétrifient le temps - ce temps toujours susceptible d’ébranler leurs certitudes réconfortantes. La "réalité" n’est pas, chez Heidegger, donnée une fois pour toutes, depuis toujours et de toute éternité. Elle est "question" & "jeu" ; elle "joue" à ouvrir et à relancer sans fin le jeu inépuisable de l’être et du temps, de la présence et de l’ "ouvert", de l’enracinement et de la désinstallation. Le jeu de l’être est sans justification ni raison, il se déploie à travers le destin, l’errance et les combats du temps. II est sans origine ni fin(s), sans référence aucune à un centre fixe et substantiel qui commanderait et garantirait son déploiement [15]. Ce rejet de toute pensée figée implique l’acceptation joyeuse de la pluri-dimensionnalité du cosmos, une pluri-dimensionnalité que le "penser" et le "dire" n’auront jamais fini d’explorer et de célébrer en toutes ses dimensions.
L’attitude de celui qui a fait sienne cette conception du monde est la Gelassenheit : impassibilité, sang-froid, sérénité. La Gelassenheit permet de supporter une existence privée de totalité rassurante. La finitude de l’homme nous place en effet dans (et non devant) un mystère inépuisable, qui ne cesse d’interpeller la pensée pour l’empêcher de se clore sur ses représentations.
un remplacement radical de toutes les ontologies
Heidegger nous propose donc son histoire de la philosophie, sa perspective sur l’œuvre des philosophes qui se sont succédés depuis Platon jusqu’à Nietzsche. Platon est celui qui a inauguré le règne de la métaphysique. Tandis que les Présocratiques concevaient l’être comme une unité harmonieuse qui conjugue stabilité, mouvance et jaillissement, Platon, brisant l’harmonie originelle de la nature, distingue la pensée de la réalité. Désormais, seul l’être saisissable par la pensée se verra attribuer la qualité d’être. Seul ce qui est non devenu, ce que le devenir ne corrode pas, ce qui est stable, limité dans l’espace, qui ne change pas, qui persiste, est. Tout ce qui est polymorphe, saisissable par les sens, tout ce qui devient et s’évanouit dans la temporalité et la spatialité, tout cela n’est, pour la tradition platonicienne, que du paraître. Cette radicale césure implique que l’esprit (noûs) ne fasse plus un avec la phusis. Au domaine de la vérité dé-limité par le champ de vision de l’esprit, Platon oppose le règne du sensible atteint par la perception (aïsthêsis). Chez les Présocratiques, le langage exprimait le surgissement de la réalité. Après Socrate et Platon, le langage devra ajuster la pensée à l’expression d’une proposition logique, "épurée" sémantiquement de toute trace de devenir. La démarche logique qui résulte de cette involution produit également la naissance de l’axiologie, de la morale. En effet, s’il faut rechercher toujours l’ajustement, il est évident que l’on finira par postuler un Ajustement suprême, que l’on nommera le Souverain Bien, l’Agathon. Sous l’influence de théologèmes pro-che-orientaux, ce divorce platonicien entre l’in-complétude du monde immanent et la complé-tude du monde des idées, recevra progressi-vement la coloration morale du bien et du mal.
Le monde a mis longtemps à triompher de la maladie dualiste. Heidegger le constate en interrogeant les grands philosophes qui l’ont précédé : Aristote, qui nuance, par sa théorie de l’acte et de la puissance, la pensée de Platon, mais qui ne le dépasse pas ; Thomas d’Aquin, qui personnalise le moteur premier sous les traits d’un Dieu chrétien déjà différent du Iahvé biblique ; Descartes, qui cherche une garantie en Dieu et n’analyse que les rapports "logiques" entre l’homme, coupé de la phusis, et cette même phusis, conçue comme étendue (res extensa) ; Leibniz et Kant, qui tentent difficilement de sortir de l’impasse ; Hegel, qui ne réhabilite que très partiellement le devenir, et enfin Nietzsche. De ce dernier Heidegger dit qu’il est le plus débridé des platoniciens, parce qu’à la place du trône désormais vacant de Dieu, il hisse la Volonté de puissance. Ce renversement (Umkehrung) n’est pas, pour Heidegger, un dépassement (Ueberwindung). La puissance remplace seulement la raison. Nietzsche, autrement dit, n’a pas suffisamment réfléchi à la façon d’extirper les illusions qui rejettent l’homme dans le règne du "on". Nietzsche a été un pionnier. Il faut le continuer et le compléter.
La Fundamentalontologie (ontologie fondamentale) de Heidegger se veut, elle, un remplacement radical de toutes les ontologies. Elle veut répondre à la question : Was ist das Seiende in seinem Sein ? (Qu’est-ce que l’étant en son être ?) Das Seiende, c’est l’agrégat "ontique", c-à-d. l’agrégat des étants, des phénomènes constituant le fond-de-monde. Un seul de ces étants est manifestement privilégié : l’homme. L’homme cherche l’être, la signification fondamentale de cet étant qui rassemble tous les étants. C’est pourquoi l’homme, seul étant a poser cette cruciale question de l’être, est un Da-Sein, un "être-là". Qu’est-ce que ce "là" ? La métaphysique occidentale avait placé l’essence de l’homme en dehors de la vie - alors que Heidegger veut remettre cette essence "là", c’est-à-dire replonger la vie dans l’immanence, dans le monde des expériences existentielles. Le résultat concret de cette "négligence" de la métaphysique occidentale avait été d’abandonner l’étude de l’homme aux social statics évoqués par Spencer. L’homme, objet d’investigations utiles et pratiques, s’était alors vu "compartimenté". Sa perception faisait l’objet de la psychologie ; son comportement faisait réfléchir la morale ou la sociologie ; enfin, la politique et l’histoire abordaient sa condition de citoyen, de membre d’une communauté organisée. Aucune de ces disciplines ne prenait en compte l’homme complet, intégral. Le "là" impliqué dans le Dasein, c’est au contraire le monde réel, actuel. Être humain, c’est être immergé, implanté, enraciné dans la terre. (Dans homo, "homme" en latin, il y a humus, "la terre").
In-der-Welt-Sein : telle est l’expression par laquelle Heidegger exprime la radicale nouveauté de sa philosophie. Depuis Platon, il s’agit, pour la 1ère fois, d’être vraiment dans ce monde. Nous sommes jetés (geworfen) dans le monde, proclame Heidegger. Notre être-au-monde est une Geworfenheit, un être-jeté-là, une déréliction. Cette banalité primordiale nous est imposée sans choix personnel, sans connaissance préalable. Elle était là avant que nous n’y soyons ; elle y sera après nous. Notre Dasein est inséparable de cette déréliction. Nous ne savons pas quel en est le but - si toutefois but il y a. La seule chose dont nous soyons sûrs, c’est qu’au bout, il y a, inéluctable, la mort. Dès lors, notre tâche est d’assumer la Faktizität (facticité) au milieu de laquelle nous avons été jetés. Si l’angoisse est bien ce qui manifeste le lien entre la dimension de l’être-jeté et le projet, le Dasein doit le reprendre dans l’horizon de sa finitude, ouvert sur l’avenir.
La philosophie traditionnelle s’est bornée à considérer le monde comme Vorhandenes, comme être-objet. La pierre, par exemple, est un être-objet pour le géologue : la pierre est jetée devant lui et il la décrit ; il reste détaché d’elle. La science de la nature détermine d’avance, a priori, ce que l’étant doit être pour être objet de savoir. Mais l’homme est plus qu’un spectateur-descripteur. En tant qu’être-au-monde, il sollicite les choses relevant, de prime abord, du Vorhandensein : l’ouvrage projeté oriente la découverte de l’outil et l’inclut en un complexe ustensilier. En les sollicitant, il les inclut dans son Dasein, il en fait des outils (Werkzeuge). Devenant "outils", ces choses acquièrent la qualité de Zuhandensein, d’être-en-tant-qu’objet-fonctionnant. Tout artiste, tout artisan, tout sportif saura ce que Heidegger veut dire : que l’homme, grâce à l’outil qu’il s’est approprié, devient un plus, ajoute "quelque chose" au "là", façonne ce "là" ; dans cette perspective, l’outil fait moins sens par son utilité que par son inscription dans un complexe de relations qui le rend bon pour tel usage, renvoyant en définitive à ce quoi le Dasein aspire. La vision strictement théorique de la philosophie platonicienne et post-platonicienne (Heidegger étant, lui, plutôt "transplatonicien", car il dépasse radicalement cet ensemble de prémisses) se concentrait sur l’élaboration de méthodes, sans percevoir ou sans vouloir percevoir le type immédiat de relation aux choses que constitue le Vorhandensein. Le Vorhandensein implique qu’il y ait d’infinies manières d’agir dans le monde. Quand il n’y a pas un modèle unique, tous les modèles peuvent être jetés dans le monde. L’homme devient créateur de formes et le nombre de formes qu’il peut créer n’est pas limité.
Jeté dans un monde qui était là avant lui et qui subsistera après lui, l’homme se trouve donc face à une sorte de "stabilité", face à ce que les philosophes classiques nommaient l’être, le stable, le non-devenu et le non-devenant. Heidegger, nous l’avons vu, reproche à cette démarche de ne pas percevoir la temporalité sous-jacente au sein même de tout phénomène. Vouloir "sortir" du temps est, de ce fait, une aberration. L’ontologie fondamentale postule que l’être est inséparable de la temporalité (Zeitlichkeit). L’être sans temporalité ne peut être expérimenté. Le souci (Sorge), qui est ce mode existentiel dans et par lequel l’être saisit son propre lieu et sa propre imbrication dans le monde comme être-en-avant-de-soi, devant utiliser le temps pour aborder les étants, car ce n’est que dans l’horizon du temps qu’une signification peut être attribuée aux réalités ontiques, aux choses de la quotidienneté. Heidegger dit : "La temporalité constitue la signification primordiale de l’être du Dasein". C’est là une position résolument anti-platonicienne et anti-cartésienne, car, tant chez Platon que chez Descartes, le temps et l’espace sont idéalisés, géométrisés. En revanche, cette position semble évoquer l’idée chrétienne d’incarnation de Dieu dans le temps. Dans un texte contemporain de Sein und Zeit, écrit lui aussi en 1927 et intitulé Phänomenologie und Theologie, Heidegger explique effectivement l’intérêt de la théologie pour comprendre ce qu’est le temps [16].
Mais l’imperfection humaine posée dans la théologie augustinienne se mue, chez lui, en une incomplétude, en un "pas-encore" (noch-nicht) qui oblige à vivre mobilisé, comme pour une croyance. L’homme doit se construire dans une perpétuelle tension, à l’instar du croyant qui vit pour mériter son salut. Mais ici, il n’y a pas de récompense au bout de cet effort ; il n’y a que la mort. Heidegger refuse donc totalement les espoirs consolateurs de la praxis chrétienne. L’augustinisme postulait que l’homme devait vivre de manière irréprochable, morale, dans l’histoire momentanée. Pour Heidegger, l’histoire s’écoule, mais cet écoulement n’est pas momentané. L’écoulement (panta rhei) s’écoulait avant nous et s’écoulera après nous. L’intérêt que porte Heidegger au temps des théologiens n’est pas du christianisme. Il est resté disciple d’Héraclite : son temps "coule", mais nullement pour, un jour, s’arrêter. Quel intérêt, d’ailleurs, y aurait-il à vivre hors de cette tension qu’implique la temporalité ? Le souci est antérieur à toute détermination biologique et rompt avec la définition de l’homme comme animal rationale car la conscience de réalité n’est jamais qu’une modalité de l’être-au-monde et non un complexe hétérogène d’âme et de corps.
les trois modes d’être selon Heidegger
Penchons-nous maintenant sur la "déréliction" personnelle de Heidegger. Né en 1889, Heidegger passe son enfance et son adolescence dans ce que l’écrivain Robert Musil, parlant de l’Autriche-Hongrie de la Belle époque, appelait la "Cacanie" (Kakanien). Qu’entendait-il par là ? Simplement l’incarnation de la décadence : une société affectée par un bourgeoisisme à bout de souffle. Pour Musil, l’Autriche-Hongrie du début du siècle incarnait la fin de toutes les valeurs. Le philosophe Max Scheler, plus optimiste, écrivait : "Là où il n’y a pas de place pour les valeurs, il n’y a pas de tragédie. Ce n’est qu’où il y a du "haut" et du "bas", du "noble" et du "vulgaire", qu’existe quelque chose qui laisse deviner des événements tragiques" [17]. C’est dans un climat analogue que Nietzsche avait placé ces mots lourds de signification dans la bouche de son Zarathoustra : "Inféconds êtes-vous ! C’est pourquoi il vous manque de la foi". Par là, il voulait signifier que le manque de foi menait à la stérilité des connaissances et de la création. Mais de quelle foi s’agissait-il ? Heidegger nous apprend que la foi post-chrétienne ou, pour être plus précis, l’intérêt pour le temps (valorisé par les chrétiens dans la mesure où il conduit à Dieu) et pour l’histoire (eschatologique chez les chrétiens) doit se retrouver demain dans la philosophie après la longue éclipse que fut l’oubli de l’être en tant qu’imbrication de la terre et du temps. Dans la mesure où les espoirs eschatologiques déçoivent, où l’objectivation implique une norme immuable, les sociétés sombrent dans le nihilisme. Les hommes, pour paraphraser le titre du roman de Robert Musil (Der Mann ohne Eigenschaften), deviennent sans qualités.
Dans quel monde vit alors l’homme sans qualités ? Comment Heidegger va-t-il cerner, par son propre langage philosophique, ce monde où gisent les cadavres des valeurs ? Dans quel paysage idéologique Sein und Zeit va-t-il éclore ? Quels rapports sommes-nous autorisés à découvrir entre Sein und Zeit et le Zeitgeist (l’esprit du temps) qui échappe, dans le tourbillon des événements et des défis, à la rigueur philosophique et au regard pénétrant de cet éveilleur que fut Martin Heidegger ?
La philosophie heideggérienne de l’existence se veut une ontologie. Mais une ontologie qui a pour particularité de poser la question de l’être après plusieurs siècles d’ "oubli". La métaphysique, on l’a vu, a été l’expression de cet oubli depuis Platon. L’oubli est la racine même du nihilisme qui afflige la société européenne, et notamment la société allemande après la première Guerre mondiale. Or, tout le mouvement de ce que l’on a dénommé Konservative Révolution (Révolution Conservatrice) est marqué par une recherche de la totalité, de la globalité perdue. L’essayiste anglais Peter Gay parle de Hunger for wholeness [18], ce que nous traduirons par "soif de totalité", une soif qui implique un jugement très sévère à l’encontre de la modernité. Le chaos social et spirituel provoque alors une recherche fébrile de "substantialité" ou, plutôt, d’ "intensité". Cette volonté de donner une réponse à la quiddité est corrélative d’un questionnement sur le "comment", sur le mode d’être qui se traduira dans la réalité tangible.
Il y a, pour Heidegger, 3 modes d’être : l’être-objet (Vorhandenes), l’être-en-tant-qu’objet-fonctionnant (Zuhandenes), l’être comme Dasein, c-à-d. comme être-conscient, être-qui-s’autodétermine, être-homme. Or, on ne peut parler de "substantialité" pour les 2 premiers de ces modes. Seul l’homme en tant que Dasein est susceptible d’acquérir de la "substantialité". Sa spécificité l’oblige à être ce qu’il est de manière complète, effective et totale. Cependant, le Dasein en tant qu’existence court toujours le risque de sombrer dans le non-spécifique (Uneigentlichkeit), c-à-d. dans un type de situation caractérisée par l’ "anodinité" de ce que Heidegger appelle l’Alltäglichkeit (la banalité quotidienne).
De telles situations évacuent de l’existence des hommes et des communautés politiques l’impératif des décisions, nécessaires pour répondre aux défis qui surgissent. La banalité quotidienne est fuite dans le règne du "on" (Man-Sein). L’homme, souvent inconsciemment, se perçoit alors comme objet soumis à des règles banalement générales. Il trahit sa véritable spécificité, dans la mesure où il refuse d’admettre ce qui, d’emblée, le jette dans une situation. Comme un navire privé de gouvernail, il n’est plus maître de la situation, mais se laisse entraîner par elle. Heidegger distingue ici deux aspects dans le mode d’être qu’il attribue au concept d’existence : l’aspect individuel (propre à un seul homme ou à une seule communauté politique) et l’aspect ontologique stricto sensu qui est l’être-effectif, l’être-qui-n’est-pas-que-pensé. Ces 2 aspects diffèrent de ce que la philosophie occidentale qualifiait du concept d’essentia. L’essence, depuis le platonisme, était perçue comme ce qui est au-delà des particularités et des spécificités. Cette volonté d’ "alignement" sur des normes non nécessairement dites, constituait précisément la structure mentale qui a permis l’avènement du nihilisme, où les personnalités individuelles et collectives se noient dans le règne du "on". Nier les particularités, c’est oublier l’être qui est fait de potentialités. Le culte métaphysique de l’essentia chasse l’être du monde. Le monde dont l’être est banni vit à l’heure du nihilisme. Et c’est un tel monde que les contemporains de Heidegger observaient dans l’Allemagne de Weimar.
La révolution philosophique du XXe siècle se réalisera lorsque les Européens s’apercevront que l’être n’est pas, mais qu’il devient. Heidegger, pour exprimer cette idée, recourt à la vieille racine allemande wesen, dont il rappelle qu’elle a donné naissance à un verbe. II écrit : Das Sein an sich "ist" nicht, es "west". L’être est pure potentialité et non pure présence. Il est toujours à appeler. L’homme doit travailler pour que quelque chose de lui se manifeste dans le prisme des phénomènes. Une telle vocation constitue son destin, et c’est seulement en l’acceptant qu’il sortira de ce que Kant nommait son "immaturité". L’impératif catégorique ne sera plus alors la simple constatation des phénomènes figés dans leur présence (en tant que non-absence), la reconnaissance pure et simple des objets et/ou des choses produits par la création "divine" des monothéistes. Il sera le travail qui fait surgir les phénomènes. L’attitude de demain, si l’on veut trouver des mots pour la définir, sera le réalisme héroïque [19], sorte de philosophie de la vigilance qui nous exhorte à éviter tout "déraillement" de l’ "être" dans l’Alltäglichkeit.
seul l’homme authentique opère des choix décisifs
Si une règle, une norme s’applique impérativement à tous les hommes, à toutes les collectivités, dans tous les lieux et en tous les temps, l’homme ne peut qu’être empêché de poser de nouveaux choix, d’élaborer de nouveaux projets (Entwürfe), de faire face à des défis auxquels ces normes (qui ne prévoient, dans la plupart des cas, que la plus générale des normalités) ne peuvent répondre. Pour Heidegger, la possibilité de choisir - et donc de faire aussi des non-choix - se voit donc investie d’une valorisation positive. La marque du temps se perçoit très clairement dans ces réflexions. L’Allemagne, en effet, se trouve alors devant un choix. Par ce choix, elle doit clarifier sa situation et rendre possible le "projeter" (Entwerfen) et le "déterminer" (Bestimmen) d’une nouvelle "facticité".
On a qualifié cette démarche heideggérienne de philosophie de Berserker, ces personnages de la mythologie scandinave, compagnons d’Odin, qui avaient le pouvoir de commettre des actes habituellement défendus. De fait, les détracteurs de la conception heideggérienne de l’existence prétendent souvent qu’elle constitue une justification de tous les excès du subjectivisme. A cette abusive simplification, on peut répondre en constatant que la volonté de légitimer l’éternité des normes traduit un simple "désir" de régner sur une humanité dégagée de toute responsabilité, sur une humanité noyée dans le monde du "on".
Pour Heidegger, l’homme, en réalité, ne choisit pas d’agir pour ses propres intérêts ou pour ses caprices, mais choisit, dans le cadre de la situation où il est jeté ou enraciné, ce que l’urgence commande. Une action ainsi absoluisée n’a rien d’égoïste ; elle a vocation d’exemplarité. Qualifier une telle conception de l’existence d’ "ontologique", comme le fit Heidegger, a peut-être constitué un défi philosophique. Il n’empêche qu’une telle conception de la décision représente un dépassement radical du fixisme métaphysique issu du platonisme. On a alors raison de faire de Heidegger le philosophe par excellence de la Révolution Conservatrice. Loin d'être une fuite dans le pathétique, la philosophie de Heidegger cherche à comprendre sereinement l'ensemble des potentialités qui s'offrent à l'existence humaine. Cette philosophie est révolutionnaire, parce qu'elle cherche à fuir le monde du "on", marqué par le répétitif et l’uniformité. Elle est conservatrice, parce qu’elle refuse d’exclure la totalité des potentialités qui restent à l’état de latence. Autrement dit, ce que la pensée heideggérienne conserve, ce sont précisément les possibilités de révolution, que l’ontologie traditionnelle avait refoulées.
Les contemporains ont fortement perçus ce que cette philosophie leur proposait. Sans apporter de remèdes consolateurs, Heidegger affirme que l'inéluctabilité finale de la mort oblige les hommes à agir pour ne pas simplement passer du "on" au néant. La mort nous commande l'action. En cela, réside un dépassement du nietzschéisme. Chez Nietzsche, en effet, la "vie" reste quelque chose en quoi l'on peut se dissoudre ; la "puissance", quelque chose par quoi l’on peut se laisser emporter. La décision face au néant est totalement non-objet, non-substance, non-produit. Elle est pure attitude jetée dans le néant, pure attitude privée de sens objectif. Dans une telle perspective, l’adversaire n’est jamais absolu. Néanmoins, l'ennemi désigné est le monde bourgeois du "on". L'idéologie conservatrice acquiert ainsi, avec Heidegger, la tâche de gérer l'aventureux. Elle prend en charge le dynamisme qu’auparavant on attribuait aux seuls négateurs. La négativité n'est plus l'apanage des penseurs de l'École de Francfort.
La négativité heideggérienne se fixe pour objectif de mettre un terme au déclin des valeurs, résultat de l’ "oubli de l’être". Face au monde banal qui s’offre à nos regards, Heidegger affirme que la mise en doute constitue un moyen pour tirer l’humanité de l’indolence dans laquelle elle se trouve, et pour lui dire qu’il y a urgence. Heidegger est aussi l’héritier de la tradition pessimiste allemande, mais il se rend parfaitement compte que le pessimisme constitue une attitude insuffisante. "La décadence spirituelle de la terre, écrit-il, est déjà si avancée que les peuples sont menacés de perdre la dernière force spirituelle, celle qui leur permettrait du moins de voir et d’estimer comme telle cette décadence (conçue dans sa relation au destin de l’ "être"). Cette simple constatation n’a rien à voir avec un pessimisme concernant la civilisation, rien non plus, bien sûr, avec un optimisme ; car l’obscurcissement du monde, la fuite des dieux, la destruction de la terre, la grégarisation de l’homme, la suspicion haineuse envers tout ce qui est créateur et libre, tout cela a déjà atteint, sur toute la terre, de telles proportions, que des catégories aussi enfantines que pessimisme et optimisme sont depuis longtemps devenues ridicules" [20].
Pour Heidegger, il n'y a pas évolution historique, mais involution. Ce sont les origines des mondes culturels qui sont les plus riches, les plus mystérieuses, les plus enthousiasmantes. L’être-homme, aux âges primordiaux, connaît son intensité maximale. Cet être-homme consiste à être sur la brèche, là où l’être fait irruption dans le monde de l’immanence. Mais c’est bien l’homme qui reste le maître du processus. Les époques de décadence sont à cet égard capitales, car elles appellent les hommes à remonter sur la brèche, à ressortir de l’abîme où l’oubli de l’être les a conduits. Dans cette perspective, le succès ou l’échec sont secondaires. Le héros qui échoue peut être quand même exemplaire. Rien n’est réellement définitif. Rien n’arrête la nécessité de l’action. Rien ne démobilise définitivement - car une démobilisation définitive impliquerait de retomber dans le nihilisme.
Cette conception heideggérienne de l’existence renoue avec une éthique présente dans la vieille mythologie nordique. Évoquant la claire perception de sa situation éprouvée par le héros de l’épopée germanique, Hans Naumann (Germanische Schicksalsglaube) a montré, par ex., que celui-ci est très conscient de sa propre déréliction. Le héros sait qu’il est jeté dans une appartenance temporelle, spatiale, sociale, politique et familiale ; il sait qu’il appartient à un peuple. La figure d’Odhinn-Wotan est l’exemple divinisé de l’attitude qu’adopte celui qui n’hésite pas à affronter son destin. Le concept heideggérien de Sorge (repris de Kierkegaard), voire celui d’Entschlossenheit (détermination, résolution), correspond au contenu psycho-éthique investi dans le personnage d’Odhinn. Naumann perçoit même, dans cette "danse avec le destin" un élément d’esthétisme, de "dandysme" qui échappe à Heidegger, malgré son indéniable présence dans les cercles de la Konservative Revolution et surtout chez Ernst Jünger [21].
De son côté, le professeur G. Srinivasan, de l’université de Mysore, en Inde, a publié un ouvrage (The Existentialist Concepts and The Hindu Philosophical Systems, Udayana, Allahabad, 1967) dans lequel il souligne les analogies existant entre la religion indienne et les traditions existentialistes européennes du XXe siècle. L’analyse existentialiste du choix, notamment, peut être comparée au récit d’Arjuna dans la Bhagavad-Gîta, ou encore à celui de Sri Rama dans le Ramayana. La mystique indienne permet aux hommes, elle aussi, de choisir entre une existence monotone et mondaine et une saisie plus "héroïque" du monde. Le mode de vie nommé dukha est l’équivalent indien de l’Alltäglichkeit heideggérienne. Le sage est invité à ne pas se laisser emporter par les séductions sécurisantes de cette situation et à "contrôler", à "transcender" l’existentialité inauthentique. Comme chez Heidegger, l’inévitabilité de la mort ne saurait empêcher l’homme authentique d’opérer, en cas d’urgence, un choix décisif. Une étude approfondie des analogies existant entre l’éthique indienne et celle de l’Edda d’une part, les enseignements de la philosophie heideggérienne d’autre part, serait d’ailleurs, probablement, des plus enrichissantes. Un trait commun est certainement la saisie unitaire (non dualiste) de l’existence.
Heidegger se trouve donc en rupture avec la conception dualiste du monde liée à l’idée biblique du péché originel et à la façon dont certains Grecs assignaient des limites au cosmos, posant ainsi, dans l’histoire des idées, l’avènement du substantialisme. Cette Grèce-là était elle-même en rupture avec une saisie de l’univers conçu comme épiphanie du divin. Pour Thalès de Milet, par ex., l’élément primordial "eau" est l’Urbild de tout ce qui s’écoule, de tout ce qui se transforme inlassablement, de tout ce qui ne cesse de vivre, de tout ce qui crée et maintient la vie. "Tout est plein de dieux" : cette sentence de Thalès constitue l’affirmation de l’unité totale cosmique. L’apeiron d’Anaximandre, qui est l’ "illimité", la solitude tragique de Héraclite, cherchant à tirer ses contemporains d’un sommeil qui les rendait aveugles à l'unité du monde, comptent aussi parmi les 1ères manifestations conscientes de la "vraie religion de l’Europe" et elles ne s'embarrassent d'aucun dualisme [22].
La lecture de ces Présocratiques, conjuguée à celle du poète romantique Friedrich Hölderlin, a fait comprendre à Heidegger quelle nostalgie est demeurée sous-jacente dans toutes les interrogations philosophiques, y compris celle de la tradition substantialiste occidentale : un désir d’unité à la totalité cosmique. "Être un avec le tout, voilà la vie du divin, voilà le ciel de l’homme, écrit Hölderlin. Être un avec tout ce qui vit, dans un saint oubli de soi, retourner au sein de la totalité de la nature, voilà le sommet des idées et de la joie, voilà les saintes cimes, le lieu du repos éternel où la chaleur de midi n’accable plus et où l’orage perd sa voix, où le tumulte de la mer ressemble au bruissement du vent dans les champs de blé... Mais hélas, j’ai appris à me différencier de tout ce qui m’environne, je suis isolé au sein du monde si beau, je suis exclu du jardin de la nature où je croîs, fleuris et dessèche au soleil de midi" (Hypérion). Ce texte ne doit toutefois pas faire passer Hölderlin pour le chantre d’un idéal d’harmonie ou d’une unité cosmique qui se résumerait dans un pastoralisme douceâtre. Les souffrances que Hölderlin a endurées ont permis chez lui l’éclosion d’une terrible volonté, qui refuse de fermer les yeux devant les réalités. La force de l’âme qui dit "oui" au monde, même devant l’abîme où aucune idéologie sécurisante ne saurait être un recours, est bien évidemment déterminante pour les réflexions ultérieures de Heidegger, dont l’anthropologie dynamique et tragique restitue de façon radicale une religiosité que l’Europe, depuis 3 millénaires, n’avait jamais vraiment perdue.
le "réalisme héroïque" de la Révolution conservatrice
En 1922, sous la direction de Moeller van den Bruck, paraissait un ouvrage collectif intitulé Die neue Front, dans lequel il était fait mention d’une attitude héroïco-tragique nécessaire au dépassement de la situation qui régnait alors en Allemagne. L’idée heideggérienne de connaissance claire de la situation y était déjà présente. L’expression "réalisme héroïque" ne faisant pas encore partie du vocabulaire, on y employait l’expression d’ "enthousiasme sceptique". Toutefois, s’il y avait convergence, dans l’analyse de la situation politico-culturelle, entre les amis de Moeller van den Bruck et Heidegger, en qui germaient alors les concepts de Sein und Zeit, les 1ers avaient le désir affiché d’intervenir dans le fonctionnement de la cité, tandis que Heidegger se préparait seulement à scruter les textes philosophiques traditionnels afin d’offrir au monde une philosophie de l’urgence - la philosophie d’un "être" qui se confondrait avec l’intensité du vécu. Le discours de Moeller van den Bruck et de ses amis, plus politisé, désignait le libéralisme comme l’idéologie incarnant le plus parfaitement l’Alltäglichkeit, postulée par ce que, quelques années plus tard, Heidegger nommera le monde hypothético-répétitif. Ernst Bertram, auteur de Michaelsberg, estimait, lui, que l’esthétique du monde à venir ressemblerait à l’architecture romane, avec sa clarté, sa sobriété, sa formalité sans luxuriance. De son côté, le poète Rainer Maria Rilke déplorait que le monde moderne ne possédât plus cette simplicité toute tangible qui offrait à l’esprit (Geist, équivalent, dans le langage de Rilke, à l’Être de Heidegger) une assise stable.
(A SUIVRE...)
00:15 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : révolution conservatrice, heidegger, existentialisme, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook





