
Vintur, le dieu lumineux des montagnes provençales
Ex: http://tpprovence.wordpress.com/
Le nom Vintur, présent uniquement en Provence, apparaît sur trois inscriptions votives datant du IIe siècle. La première a été découverte au XVIIIe siècle, à Mirabel-aux-Baronnies, dans la Drôme, sur le site de Notre-Dame de Beaulieu, par Esprit Calvet. Elle indique VENTVRI/CADIENSES/VSLM (1). La deuxième a été relevée à Apt, dans le Vaucluse, en 1700, par Joseph-François de Rémerville, qui nota : VENTVRI/VSLM/M.VIBIVUS (2). La troisième enfin, fut exhumée, également dans le Vaucluse, lors de fouilles effectuées en 1993 à la Chapelle Saint-Véran, près de Goult : seul VINTVRI restait encore lisible sur un fragment (3). Une question se pose alors : qui était ce mystérieux Vintur, honoré par ces inscriptions ?
Apollon, le Bélénos gaulois
L’on peut lire dans La Provence antique de J.P. Clébert : « Il y a aussi des dieux des sommets comme le fameux Ventur, dieu du vent, qui a donné son nom au mont Ventoux, et à celui de la Sainte Victoire (Vencturus) et probablement dieu Mistral » (4). De même, Patrice Arcelin, dans un article du magazine Dossier Archeologia sur les « Croyances et les idées religieuses en Gaule méridionale », précise à propos des divinités associées aux montagnes : « Les sommets ont également été l’objet de dévotion. On connaît plusieurs noms de divinités qui leur sont liés : le dieu Vintur, d’après une dédicace de Mirabel (Drôme) pour le mont Ventoux : le même nom se retrouve à Buoux dans le Luberon » (5).
Comme souvent, le recours à l’étymologie permet d’éclaircir la question. C’est ainsi que Claude Sterckx explique : « Le théonyme Vintur(os) a été très peu étudié jusqu’à présent. L’alternance Vint/Vind apparaît bien attestée par la série de théonymes certainement apparentés : Vindios/Vintios-Vindonnod/Vintoros. Ils semblent tous basés sur l’adjectif gaulois Vindos : “ blanc, brillant, clair “ ». Interrogé par nos soins, Jean Haudry nous a précisé : « La présence de formes en vind- à côté des formes en vint- me semble favoriser le rattachement à l’adjectif vindos « blanc », mais le flottement entre t et d est surprenant: les diverses formes qui se attachent à vindos ont toujours nd. D’autre part, je ne connais pas de formes en -ur- à côté de formes en -o-. L’étymologie de vindos est incertaine : le rattachement habituel à *weyd- « savoir », « trouver » n’est pas très bon pour le sens, le rattachement à *sweyd- « briller » serait préférable de ce point de vue, mais le *s de cette racine n’est pas un *s- mobile ».
Pour sa part, Claude Sterckx conclut : « Vintur(os) serait donc à comprendre comme “le petit blanc“, “le petit lumineux“, et donc comme une épiclèse vraisemblablement de l’Apollon gaulois dont les autres désignations (Bélénos, Vindios, Albius) ont exactement le même sens (sans la finale hypocoristique) ». Avis partagé par tous ceux qui se sont penchés sur le cas Vintur.
Le théonyme celtique Bélénos est attesté dans l’ensemble du monde celtique continental, puisque des inscriptions ont été retrouvées en Gaule cisalpine et transalpine, en Illyrie et en Norique. Mais c’est dans le sud de la Gaule, en Provence, que son culte était prééminent. Dans son ouvrage de référence La Religion des Celtes, de Vries indique qu’il était à l’honneur surtout chez les Salyens, des Celto-ligures installés précisément en Provence. Le fait que Bélénos soit, selon l’interprétation romaine, le nom de l’Apollon gaulois, divinité « solaire », a fait comprendre cet appellatif comme « le lumineux, le brillant ». Ainsi, selon de Vries, « l’Apollon gaulois a, lui aussi, d’étroits rapports avec le soleil ; son surnom de Belenus suffirait à l’indiquer » (6). On étymologise ensuite par des racines indo-européennes imaginaires, *gwel-« briller ». En réalité, comme le démontre Xavier Delamarre dans son Dictionnaire de la langue gauloise, le théonyme Belenos vient tout simplement de *belo, *bello, « fort, puissant » (7).
Bélénos n’en est pas moins un dieu lumineux, dont les principales fonctions étaient la médecine et les arts. Il était honoré lors de la fête de Beltaine, qui marquait une rupture dans l’année, le passage de la saison sombre à la saison claire, lumineuse. Parmi ses surnoms plus spécifiquement gaulois, l’on remarque « Iovancocarus » (Juvent- : jeunesse), dieu rayonnant de jeunesse.
En Irlande, Bélénos s’appelait Oengus, le Mac-Oc, c’est à dire le « dieu jeune », décrit dans les récits médiévaux comme « un jeune guerrier monté sur un cheval blanc ». Le Mac-Oc irlandais se nomme Madon au Pays de Galles : les contes gallois insistent sur son caractère solaire, car il est décrit comme « un jeune guerrier monté sur un cheval blanc ». On peut aussi assimiler Bélénos au dieu médecin de la mythologie irlandaise, Diancecht.
Il faut aussi rapprocher Bélénos du dieu germanique Balder (vieil islandais Baldr), dieu de la jeunesse décrit dans l’Edda de Snorri Sturlusson, comme « si beau d’apparence et si clair qu’il en est lumineux ». Joseph Chérade Montbron soulignait, dès le XIXe siècle : « Il est probable que ce Balder est le même que le Belen ou Belenos qu’adoraient les Gaulois. Selon Rudbek, l’étymologie de Balder ou Belenos vient de Bella, se bien porter (…) De là Bol, Bold, Baal et Baldur, puissant, sain » (8). On retrouve là l’étymologie donnée par Xavier Delamarre.
En outre, Bélénos est assimilé à l’Apollon du panthéon classique gréco-romain, dieu du chant, de la musique et de la poésie, mais aussi des purifications et de la guérison. Revenant chaque année au printemps du pays des hyperboréens, situé à l’extrême nord, il était le dieu de la lumière. Sa fonction éminemment solaire est confirmée par ses surnoms : « le blond », « le dieu aux cheveux d’or », « Phoibos », c’est à dire « le brillant », dont les Romains firent Phébus. A en croire l’hymne homérique, Apollon « a l’apparence d’un astre qui luit en plein jour. Des feux sans nombre jaillissent de sa personne, l’éclat en va jusqu’au ciel ». Dieu guérisseur, il était nommé, en Grèce, « Apotropaïos », « celui qui éloigne les maladies » ; à Rome, un premier temple lui fut érigé à la suite d’une épidémie, en 443 av JC et y port le nom d’Apollo Medicus (9). Dans son interprétation romaine du panthéon gaulois, César qualifiait ainsi Bélénos : « Apolinem morbos depellerre », soit « ils croient qu’Apollon chasse les maladies » (10).
Sous le nom de Vintur, qui n’est qu’une épiclèse, c’est à dire une épithète par laquelle nos ancêtres désignaient le dieu dont le nom devait rester occulté, se cache donc le Bélénos gaulois, le Diancecht des Irlandais, l’Apollon des Grecs, l’Apollo Medicus des Romains.
Le Mont-Ventoux
J. Whatmough, dans The dialects of Ancient Gaul, suggère un apparentement entre le nom de Vintur et celui du Mont-Ventoux (11). Il est vrai qu’en Occitan provençal, Mont-Ventoux se dit Mont Ventor selon la norme classique ou Mount Ventour selon la norme mistralienne.
Dès 1904, dans les Annales de la société d’Etudes Provençales, C.M. Clerc écrivait : « Le vrai nom du Mont Ventoux, sur les cartes du XVIIIe s est, non pas Ventoux, mais Ventour. Ce nom dérive indubitablement du nom d’une divinité, Venturius, à laquelle sont dédiées deux inscriptions romaines tracées, l’une à Mirabel, près de Vaison, l’autre à Buoux, au nord du Luberon. Il n’est pas impossible que cette divinité ait été non seulement celle du Ventoux, mais la divinité générale des montagnes de toute la région provençale, divinité d’origine celte ou plutôt ligure. Ce nom dérive, sans doute d’une racine analogue au latin Ventus ».
Si le Ventoux doit bien son appellation à Vintur, celui-ci est nullement le dieu du vent ou du Mistral, ni un dieu local. En effet, il n’existe pas de divinités topiques dans la religion gauloise. Les Gaulois ne divinisaient pas leurs forêts, leurs fleuves ou leurs montagnes. Si le nom de Sequona est associé à la Seine, Matrona à la Marne ou Vosegos aux Vosges, c’est uniquement que ces lieux étaient consacrés à ces divinités et portaient leur nom…
Le sommet du Mont-Ventoux, enneigé tout au long de l’hiver, et recouvert de pierres blanches le reste de l’année, a été consacré à Vintur, le dieu solaire, « le blanc », « le brillant », « le lumineux », en raison de sa blancheur persistance. Quant à la célèbre source du Groseau, au pied du Ventoux, elle a été considérée comme salutaire car protégée par le dieu guérisseur Vintur.
La Sainte-Victoire
De nombreux érudits ont rapproché la toponymie du Mont-Ventoux avec celle d’un autre géant de Provence, tout aussi fameux : la Sainte-Victoire.
Passons rapidement sur la légende qui rattache l’appellation de la montagne à la victoire de Marius sur les Teutons, en 102 av JC. Elle remonte au XIXe s, et fut forgée de toutes pièces par quelques écrivains et journalistes locaux. Walter Scott, qui situe à la Sainte-Victoire un chapitre de son roman Charles Le Téméraire ou Anne de Geierstein, écrit en 1829, donne l’explication (?) suivante : « Le nom de la Montagne, écrit-il, avait été donné par suite d’une grande victoire qu’un général romain nommé Caio Mario avait remporté sur deux grandes armées de Sarrasins portant des noms ultramontains, probablement les Teutons et les Cimbres. En reconnaissance de cette victoire Caio Mario fit vœu de bâtir un monastère sur cette montagne et de le dédier à la Vierge Marie, en l’honneur de laquelle il avait été baptisé ». Défense de rire !
Pour redevenir sérieux, notons que le nom de Sainte-Victoire est inconnu dans les documents avant le XVIIe s. Le terme de « Victoire » est mentionné pour la première fois en 1653, quand un bourgeois d’Aix-en-Provence, Honoré Lambert, fait le vœu, au cours d’une grave maladie, de restaurer la chapelle et l’ermitage situés au sommet de la montagne, sous le nom de « Notre-dame de la Victoire », et de s’y retirer pour se consacrer à une vie de prière et de contemplation. On ne sait pas si, avec un tel nom, il s’agit de commémorer la victoire de Louis XIII sur les Protestants, ou la bataille victorieuse de Lépante contre les Turcs, même si la première hypothèse semble la plus plausible.
Dans la période précédente, le nom de la montagne est « Venture » ou, sous une forme chrétienne, « Sainte-Venture » ou « Sainte-Adventure », cette appellation figurant encore sur des cartes du début du XVIIIe s, et il n’est question dans les textes que d’un chemin menant à Sainte Adventure (Itinere sancte Adventuro) en 1390, ou à Sainte-Venturie (Sancte Venturie) en 1345.
D’où l’hypothèse émise par Camille Jullian, en 1899, dans les colonnes de la Revue d’Etudes Anciennes : « Sainte-Victoire vient d’un mot celtique, ou ligure, comme Venturi, Venturius ou quelque chose d’approchant. Le nom même de la montagne n’a jamais été Victoria. Lorsqu’on trouve son nom sous sa vraie forme locale et provençale, elle s’appelle Venturi, du latin Ventur et Venturius comme le vrai nom et le nom primitif de Sainte-Victoire. Venturi, Ventoux, c’est tout un. Et dans le passé la distance entre ces deux mots diminue encore. Le Ventoux s’appelle dans les chartes Venturius, et à l’époque romaine, Vintur. Sainte-Victoire et le Ventoux ont donc porté, à l’origine, le même nom celtique ou ligure, nom fort approprié à des sommets d’où semblent partir nuages et vent ». Comme Camille jullian, Charles Rostaing et de nombreux érudits n’ont eu de cesse de rapprocher la toponymie de la montagne Sainte-Victoire de celle d’un autre sommet tout aussi célèbre : le Mont-Ventoux.
Par ailleurs, l’on retrouve en Provence d’autres toponymes dérivant du théonyme gaulois Vintur. Charles Rostaing cite l’exemple du village de Venterol, dans les Alpes de Haute Provence, dont le nom dérive, selon lui, du dieu gaulois. Hypothèse confirmée par le site de construction de l’ancien village : un piton à 1185 mètres d’altitude (12).
Jean-François Delfini, Grande Provence, hiver 2010, n°2.
NOTES
(1) CIL 12, 1341.
(2) CIL 12, 1104.
(3) ILN 04, 143.
(4) J.P. Clébert, La Provence antique, II, Robert Laffont, 1966.
(5) Dossier Archeologia, juin 1979, n°35.
(6) De Vries, La Religion des Celtes, Payot, 1962, 45.
(7) X. Delamarre, Dictionnaire de la langue gauloise, Errance, 2001, p. 62.
(8) J. Chérade Montbron, Les Scandinaves : poëme, Maradan, 1801, p. 522.
(9) Tite-Live, IV, 25.3 ; XL, 51.6.
(10) Jules César, De bello gallico, 6,7.2.
(11) J. Whatmough, The dialects of Ancient Gaul, Cambridge, 1970, p. 117.
(12) C. Rostaing, Essai sur la toponymie de la Provence (depuis les origines jusqu’aux invasions barbares), Laffitte reprints, Marseille, 1973, p. 295.
http://www.grandeprovence.fr/







 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg






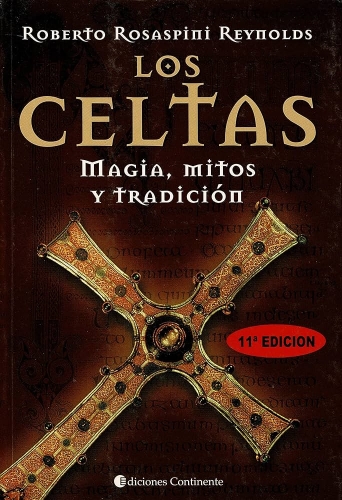

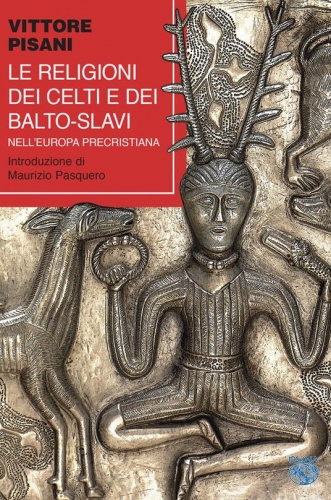









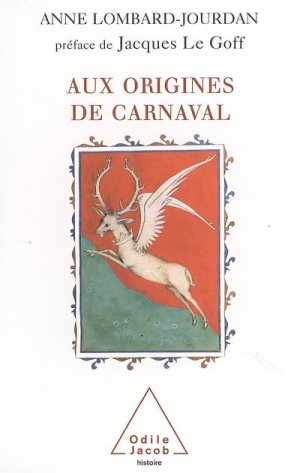 Au nombre des grands mythes transversaux européens est celui de la cavalcade surnaturelle menée par un chef divin. Dans le monde germanique c'est la
Au nombre des grands mythes transversaux européens est celui de la cavalcade surnaturelle menée par un chef divin. Dans le monde germanique c'est la 
 L'ouvrage revient alors sur la place dévolue au cerf dans la maison de France à travers les légendes mettant en scène ses membres et des cerfs surnaturels souvent liés à la figure christique, les illustrations et la présence physique des cerfs dans les demeures royales, et les métaphores littéraires qui rapprochent monarque et cervidé. C'est dans le cerf ailé (présenté en couverture) que les rois trouvent leur emblème totémique, lié non pas, comme la fleur de lys, au Royaume de France dans son entièreté, mais à la fonction monarchique en particulier. Enfin, le don de guérison des écrouelles, le rôle thaumaturgique du roi, est analysé comme un héritage chamanique lié au culte du dieu-cerf.
L'ouvrage revient alors sur la place dévolue au cerf dans la maison de France à travers les légendes mettant en scène ses membres et des cerfs surnaturels souvent liés à la figure christique, les illustrations et la présence physique des cerfs dans les demeures royales, et les métaphores littéraires qui rapprochent monarque et cervidé. C'est dans le cerf ailé (présenté en couverture) que les rois trouvent leur emblème totémique, lié non pas, comme la fleur de lys, au Royaume de France dans son entièreté, mais à la fonction monarchique en particulier. Enfin, le don de guérison des écrouelles, le rôle thaumaturgique du roi, est analysé comme un héritage chamanique lié au culte du dieu-cerf.










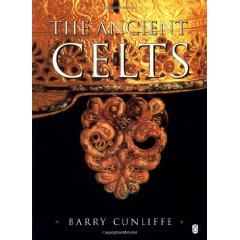
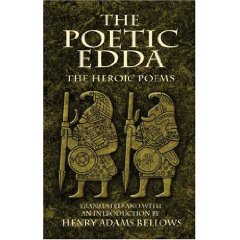


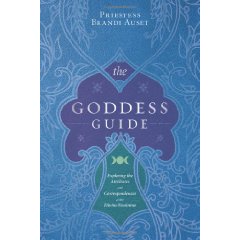
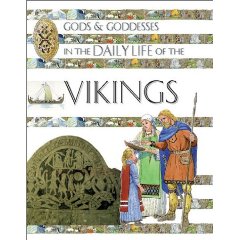
 Cù Chulainn in the GPO:
Cù Chulainn in the GPO: On Easter Monday, April 24, 1916, while all Europe was mobilized for the first of its terrible civil wars, Patrick Pearse, James Connolly, and several hundred “militia men” from the Irish Citizen Army and the Nationalist Volunteers commandeered the General Post Office on Dublin’s O’Connell (then Sackville) Street.
On Easter Monday, April 24, 1916, while all Europe was mobilized for the first of its terrible civil wars, Patrick Pearse, James Connolly, and several hundred “militia men” from the Irish Citizen Army and the Nationalist Volunteers commandeered the General Post Office on Dublin’s O’Connell (then Sackville) Street.