
Parution du numéro 465 du Bulletin célinien
Sommaire:
Jean Fontenoy et Céline
Bibliographie : les témoignages - Les souvenirs du cuirassier Pavard
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Lucien Rebatet, révolutionnaire décadent
Rebatet, selon l'essayiste Claudio Siniscalchi, est un véritable paradigme de cette large patrouille d'intellectuels qui lisent l'histoire de la France moderne en termes de décadence.
par Giovanni Sessa
Source: https://www.barbadillo.it/111174-lucien-rebatet-rivoluzio...
Ces dernières années, dans le paysage éditorial italien, il semble y avoir un regain d'intérêt pour le fascisme français. Claudio Siniscalchi fait partie des auteurs qui ont le plus contribué à cette résurgence d'études thématiques. Son dernier ouvrage, Un revoluzionario decadente. Vita maledetta di Lucien Rebatet, en librairie aux éditions Oaks (sur commande : info@oakseditrice.it, pp. 182, euro 20.00). Selon l'auteur, Rebatet est un véritable paradigme de cette vaste compagnie d'intellectuels qui ont lu l'histoire de la France moderne en termes de décadence, mais qui étaient en réalité profondément enracinés dans ce monde.
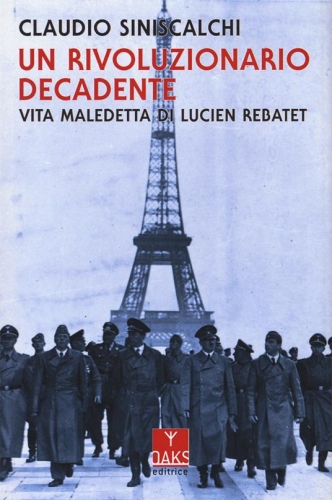
Rebatet est né en novembre 1903 dans l'ancien Dauphiné. Il est éduqué dans une école dirigée par des religieux, pour lesquels il éprouve un dégoût irrépressible. Son père, notaire d'obédience républicaine, et sa mère, catholique d'origine napolitaine, ne parviennent pas à l'attirer dans leurs univers idéaux respectifs. En 1923, le jeune Rebatet arrive à Paris. Dans la capitale, il étudie la littérature à la Sorbonne et fréquente assidûment Montparnasse, quartier excentrique où règne une vie nocturne intense et où se déroulent des manifestations culturelles et artistiques novatrices. C'est au cours de ces années que débute sa collaboration avec L'Action française de Maurras, d'abord en tant que critique musical, puis en tant que critique cinématographique. Contrairement à Maurras, Rebatet "n'est ni catholique ni anti-allemand" (p. 19). Doté d'un style mordant, ses articles connaissent un succès immédiat. Son ascension au sommet de l'intelligencija de la "droite" française commence en 1932. Cette année-là, ses contributions paraissent dans l'hebdomadaire Je suis partout. Dans ces colonnes, il passe de la critique cinématographique à la polémique politique. Ses écrits témoignent du dépassement progressif des positions de Maurras, dans le sens d'un soutien total à la cause "fasciste".
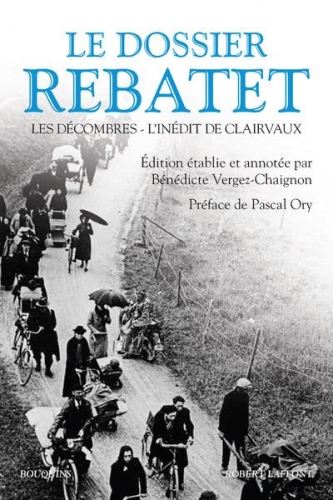 En présentant l'itinéraire intellectuel et politique de Rebatet, Siniscalchi dresse un tableau organique du monde intellectuel varié et vivant du "fascisme" français, en discutant des relations qui existaient entre les principaux interprètes de cette faction intellectuelle et politique. Il parvient ainsi à des jugements équilibrés, conformes aux exigences de la recherche historique. Il précise notamment comment le rapprochement de Rebatet avec l'Allemagne nationale-socialiste s'explique par la conviction profonde que les ennemis de la patrie sont "intérieurs" et se reconnaissent dans : "les Maghrébins, les Noirs, les Jaunes, les Russes anciens et nouveaux, les mineurs polonais, les Italiens" (p. 23), venus en France pour les raisons les plus disparates. Ces catégories seront bientôt remplacées par l'ennemi par excellence, le Juif. Les révolutionnaires et les juifs qui ont quitté l'Allemagne après 1933 ont rencontré les exilés antifascistes italiens et ont formé l'Internationale antifasciste. Celle-ci devait être combattue, selon l'auteur, par l'internationale fasciste.
En présentant l'itinéraire intellectuel et politique de Rebatet, Siniscalchi dresse un tableau organique du monde intellectuel varié et vivant du "fascisme" français, en discutant des relations qui existaient entre les principaux interprètes de cette faction intellectuelle et politique. Il parvient ainsi à des jugements équilibrés, conformes aux exigences de la recherche historique. Il précise notamment comment le rapprochement de Rebatet avec l'Allemagne nationale-socialiste s'explique par la conviction profonde que les ennemis de la patrie sont "intérieurs" et se reconnaissent dans : "les Maghrébins, les Noirs, les Jaunes, les Russes anciens et nouveaux, les mineurs polonais, les Italiens" (p. 23), venus en France pour les raisons les plus disparates. Ces catégories seront bientôt remplacées par l'ennemi par excellence, le Juif. Les révolutionnaires et les juifs qui ont quitté l'Allemagne après 1933 ont rencontré les exilés antifascistes italiens et ont formé l'Internationale antifasciste. Celle-ci devait être combattue, selon l'auteur, par l'internationale fasciste.
Ainsi, l'idée d'un fascisme européen comme seule réponse possible à la décadence de notre continent mûrit chez Rebatet, ainsi que chez Drieu La Rochelle. La fièvre antisémite se radicalise en France, avec la conquête du pouvoir par le Front populaire de Blum. Rebatet, nous dit Siniscalchi, reste un observateur attentif des phénomènes contemporains. Après la publication de l'Histoire du cinéma de Brasillach et Bardèche, il montre qu'il ne partage pas l'exégèse esthétique néoclassique de Maurras et qu'il voit dans le cinéma un art aux potentialités extraordinaires. Il n'est pas un critique de cinéma animé par des préjugés anti-américains : "Dans les films hollywoodiens [...] il trouve souvent des œuvres saines et spontanées, vitales et viriles [...] des œuvres dépourvues de superficialité et de fausseté" (p. 49). En 1937, il va même jusqu'à définir La grande illusione, un film critiqué en Italie par Luigi Chiarini, comme le meilleur produit de l'année. Il s'insurge également contre "le pessimisme moral typique des films les plus significatifs du "réalisme poétique" français" (p. 52). Rebatet devient le plus important critique de cinéma du pays pendant l'Occupation. Selon lui, les "Aryens" et les Français Lumière et Méliès sont responsables de la naissance du cinéma: "Les "Juifs" ont récolté les copieux fruits économiques de cette invention" (p. 73), tant en Europe qu'aux États-Unis.
Le collaborationniste ne fait qu'appliquer à l'histoire du cinéma le schéma développé par Wagner pour ses écrits sur le judaïsme musical. Le résultat, note Siniscalchi, est une "falsification" de l'histoire du cinéma français. L'activité d'écrivain de Rebatet trouve son apogée dans deux livres. Le premier, Les décombres, peut être considéré comme le véritable manifeste idéologique de la "tentation fasciste". Il connaît un succès inattendu et immédiat. Rebatet y "attaque avec une rare violence les institutions, les partis, les hommes politiques, les intellectuels, appelant à [...] la "déjudaïsation" du pays" (p. 100). Rebatet est convaincu de l'inanité de la tentative politique menée à Vichy: seul un authentique fascisme français aurait pu relever la France, sur la base du national-socialisme allemand. À la Libération de Paris, après une évasion audacieuse, Rebatet est arrêté et condamné à mort, mais la peine est bientôt commuée en détention à perpétuité. En fait, il est resté dans les prisons françaises pendant plusieurs années.
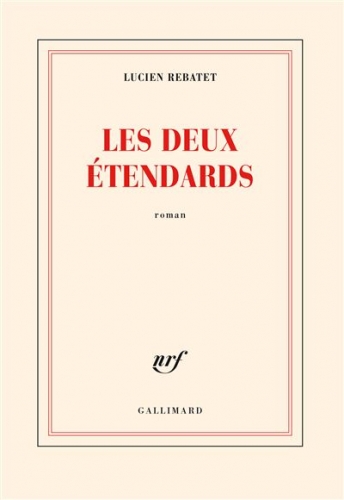
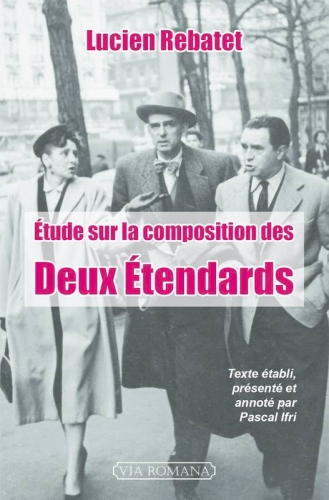
En 1951, il publie un nouveau roman, Les deux étendards. Sur le plan littéraire, il s'agit d'un retour à Proust, mais l'inspiration profonde est nietzschéenne et antichrétienne. Siniscalchi, se référant aux études de Del Noce et de Voegelin, inscrit les thèses exprimées dans ce volume dans les positions révolutionnaires modernes et néo-gnostiques des religions politiques. En ce qui nous concerne, ce qui est surprenant chez le Français, c'est que son adhésion à la vision "païenne" de la vie l'ait conduit à embrasser la cause nationale-socialiste. Au contraire, pour l'écrivain, attentif au thème de la leçon de Benoist, mais pas seulement, le nazisme est l'expression typique du monothéisme politique, "Un peuple, un Reich, un chef", rien de plus éloigné des conceptions issues d'une approche polythéiste du monde.
En tout cas, Rebatet, pendant la période dramatique de l'après-guerre, a vécu dans la solitude, marginalisé, sans abjurer, il est vrai, les idées qu'il avait défendues avec tant de véhémence dans les années précédentes. C'est le mérite de Siniscalchi d'avoir remis au centre du débat ces idées et les événements auxquels l'écrivain a participé.
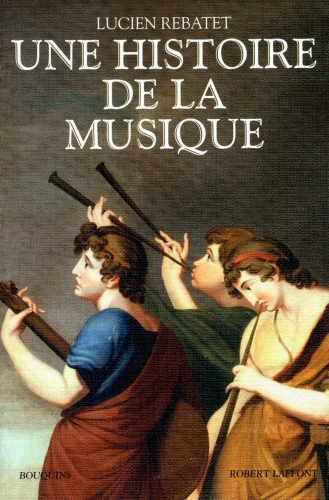
12:14 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lucien rebatet, livre, fascisme, fascisme français, france, histoire, collaboration, cinéma, années 30, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

James Fenimore Cooper et le rejet de l’Amérique moderne et démocrate
Nicolas Bonnal
Grand nostalgique, l’écrivain James Fenimore Cooper encense les indiens et rejette le monde moderne. Nous avons déjà relié son œuvre à celle de Tolkien, les indiens en voie de disparition y tenant les rôles des elfes, êtres supérieurs en voie d’exil et d’extinction.
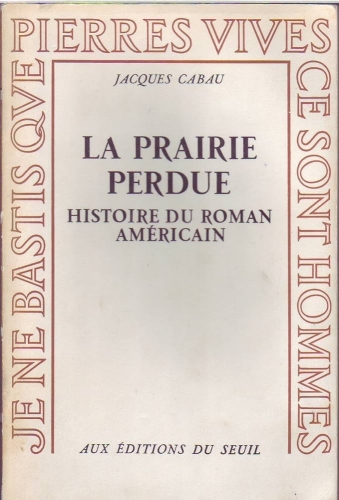
Dans son grand livre La Prairie perdue, l’universitaire Jacques Cabau écrivait :
« Là, gentleman-farmer éclairé, véritable squire à l'anglaise, il devient le prototype même de ces princes qui gouvernent alors l’Amérique, de cette nouvelle aristocratie qui s'est révoltée contre le roi d'Angleterre parce qu'elle se sait destinée au gouvernement des masses. Le drapeau frappé de treize étoiles flotte depuis quelques années seulement. On n'a pas encore inventé le dollar. On trace les plans d'une capitale digne de treize Etats fédérés. Aucune frontière ne borne l’ambition de ces trois millions d'Américains, fiers de leur liberté et de leurs sept cent mille esclaves. Mais la fédération des treize Etats si différents n'est pas encore une nation. L'esprit colonial y perpétue les traditions et les préjugés sociaux de la vieille Europe. »
Lothrop Stoddard et Madison Grant (cités dans un passage crypté de Gatsby - que j’ai commenté ailleurs) ont dressé un portrait enchanté de cette Amérique coloniale que le premier comparait au monde grec. Borges aussi encensa ce grand nombre de génies (Poe, Emerson, Hawthorne, Thoreau, Whitman, Melville, etc.) qui vont tous ou presque rejeter l’involution du monde moderne en Amérique. Mais Fenimore Cooper est le premier à rejeter l’involution de son pays (c’est vrai que pour en arriver à cet océan de laideur urbaine, à Biden et à l’invasion migratoire, au wokisme, à la dette immonde et aux néo-cons…) ; Cabau note :
« L'Amérique n'est alors ni une démocratie idéale, ni un paradis né des utopies du XVIIIème siècle. Il y a vers l'Ouest des pionniers qui défrichent, des trappeurs qui explorent; il y a dans le Nord des communautés utopiques et des exaltés qui parlent d'égalité et de droits de l'homme. Mais ces gens-là ne comptent guère ; on les méprise même dans la bonne société des planteurs sudistes et des négociants du Nord. »

On est encore dans une société aristocratique :
« Dans cette société encore coloniale où les grands propriétaires et les négociants viennent de conquérir l'indépendance pour prendre le pouvoir et imposer leurs intérêts, les privilèges sociaux rendent la naissance tout aussi nécessaire qu'en Europe. Pour avoir sa place, il faut être bien né. Cooper a tous les traits de cette nouvelle classe dirigeante, austère, très consciente de ses devoirs comme de ses droits, et qui donne l’exemple de la morale, de la dignité et du courage parce que son pouvoir est, comme la démocratie qu'elle institue, d'essence paternaliste. Comme Sir Walter Scott, son maître en littérature, Cooper est homme d'ordre, assez intolérant dans ses opinions théologiques, politiques et sociales, et très conventionnel dans ses goûts. Il s'intéresse peu aux arts, lit de préférence des traités d'histoire, de géographie, ou des récits de voyages, dont il est friand ».
Fenimore Cooper redoute cette immigration EUROPEENNE qui va détruire le pays (Tocqueville parle de la menace de masses socialistes européennes immigrées à Philadelphie) :
« II est surtout féru de droit. Car ce grand propriétaire foncier, habile gérant de ses terres, s’inquiète des libertés qu’on laisse aux immigrants de s'approprier les terres qu'ils défrichent. Cooper souhaite qu'au lieu d'éparpiller les terres défrichées aux mains des petits colons, on les rassemble en latifundia, en grand domaines. »
Fenimore Cooper s’exile en Europe comme bien des grands auteurs américains (Henry James, Hemingway, Fitzgerald…) ; et quand il revient notre aristocrate écologiste peut sangloter :
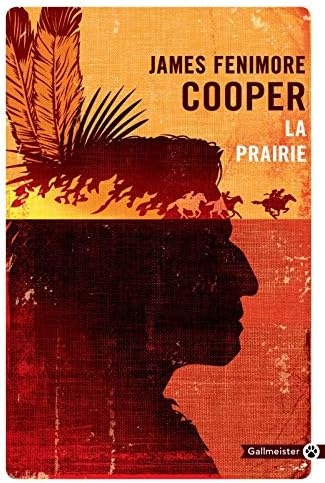 « Mais il lui faut déchanter, en 1833, quand il rentre en Amérique. Installé à Cooperstown, il découvre une Prairie ravagée par les pionniers, les terres distribuées à l'encan, un gaspillage de toutes les richesses naturelles, en particulier de la forêt. Il dénonce l'erreur d'une société de plus en plus démocratique, de plus en plus urbaine et industrielle, qui sape ses fondements naturels, et gaspille ses ressources en s'engageant à un rythme trop rapide dans une conception contestable du progrès. Ses attaques contre l’Amérique, ses luttes avec une presse trop librement critique, ses procès enfin contre les défricheurs de terres et les immigrants lui valent une réputation de réactionnaire et d'aristocrate européen. Malgré le succès de ses romans, sa popularité en souffre. Comme sir Walter Scott, et pour les mêmes raisons politiques, quand Fenimore Cooper meurt, en 1851, il est brouillé avec la nation américaine dont il a pourtant, le premier, exprimé les traits les plus profonds. »
« Mais il lui faut déchanter, en 1833, quand il rentre en Amérique. Installé à Cooperstown, il découvre une Prairie ravagée par les pionniers, les terres distribuées à l'encan, un gaspillage de toutes les richesses naturelles, en particulier de la forêt. Il dénonce l'erreur d'une société de plus en plus démocratique, de plus en plus urbaine et industrielle, qui sape ses fondements naturels, et gaspille ses ressources en s'engageant à un rythme trop rapide dans une conception contestable du progrès. Ses attaques contre l’Amérique, ses luttes avec une presse trop librement critique, ses procès enfin contre les défricheurs de terres et les immigrants lui valent une réputation de réactionnaire et d'aristocrate européen. Malgré le succès de ses romans, sa popularité en souffre. Comme sir Walter Scott, et pour les mêmes raisons politiques, quand Fenimore Cooper meurt, en 1851, il est brouillé avec la nation américaine dont il a pourtant, le premier, exprimé les traits les plus profonds. »
Nous avons écrit un texte sur le rapport de Fenimore Cooper à la presse (http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/10/08/james-fenimore-cooper-et-la-critique-de-la-presse-americaine.html). La typographie aura été le plus grand ennemi de la civilisation (effondrement qualitatif) et aujourd’hui de l’humanité.
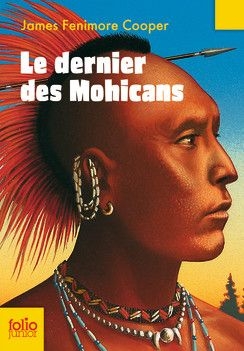 Jacques Cabau ajoutait même sur ce rejet élitiste des « modernes » qui nous fait préférer les indiens (voir Schuon) :
Jacques Cabau ajoutait même sur ce rejet élitiste des « modernes » qui nous fait préférer les indiens (voir Schuon) :
« Les Pionniers, premier volume écrit, est le plus réaliste, le plus documentaire, qui décrit Templeton en fait Cooperstown village de pionniers. Natty Bumppo, vieilli, maussade et bavard, vit là, dans une hutte aux abords de la ville Natty, est devenu une sorte de hors-la-loi. Il braconne, menace la maréchaussée, se fait arrêter par le shérif, mettre au pilori, ne cesse de se révolter contre la civilisation qu’il hait parce qu'elle a anéanti la forêt, c'est-à-dire la liberté. Avec la Prairie, qui décrit les derniers jours de Natty Bumppo, le mythe prend toute son ampleur. Au seuil de la mort, le vieux trappeur octogénaire mais encore valide, médite sur l'ensemble de sa vie, Seul avec Hector, son vieux chien édenté qui va le devancer dans la mort, il a fui la civilisation jusqu'au plus profond de la Prairie, sur les contreforts des Montagnes Rocheuses, où acculé au Pacifique, il se dresse soudain dans l'éclat du soleil couchant, et meurt en criant ce mot cryptique et splendide : Here! Ainsi s'achève une vie qui n'a été qu'une longue fuite devant la civilisation, et qui pose le problème de la marche vers l'ouest et de la disparition de la Frontier ».
On découvrira notre livre sur les westerns et on reverra avec profit et enchantement le célèbre documentaire Koyaanisqatsi en voyant le chaos déglingué cauchemardesque qui caractérise aujourd’hui l’Amérique à Biden.
https://www.dedefensa.org/article/de-thoreau-a-koyaanisqa...
https://www.dedefensa.org/article/james-fenimore-cooper-e...
https://www.amazon.fr/Tolkien-dernier-gardien-Nicolas-Bon...
https://www.amazon.fr/GRANDS-WESTERNS-AMERICAINS-approche...
20:41 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, james fenimore cooper, lettres, lettres américaines, littérature, littérature américaine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

G. K. Chesterton et la conspiration ploutocratique (Le nommé Jeudi, 1908)
Nicolas Bonnal
On lit et on relit Chesterton, et son génial Nommé jeudi, publié en 1908, lisible sur Wikisource, qui décrit la situation que nous vivons, que nos anti-conspirateurs dénoncent :
« Vous partagez cette illusion idiote que le triomphe de l’anarchie, s’il s’accomplit, sera l’œuvre des pauvres. Pourquoi ? Les pauvres ont été, parfois, des rebelles ; des anarchistes, jamais. Ils sont plus intéressés que personne à l’existence d’un gouvernement régulier quelconque. Le sort du pauvre se confond avec le sort du pays. Le sort du riche n’y est pas lié. Le riche n’a qu’à monter sur son yacht et à se faire conduire dans la Nouvelle-Guinée. Les pauvres ont protesté parfois, quand on les gouvernait mal. Les riches ont toujours protesté contre le gouvernement, quel qu’il fût. Les aristocrates furent toujours des anarchistes ; les guerres féodales en témoignent. »
C’est qu’en effet les oligarques n’aiment guère obéir.
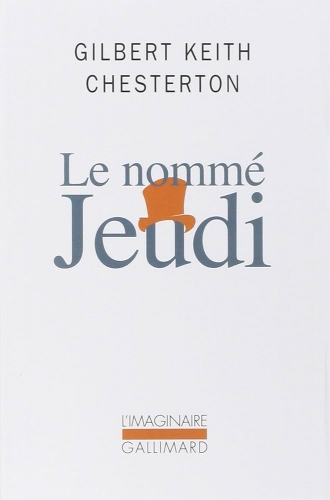
Dans son roman à clé sur la montée du communisme et de la mondialisation (tous aux mains d’une clique de banquiers), Chesterton, qui avait été révolté par la guerre des boers liée au diamant (Barnato, Rothschild, Cecil Rhodes et sa périlleuse Table Ronde), ajoute :
« Nous ne sommes pas des bouffons ; nous sommes des hommes qui luttons dans des conditions désespérées contre une vaste conspiration. Une société secrète d’anarchistes nous poursuit comme des lapins. Il ne s’agit pas de ces pauvres fous qui, poussés par la philosophie allemande ou par la faim, jettent de temps en temps une bombe ; il s’agit d’une riche, fanatique et puissante Église : l’Église du Pessimisme occidental, qui s’est proposé comme une tâche sacrée la destruction de l’humanité comme d’une vermine».
Chesterton ajoute avec humour et fantaisie cette allusion à Cecil Rhodes et à la Table ronde – dont reparlera Carroll Quigley dans ses classiques:
« Voici son application à ces circonstances : la plupart des lieutenants de Dimanche sont des millionnaires qui ont fait leur fortune en Afrique du Sud ou en Amérique. C’est ce qui lui a permis de mettre la main sur tous les moyens de communication, et c’est pourquoi les quatre derniers champions de la police anti-anarchiste fuient dans les bois, comme des lièvres. »
Et comme aujourd’hui on accuse le mondialisme et le transhumanisme des maîtres du réseau (Google, Amazon, Facebook, Apple, GAFA, etc.),
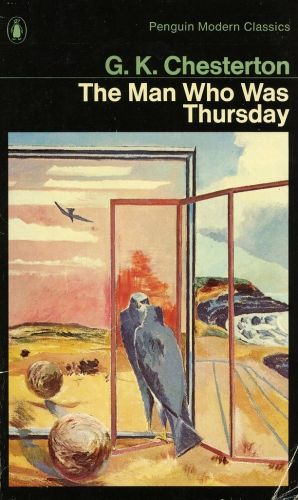
Chesterton dénonce les maîtres du rail :
« Mais permettez-moi de vous faire observer que la force de cette racaille est proportionnée à la nôtre et que nous ne sommes pas grand-chose, mon ami, dans l’univers soumis à Dimanche. Il s’est personnellement assuré de toutes les lignes télégraphiques, de tous les câbles. Quant à l’exécution des membres du Conseil suprême, ce n’est rien pour lui, ce n’est qu’une carte postale à mettre à la poste, et le secrétaire suffit à cette bagatelle. »
Bibliographie
Gilbert Keith Chesterton – Le nommé jeudi (wikisource)
Nicolas Bonnal – Littérature et conspiration (Amazon.fr, Dualpha.com)
11:39 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, g. k. chesterton, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 465 du Bulletin célinien
Sommaire:
Jean Fontenoy et Céline
Bibliographie : les témoignages - Les souvenirs du cuirassier Pavard

Inénarrable Benoît-Jeannin ! Dans un article sur les manuscrits retrouvés, il revient sur son admiration passée pour Céline. Elle fut écornée, confie-t-il, par sa rencontre avec un normalien qui lui affirma, au mitan des années soixante, « témoignage de son oncle à l’appui, que Céline était loin d’être le “médecin des pauvres” qu’il prétendait ». Durant sa carrière médicale, le docteur Destouches a essentiellement travaillé dans des dispensaires de la banlieue ouvrière (Clichy, Sartrouville, Bezons). Sa patientèle était donc composée de gens pauvres. Pourquoi diable faut-il remettre ça en question? Mais Benoît-Jeannin ajoute : « J’avais depuis longtemps fait la part des choses et j’en étais arrivé à ne plus supporter le personnage qui avait affabulé toute sa vie. » Et de conclure gauchement : « Bref je n’étais plus célinien. » Admirable ! Reprocher à un romancier d’affabuler est d’une nigauderie patentée. D’autant que Céline n’a cessé de mythifier son personnage, ayant fait de sa vie la matière romanesque de son œuvre. Benoît-Jeannin affirme aussi qu’il était le « chouchou des autorités allemandes d’occupation ». Faux : les Allemands révéraient Claudel, Montherlant, Giraudoux, Chardonne. Pas Céline. Exception notable : Karl Epting. En 1942, Bernhard Payr, érudit littéraire nazi, publie un ouvrage sur l’état de la littérature en France. Il y juge sévèrement Céline qui « a remis en question à peu près tout ce que l’être humain a produit de valeurs positives et l’a traîné dans la boue. » Et lui reproche, cela va de soi, son « langage ordurier ». Ce docteur en philologie n’était pas n’importe qui : il dirigeait l’“Amt Schrifftum” (dépendant de l’Office Rosenberg), instance de surveillance de ce qui s’éditait en Allemagne et dans les pays occupés. Telle était la position officielle des nationaux-socialistes à l’égard de Céline.

À la suite de Philippe Alméras et d’Odile Roynette, Benoît-Jeannin met en doute la validité de la réforme dont Louis Destouches bénéficia en décembre 1915. Or les archives médicales sont formelles : sa blessure au bras provoqua une paralysie qui prédominait sur l’extension des doigts de la main droite. On a même décelé une “dégénérescence” de son nerf radial au niveau de la main. Le Dr Loisel, qui a étudié la question, précise qu’il ne pouvait rigoureusement plus effectuer le geste fin d’actionner une gâchette. Le cuirassier était donc inutilisable au front. Roynette était au printemps dernier l’invitée d’une discussion télévisée sur Céline¹. Elle n’a pas craint d’affirmer que “l’esprit de la Résistance” s’est incarné dans le sauvetage des manuscrits. Elle ne dit pas s’il s’est incarné dans la disparition des œuvres de Degas et de Gen Paul qui se trouvaient aussi dans l’appartement… L’historienne fait également sienne l’affirmation de Taguieff selon laquelle Céline fut un agent des services de renseignements allemands. Émile Brami, qui participait également à ce débat, a rétorqué que, selon lui, on ne peut pas accuser quelqu’un d’un fait aussi grave sans apporter des preuves. Et d’affirmer, ce que nous savions déjà, que Taguieff sollicite les documents. Ce n’est pas défendre Céline que de rétablir les faits, ce qui n’excuse en rien les actes ou écrits dont il est réellement coupable.
• Maxime BENOÎT-JEANNIN, « Céline’s War » in Que faire ? [Bruxelles], n° 5, novembre 2022, pp. 83-96 (20 €)
14:11 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Poésie: Laurence Guillon contre « les dévoués valets des Ténèbres »
Nicolas Bonnal
Ce texte sur des vers rimés promis à de rares Happy Few (l’expression n’est pas de Stendhal mais de Shakespeare comme toujours) s’adresse aux fans de Laurence Guillon, qui offre l’originalité d’un blog double – de combat et de lutte contre les ténèbres du mondialisme ; et de survie et résurrection intérieure, résurrection qui se passe dans le cadre qui lui convenait de notre Russie orthodoxe et profonde. Le cas est assez exceptionnel : on pense à cette autrichienne ministre persécutée depuis et qui était aussi polymathe, et que Poutine avait salué le jour de son mariage. Laurence poétesse est aussi traductrice, jardinière, musicienne, chanteuse et peintre – elle m’a offert un très beau tableau solaire qui orne mon deuxième appartement de travail dans mon bled andalou. Je ne peux malheureusement pas dire que l’Espagne ait gardé les vertus que Laurence trouve en Russie profonde, à cent bornes de Moscou ? Mais Laurence est tout sauf une illuminée, cette aventurière voit les choses telles qu’elles sont, c’est une mystique avec un regard réaliste et parfois profane. Le mystique trop rêveur a vite fait de se faire bouffer – esprit compris – par les Temps qui courent. Quant au prosaïque malin (Poutine obéit aussi à Davos…) il peut crever.

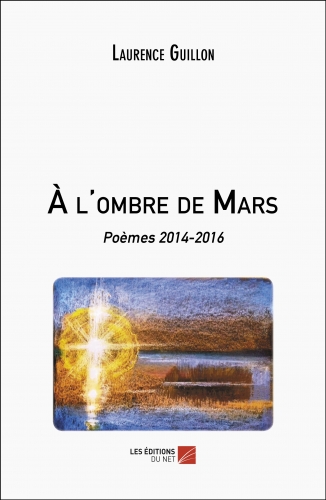
Soyons réalistes donc. J’ai demandé ses poèmes à Laurence par curiosité et aussi ai-je ajouté parce qu’ils sont trop chers. Ancien poète amateur moi-même j’ai bradé les mieux (écrits depuis trente-cinq ans quand même) à trois euros sur Amazon. Et j’ai des couillons de lecteurs qui tentent de le revendre à deux euros. La poésie est un risque à courir par les temps qui courent, puisqu’il n’y a plus de lecteurs – ou peu s’en faut. Le mieux est de lui virer une somme sur un compte français et de recevoir le PDF. Ou de commander le livre, si mon texte le justifie !
J’ai aimé le ton et les sujets guerriers des textes, et j’ai pensé au fabuleux peintre Desvallières, l’ami flamboyant de Léon Bloy, génie méconnu, mystique et expressionniste, père de toute une tribu, et qui s’engagea sous les drapeaux à 53 ans pour défendre sa patrie, dans cette guerre où tous nobles moururent. Après on n’eut plus que des électeurs et des consommateurs. Dans ses alexandrins (donc dans ses vers de mirliton, car il faut se mettre à la portée du public contemporain), Laurence écrit dans son très grand poème l’Arche, toute conscient des enjeux apocalyptiques actuels :
« Le monde s’ouvre en deux, comme un crâne brisé,
Coulent les ténèbres, avec le sang versé,
Où se noient emmêlés les bêtes et les gens,
Trop peu de coupables et beaucoup d’innocents. »
Je trouve malheureusement qu’il y a bien moins d’innocents que jadis, qu’il s’agisse de guerre américaine, de vaccins, de credo climatique ou autre. Avant le paysan sacrifié par Robespierre ou Gambetta n’était pas informé, maintenant on aime se désinformer, fût-ce au risque de se faire écharper, affamer et ruiner. Le troupeau est enthousiaste comme Céline avant la giclée de Quarante. Il aime le mensonge, il aime le chiqué.
Refusons alors leur sabbat (climat vaccin guerre totale) :
« Les voilà tous dansant sur nos tombes futures.
Et l’unique chose dont je puis être sûre,
C'est qu'à leur bal maudit, je n'irai pas valser
Sans doute je mourrai, mais sans avoir chanté
Les louanges du diable et de ses diablotins
Qu'encensent bégayant tous ces tristes pantins. »
C’est tout ce qu’on peut faire en effet : refuser de chanter avec ce pape (lui ou un autre) le diable et ses sacrements.
Laurence visionnaire écrit ensuite dans son Echo secret des massacres :
« Voilà qu’arrive l’impossible...
Ces cohortes épouvantées
Devant le fracas des armées,
Et ces nuages invisibles,
Depuis ces villes écharpées,
Sont pleins des présences terribles
Que vous nous avez déchaînées,
Dévoués valets des ténèbres,
Malfaiteurs puissants et célèbres,
Aux âmes déjà remplacées
Par ceux qui vous les ont volées. »
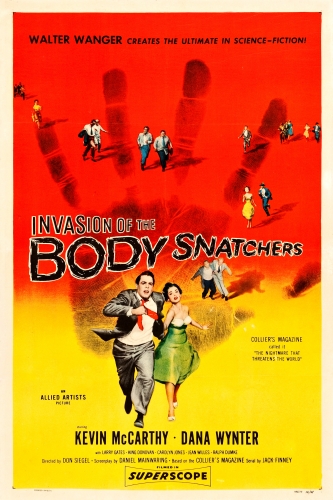
Ce grand remplacement des âmes est en effet grandiose ; je cite toujours le film de Don Siegel l’Invasion des profanateurs de sépultures. Nous voulions montrer que les gens devenaient des légumes, disait le maître de Clint Eastwood. On est au milieu des années cinquante: la télé bouffe tout, l’autoroute (voyez aussi Stanley Donen) aussi, et bientôt le monde cybernétique qui inspire à Debord des lignes superbes.
Le combat du système technétronique pour reprendre un terme célèbre passe par une censure de la terre, une interdiction de tous les éléments : terre, air, soleil, eau. L’écologiste rêve d’une terre brûlée et d’un homme affalé effaré. En effet le diable veut nous priver de la nature pas seulement de la vie (voyez et écoutez Harari sur les Territoires occupés).
Laurence écrit dans Joyeux Noël :
« C’est la terre qu’ils n’aiment pas,
Et qu’ils nous ont privée de voix,
Et puis le ciel bleu par-dessus,
Qui leur blesse par trop la vue.
Ils n’aiment pas la vie qui sourd
Des moindres failles du béton,
Tout ce qui brûle avec passion
Et sanctifie le fil des jours. »
C’est le sujet de mon libre sur la Destruction de la France au cinéma, France bétonnée et remplacée dans les années soixante par un gouvernement soi-disant souverainiste. Voyez Mélodie en sous-sol (ô Gabin à Sarcelles ville nouvelle…), Alphaville de Godard ou Play Time de Tati pour comprendre.
Laurence ajoute :
« Ils sont laids, froids, méchants et bas
Mais on n’entend plus que leurs voix,
Leurs mille voix dans le désert
De nos pays prêts à la guerre. »
Les techno-démocraties sont toujours en guerre depuis des siècles, mais ces guerres sentent la mort, elles ne témoignent jamais d’un excès de vie. De pures guerres d’attrition, celle de Quatorze et de Quarante, des guerres voulues par la bulle financière « anglo-saxonne » (ouaf), comme celle d’Ukraine. Une élite aux vues reptiliennes ou extraterrestres dirait-on.
Dans Cassandre (lisez le chant II de l’Enéide mon Dieu) Laurence écrit superbement :
« La bêtise aux cent mille bouches,
Le grand tohu-bohu du diable,
S’en va remplir ses desseins louches
En rameutant la foule instable,
Chien noir de cet affreux berger,
Glapissant à tous les échos,
Elle pousse à courir nos troupeaux
Sur les chemins qu’il a tracés.
Et comme il y va volontiers,
Le grand troupeau des imbéciles,
A l’abattoir sans barguigner,
Se pressant pour doubler la file. »
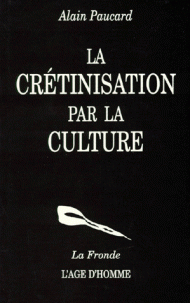 Le troupeau des imbéciles a été fabriqué artificiellement par la culture et l’art moderne (lisez Jacques Barzun, qui en parle bien, un autre exilé lui aussi) ; mon ami Paucard avait excellemment titré : la crétinisation par la culture – et par la télé, et par les médias, et par l’immobilier, et par l’économie, et par les vacances, et par la politique (quel candidat fera enfin la guerre à la Russie, merde ?).
Le troupeau des imbéciles a été fabriqué artificiellement par la culture et l’art moderne (lisez Jacques Barzun, qui en parle bien, un autre exilé lui aussi) ; mon ami Paucard avait excellemment titré : la crétinisation par la culture – et par la télé, et par les médias, et par l’immobilier, et par l’économie, et par les vacances, et par la politique (quel candidat fera enfin la guerre à la Russie, merde ?).
C’est Alain Soral qui disait l’autre jour que la France ne pourrait être sauvée que par un miracle : que c’est juste !
Car la France est tombée plus bas que la plupart des pays, même d’Europe. Et comme je l’ai montré, ce n’est pas parce qu’elle est une victime ; c’est parce qu’elle l’a voulu. C’est le coq hérétique, ou comme dit Van Helsing la concubine de Satan, et depuis longtemps.
Très beau poème aux teintes géographiques : Aigues-mortes, Saintes-Maries. Laurence pense à Saint-Louis tandis que l’emplâtre revote Macron :
« Aigues-Mortes, Saintes-Maries,
Aux quatre vents bien élargies,
Reviendra-t-il jamais le saint roi d’autrefois
Dans sa robe de lys, sur son blanc palefroi ?
Aigues-Mortes, Saintes-Maries,
Verrons-nous demain déferler,
Sur vos ruines de sel blanchies,
De sombres foules d’étrangers,
De conquérants et de bandits,
De bateleurs et d’usuriers,
Qui vendront vos fils au marché
Sous l’amer soleil du midi ? »
Quand on est Français sincère et lucide on a de quoi désespérer – j’en sais quelque chose. Laurence écrit sans hésiter dans la Fin du jour :
« Je meurs sans descendance et j’en rends grâce à Dieu,
Sur l’autel de Moloch, je n’étendrai personne.
Pas de fille soumise au plaisir des messieurs,
Pas de garçon brisé par le canon qui tonne. »
Sur l’imbécillité cosmique qui frappe ce peuple depuis longtemps (revoir Drumont, Céline ou Bernanos) Laurence écrit un texte admirable, l’abîme :
« L’abîme s’élargit et le tumulte croît
Sur la terre entière, le grand tohu-bohu…
Mais la France ébahie ne le voit toujours pas
Et n’entend pas les voix de ses anges perdus.
Elle ne comprend pas que déjà tout finit,
Qu’en bradant son honneur aux bandits de rencontre,
Elle dut en concevoir tous ces horribles fruits
Qui, mûris à présent, vont et partout se montrent.
Etrangers à la terre et bien trop loin du ciel,
Nous voici pourrissants dans cet entre-deux,
Sans idées, sans patrie, sans famille et sans Dieu,
Mollusques accrochés au néant démentiel. »
Mollusques accrochés au néant démentiel : je parlais Desvallières, on dirait du Goya. Il faudrait être Tarkovski pour filmer un texte comme celui-là.
Pour se raccrocher on a les animaux (je repense toujours à Leopardi et à ses oiseaux) ; dans Hommage notre poétesse écrit :
« Mon gentil petit chien, vas-tu me pardonner
De recueillir si tôt ce chien qui te ressemble ?
Malgré tout, je le sais, dedans l’éternité,
Nous nous retrouverons à jamais tous ensemble.
Et tu ne seras plus, là-bas, aussi jaloux,
Car d’amour jaillissant nous ne manquerons point. »
L’amitié des animaux est un don divin comme on sait (elle peut aussi devenir un don pour crétins, tout étant parodié en nos temps retournés) ; alors Laurence ajoute :
« Et toi, pendant neuf ans, mon joli petit chien,
Tu fus le gai soleil des instants quotidiens,
Gracieux comme un lutin.
Je t’ai porté là-bas, dans notre monastère,
Je t’ai bercé longtemps dans le vent de l’été,
Qui croyait avec toi pouvoir encore jouer,
Puis j’ai dû te coucher, souple et doux, dans la terre
Pour la première fois, j’ai dû t’abandonner. »
Parfois Laurence sur son blog écrit des phrases fulgurantes sur son paysage russe, et surtout sur le ciel. Je ne me suis jamais risqué à décrire le ciel moi (trop peur qu’il me tombe sur le ciel !) ; mais dans l’Arc-en-ciel elle écrit :
« De tous ces plats d’argent renversés sur les champs,
Coule le lait de la lumière qui s’étale,
Et dans les blancs remous de cette gloire pâle,
De scintillants oiseaux montent tourbillonnants.
Au loin, l’ourlet bleui des collines dormantes
Borde de noirs labours et des vignes crispées,
Les nuées soulevées basculent, chancelantes,
De lourdes draperies au nord-ouest épanchées.
Et sous leurs plis violets s’esquisse l’arc-en-ciel… »
C’est très beau, innocent, et cela me mène à mon poème préféré (techniquement – au sens de Platon dans le dialogue Ion), que je ne commenterai pas :
Pressentiment
« Il est des jours d’été pleins d’automne secret,
Comme au sein d’un beau fruit l’obscur noyau repose.
Leur lumière est plus douce et leur vent est plus frais,
Je ne sais quel mystère imprègne toutes choses.
Sur le ciel trop brûlant passe un voile doré
Qui donne à la nature un fond glorieux d’icône,
Les arbres s’illuminent et les prés desséchés
Font au nimbe solaire un drap de paille jaune.
Et mon cœur s’éclairant, pareil au verre frêle
De la lampe allumée, couvant la jeune flamme,
Laisse monter sereine à timide coups d’ailes,
La lente adoration qui embrase mon âme. »
On a ici un bel héritage de cette culture française qui n’existe pas. Mais pas de commentaires !
Dans Sainte Rencontre, Laurence écrit :
« Le vieillard Siméon prit le petit enfant,
Qui portait les étoiles dedans son corps langé,
Et vit dans ce moment jusqu’au fond le passé
Qui monte vers demain sous le flot des instants.
La grande croix du temps qui perce nos destins,
Irradiant nos larmes d’une lumière sans fin,
Instrument de supplice qui jette sur nos vies
L’éclat écartelé qui les réconcilie.
Verticale des siècles dans la mer éternelle,
Astre des jours plongé sous l’écume actuelle,
Qui tremble à la surface de l’océan profond
De l’antique existence au centre des éons. »
Ici on se promène dans le cosmos et à travers le temps.
Dans Croquis sinon Laurence renonce à nos alexandrins et affronte un mètre brutal :
« Ruissellement
Roucoulements
Tout petit chant
Intermittent
File une abeille.
Le grand azur bascule à l’orée des murailles,
Lisses, lents déplacements, très hauts lacis
Des martinets précis.
Le soleil assis sur le toit,
Rêve et balance ses pieds d’or.
L’ombre bleue le boude à l’écart,
Sous les loques lourdes de la pierraille,
Fuyant l’effroyable et douce lumière… »
On arrive à l’acédie, thème qui me préoccupe depuis toujours ; j’en ai parlé dans mon Graal et dans mon livre sur Cassien. Les moines les premiers ont vécu cette épreuve qui frappe aussi des chevaliers dont Galehot :
« Mon cœur est sourd
Comme le plomb,
Etanche et lourd
Et sans passion.
Lampe sans feu,
Miroir sans tain
Des vieux chagrins,
Vide de Dieu.
Pourquoi Seigneur
Me laisser choir
Dans ce trou noir
Et sans lueur ? »
Il y a un ton saturnien (le plomb) qui évoque Verlaine bien sûr et le titre même du recueil : A l’ombre de Mars.
Dans Vieil ami on a un ton hugolien, quand la nature parle (cf. Stella : « un vent frais m’éveilla, je sortis de mon rêve… ») :
« Le vent frais me caresse et sa chanson me suit,
De l’orée de mes jours à leur issue prochaine,
Mon plus fidèle amant me chante la rengaine
Dont jamais ne fut las mon cœur par trop meurtri.
J’écoute autour de moi son verbiage indistinct,
Ses cent chuchotements et ses multiples ailes,
Dans les remous d’azur du glorieux matin
Qui célèbre toujours son enfance éternelle.
Je passerai bientôt, mais son mouvement bleu
Et sa folle oraison ne prendront jamais fin.
Je laisserai sur terre à ses jeux incertains
La trace de mes pas et mes derniers adieux. »
Quel beau chuchotement éolien tout de même. J’ai toujours sinon pensé que trois quatrains aussi c’est mieux que deux quatrains et deux tercets.
Un dernier Lac final alors que la patrie trahie s’en est allée :
« Et je me souviendrai, devant l’espace ouvert,
De la mer vivante et douce, des rivages
Où j’allais tout enfant cherchant des coquillages
Dans la tiédeur salée, dans les parfums amers.
Large mer des larmes, ma douce France enfuie
Je m’écarte de toi comme on quitte un tombeau,
Sur nos tendres années implacablement clos,
Gisant silencieux en notre terre trahie. »
SOURCES:
Laurence Guillon, à l’ombre de Mars.
www.leseditionsdunet.com
Sur les sites Internet : Amazon.fr, Chapitre.com, Fnac.com, etc.
Auprès de votre libraire habituel
https://www.amazon.fr/DESTRUCTION-FRANCE-AU-CINEMA/dp/B0C...
https://www.amazon.fr/Perceval-reine-%C3%A9tudes-litt%C3%...
11:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : laurence guillon, poésie, lettres, littérature, littérature française, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Tolkien et l'idéologie hégémonique
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2023/07/23/tolkien-och-den-hegemona-ideologin/
Ces dernières années, l'héritage de Tolkien a fait l'objet de plusieurs réinterprétations aux accents idéologiques de plus en plus évidents. Il s'agit notamment de la longue adaptation cinématographique du Hobbit, de la série télévisée Rings of Power, qui ne s'appuie guère sur les œuvres de Tolkien et véhicule souvent un message diamétralement opposé à ce que l'on y trouve, et, dans le domaine des jeux de cartes, de The Lord of the Rings - Tales of Middle-Earth (Le Seigneur des Anneaux - Les Contes de la Terre du Milieu). Les réinterprétations ont des connotations idéologiques raciales évidentes, mais ceux qui les notent ou même les critiquent sont généralement étiquetés et rejetés comme des "racistes". Outre la projection évidente, l'ensemble est intéressant car ces produits nous donnent un aperçu de l'idéologie hégémonique. Comme toutes les idéologies, elle est imprégnée de certains modèles et logiques, dont la plupart sont tacites et inconscients. En revanche, les aspects plus profondément psychologiques de l'idéologie peuvent être cartographiés en les étudiant comme des complexes d'images, d'associations, de tabous et d'émotions. Un jeu de cartes est particulièrement utile à cet égard, car il contient tellement d'images qu'il peut être lu en partie comme un ensemble de hiéroglyphes. Chaque carte transmet un petit ensemble de caractéristiques.

Quiconque examine attentivement les cartes du Seigneur des Anneaux - Contes de la Terre du Milieu peut identifier un certain nombre de modèles. Dans une large mesure, il s'agit d'une inversion idéologique raciale ; l'anthropologie de Tolkien a, en somme, été renversée. Il a décrit certains individus et groupes d'une certaine manière et, pour des raisons d'idéologie raciale, ils changent de couleur de peau dans le jeu de cartes. C'est le cas d'Aragorn.

Le caractère américain de l'idéologie hégémonique est évident dans le fait que nous voyons des Blancs et des Noirs sur les cartes, mais beaucoup moins d'autres personnes. Il n'y a pas beaucoup d'Asiatiques, pas d'Aborigènes australiens, pas d'Amérindiens, etc. Bref, la Terre du Milieu, c'est l'Amérique avec un peu de magie et d'épées. À bien des égards, la mythologie raciale hégémonique peut être considérée comme une obsession de la relation entre Blancs et Noirs, les autres groupes prenant tout au plus la place d'ersatz de Noirs (ou, dans des cas exceptionnels, d'ersatz de Blancs, comparez les Palestiniens et les Israéliens). On peut également noter que sur les cartes, et dans les créations similaires envahies par le monde contemporain, il y a des blancs et des noirs, mais beaucoup moins de mélanges entre ceux-ci. Ceci en dépit du fait que le scénario le plus probable, en l'absence d'un système d'apartheid rigoureux, serait que dans les sociétés anciennes comme le Gondor et le Rohan, ces derniers constituaient la majorité des personnages.

C'est intéressant, mais c'est aussi un aspect superficiel de la mythologie ou de la psychologie raciale hégémonique. D'autres modèles identifiables sont plus intéressants. Nous constatons, par exemple, qu'Aragorn, sur les cartes, est devenu noir, tout comme Galadriel, Théoden et le prince Imrahil, entre autres. Le lecteur intéressé pourra en trouver plusieurs exemples dans d'autres productions culturelles contemporaines. Cela en dit long sur l'idéologie raciale hégémonique, ou la programmation raciale pour reprendre un terme utile de Boris Benulic, et sur les émotions, les rêves et les désirs qui y sont associés. En même temps, il y a des exceptions. Elrond est l'une d'entre elles, Gandalf est ambivalent dans ce contexte. Arwen est également représentée comme blanche, mais il y a une autre logique derrière cela.

La couleur noire de la peau, en revanche, est associée à contrecœur à la trahison sur les cartes. Nous constatons donc que Boromir et Denethor sont restés blancs, tout comme Saroumane et Gríma. Les orques ne sont pas non plus noirs, mais verts ou pâles (comparez leur transformation entre la trilogie cinématographique et la trilogie du Hobbit). Les serviteurs humains de Sauron, les Haradrim, le Porte-parole, les pirates et les insulaires, sont également blancs sur les cartes. Étant donné que les pirates viennent de Numenor, c'est moins surprenant, mais Aragorn aussi. D'ailleurs, les îles de l'Est ressemblent à des squelettes de l'âge de pierre. Les cartes donnent l'impression que la motivation secrète de Sauron est une sorte de politique du pouvoir blanc, dirigée contre les leaders noirs légitimes comme Aragorn et Galadriel.

Blague à part ( ?), un schéma intéressant concerne Imrahil et Gandalf. Le prince Imrahil est appelé "le Juste" et Gandalf est surnommé "le Cavalier blanc" sur une carte. Sur ces deux cartes, où le lien entre les qualités blanches et équitables et les qualités nobles est évident, les personnages sont représentés en noir. Comparez cela avec le traitement de Heimdall, "l'âne blanc", dans le film de Marvel sur Thor, désormais assez ancien. Cela ne semble pas être une coïncidence, même si ce n'est pas nécessairement délibéré, cela nous donne un petit aperçu des réactions et des tabous de l'esprit politiquement correct.
Il est gratifiant d'examiner comment différentes cartes associent différentes couleurs de peau à différents traits de caractère, de la loyauté à la trahison. Il est au moins aussi gratifiant d'examiner la dynamique entre les cartes. Nous pouvons noter, par exemple, qu'Aragorn et Arwen se marient, un thème que nous reconnaissons dans de nombreuses publicités. Il découle logiquement du fait que la royauté masculine et sacrée est associée à la couleur de peau noire que la princesse elfe Arwen et son père ont la peau blanche. Il est plus difficile de déterminer dans quelle mesure cette logique sexuelle est l'une des clés de l'idéologie raciale en question ou simplement une conséquence de celle-ci. Il convient de mentionner ici que la dynamique entre Aragorn et Denethor est également significative. Le faux souverain, Denethor, ou d'ailleurs le maire Overlord dans Paw Patrol, a la peau blanche, tandis que la véritable autorité est représentée comme noire. Il y a là un aspect historique (de la fausse autorité blanche à la légitime autorité noire), ainsi qu'un désir psychologique et un lien avec l'intersectionnalité susmentionnée entre la couleur de peau et le genre. Dans le format micro, la même dynamique entre le Shire Shirriff authentique et le Shirriff corrompu réapparaît.
Les cartes déconstruisent également les tribus et l'anthropologie créées par Tolkien. Les Rohirrim, dont les noms sont souvent associés à des peuples germaniques, sont un exemple, où l'on trouve des Rohirrim noirs et où Eowyn, mais pas son frère Eomer, se voit attribuer une couleur de peau noire. Il en va de même pour les Dunedain, mais pas pour les nains. En outre, si nous examinons toutes les cartes dans leur contexte, nous constatons qu'elles construisent un monde où les princes légitimes sont noirs, les "peuples libres", à quelques exceptions près, sont mixtes, et les hordes de Sauron sont fortement associées à la couleur de peau blanche (et verte).
Dans l'ensemble, nous constatons que les modèles qui peuvent être identifiés dans le jeu de cartes sont si cohérents qu'ils nous aident à cartographier une idéologie ou une mythologie raciale qui chevauche largement l'idéologie ou la mythologie hégémonique. Les schémas sont trop cohérents pour être réduits à la noble formule "tout le monde devrait pouvoir se reconnaître" ; il s'agit au contraire d'une idéologie raciale dirigée contre les Blancs. On ne sait pas dans quelle mesure il s'agit d'une véritable obsession psychopathologique et dans quelle mesure c'est le résultat d'un ensemble d'incitations. Cependant, il est clair que l'idéologie hégémonique comporte de forts éléments de mythologie raciale.
A propos de l'auteur : Joakim Andersen
Joakim Andersen tient le blog Oskorei depuis 2005. Il a une formation universitaire en sciences sociales et une formation idéologique en tant que marxiste. Aujourd'hui, cette formation se traduit par un intérêt pour l'histoire des idées et une attention portée aux structures plutôt qu'aux personnes et aux groupes (l'adversaire est, en somme, le nouvel ordre mondial, et non les musulmans, les juifs ou d'autres groupes). Au fil des ans, l'influence de Marx a été complétée par Julius Evola, Alain de Benoist et Georges Dumezil, entre autres, car le marxisme manque à la fois d'une théorie durable de la politique et d'une anthropologie. Aujourd'hui, Joakim ne s'identifie à aucune étiquette, mais considère que la fixation, entre autres, sur le conflit imaginaire entre la "droite" et la "gauche" occulte les véritables enjeux de notre époque. Son blog s'intéresse également à l'histoire des idées et aime présenter des mouvements étrangers à un public suédois.
20:01 Publié dans Actualité, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : j. r. r. tolkien, tolkien, idéologie dominante, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
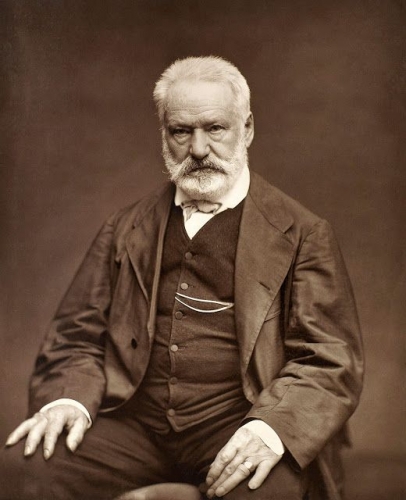
Victor Hugo et le génie des énergies naturelles (eau, vent)
Nicolas Bonnal
Dans Quatre-vingt-treize, Hugo défie les hommes et leur barbarie. Il se fait le chantre en pleine guerre civile française, en pleine horreur révolutionnaire, de la sagesse, de la beauté et de la richesse de la nature.
Il décrit ainsi une promenade :
« Pendant que ceci se passait près de Tanis, le mendiant s’en était allé vers Crollon. Il s’était enfoncé dans les ravins, sous les vastes feuillées sourdes, inattentif à tout et attentif à rien, comme il l’avait dit lui-même, rêveur plutôt que pensif, car le pensif a un but et le rêveur n’en a pas, errant, rôdant, s’arrêtant, mangeant çà et là une pousse d’oseille sauvage, buvant aux sources, dressant la tête par moments à des fracas lointains, puis rentrant dans l’éblouissante fascination de la nature, offrant ses haillons au soleil, entendant peut-être le bruit des hommes, mais écoutant le chant des oiseaux. »
Bruit des hommes, chant des oiseaux. Hugo aimait Leopardi (voyez mon texte).
Hugo explique aussi que certains paysages créent du mal-être :
« En présence de certains paysages féroces, on est tenté d’exonérer l’homme et d’incriminer la création ; on sent une sourde provocation de la nature ; le désert est parfois malsain à la conscience, surtout à la conscience peu éclairée ; la conscience peut être géante, cela fait Socrate et Jésus ; elle peut être naine, cela fait Atrée et Judas. La conscience petite est vite reptile ; les futaies crépusculaires, les ronces, les épines, les marais sous les branches, sont une fatale fréquentation pour elle ; elle subit là la mystérieuse infiltration des persuasions mauvaises. »
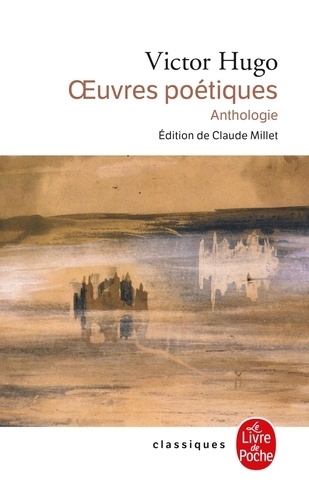
C’est tout le message de Tolkien (dernier écrivain romantique et magique) que l’on a là.
La nature est plus sage et plus belle. L’homme évidemment peut « dépasser » la nature. Cela fait longtemps qu’il ne le fait plus. Notez :
« Restez dans la nature. Soyez les sauvages. Otaïti est un paradis. Seulement, dans ce paradis on ne pense pas. Mieux vaudrait encore un enfer intelligent qu’un paradis bête. Mais non, point d’enfer. Soyons la société humaine. Plus grande que nature. Oui. Si vous n’ajoutez rien à la nature, pourquoi sortir de la nature ? Alors, contentez-vous du travail comme la fourmi, et du miel comme l’abeille. Restez la bête ouvrière au lieu d’être l’intelligence reine. »
Belle définition de la société idéale (« nature sublimée ») :
« Si vous ajoutez quelque chose à la nature, vous serez nécessairement plus grand qu’elle ; ajouter, c’est augmenter ; augmenter, c’est grandir. La société, c’est la nature sublimée. Je veux tout ce qui manque aux ruches, tout ce qui manque aux fourmilières, les monuments, les arts, la poésie, les héros, les génies. »

Malgré la brutalité et l’imbécillité de l’homme, de ses guerres et de ses fabrications (comme dit Lao Tse) la nature persiste :
« La nature est impitoyable ; elle ne consent pas à retirer ses fleurs, ses musiques, ses parfums et ses rayons devant l’abomination humaine ; elle accable l’homme du contraste de la beauté divine avec la laideur sociale ; elle ne lui fait grâce ni d’une aile de papillon ni d’un chant d’oiseau ; il faut qu’en plein meurtre, en pleine vengeance, en pleine barbarie, il subisse le regard des choses sacrées ; il ne peut se soustraire à l’immense reproche de la douceur universelle et à l’implacable sérénité de l’azur. Il faut que la difformité des lois humaines se montre toute nue au milieu de l’éblouissement éternel. L’homme brise et broie, l’homme stérilise, l’homme tue ; l’été reste l’été, le lys reste le lys, l’astre reste l’astre. »
On répète parce que c’est trop beau : « L’homme brise et broie, l’homme stérilise, l’homme tue ; l’été reste l’été, le lys reste le lys, l’astre reste l’astre. »
Il est amusant de voir d’ailleurs que la nature n’a jamais été aussi belle alors que l’homme écolo et repenti prétend à coups d’éoliennes et d’énième guerre mondiale la protéger.
Une dernière grande envolée poétique :
« Ce matin-là, jamais le ciel frais du jour levant n’avait été plus charmant. Un vent tiède remuait les bruyères, les vapeurs rampaient mollement dans les branchages, la forêt de Fougères, toute pénétrée de l’haleine qui sort des sources, fumait dans l’aube comme une vaste cassolette pleine d’encens ; le bleu du firmament, la blancheur des nuées, la claire transparence des eaux, la verdure, cette gamme harmonieuse qui va de l’aigue marine à l’émeraude, les groupes d’arbres fraternels, les nappes d’herbes, les plaines profondes, tout avait cette pureté qui est l’éternel conseil de la nature à l’homme. Au milieu de tout cela s’étalait l’affreuse impudeur humaine ; au milieu de tout cela apparaissaient la forteresse et l’échafaud, la guerre et le supplice, les deux figures de l’âge sanguinaire et de la minute sanglante ; la chouette de la nuit du passé et la chauve-souris du crépuscule de l’avenir. En présence de la création fleurie, embaumée, aimante et charmante, le ciel splendide inondait d’aurore la Tourgue et la guillotine, et semblait dire aux hommes : Regardez ce que je fais et ce que vous faites. »
L’homme brise et broie, l’homme stérilise, l’homme tue ; l’été reste l’été, le lys reste le lys, l’astre reste l’astre. »
La France de jadis…

Enfin Hugo lance même un message sublime sur l’énergie naturelle. L’homme doit s’aider de la terre pour vivre mieux :
« Que tout homme ait une terre, et que toute terre ait un homme. Vous centuplerez le produit social. La France, à cette heure, ne donne à ses paysans que quatre jours de viande par an ; bien cultivée, elle nourrirait trois cent millions d’hommes, toute l’Europe. Utilisez la nature, cette immense auxiliaire dédaignée. Faites travailler pour vous tous les souffles de vent, toutes les chutes d’eau, tous les effluves magnétiques. Le globe a un réseau veineux souterrain ; il y a dans ce réseau une circulation prodigieuse d’eau, d’huile, de feu ; piquez la veine du globe, et faites jaillir cette eau pour vos fontaines, cette huile pour vos lampes, ce feu pour vos foyers. Réfléchissez au mouvement des vagues, au flux et reflux, au va-et-vient des marées. Qu’est-ce que l’océan ? une énorme force perdue. Comme la terre est bête ! ne pas employer l’océan ! »
17:13 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : victor hugo, nicolas bonnal, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, 19ème siècle, écologie, nature |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Une admirable lettre de Saint-Exupéry au général X: «Deux milliards d’hommes n’entendent plus que le robot»
Nicolas Bonnal
Pilote de guerre Saint-Ex est placé pour parler de la technologie ; or celle-ci anéantit le combat et le goût du combat et le voyage et le goût du voyage.
Il écrit donc dans sa lettre :
« Je viens de faire quelques vols sur « P-38 ». C’est une belle machine. J’aurais été heureux de disposer de ce cadeau-là pour mes vingt ans. Je constate avec mélancolie qu’aujourd’hui, à quarante-trois ans, après quelque six mille cinq cents heures de vol sous tous les ciels du monde, je ne puis plus trouver grand plaisir à ce jeu-là. Ce n’est plus qu’un instrument de déplacement – ici, de guerre. Si je me soumets à la vitesse et à l’altitude à un âge patriarcal pour ce métier, c’est bien plus pour ne rien refuser des emmerdements de ma génération que dans l’espoir de retrouver les satisfactions d’autrefois. Ceci est peut-être mélancolique, mais peut-être bien ne l’est pas. »
Il a redécouvert par hasard le goût du déplacement en carriole, le goût du cheval, du mouton, des oliviers :
« Ceci est peut-être mélancolique, mais peut-être bien ne l’est pas. C’est sans doute quand j’avais vingt ans que je me trompais. En octobre 1940, de retour d’Afrique du Nord où le groupe 2-33 avait émigré, ma voiture étant remisée, exsangue, dans quelque garage poussiéreux, j’ai découvert la carriole et le cheval. Par elle, l’herbe des chemins. Les moutons et les oliviers. Ces oliviers avaient un autre rôle que celui de battre la mesure derrière les vitres à cent trente kilomètres à l’heure. Ils se montraient dans leur rythme vrai qui est de lentement fabriquer des olives. Les moutons n’avaient pas pour fin exclusive de faire tomber la moyenne. Ils redevenaient vivants. Ils faisaient de vraies crottes et fabriquaient de la vraie laine. Et l’herbe aussi avait un sens puisqu’ils la broutaient. »
Même la poussière est parfumée :
« Et je me suis senti revivre dans ce seul coin du monde où la poussière soit parfumée (je suis injuste, elle l’est en Grèce aussi comme en Provence). Et il m’a semblé que, durant toute ma vie, j’avais été un imbécile... »

Après la tristesse devant la mécanisation du monde lui revient :
« Tout cela pour vous expliquer que cette existence grégaire au cœur d’une base américaine, ces repas expédiés debout en dix minutes, ce va-et-vient entre les monoplaces de 2600 CV dans une sorte de bâtisse abstraite où nous sommes entassés à trois par chambre, ce terrible désert humain, en un mot, n’a rien qui me caresse le cœur. Ça aussi, comme les missions sans profit ou espoir de retour de juin 1940, c’est une maladie à passer. Je suis « malade » pour un temps inconnu. Mais je ne me reconnais pas le droit de ne pas subir cette maladie. Voilà tout. Aujourd’hui, je suis profondément triste – et en profondeur. Je suis triste pour ma génération qui est vide de toute substance humaine. Qui, n’ayant connu que le bar, les mathématiques et les Bugatti comme forme de vie spirituelle, se trouve aujourd’hui dans une action strictement grégaire qui n’a plus aucune couleur. »
En trois mots il expédie son époque :
« De la tragédie grecque, l’humanité, dans sa décadence, est tombée jusqu’au théâtre de M. Louis Verneuil (on ne peut guère aller plus loin). Siècle de la publicité, du système Bedeau, des régimes totalitaires et des armées sans clairons ni drapeaux ni messe pour les morts. Je hais mon époque de toutes mes forces. L’homme y meurt de soif. »
Ce n’est pas le même style (quelle chance nous avions tout de même), mais ce sont les thèmes de Céline et Bernanos. Saint-Ex ajoute sur la disparition spirituelle de la guerre :
« Considérez combien il intégrait d’efforts pour qu’il fût répondu à la vie spirituelle, poétique ou simplement humaine de l’homme. Aujourd’hui que nous sommes plus desséchés que des briques, nous sourions de ces niaiseries. Les costumes, les drapeaux, les chants, la musique, les victoires (il n’est pas de victoire aujourd’hui, rien qui ait la densité poétique d’un Austerlitz. »

Et alors que Bernanos prépare sa France contre les robots (pauvre France ! Pauvre Bernanos !), il écrit notre pilote :
« Ah ! Général, il n’y a qu’un problème, un seul de par le monde. Rendre aux hommes une signification spirituelle, des inquiétudes spirituelles. Faire pleuvoir sur eux quelque chose qui ressemble à un chant grégorien. Deux milliards d’hommes n’entendent plus que le robot, ne comprennent plus que le robot, se font robots. Tous les craquements des trente dernières années n’ont que deux sources : les impasses du système économique du XIXe siècle, le désespoir spirituel. »
Il pressent que l’après-guerre sera terrible, les termites (il en parle aussi) n’ayant rien compris :
« À quoi servira de gagner la guerre si nous en avons pour cent ans de crise d’épilepsie révolutionnaire ? Quand la question allemande sera enfin réglée, tous les problèmes véritables commenceront à se poser. Il est peu probable que la spéculation sur les stocks américains suffise, au sortir de cette guerre, à distraire, comme en 1919, l’humanité de ses soucis véritables. Faute d’un courant spirituel fort, il poussera, comme champignons, trente-six sectes qui se diviseront les unes les autres. Le marxisme lui-même, trop vieillot, se décomposera en une multitude de néo-marxismes contradictoires. On l’a bien observé en Espagne. À moins qu’un César français ne nous installe dans un camp de concentration néo-socialiste pour l’éternité. »
Le César on l’a ; il s’appelle Jupiter. Vive nos antiquités gréco-latines contre lesquelles se déchaînent aussi Bernanos et Céline.
On nous châtrés, ajoute le maître :
« Nous sommes étonnamment bien châtrés. Ainsi sommes-nous enfin libres. On nous a coupé les bras et les jambes, puis on nous a laissés libres de marcher. Mais je hais cette époque où l’homme devient, sous un totalitarisme universel, bétail doux, poli et tranquille. On nous fait prendre ça pour un progrès moral ! Ce que je hais dans le marxisme, c’est le totalitarisme à quoi il conduit. L’homme y est défini comme producteur et consommateur, le problème essentiel est celui de distribution. Ainsi dans les fermes modèles. Ce que je hais dans le nazisme, c’est le totalitarisme à quoi il prétend par son essence même. On fait défiler les ouvriers de la Ruhr devant un Van Gogh, un Cézanne et un chromo. Ils votent naturellement pour le chromo. Voilà la vérité du peuple ! »
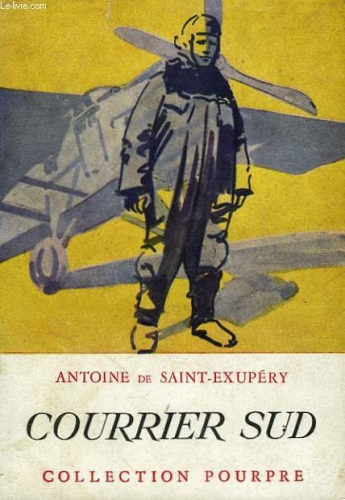
Et il n’avait pas vu la télé et les réseaux sociaux !
Plus on est allé vers le peuple au nom de la république ou de la démocratie libérale ou socialo (éducation, conscription, élections), plus on a récolté le totalitarisme qui a son tout a récolté le peuple. On a le bétail soumis en échange.
Le maître ajoute :
« On boucle solidement dans un camp de concentration les candidats Cézanne, les candidats
Van Gogh, tous les grands non-conformistes, et l’on alimente en chromos un bétail soumis. Mais où vont les États-Unis et où allons-nous, nous aussi, à cette époque de fonctionnariat universel ? L’homme robot, l’homme termite, l’homme oscillant du travail à la chaîne : système Bedeau, à la belote. L’homme châtré de tout son pouvoir créateur et qui ne sait même plus, du fond de son village, créer une danse ni une chanson. L’homme que l’on alimente en culture de confection, en culture standard comme on alimente les bœufs en foin. C’est cela, l’homme d’aujourd’hui. »
Hommage à la princesse de Clèves qui avait tant énervé l’insupportable Sarkozy :
« Et moi, je pense que, il n’y a pas trois cents ans, on pouvait écrire La Princesse de Clèves ou s’enfermer dans un couvent pour la vie à cause d’un amour perdu, tant était brûlant l’amour. Aujourd’hui, bien sûr, des gens se suicident. Mais la souffrance de ceux-là est de l’ordre d’une rage de dents. Intolérable. Ça n’a point à faire avec l’amour. »
Et il conclue pensant à ses pauvres voisins endormis dans son baraquement militaire :
« Depuis le temps que j’écris, deux camarades se sont endormis devant moi dans ma chambre. Il va me falloir me coucher aussi, car je suppose que ma lumière les gêne (ça me manque bien, un coin à moi !). Ces deux camarades, dans leur genre, sont merveilleux. C’est droit, c’est noble, c’est propre, c’est fidèle. Et je ne sais pourquoi j’éprouve, à les regarder dormir ainsi, une sorte de pitié impuissante. Car, s’ils ignorent leur propre inquiétude, je la sens bien. Droits, nobles, propres, fidèles, oui, mais aussi terriblement pauvres. Ils auraient tant besoin d’un dieu. Pardonnez-moi si cette mauvaise lampe électrique que je vais éteindre vous a aussi empêché de dormir et croyez en mon amitié. »
Car, s’ils ignorent leur propre inquiétude, je la sens bien.
Tu vas voir le prochain vaccin, tu vas voir leur Reset, tu vas voir leur nouvelle guerre mondiale, tu vas voir les CBDC.
16:58 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : antoine de saint-exupéry, nicolas bonnal, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Jünger et Schmitt, trop grands pour le panthéon de la droite fluide et pro-américaine
Gennaro Malgieri
Source: https://electomagazine.it/junger-e-schmitt-troppo-grandi-per-il-pantheon-della-destra-fluida-e-filoamericana/
Parmi les intellectuels allemands de la première moitié du 20ème siècle, Ernst Jünger et Carl Schmitt occupent des positions centrales reconnues même à notre époque, ce qui semble témoigner de leurs diagnostics politiques et métapolitiques. Tous deux ont exprimé le malaise de la modernité face à l'avancée du nihilisme (pour le premier) et aux convulsions du pouvoir (pour le second).
Il ne fait aucun doute que ces deux positions se complètent de manière exemplaire pour comprendre les contradictions dramatiques du 20ème siècle qui nous ont amenés au nouveau siècle. Jünger et Schmitt, qui étaient d'ailleurs liés par une profonde estime qui n'a cependant jamais abouti à un lien idéologico-politique comme on aurait pu s'y attendre, ont tous deux tenté une voie "rebelle" à l'égard de la culture et de la vision du monde qui étaient en train de s'imposer. Tant en ce qui concerne les involutions de la démocratie que les résultats de la crise spirituelle européenne.
L'éblouissant totalitarisme matérialiste, déterministe et relativiste les a opposés, même si leur implication dans les événements qui ont marqué la première moitié du siècle dernier les a fait passer, stupidement et superficiellement, pour des apologistes de ce qu'ils tentaient d'endiguer: travailler de l'intérieur (Schmitt) dans la mesure du possible; imaginer une manière aristocratique et impersonnelle, explicitement individualiste (Jünger), de donner un sens à la pratique aristocratique de surmonter les "valeurs bourgeoises" qui minent la stabilité et l'ordre européens.
Parmi les intellectuels révolutionnaires-conservateurs, Carl Schmitt (1888-1985) occupe une place cruciale en tant qu'idéologue qui, plus que tout autre, a posé le problème du pouvoir, de ses transformations et de son impact sur la formation des nouveaux agrégats politiques issus de la Grande Guerre. Il a "travaillé" autant qu'il le pouvait au sein des institutions, apportant non seulement des contributions théoriques à la construction d'un nouvel État allemand dans les années 1930, mais aussi concrétisant un système de légitimité qui surmonte les tendances totalitaires, ce qu'il n'a pas réussi à faire, ce qui lui a valu d'être marginalisé par les milieux les plus radicaux du Troisième Reich, détail qui n'a heureusement pas échappé aux juges de Nuremberg qui l'ont acquitté avec un "permis de ne plus agir".
Un peu plus de trente ans après sa mort, l'itinéraire intellectuel de Schmitt est reproposé en Italie par la publication de deux livres. Le premier, un syllogue de certains de ses écrits, publié par Adelphi, Stato, grande spazio, nomos, édité par l'un de ses élèves les plus attentifs, Günter Maschke. Dans ce livre, qui résume certains des principaux concepts du savant, on peut retrouver les idées de Schmitt sur la "mondialisation". En effet, Schmitt avait vu, avec une clairvoyance exceptionnelle, comment "l'universalisme de l'hégémonie anglo-américaine" était destiné à effacer toutes les distinctions et la pluralité spatiale dans un "monde unitaire" totalement subjugué par la technologie et la financiarisation globale de l'économie et soumis à une sorte de "police internationale".
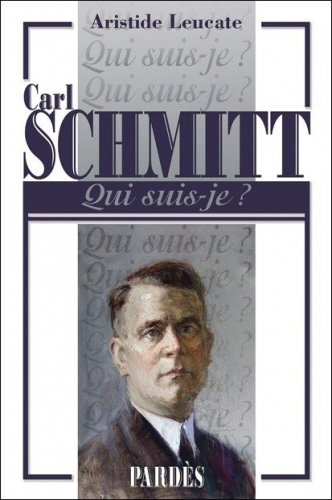
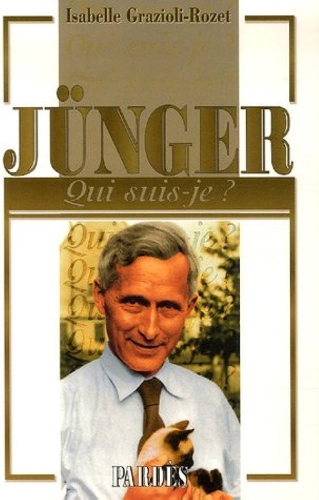
Un monde spatialement neutre, sans cloisons et sans contrastes - donc sans politique, comme nous l'avons noté dans l'introduction. Pour Schmitt, au contraire, il ne peut y avoir d'Ordnung (ordonnancement) sans Ortung (localisation, ancrage en un lieu), c'est-à-dire sans une subdivision adéquate et différenciée de l'espace terrestre. Une subdivision qui, toutefois, dépasse l'étroitesse territoriale des anciens États nationaux fermés, pour aboutir au "principe des grands espaces" : le seul capable de créer un nouveau jus gentium, au centre idéal duquel devrait se trouver à nouveau l'ancienne terre d'Europe, un authentique katechon face à l'Antéchrist de l'uniformisation planétaire sous le signe d'un unique "seigneur du monde". Ce qui est certain, c'est que la perspective de Schmitt, notée dans l'édition des écrits, déjà esquissée il y a quatre-vingts ans, apparaît aujourd'hui plus pertinente que jamais, et sa pensée se confirme comme fondamentale pour comprendre notre époque.
Le second est un long entretien, au titre évocateur d'Imperium proposé par l'éditeur Quodlibet, qui se présente comme une véritable autobiographie, réalisée à l'âge de quatre-vingt-trois ans, en 1971, par l'historien Dieter Groh et le journaliste Klauss Figge pour la radio allemande, soutenu par un puissant appareil de notes préparé par les éditeurs qui rend la parabole de Schmitt encore plus compréhensible. Le long récit de sa vie montre que le savant n'a jamais cherché à s'éloigner du contexte historique dans lequel son travail théorique a pris forme dans la définition des catégories de la politique, de la critique de la nouvelle géopolitique qui a souffert de la fin du traité de Westphalie et de la décadence conséquente du Vieux Continent après l'annulation du jus publicum europaeum (le droit interétatique qui délimitait l'ordonnancement spatial de la res publica chrétienne médiévale). Et comment le problème de la souveraineté a été posé par un raisonnement autour de la figure du "décideur". Des thèmes aujourd'hui partagés par l'ensemble de la science politique la plus avancée, sans préjugés d'aucune sorte. Dans l'entretien biographique, truffé de détails extraordinairement intéressants sur son éducation et son environnement familial, il expose sans réticence les moments les plus problématiques de sa vie et notamment comment il est devenu malgré lui "juriste du Reich", une fonction qui lui permettrait de juger les hommes et les événements avec une grande lucidité, tout comme il avoue avec une sincérité éblouissante sa critique du progrès des Lumières et sa foi catholique soutenue par sa fréquentation des penseurs contre-révolutionnaires.
Vie publique et vie privée s'entremêlent dans cette intense "confession" d'où se dégage le sens d'une longue vie consacrée à la découverte des fondements réels de la politique et de la centralité de l'État comme "ordonnateur des ordres". D'où son "inimitié" totale à l'égard de la modernité, le révélateur de tous les principes régulateurs de l'existence humaine. Et l'aversion, jamais cachée, pour l'irréalisme utopique destructeur des structures "naturelles" qui a souvent ensemencé le sol sur lequel la graine totalitaire a germé.
 Il en va de même - et cela les unit - pour Jünger (1895-1998) qui, un peu plus de cent vingt ans après sa naissance et dix-huit ans après sa mort, ne cesse de nous interpeller sur les questions posées par la catastrophe existentielle dans laquelle nous sommes plongés, rappelée par le dense volume Ernst Jünger, publié par Solfanelli, conçu et édité par Luigi Iannone, dans lequel pas moins de trente auteurs abordent les "nœuds" du dernier grand écrivain allemand que personne n'a jamais songé à nommer pour le prix Nobel (ce qui, comme l'a dit Alain de Benoist, qualifie d'une certaine manière le 20ème siècle).
Il en va de même - et cela les unit - pour Jünger (1895-1998) qui, un peu plus de cent vingt ans après sa naissance et dix-huit ans après sa mort, ne cesse de nous interpeller sur les questions posées par la catastrophe existentielle dans laquelle nous sommes plongés, rappelée par le dense volume Ernst Jünger, publié par Solfanelli, conçu et édité par Luigi Iannone, dans lequel pas moins de trente auteurs abordent les "nœuds" du dernier grand écrivain allemand que personne n'a jamais songé à nommer pour le prix Nobel (ce qui, comme l'a dit Alain de Benoist, qualifie d'une certaine manière le 20ème siècle).
Le parcours "rebelle" entrepris par Jünger dès son plus jeune âge et poussé à ses extrêmes conséquences dans sa maturité, pour aboutir à la définition de la figure existentielle, mais aussi mythopoétique, de l'Anarque, est aujourd'hui la ligne de partage des eaux entre ceux qui adhèrent à la névrose de la globalisation de la pensée et ceux qui, apparemment reclus, revendiquent la primauté de la diversité en adhérant à des valeurs qui s'écartent de l'homologation culturelle et la soumettent à une stricte dévalorisation. C'est ce que révèlent les contributions que Iannone a rassemblées et qui donnent à Jünger une connotation très actuelle. Et cela est d'autant plus vrai si on le met en relation avec les involutions de la démocratie et avec les résultats de la crise spirituelle européenne. L'éblouissant totalitarisme matérialiste, déterministe et relativiste auquel l'écrivain allemand s'est toujours opposé s'estompe à la lumière des fulgurantes intuitions de Jünger: de la conception du Travailleur à cette "mobilisation totale" qui a modifié substantiellement la considération de l'intervention existentielle, politique, métapolitique, guerrière et intellectuelle, de la classification de la guerre comme exaltation de l'esprit à la réinvention de la paix (dans un sens tout sauf kantien), des constructions oniriques de la décadence aux "radiations" (Strahlungen) qui illuminent son long travail et constituent les métaphores du dépassement de l'égalitarisme massifiant.
Iannone, à juste titre, rappelle la définition qui représente le mieux Jünger : "sismographe de l'âge de la technologie", dans la mesure où elle est liée à l'interprétation de la modernité dont il rejette les fantasmagories déclenchées par une "pensée négative" qui a liquidé les libertés substantielles pour les homologuer à un universalisme dans lequel les différences ont disparu et où se sont dissoutes les "formes", comme les appelait Gottfried Benn, qui enferment le concept décomposé d'"humanité" : le sacré, l'honneur, le courage, la communauté et ainsi de suite. La figure de l'Anarque, représentation extrême du refus de la modernité selon Jünger, est la seule habilitée à "traverser les bois", c'est-à-dire la crise.
Mais une préparation spirituelle adéquate est nécessaire. Jünger s'est fait passer pour elle. Et cela suffit à le considérer comme le partisan le plus lucide d'une renaissance possible, quel que soit le désespoir induit par le contexte.
19:46 Publié dans Littérature, Philosophie, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, carl schmitt, révolution conservatrice, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
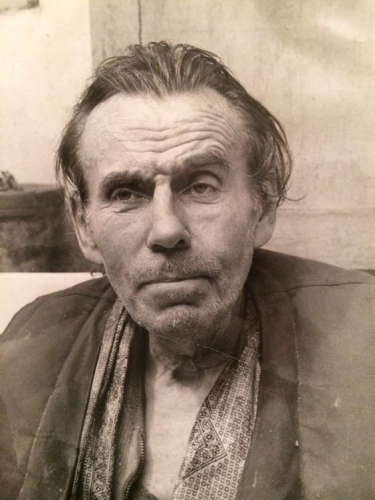
Parution du numéro 464 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
- Descendants versus ayants droit
- Réédition de Céline en Bretagne
- Entretien avec Yannick Gomez
- Biographies
- Nabe et Mergen persévèrent dans l’erreur.
20:15 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Dominique de Roux ou "le goût aristocratique de déplaire"
Par Frédéric Andreu
Paris est un labyrinthe pour qui connaît mal les rues et les portes cochères innombrables de la ville lumière. Sans le fil d'Ariane que nous tendit l'épouse de Dominique aujourd’hui octogénaire, aurions-nous réalisé notre rêve ? Sans doute que non. C'est donc avec une pointe de nostalgie onirique que nous avons fouler le sol d'un appartement mythique qu'occupait l'éditeur Dominique de Roux lorsqu'il ne voyageait pas aux quatre coins du monde. Aussitôt après avoir tapé à la porte du dît appartement, l'"Ariane" de ce jour nous guida dans une petite et étonnante pièce carrée remplie de livres, photos et souvenirs - véritable naos de la vie littéraire des années 60, 70, où Ezra Pound, Jorge-Luis Borges, Raymond Abellio, Henri Michaux, entre autres auteurs du 20ème siècle eurent leurs habitudes.
En effet, les grands auteurs de son temps, Dominique de Roux les connaissait tous, ou presque. Mais que veut dire "connaître" lorsqu'on s'appelle Dominique de Roux? Cela veut dire essayer de "comprendre" au sens de "prendre avec soi" un Borges quasi aveugle venu de Buenos Aires accompagné de sa mère, un Ezra Pound enfermé dans un mutisme presque total, hébergé plus d'un mois durant dans l'appartement sacré de la rue de Bourgogne.

"Connaitre", cela voulait encore dire publier des auteurs en dépit de leur odeur de souffre et de naphtaline; cela voulait encore dire lutter contre un certain "esprit du temps", un esprit qui dans ces années d'après-guerre exerçait un travail revanchard de brouillage des repères traditionnels. Contre cette tyrannie insidieuse, Dominique a essayé toutes les années de sa courte vie de rester debout, quitte à brandir l'écu de ses ancêtres en faisant montre de ce "goût aristocratique de déplaire" qui le caractérisait si bien. Pour moi, ce mot emprunté à Charles Baudelaire dit tout d'une attitude face à la vie et à la mort, une allégeance à la poésie - et non seulement au poème - propre aux gens de la race de Dominique. Ce mot exprime aussi une certaine tradition française d'insoumission et de résistance ironique voire onirique que l'on retrouve notamment chez de jeunes éditeurs comme Rodophe Dupuis. Est-ce mu par cet esprit de franc-tireur que Dominique publia dans un même ouvrage les plus belles stances du communiste chinois Mao Tse Toung et des textes inédits d'un Ezra Pound accusé de sympathie avec le fascisme ?
Je ne peux cependant penser à ce numéro pour le moins explosif des Cahiers de l'Herne qu'en restant songeur et suspendu. On aurait cherché à se mettre sur le dos tout ce que Paris comptaient de bien-pensants et de maîtres censeurs que l’on ne s’y serait pas pris autrement ! Bravo Dominique !
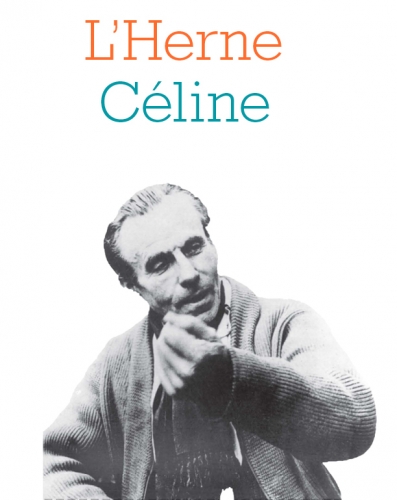
Jacqueline, en dévouée vestale de la mémoire familiale, se souvient: "Lorsque nous avons publié Louis-Ferdinand Céline, nous avons reçu par la Poste des courriers anonymes contenant des petits cercueils !".
Des cercueils par la Poste !? Oui, chers lecteurs, vous avez bien lu ! Un geste odieux, hypocrite, criminel, comparable à ces lettres anonymes qui envoyèrent à la déportation juifs et résistants pendant les années noires de l'Occupation. La comparaison entre ces deux périodes du 20ème siècle n'est pas fortuite. À sa manière, le destin de Dominique est celui qui est toujours imparti à tout «résistant». Mais contre quelle tyrannie Dominique a-t-il fait acte de résistance ?
Dominique qui avait 5 ans en 1940 et 35 en 1970 n'a pas eu a lutter contre de méchants nazis, mais contre la transformation néolibérale de la société, contre le règne croissant de la quantité, contre une hostilité aux aurores, aux épiphanies poétiques, contre une invisible mais pourtant bien réelle armée d'occupation mentale, médiatique et technologique de cette France de ces années de consommation outrancière. Une occupation qui comme toute occupation a connu ses collaborateurs zélés, ceux qu'il nommait "les arlequinades d'un certain milieu parisien".
Au fond, que reprochèrent ces "arlequins" d'un certain milieu culturo-mondain parisien - Phillipe Sollers en tête - à Dominique de Roux et à ses Cahiers de l'Herne ? Tout simplement, de considérer en premier lieu les qualités intrinsèques d'un auteur, les aurores mythologiques de certaines phrases et de certains mots, les bonheurs d’expression qui apparaissent parfois au cours d’une lecture solitaire et passionnée. En d’autres termes, on reprocha à Dominique de Roux d’être un amoureux de la vie et de l’art, un aventurier de l’esprit et tout simplement un «vivant».
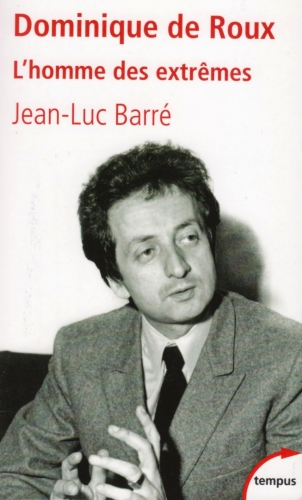
En réalité, Dominique eu la disgrâce de naître dans un pays et un temps aussi tyranniquement idéologique que la France de cette époque, un pays où un tableau exposé, un livre publié doit jouer un rôle idéologique. L'opération de détournement qui consiste à faire d'une œuvre d'art une bannière de ralliement ou un épouvantail idéologique, Dominique la connaissait bien. Il s'est battu contre cela toute sa courte vie. Il s'agit de revenir à l'œuvre, à son dieu, à sa grâce.
J’ai personnellement rencontré nombre de ces preneurs d'otage, faux esthètes dont le cerveau hypertrophié ne laisse plus de place à l'âme. Qu'il soit de droite ou de gauche, la petite rhétorique de l'idéologue est toujours la même. «Pour m’afficher de droite, je dois dire du mal de Louis Aragon ; pour m’afficher de gauche, je dois surtout dire du mal de Robert Brasillach - sans, bien sûr, n’avoir jamais ouvert un seul des ouvrages de ces auteurs respectifs. Les chiens marquent leur territoire avec du pipi; les idéologues de tous bords, marquent leurs territoires avec des ouvrages qu’ils n’ont pas lus.
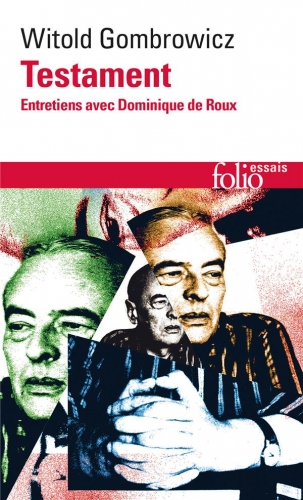
À rebours de cet instinct territorial de gagne-petit, Dominique de Roux sut rendre allégeance à la beauté et à la poésie. Pour se faire, il lut des auteurs provenant de toutes les rives, de tous les bords, sans a-priori partisan. Mao Tse Toung, Céline, Gombrowicz, combien d’autres encore ? Mais Dominique ne fut pas seulement un découvreur de talents, un écrivain stylé et un éditeur audacieux, il fut aussi un grand homme d'action. «Dominique a traversé une partie de la jungle angolaise. Il cherchait alors à rejoindre le camp retranché de son ami Jonas Savimbi, révolutionnaire africain !» s’écria Jacqueline de Roux à l’instant où, au cours de notre visite, nos yeux se posèrent sur une photo un peu jaunie où apparaissait un Dominique en chemise courte, au milieu de gigantesques baobabs…

Traverser une jungle hostile quatorze heures durant par amitié et fidélité à la parole donnée, n'est-ce pas là un "haut fait" peu compréhensible pour un de ces bourgeois parisiens n'ayant jamais traversé que le parc aux canards de son arrondissement fleuri de chrysanthèmes ? De quel «haut fait» comparable peut se prévaloir un Philippe Sollers, grand détracteur de Dominique de Roux? D’avoir simulé la schizophrénie pour éviter d’être mobilisé en Algérie ?
Nous comprenons mieux - après la visite de cet appartement mythique encore tout résonnant des pas de Pound et de Borgès – pourquoi un Paul Vandromme a pu dire de son ami Dominique de Roux : "Il n'a pas été remplacé et il nous manque beaucoup". Oui ! En ces temps de «grand remplacement», voici bien une figure héroïque qui, elle, n'a pas été remplacée ! Et c'est sans doute pourquoi, quarante-six ans après sa disparition, Dominique de Roux nous manque toujours.
Je n’ai personnellement rencontré Dominique qu’à travers quelques reportages vidéos «youtube» et quelques ouvrages. Ce que les mots, le style, les orées tremblantes de certains de ses textes ont chuchoté à mon âme, je l'ai formulé en une phrase sans doute réductrice et lapidaire. Cette formule, je veux néanmoins la publier ici en guise d’hommage à Dominique de Roux et à son épouse Jacqueline. «Essaie d’être un peu moins idéologique et un peu plus mythologique", douze mots qui pour moi composent le royal filigrane d'une vie et d'une œuvre, celle de Dominique de Roux. Cette devise crie notamment dans un de ses ouvrages intitulés «le Cinquième Empire».
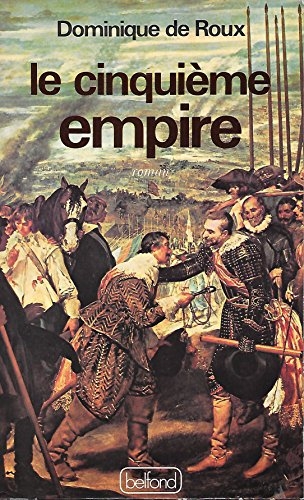
Cet ouvrage majeur, d'une altitude philosophique comparable au «Terre des Hommes» de Saint- Exupéry, nous exhorte à avancer dans la vie sans idéologie préconçue. L’horizon de ce texte n’est aucunement d’ordre idéologique, mais mythologique : un jour de brume, précise le roman, le «roi Sébastien reviendra» en majesté au-dessus du Tage ! Pour se faire, inutile de brandir des banderoles. Cette venue d’ordre épiphanique et intérieure, tient aussi bien au monde visible qu'au monde invisible, quand le «roi Sebastien» n'est pas seulement le souverain sur la terre, mais peut être aussi bien l’«autre» que l’on croise dans la rue, que le «soi» que l'on cherche en nous.
Au dela d'un lieu et d'une histoire, toute la trame narrative de ce bel ouvrage nous dit : rencontrer quelqu'un dans la rue a un sens, tomber par terre a un sens ; se relever, aussi. Elle nous exhorte encore à revenir à la concrétude de notre corps, aux fulgurances de notre esprit, à ce qui se défait en nous.

Si Dominique nous invite à laisser choir nos banderoles idéologiques, nos luttes sociétales de seconde main, ce n’est pas par esprit de démission, bien au contraire. C’est afin de (re)prendre conscience de notre respiration, de notre marche, des paroles qui sortent de notre bouche. C'est afin que nous nous placions résolument du côté de la vie et non du côté des calques idéologiques de tous bords, des causes sociétales de seconde main. Un commentaire de nous-même ne cesse de brouiller les appels de l'âme divine. La littérature, la vraie, peut faire taire ce bruit incessant et perturbateur.
En ces temps obombrés par les écrans des smartphones et des idéologies de seconde main que nous avons la disgrâce de traverser, tel un Ulysse livré aux enchantements des sirènes, nous pouvons affirmer sans trop de risque de nous tromper que Dominique de Roux s'inscrit résolument dans cette chaîne d'or des «auteurs matinaux» qui ne se comptent aujourd’hui plus que sur les doigts d’une seule main ; Luc-Olivier d’Algange, Pascal Payen-Appenzeller et quelques autres rares écrivains du dévoilement et de l'«apparaître».
Lire ou relire ces auteurs de l' "apparaître", entrer dans leurs oeuvres régénératrices, n'est-ce pas une réponse au règne tyrannique du "paraître" ?
Vidéo avec Dominique de Roux : https://youtu.be/MI4Fwfxfj-8
contact : fredericandreu@yahoo.fr
19:53 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : dominique de roux, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Qu'est-ce que la géopoétique ?
Partie 2
Partie 1: http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2023/07/29/qu-est-ce-que-la-geopoetique-premiere-partie.html
Source: https://katehon.com/ru/article/chto-takoe-geopoetika-chast-2
La géopoétique n'a pas encore été définie comme une discipline à part entière. Elle s'oppose donc à la géopolitique comme une sorte d'alternative humaniste à la géopolitique, souvent comme une tentative de réunir l'homme et la nature afin d'éviter une future catastrophe causée par l'homme.
On peut également affirmer que le concept de "géopoétique" n'est en aucun cas une définition scientifique, mais un terme trompeur, c'est-à-dire une sorte d'aimant sonore qui a une ressemblance extérieure avec les termes. Cependant, en déchiffrant le mot "géopoétique" à partir du grec, on peut identifier les sèmes suivants à l'intérieur du mot : "geos" - "terre" + "poétique" - "art, création". Il s'agit donc d'une discipline esthétique qui comprend la compréhension artistique du développement des territoires géographiques et des paysages, la compréhension de leur sphère mythique et épique, ainsi que des œuvres multigenres, la compréhension de l'influence mutuelle du monde de la géographie et du monde de la littérature (ainsi que du monde de l'art), et la généralisation des phénomènes susmentionnés.


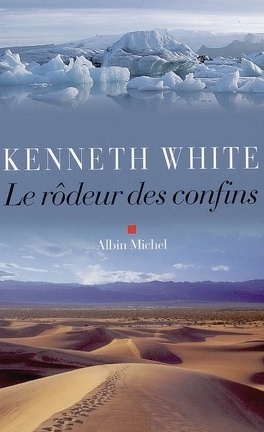
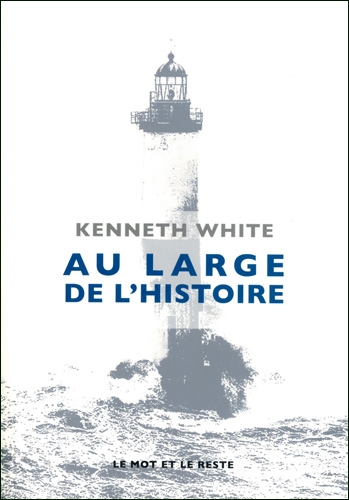
La géopoétique s'articule autour de quatre axes principaux :
Artistique
Il s'agit de textes littéraires, souvent fondés sur l'épopée ou le mythe, qui décrivent de manière métaphorique la relation à la Terre en tant que planète. Elle peut également être considérée comme un reflet littéraire du mouvement ésotérique New Age.
En ce qui concerne les représentants de la géopoétique artistique, il convient de distinguer deux figures monumentales qui ont influencé le développement de la géopoétique en général.
Il s'agit tout d'abord de l'auteur du terme "géopoétique", le Français Kenneth White. K. White, en homme honnête, a admis que la paternité du terme lui avait été injustement attribuée et qu'il n'avait fait qu'exprimer des idées qui s'étaient déjà retrouvées dans divers contextes littéraires et scientifiques. En 1989, Kenneth White a fondé l'Institut international de géopoétique afin de faire progresser la recherche dans le domaine interculturel et transdisciplinaire qu'il avait développé au cours de la décennie précédente.
En octobre 2005, Kenneth White a donné une série de trois conférences dans le cadre du projet géopoétique : "North Atlantic Investigations", "Returning to Territory" et "Feeling the Far North". Mais l'œuvre la plus monumentale de White est Le Plateau de l'Albatros. Introduction à la géopoétique, 1994). En ce qui concerne la géopoétique, Kenneth écrit dans Le Plateau de l'albatros... : "Il conviendrait peut-être de décrire comment et quand le concept est apparu au cours de mon travail. L'idée n'avait pas encore pris forme, mais le mot a commencé à se glisser dans mon discours et dans mes écrits dès la fin des années 1970. Il semblait capable de relier de nombreuses significations différentes, qui n'étaient pas entièrement définies. On m'a récemment suggéré que le mot avait déjà été utilisé dans des contextes littéraires et scientifiques. Je ne l'oublierai pas. Mais ce que je préconise, ce n'est pas le droit d'inventer le terme, mais son interprétation poétique. Non pas le mot, mais la libération d'un nouveau sens. Ce sens a pris forme dans mon esprit et s'est incarné lors d'un voyage que j'ai effectué le long de la côte nord du golfe du Saint-Laurent en 1979. Je cite mon carnet de notes de l'époque : "Les eaux de la baie m'ont attiré vers la vaste étendue blanche du Labrador. Un nouveau mot est apparu dans mon cerveau : géopoétique. Comme une exigence d'aller au-delà du texte historique et littéraire pour trouver la poésie du vent et la capacité de penser comme le flux d'une rivière. Qui vit ? Telle est la question. Ou peut-être est-ce un appel. Un appel qui vous attire vers l'extérieur. De plus en plus loin. Si loin que vous cessez d'être la personne que vous connaissiez si bien auparavant et que vous devenez juste une voix, une voix sans nom, qui raconte les innombrables merveilles du nouveau monde. Bien sûr, il faut que cela arrive. Peut-être déjà ici et maintenant...".
Kenneth White est l'auteur de vingt-cinq essais, quatorze textes en prose et plus de vingt textes lyriques.

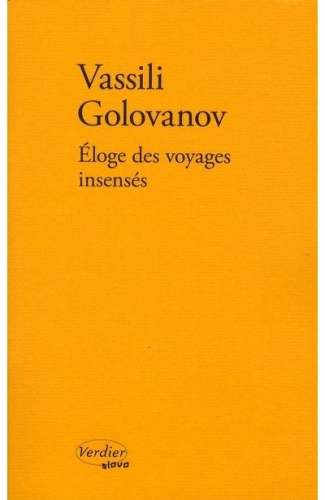
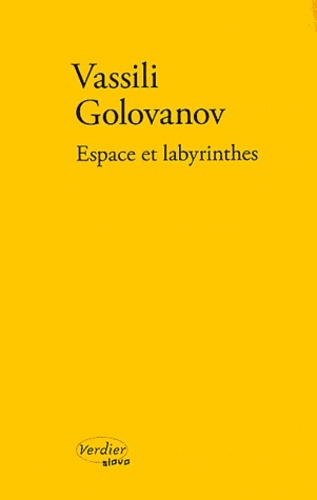
La deuxième figure n'est pas seulement l'auteur, mais aussi le traducteur Vassili Golovanov, qui a présenté de nombreuses œuvres de White en russe et est devenu son disciple en Russie. Vassili a commencé sa carrière avec le livre "Tachanki s Yuga", consacré à l'histoire du mouvement insurrectionnel makhnoviste (en Ukraine pendant la guerre civile russe, ndt). Avec R. Rakhmatullin, A. Baldin, D. Zamyatin et V. Berezin, il a été membre du groupe de recherche littéraire "Putevoy Zhurnal", dont l'action la plus marquante a été l'expédition "Aux ruines de Tchevengur". Vassili a écrit ce qui suit sur la géopoétique : "Le terme "géopoétique" est souvent utilisé ces derniers temps et s'est déjà séparé du terme familier de "géopolitique". Une clarification s'impose. La géopoétique n'est pas dérivée de la géopolitique comme une sorte de rime conditionnelle, et encore moins comme un concept pris à l'opposé. Le projet géopoétique est le résultat d'une recherche indépendante, de véritables voyages qui se sont déroulés dans une réflexion polyvalente. L'un des fondateurs de la nouvelle discipline, l'écrivain écossais Kenneth White, qui vit et travaille en France et parcourt le monde, a d'abord défini le champ d'intérêt de la géopoétique dans le cadre de la géographie existentielle. Ainsi, commençant le jeu avec son propre nom (White), il construit l'image-archétype de "l'espace blanc", incluant l'ancien nom de l'Écosse - Alba, développant parallèlement des motifs celtiques dans l'interprétation de la couleur blanche comme centre de la palette universelle, et trouve à la fin un certain module d'ordonnancement de l'espace, l'échelle blanche de White (les tautologies sont inévitables).
Il est révélateur que Kenneth White lui-même définisse les limites de l'application de son outil non pas tant dans l'espace (accrétion à l'ouest, par l'ouest), mais dans le temps. Les limites de son "White" sont le Nouveau Temps, qui a commencé au moment de la découverte de l'Amérique, le Nouveau Monde. Maintenant que le Nouveau Temps s'est épuisé dans l'hypertrophie du comptage, de la technologie numérique, de l'application verbale de la postmodernité, et ainsi de suite, White part à la recherche du temps suivant. Dans ce contexte, son module White prend une projection historiosophique".
Projectif
Comme son nom l'indique, cette orientation est basée sur une sorte de projet ou d'expérience, appliquée à des projets culturels et scientifiques, à de nouveaux mythes paysagers et territoriaux ou à la révision artistique d'anciens mythes.
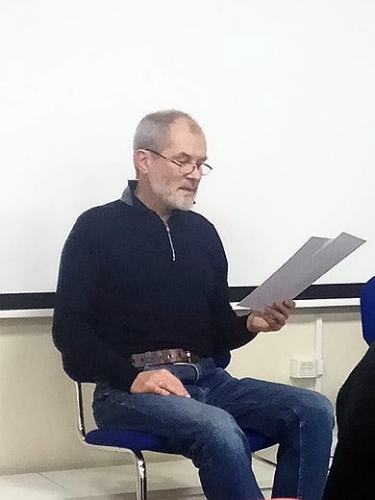
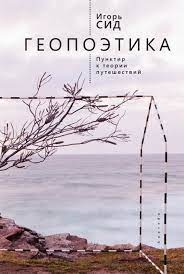
Cette orientation est le résultat du Forum de la culture contemporaine du Bosphore, anciennement dirigé par Igor Sid (non seulement le modérateur du projet, mais aussi l'auteur du livre "Geopoetics"). Selon I. Sid : "La géopoétique est un nouveau concept international qui acquiert les caractéristiques d'un terme scientifique et couvre les formes les plus diverses d'interaction créative de l'homme avec l'espace géographique, les territoires et les paysages : voyage méditatif, littéraire-artistique, projectif-appliqué, recherche et autres. Dans la définition scientifique la plus générale, la géopoétique est "le travail sur les images et/ou les mythes du paysage-territoire (géographique)".
Scientifique
Cette orientation est associée à l'étude de la poétique, aussi bien des territoires locaux que de la considération à grande échelle. Elle occupe à juste titre une place importante dans le travail d'analyse des philologues et des critiques littéraires. Parmi les érudits célèbres qui ont apporté une contribution significative dans ce domaine, citons : M. L. Gasparov, V. I. Shirina, A. A. Korablev, V. V. Abashev, N. I. Polevoy, Y. M. Lotman et V. M. Guminsky. Bien entendu, cette liste de chercheurs en géopoétique n'est pas exhaustive, mais ce sont ces scientifiques qui ont été à l'origine de cette orientation.
En outre, la direction de la géopoétique scientifique, en tant que direction formée, a été initiée en 1996 par le Club géopoétique de Crimée, qui a organisé la première (1996) et la deuxième (2009) conférences internationales sur la géopoétique.
Négatif
Il s'agit de la littérature dite dystopique qui traite des catastrophes causées par l'homme. C'est un concept proposé par le groupe de recherche Lausanne-Sorbonne des slavistes (Edouard Nadtochy, Anastasia de la Fortel, Anne Coldefi-Focard) "sur la base d'une synthèse de toutes les déterritorialisations locales dépourvues de mémoire et de signification sociale - qu'il s'agisse des "non-lieux" de l'urbanisme, qu'il s'agisse de l'"abandon" industriel, des sites de catastrophes naturelles et technologiques, des anomalies naturelles, ou des sites de tourisme noir tels que les camps abandonnés, les prisons et les lieux de mort de masse".

Un exemple frappant de cette orientation peut être donné par des œuvres telles que : "Tchernobyl" de E. Liverbarrow, "Kholochye. Chernobyl saga" de V. Sotnikov, "Dyatlov Pass, or the Mystery of the Nine" de A. Matveev.
L'image esthétique dans la géopoétique
Dans leurs travaux, V. V. Abashev et M. P. Abasheva ont donné la définition la plus objective de l'image géopoétique, à savoir : "L'image géopoétique est une "image symbolique du territoire dans son ensemble", dans laquelle "le territoire, le paysage <...> sont compris comme une instance significative dans la hiérarchie des niveaux du monde naturel et deviennent des sujets de réflexion esthétique et philosophique <...> le paysage est conceptualisé <...> et ses caractéristiques dominantes font l'objet d'une compréhension symbolique". En d'autres termes, l'image géopoétique n'est pas seulement un constructeur de la conceptosphère de l'auteur, mais aussi une image du monde, de l'expérience de l'humanité, de l'expérience de l'interaction entre l'homme et l'espace - et tout cela passe par la réflexion de l'auteur et l'hyperbolisation subjective des sensations dans le texte.

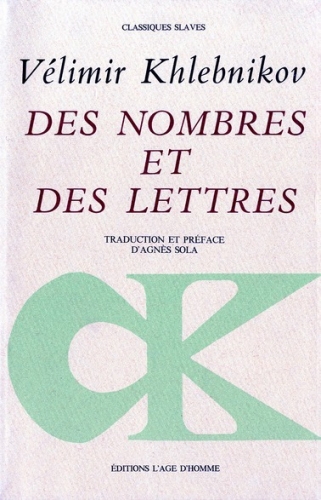
La colline de Svyatogor
Comme exemple de géopoétique dans la littérature russe, j'aimerais citer la figure de Velemir Khlebnikov et ses essais. Mais avant cela, je tiens à préciser que la fonction esthétique du langage est liée à l'attention portée à la forme linguistique/parole du texte. Les œuvres littéraires classiques sont construites sur le principe de la politesse linguistique (c'est-à-dire sans éclats et sans insultes, sans vocabulaire prétentieux et vulgaire), et si elles contiennent des jargonismes, des pléonasmes et un vocabulaire stylistiquement réduit, leur utilisation justifie le fragment artistique. Par exemple, pour créer l'image d'un héros antisocial.
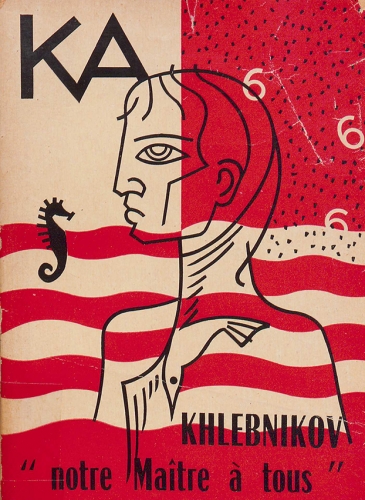
Mais il est important de se rappeler que si le lecteur ne comprend pas la langue de l'œuvre, ne comprend pas la forme, il ne sera pas en mesure d'évaluer le sens et le poème lui semblera mauvais, car l'esthétique de l'œuvre sera fortement réduite. Par exemple, le poème de Velimir Khlebnikov:
Nous sommes des enchanteurs et des churrays.
Charmant là, charmant ici,
Ici un churakhar, là un churakhar,
Ici un churil, là un churil.
De la churinya les yeux de la churinya.
Il y a un churavel, il y a un churavel.
Charari ! Churari ! Churel !
Charel ! Charesa et churesa.
Et churaisya et charelsya.
Bien que la poésie de Khlebnikov exclue presque la fonction esthétique de la langue russe, ses essais conservent un intérêt territorial et des analyses approfondies. Ses essais "La colline de Svyatogor" (1908) et "Sur l'élargissement des limites de la littérature russe" (1913) sont un reflet vivant de la direction artistique de la géopoétique. Ainsi, dans le premier essai, Khlebnikov estime que la poésie est : "La slavité russe a fait écho aux voix étrangères et a laissé muet le mystérieux guerrier du nord, le peuple-mer".
"Et l'on ne devrait pas reprocher au grand Pouchkine lui-même qu'en lui les nombres sonores de l'être du peuple - le successeur de la mer, remplacés par les nombres de l'être des peuples - obéissant à la volonté des anciennes îles ? <...> Tout moyen ne veut-il pas aussi être une fin ? Ce sont les voies de la beauté du mot, différentes de ses buts. L'arbre de la haie donne des fleurs et lui-même. <Et resterons-nous sourds à la voix de la terre : "Donnez-moi une bouche ! Donnez-moi une bouche !" Ou resterons-nous les oiseaux moqueurs des voix occidentales ? <...> Et les rusés Euclide et Lobachevsky n'appelleront-ils pas onze vérités impérissables les racines de la langue russe ? Ils verront dans les mots les traces de l'esclavage de la naissance et de la mort, appelant les racines - Dieu, les mots - l'œuvre de la main de l'homme. <...> Et si la vie et l'existence dans la bouche de la langue du peuple peuvent être comparées à la dolomie d'Euclide, alors le peuple russe ne peut-il pas s'offrir le luxe, inaccessible aux autres nations, de créer une langue - comme la dolomie de Lobachevsky, cette ombre de mondes étrangers ? Le peuple russe n'a-t-il pas droit à ce luxe ? L'intelligence russe, toujours avide de droits, renoncera-t-elle à ce qui lui est donné par la volonté même du peuple : le droit de créer des mots ? <Qui connaît le village russe, connaît les mots formés par l'heure et vivant le siècle du papillon de nuit". En d'autres termes, Khlebnikov a littéralement appelé la poésie "la voix du territoire/paysage".
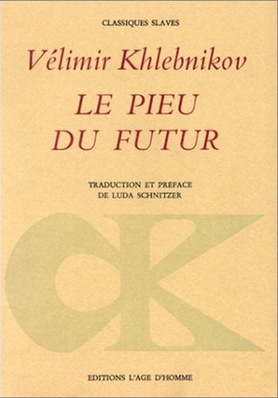
Dans l'essai "Sur l'élargissement des limites de la littérature russe" (1913), V. Khlebnikov ne se contente pas de parler de la poésie comme d'une voix du territoire/paysage. Khlebnikov a non seulement fait appel aux travaux de l'un des premiers géo-descripteurs, N. M. Przhevalsky, mais il a également écrit: "En Russie, on a oublié l'État de la Volga - l'ancien Bolgar, Kazan, les anciennes voies vers l'Inde, les relations avec les Arabes, le royaume de Biarm. Le système d'appanage, à l'exception de Novgorod, de Pskov et des États cosaques, est resté en dehors de son champ d'action. Elle ne remarque pas chez les Cosaques le plus bas degré de noblesse, créé par l'esprit de la terre, qui rappelle les samouraïs japonais. Dans certains endroits, elle fait l'éloge du Caucase, mais pas de l'Oural et de la Sibérie avec l'Amour, avec ses légendes les plus anciennes sur le passé des gens (Orochons). La grande frontière des 14ème et 15ème siècles, où se sont déroulées les batailles de Kulikovo, Kosovo et Grunwald, ne lui est pas du tout connue et attend son Przewalski". En d'autres termes, il a directement déclaré que différentes parties de la Russie "attendent leur Przewalski".
Aujourd'hui, pour comprendre la géopoétique du texte régional, les ouvrages consacrés au Nord russe, à la Crimée, à la Transouralienne (Oural, Sibérie, Altaï) ont fait l'objet des recherches les plus approfondies.
18:38 Publié dans Définitions, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : définition, lettres, lettres russes, littérature, littérature russe, kenneth white, vassili golovanov, géopoésie, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Dans les bas-fonds de la société; le "Grand hospice occidental" de Limonov
par Michele (Blocco studentesco)
Source: https://www.bloccostudentesco.org/2023/07/13/bs-limonov-grande-ospizio-occidentale/
Un livre pour en finir avec le 1984 de George Orwell, ou du moins pour le dépasser et actualiser sa critique de la société qui nous entoure, c'est aussi cela Le Grand hospice occidental d'Edouard Limonov. Si, au fond de vous, vous n'avez pas beaucoup de sympathie pour ce Winston Smith bourgeois aux veines variqueuses, dont les seuls gestes révolutionnaires consistent à baiser et à se faire baiser par le système, si chaque fois que vous entendez parler de "dérive orwellienne" vous prenez votre fusil, si vous détestez la tranquillité bovine de vos vies plus que la violence de la répression, le nouvel essai de l'écrivain russe est le livre qu'il vous faut.
Nouveau pour ainsi dire. Paru en France au début des années 1990, Le grand hospice occidental est enfin arrivé en Italie cette année aux éditions Bietti, sous la direction d'Andrea Lombardi et dans une traduction d'Andrea Scarabelli, le tout accompagné d'une introduction signée par Alain de Benoist.
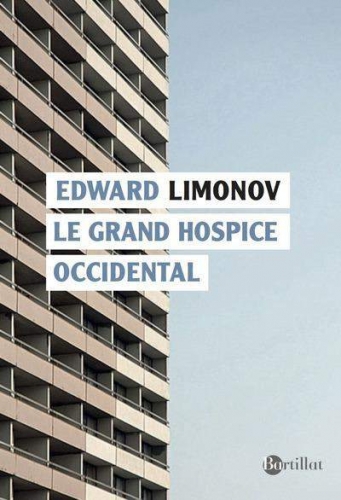
L'hypothèse de base de Limonov est que d'un système basé sur la violence dure, nous sommes passés à un système qui utilise un autre type de contrôle, celui de la violence douce. En bref, rien à voir avec la "botte qui écrase un visage pour toujours". Pour comprendre la différence entre ces deux types de violence, la comparaison avec Orwell peut encore être utile. Si l'un des rares enseignements valables que Limonov reconnaît à 1984 est l'importance accordée aux écrans de télévision, au point qu'ils deviennent "le personnage principal de la société future, son principal moyen de contrôle", c'est vrai mais selon des schémas dépassés. Au contraire, "Aujourd'hui, la télévision contrôle la population. Mais elle le fait à travers ce qu'elle montre, pas en l'observant". En d'autres termes, il ne s'agit pas d'une surveillance continue allant jusqu'à l'interdiction d'éteindre les écrans de télévision, mais d'une manipulation encore plus subtile et omniprésente. Ce changement de paradigme découle de l'apogée de la destruction et du danger extrême atteint au début du 20e siècle:
Terrifiée par son propre cannibalisme lors de la Grande Guerre puis de la Seconde Guerre mondiale, l'humanité "civilisée" a pris ses distances avec les régimes durs, optant résolument pour les régimes doux (deux autres facteurs essentiels ont déterminé ce choix : l'armement nucléaire, qui dissuade l'agression ; l'innovation technologique, qui permet d'assouvir les appétits des masses).
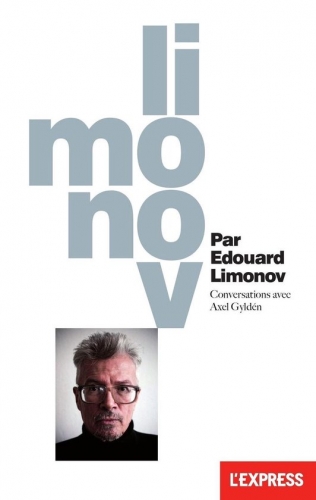
Une différenciation que Limonov explique ainsi :
Si la violence dure implique essentiellement la répression physique de l'individu, la violence douce repose sur l'exploitation de ses faiblesses. La première entend transformer le monde en cellule d'isolement, la seconde veut faire de l'homme un animal de compagnie. Bref, un régime doux ne sait pas quoi faire des uniformes noirs, des matraques et de la torture. Il dispose d'un autre arsenal : la fausse idée du bien-être matériel, la menace du chômage et de la crise, la peur et la honte d'être plus pauvre - et donc moins bon - que son voisin, la paresse. L'homme n'est pas seulement énergie mais aussi paresse.
D'où l'image de l'hospice, qui résume l'idée d'un monde sénescent et sans force, "dont les patients sont soignés dans une atmosphère douce, mais néanmoins disciplinaire". Une métaphore qui "entend créer le fameux effet de distanciation, pour que le lecteur voie le monde familier à travers un regard étranger", celui de Limonov lui-même. Il ne faut pas se faire trop d'illusions sur l'étendue de l'Hospice et sa signification "occidentale". Les sanatoriums de l'Est ne sont qu'une forme plus primitive et plus grossière de ceux de l'Ouest, ils doivent encore affiner leurs méthodes. Les chaînes qui lient ceux qui habitent l'Hospice sont les pièges du confort et de la facilité, la dilution de la vie dans l'ennui, l'exclusion de toute excitation excessive. Une perspective désespérante et sans issue, parce qu'à partir de la vieillesse, on ne peut être guéri que par la mort.

Dans cette sorte de frontière ultime qu'est l'hospice, certains hommes s'épanouissent, d'autres sont exclus. Tout prend l'allure d'une sélection par le bas, d'un élevage d'hommes qui choisit les personnages les plus faibles et les moins problématiques. Nous atteignons l'apogée - ou l'abîme ? - de ce "déséquilibre des troupeaux" que Nietzsche reprochait au libéralisme. Les "Agités", ceux que l'on appelait autrefois les héros, sont niés et désavoués. Au contraire, ce sont les faibles et les "malades" qui sont exaltés, dans un renversement de sens qui fait du révisionnisme et de la stigmatisation morale son arme :
Le culte des victimes est encore plus absurde face à l'Histoire. C'est sans doute par confusion mentale que l'humanité admire depuis deux mille trois cents ans Alexandre le Grand, le premier conquérant européen. Selon les critères d'aujourd'hui, nous devrions avoir pitié des tribus qu'il a subjuguées. Heureusement pour Alexandre, Amnesty International n'existait pas encore.
Après tout, il s'agit d'une "utopie faite et achevée", de la réalisation de rêves humides de bien-être matériel et de la rectification du monde par l'esprit socratique, par opposition à l'esprit tragique. Mais tout cela exclut, par l'amer paradoxe de tous les humanitaires, la partie la plus intéressante de l'humanité. Mais on a beau vouloir rejeter le risque et le conflit, on a beau vouloir anesthésier la vie et déformer l'homme, on ne peut pas éternellement balayer sa véritable essence sous le tapis : "une "bonne vie" peut devenir insupportable même à l'animal le plus docile. Un travail monotone, une digestion paisible, un accouplement tranquille sont d'excellentes choses, mais elles ne peuvent satisfaire qu'une partie de l'animal humain. Son agressivité veut aussi s'exprimer".
20:02 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : édouard limonov, livre, littérature, littérature russe, lettres, letres russes, occident |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Pierre Le Vigan:
La dépendance aux passions chez Balzac
L’œuvre de Balzac permet d’éclairer la question de la dépendance psychique, au delà des addictions à des produits, comme les alcools, le café, etc, abordées dans le Traité des excitants modernes. Toute l’œuvre de Balzac est en effet ordonnée par quelques idées directrices. Dans celles-ci, l’addiction et les excès psychiques ont presque toujours leur part.
 Un personnage de La Peau de chagrin s’exprime ainsi : «Je vais vous révéler en peu de mots un grand mystère de la vie humaine. L’homme s’épuise par deux actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort : vouloir et pouvoir. Entre ces deux termes de l’action humaine, il est une autre formule dont s’emparent les sages, et je lui dois le bonheur et ma longévité. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Ainsi le désir ou le vouloir est mort en moi, tué par la pensée ; le mouvement ou le pouvoir s’est résolu par le jeu naturel de mes organes ».
Un personnage de La Peau de chagrin s’exprime ainsi : «Je vais vous révéler en peu de mots un grand mystère de la vie humaine. L’homme s’épuise par deux actes instinctivement accomplis qui tarissent les sources de son existence. Deux verbes expriment toutes les formes que prennent ces deux causes de mort : vouloir et pouvoir. Entre ces deux termes de l’action humaine, il est une autre formule dont s’emparent les sages, et je lui dois le bonheur et ma longévité. Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit, mais savoir laisse notre faible organisation dans un perpétuel état de calme. Ainsi le désir ou le vouloir est mort en moi, tué par la pensée ; le mouvement ou le pouvoir s’est résolu par le jeu naturel de mes organes ».
En d’autres termes, Balzac met en garde contre les puissances du désir, contre l’activisme cherchant à les satisfaire, et rappelle les vertus de la contemplation. Mais curieusement, pour dominer le désir, il faut parfois, dit Balzac, se laisser aller à en accepter les manifestations. « Pour l’homme privé, pour le Mirabeau qui végète sous un règne paisible et rêve de tempêtes, la débauche comprend tout ; elle est une perpétuelle étreinte de toute la vie, ou mieux, un duel avec une puissance inconnue, avec un monstre : d’abord le monstre épouvante, il faut l’attacher par les cornes, c’est des fatigues inouïes ; la nature vous a donné je ne sais quel estomac étroit et paresseux, vous le domptez, vous l’élargissez, vous apprenez à porter le vin, vous apprivoisez l’ivresse, vous passez les nuits sans sommeil … » (…) « La débauche est sans doute au corps ce que sont à l’âme les plaisirs mystiques ».
 Inspiré par l’illuminisme de Saint-Martin et de Swedenborg, Balzac croit que la vérité relève de l’intuition, et que la science provient d’une tradition mère « dont nos pensées sont les débris … » (Louis Lambert). C’est évidemment une conception anti-rationaliste du monde. La place faite à l’illumination peut amener un certain a - priori favorable aux effets des excitants ou des drogues. Mais l’essentiel dans la vision balzacienne, pour ce qui nous importe, est ici : « La vie décroît, en raison directe de la puissance des désirs ou de la dissipation des idées ».
Inspiré par l’illuminisme de Saint-Martin et de Swedenborg, Balzac croit que la vérité relève de l’intuition, et que la science provient d’une tradition mère « dont nos pensées sont les débris … » (Louis Lambert). C’est évidemment une conception anti-rationaliste du monde. La place faite à l’illumination peut amener un certain a - priori favorable aux effets des excitants ou des drogues. Mais l’essentiel dans la vision balzacienne, pour ce qui nous importe, est ici : « La vie décroît, en raison directe de la puissance des désirs ou de la dissipation des idées ».
Pour Balzac, l’instinct – non sans proximité avec ce que Freud appellera l’inconscient – devient fou mû par les idées. Dit autrement : l’idée tue celui qui la porte. Comme l’écrit Ramon Fernandez : « Ainsi, l’idée de la science tue la science dans la Recherche de l’absolu, l’art tue l’œuvre dans le Chef d’œuvre inconnu, l’idée du crime est analogue au crime même dans l’Auberge rouge, l’avarice tue l’avare dans Maître Cornélius. Et il va sans dire que, dans Louis Lambert, la pensée tue le penseur » (Balzac ou l’envers de la création romanesque, Grasset, 1980, réédition, p. 92). En ce sens, les nouvelles dites philosophiques (« Etudes philosophiques ») ne le sont pas plus – et pas moins – que les autres. Pour Balzac, les idées rendent fou, et l’idée fixe rend fou absolument : la névrose est au cœur de son œuvre.
 L’idée fixe amène en effet à l’idée d’un arrière-monde. Dans Catherine de Médicis, Balzac écrit : « Je pense donc que cette terre appartient à l’homme, qu’il en est le maître, et peut s’en approprier toutes les formes, toutes les substances … Déjà, nous avons étendu nos sens, nous voyons dans les astres ! Nous devons pouvoir étendre notre vie ! Avant la puissance, je mets la vie … Un homme raisonnable ne doit pas avoir d’autre occupation que de chercher, non pas s’il est une autre vie, mais le secret sur lequel repose sa forme actuelle pour la continuer à son gré ! Voilà le désir qui blanchît mes cheveux ; mais je marche intrépidement dans les ténèbres, en conduisant au combat les intelligences qui partagent ma foi. La vie sera quelque jour à nous ».
L’idée fixe amène en effet à l’idée d’un arrière-monde. Dans Catherine de Médicis, Balzac écrit : « Je pense donc que cette terre appartient à l’homme, qu’il en est le maître, et peut s’en approprier toutes les formes, toutes les substances … Déjà, nous avons étendu nos sens, nous voyons dans les astres ! Nous devons pouvoir étendre notre vie ! Avant la puissance, je mets la vie … Un homme raisonnable ne doit pas avoir d’autre occupation que de chercher, non pas s’il est une autre vie, mais le secret sur lequel repose sa forme actuelle pour la continuer à son gré ! Voilà le désir qui blanchît mes cheveux ; mais je marche intrépidement dans les ténèbres, en conduisant au combat les intelligences qui partagent ma foi. La vie sera quelque jour à nous ».
Cette idée de Balzac, cette idée d’une connaissance cachée qui est au cœur de tous les ésotérismes – ici l’alchimie – est commune avec l’un des présupposés de l’entrée dans les drogues : l’idée qu‘il existe une « clé » permettant de vraiment comprendre les choses, et d’élargir le domaine de la vie. Il s’agit d’acquérir une puissance sur un milieu, une capacité de domination exceptionnelle. Il y a là une illusion de toute puissance que l’on retrouve comme adjuvant des conduites d’addiction, qu’elles soient ou non liées à un produit. Mais en même temps, cette illusion d’un multiplicateur de la vie qui résiderait dans un arrière-monde porte la mort en elle. Car le renouvellement de la vie suppose moins la puissance que la capacité d’oubli : « Oublier est le grand secret des existences fortes et créatrices ; oublier à la manière de la nature, qui ne se connaît point de passé, qui recommence à toute heure les mystères de ses infatigables enfantements » (César Birotteau).
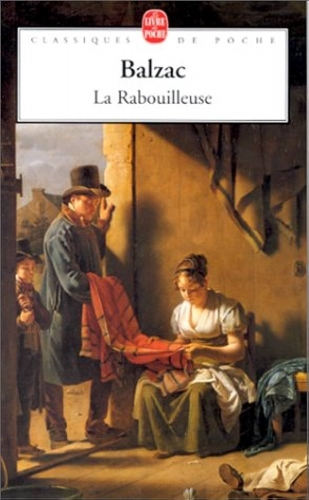 Ainsi, les livres de Balzac sont des mises en épopées d’aventures bourgeoises dans lesquelles les tendances psychologiques des personnages sont l’élément déterminant. En d’autres termes, l’intrigue sert de faire-valoir et, comme le note encore Ramon Fernandez, « précipite la catastrophe » (…) « comme un accident révèle la maladie et achève la vie d’un malade chronique qui s’abusait sur sa santé » (op. cit., p. 219). La maladie, pour Balzac, c’est la passion. Celle-ci entraîne à la dépense de l’énergie tout autant qu’un champ de bataille. Et c’est ainsi que certains personnages balzaciens, tel Philippe Bridau, « s’habituent à ériger leurs moindres intérêts et chaque vouloir de leur passion en nécessité » (La Rabouilleuse). Qu’elles amènent à des réussites, provisoires ou non, toutes les passions produisent le mal. « Les sentiments nobles poussés à l’absolu produisent des résultats semblables à ceux des plus grands vices » (La Cousine Bette). Passions, idée d’une connaissance cachée à découvrir par divers moyens, dangers de l’absolu : tous ces thèmes traversent les récits de Balzac et, à leur façon, aident à penser les dépendances.
Ainsi, les livres de Balzac sont des mises en épopées d’aventures bourgeoises dans lesquelles les tendances psychologiques des personnages sont l’élément déterminant. En d’autres termes, l’intrigue sert de faire-valoir et, comme le note encore Ramon Fernandez, « précipite la catastrophe » (…) « comme un accident révèle la maladie et achève la vie d’un malade chronique qui s’abusait sur sa santé » (op. cit., p. 219). La maladie, pour Balzac, c’est la passion. Celle-ci entraîne à la dépense de l’énergie tout autant qu’un champ de bataille. Et c’est ainsi que certains personnages balzaciens, tel Philippe Bridau, « s’habituent à ériger leurs moindres intérêts et chaque vouloir de leur passion en nécessité » (La Rabouilleuse). Qu’elles amènent à des réussites, provisoires ou non, toutes les passions produisent le mal. « Les sentiments nobles poussés à l’absolu produisent des résultats semblables à ceux des plus grands vices » (La Cousine Bette). Passions, idée d’une connaissance cachée à découvrir par divers moyens, dangers de l’absolu : tous ces thèmes traversent les récits de Balzac et, à leur façon, aident à penser les dépendances.
PLV
Dernier livre de Pierre Le Vigan:
Pierre LE VIGAN, Avez-vous compris les philosophes ? Tome V. (Thalès de Milet, Anaximandre, Anaximène, Pythagore, Héraclite, Parménide, Anaxagore, Empédocle, Démocrite, Augustin, Scot Erigène, Abélard, Ockham, Malebranche, La Mettrie, Holbach), Ed. La barque d’or:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=pierre+le+vigan+avez+vous+compris+tome+5
20:25 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre le vigan, philosophie, passions, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, honoré de balzac, balzac |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

La théologie de Tolkien contre les idéologies
par Roberto Presilla
Source : Avvenire & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-teologia-di-tolkien-contro-le-ideologie
Nous anticipons l'éditorial du philosophe Roberto Presilla qui ouvre le numéro 2/2023 de Vita e Pensiero, le bimensuel culturel de l'Université catholique du Sacré-Cœur.
Cinquante ans après sa mort, l'œuvre de Tolkien reste l'un des grands chefs-d'œuvre de la littérature. Le nombre d'exemplaires vendus et de traductions place le vieux professeur d'Oxford sur un pied d'égalité avec un autre écrivain anglais au succès certain, ce William Shakespeare dont Tolkien a discuté les choix linguistiques. Par rapport au public, la critique a évolué assez lentement : il existe aujourd'hui quelques revues académiques consacrées aux études sur Tolkien. Comme toujours, des tendances opposées émergent dans le débat, à l'instar de ce qui s'est produit au cours des dernières décennies parmi les fans. Le pendule de l'histoire montre de grandes variations : il va des "camps hobbits" de certains partisans des mouvements de droite, il y a des décennies, à l'utilisation que les communautés hippies ont faite de Tolkien dans les années 1960, en l'interprétant comme un précurseur du "flower power". Dans ce sillage, on peut aussi lire, peut-être, le choix d'Amazon Prime Video, qui a proposé une dramatisation dans une clé inclusive (avec la série The Rings of Power). S'il est évident qu'une telle opération fait appel, au moins en partie, à la collaboration des héritiers, il est tout aussi clair que les grands classiques - Shakespeare docet - sont relus et réinterprétés, parfois avec des effets qui, à terme, peuvent s'avérer intéressants.

Dans le cas de la série télévisée, cependant, on assiste à une simplification (excessive) de la profondeur philosophique et théologique de Tolkien, au nom de priorités "morales" qui sont étrangères à sa vision. On lit dans Tolkien ce que son propre cadre de référence idéologique suggère. Ainsi, la droite italienne a lu Tolkien à partir de la leçon d'Elémire Zolla et d'autres, tandis que les jeunes hippies américains l'ont inclus dans leur propre critique du capitalisme. Cependant, comme l'écrivait G.K. Chesterton dans The Banner of the Broken Sword, "quand les gens comprendront-ils qu'il est inutile de lire sa propre Bible si l'on ne lit pas aussi celle des autres ?": il est facile de lire un texte en y superposant son propre point de vue, en oubliant les mises en garde que la méthode philologique - certainement pratiquée par le professeur Tolkien - suggérerait.
Les érudits peuvent eux aussi tomber dans la même erreur : pensez à ceux qui discutent du "paganisme" de Tolkien et qui se demandent si le légendaire professeur est "catholique". Dans une lettre adressée au père Robert Murray en décembre 1953, Tolkien écrit que Le Seigneur des Anneaux est fondamentalement une œuvre religieuse et catholique ; je n'en étais pas conscient au début, je l'ai été pendant la correction" (Reality in Transparency. Letters 1914-1973, lecture 142). C'est pourquoi, ajoute l'écrivain, il a pratiquement effacé toute référence à quoi que ce soit de "religieux".
Si l'écrivain est catholique et considère son œuvre comme telle, comment résumer sa vision ? On peut esquisser une tentative à partir de l'essai sur les contes de fées (Sulle fiabe, in Albero e Foglia), qui présente le mécanisme narratif de l'eucatastrophe, qui dément la "défaite finale, et qui est donc évangile". L'eucatastrophe conjugue la vertu d'espérance et la vision providentielle, avec une saveur théologique certaine. Tolkien est parfaitement conscient du fait que les histoires - et l'Histoire - ne peuvent être optimistes, mais doivent plutôt s'accommoder du péché, du mal, de la corruption : le "happy end" de nombreux films est la version simpliste et quelque peu mensongère de l'eucatastrophe, le renversement espéré d'une situation qui s'ouvre sur une issue heureuse, sans pour autant effacer la souffrance et la destruction.
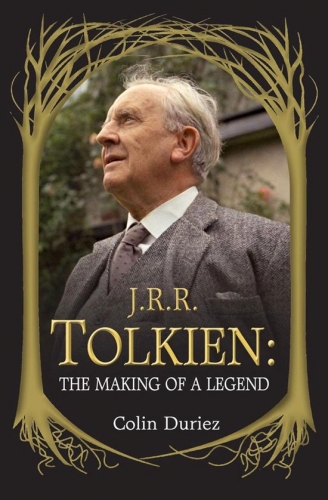
L'arc narratif du Seigneur des Anneaux est structuré autour d'une eucatastrophe, à plusieurs niveaux. L'anneau unique n'est pas détruit par Frodon, qui ne peut finalement pas résister à la tentation: c'est Gollum qui s'en empare, se mord le doigt, puis plonge dans l'abîme et détruit l'anneau. Beaucoup d'épisodes sont donc de petites eucatastrophes [...] : de toute façon, ce n'est pas l'habileté stratégique ou la prévoyance qui garantit la victoire, qui est d'ailleurs rarement indolore. C'est le contraire qui se produit pour ceux qui sont perdus : Saroumane, par exemple, est un sage qui cherche à maîtriser le réel en exploitant les moyens à sa disposition. Grâce à un Palantír - une pierre capable de communiquer à distance - il a l'illusion d'étudier l'Ennemi, mais son esprit est corrompu par la vision répétée de la puissance de Sauron, qui insinue dans son esprit la soif de pouvoir et en même temps la peur, consumant peu à peu sa capacité à discerner les traces de l'œuvre d'un Autre dans les événements de l'histoire. La peur et la soif de pouvoir mènent au désespoir : la seule défense est l'espoir, l'humble conscience de la providence en action.
Tolkien, en conteur expert, sait traduire ce concept en histoires - chaque geste de miséricorde ou de bonté portera ses fruits - et cette attitude le rapproche d'autres écrivains catholiques, tels que Manzoni. Ainsi, Gollum, bien que dévoré par la passion de l'Anneau, est plus mesquin que méchant, et est sauvé à plusieurs reprises, même par Frodon, parce qu'il suscite la compassion. C'est cette pitié qui transforme providentiellement Gollum d'antagoniste en sauveur de la Terre du Milieu. Le combat s'inscrit également dans une tension spirituelle. Dans cette perspective, c'est Faramir, à bien des égards alter ego de Tolkien lui-même, qui donne voix aux convictions de l'écrivain en déclarant qu'il n'aime ni les armes ni la gloire, mais seulement les gens qui doivent se défendre contre un ennemi maléfique.
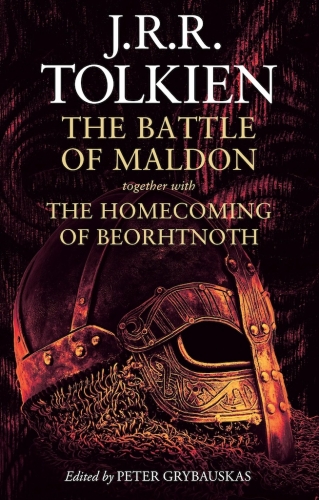
Cette conception providentielle repose sur une vision proche de celle d'Augustin. Le mal n'est pas le contraire du bien, mais la négation du bien, sa diminution : c'est pourquoi le mal ne peut être combattu avec les armes que le mal lui-même a forgées. Ce concept, qui traverse toutes les histoires du corpus de Tolkien, est également explicité ailleurs : dans une lettre à son fils Christopher de septembre 1944 (Reality in Transparency, op. cit. 81), critiquant sévèrement la diabolisation des adversaires allemands, Tolkien commente : "You cannot fight the Enemy with his Ring without turning yourself into an Enemy too" (On ne peut pas combattre l'ennemi avec son anneau sans se transformer soi-même en ennemi). Et plus tard, écrivant à Rayner Unwin en octobre 1952 (Reality in Transparency, op. cit. 135), Tolkien commente ainsi le premier essai atomique effectué par le Royaume-Uni: "Le Mordor est au milieu de nous. Et je suis désolé de devoir souligner que le nuage bouffi récemment créé ne marque pas la chute de Baradur, mais a été produit par ses alliés - ou du moins par des gens qui ont décidé d'utiliser l'Anneau à leurs propres fins (bien sûr excellentes)".
On ne peut pas penser contrer les effets de la corruption en recourant à ce qui corrompt: l'Anneau ne peut pas réaliser le bien parce qu'il a été créé pour soumettre le bien à un dessein de pouvoir. Mais la création est belle, et le deuxième monde d'Arda l'est aussi : Tolkien contemple avec fascination la beauté de la création, la variété des arbres et des paysages. Et, obéissant à la même logique que celle qui gouverne ses personnages, le narrateur insère Tom Bombadil, la figure la plus énigmatique de l'œuvre, régulièrement oubliée dans les adaptations cinématographiques. C'est facile à faire, car Tom Bombadil ne sert apparemment pas l'histoire. Mais il chante toute la journée, il connaît et aime la nature sans prétention de domination. Ainsi, dans son lien avec la terre non corrompue, il ne peut être victime de la volonté de puissance que l'Anneau sait nourrir et canaliser. La meilleure façon de célébrer Tolkien est peut-être de se rappeler que Frodon et Gandalf, eux aussi, au milieu de leurs aventures, ont été divertis par Tom Bombadil.
14:15 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : théologie, catholicisme, j. r. r. tolkien, lettres anglaises, littérature anglaise, lettres, littérature, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Hoffmann et Jünger: la nature perturbatrice de la technologie
par Marco Zonetti
Source: https://www.ariannaeditrice.it/articolo.php?id_articolo=49112
En lisant la nouvelle Le marchand de sable (ou: L'homme au sable) d'Ernst Theodor Hoffmann et le court roman dystopique Abeilles de verre d'Ernst Jünger, nous pourrions découvrir que les deux auteurs ne partagent pas seulement un prénom et une nationalité, mais aussi une méfiance particulière et clairvoyante à l'égard de la technologie, ou du moins de son pouvoir de manipulation et de déshumanisation.


Dans le conte d'Hoffmann, écrit en 1815, le jeune Nathanaël est obsédé par la figure d'un homme mystérieux, Coppelius, qu'il assimile iconographiquement dès l'enfance au Marchand de sable, sorte de croquemitaine du folklore qui jette du sable dans les yeux des enfants, les arrache et les emporte dans sa hutte du "croissant de lune" pour les donner à manger à ses "petits becs".
Coppelius est introduit dans l'histoire comme un vieil ami avocat du père de Nathanaël, mais il s'avère être une sorte de savant alchimiste fou, complice d'un fabricant d'automates italien, Lazzaro Spalanzani, qui se fait passer pour un inoffensif professeur de physique. Nathanaël rencontre la fille de ce dernier, Olympia, en réalité un automate construit par Spalanzani avec l'aide de Coppelius, et en tombe éperdument amoureux, ce qui le plonge dans un tourbillon de folie. Après un bref intermède de sérénité, sous les soins affectueux de sa fiancée Clara et de son ami Lothar, qui représentent le foyer domestique et l'affection sincère non contaminée par l'Unheimlichkeit représentée par la "diablerie" de la technologie incarnée par Coppelius et Spalanzani, Nathanael semble avoir brièvement retrouvé la raison, pour sombrer à nouveau dans ses anciennes obsessions - réveillées par une lorgnette fabriquée par Coppelius - qui le conduiront au suicide.
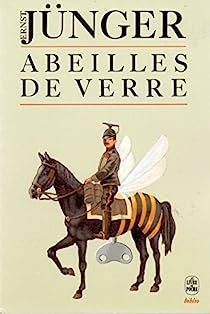 La même approche de la science et de la technologie considérées comme "dérangeantes" transparaît dans le court roman d'Ernst Jünger, Abeilles de verre, paru en 1957. Des abeilles de verre, c'est-à-dire de minuscules automates intelligents, peuplent les jardins de l'industriel Zapparoni (un autre Italien) où le protagoniste Richard - un vétéran de guerre issu d'un monde simple aux traditions axées sur l'honneur et aux valeurs perdues - s'est retrouvé à la recherche d'un emploi. Dans les jardins de Zapparoni, enrichis par la conception et la construction de machines technologiquement avancées, telles celles qui dominent aujourd'hui le monde, Richard observe la "symétrie effrayante", pour citer William Blake, des abeilles de verre et de leur physiologie hypertechnologique qui, loin d'améliorer ou de perfectionner la nature (imparfaite en soi, comme le souligne Jünger dans nombre de ses œuvres), nous rappelle que plus la technologie progresse, plus elle devient efficace, et que plus la technologie progresse, plus l'humanité involue et vice versa), elles l'appauvrissent, et finalement la dévastent - les fleurs touchées par les "abeilles de verre" sont en effet destinées à périr car elles sont privées de pollinisation croisée.
La même approche de la science et de la technologie considérées comme "dérangeantes" transparaît dans le court roman d'Ernst Jünger, Abeilles de verre, paru en 1957. Des abeilles de verre, c'est-à-dire de minuscules automates intelligents, peuplent les jardins de l'industriel Zapparoni (un autre Italien) où le protagoniste Richard - un vétéran de guerre issu d'un monde simple aux traditions axées sur l'honneur et aux valeurs perdues - s'est retrouvé à la recherche d'un emploi. Dans les jardins de Zapparoni, enrichis par la conception et la construction de machines technologiquement avancées, telles celles qui dominent aujourd'hui le monde, Richard observe la "symétrie effrayante", pour citer William Blake, des abeilles de verre et de leur physiologie hypertechnologique qui, loin d'améliorer ou de perfectionner la nature (imparfaite en soi, comme le souligne Jünger dans nombre de ses œuvres), nous rappelle que plus la technologie progresse, plus elle devient efficace, et que plus la technologie progresse, plus l'humanité involue et vice versa), elles l'appauvrissent, et finalement la dévastent - les fleurs touchées par les "abeilles de verre" sont en effet destinées à périr car elles sont privées de pollinisation croisée.
Bien que conçus à deux époques différentes, Olympia et les abeilles de verre représentent l'élément perturbateur d'un monde obsédé par la science, et dans une course folle vers un futur ultra-technologique où hommes et machines deviennent de plus en plus interchangeables au détriment des premiers. Où la poésie de l'idéal romantique et de l'amour sincère, comme celui de Nathanaël pour Clara, est gâchée par l'obsession suscitée par la froide et contre-naturelle Olympia, mécanisme parfait mais inhumain, à l'image des "automates de Neuchâtel" qui ont dû inspirer Hoffmann pour créer son personnage. Dans lequel les hommes et les animaux sont progressivement remplacés de manière dystopique par des machines et des automates, et où la naissance même, l'acte d'amour même qui conduit à la conception d'un être humain est remplacé par un alambic, une éprouvette, un mélange concocté en laboratoire, dans une sorte de "chaîne de montage" de la reproduction, de "fordisme" appliqué aux naissances comme dans le "meilleur des mondes" d'Aldous Huxley, "un excellent nouveau monde" dans lequel Olympia et les abeilles de verre seraient des citoyens d'honneur et des habitants privilégiés.

Une autre affinité particulière entre les deux œuvres est la récurrence de l'élément "yeux" et "verre". Dans le conte d'Hoffmann, on retrouve par exemple le leitmotiv des télescopes ("yeux" en verre comme ceux des abeilles) construits par Coppelius sous les traits de l'Italien Coppola. Des lorgnettes qui nous renvoient immédiatement à Galileo Galilei, représentant suprême de l'ambition scientifique de l'homme, ambition qui, dans le conte d'Hoffmann, est néanmoins faussée par les visées ambiguës de Coppelius, désireux de priver Nathanaël de ses yeux, d'en faire un automate aveugle à l'instar d'Olympia elle-même. Paradoxalement, au lieu de lui donner une vision amplifiée de la réalité, de le rendre plus "clairvoyant", le télescope que Nathanaël acquiert de Coppelius le plonge dans une folie primitiviste qui ne reconnaît ni l'affection, ni l'amour, ni l'amitié, ni même les connotations humaines, le conduisant finalement à l'autodestruction, ou au suicide.
Comme Richard lui-même, le protagoniste des Abeilles de verre, Nathanaël perd peu à peu son humanité et son attachement à ses traditions et à ses valeurs, submergé par la technologie maléfique de deux êtres voués à la création de marionnettes et de clowns destinés à amuser les foules, des monstres comme Olympia, ou comme les automates de Zapparoni qui en sont venus à remplacer les acteurs en chair et en os dans les films, tels que Jünger les décrit dans son roman.
Pour en revenir aux yeux, le protagoniste des Abeilles de verre comprendra peu à peu que, pour la tâche qu'il entend entreprendre, il a besoin d'yeux déshumanisés, aseptisés, (des yeux de verre ?) qui doivent voir sans regarder, sans discerner, afin de passer outre les atrocités perpétrées dans le jardin (et la société) d'horreurs technologiques de Zapparoni. Pour survivre dans le monde hyper-technologique et inhumain instauré par la perte des valeurs et de la tradition, Richard réalisera donc qu'il faut se laisser métaphoriquement crever les yeux par le marchand de sable représenté par l'ambition et l'arrogance de l'homme.

Avec les dérives de la technologie, avec le sacrifice de l'éthique sur l'autel d'Hybris, avec la course effrénée pour plier la nature à notre volonté, Hoffmann et Jünger semblent ainsi le prévoir, l'être humain devient un simulacre de lui-même, un automate (faussement) parfait, une "abeille de verre" sans âme, sans cœur, sans sexe. Transgenre et ultragender construits en série comme une marionnette, au point que - dans notre réalité la plus proche - les parents sont tellement dépersonnalisés qu'ils abdiquent même les noms de père et de mère pour devenir "parent 1" et "parent 2", des expressions qui plairaient non seulement à l'ambigu Zapparoni - qui doit son succès au déclin de l'éthique et de la tradition - mais aussi au perfide Coppelius, sorte de "tourment du chef de famille" kafkaïen, non moins inquiétant que la "bobine de fil" Odradek, figure du célèbre conte de l'écrivain pragois. Mais surtout au monstrueux marchand de sable qui, depuis son repaire du "croissant de lune", ne pouvait que se réjouir de notre ambition aveugle qui nous empêche de voir la réalité dystopique dans laquelle, hautains et arrogants, nous nous jetons à corps perdu à la poursuite des dérives de la technologie et du génie génétique.

L'Hybris démiurgique de la technique représenté par Coppelius et Zapparoni, c'est-à-dire l'aspiration à reproduire la puissance créatrice divine, englobe nécessairement l'anéantissement de soi et de l'humanité, c'est pourquoi le Nathanaël d'Hoffmann ne peut que se suicider et le Richard de Jünger trahir ses propres principes pour se soumettre au nouveau statu quo et au nouveau régime de dépersonnalisation de l'homme.
Privés des yeux de l'éthique, des valeurs et du respect sacré de la nature, aveuglés par notre arrogance, nous ne sommes que des enfants désemparés destinés à devenir pitance pour la progéniture des "hommes des sables" occultes ou les esclaves de "Zapparoni" rusés et impitoyables.
Plus d'informations sur www.ariannaeditrice.it
23:11 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : e.t.a. hoffmann, ernst jünger, marchande sable, abeilles de verre, technologie, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Ernst Jünger, méditateur en uniforme et maître de la liberté
Ernst Jünger fut un maître inégalé de la contemplation, un mémorable exemple d'action, un théologien des temps nouveaux, un platonicien morose, un entomologiste compétent, un pédagogue de la liberté. Enfin, un amoureux de l'Italie, de la Dalmatie irrédente à la Sicile ensoleillée, de Naples à la plus aimée de toutes, cette Sardaigne à la "terre rouge, amère, virile, tissée d'un tapis d'étoiles, de tout temps fleurie à chaque printemps, berceau primordial".
par Alessio Mulas
Ex : http://www.lintelletualedissidente.it
Nous sommes en 1895. Röntgen est sur le point de découvrir les rayons X; l'affaire Dreyfus éclate en France. Ernst Jünger aimait évoquer ces deux événements. Ils ont tacitement traversé sa vie et ses réflexions, qui ne sont rien d'autre que le miroir d'un siècle: ce vingtième siècle aussi rapide et puissant que l'éclair d'Héraclite, cet éclair qui "gouverne toutes choses", comme il était écrit au-dessus du seuil de la cabane de Heidegger dans la Forêt-Noire. La découverte de Röntgen a ouvert le siècle de la technologie, permettant à l'homme de "voir l'invisible", d'observer ce qui était encore interdit par le microscope, de développer la recherche sur l'atome et la fission nucléaire. Cinquante ans séparent la découverte aussi fortuite qu'heureuse de 1895 du lancement de Little Boy, doux artifice américain, dont Hiroshima se souvient comme d'un feu céleste: moins modeste que le lumineux bagherino giottesque de saint François, plus furieux que le char enflammé du Livre des Rois, peint par Roerich dans de chaudes nuances de rouge. La bombe atomique n'a rien laissé derrière elle, pas plus que le manteau tombé sur Elie lors de l'ascension. Ceux qui ont vécu le 20ème siècle craignent plus l'homme que Dieu, dont les destructions racontées dans l'Ancien Testament semblent des grâces comparées aux massacres des deux guerres mondiales. L'affaire Dreyfus, en revanche, a inauguré la meilleure arme des démocraties occidentales: l'opinion publique, lame munie de la critique la plus acérée, a augmenté le degré d'incertitude politique, profitant d'une victoire sur les forces conservatrices "moustachues et poussiéreuses". Le siècle dernier a été aussi changeant que l'eau, aussi terrible que la foudre.
Ernst Jünger est né ainsi : avec une invitation à réfléchir sur la technologie et la politique, mais sans tomber dans la spirale de la simple contemplation. Le temps de l'homme est limité, l'éducation coûteuse. Il a combiné la contemplation et l'action, mais il l'a fait d'une manière plus harmonieuse et plus constante que le Japonais Mishima, autre équilibriste à mi-chemin entre la lumière nocturne de la pensée et la lumière diurne de l'action sans but. La beauté, nous rappelle-t-on, est un coucher de soleil : le moment où les forces lunaires et solaires divisent le champ, et où la contemplation et l'action ne font plus qu'un, dans l'ascension d'un pilote vers l'étoile la plus proche, sur une lame tranchante des cieux. Dans Soleil et acier, Mishima enseigne que "le corps et l'esprit ne se confondent jamais".
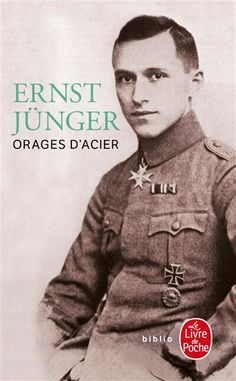
Jünger s'est battu contre de l'acier, celui de l'artillerie britannique et française, sur le front occidental. Et, comme le dit un adage militaire moqueur, le petit-déjeuner ne suffit pas à garder le corps et l'esprit unis: il faut plus que cela. Dès 1913, dès qu'il est majeur et qu'il s'échappe de l'environnement bourgeois de la maison familiale, il s'engage dans la Légion étrangère, un repaire d'aventuriers et de délinquants plutôt que de soldats disciplinés. L'expérience algérienne à Sidi-bel-Abbès, qu'il qualifie d'"événement bizarre comme un fantasme", est publiée sous la forme d'une confession fictive en 1936, sous le titre Afrikanische Spiele (Jeux africains). Mais Jünger est alors déjà connu pour ses exploits lors de la Première Guerre mondiale. Rapatrié d'Afrique grâce à l'intervention de son père Ernst Georg Jünger, un pharmacien plus familier avec la verrerie des laboratoires qu'avec les balles, il a volontiers accepté l'invitation de l'année 1914 et s'est engagé comme volontaire dans l'armée de l'empereur Guillaume II. Il vient de découvrir sur le papier ce qu'il s'apprête à voir sur le front. Les lectures de Friedrich Nietzsche l'ont jeté dans les bras de la guerre comme un veau qui, conduit à l'abattoir, se sent dans un palais royal. Mais la viande de Jünger n'était pas aussi tendre que celle d'un veau, et il survécut avec une extrême bravoure à pas moins de quatorze blessures, dont la dernière très grave, passant du statut de simple fantassin à celui de Strosstruppfüher (chef de commando d'assaut), à l'honneur de porter deux Croix de Fer sur la poitrine, une Croix de Chevalier de l'Ordre de Hohenzollern et une croix de l'Ordre Pour le Mérite, reconnaissance d'une volonté aussi dure que le fer de la médaille, privilège que seuls douze officiers subalternes de l'armée impériale avaient pu obtenir.
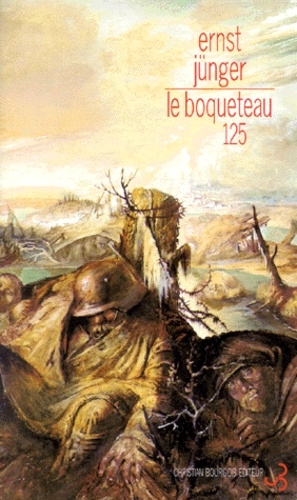
Dans une caserne de la Reichswehr (ancêtre de la Wehrmacht), entre 1918 et 1923, il écrit ses premiers livres, dont un titre incontournable pour ceux qui ont subi (et subissent) la fascination de la Grande Guerre : In Stahlgewittern (Orages d'acier), fruit du remaniement de notes de tranchées sous forme de mémoires de guerre, publié en 1920. Le destin de l'œuvre est différent de celui d'autres récits de guerre. Il ne s'agit pas du Feu de Barbusse, paru en plein conflit, mais pas non plus du célèbre A l'Ouest rien de nouveau de Remarque. Si le succès de ce dernier fut rapide et universel, In Stahlgewittern - publié assez tard en traduction italienne (1961) - circula dans les milieux de droite, parmi les cercles militaires, les associations d'anciens combattants, les groupes nationalistes et conservateurs, qui n'en comprirent que partiellement l'esprit. L'expérience de la guerre - décrite plus tard dans d'autres mémoires comme Le combat comme expérience intérieure (récemment publié par Piano B), Lieutenant Sturm, Le boqueteau 125, Feu et sang - avait non seulement capturé la jeunesse "comme une ivresse" et émancipé les nouvelles générations d'Allemands du "moindre doute que la guerre nous offrirait la grandeur, la force, la dignité", mais avait la saveur d'une "initiation qui non seulement ouvrait les chambres ardentes de la terreur, mais les traversait". Les explosions incessantes des shrapnels, anges du ciel qui, plus que de nouvelles billes de plomb, déchirent les chairs, ne sont qu'un des aspects les plus terribles de cette guerre technique et matérielle. Ce n'est pas la France peinte par les impressionnistes, la France des taches et des coups de pinceau juxtaposés, mais c'est le pays de la mutilation, des corps ensanglantés recouverts de neige fondue, d'un ciel de balles. C'est la guerre des tranchées. C'est le soldat "chantant sans souci sous une voûte ininterrompue de shrapnels", comme l'imaginait Marinetti avec une excitation futuriste. Et le jeune Jünger saisit tout cela avec un nihilisme esthétisant, cristallisé dans une prose magistrale. Le soldat et l'artiste célèbrent ici leur parenté intime, puisque la guerre est un art et vice versa.
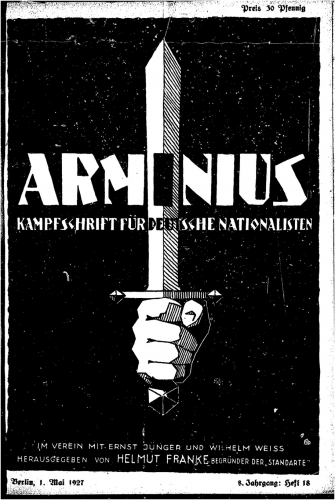
Les mots concernant Aschenbach, le protagoniste de Mort à Venise de Thomas Mann, s'appliquent : "Lui aussi avait été un soldat et un homme de guerre comme certains de ses pairs ; car l'art est une guerre, c'est une bataille épuisante". Dans Stahlgewittern, on trouve une splendide glose de Novalis, esprit européen et chrétien, dans son exaltation du dynamisme poétique de la guerre. La notoriété que lui apporte le livre permet à Jünger de participer activement à des mouvements nationalistes et antidémocratiques et de collaborer à des journaux tels que Arminius, Der Vormarsch et Widerstand, une revue politique de son ami national bolchevique Ernst Niekisch. C'est au début de la période d'après-guerre qu'il a commencé à produire des ouvrages non romanesques, La mobilisation totale, Sur la douleur, Le Travailleur. Hans Blumenberg n'a pas tort lorsqu'il affirme que Jünger est le seul auteur allemand à nous avoir laissé la trace d'une confrontation longue de plusieurs décennies avec le nihilisme.
L'inévitabilité de cette confrontation et le défi qu'elle représente sont très présents dans son œuvre. Il a cherché le néant, l'anéantissement du vieux monde des bourgeois, des savants et des porteurs de perruques; il l'a poursuivi, inlassablement, dans le désert (Jeux africains), dans le mépris de la vie face à la guerre (Orages d'acier), dans l'ivresse (Approches. Drogues et ivresse), dans la douleur (Sur la douleur), "l'équivalent métaphysique du monde éclairé-hygiénique du bien-être" (Blumenberg, Der Mann vom Mond. Über Ernst Jünger). L'anéantissement de l'homme passe par son élévation, par la planification totale de la société "mobilisée" dans le travail et l'étude, par la réduction finale de la personne à la monade techno-biologique envisagée dans la métaphysique du Travailleur, livre fondamental dans les étapes de l'évolution intellectuelle du penseur allemand, texte étudié par deux grands philosophes comme Martin Heidegger, qui organisa des séminaires privés sur le sujet dans les années 1930, et Julius Evola, qui en fit un commentaire (Le Travailleur dans la pensée d'Ernst Jünger).
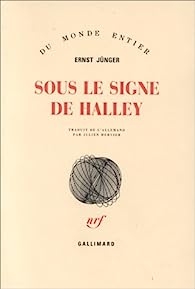 Mais il y a un événement au milieu du nôtre, aussi lumineux que cette comète de Halley que Jünger a contemplée à deux reprises (Sous le signe de Halley). Alors que l'état total de l'œuvre qu'il envisageait se réalisait, voici un "tournant imprévu, qui doit être compté parmi les événements les plus importants de l'histoire spirituelle allemande" (Blumenberg à nouveau) : Sur les falaises de marbre, le diamant précieux parmi les petites lames scintillantes de l'asphalte. Il est indispensable de s'y attarder. L'arrière-plan biographique du livre rend le tournant plus clair. Comme l'a dit Goebbels, ministre de la Propagande du Troisième Reich, "nous avons offert à Jünger des ponts d'or, mais il n'a pas voulu les franchir". L'intolérance de l'écrivain à l'égard des manières d'agir et de la vulgarité du parti national-socialiste lui vaut l'antipathie des hiérarques: la presse ne parle plus de ses livres et la Gestapo perquisitionne chez lui. Dans ce roman décisif pour sa vie, il décrit un pays - la Marina, où tous les éléments sociaux et politiques sont en harmonie - menacé par un peuple dangereux massé aux frontières, un peuple barbare, porteur de violence et de destruction, au style terrible et plébéien, dirigé par les Forestiers (une figure que beaucoup identifient à Hitler, d'autres à Staline).
Mais il y a un événement au milieu du nôtre, aussi lumineux que cette comète de Halley que Jünger a contemplée à deux reprises (Sous le signe de Halley). Alors que l'état total de l'œuvre qu'il envisageait se réalisait, voici un "tournant imprévu, qui doit être compté parmi les événements les plus importants de l'histoire spirituelle allemande" (Blumenberg à nouveau) : Sur les falaises de marbre, le diamant précieux parmi les petites lames scintillantes de l'asphalte. Il est indispensable de s'y attarder. L'arrière-plan biographique du livre rend le tournant plus clair. Comme l'a dit Goebbels, ministre de la Propagande du Troisième Reich, "nous avons offert à Jünger des ponts d'or, mais il n'a pas voulu les franchir". L'intolérance de l'écrivain à l'égard des manières d'agir et de la vulgarité du parti national-socialiste lui vaut l'antipathie des hiérarques: la presse ne parle plus de ses livres et la Gestapo perquisitionne chez lui. Dans ce roman décisif pour sa vie, il décrit un pays - la Marina, où tous les éléments sociaux et politiques sont en harmonie - menacé par un peuple dangereux massé aux frontières, un peuple barbare, porteur de violence et de destruction, au style terrible et plébéien, dirigé par les Forestiers (une figure que beaucoup identifient à Hitler, d'autres à Staline).
Le marginal de la forêt s'oppose à la civilisation, l'anarchie nihiliste aux forces de la Tradition. Les deux protagonistes, deux frères (allusion à l'auteur lui-même et à son frère Friedrich Georg), sont soutenus par quatre personnages: le père Lampros, derrière lequel on peut entrevoir l'Église, ou du moins la force spirituelle de la religion; Belovar, un brave vieux barbu représentant l'ancien monde rural; de noble lignée, d'autre part, le prince Sunmyra, dont la tête coupée après un exploit héroïque est récupérée par le protagoniste et devient l'objet de rituels; enfin, Braquemart, compagnon belliqueux du prince et effigie de l'intellectuel nihiliste noble, qui interprète la vie comme un mécanisme dont les rouages sont la violence et la terreur, un homme à "l'intelligence froide, déracinée et encline à l'utopie".

Les familiers de la littérature jüngerienne se souviennent des mots qui ouvrent Sur les falaises de marbre: "Vous connaissez tous la tristesse sauvage que suscite le souvenir d'un temps heureux: il est irrémédiablement passé, et nous sommes plus impitoyablement divisés par lui que par l'éloignement des lieux". La recherche de la belle mort dans la guerre laisse place à "la vie dans nos petites communautés, dans un foyer où règne la paix, au milieu de bonnes conversations, accueillies par un salut affectueux le matin et le soir". Ceux qui vivent l'existence comme une poésie n'ont d'autre choix que de chercher asile dans les manoirs de leur propre intériorité, en faisant confiance à la résistance du noble contre le néant, à la sublimation de tout dans le feu cathartique du miroir nigromontanien.
C'est Hitler qui a sauvé Jünger d'une mort certaine. Il a apprécié la plume qui a saisi la guerre qu'il avait faite, lui aussi. Il l'a aussi sauvé après le 20 juillet 1944, date de la fameuse tentative d'assassinat du Führer. S'il est vrai qu'aucune preuve n'a été trouvée d'une collaboration entre les poseurs de bombe et Jünger (qui était responsable du bureau de la censure à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale en tant qu'officier de l'état-major général), il est tout aussi vrai que les soupçons qui pesaient sur lui étaient plus que suffisants pour qu'il soit expulsé de l'armée pour Wehrunwürdigkeit (indignité militaire). Le temps du héros de guerre est définitivement révolu, celui du contemplateur solitaire commence.
Soumis à la censure pendant l'occupation alliée, sort qu'il partage avec ses amis Martin Heidegger et Carl Schmitt (qui fut, entre autres, le parrain du second fils d'Ernst, Alexander Jünger), il se retire dans le village de Wilflingen, d'abord dans le château des Stauffenberg (la famille de Claus Schenk von Stauffenberg, organisateur de l'attentat manqué contre Hitler), puis dans la maison du conservateur des eaux et forêts de la famille, bâtiment qui sera sa demeure jusqu'à sa mort. L'œuvre de ce grand écrivain allemand est vaste. Il fut le mémorialiste du 20ème siècle, l'interprète de son esprit. La constance avec laquelle il consignait faits et réflexions dans ses journaux est bien connue. Même dans son écriture, Ernst Jünger a fait preuve de courage : le journal est plus que toute autre forme stylistique par laquelle un penseur ou un écrivain se montre dans sa faiblesse intérieure d'homme, se soumettant à une dilapidation de la crédibilité ; le renoncement extrême à la plasticité de l'artiste en échange de l'authenticité de l'origine de sa pensée.


Les journaux intimes complètent les autres écrits, montrant que Jünger n'offrait pas des produits finis, mais indiquait des chemins. Il l'a fait dans toute la littérature qui a suivi Sur les falaises de marbre, d'Héliopolis à Eumeswil, du Traité du sablier au Mur du temps, du Nœud gordien (dialogue à deux voix avec Carl Schmitt) à Passage de la ligne (avec Martin Heidegger). C'est précisément dans ce dernier texte, composé de deux écrits qui rendent hommage au soixantième anniversaire de leur interlocuteur respectif, qu'a lieu l'affrontement sur le thème du nihilisme entre deux dioscures symboliques du crépuscule, vivants en une époque donnée, un duel où chacun, ça va sans dire, se complaît dans la maîtrise de l'autre. S'interroger sur le nihilisme, c'est, après la Seconde Guerre mondiale, chercher une réponse à la question : quelle poésie après Auschwitz?
Nous ne sommes pas d'accord avec l'évaluation qu'Evola fait du second Jünger. Ce n'était pas un "normalisé et rééduqué", comme le philosophe romain l'a marmonné lors d'une conversation avec Gianfranco de Turris, mais un penseur capable de réflexions profondes, d'analyses et de prédictions qui se sont révélées aussi justes que dérangeantes. Il est l'un des rares à avoir réussi à dévoiler, avec une tranquillité tourmentée, le vernis idéologique qui recouvre la réalité. Ici, les idéologies. Il ne les aimait pas, car "une erreur ne devient une faute que lorsqu'on persiste" (Sur les falaises de marbre) ; il rejetait tous les ismes, mais il revendiquait le droit de vivre la vie comme une expérience, et non comme un processus soumis à une logique contraignante. "Le suffixe isme a un sens restrictif : il valorise la volonté au détriment de la substance" (Eumeswil). Son écriture est "l'expression de ce qui est problématique, de l'ici et de l'ailleurs, du oui et du non", comme l'exprime Thomas Mann dans Considérations d'un apolitique. Ernst Jünger fut un maître inégalé de la contemplation, un mémorable exemple d'action, un théologien des temps nouveaux, un platonicien morose, un entomologiste compétent, un pédagogue de la liberté. Enfin, un amoureux de l'Italie, de la Dalmatie irrédente à la Sicile ensoleillée, de celle de Naples à la plus aimée de toutes, cette Sardaigne à la "terre rouge, âpre, virile, tissée d'un tapis d'étoiles, de tout temps fleurie à chaque printemps, berceau primordial". "Les îles, enseigne-t-il, sont des patries au sens le plus profond du terme, les derniers lieux terrestres avant l'envol vers le cosmos. Ce n'est pas le langage qui leur convient, mais plutôt le chant du destin qui se répercute sur la mer. Alors le marin laisse tomber la main de la barre ; on atterrit volontiers au hasard sur ces rivages" (Terra sarda). Et son œuvre fut un îlot de lumière loin de la bagarre littéraire du 20ème siècle, une oasis pour les esprits assoiffés de liberté.
22:50 Publié dans Littérature, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, lettres, lettres allemandes, littérature allemande, révolution conservatrice |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Les hauteurs de l'infinie bonne humeur
Regina Bärthel
Source: https://jungefreiheit.de/kultur/2023/kunderas-gute-laune/
Dans ses romans, Milan Kundera a raconté la vie sous le socialisme, où les désirs et les espoirs sont toujours contrariés par les hasards et les caprices inattendus de l'appareil du parti. L'écrivain est aujourd'hui décédé à Paris à l'âge de 94 ans. Une nécrologie.
"Milan Kundera est né en Tchécoslovaquie. Il vivait en France depuis 1975". Derrière cette maigre biographie, la seule que Milan Kundera avait autorisée pour la publication de ses livres, se cache la vie d'un intellectuel d'Europe centrale : une vie entre oppression politique et révolte, entre identité et histoire. Et il est toujours question d'amour ; l'amour comme motivation de vie, comme fuite, comme vengeance, comme trahison.
Milan Kundera, né en 1929 dans une famille de la bourgeoisie cultivée de Brno, en Moravie, a adhéré au parti communiste peu après la fin de la guerre. Les premiers conflits surviennent rapidement, y compris une exclusion temporaire du parti, car il se montre critique envers la doctrine du réalisme socialiste et se prononce en faveur des valeurs nationales et du patriotisme.

Le Printemps de Prague a marqué les romans de Kundera
Dans les années 1960, l'auteur fait partie des intellectuels qui prônent un "socialisme à visage humain" et soutiennent le processus de libéralisation et de démocratisation. Son premier roman, "La plaisanterie", publié à Prague en 1967, est déjà une critique sarcastique d'un régime totalitaire qui non seulement intervient massivement dans les affaires privées de ses citoyens, mais détruit aussi leur existence pour toute insubordination même mineure.
Suite à la répression violente du Printemps de Prague - et donc à la fin de toute liberté de la presse et de la culture en Tchécoslovaquie - Kundera a perdu son poste de professeur à l'Académie des arts de Prague et ses livres ont été retirés du domaine public.
Livré aux caprices du socialisme
De même, ses romans "La vie est ailleurs" et "La Valse aux adieux", qui traitent des relations entre l'avant-garde artistique et la politique révolutionnaire ainsi que de l'arbitraire politique du système communiste, ne furent publiés qu'en France. Kundera y vivait avec son épouse Věra Hrabánková depuis 1975, mais la surveillance de l'auteur par les services secrets tchécoslovaques n'a pris fin que dix ans plus tard.
C'est le roman "L'insoutenable légèreté de l'être", publié en 1984, qui a fait la renommée internationale de Kundera : dans un mélange éclatant d'amour, d'érotisme et de trahison, il raconte l'histoire de Teresa, une serveuse tolérante, et de Tomáš, un chirurgien en mal d'amour qui, à l'époque du Printemps de Prague et de sa fin violente, perd son poste de chirurgien à cause d'une déclaration politique et devient laveur de vitres pour ses nombreuses relations amoureuses. Quelles sont les possibilités de choix qui s'offrent à l'homme face à une politique restrictive ? Réussit-on à s'échapper dans la légèreté de l'existence ou la trouve-t-on insupportable ?

La finesse psychologique rencontre l'acuité politique
Milan Kundera s'est intéressé aux conditions politiques et psychologiques qui font des hommes des traîtres à leurs valeurs, à leur amour et, en fin de compte, à eux-mêmes. Il a également été accusé de trahison réelle : il aurait dénoncé un agent anticommuniste en 1950, selon l'historien Adam Hradilek en 2008, une accusation reprise avec zèle par de nombreux médias, que Kundera a niée avec véhémence et qui est aujourd'hui considérée comme réfutée.
Le monde n'évolue pas selon une logique interne, un plan. Kundera l'a clairement démontré dans ses romans. Les projets de vie, les souhaits et les espoirs sont toujours contrariés par des coïncidences, des rebondissements inattendus et - bien sûr - par l'amour. Et pourtant, les personnages littéraires de Kundera sont toujours confrontés à de nouveaux choix, doivent faire une chose et en laisser une autre. Sans même pouvoir prévoir à quelles nouvelles circonstances, à quelles nouvelles décisions le cours futur du monde les conduira.
Pas de retour au pays
Lorsque le bloc de l'Est s'est effondré de manière plus ou moins inattendue, Kundera n'a pas décidé de retourner à Prague, contrairement à de nombreux exilés. Comme Irina, le personnage principal de son roman "Ignorance" paru en 2000, il n'attendait pas avec impatience de renouer avec la vie dans son ancien pays.
Sa vie quotidienne, il l'avait déjà réalisée en France. D'ailleurs, ce n'est qu'en 2019 que l'État tchèque a rendu au célèbre auteur sa nationalité, qui lui avait été retirée 40 ans plus tôt. Kundera l'a acceptée, mais au lieu de se rendre à Prague pour cela, il s'est fait remettre le document à son domicile parisien.
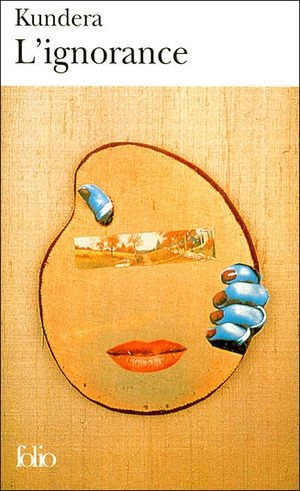
"L'insignifiance est l'essence même de l'existence".
A-t-il été désillusionné dans sa vieillesse ? Kundera s'était longtemps battu pour un "socialisme à visage humain" et avait perdu son ancienne existence, son ancienne patrie. Par la suite, il n'a cessé de thématiser cet objectif comme une illusion avec laquelle il s'était lui-même trompé.
Dans son dernier livre intitulé "La fête de l'insignifiance" (paru en 2014), il fait réfléchir quatre vieux messieurs sur la vie et tout le reste : "L'insignifiance est l'essence même de l'existence", dit-il, même dans les combats sanglants et les pires malheurs. Kundera y répond à un éventuel besoin de régler ses comptes avec humour et sagesse : "Ce n'est que depuis les hauteurs de l'infinie bonne humeur que tu peux observer sous toi l'éternelle stupidité des hommes et en rire".
Kundera a opté pour une légèreté de l'être
Dans ses écrits, Kundera s'est penché sur le conflit entre les désirs et les espoirs de l'individu et les systèmes politiques qui se sont engagés - souvent de manière totalitaire - à combattre toute individualité. Il s'agit également d'une réflexion sur la manière dont l'activisme politique - qu'il s'agisse d'intellectuels, d'artistes ou de citoyens - peut soudainement les exposer à la répression des systèmes qu'ils ont soutenus ou même aidés à prendre le pouvoir.
Kundera a plaidé pour une légèreté de l'être, même si elle est insupportable. Car "les extrêmes marquent des limites au-delà desquelles la vie s'achève, et la passion pour les extrêmes, dans l'art comme en politique, est un désir de mort voilé". Mardi 11 juillet, Milan Kundera s'est éteint à Paris à l'âge de 94 ans.
21:47 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, littérature, lettres, lettres tchèques, tchèquie, littérature tchèque, milan kundera |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Adieu à Milan Kundera, l'insoutenable légèreté d'être libre
La leçon que nous laisse l'écrivain tchèque : "Je vis dans la terreur d'un monde qui a perdu le sens de l'humour"
par Spartaco Pupo
Source: https://www.barbadillo.it/110334-addio-a-milan-kundera-linsostenibile-leggerezza-di-essere-liberi/
Milan Kundera, décédé hier à l'âge de 94 ans, était l'écrivain tchèque le plus célèbre de la seconde moitié du 20ème siècle. La lecture de ses derniers romans, de plus en plus abstraits et éloignés de ceux qui l'ont rendu célèbre, était devenue fatigante. Ses vieux chevaux de bataille étaient donc complètement démodés.
Sa complaisance pour "l'esprit de complexité" s'accommode mal de la "simplification" de notre époque. Son intelligence hétérodoxe est désormais incompatible avec la quête spasmodique de pureté morale. Ses explorations parfois déviantes de la sexualité féminine ne pouvaient être tolérées à l'ère de #MeToo. Pourtant, c'est précisément le sexe qui a été le principal héritage de la période communiste de la production de Kundera, lorsqu'il a été élevé par lui à l'un des rares moyens par lesquels les individus pouvaient affirmer leur liberté face à l'État répressif. Son attachement à la forme a atteint un tel degré d'obsession qu'il a un jour renvoyé un éditeur pour avoir remplacé ses deux points par un point. Il a toujours interdit, depuis lors, aux éditions Kindle de publier ses livres. Bref, il était désormais trop démodé.
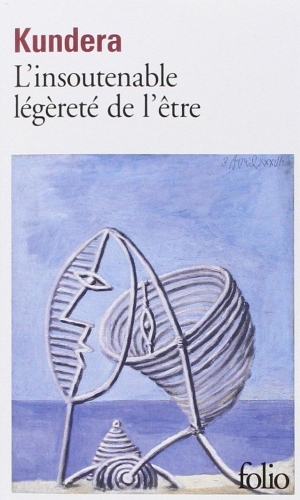
Personne n'a jamais réussi à lui coller une étiquette. À ceux qui l'interviewaient pour lui demander s'il était de gauche, il répondait : "Je suis romancier". De droite donc ? "Je suis un romancier". Pourtant, presque tous ses romans sont un mélange de politique, de psychologie, d'histoire, de philosophie et de sexe, avec un fil conducteur : l'anticommunisme. À l'âge de 40 ans, il avait déjà vécu l'occupation nazie de son pays, la capitulation devant le stalinisme qui s'en est suivie, les libéralisations du Printemps de Prague et la répression soviétique qui leur succéda.

Dans "La plaisanterie" (1967), Kundera raconte l'histoire d'un jeune communiste exclu du parti pour une plaisanterie malencontreuse. Il avait été exclu du parti en 1950 pour ses idées "non-conformistes" et son "activité anticommuniste". "La vie est ailleurs" (1973) traite de l'évolution du personnage d'un jeune poète obsédé par sa mère et de son passage ultérieur à la politique étudiante de gauche. Dans la nouvelle incluse dans "Le livre du rire et de l'oubli" (1979), il imagine un groupe de "fidèles" communistes dansant en cercle et lévitant joyeusement sur les toits de Prague. "L'insoutenable légèreté de l'être" (1984), ouvrage très largement connu, se déroule dans un climat d'aversion à l'égard de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie en 1968.
Le début de la période communiste à Prague, outre son atmosphère de psychose utopique étourdissante, a été marqué par des horreurs, souvent surréalistes. Il y a eu la défenestration fatale de Jan Masaryk, fils de l'ancien président, qui s'est d'abord plié au nouveau régime puis a réalisé trop tard sa monstrueuse erreur. En 1952, au cours de procès et de purges grotesques, les esprits les plus brillants du communisme ont été exécutés et incinérés. Mais les danseurs de Kundera poursuivent leur joyeuse cadence, se pavanant avec une double ferveur. Ils étaient du bon côté de l'histoire et leurs cœurs étaient purs. Il les appelait "anges" et enviait leurs mouvements de dernière minute.

Kundera savait que le fondamentalisme communiste était incompatible avec l'humour, qui était une réalité alternative faite de ses propres règles, qui banalisait le sérieux des idéologues et se moquait d'eux jusqu'à l'"évaporation". L'humour est un système philosophique qui "éclaire tout" et ceux qui le pratiquent doivent donc être anéantis. Dans une interview accordée en 1980 à Philip Roth, il a déclaré qu'il pouvait reconnaître un "antistalinien" à la façon dont il souriait : "Le sens de l'humour était un signe de reconnaissance fiable. Depuis, je vis dans la terreur d'un monde qui a perdu le sens de l'humour".
Dans les mains d'un autre écrivain, plus conventionnel, la recette aurait pu s'avérer indigeste, mais avec Kundera, la légèreté prévalait en tout, même dans les tragédies de la politique.
21:09 Publié dans Hommages, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : milan kundera, tchèquie, hommage, littérature, lettres, lettres tchèques, littérature tchèque |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Burgess, une dystopie dépopulationniste
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2023/06/09/burgess-som-depopulationistisk-dystopiker/
Anthony Burgess (1917-1993) est surtout connu aujourd'hui comme l'auteur d'Orange mécanique. On sait moins qu'il était politiquement proche de la même école de pensée "anarcho-monarchiste" que Tolkien et qu'il a collaboré avec le GRECE, le Groupement de Recherche et d'Études pour la Civilisation Européenne de la Nouvelle Droite. Burgess s'intéressait également à l'histoire, passée et future, et écrivait des dystopies. A Clockwork Orange en est un exemple ; une autre, moins connue mais non moins d'actualité, est The Wanting Seed (= La folle semence, 1962).
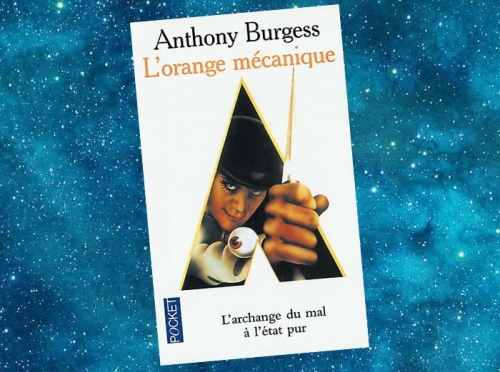
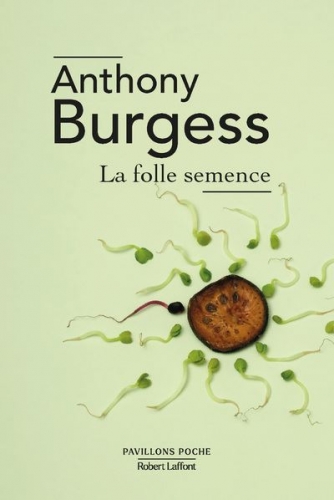
The Wanting Seed se déroule dans un futur malthusien, où la lutte contre la surpopulation domine à la fois la théorie et la pratique. Le mariage et la natalité sont découragés ; il existe un ministère de l'infertilité et une police de la population. Les lois formelles sont tout aussi importantes que les lois informelles, lesquelles se présentent sous la forme d'une culture et d'une idéologie. On nous dit que "vous avez le droit de vous marier si vous le souhaitez, vous avez le droit à une naissance dans la famille, même si, bien sûr, les meilleures personnes ne le font pas". Les classes respectables n'ont pas d'enfants ; en termes de carrière, les personnes sans enfants, homosexuelles et castrées sont favorisées. Les policiers, les "greyboys", semblent être recrutés parmi ces derniers, y compris les "greyboys brutaux aux lèvres fardées". Il convient de noter que Burgess ne semble pas être homophobe au sens propre du terme; il décrit une logique politique et idéologique. Entre autres choses, cette logique recoupe en partie ce que le polémiste américain conservateur Steve Sailer appelle "la fuite du blanc", qui explique en partie l'augmentation rapide du nombre de personnes LGBT parmi les jeunes Américains blancs: "être homo, voyez-vous, efface tous les autres péchés, les péchés des pères, par exemple, voyez-vous".
L'histoire se déroule dans une future Union anglophone, Enspun, comprenant un empire russophone appelé Ruspun. Contrairement à Orwell, il n'y a pas de guerre entre eux, la lutte est à la fois réelle et symbolique mais focalisée seulement contre la surpopulation. Enspun est multiethnique; la future Angleterre est peuplée de personnes originaires de différentes parties du monde ("Eurasiens, Euro-Africains, Euro-Polynésiens"). Il n'y a pas non plus de conflits entre eux. Cependant, Burgess introduit discrètement dans l'intrigue des souvenirs de sang racial, à la fois gastronomiques et plus concrets. Les personnages principaux sont d'origine anglo-saxonne, le professeur d'histoire Tristram Foxe et sa femme Beatrice-Joanna. Alors que leur relation se dégrade suite à l'infidélité de Béatrice avec le frère de Tristram, de profonds changements sociaux sont en cours. Ces changements sont conformes à la théorie cyclique de l'histoire que professe Tristram.
Tristram utilise les concepts de pelfase, d'interphase et de gusphase, le premier et le dernier étant nommés d'après les théologiens Pélage et Augustin. Pendant la phase de pelfase, les dirigeants partent du principe que les gens sont relativement bons par nature. Les punitions sont légères et la société est socialiste. Mais avec le temps, l'élite perd confiance dans la bonté de la population, ce qui conduit à une répression accrue. "Les gouverneurs sont déçus lorsqu'ils découvrent que les hommes ne sont pas aussi bons qu'ils le pensaient. Enveloppés dans leur rêve de perfection, ils sont horrifiés lorsque le sceau est brisé et qu'ils voient les gens tels qu'ils sont réellement". Nous passons alors à l'interphase, qui rappelle davantage le 1984 d'Orwell. Elle aussi ne dure pas éternellement, les gouvernants se détournent de la répression ("les gouvernants sont choqués par leurs propres excès"). Ils assouplissent les règles et le chaos s'installe. Mais ils ont désormais une vision pessimiste de la nature humaine et ne répondent pas par la répression. Peu à peu, ils se rendent compte que les hommes sont encore très bons et la phase pélagienne reprend. Etcetera.
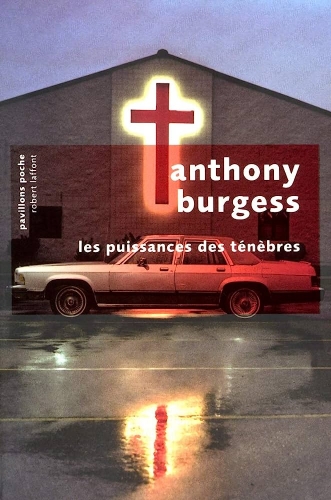
Le modèle cyclique de l'histoire selon Tristram n'est pas totalement inintéressant, même s'il peut être difficile d'identifier la phase de notre propre époque. Par exemple, nous avons la punition douce de la pelphase combinée au chaos de la gusphase. Une société véritablement multiethnique permet évidemment une vision pélagienne de certains groupes avec une répression interphase des autres, bref la fameuse anarcho-tyrannie. Néanmoins, le modèle historique de Burgess est une petite théorie originale de l'élite, où les réactions émotionnelles de l'élite aux résultats de ses propres politiques conduisent l'histoire. Il contient de nombreux passages percutants, tels que l'observation selon laquelle "les petits capitalistes sortaient de leur trou, rats au cours de la pelphase mais lions d'Augustin (dans la gusphase)".
Un thème intéressant de The Wanting Seed est le dépopulationnisme en tant qu'idéologie excessive ; il y a quelques similitudes avec notre époque. Tout aussi intéressant est l'accent mis par Burgess sur les mécanismes informels de la politique. Il s'agit notamment de la création d'une pression sociale et de l'influence de l'industrie culturelle. Il écrit que "pendant des générations, les gens se sont allongés sur le dos dans l'obscurité de leur chambre à coucher, les yeux rivés sur le carré bleu aquatique du plafond: des histoires mécaniques sur les bonnes personnes qui n'ont pas d'enfants et les mauvaises qui en ont, les homos qui s'aiment, les héros d'Origène qui se castrent eux-mêmes au nom de la stabilité mondiale". En même temps, cette influence semble moins efficace lorsqu'elle entre en conflit avec les instincts humains. Dès que la super-idéologie sexuellement négative est ébranlée dans ses fondements, les gens recommencent à avoir des relations sexuelles et à manger de la viande dans le roman.
Dans l'ensemble, il s'agit d'une dystopie originale, avec plusieurs thèmes intéressants. Certains passages sont passionnants et captivants, comme l'introduction où nous faisons connaissance avec les personnages principaux et le voyage de Tristram dans une Angleterre où la société est en crise et où le cannibalisme est une menace réelle. Mais le point faible est la longueur, l'histoire est trop longue et aurait pu être raccourcie. A bien des égards, il est plus actuel que Clockwork Orange, mais c'est en tant que dystopie plutôt que purement fictionnel qu'il est un petit bijou.
21:42 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthony burgess, lettres, lettres anglaises, dystopies, littérature, littérature anglaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Friedrich Georg Jünger et les mythes grecs: Apollon, Pan et Dionysos
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/friedrich-gerog-junger-e-i-miti-greci-apollo-pan-e-dioniso-giovanni-sessa/
Un texte vient de sortir en librairie qui non seulement nous permet de saisir la grandeur spéculative et littéraire d'une des figures "secrètes", apparemment marginales, de la culture du 20ème siècle, mais qui nous confronte aussi à la pauvreté de notre temps, au "désastre" de la modernité, à l'isolement atomistique de l'homme face au cosmos. Nous nous référons au volume de Friedrich Georg Jünger, frère d'Ernst, plus connu, Apollo, Pan, Dionisio, publié par les éditions Le Lettere et édité par Mario Bosincu, germaniste à l'Université de Sassari (pp. 283, euro 18.00). En 1943, un petit opuscule a été publié sous le même titre, que l'auteur a fait suivre d'un essai intitulé I Titani (= Les Titans) en 1944. En 1947, les deux livres, auxquels ont été ajoutés deux chapitres consacrés aux Héros et à Pindare, ont été rassemblés dans le volume Mythes grecs. L'édition italienne que nous présentons est une traduction de ce livre. On doit à Bosincu une rédaction impeccable.
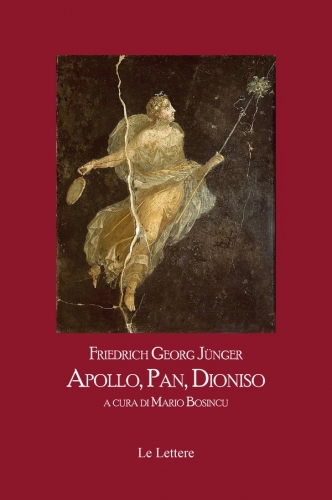
Ces pages représentent "l'un des trésors de ce continent submergé qu'est la littérature de l'émigration intérieure [...] dont les représentants sont restés dans l'Allemagne nazie, vivant comme des "exilés" dans leur patrie" (pp. 8-9). En effet, sous la République de Weimar, Friedrich Georg, avec son ouvrage Aufmarsch des Nationalismus, s'était fixé comme objectif de "faire de ses lecteurs [...] un nouveau sujet (de l'histoire) qui pourrait transformer la jeune république en une communitas totalitaire" (p. 110). Il participe ainsi au mouvement culturel hétérogène et vivant des intellectuels révolutionnaires-conservateurs, dont les idéaux ont été trahis par le national-socialisme au pouvoir. Dans l'essai introductif bien informé, vaste et organique, Bosincu présente les moments généalogiques de cette culture anti-moderne, une réponse à la crise induite par l'affirmation du Gestell, de l'implant techno-scientifique au service de la Forme-Capital. Il s'attarde notamment sur les figures de Schiller, Carlyle et Chateaubriand. Ce dernier, dans le Génie du Christianisme, en appelait, contre le présent historique dans lequel il était destiné à vivre, aux "intérêts du coeur" (p. 41).
Il fait appel, conformément à la sensibilité romane, à une connaissance autre que la raison calculatrice. Dans ses pages chargées d'émotion, se dessine : "après le sermo propheticus, le sermo mysticus et l'écriture ascétique [...] un style psychique alternatif à celui qui prévalait" (p. 41) à l'époque contemporaine, qui tendait à réaliser l'utile par la réduction de la nature à une res extensa à la disposition du maître de l'entité, l'homme. Les antimodernes, qui ont eu tant d'influence sur Friedrich Georg, n'ont pas cherché, sic et simpliciter, à explorer les traits d'une possible "autre subjectivité" que la moderne, mais ont visé à la réaliser en utilisant le trait démiurgique de leurs écrits.
Fondamentalement, explique Bosincu, en se référant à l'exégèse du gnosticisme par Eric Voegelin, ils étaient habités par une véritable horreur de l'existant et devenaient les porteurs d'un savoir sotériologique. Le gnostique : "connaît la matrice de la misère (temporaire) de l'homme [...] est en possession d'une sotériologie qui "donne à l'homme la conscience de sa déchéance et la certitude de la restauration de son être originel"" (p. 53). La fuite du moderne est centrée sur la "sotériologie de l'intériorité". Selon l'éditeur, Jünger a connu deux phases différentes de cette attitude néo-gnostique : dans sa jeunesse, il était proche du prométhéisme "wotaniste" du nazisme et de la "mobilisation totale".
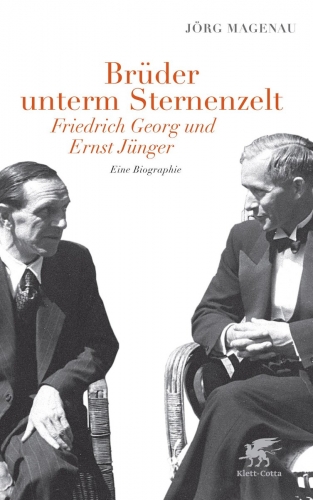
Cette référence visait à construire une subjectivité "active", animée par la volonté de puissance, destinée à dépasser l'individu bourgeois. Dans la phase d'"émigration intérieure", dont témoignent de façon paradigmatique Apollon, Pan, Dionysos, par l'influence du monde spirituel hellénique médiatisé par les lectures de Walter Friedrich Otto, et anticipant la psychologie des profondeurs de Hillman, Jünger devient le porteur de l'"homme total" schillérien, dans la psyché duquel la puissance titanesque revient se réconcilier avec les potestats des trois dieux en question. Cette métamorphose a amené notre homme à mûrir : "Le respect de la vie dans sa nature élémentaire", car il a pris conscience que : "le présupposé de la modernisation technologique est [...] la désanimation de la nature" (p. 99). La physis est vécue comme transcendant l'horizon humain : il y a un fossé évident entre le flux du devenir et de l'histoire, accumulateur de ruines, et les rythmes éternels et cycliques de la nature.
Le paganisme jüngerien est un "paganisme de l'esprit" qui s'adresse à une dimension inclusive profonde : "le noumène d'où jaillissent l'histoire et l'expérience empirique" (p. 111). L'auteur montre qu'il adhère à une perspective mythique : il croit que dans chaque entité, dans l'intériorité de l'homme et dans ses activités, un dieu agit. Le divin palpite, il s'expérimente. La technique elle-même n'est pas une simple expression de la raison instrumentale, mais a des racines mythiques, titanesques, prométhéennes.
Pour échapper à sa domination réifiante, l'homme doit retrouver la dimension imaginaire : ce n'est qu'en elle, et non dans les concepts qui statisent le réel, qu'il est possible de retrouver le souffle d'Apollon, de Pan et de Dionysos, l'éternelle métamorphose animique de la physis. Ces dieux sont dans une relation d'"antithèse fraternelle" (p. 244). Pour en retrouver le sens, il faut se pencher sur la coincidentia oppositorum, sur la logique du troisième inclus: "Apollon est exalté comme l'archétype à la base d'un style cognitif et existentiel qui privilégie la raison contemplative et le sens de la mesure" (p. 135), antithétique à l'hybris prométhéenne du nazisme et du capitalisme cognitif de nos jours. Pan incarne le "principe de plaisir" par opposition au "principe de performance", la légèreté de vivre que l'on peut éprouver en se plaçant dans la nature sauvage, perçue comme étrangère par l'homme moderne. La nature se suffit à elle-même, ce dont Karl Löwith était également conscient. Dionysos, enfin, est le dieu qui libère des fixités identitaires, de la dimension téléologique de la vie. Sa potestas met en échec la "folie enveloppée dans l'apparence de la raison" (p. 139).

Le Jünger de l'"émigration intérieure", à notre avis, est porteur d'un contre-mouvement gnostique non néognostique (Gian Franco Lami), capable de ramener l'homme à la physis, à la vie éternellement jaillissante du cosmos. Le cosmos, dans les pages d'Apollon, Pan, Dionysos, n'est pas amendable, comme le croyaient les gnostiques, et avec eux les chrétiens et leurs substituts modernes (positivistes, marxistes, etc.) car, comme l'affirme Héraclite (fr. 30) : "Il est identique pour toutes choses, aucun des dieux ou des hommes ne l'a fait, mais il a toujours été, il est et il sera un feu éternellement vivant, qui selon la mesure s'allume et selon la mesure s'éteint". Apollon, Pan, Dionysos montre, comme l'a affirmé Calasso, que les dieux anciens ont trouvé refuge dans la littérature. C'est l'extraordinaire modernité des anti-modernes, dont parlait Antoine Compagnon.
20:18 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Révolution conservatrice | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : friedrich-georg jünger, livre, dieux grecs, paganisme, lettres, lettres allemandes, littérature, littérature allemande, révolution conservatrice, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Colin Wilson et les "exclus" du monde moderne
Par Manlio Triggiani
Source: https://domus-europa.eu/2023/03/23/colin-wilson-e-gli-esclusi-del-mondo-moderno-di-manlio-triggiani/
La littérature de Colin Wilson (1931-2013) revient avec une trilogie publiée par Carbonio editore, appelée "Gerard Sorme Trilogy". Le premier volume, Ritual in the Dark (pp. 448, euro 18.00), illustre la vie de Gérard Sorme, un aspirant écrivain qui vit d'un petit revenu dans une chambre meublée de Soho. Par un concours de circonstances, il se met sur la piste d'un tueur en série qui rappelle un autre criminel, Jack l'Éventreur, personnage maintes fois représenté dans la littérature et le cinéma. L'Éventreur, dont l'identité n'a jamais été connue, a terrorisé le Londres victorien en tuant et en dépeçant cinq jeunes prostituées dans le quartier populaire de Whitechapel.
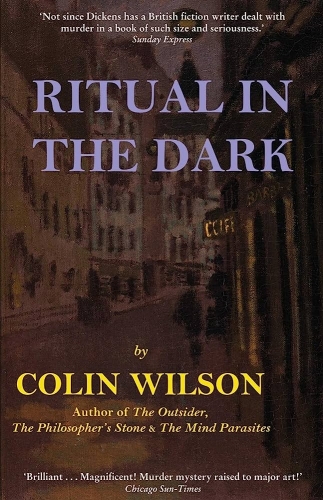
Wilson fait analyser par Sorme le profil psychologique du criminel qui arpente le Swinging London et décrit le cheminement mental du jeune écrivain. Une imbrication entre le crime planifié et le raisonnement se dessine pour définir les cheminements mentaux du criminel.
L'homme sans ombre
Deuxième volume de la trilogie, L'homme sans ombre (p. 299, 16,50 euros) est un autre chapitre de la vie de l'écrivain Gérard Sorme, cette fois centré sur le sexe: une sorte de "journal intime", comme l'indique le sous-titre.
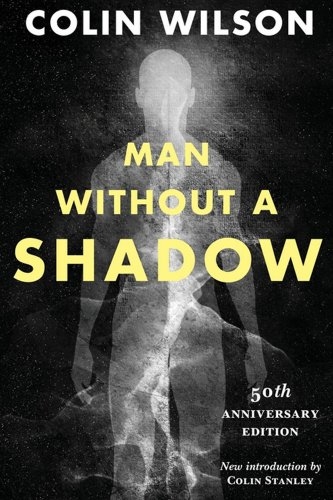
Pour Sorme, le sexe est une source d'inspiration pour ses histoires, pour élargir la conscience, et il s'efforce d'avoir une vie intense à cet égard en transcrivant dans un journal ses expériences avec les filles qu'il fréquente. Les femmes se succèdent jusqu'à ce qu'il rencontre et tombe amoureux de Diana, une femme mariée à un étrange musicien plus âgé qu'elle.
Rites nocturnes
Un personnage inquiétant, Caradoc Cunningham, ami d'Aleister Crowley (1875-1947) et auteur d'écrits sur la magie, entre dans l'histoire. Cunningham mène une lutte perpétuelle avec lui-même et contre les autres, pour s'imposer dans sa quête de la magie, avec l'aspiration de forcer la volonté de ceux qui l'entourent à ses propres fins souvent avec une telle douceur et un tel désintérêt qu'ils le font passer - surtout aux yeux de Gérard - pour un être amical. Entre les deux, les relations oscillent entre des sentiments mitigés. Cunningham a un fort charisme et implique Gérard, Diana et Carlotta dans ses opérations sexuelles et de magie noire organisées pour neutraliser les pouvoirs d'entités qui auraient dû le frapper à mort.
Entre sexe et magie
Wilson cite souvent des maîtres de l'ésotérisme, des magiciens et mentionne toujours la nature comme lieu privilégié de la vie humaine. Il le fait avec l'esprit de celui qui cherche une voie d'affirmation spirituelle, presque religieuse. Le roman L'homme sans ombre est écrit à plusieurs niveaux de compréhension. Wilson a souligné plus tard qu'il s'agissait d'expériences sexuelles, mais aussi de quêtes visant à faciliter un voyage dans sa propre conscience, une quête de sa propre existence.
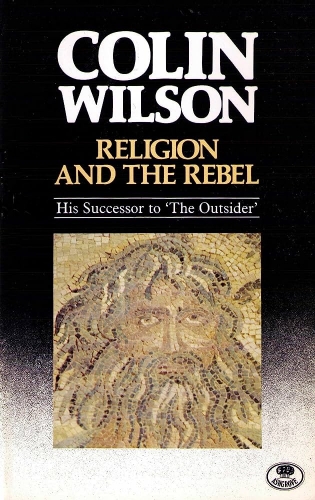
Le troisième livre de la trilogie, Religion and the Rebel, n'a pas été apprécié à sa sortie, mais il a été réévalué par la suite. Il y associe la religion - et une vision spirituelle du monde - à la rébellion contre le monde moderne et matérialiste. Il analyse également, dans cette optique, la relation entre le génie individuel et une société avec ses règles, exerçant la pensée contre les idées établies et préfixées de la société contemporaine (nous dirions aujourd'hui "politiquement correct").
Religion and the Rebel est un ouvrage de fond sur des intellectuels, des penseurs, des écrivains qui ont pris leurs distances avec la société moderne, matérialiste, nihiliste et consumériste et ont entamé une quête spirituelle.
Wilson développe une critique de la dimension spirituelle, de la moralité, à travers la psychologie, la critique littéraire, la philosophie, la poésie et l'histoire. Wilson s'appuie sur l'historien Arnold Toynbee qui estime que dans toute société, les individus les plus importants sont une "minorité créative" qui fait face à l'évolution de la société et qui est composée de philosophes, d'artistes et de penseurs. Ces hommes, selon Toynbee, ont atteint un niveau de créativité en suivant un processus impliquant la solitude, puis en "libérant" leurs visions et leurs idées dans la société, en les illustrant et en essayant de convaincre les autres de les mettre en pratique. Les exemples cités par Toynbee sont Bouddha, Confucius, Saint Paul, Mahomet, Dante, Kant, etc., et il affirme que les civilisations se dégradent lorsque les minorités actives et créatives disparaissent. Wilson, un véritable outsider, surtout dans ces années-là, a offert un certain nombre de perspectives contre la société matérialiste et libérale.
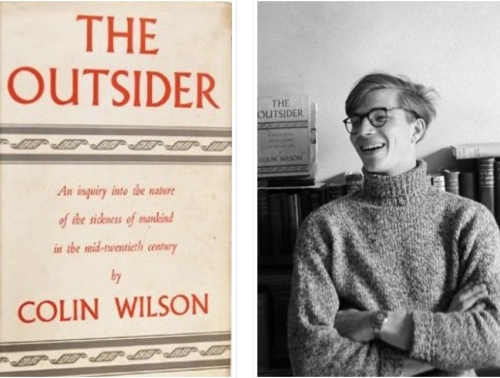
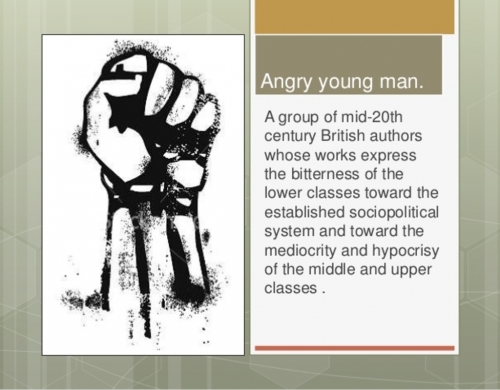
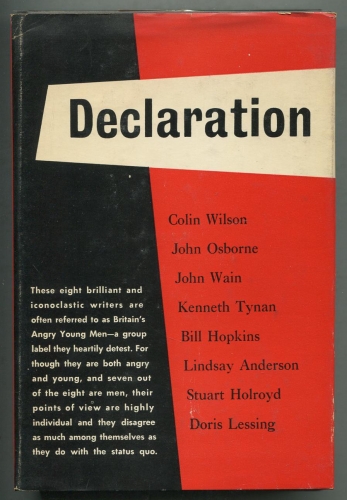
Un jeune homme en colère
Chez Wilson, on trouve un refus récurrent de la société bourgeoise et de ses valeurs, du "politiquement correct" de la classe moyenne supérieure britannique, mais surtout de la contestation des intellectuels britanniques de la fin des années 1950 et du début des années 1960, les "jeunes hommes en colère" (angry young men). Dans les controverses journalistiques et dans la présentation de ce "courant littéraire", aucune distinction n'était généralement faite. On présente une liste de noms et on dit qu'ils sont tous unis dans leur rejet du statu quo, mais sans préciser les différences entre les écrivains, qui sont pourtant importantes. Les socialistes déclarés comme Lessing et Anderson sont une chose, les irrationnels comme Wilson et Holroyd en sont une autre.

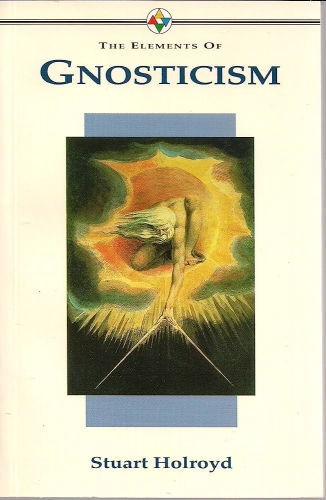
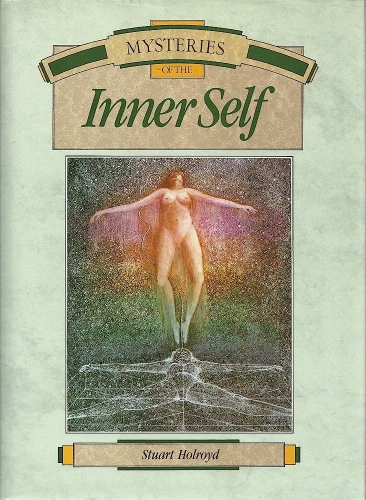

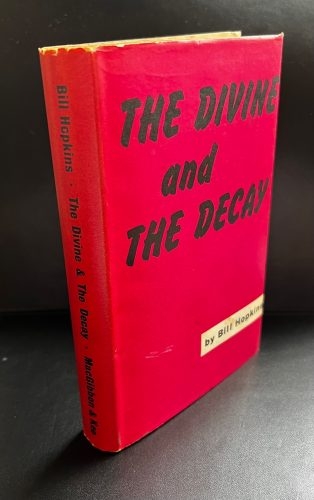
Wilson s'en prend au monde moderne, à la société démocratique et de consommation en faveur d'une vision spirituelle, d'une société liée aux valeurs de l'héroïsme contre une société de "chiffres et d'étiquettes". Il réévalue l'homme héroïque et donc "l'exclu", celui qui vit dans la société moderne mais qui n'en fait pas partie, qui s'en éloigne. Le type humain non bourgeois est quant à lui "l'exclu". L'exclu aspire à un "idéal divin". Une référence au "passage à la forêt" de Jünger. "Voici la leçon de l'Exclu", dit l'auteur.
Wilson: "une leçon de solitude délibérée et de réaction aux valeurs de la masse, une révolte contre le désir de sécurité réclamé par la plèbe". Une vision spirituelle, anti-démocratique, qui s'exprime ainsi : "Je crois que notre civilisation est en déclin, et que, de ce déclin, la présence des 'Exclus' est un symptôme. Ce sont des hommes qui réagissent au matérialisme scientifique: des hommes qui, autrefois, auraient eu l'Eglise comme point cardinal. Je crois, dit Wilson, que lorsqu'une civilisation commence à s'exprimer avec "l'Exclu", elle a relevé un défi, celui de produire un type d'homme plus digne, de se donner une nouvelle unité de but, à moins qu'elle ne veuille se résigner à tomber dans l'abîme comme tant d'autres civilisations qui ont choisi d'ignorer le défi. L'exclu, c'est l'individu, l'individu qui ose relever lui-même le défi".
L'Occident, Spengler et l'anti-Sartre
Wilson conseille: "Le lecteur qui souhaite des éclaircissements supplémentaires peut se rafraîchir en lisant, s'il ne l'a pas déjà fait, le Déclin de l'Occident de Spengler ou les écrits d'Arnold Toynbee". Et encore, pour réagir contre la société de consommation, il déclare: "La civilisation, comme "l'exclu", doit avoir une religion si elle veut survivre. Nous avons eu assez d'"humanisme" et de "progrès" scientifique pour ne pas savoir ce qu'ils valent maintenant". L'appel à la religion est un appel à l'esprit, à la discipline intérieure. Colin Wilson a abordé l'existentialisme en lisant Kierkegaard, mais son existentialisme était loin de l'existentialisme "social" de Sartre. Wilson a d'ailleurs publié un pamphlet sur le penseur français intitulé Anti-Sartre.
Ce refus du système, Wilson l'a également transposé dans ses romans. Plutôt que de prôner la drogue et la liberté sexuelle, il exalte la vision spirituelle et métaphysique.
Manlio Triggiani
14:21 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, littérature anglaise, lettres, lettres anglaises, colin wilson, angry young men |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le grand hospice occidental: le "déclin de l'Occident" selon Eduard Limonov
Giovanni Sessa
Source: https://www.paginefilosofali.it/grande-ospizio-occidentale-il-tramonto-delloccidente-secondo-eduard-limonov-giovanni-sessa/
Depuis des décennies, la scène littéraire, en Italie, connaît le succès d'auteurs et de textes en phase avec l'"intellectuellement correct". Rares sont les écrivains et les penseurs qui ont réussi à s'imposer avec des œuvres clairement dissidentes par rapport à la culture dominante. Cette fois-ci, nous pensons qu'Edouard Limonov y parviendra avec un livre publié par Bietti, Grande ospizio occidentale, édité par Andrea Lombardi (pp. 233, 21,00 euros). Il s'agit de pages qui, tant du point de vue littéraire que du point de vue du contenu, dégagent une grande puissance. La prose de Limonov est caustique, elle s'en prend aux idoles du présent post-moderne, mais elle est aussi captivante, capable d'engager le lecteur. Le volume se lit d'une traite. Mais qui était Limonov, mort d'un cancer en 2020, au milieu des restrictions causées par la pandémie de Cov id-19 ? Le journaliste parisien Alain de Benoist le précise dans l'introduction: "Poète et voyou, vagabond et majordome, milicien pro-serbe pendant la guerre de Bosnie [...] opposant dans l'âme, fou de littérature, amateur de femmes et de bagarres, opposant puis partisan de Poutine" (p. 11).
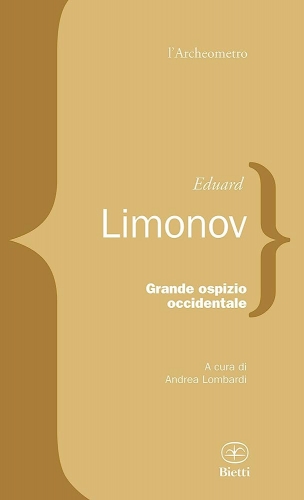

Limonov, après l'effondrement de l'URSS, a fondé le Parti national-bolchevique avec Douguine (les destins des deux hommes prendront plus tard des chemins différents). Né en Russie, mais ayant longtemps vécu en Ukraine, l'écrivain connaissait parfaitement la réalité du monde occidental, ayant séjourné assez longuement à New York et, à partir du début des années 1980, à Paris. La biographie fictive que lui a consacrée Emmanuel Carrère, publiée en Italie par Adelphi, l'a fait connaître il y a quelques années. L'édition italienne du Grand hospice occidental est une traduction de l'édition française de 2016. En réalité, le volume a été écrit par Limonov entre 1988 et 1989. La thèse centrale est illustrée par le titre. Vivre dans les sociétés occidentales (notons que pour Limonov, la Russie et la Chine font également partie de leur groupe), c'est comme séjourner dans une maison de retraite. L'Occident est une maison pour les personnes âgées "malades", réduites à un état pré-comateux par le capitalisme cognitif (pour l'auteur, la France de la fin des années 1980 est un paradigme exemplaire), qui ont perdu depuis longtemps l'élan faustien, l'énergie vitale qui leur permettait de se présenter au monde comme des créateurs de civilisation : "Un hospice géré par les autorités publiques (appelées ici "administrateurs") et peuplé de patients vivant sous sédatifs" (p. 13). Tout est sénescent, privé de vie réelle.


Limonov s'éloigne des pages de 1984 d'Orwell, un ouvrage lu non pas comme une prophétie politique, mais comme un simple enregistrement et une description de la violence explicite que les totalitarismes du 20ème siècle ont utilisée pour opprimer ou éliminer les minorités dissidentes. Au contraire, le pouvoir exercé par les "administrateurs" de l'Hospice a un côté doux : il passe par le contrôle psychologique-imaginal des masses, et est encore plus envahissant et dangereux que le pouvoir totalitaire du passé. En effet, "aujourd'hui [...] la télévision contrôle la population. Mais elle le fait à travers ce qu'elle montre, pas en l'observant" (p. 23). La violence douce repose sur l'exploitation des faiblesses des asservis qui sont poussés à considérer comme seul horizon existentiel possible la réalisation du bien-être matériel comme une fin en soi. Les masses contemporaines sont amenées à penser la pauvreté comme quelque chose de honteux, elles sont terrifiées par la crise économique, projetée comme imminente, et le chômage qui en découle. L'habitant de l'Hospice : "Assommé par le jonglage des blaireaux, au rythme des statistiques, [...] immergé dans le bourdonnement d'une musique pop de plus en plus vulgaire [...] l'habitant [...] des villes industrialisées prospères fait une course accélérée de la naissance à la retraite" (p. 28). Cette humanité bornée est terrifiée par la liberté, les choix individuels et divergents, l'esprit critique. En effet, le principal précepte en vigueur à l'Hospice identifie l'"Agité", sujet extrêmement dangereux, à marginaliser et à isoler.
Afin d'endormir les masses et de les forcer à embrasser inextricablement la simple réalité matérielle du monde, on leur rappelle souvent le résultat que la pensée de l'"Agité" a eu et pourrait avoir. En ce sens, les images d'Auschwitz ou du Goulag jouent un rôle "éducatif" et sédatif, ou celles qui proviennent de l'extérieur de l'hospice, du tiers-monde où les gens meurent de faim, sont utilisées à cette fin. Le patient modèle est celui qui adhère pleinement à la "vie assurée" que l'hospice dispense généreusement. Parmi les "Agités", les plus dangereux sont ceux qui, dans un monde qui a en fait oublié le sens de la virilité et du risque, du gâchis, se remettent à regarder le Héros comme la figure de référence d'un avenir possible. Leurs ambitions sont étouffées dans l'œuf: c'est le fait du révisionnisme historique, qui met en œuvre l'habituelle reductio ad Hitlerum contre les "Agités" émergents. Un nouveau modèle anthropologique se trouve, au contraire, dans la Victime. Dans l'hospice, le "dernier homme" nietzschéen vit à l'aise, sa vie est faite de "demi-passions du jour et de demi-passions de la nuit". Un homme qui a oublié le sens du destin.

Ses seules préoccupations sont la recherche du plaisir, de plus en plus dégradé, et la prospérité, pour laquelle il s'est livré à la dévastation de la nature. Il vit une éternelle adolescence ludique : "Portant des couleurs puériles et criardes, comme s'il était un clown, l'homo hospitius transforme son existence en roman-photo" (p. 153). Une photo-histoire mise sous protection par les pourcentages, par la société numérisée, par ceux qui créent l'information qui est ensuite propagée au Peuple, une sorte de divinité intouchable seulement en paroles, mais en fait violée chaque jour dans sa dignité. Un dogme prévaut sur tous : "Ne jamais, au grand jamais, troubler la paix du monde télévisuel, miroir de l'harmonie immaculée de l'Hospice" (p. 171). La musique pop devenue incontournable contribue à détourner les jeunes : "de leur tâche ancestrale, un instinct purement biologique qui les pousse à arracher le pouvoir aux vieux" (p. 179), tout comme la sexualité "libre" qui : " enlève de l'énergie à une [...] pulsion intrinsèquement plus forte, l'instinct de domination " (p. 188).
Limonov estime que pour sortir de la stagnation dans laquelle se trouve l'hospice, il est nécessaire de rouvrir les portes à la vie, aux passions, à la douleur, à la nature. Retrouver le sens et la signification de se dépenser pour soi et pour la communauté. Heureux donc le monde capable d'honorer les Héros !
18:53 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : édouard limonov, russie, lettres, lettres russes, littérature, littérature russe, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
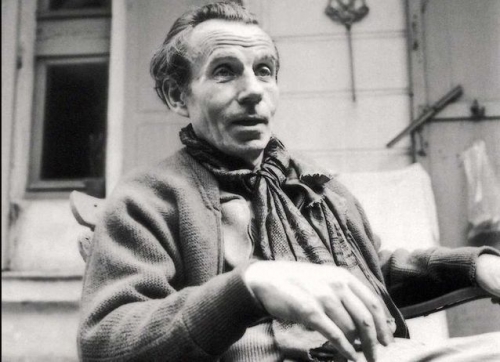
Parution du numéro 463 du Bulletin célinien
Sommaire :
 Le goût de Céline chez Sollers
Le goût de Céline chez Sollers
Krogold face à la critique
Céline loin des Lumières
Entretien avec Maxim Görke
Céline et Mirbeau
Gen Paul et Céline
Il faut savoir beaucoup de gré à Henri Godard, Pascal Fouché et Régis Tettamanzi pour le travail magistral accompli dans cette nouvelle édition de la Pléiade. Rappelons à ceux qui possèdent déjà l’œuvre romanesque dans cette collection que seuls deux volumes apportent, avec l’exégèse requise, un corpus inédit. À ne plus confondre avec les deux premiers volumes de l’édition précédente ; avant cette année, pour lire l’œuvre dans l’ordre chronologique de leurs phases de rédaction, il fallait lire les volumes dans l’ordre suivant : I, III, IV et II ! Cette tomaison est abandonnée ; désormais, les quatre volumes sont classés par grandes périodes d’écriture : Romans 1932-1934 (comprenant Voyage au bout de la nuit, avec notamment des séquences inédites du manuscrit et du dactylogramme, et ce que l’éditeur nomme “textes retrouvés” : La Volonté du roi Krogold, Guerre et Londres) ; Romans 1936-1947 (comprenant Mort à crédit, augmenté de dix séquences du roman dans la version du manuscrit retrouvé ; Casse-pipe suivi de ce que l’éditeur nomme “scènes retrouvées” ; et Guignol’s band). N’étant pas affectés par les découvertes de l’été 2021, les deux derniers volumes demeurent inchangés et sont seulement rebaptisés en Romans 1952-1955 et Romans 1957-1961.
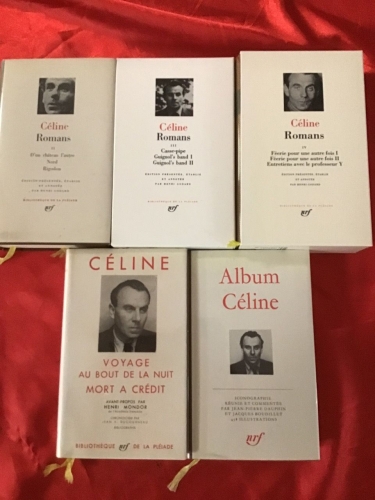
À moins d’être un collectionneur éperdu de toutes les éditions céliniennes, seule l’acquisition des deux premiers volumes cités s’impose pour découvrir de l’inédit non procuré par la collection “Blanche”. Idéalement – puisqu’il s’agit de textes non achevés – il aurait fallu réserver Guerre, Londres et Krogold à la “Bibliothèque de la Pléiade”, et aux “Cahiers de la NRF” mais, outre les impératifs commerciaux, il est naturel de songer au grand public.

Au moins ces inédits ne lui ont-ils pas été présentés comme des “romans” puisque non avalisés par Céline qui les considérait à juste titre comme des textes non aboutis. Ajoutons que les deux nouveaux volumes de la Pléiade comprennent un avant-propos inédit de Henri Godard pour le premier et une préface actualisée pour le deuxième. Ses commentaires sagaces font litière de l’affirmation de certains selon laquelle Guerre serait un texte écrit en 1930-1931 destiné, à l’origine, à être intégré dans Voyage au bout de la nuit.
Cette hypothèse est, on s’en souvient, celle de l’universitaire italien Pierluigi Pellini¹. Il n’est pas le seul dans ce cas : en France aussi il se trouve deux ou trois céliniens qui le pensent aussi. Or Guerre ne peut avoir été écrit à la même période que Voyage puisqu’y figurent des bribes de Krogold. Lequel fut rédigé, comme on le sait, après la parution de son premier roman. Mais la grande découverte apportée par ces inédits est qu’après le fabuleux retentissement de Voyage, Céline a longuement tâtonné. Et n’a donc pas trouvé d’emblée ce qui sera désormais son style : celui inauguré par Mort à crédit. Auparavant il adopta encore, dans ces tentatives que sont Guerre et Londres, un langage proche de l’oralité populaire qui était celui de Voyage. Sa révolution stylistique sera la consécration d’un éprouvant et patient labeur.
19:23 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, la pléiade, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
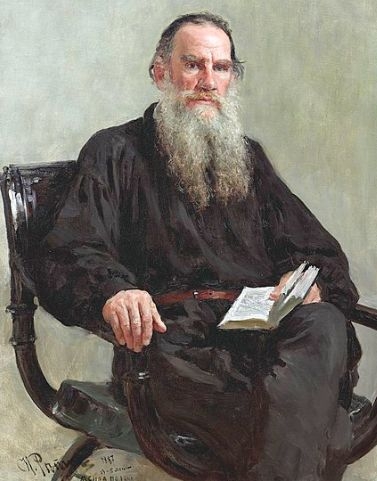
Léon Tolstoï et la déchéance de l’art en Europe occidentale
Nicolas Bonnal
L’écroulement artistique de l’art occidental frappe tous les bons esprits (ne parlons pas du wokisme), mais il est ancien. Dans son magnifique Essai sur l’Art, le comte Tolstoï recense ces catastrophes culturelles du dix-neuvième siècle dont les Français sont souvent responsables (ô festival de Cannes, ô exception culturelle, ô théâtre de soixante-huitard ou de boulevard, ô musique sérielle…) et il les réduit la cause à la décadence religieuse venue avec la Renaissance. C’est Huysmans qui dit que nous chutons depuis le XIIIème siècle.
Tolstoï accuse une élite du plaisir, de surhommes de la consommation artistique (le public friqué des festivals dont se moque à demi-mot Zweig dans le Monde d’hier) ; il incrimine Nietzsche mais Nietzsche tape bien sur Wagner et sur le culte de Bayreuth.
Tolstoï :
« Et pour ne rien dire des effets moraux qu’a eus sur la société européenne une telle perversion de la notion de l’art, cette perversion a encore affaibli l’art lui-même, et l’a, pour ainsi dire, détruit. Elle a eu pour premier résultat que l’art, en faisant du plaisir son seul objet, s’est privé de la source de sujets infiniment variée et profonde que pouvaient être, pour lui, les conceptions religieuses de la vie. Et son second résultat a été que, ne s’adressant qu’à un petit cercle, l’art a perdu la beauté de sa forme, est devenu affecté et obscur. Et son troisième et principal résultat a été que l’art a cessé d’être spontané, ou même sincère, pour devenir absolument apprêté et artificiel. »
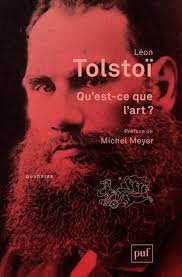 En quittant la religion l’art quitte sa source, devient cochon (on en reparle), obscur, surtout se professionnalise. Il est obsédé par la nouveauté :
En quittant la religion l’art quitte sa source, devient cochon (on en reparle), obscur, surtout se professionnalise. Il est obsédé par la nouveauté :
« Le mérite des sujets, dans toute œuvre d’art, dépend de leur nouveauté. Une œuvre d’art n’a de prix que si elle transmet à l’humanité des sentiments nouveaux. De même que, dans l’ordre de la pensée, une pensée n’a de valeur que quand elle est nouvelle et ne se borne pas à répéter ce que l’on sait déjà, de même une œuvre d’art n’a de valeur que quand elle verse dans le courant de la vie humaine un sentiment nouveau, grand ou petit. »
L’art ne se préoccupe plus que des riches et de leurs soucis sexuels, sentimentaux et existentiels :
« La vie des travailleurs lui paraissait une chose si misérable que les histoires de paysans de Tourgueniev en avaient dit tout ce qu’il y en avait à dire. La vie des riches, au contraire, avec leur galanterie et leur mécontentement de tout, lui paraissait une matière à jamais inépuisable. Tel homme du monde donnait à sa dame un baiser sur la main, tel autre sur l’épaule, un troisième sur la nuque. Tel était mécontent à force de ne rien faire, tel autre parce qu’il sentait qu’on ne l’aimait pas. Et Gontcharov avait la conviction que cette sphère offrait à l’artiste une variété de sujets infinie. Combien de gens sont aujourd’hui de son avis ! »
A la même époque le naturalisme de Zola nous découvre le monde des travailleurs, mais de quelle manière !
Tolstoï évoque l’obsession sexuelle occidentale :
« Plus tard, l’élément du désir sexuel a commencé à pénétrer de plus en plus dans l’art ; il est devenu désormais, à très peu d’exceptions près, un élément essentiel dans tous les produits artistiques des classes riches, et en particulier dans les romans. De Boccace à Marcel Prévost, tous les romans, contes, et poèmes expriment le sentiment de l’amour sexuel sous ses formes diverses. L’adultère est le thème favori, pour ne pas dire l’unique thème de tous les romans. »
Le cul (cf. le roman de Lemaire) envahit tout :
« Les opéras et les chansons, tout est consacré à l’idéalisation de la luxure. La grande majorité des tableaux des peintres français représentent le nu féminin. Dans la nouvelle littérature française, à peine s’il y a une page où n’apparaisse le mot « nu ». »
La mauvaise humeur et le spleen se répandent !
« Le troisième des grands sentiments qu’exprime l’art des riches, celui du mécontentement universel, a fait son apparition plus tard encore que les deux autres. Ce sentiment n’a pris toute son importance qu’au début de notre siècle ; il a trouvé ses représentants les plus forts en Byron et Leopardi, puis en Heine. Aujourd’hui, il est devenu général ; et on le trouve constamment exprimé dans les diverses œuvres d’art, mais en particulier dans les poèmes. »
On accuse tout (« je suis maudit ! ») :
« Les hommes vivent d’une vie stupide et mauvaise, et en rejettent le blâme sur l’organisation de l’univers. »
Il en résulte un appauvrissement général :
« Le premier résultat de la perte de foi des classes supérieures a été, pour l’art de ces classes, l’appauvrissement de leur matière. Mais par un second résultat, en devenant sans cesse plus exclusif, cet art devenait en même temps sans cesse plus artificiel, plus embarrassé, et plus obscur. »
Ensuite vient l’abscons que Tolstoï dénonce chez Baudelaire comme chez Mallarmé (le Second Empire, toujours, ce prototype totalitaire de notre méphitique moderne monde, comme le comprit Maurice Joly) :
« C’est bien, comme on le voit, l’obscurité érigée en dogme artistique. Et le critique français Doumic, qui n’a pas encore admis ce dogme, a bien raison de dire « qu’il serait temps aussi d’en finir avec cette fameuse théorie de l’obscurité, que la nouvelle école a élevée, en effet, à la hauteur d’un dogme ».

Je pense aussi à l’An dernier à Marienbad : un adultère raconté de façon incompréhensible dans un décor de rêve (château baroque teuton) ! L’essence de nos cannois émerveillements. Lourcelles a très bien étrillé ce produit si franchouillard (le franchouillard, c’est l’exception culturelle, art nul et étatisé financé par le contrit contribuable, voyez mon livre sur cette Exception). Mais l’important c’est de créer une élite fondée sur le fric et la technocratie (cf. le Grand Reset). En matière culturelle on y est depuis longtemps ; en économie on va y être. Le tout est de formater son public. En France on est champion.
L’auteur de Guerre et Paix ajoute :
« Du jour où l’art des classes supérieures s’est séparé d’avec l’art du peuple, cette conviction est née que l’art pouvait être l’art et rester, cependant, hors de la portée des masses. Et du jour où ce principe a été admis, on pouvait prévoir que le moment viendrait où l’art ne serait plus accessible qu’à un petit nombre d’élus, et qu’il finirait même par ne plus l’être qu’à deux ou trois personnes, voire à une seule, l’artiste qui le produirait. »
Tolstoï répugne à l’idée de l’œuvre élitiste, incompréhensible :
« Dire qu’une œuvre d’art est bonne, et cependant incompréhensible à la majorité des hommes, c’est comme si l’on disait d’un certain aliment qu’il est bon, mais que la plupart des hommes doivent se garder d’en manger. »
Or le grand public n’est alors pas si nul :
« Il est faux de dire, en outre, que la majorité des hommes manquent du goût nécessaire pour apprécier les œuvres d’art supérieures. Cette majorité a toujours compris, et continue à comprendre ce que nous aussi nous reconnaissons comme étant le meilleur : l’épopée de la Genèse, les paraboles de l’Évangile, les contes de fées, les légendes et chansons populaires. Comment donc se fait-il que la majorité des hommes ait soudain perdu cette faculté naturelle, et soit devenue incapable de comprendre l’art de notre temps ? »
Céline dira l’inverse dans les pamphlets. Il faut dire qu’entretemps le peuple a été bien préparé, mitonné, abruti et conditionné par radio, TV, ciné et festivals.
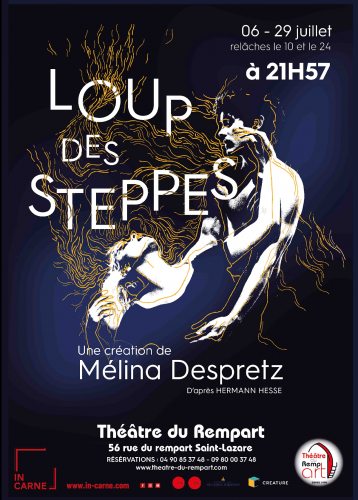
Ensuite vient le business ; voyez comment Hermann Hesse décrit l’abrutissement par le cinéma dans son Loup des steppes (comme pour beaucoup de livres : ce n’est pas que ce livre est mal lu, c’est qu’il n’est pas lu) et comment Zweig décrit la destruction de Salzbourg par son festival ; Tolstoï :
« Cette énorme et croissante diffusion des contrefaçons de l’art, dans notre société, est due au concours de trois conditions, à savoir : 1° le profit matériel que ces contrefaçons rapportent aux artistes, 2° la critique, 3° l’enseignement artistique. »
Oui, les écoles de cinéma ont détruit le cinéma. Ford, Walsh, Hawks étaient-ils élèves d’écoles de cinéma ? Le problème est que l’argent, les subventions, vont fabriquer un public snob (celui des nouvelles Femmes savantes ou des nouveaux Trissotin) à coups d’universités et de festivals. C’est le monde moderne qui se met en place : dette, gabegie et gaspillage – technocratie partout. En attendant les immondes ateliers d’écriture… Dès le début du vingtième siècle la poésie devient de la littérature pour profs écrite par des normaliens. Et le poète n’est plus très nature : ô cimetière marin ! O mer toujours recommencée !
On avait le business, on a maintenant le job :
« Mais aussitôt que la distinction se produisit de l’art de l’élite et de l’art du peuple, aussitôt que les classes supérieures se mirent à acclamer toute forme d’art, pourvu seulement qu’elle leur apportât du plaisir, aussitôt enfin que ces classes commencèrent à rémunérer leur soi-disant art plus encore que toute autre activité sociale, aussitôt un grand nombre d’hommes s’employèrent à ce genre d’activité, et l’art prit un caractère nouveau, et devint une profession. »
Notre génie (il détestait le mot, car en effet on a voulu remplacer Dieu et ses anges par Einstein et les génies) mal intentionné ajoute :
« Le professionnalisme est la première cause de la diffusion parmi nous des contrefaçons de l’art. »
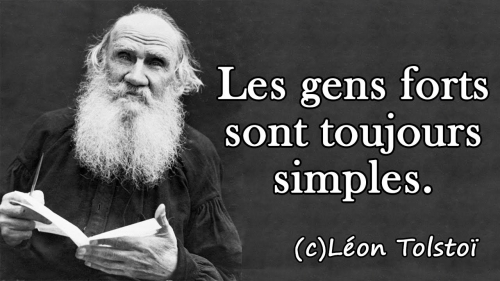
La critique joue aussi un rôle sinistre :
« La seconde cause est la naissance, toute récente, et le développement de la critique, c’est-à-dire de l’évaluation de l’art non plus par tout le monde, non plus par des hommes simples et sincères, mais par des érudits, des êtres à l’intelligence pervertie, et remplis en même temps de confiance en soi. »
Comme me disait Jean-Jacques Annaud, souvent victime de cette critique de cinéma, « elle garde son pouvoir de nuisance ». En effet puisqu’elle a détruit de fond en comble le cinéma français – devenu froncé.
Tolstoï répugne à l’enseignement de l’art :
« Ces écoles ont pour objet l’enseignement professionnel de l’art. Mais l’art est la transmission à d’autres hommes d’un sentiment personnel éprouvé par un artiste. Comment donc pourrait-on enseigner cela dans des écoles ? »
Et de s’en prendre à nos merveilleuses dissertations fabricantes de bêtes à concours et d’experts-parlementaires-énarques-ministres inexpugnables :
« En littérature, on apprend aux jeunes gens comment, sans avoir rien à dire, ils peuvent écrire une composition de plus ou moins de pages sur un sujet auquel ils n’ont jamais pensé, et l’écrire de telle façon qu’elle ressemble à des écrits d’auteurs d’une célébrité reconnue. »
L’enseignement théâtral aussi lui donne du souci :
« De même encore, dans les écoles d’art dramatique, on apprend aux élèves à réciter des monologues exactement comme les récitaient les acteurs célèbres. »
Le monde moderne ressasse Mozart, Bach, Racine, Shakespeare depuis trois ou quatre siècles, preuve qu’il n’a pas fait mieux et qu’il ne cherche pas à le faire. C’est l’ancienne culture congelée et préservée dont parla Guy Debord dans sa Société du Spectacle. Tolstoï la voit venir, qui parle d’auteurs (Gourmont, Louÿs) que nous connaissons tous encore.
La musique devient un entraînement d’automates :
« Et de même en musique. Toute la théorie de la musique n’est qu’une simple répétition des méthodes dont se sont servis les musiciens célèbres. Quant à l’exécution musicale, elle devient de plus en plus mécanique et semblable à celle d’un automate. »
Bref on est déjà dans la consommation et le recyclage.
Tolstoï comme tout le monde présente ses solutions (arrêtez avec ça) ; elles n’ont été adoptées nulle part. L’idée essentielle et guénonienne c’est cet affaissement lent et progressif depuis la fin du Moyen Age. Cet effondrement spirituel est accompagné d’une montée de l’esprit totalitaire (Bernanos).
Le reste est littérature.
Sources principales :
Léon Tolstoï - Qu’est-ce que l’art ? – Chapitres VII à XI.
https://bibliotheque-russe-et-slave.com/Livres/Tolstoi%20...
https://leblogalupus.com/2019/11/04/le-loup-des-steppes-c...
https://www.dedefensa.org/article/bernanos-et-la-fin-de-l...
https://www.amazon.fr/Autopsie-lexception-fran%C3%A7aise-...
https://www.amazon.fr/Louis-Ferdinand-C%C3%A9line-pacifis...
18:51 Publié dans art, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : léon tolstoï, art, décadence, russie, lettres, lettres russes, littérature, littérature russe |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook