À Athènes, dans l’Antiquité, les tâches d’expertise étaient confiées à des esclaves publics, que l’on honorait mais qu’on privait de tout pouvoir de décision. C’est ainsi, explique P. Ismard, que la démocratie parvenait à se préserver des spécialistes.
mardi, 29 avril 2025
Pléthon, Sparte et Zarathoustra

Pléthon, Sparte et Zarathoustra
Claude Bourrinet
Source: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002364487528
Dans la traduction de 1492 des Ennéades de Plotin, dédicacée à Laurent de Médicis, Marcile Ficin évoque le philosophe byzantin Gémiste, dit Pléthon (1355/1360/26 juin 1452), et le présente « comme un autre Platon », avec qui Cosme discutait des « mystères platoniciens ». La redécouverte du platonisme, à la Renaissance, s’accompagne d’une victoire progressive sur l’aristotélisme (bien que l’on cherchât en général la concordance entre les philosophes), et ce, malgré la résistance des milieux monastiques et la plupart des « réformateurs » de l’Eglise, qui prônaient plutôt le retour aux Pères. La prise de Constantinople en 1453, et le patronage des mécènes médicéens, en particulier de Cosme, fondateur de l’Académie platonicienne florentine, ont favorisé la translatio studii du corpus néoplatonicien et la vision d’une chaîne d’or liant cette tradition de pensée à des sagesses archaïques, comme celle d’Hermès ou de Zoroastre. La venue au Concile de Ferrare/Florence de 1438/1439, auquel participait l’empereur Jean VIII Paléologue, qui visait à réconcilier, en vue d’affronter l’empire turc, les deux parts d’une chrétienté déchirée par le schisme de 1054, notamment par la question du Filioque, a été l’occasion de rencontres fructueuses entre intellectuels grecs et latins. On pourrait penser que Pléthon fût l’un des acteurs de cet échange. N’a-t-il pas rédigé alors, en 1439, un texte sur les différences (appelé couramment De differentiis, publié en grec en 1450 - celle en latin ne le fut jamais- entre Platon et Aristote ? Cette comparaison, restée confidentielle, provoqua une réponse virulente, en 1448/1449, de son adversaire Scholarios Gennade. Ce modèle comparatif allait pourtant inspirer de nombreuses analyses de ce type en Occident. Et si l’étude des sources qui ont nourri les œuvres de Ficin montre bien un démarquage, parfois presque une paraphrase, du philosophe de Mistra, sa personne et ses ouvrages souffrirent d’une occultation qui le firent oublier du monde savant. Une part de ses idées fut utilisée, par Pic de la Mirandole ou par Ficin, en ce qui concerne singulièrement la référence aux prophètes et aux sages de haute antiquité comme Zoroastre.
Toutefois elles furent réorientées dans un sens chrétien, et récupérées pour refonder une Eglise fragilisée par des attaques multiples. Ce qui était loin des préoccupations de Pléthon. Le philosophe de Morée aurait dû, de ce fait, demeurer comme une référence relativement anecdotique, une note en bas de page pour spécialistes de l’histoire de la pensée, d’autant plus que ses livres furent peu édités, quand ils ne furent pas détruits, comme son ouvrage majeur, le Traité des lois, brûlé, à l’exception de quelques feuillets attestant le polythéisme de l’ouvrage, par Georges Scholarios (v. 1405 – 1472), qui l’accusait d’être païen et polythéiste, et, pour tout dire, antichrétien.

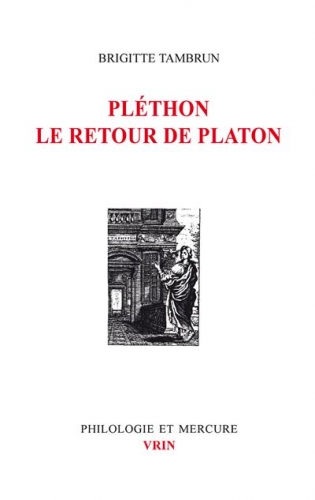
Néanmoins, en recoupant ces passages préservés avec d’autres écrits, il est possible de reconstituer la pensée de Pléthon, ce qu’ont fait François Masai, en 1956, dans son étude Pléthon et le platonisme de Mistra, parue aux éditions « Les Belles Lettres », et Brigitte Tambrun, en 2006, aux éditions Vrin, dans la collection « Philologie et Mercure », dans son ouvrage qui a pour titre Pléthon, le retour de Platon, que je suis de près pour cette étude. Comme il n’est pas question de remplacer des analyses aussi fouillées et solides, surtout celle de Madame Tambrun, qui nous livre en même temps de fort profondes réflexions sur plusieurs auteurs néoplatoniciens et sur l’empereur Julien, je vais me contenter, par cette présentation, de mettre l’accent sur ce qui peut nous importer chez un philosophe méconnu et, apparemment, si étranger à la modernité philosophique.
Situation de Pléthon
- 1) La philosophie des Hellènes à Byzance (source : Alain de Libera ; La philosophie médiévale ; PUF) .
Bien que grecque d’origine, la philosophie, considérée comme « hellénique », est regardée comme étrangère à la pensée religieuse stricto sensu. Du IXe au milieu du XVe siècle, on l’appréhende comme une « science extérieure », une « philosophie du dehors » (exôthen, thurathen), contraire à la « philosophie de l’intérieur », la théologie. Ce statut précaire (puisque sujet à la censure) lui confère une certaine autonomie, contrairement à son rôle de « servante de la théologie » joué dans l’université latine, institution complètement inconnue du monde byzantin. Si la logique d’Aristote et de Porphyre est utilisée dans l’élaboration de la théologie trinitaire, elle n’est pas déterminante comme instrument de la théologie dans son ensemble. Le fossé entre corpus philosophique et religion va se creuser, au XIVe siècle, avec le palamisme mystique et le courant hésychaste (la doctrine palamite, antiphilosophique, est devenue, en 1352, la théologie officielle de l’Eglise orthodoxe). L’enseignement supérieur est octroyé, à titre privé, pour former les hauts fonctionnaires, ce qui entraîne que de nombreux lettrés, à Constantinople, sont laïcs. Pléthon appartient à ce cénacle. Les polémiques entre philosophes et théologiens, comme en Occident chrétien, sont peu probables entre deux univers qui ne se rencontrent pas. En revanche, toute affirmation de l’un, pour rare qu’elle soit, entraîne des conséquences radicales. L’empire byzantin, qui laissait tomber en ruine ou transformait les monuments de Grèce antique, se voulait l’ennemi déclaré de l’hellénisme. Sans remonter à la fermeture de l’Ecole platonicienne d’Athènes, en 529, par Justinien, Jean Italos, sous l’empereur Alexis Comnène (1081 – 1118), va être condamné à la relégation dans un monastère pour neuf articles tès hellènikès athéotètos gémonta, « emplis d’athéisme hellénique », autrement dit « païen ».
Pléthon lui-même, sous la pression du haut-clergé, fut contraint, bien qu’il fût relativement protégé par Manuel II Paléologue, de s’exiler à Mistra, citadelle laconienne, à Sparte (et c’est déjà tout un programme), centre du renouveau de la pensée antique, où l’empereur lui octroya une magistrature (et, un peu plus tard, le despote de Morée, Théodore, fils de Manuel II, lui accorde, en 1427, par un argyrobulle, un domaine en pronoia, propriété provisoire – puis héréditaire - qui lui permet de percevoir , en gouverneur, ou képhalis, des droits sur les paysans, moyennant service (douleia) rendu au souverain, et lui assure les moyens de vivre, ainsi qu’une relative indépendance, à l’abri des poursuites de l’Eglise). Mais son retour à l’hellénisme, plus ou moins affiché (nous verrons qu’il s’adressait à une élite) provoqua un conflit violent avec le monothéisme chrétien. De fait, la décadence byzantine ouvrait des perspectives de renaissance d’une Grèce renouant avec un passé qu’on aurait voulu oublier, ou soumettre, en le trahissant, à une autre Weltanschauung.

- 2) Un monde culturel multipolaire
La gigantomachie qui oppose le monde musulman au monde chrétien, et, à l’intérieur de celui-ci, depuis la prise de Constantinople par les Latins en 1204, (mais, religieusement, bien avant), le heurt entre Eglise d’Orient et Eglise d’Occident, elle-même ébranlée par des schismes depuis 1378 (papes contre anti-pape(s), pape Eugène IV, élu en 1431, contre le Concile de Bâle, ou les hérésies (par exemple celle de Jean Hus, brûlé le 6 juillet 1415), ouvrent, paradoxalement, et, somme toute, fort logiquement, un espace de remise en question(s) des certitudes idéologiques, et autorisent un approfondissement des identités.
Nous avons vu que la nécessité militaire motivait un rapprochement entre l’Orient chrétien et l’Occident. En fait c’était une soumission qui était exigée, moyennant l’acceptation du controversé Filioque, qui plaçait sur le même plan ontologique le Père et le Fils (conception d’une grande importance politique : elle induit la relation, égalitaire ou hiérarchique, de l’Etat et de la société). Pléthon, anti-unioniste, comme Marc d’Ephèse (Marc Eugénikos), contrairement au célèbre Bessarion, s’était élevé contre ce qu’il considérait comme une abdication, ce qui lui avait permis, sous couvert de critiquer le thomisme, de s’en prendre directement, au nom de Platon, à l’aristotélisme.
Quant à l’Islam, empreint de tradition néoplatonicienne, Byzance n’était pas sans recevoir son influence philosophique, même si l’Eglise, acculée par les désastres militaires, s’arc-boutait sur l’orthodoxie strictement religieuse (le même pendant se retrouvant dans le sunnisme, par exemple les Docteurs de la Loi, les ‘olama d’Alep, ceux-là mêmes qui prononcèrent contre Sohravardi le takfir, et le vouèrent à la mort). Il se trouve justement que Georges Scholarios, pour nuire à adversaire, prétendait tenir « de nombreuses personnes qui ont bien connu Pléthon dans sa jeunesse », qu’il s’était rendu « à la cour des barbares », sans doute Andrinople, et qu’il y avait fréquenté « un Juif très influent », Elissaios (Elisha). Scholarios ajoute qu’en fait, le « maître » (didaskalos) de Pléthon n’était pas un Juif, mais un païen (hellênistês), un « polythéiste » (polutheos), qui lui aurait fait connaître « les doctrines concernant Zoroastre et les autres ».

Or, l’une des sources de la falsafa, outre Aristote, Plotin, Proclus, qu’on essayait de concilier, un commentateur « persan », influencé par le soufisme, héritier des anciens Perses et restaurateur de la doctrine de Zoroastre, est Sohravardi, dont la pensée était alors très active. Même si le projet du penseur iranien et celui de Pléthon divergent (« Pléthon voit dans la résurrection du platonisme une arme de salut pour l’indépendance hellénique, une juste politique, une renaissance spirituelle dirigée contre la double menace, latine et turque. Sohravardi situe d’emblée son projet au niveau de l’ontologie pure et de la véritable signification du monothéisme. La vérité du Livre saint est pour lui un essentiel souci. Revenir à la sagesse de l’ancienne Grèce, de l’ancienne Perse, ce n’est pas contester l’islam, mais en approfondir le sens » (Christian Jambet, introduction au Livre de la sagesse orientale, traduit par Henri Corbin), il n’en demeure pas moins que la doctrine du prophète du Mazdéisme permettra à ce dernier non seulement de contester la prétention des chrétiens de faire remonter la sagesse archaïque à Moïse, mais aussi d’asseoir une conception large de la religion capable de subsumer toutes croyances positives ancrées dans les périodes postérieures à Zoroastre, et, de ce fait, inférieures. Cette perception d’un sacré évolutif, et néanmoins toujours le même, malgré des dissemblances apparentes, ne sera pas sans conséquences pour son projet que l’on pourrait appeler « métapolitique ».
- 3) Un cul de sac géopolitique
La situation politique, militaire de l’empire byzantin est alors désespérée. Dans son Mémoire pour Théodore, Pléthon écrit : « Nous n’avons actuellement besoin de rien moins que d’être sauvés : nous voyons, en effet, ce qu’est devenu l’Empire des Romains. Toutes nos cités sont perdues, il nous en reste juste deux en Thrace, plus le Péloponnèse, encore pas tout entier, et l’une ou l’autre petite île. » Pire : après la bataille de Maritsa, les Byzantins durent payer aux Ottomans le haradj et participer aux expéditions du sultan. L’empire était vassalisé. Les Turcs, comme d’ailleurs Vénitiens et « Francs », interviennent parfois dans les querelles internes des Grecs. Les ports et le commerce, en outre, étaient le monopole des Italiens. Il ne faut pas oublier que la reconquête du Péloponnèse (la Morée) se fit contre les « Francs », les Latins, singulièrement la famille champenoise de Villehardouin, dont les ruines du castel, au sommet de la colline de Mistra, attestent encore la puissance.
Mais au fond, ce morcellement territorial et politique, non seulement rappelait l’état anarchique de l’Hellade antique, finalement si propice à l’éclosion de la pensée, mais aussi donnait loisir aux réfractaires de se réfugier quand c’était nécessaire, ou de jouer sur les oppositions d’intérêts. La faiblesse pouvait s’avérer une force, à condition que l’on trouvât le moyen de dispenser une sécurité et une durée suffisante à chaque nation, pour qu’elle donne le meilleur d’elle-même, ce qui était loin d’être assuré pour un empire byzantin qui était réduit à la dimension d’une province prise en étau, et à la merci d’un dernier coup de boutoir.

L’espoir demeurait : en 1429, presque tout le Péloponnèse était reconquis, hormis les possessions vénitiennes. Malheureusement, l’assaut final de 1453 mettra fin aux rêves de reconquête et de renaissance nationale. Auparavant, la victoire ottomane de Varna, en 1444, avait enlevé tout espoir de salut au despotat de Morée récemment devenu royaume. Le défi que va essayer de relever Pléthon, non sans courage, sera de restaurer les conditions intellectuelles, morales et politiques pour retrouver l’indépendance nationale. Toutefois, ce dessein, bien que prenant une distance audacieuse avec la prétention de l’empire à incarner l’universalisme chrétien, n’est pas un programme « laïc ». Il n’est nullement moderne, c’est-à-dire ne se soustrait pas au rapport puissant qui existe entre la théologie, la science du divin, et un mode opératoire civique qui s’avère être une application nécessaire des principes sacrés. Pour Pléthon, ce qui s’impose « là-bas » doit ordonner, mettre en ordre, ici-bas. C’est pourquoi, avant d’exposer les préceptes politiques du conseiller de Manuel et de Théodore, convient-il d’énoncer la doctrine relative aux choses divines, proposée par le philosophe de Mistra.
Théologie
- 1) Une doctrine « secrète »
L’ouvrage le plus important de Pléthon, le Traité des lois, dont il reste des partie substantielle souvent reproduite dans l’étude de François Masai, et qui a été intégralement publiées en 1987 (édition B. Tambrun-Krasker), est tenu pour un livre secret, peut-être destiné à ceux de son entourage qu’il nomme sa « phratrie ». La prudence entre pour une bonne part dans cette volonté d’extrême discrétion (le sort du livre le démontre assez bien), car, d’inspiration païenne et polythéiste, il y enseigne la théologie selon « Zoroastre », et présente les bases de sa réforme, la politeia lakônikê, le régime spartiate qu’il préconise (moins la dureté extrême de son éthique).
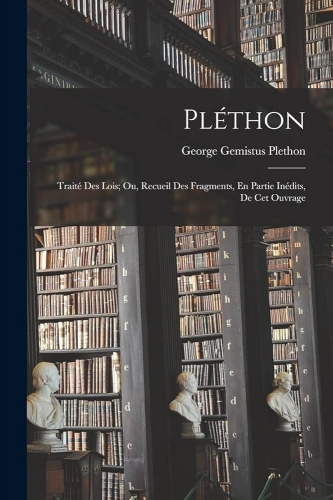
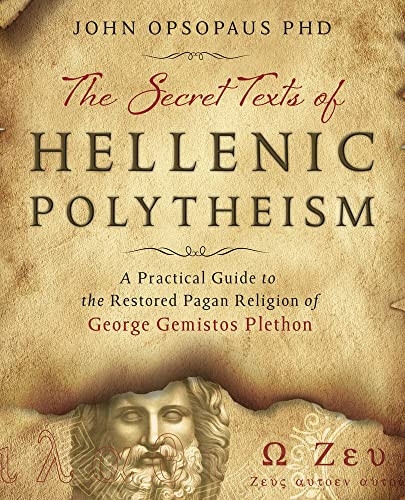
Cependant, cette dissimulation d’une partie du message, qui se concrétise, dans l’ouvrage, en deux parties qui semblent parfois se répéter, reprend la méthode des études platoniciennes, qui comportent deux niveaux, en fonction de l’approfondissement du disciple. La deuxième partie livrerait donc un enseignement plus « ésotérique », ce que recoupe aussi ce qu’avance la tradition, que Platon livrait oralement une doctrine secrète, s’inscrivant dans la « chaîne d’or » des sages d’antique mémoire, instruction seulement réservée à une élite.
- 2) Contre l’aristotélisme
Nous avons évoqué l’ouvrage de Pléthon, En quoi Aristote est en désaccord avec Platon, appelé De differentiis, et sa participation au concile de Ferrare/Florence. Pour lui, il ne s’agit pas de concilier les religions entre elles, ni Aristote et Platon. L’échec du concile de Florence, imputé en partie à la méthode utilisée, le syllogisme aristotélicien, qui n’aboutit qu’à une éristique stérile, concile qui débattait de la question du Filioque, mais visait expressément à une absorption de l’Eglise d’Orient par celle d’Occident, montrait que cette ambition était vaine, sinon absurde. En fait, jamais le schisme n’avait paru si évident. Au demeurant, Pléthon ne vise pas seulement la christianisation d’Aristote dans le thomisme, mais Aristote lui-même, plus précisément sa dissidence par rapport à Platon. Il lui reproche d’ignorer le dieu créateur, et de ne penser l’Être qu’en logicien. Il dénonce aussi chez lui sa position ambiguë sur l’immortalité de l’âme.
- 3) Retour à l’hellénisme
Pléthon va renverser totalement la théologie historique et sapientielle des chrétiens. La question du Filioque, pour abstruse qu’elle passe au regard des modernes, est d’une importance majeure. « Les Grecs enseignent que l’Esprit Saint procède du Père, tandis que les latins affirment qu’il procède du Père et du Fils » (B. Tambrun). Pléthon, à la suite de Marc d’Ephèse, souligne que la dernière assertion induit la présence de deux « causes » et de deux « principes » d’origine dans la Trinité, ce qui est contraire à la conception hellénique (explicitée dans la Lettre II, 312e, attribuée à Platon) qui soutient l’existence d’une hiérarchie interne au divin. Le retour à l’hellénisme est aussi une réaction contre le palamisme, dont le centre de diffusion est précisément Mistra (Défense des saints hésychastes, de Grégoire Palamas), dont l’irrationalisme mystique, encouragé par la théologie négative (le Bien est au-dessus de la parole), contredisait directement le rationalisme hellénique, et enjoignait, plutôt que de choisir Platon ou Aristote, de s’en remettre à Jésus et Moïse : « La folle philosophie des sages du dehors ne comprend donc pas et ne révèle pas la sagesse de Dieu » (Cf. Paul, dans la Première Lettre au Corinthiens, par exemple : « Et nous n’en parlons pas dans le langage qu’enseigne la sagesse humaine… »). Enfin, pour Platon, le principe de non-contraction était une garantie de la vérité, et les polémiques entretenues entre théologiens monothéistes, orthodoxes ou hérétiques, sont autant de « sophismes ». Car les dieux ont déposé dans notre âme rationnelle des « notions communes », dont Zoroastre saura formuler les vérités, léguées au fil des âges.

- 4) Retour à Zoroastre
La justification d’une doctrine, avant les Temps modernes, se situe aux origines, dans le passé le plus reculé. Pour discréditer une doctrine adverse, il est nécessaire de prouver qu’elle est une « nouveauté », ce que ne manquera pas de faire Pléthon à propos des monothéismes, qui appellera des « sophismes », et qui sont, pour lui des dégradations d’une sagesse archaïque transmise par une « chaîne » de guides (hodêgoi). Il s’agit donc de trouver quel a été le plus ancien législateur, qui a été le maître (didaskalos) originel. Les chrétiens, à la suite de Justin martyr, qui situe Moïse cinq mille ans avant le Christ, puis de Tatien, Clément d’Alexandrie, qui décrit un Logos pédagogue se servant de la Loi et des prophètes, Origène et Eusèbe de Césarée (au début de L’Histoire ecclésiastique), et en se référant aux historiens juifs, comme Artapanus, Eupolemus, Philon d’Alexandrie et Flavius Josèphe, ont avancé le thème du larcin : Platon devrait tout à Moïse. Clément et Eusèbe citent le pythagoricien Numénius : « Qu’est-ce en effet que Platon, sinon un Moïse qui parle attique ? » Il s’agit donc, pour Pléthon, de découvrir la date à laquelle Zoroastre a professé sa doctrine, ses principes (arkhas). Dans le Traité des Lois, Pléthon dit que Zoroastre est « le plus ancien des législateurs et des sages dont nous ayons mémoire », qu’il a été « pour les Mèdes et les Perses et la plupart des autres anciens de l’Asie l’interprète le plus illustre des choses divines et du plus grand nombre des autres grandes questions. » Ayant vécu 5000 ans avant la guerre de Troie (d’après Plutarque – en fait, l’auteur des Gathas – Zarathoustra, en avestique - prophète des Aryens (« Nobles »), peuple indo-européen originaire du nord-est de l’Iran, a peut-être vécu vers -1700), il est à l’origine d’une chaîne d’or qui aboutit à Pythagore et Platon. Il serait aussi, pour Pléthon, l’inspirateur des Oracles chaldaïques, qui, sous Marc-Aurèle, auraient été recueillis par deux théurges chaldéens, Julien le Père, et son fils Julien, et transmis par Psellos (XIe siècle). Ils seraient, une fois rattachés à la tradition des « mages », des révélations philosophiques du prophète iranien, que Pléthon purgera des scories chaldaïques et chrétiennes, et qui constitueront le « centre de gravité » (Brigitte Tambrun, qui en reproduit une traduction) de son système. Ils « présentent l’itinéraire de l’âme, sa descente dans le corps, le service qu’elle doit accomplir sur terre, puis sa remontée ».

Le terme « mage » est étranger, ici, à la tradition chrétienne. Majûs, en arabe comme en persan, désigne les « Anciens Sages de la Perse », à ne pas confondre avec les « Mages mazdéens », adeptes du dualisme, contrairement à Zoroastre, qui affirme un principe unique à l’origine du monde. En grec, magos peut se référer à celui qui pratique la theôn therapeia, le culte des dieux, ou au goês, le magicien. La confusion peut s’effectuer aussi, en grec, entre mages et Chaldéens (qui s’occupent d’astronomie, et qui peuvent être rattachés, de près ou de loin, à la tradition zoroastrienne). Le but de Pléthon est de disqualifier le monothéisme en évinçant Moïse de la liste des sages primordiaux. Il détaille une liste de législateurs, dont le dénominateur commun est avant tout l’immortalité de l’âme, base morale de toute application des lois : d’abord Zoroastre, puis Eumolpe, Minos, Lycurgue, Iphitos et Numa. Trois de ceux-ci représentent la Crète, Sparte et Rome. Ensuite, il évoque les brahmanes de l’Inde, ou gymnosophistes, les mages de Médie, et les Courètes. Il faut s’attarder sur ces desservants de Zeus, qui exécutent, dans un bruit étourdissant, une danse en armes énergique.
Pour Pléthon, ils sont les défenseurs et les conservateurs de la tradition polythéiste. Ils ont un rôle éthique et militaire. Selon la mythologie, grâce à eux, les géants, allégorie du monothéisme, qui assaillaient les dieux, ont été défaits. D’autre part, ils sont des prêtres de Zeus, autrement dit le premier principe, et le philosophe hellène porte un intérêt particulier pour l’oracle de Zeus à Dodone, peut-être le plus antique « centre de la fondation de l’hellénisme », dont les prêtres, les Selloi, ou Helloi, portent un nom hautement significatif. Pléthon récuse l’approche mystique du divin, sa vision directe, illustrée par le courant néoplatonicien et les palamites. L’écoute lui paraît plus adéquate. Il mentionne aussi Polyide, que Minos consultait, puis le centaure Chiron, éducateur de héros, enfin des sages, rattachés au courant pythagoricien et platonicien, Pythagore, Platon, Parménide, Timée, Plutarque, Plotin, Porphyre et Jamblique. Le philosophe néoplatonicien, Proclus, l’un des membres de l’Ecole d’Athènes, fermée par Justinien, qui s’exilèrent en Perse en 529, et qui est assidûment étudié à Byzance, est absent de cette liste (en même temps qu’Homère, Orphée : Pléthon se méfie des poètes ; quant à Hermès, la confusion qu’on en a fait avec Moïse le pousse à le refuser).
- 5) Sohrawardi
Avant d’expliquer pourquoi Proclus est rejeté, il faut revenir sur la découverte que fit Pléthon, dans sa jeunesse, auprès d’Elisha, un Juif, mais en fait un hellênistês, peut-être un disciple de l’école du platonicien Sohrawardi, de Zoroastre et des mages de Perse, ce qui permettra d’en comprendre les raisons. La doctrine de celui qui revivifia l’avicennisme par un retour aux sages iraniens est un philosophe de la lumière orientale, c’est-à-dire de la lumière qui se lève. Or, pour Sohrawardi, la lumière n’est pas une métamorphose, ou pas seulement, mais aussi le principe métaphysique qui manifeste tout existant, et lui donne tout l’éclat de l’Etre. Du premier principe au bas de l’échelle des êtres, tout est régi par un même lien. La lumière s’oppose aux Ténèbres, ce en quoi consiste l’enseignement des Sages de l’ancienne Perse. Le symbolisme de la lumière et du feu, omniprésent dans les Oracles chaldaïques, sera essentielle dans la théologie de Pléthon. Pour bien en saisir l’essence, il est nécessaire de les lire dans l’ouvrage de B. Tambrun, et de parcourir les commentaires qui les accompagnent. Mais pourquoi Pléthon a-t-il dédaigné le grand Proclus, malgré l’insinuation de Scholarios qu’il en fît sa source cachée ?
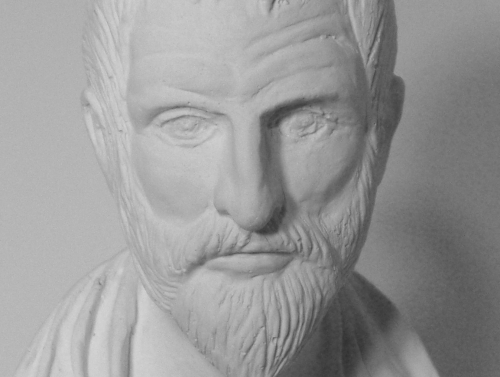
- 6) Rejet de Proclus et d’une partie du néoplatonisme, notamment l’apophatisme.
Les points communs entre les deux philosophes platoniciens appartiennent à la tradition néoplatonicienne (B. Tanbrum en donne la liste, que je reproduis en la raccourcissant p. 153-154-155) : composition d’une théologie à partir de Platon et des Oracles, existence d’un premier principe qui est cause (aitia), production du monde sensible par l’intermédiaire d’un monde intelligible, pluralité unitaire des dieux, conçus comme des idées, divinisation des planètes et des astres fixes, dégradation progressive de l’être, rapport proportionnel entre les causes et leur mode de production, existence de plusieurs ordres de réalité, de plusieurs ordres de dieux, dont le nombre est fini, et dont les deux principes primordiaux sont le limitant et l’illimité. De plus, la génération des dieux diffère selon les différents niveaux ontologiques, les réalités divines sont produites, chaque ordre dérive d’un seul principe, il y a communauté entre les dieux, les propriétés des dieux et leurs attributions ne sont pas équivalentes, chaque dieu a son rang, il y a ressemblance des dérivés par rapport aux êtres dont ils sont issus. Les points divergents ont, en revanche, des conséquences majeures : la théologie scientifique de Proclus se fonde sur le « Parménide », traité de théologie de Platon qui a influencé aussi Plotin. Or, il est à la source de l’apophatisme païen et chrétien.

Pléthon, fortement inspiré par l’Hymne à Zeus, d’Aristide Aelius, s’oppose aussi bien au pseudo-Denys qu’à Grégoire Palamas et à Thomas d’Aquin, et surtout aux acquis du concile de Nicée au sujet du Divin. Pour le néoplatonisme, le premier principe est transcendant de manière absolue, il est « hors de tout et incoordonné à ses dérivés ». Proclus dit : ce dieu est « au-delà des premiers aduta, plus ineffable que tout silence et plus inconnaissable que toute existence ». Or, Pléthon « procède exclusivement par voie de théologie affirmative ». Le dieu ne se cache pas. Pour lui, il est communicable (sauf le fait d’être par soi), il n’est pas absolument transcendant, même s’il est un et unique. Surtout, il est générateur, démiurge, démiurge des démiurges. Zeus est désigné par de très nombreuses qualifications : il est père, démiurge et roi, c’est-à-dire basileus ou autokrator ; il est dit maître, c’est-à-dire despotês absolu, tandis que Proclus identifie le démiurge comme troisième père de la première triade des dieux intellectifs. « Pour Pléthon, le premier dieu est aussi dit réellement être, et être en soi (autoôn), véritablement un et un en soi (autoen), bon en soi (autogathos), parfait en soi (autotelês) ; il est véritable Janus ; il est aussi qualifié d’inengendré, de bienheureux au plus haut degré ; il est noble par essence, il est doux ; il est cause ultime et premier chef, le plus haut de tous (panupertatos), tout-puissant (pagkratês), engendrant toutes choses (paggenetôr) », enfin « être par lui-même (auto dia sauton) ». Nous verrons quelles les implications politiques d’une telle capacité de l’homme à pouvoir connaître le premier dieu.
- 7) Une théologie polythéiste
Pléthon est résolument polythéiste. Il s’agit d’un polythéisme hiérarchisé, dont les divinités sont énumérées dans l’ordre d’une « échelle », terme désignant les taktika de l’époque, les titres et fonctions de la nomenclature impériale, et de ceux qui leur sont subordonnés. Il développe cette vision dans son « livre secret », le Traité des lois, celui-là même, et pour cette raison, qui encourra l’ire de Scholarios. Il reprend les noms des dieux de la tradition grecque, mais en leur faisant subir des distorsions (diastrophas), en les « redressant » par la réflexion, et en les transformant de façon à y placer une intention rationnelle. Ses dieux sont des « Dieux-Idées », que le néoplatonisme utilise régulièrement. Sans exposer une théogonie assez savante et subtile, et non moins cohérente (voir le tableau de B. Tambrun page 159, avec son exégèse), il est nécessaire d’en présenter la logique.
- 8) Une théologie généalogique
La clé de cette théologie – opposée à celle du néoplatonisme, pour qui l’on n’est pas le genre suprême, est la conception d’un panthéon généalogique. Les Dieux-Idées ne sont pas hétérogènes, ils sont apparentés, engendrés, « et sortent l’un de l’autre », à partir de l’Être-Un-Bien : « […] Zeus, premier principe et première cause, engendre deux « genres » (genê), c’est-à-dire deux familles, de dieux hypercosmiques, et celles-ci engendrent à leur tour les autres êtres » (B. Tambrun). « Zeus engendre le deuxième dieu qui est aussi le deuxième père, Poséidon ou l’ousia, (le Noûs, l’Intellect de Plotin), et de lui proviennent des générations de dieux et d’êtres », jusqu’à la matière. Il s’agit là d’un système en miroir, « chaque niveau de l’ousia reflétant le niveau immédiatement supérieur ». Tous les êtres sont donc rassemblés en un seul genre, eph’ hen genos.

La fraternité hiérarchique préside le monde des dieux, et le monde terrestre en est l’analogie. « Le monde est bien un kosmos, un bel ordonnancement où les êtres sont assignés à une place et à un rang déterminé ». Le mal en est exclu. Pléthon est résolument optimiste. En outre, la matière est exempte de toute uniformisation et réduction, d’arasement rationaliste, car le mode de génération est fondé sur le processus de la division par dichotomie, qui est explicitation et création (démiurgie), du sommet de l’être à la base, et par production de l’altérité, qui est le double inverse du producteur. Le principe de l’identité-altérité conduit le monde, donc, à ce titre, est accessible à la raison dans sa richesse liée à sa diversité, et liant l’universel au particulier. C’est pourquoi le problème religieux est appréhendé selon le mode du « même » (l’arkhê zoroastrien générant la théorie des déclinaisons de la sagesse éternelle) et de l’ « autre » (les différentes philosophies, religions et Eglises qui ont existé au fil des âges, avec leurs langues, leurs particularités ethniques, historiques, et se sont plus ou moins éloignées de l’origine). Une théologie universelle est donc possible, « située au niveau des formes intelligibles », ces « notions communes » qui donnent la possibilité de compréhension d’un monde où tout est uni selon le même principe, sont des symboles, semés « en puissance » par le démiurge, que chaque âme possède pour saisir la raison des êtres.
Politique
Pléthon reprend la conception byzantine qui veut que le modèle politique prenne sa source dans celui de la théologie. Cependant, pour lui, il n’existe pas de peuple élu, chaque civilisation ayant sa propre raison d’être.
- 1) Les origines de la catastrophe, selon Pléthon
Tout membre de l’empire, au XVe siècle, pour peu qu’il eût quelque lumière de l’antiquité, devait être saisi par le contraste tragique entre la misère des temps et la grandeur de la Grèce païenne. D’où cette catastrophe prenait-elle sa source ? Les souvenirs de Saint Augustin et les circonstances de la rédaction de La Cité de Dieu reviennent à l’esprit. L’évêque d’Hippone répondait en effet aux détracteurs du christianisme, à ceux qui expliquaient la prise de Rome, en 410, par Alaric, par l’abandon des divinités ancestrales de l’Urbs. De même, Julien, à la suite de ceux qui prônaient une restauration des cultes polythéistes, avait tenté de renouer le fil brisé des dieux.

Et que dit Pléthon ? Il constate que le démembrement de l’empire des Rhomaioi est dû aux luttes intestines, mais aussi à la faillite de l’idéologie monothéiste. Le simple fait de perdre sa puissance, à l’époque, « prouve » que l’on est abandonné de Dieu. Après avoir vaincu les dieux nationaux, l’empire chrétien a imposé un culte qui s’est voulu universel, et que l’on avait l’intention d’étendre à la terre entière. C’était le postulat eusèbien qui repose la vérité religieuse sur la puissance de la monarchie constantinienne, argument qui se retourne en ce quinzième siècle, époque qui est l’aboutissement d’une série de catastrophes. Outre ce réquisitoire d’ordre idéologico-historique, Pléthon recourt à une critique interne à la conception qu’a Eusèbe du modèle politique de la monarchie. En effet, en considérant le pouvoir divin, prototype de la monarchie, comme une triade (la Trinité nicéenne), et non comme une monade, en posant l’identité entre le Père et le Fils (contre l’arianisme), il instaure une isotomia, c’est-à-dire une égalité d’honneurs, une égalité entre principes divins qui devraient être hiérarchisés, et postule donc deux causes à la réalité du monde, donc à la structure politique de l’empire. L’universalité monothéiste « orthodoxe » devient non seulement une coquille vide, mais aussi le modèle de l’impuissance politique, d’autant plus qu’il est menacé par d’autres monothéismes, celui des Latins et celui de l’Islam ottoman.
- 2) Un programme de restitutio politique
Les institutions des anciens Grecs ayant fait leurs preuves, il convient de s’en inspirer. Contre les ploutocrates, ou la trop grande pauvreté, Pléthon recommande que les conseillers du prince fussent instruits et vivant dans une aurea mediocritas. S’inspirant de Sparte, (si la terre exerce une influence déterminante sur la pensée, il n’est pas indifférent que ce fût sur l’antique sol de Lacédémone qu’il soumit à ses compatriotes les instruments de leur salut) et constatant que le modèle du paysan corvéable, ou celui du mercenaire intéressé, ne sont pas viables, dans le Mémoire pour Théodore, le Mémoire pour Manuel (1418) et le Traité des lois, il propose une refondation du corps social en trois classes bien distinctes. « En toute cité ou presque, la première classe, la plus nécessaire et la plus nombreuse, est celle des producteurs, écrit-il dans le Traité des lois, c’est-à-dire des agriculteurs, des pâtres et de tous ceux qui se procurent directement les fruits de la terre », ceux qu’il nomme les « hilotes », en souvenir de Sparte. La deuxième classe (qui n’est mentionnée que dans le second Mémoire) est intermédiaire et tenue dans un état d’infériorité. Elle aide à produire (les ouvriers agricoles) ou à se procurer des produits (les négociants). Cette « classe » en est à peine une : en homme de la terre, Pléthon rejette le mercantilisme et le modèle oligarchique vénitien, et prône l’autarcie économique. La troisième classe est celle des dirigeants (les « gardiens » de Platon et les « philosophes »), c’est-à-dire l’armée, l’administration (les archontes), le basileus (l’empereur). Cette classe ne peut exercer efficacement son office qu’en étant dégagée des soucis de la production et des tentations du négoce, donc en étant nourrie par les deux autres par un impôt sur le revenu (en nature), cet impôt étant par ailleurs réparti en trois parts (en fait deux) : pour les producteurs et les propriétaires (mais la terre est commune et concédée par l’Etat), et pour ceux qui assurent la sécurité. Ces trois (deux en fait) strates sont attachées par l’intérêt réciproque, la vertu, et la fidélité à des valeurs communes. Pléthon propose donc un système d’armée permanente, loyale et solide, un corps civique préoccupé d’abord du souci national, de la patrie, plutôt que du sort de l’Eglise et de la religion, telles qu’elles sont dans le cadre de l’empire. D’autre part, les fonctions civiles et militaires seront bien distinctes. Enfin, il insiste, dans son traité de 1439, Des vertus, sur la nécessité d’appliquer vigoureusement ces lois, application illustrant la vertu des dirigeants.

- 3) La cité vertueuse
Toutes les exhortations destinées aux responsables politiques, à Manuel, à Théodore, aux nobles, visent à ce qu’ils ne désespèrent pas de la cause grecque, et qu’ils se persuadent que la victoire dépend de la fidélité à des principes et à des valeurs. La puissance d’un Etat tient aux idées qui régissent son organisation, et à la vertu des hommes qui l’incarnent. Un exemple parmi d’autres, du lien entre principes spirituels et comportement, est la source des succès musulmans. Pléthon y décèle deux causes : d’abord, la conviction que l’âme est immortelle, croyance qui rend la mort moins redoutable, et même, d’une certaine façon, qui la présente sous un jour favorable, dans le cadre du jihad, puis la certitude que le destin (Mektoub, « ce qui était écrit », l’équivalent arabe du fatum) mène le jeu, que la liberté (au sens moderne) n’existe pas (de là peut-être son intérêt pour l’astronomie, peu dégagée, à l’époque, de l’astrologie, et qu’il explicite dans un manuel), et que chaque sort est imparti par une nécessité transcendante, conviction qui libère l’énergie en prodiguant à l’être la sensation de se réaliser pleinement, sans crainte d’être paralysé par l’assaut de choix fallacieux, facteurs d’hésitations nuisibles.
Dans le Traité du Destin, contenu dans le Traité des lois, il compare les humains à des douloi, des esclaves, (ils sont « sous la main », hupo kheira) – les fonctionnaires sont des esclaves de la chose publique, des douloi tou koinou - esclaves dont le sort ne peut être malheureux sous l’emprise d’un bon maître (cf. notre mot « ministre », minister, « serviteur », dérivé de ministerium, « ministère », « devoir », « service »). Le tout est de prendre conscience de cette « nécessité », et, pour le reste, de faire confiance à la volonté divine. La force des armées ottomanes, pour Pléthon, est à comparer favorablement avec celle des anciens Hellènes, qui mettaient très haut, à un niveau supérieur à celui des dieux, la Moïra, issue de l’ousia de Zeus, l’ Heimarmenê des stoïciens, la « part », le « lot » de chaque être. Pour Pléthon, c’est Héphaistos, «préposé à la « stasis », au repos, au maintien, fixe « à chacun son domaine et sa place » » (B. Tambrun).
L’hybris, par exemple, est la tentative vaine de transgression de ces limites imparties par le destin. « […] véritablement trois Parques (Moirai) tiennent sous leur garde vigilante la parfaite réalisation de ce que chacun des Dieux a décidé par la plus excellente délibération », écrit-il dans le Traité des lois. Le droit naturel est conditionné par les idées adéquates sur le monde divin. Celles-ci ont pour base le constat que le monde terrestre est intimement uni, par analogon, au monde céleste, que les dieux gouvernent toutes choses, avec rectitude et justice.
Pléthon, à l’opposé des pratiques cultuelles des fidèles, notamment dans les monastères, considère que, le « divin » (thèîon) octroyant à chaque être la part qui lui revient selon ce qui lui convient, il est inutile de vouloir le fléchir ou le flatter. La divinité n’a pas besoin des hommes. La piété consiste dans la reconnaissance des biens qui proviennent de là-haut. Du reste, l’éthique, la morale, le comportement des hommes doivent se moduler sur le Bien, équivalant à l’Un et à l’Être en soi. Autant dire que l’homme, comme Dieu, est bon. La morale de Pléthon est optimiste. Il s’éloigne par-là de la tradition néoplatonicienne. En effet, pour elle, la vertu supérieure consiste à se séparer le plus possible du corps et des richesses matérielles. Il faut procéder à un éloignement de la vie d’ici-bas, comme le préconise Platon dans le Théétète : « … il faut, le plus vite possible, s’enfuir d’ici, là-bas ». La « justice » doit tendre vers l’intelligence, la tempérance, le courage, et la sagesse, qui est contemplation des êtres. Or Pléthon « introduit une restriction considérable à l’imitation de Dieu par l’homme ». Il est beaucoup plus proche de la morale stoïcienne.

L’homme étant placé à la limite (methoriôi) entre la matière périssable et le monde divin immortel, auquel nous sommes apparentés, l’âme se trouvant entre deux genres de formes (il emploie le terme metaxu), le composé humain étant methorion et sandesmos, limite commune et lien de l’univers, , mélange (mixis), son pneuma rendant possible cette jonction, il appartient à deux patries qui, au fond, ne forment qu’une Cité. Il est redevable de la société (koinônia), cette société s’étendant verticalement et horizontalement, et étant fondée sur le principe de l’association, une « sympathie » vis-à-vis de tout ce qui survient. Il « se trouve au centre de la « cité complète des êtres » (tôn ontôn têi pantelei têide polei). Il est un centre nodal. L’homme est donc à la ressemblance des dieux. Comme eux, il doit se charger de son lot de devoirs. Il possède une véritable mission. De lui dépend l’harmonie universelle. Il doit tenir son poste, son rang dans la société et le monde. Il est copula mundi, car il est le lien entre plusieurs cercles concentriques, sa famille, sa patrie, son domaine, sa terre, l’univers. Son action est un service, une leitourgia. Il est en effet le médiateur par excellence, celui par qui passent les dimensions de l’être, et il prend la place du Christ. Nouvel Hercule, il ne peut se soustraire à sa tâche. Là est sa dignité. La doctrine théologico-politique de Pléthon est une propédeutique à l’action.
- 4) Un Etat monarchique analogue au monde divin
La structure de l’empire doit être calquée sur celle de la famille. Cette notion, d’origine commune et de filiation, est essentielle pour Pléthon. Il rejette la conception d’un empereur « lieutenant de Dieu sur terre », d’un empire à vocation militaire. Certes, le monde politique reflète l’archétype divin, l’ordre céleste. Mais chaque strate, si elle est semblable par l’origine ultime avec celle qui la précède et l’engendre, en est en même temps différente. Chaque maillon de la chaîne hiérarchique possède sa « part », son rôle, son devoir. L’empereur, comme le premier dieu, fonde une lignée, qui est une diffusion hiérarchique de la puissance politique. Mais chaque « fils », ou chaque condition est une créature à part entière. Il n’existe pas, chez Pléthon, cette abolition des limites, des puissances intermédiaires entre le pouvoir central et les exécutants, comme l’implique la conception palamite, qui supprime la distance entre l’homme et Dieu, et, finalement, aboutit à un écrasement, à un nivellement universel. Chaque rouage recrée le pouvoir transmis, comme les dieux le font dans le domaine. Le basileus, qui n’est pas un magistrat (il n’est pas élu), n’est pas un tyran. Il est certes, pour ainsi dire, partout à la fois, mais il délègue son pouvoir. Il doit exister des « centres de relais décisionnels entre [l’empereur] et ses sujets ». Il « faut une adaptation des décisions impériales à la variété des réalités locales ».

- 5) Le genos comme paradigme universel
On voit par là que le modèle généalogique est un paradigme politique. Toute sa pensée est régie par ce principe universel. « Or déjà Plotin (Ennéades, VI, 1 [42] 2 et 3) montrait que si l’ousia était un genre unique (ou une unique catégorie), cela ne pourrait être qu’au sens où les Héraclides forment un seul « genos », non parce qu’ils ont tous un prédicat commun, mais au sens où ils sont tous issus d’un seul (aph’ henos) ». Cette référence aux Héraclides (Hêrakleidôn kathodos), leur retour dans le Péloponnèse, qui est à l’origine de la « race » des Grecs, est mise en parallèle avec le retour des frères de l’empereur Jean VIII Paléologue, en qui il voit l’aube d’une renaissance hellénique. C’est à cette fin qu’il invoque le « germe » d’où peut resurgir la puissance hellénique, Sparte-Mistra, en plein cœur du Péloponnèse, le berceau de l’âme de l’Hellade. Il écrit en effet à Manuel II : « … nous, que vous gouvernez et dont vous êtes l’empereur nous sommes Hellènes de genos, comme l’attestent notre langue et la culture de nos pères. Et pour les Grecs il n’est pas possible de trouver un pays qui leur soit plus propre et qui leur convienne mieux que le Péloponnèse et toute la partie de l’Europe qui lui est contiguë ainsi que les îles adjacentes. En effet, c’est manifestement le pays que les Grecs eux-mêmes ont toujours habité, du moins d’après les souvenirs que les hommes ont conservés ; personne d’autre ne l’avait habité avant eux et aucun étranger ne l’a occupé ».
- 6) Un monde apaisé
D’après Georges de Trébizonde relate qu’à Florence, Pléthon aurait prédit qu’il n’y aurait plus qu’une seule religion. Il ne s’agissait évidemment pas de concilier l’inconciliable, c’est-à-dire des dogmes figés par le temps et des certitudes ancrés dans des préférences chauvines. Le concile de Ferrare-Florence en avait montré l’inanité. Or, le retour à l’Arkhê, aux origines de la sagesse primordiale portée par Zoroastre, le premier Sage à partir de qui est engendrée cette « chaîne d’or » qui passe par Pythagore et Platon, « apparaît comme particulièrement propre à servir de référence commune à une multiplicité d’Etats bien cloisonnés qui pourront disposer chacun d’une version particulière de cette doctrine ». Pléthon a conscience que le platonisme irrigue la philosophie musulmane chiite de Perse et la tradition byzantine, et constate qu’il se répand en Occident latin. Ce substrat spirituel commun ne va-t-il pas être reconnu universellement, et servir, non à une fusion des particularités nationales, qui est impossible, et de toute façon non souhaitable, mais à une entente, plutôt à une écoute capable de juguler les expansionnismes, et même d’asseoir une paix universelle fondée sur la quête harmonieuse de la vie vertueuse ? Des notions sont communes à ces civilisations, comme la reconnaissance de réalités intelligibles, la thèse de l’immortalité de l’âme. D’autre part, le polythéisme rectifié peut souffrir d’être perçu, par les théologies qui en nient le principe, comme une relation d’Idées acceptable. Les coutumes seraient donc sauvegardées, avec leurs spécificités politiques, les constitutions idoines (Pléthon s’oppose cependant à la vision qu’avait Julien l’empereur de dieux ethnarques (ou d’anges, selon le Pseudo-Denys), divinités tutélaires des nations), mais une cohabitation pacifique serait possible grâce à un référent conjoint, pour ainsi dire par la reconnaissance d’un même paggenetôr, chaque nation étant elle-même genos (suggeneis, « de même parenté »), c’est-à-dire reflet du modèle divin.
14:26 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie politique, pléthon, byzance, hellénité, polythéisme, hellénisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 05 février 2022
L'hédonisme autarcique de l'école cyrénaïque
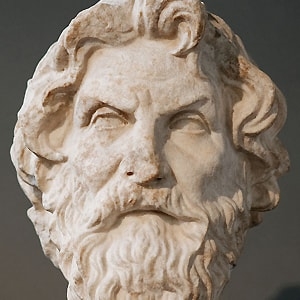
L'hédonisme autarcique de l'école cyrénaïque
Écrit par "Noorglo"
Ex: https://www.liberecomunita.org/index.php/filosofia/243-l-edonismo-autarchico-della-scuola-cirenaica
L'école cyrénaïque s'est développée à Cyrène, une ville grecque d'Afrique du Nord, dans la première moitié du IVe siècle av. J.C. L'école s'est formée quelques décennies après la mort de son initiateur Aristippe, un Cyrénéen qui avait émigré à Athènes, étudié avec Socrate et Protagoras, puis était retourné dans sa patrie pour diffuser sa pensée. Plus qu'une véritable école, on devrait parler d'une direction philosophique variée et non unique.

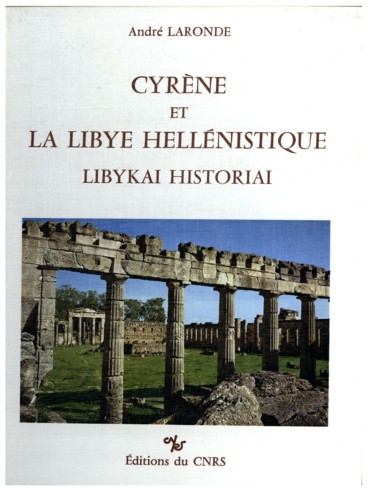
L'histoire de l'école cyrénaïque commence avec Aristippe de Cyrène, né vers 435 av. Il est venu à Athènes à un jeune âge et est devenu un disciple de Socrate. Nous disposons de peu d'informations sur ses déplacements après l'exécution de son maître en 399 avant J.-C., bien qu'il ait vécu un certain temps à la cour de Dionysius Ier de Syracuse. On ne sait pas exactement quelles doctrines philosophiques attribuées à l'école cyrénéenne ont été formulées par Aristippe. Diogène Laertius, à la suite de Diction le Péripatéticien et de Panetios, propose une longue liste de livres attribués à Aristippe, bien qu'il rapporte également que Sosicrate a déclaré qu'il n'avait rien écrit.
Parmi ses élèves, il y avait sa fille Arete, qui a transmis ses enseignements à son fils, Aristippe le Jeune. C'est lui, selon Aristocle de Messène, qui transforma les enseignements de son grand-père en un système complet, bien qu'il soit encore possible de dire que les bases de la philosophie cyrénaïque furent posées par Aristippe l'Ancien.
Plus tard, l'école se scinde en différentes factions, représentées par Annicéris de Cyrène, Hégésias de Cyrène, Théodore l'athée, qui développent des interprétations opposées de la philosophie cyrénaïque, dont beaucoup sont une réponse au nouveau système hédoniste posé par Épicure. Au milieu du IIIe siècle avant J.-C., l'école cyrénaïque était devenue obsolète ; l'épicurisme avait dépassé ses rivaux cyrénaïques en offrant un système plus sophistiqué.
L'école de philosophie cyrénaïque a donc été fondée par Aristippe, qui a fait du plaisir le but premier de l'existence. École non homogène, l'école cyrénaïque devait s'articuler intérieurement en diverses nuances éthiques et ne se retrouver que plus tard et en partie dans l'épicurisme. Épicure, en effet, a doté sa doctrine hédoniste d'un fondement ontologique et gnoséologique absent chez les Cyrénaïques, développant leur pensée exclusivement sur le terrain d'une éthique de la vie quotidienne, pragmatique et loin des principes théoriques. Aristippe caractérise cette orientation philosophique sur la base de l'anthropocentrisme, du sensualisme absolu, de la recherche du plaisir corporel et de l'autosuffisance individualiste.
Ce dernier point, qui caractérise l'hédonisme d'Aristippe, se traduit par l'énonciation d'un individualisme extrême et d'une autosuffisance non loin du cynisme, avec un certain mépris des conventions sociales et de toute tradition. Le plaisir immédiat et dynamique va de pair avec l'individualisme de la recherche du plaisir, embrassant chaque moment de l'existence qui peut l'offrir et sous quelque forme que ce soit. Seuls les faits humains sont dignes d'intérêt et les phénomènes naturels ne sont dignes d'intérêt que s'ils produisent du plaisir.
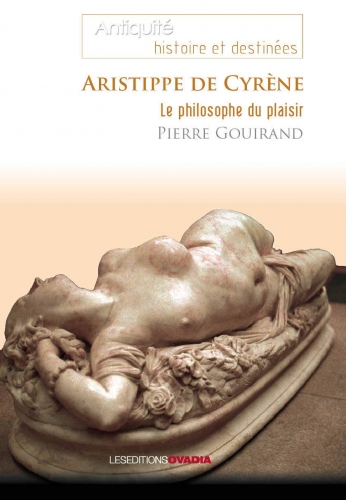
Mais l'autosuffisance, cet important principe aristippéen, concerne aussi le plaisir, qu'il faut poursuivre sans en devenir dépendant, car s'il est toujours bon, donc à poursuivre en toute situation et circonstance, s'il devient possédé, il doit être abandonné car l'autosuffisance et l'autonomie individuelle sont au-dessus de tout.
Le vrai plaisir est toujours et dans tous les cas dynamique (et non pas l'aponeia épicurienne = "absence de douleur") et constitue le véritable moteur positif de l'existence d'une personne, qui est une succession discontinue d'instants et qui doit être vécue uniquement dans le présent, en ignorant le passé et le futur : c'est une formulation ante litteram du soi-disant carpe diem, un message qui trouvera des adeptes et des interprètes surtout parmi de nombreux intellectuels du monde latin. Enfin, le phénoménalisme d'Aristippe est absolu, puisqu'il soutient que seul ce qui est perçu est réel: ce réductionnisme sensoriel et individualiste révèle également chez Aristippe des références indubitables à la philosophie sophistique.

Plusieurs chercheurs ont tendance à déplacer la théorisation de l'hédonisme cyrénaïque d'Aristippe (l'Ancien) à son petit-fils Aristippe le Métrodacte (également appelé Aristippe le Jeune) par l'intermédiaire de sa fille Arete (buste, ci-dessus), qui était une femme cultivée et sensible à la philosophie de son père. En d'autres termes, Aristippe l'Ancien se serait limité à orienter son comportement dans une direction hédoniste (mais tout de même avec une certaine mesure) et vers un certain détachement ironique aristocratique qui favorisait plutôt les éléments d'autonomie existentielle et d'autosuffisance. Selon cette interprétation, il se serait tenu à l'écart de l'hédonisme grossier dont l'école cyrénaïque fut souvent accusée par la suite.
Il serait resté fondamentalement un socratique, qui aurait conservé un certain détachement du plaisir, non sans réserves, exprimé dans l'aphorisme bien connu : "posséder le plaisir, mais ne pas être possédé par lui" (traduit en latin par habere non haberi). Il semble qu'il s'agissait d'une réponse à une critique concernant sa fréquentation d'une hétérosexuelle appelée Laide: "Je la possède, je ne suis pas possédé par elle" était sa réponse, ainsi que "il vaut mieux gagner et ne pas être esclave des plaisirs que de ne pas en profiter du tout".
Bien que, par conséquent, il ne recherchait pas seulement le plaisir catastématique "négatif" comme les épicuriens, mais surtout le plaisir cinétique et actif, Aristippe proposait la "mesure", contrairement à certains de ses élèves qui ont été définis comme proto-Libertins pour cette raison.
Après la mort du fondateur, l'école a d'abord été dirigée par sa fille Arete et son petit-fils Aristippe le Jeune. Les disciples d'Aristippe, comme nous l'avons déjà mentionné, ne constitueront jamais une école véritablement homogène, mais développent son hédonisme dans différentes directions. Cela peut être considéré comme une confirmation du manque de théorisation de sa philosophie, puisqu'il s'est limité à indiquer une direction éthique, qui à son tour peut être interprétée de diverses manières.
En dehors d'Aristippe le Jeune, dont nous avons parlé et auquel certains attribuent une intention de radicalisation dans le même cadre hédoniste, émergent comme successeurs ultérieurs trois personnages d'une profondeur notable, même s'ils ne sont pas très bien documentés, tous trois vivant entre la seconde moitié du IVe et la première moitié du IIIe siècle avant J.-C. (donc contemporains ou légèrement plus jeunes que le IIIe siècle avant J.-C.). (donc contemporains ou légèrement plus jeunes qu'Épicure) : Hégésippe, Annicéris (ou Annicerides) et Théodore l'athée.
Vision philosophique
Les Cyrénaïques étaient des hédonistes et croyaient que le plaisir, surtout le plaisir physique, était le bien suprême de la vie. Ils considéraient le type de plaisir physique comme plus intense et plus désirable que les plaisirs mentaux. Le plaisir était pour les Cyrénaïques le seul bien de la vie et la douleur le seul mal. Socrate avait considéré la vertu comme le seul bien humain, mais il avait également accepté un rôle limité pour son côté utilitaire, permettant au bonheur d'être un objectif secondaire de l'action morale. Aristippe et ses partisans en ont tiré parti et ont élevé le bonheur au rang de facteur primordial de l'existence, niant que la vertu ait une quelconque valeur intrinsèque.

Épistémologie
Les Cyrénaïques étaient connus pour leur théorie sceptique de la connaissance. Ils ont réduit la logique à une doctrine concernant le critère de la vérité. Selon eux, nous pouvons connaître avec certitude nos expériences sensorielles immédiates, mais nous ne pouvons rien savoir de la nature des objets qui provoquent ces sensations.
Toute connaissance est une sensation immédiate. Ces sensations sont des mouvements purement subjectifs, et sont douloureuses, indifférentes ou agréables, selon qu'elles sont violentes, tranquilles ou douces. En outre, elles sont entièrement individuelles et ne peuvent en aucun cas être décrites comme quelque chose qui constitue une connaissance objective absolue. La sensation est donc le seul critère possible de connaissance et de conduite. Les manières dont nous sommes affectés sont les seules que l'on puisse connaître, donc le seul but pour chacun doit être le plaisir.
Éthique
L'école cyrénaïque déduit un but unique et universel pour tous les hommes, à savoir le plaisir. Il s'ensuit que les plaisirs passés et futurs n'ont pas d'existence réelle pour nous, et que parmi les plaisirs présents il n'y a pas de distinction de genre. Socrate avait parlé des plaisirs supérieurs de l'intellect ; les cyrénaïques niaient la validité de cette distinction et affirmaient que les plaisirs du corps, plus simples et plus intenses, devaient être préférés. Le plaisir momentané, de préférence physique, est donc le seul bien pour les hommes.

Selon les Cyrénaïques, le sage doit avoir le contrôle des plaisirs plutôt que d'en être l'esclave, sinon il éprouvera de la douleur ; cela exige du jugement pour évaluer les différents plaisirs de la vie. Selon la doctrine cyrénaïque, les lois et les coutumes doivent être prises en compte, car bien qu'elles n'aient aucune valeur intrinsèque, leur violation entraînera des sanctions désagréables imposées par d'autres. De même, l'amitié et la justice sont utiles pour le plaisir qu'elles procurent.
Les derniers Cyrénaïques
Les cyrénaïques postérieurs, Annicéris de Cyrène, Hégésias de Cyrène, Théodore l'athée, ont tous développé des variantes de la doctrine cyrénaïque. Selon Annicéris, le plaisir est obtenu par des actes individuels de gratification, recherchés pour le plaisir qu'ils produisent ; Annicéris a beaucoup insisté sur l'amour de la famille, de la patrie, de l'amitié et de la gratitude, qui procurent du plaisir même lorsqu'ils exigent des sacrifices.

Hégésippide pense que le bonheur est impossible à atteindre et que, par conséquent, le but de la vie est d'échapper à la douleur et à la tristesse. Les valeurs traditionnelles telles que la richesse, la pauvreté, la liberté et l'esclavage sont toutes indifférentes et ne produisent pas plus de plaisir que de douleur. Selon le philosophe, l'hédonisme cyrénaïque était la façon la moins irrationnelle de gérer les peines de la vie.
Pour Théodore, en revanche, le but de la vie est le plaisir mental, et non le plaisir physique, et il s'attarde davantage sur la nécessité de la modération et de la justice. Dans une certaine mesure, tous ces philosophes tentaient de répondre au défi posé par l'épicurisme.
14:37 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, philosophie grecque, antiquité grecque, hellénisme, hellénité, cyrénaïques, cyrène, épicuriens, épicure |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 21 septembre 2020
Mais qu’est-ce qui est proprement grec?

Mais qu’est-ce qui est proprement grec?
Par Diego Sanchez Meca
Ex: http://www.in-limine.eu
Dernier paragraphe du texte de Diego Sanchez Meca, professeur de philosophie à l’université de Madrid, « Généalogie et critique de la philologie aux sources de Choses humaines, trop humaines », paru dans le recueil Nietzsche, Philosophie de l’esprit libre sous la direction de Paolo D’Iorio et Olivier Ponton, éditions Rue d’Ulm, pp. 89-95, 2004.
On pourrait dire que les écrits philologiques de Nietzsche entre 1871 et 1875 cherchent à déterminer ce qui est proprement grec. Et cette recherche se fait sans la passion qui caractérisait La Naissance de la tragédie et les écrits antérieurs et préparatoires, rédigés en particulier sous l’influence du romantisme de Wagner. Maintenant, lorsque Nietzsche analyse par exemple la vie religieuse, le culte des dieux, il est prêt à démystifier l’idée classiciste de la religion grecque comme « religion de la beauté », pour déterminer le sens authentique de sa fonction strictement politique. Dans le cadre de cette recherche de type généalogique, la religion est considérée comme une expression parmi d’autres de la culture grecque, dans laquelle on analyse les symboles qui l’expriment, les forces sous-jacentes à ces symboles et l’origine des ces forces.
Dans cette analyse Nietzsche remarque qu’il appartient à la mentalité magique sous-jacente au culte grec de croire que, tout comme on peut maîtriser la volonté des hommes en agissant sur leur corps, on peut influer sur la volonté des dieux ou des esprits en agissant sur leurs idoles ou sur les objets matériels dans lesquels ils habitent ou s’incarnent : c’est croire qu’il est possible de négocier avec les dieux et d’user de procédés pour les maîtriser et exercer un pouvoir sur eux. Par exemple, on peut essayer d’attirer leur sympathie avec des dons ou des offrandes ; nouer une alliance avec la divinité en l’engageant par une promesse, en obtenant en échange un otage comme symbole qui reste sous le contrôle humain et qui est enfermé et protégé comme garantie de l’accomplissement de ce qui a été promis ; on peut aussi célébrer des purifications pour éliminer les forces malignes, brûler les mauvais esprits ou les éloigner avec une musique. Tous ces éléments sont des contenus du culte grec primitif1. En cela les Grecs anciens ne sont pas une exception : chez tous les peuples primitifs l’aspect magique, symbolique et mimétique constitue une étape précédent la pensée causale, logique et scientifique.

Contrairement à ce qui se passe chez les autres peuples, à partir de cette intelligence impure et impuissante, de cet état mental prélogique et magique, se développent cependant chez les Grecs les plus grandes œuvres et les plus hauts produits de l’esprit. En quoi consiste la différence entre les Grecs anciens et les autres peuples primitifs, cette différence qui les rend exemplaires, uniques, classiques ? C’est qu’ils ne restent pas immobilisés dans la paresse des mœurs, comme le font les peuples non civilisés. Si, dans une situation primitive, les Grecs croient que la nature est régie par un arbitraire dépourvu de toute loi, leur grandeur consiste en ce qu’ils apprennent à classer leurs expériences en généralisant les données de leurs observations et en découvrant finalement des régularités et des lois dans le cours des événements naturels. Comment les Grecs atteignent-ils cet état mental plus mûr et vigoureux ? Comment acquièrent-ils cette sérénité et cette noblesse que reflètent l’art, la science et la poésie de leur meilleure époque ? Étant donné que cette sérénité n’est pas primitive, mais manifestement acquise ou conquise, quel est le processus – se demande Nietzsche – par lequel les Grecs passent de l’aspect monstrueux de leurs dieux originels à l’aspect rayonnant et lumineux des dieux olympiens ? Et enfin, comment l’anthropomorphisme de ces dieux se forme-t-il ?
Nietzsche part de l’idée que les cultures s’expliquent fondamentalement par le sentiment qui les fait naître et qui illumine ou assombrit le genre de vie qui s’y développe. La pensée généalogique de Nietzsche considère, dès le départ, que ce sont des métamorphoses d’une force fondamentale d’affirmation ou de négation de la vie qui font surgir une culture et qui la transforment. C’est pourquoi, ce qu’il essaie d’analyser maintenant c’est la transformation, dans la formation du peuple grec, d’un sentiment originaire de faiblesse, de peur et de terreur face à la vie – ce en quoi les Grecs ne diffèrent des autres peuples primitifs – en un sentiment opposé, c’est-à-dire une attitude d’affirmation inspirée par la force qui ne craint plus ni la vie ni ses énigmes. C’est cela que Nietzsche cherche dans l’étude de l’évolution qui mène à l’abandon des rites obscurs et des sacrifices sanglants par lesquels les Grecs essayaient à l’origine d’apaiser les puissances infernales, pour arriver, à l’époque classique, à une solidarité exceptionnelle avec la société imaginaire de leurs dieux :
-
Dans le culte des Grecs et dans leurs dieux, on trouve tous les indices d’un état archaïque, rude et sombre. Les Grecs seraient devenus quelque chose de très différent s’ils avaient dû y persévérer. Homère les a délivrés, avec cette frivolité qui est le propre de ses dieux. La transformation d’une religion sauvage et sombre en une religion homérique est tout de même le plus grand événement2

Ce changement peut être déterminé historiquement et il peut être illustré par une lecture attentive d’Homère, Hésiode et Eschyle. De la Grèce pré-homérique à celle de Phidias il y a une transformation profonde de la sensibilité qui apparaît comme un passage des ténèbres à la lumière. Dans des fêtes comme les Diasies, quel était le dieu auquel on offrait originairement l’holocauste expiatoire de la manière la plus sombre (méta stygnotètôn) ? Comment les esprits souterrains des ancêtres laissent-ils la place à Zeus Meilichios (doux comme le miel) ? Comment, en partant des dieux-arbres ou des dieux-animaux de l’origine, les figures rayonnantes d’Apollon, Héra, Artémis surgissent-elles ? Les dieux grecs étaient, dans leur origine la plus lointaine, les animaux sacrificiels. Ils portaient en eux la force vitale que l’homme s’appropriait en mangeant leur chair et en buvant leur sang. Comment l’animal auquel on attribuait une force divine aurait-il pu ne pas devenir objet de vénération ? Un progrès important est réalisé par la transformation de cette croyance, transformation impliquée par le fait que c’est un homme qui incarne le dieu, bien qu’il porte un masque d’animal. Cet homme, le prêtre ou le roi, a donc le pouvoir – qui appartenait auparavant à l’animal sacré – d’éloigner les épidémies, de provoquer la pluie ou de stimuler la fécondité des femelles. Les Grecs homériques appellent déjà leurs dieux avec des chants bouleversants et ceux-ci combattent à leur côté sur le front de leurs armées. Le monde commence à offrir un nouvel aspect lorsque la croyance selon laquelle il serait dominé par des forces arbitraires, incompréhensibles et terrifiantes (titans, gorgones, sphinx, serpents souterrains, etc.) se dissout et qu’on commence à penser qu’il est régi par des dieux-hommes à la splendeur sereine. C’est là pour Nietzsche la démonstration que la culture grecque, qui se caractérise fondamentalement – comme toute culture – par une certaine interprétation du monde et de l’homme, se transforme suivant un changement dans l’évaluation que l’homme grec fait de lui-même en tant qu’homme. La valeur que l’homme attribue aux choses et à lui-même modifie peu à peu sa substance et son pouvoir.
Le Grec homérique ne se considère pas originairement comme différent des dieux eux-mêmes. Contrairement à ce qui se passe chez les autres peuples primitifs, le sentiment de la différence essentielle entre les dieux et les hommes n’amène pas les Grecs à sous-estimer ce qui est humain, ni à s’humilier comme des esclaves :
-
Ils voient des dieux au-dessus d’eux, mais non comme des maîtres, ils ne se voient pas non plus eux-mêmes comme des serviteurs, à la manière des Juifs. C’est la conception d’une caste plus heureuse et plus puissante, un reflet de l’exemplaire le plus réussi de leur propre caste, donc un idéal et non un contraire de leur propre essence. On se sent en affinité complète. […] On a de soi-même une noble image, quand on se donne de tels dieux3.
Les Grecs se voient capables de vivre en société avec des puissances aussi différentes et terribles que l’étaient leurs dieux primitifs. Elles leur sont familières et ils cohabitent comme deux castes de puissance inégale, mais de même origine, sujettes au même destin et qui peuvent discuter sans honte ni crainte. En ce sens les dieux olympiens apparaissent comme le fruit d’un effort inégalable de réflexion dans lequel la force et l’équilibre triomphent. Au passage de la statue d’Athéna, sculptée par Phidias, les Grecs fermaient encore les yeux, de crainte d’être victimes de terribles malheurs : Athéna, symbole de la sagesse, conserve le mystère inquiétant de ces obscures forces primitives. Cependant, les Grecs instaurent avec leurs dieux une sorte de jeu politique dans lequel ces derniers dominent la relation, tandis qu’ils disposent des moyens symboliques pour les contrôler. Ceci explique la rigueur des formules rituelles et l’équilibre extraordinaire du culte grec, y compris dans sa capacité d’assimilation et de transformation. De là aussi sa place centrale et fondatrice dans la polis et les affreux châtiments qu’entraînait le délit d’asebeia (impiété).

De ce point de vue, le culte religieux, tout comme la tragédie, est une action (Handlung), un drame4, ainsi qu’une alliance, autrement dit un ordre, un monde, un cosmos. Le Grec parie sur une affirmation de soi dans le cadre de cette rivalité agonistique avec ses dieux, il croit en la maîtrise de l’esprit sur la nature et en l’aménagement du chaos par la clarté de l’ordre et de la beauté. En ce sens, tout comme le drame musical grec, le culte fait apparaître l’énigme de la génialité : « L’œuvre d’art est […] un moyen pour la perpétuation du génie5. » C’est en cela que la religion grecque se distingue des religions asiatiques. Pour les Grecs aussi, par exemple, le prêtre est le plus haut symbole de la relation entre les dieux et les hommes. Mais il n’en devient pas pour autant le « seigneur » des autres hommes. La famille, le clan, la phratrie, le démos ou la cité ont chacun leurs dieux et chacun de ces dieux a sa résidence dans un lieu et un temple précis. Il n’y a pas de dieux sous forme d’esprits diffus qui survoleraient le monde. Les dieux sont individuels et ils exigent d’être servis par un culte particulier et par des prêtres déterminés. La fonction sacerdotale en Grèce est intimement mêlée à la vie de la polis, elle n’est pas organisée en corporations ou hiérarchisée, tout comme cela arrive avec les dieux, leurs idoles ou les lieux de culte.
D’autre part, la substitution des dieux olympiens aux forces infernales primitives et aux esprits des morts n’entraîne pas la répression des enthousiasmes religieux originaires, même les plus brutaux. La religion grecque, contrairement par exemple à la religion italique primitive jusqu’à l’avènement de l’Empire romain, est un chaos de formes et de notions de différentes origines dans lequel les Grecs surent mettre de l’ordre et de la beauté. Dans ce processus d’organisation aucun culte ne fut aboli ni repoussé : dans le panthéon grec les dieux étrangers se confondirent avec les dieux grecs6. Cet éclectisme montre jusqu’à quel point les Grecs classiques conservent les énergies ancestrales présentes dans leurs origines : c’est une manière naïve de dire que celles-ci ne sont pas perdues. C’est pourquoi l’on peut dire que la véritable magie des grecs est en ce sens celle par laquelle ils arrivent à transfigurer les passions humaines. À la vie humaine, pleine de misère et de souffrances, les Grecs opposent l’image de leurs dieux comme image d’une vie facile et resplendissante. Dans cette opposition, la véritable grandeur de l’homme consiste à souffrir héroïquement :
-
Du reste, au temps d’Homère, l’essence grecque était achevée ; la légèreté des images et de l’imagination était nécessaire pour calmer et libérer l’esprit démesurément passionné. La raison leur parle-t-elle, oh ! comme la vie leur paraît dure et cruelle. Ils ne s’abusent pas. Mais ils mentent pour jouer avec la vie : Simonide conseilla de prendre la vie comme un jeu : la douleur du sérieux leur était trop connue. La misère des hommes est une jouissance pour les dieux, quand on la leur chante. Les Grecs savaient que seul l’art peut faire de la misère une jouissance7.
Avec sa magie, l’homme calme la fureur des immortels, mais en même temps, cette magie le séduit lui-même et le transforme, car la douleur transformée en force et en une plus grande résistance est ce qui nous élève à la condition divine.

C’est ainsi que l’étude du monde préhomérique, duquel a surgit l’hellénisme, nous montre une époque sombre, pleine d’atrocités, de ténèbres et d’une sensualité funèbre, une période de cruauté, de crimes et d’implacables vengeances. L’originalité des Grecs consiste en ce que ce spectacle permanent d’un monde de lutte et de cruauté ne conduit pas au dégoût de l’existence, ni à concevoir celle-ci comme châtiment expiatoire pour quelque crime mystérieux qui toucherait aux racines de l’être. Ce pessimisme n’est pas le pessimisme grec. L’exemplarité des Grecs anciens consiste dans le fait d’avoir été capables de s’adapter à un monde enflammé par les passions les plus déchaînées, sans les réprimer ni les repousser. Leur pessimisme est le pessimisme de la force qui accepte comme légitimes tous les instincts qui font partie de la substance de la vie humaine en essayant de sublimer leur énergie. Et sur la base de cette affirmation initiale ils ont su construire une nouvelle mythologie et une culture fascinante : « Les ‘’dieux à la vie facile’’ sont le suprême embellissement que le monde ait reçu en partage ; comme il est difficile de le vivre dans le sentiment8. »
Ces dieux gardent une image avec des traits sombres, qui ne peuvent pas s’effacer complètement, mais qui fonctionnent comme de sublimes allégories qui ne résolvent pas les contradictions de la vie humaine en des intuitions rationnelles, claires et distinctes. Ce n’est qu’à l’époque de la décadence grecque que la pensée rationnelle, qui se veut affranchie du pathos de la mythologie et de la sensibilité religieuse, réduit l’image des dieux à une pure fantaisie mythique de poètes et d’artistes. Les dieux olympiens, ridiculisés par Xénophane, laissent la place au Nous d’Anaxagore, au Bien de Platon et à la tuchè d’Épicure. C’est ainsi que la sérénité grecque se dénature déjà dans la philosophie. Mais avant cela, le culte assume une extraordinaire fonction de formation, de spiritualisation des instincts en tant que forces naturelles dangereuses et de sublimation des impulsions violentes, sauvages et capables de détruire l’humanité de l’homme. La violence et la souffrance se transforment avec cette religion qui les sublime et cette sublimation est l’essence de la culture grecque, à l’opposé de la tâche d’apprivoisement de d’intoxication des instincts qu’accomplira le christianisme, comme tâche fondamentale de débilitation et de déformation de l’homme moderne.
1« Le culte religieux est à rapporter au fait d’acheter ou de mendier la faveur des divinités. Cela dépend du degré de crainte qu’on éprouve à l’égard de leur défaveur. - Par conséquent, là où l’on ne peut ou ne veut pas obtenir un succès par sa propre force, on cherche des forces surnaturelles : et donc à soulager la peine de l’existence. Quand on ne peut pas ou quand on ne veut pas réparer quelque chose par l’action, on demande grâce et pardon aux dieux, et l’on cherche donc à soulager la conscience oppressée. Les dieux ont été inventés pour la commodité des hommes : et finalement leur culte est la somme de tous les délassements et de tous les divertissements. » Fragments Posthumes 5 [150] 1875
2Fragments Posthumes 5 [165] 1875. Cf. FP 3 [17] 1875 : « la manière de voir sceptique : l’héllénité sera reconnue comme le plus bel exemple de la vie » ; cf. aussi FP 3 [65] 1875.
3PF 5 [150] 1875.
4« Presque tous les cultes comprennent un drame, une action mimétique, un fragment de mythe représenté qui se réfère à la fondation du culte ».
5FP 7 [139] 1870-1871.
6Nietzsche insiste sur le fait que, malgré tout ce qu’ils empruntent aux autres peuples, les Grecs font preuve de génialité pour l’originalité de l’interprétation et de l’élaboration de ce qu’ils reçoivent : « Les Grecs comme le seul peuple génial de l’histoire du monde ; ils le sont même comme élèves, ce qu’ils savent être mieux que quiconque parce qu’ils ne se contentent pas d’utiliser ce qu’ils empruntent pour le décor et la parure : comme le font les Romains. La constitution de la Polis est une invention phénicienne : même cela, les Hellènes, l’ont imité. Pendant longtemps, comme de joyeux dilettantes, ils ont appris d’un peu tout le monde d’alentour ; l’Aphrodite aussi est phénicienne. Au reste, ils ne désavouent pas du tout ce qu’ils ont d’importé et de non originel. » FP 5 [65] 1875.
7FP 5 [121] 1875 ; cf. aussi FP 5 [71] 1875.
8FP 5 [105] 1875.
18:40 Publié dans archéologie, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : grèce, grèce antique, antiquité grecque, philosophie, esthétique, classicisme, antiquité gréco-romaine, hellénisme, hellénité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 04 décembre 2017
L’esclave-expert et le citoyen

L’esclave-expert et le citoyen
À propos de : Paulin Ismard, La Démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne, Seuil
 Recensé : Paulin Ismard, La Démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne, Paris, Seuil, 2015, 273 p., 20 €.
Recensé : Paulin Ismard, La Démocratie contre les experts. Les esclaves publics en Grèce ancienne, Paris, Seuil, 2015, 273 p., 20 €.Dans la démocratie athénienne, avec la rotation de ses magistrats et de ses conseillers choisis pour un an, ceux qui, « à l’occasion », tenaient lieu d’experts stables, étaient, selon Paulin Ismard, les esclaves publics, mais ils n’incarnaient l’État que comme « pure négativité » (p. 30), car ils étaient, en tant qu’esclaves, exclus de la sphère politique. D’où le sous-titre du livre : Les esclaves publics en Grèce ancienne. Qui étaient ces esclaves publics (dêmosioi) et quel était leur rôle ? C’est le premier objet du livre.
Esclavages publics antiques et modernes
On lit d’abord de brillantes et utiles analyses sur l’historiographie de l’esclavage, que Paulin Ismard résume de façon extrêmement claire et convaincante, avec ses différentes « vagues » de comparaisons très idéologiques entre l’Antiquité et l’esclavage en Amérique, tantôt pour opposer l’humanité des Anciens à la cruauté des Modernes, tantôt pour légitimer l’esclavage moderne, tantôt pour le condamner comme on condamnait l’esclavage antique. Moses I. Finley y a ajouté la distinction entre sociétés à esclaves et les véritables sociétés esclavagistes (qui seraient apparues à dans l’Athènes classique). Cette historiographie laissait de côté de nombreux aspects du si divers et si massif « phénomène esclavagiste ». Les travaux des anthropologues permettent maintenant de mieux comprendre les différents types d’esclaves royaux, et plus généralement « les esclaves publics » qui sont l’objet du livre.
Mais la genèse des dêmosioi dans la Grèce archaïque est problématique. Paulin Ismard tente d’abord de suggérer (« un fil ténu », p. 32, « un sentier étroit », p. 42) une sorte de continuité entre les artisans (dêmiourgoi) de l’époque archaïque et les dêmosioi de l’âge classique. Il conduit agréablement le lecteur des aèdes et des héros attachés aux rois chez Homère à l’ingénieux Dédale, que son savoir a conduit à l’esclavage auprès des rois qui voulaient l’avoir à son service, selon un schéma traditionnel (attesté par exemple chez Hérodote pour le médecin Démocédès, au service du roi Darius) : sa mention par Xénophon, selon Paulin Ismard, « loin d’être innocente », ferait de Dédale « l’emblème du mal que le régime démocratique fait à celui qui sait » — une conclusion qui peut sembler faiblement étayée (p. 46-47). Quelques contrats conservés entre une cité et un dêmiourgos à l’époque archaïque dans diverses cités non démocratiques permettent de mieux observer les conditions concrètes de leur emploi : un archiviste en Crète, un scribe près d’Olympie. Dans un « constat » dont il reconnaît qu’il est « hypothétique », Paulin Ismard y voit « le statut de dêmosios confusément défini » (p. 53). Il est difficile cependant d’adhérer à la notion d’un « passage progressif du dêmiourgos de l’archaïsme au dêmosios de l’époque classique » : l’âge classique, bien sûr, et particulièrement à Athènes, continue d’avoir des dêmiourgoi libres et citoyens en abondance. Pour Aristote, il est vrai, dans une petite cité, on pourrait à la rigueur concevoir une équivalence entre esclaves publics et artisans effectuant des travaux publics (Politique, II, 7, 1267b15 : un texte difficile, qui pourrait être examiné). L’hypothèse traditionnelle lie le développement des esclaves publics aux progrès de la démocratie athénienne, avec ses institutions complexes et la rotation des charges qui limitait la continuité de l’action publique, et au développement, « main dans la main » (selon une célèbre formule de Finley associant démocratie et société esclavagiste, p. 58), de l’esclave-marchandise à Athènes.
Platon, dans un texte étonnant du Politique (290a), évoque « le groupe des esclaves et des serviteurs » dont on pourrait imaginer qu’ils constituent le véritable savoir politique de la cité. L’étude des esclaves publics éclaire la volonté platonicienne de séparer ceux que Paulin Ismard appelle joliment « les petites mains des institutions civiques » (p. 66) et le véritable homme politique. Pourtant, assistance aux juges, archivage, inventaires, comptabilité, surveillance de la monnaie, des poids et mesures, police, tout cela, que décrit très clairement et très utilement Paulin Ismard dans son chapitre « Serviteurs de la cité », était confié aux esclaves publics. Certaines tâches, rémunérées, attribuées le cas échéant par vote des citoyens, donnaient accès à des privilèges civiques ou religieux, comme la prêtrise de certains cultes. D’autres esclaves en revanche étaient affectés à divers chantiers, en grand nombre, si l’on pense à ceux qui exploitaient les mines du Laurion en Attique, qui ne sont pas examinés dans le livre, car ils ne rentrent guère dans la perspective adoptée. Par rapport à d’autres types d’esclaves publics, l’originalité grecque tiendrait à l’absence d’esclaves publics travaillant la terre (mais la documentation est limitée) ou enrôlés dans les armées (cela est corrigé p. 118 : il y avait de nombreux esclaves, en tout cas, dans la marine). Au total, les dêmosioi constituaient donc un ensemble extrêmement disparate, qui n’a jamais formé un corps, d’esclaves acquis surtout par achat.
Dans une inscription de la fin du IIe siècle, bien après la démocratie classique, à propos d’un préposé aux poids et mesures à Athènes, il est question d’une eleutheria (qu’il faudrait corriger en el[euth]era) leitourgia, un « service libre » : pour Paulin Ismard, un « service public » au sens où il assure la liberté des citoyens. Cette formule restituée, tardive et unique condenserait « le paradoxe qui réside au cœur du ‘miracle grec’, celui d’une expérience de la liberté politique dont le propre fut de reposer sur le travail des esclaves » (p. 92). Les esclaves publics grecs, bien que « corps-marchandises », étaient (ajoutons : parfois) d’« étranges esclaves » (chapitre 3), jouissant de certains privilèges des citoyens, dont l’accès à la propriété et peut-être à une certaine forme de parenté, ce qui pose quelquefois le problème de la distinction entre esclave et citoyen libre. L’emploi du mot dêmosios suffit-il en effet à établir la qualité servile ? L’épigraphiste Louis Robert mentionne un édit déplorant que des hommes libres exercent « une fonction d’esclaves publics », ainsi qu’une épitaphe commune à Imbros pour un citoyen de Ténédos et son fils qualifié de dêmosios, et conclut qu’un dêmosios avec patronyme doit désigner un homme libre exerçant des tâches publiques (BE 1981, 558). Le sens de ce type de patronyme est incertain. Pour le corpus assez comparable des actes d’affranchissements delphiques, où se pose aussi cette question, Dominique Mulliez observe que le nom au génitif renvoie au père naturel de l’affranchi, sans préjuger du statut juridique de la personne ainsi désignée ; il s’agit parfois de l’ancien maître de l’affranchi, lequel peut ou non se confondre avec le prostates. En ce qui concerne les dêmosioi, Paulin Ismard estime, lui, que « l’ensemble de la littérature antique (…) associe invariablement le statut de dêmosios au statut d’esclave » (p. 109). Il propose en ce sens une analyse nouvelle du statut d’un certain Pittalakos mentionné dans un plaidoyer d’Eschine, un dêmosios qu’il ne juge assimilé à un homme libre dans une procédure que faute d’un propriétaire individualisable. En Grèce, les esclaves publics pouvaient même recevoir des honneurs publics, ce qui interdit, note très justement Paulin Ismard, de faire de l’honneur une ligne de partage universelle entre liberté et esclavage (contrairement aux thèses de certains anthropologues).

Expertise, esclavage et démocratie
Paulin Ismard se situe résolument dans la perspective du « malheur politique » contemporain, la séparation entre le règne de l’opinion et le gouvernement des experts : un savoir politique utile ne peut plus naître « de la délibération égalitaire entre non-spécialistes ». L’État, défini comme « organisation savante » (p. 11), exclut le peuple. C’est le second objet du livre que de situer la démocratie athénienne (et non plus « la Grèce ancienne ») par rapport à cette perspective. « L’expertise servile » y serait « le produit de l’idéologie démocratique », « qui refusait que l’expertise d’un individu puisse légitimer sa prétention au pouvoir » et cantonnait donc les experts hors du champ politique (p. 133, répété avec insistance).
Mais la documentation ne permet d’atteindre que quelques experts esclaves : des vérificateurs des monnaies, ayant seuls le pouvoir et la capacité d’en garantir la validité, un greffier dans un sanctuaire. Le cas de Nicomachos, chargé par Athènes de la transcription des lois pendant plusieurs années consécutives, est différent : on le connaît par des sources hostiles, qui insistent sur le fait que c’est un fils de dêmosios, mais c’est un citoyen athénien, qui n’a un « statut incertain » que dans la polémique judiciaire : voici donc un citoyen expert. Ce n’est pas le seul. Paulin Ismard lui-même évoque une page plus tôt les cas célèbres d’Eubule et de Lycurgue en matière financière ; et que dire, en matière militaire et diplomatique, de Périclès, réélu 14 fois stratège consécutivement ? Ajoutons, à un moindre niveau, les secrétaires mentionnés par la Constitution d’Athènes aristotélicienne : leur contrôle ne peut guère avoir été seulement « formel ».
Sur le plan idéologique, le fameux mythe de Protagoras, dans le Protagoras de Platon, explique que, contrairement aux compétences techniques réservées chacune à un spécialiste (à un dêmiourgos), une forme de savoir politique, par l’intermédiaire des notions de pudeur (ou respect) et de justice, a été donnée à tous les hommes. On y trouverait donc « une épistémologie sociale qui valorise la circulation de savoirs, même incomplets, entre égaux », « une théorie associationniste de la compétence politique », comme celle que développe l’historien américain Josiah Ober dans ses ouvrages récents sur la démocratie athénienne. Protagoras veut pourtant montrer — c’est le raisonnement qui explique ensuite le mythe dans le dialogue de Platon — que si tous les citoyens doivent partager une compétence minimale, il y a des gens plus compétents que d’autres en politique, et des maîtres, comme lui, pour leur enseigner cette expertise. Signalons à ce propos la virulence de ce débat dans le libéralisme radical anglais du XIXe siècle. John Stuart Mill, rendant compte en 1853 de l’History of Greece du banquier et homme politique libéral George Grote, cite avec enthousiasme ses pages sur le régime populaire :
« The daily working of Athenian institutions (by means of which every citizen was accustomed to hear every sort of question, public and private, discussed by the ablest men of the time, with the earnestness of purpose and fulness of preparation belonging to actual business, deliberative or judicial) formed a course of political education, the equivalent of which modern nations have not known how to give even to those whom they educate for statesmen / Le fonctionnement journalier des institutions athéniennes (qui habituaient chaque citoyen à entendre la discussion de toute sorte de question publique ou privée par les hommes les plus capables de leur temps, avec le sérieux et la préparation que réclamaient les affaires politiques et judiciaires) formait un cursus d’éducation politique dont les nations modernes n’ont pas su donner un équivalent même à ceux qu’elles destinent à la conduite de l’État ».
En revanche, lorsqu’un peu plus tard, en 1866, il commente un autre livre célèbre de Grote, Plato and the other Companions of Socrates, il condamne le relativisme qui est selon lui la conséquence inéluctable de sa position, et affirme avec Platon « the demand for a Scientific Governor » (« l’exigence d’un gouvernant possédant la science »), c’est-à-dire, dans les conditions modernes du gouvernement représentatif, « a specially trained and experienced Few » (« Un petit nombre de spécialistes éduqués et entraînés »).
« La figure de l’expert, dont le savoir constituerait un titre à gouverner, (…) était inconnue aux Athéniens de l’époque classique » (p. 11, 16) : c’est la thèse centrale. Le mot « expert » est ambigu. Le « gouvernement » des Athéniens s’exerçait principalement par l’éloquence, sous le contrôle des citoyens, dans une démocratie directe : c’est donc dans la maîtrise de l’éloquence que se logeait pour une part l’expertise de ceux que Mill appelle « the ablest men of the time ». La question de la rhétorique, qui est sans cesse débattue à l’époque, est absente dans le livre de Paulin Ismard, car aucun esclave n’a accès à la tribune. Or, comme Aristote l’écrit (et comme Platon le pensait), même la formation technique de certains citoyens à la rhétorique devait inclure une expertise politique extérieure à la technique du langage : « les finances, la guerre et la paix, la protection du territoire, les importations et les exportations, la législation » (Rhétorique I, 4, 1359b).

« Polis », Cité, État
Le dernier chapitre aborde un autre point central de la réflexion sur l’Athènes classique, la notion de « Cité-État ». Après Fustel de Coulanges et sa « cité antique », a été inventé pour décrire les formes grecques d’organisation politique le concept de « Polis », ce « dummes Burckhardtsches Schlagwort » [1] (Wilamowitz), qu’on traduit ordinairement par « Cité-État ». Paulin Ismard, lui, prend ses distances à l’égard des travaux récents de l’historien danois Mogens H. Hansen, qui aboutissent à distinguer polis et koinônia, « cité » et « société » : il n’y a pas, selon lui, de polis distincte qui correspondrait peu ou prou à l’État moderne, la communauté athénienne « se rêvait transparente à elle-même » (p. 172). Dans cette perspective, confier l’administration, la bureaucratie (Max Weber est évoqué) aux esclaves publics permettait de « masquer l’écart inéluctable entre l’État et la société », dans une « tension irrésolue ».
L’esclave royal qui déclenche la tragédie d’Œdipe dans l’Œdipe-Roi de Sophocle détient le savoir qui met à bas les prétentions au savoir du Roi : voilà l’image que le « miroir brisé » de la tragédie tend pour finir, par l’intermédiaire de Michel Foucault, à Paulin Ismard. Le Phédon lui offre mieux encore : un dêmosios, le bourreau officiel d’Athènes, apportant le poison à Socrate, est accueilli par le philosophe comme le signe de l’effet qu’il suscite bien au-delà d’Athènes et des Athéniens, si bien que cet esclave se trouve placé dans la « position éminente » du « témoin ». De façon un peu étrange, le baptême du premier des Gentils, l’eunuque éthiopien des Actes des Apôtres complète ce « fil secret » (une métaphore récurrente) de « l’altérité radicale », « un ailleurs d’où peut se formuler la norme » (p. 200).
En fin de compte, la figure de l’esclave public, dont cet ouvrage remarquablement écrit propose une analyse très fouillée et neuve, sans toujours entraîner la conviction, permet à Paulin Ismard de mettre à distance le rêve de transparence qu’incarne pour beaucoup (par exemple pour Hannah Arendt) la démocratie athénienne classique.
Aller plus loin
On pourra lire la controverse, brièvement évoquée dans ce compte rendu, entre Christophe Pébarthe (Revue des Etudes Anciennes, 117, 2015, p. 241-247) et Paulin Ismard).
Sur George Grote et John Stuart Mill, voir Malcolm Schofield, Plato. Political Philosophy, Oxford, 2006, 138-144.
Sur la question de la science politique et de la rhétorique, voir une première approche dans Paul Demont, « Y a-t-il une science du politique ? Les débats athéniens de l’époque classique », L’Homme et la Science, Actes du XVIe Congrès international de l’Association Guillaume Budé, Textes réunis par J. Jouanna, M. Fartzoff et B. Bakhouche, Paris, Les Belles Lettres, 2011, p. 183-193.
Pour citer cet article :
Paul Demont, « L’esclave-expert et le citoyen », La Vie des idées , 25 novembre 2015. ISSN : 2105-3030. URL : http://www.laviedesidees.fr/L-esclave-expert-et-le-citoyen.html
02:30 Publié dans Histoire, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démoncratie athénienne, athènes, athènes antique, antiquité, hellénisme, hellénité, humanités classiques, humanités gréco-latines, philologie classique, histoire, grèce, grèce antique, livre, théorie politique, philosophie politique, sciences politiques, politologie, expertocratie, experts |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 21 juin 2016
The Four Elements of National Identity in Herodotus
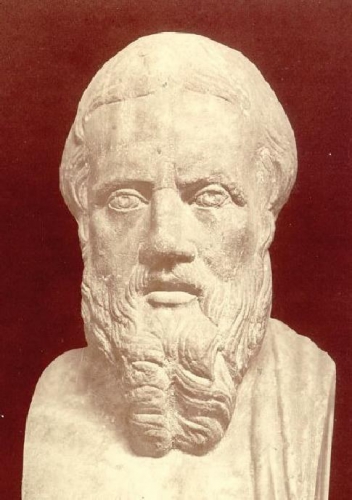
The Four Elements of National Identity in Herodotus
By Martin AurelioThe Western Classical notion of identity comes to us from Herodotus’ Histories, written in the 5th century B.C. It’s from Herodotus that we have the story of the 300 Spartans at Thermopylae, told in the broader context of the entire Hellenic world’s successful resistance of the Persian invasion. In order to do that, the Spartans (Dorians) and Athenians (Ionians) had to overcome their differences and join together to defend what was common to both of them as Greeks.
In Book VIII, there is a scene in which the Athenians explain to a messenger from Sparta why the Spartans should side with the Athenians and not the Persians. (It should be remembered that both the ancient Greeks and ancient Persians were Indo-European peoples.)
“First and foremost of these is that the images and buildings of the gods have been burned and demolished, so that we are bound by necessity to exact the greatest revenge on the man who performed these deeds, rather than to make agreements with him. And second, it would not be fitting for the Athenians to prove traitors to the Greek people, with whom we are united in sharing the same kinship and language, with whom we have established shrines and conduct sacrifices to the gods together, and with whom we also share the same way of life.” (VIII:144.2)
In this passage are no less than four criteria for being a Greek, or Hellene: common religion, common blood, common language, and common customs. (One could argue that customs are almost entirely derivative of religion and blood, but we will stick to the four-part formulation in the text.) That was 2500 years ago, but in my opinion this is still the best and most comprehensive working definition of national identity. This is because one can extract it fro m this particular situation in ancient history and apply it to virtually anywhere in the world at any time. The four elements of identity are either present or absent, to varying degrees, and a people are correspondingly either strong or weak.
The story of the Greek resistance to Persian tyranny is the story of the self-realization and self-actualization of a people. When the four elements of identity are in place, they work together synergistically to form a kind of collective body, capable of functioning as an organic whole. The Persian army was numerically much stronger than the Greek, but most of their soldiers were conscripts from conquered territories who were forced into service. They were Persians in name only.
It’s interesting to note that the Athenians tell the Spartan messenger that the most important reason for opposing the Persians is their desecration of Greek religious shrines. (It should be remembered that the Spartans were known as both the fiercest warriors of the ancient world and also the most pious, dividing their time more or less equally between military training and religious ritual. How Evolian.) The Classical notion of identity is thus supportive of the Traditionalist view of the primacy of religious faith — that “culture comes from the cult,” as Russell Kirk put it — but it also checks it by including the other criteria. Common faith alone will not suffice, even if it is ultimately the most important unifying factor of a culture.
It should also be noted that the Classical definition of identity comes to us from a time prior to the reign of Homo economicus. (Though even then, Herodotus has the Persian king Cyrus mocking the Athenians for having “a place designated in the middle of their city [the agora, marketplace] in which they gather to cheat each other.”) It is a formula for the cohesion of a people and the health of a culture. It is not necessarily a formula for dominance in the world, particularly economic dominance.
Finally, the Classical definition of identity represents an ideal, a standard. As with other standards, there are bound to be deviations and variations. Elsewhere in The Histories, Herodotus tells us that the Athenians were originally Pelasgians — pre-Indo-European inhabitants of Greece — who “learned a new language when they became Hellenes.” (I:57.3 – I:58) The dominant influence on Classical Greek culture and identity was probably Dorian, the Indo-Europeans who conquered Greece from the north. But these Pelasgians were apparently able to assimilate and “become Hellenes,” although history shows us that Athens was always culturally and spiritually different from Sparta. Still, at the time of the Greco-Persian war, the Athenians and Spartans must have had enough in common for the Athenians to cite the four elements of their common identity to the Spartan messenger.
But the further one moves from the quadripartite Classical definition of identity, the more the strength and cohesion of a people is diluted. This is so because the elements which give rise to feelings of otherness gain in power, and consequently the elements of commonality diminish. Classical identity works because it’s based on nature, both human psychological nature and larger biological nature.
Applying this model to the history of Western civilization, we can see that the peak of Western identity in terms of cohesion and strength was probably the Middle Ages. Despite the diversity of European customs and languages, Latin was the lingua franca that united the educated peoples of every European country, and Christianity was the faith of the whole continent. One could go to any church in Western Europe and partake in the same Latin mass. The racial identity of Europeans was, I think, a given — an obvious fact of nature that need not even be dwelt upon. This entire scenario stands in stark contrast to contemporary Europe and North America, where racial, linguistic, religious and cultural diversity are pushed to further and further extremes, with predictable consequences.
The coming together of the greater Hellenic world to resist the Persian invasion offers an inspiration and a model for contemporary Western people who value their identity and heritage. However, it should also be remembered that ultimately, the differences between Athens and Sparta proved greater than their commonalities, and the two city-states destroyed each other in the Peloponnesian War, a mere fifty years or so after their shared victory over the Persians.
Perhaps the unspoken fifth element of identity is a common enemy.
Source: https://martinaurelio.wordpress.com/2016/06/11/four-eleme... [2]
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hérodote, antiuité grecque, grèce antique, hellénisme, hellénité, philologie classique, théorie politique, philosophie, philosophie politique, sciences politiques, politologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 15 juin 2016
The Ancient Greeks: Our Fashy Forefathers

The Ancient Greeks:
Our Fashy Forefathers
By Guillaume Durocher
Ex: http://www.counter-currents.com
Nigel Rodgers
The Complete Illustrated Encyclopedia of Ancient Greece [2]
Lorenz Books, 2014
“Western civilization” is certainly not fashionable in mainstream academia these days. Nonetheless, the ancient Greek and Roman heritage remains quietly revered in the more thoughtful and earnest circles. Quite simply, virtually all of our social and political organization, to the extent these are thought out, ultimately go back to Greek forms, reflected in the invariably Greek words for them (“philosophy,” “economy,” “democracy” . . .). Those who still have that instinctive pride of being European or Western always go back to the Greeks, to find the means of being worthy of that pride.
Thus I came to the Illustrated Encyclopedia produced by Nigel Rodgers. Life is short, and lots of glossy pictures certainly do help one get the gist of something. Rodgers does not limit himself to pictures of ancient Greek art, though that of course forms the bulk. There are also photos of the sites today, to better imagine the scene, and many paintings from later epochs imagining Greek scenes, the better show Greece’s powerful influence throughout Western history. The Encyclopedia is divided into two parts: First a detailed chronological history of the Greek world, second a thematic history showing different facets of Greek life.
 The ancient Greeks are more than strange beings so far as post-60s “liberal democracy” is concerned. Certainly, the Greeks had that egalitarian and individualist sensitivity that Westerners are so known for.
The ancient Greeks are more than strange beings so far as post-60s “liberal democracy” is concerned. Certainly, the Greeks had that egalitarian and individualist sensitivity that Westerners are so known for.
Many Greek cities imagined that their legendary founders had equally distributed land among all citizens. As inequality and wealth concentration gradually rose over time, advocates of redistribution would cite these founding myths. (Rising inequality and revolutionary equality seems to be a recurring cycle in human history.)
Famously, Athens and various other Greek cities were full-fledged direct democracies, a kind of regime which is otherwise astonishingly rare. This was of course limited to only full male citizens, about 10 percent of the population of this “slave state.” (Alain Soral, that eternal mauvaise langue, once noted that the closest modern state to democratic Athens was . . . the Confederate States of America.)
The Greeks were individualists too, but not in the sense that Americans are, let alone post-60s liberals. Their “kings” seem more like “chiefs,” with a highly variable personal authority, rather than absolute monarchs or oriental despots.
In all other respects, the Greeks were extremely “fash”: misogynistic, authoritarian, warring, enslaving, etc. One could say that, by the standards of the United Nations, the entire Greek adventure was one ceaseless crime against humanity.
The most proto-fascistic were of course the Spartans, that famous militaristic and communal state, often idealized, as most recently in the popular film 300. Sparta would be a model for many, cited notably by Jean-Jacques Rousseau and Adolf Hitler (who called the city-state “the first Volksstaat). Seven eighths of Sparta’s population was made of helots, subjects dominated by the Spartiate full-time warriors.
The Greeks generally were enthusiastic practitioners of racial citizenship. Leftists have occasionally (rightly) pointed to the fact that the establishment of democracy in Athens was linked to the abolition of debt. But one should also know that Pericles, the ultimate democratic politician, paired his generous social reforms with a tightening of citizenship criteria to having two Athenian parents by blood. (The joining of more “progressive” redistribution with more “exclusionary” citizenship makes sense: The more discriminating one is, the more generous one can be, having limited the risk of free-riding.)
In line with this, the Greeks practiced primitive eugenics so as to improve the race. The most systematic in this respect was Sparta, where newborns with physical defects were left in the wilderness to die. By this cruel “post-natal abortion” (one can certainly imagine more human methods), the Spartans thus made individual life absolutely secondary to the well-being of the community. This is certainly in stark contrast to the maudlin cult of victimhood and personal caprice currently fashionable across the West.

Athenian democracy was also known for the systematic exclusion of women, who seemed to have had lives almost as cloistered and private as that of pious Muslims. The stark limitations on sex (arranged marriages, the death penalty for adultery) may have also contributed to the similar Greek penchant for pederasty and bisexuality. Homosexuals were not a discrete social category (how sad for anyone to make their sexual practices the center of their identity!). Homosexual relationships, in parallel to wives, were often glorified as relations of the deepest friendship and entire regiments of male lovers were organized (e.g. the Sacred Band of Thebes [3]), with the idea that by such bonds they would fight to the death.
To this day, it is not clear if we have ever matched the intellectual and moral level of the Greeks (and I do not confuse morality with sentimentality, the recognition of apparently unpleasant truths is one of the greatest markers of genuine moral courage). Considering the education, culture (plays), and politics that a large swathe of the Greek public engaged in, their IQs must have been very high indeed.
Some argue we have yet to surpass Homer in literature or Plato in philosophy. (In my opinion, our average intellectual level is clearly much lower and our educated public probably peaked in consciousness and morality between the 1840s and 1920s. Our much superior science and technology is of no import in this respect, we’ve simply acquired more means of being foolish, something which could well end in the extinction of our dear human race.)
Homer’s influence over the Greeks was like “that of the Bible and Shakespeare combined or to Hollywood plus television today” (29). (Surely another marker of our catastrophic moral and intellectual decline. Of course, in a healthy culture, audiovisual media like cinema and television would be propagating the highest values, including the epic tales of our Greek heritage, among the masses.)

Homer glorified love of honor (philotimo) and excellence (areté), a kind of individualism wholly unlike what we have come to know. This was a kind of competitive individualism in the service of the community. They did not glorify individual irresponsibility or fleeing one’s community (which, to some extent, is the American form of individualism). If the hoplite citizen-soldiers did not fight with perfect cohesion and discipline, then the city was lost.
Dominique Venner has argued [4] that Homer’s Iliad and Odyssey should again be studied and revered as the foundational “sacred texts” of European civilization. (I don’t think the Angela Merkels and the Hillary Clintons would last very long in a society educated in “love of honor” and “excellence.”)
Plato, often in the running for the greatest philosopher of all time, was an anti-democrat, arguing for the rule of an enlightened elite in the Republic and becoming only more authoritarian in his final work, the Laws. Athenian democracy’s chaos, defeat in war with Sparta, and execution of his mentor Socrates for thoughtcrime no doubt contributed to this. Karl Popper argued Plato, the founder of Western philosophy, paved the way for modern totalitarianism, including German National Socialism.
The Greek city-states were tiny by our standards: Sparta with 50,000, Athens 250,000. One can see how, in a town like Sparta, one could through daily ritual and various practices (e.g. all men eating and training together) achieve an incredible degree of social unity. (Of course, modern technology could allow us to achieve similar results today, as indeed the fascists attempted and to some extent succeeded.) Direct democracy was similarly only possible in a medium-sized city at most.
The notion of citizenship is something that we must retain from the Greeks, a notion of mutual obligation between state and citizen, of collective responsibility rather than the selfish tyranny of ethnic and plutocratic mafias. Rodgers argues that polis may be better translated as “citizen-state” rather than “city-state.” The polis sometimes had a rather deterritorialized notion of citizenship, emigrants still being citizens and in a sense accountable to the home city. This could be particularly useful in our current, globalizing age, when technology has so eliminated cultural and economic borders, and our people are so scattered and intermingled with foreigners across the globe.
The ancient Greeks are also a good benchmark for success and failure: Of repeated rises and falls before ultimate extinction, of successful unity in throwing off the yoke of the Persian Empire (with famous battles at Thermopylae and Marathon . . .), and of fratricidal warfare in the Peloponnesian War.
The sheer brutality of the ancient world, as with the past more generally, is difficult for us cosseted moderns to really grasp. Conquered cities often (though not always) faced the extermination of their men and the enslavement of their women and children (often making way for the victors’ settlers). Alexander the Great, world-conqueror and founder of a still-born Greco-Persian empire, was ruthless, with frequent preemptive murders, hostage-taking, the razing of entire cities, the crucifixion of thousands, etc. He seems the closest the Greeks have to a universalist. (Did Diogenes’ “cosmopolitanism” extend to non-Greeks?) The Greeks thought foreigners (“barbarians”) inferior, and Aristotle argued for their enslavement.

The Greeks’ downfall is of course relevant. The epic Spartans gradually declined into nothing due to infertility and, apparently, wealth inequality and female emancipation. Alexander left only a cultural mark in Asia upon natives who wholly failed to sustain the Hellenic heritage. One Indian work of astronomy noted: “Although the Yavanas [Greeks] are barbarians, the science of astronomy originated with them, for which they should be revered like gods.”
One rare trace of the Greeks in Asia is the wondrous Greco-Buddhist statues [5] created in their wake, of serene and haunting otherworldly beauty.
The Jews make a late appearance upon the scene, when the Seleucid Hellenic king Antiochus IV made a fateful faux pas in his subject state of Judea:
Not realizing that Jews were somehow different form his other Semitic subjects, Antiochus despoiled the Temple, installed a Syrian garrison and erected a temple to Olympian Zeus on the site. This was probably just part of his general Hellenizing programme. But the furious revolt that broke out, led by Judas Maccabeus the High Priest, finally drove the Seleucids from Judea for good. (241)
No comment.
There is wisdom: “Nothing in excess,” “Know thyself.”
So all that Alt Right propaganda using uplifting imagery from Greco-Roman statues and history, and films like Gladiator and 300, and so on, is both effective and completely justified.
00:05 Publié dans archéologie, art, Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : archéologie, art, histoire, hellénisme, hellénité, grèce antique, antiquité grecque, culture classique, humanités classiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 09 novembre 2015
Une spiritualité de la Forme

Une spiritualité de la Forme
Pourquoi l’Antiquité gréco-romaine a-t-elle toujours exercé une attraction si forte sur l’homme européen ? L’attribuer tout entière à la fascination que procure l’art antique serait superficiel, car l’art grec tire précisément son prestige du fait qu’il rend visible la nostalgie métaphysique pour un modèle tout à la fois corporel et spirituel. L’art grec, en somme, est lui-même une partie de la religiosité grecque, comme le comprirent déjà Goethe et Winckelmann, puis, à notre époque, un Schefold [archéologue allemand] et un Walter F. Otto. Mais même quand on met l’accent sur la “rationalité” de la Grèce antique — en l’opposant, le cas échéant, à “l’irrationalité” du Moyen Âge —, on ne fait qu’interpréter banalement cette rationalité, on perd de vue sa dimension la plus profonde, où la clarté devient symbole, dans le credo apollinien et olympien, d’une très haute forme de maîtrise de soi.
Dans le monde grec, c’est la préhistoire indo-européenne qui se met à parler. Le premier “verbe” articulé de la civilisation grecque est la religion olympienne. Toutes les obscures luttes préhistoriques du principe diurne contre le principe nocturne, du principe paternel contre le principe maternel, s’y donnent à voir, mais sous une forme qui atteste la victoire de la claire lumière du jour. Apollon a déjà tué Python, Thésée est déjà venu à bout du Minotaure et, sur la colline sacrée d’Arès, Oreste a été acquitté de la faute d’avoir tué “la mère”. Il s’agit là d’une “sagesse poétique”, pour reprendre l’expression de Vico, où s’exprime une conscience nouvelle, une conscience qui fit dire à Plutarque : « Rien sans Thésée. »
Les Olympiens
Un jour nouveau se lève sur les cimes boisées du plus ancien paysage européen, répandant une clarté aurorale identique à la lumière de l’Olympe chantée par Homère :
« À ces mots, l’Athéna aux yeux pers disparut, regardant cet Olympe où l’on dit que les dieux, loin de toute secousse, ont leur siège éternel : ni les vents ne le battent, ni les pluies ne l’inondent ; là-haut, jamais de neige ; mais en tout temps l’éther, déployé sans nuages, couronne le sommet d’une blanche clarté […] ». [Odyssée, chant VI, trad. V. Bérard].
Le jour olympien est le jour de l’Ordre. Zeus incarne avec la spontanéité la plus puissante et la plus digne qui soit l’idée de l’ordre comme autorité. C’est une idée qui, à travers le Deus-pater (Iuppiter) romain, répand sa lumière bien au-delà des débuts du monde antique. Il suffit pour s’en convaincre de comparer la figure de Dieu le Père dans sa version la plus humble et patriarcale du paysan chrétien avec la notion, autrement abstraite et tyrannique, de Yahvé.
Apollon, lui, incarne un autre aspect de l’Ordre : l’Ordre comme lumière intellectuelle et formation artistique, mais aussi comme transparence solaire qui est santé et purification. Il se peut que le nom d’Apollon ne soit pas d’origine indo-européenne, même si la chose n’est pas établie, car l’illyrien Aplo, Aplus (cf. le vieil islandais afl, “force”), va à l’encontre de cette hypothèse, d’autant plus qu’Apollon est le dieu dorien par excellence et que la migration dorienne et la migration illyrienne ne font qu’un. Mais surtout, quand on traite d’histoire des religions, il ne faut jamais oublier que c’est le contenu qui importe, non le contenant.

L’Artémis dorienne, représentée comme une jeune fille dure, sportive et nordique, n’est pas l’Artémis d’Éphèse aux cent mamelles. Sous un nom préexistant prend forme une figure religieuse profondément nordique et indo-européenne, qui exprime sa nature farouche, athlétique et septentrionale. Une même désignation recouvre donc deux “expériences” religieuses bien différentes. De même, Marie — entendue comme la “Grande Mère”, par ex. dans le cas de la Madone de Pompéi — est différente de la Vierge Marie de Bernard de Clairvaux et du catholicisme gothique. Ce n’est pas seulement la différence existant entre la jeune fille blonde des miniatures gothiques et la “Mère de Dieu” des terres du Sud. C’est la même diversité de vision que celle qui sépare l’Artémis d’Éphèse de l’Artémis Orthia spartiate apparue avec la migration dorienne.
Comme toujours, l’essence de la conception religieuse réside dans la spécificité de sa vision du divin. Une vision non pas subjective ou, mieux, une vision subjective en tant que l’absolu, en se manifestant, se particularise et se fait image pour le sujet. Apollon et Artémis, le Christ et la Vierge sont avant tout des “visions”, des présences saisies par l’intuition intellectuelle, là où “les dieux”, degrés se manifestant à partir de l’Être, sont vraiment. Goethe écrivait à Jacobi : « Tu parles de foi, moi, j’attache beaucoup d’importance à la contemplation » (Du sprichst von Glaube, ich halte viel auf Schauen).
Dans les divinités olympiennes, l’âme nordique de la race blanche a contemplé sa plus pure profondeur métaphysique. L’eusébeia, la vénération éclairée par la sagesse du jugement ; l’aidos, la retenue pudique face au divin ; la sophrosyné, la vertu faite d’équilibre et d’intrépidité : telles sont les attitudes à travers lesquelles la religion olympienne s’exprime comme un phénomène typiquement européen. Et le panthéon olympien est le miroir de cette mesure. De manière significative, même ses composantes féminines tendent à participer des valeurs viriles : comme Héra, en tant que symbole du coniugium, comme Artémis, en raison de sa juvénilité réservée et sportive, comme Athéna, la déesse de l’intelligence aguerrie et de la réflexion audacieuse, sortie tout armée de la tête de Zeus. C’est pourquoi Walter F. Otto a pu parler de la religion grecque comme de l’« idée religieuse de l’esprit européen » :
« Dans le culte des anciens Grecs se manifeste l’une des plus hautes idées religieuses de l’humanité. Disons-le : l’idée religieuse de l’esprit européen. Elle est très différente des idées religieuses des autres cultures, surtout de celles qui, pour notre histoire et notre philosophie des religions, passent pour fournir le modèle de toute religion. Mais elle est essentiellement apparentée à toutes les formes de la pensée et des créations authentiquement grecques, et recueillie dans le même esprit qu’elles. Parmi les autres œuvres éternelles des Grecs, elle se dresse, majeure et impérissable, devant l’humanité. […] Les figures dans lesquelles ce monde s’est divinement ouvert aux Grecs n’attestent-elles pas leur vérité par la vie qui est encore la leur aujourd’hui, par la permanence où nous pouvons encore les rencontrer, pourvu que nous nous arrachions aux emprises de la mesquinerie et que nous recouvrions un regard libre ? Zeus, Apollon, Athéna, Artémis, Dionysos, Aphrodite… là où l’on rend hommage aux idées de l’esprit grec, il n’est jamais permis d’oublier que c’en est le sommet et, d’une certaine manière, la substance même. Ces figures demeureront tant que l’esprit européen, qui a trouvé en elles son objectivation la plus riche, ne succombera pas totalement à l’esprit de l’Orient ou à celui du calcul pragmatique » [Les Dieux de la Grèce, Payot, 1981, p. 31]
Le monde grec
De même que le monde olympien est toujours resté vivant pour l’Européen cultivé, ainsi la civilisation grecque est demeurée exemplaire pour la civilisation européenne. Il importe cependant de comprendre correctement le sens de cette exemplarité. Si celle-ci devait valoir comme synonyme de scientificité, au sens banalement laïque du terme, alors il faudrait rappeler que l’attitude éminemment rationnelle de l’esprit hellénique n’a jamais été séparée de la foi dans le mythe comme archétype d’une raison plus haute. La rationalité de ce qui est naturel est étudiée et admirée précisément parce qu’elle renvoie à un équilibre supérieur. Chez Aristote, on trouve encore, au début de son traité de zoologie, cette citation d’Héraclite : « Entrez, ici aussi habitent les dieux » Quant à Goethe, il dira que « le beau est un phénomène originel » (Das Schöne ist ein Urphanomen). Mais c’est surtout Platon qui nous communique le sens le plus authentique de la “scientificité” de la pensée grecque, lorsqu’il compare la rationalité d’ici-bas (la “chose”) à la rationalité de là-haut (“l’idée”) et mesure la réalité empirique avec le mètre d’une réalité éternelle. Il est celui qui dans le mythe de la caverne (République, VII, 514-517) illustre la logique ultime de la connaissance : par-delà les ombres projetées par le feu, il y a la réalité supérieure de la lumière solaire. En effet, l’Être, qui est le fond obligatoire de la spéculation hellénique, est aussi ce qui l’empêche de tomber dans l’intellectualisme.
Cette myopie caractéristique qui a confondu le rationalisme des Grecs avec le rationalisme des modernes a également créé l’équivoque d’un hellénisme “adorateur du corps”. Ici aussi, la gymnastique et l’athlétisme grecs ont été saisis avec superficialité. En fait, les Grecs ont exalté l’éducation du corps comme une partie de l’éducation de l’esprit. C’est le sens hellénique de la forme qui exige que le corps également reçoive une discipline formatrice. Le kosmos est l’infiniment grand et l’infiniment petit, l’ordre de l’univers et celui du corps humain. L’instance ultime du monde des corps et de la société est l’Ordre, tout comme l’instance ultime de la connaissance est l’Être.
Mais il va de soi que l’aveuglement principal est celui qui concerne le caractère prétendument “démocratique” de l’esprit grec. Si l’on excepte une brève période de l’histoire d’Athènes, la liberté des cités grecques a toujours été la liberté pour les meilleurs. Les partis aristocratiques et les partis démocratiques ne se séparaient que sur le nombre, plus ou moins grand, de ces “meilleurs”. Mais la masse et les esclaves restèrent toujours en dehors de l’organisation politique de la cité. C’est pourquoi toute la civilisation grecque resplendit encore de cet idéal de la sélection — l’ekloghé — qui a exercé une si grande fascination sur les élites de l’Occident. Julius Evola a résumé comme suit les valeurs exprimées par la Grèce antique à son apogée :
« […] le culte apollinien, la conception de l’univers comme kosmos, c’est-à-dire comme une unité, comme un tout harmonieusement ordonné […] l’importance conférée à tout ce qui est limite, nombre, proportion et forme, l’éthique de l’unification harmonieuse des différentes puissances de l’âme, un style empreint d’une dignité calme et mesurée, le principe de l’eurythmie, l’appréciation du corps et la culture du corps […] la méthode expérimentale dans les applications scientifiques en tant qu’amour de la clarté par opposition aux nébulosités pseudo-métaphysiques et mystiques, la valeur accordée aussi à la beauté plastique, la conception aristocratique et dorienne du gouvernement politique et l’idée hiérarchique affirmée dans la conception de la vraie connaissance » [I Versi d’oro pitagorei, Atanor, Rome, 1959, p. 30].
Ce sont des valeurs qui suffisent à attribuer à l’expérience grecque une place de premier plan dans le cadre d’une tradition européenne.
* * *
La Question d’une tradition européenne, Akribeia, 2014. Tr. fr.: Philippe Baillet.
00:05 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hellénité, grèce antique, classicisme, tradition, forme, philosophie, esthétique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 septembre 2013
Nietzsche e o Mundo Homérico

Nietzsche e o Mundo Homérico
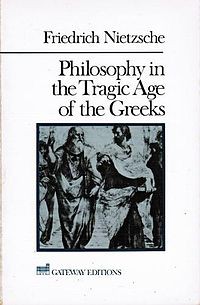 Nietzsche desde o princípio apresentou um apego ao mundo grego, uma idealização deste como estrutura social, ideológica e intelectual. Esta aproximação não é especificamente com a época clássica, mas com a época arcaica que é representada através dos poemas homéricos.
Nietzsche desde o princípio apresentou um apego ao mundo grego, uma idealização deste como estrutura social, ideológica e intelectual. Esta aproximação não é especificamente com a época clássica, mas com a época arcaica que é representada através dos poemas homéricos. Tomando esta citação compreendemos que a aristocracia se conforma a partir de sua riqueza, e devido a isto é fundamental entre os nobres fomentar vínculos com seus iguais, o qual se dá através da hospitalidade, já que se atende a alguém do mesmo valor moral e social. Neste sentido também se volta importante uma espécie de relação de parentesco dentro da que surge certo intercâmbio econômico representado em presentes (hedna). Na Odisséia se faz patente esta relação de hospitalidade através da narração da viagem de Telêmaco pelas cortes gregas, onde é bem recebido e por sua vez se atende tal como se formara parte da família, sem importar de onde venha, nem as fronteiras que os separam. Outro exemplo chave é o fato que conduz à Guerra de Tróia, a falta da hospitalidade de Paris (Alexandre) frente a Menelau ao raptar Helena.
Tomando esta citação compreendemos que a aristocracia se conforma a partir de sua riqueza, e devido a isto é fundamental entre os nobres fomentar vínculos com seus iguais, o qual se dá através da hospitalidade, já que se atende a alguém do mesmo valor moral e social. Neste sentido também se volta importante uma espécie de relação de parentesco dentro da que surge certo intercâmbio econômico representado em presentes (hedna). Na Odisséia se faz patente esta relação de hospitalidade através da narração da viagem de Telêmaco pelas cortes gregas, onde é bem recebido e por sua vez se atende tal como se formara parte da família, sem importar de onde venha, nem as fronteiras que os separam. Outro exemplo chave é o fato que conduz à Guerra de Tróia, a falta da hospitalidade de Paris (Alexandre) frente a Menelau ao raptar Helena.
00:05 Publié dans Philosophie, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : iliade, monde homérique, nietzsche, tradition, mythologie, traditionalisme, homère, grèce antique, philologie classique, hellénité, hellénisme, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 12 avril 2009
Hellenes and Indo-Aryans
Hellenes and Indo-Aryans
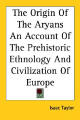 To us it seems almost mockery, if one compares a philosopher with a blind man. In order to avoid any misinterpretation of my comparison, I want to make myself even more clear by referring to the Greeks. It is by no means certain, I believe, that the Greeks (those virtuosi when it comes to using the eye) had the right capabilities to serve mankind as the exclusive leaders on philosophical issues. Their whole life was a denial of introspection and therefore formed the sharpest contrast possible with the Indo-Aryan lifestyle. Now let us look at the upbringing of the Aryan thinker. The young Brahman received his education in the seclusion of a rural surrounding: mental treasures and moral habits; with incomparable severity and perseverance he was educated for thinking, according to plan. Twelve years and often longer the theoretical instruction and exercise took; then came the indispensable school of practical life, the founding of his own household. And it was only after his own son had grown up and had build his own house, that the time had come for a wise man to disappear into the forests, he, now freed from all the obligations of the rituals and from the entire equipment of the symbolic belief in gods, he, whose speculative abilities formed the best personal civilization one could think of, whose memories were enriched by all joys and sadness of family life, he whose knowledge of human nature had matured by the fulfilment of his practical civic duties — only now the time had come for this wise man to increase the treasures of thought, inherited from his ancestors, and thus to increase the mental possession of his people.
To us it seems almost mockery, if one compares a philosopher with a blind man. In order to avoid any misinterpretation of my comparison, I want to make myself even more clear by referring to the Greeks. It is by no means certain, I believe, that the Greeks (those virtuosi when it comes to using the eye) had the right capabilities to serve mankind as the exclusive leaders on philosophical issues. Their whole life was a denial of introspection and therefore formed the sharpest contrast possible with the Indo-Aryan lifestyle. Now let us look at the upbringing of the Aryan thinker. The young Brahman received his education in the seclusion of a rural surrounding: mental treasures and moral habits; with incomparable severity and perseverance he was educated for thinking, according to plan. Twelve years and often longer the theoretical instruction and exercise took; then came the indispensable school of practical life, the founding of his own household. And it was only after his own son had grown up and had build his own house, that the time had come for a wise man to disappear into the forests, he, now freed from all the obligations of the rituals and from the entire equipment of the symbolic belief in gods, he, whose speculative abilities formed the best personal civilization one could think of, whose memories were enriched by all joys and sadness of family life, he whose knowledge of human nature had matured by the fulfilment of his practical civic duties — only now the time had come for this wise man to increase the treasures of thought, inherited from his ancestors, and thus to increase the mental possession of his people.
For the Greeks however education consisted of the training of the eye and of rhythmic feeling: gymnastics and music, being pretty and recognizing beauty with sureness. From their childhood up they filled their days with looking at the other, „watching the outside“, talking and discussing and tuning. In short: the publicity was the atmosphere of Greek existence; all Greek philosophers were politicians and orators. And while even in today’s degenerated times many Indo-Aryans of pure race conclude their life in complete seclusion, prepare their grave, and calmly lie down, silent and lonely while death approaches, in order to unite themselves with the omnipresent world spirit, we hear Socrates, up to the moment when he empties the cup of hemlock, amusing himself with dialectic hair-splitting with his friends and discussing the advantage of the believe in immortality for the human society.
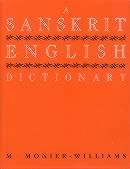 So we see that the serious obstacles, raised by the formlessness of the Indo-Aryan representation of their world-view, are not without some kind of atonement; and it’s justified to expect to find something new here. But we would be superficial, if we were satisfied with just this one insight. Because the distinction between form and matter can lay claim to a limited value only; so here we have to dig somewhat deeper.
So we see that the serious obstacles, raised by the formlessness of the Indo-Aryan representation of their world-view, are not without some kind of atonement; and it’s justified to expect to find something new here. But we would be superficial, if we were satisfied with just this one insight. Because the distinction between form and matter can lay claim to a limited value only; so here we have to dig somewhat deeper.
Hellenic humanism — to which the Indo-Aryan now forms a counterweight — was for us in particular a school of form, or perhaps better of shaping, of creation, of the artists’ individual works on up to the realization that a human society can have a form in which free-creative art is the all-penetrating element. In admiration of related strangers we climbed up to new achievements of our own. On the other hand, each attempt failed to master what was specifically Hellenic regarding the contents, if one refrains from those things — logic, geometry — where the form is already contents. This is quiet clear for the arts, but for philosophy the emancipation from Helleno-Christian ties has to still take place, although it was always followed out by our real philosophers, from Roger Bacon on to Kant. As for India the conditions differed. The Indian Aryan missed a Hellene, to keep within bounds in time his innate inclination — also inborn to us — to digress excessively, to canalize his over-rampantly thriving forces as it were, to accompany his overflowing fantasy with the wise guide called „taste“, and his judgement with a notion of shape-giving. That effusiveness, which Goethe calls the source of all greatness, was present with the Indian Aryan just as abundantly as with the Hellenes, they missed however sophrosyne, the restrictress. No poem and no philosophical writing of the Indian is enjoyable for a man of taste, formally speaking. And once these people wanted to avoid the excessiveness and therefore untransparancy, the unartisticness of their creations, they immediately ran into the opposite extreme and availed themselves of such an exaggerated aphoristical briefness that their writings became nearly an unsolvable mystery.
 A well-known example is Pânini’s grammar of Sanskrit, which is written in the form of algebraic formulas, so that this exhaustive representation of the Sanskrit language, 4000 rules large, fills hardly 150 pages. Another example are the philosophical comments of Bâdarâyana, with whom sometimes a whole chapter with explanations was necessary, before one could understands three words of his way of expression, concise to absurdity. The form of the Indian is therefore nearly always rejectable. And this means a lot; because a clear distinction between form and contents can’t be found anywhere; he who criticizes the form, cannot praise the contents without some reservations. For this is also true; with the Indo-Aryan we have to dig deeply before we hit upon pure, unslagged gold. If one is not determined or capable to descend into the depths of this soul (for which a congenial attitude is necessary), one shouldn’t make attempts at all; he will harvest little for much trouble. However, he who can and may descend, will return with ever-lasting rewards.
A well-known example is Pânini’s grammar of Sanskrit, which is written in the form of algebraic formulas, so that this exhaustive representation of the Sanskrit language, 4000 rules large, fills hardly 150 pages. Another example are the philosophical comments of Bâdarâyana, with whom sometimes a whole chapter with explanations was necessary, before one could understands three words of his way of expression, concise to absurdity. The form of the Indian is therefore nearly always rejectable. And this means a lot; because a clear distinction between form and contents can’t be found anywhere; he who criticizes the form, cannot praise the contents without some reservations. For this is also true; with the Indo-Aryan we have to dig deeply before we hit upon pure, unslagged gold. If one is not determined or capable to descend into the depths of this soul (for which a congenial attitude is necessary), one shouldn’t make attempts at all; he will harvest little for much trouble. However, he who can and may descend, will return with ever-lasting rewards.
And now we see immediately, how very limited the criticism of such an organism often is; for while I just criticized the Indian form, one also has to admit that especially within this „formlessness“ the possibility of certain conceptions, certain suggestions, a certain communication between soul and soul emerges, which one would search for in vain in other places. Such things are untransferable and cannot not be detached from their environment; we learn to think thoughts, which we would not have thought otherwise, because we missed the material mediator — if I may say so. Nevertheless we may summarize our views on form with the following statement: what causes our deepest interests in the creations of the Indo-Aryan spirit, is the inner core, from whence they originate, and not the form in which they are represented to us. Thus if we expect an animating influence from India on our own spiritual life, then this expectation is mainly related to that core only.
* * *
From Aryan World-view, (or. Arische Weltanschauung). The translation, based upon the 8th. ed. in German, published by F. Bruckmann A.-G., Munich 1938, was made by hschamberlain.net.
Houston Stewart Chamberlain
00:05 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hellenité, grèce antique, antiquité, iran, perse, perse antique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




