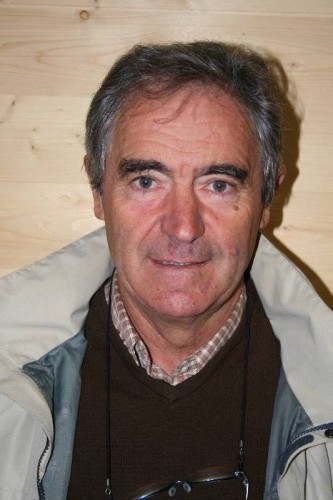Il est naturel qu’un pays dont le nom vient du mot Aryanam-vaejo, c’est-à-dire le pays des Aryens, n’ait pu rester indifférent aux événements européens. La religion et la tradition islamiques furent imposées au pays d’abord par les conquérants arabes, puis par les fondamentalistes musulmans. Dans le pays de Zoroastre, Kir, Darius, Iskander et Rustem, elles sont étrangères. De plus, les nouveaux venus turco-mongols inondant au XIIIe siècle toute l’Asie supprimèrent toute l’élite persane. Jusqu’au siècle dernier les Turcs occupaient les postes-clés dans l’armée persane et dans le gouvernement, ce qui mena le pays à l’appauvrissement et à la dévastation.
Pour lutter contre la contagion révolutionnaire les Perses à l’exemple des Russes commencèrent à utiliser des cosaques, qui créèrent la brigade persane des cosaques. Le commandant de cette brigade devint bientôt le jeune et talentueux Mohamed Reza, qui était le fils d’un riche paysan persan. Reza détruisit d’abord les révolutionnaires et les séparatistes, puis tourna ses troupes vers Téhéran.
S’étant mis à la tête du gouvernement, il tâcha par tous les moyens de discréditer le shah, qu’il détestait. En 1925, le Premier ministre, profitant de l’absence du shah, l’accusa d’incompétence et le démit. Mohamed Reza décida de fonder une nouvelle dynastie Pahlavi, d’après l’ancien nom des rois parthes. Pendant le couronnement, le shahinshah (l’empereur) frais émoulu, imitant Charlemagne, arracha la couronne des mains du religieux qui devait le couronner. Alors l’un des hommes politiques présents prononça cette phrase historique : « Enfin un homme appartenant à la race aryenne est arrivé à la tête de notre Etat ».
Le nouveau shah proclama la nécessité de l’européisation : le costume européen et le calendrier solaire furent introduits, les noms des villes et des mois du vieil Iran furent rétablis. Les journaux et la radio commencèrent à glorifier la grandeur de l’ancien Iran, prêchant partout le nationalisme persan. En politique étrangère le shah s’orienta vers l’Italie fasciste, à l’exemple de laquelle furent créés de nombreux détachements de jeunesse scouts. Le shah souligna par tous les moyens que son arrivée au pouvoir était une sorte de révolution fasciste.
Mais la jeunesse était encore plus attirée par le mouvement pour la pureté de la race aryenne en Allemagne, que préconisait l’hebdomadaire l’« Iran-e-bastan » (L’Ancien Iran) et le groupe formé autour de lui. La jeunesse organisait des manifestations bruyantes en soutien aux nazis allemands, manifestations qui finissaient le plus souvent par des heurts avec la police, parce que le shah était très réservé concernant le parti d’Hitler. Cependant l’influence du national-socialisme germanique était très grande en Iran : le général Zahedi, le Parti Nationaliste de l’Iran, plusieurs représentants du clergé et des députés du Medjlis (le parlement iranien) sympathisaient avec lui. Même le parti gouvernemental « Iran Novin » (Nouvel Iran), créé en 1929, prit la croix gammée comme emblème.
La propagande du national-socialisme en Iran se renforça après l’arrivée au pouvoir d’Hitler en 1933. Le Troisième Reich commença à aider l’Iran avec des techniciens et des spécialistes. Des étudiants et des officiers iraniens firent leurs études en Allemagne. La propagande hitlérienne radiodiffusait sur la nécessité de l’union entre les « Aryens du Nord » et la « nation de Zoroastre » ; en plus de cela, les Perses étaient considérés comme des Aryens pur sang et par un décret spécial furent exemptés de l’application des lois raciales de Nuremberg. Après cela en Iran vinrent souvent d’Allemagne des conférenciers pour des sujets raciaux, et des peintres allemands, qui organisaient là des expositions de tableaux glorifiant la race aryenne.
Quand, en 1937, l’Iran reçut la visite du leader de la jeunesse allemande Baldur von Schirach, on lui organisa une réception pompeuse, et la jeunesse iranienne défila le bras tendu. Cette activité effraya le shah, qui voyait en cela une menace pour son pouvoir. D’autant plus que la même année on découvrit un complot ayant à sa tête le lieutenant M. Dzhadzhuz, qui voulait renverser le shah et établir une dictature de droite. Après l’exécution des révoltés, le shah interdit le national-socialisme dans le pays et ordonna de fermer l’« Iran-e-bastan ». Le mouvement national-socialiste avec à sa tête le docteur Dzhahansuzi entra dans la clandestinité.
Mais la propagande nazie en Iran se poursuivit quand même. Elle agissait officiellement – par les journaux et les consulats allemands – et illégalement. Une fois une affaire fit scandale : le bulletin officiel iranien publia l’article de A. Rosenberg : « Où la race aryenne s’est le mieux conservée », offensant les sentiments des musulmans. Les Allemands durent annoncer que Hitler avait accepté l’islam pour retrouver la sympathie du petit peuple iranien. Vers 1940 les Allemands devinrent tellement audacieux qu’une « maison Brune » fut ouverte à Téhéran et qu’ils procédèrent à la construction de la « Naz’jabada » (la ville des nazis), à laquelle participèrent les membres de l’organisation « Melli modafe » (la Protection Nationale) de la jeunesse radicale de droite. Les consulats allemands répandaient activement « Mein Kampf » et le bulletin « l’Aryen » en farsi.
Dès 1940 dans le pays apparurent de nouveaux groupements radicaux de droite : « Kabud » (Bleu), « Millet » (Nation), « Mejhanparastan » (les Patriotes), l’« Iran-e-bidar » (l’Iran Réveillé), « Shijahtushan » (les Manœuvres), « Pejkar » (la Lutte), « Mejhan » (la Patrie), « Istikal » (Indépendance), ainsi que l’organisation« Nehzat-e-melli » des officiers nazis (le Mouvement national). Toutes ces organisations s’unirent en 1942 au parti « Mellijun Iran » (les Nationalistes iraniens). Le renforcement de la droite radicale fut notamment la raison de l’occupation de l’Iran par les troupes de la coalition anti-hitlérienne.
Après leur départ en 1949, il y eut un Parti national des ouvriers socialistes. En 1951, les sections d’assaut de cette organisation saccagèrent l’exposition des marchandises soviétiques. Dès 1952, le Parti de la nation iranienne s’orienta contre le capitalisme et l’impérialisme, mais agit aussi contre le communisme pour la protection de la nation et de la monarchie. Le Parti des travailleurs de l’Iran et le groupement « Troisième force » manifestaient avec des slogans analogues.





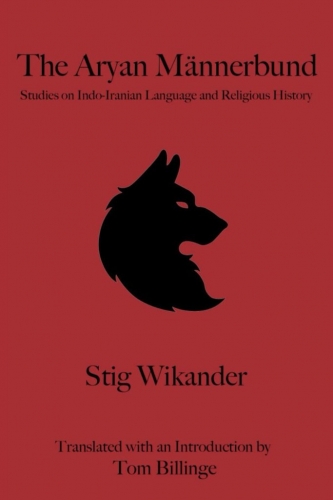
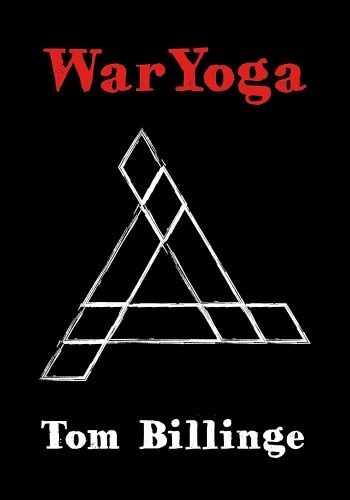
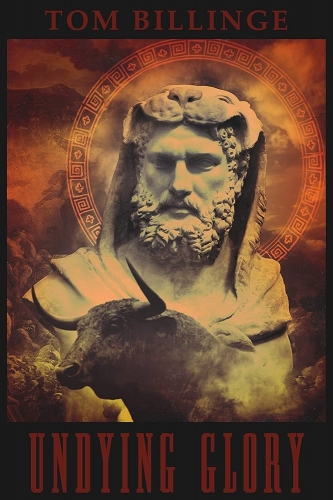
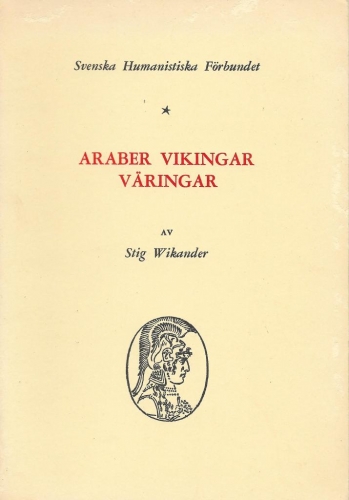
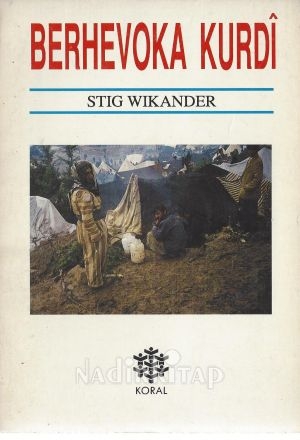
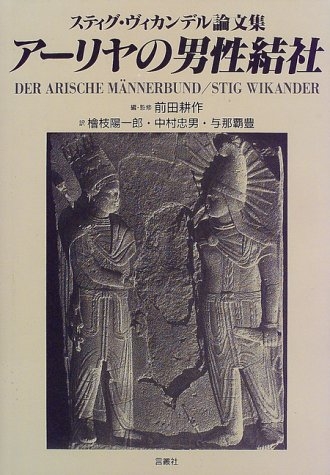
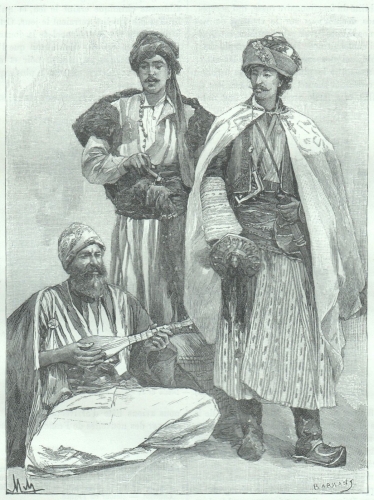

 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg