mercredi, 11 février 2026
L’éveil du Japon à la multipolarité - L'archipel se soustrait à l’ombre américaine

L’éveil du Japon à la multipolarité
L'archipel se soustrait à l’ombre américaine
Constantin von Hoffmeister
Les élections pour la Chambre des représentants du Japon ont rendu un verdict d’une clarté sans pareille. Le centre-gauche s’est effondré, ses rangs se sont réduits à de simples fragments. Plus des deux tiers de ses sièges ont disparu, un événement de portée historique. Le Parti libéral-démocrate nationaliste (PLD), dirigé par la Première ministre Sanae Takaichi, est sorti de la compétition électorale pour devenir une force dominante après s'être conquis une part record des votes. Le public a choisi la fermeté politique plutôt que la dérive, la souveraineté plutôt que la tutelle, et la continuité identitaire plutôt que les abstractions alambiquées, prônées par les idéologues atlantistes.

Dans les derniers jours avant le scrutin, des commentateurs libéraux ont lancé les alarmes habituelles. Des colonnes, dans les journaux, évoquaient le spectre de l'autoritarisme et utilisaient un langage rituel autrefois employé dans toute la sphère occidentale chaque fois qu’un pays sortait du cadre convenu. Mais ces avertissements se sont dissous au contact de la réalité. Le PLD est passé de 198 à 316 sièges. Avec son allié, le Parti de l’innovation du Japon, la majorité gouvernementale a obtenu 352 mandats et une super majorité des deux tiers dans la chambre de 465 sièges. De tels chiffres confèrent une autorité sur la législation, le budget et le rythme de la vie nationale. La procédure parlementaire reflète désormais la volonté d’une population prête à agir en tant qu’État-civilisation plutôt qu’en tant que province administrative au sein d’une structure de sécurité américaine.
Ce résultat revêt une signification bien au-delà de l’arithmétique partisane. Une ère multipolaire avance à grands pas dès que les cultures anciennes retrouvent une capacité stratégique. Le Japon prend sa place parmi les pôles de grande profondeur historique et se prépare à l’émergence d’un concert de puissances souveraines. Washington a longtemps considéré le Pacifique comme un lac géré par ses soins, par ses alliances structurées autour de la dépendance, par ses bases disposées comme des rappels permanents de 1945. L’électorat japonais a signalé sa fatigue face à cet arrangement. Une nation avec des millénaires de mémoire cherche un partenariat entre égaux, que ce soit à travers l’Eurasie ou dans l’ensemble de l’Indo-Pacifique, plutôt que la subordination à un ordre occidental unipolaire en déclin.
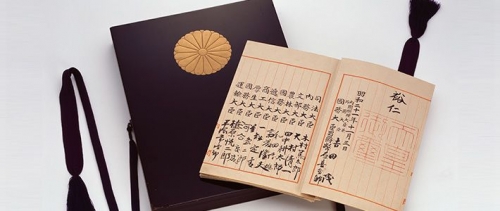
La constitution japonaise de 1947.
La nouvelle majorité détient les voix nécessaires pour ouvrir le débat sur une révision de la Constitution de paix de 1947. Cette charte est née durant l’occupation, façonnée par les impératifs américains, et a enfermé le Japon dans un cadre de retenue stratégique. Une révision marquerait un tournant psychologique : le passage du pacifisme supervisé vers une souveraineté mature. La théorie multipolaire considère de telles transitions comme essentielles. Chaque pôle doit disposer d’une défense crédible, d’une autonomie industrielle, d’une confiance culturelle et de la capacité à dissuader la coercition. La réarmement, dans cette optique, devient moins un geste d’agression qu’une déclaration qui affirme que l’histoire a repris son rythme pluriel.
L’énergie politique s’est concentrée autour de Takaichi elle-même. Elle a convoqué les élections en avance sur le calendrier, demandé au peuple son jugement, et l’a reçu en plénitude. Sa présence — directe, vive et indiscutablement distincte du ton gestionnaire de ses nombreux prédécesseurs — a captivé l’imaginaire public. Les foules ont répondu avec l’ardeur autrefois vue lors de la montée insurgée de Junichiro Koizumi (photo, ci-dessous) deux décennies plus tôt. Le leadership, en période de recalibrage civilisationnel, se condense souvent en une figure. L’électorat reconnaît dans une seule personne la possibilité d’un réveil national.

Les critiques qualifient cette personnalisation de dangereuse. Leur anxiété révèle un attachement plus profond à la neutralité procédurale, une doctrine exportée dans le monde entier durant l’ère libérale. Pourtant, la politique, dans chaque culture durable, puise sa force dans les mythes, les symboles et les émotions collectives. Le réalisme multipolaire soutient que les nations prospèrent lorsque leur classe dirigeante parle dans l’idiome de leur propre tradition plutôt que dans le dialecte standardisé d’une technocratie mondiale. Une idée du nation émotionnellement résonante renforce la cohésion à une époque marquée par des blocs continentaux et la compétition entre grandes puissances.
Les débats sur la sécurité tournent de plus en plus autour de la Chine, présentée dans les commentaires occidentaux comme la menace du siècle, la mieux organisée. Le Japon aborde cette question d’un point de vue plus complexe. La géographie garantit la proximité ; l’histoire encourage la prudence ; la stratégie exige un équilibre. Un Tokyo souverain peut poursuivre la fermeté parallèlement à la diplomatie, cultivant l’équilibre à travers l’Asie plutôt que servant d’instrument avancé pour l'endiguement voulu par les Américains. La multipolarité prospère par des relations calibrées entre puissances voisines, conscientes que la stabilité se manifeste par la reconnaissance mutuelle plutôt que par la pression hégémonique.
L’expansion fiscale, la volatilité monétaire et la hausse des rendements obligataires font partie du paysage économique. De telles pressions accompagnent tout État qui choisit l’autonomie stratégique, car les marchés financiers reflètent souvent les préférences du noyau atlantiste. Pourtant, le Japon dispose de ressources internes redoutables: maîtrise technologique, discipline sociale, culture de l’épargne, rares dans les économies avancées. Une politique économique axée sur le développement national, le renouvellement des infrastructures et la résilience industrielle peut transformer la turbulence à court terme en force à long terme.
L’élection a également porté au pouvoir le Parti de la participation politique, dont la présence parlementaire est passée de deux à quinze sièges, tandis que l’Alliance réformatrice centriste a connu une chute spectaculaire, passant de 167 à 49 sièges. Le Parti communiste a perdu la moitié de ses représentants. Ce schéma suggère une consolidation plus large autour des questions de souveraineté, d’identité et d’orientation stratégique. Les systèmes de partis dans le monde entier montrent des réalignements similaires à mesure que les électeurs s’adaptent à la fin de l’uniformité idéologique imposée durant les décennies de la prépondérance unipolaire.
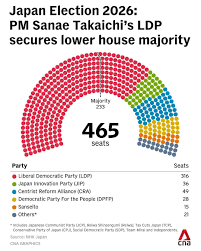
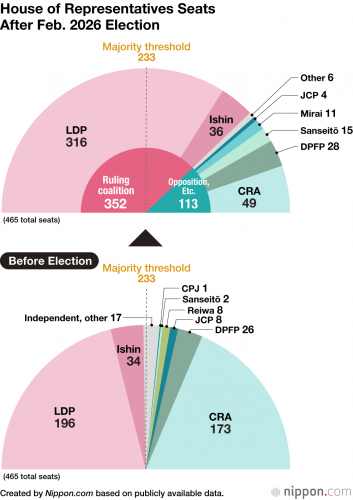
Les observateurs qui craignent pour la démocratie assimilent souvent le pluralisme à une conformité aux normes libérales occidentales. La pensée multipolaire propose une définition plus riche: une démocratie authentique est l’expression authentique d’un peuple façonné par sa propre dynamique civilisatrice. La poussée du Japon s’inspire de la continuité impériale, du devoir communautaire, de la retenue esthétique et d’une éthique guerrière raffinée au fil des siècles. Ces éléments coexistent avec des institutions modernes et donnent naissance à une forme politique distincte des modèles américains.

Le poète samouraï Yukio Mishima évoquait la beauté associée à la discipline, d’une nation dont la vitalité émane de l’unité de la culture et de la défense. Son acte final, dramatique, présenté comme un appel à la restauration de l’honneur, résonne encore comme un avertissement contre une prospérité purement matérielle. Il imaginait un Japon conscient de son âme, prêt à la protéger. À l’ère multipolaire, sa vision acquiert une actualité renouvelée. La souveraineté culturelle, en plus de l’indépendance militaire et économique, constitue l’un des piliers du pouvoir durable.
Derrière le langage mesuré des comités et de la stratégie, vit un autre Japon, où le soleil brille clairement et où l’épée reflète sa lumière. La force apparaît comme une beauté disciplinée dans la forme ; la souveraineté comme une posture de l’esprit avant qu’elle ne devienne un instrument de l’État. Pendant des décennies, l'archipel nippon s'est reposé sous un parapluie nucléaire étranger, la prospérité s’est étendue alors que l’instinct guerrier dormait d'un sommeil léger et ne s'éteignait pas. Maintenant, l’histoire le remue à nouveau. La nation sent que la dignité exige plus que le confort ; elle appelle à la préparation, à l’autodiscipline et à la volonté de durer. Comme une lame doucement dégainée de son fourreau, le pouvoir acquiert du sens par la retenue, la mémoire et la résolution silencieuse de rester debout plutôt que de s’agenouiller sous son propre ciel.
À travers l’Eurasie et au-delà, le schéma se répète. Les États-civilisations émergent, chacun ancré dans la mémoire, la langue et l’ethnie. Le siècle américain recule devant l’histoire qui se remet en marche; un ordre polycentrique prend forme. Le Japon, longtemps limité par l’architecture de la dépendance d’après-guerre, signale désormais sa volonté de s’affirmer comme un pôle pleinement réalisé: autodirigé, enraciné culturellement et engagé avec le monde par la réciprocité plutôt que par la soumission.
20:21 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, politique internationale, japon, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 28 novembre 2025
Mishima et l’esprit chevaleresque - La passion de Mishima pour l’Espagne
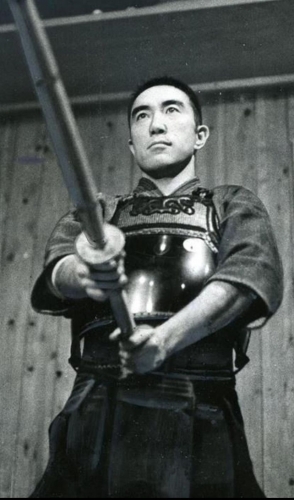
Mishima et l’esprit chevaleresque
La passion de Mishima pour l’Espagne
Source: https://revistahesperia.substack.com/p/mishima-y-el-espir...
Le code d’honneur caldéronien
Mishima était un lecteur vorace. Il semble qu’il ait été familiarisé dès son plus jeune âge avec les auteurs de notre Siècle d’Or espagnol. En particulier, le théâtre baroque et ses thèmes de l’honneur et de la gloire l’attiraient beaucoup. Et ici, Calderón de la Barca était, pour lui, notre étoile la plus brillante.

Mishima découvrit que le peuple espagnol et le peuple japonais partageaient un même concept de l’honneur. L’honneur calderonien était similaire à celui du Bushido, le code des samouraïs, car tous deux se placent au-dessus des volontés des rois et des seigneurs. « Au roi, il faut donner la terre et la vie, mais pas l’honneur, car l’honneur, c’est le patrimoine de l’âme, et l’âme n’appartient qu’à Dieu. »
Dans un contexte historique, un hidalgo était un chevalier de la petite noblesse. Mais avec le temps, il en est venu à signifier noble et généreux. Dans la tradition espagnole, l’esprit hidalgo trace un arc allant des chevaliers médiévaux jusqu’à la Légion de Millán-Astray. Notre passé est rempli de chapitres héroïques, des exploits des Tercios aux derniers combattants des Filipinas. Ce sens de la vie était également très présent dans nos arts et nos lettres jusqu’au début de la décadence.

Luis Díez del Corral
Ce professeur fut procureur sous le régime franquiste, juriste, politologue et disciple d’Ortega y Gasset. Dans les années soixante, il fit une tournée au Japon pour parler de l’Espagne des Austriacos (des Habsbourgs). Lors de ses conférences, il expliquait le sens de l’honneur caldéronien et de l’esprit chevaleresque. Mishima voyait dans cette attitude face à la vie une fraternité avec la tradition japonaise.
Une anecdote espagnole qui fit le plaisir de l’auteur nippon fut le geste du marquis de Benavente après avoir été contraint par l’empereur Charles Quint de recevoir dans son palais de Tolède le Connétable de Bourbon. Le marquis respecta la volonté impériale, qu’il considérait comme une humiliation, puis incendia son palais car il n’était pas disposé à vivre là où un traître l’avait fait. Mishima affirmerait que cette action était l’équivalent le plus précis du code d’honneur samouraï :
« L’un des nôtres aurait obéi sans rechigner, comme Benavente, à l’ordre de son « daimyō » ou du « shogun », puis aurait commis un seppuku. Comme en Espagne cette tradition n’existe pas, l’acte de Benavente est un symbole parfait. C’est la même chose, d’une autre manière. »
Après une des conférences, Mishima s’approcha pour discuter avec Díez del Corral. La présence de la célébrité japonaise attira dans la salle un essaim de journalistes et une masse énorme d’amateurs. Les deux échangèrent d’abord leurs impressions sur leurs goûts communs, puis se séparèrent de la foule pour continuer leur conversation en privé durant plusieurs heures. Ce fut le début d’une belle amitié qui dura dans le temps et conduisit les intellectuels à se rendre visite mutuellement dans leurs pays respectifs. Lors de ses voyages en Espagne, Mishima en profita pour vivre de près deux traits de notre identité qui l’impressionnaient le plus : la tauromachie et le flamenco.
Dans une interview, lorsqu’on lui demanda qui il sauverait si une bombe atomique devait dévaster l’Europe, Mishima répondit que ce serait le philosophe allemand Martin Heidegger et l’historien espagnol Díez del Corral.

La Légion et le Bushido
Une autre chose qu’aimait Mishima dans l’âme espagnole était la Légion. Il n’était pas surprenant, puisque Millán-Astray avait étudié le Bushido, et a même écrit la préface de sa traduction en espagnol. Le fameux militaire espagnol, boiteux, manchot et aveugle s’inspira du code samouraï pour fonder sa milice. Il l’a lui-même déclaré : « Et aussi, je me suis appuyé sur le Bushido pour soutenir le credo de la Légion, avec son esprit légionnaire de combat et de mort, de discipline et de camaraderie, d’amitié, de souffrance et de dureté, de répondre au feu. Le légionnaire espagnol est aussi samouraï et pratique l’essence du Bushido: Honneur, Courage, Loyauté, Générosité et Esprit de Sacrifice. Le légionnaire espagnol aime le danger et méprise la richesse».
Dans ces légionnaires, qui criaient « Vive la mort » et dont l’hymne s’appelait El novio de la muerte, Mishima voyait une attitude épique très similaire à celle qu’il défendait. Évidemment, les slogans légionnaires ne répondaient pas à une impulsion d’autodestruction, mais étaient des consignes pour donner du courage à ceux qui étaient prêts à tout sacrifier pour défendre des causes supérieures à leur propre vie.

Une problématique de culture
Mishima comprenait que le code d’honneur caldéronien partageait une ressemblance avec l’honneur japonais « plus que n’importe quel autre schéma de dignité personnelle des pays occidentaux ». Le 24 septembre 1969, il publia dans le journal The Times de Londres un article intitulé A problem of culture. Il y parle de « l’esprit espagnol du samouraï » et énumère ses préférences et ses fétiches. Juan Antonio Vallejo-Nágera considère dans Mishima ou le plaisir de mourir que cet article est très important pour comprendre l’idéologie politique de l’écrivain.
L’auteur nippon loue les Espagnols devant le public britannique et souligne leur conscience collective de la mort, l’idéal du « bon mourir » hérité des Tercios sous la proclamation du « ¡Viva la Muerte ! » et la défense de la tauromachie comme un exemple de résistance face à l’uniformisation occidentale. Il affirme aussi que seul un Espagnol aurait pu dire qu’il était « meilleur honneur sans navires que navires sans honneur » — une attitude qui aurait semblé insensée pour le reste des nations.
Mishima ajoutait dans cet article qu’il se considérait comme « un Don Quichotte ; bon, un Don Quichotte mineur contemporain ». Et c’est ainsi qu’il unissait à jamais l’esprit du samouraï à celui du hidalgo, terminant ainsi sa recherche.
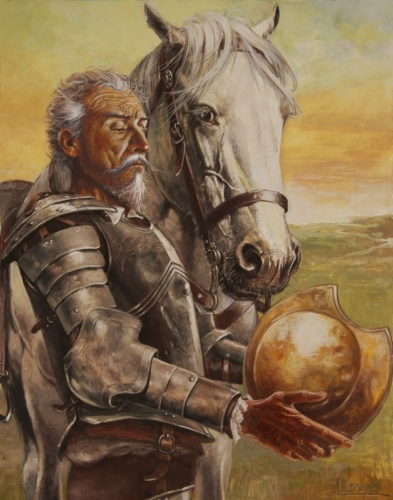
L’heure des hidalgos
Don Quichotte de la Mancha est un archétype du véritable hidalgo. C’est un homme qui vit humblement et qui, influencé par la lecture des livres de chevalerie, décide de sortir du confort de sa vie et de mettre ses armes au service des nécessiteux. L’ingénieux hidalgo disait que « la chose dont le monde avait le plus besoin était de chevaliers errants et que l’on ressuscitât la chevalerie errante ».
François Bouqsuet appliquait une réflexion similaire aux temps modernes : « Je crois profondément que, s’il y a lutte — et il y en a — ce n’est pas une lutte de classes dont il s’agit, mais la lutte millénaire des poètes, des chevaliers, contre la classe prédominante des êtres grossiers et vulgaires (…) une lutte entre ceux qui soutiennent les colonnes du temple et ceux qui les profanent et les détruisent. »
Dans une époque marquée par la vulgarité et le narcissisme, l’esprit hidalgo nous offre un code différent. Un style qui allie l’exigence de soi à la défense d’idées nobles. On peut trouver dans l’esprit hidalgo une référence pour avancer (même avec beaucoup d’efforts et d’erreurs) debout dans un monde en ruine.
18:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yukio mishima, japon, espagne, lettres, lettres japonaises, littérature, littérature japonaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 25 novembre 2025
Jeux orientaux

Jeux orientaux
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/giochi-orientali/?sfnsn=scwspmo
La Chine et le Japon semblent être à couteaux tirés. Les tensions entre Pékin et Tokyo n'avaient jamais atteint un tel paroxysme depuis la Seconde Guerre mondiale.
En effet, les relations entre ces deux empires historiques d'Extrême-Orient s'étaient considérablement améliorées au cours des années qui suivirent la Seconde Guerre mondiale. Notamment parce que le Japon, sous la tutelle des États-Unis, semblait avoir totalement renoncé à jouer un rôle politico-militaire. Il était devenu une simple puissance économique et industrielle.
En somme, un géant, mais un géant aux pieds d'argile.
Aujourd'hui, cependant, les choses changent rapidement. Et elles changent de manière radicale.
Washington, de plus en plus préoccupé par la croissance de Pékin, a en effet levé les restrictions sur le réarmement de Tokyo. Afin de pouvoir utiliser la puissance du Japon pour contenir la Chine.

Cela a bien sûr posé des problèmes. Car la charmante Mme Sanae Takaichi, première femme à la tête du gouvernement japonais, a immédiatement commencé à montrer les dents. Aiguisées comme les crocs d'un tigre à dents de sabre.
D'autre part, Sanae Takaichi est une représentante de l'aile la plus conservatrice du Parti libéral-démocrate. Une aile qui a toujours nourri des sentiments fortement nationalistes et le rêve de ramener le Japon à un rôle de véritable puissance.
Après tout, cela fait quatre-vingts ans que la guerre a mis Tokyo à genoux. Et quatre-vingts ans, pour nous Occidentaux, c'est une éternité, pour les Orientaux, un simple souffle du vent.
Et, bien que colonisés par les Américains, les Japonais restent profondément orientaux.
Quoi qu'il en soit, Mme Sanae a clairement indiqué que son Japon n'avait pas l'intention de suivre la dérive occidentale à l'égard de Moscou. Au contraire, elle entend améliorer les relations commerciales avec la Russie, car elles sont essentielles au développement de l'économie nationale.
Une décision qui a laissé perplexes de nombreux représentants de l'opposition interne. Mais qui s'est également fondée, peut-être surtout, sur la certitude que le Washington de Trump n'en ferait pas une tragédie.
Certes, cela a dérangé, mais sachant que la Maison Blanche a aujourd'hui d'autres priorités. Et que, pour cette raison, elle a virtuellement besoin du soutien de Tokyo.
Et la priorité des priorités, inutile de le dire, s'appelle Pékin.
Endiguer la Chine est aujourd'hui l'impératif principal de Washington. Et c'est à cela qu'il subordonne, parfois au détriment de tous les autres objectifs.
Cela peut expliquer le comportement du gouvernement japonais. D'un côté, il revendique une autonomie totale dans sa politique vis-à-vis de la Russie. Avec laquelle il entend intensifier ses échanges commerciaux.
Mais, d'autre part, il montre son visage armé à Pékin. Allant même jusqu'à proposer une sorte de protectorat sur Taïwan.
Un choix obligé. Mme Sanae Takaichi est évidemment bien consciente que l'autonomie croissante de son Japon doit payer un prix à Washington.
Et ce prix consiste à montrer un visage dur à Pékin.
En se montrant le plus fiable, le Japon est un allié important de Washington dans la lutte pour le contrôle de la zone panpacifique.
17:52 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, chine, russie, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 24 novembre 2025
Alchimie orientale
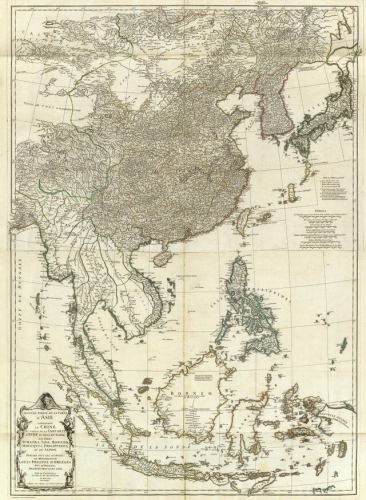
Alchimie orientale
par Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/alchimie-orientali/
Comprendre la Chine, comprendre le Japon ou Taiwan est, pour nous, Occidentaux, une tâche extrêmement ardue.
Car leurs politiques échappent à nos critères habituels. Elles deviennent floues, difficiles à déchiffrer.
Bien sûr, nous lisons ce qu’ils écrivent. Nous écoutons ce qu’ils disent. Et pourtant, nous ne comprenons pas, ou plutôt, nous ne pouvons pas comprendre parce que nous avons une conception/représentation différente du temps.
Même avec les Japonais et les Taiwanais, qui ont pourtant subi des décennies de domination américaine. Qui les ont imprégnés de notre modernité.
Mais cela n’est qu’une couche extérieure. Une apparence, qui peut tomber à tout moment.
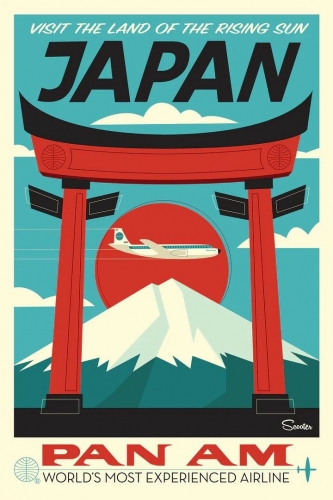
Le Japon a été, depuis 1945 jusqu’à aujourd’hui, en fait, une colonie américaine. Contrôlé de toutes les manières. Contraint d’être différent de ce qu’il est, par l'histoire et la culture.
Et cela semblait l’avoir dompté, anesthésié. Malgré des révoltes et des protestations solitaires. Comme le seppuku de Mishima.
Cela semblait…
Mais maintenant, Washington, pour des raisons spécifiques dictées par leur volonté d'endiguer l’expansion chinoise, a accordé, ou plutôt été obligé d’accorder, à nouveau au Japon la possibilité de se réarmer. Autrement dit, de ne plus être une puissance économique géante tout en demeurant un lilliputien sur le plan de la puissance militaire.
Et, immédiatement, Tokyo a recommencé à faire de la politique. De manière décidément autonome. En déclarant, par la voix de son Premier ministre, qu’il n’a pas l’intention de rompre ses relations commerciales avec Pékin. Au contraire, il souhaite les renforcer. Parce que cela sert l’intérêt national du Japon.

Taïwan vit encore dans une dimension suspendue. Les États-Unis cherchent, de toutes leurs forces, à favoriser ceux qui voudraient faire des Taiwanais un peuple distinct, et éloigné, de la Chine.
Une ingénierie ethnique et sociale qui n'est guère facile. Parce qu’au-delà de ces jeunes faucons taïwanais, nourris par les États-Unis, il y a de nombreux liens profonds entre la grande île et la Chine continentale. Au point que le Kuomintang, héritier du nationalisme chinois, revendique toujours le lien avec le continent. Et continue à se battre pour le maintenir en vie.
Paradoxe, l’ennemi historique du Parti communiste chinois est aujourd’hui l'allié potentiel de Pékin. Qui, en toutes occasions, revendique la réunification définitive avec Taïwan. Mais sans hâte, toutefois. Avec toute la sérénité orientale.
Oui… Pékin. Le géant économique, industriel, qui représente la véritable obsession de toutes les administrations américaines. Qui le voient comme l’ennemi. Et pourtant, elles ne peuvent s’en passer, tant les intérêts entre les deux puissances sont étroitement liés et imbriqués.
Les maîtres de la Cité Interdite sont convaincus qu’un affrontement frontal avec les Américains est inévitable. Mais ils n’ont aucune hâte. Au contraire, ils laissent le temps s’écouler paisiblement, en veillant attentivement à leurs propres affaires. Et en élargissant progressivement leur champ d’action et d’influence.
L’Asie, le Moyen-Orient, de vastes zones de l’Afrique. Et, non en dernier lieu, les grandes routes commerciales entre la Chine et l’Europe. La Route de la Soie 2.0, et le Noble Collier de Perles, ou la Route maritime de la Soie. De la Chine à la Méditerranée, en passant par l’océan Indien et Suez.
Ils n’ont pas hâte. Xi Jinping sourit sournoisement. Et ainsi tout son groupe dirigeant. Les nouveaux mandarins de la Cité Interdite.
Ils comptent sur le temps, qui travaille pour eux.
L’urgence névrotique des Occidentaux ne les touche pas.
Au contraire, cela leur profite.
16:27 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, extrême-orient, chine, japon, taiwan, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 28 octobre 2025
Le Japon se réveille à la Tradition

Le Japon se réveille à la Tradition
Moscou voit une nouvelle voie alors que le Japon passe d’un déclin libéral à une consolidation sur base de ses valeurs ancestrales
Alexander Douguine
Alexander Douguine voit le tournant du Japon sous Sanae Takaichi comme un réveil civilisateur qui pourrait aligner Tokyo avec la Russie dans la révolte mondiale contre le libéralisme.
Le Japon a élu sa première femme Premier ministre — Sanae Takaichi. Son élection constitue un signe politique très sérieux.

Partout dans le monde, l’idéologie libérale s’effondre. Dès le début des années 1990, elle avait dominé la politique, l’économie et la culture — presque sans rencontrer d'opposition. Pourtant, après trente-cinq ans de règne ininterrompu, le libéralisme est arrivé à une exhaustion totale. Ses principes fondamentaux — universalité des droits de l'homme, la notion de « fin de l’histoire » (Fukuyama), le principe de l’identité individuelle, la woke culture, l’idéologie transgenre, l’immigration illégale, et le multiculturalisme — ont échoué à l’échelle mondiale.
Les libéraux étaient sur le point de prendre le contrôle de toute l’humanité; aujourd’hui, le libéralisme et le mondialisme s’effondrent partout. La Russie, la Chine, l’Inde, le monde islamique, les pays africains et l’Amérique latine — unis dans le BRICS — se sont levés précisément contre ce programme. L’élection de Donald Trump a été le premier grand coup porté à l’hégémonie libérale: dès son premier jour au pouvoir, il a rejeté les dogmes fondamentaux du projet libéral, y compris l’activisme LGBT et transgenre, ainsi que l’idéologie de la Critical Race Theory — celle du racisme anti-blanc qui avait envahi l’éducation et la culture occidentales. Tout ce paquet a été rejeté par la majorité de l’humanité non-occidentale, et maintenant aussi par l’Amérique elle-même. Seule l’Union européenne reste la dernière forteresse de ce pandémonium, bien que tous ses États membres ne partagent pas encore les mêmes convictions.
Il n’est donc pas surprenant que le paradigme libéral ait également disparu au Japon — longtemps considéré comme un pays intégré dans le monde occidental centré sur l’Amérique. À l’instar des Etats-Unis trumpistes, le Japon a élu une femme qu’on peut qualifier de « Trumpiste » — ou peut-être de «Trumpiste japonaise ». Sanae Takaichi incarne des valeurs traditionnelles: elle voit le mariage comme une union entre un homme et une femme, elle trouve normal que les femmes prenant le nom de leur mari après le mariage, et vise le « zéro immigration » — ce qui signifie que les migrants illégaux et légaux devraient être expulsés du Japon.

Takaichi appelle à un retour à la foi shintoïste, à une réaffirmation du culte impérial, et à la renaissance du bouddhisme traditionnel. Elle visite régulièrement le sanctuaire dédié aux morts de la guerre de la Seconde Guerre mondiale, défiant ouvertement les récits libéraux sur le passé du Japon. En substance, elle prône la restauration de la souveraineté militaire et politique du Japon. Il est frappant que la première femme Premier ministre ait autrefois joué de la batterie dans un groupe de heavy metal. Cette femme remarquable — une ancienne batteuse de métal — mène désormais la renaissance de l’esprit samouraï, des valeurs traditionnelles, du culte impérial, de la religion shintoïste, et du culte de la déesse du soleil Amaterasu, ancêtre de la lignée impériale.
C’est rien de moins qu’une révolution conservatrice au Japon, qui se déroule sous nos yeux. Le parti bouddhiste modéré Komeito s’est retiré de la coalition de gouvernement avec le Parti libéral-démocrate maintenant dirigé par Mme Takaichi. Pourtant, elle a mobilisé une autre force — le Parti de l’innovation japonaise (Ishin no Kai), encore plus à droite et conservateur.
Est-ce une bonne ou une mauvaise chose pour nous ? Idéologiquement, c’est positif. La Russie aussi revient à des valeurs traditionnelles — aux idéaux de l’Empire, de l’Orthodoxie et de l’identité nationale. C’est notre tendance, comme c’est le cas en Amérique et de plus en plus dans le monde entier. Le Japon, qui se dresse aujourd'hui contre le libéralisme, ne fait que rattraper le reste de l’humanité, qui se débarrasse rapidement de toute la pourriture de l’idéologie libérale.
L’Union européenne reste le dernier bastion du déclin, de la dégénérescence et de la sénilité politiques — mais probablement pas pour longtemps. Le Japon, en revanche, rejoint les rangs des pays fondés sur des valeurs traditionnelles. La Russie appartient à ce même camp, ce qui crée un terrain fertile pour le dialogue.

Parallèlement, le Japon reste néanmoins bien ancré dans le cadre de la politique étrangère américaine. Sa militarisation croissante signifie qu’il adoptera une ligne plus agressive dans la région du Pacifique. La Russie et le Japon ont une longue et difficile histoire commune — à commencer par la guerre russo-japonaise du début du 20ème siècle, lorsque Tokyo, après la restauration Meiji, s’était orienté vers les États-Unis. Cela pourrait présenter un certain risque pour la Russie.
Pourtant, cette nouvelle orientation du Japon est un défi encore plus grand pour la Chine — un autre géant du Pacifique, et ami proche ainsi que partenaire de la Russie. C’est pourquoi la restauration de relations normales avec un Japon récemment redevenu traditionaliste — et désormais idéologiquement plus proche de nous — ne doit pas se faire au détriment de notre partenariat qu'est la Chine, notre principal allié et partenaire fondamental .
Cependant, si nous voyons dans Sanae Takaichi — cette « batteuse d'esprit samouraï » — quelqu'un qui amorce un véritable mouvement vers la Russie et qui preste un effort sincère pour atteindre la souveraineté stratégique du Japon, c’est-à-dire vise à se libérer du contrôle direct du pays par les Américains, alors nous aurons une bonne base pour discuter. La Russie pourrait établir une relation bilatérale avec le Japon basée sur des intérêts mutuels. Nous pourrions même agir en tant que médiateurs de la paix dans le Pacifique, aidant nos amis chinois à passer de la confrontation à une forme de coopération en Asie de l’Est. En tant que grande puissance pacifique, la Russie pourrait jouer un rôle important dans cette transformation.

Il est encore trop tôt pour dire ce que la gouvernance de cette exceptionnelle figure du Japon — qui incarne l’essence symbolique de la déesse Amaterasu — apportera. Mais, quoi qu'il en soit, son arrivée au pouvoir marque un moment remarquable dans l’histoire du Japon. Et peut-être, sous cette nouvelle « Déesse Amaterasu », la Russie pourra établir des relations constructives, tournées vers l’avenir, et multipolaires avec le Japon — des relations basées sur les plans idéologique, civilisationnel et géopolitique — en harmonie avec notre alliée et partenaire la plus chère, la grande Chine, où les valeurs traditionnelles prévalent également.
Au fait, les valeurs traditionnelles triomphent aussi dans la belle Corée du Nord — contrairement à ce qui se passe en Corée du Sud, pays qui demeure l’un des bastions de la décadence libérale. J’espère cependant que ce ne sera que temporaire, et que la Corée retrouvera son unité et sera alors véritablement coréenne. Il faut aussi se rappeler qu’il existe de profondes tensions entre la Corée et le Japon.
En résumé, la Russie a maintenant une chance de réinitialiser ses relations avec le Japon sur la base d’un retour commun aux valeurs traditionnelles. Voyons ce que cela donnera.
17:19 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, actualité, japon, asie, affaires asiatiques, sanae takaichi |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 29 septembre 2025
Le Japon comme colonie américaine
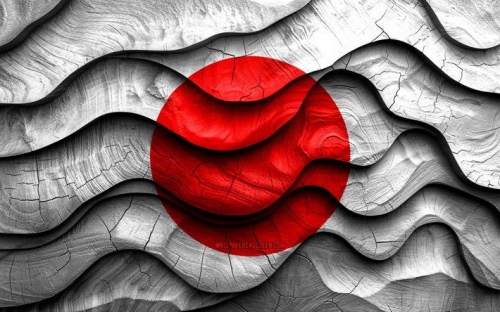
Le Japon comme colonie américaine
par Kazuhiro Hayashida
Kazuhiro Hayashida soutient que le Japon contemporain se méprend sur la Chine, confond amis et ennemis, et demeure une colonie américaine.
Depuis quelque temps, je parle d’une inversion particulière dans l’interprétation que le Japon se donne de lui-même. Normalement, il devrait être simple de comprendre la distinction entre ami et ennemi. Pourtant, de façon étrange, de nombreux Japonais semblent incapables de reconnaître cette distinction fondamentale.
Le terme « État profond » est récemment devenu courant au Japon, mais peu reconnaissent que son quartier général se trouve aux États-Unis.
Trump a, par moments, affronté l’État profond, mais sa lutte contre lui est restée limitée. Il ne l’a pas complètement soumis. À la place, en négociant des accords, il semble affaiblir son influence intérieure tout en exécutant à l’étranger les actions mêmes souhaitées par l’État profond.
Ayant été chassé d’Amérique, l’État profond semble avoir déplacé ses opérations vers le Japon. Ici, ses forces résiduelles trouvent un terrain fertile. Le gouvernement japonais adopte désormais des politiques qui ignorent la volonté de ses propres citoyens, tandis qu’en politique étrangère il prend des décisions contraires au bon sens.

Dans le monde entier, l’équation « anti-État profond = Russie » est considérée comme allant de soi. La particularité du Japon est que cette vérité ne s’applique pas chez lui. Parce que les attentes japonaises envers Trump en tant que figure anti-État profond étaient exagérément gonflées, son incapacité à y répondre a engendré une désillusion qui s’est rapidement muée en désespoir.
Historiquement, le Japon était gouverné selon une structure duale: l’Empereur et le shogunat. Le shogunat exerçait le pouvoir effectif. Aujourd’hui, l’Amérique agit au Japon comme un nouveau shogunat.
À la fin de la Grande Guerre en Asie orientale, l’Amérique a démantelé les institutions politiques japonaises, remplacé le gouvernement japonais et imposé un régime d’occupation. En réalité, cela équivalait à un changement de shogunat. L’Amérique avait instauré le sien.

Ainsi, le gouvernement japonais fonctionne aujourd’hui comme un régime fantoche, militaire, modéré, administré par le shogunat américain, gouvernant une nation désarmée. C’est précisément cet arrangement — né de la défaite du Japon, de son occupation et de sa subordination ultérieure à la puissance américaine — qui a produit le cadre idéologique dans lequel les bombardements atomiques et la destruction indiscriminée des grandes villes japonaises sont défendus comme des actes de guerre légitimes. Parce que le régime d’après-guerre doit son existence même aux États-Unis, il hérite et perpétue le récit selon lequel la violence américaine était juste, même lorsqu’elle signifiait le massacre de civils en masse.
De telles justifications provoquent une réaction corrosive chaque fois que les nations asiatiques condamnent le Japon pour son rôle d’avant-guerre dans la domination régionale.
Le raisonnement japonais se formule ainsi:
Le Japon était une menace pour l’Asie ; par conséquent, la libération par l’Amérique était nécessaire. Si l’intervention militaire américaine était juste, alors les bombardements atomiques et les bombardements aveugles des villes nippones l’étaient aussi.
L’Amérique a libéré le Japon. En libérant le Japon, elle a aussi libéré l’Asie. Si cette libération est reconnue mondialement comme juste, alors les politiques américaines le sont aussi — et de façon absolue.

Ce récit a été imprimé à maintes reprises au Japon durant la Guerre froide. Puis vinrent l’éclatement de la bulle économique, l’effondrement de l’Union soviétique et l’ascension de George Soros. « La société ouverte » de Karl Popper fut soudain appliquée au Japon lui-même. Les structures politiques traditionnelles furent effacées, la mémoire historique des relations régionales gommée, et la perception de la Russie et de la Chine comme ennemis solidement ancrée.
Les conservateurs japonais font face à un argument auquel ils ne peuvent répondre. Cet argument dit: la Chine est peut-être communiste, mais si on l’évalue du point de vue de la résistance à la domination américaine, alors, comparées à l’acte du Premier ministre Kishida de vendre le Japon à Washington, les actions de la Chine envers le Japon paraissent plus justes.
Les Japonais vivent sous l’illusion qu’ils gouvernent un État indépendant. Leur situation reflète celle de l’Ukraine. Privé de véritables droits politiques, le peuple japonais n’a aucun moyen direct de résister à la campagne discrète de Soros visant à racheter le Japon.

En pratique, cela signifie que le Japon est incapable de contrer le récit, exprimé par Soros à l’Asia Society, d’une guerre imminente entre le Japon et la Chine.
D’un point de vue géopolitique, la ligne en neuf traits de la Chine — sa revendication de souveraineté sur la majeure partie de la mer de Chine méridionale — chevauche la « ligne de défense absolue » autrefois proclamée par l’Empire du Japon, cette frontière de guerre que Tokyo s’était juré de tenir à tout prix. De ce point de vue, quand la Chine regarde le Japon, elle voit l’Amérique — car le Japon d’aujourd’hui est une colonie américaine.
Ce dont le Japon a surtout besoin, c’est de reconnaître que l’Amérique est l’ennemi, et que le libéralisme doit être abandonné. Je me sens obligé de rappeler sans cesse que le « libéralisme » n’est pas synonyme de démocratie.
14:39 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 18 septembre 2025
L’essor du technofascisme dans l’Amérique de Trump

L’essor du technofascisme dans l’Amérique de Trump
Markku Siira
Source: https://geopolarium.com/2025/09/15/teknofasismin-nousu-tr...
Le développement de l’intelligence artificielle a déclenché une vague d’investissements dans le secteur technologique. Des grandes entreprises comme Microsoft, Meta, Amazon et Google misent sur les modèles linguistiques, la puissance de calcul, la technologie des semi-conducteurs et les centres de données. Toutefois, la rentabilité économique de ces investissements demeure incertaine. Des innovations telles que celle de DeepSeek, une entreprise chinoise, démontrent que d’immenses ressources ne sont pas toujours nécessaires pour réussir dans la compétition mondiale.
Les récits médiatiques sur le potentiel révolutionnaire de l’IA se polarisent entre deux extrêmes: des visions utopiques prédisant que l’IA résoudra les problèmes de l’humanité, et des scénarios de menaces existentielles où l’IA relèguerait l’humanité au second plan. Ce discours polarisant néglige souvent les changements progressifs et pratiques par lesquels la technologie influence réellement la société.

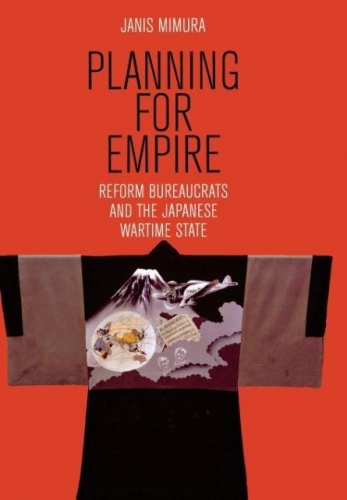
La recherche de l’historienne Janis Mimura sur le technofascisme japonais, Planning for Empire: Reform Bureaucrats and the Japanese Wartime State (2011), offre un cadre d’analyse pour les évolutions actuelles. Mimura décrit comment le Japon a colonisé la Mandchourie, au nord-est de la Chine, dans les années 1930, faisant de la région un terrain d’expérimentation précoce du technofascisme. Il en résulta un État fantoche autoritaire, le Mandchoukouo, centré sur l’industrie lourde comme la production d’acier et d’armes, exploitant la population locale et les ressources naturelles au service des besoins militaires du Japon.

Le fonctionnaire du ministère du Commerce, Kishi Nobusuke (photo), a dirigé à partir de 1936 un programme d’industrialisation soutenu par les conglomérats zaibatsu au Mandchoukouo. Cela impliquait le recours au travail forcé et à l’esclavage, ainsi que des conditions de travail inhumaines, entraînant de nombreuses victimes. De retour à la politique nationale japonaise en 1939, Kishi a promu une industrialisation dirigée par l’État similaire dans son pays.
La technocratie était un projet idéologique plaçant la rationalité technologique au-dessus des valeurs sociales, légitimant ainsi la concentration du pouvoir. Contrairement au fascisme de Mussolini ou au national-socialisme d’Hitler, le système japonais ne reposait pas sur un chef charismatique, mais sur des bureaucrates et sur l’armée. Selon Mimura, le Japon a « glissé vers le fascisme » lorsque les fonctionnaires utilisaient leur pouvoir dans l’ombre au nom de l’empereur. La survie de la technocratie dans le Japon d’après-guerre témoigne de sa capacité d’adaptation institutionnelle.
L’élite technocratique de la Silicon Valley est devenue un acteur central aux États-Unis. Les géants du numérique tirent un pouvoir symbolique et matériel de l’apparente irrésistibilité de la technologie, marginalisant les débats critiques sur les impacts sociaux de la digitalisation. Ce pouvoir s’inscrit dans le plan d’action sur l’IA de l’administration Trump, visant à accélérer le développement de l’IA en réduisant la régulation et en promouvant le leadership mondial des États-Unis selon des objectifs géopolitiques stratégiques.
Lors de l’investiture présidentielle en janvier, des leaders technologiques tels qu’Elon Musk et Mark Zuckerberg ont apporté leur soutien à Donald Trump, ce qui a été interprété comme une alliance stratégique au service d’intérêts économiques et politiques. Selon Mimura, une telle alliance entre l’État et l’élite industrielle rappelle le technofascisme du Japon durant la Seconde Guerre mondiale, où les technocrates ont pris le pouvoir.

Contrairement au fascisme traditionnel, le technofascisme américain s’exprime comme une gouvernance technocratique subtile. Il se manifeste dans la prise de décision militaire, les opérations des services de sécurité et la projection de puissance mondiale. Socialement, il se traduit par la surveillance policière préventive, la surveillance des réseaux sociaux et le soutien au sionisme dans la politique étrangère. Dans le monde du travail, la culture du « hustle » issue de la Silicon Valley normalise la surcharge et affaiblit les droits des travailleurs. Cette évolution légitime la discrimination algorithmique et approfondit les inégalités socio-économiques.
Si le progrès technologique repose souvent sur des réformes progressives, le cœur du technofascisme consiste à considérer que la régulation – qu’il s’agisse de la protection de l’environnement, des droits des travailleurs ou de la supervision financière – freine l’innovation. Par exemple, le discours public d’Elon Musk est passé de la mise en avant des risques de l’IA à sa valorisation stratégique dans la prise de décision automatisée et les applications basées sur les données, comme le développement de technologies par xAI.
Les conglomérats zaibatsu du Japon ont mené le développement industriel sans considération pour les droits des travailleurs; une dynamique similaire est visible aujourd’hui aux États-Unis, où les entreprises technologiques promeuvent automatisation et technologies de surveillance. L’infrastructure bâtie par les géants du numérique crée un « État profond » modernisé et antidémocratique, au service de l’élite technocratique et économique.
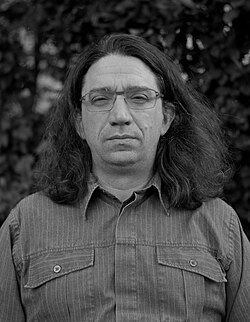 Ce système démantèle les structures de gouvernance traditionnelles et remplace les processus démocratiques par une logique d’efficacité. Comme l’affirme le penseur Curtis Yarvin (photo), apprécié des techno-oligarques, « les élections démocratiques sont inutiles pour la gestion administrative, et même si le système électoral disparaissait, Washington continuerait à fonctionner comme avant ».
Ce système démantèle les structures de gouvernance traditionnelles et remplace les processus démocratiques par une logique d’efficacité. Comme l’affirme le penseur Curtis Yarvin (photo), apprécié des techno-oligarques, « les élections démocratiques sont inutiles pour la gestion administrative, et même si le système électoral disparaissait, Washington continuerait à fonctionner comme avant ».
La recherche de Mimura souligne la capacité des technocrates à survivre à l’effondrement des systèmes autoritaires en dépit des changements institutionnels. L’ascension de Kishi Nobusuke – malgré qu'il dirigea le projet technofasciste en Mandchourie et malgré des accusations de crimes de guerre – au poste de Premier ministre du Japon, avec le soutien des États-Unis, montre comment la compétence technocratique peut légitimer les changements de pouvoir dans les moments de rupture historique.
Aux États-Unis, une dynamique similaire ne s’exprime pas à travers des alliances fragiles (comme l’illustre la rupture entre Trump et Musk), mais par une intégration systémique: les géants du numérique sont devenus une partie essentielle de la cybersécurité fédérale, du renseignement et de la gestion des infrastructures critiques. La base du pouvoir se déplace du mandat démocratique vers une irremplaçabilité technique.
À mesure que l’ordre libéral occidental chancelle, il pourrait être remplacé par un pouvoir d’entreprise technofasciste agissant dans les coulisses de la politique. Selon une nouvelle étude, la majorité de plus de 500 politologues estime que les États-Unis évoluent vers un modèle de gouvernance autoritaire, où un groupe dominant utilise les institutions étatiques pour réprimer ses opposants politiques.
17:00 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : technofascisme, actualité, états-unis, japon, technocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 13 septembre 2025
La crise terminale de la politique japonaise

La crise terminale de la politique japonaise
par Kazuhiro Hayashida
Kazuhiro Hayashida soutient que la démission du Premier ministre Shigeru Ishiba met à nu la vacuité de la politique japonaise et sa dépendance extérieure, avertissant que seule une orientation vers la multipolarité et la Quatrième Théorie Politique peut restaurer l’autonomie nationale et la survie culturelle.

Shigeru Ishiba (photo) a annoncé sa démission du poste de Premier ministre. Cet événement dépasse le simple changement de personnel; il a révélé les contradictions profondes de la politique japonaise. Ishiba est depuis longtemps considéré comme pro-chinois et s’est retrouvé engagé dans une rivalité féroce au sein du Parti libéral-démocrate contre la faction de l’ancien Premier ministre Shinzo Abe. Pour protéger sa propre position politique, Ishiba a donné la priorité à l’élimination de la faction Abe, allant jusqu’à conduire délibérément le parti à la défaite électorale. Dans l’histoire politique japonaise, il existe peu de précédents où un homme politique place le conflit de faction au-dessus de la victoire globale de son parti.
À l’inverse, l’ancien Premier ministre Fumio Kishida est l’archétype du pro-américain, dont la politique étrangère et de sécurité a toujours été étroitement coordonnée avec Washington. Ainsi, les gouvernements japonais se sont retrouvés pris dans une structure duale — « Ishiba pro-chinois » contre « Kishida pro-américain » — qui a sapé toute cohérence dans la stratégie nationale. Cette structure instable a empêché le Japon d’élaborer une diplomatie autonome et créé un « vide » récurrent, propice à l’exploitation par des puissances extérieures.
Aujourd’hui, un point de vue largement partagé au Japon considère que la Chine collabore avec les États-Unis pour affaiblir le pays. En effet, lorsque la posture du Japon en tant qu’allié américain devient gênante pour la Chine ou la Russie, il n’est pas exclu que l’ordre politique interne soit sciemment perturbé afin de saper les fondements de la politique japonaise. Pour ma part, je trouve l’attitude de la Chine envers le Japon opaque: un mélange de coopération économique apparente et d’une stratégie d’infiltration difficile à démêler.
Le véritable problème réside dans la pauvreté extrême de l’imagination des politiciens japonais face à une telle pression extérieure. Ils manquent de stratégies à long terme ancrées dans la survie de leur culture et de leur histoire, et restent obnubilés par des luttes de pouvoir à court terme et des réponses improvisées à la pression extérieure. En conséquence, le Japon a perdu son autonomie culturelle, la politique s’est vidée de sa substance, et dans ce vide se précipitent les forces du capital international: ce qu’on appelle l’État profond. L’État profond ronge un Japon encore vivant, pillant ses ressources économiques et ses institutions sociales.

Cette image rappelle l’effondrement de l’Union soviétique: dépendance croissante à l’égard des puissances extérieures, corruption systémique, perte de l’imagination politique, désillusion et démoralisation du peuple. À l’instar du système soviétique finissant, le Japon dépend aujourd’hui excessivement de cadres économiques et sécuritaires gérés de l’extérieur, et dérive vers un effondrement interne. Plus grave encore, ceux qui s’élèvent contre ce processus ne sont pas organisés en véritables acteurs de l’autonomie; au contraire, ils sont achetés et instrumentalisés – à l’image du nationalisme ukrainien – de sorte que leurs appels se transforment en demandes de « renforcement militaire contre la Chine et la Russie », ce qui ne sert au final que le scénario des puissances extérieures.

Ceci marque la phase terminale d’un État financiarisé, dénué de philosophie. Jadis, le Japon disposait d’un art de gouverner résilient, fondé sur l’unicité culturelle et la solidarité sociale. Aujourd’hui, le manque d’imagination des politiciens et la dépendance accrue vis-à-vis de l’extérieur ont vidé de leur substance les fondements mêmes de la nation. Il ne subsiste qu’un faible reste de force, qu’il faut mobiliser si le Japon veut se libérer du sortilège de l’occidentalisme. Sinon, le pays sera entièrement absorbé par le capital et la pression extérieure, et sa culture disparaîtra.
Désormais, l’acceptation de la multipolarité s’impose. Le Japon doit s’éloigner de l’unipolarité centrée sur l’Occident et réévaluer sa place au sein d’un ordre multipolaire eurasiatique. La Quatrième Théorie Politique offre la base philosophique pour ce changement. Elle rejette l’idée du libéralisme comme aboutissement final de l’histoire, et vise à replacer l’existence même (Dasein) – et non l’homme, la classe, la nation ou la race – au centre de la politique. En reconnaissant l’autonomie des civilisations et en concevant un ordre fondé sur la reconnaissance et la retenue mutuelles, cette perspective offre au Japon la possibilité de transcender la subordination à l’Occident.
La politique japonaise actuelle souffre cruellement de l’absence de cet horizon philosophique. La démission d’Ishiba, la rivalité des factions Abe et Kishida – tout cela n’est que luttes de pouvoir manipulées par des forces extérieures. Il n’y a aucune vision pour l’avenir national, aucune stratégie pour préserver la culture – seulement la préservation de l’équilibre interne du parti et la soumission aux injonctions extérieures. Or, ce vide même est l’essence de la crise japonaise.

Pour que le Japon retrouve son autonomie, il doit d’abord affronter ce vide en face. L’imagination qui fait défaut aux politiciens doit être apportée par un réveil philosophique du peuple. Il lui faut affronter la fin du capitalisme financier occidental, rompre avec l’anglo-saxonisme, et embrasser la multipolarité. Dans ce processus, le Japon ne doit pas voir la Russie et la Chine uniquement comme des adversaires, mais construire de nouveaux circuits de coopération au sein de la civilisation eurasienne.
La démission de Shigeru Ishiba constitue à cet égard peut-être le dernier avertissement adressé au Japon. Si le pays laisse passer cette chance, sa culture disparaîtra et l’État ne sera plus qu’un fragment du capital. Mais si la Quatrième Théorie Politique se diffuse largement et provoque un réveil national, le Japon peut encore retrouver la voie de l’autonomie.
17:43 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 09 août 2025
De McArthur à la bombe atomique: le lourd héritage du Japon
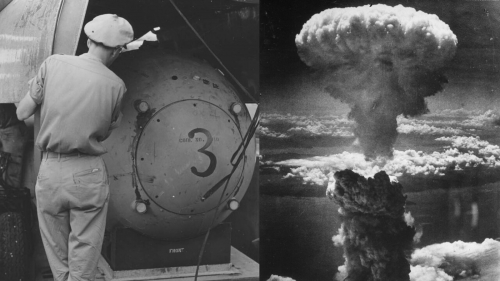
De McArthur à la bombe atomique: le lourd héritage du Japon
Federico Giuliani
Source: https://it.insideover.com/storia/da-mcarthur-alla-bomba-atomica-la-pesante-eredita-del-giappone.html
80 ans se sont écoulés depuis les bombardements atomiques contre le Japon. Le 4 août 1945, les États-Unis ont largué Little Boy sur Hiroshima. Le 9 du même mois, ils ont frappé Nagasaki avec Fat Man.
Une bombe à l'uranium et une autre au plutonium qui ont contraint Tokyo à capituler définitivement et qui, surtout, ont fait entre 200.000 et 240.000 victimes, en comptant les morts immédiats et ceux décédés dans les mois et les années qui ont suivi à cause des radiations et des blessures subies.
Quelques personnes ont survécu à l'apocalypse et portent encore en elles l'horreur de ces instants. Le Japon, en tant qu'État, porte également de nombreuses cicatrices sur le corps. La plus évidente est la Constitution pacifiste, peut-être l'aspect le plus important de l'héritage lourd laissé par le général Douglas McArthur à l'ensemble du pays.
L'héritage nucléaire
Pour comprendre ce qui s'est passé à Hiroshima, il vaut la peine de lire le livre Hiroshima. Le récit de six survivants (éd. it.: Utet; éd. franç.: voir infra) de John Hersey. Il s'agit d'un ouvrage amorcé, au départ, comme un reportage.
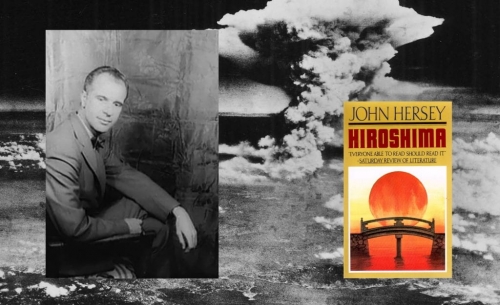
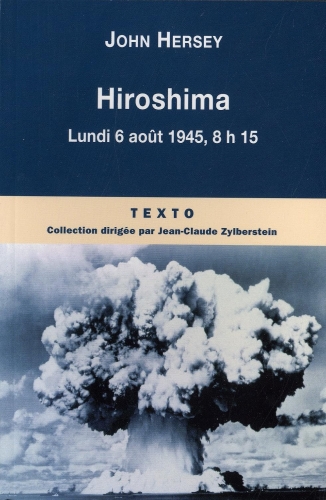
Moins d'un an après le 6 août 1945, Hersey, alors correspondant du New Yorker, fut envoyé au Japon. Le journaliste a rencontré les cicatrices urbaines et humaines et a recueilli les récits des survivants. Il en a choisi six, précisément ceux de Kiyoshi Tanimoto, pasteur de l'Église méthodiste ; Toshiko Sasaki, très jeune employée dans une fonderie ; Masakazu Fujii, patron respecté d'une clinique privée ; Hatsuyo Nakamura, couturière et mère, veuve de guerre depuis peu ; Terufumi Sasaki, jeune chirurgien de la Croix-Rouge ; Wilhelm Kleinsorge, jésuite allemand en mission.
L'article allait se transformer en une fresque émouvante. Hiroshima rend la parole aux victimes, livrant un témoignage inoubliable à leurs contemporains et aux générations futures. En 1985, Hersey retourna voir les six survivants et ajouta une deuxième partie à son livre, qui boucle la boucle et parle d'héritage et de mémoire, préfigurant en quelque sorte le prix Nobel de la paix décerné en 2024 à l'association Nihon Hidankyo, créée par les survivants d'Hiroshima et de Nagasaki.
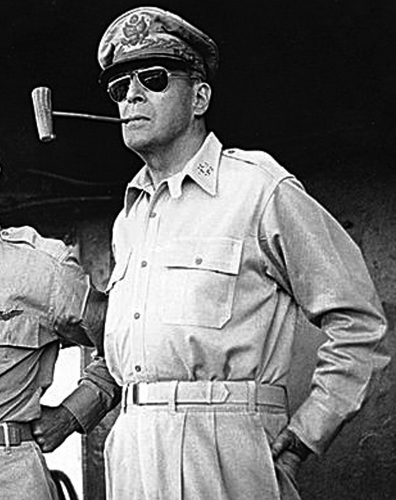
L'héritage politique et militaire de McArthur
Qui était McArthur ? Pour certains, il était un réformateur qui a jeté les bases de la démocratie, du pacifisme et de la prospérité au Japon. Pour d'autres, au contraire, il était une sorte de dictateur étranger qui a imposé à Tokyo une Constitution qui allait étouffer la souveraineté nationale japonaise.
Comme l'explique l'hebdomadaire Nikkei Asian Review, l'héritage de l'occupation japonaise gérée par les États-Unis – et les institutions qui en ont découlé – continue aujourd'hui encore de définir la trajectoire géopolitique du Japon.
Pour comprendre pourquoi, il suffit de rappeler certaines des mesures drastiques prises par McArthur lui-même qui, entre autres, maintint l'empereur Hirohito sur le trône comme symbole de continuité et de stabilité; abolit le soutien gouvernemental au shintoïsme en tant que religion d'État ; fit condamner les criminels de guerre par les tribunaux internationaux ; purgea les fonctionnaires en place pendant la guerre (certains revinrent à leurs ministères) ; démantela partiellement les zaibatsu, les puissants conglomérats familiaux qui dominaient l'économie depuis l'ère Meiji (1868-1912) ; redistribua les terres des grands propriétaires fonciers aux métayers et ouvriers agricoles afin d'affaiblir l'attrait du communisme ; et accorda le droit de vote aux femmes.
Comme si cela ne suffisait pas, en 1947, le général imposa au Japon l'utilisation d'une constitution rédigée par les Américains (traduite en japonais à partir de l'anglais!), qui contenait le fameux article 9. À partir de ce moment, Tokyo devait renoncer à la guerre en tant que droit souverain et ne pouvait plus posséder de forces armées ayant un potentiel militaire. Un héritage très lourd.
13:40 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hiroshima, japon, histoire, douglas macarthur, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 03 août 2025
Le Japon se rapproche davantage de l'Occident collectif

Le Japon se rapproche davantage de l'Occident collectif
Leonid Savin
Au début du mois, le Japon a franchi une nouvelle étape importante dans l'approfondissement de ses relations avec certains membres du groupe de renseignement « Five Eyes » en concluant un accord avec le Canada sur l'échange d'informations classifiées. L'accord sur la protection des informations (SIA) a été signé par le ministre des Affaires étrangères Takeshi Iwaya et son homologue canadienne Anita Anand lors d'une cérémonie à Tokyo le 8 juillet.
Ce document juridiquement contraignant, qui doit encore être ratifié par le Parlement, régira les modalités d'échange, de traitement, de stockage et de destruction des informations confidentielles par les deux parties. Bien que l'accord en soi n'autorise pas l'échange d'informations et ne précise pas quelles données seront échangées, il est considéré comme une étape importante vers l'approfondissement des relations bilatérales dans le domaine de la défense et de la sécurité.
En novembre 2024 le Japon a organisé pour la première fois une réunion de hauts responsables militaires du partenariat de renseignement « Five Eyes », sans être membre de cette structure qui rassemble les pays anglophones.
Cela souligne clairement la coopération croissante entre Tokyo et ses alliés occidentaux dans un contexte de préoccupations communes concernant l'évolution de la situation internationale en matière de sécurité. La réunion avec les membres du groupe, qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, s'est tenue dans le cadre d'une conférence plus large organisée à Tokyo entre des militaires de haut rang des Forces d'autodéfense japonaises.

En décembre 2024, Bloomberg a noté : « L'intégration de Tokyo dans ce club était attendue depuis longtemps, d'autant plus que la région est confrontée à l'assertivité croissante de la Chine et à l'imprévisibilité des ambitions nucléaires de la Corée du Nord. Le groupe ne doit plus perdre de temps pour tirer parti de l'expérience de Tokyo. Il dispose de l'une des plus grandes agences de renseignement au monde et surveille depuis longtemps la Chine et la Corée du Nord, considérées comme l'une des menaces les plus graves pour la sécurité nationale. Ces connaissances seraient inestimables pour la coalition dirigée par Washington, qui subit la pression d'un environnement de plus en plus hostile.
Cependant, la question de l'adhésion du Japon à cette coalition de services de renseignement a été soulevée bien avant. Le Centre pour la politique de sécurité de Washington a fait pression sur cette question dès 2020, soulignant que « l'intégration du Japon dans les « Cinq yeux » constituerait une avancée majeure tant pour les pays membres des « Cinq yeux » que pour les Japonais. Mais la situation en Asie de l'Est devient de plus en plus complexe, et cela semble devoir se poursuivre. C'est un pari risqué, mais le moment est peut-être venu de transformer les Cinq Yeux en Six Yeux ».
Il n'est un secret pour personne que les États-Unis ont tout intérêt à s'assurer la participation du Japon dans la contenir la Chine.
Comme l'a souligné l'Institut allemand pour les affaires internationales et la sécurité dans son analyse de juin, « le Japon considère l'influence croissante de la Chine en Asie du Sud-Est comme un problème majeur de politique étrangère. Il souhaite empêcher l'émergence d'un ordre régional hiérarchisé, fondé sur une asymétrie des pouvoirs et centré sur la Chine. Elle a des intérêts économiques et sécuritaires en Asie du Sud-Est, ainsi que dans le domaine de la coopération multilatérale et des structures institutionnelles de la région. L'action de Tokyo en Asie du Sud-Est vise à maintenir un ordre multilatéral fondé sur des règles dans la région, soutenu par la participation des États-Unis. Son attachement aux règles, principes et normes communs, dont il a fait preuve notamment lors des négociations sur les accords régionaux de libre-échange, mérite d'être souligné. Dans sa politique de sécurité, Tokyo est attachée au respect des normes et règles communes consacrées par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer... »

Le Japon renforce également activement ses relations tant avec les pays qui se montrent plus critiques à l'égard de la Chine, comme les Philippines, qu'avec ceux qui sont considérés comme plus loyaux envers la Chine, comme le Cambodge. Par ses propositions de coopération, le Japon offre aux pays d'Asie du Sud-Est une alternative aux initiatives chinoises et empêche ainsi la Chine de monopoliser la région.
C'est pourquoi les États-Unis et leurs satellites, y compris l'UE, saluent l'intérêt du Japon pour le maintien d'un « ordre fondé sur des règles » en Asie du Sud-Est, y compris en ralliant à leur cause les États de l'ASEAN.
Dans le même temps, les États-Unis misent davantage sur la dissuasion militaire de la Chine et, potentiellement, de la Corée du Nord. Après la rencontre entre Donald Trump et Shigeru Ishiba le 7 février 2025 à Washington, le ministre américain de la Défense, Pete Hegseth, a rencontré le ministre japonais de la Défense, le général Nakatani, le 29 mars à Tokyo. La question de Taïwan a été abordée, et le secrétaire d'État Hegseth a déclaré que « le Japon serait en première ligne dans tout conflit auquel nous pourrions être confrontés dans l'ouest de l'océan Pacifique » et a réaffirmé l'engagement des États-Unis à maintenir « une dissuasion fiable, opérationnelle et crédible dans la région indo-pacifique, y compris de l'autre côté du détroit de Taiwan ». Le ministre Nakatani a réaffirmé que « la paix et la stabilité dans l'ensemble du détroit de Taiwan sont importantes pour la sécurité nationale du Japon ».
Néanmoins, Tokyo ne dépend pas à 100 % des États-Unis dans le domaine des technologies à double usage. La veille, il a été annoncé que le Japon et l'Union européenne prévoyaient de créer un vaste réseau de satellites de communication, comme l'indique le projet d'accord préparé pour le sommet Japon-UE du 23 juillet (dans le cadre des efforts visant à réduire la dépendance vis-à-vis des entreprises américaines telles que SpaceX). À l'issue de la réunion, l'Union européenne et le Japon ont convenu d'une coopération dans le domaine militaire et industriel et ont entamé des négociations sur un accord dans le domaine de la sécurité de l'information, a déclaré le Premier ministre Ishiba.
Il n'est pas exclu que le Japon envoie ainsi un message à l'administration de Donald Trump, qui a promis d'introduire à partir du 1er août des droits de douane de 25% sur toutes les importations de voitures japonaises et de pièces détachées.
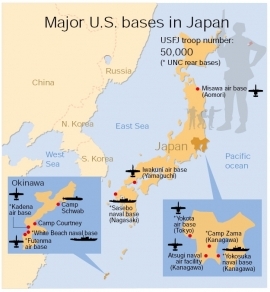
20:23 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 26 juillet 2025
Le parti « Japon d'Abord » l’un des grands gagnants des élections sénatoriales

Le parti « Japon d'Abord » l’un des grands gagnants des élections sénatoriales
Source: https://www.freilich-magazin.com/welt/gegen-migration-jap...
Avec une ligne claire contre la migration et une orientation nationale, Sanseito devient une force sur laquelle il faudra compter dans la politique japonaise.
Tokyo – Lors des élections sénatoriales au Japon dimanche dernier, le parti Sanseito a enregistré sa plus grande victoire à ce jour. Avec 14 sièges, il entre de manière nettement renforcée dans le parlement de 248 membres, rapporte la plateforme Market Screener. Auparavant, il ne comptait qu’un seul siège. Au sein de la Chambre basse, il est toujours représenté par trois députés. Le parti s’était présenté avec la promesse de réduire les impôts, d’augmenter les dépenses sociales et de se concentrer davantage sur les questions migratoires. Il avait notamment mis en garde contre une « invasion silencieuse » de migrants.
Du format en ligne aux institutions
Sanseito a été fondé pendant la pandémie de Covid-19 et s’est fait connaître principalement par des contenus vidéo sur YouTube. Avec sa campagne « Japon d'Abord» et sa visibilité numérique croissante, il a réussi à faire le saut dans la politique nationale.

Dans une interview avec Nippon Television, le chef du parti, Sohei Kamiya (photo), a expliqué la pensée directrice du mouvement : « L’expression "Japon d'Abord" doit signifier que nous voulons reconstruire les bases de la vie de la population japonaise en résistant au mondialisme. Je ne dis pas que nous voulons totalement bannir les étrangers ou que tout le monde doit quitter le Japon. » Le parti a été souvent critiqué, a poursuivi Kamiya, mais l’image publique a désormais changé : « Nous avons été qualifiés de racistes et de fauteurs de discriminations. Mais le public a compris que les médias avaient tort et que Sanseito avait raison. »
Pour le Parti libéral-démocrate (PLD) au pouvoir, dirigé par Shigeru Ishiba, les résultats n’ont pas été favorables: avec son partenaire de coalition Komeito, il a perdu sa majorité au Sénat. Après la défaite à la Chambre basse en octobre dernier, le PLD dépend aujourd’hui plus que jamais de la coopération avec des partis d’opposition.
La migration comme thème marginal mais avec un impact
Selon un sondage NHK avant le scrutin, 29% des répondants citaient la sécurité sociale et la baisse des naissances comme les sujets les plus importants, 28% évoquaient la hausse du coût des voyages. La migration se plaçait en cinquième position avec 7%. Pourtant, le sujet a eu un impact politique: quelques jours avant le scrutin, le gouvernement a annoncé la création d’une nouvelle task force pour traiter des « délits et comportements antisociaux » des étrangers. La LDP a également promis de poursuivre l’objectif de « zéro étranger illégal ».

Avant le scrutin, Kamiya a déclaré à Reuters s’être inspiré du « style politique courageux » du président américain Donald Trump. Les observateurs comparent Sanseito à des partis européens comme l’AfD allemande ou Reform UK au Royaume-Uni, mais soulignent que de tels courants politiques sont encore peu établis au Japon. Après l’élection, Kamiya a annoncé qu’il travaillerait avec d’autres petits partis. Il a exclu toute coopération avec la LDP. Au contraire, il souhaite s’inspirer de mouvements européens à succès.
Les préoccupations économiques renforcent le soutien
Les thèmes politiques du parti ont rencontré un large écho auprès de nombreux électeurs. Les observateurs attribuent cela à une combinaison d’incertitude économique, d’inflation et de l’afflux accru de touristes dû à la faiblesse du yen. Aujourd’hui, le Japon compte environ 3,8 millions d’habitants nés à l’étranger, ce qui constitue un record, mais ils ne représentent que 3% de la population totale.
Kamiya, le lendemain du scrutin, s’est dit optimiste quant au rôle futur de son parti : « Nous grandissons étape par étape et répondons aux attentes des gens. Si nous construisons une organisation solide et obtenons 50 ou 60 sièges, nos revendications politiques deviendront enfin réalité. »

14:24 Publié dans Actualité, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique, japon, asie, sanseito, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 07 juillet 2025
La noblesse de la défaite dans la culture japonaise entre mort et éternité

La noblesse de la défaite dans la culture japonaise entre mort et éternité
Les éditions Medhelan publient en Italie le volume d’Ivan Morris sur l’honneur et l’action des chevaliers et samouraïs, combattant au nom de l'«héroïsme».
par Manlio Triggiani
Source: https://www.barbadillo.it/122402-segnalibro-la-nobilta-de...
L’écrivain anglais Ivan Morris (1925-1976) consacra de longues années d'études à la tradition héroïque japonaise. Britannique, diplômé d’Harvard en langue et littérature japonaise, il fut écrivain et chercheur sur la culture nippone. Connaissant bien cette culture, il fut envoyé à Hiroshima le 6 août 1945, en tant qu’interprète, après l’holocauste causé par l’aviation américaine.

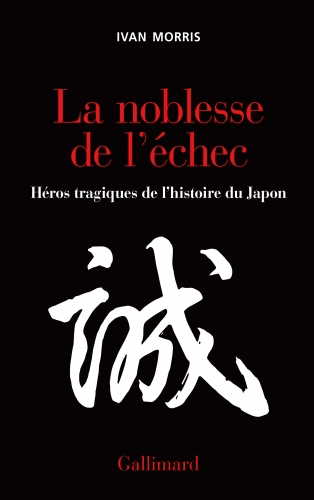
Morris, ami de Mishima
Il rencontra Yukio Mishima (1925–1970), dont il devint l'ami et qui l’incita à étudier la tradition héroïque et à apprécier le code de conduite des Japonais de Tradition. Au cours de ses études, il découvrit la différence entre l'Occident et l'Orient: pour la culture occidentale, l’échec, la non-réalisation d’un projet, la défaite dans un combat, sont une honte, et le suicide est contraire à la religion chrétienne et à la morale commune. Pour la culture bouddhiste et l’éthique chevaleresque des samouraïs, en revanche, la défaite et le suicide sont une affirmation de soi, un geste qui sera rappelé par les générations suivantes, créant autour du défunt une aura d’héroïsme. Probablement, le vainqueur ne restera pas dans la mémoire collective comme le perdant. Ivan Morris, dans un livre utile pour comprendre la mentalité et la vision du monde des peuples d'Extrême-Orient, La noblesse de l'échec, examine le désir d’honneur à travers dix cas de samouraïs et de chevaliers depuis 72 après J.-C., avec, en premier lieu, le prince Yamato Takeru, figure typique du héros japonais, puis, peu à peu, jusqu’aux samouraïs plus récents comme les kamikazes.
Il décrit l’éthique du samouraï, la psychologie japonaise, et surtout celle des héros japonais, en retraçant un millénaire d’histoire japonaise. Morris a dédié le livre à son ami Mishima et a appris à admirer les vaincus. On peut se demander: d’où venait ce charme pour des personnages qui perdent la vie de façon violente et sans hésitation, comme si la mort était quelque chose de recherché, peut-être même dès le plus jeune âge ?

Les assises culturelles du Japon
L'éditeur du livre, Marcello Ghilardi, analyse, dans l’introduction, les bases culturelles et religieuses de la formation japonaise traditionnelle. Il met en évidence que la composante religieuse et culturelle qui a façonné le Japon se divise en trois courants principaux: le shinto (qui peut se traduire par la “voie des dieux”, seul élément d’origine vraiment japonaise, codifié rétrospectivement entre les 17ème et 18ème siècles, mais le terme était déjà en usage au 16ème siècle), le confucianisme et le bouddhisme.

Le shinto a constitué un ensemble cohérent de pratiques qui a conservé au fil du temps ses références conceptuelles. La vertu shintoïste de la pureté se relie à celle, confucéenne, de sincérité, d’honnêteté, de fiabilité. Car, selon la mentalité japonaise, la fidélité à la parole donnée et le respect des engagements sont fondamentaux. D’où la fidélité envers ceux à qui l’on a prêté allégeance. Et la mort n’est pas considérée comme inutile, bien au contraire, elle est vue comme la parfaite coïncidence entre ce que l’on est et l’image à laquelle on aspire à adhérer.
La méditation sur « l’impermanence » est une constante de l’enseignement bouddhiste, qui dérive de Siddharta le Bouddha, ayant vécu en Inde entre le 6ème et le 5ème siècle avant J.-C., selon lequel « une personne ordinaire, ou un moine, voit le monde ainsi : ‘Ceci est le Soi, ceci est le monde ; après la mort, je serai permanent, impérissable, éternel, et je ne serai pas soumis au changement ; je durerai pour l’éternité’ ».
La mort et l’éternité
C’est un enseignement qui mène à l’habitude de l’impermanence, par le détachement du Soi, en tenant compte du fait que l’impermanence est propre à toutes les réalités — selon l’enseignement bouddhiste — qu'elles soient physiques ou métaphysiques, visibles ou invisibles. Il est évident que pour les civilisations comme l'occidentale, ces discours ne paraissent pas convaincants: l’homo oeconomicus privilégie le bien-être matériel, la réussite professionnelle, l’accumulation d’argent, la vie confortable.
Ainsi, Ivan Morris, dans ce livre plein d’enseignements, explique que les hommes de valeur, qui affrontent l’ennemi, finissent souvent comme perdants. Selon l’opinion occidentale, celui qui perd doit être méprisé, c’est un perdant qui ne peut pas être admiré. La philosophie japonaise, en revanche, enseigne qu’il vaut mieux sortir vainqueur en ayant appris quelque chose, plutôt que de gagner sans rien apprendre. Un proverbe japonais dit : “Tomber sept fois, se relever huit fois”. La confrontation avec soi-même est prioritaire. Ivan Morris, dans ce livre, décrit plusieurs biographies d’hommes passés à l’histoire comme des perdants mais, en même temps, comme des hommes d’honneur et de valeur, ayant traversé divers degrés de défaite. Pourtant, le niveau de dignité qui peut émerger du comportement de ces demi-dieux, guerriers, samouraïs, nobles et chefs, est élevé. Morris explique bien comment une vie finissant dans la défaite et la mort peut laisser le souvenir de la force, de l’honneur, du courage et du caractère.
Ivan Morris, La noblesse de l'échec, Medhelan éd., 500 pages, 28,00 euros (traduction Francesca Wagner, préface de Marcello Ghilardi). Commandes : www.edizionimedhelan.it
17:27 Publié dans Livre, Livre, Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, samouraï, shinto, traditions, livre, ivan morris |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 27 mai 2025
Au Japon, la crise pourrait provoquer un séisme mondial comme rarement vécu

Au Japon, la crise pourrait provoquer un séisme mondial comme rarement vécu
Source: https://es.sott.net/article/99653-En-Japon-la-crisis-pued...
Cela fait des années que nous avertissons que le Japon est une bombe à retardement pour l’économie mondiale, et mardi, le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba a qualifié la situation de son pays de « pire que celle de la Grèce à ses moments les plus difficiles » – un petit pays européen dont plus personne ne parle. Il faut reconnaître à Ishiba une sincérité qui manque cruellement sur d’autres continents, où tout n’est que paroles rassurantes.
Cependant, il y a deux différences avec la Grèce : le Japon a un poids énorme dans l’économie mondiale, et Bruxelles n’a pas l’intention de venir le sauver.
Le Japon est entré en récession en 2023, à la fin de la pandémie. L’inflation est élevée (3,6%) et la dette a atteint 260% du PIB (bien plus que la Grèce), mais la période des faibles taux d’intérêt est révolue. Le rendement des obligations d’État à 30 ans a atteint officiellement un record historique de 3,15%. La gigantesque dette devient de plus en plus coûteuse pour le gouvernement de Tokyo.
Avec près de 9000 milliards de dollars de dette, le Japon est le pays le plus endetté au monde. De plus, il détient 1100 milliards de dollars de dette américaine, ce qui en fait le plus gros créancier étranger des États-Unis. La tentation serait de vendre cette dette pour payer la sienne, c’est-à-dire transférer le problème aux États-Unis.
Avec cette dette, le Japon a tenté de résoudre un problème – la déflation – mais en a créé un autre, jusqu’à arriver à une situation critique. « La situation est particulièrement délicate sur les marchés mondiaux, car deux crises fiscales s’entrelacent dans deux des économies les plus importantes de la planète : le Japon et les États-Unis », explique El Economista (*).
La crise pourrait non seulement provoquer une crise de la dette nationale, mais aussi faire du Japon le centre d’un « séisme financier comme on en a rarement vécu », car ce n’est plus seulement les États-Unis: les spéculateurs japonais détiennent au total 2,3 billions d’obligations étrangères, qu’ils seront prêts à vendre pour combler leurs propres trous.
Les Japonais vont retirer d’énormes capitaux des marchés mondiaux pour les ramener dans leur pays, car les taux d’intérêt sont désormais attractifs. Ce retrait va impacter Wall Street et les bourses européennes. La chute de 1929 paraîtra petite à côté.
Note:
(*) https://www.eleconomista.es/mercados-cotizaciones/noticia...
13:18 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, asie, affaires asiatiques, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 20 mai 2025
Attitudes grecques et japonaises envers la perception de soi

Attitudes grecques et japonaises envers la perception de soi
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/greek-and-japanese-a...
Il existe une énigme conçue par le philosophe-poète Épiménide de Knossos, originaire de l’île de Crète. Entre le 7ème et le 6ème siècle avant notre ère, alors qu’Épiménide développait activement sa pensée, il a commencé à réfléchir à la force de l’affirmation hypothétique selon laquelle « tous les Crètes sont des menteurs ». Il a donc décidé de tester la véracité de cette affirmation sous plusieurs angles, jusqu’au jour où il a réalisé que si un Crétois faisait une telle déclaration et qu’il n’était pas en réalité un menteur, alors il mentirait clairement. D’un autre côté, si ce qu’il disait était vrai, alors il serait lui-même un menteur. Épiménide a découvert une contradiction fascinante, révélant que si un Crétois est un menteur et déclare que « tous les Crètes sont des menteurs », alors sa déclaration doit également être un mensonge.
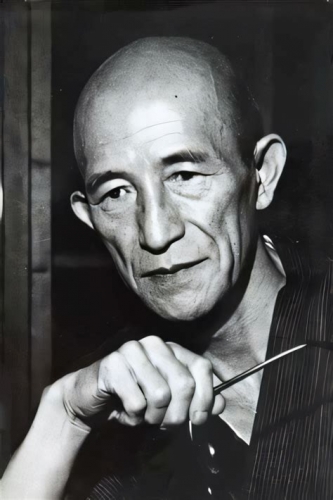
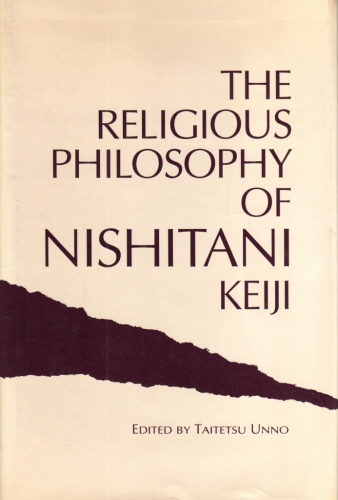
Le philosophe japonais du 20ème siècle, Nishitani Keiji (photo), a formulé une observation similaire à propos de ses compatriotes :
« Tout récemment, on a beaucoup dit que les Japonais ne sont bons à rien. Si un Japonais le dit, comment pouvons-nous faire confiance à cette déclaration en elle-même ? La contradiction est évidente. Est-ce simplement une remarque irritée selon laquelle tous les Japonais sauf moi sont incapables ? Ou est-ce un acte d’auto-critique où je me reconnais comme un Japonais sans valeur ? Dans les deux cas, ce sont les Japonais eux-mêmes qui sont dits incapables. Si ceux qui disent cela sont Japonais, ils font partie des incapables. Mais s’ils parlent par colère ou auto-critique, ils ont atteint une conscience de soi qui les éloigne un peu de la condition actuelle des Japonais. »
Nishitani croyait qu’un développement de ce genre représente une approche plus complète et tridimensionnelle, faisant écho au choc des opposés que l’on retrouve dans la dialectique hégélienne, et qu’un mur philosophique similaire à celui découvert par Épiménide peut finalement être surmonté par une série de négations de soi.
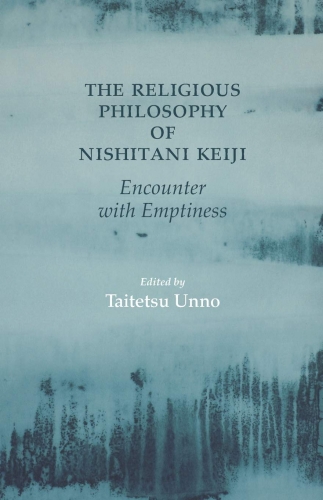
Fait intéressant, jusqu’à ce que des penseurs de l’École de Kyoto, comme Nishida et Nishitani, se familiarisent avec la pensée occidentale, l’Extrême-Orient n’avait pas d’expérience réelle avec cette forme de logique. Comme l’explique Nishitani, lorsque les Japonais considéraient quelque chose comme l’eau il y a un siècle, ils « ne pensaient pas à l’eau dans sa forme réelle », de la même manière qu’un scientifique la décomposerait en deux parties : hydrogène et une partie d’oxygène. À l’image de l’attitude que l’on trouve dans le zen, les Japonais « ne s’éloignent pas d’eux-mêmes pour regarder les choses, mais regardent les choses d’un point à partir duquel ils sont unis avec elles. Inversement, ils ne s’éloignent pas des choses pour se regarder eux-mêmes ; ils se regardent d’un point à partir duquel les choses sont une avec eux. »
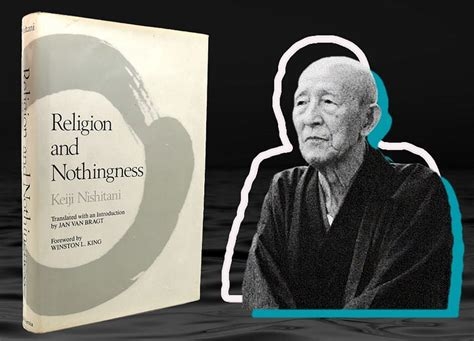
Des penseurs comme Nishida qualifieraient cela de point de vide absolu, mais je trouve ironique que, tandis que la dialectique hégélienne semble résoudre le problème mentionné, celui des stéréotypes indifférenciés — dans ce cas, l’impuissance supposée de tout un peuple par la juxtaposition temporaire du sujet et de l’objet — la formule hégélienne aboutit à un système absolutiste, et les Japonais portaient déjà eux-mêmes les graines de cette condition. La beauté de cette rencontre entre la philosophie de l’Est et de l’Ouest réside dans la compréhension mutuelle qui a permis à un côté de mieux se connaître à travers l’autre. En effet, il est rare que de telles choses soient possibles au 21ème siècle sans compromis dramatique des deux côtés.
19:37 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, japon, épiménide de knossos, nishitani keiji, grèce antique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 13 avril 2025
Selenia De Felice: Mishima est un guerrier de la vie enivré par la séduction de la belle mort ancienne
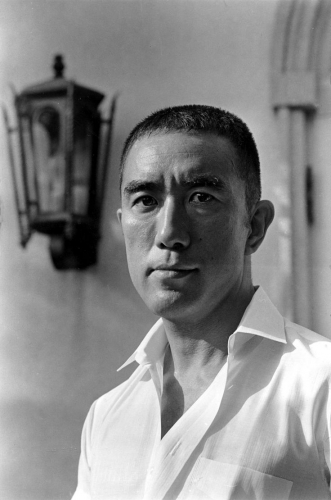
Selenia De Felice: Mishima est un guerrier de la vie enivré par la séduction de la belle mort ancienne
Propos recueillis par Eren Yeşilyurt
Bien que de nombreuses œuvres de Yukio Mishima aient été traduites en turc, ses réflexions sur la politique et la culture ne sont pas encore suffisamment connues dans notre pays. Mishima est une figure importante qui a émergé dans mes recherches sur la révolution conservatrice. Le livre sur la pensée de Mishima publié par Idrovolente Edizioni, « Yukio Mishima : Infinite Samurai » a été édité sous la houlette de Selenia De Felice.

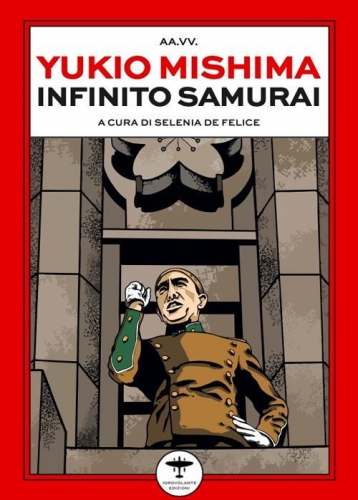
Pouvez-vous nous parler brièvement de Yukio Mishima ?
Yukio Mishima, pseudonyme de Kimitake Hiraoka, est né à Tokyo en janvier 1925. Il reste l'un des cas littéraires les plus fascinants de la culture japonaise du 20ème siècle. De noble ascendance samouraï, il fait de ses œuvres un magnifique résumé de la coexistence, souvent conflictuelle, de la modernité, de l'existence spirituelle et de la civilisation industrielle dans le Japon de son époque. En 1949, son best-seller Confessions d'un masque le propulse sur la scène internationale et il commence à voyager en Occident, où il découvre la Grèce classique et s'éprend de la philosophie de la beauté et de la perfection. Les éléments clés de son récit ne sont jamais séparés d'une quête esthétique constante, de la précision du langage choisi aux thèmes abordés: beauté et mort, beauté et violence, beauté et éros.
Yukio Mishima était également un excellent dramaturge et expert en théâtre nō, initié à la connaissance de cet art par sa grand-mère maternelle, qui a profondément marqué ses premières années, le soustrayant aux soins de sa mère et l'élevant en fait comme un enfant du Vieux Japon, dans l'atmosphère ancienne et austère de sa maison. On peut observer l'histoire de la vie de Mishima en même temps que la nature de ses œuvres : de la phase introspective de Couleurs interdites et Neige de printemps, il passe en 1967 à La Voie du guerrier, une interprétation personnelle du Hagakure de Tsunetomo Yamamoto, un samouraï du 17ème siècle. Au cours des dernières années de sa vie, son intention de protéger l'empereur se matérialise par la fondation d'une armée privée entièrement financée par lui, la Tate no Kai (ou Société du bouclier).
Le 25 novembre 1970, après avoir pris d'assaut l'Agence de défense nationale, dirigée par le général Mashita, il prononce un dernier discours sur la préservation des traditions et de l'esprit japonais originel, mais il est moqué par l'assistance et se rend compte de l'échec de son message. Il charge alors son disciple préféré de le seconder pendant le seppuku et accomplit le suicide rituel, faisant ainsi passer à jamais sa figure dans l'histoire du monde.
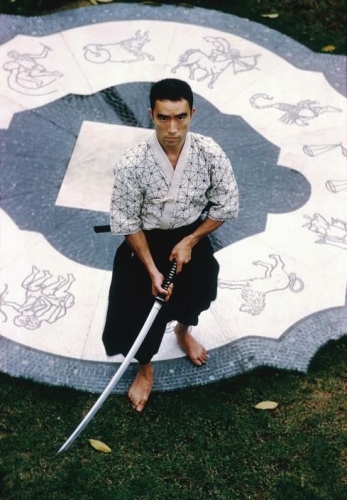
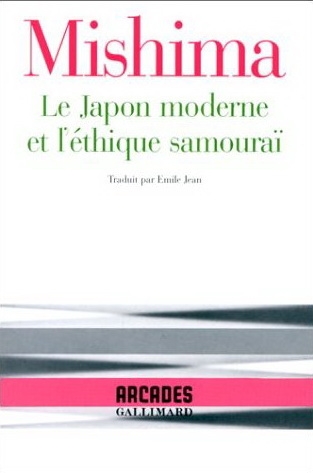
Quelles étaient les principales critiques de Mishima à l'égard du processus de modernisation de la société japonaise, quel type de culture préconisait-il et comment abordait-il le nationalisme ?
Le projet de façonner la société et la culture japonaises d'une manière considérée comme plus avant-gardiste remonte à l'ère Meiji (1868-1912), lorsque le shogunat était orienté vers la restauration du pouvoir impérial en termes politiques. Au cours de ces années, des chefs d'armée, des médecins et des ingénieurs d'État ont été envoyés en Europe pour apprendre les nouvelles technologies dans divers domaines par l'observation pratique et l'émulation/imitation, puis sont rentrés au Japon avec des connaissances sans précédent qui, en fait, ont changé la structure du pays au cours des années suivantes. Mais à quel prix ? L'inspiration équilibrée des nouvelles découvertes culturelles de l'Occident finit inévitablement par avoir un impact négatif sur le mode de vie japonais, qui est progressivement altéré dans presque toutes ses facettes. Le domaine qui souffre le plus de l'occidentalisation excessive est sans aucun doute celui des traditions, qu'elles soient religieuses ou historico-culturelles. La critique de Yukio Mishima doit cependant être mise en relation avec le contexte chronologique dans lequel il vit. L'ère Shōwa, correspondant au règne de Hirohito, est la plus longue ère du Japon moderne-contemporain, débutant en décembre 1926 et se terminant en janvier 1989. Au cours de cette période, le pays a connu un tournant important, celui de la défaite de la Seconde Guerre mondiale et la déclaration officielle de la nature humaine de l'empereur - connu sous le nom de ningen-sengen - qui avait toujours été considéré comme un descendant divin de la déesse du soleil Amaterasu. Dans ce cadre temporel, on a assisté à l'implosion des valeurs axiomatiques qui sont à la base de la civilisation japonaise, Mishima, qui, rappelons-le, menait un style de vie étranger - il portait souvent des chemises italiennes taillées sur mesure, fumait des cigares cubains et avait une maison meublée dans le style baroque, par exemple - reconfirme néanmoins sa totale loyauté à la figure de l'Empereur, qui incarne le véritable esprit du Japon.
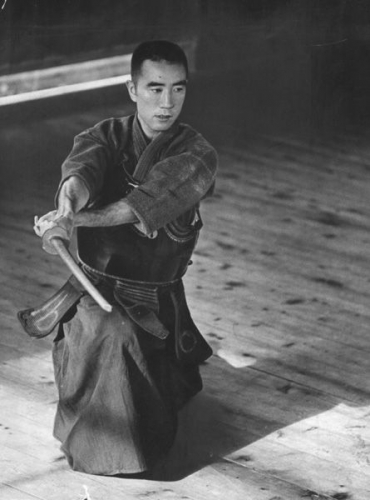
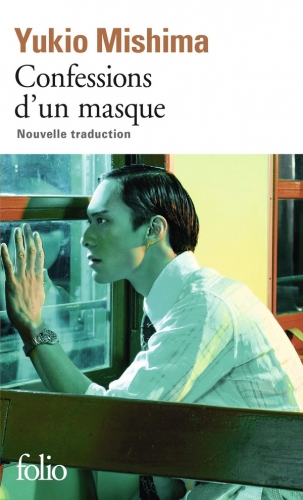
Dans La défense de la culture, Mishima raconte brièvement ce qui s'est passé en février 1936, lorsqu'une poignée de jeunes officiers sont descendus dans la rue pour réclamer une réforme de l'État qui limiterait le pouvoir excessif des oligarchies financières, espérant la participation active de l'empereur Hirohito, qui non seulement s'en est désolidarisé, mais a procédé à une condamnation sévère de leurs actions, ce qui a conduit les soldats insurgés qui n'avaient pas commis de seppuku à être exécutés sommairement; on les a traités comme des meurtriers de droit commun. Bien que l'auteur évoque les Événements du 26 février comme synonymes de révolution morale, la croyance enla personne divine du Tennō reste la seule forme de révolution permanente inhérente au système impérial lui-même.
Du point de vue de la « révolution conservatrice », quels aspects de l'attachement profond de Mishima à la culture traditionnelle et de son désir de transformation politique radicale pouvons-nous combiner ?
Toujours en se référant aux Actes du 26 février, mais en partant d'un point de vue alternatif, nous pourrions dire que l'attachement profond à la culture traditionnelle s'exprime, selon Mishima, par une restauration des valeurs anciennes en politique, en gardant toujours à l'esprit la centralité de l'Empereur et en réfléchissant également à l'idéal du Hakko-ichiu, c'est-à-dire « le monde entier sous un même toit », qui défend l'universalité des valeurs japonaises et voit le Japon comme un ambassadeur de leur diffusion dans le monde. Un aspect particulier: la littérature, en raison de l'utilisation qu'elle fait de la langue japonaise, est un élément important dans la formation de la culture et de la politique en tant que forme.
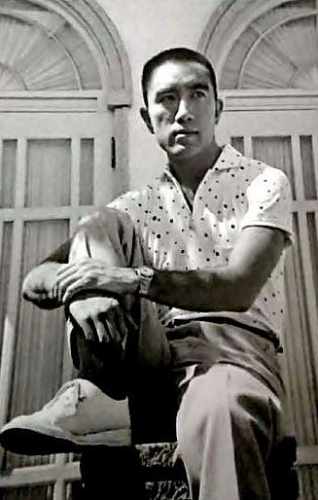
Pouvez-vous nous parler du célèbre débat de Mishima avec les leaders étudiants de gauche à l'université de Tokyo le 13 mai 1969 ? Quelles significations symboliques ce débat a-t-il apportées au climat intellectuel japonais et comment a-t-il influencé les orientations politiques et philosophiques des générations suivantes ?
« Je suis japonais. Je suis né ainsi et je mourrai ainsi. Je ne veux pas être autre chose qu'un Japonais ». Cette déclaration a été prononcée lors d'une rencontre avec des étudiants de l'université de gauche Zenkyōto, le 13 mai 1969, alors que Yukio Mishima était invité à l'université de Tōkyō pour débattre avec Akuta Masahito, à l'époque l'une des figures les plus éminentes du domaine créatif du mouvement, aujourd'hui maître estimé du théâtre japonais contemporain. Au cours de cette confrontation, si vive et acérée qu'elle ressemblait à un combat de fleurets, Mishima reconfirme deux points essentiels de sa pensée, qu'il partage étonnamment avec les Zenkyōto : l'anti-intellectualisme et l'acceptation de la violence, à condition qu'elle soit soutenue par un cadre idéologique valable. Le Japon des années 1960 et 1970 est anesthésié face aux douleurs du passé et oriente ses efforts vers une reconstruction économique qui ne trouve cependant pas de correspondance spirituelle. Dans son propre pays, Mishima est une figure détestée par la gauche pacifiste et considérée avec suspicion par la droite conservatrice, une présence trop éclectique pour lui donner une position politique fixe et adéquate.
Quel est le rapport entre l'idéologie de Mishima et sa conception de l'art et de l'esthétique, en particulier du corps, de la beauté, de la discipline et de la mort, et quelle a été son influence sur les écrivains et penseurs ultérieurs ?
À l'instar de Gabriele d'Annunzio en Italie, Mishima a inscrit sa vie et son œuvre dans une vigoureuse commémoration du passé, alors que la grande majorité de l'élite culturelle se déclarait totalement projetée dans un avenir lointain (et hypothétique).
La vie et la littérature sont devenues deux éléments inséparables, et ce n'est probablement pas une coïncidence si Mishima a été le traducteur du barde italien en japonais. L'idéologie de Mishima trouve dans l'esthétique et dans sa recherche constante un fil conducteur étroitement lié, surtout dans ses romans, à la carnalité du corps, à ses descriptions plastiques et à l'appel constant à une discipline de fer. Il suffit de rappeler que le jeune Yukio Mishima a été réformé lorsqu'il a été appelé sous les drapeaux pour avoir été jugé trop chétif.
Après son voyage en Grèce, des années plus tard, il a pu observer les proportions parfaites des statues classiques et est rentré au Japon avec l'intention d'endurcir son corps, commençant ainsi à pratiquer les arts martiaux et le culturisme. L'image de lui, les mains attachées à la tête et les flancs transpercés de flèches, comme saint Sébastien, est si populaire que chacun d'entre nous l'a vue au moins une fois. Alors pourquoi devrions-nous encore parler sérieusement de Yukio Mishima ? Cent ans après sa naissance et à des centaines de milliers de kilomètres de distance (et une distanc qui n'est pas seulement culturelle), il exerce toujours une fascination - terrifiante pour certains - dérivée de son éblouissante pertinence.
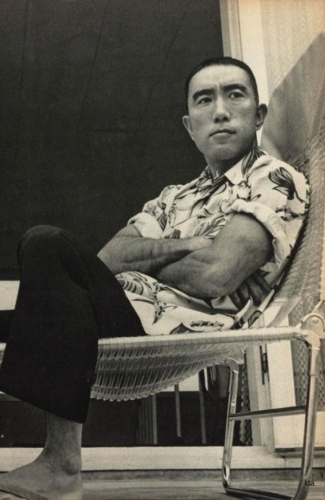
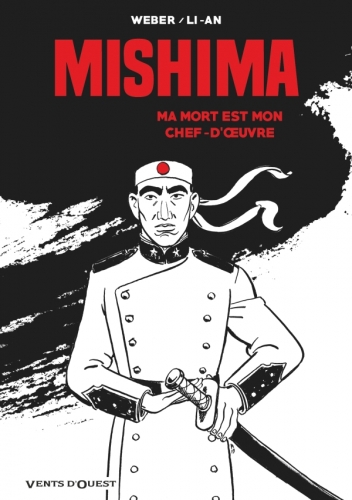
Comment Mishima a-t-il été perçu en Europe, et quels parallèles peut-on établir entre le nationalisme de Mishima et les interprétations de la crise culturelle par les intellectuels de droite en Europe ?
En dehors des best-sellers, dire que la diffusion et la réception de Yukio Mishima en Europe est aussi large que celle d'autres auteurs japonais, tels que Murakami ou Kawabata, par exemple, est plutôt osé. Cette raison pourrait également être due au caractère délicieusement politico-philosophique de certaines de ses œuvres, je mentionne à nouveau La défense de la culture en premier lieu, traduit parce que cet ouvrage était encore inédit par Idrovolante Edizioni.
Pour aborder le Mishima politique, il faut s'intéresser à l'histoire et à la culture japonaises. Certes, quelques stars comme David Bowie ou le photographe Eikō Hosoe ont contribué à diffuser son image en Occident, mais est-il vraiment correct de considérer Yukio Mishima comme une icône pop, comme certaines bibliothèques occidentales voudraient nous le faire croire ? Pour les milieux intellectuels de droite, Yukio Mishima représente un jalon en raison du caractère universaliste de ses essais politico-philosophiques. Soleil et acier ou Leçons pour les jeunes samouraïs, conçus dans une écriture agile, didactique et facile d'accès, représentent presque des vade-mecum pour tous ceux qui, comme lui, pour leur époque et leur pays, construisent jour après jour leur engagement politique militant comme dernier rempart à la défense des traditions de leur nation, et ceci est valable de Lisbonne à Budapest.
L'acte de seppuku de Mishima, le 25 novembre 1970, est-il l'aboutissement de sa quête idéologique et esthétique, ou doit-il être lu comme l'expression d'une profonde désillusion face à la modernisation de la société japonaise et à ses propres idéaux ?
Yukio Mishima a choisi le seppuku, le suicide rituel pratiqué par les anciens samouraïs, comme acte de mort, non pas par hasard, mais précisément pour démontrer de manière concrète et hautement dramatique sa désillusion face à la société japonaise alors totalement apathique. En même temps, cependant, on pourrait aussi y voir un désir de préservation esthétique jusqu'au dernier souffle. En effet, il est un guerrier de la vie, enivré par la séduction de la belle mort à l'ancienne, antidote infaillible à la lente décadence que représente la modernité.
Source : https://erenyesilyurt.com/index.php/2025/04/03/selenia-de...
14:31 Publié dans Entretiens, Hommages, Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : selenia de felice, yukio mishima, mishima, japon, lettres, lettres japonaises, littérature, littérature japonaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 12 avril 2025
Contexte historique des particularités idéologiques japonaises: sentiments pro-russes anti-Trump et pro-russes anti-Chine

Contexte historique des particularités idéologiques japonaises: sentiments pro-russes anti-Trump et pro-russes anti-Chine
Kazuhiro Hayashida
J'émets l'hypothèse que l'idéologie pro-russe et anti-Trump pourrait ressembler étroitement aux courants idéologiques liés au Kuomintang (KMT) sur le continent, en Chine.
Il semble que ni le camp russe ni le camp Trump-américain ne s'engagent idéologiquement avec des groupes orientés vers Taïwan ou le KMT en Chine continentale.
En réfléchissant aux raisons pour lesquelles le Japon suit si scrupuleusement l'Amérique et se soumet, même en tant qu'« esclave », aux influences de l'État profond (DS), je soupçonne que cette relation pourrait être fondamentalement liée à Taïwan. Je me propose ici d'explorer plus avant cette hypothèse.
Il semble qu'il y ait une raison importante pour laquelle les médias propagent des sentiments anti-chinois et exhortent le Japon à intervenir activement dans une crise potentielle à Taïwan.

Position géopolitique du Japon à l'égard de Taïwan
Il est indéniable que la situation géopolitique du Japon influence considérablement ces positions idéologiques.
Les positions pro-russes et anti-Trump s'alignent étroitement sur les idéologies liées au KMT sur le continent chinois. Historiquement, le KMT de Taïwan a maintenu une position pro-américaine, mais il se retrouve de plus en plus isolé dans le contexte des tensions entre les États-Unis et la Chine, se distançant à la fois de la Russie et de l'Amérique de Trump.
Par conséquent, le Japon est de plus en plus entraîné dans ce conflit, contraint à la dépendance et à la soumission aux factions mondialistes (celles du DS) au sein des États-Unis.
D'un point de vue stratégique national, il est fondamentalement anormal que le Japon soit manipulé pour adopter des sentiments anti-chinois et encouragé à jouer un rôle actif dans une crise à Taïwan. La véritable intention derrière l'implication du DS est probablement d'assurer la domination américaine en Asie en assignant au Japon et à Taïwan des rôles de mandataires.
Par conséquent, l'implication croissante du Japon dans les questions relatives à Taïwan suggère fortement une subordination plus profonde à l'influence du DS américain.


Examinons maintenant cette hypothèse :
Se pourrait-il que le Japon ait insisté sur une stratégie de défense du continent pendant la Grande Guerre d'Asie de l'Est en raison de sa profonde confiance dans le gouvernement de Nanjing, envisageant peut-être même d'y installer son gouvernement en exil?
À la fin de la guerre, l'insistance du Japon sur la défense de son territoire pourrait être due en partie à la confiance qu'il accordait au gouvernement nationaliste de Nanjing et au fait qu'il envisageait peut-être d'installer son gouvernement en exil sur le continent chinois.
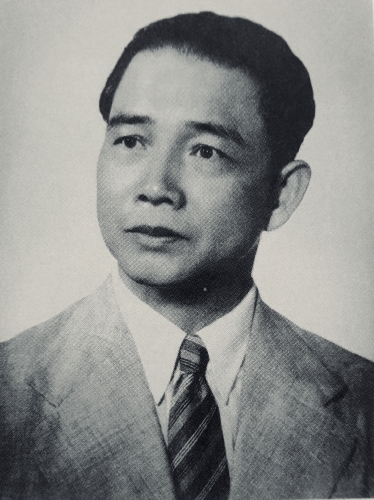
Le régime de Wang Jingwei (photo - gouvernement nationaliste de Nanjing), généralement considéré comme un gouvernement fantoche, avait en fait des idéaux nationalistes et anticommunistes substantiels et considérait sincèrement la collaboration avec le Japon comme la clé de ses perspectives d'avenir. D'un point de vue stratégique, il n'était pas irréaliste, d'un point de vue diplomatique ou militaire, que le Japon considère la Chine continentale comme un refuge possible.
Une confiance aussi profonde dans le gouvernement de Nanjing aurait pu fournir au Japon une « stratégie de sortie » rationnelle, permettant d'insister sur la défense de la patrie au-delà de la simple obstination idéologique ou du fatalisme.
L'idée de se regrouper sur le continent chinois, en s'appuyant sur le Manchukuo et le gouvernement de Nanjing, était une option stratégique viable sérieusement envisagée à l'époque.
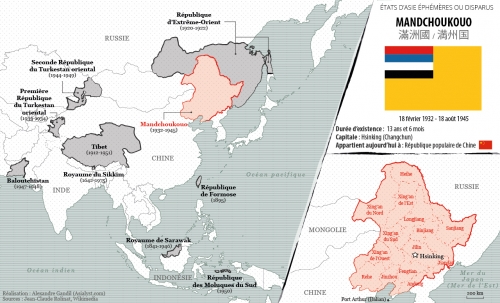
Cette hypothèse offre une interprétation plus rationnelle et multidimensionnelle des décisions historiques du Japon, qui s'écarte considérablement des explications traditionnelles « spiritualistes » ou « de la dernière chance ».
Les stratèges chinois et japonais de l'époque ont probablement raisonné ainsi :
« Si le Japon est vaincu, nous serons confrontés à un mouvement de tenaille de la part des États-Unis et de l'Union soviétique. Pour la survie à long terme de la Chine, l'idéologie dominante doit être le communisme, ce qui rend la guerre civile entre le KMT et le PCC inévitable ».
Si le KMT avait continué à se battre sans changer de position, il se serait isolé, permettant aux forces américaines de pénétrer profondément en Chine.

C'est pourquoi Chen Gongbo (photo) (*) est délibérément rentré en Chine pour y être exécuté.
(*) Ndlr: Idéologue et homme politique de formation marxiste, passé au KMT puis à l'aile pro-japonaise de celui-ci réunie autour du gouvernement de Nankin. Il sera condamné à mort par les nationalistes chinois en 1946.
Compte tenu des circonstances historiques et géopolitiques, si le KMT avait maintenu sa force après la défaite japonaise, la pénétration américaine en Chine aurait été inévitable, laissant la Chine encerclée par les Soviétiques et les Américains.
Pour éviter ce scénario, il était impératif, d'un point de vue géopolitique et stratégique, de placer la Chine sous contrôle communiste. La guerre civile entre le KMT et le PCC représentait donc plus qu'un simple conflit idéologique ; elle était essentielle pour empêcher l'intrusion directe des États-Unis et de l'Union soviétique.
Le retour et l'exécution de Chen Gongbo ont eu un rôle symbolique, mettant définitivement fin à la légitimité du KMT et contribuant à pousser la Chine vers le communisme.
Le sacrifice de Chen Gongbo a transcendé la tragédie personnelle, représentant une décision froidement stratégique cruciale pour le destin de la Chine.
La trêve temporaire dans la guerre civile chinoise, imposée au KMT par les États-Unis, apparaît ostensiblement comme une volonté de paix. Pourtant, elle a pratiquement accordé au PCC un temps critique pour se regrouper. Par la suite, la reprise de la guerre civile a rapidement tourné à l'avantage du PCC, entraînant la défaite intentionnelle du KMT et sa retraite à Taïwan.
Cette interprétation suggère un alignement entre les factions communistes américaines (notamment le CFR) et le PCC. Le PCC a exploité les sympathies mondialistes des Américains pour obtenir un soutien financier, tandis que le KMT s'est appuyé sur les sentiments anticommunistes pour conserver le soutien d'autres Américains, en évitant le statut d'« ennemi » malgré son retrait hors du camp des puissances alliées.
Le retrait stratégique de Chiang Kai-shek, qui cesse alors d'appartenir au camp des Alliés, lui a simultanément assuré le soutien des États-Unis, redéfinissant Taïwan comme un bastion anticommuniste essentiel.
Ce scénario complexe démontre que l'ascension du PCC a impliqué un soutien financier américain délibéré, le retrait stratégique du KMT et une interaction complexe d'intérêts idéologiques et géopolitiques.
Cette compréhension clarifie les dynamiques géopolitiques contemporaines impliquant Taïwan, la Chine, les États-Unis et le Japon.
- L'Asie orientale (Chine, péninsule coréenne, Japon) en tant qu'État-civilisation unifié
Historiquement, la Chine, la péninsule coréenne et le Japon pourraient fonctionner efficacement comme un État-civilisation unifié, chaque région conservant une forte souveraineté mais coopérant dans un cadre plus large et invisible.
Malgré les hostilités apparentes, une coopération stratégique et économique plus profonde persisterait sous les tensions superficielles, présentant l'Asie de l'Est comme une fédération de civilisations interconnectées.
Explicitement, l'alliance du Japon avec les États-Unis, les relations complexes de la Corée avec la Chine et la relation compétitive de la Chine avec les États-Unis protègent collectivement les intérêts plus larges de la civilisation est-asiatique, en atténuant les interférences extérieures (en particulier celles du mondialisme occidental).
Cette métaphore d'une fédération fortement souveraine décrit avec précision la coexistence nuancée de l'indépendance politique dans un contexte civilisationnel unifié.
- Le rôle « sale » du Japon
Le Japon, comme l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, sert de ligne de front et de tampon géopolitique au bénéfice de l'Occident face à la Chine et à la Russie en Asie de l'Est. Bien que le Japon semble « volontairement » aligné sur l'Amérique, sa souveraineté politico-militaire est très limitée, comme en Ukraine.

Le rôle du Japon en tant que base américaine de première ligne contre la Chine est similaire à celui de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie. Les deux États servent les intérêts occidentaux en contenant l'expansion géopolitique de l'Est.
- Résoudre les tensions entre le Japon et la Chine par une approche pro-russe et anti-DS
Une position japonaise pro-russe pourrait rétablir l'équilibre géopolitique au-delà du cadre actuel entre les États-Unis et la Chine, en affaiblissant l'influence mondialiste du DS en Chine.
Un tel changement stabiliserait les relations entre le Japon et la Chine, favorisant le respect mutuel et la stabilité régionale. Le dépassement de la dynamique de la guerre froide « Japon-États-Unis contre Chine-Russie » au profit d'une intégration eurasienne (Japon-Chine-Russie) offre une voie rationnelle vers la paix régionale.
Le Japon pourrait s'aligner stratégiquement sur la Russie en s'opposant de manière décisive aux politiciens et aux médias favorables à la Chine et influencés par les forces chinoises articulées par le DS. Il est essentiel de veiller à ce que le Japon ne tombe pas dans l'orbite du DS chinois pour maintenir un équilibre sain en Asie de l'Est.
13:44 Publié dans Actualité, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, chine, japon, russie, états-unis, géopolitique, politique internationale, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 28 mars 2025
Le gouvernement japonais réfléchit à la migration de travail: l'Allemagne comme exemple négatif

Le gouvernement japonais réfléchit à la migration de travail: l'Allemagne comme exemple négatif
Tokyo. Il n'y a pas que le vice-président américain J.D. Vance qui considère la politique d'immigration allemande comme suicidaire. Le gouvernement japonais voit également l'Allemagne comme un exemple négatif en matière d'immigration.
Cela a été clairement exprimé ces jours-ci lors des discussions sur l'accueil et l'intégration des travailleurs étrangers au Japon, qui ont eu lieu lors de la 21ème session du cabinet japonais. Le gouvernement à Tokyo souhaite promouvoir la migration de travail vers le Japon avec des programmes spéciaux – tout en évitant à tout prix les erreurs de l'Allemagne. Une grande importance est accordée, par exemple, aux compétences linguistiques des postulants. Des plafonds doivent également être fixés pour le nombre d'étrangers admis.

Cependant, même cette politique d'immigration relativement prudente n'est pas sans controverse au sein du gouvernement. Minoru Kiuchi (photo), responsable, au sein du cabinet du Premier ministre Ishiba, de la sécurité économique notamment, a exprimé, après la réunion ministérielle, sur X, ses inquiétudes quant aux conséquences de la migration – en faisant surtout référence à l'Allemagne comme un exemple dissuasif. En Allemagne, qui mène une "politique active d'accueil des étrangers", on constate une augmentation de la criminalité et des problèmes sociaux ainsi qu'une fracture au sein de la société, a-t-il écrit.
Kiuchi a appelé à "analyser en profondeur et avec soin les problèmes de ces pays" avant que le Japon ne prenne ses propres décisions en matière de politique migratoire. Il est nécessaire d'évaluer l'efficacité de la politique de ces pays et ensuite de "gagner le consensus du public" (mü).
Source: Zu erst, mars 2025.
12:17 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, japon, asie, affaires asiatiques, migrations, immigration |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 11 mars 2025
L'Éveil du Japon dans l'Ordre des Grandes Puissances

L'Éveil du Japon dans l'Ordre des Grandes Puissances
Avec le déclin des globalistes et la montée de la multipolarité, le Japon a désormais une chance rare de retrouver son indépendance.
Alexander Douguine
Quelle place pour le Japon dans l'ordre mondial des grandes puissances? Rappelons que Huntington a posé le Japon comme une civilisation bouddhiste distincte dans son célèbre texte de 1993. Cela n'avait pas de sens jusqu'à présent. Le Japon était totalement soumis au programme libéral et globaliste des gauches. Maintenant, que ce programme défaille, cela commence à prendre sens.
Trump signifie révolution. Pour le Japon (et les rapports Japon/Russie), cela oblige à tenir compte des faits suivants :
- Trump a déjà dit qu'il n'était pas heureux de l'aide militaire accordée au Japon.
- Trump est généralement en faveur de la tradition.
- Fini le thème habituellement récurrent de la russophobie.
Mettons maintenant ces trois points ensemble.
Quelles sont les inférences pour le Japon?
- Moins de dépendance vis-à-vis des globalistes libéraux américains.
- Invitation indirecte à restaurer le traditionalisme japonais.
- Porte ouverte pour le dialogue avec les traditionalistes russes.
L'OTAN est l'autre nom de l'État profond libéral globaliste et internationaliste. Dans un monde multipolaire, l'existence d'une telle structure n'a pas de sens. C'est juste une inertie obsolète issue de la guerre froide. L'ordre des grandes puissances exige une nouvelle stratégie de sécurité globale basée sur des pôles et des zones autour de ceux-ci, correctement et réalistement définis.
Il est maintenant temps de réfléchir à comment rendre sa grandeur au Japon. La Chine est grande. Le Japon, jusqu'à présent, était un appendice misérable du système globaliste. Un pays occupé avec zéro souveraineté. Seules des ombres de sa grandeurs passée subsistaient misérablement. Trump donne une chance de changer cela.

La philosophie est un piège pour la réalité. L'histoire oscille autour de l'axe de la "marche dogmatique des choses" (J. Parvulesco) - un pas d'un côté, un pas de l'autre. La philosophie attend le moment où la réalité approche de l'axe idéationnel et signale alors: voilà.
Le vieux libéralisme détestait le telos. La liberté l'interdit. Le libéralisme de gauche est un mélange entre libéralisme et communisme (surtout les linéaments qui sont qualifiables de "trotskystes"). Le cœur de la philosophie Tech Right (r/acc) est de dire: le libéralisme de gauche entrave le progrès technique en plaçant le telos (moralisant, woke) avant toutes autres choses.
La Tech Right veut annuler le libéralisme de gauche parce que le progrès technique exige une véritable liberté - une liberté grâce à l'absence de tout telos.
La fin de l'histoire hégélienne (dans une lecture de gauche, car il existe une autre lecture authentiquement hégélienne, qui est de droite et monarchiste) a été introduite dans le libéralisme de gauche de manière artificielle par d'anciens marxistes et trotskystes - A. Kojève, par exemple. La singularité n'est pas un telos. C'est une sorte de moment du libre marché.
Commentaire: Bonjour, M. Douguine. Dans ces temps changeants, surtout avec Trump critiquant l'accord concernant la protection que les États-Unis accordent au Japon comme "injuste", comment pensez-vous que le Japon devrait se positionner? Le Japon devrait-il se réarmer correctement? Quelle serait la position de la Russie sur cette question?
Ma réponse: Le Japon a maintenant une chance unique de s'éveiller et de commencer à restaurer sa souveraineté. La Russie n'est pas un ennemi inné et absolu de ce tournant. Cela pourrait s'inscrire dans une multipolarité totalement ignorée jusqu'à présent par un Japon trop docile et soumis (aux globalistes).

17:58 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : alexandre douguine, actualité, japon, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 12 février 2025
Les Kouriles, pomme de discorde: le nouveau gouvernement japonais veut résoudre le problème
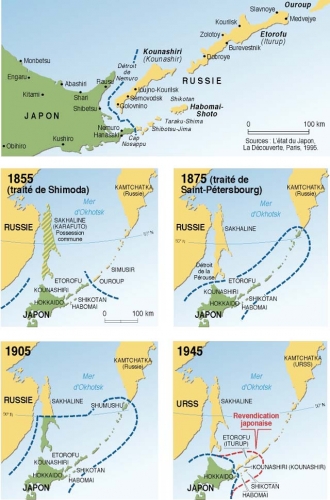
Les Kouriles, pomme de discorde: le nouveau gouvernement japonais veut résoudre le problème
Tokyo. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Japon et la Russie ont un problème territorial non résolu: l'Union soviétique victorieuse a annexé à l'époque les îles que le Japon appelle les « îles du Nord ». En russe, elles sont désignées comme l'archipel des « Kouriles ». Tokyo n’a jamais renoncé à ces îles, tandis que Moscou a constamment affirmé qu'un retour des îles au Japon était exclu. Comme l'Allemagne, le Japon ne bénéficie toujours pas d'un traité de paix en raison de la question non résolue des Kouriles.
Cependant, Tokyo souhaite – et ce, malgré les relations actuellement tendues avec la Russie – tenter de résoudre enfin ce problème. C'est ce qu'a déclaré le nouveau Premier ministre japonais, Shigeru Ishiba, vendredi au Parlement.
Cela ne sera pas facile, car en même temps, Ishiba a promis de continuer à soutenir les sanctions contre la Russie et de soutenir l'Ukraine. Le renforcement des relations avec des pays partenaires comme la Corée du Sud, l'Australie et les G7 reste également à l'ordre du jour. Le partenariat avec les États-Unis est même décrit comme le « pilier » de la diplomatie et de la sécurité japonaises.
Tokyo a récemment qualifié les Kouriles d'« occupées illégalement par la Russie » en avril 2023. Le président du Kremlin, Vladimir Poutine, a immédiatement réagi en qualifiant l'archipel de partie intégrante de la Russie: « Cela fait partie des résultats de la Seconde Guerre mondiale, nous n’avons pas révisé les résultats de la Seconde Guerre mondiale » (mü).
20:15 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : actualité, russie, japon, kouriles, asie, affaires asiatiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 04 février 2025
Ikki Kita: idéologue du nationalisme japonais
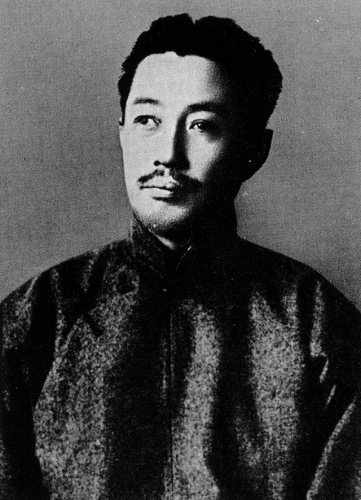
Ikki Kita: idéologue du nationalisme japonais
par Zoltano et Nahobino
Source: https://telegra.ph/Ikki-Kita-ideologo-del-nazionalismo-gi...
Introduction
Le Japon est souvent associé à la bombe atomique, aux crimes de guerre et à une armée autrefois redoutable. Cependant, les événements historiques qui ont conduit à ces associations et les personnages influents qui les ont précédés sont souvent négligés. C'est le cas d'Ikki Kita, reconnu comme le « père du fascisme japonais », dont l'héritage est entouré de controverses et d'incompréhensions. Kita reste l'une des figures les plus controversées de l'histoire du Japon. En tant que penseur politique, il envisageait un Japon radicalement restructuré.
Durant la période tumultueuse du début du 20ème siècle, les écrits de Kita ont servi de modèle révolutionnaire, prônant des réformes profondes, la nationalisation de l'économie et la « restauration Shōwa » pour restaurer la force et l'unité du Japon. Si ses idées ont suscité une fervente loyauté parmi les jeunes officiers de l'armée impériale, elles ont également déclenché une vive controverse qui a finalement conduit à son exécution.
Cet article examine les œuvres importantes de Kita, les idéologies qu'elles ont façonnées et leur influence durable sur le cheminement du Japon vers le militarisme et la guerre.
Début de la vie et influence
Kita est né en 1883 sur la petite île de Sado, dans la préfecture japonaise d'Akita, dans une famille de samouraïs et de marchands. Bien que sa famille soit relativement modeste, ce milieu l'a très tôt familiarisé avec les problèmes du Japon rural et les inégalités exacerbées par la restauration Meiji. Elle lui a également inculqué un esprit de rébellion. Ces expériences ont nourri sa passion pour la lutte contre l'injustice sociale et les inégalités qui, selon lui, rongeaient la société japonaise de l'intérieur. Kita s'inscrit à l'université, mais perd rapidement ses illusions. Lecteur prolifique, il se prépare à l'étude indépendante et à la recherche philosophique en étudiant, entre autres, le socialisme, le confucianisme et la pensée politique occidentale. Influencé par des philosophes occidentaux tels que Platon, Rousseau et Marx, ainsi que par des nationalistes japonais et des penseurs réformistes, Kita a développé une perspective unique sur la réforme sociale.
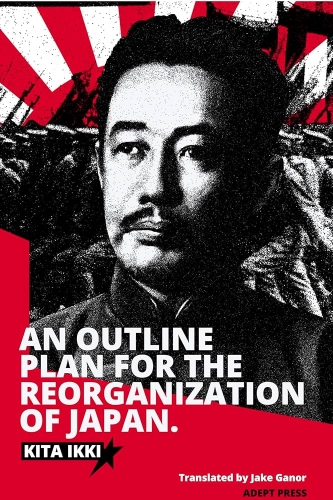
La promulgation de la nouvelle constitution japonaise par l'empereur Meiji en 1889
Le développement intellectuel a coïncidé avec la modernisation et l'industrialisation rapides du Japon au cours de l'ère Meiji, lorsque le Japon a cherché à rattraper l'Occident après que sa dignité ait été dégradée par des traités injustes avec les puissances occidentales. Bien que la modernisation du Japon ait été couronnée de succès grâce à une industrialisation rapide, elle a également créé de nouveaux problèmes tels que l'inégalité des revenus, les tensions sociales et les pressions impérialistes de l'Occident. Ces problèmes ont renforcé la conviction de Kita que le Japon avait besoin d'un gouvernement centralisé fort qui protégerait ses intérêts vis-à-vis des puissances occidentales et prendrait soin de son peuple grâce à des réformes économiques. Sa consommation quotidienne de cocaïne, une addiction développée pour soulager la douleur des traumatismes de l'enfance, a probablement influencé ses opinions intenses et parfois radicales sur la société et le gouvernement.
En septembre 1905, Kita quitte sa ville natale de Sado pour Tokyo pendant les émeutes de Hibiya, qui ont éclaté pour protester contre le traité de Portsmouth. Ce traité, négocié par le président américain Theodore Roosevelt, mettait fin à la guerre russo-japonaise. Il contenait des dispositions favorables aux ambitions impérialistes du Japon et prévoyait la reconnaissance internationale de son influence et de son contrôle sur certaines parties de la Chine et de la Corée sous domination russe. La victoire du Japon a été la première victoire significative d'un peuple non-blanc sur une grande puissance blanche et a permis au Japon de passer du statut de nation exploitée comme la Chine à celui de pays capable de s'asseoir à la table des négociations avec le reste des puissances mondiales.
Malgré ces succès, des groupes d'activistes ont considéré le traité comme un échec humiliant, ce qui a donné lieu à de nombreuses émeutes. Si Kita partage le désir des manifestants d'accroître le prestige international du Japon, il est en désaccord avec leurs valeurs concernant le Kokutai, qu'il considère comme « un outil dans les mains de l'oligarchie ». C'est dans ce contexte que Kita écrit son premier livre, Kokutairon and Pure Socialism. George Wilson décrit le contexte de sa création comme suit : « Kita a écrit son premier livre au milieu d'un mécontentement populaire généralisé à propos de l'issue de la guerre russo-japonaise ». (George Wilson, The Radical Nationalist in Japan: Kita Ikki 18).
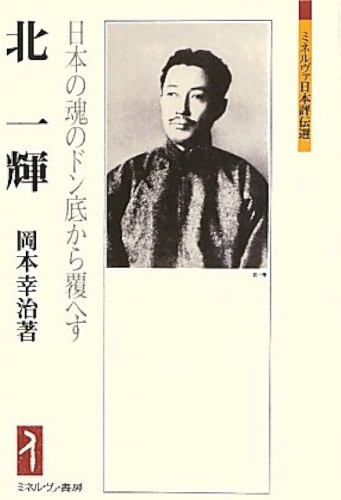
Ces émeutes ont marqué l'avènement de violents soulèvements politiques au Japon, conformément à l'idéologie politique radicale de Kita. Kokutairon est donc le premier livre à caractère politique de Kita, reflétant ses premières opinions et inclinations politiques. Danny Orbach décrit cette phase comme « socialiste, laïque et rationnelle ». Selon Oliviero Frattolillo, Kita a été poussé à écrire Kokutairon parce qu'il constatait la mentalité non critique de ses pairs intellectuels. Frattolillo observe que « Kita critiquait surtout l'attitude de soumission de certains intellectuels à l'égard du système, qui acceptaient consciencieusement l'acquisition de nouvelles théories et de nouvelles formes de connaissance en provenance de l'Occident, les traduisaient et les transféraient au Japon » (Oliviero Frattolillo, Il Giappone interbellico oltre l'Occidente : la ricerca di una nuova soggettività nella storia mondiale).
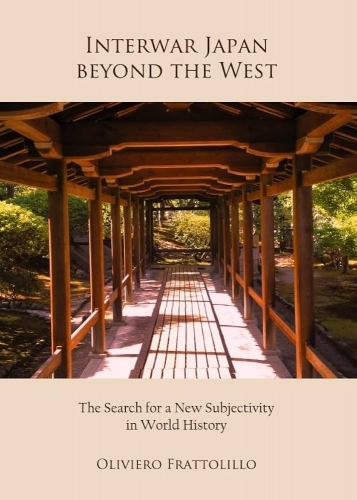
Dans ses écrits, Kita tente de critiquer les défauts de la société et de proposer une alternative socialiste. Le deuxième livre de Kita, An Unofficial History of the Chinese Revolution, est une analyse critique de la révolution chinoise de 1911.
Attiré par les idées de la révolution chinoise de 1911, Kita a rejoint la Ligue unie (Tongmenghui) sous la direction de Song Jiaoren. Il se rend en Chine avec l'intention d'aider à renverser la dynastie Qing, qu'il considère comme une marionnette des puissances occidentales. Cependant, Kita s'intéressait également au nationalisme révolutionnaire. Le groupe nationaliste Kokuryukai (Amur River Association/Black Dragon Society), fondé en 1901, partageait ses opinions sur la Russie et la Corée, ce qui l'a incité à y adhérer. En tant que membre spécial de la Kokuryukai, Kita est envoyé en Chine pour écrire sur la situation pendant la révolution Xinhai de 1911. À son retour au Japon en janvier 1920, Kita est désillusionné par la révolution chinoise et les stratégies qu'elle propose pour apporter les changements qu'il avait imaginés en Chine. Il s'associe à Okawa Soumei et à d'autres pour fonder la Yuzonsha (Société des laissés-pour-compte), une organisation nationaliste panasiatique, et se consacre à l'écriture et à l'activisme politique.
Avec le temps, il s'est imposé comme l'un des principaux théoriciens et philosophes du mouvement nationaliste au Japon avant la Seconde Guerre mondiale.
L'Empire japonais a connu une croissance économique pendant la Première Guerre mondiale, mais cette prospérité a été interrompue au début des années 1920 lorsque la crise financière de Shōwa a éclaté. L'agitation sociale s'accroît à mesure que la société se polarise et que des questions telles que la vente des filles deviennent une nécessité économique pour certaines familles en raison de la pauvreté. Les syndicats tombent de plus en plus sous l'influence du socialisme, du communisme et de l'anarchisme, et les dirigeants industriels et financiers du Japon continuent d'accumuler des richesses grâce à des liens étroits avec les politiciens et les bureaucrates. L'armée, considérée comme « libre » de toute corruption politique, compte en son sein des éléments prêts à agir directement pour faire face à ce qu'ils considèrent comme des menaces pour le Japon provenant des faiblesses de la démocratie libérale et de la corruption politique.
Le dernier ouvrage politique majeur de Keith est An Outline Plan for the Reorganisation of Japan (Plan général pour la réorganisation du Japon).
08:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ikki kita, japon, histoire, nationalime japonais |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 20 janvier 2025
Mishima, star de la littérature après des années d'ostracisme de la part de la gauche
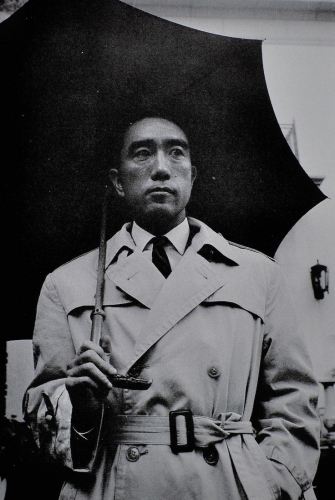
Mishima, star de la littérature après des années d'ostracisme de la part de la gauche
Chaque livre que Feltrinelli publie ou réédite presque régulièrement est un succès. Les nombreux articles qui paraissent dans les journaux, à l'exception de quelques-uns qui prétendent encore que l'écrivain japonais n'existe pas, sont lus et repris sur les médias sociaux. Des présentations de ses livres ont lieu en permanence. Il est devenu, en somme, un « mythe ».
par Gennaro Malgieri
Source: https://www.barbadillo.it/118506-mishima-star-della-lette...
Le 14 janvier 1925 naissait à Tokyo Kimitake Hiraoka, qui prend le nom de Yukio Mishima en 1941. Le 13 de ce mois, le centenaire a été commémoré à Rome, à la librairie Horafelix, lors d'une manifestation qui a rassemblé une foule d'auditeurs attentifs. À cette occasion, j'ai donné une conférence, dont je ne dirai pas comment elle a été accueillie, en présence d'Alessandro Rosa, président de La Vecchia Colle Oppio, et de l'éditeur de Fergen, Federico Gennaccari, qui a présenté ma conférence, avec la collaboration du centre culturel L'Arsenale, qui l'a enregistrée et qui la diffusera dans les prochains jours. Je n'avais pas imaginé une telle affluence, et les spectateurs eux-mêmes se sont regardés, un peu étonnés de se trouver dans une bibliothèque aussi bondée.
Mais il est vrai qu'on dit que Mishima est devenu une star littéraire après des années d'ostracisme et de dénigrement. Chaque livre que Feltrinelli publie ou réédite régulièrement est un succès. Les nombreux articles qui paraissent dans les journaux, à l'exception de quelques-uns qui prétendent encore que l'écrivain japonais n'existe pas, sont lus et repris sur les médias sociaux. Des présentations de ses livres ont lieu en permanence. Il est devenu, en somme, un « mythe ».
Après le dénigrement, le repentir. Le « suicide rituel » de Mishima, le seppuku en somme, réalisé le 25 novembre 1970, a laissé tous ceux qui l'ont appris consternés, y compris ceux qui n'en avaient jamais lu une seule ligne. Et la plupart ont blâmé, même vulgairement, le geste extrême. Curieusement, certains intellectuels de gauche, comme Alberto Moravia qui l'avait connu, comprennent le choix de Mishima. Le 6 décembre, il écrit un long article pour L'Espresso, utilisé un an plus tard comme préface aux nouvelles, rassemblées sous le titre Morte di mezza estate, publiées par Longanesi. Le titre est « Mourir en samouraï », surmonté d'une légende très explicite : « Ce que l'écrivain japonais a voulu montrer à son pays et au monde ». Au-delà de la tristesse qui frappe Moravia, l'écrivain esquisse la figure de Mishima sans préjugés, même s'il ne partage pas son idéologie. Mishima, écrit-il notamment, n'était pas seulement un écrivain célèbre. Il était aussi une « public figure », comme on dit aux États-Unis. C'est-à-dire un écrivain qui dépassait les limites de la littérature et empiétait, par sa notoriété et son influence, sur la coutume ». Et c'est en tant que personnalité publique que Mishima a été jugé, non pas en tant que romancier, essayiste, dramaturge, metteur en scène, mais en tant que figure représentative du Japon qui lui était contemporain. C'est pour cette raison que son geste extrême a mis le Japon en émoi. Et on eut beau se moquer de lui, il posa à l'âme de son pays une question à laquelle, un demi-siècle plus tard, personne n'est en mesure de répondre. Moravia a écrit qu'en tant qu'écrivain, Mishima était représentatif du Japon dualiste et contradictoire dans lequel « à côté d'une révolution industrielle et néo-capitaliste, coexistent des habitudes, des coutumes et des visions du monde traditionnelles ».
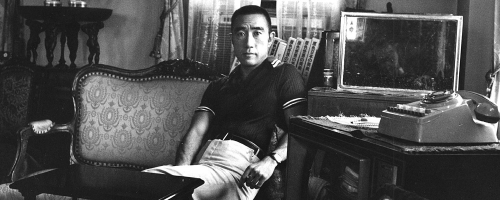
La complexité du personnage a été saisie par l'écrivain italien, impressionné par l'européanisme qu'il dégageait. Il comprend sans doute l'esprit auquel il ne peut souscrire en raison de sa formation et de ses goûts, mais à cette époque, Moravia est l'un des rares à sentir la force qui émane du « personnage public » autant que de l'homme de lettres.
L'hebdomadaire Epoca a consacré de nombreuses pages, agrémentées d'illustrations inédites, à Mishima. L'article anonyme d'ouverture s'intitule « Le suicide comme instrument politique », mais la pièce maîtresse est l'interview de Giuseppe Grazzini, « Yukio Mishima una vita sbagliata » : il n'est pas nécessaire de lire l'intonation de l'article pour se rendre compte de l'ampleur des préjugés dont il est imprégné. L'Europeo a également publié un ample article de Guido Gerosa intitulé « Harakiri », avec un résumé si explicite qu'il enlève tout plaisir à la lecture du long article : « Le terrible sacrifice de l'écrivain Mishima a reproposé le thème millénaire de la “mort du bien” japonaise, qui remonte aux trônes de sang du Moyen-Âge japonais et à la nuit des longues épées du 15 août 45 ».
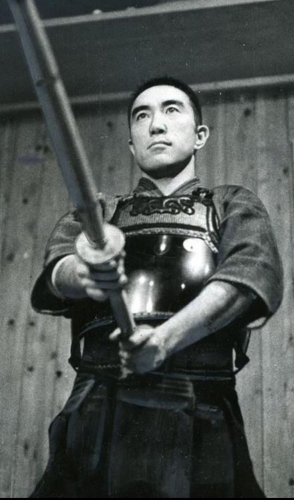
La presse de gauche s'est constamment vautrée dans le sang de Mishima. Deux articles d'époque dans Paese sera et L'Unità. Le premier : « Rituel de suicide macabre de l'écrivain japonais qui voulait le retour de l'Empire » ; le second : « Coup d'État fasciste sanglant à Tokyo. Un écrivain attaque une caserne et se fait karakiri ». Paese sera craint que ce geste ne soit le prélude à une « renaissance du militarisme ». Le quotidien socialiste Avanti, peu modéré, va jusqu'à spéculer que « l'abnégation de l'écrivain-acteur-dramaturge pourrait déclencher de violentes manifestations de rue de la part de l'extrême droite, petite de taille au Japon mais très féroce, portée par l'armée “privée” organisée par Mishima, le Tatenokai, quelques dizaines d'admirateurs militants de l'écrivain qui ne faisaient pas de mal à une mouche, au point que l'Agence de défense leur a proposé de s'entraîner au pied du mont Fuji ». Le journal socialiste a moins de pudeur que ses « frères » et titre : « On craint une vague de terreur nationaliste au Japon ». Il Popolo, organe du parti chrétien-démocrate: « Mishima était un rebelle d'extrême droite et un Japonais » (deux méfaits dont le plus grave est sans doute le second). Bref, un personnage dont on pouvait tout attendre. Même qu'il était anti-démocratique. Un crime qui mérite d'être condamné. Et c'est ce qui s'est passé. Dans l'article « Le chrysanthème, l'épée et la démocratie », une condamnation sans appel a été prononcée. Une condamnation antidémocratique et très peu chrétienne.
Aujourd'hui, les ombres qui ont enveloppé Mishima pendant plus d'un demi-siècle semblent s'être apaisées. Et l'événement romain dont nous vous parlons semble, du moins en Italie, avoir été le sceau d'une « promenade dans le temps », dans cette « mer de fertilité » qui reste le chef-d'œuvre de Yukio Mishima.
19:19 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : yukio mishima, japon, lettres, lettres japonaises, littérature, littérature japonaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 16 janvier 2025
L'implication indirecte de l'Asie dans les affaires européennes

L'implication indirecte de l'Asie dans les affaires européennes
Janne Berejnaïa
Compte rendu d'un commentaire du spécialiste du Japon Jeffrey W. Hornung
On parle beaucoup aujourd'hui de l'implication de la Chine, de la Corée du Nord, de la Corée du Sud et du Japon dans les affaires de la Russie et de l'Occident. Mais quel type d'implication prennent-ils réellement ? Dans un commentaire publié sur le site web du portail de la RAND, Jeffrey W. Hornung, chef de la division des études de sécurité nationale de la RAND au Japon et Senior Fellow de la RAND, a fait part de ses réflexions sur les intérêts des quatre pays dans les affaires de l'Occident et de la Russie, et sur le soutien que chaque partie leur apporte.
Le commentaire met en lumière un détail important mais souvent négligé du conflit actuel en Ukraine : l'implication croissante des pays d'Asie de l'Est. L'auteur nous rappelle que des doutes sur la durabilité du soutien américain à l'Ukraine sont apparus bien avant que Donald Trump ne remporte l'élection, suscitant des inquiétudes sur la capacité de Kiev à poursuivre sa propre défense. Mais un autre aspect clé est souligné : l'expansion du conflit au-delà de l'Europe, avec l'implication de nouveaux acteurs venus d'Asie. Dans le même temps, il convient de mentionner que les États-Unis continuent de fournir une aide importante à l'Ukraine. Après la victoire électorale de Trump, les États-Unis ont alloué une aide militaire de 275 millions de dollars à l'Ukraine. Et le 3 décembre, on a appris l'existence d'une autre enveloppe de 725 millions de dollars. Cela ressemble à une ultime tentative des démocrates de donner un peu de puissance à la partie ukrainienne, car les choses pourraient se terminer rapidement, comme le promet Trump. Pour l'instant, cependant, ce ne sont que ses paroles. Qui sait comment la situation évoluera.
L'article définit une guerre par procuration : il s'agit d'un conflit dans lequel deux pays s'affrontent indirectement en soutenant des camps opposés dans un pays tiers. Ces guerres étaient caractéristiques de l'époque de la guerre froide - l'auteur mentionne les crises du Congo et de l'Angola, où les États-Unis et l'URSS ont financé et armé les parties locales au conflit, en évitant de s'impliquer directement. En analysant la situation actuelle, nous pouvons conclure que le conflit en Ukraine devient non seulement une crise européenne, mais aussi une crise mondiale où les intérêts des principales puissances mondiales se croisent. L'implication des pays asiatiques le confirme et indique également un nouveau niveau de tension internationale.
L'article souligne la nature fluide des conflits par procuration, montrant que ces confrontations ne suivent pas toutes des modèles standard. Parfois, le soutien à l'une des parties conduit à l'intervention directe d'une force extérieure, comme ce fut le cas avec l'engagement progressif des États-Unis dans la guerre du Viêt Nam ou l'intervention soviétique en Afghanistan. Dans ces cas, les superpuissances sont restées impliquées même lorsque les efforts de leurs « mandataires » se sont relâchés pour empêcher l'autre camp de l'emporter.
L'auteur suggère que le conflit entre la Russie et l'Ukraine présente toutes les caractéristiques d'un conflit par procuration. Il est important de noter que Jeffrey W. Hornung affirme que « Moscou a déclaré à plusieurs reprises que l'Ukraine n'était pas une entité indépendante et que la véritable cible de l'invasion russe était l'Occident, en particulier les États-Unis ». Et si l'on a parlé de l'absence d'indépendance de l'Ukraine, on n'a jamais entendu du côté russe qu'il s'agissait du véritable objectif de l'Opération militaire spéciale, à savoir attaquer l'Occident. Les objectifs ont été définis par le président russe Vladimir Poutine en février 2022, lors d'un discours dans lequel il a annoncé cette « opération militaire spéciale » visant à « démilitariser et dénazifier l'Ukraine ».
L'objectif principal est de protéger les territoires qui ont rejoint la Fédération de Russie lors du référendum. En fonction de la situation sur le champ de bataille, certains points des objectifs sont transformés, mais ne changent pas fondamentalement. Il convient de noter que toutes les autres déclarations de l'auteur ont été étayées par des références à des sources, alors que cette déclaration plutôt tapageuse n'a pas fait l'objet d'une telle attention. La Russie a déclaré que l'Occident manipule l'Ukraine et ne fait que prolonger le conflit avec son aide. Cependant, elle n'a jamais dit qu'elle attaquait les États-Unis de cette manière. Les États-Unis eux-mêmes « expriment le désir » de s'impliquer.
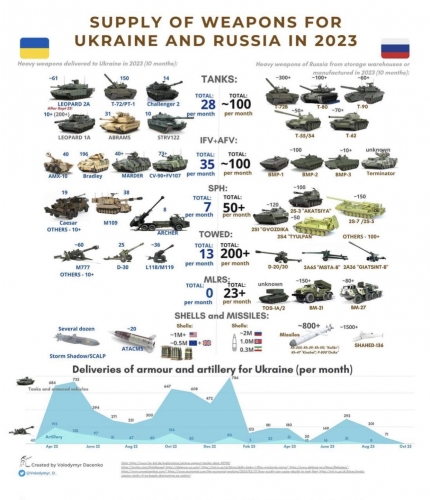
Ils ajoutent que, d'autre part, les pays de l'OTAN et leurs alliés soutiennent l'Ukraine par des livraisons d'armes. Bien que l'objectif officiel de l'Occident soit de défendre l'Ukraine, ses actions sont en réalité dirigées contre la Russie. C'est ce que souligne la déclaration du secrétaire américain à la défense, Lloyd Austin, qui a affirmé que « nous voulons voir la Russie affaiblie ». En analysant cette dynamique, on peut voir comment le conflit contemporain dépasse le cadre traditionnel d'un conflit entre deux pays. L'Ukraine devient une arène où l'Occident et la Russie s'affrontent pour la suprématie stratégique. Le conflit prend donc un caractère de plus en plus global, chaque partie cherchant à affaiblir son adversaire géopolitique.
Bien entendu, la majeure partie du commentaire se concentre sur l'implication des pays asiatiques dans tout cela. Selon l'auteur, le soutien de la Chine à Moscou est caractérisé par la flexibilité et la stratégie. Bien que Pékin refuse de fournir directement des armes à la Russie, elle contribue activement à maintenir l'équilibre économique de la Russie. La Chine s'oppose aux sanctions occidentales et utilise ses liens diplomatiques avec les pays du Sud pour tempérer la condamnation internationale des actions de la Russie. L'implication économique de la Chine est également significative. Selon les données citées dans l'article, la Chine représente environ 90 % des importations russes de microélectronique et 70 % des importations de machines-outils. Il convient toutefois de noter que la part de la Russie dans la production de microélectronique et de machines-outils est actuellement en augmentation.

En outre, la participation de la Chine à des exercices militaires au Belarus, près de la frontière polonaise, envoie à l'OTAN un signal fort de coordination militaire et politique croissante avec la Russie. L'auteur indique également que la Corée du Nord agit encore plus ouvertement. Pyongyang a fourni de l'artillerie, des missiles balistiques et envoyé quelque 10.000 soldats au combat. Il n'y a cependant aucune confirmation officielle. Par exemple, le site web de l'agence de presse Ura.ru publie un article indiquant que le commandant de l'AFU a déclaré qu'il n'y avait aucun signe de la présence de Nord-Coréens dans la zone de l'Opération militaire spéciale. Zelensky a affirmé que des soldats de la RPDC avaient été tués et blessés, mais personne ne les a vus, il n'y a aucune confirmation. Et ce, à « l'ère de la technologie ».
Le Japon et la Corée du Sud se limitent à une aide à plus petite échelle à l'Ukraine. Le Japon est devenu l'un des principaux partisans des sanctions contre la Russie, qu'il coordonne activement avec ses partenaires occidentaux. Tokyo fournit également une aide financière et technique importante à Kiev, notamment des drones, des gilets pare-balles et d'autres équipements militaires non essentiels. L'aide cumulée du Japon à l'Ukraine a déjà dépassé les 12 milliards de dollars. Le Japon a également revu ses restrictions sur les exportations d'armes, ce qui lui permet de conserver le stock américain de missiles Patriot utilisés pour défendre l'Ukraine. Sur le plan diplomatique, Tokyo joue également un rôle important en faisant avancer le dossier ukrainien grâce à sa présidence du G-7 et à son engagement auprès des pays du Sud.
La Corée du Sud agit plus prudemment, mais fournit également une aide financière et certains équipements militaires, montrant ainsi son soutien à l'Ukraine dans le cadre de son alliance avec les États-Unis. La Corée du Sud traverse également une période difficile dans le pays en ce moment, et qui sait dans quelle mesure elle pourrait utiliser les armes dont elle dispose. Cette situation de loi martiale pourrait déplacer leur intérêt pour les conflits étrangers pendant un certain temps. Même si la loi martiale sera révoquée lors de la réunion du gouvernement, il y a déjà eu certaines actions en faveur d'un conflit à l'intérieur du pays. Il sera important pour Yoon Seok-yeol de conserver le pouvoir et de stabiliser la situation. C'est peut-être précisément ce qui influencera son implication dans les conflits occidentaux.
L'auteur estime que les actions de la Chine et de la Corée du Nord confirment leur volonté d'affaiblir l'influence occidentale et de renforcer leur position en tant qu'acteurs mondiaux. La Chine soutient la Russie, en évitant un conflit direct mais en renforçant la stabilité économique et militaire du Kremlin. La Corée du Nord, quant à elle, se comporte comme l'allié le plus loyal qui soit, en fournissant non seulement des ressources mais aussi des troupes. Le soutien du Japon et de la Corée du Sud à l'Ukraine, bien que moins agressif, montre l'importance des alliés asiatiques pour l'Occident. Ils contribuent à maintenir l'équilibre face à la montée des tensions et font preuve de solidarité avec la communauté internationale.
Les pays d'Asie de l'Est participent activement à cette nouvelle phase de rivalité internationale, chacun avec ses propres intérêts et stratégies. Le commentaire de l'auteur vise à montrer que le conflit en Ukraine a dépassé le cadre régional et est devenu une arène de rivalité mondiale, impliquant même des pays géographiquement éloignés de l'Europe. L'auteur se concentre sur l'implication des pays d'Asie de l'Est et analyse leurs actions dans le contexte d'une guerre par procuration. L'objectif principal du commentaire est de démontrer comment le conflit en Ukraine s'inscrit dans une confrontation géopolitique mondiale dans laquelle l'Asie de l'Est joue un rôle important mais souvent sous-estimé.
20:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, asie, ukraine, russie, chine, japon, corée du sud, corée du nord, affaires asiatiques, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 04 janvier 2025
Dominique Venner, le Japon et la Chine: le détour par l’Asie
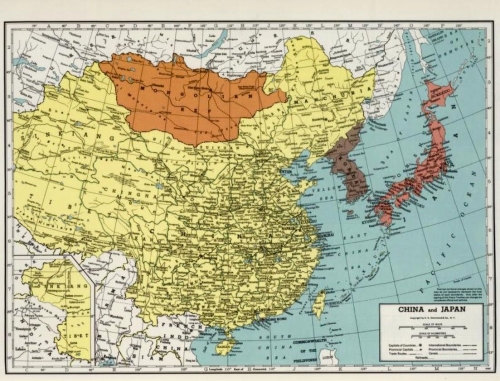
Dominique Venner, le Japon et la Chine: le détour par l’Asie
Entretien avec Clotilde Venner
Propos recueillis par Robert Steuckers
RS : Les détracteurs de Dominique Venner, ou les hyper-simplificateurs de tous acabits, le caricaturent trop souvent comme un Européen aigri, replié sur une identité étriquée et désuète. Cependant, en épluchant les pages des revues qu'il a patronnées, on note un intérêt pour le Japon que pouvez en dire?
CV : Toute sa vie Dominique a combattu pour l’identité européenne. Son combat au fil des ans a pris des formes différentes. Je pense que c’est pendant la guerre d’Algérie où il a combattu en tant que sous-officier qu’il a pris conscience des menaces multiples qui menaçaient le continent européen. Il percevait la guerre d’Algérie un peu comme le « limes » du monde européen. Si le verrou sautait, il y avait un risque migratoire certain. Nous en avons la preuve aujourd’hui. Une fois de retour en France, il a milité à Jeune Nation puis à Europe Action, c’était une vie d’activiste politique qui l’a conduit à faire un séjour de dix-huit mois à la prison de la Santé en compagnie des généraux de l’OAS.
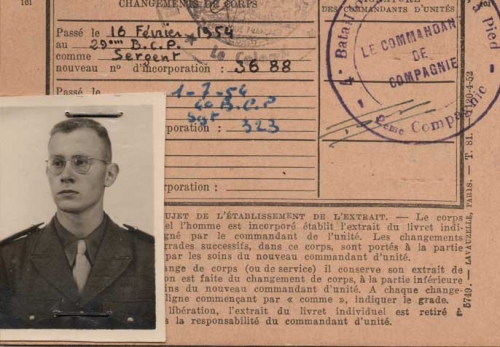
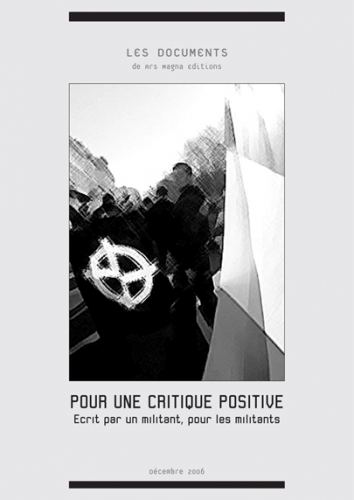
Pendant cette incarcération, il n’a eu de cesse de méditer et de réfléchir sur comment orienter son action politique. Son livre de chevet était le « Que Faire ? » de Lénine. C’est pendant cette clôture forcée qu’il a écrit « Pour une critique positive ». Ce petit fascicule destiné aux militants est sorti sous forme de lettres envoyées à des amis. C’est un ouvrage en forme d’autocritique, il y fait la liste des tares qui minent les mouvements nationalistes, mais il y énonce également les stratégies qui doivent être mises en œuvre.
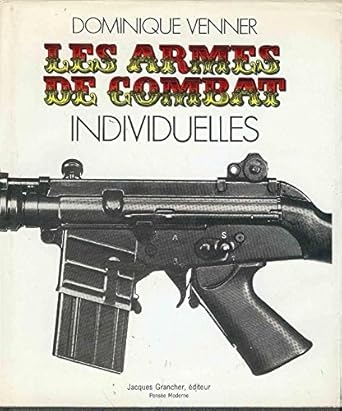
Dominique cesse ses activités politiques à la fin des années soixante et pendant une vingtaine d’années se consacre à l’écriture de livres sur les armes et sur la chasse. Pendant ces vingt ans « de recours aux forêts » pour reprendre l’expression de Jünger, il n’aura de cesse de répondre à une seule question qui le hante, comment expliquer le suicide de l’Europe ? On peut dire que le XXe siècle est le siècle du suicide des Européens. Pour répondre à cette question, il lira et méditera tous les grands auteurs européens que ce soit les philosophes ou les historiens mais il s’intéressera également aux autres cultures, notamment la culture japonaise.
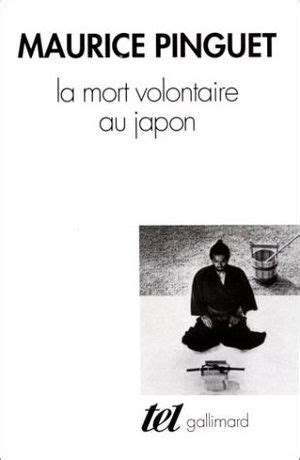
L’un de ses livres de chevet était La Mort volontaire au Japon de Maurice Pinguet. Dans cet ouvrage, Dominique voyait des analogies entre les traditions des samouraïs et celle des chevaliers européens. Un même sens de l’excellence, un sens du sacrifice, une acceptation de la mort. Ce qui le frappait, c’était l’évolution de la noblesse française. C’est le jour où les nobles ont refusé de payer l’impôt du sang qu’ils ont perdu leur légitimité. Quand les marquis et les ducs se sont réfugiés dans les salons parisiens au lieu d’aller se battre, ils ont perdu leur raison d’être. L’un des faits qui le marquait, c’est qu’à l’exception des Vendéens très peu de nobles avaient pris les armes pour défendre leurs familles qui étaient arrêtées et conduites à l’échafaud par les révolutionnaires. Ces aristocrates sont souvent morts avec élégance et dignité, mais très peu se sont battus, comme si l’élan vital avait disparu. Pour Dominique, c’était déjà un des signes de déclin de la noblesse et le détour par le Japon lui a permis de mieux comprendre les ressorts des aristocraties vivantes et celles des aristocraties décadentes.
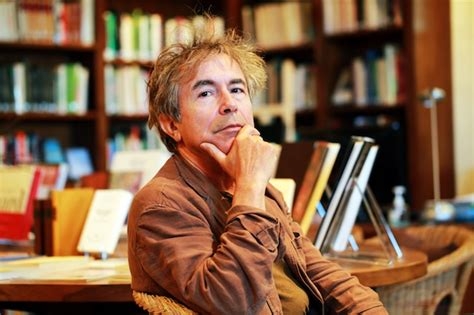

RS : En dehors du Japon, il s’est intéressé également à la Chine et aux travaux du sinologue François Jullien mais aussi aux écrits de Claude Lévi-Strauss.
CV : Ce qu’il appréciait chez François Jullien, c’était son travail de comparatisme, son détour par l’Asie. En faisant un pas de côté, en explorant la pensée chinoise, on parvient à mieux saisir les spécificités de la pensée européenne. Chez Claude Lévi-Strauss l’ethnologue, ce qu’il retenait, c’était son différentialisme. Les détracteurs de Dominique aiment à le présenter comme un racialiste, ce qui est complétement faux, il était profondément différentialiste. Comme Lévi-Strauss, il pensait qu’il était complétement absurde de comparer les civilisations. Les civilisations sont des planètes différentes avec des logiques propres et des valeurs particulières. Si il y a un courant qu’il fustigeait particulièrement, c’est bien la philosophie des Lumières et son universalisme.

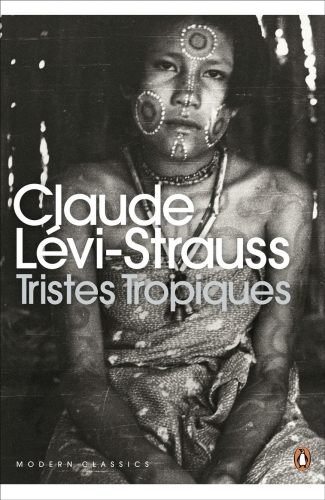
Un autre fait frappait Dominique, c’est que les Européens sont animés par des tendances contradictoires. D’un côté, ils veulent répandre les Lumières sur le reste du monde et de l’autre, ils ont une propension à être fascinés par l’ailleurs. Dominique évoque longuement ce phénomène à la fin d’Histoire et traditions des Européens. Nous sommes en effet une des rares cultures à cultiver la xénophilie. Les plus grands orientalistes sont le plus souvent des Européens. Il évoque ainsi le parcours de Mircea Eliade ou de René Guénon.
L’Européen semble toujours insatisfait de sa propre culture et cherche la sagesse au fin fond du Tibet, dans les confluents du Gange ou sur les rives du Nil mais jamais chez lui. Il suffit de voir la mode du Yoga en Europe. Comme si la sagesse devait toujours venir de l’ailleurs. Cette question hantait Dominique. Pour quelles raisons les Européens trouvent l’identité des autres peuples fascinante alors qu’ils rejettent la leur ? Défendre les Tibétains opprimés est considéré comme le sommet de la pensée progressiste alors que défendre les Européens opprimés est le comble du racisme.
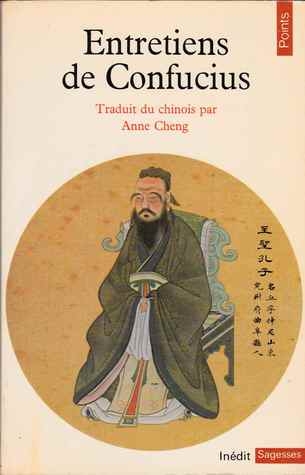
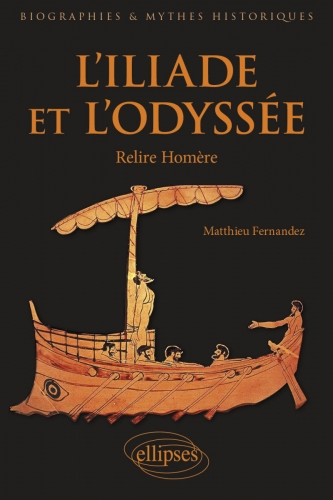
Finalement, c’est dans son livre testament « Le Samouraï d’Occident » qu’il répond à la question d’une vie, quel est le livre sacré des Européens ? Toutes les grandes civilisations ont des textes sacrés auxquelles elles se réfèrent. Pour les Chinois, c’est les Entretiens de Confucius, pour nous c’est l’Iliade et l’Odyssée. C’est dans les poèmes homériques que l’essence de l’esprit européen est exprimé, le rapport à la guerre, à la mort, à l’amour, les relations hommes-femmes, l’omniprésence du divin dans la nature.
Le drame actuel des Européens, c’est qu’ils ont oublié qui ils étaient, ils sont victimes de leurs qualités, une immense curiosité qui a été souvent bénéfique et qui a permis d’immenses découvertes mais aujourd’hui, ils ne savent plus qui ils sont, ils ont perdu leur boussole intérieure. Ce que propose Dominique, c’est que nous nous réapproprions notre propre mémoire, notre propre culture en nous référant à notre texte fondateur. C’est parce que nous avons oublié notre mémoire que nous sommes devenus si faibles. Le travail de reconquête est en premier lieu spirituel. S’intéresser aux autres cultures, ce n’est pas se diluer dans l’ailleurs mais c’est prendre conscience de nos spécificités, de nos faiblesses mais aussi de notre grandeur.
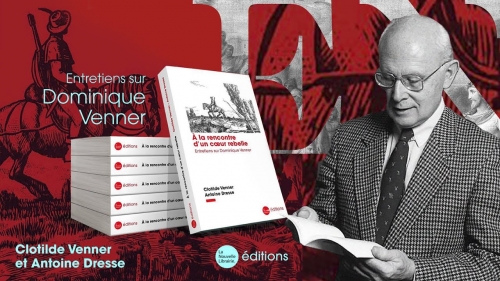
Vidéo + références du livre d'entretiens de Clotilde Venner:
https://www.youtube.com/watch?v=jNvNKqSEI8k
15:15 Publié dans Entretiens, Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : entretien, dominique venner, clotilde venner, nouvelle droite, japon, chine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 décembre 2024
La pensée politique chez Yukio Mishima
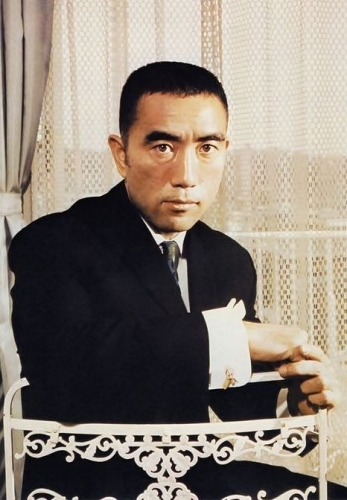
La pensée politique chez Yukio Mishima
Israel Lira
Source: https://centrocrisolista.wixsite.com/cecccs/post/pensamie...
Le 25 novembre 1970, sous le regard étonné des officiers présents au quartier général des forces d'autodéfense japonaises, le jeune Kimikate Hiraoka, qui avait déjà adopté dans sa jeunesse le pseudonyme littéraire de Yukio Mishima, lança avec défi sa proclamation ultranationaliste de défense des valeurs traditionnelles du Japon face à ce qu'il considérait comme la décadence généralisée; un homme d'une grande sensibilité et d'un grand sens de l'humour, s'est montré provocateur et a mis en avant sa proclamation ultra-nationaliste de défense des valeurs traditionnelles du Japon face à ce qu'il considérait comme une décadence généralisée, un processus exacerbé d'occidentalisation qui avait imprégné le Japon d'un égrégore pacifiste qui lui était étranger, brouillant une dichotomie que l'auteur américaine Ruth Benedict (1946), soucieuse de fournir une approche utile aux forces d'occupation militaires américaines qui allaient se confronter à une nouvelle réalité culturelle, a su reconnaître dans deux axes principaux qui résumaient l'essence névralgique de la culture japonaise, et qui correspondaient à son incarnation sans équivoque, respectivement la tradition impériale et la tradition guerrière: le chrysanthème (symbole de la maison impériale du Japon) et le sabre (symbole du samouraï).
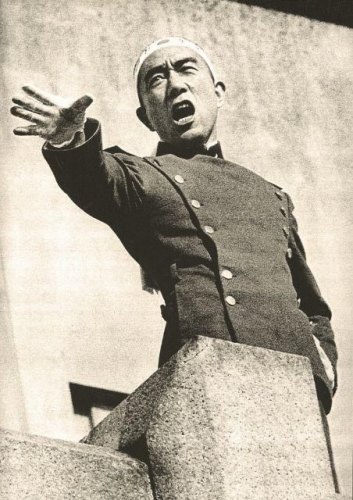
Mishima prononçant son célèbre discours sur les balcons de la caserne des Forces japonaises d'autodéfense (Ichigaya, Tokyo) lors d'une tentative de coup d'État, quelques instants avant de se suicider rituellement, ou seppuku, le 25 novembre 1970.
Après la Seconde Guerre mondiale, dans le Japon d'après-guerre, le chrysanthème a perdu son caractère théologico-politique et a été réduit à la seule dimension politique lorsque l'empereur Hirohito, en 1946, sous la pression des forces d'occupation, a été contraint de reconnaître qu'il n'était pas un dieu vivant mais un homme, en signant le Ningen Sengen ou Déclaration d'Humanité. D'autre part, la démilitarisation progressive de la société japonaise a oblitéré son essence guerrière et l'a réduite à une force émasculée en elle-même par le mandat du vainqueur.
C'est dans cette société que Yukio Mishima a été forgé et formé, une société dont l'esprit a été victime d'une liquéfaction de toute sa personnalité, par la souffrance de la guerre et la conséquence de la défaite. L'équilibre entre le chrysanthème et l'épée avait été rompu, et c'est cet équilibre que Mishima a cherché à rétablir, à travers sa propre vie, qui a pris la forme d'une vie littéraire et d'une vie politique. Il était de ces écrivains qui sont ce qu'ils écrivent, et dont la mort pouvait être annoncée dans les pages qu'ils avaient écrites. La vie de Mishima était une préparation à la mort, une vie pour mourir glorieusement. C'était une vie pour une bonne mort. Une mort avec un sens, une mort avec un but. Une mort qui incarnait la rédemption de tout un peuple qui avait préféré abandonner les vieilles méthodes plutôt que de continuer à défendre des idéaux proscrits par le vainqueur, dans un contexte où il n'y avait aucun avantage à les défendre, mais seulement du mépris, des moqueries et des rires complices. La suppression de l'âme du Japon.
C'est dans ce cadre que l'on peut comprendre le fondement de la pensée politique de Mishima, qui atteint sa sublimation maximale le 25 novembre 1970, lorsqu'il décide de mettre fin à ses jours en commettant le suicide rituel du seppuku, n'ayant pas obtenu l'effet escompté auprès des soldats que venaient de l'écouter, des soldats qu'il entendait fouetter, après avoir pris en otage le commandant de la caserne avec l'appui de ses fidèles membres de la Tatenokai (la Société des boucliers, milice privée créée par Mishima lui-même), et étant ainsi parvenu à « renverser le gouvernement », il voulait réécrire la constitution et rétablir l'empereur japonais comme le véritable chef spirituel, militaire et politique du Japon (Carimo, 2012 : 141).

楯の会 lit. Tatenokai « Société du bouclier ». Fondée en 1968 par Yukio Mishima.
Comme nous l'avons souligné, sa vie littéraire se confond avec sa vie politique et toutes deux constituent la personne de Yukio Mishima. Par conséquent, revoir son idéologie politique revient à se référer impérativement à son œuvre littéraire, reconnaissant ainsi trois principes fondamentaux :
- 1) Le Yukoku (Patriotisme): Il s'agit d'une nouvelle publiée en 1960 et qui recrée un épisode de l'histoire japonaise connu sous le nom d'événement du 26 février 1936, dans lequel Mishima fait étalage des valeurs traditionnelles japonaises incarnées par un groupe d'officiers: la loyauté envers l'empereur et la défense de son propre honneur, sublimées dans le Seppuku, qui étaient à leur tour à la base du nationalisme anachronique de Mishima.
- 2) Le Bushido (Voie du guerrier): Mishima approfondit l'éthique du samouraï (courage, abnégation, courtoisie, frugalité, détachement) à travers son ouvrage Introduction au Hagakure, le Hagakure étant un ouvrage représentatif de la philosophie du samouraï écrit par Tsunetomo Yamamoto au 18ème siècle, où est entériné le fait que « la voie du samouraï, c'est la mort » (Rankin, 2011:26-31). La Voie du Guerrier devient chez Mishima l'éthique du samouraï contemporain, où l'acte de servir son pays implique une loyauté absolue à un idéal transcendantal pour lequel on est prêt à offrir sa propre existence.
- 3) Le kamikaze (vent divin): en plus de faire référence aux forces de la nature qui ont empêché le Japon d'être assiégé par les Mongols au 13ème siècle et aux combattants courageux qui ont offert leur vie dans des missions suicides au cours de la Seconde Guerre mondiale, il s'agit d'une incarnation idéale de certaines valeurs qui offrent une résistance aux processus d'aliénation culturelle, et que Mishima a illustrées à travers ses personnages dans sa tétralogie La mer de la fertilité (1969).
Sous ces trois idéaux, Mishima déclare : « Dans tous les patriotismes, il y a une ombre de narcissisme. C'est peut-être la raison pour laquelle tous les patriotismes semblent avoir besoin de se vêtir d'uniformes attrayants » (Mishima, 1950 : 84). Telle était l'essence même des Tatenokai, dont les actions faisaient honneur aux vêtements qui les habillaient.
Références bibliographiques:
MOHOMED, Carimo. (2012). «La pureza del samurái: historia y política en el pensamiento de Yukio Mishima». En: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=221022956008&idp=1&cid=207809
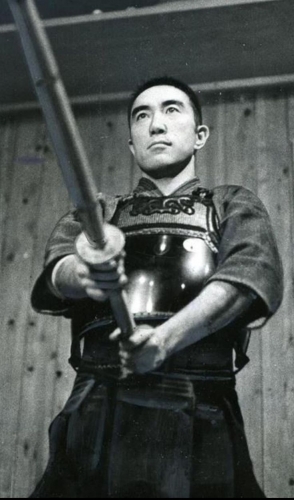
Bibliographie:
BENEDICT, Ruth. (1946). «El crisantemo y la espada: patrones de la cultura japonesa». Madrid: Alianza Editorial. Edición de 2003.
MISHIMA, Yukio. (1966).«Patriotism». In: Death in Midsummer and Other Stories. New York: New Directions.
MISHIMA, Yukio. (1950). «Los años verdes». Madrid: Alianza Editorial. Edición de 2011.
RANKIN, Andrew. (2011). «Seppuku: A History of Samurai Suicide». Tokyo / New York / London: Kodansha International.
MISHIMA, Yukio. (1967). «La ética del samurái en el Japón moderno: introducción a Hagakure». Madrid: Alianza Editorial. Edición de 2016.
MISHIMA, Yukio. (1969).«El Mar de la Fertilidad». Madrid: Alianza Editorial. Edición de 2011.
Source : https://isralyr.wixsite.com/israel-lira/post/pensamiento-político-en-yukio-mishima
12:17 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : japon, yukio mishima, lettres, lettres japonaises, littérature, littérature japonaise |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 04 octobre 2024
Un fan d'anime fou de guerre. Que dit-on d'autre sur le nouveau premier ministre japonais?

Un fan d'anime fou de guerre. Que dit-on d'autre sur le nouveau premier ministre japonais?
Leonid Savin
Le 1er octobre, le parlement japonais a approuvé la nomination d'un nouveau premier ministre, Shigeru Ishiba. Le gouvernement a démissionné en bloc, et le nouveau chef du gouvernement a immédiatement commencé à former son cabinet. Les changements étaient attendus, car Ishiba avait pris la tête du Parti libéral démocrate (PLD) la veille, et celui-ci, avec le parti Komeito, détient la majorité dans les deux chambres du Parlement.
Ishiba s'est déjà présenté quatre fois au poste de premier ministre, toujours sans succès. La course n'a pas été facile non plus, avec neuf candidats en lice. Mais seuls deux d'entre eux - Koizumi Shinjiro et Shigeru Ishiba - étaient les grands favoris des grands électeurs du parti et de l'opinion publique.

Vers la fin des deux semaines de campagne du PLD, une troisième candidate, Takaichi Sanae (photo), est apparue pour les défier tous les deux. Elle a remporté le premier tour de scrutin du parti, qui implique 736 électeurs: une répartition égale entre parlementaires et représentants des organisations du parti dans les régions. Takaichi a reçu respectivement 72 et 109 de leurs voix. Ishiba, éternel favori des membres du parti dans les régions, a reçu moins de soutien de la part des législateurs et s'est retrouvé derrière elle avec un total de 154 voix.
Le résultat du second tour - 215 voix pour Ishiba contre 194 pour Sanae - a révélé les divisions au sein du parti.
Ces chiffres sont la conséquence directe des particularités de l'organisation des partis au Japon. Alors que dans notre conception d'une organisation politique, il doit y avoir de la discipline, au Japon, tous les partis sont constitués de cliques dont les intérêts peuvent parfois être contradictoires.
Ce banquier de 67 ans, fan d'anime et collectionneur de modèles de véhicules militaires, a été qualifié de 'fou de l'armée' en raison de son intérêt pour la politique de défense, qui est apparu, selon lui, dans les années 1990, après la guerre du Golfe. En 38 ans de carrière politique (il a été élu pour la première fois au parlement en 1986), il a occupé le poste de ministre de la défense et s'est principalement concentré sur la sécurité et la revitalisation des communautés rurales du Japon.
Ishiba est favorable à la création d'une organisation militaire asiatique, analogue à l'OTAN, et à la possibilité de déployer des armes nucléaires américaines dans la région Asie-Pacifique, propositions qu'il a mises en avant pendant la campagne électorale. Le nouveau premier ministre promeut activement sa position aux États-Unis également. En particulier, l'Institut Hudson a publié son article sur la coopération bilatérale et le système de sécurité dans la région asiatique le 25 septembre.
On peut dire que l'accent mis sur la politique étrangère et la défense a joué un rôle majeur dans le succès d'Ishiba.

Peu avant son élection, il s'était rendu à Taïwan, où il avait été reçu par le président Lai Jingde pour discuter des relations entre le Japon et Taïwan et de l'endiguement de la Chine. Auparavant, la Chine et le Japon se sont mutuellement accusés de violer les frontières maritimes. Ishiba estime que les forces d'autodéfense japonaises devraient être autorisées à tirer des coups de semonce si d'autres navires étrangers pénètrent dans leur espace aérien ou dans leurs eaux.
Outre l'idée de créer un analogue asiatique de l'OTAN, M. Ishiba propose de modifier l'accord sur le statut des forces, qui régit la présence militaire américaine au Japon. Le premier ministre a déclaré que cette question serait une priorité pour son cabinet.
Le deuxième axe de la campagne de M. Ishiba en matière de politique étrangère était la réaction du Japon à la mort d'un enfant japonais de dix ans en Chine, alors que sa mère l'accompagnait à l'école à Shenzhen, le 18 septembre. Les autorités chinoises ont prétendu qu'il s'agissait d'un accident, mais cette tragédie coïncidait avec l'anniversaire de l'incident dit de Mukden en 1931, qui a conduit à la deuxième guerre sino-japonaise.
Ishiba s'est immédiatement attelé à l'exercice de ses pouvoirs et à la réalisation de ses promesses électorales.
Dans la nuit du 1er au 2 octobre, après l'entrée en fonction de son cabinet, il a appelé le président américain Joe Biden et a discuté du renforcement de l'alliance entre le Japon et les États-Unis, invitant ces derniers à continuer à travailler en étroite collaboration avec le Japon en tant que partenaire mondial. Le chef du cabinet japonais a également fait part de son intention d'augmenter le budget de la défense du pays et de renforcer ses capacités militaires.
On sait également que MM. Biden et Ishiba ont soutenu la nécessité de développer des blocs multilatéraux de pays partageant les mêmes idées, tels que la coopération avec l'Australie et l'Inde dans le cadre du partenariat quadrilatéral, ainsi que le partenariat trilatéral avec la Corée du Sud et les Philippines. D'autres sujets ont été abordés, tels que la RPDC, l'Ukraine et le lancement par l'Iran d'un missile balistique en direction d'Israël.
Bien que M. Ishiba affirme qu'il poursuivra la politique économique du précédent Premier ministre, Fumio Kishida, pour sortir le Japon d'une spirale déflationniste qui dure depuis des années, son élection a fait fluctuer le yen.
Avant que M. Ishiba ne devienne le nouveau chef du parti, on donnait 146 yens pour un dollar, et le 30 septembre, il n'en donnait déjà plus que 141. Le nouveau premier ministre a déclaré vouloir augmenter les impôts sur les revenus financiers, ce qui a fait chuter l'indice Nikkei, les investisseurs estimant que de telles politiques pourraient avoir un impact négatif sur les actions japonaises.
La volatilité monétaire devrait persister jusqu'au début du mois de novembre, lorsque le Japon et les États-Unis organiseront des élections dont les résultats permettront de déterminer plus facilement l'orientation de la politique monétaire au Japon et aux États-Unis.
La dissolution de la chambre basse du parlement japonais est attendue pour le 9 octobre et des élections anticipées auront lieu le 27 octobre. Le nouveau premier ministre a déjà exprimé sa volonté de participer aux prochaines élections de la Chambre des représentants : « Je veux affronter les élections face à face, de tout mon cœur et de toute mon âme, sans m'enfuir ».
Malgré son enthousiasme, les élections risquent de ne pas être faciles pour lui.

Le 23 septembre, le Parti constitutionnel démocratique du Japon a élu l'ancien Premier ministre Noda Yoshihiko à sa tête, dans une tentative d'attirer à lui des conservateurs plus centristes déçus par le PLD. Le parti Komeito, partenaire du PLD, connaît également des changements de direction.
On pense qu'Ishiba, bien qu'il ait accédé au bureau du premier ministre, ne pourra pas y rester longtemps.
Sa proposition d'une « OTAN asiatique » est totalement irréaliste et ne résistera pas à une discussion au parlement, étant donné que même les États-Unis se méfient de cette idée. De plus, l'appel à l'augmentation des impôts, mentionné plus haut, sera mal perçu par les électeurs japonais.
Enfin, les particularités du système politique japonais, où les scandales impliquant des membres du cabinet sont souvent à l'origine d'un remaniement du gouvernement, peuvent également jouer un rôle.
Par exemple, un conseiller spécial de l'ancien Premier ministre Shinzo Abe estime que les positions politiques d'Ishiba et ses compétences douteuses en matière de gestion ne sont pas de bon augure.
Pour la Russie, il est évident que si l'idée d'une « OTAN asiatique » commence à se concrétiser, même partiellement, une telle orientation stratégique n'est pas de bon augure pour le Japon. Et elle n'aura pas le meilleur effet sur la sécurité de la région dans son ensemble.
21:41 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, asie, affaires asiatiques, japon, shigeru ishiba |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


