Enlace Revista documento pdf
Sumario.-
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

Obama est devenu président pour la seconde fois grâce aux minorités ethniques. Les Euro-Américains (ou les “Blancs”) n’ont été que 39% à voter pour le premier président (à moitié) noir des Etats-Unis. Chez les “Latinos”, Obama a récolté 71% des voix et chez les Noirs (ou Afro-Américains), le score mirobolant de 93%, qui est toutefois inférieur à celui qu’il avait obtenu lors de sa première élection à la présidence en 2008. Chez les Asiatiques, Obama a récolté le score très confortable de 73%. Même les Latinos d’origine cubaine, dont une bonne part était jusqu’ici demeurée fidèle au Parti Républicain, ont voté majoritairement pour Obama lors des dernières présidentielles. Le soutien à Obama chez les autres minorités s’est révélé en recul mais il obtient néanmoins une majorité de 58%.
00:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, états-unis, élections américaines, présidentielles américaines, obama |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
ELEMENTOS Nº 36. DRIEU LA ROCHELLE. ARTISTA DE LA DECADENCIA
00:05 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : drieu la rochelle, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
00:05 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : carl schmitt, théorie politique, sciences politiques, politologie, philosophie, nouvelle droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le 29 mai dernier, à une forte majorité, le corps électoral français a rejeté la ratification du Traité constitutionnel européen (T.C.E.). Trois jours plus tard, le 1er juin, les électeurs néerlandais ont fait de même, plus massivement encore. Cette double victoire du non a plongé l’eurocratie dans la consternation, l’hébétude et la rage. Malgré la nette victoire du oui survenue au Luxembourg le 10 juillet suivant, l’état comateux du T.C.E. demeure.
La vigueur du non français a surpris les observateurs. Il signifie le cinglant désaveu du peuple envers une certaine manière de faire campagne. Matraqué par une intense propagande « oui-ouiste » orchestrée par la quasi-totalité du personnel politique, reprise et démultipliée par la grande presse et les grands médias, l’électeur, d’instinct, s’est opposé à ce nouveau « bourrage de crâne ». « Ce non est bien évidemment une réaction automatique, immédiate, à l’ultimatum qu’a été dès le début ce référendum, commente Jean Baudrillard. Réaction à cette coalition de la bonne conscience, de l’Europe divine, celle qui prétend à l’universel et à l’évidence infaillible, réaction à cet impératif catégorique du oui, dont les promoteurs n’ont même pas supposé un seul instant qu’il pouvait constituer un défi – et donc un défi à relever. Ce n’est donc pas un non à l’Europe, c’est un non au oui, comme évidence indépassable » (Libération, 17 mai 2005).
Déçus, amers et vindicatifs (comme le prouve l’hallucinant et édifiant éditorial de July dans Libération du 30 mai), les tenants du oui ont beau jeu de souligner l’hétérogénéité du non. Pour la circonstance, la distinction gauche-droite a su s’éclipser au profit d’une convergence circonstancielle et momentanée de périphéries radicales, contestataires et oppositionnelles contre un centre modéré, gouvernemental et installé. D’après les enquêtes d’opinion, la majorité des électeurs « nonistes » provient de la gauche. Pour le démographe Hervé Le Bras, il ne fait aucun doute que « la carte des résultats du référendum donne un verdict clair : le non de 2005 épouse la géographie de la gauche, pas celle de l’extrême droite » (Libération, 1er juin 2005). « L’importance de la victoire du non, insistent Bruno Cautres et Bernard Denni, doit donc assez peu aux souverainistes qui, à la différence de 1992, ne se retrouvent en nombre qu’au F.N. et au M.P.F. » (Libération, 7 juin 2005). Annie Laurent confirme cette analyse en précisant qu’« à l’aune des élections régionales de 2004, la gauche parlementaire représente 44 % du vote non, la droite parlementaire 18 % et le F.N. 28 % » (Le Figaro, 14 juillet 2005). « Pour le philosophe Philippe Reynaud, signale Nicolas Weill, “ ce qui l’a emporté, c’est avant tout une problématique sociale, antilibérale et anticapitaliste ” » (Le Monde, 4 juin 2005).
Un non pluraliste
La part de la gauche dans le succès du non est indéniable. Il faut toutefois appréhender ce non de gauche comme passéiste et rétrograde. Tout au long de la campagne, les dissidents des Verts et du P.S. (Fabius, Mélenchon, Emmanuelli, Montebourg), José Bové, le P.C.F., la L.C.R., Lutte ouvrière, l’extrême gauche et la C.G.T. ont défendu l’« exception française », les « acquis sociaux » et le droit illimité et incompressible à la « gréviculture ». Critiquant surtout la troisième partie économiciste du texte, ils ont encouragé une certaine conception de la France, sœur jumelle survivante de l’Albanie maoïste d’Enver Hodja, dernière réserve à dinosaures bourdivins, ultime « Sovietic Park » au monde. La gauche revendicative a favorisé un non de résignation, car elle est incapable de comprendre les défis du XXIe siècle, aveuglée par une grille de lecture antédiluvienne remontant à la Ire Révolution industrielle ! Ne soyons pas surpris d’y retrouver d’indécrottables utopistes, d’ineffables pacifistes et de pitoyables tiers-mondistes. Ainsi, Libération (31 mai 2005) rapporte le témoignage d’un étudiant appelé Jérôme qui a voté « non » parce qu’il n’a « pas envie de créer une seconde superpuissance qui, comme les États-Unis, pillerait les pays d’Afrique » (sic). La sottise idéologique reste d’actualité !
La deuxième composante du non rassemble la nébuleuse souverainiste, national-républicaine et nationiste, c’est-à-dire le F.N. et le M.P.F., bien évidemment, mais aussi le M.N.R., les gaullistes de Charles Pasqua et de Nicolas Dupont-Aignan, les chevènementistes, les royalistes, le Parti des travailleurs de Daniel Gluckstein (catalogué « national-trotskyste »), les chasseurs de C.P.N.T., etc. D’une argumentation plus fondée, leur non n’est pas moins présentiste et paradoxal. Ils condamnent, à juste titre, ce qu’entreprend l’Europe technocratique, c’est-à-dire l’éradication et le remplacement des identités populaires par un grand marché planétaire, tout en reproduisant cette démarche ethnocidaire dans l’Hexagone. Plus exactement, la bureaucratie bruxelloise reprend la méthode jacobine républicaine hexagonale afin d’édifier un super-État centralisé européen. Ne s’exemptant pas de contradictions, ils défendent avec acharnement la langue française, mais méprisent les langues régionales et vernaculaires ! Au nom d’une francophonie mythique, ils acceptent les migrants du Maghreb et d’Afrique noire, mais accusent le « plombier polonais » et la « coiffeuse hongroise » de « manger le pain des Français ». Dans Le Figaro du 31 juin 2005, un certain Nordine, chauffeur de taxi de son état, explique son vote négatif par un raisonnement xénophobe : « L’Europe va s’épuiser en voulant renflouer l’Est. Les Roumains et les Polonais que je vois ici ne respectent rien. » Tiens donc ! Les « jeunes » des banlieues qui brûlent les voitures viendraient-ils d’Europe de l’Est ? L’information sensationnelle vaut son pesant de cacahuètes. Le discours souverainiste atteint ici ses limites. Son fixisme autour d’une France idéalisée par les « quarante rois qui… » (on connaît la chanson) et les « hussards noirs de la République », l’empêche de comprendre les grandes mutations de notre temps. Il est intéressant de remarquer que les territoires dont les élus sont des ténors de l’État-nation (la Vendée pour Philippe de Villiers, les Yvelines pour Christine Boutin, Maison-Laffitte pour Jacques Myard, les Hauts-de-Seine pour Charles Pasqua) ont porté le oui en tête.
La dernière catégorie du non ressort de la marginalité. Elle n’en est pas moins fondamentale, car porteuse d’une ambition européiste s’appuyant sur l’identité, la souveraineté et la puissance. C’est un non d’avenir qui entend bouleverser l’actuel paysage politique et politiser l’enjeu européen. C’est déjà en bonne voie puisque « les référendums sur l’Europe réussissent là où échouent les élections au Parlement européen : créer un espace démocratique pour organiser le débat autour de la construction européenne » (B. Cautres et B. Denni, art. cit.). Ce non d’avenir dépasse de loin le non droitier et le non gauchiste. En effet, « si l’on retient qu’il s’agissait d’abord d’un non identitaire s’opposant à un élargissement sans limites, à une fédéralisation d’éléments clés des politiques nationales, et à une réduction des protections sociales nationales sans contreparties apparentes pour les salariés exposés, la réponse ne peut résider dans un replâtrage de l’Union. C’est une refondation de la construction européenne qui s’impose » (Christian Saint-Étienne, Le Figaro, 18 et 19 juin 2005). Et l’auteur d’ajouter, avec pertinence, que « le non social est un non identitaire au sens où les salariés ont l’impression qu’on veut casser les protections nationales pour mieux les laminer dans une Union qui, du fait d’un élargissement sans limites, a changé de nature ». « Est-ce à dire que la question sociale primerait désormais sur la question nationale ? “ L’une et l’autre sont liées ”, fait observer l’historien de l’Europe Robert Frank, de l’université Paris-I. Le chômage que la France connaît depuis des décennies représente un ferment “ destructeur de l’identité nationale ”. Aujourd’hui, pense M. Frank, “ l’identité nationale est multiple et superpose plusieurs attachements, régionaux, nationaux mais également européens ”. Plutôt que de malaise, il préfère parler d’une “ crise de l’identité européenne des Français ” » (Nicolas Weill, art. cit.).
Préparer la Grande Europe identitaire et populiste
Dépassant la stupide et stérile querelle gauche-droite, le non d’avenir identitaire et populiste, car populaire, sait, comme semble le convenir Emmanuel Todd, que « les milieux populaires, ouvriers et employés, représentent 50 % du corps électoral, et que cette proportion explique les instabilités du système politique français. Les ravages du libre-échange, dont souffrent les milieux ouvriers, ont encore radicalisé leur révolte. […] La vraie nouveauté est l’entrée en fureur d’une parties des classes moyennes » (Emmanuel Todd, Le Nouvel Observateur, 9 – 15 juin 2005). Attirons toutefois l’attention sur le discret mépris à l’égard des couches populaires. E. Todd semble leur reprocher l’instabilité politique comme s’il croyait que la politique ne fût que la version sophistiquée de La Petite Maison dans la prairie et non l’acceptation du conflit. C’est indéniable : « le non, de “ gauche ” ou d’extrême droite, confirme le géographe Jacques Lévy, contient une incontestable composante nationaliste, à la fois sous la forme d’un protectionnisme commercial, relancé à propos des services par la directive Bolkenstein, et d’un refus de la libre circulation » (Libération, 1er juin 2005). Il en résulte « une recomposition du champ politique. Au clivage gauche-droite s’est substituée une ligne de partage qui oppose schématiquement le “ peuple ” aux “ élites ”, les radicaux aux modérés, les électeurs anti-système à ceux qui se reconnaissent dans les partis de gouvernement. En ce sens, le 29 mai n’est pas un nouveau 10 mai, mais bien plutôt un super-21 avril. Or cette recomposition s’est opérée autour du rapport à l’État et à la nation. Plus précisément, la question sociale a rejoint la question nationale » (Claude Weill, Le Nouvel Observateur, 9 – 15 juin 2005).
Plus généralement, la victoire du non démontre la faillite des oligarchies. Le 29 mai restera comme une magnifique claque donné à un Établissement plus attiré par les lubies mondialistes libérales-libertaires de la « Nouvelle Classe » que par les inquiétudes légitimes du peuple. Il est cependant navrant d’employer le beau mot d’« élite » pour désigner les couches dirigeantes maffieuses qui monopolisent la politique, l’économie, les syndicats, la culture, les médias, et qui asservissent la France. Si elles forment une élite, c’est très sûrement dans la gabegie des ressources, le détournement des finances et le conformisme politique ! Elles sont les élites de la nullité; une parodie d’élite. Le seul terme adéquat qui leur convient est celui d’« oligarchie ». Dans Sinistrose. Pour une renaissance du politique (Flammarion, 2002), Vincent Cespedes observe que la France vit en non-démocratie : en-dehors de l’exercice d’un droit de vote formel et illusoire car sans grand effet, le citoyen est réduit à la figuration politique. Le fort taux de participation sur un sujet a-priori jugé compliqué par les oligarques prouve a contrario l’intérêt du peuple pour la Res Publica.
Emmanuel Todd croit que « les gens du oui ont choisi leur défaite. Les gens du oui, compétents, les élites, se sont refusé, ou ont été incapables, de définir une Europe effectivement protectrice » (art. cit.). La dénonciation reste bien modeste. Traduirait-elle en fait sa lassitude et son agacement de Todd de faire partie des perdants, une fois encore après Maastricht en 1992 ? « La classe politique française toute entière porte dans cet échec une énorme responsabilité, écrit pour sa part Alain Caillé. Vis-à-vis de l’Europe, elle n’a su que cumuler arrogance, ignorance et incompétence. Arrogance aussi longtemps qu’elle a cru pouvoir donner le la en Europe. Ignorance de la réalité des autres pays qui rejoignaient l’Europe. De la réalité tout court. Incompétence dans le rapport aux nouvelles institutions européennes. Les députés français y brillent plus souvent par leur absence que par leur force de proposition. Force est de constater qu’aucun des grands partis français n’a su développer un discours sur l’Europe, totalement absente de la dernière présidentielle ou des dernières législatives » (Libération, 24 mai 2005). « Cela signifie, poursuit Jean Baudrillard, la faillite du principe même de la représentation, dans la mesure où les institutions représentatives ne fonctionnent plus du tout dans le sens “ démocratique ”, c’est-à-dire du peuple et des citoyens vers le pouvoir, mais exactement à l’inverse, du pouvoir vers le bas, par le piège d’une consultation et d’un jeu de question / réponse circulaire, où la question ne fait que se répondre oui à elle-même » (art. cit.). Le scrutin du 29 mai 2005 indique l’état de sécession du peuple. Son exaspération peut, à plus ou moins long terme, virer en révolution, avec le risque d’une reprise en main possible par les gauchistes et leurs alliés islamistes.
Néanmoins, « le non identitaire ouest-européen pourrait servir de socle à un renouveau de la construction européenne [car] s’interdire d’analyser les non français et hollandais pour ce qu’ils sont, c’est s’interdire de penser la refondation de l’Europe. L’avenir de l’Europe ne peut se construire que sur la vérité et la lucidité » (Christian Saint-Étienne, art. cit.). La construction européenne voulue par ses fondateurs dans une direction intégratrice fonctionnaliste paie maintenant au prix fort son absence de politisation. « Car, insiste Alain Caillé, le défaut majeur auquel a succombé la construction européenne est connu : avoir préféré l’élargissement économique à sa consolidation politique » (art. cit.).
L’urgente et souhaitable politisation ne doit pas toucher que les instances européennes, elle doit aussi concerner la France et ses terroirs. L’alternative est désormais simple : ou les oligarchies sourdes, autistes et aveugles poursuivent leur travail de dissolution des identités ethniques, culturelles et populaires dans le grand chaudron de la mondialisation avec les inévitables réactions de résistance et de rejet, ou les peuples retrouvent leur citoyenneté, recouvrent, enfin, le pouvoir de décider de leur destin.
Georges Feltin-Tracol http://www.europemaxima.com
00:04 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, france, europe, affaires européennes, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
|
Avec :
René NABA, écrivain, journaliste, auteur de Les révolutions arabes ou la malédiction de Camp David.
Bahar KIMYONGUR, auteur de Syriana, la conquête continue.
Bamba GUEYE LINDOR, fondateur des Damnés de la Terre, militant sénégalais panafricaniste.
Ibrahim ILBOUNDO, ancien secrétaire général de l'Union Générale des Etudiants Burkinabés (section France)
Comité palestinien contre la guerre en Syrie
|
|
Qu'est-ce que le comité anti-impérialiste?
Le Comité anti-impérialiste a pour but de mettre en lumière la face cachée de la "démocratie" bourgeoise mais aussi de soutenir les résistances populaires et les mouvements révolutionnaires dans le monde, en particulier ceux qui luttent pour la libération sociale, pour le communisme. Nous soutenons les Guerres Populaires menées actuellement par les Partis maoïstes en Inde, au Pérou, aux Philippines ou ailleurs. Comme dans les années 1930, le capitalisme qui connaît une phase aiguë de sa crise générale mène de concert des programmes d'austérité sociale, engendre la montée du fascisme et provoque des guerres de plus en plus sanglantes pour sauver un système indéfendable. L'incroyable violence inégalitaire de l'ordre marchand se nourrit du supplice infligé aux peuples opprimés. Une même logique, celle de l'ordre du profit relie les licenciements de Peugeot aux campagnes guerrières contre les pays dominés. A ce titre la lutte contre l'impérialisme ne dépend pas en premier lieu d'un comportement moral mais c'est un aspect indispensable de la lutte des peuples du monde pour se libérer du capitalisme. Un peuple qui en opprime un autre ne saurait être libre.
|
01:29 Publié dans Evénement | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : événement, paris, france, nanterre, politique internationale, mali, syrie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
 Le maire de Salonique accusé de “turcophilie”
Le maire de Salonique accusé de “turcophilie”
Boutaris (photo), maire de Salonique en Grèce, imaginait naguère avoir élaboré un bon plan pour faire entrer de l’argent dans l’escarcelle de sa ville: il a organisé une vaste campagne publicitaire pour faire venir des touristes turcs à Salonique (ou Thessaloniki). Comme beaucoup d’autres villes grecques, Salonique contient encore bon nombre de traces de l’occupation ottomane pluriséculaire que le pays tout entier a subie depuis les 14ème et 15ème siècles. Boutaris a pensé, sans doute à juste titre, que beaucoup de Turcs aimeraient visiter les restes de leur “glorieux passé” en cette Grèce, où ils furent jadis conquérants et oppresseurs. De surcroît, Salonique est la ville où Atatürk est né. Sa maison natale pourrait bien attirer des autocars complets de touristes turcs. Bref, Boutaris se voyait déjà palper à pleines mains l’oseille des touristes.
Mais les Grecs sont un peuple qui a le sens de l’honneur: ils ne sont pas prêts à tout pour encaisser de l’argent, même en cette période de crise, de restriction, d’austérité et de disette. Le “bon plan” de Boutaris a suscité le scandale. Les Grecs sont furieux. Ils accusent le maire de Salonique d’être un traitre à l’hellénité et d’être un “turcophile”. Lors d’une cérémonie religieuse en souvenir de l’évacuation définitive de Salonique par les Turcs (en 1912), Boutaris a essuyé des tombereaux d’injures, notamment proférés par les moines descendus, pour l’occasion, du célèbre monastère du Mont Athos.
Sans doute Boutaris aurait-il pu éviter ces déboires s’il avait rédigé la présentation de son plan en des termes plus mesurés et plus banals. Mais ce bougre de “turcophile” de Boutaris a absolument tenu à faire du zéle, du “politiquement correct”, en écrivant notamment cette phrase malheureuse: “Avec l’UE, je me sens partenaire (de la Turquie). Avec les Turcs, je me sens comme un frère”. Voilà ce qu’il ne fallait pas dire!
(source: “ ’t Pallieterke”, Anvers, 14 novembre 2012).
00:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, grèce, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Un regard canadien sur les cultures, les identités et la géopolitique
par Georges FELTIN-TRACOL
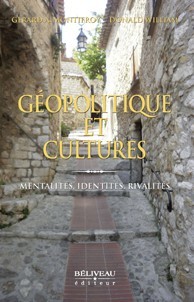 Dans les années 1990, deux géopoliticiens canadiens, Gérard A. Montifroy et Marc Imbeault, publiaient cinq ouvrages majeurs consacrés à la géopolitique et à ses relations avec les démocraties, les idéologies, les économies, les philosophies et les pouvoirs dont certains furent en leur temps recensés par l’auteur de ces lignes. Aujourd’hui, Gérard A. Montifroy et Donald William, auteur du Choc des temps, viennent d’écrire un nouvel essai présentant les rapports complexes entre la géopolitique et les cultures qu’il importe de comprendre aussi dans les acceptions d’identités et de mentalités. Ils observent en effet qu’en géopolitique, « les mentalités constituaient un premier “ pilier ”, se prolongeant naturellement avec les données propres aux identités, celles-ci débouchant sur le contexte dynamique des rivalités (p. 7) ».
Dans les années 1990, deux géopoliticiens canadiens, Gérard A. Montifroy et Marc Imbeault, publiaient cinq ouvrages majeurs consacrés à la géopolitique et à ses relations avec les démocraties, les idéologies, les économies, les philosophies et les pouvoirs dont certains furent en leur temps recensés par l’auteur de ces lignes. Aujourd’hui, Gérard A. Montifroy et Donald William, auteur du Choc des temps, viennent d’écrire un nouvel essai présentant les rapports complexes entre la géopolitique et les cultures qu’il importe de comprendre aussi dans les acceptions d’identités et de mentalités. Ils observent en effet qu’en géopolitique, « les mentalités constituaient un premier “ pilier ”, se prolongeant naturellement avec les données propres aux identités, celles-ci débouchant sur le contexte dynamique des rivalités (p. 7) ».
Comme dans les précédents ouvrages de la série, le livre présente une abondante bibliographie avec des titres souvent dissidents puisqu’on y trouve Julius Evola, Julien Freund, Éric Zemmour, Danilo Zolo, Éric Werner, Jean-Claude Rolinat, Hervé Coutau-Bégarie, etc. L’intention est limpide : « Il nous fallait sortir de l’actuel esprit du temps qui déforme les raisonnements en débouchant sur la pulvérisation de la réalité des faits. Face à la dictature de la pensée dominante, il existe une défense formidable : les livres aussi “ parlent ” aux livres (p. 08) ». On doit cependant regretter l’absence d’une liste de blogues et de sites rebelles sur la Toile. Car, contrairement à ce que l’on croit, Internet est plus complémentaire que concurrent à la lecture à la condition toutefois de cesser de regarder une télévision toujours plus débilitante. Leur compréhension du monde se fiche des tabous idéologiques en vigueur. « C’est pourquoi la géopolitique, telle que nous la concevons, concourt à faire sortir de l’ombre le dessous des cartes, le monde du réel (p. 9). » Ce travail exige une démarche pluridisciplinaire dont un recours à la philosophie, parce qu’« en géopolitique, l’apport de la réflexion philosophique est essentiel, fondamental même (p. 16) ». Les auteurs ne cachent pas qu’ils s’appuient sur les travaux du général autrichien Jordis van Lohausen, un disciple de Karl Haushofer. Ils mentionnent dans leur ouvrage les écoles géopolitiques anglo-saxonne (britannique et étatsunienne), allemande/germanique et française, mais semblent ignorer le courant géopolitique russe ! Dommage !
La lecture est une nécessité vitale pour qui veut avoir une claire vision des enjeux géopolitiques. Seuls les livres – imprimés ou électroniques – sont capables de répliquer à la désinformation ambiante. « Justifier des guerres d’agression en modifiant le sens des mots relève directement d’une stratégie orwellienne de manipulation mentale : les stratèges de la communication mettent en avant un interventionnisme qualifié d’humanitaire pour justifier l’expression (p. 21). »
Le contrôle des esprits, la modification des mentalités, le dénigrement ou non des identités ont des incidences géopolitiques telles qu’« un État n’est donc pas synonyme d’une mentalité globale (p. 61) ». Cette assertion guère évidente provient de Canadiens. Or le Canada aurait-il pu (peut-il encore ?) se construire un destin ? Les auteurs s’interrogent sur son caractère national, étatique, quelque peu aléatoire du fait de la conflictualité historique entre les Canadiens – Français, les anglophones et les Amérindiens. Et ce, au contraire de la France ! « Pour ses composantes humaines, la France est également née de son propre voisinage : de son “ proche ” contexte. C’est-à-dire que l’identité collective, nationale, est directement issue de populations celtes, latines et germaniques (pp. 69 – 70). » La France a ainsi bénéficié de la longue durée historique pour se forger et se donner une indéniable personnalité politique, temporelle et géographique.
Montifroy et William s’attachent à démontrer les « spécificités géopolitiques canadiennes (p. 87) » et dénoncent leur « vendredi noir ». Ce jour-là, le 20 février 1959, le Premier ministre conservateur-progressiste canadien, John G. Diefenbaker, ordonnait la destruction de l’avion d’interception Avro C.F.-105 Arrow et la fin immédiate du projet au profit des produits étatsuniens. Un vrai sabordage ! Les difficultés de vente actuelles à l’étranger de l’avion français Rafale reproduisent ce lent travail de sape voulu par les États-Unis afin d’être les seuls à armer leurs obligés (et non leurs alliés).
Ce « coup de poignard dans le dos » n’est pas le premier contre le Canada. Deux cents ans plus tôt commençait la Seconde Guerre d’Indépendance américaine (1812 – 1814) entre la Grande-Bretagne et les États-Unis. Dans ce conflit peu connu en Europe, on pourrait en imputer le déclenchement à Londres qui se vengeait du traité de Versailles de 1783. Erreur ! C’est Washington qui déclare la guerre au Royaume-Uni le 18 juin 1812 et essaie d’envahir le Canada. « L’initiative américaine comporte alors un double objectif : couper une source d’approvisionnement stratégique, le bois canadien, remplaçant le commerce des fourrures, matière nécessaire pour les navires anglais, et s’approprier une aire d’expansion aux dépens de possessions britanniques, depuis longtemps convoitées au Nord (p. 95). »
Cette nouvelle guerre aurait pu déchirer la société canadienne divisée entre Canadiens-Français catholiques et anglophones protestants (colons venus d’Europe et « Loyalistes » américains installés après l’indépendance des États-Unis), ce n’est pas le cas ! Une union nationale anti-américaine se réalise. À la bataille de Stoney Creek du 6 juin 1813, 700 combattants canadiens – anglophones et francophones – repoussent environ 3 500 soldats étatsuniens ! Une paix blanche entre les deux belligérants est conclue en 1814. Les États-Unis continueront à vouloir encercler le Canada en acquérant en 1867 l’Alaska, en guignant la Colombie britannique et en lorgnant sur les Provinces maritimes de l’Atlantique. On peut même envisager que Washington attisa les forces centrifuges du futur Canada ?
Les contentieux frontaliers évacués à partir du milieu du XIXe siècle, les classes dirigeantes étatsuniennes et britanniques nouèrent des liens si étroits que « la culture s’impose à la géographie (p. 138) ». Si les auteurs soulignent le grand rôle africain de Cecil Rhodes, ils oublient qu’il fut parmi les premiers à concevoir une entente permanente entre les États-Unis et la Grande-Bretagne. Cette alliance transatlantique allait devenir au XXe siècle une Anglosphère planétaire matérialisée par le réseau d’espionnage électronique mondial Echelon qui est « une organisation ne comprenant que des pays anglo-saxons : Grande-Bretagne, États-Unis, Australie, Nouvelle-Zélande et Canada (majorité anglophone) (p. 180) ».
Depuis la fin de la Guerre froide, les États-Unis et derrière eux, l’Anglosphère-monde, manifestation géographique du financiarisme, s’opposent à l’Europe et à la France en particulier, car « la France est le seul obstacle fondamental à leur domination mondiale sur les Esprits (p. 166) ». Pour l’heure, l’avantage revient au camp anglo-saxon. Gérard A. Montifroy et Donald William déplorent par exemple que la fonction de haut-représentant de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité soit revenue à une tonitruante, gracieuse et charismatique Britannique, la travailliste anoblie Catherine Ashton. « Cette confusion entre l’Europe purement géographique et l’Europe géopolitique constitue l’une des fractures cachées de l’actuelle Union européenne, celle de Bruxelles (p. 149). » À la suite de Carl Schmitt, les auteurs prônent par conséquent qu’« à son tour, l’Europe doit projeter sa propre “ Doctrine Monroe ” (p. 228) ». Un bien bel ouvrage didactique en faveur d’une résistance européenne au Nouvel Ordre mondial fantasmé par les Anglo-Saxons !
Georges Feltin-Tracol
• Gérard A. Montifroy et Donald William, Géopolitique et cultures. Mentalités, identités, rivalités, Béliveau éditeur, Longueil (Québec – Canada), 2012, 251 p., 22 €.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2694
00:09 Publié dans Géopolitique, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, livre, gérard montifroy, canada |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
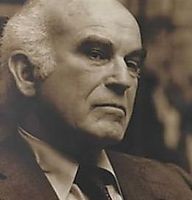 Robert Nisbet oltre l'etichetta di conservatore
Robert Nisbet oltre l'etichetta di conservatore 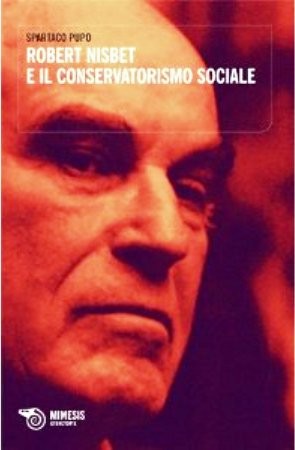 Autore di libri di culto come The Quest for Community, bibbia della primavera conservatrice a stelle e strisce dei primi anni Cinquanta, pubblicata in Italia nel 1957 dalle Edizioni di Comunità con il titolo La comunità e lo Stato, Nisbet, considerato non del tutto a ragione l’ideologo principale del reaganismo, da noi è pressochè sconosciuto, in particolare tra i più giovani. Il testo di Pupo, docente di Storia delle dottrine politiche presso l’università cosentina, colma questa lacuna e ne propone la riscoperta attraverso un’agile ma completa introduzione al pensiero politico, sottolineandone sin dal titolo l’originalità. Nisbet, infatti, ha indagato il carattere meno conosciuto del conservatorismo: la socialità, riconducibile non solo alla diffusa ricerca dell’identità e dell’autorità delle lealtà tradizionali, ma anche alle attenzioni verso gli indiscutibili benefici del welfare state e all’individuo inteso non come soggetto astratto ma come persona che nasce, vive e muore in una comunità di appartenenza. L’intuizione del sociologo californiano, ammesso che possa così definirsi un’attività di studio pluridecennale, è proprio nell’individuare nel declino delle comunità il più grande problema sociale e politico del nostro tempo e nella relativa “domanda di comunità” la risposta al malessere della società occidentale. Di qui la necessità di preservare, tra Stato e Mercato, una sfera di libertà basata su un tessuto di relazioni comunitarie, dalla scuola alla famiglia, dall’amministrazione locale alla piccola impresa economica. La moderna storia dell’occidente, a partire dalla rivoluzione industriale e dalla rivoluzione francese, altro non è – spiega Nisbet – che la storia del disfacimento delle comunità e del concomitante sviluppo di uno Stato politico che, sin dalla sua nascita, non solo riconosce come cittadini soltanto individui isolati e non più gruppi di uomini ma pretende di dirigere la vita di ogni uomo, sia nella sfera pubblica che in quella privata, indebolendo le lealtà umane fondate sulla fede, sul lavoro, sulla parentela, sull’etnia, sul luogo, sull’interesse condiviso e sul volontariato. Così facendo – ne conclude il sociologo – viene meno quella saldatura sociale che è stata la vera protagonista della crescita dell’America e degli altri paesi occidentali. Perché non è stato l’individuo solitario ma i gruppi di individui, ossia le comunità, le famiglie, i parentadi, i villaggi, le associazioni di volontariato, a realizzare scuole, strade, chiese, imprese comuni, istituzioni, regioni e nazioni. Quando politica ed economia recidono il legame individuo-società, l’individuo rischia di perdere, con il senso responsabilità verso l’altro, la sua stessa libertà. La libertà autentica, per Nisbet, è invece quella che nasce spontaneamente nella società pluralistica, dove una varietà di gruppi sociali intermedi tra l’individuo e lo Stato detiene ruoli, funzioni e responsabilità reali e autonomie sufficienti ad offrire al singolo individuo un senso di protezione, finalità, identità, appartenenza. Tutto ciò al fine di evitare che uomini nominalmente liberi diventino spiritualmente sterili, emozionalmente vuoti e sempre più soli, oltre che vulnerabili ai richiami di uno Stato non più comunità di comunità ma paternalistico, onnicomprensivo e autoritario. Critica che Nisbet, però, rivolge anche al liberalismo e a chi riteneva (e ritiene) che l’unica alternativa a a statalismo e dirigismo potesse essere rappresentata da un mercato sempre più incontrollato, un mercato che “deresponsabilizzando” l’individuo, finisce per renderlo schiavo delle grandi istituzioni politiche ed economiche contemporanee.
Autore di libri di culto come The Quest for Community, bibbia della primavera conservatrice a stelle e strisce dei primi anni Cinquanta, pubblicata in Italia nel 1957 dalle Edizioni di Comunità con il titolo La comunità e lo Stato, Nisbet, considerato non del tutto a ragione l’ideologo principale del reaganismo, da noi è pressochè sconosciuto, in particolare tra i più giovani. Il testo di Pupo, docente di Storia delle dottrine politiche presso l’università cosentina, colma questa lacuna e ne propone la riscoperta attraverso un’agile ma completa introduzione al pensiero politico, sottolineandone sin dal titolo l’originalità. Nisbet, infatti, ha indagato il carattere meno conosciuto del conservatorismo: la socialità, riconducibile non solo alla diffusa ricerca dell’identità e dell’autorità delle lealtà tradizionali, ma anche alle attenzioni verso gli indiscutibili benefici del welfare state e all’individuo inteso non come soggetto astratto ma come persona che nasce, vive e muore in una comunità di appartenenza. L’intuizione del sociologo californiano, ammesso che possa così definirsi un’attività di studio pluridecennale, è proprio nell’individuare nel declino delle comunità il più grande problema sociale e politico del nostro tempo e nella relativa “domanda di comunità” la risposta al malessere della società occidentale. Di qui la necessità di preservare, tra Stato e Mercato, una sfera di libertà basata su un tessuto di relazioni comunitarie, dalla scuola alla famiglia, dall’amministrazione locale alla piccola impresa economica. La moderna storia dell’occidente, a partire dalla rivoluzione industriale e dalla rivoluzione francese, altro non è – spiega Nisbet – che la storia del disfacimento delle comunità e del concomitante sviluppo di uno Stato politico che, sin dalla sua nascita, non solo riconosce come cittadini soltanto individui isolati e non più gruppi di uomini ma pretende di dirigere la vita di ogni uomo, sia nella sfera pubblica che in quella privata, indebolendo le lealtà umane fondate sulla fede, sul lavoro, sulla parentela, sull’etnia, sul luogo, sull’interesse condiviso e sul volontariato. Così facendo – ne conclude il sociologo – viene meno quella saldatura sociale che è stata la vera protagonista della crescita dell’America e degli altri paesi occidentali. Perché non è stato l’individuo solitario ma i gruppi di individui, ossia le comunità, le famiglie, i parentadi, i villaggi, le associazioni di volontariato, a realizzare scuole, strade, chiese, imprese comuni, istituzioni, regioni e nazioni. Quando politica ed economia recidono il legame individuo-società, l’individuo rischia di perdere, con il senso responsabilità verso l’altro, la sua stessa libertà. La libertà autentica, per Nisbet, è invece quella che nasce spontaneamente nella società pluralistica, dove una varietà di gruppi sociali intermedi tra l’individuo e lo Stato detiene ruoli, funzioni e responsabilità reali e autonomie sufficienti ad offrire al singolo individuo un senso di protezione, finalità, identità, appartenenza. Tutto ciò al fine di evitare che uomini nominalmente liberi diventino spiritualmente sterili, emozionalmente vuoti e sempre più soli, oltre che vulnerabili ai richiami di uno Stato non più comunità di comunità ma paternalistico, onnicomprensivo e autoritario. Critica che Nisbet, però, rivolge anche al liberalismo e a chi riteneva (e ritiene) che l’unica alternativa a a statalismo e dirigismo potesse essere rappresentata da un mercato sempre più incontrollato, un mercato che “deresponsabilizzando” l’individuo, finisce per renderlo schiavo delle grandi istituzioni politiche ed economiche contemporanee.
00:05 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert nisbet, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Abolghâssem Hassan ben Ali Ferdowsi, grand maître de la langue persane, fut une personnalité aussi légendaire que ses héros. Du jeune noble, lettré et bien élevé, qui décide de transcrire sous forme d’un immense ouvrage épique les légendes et les mythes de l’ancienne Perse, au vieux sage usé et fatigué qui, vers la fin de sa vie, nous conte les tourments de son âme en peine, l’itinéraire de ce héros inclassable et obstiné est unique. Il fut noble dehghân, poète de cour, satiriste, chef de file du mouvement sho’oubbieh et surtout, l’auteur du Shâhnâmeh ou Livre des Rois, recueil épique de 120 000 vers, où l’histoire de l’Iran ancien rejoint celle des autres civilisations antiques. Même si, pour les persanophones du monde entier, Ferdowsi est non seulement un poète, mais il constitue également un patrimoine personnel destiné à chaque membre de cette communauté. La vie de ce maître est, telle celles de ses héros, entourée de légendes et de mystères qui ne donnent que plus de valeur à la place qu’il tient unanimement dans le cœur de tout iranien.
Dans la traduction arabe du Shâhnâmeh réalisée par Albandâri datant approximativement de l’année 1223, le nom de Ferdowsi est « Mansour ben Hassan ». Il apparaît ailleurs sous le nom de « Hassan ben Ali » ou » Hassan ben Eshagh Sharafshâh ». Pour les chercheurs, c’est la version de la traduction arabe du Livre des Rois par Albandâri qui paraît la plus probable. Son patronyme « Abolghâssem Ferdowsi » est quant à lui unanimement accepté et il n’existe pas de doute au sujet de son exactitude.
Ferdowsi est né à Baj dans la région de Touss. La date précise de sa naissance est inconnue mais les divers recoupements permettent de croire qu’il est né en 940 ou 941. De ses études, on ne sait pas grand-chose mais il connaissait certainement la littérature persane et arabe. Certains pensent que Ferdowsi aurait pu être zoroastrien. C’est une idée totalement fausse. Comme toujours avec les auteurs, le meilleur moyen de connaitre exactement leur biographie est de prendre en compte ce qu’ils en ont dit dans leurs œuvres. D’après les biographes officiels et Ferdowsi lui-même, il était musulman chiite, d’une optique proche de celle des Mo’tazzelleh. C’est ce que dit également Nezâmi Arouzi dans ses Quatre Articles. Ferdowsi présente son chiisme dans l’introduction du Shâhnâmeh :
Tu ne verras point de tes deux yeux le Créateur
Ne les fatigue donc point à Le voir
Par ailleurs, dans beaucoup d’autres vers, il loue l’Imam Ali et c’est dans son Hajvnâmeh, recueil satirique, qu’il montre le plus franchement son appartenance au chiisme. D’autre part, Ferdowsi s’est toujours montré fidèle à ses idéaux et son patriotisme ne doit pas être pris pour une tendance zoroastrienne. Le Maître de Touss était monothéiste, et en de très nombreux endroits de son Livre des Rois, il loue Dieu l’unique et parle de Son Unicité et de Son Immatérialité. Sa plus célèbre louange est celle qui introduit 
le Shâhnâmeh :
Tu es le haut et le bas de ce monde
Je ne sais point ce que Tu es,
Tu es tout ce que Tu es.
Ferdowsi était noble et descendait d’une très vieille famille de propriétaires terriens. Cette naissance et cette situation familiale jouèrent sans aucun doute un rôle important dans la formation du jeune Ferdowsi. Premièrement car en tant que noble persan, il s’était familiarisé très jeune avec l’histoire mythique de l’Iran antique. Il est intéressant de noter qu’en la matière, Ferdowsi n’est que le digne héritier des Khorâssânis : quand les Arabes musulmans envahirent l’Iran en l’an 641, toute la cour sassanide, ainsi que les grands administrateurs de cet empire immense se réfugièrent dans la région du Khorâssân, qui comprenait également à cette époque une partie de la Transoxiane. C’est pourquoi, après l’arabisation forcée de la culture iranienne qui ne s’est pas fait sans résistance, ainsi qu’avec la politique de discrimination raciale mise en œuvre par les califes omeyyades, la région du Khorâssân, géographiquement la plus lointaine de la capitale du califat, devint le centre de la résistance iranienne culturelle, religieuse et même militaire et politique. Ce d’autant plus que le Khorâssân était, dès avant l’islam, une satrapie particulièrement importante étant donné qu’elle avoisinait les tribus nomades et très peu civilisées de l’Asie centrale et que par conséquent, les habitants avaient depuis très longtemps un patriotisme à la limite du chauvinisme qui ne fit que s’exacerber avec les exactions arabes. Après l’invasion arabe et la migration de l’élite sassanide, qui parlait une langue noble, le dari, c’est-à-dire la langue du « darbar » (la cour), cette province devint le bastion des défenseurs de l’identité persane, symbolisée par le dari. C’est par la voie de cette langue, qui se répandit rapidement et perdit son statut de langue privilégiée, que les légendes et les mythes de l’ancienne Perse, rassemblés dans des textes religieux tels que le Khodâynamak ou « Le Livre divin », ou dans des semi biographies narrant l’histoire des rois perses, telles que les multiples Tâj namak ou « Livre des couronnes », commencèrent à circuler, narrés par les conteurs ambulants ou sous forme de contes pour enfants. C’est pourquoi Ferdowsi le Tousssi, pur enfant du Khorâssân, connaissait, comme tous les habitants de cette région, les mythes de l’Iran préislamique.

Il est d’ailleurs intéressant de souligner ici le rôle des vieilles familles patriciennes de propriétaires terriens, les « dehghâns », d’où était issu Ferdowsi, dans la préservation du patrimoine littéraire et culturel persan. En effet, lors des premiers siècles de l’histoire de l’Iran islamique, à l’époque où la politique d’arabisation des Ajams ou adorateurs de feu qu’étaient les Iraniens au regard des Arabes était appliquée par les califes avec la plus grande rigueur, ce furent ces familles qui, beaucoup plus que les rois, furent les mécènes des artistes persans et les protecteurs du patrimoine culturel iranien.
L’autre importance qu’eût le statut familial de Ferdowsi dans la rédaction de son livre fut l’aspect financier. En tant que propriétaire, Ferdowsi vécut et travailla son ouvrage magistral sur ses terres sans être inquiété par la nécessité d’avoir un emploi. Il est vrai que trente-cinq après le commencement de la rédaction du Livre des Rois, le poète n’était plus qu’un octogénaire fatigué et appauvri, ayant perdu ses terres, sa fortune engloutie par son œuvre, qui cherchait un mécène.
C’est vraisemblablement dès avant la mort de Daghighi, son prédécesseur dans la rédaction du Shâhnâmeh, que Ferdowsi a commencé à versifier les mythes anciens. Semblable en cela en la plupart des poètes du Xème siècle, Daghighi est un poète très peu connu. La plupart des auteurs de cette période ne sont connus qu’à travers les œuvres des autres écrivains ou de par quelques rares vers qui nous sont parvenus à travers les anthologies. De Daghighi, l’on sait qu’il fut poète lyrique, qu’il vécut à la cour des Ghaznavides et qu’il était très talentueux, au point d’en être célèbre dans cette cour pourtant si riche en poètes. Grâce à son talent, Daghighi était capable de manier tous les genres et de jongler avec tous les styles. C’est pourquoi, quand en poète Khorassani, il décida comme tant d’autres avant lui, de mettre en vers les mythes de la Perse, il put, comme il l’avait fait en tant qu’auteur lyrique, impressionner en tant que poète épique dans son Gashtasbnâmeh. Mais Daghighi avait un mauvais caractère, querelleur et belliqueux. Ses contemporains poètes ont préféré garder le silence à ce sujet ou se sont cantonné à y faire allusion. Ferdowsi dit de lui que, malgré sa jeunesse, ses dons et son talent, il avait le mal en lui et que c’est de par sa propre faute qu’il perdit la vie. En effet, Daghighi mourut jeune, tué par son esclave, alors qu’il avait à peine rédigé cinq cents distiques de son Gashtasbnâmeh.
C’est probablement la mort de Daghighi, qui n’avait qu’à peine eu le temps d’entreprendre sa compilation des mythes de l’Iran antique, qui provoqua chez Ferdowsi le désir de continuer cette compilation. D’après les divers recoupements, on a estimé que le travail de la rédaction du Shâhnâmeh fut définitivement entamée entre les années 980 et 982, à une époque très troublée par les dissensions qui opposaient les trois héritiers du gouverneur de Khorâssân, et les escarmouches ravageuses qui opposaient les armées du roi samanide à celle du roi bouyide, que Ferdowsi évoque dans son ouvrage. Autre indice, Ferdowsi fait également état d’une famine violente l’année où il termina la version première du Livre des Rois ; d’après un historien du XIIème siècle, Attabi, cette famine sévit de 992 à 994, ce qui correspond à la date déterminée par les chercheurs.
D’après les recherches des biographes, à ce moment là, Ferdowsi avait déjà exercé sa plume à versifier quelques unes des légendes anciennes.
Parmi les divers travaux d’écriture que Ferdowsi avait déjà amorcés quand il commença la rédaction du Shâhnâmeh, l’on peut citer la légende de « Bijane et des sangliers », également connue sous le nom de « Bijane et Manijeh ». Cette légende, qui forme l’un des chapitres du Livre des Rois, a été très visiblement écrite par un Ferdowsi à la plume encore inexpérimentée, un Ferdowsi qui n’a pas encore trouvé sa vitesse de croisière et son style particulier, précis et puissant, c’est-à-dire par Ferdowsi jeune, quelques années avant qu’il ne se lance de façon sérieuse dans la rédaction de son œuvre. La légende de « Bijane et les sangliers » est donc le premier chapitre rédigé du Livre des Rois. D’ailleurs, cette légende était visiblement très connue au Xème siècle car de nombreux auteurs l’ont cité dans leurs ouvrages. On peut mentionner les vers de Manoutchehri, qui compare la nuit à la chevelure de Manijeh et au puits de Bijane, ainsi que quelques uns des vers de Ferdowsi lui-même, qui prouvent que cette légende inspirait à l’époque non seulement les gens de lettres, mais également et beaucoup plus les architectes, les décorateurs et les graveurs.
Quand il commença sa « compilation », Ferdowsi ne possédait pas encore le manuscrit du Gashtasbnâmeh. En effet, Daghighi venait à peine de mourir et son ouvrage inachevé n’avait pas encore été copié pour le public. C’était un vrai désagrément pour Ferdowsi car il avait besoin de cet ouvrage en tant que référence. Son rythme de travail risquait de se ralentir lorsqu’un ami bienfaiteur lui fit don du manuscrit du Shâhnâmeh d’Abou-Mansouri, le plus vieux des Shâhnâmeh en prose connu à ce jour.
Ce Shâhnâmeh ainsi que celui d’Aleman furent les deux principaux ouvrages de référence de Ferdowsi dans la mesure où le maître se servit de références écrites. Car contrairement à ce que les chercheurs ont longtemps cru, de nombreux chapitres du Shâhnâmeh ne trouvent pas leur source dans les deux ouvrages de référence cités plus haut. De fait, ces chapitres faisaient partie des contes et des légendes qui circulaient librement dans la société du Khorâssân et qui étaient connus par tous.

Ainsi, Ferdowsi raconte dans l’un de ces chapitres qu’une nuit, l’inspiration lui manquant, son épouse, le voyant troublé et énervé, lui prépara une collation qu’elle lui servit tout en lui narrant en pahlavi l’une de ces légendes. Cette légende fut la référence principale du chapitre de Rostam et Esfandyâr. Il est intéressant de noter que Ferdowsi précise que la légende lui fut contée dans la langue pahlavi. Comme nous l’avons précisé plus haut, c’est avant d’avoir accès au manuscrit du Livre des Rois d’Abou-Mansouri que Ferdowsi commença à mettre en vers certaines légendes de l’ancienne Perse. C’est pourquoi, il n’avança pas dans l’ordre classique. Il préféra choisir les épisodes légendaires selon ses propres goûts et selon le plan général qu’il avait pour son Livre des Rois. C’est donc après avoir rédigé le livre dans son intégralité qu’il le remania entièrement et plaça les épisodes selon son propre flair littéraire, tout en les reliant ensemble par des vers de « connexion ». De plus, la comparaison du Livre des Rois de Ferdowsi avec l’Histoire des rois perses, ouvrage qui est quasiment une traduction du Livre des Rois d’Abou-Mansouri montre parfaitement que de nombreux chapitres du Shâhnâmeh de Ferdowsi, tels les épisodes de « Bijane et Manijeh », « Rostam et Sohrâb » ou « Rostam et le démon Akvane » n’ont pas été inspirés par le Shâh-Nâmeh d’Abou-Mansouri mais plutôt par le Azad sar, recueil préislamique iranien de légendes à l’auteur inconnu.
Lorsque Ferdowsi débuta la rédaction du Livre des Rois, il se plaça très probablement sous la protection d’un seigneur de la région de Touss, dont on ne connaît pas le patronyme et il serait par trop inexact de s’en tenir à des estimations approximatives. Cet homme, qui disparut de façon mystérieuse quelques années plus tard, éprouvait, selon le Livre des Rois, énormément de respect pour Ferdowsi qu’il traitait avec les plus grands égards et Ferdowsi avoue que les encouragements de ce seigneur lui furent précieux dans la continuation de son travail.
Quelques années plus tard, ce fut Hossein Ghotaybeh, l’envoyé du calife à Touss, qui devint le mécène de Ferdowsi.
Il y également deux des grands de Touss et de Bâj qui le soutinrent financièrement lors de la rédaction du Shâhnâmeh et Ferdowsi fait également état d’eux dans son Livre des Rois. Mais leur nom n’est pas lisible et change d’un manuscrit à l’autre. C’est pourquoi ils sont toujours anonymes et il ne reste d’autre choix que de faire des suppositions au sujet de leur identité.
Après avoir entamé la rédaction de son ouvrage, le Maître de Touss chercha un seigneur digne de ce nom pour lui dédicacer son livre phénoménal. Des seigneurs de la région, aux yeux de Ferdowsi, aucun ne méritait de se voir dédicacer le Shâhnâmeh et il chercha longtemps un grand roi pour lui offrir son livre.
D’autre part, l’on sait qu’une version première du Shâhnâmeh a été rédigée par Ferdowsi et terminé en 994, c’est-à-dire quatorze ans après avoir commencé son travail. Cette version ne fut dédiée à personne mais elle est devint célèbre dans les siècles suivants et c’est cette version qui a été traduite en arabe par Albandâri. Elle est cependant beaucoup moins complète que les deux versions principales.
En réalité, de nombreux manuscrits du Shâhnâmeh furent copiés du vivant de Ferdowsi, alors qu’il travaillait encore sur ce livre. C’est pourquoi les manuscrits existants ont chacun des versions propres et uniques.
Grâce aux multiples copies qui se firent du Shâhnâmeh du vivant de Ferdowsi, ce dernier, déjà auparavant reconnu comme grand lettré, devint de plus en plus célèbre. C’est ainsi que sa célébrité grandissante dépassa même les murs du palais du roi Mahmoud le Ghaznavide, le seul qui fut jugé digne par Ferdowsi de se voir dédicacer le Livre des Rois. Il est vrai que le Maître de Touss regretta très vite sa décision, étant donné les conséquences assez désastreuses qui en découlèrent pour lui.
C’est soit par l’intermédiaire de Nasr ben Nasser-e-Din Saboktakin, le frère du roi, soit par celui du ministre Abol Abbâs Fazl ben Ahmad, que les deux grands, le roi et le poète, se rencontrèrent en l’an 1003 ou 1004. C’est à cette époque que Ferdowsi décida de réviser son œuvre et d’y louer le roi ghaznavide, pour ainsi pouvoir échapper à sa pauvreté qui commençait sérieusement à se transformer en misère. En effet, trente ans après avoir débuté la rédaction du Livre des Rois, il ne restait à Ferdowsi qu’une petite partie de son héritage de patricien. Il s’en plaint d’ailleurs avec fierté vers la fin de son œuvre, quand il précise qu’après trente ans, il ne lui reste ni jeunesse, ni grâce, ni vigueur et surtout, ni argent. Quand le poète et le roi se rencontrèrent pour la première fois, la réputation de ce nouveau Livre des Rois avait déjà dépassé les frontières de la région et les grands et les savants se faisaient copier des manuscrits de ce monument littéraire, mais personne parmi eux ne s’avisait d’aider financièrement le vieux gentilhomme de Touss. Cette mauvaise fortune obligea donc Ferdowsi à dédier son livre à Mahmoud le Ghaznavide, à qui pourtant il était en tout point opposé. Le poète avait alors soixante-cinq ou soixante-sept ans.
Il est plus probable que l’intermédiaire entre le roi et le poète ait été Abol Abbâs Fazl ben Ahmad Esfareyeni, le vizir du roi, ainsi que quelques uns des vers du début de l’histoire de « Keykhosrow et Afrassiâb » nous le font penser. On peut déduire de ces vers que le ministre de Mahmoud était un homme cultivé et un grand lettré, amateur de littérature persane et protecteur et mécène de ce qu’il considérait dès cette époque comme le seul patrimoine purement persan qui pourrait rester et être préservé tout au long des siècles troublés que traversait l’Iran.
Dans le Shâhnâmeh, Ferdowsi a essayé dans la mesure du possible de rester fidèle aux légendes manuscrites ou orales qui existaient en grand nombre dans cette région de l’Iran, préservées avec chauvinisme par les Persans restés fidèles à leurs traditions par esprit de contradiction avec les Arabes. Mais cette fidélité ne signifie pas que Ferdowsi avait simplement été un compilateur : tout en respectant la trame originale du récit, le maître donne libre cours à sa puissance narrative pour faire du Livre des Rois un monument épique unique au monde.
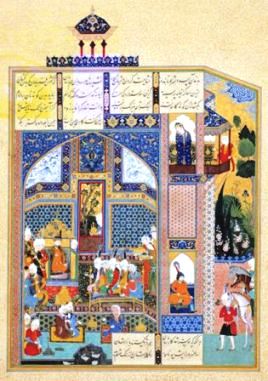
Comme avant lui Homère et comme des siècles plus tard Balzac et Hugo, Ferdowsi est le maître de la description. Il fait quasiment vivre les personnages antiques sous le regard enchanté du lecteur. C’est pourquoi son chef d’œuvre est toujours aussi moderne. Nous vivons la vie de Rostam, nous partageons les peines et les angoisses de ce héros humain, qui contrairement aux héros surhommes de Homère, est un homme comme les autres, qui se trompe, qui a parfois mal, souvent besoin d’aide ; un homme faible et orgueilleux comme tant d’autres, qui vit les mêmes joies et peines.
Ferdowsi décrit les personnages, les champs de batailles, les beuveries et autres orgies, les palais, les forêts et les démons avec une vivacité qui fait les délices du lecteur moderne. C’est surtout dans la description des scènes de bataille qu’il atteint l’apogée de son pouvoir narratif incroyable.
Dans le Livre des Rois, de même que dans toutes les œuvres épiques, le lecteur se voit confronté à des sentiments de patriotisme et de fierté nationale, ainsi qu’à des exagérations délicieuses et littéralement incroyables, des événements inattendus et logiquement impossibles, et parfois à l’amour du héros. Les histoires d’amour du Livre des Rois donnent un charme tout particulier à ce livre.
Ferdowsi commence d’habitude ses chapitres avec un prêche à caractère moral. Ainsi, il prologue ses chapitres en incitant le lecteur à prendre leçon de ce qu’il va lire et à en tirer une morale efficace dans sa propre vie. Et tout en narrant les histoires conformément à la trame traditionnelle de l’intrigue, il ne se prive pas d’orner le récit par des rajouts stylistiques qui font tout le charme de l’histoire. C’est pourquoi l’importance du talent de conteur qu’est celui de Ferdowsi doit être absolument prise en compte lors de la lecture de son Livre des Rois.
On peut également suivre la trace du poète dans son œuvre quand il parle de lui-même ou des personnages réels qu’il a connus ou qui lui sont liés d’une manière ou d’une autre. Ici aussi, ses descriptions sont puissantes et vivaces, dix siècles plus tard, nous avons l’impression d’avoir affaire à des contemporains, vivant sous nos yeux.
Quant au style de Ferdowsi en soi, il est très difficile d’en parler. On peut simplement dire que Ferdowsi est, comme Saadi, le maître incontesté de la simplicité et comme Saadi, ce qu’il écrit est facile à lire mais impossible à imiter, ainsi que le prouvent plusieurs centaines de tentatives d’imitation. Le style de Ferdowsi est limpide, clair, sans préciosité langagière, tout cela sans pour autant éviter les figures stylistiques. Mais il le fait avec tant de raffinement et tant de précision que le lecteur ne garde de sa lecture que l’impression d’une chute vraie dans le temps et d’une participation quasi personnelle à une bataille antique pour ne pas dire préhistorique. Même lors de l’usage de figures stylistiques, usage beaucoup plus fréquent qu’on ne le l’imagine à la simple lecture du texte, Ferdowsi préserve sa parole souple, bien faite et simple.
Ses comparaisons et métaphores portent bien la marque de leur temps. En effet, à l’époque des Samanides et au début du règne des Ghaznavides, la poésie persane possédait une fraîcheur et une simplicité qu’elle perdit au fil des siècles. Le langage de Ferdowsi est aussi imaginatif, haut en couleur, simple, et efficace dans sa simplicité que celui de la plupart des poètes de son époque.
Malgré ses connaissances étendues dans les sciences de son époque, il utilise rarement des termes scientifiques ou philosophiques. Ce n’est que dans des contextes particuliers, par exemple lorsqu’il veut disserter sur Dieu, ou l’infini ou épiloguer un chapitre de façon à en tirer des conclusions moralisantes, qu’il use de ce genre de termes. Et même dans ce cas, l’utilisation de termes savants se fait de manière très simple, sans appuyer et sans entrer dans des dissertations.
Le Livre des Rois est l’une des sources les plus importantes aujourd’hui disponibles des anciens mots persans. Car sans ce livre, le persan, à l’époque parfaitement dominé par l’arabe, aurait disparu, comme les langues des autres pays conquis par les Arabes musulmans qui se sont en grande majorité arabisés.
Les phrases et les expressions du Shâhnâmeh sont en général simples et sans aucune ambigüité. Les noms du Shâhnâmeh sont tous utilisés de manière conforme à la plus stricte des rhétoriques et, judicieusement placés, ils donnent à l’ensemble un maximum de beauté. C’est le langage utilisé par Ferdowsi dans cette œuvre, tenant à utiliser dans la mesure du possible du plus pur persan, qui a permis la préservation de centaines de mots de la langue persane qui, même s’ils n’ont guère été utilisés par la suite par les écrivains et poètes, ont ainsi échappé à la disparition. Cela ne veut bien sûr pas dire que Ferdowsi n’a absolument pas utilisé des mots arabes. En effet, même si la plupart des mots du Livre des rois sont en pur persan, l’on rencontre quand même un certain nombre de mots arabes. Ces derniers sont pour la plupart simples et étaient -et le sont toujours- communément utilisés par les Persans. C’est pourquoi, on les rencontre également dans les ouvrages de poésie des contemporains ou même des proches prédécesseurs du Maître. Quant aux mots arabes inusités à l’époque, ils sont quasi inexistants et dans les rares cas où le poète les a choisis, il s’est souvent trompé dans leur usage.
Dans l’histoire d’Alexandre, conté dans le Livre des Rois, la présence des mots arabes est beaucoup plus palpable. Il y a dans cet épisode beaucoup plus de mots arabes que dans le reste des histoires de l’ouvrage. La raison en est que la référence principale du maître de Touss pour ce chapitre fut la traduction arabe du Livre d’Alexandre, qui avait été originellement un texte grec et qui avait été ensuite traduit en pahlavi, syriaque et arabe et finalement, de l’arabe, avait été retraduit en persan.

L’examen du Livre des Rois met en évidence le fait que la persistance et l’obstination de Ferdowsi à utiliser des mots persans, ne sont pas le résultat d’un chauvinisme exacerbé par les exactions des califes arabes. Le Maître de Touss n’a fait qu’user de la langue ordinaire alors en vigueur dans le Khorâssan. En effet, le Khorâssân, – aujourd’hui la Transoxiane-, était loin du centre du califat, où la langue arabe régnait en maître, c’est pourquoi les habitants de cette région ont continué pendant très longtemps à parler un persan proche du persan préislamique. De plus, Ferdowsi était assez influencé dans son langage poétique par les œuvres de référence dont il se servait et qui étaient pour la plupart, soit en pahlavi, soit en persan traduit du pahlavi. C’est donc pour cette raison que le chapitre d’Alexandre, où Ferdowsi a utilisé une référence en langue arabe, est rédigé dans un langage plus « arabisé ».
Quant à ce qui est des idées personnelles de Ferdowsi, nous les rencontrons souvent au cours de la lecture du Shâhnâmeh. Il arrive souvent à l’auteur d’argumenter sur des notions philosophiques. Pourtant, Ferdowsi attaque parfois violemment les philosophes qu’il considère bavards et incapables de montrer une voie bonne à suivre.
Chaque fois qu’il l’a jugé nécessaire, Ferdowsi moralise et tente de montrer la voie la plus juste et la plus sage. Il est en la matière l’un des plus grands auteurs moralisateurs. Certains de ses conseils font partie de la structure de l’histoire qu’il conte, tels ceux que donne le sage Bozorgmehr, sage qui revient de façon récurrente dans le Livre des Rois. Quant aux conseils et prêches qui ne faisaient pas originellement partie de la structure du conte et qui ont été rajoutés par Ferdowsi, ils sont souvent placés à la fin de l’épisode, qui conte dans la plupart des cas la mort d’un héros ou d’un roi.
La première chose qui frappait Ferdowsi quand il mettait en scène la mort d’un de ses personnages était l’infidélité et l’inconstance du monde. Mais pour lui, cette inconstance de la vie ne doit pas mener au désespoir, au contraire, il faut tenter de bien vivre, de vivre sagement et d’être bon.
Etant donné l’influence et l’impact énorme du Livre des Rois sur l’ensemble de la population persanophone mondiale, et ce depuis l’existence de cet ouvrage magistral, la généralisation de sa lecture par toutes les catégories sociales et l’importance simplement littéraire de cette œuvre, après Ferdowsi, de nombreux poètes tentèrent de créer de pareilles œuvres épiques, contant l’histoire, les mythes, les légendes et les épisodes religieux de l’Iran, mais aucune de ces œuvres n’eut le succès du Shâhnâmeh, aucun poète ne réussissant à égaler son auteur de génie.

L’influence du Shâhnâmeh ne se limita pas au seul territoire persanophone et très vite, ce livre fut traduit en d’autres langues par des étrangers influencés par sa beauté et sa puissance narrative. La première traduction de cette œuvre est celle de Ghavâmeddin Albandâri al Esfahâni qui le traduisit en vingt et un ans, de 1223 à 1244, sur l’ordre de l’émir de Damas. Cette traduction fut faite d’après le manuscrit original du Livre des Rois. Une autre traduction fut effectuée deux siècles plus tard, en turc, par Ali Afandi. Des traductions intégrales ou partielles du Livre des Rois de Ferdowsi sont également disponibles en arménien, géorgien, gujrati, anglais, français, allemand, russe, espagnol, italien, danois, latin, polonais, magyar, suédois, etc.
Parmi ces traductions, la plus importante est celle de Schack en allemand et celle de Jules Mohl en français. Il y a également une traduction versifiée allemande de l’histoire de Rostam et Sohrâb, faite par Friedrich Rückert. Il y a de même une traduction anglaise de cette même histoire, par Atkinson, en vers, et une traduction intégrale du Livre des Rois en vers par l’italien Pazzi, de même qu’une traduction versifiée de l’histoire de Rostam et Sohrâb en russe par Joukovski. Les orientalistes ont fait beaucoup de recherches au sujet du Livre des Rois. On pourrait notamment citer le travail de Jules Mohl dans son introduction au Livre des Rois ainsi que celui de Nِldeke en allemand dans son Das Iranische Nationalepos, qu’il publia en 1920.
Aujourd’hui, plus de mille ans après la rédaction du Shâhnâmeh de Ferdowsi, ce livre épique aux trésors inépuisables n’a pas fini d’intéresser les chercheurs et les mythologistes de tous horizons. En effet, au delà d’un ouvrage littéraire monumental, cet ouvrage est la compilation de légendes et de mythes souvent plus anciens que l’histoire et qui partagent de nombreux traits communs avec ceux de toutes les autres civilisations. A ce titre, ils intéressent de nombreux chercheurs. Cependant, il est aujourd’hui évident que les recherches concernant le Shâhnâmeh n’ont fait que commencer et que de nombreux aspects et dimensions de ce livre sont encore à découvrir.
Arefeh Hedjazi pour la Revue de Téhéran
00:05 Publié dans Traditions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : perse, iran, tradition, histoire, littérature, littérature perse, lettres, lettres perses |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Sebastiano CAPUTO:
Hu Jintao: “Nous n’adopterons aucun modèle de démocratie occidentale!”
Les défis majeurs du nouveau président Xi Jinping seront la lutte contre la corruption et les réformes relatives à la redistribution des richesses
Hu a défendu son idée de “développement scientifique”, c’est-à-dire une idée qui vise l’équilibre entre progrès économique illimité et souci de la pauvreté
Le 8 novembre 2012, lors de son discours d’ouverture pour le dix-huitième congrès national du parti communiste chinois, le secrétaire général, qui est aussi le président sortant, Hu Jintao, a parlé pendant plus de 90 minutes pour proposer une nouvelle fois les politiques qu’il avait suggérées pendant les dix ans de son “règne”; il lançait simultanément un avertissement à son successeur Xi Jinping. Devant près de trois mille délégués chinois élus aux niveaux municipaux, provinciaux et régionaux, réunis dans la “grande salle du peuple” à Pékin (Beijing) sur la Place Tienanmen, Hu a défendu son idée de “développement scientifique”, c’est-à-dire une idée qui vise l’équilibre entre un progrès économique illimité et l’attention qu’il convient d’apporter à la pauvreté, à l’écologie, à l’augmentation de la richesse, qui se conjugue à des rythmes différents dans les villes et dans les campagnes. “Nous devons viser plus haut et travailler plus durement encore pour pouvoir poursuivre notre développement de manière scientifique, c’est-à-dire en promouvant l’harmonie sociale et en améliorant la vie des gens”, a affirmé le président sortant qui, en mars 2013, cèdera officiellement le pouvoir à Xi Jinping. “La Chine restera au stade premier du socialisme”, a-t-il ajouté sur le ton de l’avertissement, “et devra viser une modernisation socialiste avec pour objectif au terme de l’année 2020 de doubler les revenus pro capita de la population urbaine et rurale par rapport aux chiffres de l’année 2010. Il faudra aussi veiller à augmenter la demande intérieure dans le but de parfaire une stratégie cherchant à diversifier notre économie jusqu’ici axée principalement sur l’exportation, afin d’en arriver à une économie modérément prospère en 2020”.
“La perspective scientifique pour le développement” est donc la formule que Hu Jintao a répété à plusieurs reprises lors de son discours d’adieu. Cette perspective cherche ainsi à promouvoir l’objectif d’un développement équilibré et durable, perspective qui devra guider le parti communiste chinois dans les années à venir. En se référant encore et toujours aux idées de ses prédécesseurs Mao Zedong, Deng Xiaoping et Jiang Zemin, le chef de l’Etat chinois a très nettement exclu, pour l’Empire du Milieu, toute adoption d’un modèle de “démocratie à l’occidentale”, en valorisant clairement, comme il y a trente ans, l’idéal d’un “socialisme à caractère chinois”. Tout en recherchant un “développement pacifique”, Hu a toutefois ajouté que, dans le futur, “il faudra moderniser l’armée pour se préparer à la sauvegarde résolue des droits maritimes de la Chine qui”, selon lui, “doit devenir une puissance toujours plus maritime”. Hu faisait bien entendu référence au contentieux diplomatique récent avec le Japon à propos des îles Senkaku/Diaoyu. Enfin, le leader communiste a abordé plusieurs fois le problème de la corruption, qui affecte certains membres de l’aréopage, un mal endémique qui, s’il n’est pas éradiqué, provoquera la chute du pays. De fait, Hu a promis une politique de la “main de fer” même s’il revendique, conjointement à son dauphin Wen Jiabao, des résultats fort probants en matière de lutte contre la corruption: leur équipe a justement dénoncé près de 640.000 cas de corruption en un an! Dans cette masse, seuls 24.000 coupables ont été traduits devant les tribunaux. Le discours de Hu était assorti de menaces: “celui qui violera la loi sera poursuivi, qui qu’il soit, et quel que soit le niveau de pouvoir ou le rôle officiel qu’il aura tenu”. Toutefois la lutte contre la corruption demeurera le défi le plus important pour Xi Jinping, surnommé le “petit prince rouge” (parce qu’il a été “recommandé”, étant le fils de Xi Zhong Xun, figure mythique de la “longue marche” et fondateur du parti communiste chinois). Il est donc un successeur qui apparaît aux yeux des trois mille délégués réunis pour le congrès de Pékin (Beijing) comme la personnalité médiatrice qu’il faut pour unir les multiples factions qui cohabitent au sein du parti, comme le “Clan de Shanghaï”, la coalition dite de “Tuanpai”, les “réformistes” et l’armée. Issu de l’université de Tsinghua,véritable Mecque de l’élite politique chinoise, où ont été formés la plupart des hauts dirigeants du pays, y compris le président sortant Hu Jintao, Xi Jinping a reçu plusieurs postes dans l’administration politique, économique et militaire au cours de ces cinq dernières années. Mais, au-delà de la lutte contre la corruption, le défi le plus important à relever, et qui attend le nouveau chef de l’Etat chinois, est sans nul doute la réforme à parfaire dans le domaine de la redistribution des richesses du pays dans les strates les plus pauvres de la population, ce qui implique d’améliorer les modes d’assistance sociale par l’Etat et d’augmenter les salaires.
Sebastiano CAPUTO.
( sebastianocaputo@hotmail.it ; article issu de “Rinascita”, Rome, 10 novembre 2012; http://rinascita.eu/ ).
00:02 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, politique internationale, hu jintao, chine, asie, affaires asiatiques, extrême orient |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

In corso di stampa: l’inizio della distribuzione è previsto per il 29 novembre
La rinascita della geopolitica sembra aver soppiantato negli ultimi decenni le analisi tipiche delle Relazioni Internazionali riguardo alla identificazione dei futuri scenari globali. Tuttavia, a fronte del successo mediatico di tale disciplina, scarsi risultano essere le riflessioni teoriche a suo sostegno. Manca infatti ancora una valida teoria della geopolitica. Tale carenza sembra essere dovuta alla sua caratteristica di disciplina limite tra impostazione operativa e approccio speculativo.
Focus
Che cos’è la geopolitica?
La geopolitica è una scienza dotata d’una propria e precisa metodologia. Essa si può definire come lo studio delle relazioni politiche tra poteri statali, intra-statali e trans-statali a partire dai criteri geografici. Tali criteri sono non solo quelli della geografia fisica, ma anche identitaria (etnica e religiosa) e delle risorse. La nuova scuola francese di geopolitica, inaugurata da Thual nei primi anni ’90, rifiuta qualsiasi ideologizzazione, semplificazione e riduzionismo della storia. Sfortunatamente, il termine “geopolitica”, dopo essere stato a lungo rigettato, è ora diventato di moda al punto che giornalisti che si occupano di affari internazionali sono spesso definiti dai media come “geopolitici”, pur non praticando affatto la materia. Il termine è stato assimilato dall’ideologia dominante ma svuotato di contenuto.
Quarantatre teorie e concetti per un modello geopolitico
Lo studio della geopolitica classica richiede un modello che ne raccolga gli assunti, i concetti e le teorie, selezionandoli e inquadrandoli rispetto a una ben precisa definizione. Definita la geopolitica come lo studio dell’impatto di certe caratteristiche geografiche sul comportamento degli Stati, s’individuano almeno 43 teorie o concetti che possono appartenere al modello della geopolitica classica. Tra essi ve ne sono alcuni connessi alla dicotomia centro-periferia, altri all’idea del perno, altri ancora al ruolo di confini e frontiere o alla nozione di spazio. Quest’articolo vuol essere un primo passo per elevare la geopolitica a metodo di studio delle relazioni internazionali.
A cosa serve la geopolitica? Alcune lezioni dal caso turco
La geopolitica non serve a esprimere l’interesse nazionale e le percezioni spaziali dei popoli, bensì a formulare scenari. V’è la geopolitica degli analisti, che indica vincoli e opportunità ai decisori; la geopolitica dei critici, che decostruisce questi scenari; e la geopolitica delle relazioni internazionali. La geopolitica può infatti inserirsi come paradigma nelle relazioni internazionali, avendo i suoi tratti distintivi nell’impostazione globale e nell’attenzione per i processi di controllo e gestione dello spazio. Il caso della Turchia offre alcuni esempi e lezioni.
Spunti di riflessione su geopolitica e metodo: storia, analisi, giudizio
La geopolitica conosce un successo straordinario nel linguaggio giornalistico e sempre più si va diffondendo anche in ambito accademico, pur non avendo una chiara definizione disciplinare. Questo saggio si propone di discutere i presupposti per una fondazione scientifica della geopolitica, tentando di unire all’interno dello stesso problema di ricerca la storia della disciplina, l’analisi dei casi concreti e il giudizio su di essi. La geopolitica sarà scientifica solo se saprà risvegliarsi alla migliore tradizione della sua origine di pensiero, cioè come critica della frammentazione del sapere e della separazione tra scienza e politica.
Itinerario d’un geopolitico del XX secolo
Il brano seguente è tratto dall’opera La passion des autres. Itinéraire d’un géopoliticien du XX siècle. Conversation avec Emile Chapuis, pubblicata da CNRS Editions di Parigi nei primi mesi del 2011. François Thual, tra i più importanti studiosi di geopolitica viventi, vi ripercorre la propria carriera, sintetizza i propri studi e riflessioni, formula previsioni per il futuro. La parte qui presentata si riferisce all’introduzione ed alle conclusioni del libro, dove discute la sua concezione della geopolitica, lo scopo e i limiti del modello geopolitico, la natura della guerra.
Intervista a Carlo Jean
Intervista a cura di Daniele Scalea, segretario scientifico dell’IsAG e condirettore di “Geopolitica”. Il generale Jean discute di definizione e finalità della geopolitica, e suo stato in Italia. La presente intervista è stata realizzata il 6 luglio 2012.
Geografia, geopolitica e Heartland: la politica estera britannica e l’eredità di Sir Halford Mackinder
H.J. Mackinder sviluppò, unendo la prospettiva geografica di lungo periodo a quella strategico-militare, una visione delle relazioni internazionali concettualizzata nella teoria dell’Heartland. Il presente articolo mira a riepilogare l’esposizione di tale teoria che diede prima nel 1904 e poi nel 1919, e analizzare l’operato di Mackinder quando per la prima e unica volta nella sua vita si trovò in condizione d’influire concretamente sulla politica estera britannica, in qualità di alto commissario in Russia Meridionale durante la guerra civile. Infine, si valuta quanto la teoria dell’Heartland sia ancora rilevante nella situazione geopolitica odierna.
Il percorso di un geopolitologo tedesco: Karl Haushofer
Il testo che segue, realizzato come recensione del primo dei due sostanziosi volumi che il professor Hans-Adolf Jacobsen ha dedicato a Karl Haushofer, si concentra sul periodo in cui si forma la visione geopolitica dell’autore tedesco. Si ripercorrono dunque il suo periodo in Giappone, l’esperienza di combattimento nella Prima Guerra Mondiale, e l’elaborazione delle prime teorie geopolitiche negli anni ’20, incentrate principalmente sulla zona del Pacifico. La conclusione è che la geopolitica tedesca di Haushofer prese avvio prima dell’avvento del nazismo e come cambiamento nazional-rivoluzionario più o meno russofilo.
Lev Gumilëv e la geopolitica contemporanea
La teoria etnologica e le ricerche storiche dello studioso russo Lev Gumilëv (1912-1992) hanno esercitato una grande influenza sulle dottrine geopolitiche in molti Paesi dell’ex Unione Sovietica. L’articolo esamina in dettaglio
il pensiero di questo Autore, proponendone una specifica interpretazione complessiva per poi passare in rassegna le letture che ne hanno dato numerosi intellettuali e politici contemporanei: dagli esponenti della cosiddetta etnogeopolitica russa all’eurasismo kazako, dalla proiezione geostrategica di un ex Generale dell’esercito russo alle riflessioni dell’ex Presidente del Kirghizistan Askar Akaev. Ne emerge una ricezione estremamente differenziata, indicante che l’attualizzazione propriamente geopolitica del suo pensiero è frutto molto più della rielaborazione altrui che dei suoi contenuti intrinseci. Ciò malgrado, la sua eredità occupa un posto di rilievo nell’ambito della
storia della storiografia e del pensiero sociale.
Polvere, spade e pietre: la comparsa del pensiero geopolitico presso gli storici greci dell’età classica
Se la geopolitica è lo studio degli antagonismi tra poteri o dell’influenza sui territori – tali antagonismi sono indotti non soltanto da interpretazioni oggettive degli attori ma anche soggettive – allora la geopolitica è antica. Poiché gli antagonismi tra poteri sono propri delle società umane, i pensatori della loro epoca hanno cominciato molto presto a commentare, riportare, spiegare e interpretare questi conflitti. Nella Grecia di allora gli storici viaggiarono, insegnarono, combatterono, pensarono e rifletterono su questioni geopolitiche con formulazioni che soddisfacevano criteri molto diversi ma che fornivano tutte delle risposte, in parte, in un contesto generale. Di conseguenza, molti concetti geopolitici classici fecero la loro comparsa in Europa per la prima volta.
L’interpretazione geopolitica del continuum spazio-temporale nell’ambito delle scienze storiche
Quando nasce la comprensione propriamente geopolitica dei rapporti fra gli Stati? In questa breve riflessione teorica si propende per una risposta duplice. Da un lato, le relazioni fra i popoli e fra gli Stati hanno avuto sin dall’Antichità un carattere «oggettivamente» geopolitico per via dell’influenza che in forme diverse lo spazio geografico ha sempre esercitato sulla storia. Dall’altro lato, una coscienza geopolitica dello Stato, intesa come rappresentazione di sé e dei propri interessi in relazione allo spazio, è un fenomeno sostanzialmente moderno. Sebbene l’antagonismo fra Roma e Cartagine costituisca forse il primo esempio di coscienza geopolitica da parte di un’entità politica, soltanto con le riflessioni degli ultimi secoli la geopolitica ha assunto una fisionomia specifica come disciplina e come orientamento programmatico delle classi dirigenti.
La geopolitica contemporanea e i problemi globali di un mondo in cambiamento
La geopolitica, disciplina che per definizione studia i processi di lunga durata, non può esimersi dall’affrontare uno dei più difficili problemi del mondo contemporaneo: il divario tra una disponibilità limitata di risorse e la tendenza globale a stili di vita insostenibili con essa. Il caso del petrolio, a rischio di esaurimento ma ancora determinante sia nelle economie sia nelle strategie geopolitiche dei diversi Stati, ne costituisce esempio emblematico. L’articolo sviluppa una riflessione generale sull’importanza di inserire questo problema tra le priorità dell’analisi geopolitica, insistendo su due punti: la comprensione che dietro il «villaggio globale» si celano irriducibili diversità identitarie ed enormi disparità di condizione fra fasce di popolazione; la necessità di concepire la geopolitica non nei termini di una corsa allo sviluppo per garantirsi un vantaggio a breve-medio termine sugli altri Paesi, bensì come strategia di lungo periodo che miri anche ad un equilibrio tra bisogni e risorse.
La Geopolitica dei Grandi spazi multidimensionali
A cavallo tra il secondo e il terzo millennio, nella geopolitica si è verificato un Rinascimento – un ritorno della geopolitica alla sua veste di scienza interdisciplinare analitica. Si avvertiva un urgente bisogno di sistemi analitici dotati di un moderno pensiero geopolitico. Senza la previsione geopolitica è impossibile immaginare il futuro di un Paese. Un buon statista è tenuto a conoscere il pensiero geopolitico. La geopolitica deve diventare una parte integrante della cultura generale. Ogni persona che ambisce ad un attivismo civile nella società dovrebbe avere delle nozioni di geopolitica. L’articolo descrive le principali posizioni della teoria geopolitica dei Grandi spazi multidimensionali, illustrata come “nuova geopolitica”.
Geoeconomia: un nuovo paradigma per lo studio della politica mondiale
La Geoeconomia è entrata nel dibattito scientifico e nella pratica mondiale per porre fine alle controversie del vecchio mondo della Pace di Vestfalia. L’attacco al sistema economico semifeudale si è svolto in maniera potente e
senza compromessi, da tre fronti contemporaneamente, ossia da tre scuole geoeconomiche con i propri pionieri: nordamericana (con M. Parmelle, E. Luttwak e altri), russa (E. Kočetov, A. Neklessa e altri) e italiana (C. Jean, P. Savona e altri). Animato da umanismo e nuove conoscenze, mira a costruire la pace. Per capire l’idea di questo potente paradigma umanitario, la geopolitica, bisogna osservare i principi fondamentali, le caratteristiche e i meccanismi della geoeconomia. Nell’articolo è esposto il senso di questa disciplina.
La dicotomia geopolitica terra-mare nell’epoca della globalizzazione
La scuola geopolitica classica, sia quella di matrice anglosassone sia quella “continentale”, si connotava per aver riprodotto la millenaria contrapposizione tra potenze talassiche e potenze telluriche. La disamina riassume le maggiori teorie geopolitiche del secolo scorso e analizza lo scenario internazionale contemporaneo alla luce della dualità geopolitica terra/mare e servendosi delle moderne teorie delle relazioni internazionali. S’intende pertanto, seguendo una metodologia comparativa, riconsiderare il ruolo della geopolitica classica nello studio delle relazioni interstatuali, svincolandolo dal determinismo tipico di un approccio meramente ambientale, onde arricchirlo attraverso l’apporto delle varie scienze ausiliarie e dei diversi fattori analitici.
Orizzonti
ATOM Project. L’impegno del Kazakhstan per un uso responsabile dell’energia nucleare nel mondo
Il fabbisogno energetico mondiale legato soprattutto alle prospettive di sviluppo delle nuove potenze mondiali contribuisce ad orientare l’interesse del mondo scientifico e tecnologico verso la diversificazione delle fonti energetiche, dando nuova linfa al dibattito sull’uso del nucleare per scopi civili. Ad oltre 25 anni dal mai dimenticato incidente nucleare di Černobyl’ ed a seguito dei recenti avvenimenti presso la centrale giapponese di Fukushima Dai-ichi del Marzo scorso, il tema della sicurezza nucleare si ripropone in modo prepotente a livello internazionale. Anche sul fronte del nucleare per scopi bellici il dibattito è sempre vibrante. Per quanto riguarda le iniziative volte a scongiurare la proliferazione nucleare nel mondo per scopi militari, senza dubbio meritevole di considerazione è il cosiddetto “ATOM Project”, nata con il supporto del Centro Nazarbayev per volontà dello stesso presidente kazaco.
La società postmoderna dei consumi e i valori estetici della cultura popolare
Il postmodernismo da tempo esercita una forte influenza sulla vita e la cultura cinese. La nuova cultura popolare di consumo sfida la produzione e circolazione della cultura elitaria. In Cina v’è una notevole differenza tra ricchi e poveri, cittadini e contadini. A Pechino e nelle città costiere la cultura di consumo è dominante, anche se l’80% della popolazione sta ancora modernizzando i suoi stili di vita. La cultura popolare è benvenuta dalla maggioranza della popolazione, che ne fruisce tramite i moderni mezzi di comunicazione. Pochi dei suoi prodotti diventeranno però opere d’arte canoniche degne d’essere riscoperte dai critici e ricercatori del futuro. Su questa base gl’intellettuali umanisti dovrebbero assumere un giusto atteggiamento verso la prevalenza della cultura popolare nella società consumista postmoderna. La versione italiana di quest’articolo è stata curata da Lavinia Benedetti (Università di Catania, ricercatrice) su incarico diretto dell’Autore.
“Primavera Araba” o “Risveglio Islamico”?
Negli ultimi 18 mesi, in Nordafrica e nel Vicino Oriente, sono accaduti alcuni eventi politici di cui sono state fornite differenti interpretazioni. Nell’articolo seguente si cercano di chiarire alcuni punti cruciali. Il primo è quello, non solo terminologico, della scorrettezza dell’appellativo “Primavera Araba”, frutto di un malinteso o d’una volontà di distorsione occidentale: quello in corso è in realtà un risveglio islamico Tale Risveglio Islamico è in relazione con la Rivoluzione Islamica dell’Iran, e da essa trae ispirazione, ma s’inserisce in un processo di più ampia portata sia geografica sia storica. Il suo effetto sarà la nascita d’una nuova civiltà islamica, improntata all’islamismo moderato e al rifiuto dell’occidentalizzazione.
Il problema del Kashmir: un confronto con lo Xinjiang e qualche possibile soluzione
L’India amministra oggi circa il 43% del Kashmir, ma il governo indiano su queste aree è contestato dal Pakistan, il quale controlla circa il 37% della regione, vale a dire l’Azad Kashmir e le zone settentrionali di Gilgit e Baltistan. Una piccola porzione di Kashmir è controllata infine dalla Cina. Nell’articolo si prendono in esame gli interessi geopolitici di India, Pakistan e Cina collegati alla regione del Jammu e Kashmir. Si effettua inoltre un confronto tra come l’India ha gestito la questione del Kashmir e come la Cina quella dello Xinjiang. Affinché si trovino pace e sicurezza in Kashmir, è necessario interrompere i sospetti tra le tre parti che da tempo condizionano le loro relazioni, così come sono necessari contemporaneamente una più ampia autonomia per il popolo del Kashmir.
I BRICS e la ricerca di un nuovo ordine mondiale
I BRICS incarnano la speranza di costruire un’alternativa al sistema di governance mondiale, nato dopo la Seconda Guerra Mondiale e guidato da USA, Europa e Giappone, ormai in crisi e screditato. Sono errati i moniti degli analisti occidentali, secondo cui l’alternativa all’unipolarismo sarebbe solo il caos, o che vedono nei BRICS la forza in grado di sorreggere la globalizzazione senza intaccare il predominio occidentale. È altresì vero che i BRICS non potranno rimpiazzare gli USA come egemone, dal momento che alla potenza economica non corrisponde una pari forza militare; né i BRICS potranno costruire una vera alternativa di governance mondiale finché non riusciranno a risolvere i loro squilibri interni e di gruppo.
Gli autori:
LUCA BIONDA Direttore Programma “Sistema Italia” dell’IsAG
AYMERIC CHAUPRADE Direttore di “Realpolitik.tv”, già professore di Geopolitica all’École de Guerre
ALEKSEJ G. ČERNYŠOV Professore di Politologia e preside della Facoltà di Tecnologie sociali (Università di Economia e Commercio di Mosca (RGTEU)
EMILE CHAPUIS Giornalista
DARIO CITATI Ricercatore associato e direttore del Programma “Eurasia” dell’IsAG, dottorando in Slavistica (Università La Sapienza di Roma)
ZORAWAR DAULET SINGH Ricercatore presso il Center for Policy Alternatives di Nuova Delhi
VLADIMIR A. DERGAČËV Doktor nauk in Scienze geografiche
EMIDIO DIODATO Professore associato in Scienze politiche (Università per Stranieri di Perugia)
TIBERIO GRAZIANI Presidente dell’IsAG, direttore di “Geopolitica”
VLADISLAV GULEVIČ Analista del Centro di Studi Conservatori, Università Statale di Mosca
CARLO JEAN Generale dell’Esercito Italiano, docente alla Link Campus University (Roma)
PHIL KELLY Docente di Scienze politiche (Emporia State University, Kansas, USA)
ERNEST G. KOČETOV Presidente dell’Accademia Pubblica di Scienze Geoeconomiche e Globalistiche
MEHDI LAZAR Ispettore del Ministero dell’Istruzione francese. Dottore in geografia presso l’Università Panthéon Sorbonne, laureato al Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques e all’Institut Français de Géopolitique.
MATTEO MARCONI Docente di Geografia politica ed economica (Università La Sapienza di Roma), direttore del Programma “Teoria geopolitica” dell’IsAG
WANG NING Professore di Letteratura comparata e direttore del Centro di Letterature comparate e studi culturali all’Università Tsinghua di Pechino, titolare della Cattedra Zhiyuan di Lettere e filosofia presso l’Università Jiatong di Shanghai
GHORBANALI POUR MARJAN VARJOVI Consigliere per gli affari culturali dell’Ambasciata della Repubblica Islamica d’Iran in Italia
ANAND PRATAP SINGH Dipartimento di Scienza politica, Babasaheb Bhimrao Ambedkar University, Lucknow (India)
GEOFFREY SLOAN Direttore del Graduate Institute for Political and International Studies (GIPIS), Università di Reading
ROBERT STEUCKERS Direttore di “Synergies européennes”
ALESSIO STILO Dottore in Relazioni internazionali (Università degli Studi di Messina)
FRANÇOIS THUAL Docente presso il Collège interarmées de défense e la École Pratique des Hautes Etudes
21:11 Publié dans Géopolitique, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, géopolitique, italie, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

von Anne Barnard
ex: http://www.zeit-fragen.ch/
«Sie hätten die Leute sein sollen, auf die wir für den Aufbau einer Zivilgesellschaft angewiesen sind.»
Nach zwanzig Monaten syrischem Bürgerkrieg verstärken sich Gewalt und soziale Desintegration, da die Regierung und die Rebellen brutalere Taktiken anwenden ohne voranzukommen, die Syrer sind zunehmend düsterer Stimmung, von Abscheu und Hoffnungslosigkeit erfasst, und haben die Befürchtung, dass keine der beiden Seiten den Konflikt beenden kann.
Selbst für Parteigänger der Regierung von Präsident Bashar al-Assad scheint die extreme Gewalt um so sinnloser, als sie keine Erfolge zeitigt. Aber der vielleicht grösste Stimmungsumschwung fand unter den Anhängern der Rebellen statt, die lange Zeit die moralische Überlegenheit des Kampfes gegen die Diktatur für sich beanspruchten, nun aber ihre eigenen Kämpfer der Arroganz, des kriminellen Verhaltens und der Hinrichtungen wegen kritisieren.
Neue Protestrufe richten sich nicht gegen die Regierung, sondern gegen die Streitkräfte der Rebellen. «Die Leute wollen eine Reform der Freien Syrischen Armee», haben die Menschenmengen ausgerufen. «Wir lieben euch, korrigiert euren Weg.»
Jüngste Greueltaten und Fehltritte von Rebellen haben den Enthusiasmus mancher ziviler Anhänger zum Schwinden gebracht, deren Opferbereitschaft den Kämpfern geholfen hatte, der überlegenen Schlagkraft der Regierung standzuhalten. Schlecht durchgeführte Offensiven haben Vergeltungsmassnahmen und Zerstörung gebracht, insbesondere in Syriens grösster Stadt, Aleppo, einer historischen Stadt, die seit Jahrhunderten das stolze Erbe aller Syrer darstellte.
Die zunehmende Zahl der Defizite, welche die Rebellen auf dem Kerbholz haben, ist durch den sich wandelnden Charakter der Opposition noch verstärkt worden: von einer Streitkraft aus Zivilisten und abtrünnigen Soldaten, die zu den Waffen griff, nachdem die Regierung tödliche Gewalt gegen friedliche Proteste einsetze, zu einer, die zunehmend von extremistischen islamischer Dschihadisten getrieben wird.
Die Radikalisierung der Opposition hat auch westliche Hauptstädte zurückhaltender werden lassen, die Rebellen mit Waffen zu versehen, die sie für einen Sieg brauchen. Sie rangen statt dessen mit wenig Erfolg darum, einen anderen Weg zur Beendigung des Abnützungskrieges zu finden, wobei Washington bei der Bildung einer funktionsfähigen Exilregierung behilflich war, und die Türkei die Einführung einer de-facto Flugverbotszone über dem nördlichen Syrien erwog.
Es waren die kleinen Akte sinnloser Zerstörung und kleinlicher Erniedrigung und die kaltblütige Hinrichtung von Gefangenen, welche viele Syrer dazu brachten, zu glauben, dass manche Rebellen genauso verdorben sind wie die Regierung, die sie bekämpfen. Letzte Woche zirkulierte ein Video, das Rebellen zeigt, die gefesselte syrische Soldanten zu Boden zwangen und auf sie schossen; die Vereinten Nationen bezeichneten es als Beweis für ein Kriegsverbrechen.
«Sie hätten die Leute sein sollen, auf die wir für den Aufbau einer Zivilgesellschaft angewiesen sind», klagte ein ziviler Aktivist in Sarqeb, der nördlichen Stadt, in der das Video am Donnerstag offensichtlich aufgenommen worden war. An diesem Tag, sagte der Aktivist, habe er Rebellen gesehen, die Soldaten aus einer Milchfabrik vertrieben und diese dann zerstörten, obwohl die Einwohner die Milch bräuchten und gute Beziehungen zum Besitzer hätten. «Sie beschossen die Fabrik mit Granaten und stahlen alles», schilderte der Aktivist, «das sind widerwärtige Taten.»
Einige der strammsten Anhänger des Aufstandes beginnen zu fürchten, dass die Leidens Syriens – die verlorenen Menschenleben, die Auflösung des sozialen Netzes, die Zerstörung des Erbes – umsonst sind.
«Wir dachten, die Freiheit sei so nahe», sagte ein Kämpfer, der sich selbst Abu Ahmed nannte und dessen Stimme von Kummer belegt war, als er letzten Monat via Skype aus Maaret al-Noaman – einer strategischen Stadt an der Fernverkehrsstrasse von Aleppo nach Damaskus – sprach. Stunden später endete dort ein Sieg der Rebellen in einem Desaster, als Luftschläge der Regierung Zivilisten zerrieben, die glaubten, an einen Ort der Sicherheit zurückzukehren.
«Das zeigt, dass das eine grosse Lüge war», meinte Abu Ahmed über den Traum der Selbstregierung, der, wie er sagte, ihn dazu inspirierte, eine kleine Rebellen-Kampftruppe aus seinem nahegelegenen Dorf Sinbol zu führen. «Wir können das nicht erreichen. Wir können nicht einmal an Demokratie denken – wir werden für Jahre betrübt sein. Wir beklagen Opfer auf beiden Seiten.»
Wie Dutzende von Interviews mit Syrern zeigen, schüren eine Folge von Katastrophen Ekel und Frustration auf allen Seiten.
Im Juli tötete ein Bombenanschlag der Rebellen vier höhere Beamte in einem schwer bewachten Gebäude in Damaskus, was zu neuer Unsicherheit unter den Anhängern der Regierung führte. Der zunehmende Einsatz grosser Bomben durch die Rebellen, die Zuschauer töten, und die zunehmende Profilierung von Kommandos mit extremistischen religiösen Programmen haben auf beiden Seiten Bedenken Auftrieb gegeben.
Im September haben Rebellen in Aleppo eine Offensive gestartet, die blutige Kämpfe in zuvor ruhige Gebiete brachten, die aber nicht zu der Wende führten, die sie versprochen oder auf die sie gehofft hatten.
Im Versuch, das Überlaufen von Soldaten einzudämmen und die Belastung des Militärs zu reduzieren, hielt die Regierung die Truppen auf den Basen zurück und setzte vermehrt die Luftwaffe und Artillerie ein und ebnete hemmungslos ganze Viertel ein. Aber der Strategiewechsel hatte Kontrolle und Sicherheit nicht wiederhergestellt. Die Hauptstadt Damaskus gleicht Bagdad, als es im Griff von amerikanischer Besatzung und Aufstand war; offizielle Gebäude sind von Schutzwällen gegen Explosionen umgeben und Checkpoints drosseln Handel und tägliches Leben.
Nachdem er Zeuge eines Bombenanschlages der Rebellen und eines Angriffs mit Kleinwaffen auf ein zentrales Regierungsgebäude geworden war, beklagte der Chauffeur eines wohlhabenden Geschäftsmannes, dass die auffälligen Sicherheitsmassnahmen ihn «in Angst leben» liessen – ohne wirksam zu sein.
«Ich will, dass mir jemand von der Regierung eine Antwort gibt», sagte er. «Die Regierung kann seine wichtigsten Armee- und Sicherheitsgebäude nicht schützen, wie kann sie dann uns schützen und das Land führen?»
Selbst innerhalb Assads solidester Basis, der Minderheit der Alawiten, quoll letzten Monat bei einem Handgemenge in einem Coffeeshop in Qardaha, der Stadt der Vorfahren des Präsidenten, die Unzufriedenheit über. Einige Alawiten beklagen, dass sie von alawitischen regierungstreuen Milizen an den Rand gedrängt und drangsaliert würden.
Laut Fadi Saad, der eine Facebook-Seite mit dem Namen «Alawiten in der syrischen Revolution» unterhält, seien andere kürzlich von schweren Verlusten in der überproportionalen alawitischen Vertretung in Militär und Milizen erschüttert worden.
Auf seiten der Rebellen hat die Schlacht in Aleppo schwelende Frustrationen unter zivilen Aktivisten angefacht, die sich von Bewaffneten dominiert fühlen. Eine Aktivistin aus Aleppo berichtet, dass sie sich mit Kämpfern traf, um nach Wegen zu suchen, wie man die Versorgungswege der Regierung unterbrechen könnte, ohne die Stadt zu zerstören – vergebens. Rebellen wollten Ruhm und Publizität, sagte die Aktivistin, selbst wenn das bedeutet, in die Altstadt einzudringen und damit das Feuer der Regierung dorthin zu ziehen, durch das ihr mittelalterlicher Markt niederbrannte.
«Wozu riskiert man das Leben der Menschen?» sagte die Aktivistin. «Die Freie Syrische Armee schneidet dem Regime nur die Nägel – wir wollen Resultate sehen.»
Ein anderer Aktivist aus Aleppo, Ahmed, sagte, er habe die Rebellen gebeten, nicht im Amt für Telekommunikation zu campieren. Sie taten es trotzdem und die Angriffe der Regierung legten den Telefondienst lahm.
Ein anderer Kämpfer, an den er sich erinnerte, schoss in die Luft, als Kunden ihn bei einer langen Schlange vor einer Bäckerei für das Brotholen nicht vorliessen. Wieder ein anderer, schilderte er, geriet in Wut, als ein Mann, der seinen Wagen wusch, ihn versehentlich anspritzte. «Er schoss auf ihn», sagte Ahmed, «aber Gott sei dank war er kein guter Schütze, so dass der Kumpel nicht verletzt wurde».
Die namentlichen Führer des losen Dachverbandes Freie Syrische Armee sagen, sie hielten sich an ethische Standards und behaupten, dass die Regierung die überwiegende Zahl der Übergriffe begehe und machen verbrecherische Gruppierungen für das schlechte Verhalten der Rebellen verantwortlich.
Dann kam letzte Woche das Video: Männer krümmen sich am Boden, starren nach oben und schreien vor Entsetzen. Rebellen stehen über ihnen und brüllen eine Kakophonie von Befehlen und Beleidigungen. Einige tragen Kampfanzüge, aber sie bewegen sich wie eine Bande, nicht wie eine militärische Einheit: sie rempeln und drängeln, treten Gefangene, zwingen sie auf einen Haufen. Plötzlich wird der Lärm von automatischen Waffen übertönt. Staubspritzer steigen aus dem Haufen auf, dann Stille.
«All das abstossende Zeug, welches das Regime praktizierte, kopiert jetzt die F.S.A.», sagte Anne, eine Angestellte im Finanzbereich in Damaskus über das kürzliche Verhalten.
Sie machte die Regierung für das missliche Verhalten der Gesellschaft verantwortlich, sagte aber, dass die Rebellen nicht besser seien. «Sie sind ungebildete Leute mit Waffen», sagte sie.
Nach den Luftschlägen in Maaret al-Noaman sagte der enttäuschte Kämpfer Abu Ahmed, die Syrer würden weinen, wenn sie die Zerstörung der Stadt «unseres berühmten Dichters und Philososophen» Abu al-Ala alMa’arri sähen.
Der Dichter des 10. Jahrhundert, ein Skeptiker und Rationalist, der in der jetzt verwüsteten Stadt begraben liegt, schrieb oft über Desillusionierung und die Fehlbarkeit von Möchtegern-Helden: «Wie oft sind unsere Füsse auf Staub getreten/Die Augenbraue eines Arroganten, den Schädel eines Liebenswürdigen?»
Abu Ahmed sagte, er habe das Mosaik-Museum der Stadt zunächst von Soldaten, dann von Rebellen geplündert und mit Abfall übersät vorgefunden. «Ich sah Leichen sowohl von Rebellen als auch von Regimetruppen, ich sah Bierflaschen», sagte er. «Ehrlich, ehrlich, die Worte sind mir im Halse stecken geblieben.» •
Quelle: © International Herald Tribune vom 9. November 2012
(Übersetzung Zeit-Fragen)
Art. 13
Die Kriegsgefangenen sind jederzeit mit Menschlichkeit zu behandeln. Jede unerlaubte Handlung oder Unterlassung seitens des Gewahrsamsstaates, die den Tod oder eine schwere Gefährdung der Gesundheit eines in ihrem Gewahrsam befindlichen Kriegsgefangenen zur Folge hat, ist verboten und als schwere Verletzung des vorliegenden Abkommens zu betrachten. Insbesondere dürfen an den Kriegsgefangenen keine Körperverstümmelungen oder medizinische oder wissenschaftliche Versuche irgendwelcher Art vorgenommen werden, die nicht durch die ärztliche Behandlung des betreffenden Kriegsgefangenen gerechtfertigt sind und nicht in seinem Interesse liegen.
Die Kriegsgefangenen müssen ferner jederzeit geschützt werden, namentlich auch vor Gewalttätigkeit oder Einschüchterung, Beleidigungen und der öffentlichen Neugier.
Vergeltungsmassnahmen gegen Kriegsgefangene sind verboten.
Genfer Abkommen über die Behandlung der Kriegsgefangenen, abgeschlossen in Genf am 12.8.1949
* * *
me. Der in der Konvention erwähnte «Gewahrsamsstaat» dürfte im Fall des von aussen nach Syrien hineingetragenen Destabilisierungskrieges eine Staatengruppe sein. Dazu zählen alle Staaten, welche die irregulären Truppen mit Waffen, Munition, Logistik, «Ausbildnern» und Spionage unterstützen. Dazu müssen den Meldungen nach gezählt werden: Frankreich, England, Deutschland, die Türkei, Kuwait, Saudi-Arabien, Israel und die USA. Sie alle tragen die Verantwortung für «ihre Truppen», sind also Gewahrsamsstaaten im Sinne der Genfer Konventionen und können entsprechend sanktioniert werden.
00:11 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : syrie, politique internationale, monde arabe, monde arabo-musulman, proche orient, levant |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, europe, affaires européennes, actualité, italie, presse, journaux, médias |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Genèse de la pensée unique
par Claude BOURRINET
« Il n’y eut plus de rire pour personne. »
Procope
Polymnia Athanassiadi, professeur d’histoire ancienne à l’Université d’Athènes, spécialiste du platonisme tardif (le néoplatonisme) avait bousculé quelques certitudes, dans son ouvrage publié en 2006, « la lutte pour l’orthodoxie dans le platonisme tardif », en montrant que les structures de pensée dans l’Empire gréco-romain, dont l’aboutissement serait la suppression de toute possibilité discursive au sein de l’élite intellectuelle, étaient analogues chez les philosophes « païens » et les théologiens chrétiens. Cette osmose, à laquelle il était impossible d’échapper, se retrouve au niveau des structures politiques et administratives, avant et après Constantin. L’État « païen », selon Mme Athanassiadi, prépare l’État chrétien, et le contrôle total de la société, des corps et des esprits. C’est la thèse contenue dans une étude éditée en 2010, Vers la pensée unique. La montée de l’intolérance dans l’Antiquité tardive.
Un basculement identitaire
L’Antiquité tardive est l’un de ces concepts historiques relativement flous, que l’on adopte, parce que c’est pratique, mais qui peuvent susciter des polémiques farouches, justement parce qu’ils dissimulent des pièges heuristiques entraînant des interprétations diamétralement apposées. Nous verrons que l’un des intérêts de cette recherche est d’avoir mis au jour les engagements singulièrement contemporains qui sous tendent des analyses apparemment « scientifiques ».
La première difficulté réside dans la délimitation de la période. Le passage aurait eu lieu sous le règne de Marc Aurèle, au IIe siècle, et cette localisation temporelle ne soulève aucun désaccord. En revanche, le consensus n’existe plus si l’on porte le point d’achoppement (en oubliant la date artificielle de 476) à Mahomet, au VIIe siècle, c’est-à-dire à l’aboutissement désastreux d’une longue série d’invasions, ou aux règnes d’Haroun al-Rachid et de Charlemagne, au IXe siècle, voire jusqu’en l’An Mil. Ce qui est en jeu dans ce débat, c’est l’accent mis sur la rupture ou sur la continuité.
Le fait indubitable est néanmoins que la religion, lors de ce processus qui se déroule quand même sur plusieurs siècles, est devenue le « trait identitaire de l’individu ». L’autre constat est qu’il s’éploie dans un monde de plus en plus globalisé – l’orbis romanus – dans un empire qui n’est plus « romain », et qui est devenu méditerranéen, voire davantage. Une révolution profonde s’y est produite, accélérées par les crises, et creusant ses mines jusqu’au cœur d’un individu de plus en plus angoissé et cherchant son salut au-delà du monde. La civilisation de la cité, qui rattachait l’esprit et le corps aux réalités sublunaires, a été remplacée par une vaste entité centralisée, dont la tête, Constantinople ou Damas, le Basileus ou le calife, un Dieu unique, contrôle tout. Tout ce qui faisait la joie de vivre, la culture, les promenades philosophiques, les spectacles, les plaisirs, est devenu tentation démoniaque. La terre semble avoir été recouverte, en même temps que par les basiliques, les minarets, les prédicateurs, les missionnaires, par un voile de mélancolie et un frisson de peur. Une voix à l’unisson soude les masses uniformisées, là où, jadis, la polyphonie des cultes et la polydoxie des sectes assuraient des parcours existentiels différenciés. Une monodoxie impérieuse, à base de théologie et de règlements tatillons, s’est substituée à la science (épistémé) du sage, en contredisant Platon pour qui la doxa, l’opinion, était la source de l’erreur.
Désormais, il ne suffit pas de « croire », si tant est qu’une telle posture religieuse ait eu sa place dans le sacré dit « païen » : il faut montrer que l’on croit. Le paradigme de l’appartenance politico-sociale est complètement transformé. La terreur théologique n’a plus de limites.
Comme le montre Polymnia Athanassiadi, cet aspect déplaisant a été, avec d’autres, occulté par une certaine historiographie, d’origine anglo-saxonne.
Contre l’histoire politiquement correcte
La notion et l’expression d’« Antiquité tardive » ont été forgées principalement pour se dégager d’un outillage sémantique légué par les idéologies nationales et religieuses. Des Lumières au positivisme laïciste du XIXe siècle, la polémique concernait la question religieuse, le rapport avec la laïcité, le combat contre l’Église, le triomphe de la raison scientifique et technique. Le « récit » de la chute de l’Empire romain s’inspirait des grandes lignes tracées par Montesquieu et Gibbon, et mettait l’accent sur la décadence, sur la catastrophe pour la civilisation qu’avait provoquée la perte des richesses antiques. Le christianisme pouvait, de ce fait, paraître comme un facteur dissolvant. D’un autre côté, ses apologistes, comme Chateaubriand, tout en ne niant pas le caractère violent du conflit entre le paganisme et le christianisme, ont souligné la modernité de ce dernier, et par quelles valeurs humaines il remplaçait celles de l’ancien monde, devenu obsolète.
C’est surtout contre l’interprétation de Spengler que s’est élevée la nouvelle historiographie de la fin des années Soixante. Pour le savant allemand, les civilisations subissent une évolution biologique qui les porte de la naissance à la mort, en passant par la maturité et la vieillesse. On abandonna ce schéma cyclique pour adopter la conception linéaire du temps historique, tout en insistant sur l’absence de rupture, au profit de l’idée optimiste de mutation. L’influence de Fernand Braudel, théoricien de la longue durée historique et de l’asynchronie des changements, fut déterminante.
L’école anglo-saxonne s’illustra particulièrement. Le maître en fut d’abord Peter Brown avec son World of late Antiquity : from Marcus Aurelius to Muhammad (1971). Mme Athanassiadi n’est pas tendre avec ce savant. Elle insiste par exemple sur l’absence de structure de l’ouvrage, ce qui ne serait pas grave s’il ne s’agissait d’une étude à vocation scientifique, et sur le manque de rigueur des cent trente illustrations l’accompagnant, souvent sorties de leur contexte. Quoi qu’il en soit, le gourou de la nouvelle école tardo-antique étayait une vision optimiste de cette période, perçue comme un âge d’adaptation.
Il fut suivi. En 1997, Thomas Hägg, publia la revue Symbolae Osbenses, qui privilégie une approche irénique. On vide notamment le terme le terme xenos (« étranger ») de son contenu tragique « pour le rattacher au concept d’une terre nouvelle, la kainê ktisis, ailleurs intérieur rayonnant d’espoir ». Ce n’est pas un hasard si l’inspirateur de cette historiographique révisionniste est le savant italien Santo Mazzarino, l’un des forgerons de la notion de démocratisation de la culture.
La méthode consiste en l’occurrence à supprimer les oppositions comme celles entre l’élite et la masse, la haute et la basse culture. D’autre part, le « saint » devient l’emblème de la nouvelle société. En renonçant à l’existence mondaine, il accède à un statut surhumain, un guide, un sauveur, un intermédiaire entre le peuple et le pouvoir, entre l’humain et le divin. Il est le symbole d’un monde qui parvient à se maîtrise, qui se délivre des entraves du passé
Polymnia Athanassiadi rappelle les influences qui ont pu marquer cette conception positive : elle a été élaborée durant une époque où la détente d’après-guerre devenait possible, où l’individualisme se répandait, avec l’hédonisme qui l’accompagne inévitablement, où le pacifisme devient, à la fin années soixante, la pensée obligée de l’élite. De ce fait, les conflits sont minimisés.
Un peu plus tard, en 1999, un tome collectif a vu le jour : Late Antiquity. A Guide to the postclassical World. Y ont contribué P. Brown et deux autres savants princetoniens : Glen Bowersock et Oleg Grabar, pour qui le véritable héritier de l’empire romain est Haroun al-Rachid. L’espace tardo-antique est porté jusqu’à la Chine, et on met l’accent sur vie quotidienne. Il n’y a plus de hiérarchie. Les dimensions religieuse, artistique politique, profane, l’écologique, la sexuelle, les femmes, le mariage, le divorce, la nudité – mais pas les eunuques, sont placées sur le même plan. La notion de crise est absente, aucune allusion aux intégrismes n’est faite, la pauvreté grandissante n’est pas évoquée, ni la violence endémique, bref, on a une « image d’une Antiquité tardive qui correspond à une vision politiquement correcte ».
La réaction a vu le jour en Italie. Cette même année 1999, Andrea Giardina, dans un article de la revue Studi Storici, « Esplosione di tardoantico », a contesté « la vision optimiste d’une Antiquité tardive longue et paisible, multiculturelle et pluridisciplinaire ». Il a expliqué cette perception déformée par plusieurs causes :
— la rhétorique de la modernité,
— l’impérialisme linguistique de l’anglais dans le monde contemporain (« club anglo-saxon »),
— une approche méthodologique défectueuse (lecture hâtive).
Et, finalement, il conseille de réorienter vers l’étude des institutions administratives et des structures socio-économiques.
Dans la même optique, tout en dénonçant le relativisme de l’école anglo-saxonne, Wolf Liebeschuetz, (Decline and Full of the Roman City, 2001 et 2005), analyse le passage de la cité-État à l’État universel. Il insiste sur la notion de déclin, sur la disparition du genre de vie avec institutions administratives et culturelles légués par génie hellénistique, et il s’interroge sur la continuité entre la Cité romaine et ses successeurs (Islam et Europe occidentale). Quant à Bryan Ward-Perkins, The fall of Rome and the End of Civilization, il souligne la violence des invasions barbares, s’attarde sur le trauma de la dissolution de l’Empire. Pour lui, le déclin est le résultat de la chute.
On voit que l’érudition peut cacher des questions hautement polémiques et singulièrement contemporaines. Polymnia Athanassiadi prend parti, parfois avec un mordant plaisant, mais nul n’hésitera à se rendre compte combien les caractéristiques qui ont marqué l’Antiquité tardive concernent de façon extraordinaire notre propre monde.
Polymnia Athanassiadi rappelle, en s’attardant sur la dimension politico-juridique, quelles ont été les circonstances de la victoire de la « pensée unique » (expression ô combien contemporaine !). Mais avant tout, quelle a été la force du christianisme ?
La révolution culturelle chrétienne
Le christianisme avait plusieurs atouts à sa disposition, dont certains complètement inédits dans la société païenne.
D’abord, il hérite d’une société où la violence est devenue banale, du fait de la centralisation politico-administrative, et de ce qu’on peut nommer la culture de l’amphithéâtre.
Dès le IIe siècle, en Anatolie, le martyr apparaît comme la « couronne rouge » de la sainteté octroyée par le sens donné. Les amateurs sont mus par une vertu grecque, la philotimia, l’« amour de l’honneur ». C’est le seul point commun avec l’hellénisme, car rien ne répugne plus aux esprits de l’époque que de mourir pour des convictions religieuses, dans la mesure où toutes sont acceptées comme telles. Aussi bien cette posture est-elle peu comprise, et même méprisée. L’excès rhétorique par lequel l’Église en fait la promotion en souligne la théâtralité. Marc Aurèle y voit de la déraison, et l’indice d’une opposition répréhensible à la société. Et, pour une société qui recherche la joie de vivre, cette pulsion de mort paraît bien suspecte.
Retenons donc cette aisance dans l’art de la propagande – comme chacun sait, le nombre de martyrs n’a pas été si élevé qu’on l’a prétendu – et cette attirance morbide qui peut aller jusqu’au fond des cœurs. Le culte des morts et l’adoration des reliques sont en vogue dès le IIIe siècle.
Le leitmotiv de la résurrection des corps et du jugement dernier est encore une manière d’habituer à l’idée de la mort. Le scepticisme régnant avant IIIe siècle va laisser place à une certitude que l’on trouve par exemple chez Tertullien, pour qui l’absurde est l’indice même de la vérité (De carne christi, 5).
L’irrationalisme, dont le christianisme n’est pas seul porteur, encouragé par les religions orientales, s’empare donc des esprits, et rend toute manifestation surnaturelle plausible. Il faut ajouter la croyance aux démons, partagée par tous.
Mais c’est surtout dans l’offensive, dans l’agression, que l’Église va se trouver particulièrement redoutable. En effet, de victimes, les chrétiens, après l’Édit de Milan, en 313, vont devenir des agents de persécution. Des temples et des synagogues seront détruits, des livres brûlés.
Peut-être l’attitude qui tranche le plus avec le comportement des Anciens est-il le prosélytisme, la volonté non seulement de convertir chaque individu, mais aussi l’ensemble de la société, de façon à modeler une communauté soudée dans une unicité de conviction. Certes, les écoles philosophiques cherchaient à persuader. Mais, outre que leur zèle n’allait pas jusqu’à harceler le monde, elles représentaient des sortes d’options existentielles dans le grand marché du bonheur, dont la vocation n’était pas de conquérir le pouvoir sur les esprits. Plotin, l’un des derniers champions du rationalisme hellène, s’est élevé violemment contre cette pratique visant à arraisonner les personnes. On vivait alors de plus en plus dans la peur, dans la terreur de ne pas être sauvé. L’art de dramatiser l’enjeu, de le charger de toute la subjectivité de l’angoisse et du bon choix à faire, a rendu le christianisme particulièrement efficace. Comme le fait remarquer Mme Athanassiadi, la grande césure du moi, n’est plus entre le corps et l’âme, mais entre le moi pécheur et le moi sauvé. Le croyant est sollicité, sommé de s’engager, déchiré d’abord, avant Constantin, entre l’État et l’Église, puis de façon permanente entre la vie temporelle et la vie éternelle.
Cette tension sera attisée par la multitude d’hérésie et par les conflits doctrinaux, extrêmement violents. Les schismes entraînent excommunications, persécutions, batailles physiques. Des polémiques métaphysiques absconses toucheront les plus basses couches de la société, comme le décrit Grégoire de Nysse dans une page célèbre très amusante. Les Conciles, notamment ceux de Nicée et de Chalcédoine, seront des prétextes à l’expression la plus hyperbolique du chantage, des pressions de toutes sortes, d’agressivité et de brutalité. Tout cela, Ramsay MacMullen le décrit fort bien dans son excellent livre, Christianisme et paganisme du IVe au VIIIe siècle.
Mais c’est surtout l’arme de l’État qui va précipiter la victoire finale contre l’ancien monde. Après Constantin, et surtout avec Théodose et ses successeurs, les conversions forcées vont être la règle. À propos de Justinien, Procope écrit : « Dans son zèle pour réunir l’humanité entière dans une même foi quant au Christ, il faisait périr tout dissident de manière insensée » (in 118). Des lois discriminatoires seront décrétées. Même le passé est éradiqué. On efface la mémoire, on sélectionne les ouvrages, l’index des œuvres interdites est publié, Basile de Césarée (vers 360) établit une liste d’auteurs acceptables, on jette même l’anathème sur les hérétiques de l’avenir !
Construction d’une pensée unique
L’interrogation de Polemnia Athanassiadi est celle-ci : comment est-on passé de la polydoxie propre à l’univers hellénistique, à la monodoxie ? Comment un monde à l’échelle humaine est-il devenu un monde voué à la gloire d’un Dieu unique ?
Son fil conducteur est la notion d’intolérance. Mot piégé par excellence, et qui draine pas mal de malentendus. Il n’a rien de commun par exemple avec l’acception commune qui s’impose maintenant, et dont le fondement est cette indifférence profonde pour tout ce qui est un peu grave et profond, voire cette insipide légèreté contemporaine qui fuit les tragiques conséquences de la politique ou de la foi religieuse. Serait intolérant au fond celui qui prendrait au sérieux, avec tous les refus impliqués, une option spirituelle ou existentielle, à l’exclusion d’une autre. Rien de plus conformiste que la démocratie de masse ! Dans le domaine religieux, le paganisme était très généreux, et accueillait sans hésiter toutes les divinités qu’il lui semblait utile de reconnaître, et même davantage, dans l’ignorance où l’on était du degré de cette « utilité » et de la multiplicité des dieux. C’est pourquoi, à Rome, on rendait un culte au dieu inconnu. Les païens n’ont jamais compris ce que pouvait être un dieu « jaloux », et tout autant leur théologie que leur anthropologie les en empêchaient. En revanche, l’attitude, le comportement, le mode de vie impliquaient une adhésion ostentatoire à la communauté. Les cultes relevaient de la vie familiale, associative, ou des convictions individuelles : chacun optait pour un ou des dieux qui lui convenaient pour des raisons diverses. Pourtant les cultes publics concernant les divinités poliades ou l’empereur étaient des actes, certes, de piété, mais ne mettant en scène souvent que des magistrats ou des citoyens choisis. Ils étaient surtout des marques de patriotisme. À ce titre, ne pas y participer lorsqu’on était requis de le faire pouvait être considéré comme un signe d’incivisme, de mauvaise volonté, voire de révolte. En grec, il n’existe aucun terme pour désigner notion de tolérance religieuse. En latin, l’intolérance : intolerentia, est cette « impatience », « insolence », « impudence » que provoque la présence face à un corps étranger. Ce peut être le cas pour les païens face à ce groupe chrétien étrange, énigmatique, considéré comme répugnant, ou l’inverse, pour des chrétiens qui voient le paganisme comme l’expression d’un univers démoniaque. Toutefois, ce qui relevait des pratiques va s’instiller jusqu’au fond des cœurs, et va s’imprégner de toute la puissance subjective des convictions intimes. En effet, il serait faux de prétendre que les païens fussent ignorants de ce qu’une religion peut présenter d’intériorité. On ne s’en faisait pas gloire, contrairement au christianisme, qui exigeait une profession de foi, c’est-à-dire un témoignage motivé, authentique et sincère de son amour pour le dieu unique. Par voie de conséquence, l’absence de conviction dûment prouvée, du moins exhibée, était rédhibitoire pour les chrétiens. On ne se contentait pas de remplir son devoir particulier, mais on voulait que chacun fût sur la droite voie de la « vérité ». Le processus de diabolisation de l’autre fut donc enclenché par les progrès de la subjectivisation du lien religieux, intensifiée par la « persécution ». Au lieu d’un univers pluriel, on en eut un, uniformisé bien que profondément dualiste. La haine fut érigée en vertu théologique.
Comment l’avait décrit Pollymnia Athanassiadi dans son étude de 2006 sur l’orthodoxie à cette période, la première tâche fut de fixer le canon, et, par voie de conséquence d’identifier ceux qui s’en écartaient, à savoir les hérétiques. Cette classification s’élabora au fil du temps, d’Eusèbe de Césarée, qui procéda à une réécriture de l’Histoire en la christianisant, jusqu’à Jean Damas, en passant par l’anonyme Eulochos, puis Épiphane de Salamine.
Néanmoins, l’originalité de l’étude de 2010 consacrée à l’évolution de la société tardo-antique vers la « pensée unique » provient de la mise en parallèle de la politique religieuse menée par l’empire à partir du IIIe siècle avec celle qui prévalut à partir de Constantin. Mme Athanassiadi souligne l’antériorité de l’empire « païen » dans l’installation d’une théocratie, d’une religion d’État. En fait, selon elle, il existe une logique historique liant Dèce, Aurélien, Constantin, Constance, Julien, puis Théodose et Justinien.
L’édit de Dèce, en 250, est motivé par une crise qui faillit anéantir l’Empire. La pax deorum semblait nécessaire pour restaurer l’État. Aussi fut-il décrété que tous les citoyens (dont le nombre fut élargi à l’ensemble des hommes libres en 212 par Caracalla), sauf les Juifs, devaient offrir un sacrifice aux dieux, afin de rétablir l’unité de foi, le consensus omnium.
Deux autres persécutions eurent lieu, dont les plus notoires furent celles en 257 de Valérien, en 303 de Dioclétien, et en 312, en Orient, de Maximin.
Entre temps, Aurélien (270 – 275) conçut une sorte de pyramide théocratique, à base polythéiste, dont le sommet était occupé par la divinité solaire.
Notons que Julien, le restaurateur du paganisme d’État, est mis sur le même plan que Constantin et que ses successeurs chrétien. En voulant créer une « Église païenne », en se mêlant de théologie, en édictant des règles de piété et de moralité, en excluant épicuriens, sceptiques et cyniques, il a consolidé la cohérence théologico-autoritaire de l’Empire. Il assumait de ce fait la charge sacrale dont l’empereur était dépositaire, singulièrement la dynastie dont il était l’héritier et le continuateur. Il avait conscience d’appartenir à une famille, fondée par Claude le Gothique (268 – 270), selon lui dépositaire d’une mission de jonction entre l’ici-bas et le divin.
Néanmoins, Constantin, en 313, lorsqu’il proclama l’Édit de Milan, ne saisit probablement pas « toute la logique exclusiviste du christianisme ». Était-il en mesure de choisir ? Selon une approximation quantitative, les chrétiens étaient loin de constituer la majorité de la population. Cependant, ils présentaient des atouts non négligeables pour un État soucieux de resserrer son emprise sur la société. D’abord, son organisation ecclésiale plaquait sa logique administrative sur celle de l’empire. Elle avait un caractère universel, centralisé. De façon pragmatique, Constantin s’en servit pour tenter de mettre fin aux dissensions internes génératrices de guerre civile, notamment en comblant de privilèges la hiérarchie ecclésiastique. Un autre instrument fut utilisé par lui, en 325, à l’occasion du concile de Nicée. En ayant le dernier mot théologique, il manifesta la subordination de la religion à la politique.
Mais ce fut Théodose qui lança l’orthodoxie « comme concept et programme politique ». Constantin avait essayé de maintenir un équilibre, certes parfois de mauvaise foi, entre l’ancienne religion et la nouvelle. Pour Théodose, désormais, tout ce qui s’oppose à la foi catholique (la vera religio), hérésie, paganisme, judaïsme, est présumé superstitio, et, de ce fait, condamné. L’appareil d’État est doublé par les évêques (« surveillants » !), la répression s’accroît. À partir de ce moment, toute critique religieuse devient crime de lèse-majesté.
Quant au code justinien, il défend toute discussion relative au dogme, mettant fin à la tradition discursive de la tradition hellénique. On élabore des dossiers de citations à l’occasion de joutes théologiques (Cyrille d’Alexandrie, Théodoret de Cyr, Léon de Rome, Sévère d’Antioche), des chaînes d’arguments (catenae) qui interdisent toute improvisation, mais qui sont sortis de leur contexte, déformés, et, en pratique, se réduisent à de la propagande qu’on assène à l’adversaire comme des coups de massue.
La culture devient une, l’élite partage des références communes avec le peuple. Non seulement celui-ci s’entiche de métaphysique abstruse, mais les hautes classes se passionnent pour les florilèges, les vies de saints et les rumeurs les plus irrationnelles. L’humilité devant le dogme est la seule attitude intellectuelle possible.
Rares sont ceux, comme Procope de Césarée, comme les tenants de l’apophatisme (Damascius, Pseudo-Denys, Évagre le Pontique, Psellus, Pléthon), ou comme les ascètes, les ermites, et les mystiques en marge, capables de résister à la pression du groupe et de l’État.
Mise en perspective
Il faudrait sans doute nuancer l’analogie, la solution de continuité, entre l’entreprise politico-religieuse d’encadrement de la société engagée par l’État païen et celle conduite par l’État chrétien. Non que, dans les grandes lignes, ils ne soient le produit de la refonte de l’« établissement » humain initiée dès le déplacement axiologique engendré par l’émergence de l’État universel, période étudiée, à la suite de Karl Jaspers, par Marcel Gauchet, dans son ouvrage, Le désenchantement du monde. Le caractère radical de l’arraisonnement de la société par l’État, sa mobilisation permanente en même temps que la mise à contribution des forces transcendantes, étaient certes contenus dans le sens pris par l’Histoire, mais il est certain que la spécificité du christianisme, issu d’une religion née dans les interstices de l’Occident et de l’Orient, vouée à une intériorisation et à une subjectivité exacerbées, dominée par un Dieu tout puissant, infini, dont la manifestation, incarnée bureaucratiquement par un organisme omniprésent, missionnaire, agressif et aguerri, avait une dimension historique, son individualisme et son pathos déséquilibré, la béance entre le très-haut et l’ici-bas, dans laquelle pouvait s’engouffrer toutes les potentialités humaines, dont les pires, était la forme adéquate pour que s’installât un appareil particulièrement soucieux de solliciter de près les corps et les âmes dans une logique totalitaire. La question de savoir si un empire plus équilibré eût été possible, par exemple sous une forme néoplatonicienne, n’est pas vaine, en regard des empires orientaux, qui trouvèrent un équilibre, un compromis entre les réquisits religieux, et l’expression politique légitime, entre la transcendance et l’immanence. Le néoplatonisme, trop intellectuel, trop ouvert à la recherche, finalement trop aristocratique, était démuni contre la fureur plébéienne du christianisme. L’intolérance due à l’exclusivisme dogmatique ne pouvait qu’engager l’Occident dans la voie des passions idéologiques, et dans une dynamique conflictuelle qui aboutirait à un monde moderne pourvu d’une puissance destructrice inédite.
Il faudra sans doute revenir sur ces questions. Toutefois, il n’est pas inutile de s’interroger sur ce que nous sommes devenus. De plus en plus, on s’aperçoit que, loin d’être les fils de l’Athènes du Ve siècle avant le Christ, ou de la République romaine, voire de l’Empire augustéen, nous sommes dépendants en droite ligne de cette Antiquité tardive, qui nous inocula un poison dont nous ne cessons de mourir. L’Occident se doit de plonger dans son cœur, dans son âme, pour extirper ces habitus, ces réflexes si ancrés qu’ils semblent devenus naturels, et qui l’ont conduit à cette expansion mortifère qui mine la planète. Peut-être retrouverons-nous la véritable piété, la réconciliation avec le monde et avec nous-mêmes, quand nous aurons extirpé de notre être la folie, la « mania », d’exhiber la vérité, de jeter des anathèmes, de diaboliser ce qui nous est différent, de vouloir convertir, persuader ou contraindre, d’universaliser nos croyances, d’unifier les certitudes, de militariser la pensée, de réviser l’histoire, d’enrégimenter les opinions par des lois, d’imposer à tous une « pensée unique ».
Claude Bourrinet
• Polymnia Athanassiadi, Vers la pensée unique. La montée de l’intolérance dans l’Antiquité tardive, Paris, Les Belles Lettres, 2010.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2092
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : philosophie, pensée unique, théologie, christianisme, christianisme primitif |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, géopolitique, poutine, russie, europe, affaires européennes, actualités |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le sacré : Unité du monde et destin du peuple
Ex: http://vouloir.hautetfort.com/
Le problème posé ici est le suivant : que peut signifier la locution « unité du monde », que certains ont déjà élevée au rang de concept fondamental (1) et dans laquelle, apparemment, se trouve beaucoup plus qu'un antidote au dualisme métaphysique et chrétien ? En d'autres termes : comment penser “l'unité du monde” ? Pour répondre à cette question, considérons d'abord la formule grecque panta : en, « tout : un ». C'est, pourrait-on dire, sur ces simples mots d'Héraclite d'Éphèse que s'ouvre la pensée européenne. Toute sa vie, Heidegger n'a cessé de “tourner” autour d'eux en s'en rapprochant. « Tout : un » : que peut vouloir dire cela ?
“Tout” est la multiplicité changeante de ce qui est, c'est-à-dire de ce qui se manifeste, se présente à nous : tout ce qui change et devient, tout ce qui coule. Panta rhei, « tout coule », dit une autre maxime d'Héraclite. Tout coule, et pourtant tout est un. Comment ce qui constitue la multiplicité même peut-il être “un” ? Qu'est-ce que cette unité du divers ? “Unité” signifie-t-il ici “totalité”, “globalité” ? Est-il ici seulement question de cette évidence ensembliste qui veut que chaque chose soit un élément de l'ensemble de toutes les choses, contribue à l'unicité de cet ensemble ? Certes non. Panta : En pourrait également s'énoncer : chaque étant : un. La question qui surgit alors est : comment ce qui à chaque instant se manifeste comme pluralité peut-il être un ?
L'unité, par ailleurs, ne saurait être conçue en tant que “principe unifiant”, causal ou non. Une telle conception resterait enfermée dans le dualisme métaphysique, auquel d'ailleurs elle s'apparente, puisqu'elle ne permettrait jamais de résoudre la dualité de l'étant et du principe. La réponse souvent invoquée par la théologie chrétienne, qui postule l'unité du monde en Dieu, n'est en rien satisfaisante, dans la mesure où elle ne produit qu'une pseudounité surajoutée à la dualité fondamentale du monde et de Dieu.
En fait, si nous voulons véritablement saisir ce que contient le panta : en héraclitéen, il nous est demandé, autant que possible, de sortir du “règne” de l'essence platonicienne, de l'essence comme principe ultime constituant le “soi” de chaque étant. Une telle conception des essences fondatrices accessibles à la ratio pèse, on le sait, sur la plupart des modes explicatifs en usage aujourd'hui. Cependant, elle ne va pas “de soi” : elle n'est venue qu'après la pensée présocratique (qui, à l'exception du poème de Parménide, nous est parvenue sous forme de fragments) et avant celle de Heidegger, qui s'est d'ailleurs constamment appuyée sur la précédente.
Mais revenons-en au “paradoxe” évoqué plus haut : panta : en / panta rhei. On interprète souvent maladroitement l'image héraclitéenne du fleuve. « On ne se baigne jamais deux fois dans la même eau (du fleuve) », dit en substance Héraclite. On en déduit que le fleuve n'est qu'en tant que devenir — en se gardant bien de se demander ce que peut signifier ce “devenir” —, et l'on conclut que, hors du devenir, il n'y a rien (à penser). On passe alors à côté de ce que voulait dire Héraclite, et à côté de ce qui, dans ce “devenir”, se présente comme question.
Tout dans le fleuve est courant, changement, devenir. Mais qu'est-ce qui fonde ce devenir comme devenir-du-fleuve, et, plus précisément, devenir-de-ce-fleuve-ci ? Autre formulation (qui est plus qu'une boutade) : si le fleuve est devenir, il faut bien qu'il soit. De fait, pour que soit pensable le devenir du fleuve, il faut qu'une entité rassemble en soi ce devenir, ou plutôt (pour éviter de penser à une entité “agissante”) que ce devenir se rassemble en une entité : on ne se baigne jamais deux fois dans la même eau, mais cette eau qui coule est toujours celle du fleuve. Le fond de l'image du fleuve réside en ceci que le devenir voile ce qui est, dirons-nous par approximation, sa condition essentielle de possibilité : l'unité, celle-là même en laquelle sont assemblées les diverses et changeantes apparences (c'est-à-dire : manifestations de la présence) de l'étant.
Cette unité où sont assemblés les divers modes de l'apparaître d'un étant, Heidegger la nomme Wesen. Ce mot est généralement traduit par “essence”. (Il n'est d'ailleurs pas une des nombreuses inventions terminologiques de Heidegger, mais appartient à la langue philosophique allemande, qui l'utilisa pour rendre le latin essentia). Il ne faut pas oublier néanmoins toute la distance qui sépare ce Wesen de l'essence platonicienne. Osons une définition : Wesen (“essence d'un étant”), “unité rassemblante de ses modes de présence (de ses manifestations phénoménales)”. Être veut alors dire “déployer” son essence, apparaître de manière multiple, changeante, ambiguë, dans (et à partir de) l'unité de son essence. Il apparaît alors clairement que l'essence-unité rassemblante n'est “extérieure” ni à l'étant ni au temps, qu'elle n'induit aucune coupure entre un monde dit “sensible” et un monde dit “intelligible”. L'essence étant unité rassemblante des apparences, elle ne saurait être “au-delà” de ces apparences. Ne pouvant être pensée hors de son “déploiement” en présence, hors de son surgissement en un devenir, elle ne saurait non plus être “au-delà” du temps.
Les messagers de la “divinité”
 Loin d'induire une coupure entre le “sensible” et “l'intelligible”, la notion heideggérienne de Wesen réduit celle-ci à néant. L'essence se manifeste en présence ; elle n'est pas accessible hors de cette manifestation. Les présocratiques, d'ailleurs, étaient incapables de concevoir la moindre distinction entre le sensible et l'intelligible pour la simple raison que, pour eux, le penser et le sentir n'étaient que des modes d'un même “faire face à la présence”. En allemand, “briller” et “apparaître” se disent tous deux scheinen. L'éclat, la lueur, l'apparence : der Schein. Paraître, c'est briller, laisser se déployer la totalité des signes de soi. Être et (ap)paraître ne sont donc nullement antinomiques. Être, c'“est” paraître, tout comme pour le soleil, être, c'“est” briller. Panta : en signifierait alors d'abord ceci : la pluralité des phénomènes est toujours rassemblée dans l'unité d'une essence (Wesen). La coupure entre “l'intelligible” et le “sensible” n'est qu'un sous-produit de la pensée socrato-platonicienne.
Loin d'induire une coupure entre le “sensible” et “l'intelligible”, la notion heideggérienne de Wesen réduit celle-ci à néant. L'essence se manifeste en présence ; elle n'est pas accessible hors de cette manifestation. Les présocratiques, d'ailleurs, étaient incapables de concevoir la moindre distinction entre le sensible et l'intelligible pour la simple raison que, pour eux, le penser et le sentir n'étaient que des modes d'un même “faire face à la présence”. En allemand, “briller” et “apparaître” se disent tous deux scheinen. L'éclat, la lueur, l'apparence : der Schein. Paraître, c'est briller, laisser se déployer la totalité des signes de soi. Être et (ap)paraître ne sont donc nullement antinomiques. Être, c'“est” paraître, tout comme pour le soleil, être, c'“est” briller. Panta : en signifierait alors d'abord ceci : la pluralité des phénomènes est toujours rassemblée dans l'unité d'une essence (Wesen). La coupure entre “l'intelligible” et le “sensible” n'est qu'un sous-produit de la pensée socrato-platonicienne.
Il vaut la peine d'insister. L'essence (Wesen) n'“est” aucun principe, ni actif (l'unité est toujours, pourrait-on dire, intrinsèque et implicite) ni explicatif (expliquer est toujours re-présenter ; or, par l'unité, on ne re-présente rien, et l'unité elle-même est sans doute absolument non re-présentable). Heidegger a parfois utilisé l'image de la coupe pour faire sentir que cette unité n'“est” pas un lien, causal ou non, qui unirait en interdisant on ne sait quel éparpillement. Bien au contraire, il faut s'exercer à penser la coupe comme recueillant en elle la multiplicité, tout en n'étant pas “extérieure” au recueillement. (La coupe du Wesen est à la fois “recueillante” et “recueillement”).
Heidegger parlait des dieux (die Götter) en les appelant « les divins » (die göttlichen). Il voyait en eux les messagers de la « divinité » (die Gottheit). Maître Eckart, Angelus Silesius et d'autres ont aussi parlé de Gott ou de Gottheit en termes d'unité, de consubstantialité, de co-propriation. En fait, Gottheit ne signifie rien d'autre que cette « unité du monde » au sein de l'unité-recueillante que nous venons d'évoquer. Qu'est-ce alors que le sacré ? Il est le dévoilement de cette unité, et l'homme, en tant que faisant — face-à-l'étant (Da-sein), en est le dépositaire.
Essayons maintenant d'approcher l'unité-recueillante du monde en certains de ses modes de dévoilement. L'un des modes les plus importants est constitué par le peuple (das Volk). Qu'est-ce qu'un peuple ? Ce n'est ni une somme d'individus ni une structure évoluant dans un temps linéaire. Un peuple est une entité qui rassemble les ancêtres, c'est-à-dire le passé-origine surgissant dans l'immédiat d'une présence-au-monde, les présents, c'est-à-dire ceux qui vivent aujourd'hui et qui font la présence du monde, et les hommes-à-venir, notion qui représente l'anticipation dans la présence au monde d'un être-en-projet.
Pas d'opposition entre le sacré et le profane
 L'unité-peuple est pour nous l'un des modes où se dévoile la Gottheit, la divinité de l'unité du monde. Nous dirons, par suite, que le sacré ne se laisse appréhender authentiquement qu'au sein d'une communauté populaire qui en constitue le « lieu de surgissement ». En ce sens, il n'y a pas de médiateur entre l'homme-d'un-peuple et la divinité ; celle-ci constitue pour lui le plus immédiat. Autrement dit, l'homme n'a accès à l'unité-du-monde qu'à partir (et dans) l'unité-du-peuple. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il n'y ait d'accès au sacré que dans la “religion collective”. Cela signifie que la personne individuelle ne peut s'ouvrir au sacré sans que l'ensemble du peuple soit “présent”, c'est-à-dire délimite le lieu de venue du sacré.
L'unité-peuple est pour nous l'un des modes où se dévoile la Gottheit, la divinité de l'unité du monde. Nous dirons, par suite, que le sacré ne se laisse appréhender authentiquement qu'au sein d'une communauté populaire qui en constitue le « lieu de surgissement ». En ce sens, il n'y a pas de médiateur entre l'homme-d'un-peuple et la divinité ; celle-ci constitue pour lui le plus immédiat. Autrement dit, l'homme n'a accès à l'unité-du-monde qu'à partir (et dans) l'unité-du-peuple. Bien entendu, cela ne signifie pas qu'il n'y ait d'accès au sacré que dans la “religion collective”. Cela signifie que la personne individuelle ne peut s'ouvrir au sacré sans que l'ensemble du peuple soit “présent”, c'est-à-dire délimite le lieu de venue du sacré.
Cette notion de co-propriation de l'homme authentique et de la communauté populaire dans l'unité-recueillante de l'être est à la fois très immédiate, car elle s'adresse à une sensibilité originaire, et très difficile à saisir, car elle s'exprime difficilement au travers d'un langage bâti sur l'effectivité du concept. Heidegger la développe à partir d'un certain nombre de considérations sur l'idée de monde.
Pour Heidegger, un « monde » est un « existential », autrement dit un mode d'être de l'homme historial, c'est-à-dire de l'homme en tant qu'il est engagé dans le déploiement du destin de la communauté dont il relève. Qu'est-ce à dire ? Que cet homme ne vit jamais dans un “monde” qui lui serait indifférent et pré-existant, comme une boîte contenant un objet, mais qu'à proprement parler, il fonde sans cesse le “monde” en prenant sa part du destin communautaire. Heidegger dit : der Welt ist nicht, sondern weltet (le monde n'est pas, il mondifie). Le monde mondifie : il se manifeste comme une unité rassemblant d'une manière toujours progressante l'homme d'une communauté, cette communauté elle-même, les étants qui viennent à la “rencontre” de l'homme et les modes existentiels généralement représentés comme des fonctions culturelles. Cette unité de tout ce qui est dans un monde et de ce qui le fonde (l'homme historial) constitue à nos yeux un mode de la divinité.
Un temple n'est sacré que dans la mesure où il est un lieu de co-appartenance de la communauté du peuple et des hommes de cette communauté. S'il est ainsi, ainsi est-il immédiatement perçu. Cette immédiateté est le signe de l'unité qui se manifeste dans la rencontre de l'homme et du temple, par laquelle le temple est livré à son être, et l'homme révélé au sien. Quand, au contraire, le temple devient un “médiateur” entre l'homme et le dieu, il a déjà cessé d'être sacré. (Une réflexion sur la notion d'“idole” pourrait être développée à partir de là). Que nous le voulions ou non, nous ne pourrons plus jamais voir le temple d'Apollon à Delphes ainsi que le voyait un Grec contemporain de ceux qui l'ont bâti. Pour celui-ci, la place du temple à l'intérieur de la polis allait de soi. Or, c'est précisément cet “allant de soi” qui signale l'étant mondain (la Chose) en opposition à l'étant hors-du-monde (l'Objet). On comprend, dès lors, que pour un paganisme authentique, il ne saurait y avoir de “lieux saints” en opposition à des “lieux profanes” (tout comme il ne saurait y avoir, en général, d'opposition entre le profane et le sacré). Est sacré, relève de la Gottheit, de l'Un, tout lieu “mondain”, toute chose, toute région du monde en tant que ce dernier est sans cesse fondé et soutenu par la communauté du peuple. Tacite disait à propos des Germains : « Ils nomment Dieu le secret des bois ». On pourrait traduire : « Le sacré est partout où se fonde le monde de la communauté du peuple ».
Ce qui se manifeste dans la divinité, comme l'unité du monde, se manifeste partout, mais ne s'institue nulle part comme pouvoir (2). De même, la divinité n'étant aucun principe, elle n'est source également d'aucun principe, et en particulier d'aucune morale. Plutôt que d'“homme bon”, il vaudrait donc mieux, dans la perspective où nous nous plaçons, parler d'homme “bien destiné”, au sens que Heidegger a su retrouver chez les présocratiques. L'homme bien destiné est celui qui est “tout-un” avec le destin lui-même, c'est-à-dire avec l'Un de tous les tenants du peuple.
Il ne saurait pour nous y avoir de doute sur ce point : l'homme n'existe qu'en tant qu'homme-du-peuple. Le peuple en tant qu'unité à penser ne se définit pas par l'homme. Le peuple est ce dans quoi se trouve réalisée une unité essentielle, en même temps que le mode d'approche de cette unité. Comme “lieu” (topos) de réalisation d'un passé, d'un présent et d'un “à-venir”, le peuple n'est rien qui se laisse définir par l'homme. C'est au contraire l'homme qui ne se trouve révélé comme homme que par son appartenance à un peuple. Et si l'on tient à parler de “volonté de puissance”, on doit admettre que celle-ci tient son être de l'être du peuple, et non l'inverse.
Mais qu'en est-il de l'être du peuple ? Notre formulation, loin de régler les problèmes, les fait au contraire surgir avec force. Certes, on peut conjecturer un lien fondamental avec ce que Heidegger appelle la temporalité de l'être, et qu'on peut appeler aussi tridimensionnalité du temps historique. Mais des interrogations surgissent, en particulier dès que l'on parle d'« auto-affirmation de la volonté de l'homme » ou d'« auto-affirmation de l'homme dans la volonté ».
L'image d'un homme en pamoison devant sa propre marche vers la puissance, c'est-à-dire finalement devant lui-même, est à la fois puérile et bien commune : le réalisme socialiste l'a multipliée à l'infini. Ce n'est pas sur une telle image que l'on peut fonder le sacré, bien au contraire. Le mot “auto-affirmation” signifie-t-il affirmation de l'homme en tant que “porteur d'une volonté” ? Supposons cela. Les difficultés auxquelles on se heurte sont tout de suite insurmontables. Définir l'homme comme “sujet voulant” n'est rien d'autre qu'utiliser un mode “moderne” de la définition métaphysique de l'homme comme “animal rationnel”. Déplacer le centre de gravité de la raison vers la volonté ne change rien quant au fond (surtout si l'on pense la volonté comme projection de la raison dans un univers de pensée nominaliste). L'homme comme “animal doué de volonté” reste un fantasme métaphysique. En outre, une telle définition revient à se couper définitivement l'accès au peuple en tant que phénomène fondateur, et donc, à l'essence de la volonté comme pro-venant de celle du peuple. L'homme en tant que porté-par-un-peuple ne saurait donc se définir, et encore moins s'affirmer, comme “sujet voulant”. Tout au plus peut-il interpréter la volonté comme ouverture au destin du peuple et lien à son essence. Un tel homme ne dit “je” que secondairement.
Homme-du-peuple et liberté-pour fonder-un-monde
[Les métaphores heideggériennes restituent « l'appel silencieux de la terre », sol sur lequel prend pied notre liberté. Ci-dessous : gravure de Bodo Zimmermann (1902-1945)]
 Allons plus loin. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'homme comme “animal-doué-de-volonté” ressemble à s'y méprendre à l'homme du nihilisme achevé, c'est-à-dire à l'homme de la technique mondiale. En effet, l'homme du nihilisme achevé se constitue comme tel en tant que, dans son “faire”, il se reconnaît lui-même comme seule réalité. “Poétiquement”, il est cet étant solitaire à qui l'existant dans son ensemble ne renvoie plus que sa propre image, tellement vidée de substance qu'elle n'est plus qu'un leurre. Poser l'homme comme “animal voulant”, après qu'il l'eut été comme “animal rationnel”, c'est-à-dire, en fin de compte, comme individu absolu, c'est s'enfermer à terme dans cette fatalité de l'homme seul parmi ses avatars. Or, si l'essence de la technique n'est rien de technique, l'essence de l'homme n'est rien d'humain. L'homme comme “animal voulant” est précisément celui qui a perdu tout lien avec le “non-humain en l'homme”, qui a totalement oublié l'être.
Allons plus loin. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, l'homme comme “animal-doué-de-volonté” ressemble à s'y méprendre à l'homme du nihilisme achevé, c'est-à-dire à l'homme de la technique mondiale. En effet, l'homme du nihilisme achevé se constitue comme tel en tant que, dans son “faire”, il se reconnaît lui-même comme seule réalité. “Poétiquement”, il est cet étant solitaire à qui l'existant dans son ensemble ne renvoie plus que sa propre image, tellement vidée de substance qu'elle n'est plus qu'un leurre. Poser l'homme comme “animal voulant”, après qu'il l'eut été comme “animal rationnel”, c'est-à-dire, en fin de compte, comme individu absolu, c'est s'enfermer à terme dans cette fatalité de l'homme seul parmi ses avatars. Or, si l'essence de la technique n'est rien de technique, l'essence de l'homme n'est rien d'humain. L'homme comme “animal voulant” est précisément celui qui a perdu tout lien avec le “non-humain en l'homme”, qui a totalement oublié l'être.
Nous dirons, au contraire, que le non-humain est peut-être ce en quoi résident l'essence du sacré comme celle du peuple. Nous prendrons alors le mot d'“auto-affirmation” dans le sens que lui donne Heidegger, en parlant, par ex., de « l'auto-affirmation de l'université allemande » (die Selbstbehauptung der deutschen Universität). Ce sens est celui d'un retour à l'essence ou, pour employer un vocabulaire plus expressif, d'une compréhension et d'une explicitation (d'un déploiement) de ce qui appartient en propre à l'homme, de son essentiellement possible. La possibilité essentielle de l'homme, dit Heidegger, est sa liberté. Cette liberté est liberté-pour-fonder-un-monde, c'est-à-dire — si l'on considère les textes que Heidegger a pu écrire “en situation” — liberté que l'homme en tant que porté-par-un-peuple reçoit de la pro-venance, du destin du peuple. La liberté humaine est liberté pour la fidélité à ce destin. Dès lors, la volonté peut être sortie du cadre métaphysique. Il suffit de la penser comme résolution de soi dans le déploiement du destin d'un peuple.
Cette définition peut être difficile à recevoir en tant que notion à penser. Nous sommes, de toute évidence, encore trop conditionnés à penser la volonté comme l'attribut d'un ego absolu. Que dans une pensée radicalement différente de la volonté, l'ego doive se dissoudre (au moins en apparence) dans ce qui ne saurait se ramener à aucun “je”, le destin d'un peuple, voilà qui ne peut que troubler. Ceux qui, les premiers, ont reçu l'appel d'un peuple n'en ont-ils pourtant pas déjà fait l'expérience ? Le peuple dont nous relevons n'est pas en tant que présence ; il est en tant que venant. Nous ressentons son appel, et l'essence de notre action réside dans notre réponse à cet appel. Cette réponse n'est autre que l'expérience que nous faisons déjà de la liberté comme fidélité au destin d'un peuple. Chacun à un moment tragique de leur existence, Heidegger et René Char se sont retrouvés pour reconnaître que « toute grandeur est dans le départ qui oblige ». Cette simple phrase dit tout. L'engagement est fidélité résolue au destin du peuple qui nous appelle en tant qu'“à-venir”.
Quels sont les rapports existant entre le sacré et l'auto-affirmation telle que nous la concevons ? Plus précisément, quelle expérience du sacré avons-nous en tant que nous manifestons cette auto-affirmation ? Répondre à cette question, ce n'est pas dire ce qu'est le sacré aujourd'hui, tâche peut-être impossible, mais dire où il est. Panta : en : voilà Héraclite et voilà où est le sacré. Gott ist in mir das Feuer, ich bin ihm der Schein (Dieu est en moi le feu, je suis en lui l'éclat lumineux) : voilà Silesius et voilà où est le sacré. L'intuition que nous avons du sacré est qu'il réside dans une unité essentielle, et que c'est dans sa lumière que se déploie cette unité. Les textes sacrés indo-européens ne disent pas autre chose : ils disent la lumière dans laquelle un peuple se maintient en tant que peuple, c'est-à-dire la lumière dans laquelle se fait l'unité d'un monde. (Ainsi dans les Védas, où le sacrifice est pris comme acte de soutien du monde).
Que le sacré puisse ou non se passer de dieux, c'est là une question qui vient trop tard ou trop tôt. Quand un dieu est reconnu comme figure, c'est qu'il a déjà cessé d'être en tant que dieu. Qu'est-ce donc qu'un dieu ? Voilà une interrogation face à laquelle la prudence s'impose. Lorsque Friedrich Georg Jünger évoque Apollon [in : Nouvelle école n°35, 1979], il parle d'un dieu qui n'est rien d'humain, qui ne symbolise en aucune façon quelque chose d'humain. Le seul Apollon dont il a voulu s'approcher est celui dont les Grecs de la haute époque avaient l'expérience, qui aussi le seul qui puisse nous concerner. Tout questionnement sur la “réalité effective” du dieu, questionnement nécessairement métaphysique, car refusant d'emblée de prendre en compte ce par quoi le dieu se tourne vers les hommes pour mieux pouvoir le mesurer à un seul critère d'existence “objective”, nous semble oiseux. Relisons ce texte. Apollon y est délivré comme énigme. Cette énigme n'a rien à voir avec les mystères des religions révélées ; elle ne contient ni n'inspire aucun credo, et même elle rejette tout credo comme lui étant essentiellement étranger. Mais elle n'en a pas moins ce caractère incontournable d'inconnu, où Heidegger a cru retrouver le signe premier de la divinité. Quelle est donc l'énigme qui a nom “Apollon” ? Elle n'est pas tel ou tel caractère, tel ou tel attribut, telle ou telle apparence du dieu. L'énigme est l'unité des aspects du dieu, le rassemblement de ses aspects, de ses Scheinen, de ses “apparaître” au sein d'un même. Cette unité est le divin dans Apollon, et la divinité elle-même.
L'unité qui a pour nom “peuple” est aussi un tel mode d'approche de la divinité. Plus précisément, elle est à la fois le mode par lequel la divinité s'approche de l'homme dans le peuple, et le chemin par lequel l'homme en tant que porté-par-un-peuple s'approche de la divinité. Cette unité — qu'encore une fois il serait absurde de penser comme « unité d'un ensemble » — est le non-humain en l'homme. On pourrait alors reprendre, en la modifiant à peine, la sentence de Silesius : Das Volk ist in mir das Feuer, ich bin in ihm der Schein. Considérant le mot Schein dans le sens du grec phainestai, sa signification deviendrait la suivante : « Le peuple est en moi le feu, la flamme » (il est ce qui m'anime, me fait moi, me donne accès à mon essence, ce en quoi j'ai liberté de m'affirmer en tant que l'homme que je dois être), « Je suis en lui l'éclat de l'apparaître » (en tant qu'homme, je suis un aspect, un mode de l'apparaître du peuple, et ceci, en moi, est l'énigme et aussi, peut-être d'abord, le sacré).
On dira encore : quel rapport y-a-t-il entre l'expérience que nous faisons du sacré dans la “nature”, face à (et dans nos rapports avec) l'existant dans son ensemble, et l'unité ? Cette question est assez vaine. Car où donc se réalise l'unité du monde sinon dans une perception de l'existant dans son ensemble, qui, est, comme le dit Heidegger, une “prise en garde” ? Il nous faut en fait réapprendre à penser le monde comme destin, et dépasser autant qu'il est possible la perception comme “activité d'un sujet”. Tant que l'homme demeure en son essence, le monde n'est jamais un “dehors” auquel l'homme aurait accès en tant que sujet. L'homme ne voit le monde en tant que monde qu'autant qu'il est lui-même l'apparaître d'un peuple. Unité du peuple et unité du monde sont deux modes d'un même.
Nous autres aussi, bien que vivant en une époque où règne en maître la perception “objective” propre à l'individu (c'est-à-dire à ce que Heidegger appelait le « semi-homme »), nous faisons cette expérience. Si nous trouvons du sacré dans la “nature”, c'est que nous la voyons, non en tant qu'individus, non en “sujets-voulants-décidant-de-l'investir”, mais en hommes portés-par-un-peuple, le peuple européen, qui, rassemblé sur son essence (le “passé”), nous enjoint par son appel de le faire-venir à une nouvelle présence. Si la “nature”, pour nous, contient du sacré, ce n'est pas parce que nous y en avons mis, et pas non plus parce qu'elle nous renverrait l'image, au moins potentielle, de notre propre “volonté de puissance”, mais bien parce qu'un peuple est encore quelque peu en nous le « feu », même si nous n'en sommes encore que confusément l'« éclat ». Et c'est ce « feu » (das Feuer), constitutif de notre identité essentielle, de notre « hespérialité », qui est ce en quoi se dépose notre perception du monde, et donc aussi ce par quoi se réalise l'unité de notre monde.
Matin passé et matin venant sont les mêmes
 Que le sacré ait donc beaucoup à faire avec l'auto-affirmation de l'homme en tant que mode de l'apparaître d'un peuple, c'est ce que l'on ne saurait nier. Unité du monde, unité du peuple : le même. Le même, mais pas « la même chose » — et, sur ce point, nous renverrons à ce que Heidegger a pu écrire dans le texte, essentiel, intitulé Identité et différence. En tant que le même, unité du monde et unité du peuple se trouvent dans un rapport de co-propriation, ce qui revient à dire qu'ils s'y cherchent pour y trouver ce qui est à chacun son propre. Le point, le “nœud” autour duquel s'enroulent ces “deux” unités est proprement pour nous le plus proche et le plus lointain. Il est, au sens le plus profond, le lieu de venue du sacré.
Que le sacré ait donc beaucoup à faire avec l'auto-affirmation de l'homme en tant que mode de l'apparaître d'un peuple, c'est ce que l'on ne saurait nier. Unité du monde, unité du peuple : le même. Le même, mais pas « la même chose » — et, sur ce point, nous renverrons à ce que Heidegger a pu écrire dans le texte, essentiel, intitulé Identité et différence. En tant que le même, unité du monde et unité du peuple se trouvent dans un rapport de co-propriation, ce qui revient à dire qu'ils s'y cherchent pour y trouver ce qui est à chacun son propre. Le point, le “nœud” autour duquel s'enroulent ces “deux” unités est proprement pour nous le plus proche et le plus lointain. Il est, au sens le plus profond, le lieu de venue du sacré.
Ce “nœud”, qui correspond peut-être à ce que Heidegger a interrogé sous le nom d'Ereignis, nous apparaît, à nous aussi, comme question. Il ne s'agit pas d'une question à résoudre, mais d'une question à déployer. Que signifie ce terme ? Certainement pas aligner des propositions logiques ou paralogiques. Déployer la question du lieu de venue du sacré, c'est fonder le sacré en tant que sacré, et, du même coup, le peuple en tant que peuple. Heidegger en était arrivé à dire : Ereignis ereignet ; et il ajoutait : « c'est tout ». Ce « c'est tout » ne pose pas une fin, mais ouvre un horizon, en ce sens qu'il est un ordre de « départ pour l'assaut » ; et dans ce départ, est toute grandeur. Il signifie, si l'on peut dire, laisser Ereignis ereignen, c'est-à-dire répondre à l'appel qui nous enjoint de prendre en notre garde la « croissance de ce qui est petit » — la venue d'un peuple que nous nommerons peut-être hespérial. Là et là seulement est l'auto-affirmation.
Que dire maintenant de la technique ? Pour beaucoup, aujourd'hui, la technique reste quelque chose de “mécanique”, de “machinal” : un zu-Hand, dont l'homme aurait usage en tant que sujet, et sur lequel il pourrait agir. Une telle conception nous semble erronée. Cette apparence que prend la technique d'objet à la disposition d'un homme-sujet n'est qu'un leurre, ou plutôt un masque. (Ce qui ne veut pas dire qu'elle soit fausse, car il n'y a jamais d'apparence “fausse”). Quitte à tout décrire en termes de sujet et d'objet, c'est bien plutôt la technique qu'il faudrait considérer comme “sujet”, et l'homme désintégré du “on” qu'il faudrait voir comme “objet”. La technique n'est un outil pour le bien-être ou la puissance que pour les hommes du nihilisme achevé. En fait, elle n'est pas un outil du tout. Elle est ce qui nous enjoint de voir l'étant comme objet, et l'être comme efficience. Cette injonction se confond avec la nuit où les peuples se sont perdus eux-mêmes, et le danger — ce « désert qui croît », ainsi que Nietzsche nous en a avertis — est que, dans cette nuit de la technique mondiale, l'homme finisse par perdre tout lien avec son essence.
Relisons Nietzsche. S'il y a, aujourd'hui, un “seigneur de la terre”, c'est bien le « dernier homme » dont parle Zarathoustra, le « semi-homme » évoqué par Heidegger dans son texte sur le Service du Travail. C'est lui l'engeance aveugle et oublieuse qui règne en maître dans la nuit de la technique mondiale. Qui règne sur quoi ? Non pas sur la terre, qui, en tant que phénomène, qu'entité ou mode du Geviert, lui est interdite, mais sur le désert.
Quel est alors le salvateur qui vient avec l'ère de la technique ? On dira : l'être, en tant que lumière du matin qui se dévoile comme telle aux hommes du soir (Jean Beaufret). C'est dire trop et pas assez. On dira encore : l'Ereignis, en tant que signalé, devancé dans notre pensée, par le Gestell. Cette réponse, identique en fait à la précédente, ne nous mène pas plus loin. Il faut rappeler, en effet, que l'expérience que l'homme de l'aurore grecque avait de l'être ne s'est déployée en un monde que pour autant que l'être a pris cet homme en tant que son Dasein, c'est-à-dire, finalement en tant que peuple. Et de même, l'Ereignis implique la conjonction de l'unitépeuple et de l'unité intérieure de l'homme en tant que liberté pour l'accomplissement du destin du peuple.
Que deviennent alors la poiésis et la téchnè ? En quoi sont-elles, identifiées comme au cœur de la technique, de l'ordre de ce qui sauve ? Sûrement pas dans le sens où nous aurions le pouvoir d'investir d'un “sens nouveau” la production d'objets techniques. On ne peut asseoir sur la technique la tâche « destinale » de faire-venir d'un peuple. La poiésis nous regarde dans la mesure seulement où elle n'est au cœur de toute production technique d'objets que parce qu'elle est au cœur de tout faire-venir, de toute éclosion à la présence. Elle nous regarde d'abord en ceci que nous savons, comme on a savoir d'une évidence secrète, que vers nous s'est tourné ce qui « est encore petit », ce qui appelle à croître dans le danger. Et cela qui nous “appelle”, étant encore petit, pour qu'en son « faire-venir » nous trouvions notre liberté et notre destin, est un peuple et rien d'autre.
Le monde n'est jamais fait d'objets. Le monde est destin de l'homme en tant que Dasein, ce qui signifie : le monde est monde pour autant qu'il est demeure de l'homme, et l'homme, lui, n'est homme qu'en tant que porté-par-un-peuple. Nous ne ferons pas venir à la présence le peuple qui nous appelle en tant qu'« à-venir » en nous efforçant de donner un autre “sens” à des objets, quels qu'ils soient. Les étants ne seront rendus disponibles pour un usage poiétique qu'une fois délivrés à cet usage par un peuple. Ne confondons donc pas les racines et les derniers rameaux de l'arbre. C'est un peuple — nos racines — qui est à « pro-duire », et non pas une “nouvelle technique”.
Mais comment “pro-duit”-on un peuple ? On ne peut, à cet égard, qu'envisager un horizon appelé, une fois atteint, à disparaître pour céder la place à un autre. La pro-duction d'un peuple ne saurait en effet avoir de “fin”. Elle est un acte continu. Dans l'immédiat, il faut lutter par tous les moyens contre l'idée de l'homme-sans-peuple, du « semi-homme », de cet individu moral qui peut d'autant mieux se construire un “humanisme” qu'il a oublié l'être et s'est ainsi détourné de l'essence de l'homme. Sur notre chemin, nous sommes guidés par une lumière qui, n'étant aucune lueur nocturne, ne peut être que celle du matin. Matin passé et matin venant sont pour nous les mêmes. Ma certitude la plus profonde est que nous sommes voués à ce matin.
► Patrick Simon, Nouvelle École n°37, 1982.
◘ Notes :
(1) Cf. not. Alain de Benoist, Comment peut-on être païen ?, Albin Michel, 1981.
(2) Là réside l'erreur de ceux qui, tel Pierre Chaunu dans La mémoire et le sacré, tirent argument de la non-opposition entre sacré et profane pour affirmer, de façon plutôt légère, que le paganisme est fondamentalement théocratique.
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, sacralité, tradition |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
par Arefeh Hedajazi
Ex: http://mediabenews.wordpress.be/