mercredi, 20 août 2025
L'échec historique des démocraties libérales

L'échec historique des démocraties libérales
par Andrea Zhok
Source: https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/31036-andr...
« L'égoïsme individualiste promu par le libéralisme a produit des représentants autoréférentiels, la privatisation des profits et l'impuissance des peuples, du krach subprime au génocide palestinien délibérément ignoré par les médias dominants. La volonté populaire est vidée de son sens, tandis que les médias et les institutions répriment toute dissidence. Un système oligarchique déguisé se consolide ».
De la « crise des subprimes » au génocide palestinien actuel retransmis en direct dans le monde entier, ce qui frappe, c'est la manifestation flagrante de l'échec historique des démocraties libérales.
Avant d'aborder ce sujet, il convient de réfléchir un instant à ce qui rendrait, en principe, un régime démocratique qualitativement meilleur que les alternatives autocratiques ou oligarchiques.
L'avantage théorique des systèmes démocratiques réside dans leur plus grande souplesse et leur réactivité potentielles pour répondre aux besoins de la majorité. En d'autres termes, un système démocratique peut être considéré comme comparativement meilleur dans la mesure où il permet une communication facilitée entre le haut et le bas, entre les individus les moins influents et les individus plus influents, entre ceux qui ne détiennent pas le pouvoir et ceux qui le détiennent.
Les systèmes autocratiques ou oligarchiques présentent le défaut de faire de l'écoute des sans pouvoir un choix facultatif pour ceux qui sont au sommet. En l'absence de systèmes de communication efficaces de bas en haut (il existait des choses comme les « audiences royales », mais elles avaient un caractère manifestement improvisé), il faut compter sur l'intérêt et la bienveillance des dirigeants pour que les intérêts du peuple soient pris en compte.
Or, il serait erroné de penser que de telles situations d'intérêt et de bienveillance de la part des dirigeants ont été rares dans l'histoire, mais les éléments d'arbitraire et d'aléatoire étaient évidents, et un empereur, un roi ou un souverain éclairé pouvait être remplacé par un autre insensible, obtus, belliciste, etc.
L'avantage comparatif du modèle démocratique semble évident, mais il est important de comprendre qu'il repose sur UN SEUL ET UNIQUE POINT, à savoir la grande perméabilité de la communication entre le haut et le bas et le contrôle du bas vers le haut.
Si l'on supprime cet élément, d'autres facteurs, tels que la linéarité décisionnelle, peuvent faire pencher la balance en faveur des gouvernements autocratiques, qui ont toujours l'avantage de pouvoir mettre en œuvre plus facilement que les démocraties les décisions du pouvoir exécutif (c'est la raison pour laquelle, dans les états en guerre, même les systèmes démocratiques prévoient la centralisation du pouvoir au sommet de la hiérarchie décisionnelle).

Cependant, la démocratie idéale est la démocratie directe, qui ne peut toutefois fonctionner qu'à une échelle limitée, où la discussion personnelle et la décision publique peuvent avoir lieu directement et efficacement.
Aujourd'hui, grâce à certains supports technologiques, il serait peut-être possible d'étendre bien au-delà des dimensions classiques de l'Agora le nombre de personnes impliquées dans une forme de démocratie directe, mais il est illusoire de penser que l'on puisse se passer d'une médiation lorsque les chiffres impliqués sont de l'ordre de millions. C'est pourquoi les démocraties modernes sont des démocraties représentatives.
Et c'est là qu'intervient un problème bien connu de nature éthico-politique: pourquoi un représentant élu devrait-il défendre les intérêts de ceux qui l'ont élu ?
Il est important de comprendre qu'un contrôle capillaire par la base des représentants est techniquement impossible.
L'asymétrie d'information entre ceux qui gèrent le pouvoir et ceux qui doivent joindre les deux bouts est incompressible.
Pour ceux qui détiennent le pouvoir, il n'est pas difficile de prétendre que les raisons de leurs actions sont différentes de celles qui les motivent réellement (« il suffit d'une pincée de social », disait récemment un prétendu défenseur des revendications populaires).
Et même lorsque la dissimulation finit par être découverte, les possibilités de revanche sont extrêmement limitées: après 4 ou 5 ans, on peut s'abstenir de le soutenir.
Quelle peur !
Cette dérive ne peut être limitée que par la tempérance morale de l'élu, par son envergure idéale.
Mais nous sommes ici confrontés à un problème colossal spécifiquement lié aux démocraties LIBÉRALES.
Le libéralisme, abstraction faite des significations secondaires et peut-être louables que l'on peut tirer du chapeau de l'histoire, est essentiellement une idéologie qui encourage l'égoïsme individualiste et la compétition de tous contre tous.
Il le fait systématiquement.
C'est la première et unique théorie morale qui affirme que la poursuite individuelle de ses propres intérêts, sans conditions, finira toujours par profiter à tous (la « main invisible » du marché).
Cette théorie est manifestement une idiotie nuisible.

Dans une atmosphère culturelle libérale, qui promeut l'égoïsme individuel et la concurrence illimitée, tout en dépréciant toute forme de valeur objective, toute valeur de devoir moral et tout fondement idéal et religieux, il n'y a aucune raison au monde de s'attendre à ce qu'un représentant élu cherche autre chose que ses propres intérêts.
Bien sûr, tout le monde ne suit pas le canon libéral, mais celui-ci est statistiquement prédominant dans les démocraties libérales.
Ce qui en découle est banal: plus la vie d'une démocratie libérale se prolonge, plus les vestiges de croyances éthiques différentes ont tendance à s'estomper, et plus une classe de représentants autoréférentiels, à la solde du plus offrant et essentiellement de mèche entre eux pour préserver leurs positions de pouvoir, fait son apparition.
Il n'y a donc aucun mystère à ce qu'un système continue de fonctionner dans lequel les profits sont privatisés et les pertes imputées au public (voir la crise des subprimes), où, depuis le référendum grec de 2015 jusqu'à l'actuel Rearm Europe, la volonté populaire ne compte pour rien, où des foules immenses peuvent manifester pendant des années contre le génocide palestinien tandis que les chefs d'État prennent des selfies avec Netanyahu, etc.
Souvent, on ne remarque même pas ces divergences d'intérêts et de valeurs, car les chiens de garde de l'« information publique » parviennent à façonner une opinion publique fatiguée et distraite (tout le monde n'a pas le temps de mener des enquêtes privées sur chaque information).
Mais même lorsque cette distance entre les intérêts du plus grand nombre et les actions de la classe dirigeante apparaît tout à fait flagrante, rien ne change.
Aujourd'hui, le spectacle de l'impuissance absolue des peuples libéraux-démocrates triomphe sur toutes les chaînes.
Et pendant ce temps, sous les formes les plus éhontées, les « institutions » s'efforcent de faire taire même les quelques éléments résiduels de perturbation, de protestation dans la rue, de contestation sur les réseaux sociaux.
Et les « chiens de garde » avec leur journal et leurs slogans dans la gueule vous expliquent que le harcèlement moral et la diffamation ont lieu au nom de l'inclusion; que la censure et les sanctions ont lieu au nom de l'information; que les charges des matraqueurs et les jets des canons à eau ont lieu pour défendre la sécurité publique; que les provocations et la course aux armements sont nécessaires au nom de la paix ; etc. etc.
20:18 Publié dans Actualité, Définitions, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : démocratie, démocratie libérale, actualité, définition, théorie politique, politologie, sciences politiques, libéralisme, individualisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 19 février 2025
Max Stirner, Ferdinand Tönnies et les Notions de Communauté

Max Stirner, Ferdinand Tönnies et les Notions de Communauté
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/max-stirner-ferdinan...
ÉCRIVANT dans son œuvre de 1844, L'Unique et sa Propriété, le philosophe anarcho-individualiste Max Stirner (1806-1856) déclara :
« Nous deux, l'État et moi, sommes ennemis. Moi, l'égoïste, je n'ai pas à cœur le bien-être de cette 'société humaine'. Je ne lui sacrifie rien, je ne fais que l’utiliser ; mais pour pouvoir l'utiliser pleinement, je la transforme plutôt en ma propriété et ma créature : c'est-à-dire que je l'anéantis et que je forme à sa place l'Union des égoïstes. »
Prenant l'exemple des personnes qui prêtent allégeance à une religion sous une forme ou une autre, Stirner poursuivit en affirmant :
« Chacun est un égoïste et d'une importance capitale pour lui-même. Le juif n'est pas purement égoïste, car il se consacre encore à Jéhovah ; le chrétien ne l'est pas non plus, car il vit de la grâce de Dieu et se soumet à lui. En tant que juif et en tant que chrétien, un homme ne satisfait que certains de ses besoins, une certaine nécessité, mais pas lui-même : un demi-égoïsme, car l'égoïsme d’un demi-homme, qui est à moitié lui-même, à moitié juif, ou à moitié son propre maître, à moitié esclave. C'est pourquoi, aussi, le juif et le chrétien s'excluent toujours à moitié ; en tant qu'hommes, ils se reconnaissent mutuellement, en tant qu'esclaves, ils s'excluent, car ils sont les serviteurs de deux maîtres différents. S'ils pouvaient être des égoïstes complets, ils s'excluraient totalement et se tiendraient d'autant plus fermement unis. »

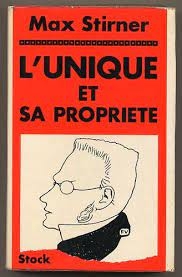
Un libéral pourrait soutenir que chrétiens et juifs doivent mettre de côté leurs différences religieuses et embrasser une 'humanité' commune, mais ce que propose Stirner est bien plus radical : une unité dans la diversité. En effet, plutôt que d'échanger un 'fantôme' contre un autre, l'égoïsme s'accomplit par la reconnaissance du pouvoir de ses propres capacités. S'il y a ceux qui, comme moi, favorisent une interprétation plus holistique de l'anarchisme et d'autres qui préfèrent l'égoïsme individualiste prôné par Stirner, il n'en reste pas moins que le national-anarchisme semble apporter une réponse à ce problème apparemment insoluble.
Reconnaître qu'un individu peut se sentir partie intégrante d'un tout organique tout en conservant son individualité s'accorde parfaitement avec l’'union des égoïstes' de Stirner. En raison de notre rôle en tant que mouvement regroupant des personnes d'horizons politiques divers ayant mis de côté leurs différences pour œuvrer en faveur d'une décentralisation radicale et d'alternatives réelles au statisme et à la mondialisation, les partisans et sympathisants du milieu national-anarchiste incluent des post-gauchistes, des anticapitalistes, des anarchistes chrétiens, des séparatistes raciaux, des anarcho-primitivistes, d'anciens nationalistes, des antifascistes, des ex-fascistes, des post-strassériens et même des anarcho-individualistes dans la lignée traditionnelle de Stirner. Bien que ce mouvement ait été qualifié de 'fascisme' clandestin par la gauche, ce phénomène rejetant tout dogme représente probablement la variante la plus ouverte d'esprit, non coercitive et libre de l’anarchisme moderne. À cet égard, le national-anarchisme a donc le potentiel d'agir comme un véhicule à la fois pour les communautaristes et les égoïstes. Cela n'est possible que si nous établissons une distinction cruciale entre deux termes souvent confondus.
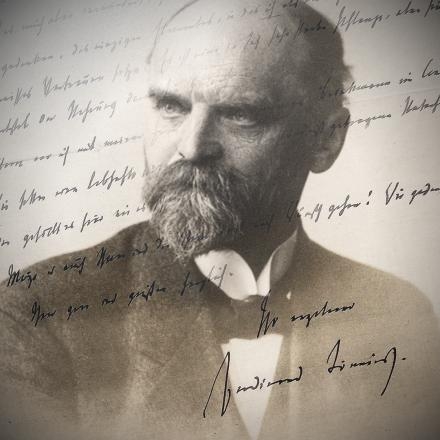
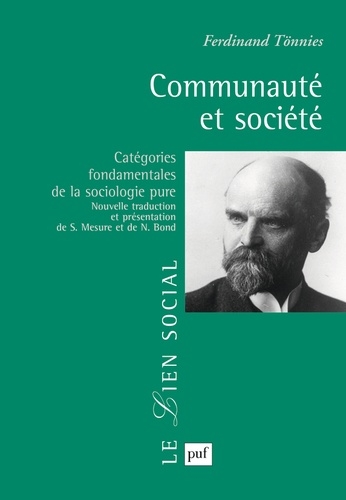
Le sociologue allemand Ferdinand Tönnies (1855-1936) publia en 1887 Communauté et Société, dans lequel il affirmait que l'Europe du 19ème siècle dégénérait en un esprit de masse et que le mot 'communauté' (Gemeinschaft) possédait donc bien plus de validité que celui de 'société' (Gesellschaft). La première, expliquait-il, est davantage un organisme vivant que la seconde et, plutôt que de ne représenter qu'un simple « agrégat mécanique et artefact » purement « transitoire et artificiel », une communauté possède une plus grande longévité qu'une société et est donc bien plus bénéfique.
Les sociétés, contrairement aux divisions intentionnelles ou aux communautés soudées, ne reposent pas sur des valeurs partagées, mais sur des lois, la répression et d'autres formes de coercition. En réalité, au sein d'une communauté, les individus sont « unis malgré toutes les divisions », tandis que dans une société de masse, ils sont « divisés malgré toute unité ». Ainsi, bien qu'un individualiste de type stirnérien puisse ne pas souhaiter faire partie d'une communauté plus large, il peut néanmoins s’unir à elle dans son opposition à l’État et à la société de masse.
21:43 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : max stirner, ferdinand tönnies, communauté, société, anarchisme, communautarisme, national-anarchisme, individualisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 06 avril 2024
Le mensonge de Robinson

Le mensonge de Robinson
par Roberto Pecchioli
Source : EreticaMente & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-menzogna-di-robinson
En ces temps de culture de l'effacement, où même la musique de Beethoven et les épopées d'Homère sont mises à l'index selon le jugement sans appel du présent, où Shakespeare est accusé de sexisme, d'antisémitisme et de mépris pour les handicapés, il est curieux que l'une des œuvres les plus significatives de la littérature anglaise, Robinson Crusoé (1660-1731) de Daniel De Foe, soit rarement remise en question. Publié en 1719, il a immédiatement connu un succès extraordinaire qui perdure encore aujourd'hui, bien qu'il soit surtout considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature enfantine. L'intrigue est bien connue: le marin Robinson s'échappe du naufrage de son navire et débarque sur une île déserte où il vit seul pendant douze ans. Il se débrouille comme il peut, trouve la foi en Dieu et rencontre alors un indigène, un "bon sauvage", qu'il sauve d'une tribu cannibale. Il l'appelle Vendredi, du nom du jour de la semaine où il le rencontre, l'éduque, lui apprend l'anglais et en fait un sujet. Au bout de vingt-huit ans, Robinson parvient à retourner à la civilisation avec Vendredi, pour vivre d'autres aventures avec lui. Son île, quant à elle, devient une colonie espagnole pacifique, dont il est nommé gouverneur.
Peu d'intrigues sont plus politiquement incorrectes que celle de Robinson. Pourquoi, alors, n'est-il pas attaqué par les "woke" avec la véhémence qui n'épargne pas Dante et Michel-Ange - sa chapelle Sixtine ne représente, par culpabilité, que des Blancs - jusqu'à Aristote, répudié pour avoir justifié - dans la Grèce du IVe siècle avant J.-C. - l'esclavage ? Même les woke en colère ont une laisse et une chaîne, celle du sommet du mondialisme, des maîtres qui les ont placés dans le fauteuil, à la tête des journaux, des chaînes de télévision, des maisons d'édition et des centrales du divertissement. La raison en est simple: Robinson est un symbole, la représentation parfaite de leur idéologie, l'un des mythes fondateurs de l'individualisme libéral.

De Foe (tableau, ci-dessus) représente en Robinson le caractère des Lumières britanniques, la montée de la bourgeoisie mercantile, triomphante dans le sang de la Glorieuse Révolution proto-libérale de la fin du XVIIe siècle, la croyance en la raison, la religiosité moraliste puritaine, toujours présente - bien que bouleversée dans ses valeurs - dans la culture d'annulation anglo-saxonne d'aujourd'hui. Robinson exalte la mentalité individualiste qui sous-tend la société capitaliste naissante. Celle-ci s'efforce de plier la nature à ses besoins, de dominer la nature sauvage, en ne faisant confiance qu'à ses forces, éclairées par la raison et soutenues par la technologie. James Joyce a vu dans ce livre le manifeste de l'utilitarisme anglais qui, au début du XIXe siècle, avait trouvé en Jeremy Bentham son plus grand théoricien. Le personnage de Vendredi a été repris par Jean Jacques Rousseau dans l'archétype pédagogique du "bon sauvage" de l'Emile.
C'est pourquoi Robinson échappe à la censure: à sa manière, il est politiquement correct, ou du moins acceptable. Le politiquement correct est une forme de mensonge et doit être contré non pas par son antonyme, l'incorrection, mais par la vérité. Dans l'Europe de l'époque de De Foe, personne n'était un naufragé dans la mer de l'histoire. La société traditionnelle était un ensemble de racines, de dépendances mutuelles et de loyautés dont dépendait la survie de la communauté: un ensemble organique, une immense famille, une figure quasi biologique dans laquelle l'esprit de la terre et les générations précédentes confirmaient les coutumes et les croyances collectives sans qu'il soit nécessaire d'établir des constitutions écrites.
L'idée de l'individu est un produit de l'ingéniosité littéraire et non de la nature humaine. Pour le lecteur des XVIIIe et XIXe siècles, l'exemple de Robinson Crusoé, l'homme qui se prend en charge et parvient à optimiser des ressources rares grâce à son initiative et à ses connaissances techniques sur une île déserte, est devenu la parabole favorite du libéralisme européen et américain, dont Daniel De Foe a été - sans le savoir - le premier prophète. D'autres fables heureuses ont ensuite accompagné le développement du mythe : les vices privés qui deviennent des vertus économiques (Mandeville) ; la main invisible du marché (Adam Smith - portrait, ci-dessous) qui règle et résout tout dans l'intérêt ; la loi qui fait d'une chimère, la poursuite du bonheur inscrite dans la constitution américaine, un objectif de haute force symbolique.

L'homme rationnel, indépendant, libre, libéré des contraintes, abstrait, naufragé sans histoire et sans racines, est l'ancêtre, le totem de l'homo oeconomicus contemporain: apatride, monade destinée à la production et à la consommation parfaitement interchangeable avec n'importe quelle autre. L'étonnant paradoxe de l'individualisme: des millions d'atomes identiques convaincus d'être uniques. La faiblesse de l'aventure robinsonnienne est qu'elle exige d'abord le naufrage, la solitude, l'absence de lien social. Au bout du compte, l'Anglais aride et morne finit par rencontrer un Vendredi. Le naufragé éclairé et "civilisé" colonise le sauvage, l'innocent Caliban de la Tempête de Shakespeare qui tombe entre ses mains, lui donne un nom - manifestation absolue de pouvoir, acte qui ne peut être accompli qu'avec un nourrisson ou un animal domestique -, le réduit à ses catégories morales et le soumet à un processus paternaliste d'acculturation qui le dénature.
Ces mêmes actions montrent que Robinson n'est pas un individu qui surgit du néant, mais une personne qui a des racines culturelles, identitaires, spirituelles: sans l'héritage millénaire du christianisme, il aurait probablement mangé ou tué Vendredi. Sans son éducation, l'apprentissage de la division du travail et de la technologie, il n'aurait pas exploité son serviteur avec autant de profit. Après tout, les Anglais pratiquaient le trafic d'esclaves depuis le XVIe siècle, avec la bénédiction de la couronne, qui délivrait aux entrepreneurs du vol et de l'inhumanité tels que Francis Drake et Walter Raleigh une autorisation spécifique, la "lettre de passage", et les érigeait en baronnets pour leurs tristes succès.
Robinson Crusoé a connu un immense succès dans l'Europe des Lumières et il n'est guère d'essayiste de l'époque qui ne le cite. Bernardin de Saint Pierre - écrivain et scientifique - Chateaubriand, mais aussi Rousseau, ont trouvé leur inspiration dans ce classique qui a enchanté d'innombrables enfances, dont la nôtre. Mais il aura fallu que Robinson se retrouve sur une île déserte, devienne une épave, un atome humain à la dérive pour devenir l'un des héros de l'individualisme libéral. Et devenir une sorte de Jean-Baptiste - le précurseur annonçant la naissance de ceux qui viendront après lui - de la modernité naissante, de l'homme nouveau engagé à fonder son paradis sur les ruines du monde traditionnel. Paradoxalement, ceux qui deviendront les chantres de l'individualisme sont des gens solidement organisés en corporations, actionnaires de banques et fondateurs des premières compagnies d'assurance, des personnages respectables membres de "guildes" et de corps de métiers, la bourgeoisie de Rembrandt et de Frans Hals, premiers acteurs de l'épopée séculaire du marchand, leur protecteur.
L'argent a toujours eu besoin de lois, de gendarmes, de prisons, d'Etats, de juges. Robinson était l'image que les puissances montantes des XVIIIe et XIXe siècles se faisaient d'elles-mêmes, une idéalisation de l'individu proactif qui permettait à quelques-uns d'exploiter sans pitié une masse de millions de Vendredi à la peau blanche et chrétienne, l'ancêtre de Kurtz dans Au cœur des ténèbres. Les universitaires anglo-saxons ne se soucient pas de cette gigantesque exploitation indifférente à la race et ne réclament pas de réparations historiques pour les héritiers des pauvres Européens blancs. C'est la mystique inversée - intouchable - du libéralisme, dont la neutralité/l'indifférence morale justifie toutes les infamies commises au nom de l'intérêt personnel.
L'histoire déclenchée par le type humain dont Robinson est le héros éponyme est dramatique : lois sévères contre les pauvres, enclosures des champs communaux (enclosures qui ont poussé des millions de paysans privés de subsistance vers les usines), enfers industriels de Manchester et de Birmingham, landlords vantant les vertus morales du travail des enfants dans les mines et les filatures. L'Angleterre, dominée par l'oligarchie qui en est encore aujourd'hui l'architrave, a été la première à penser à limiter la croissance de la pauvreté non pas par une juste répartition des revenus, mais en imposant des limites à la reproduction biologique des misérables. L'élevage contrôlé du bétail humain prolétaire esquissé par le révérend Malthus est aujourd'hui concrétisé par le mondialisme anti-humain, qui considère l'avortement et l'euthanasie comme philanthropiques. "Son intérêt supérieur", peut-on lire dans la sentence qui a condamné à mort l'enfant malade Alfie, faute de soins.
Depuis Robinson, les riches donnent des leçons de morale: les guerres de l'opium en Orient ont été déclenchées pour défendre le libre-échange. Peut-on s'étonner de l'indifférence actuelle face à la propagation des drogues ? Robinson l'utilitariste, l'inépuisable homo faber, est le protagoniste de l'agonie de la beauté (à quoi sert-elle ?): la laideur à grande échelle, la fonctionnalité comme icône du profit, l'expression ultime de la rationalité libérale.

Karl Friedrich Schinkel, le grand architecte néoclassique prussien, a visité les villes industrielles d'Angleterre, sombres, enfumées, dépourvues de services, grouillant d'une humanité appauvrie et échevelée sous les "noirs moulins sataniques" haïs par le poète William Blake. Il repart en pleurant : c'était un homme de l'ancien régime. La révolution industrielle anglaise, qui a commencé à l'époque de De Foe, a été la première révolution libérale, plus que la révolution américaine de 1776. Celle de la France fut un chaos causé par le vide d'une noblesse débauchée qui avait renoncé à son rôle de leader.
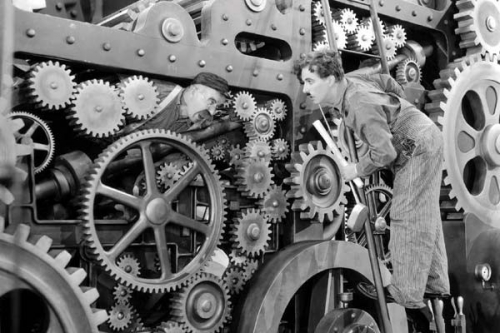
Le libéralisme est le bras politique du système qui a ensuite trouvé dans la social-démocratie une soupape de sécurité servile. Le capitalisme a besoin d'ordre, de discipline, d'horaires, de division du travail ; Charlie Chaplin, dans Les Temps modernes, a représenté la chaîne de montage avec la précision plastique du génie. L'exploitation intensive de ces enfers (réserves de plus-value !) emploie des voyous pires que ceux des mines des Indes. L'enfant et la femme deviennent des instruments du processus de production. L'expansion des marchés passe par la destruction des sociétés traditionnelles : toute transformation du système de production impose d'innombrables sacrifices. En Espagne, les confiscations du 19ème siècle ont conduit à la transformation des paysans en ouvriers affamés, à la destruction du patrimoine artistique, à la déforestation et à un état de guerre civile permanent. Les libéraux ont apporté la liberté à ceux qui en avaient les moyens. Le suffrage censitaire était l'ancêtre grossier de la partitocratie actuelle, où le peuple plébiscite des candidats payés par les oligarques.
La démocratie est formelle car le pouvoir réside dans les conseils d'administration. Les marchés, hypostases terrestres de la divinité, décident mieux que nous. L'individualisme du naufragé Robinson est une revendication idéologique, une publicité. Un solvant, un acide nihiliste qui corrode toute forme de communauté, détruit tout lien, coupe toute racine. Vendredi perd son nom, son dieu, sa langue et sa mémoire. C'est la seule façon pour lui de servir Robinson. La dérive matérialiste du naufragé Crusoé, devenu gouverneur colonial, s'accomplit. À son mensonge, il faut opposer une vérité perdue : le matérialisme est l'effondrement de toute morale. C'est la leçon de Giovanni Gentile dans Genèse et structure de la société. "L'homme accomplit une action universelle qui est la raison commune aux hommes et aux dieux, aux vivants, aux morts eux-mêmes et même aux enfants à naître. " Il n'est pas un atome solitaire, ni Robinson ni Vendredi : il vit et devient une personne dans la mesure où il crée et transmet de la civilisation, et non des produits. "Au fond de l'ego, il y a toujours un Nous, qui est la communauté à laquelle il appartient et qui est la base de son existence spirituelle, et il parle avec sa bouche, sent avec son cœur, pense avec son cerveau". Robinson est le père glacial du "je" contemporain, Vendredi le serviteur nécessaire, éloigné de son destin originel, de son peuple, de son nom. Le mensonge de Robinson est un suprémacisme exigeant, brillant de paillettes, vendu à prix d'or.
19:42 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, daniel de foe, robinson crusoe, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise, libéralisme, individualisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 20 septembre 2022
Le délcin de l'empire

Le déclin de l'empire
par Klaus Kunze
Source: http://klauskunze.com/blog/2022/09/18/der-niedergang-des-imperiums/
Le déclin des États-Unis entraînera-t-il notre Allemagne dans sa chute ? Ceux qui s'étonnent de cette question devraient se familiariser avec l'analyse d'un capitaliste de premier plan : Ray Dalio, qui est classé 71ème sur la liste des personnes les plus riches et possède le plus grand fonds spéculatif.
Pour lui, il n'y a aucun doute : les États-Unis déclinent et la Chine monte en puissance :
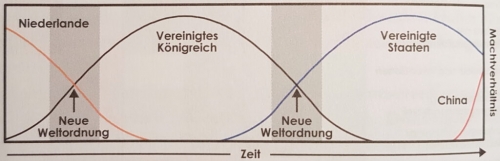
Exemple conceptuel du changement cyclique de l'ordre mondial (Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.76).
Son analyse révélatrice concerne directement la situation allemande et fait partie des livres à lire.

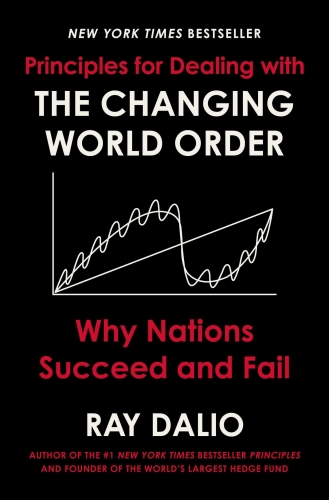
Ray Dalio, World Order in Change, Principles for Dealing with the Chanching World Order, 2021, World Order in Change, Vom Aufstieg und Fall von Nationen, 2022.
Ceux qui n'aiment pas le capitalisme financier mondial devraient cependant regarder cet homme et ses thèses en face. Dalio est l'un des plus grands joueurs et connaît personnellement un grand nombre de chefs d'État renommés. Il adopte une perspective à vol d'oiseau et a étudié de manière approfondie l'histoire économique des derniers siècles.
Du point de vue de Dalio, tout tourne autour de l'argent, car le pouvoir d'achat est toujours synonyme de prospérité et de puissance. Son hypothèse principale est que tous les pays traversent des cycles d'ascension et de déclin et sont fondamentalement soumis aux mêmes "relations de cause à effet intemporelles et universelles" (Dalio p.191): le leadership, l'éducation, une culture forte et la capacité d'innovation mènent à l'apogée de la puissance. Un très petit nombre de personnes deviennent extrêmement riches, ce qui entraîne des tensions sociales. Les générations suivantes s'en sortent encore bien, mais leur productivité diminue parce qu'elles ne sont pas aussi travailleuses que leurs parents.
Lorsque les habitants du pays leader deviennent plus riches, ils ne travaillent généralement plus aussi dur. Ils s'accordent plus de temps libre, se consacrent aux choses plus agréables et moins productives de la vie et, dans les cas extrêmes, deviennent décadents. Au cours de l'ascension vers le sommet, les valeurs changent d'une génération à l'autre - de ceux qui ont dû se battre pour la richesse et le pouvoir à ceux qui en ont hérité. La nouvelle génération n'est plus aussi combative, mais elle est gâtée par le luxe et s'est ramollie.
Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.67.
Leurs désirs et leurs exigences sont de plus en plus grands et ne sont satisfaits que par des emprunts. L'État s'endette, mais dépense de moins en moins pour les investissements et de plus en plus pour la redistribution improductive des riches vers les pauvres. Si les guerres imposent des dépenses militaires de plus en plus importantes, la dette finit par atteindre un niveau critique : elle consiste en la promesse d'honorer un jour une dette monétaire et forme une bulle financière.
Inévitablement, le pays commence à emprunter de manière excessive, ce qui entraîne un gonflement énorme de ses dettes envers les prêteurs étrangers. [...] Si l'on emprunte beaucoup, le pays paraît très fort, mais en réalité sa puissance financière s'affaiblit, car le pouvoir du pays est maintenu à crédit, alors que cela ne se justifie plus fondamentalement. Les fonds étrangers servent à financer à la fois la surconsommation nationale et les conflits militaires internationaux.
Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.68.
Alors que la population est aussi pauvre au début de chaque cycle, les écarts entre riches et pauvres et entre différents groupes ethniques et religieux se creusent. L'économie s'affaiblit et, devant le choix entre la faillite de l'État et le lancement de la presse à imprimer, les gouvernements décident presque toujours d'imprimer de la monnaie en quantité. "Ce faisant, la monnaie perd de sa valeur et l'inflation s'accélère" (p.69 et s.). Les conflits conduisent, selon Dalio,
à l'extrémisme politique, qui se traduit par le populisme de gauche et de droite. La gauche veut redistribuer les richesses, la droite veut s'assurer qu'elles restent entre les mains des riches. Il s'agit de la "phase anticapitaliste", dans laquelle les problèmes sont imputés au capitalisme, aux capitalistes et, plus généralement, aux élites.
Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.70.

Quand les promesses de payer ne peuvent plus être tenues, le cycle se termine par un effondrement.
L'effondrement inévitable de la monnaie entraîne, à la fin du cycle, la perte totale de tous les actifs financiers, le chaos, la guerre civile et un nouveau départ. Le cycle typifié ressemble donc à ceci :
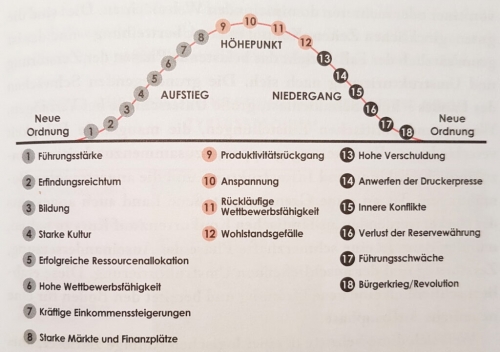
Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De la montée et de la chute des nations, 2022, p.73.
Dalio estime que les États-Unis ont parcouru environ 70% de leur cycle. La limite de la phase "de guerre civile ou de révolution, où l'on prend les armes, n'a pas encore été franchie, mais les conflits politiques internes sont violents et s'intensifient" (S.443).
Et l'Allemagne ?
"Parce que la nature des hommes change peu avec le temps" (p.52), écrit Dalio, "le cycle politique interne d'ordre et de chaos" (p.25) se répète partout et toujours selon une loi. Il a tenté de démontrer empiriquement cette hypothèse en 668 pages, en s'appuyant sur une multitude de données. L'ère des temps modernes a commencé, entre autres, avec l'invention de la comptabilité en partie double et du capitalisme financier. Les analyses de Dalio sont cohérentes. Que signifient-elles pour nous ?
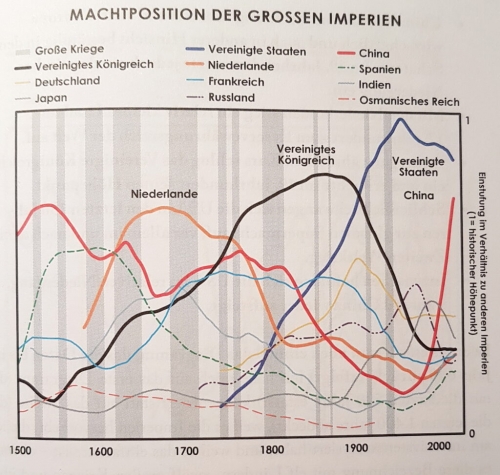
Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.57.
La "prospérité et la puissance" de l'Allemagne - que Dalio cite souvent dans le même souffle - ont suivi les lois qu'il a mises en évidence. Au 20ème siècle, après des guerres perdues, la politique financière a connu deux nouveaux départs à la fin d'un cycle d'endettement. Les facteurs déterminants de notre renaissance après 1945 sont un exemple qui confirme l'hypothèse de Dalio. Nous sommes, comme les États-Unis, sur la branche descendante de notre cycle. Selon Dalio, ces cycles durent généralement une centaine d'années. La fin de la situation actuelle est annoncée.
Les États-Unis sont en train de descendre. Et nous, ses satellites ? La fin est d'autant plus proche que nos gouvernements accélèrent les facteurs de déclin.
Le leadership a été remplacé par les atermoiements de Kohl et Merkel et les tergiversations de Scholz. L'inventivité est de moins en moins récompensée. L'éducation pluridisciplinaire a été remplacée par un système qui sabote les pics de performance, réduit l'éducation historique à néant, impose l'endoctrinement comme le genderisme et donne souvent l'illusion d'une éducation plus générale uniquement grâce à des diplômes sans valeur. Ce qu'un bachelier sait aujourd'hui, un collégien le savait depuis longtemps il y a 40 ans. La pensée indépendante et le questionnement critique sont réprimés par la surveillance idéologique au lieu d'être encouragés.
La "culture forte", l'une des caractéristiques d'ascension d'un pays soulignée par Dalio, a été remplacée par un bric-à-brac ridicule de gadgets à la mode. Des us et coutumes de peuples étrangers, incompatibles avec notre culture, s'immiscent dans le vide culturel.
La dette publique, qui ne peut plus être remboursée, est typique des périodes de déclin. Pendant la période de la pandémie, nous avons réduit la productivité par des interdictions, tout en distribuant des milliards à ceux qui étaient dans le besoin et en contractant des sommes exorbitantes de nouvelles dettes, ce qui nous a rapprochés de l'effondrement. Notre guerre économique contre la Russie, combinée aux dépenses militaires, menace à nouveau de ruiner notre économie réelle et de réduire de grands groupes de personnes à la mendicité. Afin d'anticiper les troubles sociaux imminents, de nouvelles quantités d'argent non remboursable sont produites. La masse monétaire nominale n'est pas compensée par une quantité suffisante de biens et de services réels à acheter. L'argent a de moins en moins de valeur.
Les conflits de répartition internes autour des lignes de fracture déjà existantes de notre société divisée augmentent le potentiel de conflit idéologique. Spirituellement, la guerre civile bat déjà son plein. Les restes de la génération d'après-guerre maintiennent encore des vestiges de l'orientation vers la performance et de nos valeurs traditionnelles. Au plus tard lorsque ses ressortissants seront décédés, la part de la population non allemande, et donc la part de personnes ne présentant aucune des caractéristiques conduisant à une résurgence, sera prépondérante. En bref, tout cela va exploser à la figure de nos enfants.
Philosophie de l'histoire ou analyse basée sur les données ?
Les analyses de Dalio se distinguent des philosophies de l'histoire comme celle de Marx par leur approche basée sur des données factuelles. Il ne prédit pas, mais cherche des lois permanentes, il recherche ce qui est toujours valable. C'est une position de base conservatrice. Il voit aussi les lois sociologiques avec un regard clair :
De même, j'ai compris que depuis toujours et dans tous les pays, les personnes qui possèdent la prospérité sont celles qui possèdent les moyens de la produire. Pour maintenir ou accroître leur prospérité, ils collaborent avec ceux qui ont le pouvoir politique d'édicter et d'appliquer des règles, et entretiennent avec eux une relation symbiotique. Je me suis rendu compte que cela s'était produit de manière très similaire dans tous les pays et à toutes les époques. [...] Au fil du temps et à travers les pays, l'histoire montre qu'il existe une relation symbiotique entre les riches et ceux qui exercent une influence politique, et que les arrangements qu'ils prennent entre eux déterminent l'ordre dominant".
Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De la montée et de la chute des nations, 2022, p.39, 111.
Si nous prenons comme exemple la nouvelle symbiose entre le capitalisme financier international et nos représentants gouvernementaux "progressistes" issus de la gauche alternative, elle a été récemment qualifiée aux Etats-Unis de "woke capitalism": capitalisme "éveillé" (?). Il a culminé avec le mouvement d'émancipation des minorités sexuelles et raciales, et a démoli tous les bastions de la normalité traditionnelle. Des drapeaux arc-en-ciel flottent devant les sièges sociaux des grandes entreprises. J'ai expliqué en détail pourquoi cela semble être dans l'intérêt des deux parties dans mon livre sur "Le libéralisme, ennemi public" (2022) (cf. infra).
La principale critique adressée au capitalisme financier est, du point de vue de la gauche, son manque d'équité dans la répartition des biens et, du point de vue de la droite, la dissolution et l'anéantissement des peuples qui se sont accrus ainsi que la disparition de l'héritage financier et la mise au pas des États. Les opposants de droite et de gauche s'accordent en revanche à dire que les limites de la croissance mondiale ont été atteintes et que toute croissance supplémentaire détruit nos bases naturelles de vie. Or, la croissance est une condition d'existence inhérente au capitalisme financier.
Les peuples et les cultures n'intéressent pas particulièrement Dalio. Ils ne sont pas des variables de calcul dans ses modèles analytiques qui s'interrogent sur les relations de cause à effet, comme entre la croissance de la masse monétaire et l'endettement, le pouvoir et le déclin. Il est cependant évident pour lui aussi que tous les peuples n'ont pas la même capacité à "monter" :
Tous les êtres humains viennent au monde avec un patrimoine génétique qui influence dans une certaine mesure la manière dont ils se comportent. Il est donc logique que la nature génétique de la population d'un pays ait un effet sur la manière dont ce pays se développe.
Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.93.
Tout le monde n'aime pas tout le monde, ce qui conduit à des conflits le long de certaines lignes de fracture :
Les personnes avec lesquelles les gens se sentent le plus liés, avec lesquelles ils s'entourent le plus souvent et ont le plus de points communs déterminent la ou les classes auxquelles ils appartiennent. Et leur classe détermine qui sont leurs amis et alliés, et qui sont leurs ennemis. Les classes déterminantes les plus courantes sont les riches et les pauvres, et la droite (c'est-à-dire capitaliste) et la gauche (socialiste). Il existe de nombreuses autres distinctions importantes, telles que l'ethnie, la religion, le sexe, le style de vie (libéral ou conservateur) et le lieu de résidence (par exemple, ville, banlieue ou campagne). En général, les gens peuvent être répartis dans ces classes et, en période de prospérité, au début d'un cycle, il existe une harmonie entre ces classes. Lorsque les temps deviennent mauvais, les conflits se multiplient.
Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De la montée et de la chute des nations, 2022, p.124.
De trop grandes différences intra-culturelles au sein d'un pays sont sources de conflits et peuvent accélérer son déclin :
Chaque société développe une culture sur base de la manière dont elle perçoit le fonctionnement de la réalité, et chaque culture fournit des principes qui devraient guider les individus dans leur rapport à la réalité - et surtout dans leurs relations mutuelles. [...] Lorsque les valeurs divergent de plus en plus, en particulier en période de crise économique, cela conduit généralement à des périodes de plus grand conflit. [...]
Souvent, ils diabolisent les membres d'autres tribus au lieu de se rendre compte que, comme eux, ils ne font que ce qui est dans leur propre intérêt.
Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, De l'ascension et de la chute des nations, 2022, p.99, 101.
Problème identifié
Selon Dalio, des conflits surviennent au sein de chaque cycle juste avant l'effondrement. Ceux-ci sont à première vue de nature idéologique ou religieuse. Mais il les classe en fin de compte comme des luttes pour la répartition. Plus un État laisse l'écart entre les riches et les pauvres se creuser, plus cet écart devient dangereux. Dalio reconnaît, dans la critique par la gauche de l'absence d'équité dans le capitalisme, le potentiel de mise en danger du système.
Je pense que le plus grand défi pour la politique est de mettre en place un système économique capitaliste qui augmente la productivité et le niveau de vie sans accroître l'inégalité et l'instabilité.
Ray Dalio, L'ordre mondial en mutation, L'ascension et la chute des nations, 2022, p.128.
Malheureusement, il ne nous dit pas à quoi devrait ressembler un tel système, car personne ne le sait apparemment à ce jour. Il y a un point aveugle dans la logique du système du libéralisme économique. Il se fonde exclusivement sur l'individualisme méthodologique. Chacun est le plus proche de soi-même et si chacun poursuit ses intérêts privés de manière purement égoïste, cela servira au mieux la prospérité de tous, pensent les tenants de l'individualisme méthodologique. Malheureusement, personne ne croit encore à cette légende du 19ème siècle, pas même Dalio. Pour lui, le fossé qui se creuse entre les riches et les pauvres est précisément la conséquence inévitable de la prospérité à l'apogée d'un cycle, et s'il revient inévitablement, on ne peut justement pas le changer.
Comme Friedrich von Hayek avant lui, Dalio pense fondamentalement à partir de l'individu. C'est pourquoi, pour lui, les systèmes collectivistes sont un indicateur de crise pour la période de conflits internes dans les phases de déclin. Dans l'individualisme, en revanche, "le bien-être de l'individu prime sur tout le reste" (p. 258). Dalio ne mentionne pas le fait que l'on puisse partager ce point de départ mais en voyant dans le bien-être d'une communauté de personnes (famille, tribu, peuple) une condition fondamentale pour le bien-être de l'individu.
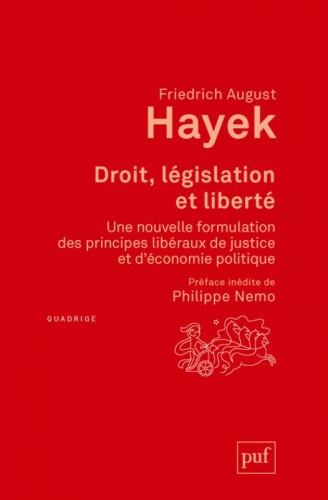
Hayek : l'apôtre libéral du pur individualisme
L'autre extrême, le collectivisme, repose philosophiquement sur un holisme. Pour lui, l'ensemble collectif est donc une sorte d'"essence" propre et unifiée, à laquelle les personnes individuelles doivent s'intégrer en tant que parties.
"La volonté de mettre dans le même panier du holisme, d'un point de vue libéral occidental, le communisme menaçant et le fascisme ou le nazisme tout juste vaincus, a donné un élan idéologique supplémentaire à l'évangile de l'individualisme méthodologique et a assuré sa rapide diffusion. C'est en tant qu'évangélistes des valeurs libérales de l'Occident en difficulté que Hayek et Popper ont acquis leur renommée".
Panajotis Kondylis, La politique et l'homme, volume 1 : Relation sociale, compréhension, rationalité (1999), p.141.
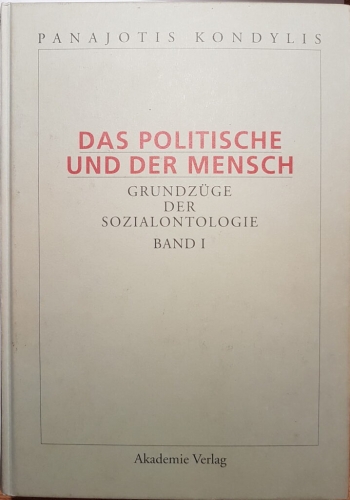
La communauté : le point aveugle
Le "schéma de pensée néolibéral" de Röpke et Hayek souffrait toutefois d'une erreur de raisonnement :
"Il approuvait le libéralisme économique et rejetait ses conséquences, il défendait les prémisses libérales et combattait la réinterprétation et le développement démocratiques de masse de celles-ci. Mais l'atomisation de la société, le calcul eudémoniste et la dissolution des traditions et des conditions substantielles dans le pluralisme des valeurs constituent les conséquences nécessaires du libéralisme économique sur une base hautement technologique" [1].
Panajotis Kondylis, Le politique et l'homme, volume 1 : Relation sociale, compréhension, rationalité (1999), p.141.
Le libéralisme est aveugle à ces conséquences, le capitalisme financier n'a pas d'œil pour elles. Hayek l'avait négligé et Dalio persiste dans cette voie de pensée. Hayek qualifiait la solidarité et l'altruisme d'instincts ataviques, devenus anachroniques aujourd'hui [2]. En revanche, Konrad Lorenz écrivait qu'un homme seul n'est pas un homme du tout, d'une certaine manière :
"Ce n'est qu'en tant que membre d'un groupe spirituel qu'il peut être pleinement humain. La vie spirituelle est fondamentalement une vie supra-individuelle ; nous appelons culture la réalisation concrète individuelle de la communauté spirituelle".
Konrad Lorenz, Les huit péchés capitaux de l'humanité civilisée, 1973, 9ème éd. 1978, p.66.
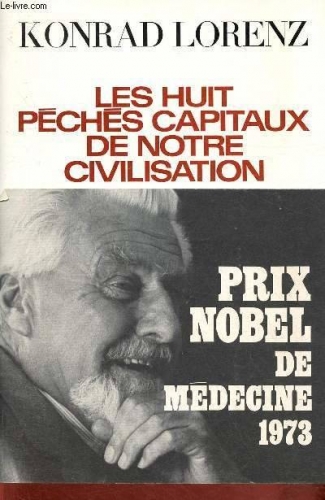

Le comportementaliste avait déjà formulé avec clairvoyance il y a quelques années :
"Nous devons apprendre à combiner une humanité lucide envers l'individu avec la prise en compte de ce qui est nécessaire à la communauté humaine. L'individu qui est frappé par la défaillance de certains comportements sociaux et par la défaillance simultanée de la capacité à éprouver les sentiments qui les accompagnent est en effet un pauvre malade qui mérite toute notre compassion. Mais la défaillance elle-même est le mal par excellence" [3].
Konrad Lorenz, Les huit péchés capitaux de l'humanité civilisée, 1973, 9ème éd. 1978, p.66.
Dalio est un spécialiste de la prospérité. Ce dont la communauté a besoin ? Du pouvoir d'achat, bien sûr. Y avait-il autre chose ? Dans son univers mental, les communautés supra-individuelles n'existent pas. Il incarne la position extrême de l'individualisme par rapport à la position extrême du collectivisme. Il considère que le problème est de "mettre en place un système économique capitaliste qui augmente la productivité et le niveau de vie sans accroître l'inégalité et l'instabilité". Il va sans dire qu'il n'a pas trouvé de solution à ce problème dans le cadre de l'idéologie libérale.
Et si un pays n'allait pas bien ou était en déclin ? Son conseil radicalement individualiste est le suivant : vous pouvez toujours changer de domicile : Ubi bene, ibi patria.
Pour en savoir plus sur le capitalisme financier, cliquez ici :

Notes:
[1] Panajotis Kondylis (1999), p.142. Klaus Kunze, Staatsfeind Liberalismus, 2022, p.116.
[2] Alain de Benoist, Contre le libéralisme (2021), p.243.
[3] Konrad Lorenz (1973 / 91978), p.66.
19:26 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, états-unis, libéralisme, individualisme, cycles économiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 10 mars 2022
Comment l'individualisme défait le conservatisme
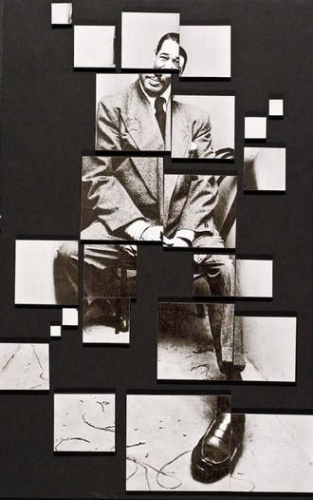
Comment l'individualisme défait le conservatisme
par Brett Stevens
Source: http://www.amerika.org/politics/how-individualism-defeats-conservatism/
Les conservateurs ne succombent pas directement à la gauche ; au contraire, selon la stratégie classique des gauches, ils sont secrètement envahis, divisés contre eux-mêmes, et ainsi subvertis et transformés en véhicule pour ces mêmes idées de gauche. Cela peut être observé dans le conservatisme traditionnel à travers la première loi de O'Sullivan :
- La première loi d'O'Sullivan stipule que toute organisation ou entreprise qui n'est pas expressément de droite deviendra de gauche avec le temps. La loi porte le nom du journaliste britannique et ancien rédacteur en chef de National Review, John O'Sullivan.
... [La motivation première d'un conservateur de gauche] est de signaler sa fidélité à la "seule vraie foi" en désignant l'hérétique le plus proche de lui et en criant "sorcière" [par] l'utilisation de la propriété transitive pour relier l'ennemi ciblé à un mal imaginaire et, bien sûr, l'exigence que la cible abandonne sa position ou risque d'être qualifiée d'hérétique [avec] ses interrogations dérangeantes qui sont jugées hors de portée des gens décents.
...Ils ont toujours été juste à la droite de la gauche officielle... [Leur présence sur l'échiquier politico-intellectuel n'a] jamais été expressément de droite, il s'agissait plutôt d'un véhicule de marketing pour les personnes qui les ont lancés. Tous sont passés à autre chose au fur et à mesure que l'entreprise remplissait son objectif.

En d'autres termes, une opportunité de marché est créée pour les droitiers, mais le meilleur produit est celui qui est comme tout le reste, mais suffisamment différent pour plaire, sans toutefois susciter l'ire du reste du troupeau. En conséquence, il fait fuir la droite de principe et attire les opportunistes, qui se font un revenu juteux en fanfaronnant sur leur différence, mais finissent par céder à la tendance dominante.
L'individualisme de ces opportunistes convertit le conservatisme en une autre forme de gauchisme, et le rend plus prompt à être accepté par le troupeau car il ressemble à ce que font les autres, et les humains ne sont rien d'autre que des conformistes.
La droite ne peut vaincre cela qu'en rendant la grande tente non pas intersectionnelle, mais hiérarchique. Le conservatisme doit redécouvrir ses principes fondamentaux de la manière la plus simple possible et faire dériver tous les autres principes de ceux-ci.
Comme écrit précédemment sur amerika.org, le noyau du véritable conservatisme est double :
- Des résultats éprouvés par le temps, ou un conséquentialisme basé non pas sur la préférence individuelle mais sur les effets observables dans la réalité, ce qui nous permet de faire correspondre la cause à l'effet et de comprendre les principes qui font une société prospère.
- Afin de comprendre pourquoi avoir une société prospère, et à quoi cela ressemble, le conservatisme s'appuie également sur le transcendantalisme ou la compréhension de l'ordre de la nature comme étant plus intelligent que l'humanité, et à travers cela, la découverte d'un désir d'exister en équilibre avec elle.
La forme corrompue du conséquentialisme, détruite de la même manière que le conservatisme l'a été, est une version basée sur les préférences qui assimile les "conséquences" à "ce que les gens pensent qu'ils aiment", dans un gambit utilitaire classique. Le conséquentialisme originel examine les résultats non seulement dans le présent, mais sur toute la durée, afin que nous puissions comparer avec précision et honnêteté différentes actions/causes.
Tant que la droite ne redécouvrira pas cette orientation primitive, elle sera à jamais subvertie parce que ses principes intermédiaires - marchés libres, liberté, liberté, petit gouvernement - sont en fait des orteils trempés dans l'eau tiède et putride du gauchisme, ou suffisamment proches pour que les deux deviennent rapidement identiques dans l'esprit de son public.
S'il revient à une voie distincte incompatible avec le gauchisme, et donc non sujette aux sottises du "bipartisme" et du "compromis", il peut atteindre son objectif de ralentir et éventuellement d'inverser le déclin de la civilisation. Mais lorsque ce conservatisme est transformé en un produit simplifié et juste axé sur la marge, comme un cheeseburger, il redevient la même chose que tout le reste, juste avec un arôme ajouté et sans réelle substance.
11:47 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : conservatisme, individualisme, droite, théorie politique, politologie, sciences politiques, john o'sullivan, philosophie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 16 mars 2016
Entretien avec Jean-Pierre Le Goff sur le nouvel individualisme
Sur le nouvel individualisme...
Ex: http://metapoinfos.hautetfort.com
Nous reproduisons ci-dessous un entretien donné par Jean-Pierre Le Goff à l'hebdomadaire Marianne à l'occasion de la sortie de son dernier livre Malaise dans la démocratie (Stock, 2016). Philosophe et sociologue, Jean-Pierre Le Goff a récemment publié La gauche à l'épreuve : 1968 - 2011 (Tempus, 2011) et La fin du village (Gallimard, 2012).
Entretien avec Jean-Pierre Le Goff sur le nouvel individualisme
 Marianne : Dans votre dernier livre, Malaise dans la démocratie, vous décrivez – et déplorez – l’avènement d’un « individualisme moderne ». Comment le définiriez-vous ?
Marianne : Dans votre dernier livre, Malaise dans la démocratie, vous décrivez – et déplorez – l’avènement d’un « individualisme moderne ». Comment le définiriez-vous ?
Jean-Pierre Le Goff : Rassurons tout de suite nos lecteurs, tout n’est pas à jeter, loin de là, dans la modernité et je ne confonds pas la modernité avec ses évolutions problématiques de la dernière partie du xxe siècle que j’ai traitées dans mon livre. Pour le dire de façon schématique, avec l’avènement de la démocratie, l’individu a été amené à se détacher des communautés premières d’appartenance. Les Lumières ont valorisé l’usage de la raison, le recul réflexif, l’autonomie de jugement : c’est le bon côté de l’individualisme moderne. Mais ce dernier est ambivalent : il existe aussi une tendance au repli sur la sphère individuelle et une désaffiliation historique. Tocqueville l’avait brillamment pressenti quand il a écrit De la Démocratie en Amérique : « [Chaque homme] n'existe qu'en lui-même et pour lui seul, et s'il lui reste encore une famille, on peut dire du moins qu'il n'a plus de patrie. »
Pendant longtemps, ce phénomène de repli a été contrebalancé par la vitalité d’un tissu associatif qui amenait l’individu à s’intéresser aux affaires de la cité. En France, le mouvement syndical, les associations d’éducation populaire comme « Peuple et culture », ou encore celles liées au christianisme qui s’investissaient dans le domaine social ont joué ce rôle, sur fond d’un sentiment d’appartenance national qui demeurait bien présent. On pouvait se quereller sur l’histoire du pays et son interprétation mais cette histoire constituait un arrière fond de référence. Cet équilibre entre individualisme, engagement et appartenance collective a été rompu et a débouché sur un individualisme de type nouveau.
Quand cet équilibre s’est il rompu ?
J-P LG : Dans mon livre, je parle du basculement qui s’est déroulé dans la seconde moitié du xxe siècle et il est possible de distinguer deux moments qui sont liés. D’abord, le tournant des années 1950-1960, après la phase de reconstruction de l’après-guerre, les sociétés démocratiques européennes ont inauguré une nouvelle phase de leur histoire, où la question du paupérisme – qui hantait la société depuis le xixe siècle et bien avant – a été globalement résolue. Avec le développement de la production, des sciences et des techniques, nous sommes entrés dans la « société de consommation, de loisirs et des mass-medias ». Les week-ends passés pour soi, les loisirs, la télé, la radio et la voiture... tout cela a érodé les rapports de sociabilité traditionnels. C’est dans ces nouvelles conditions sociales-historiques, que l’individualisme moderne s’est transformé. Cet individualisme ne correspond plus alors à la vision que la gauche, notamment, se faisait du citoyen-militant, à savoir quelqu’un qui serait constamment « impliqué » dans les affaires de la cité, avec un aspect dévoué et sacrificiel assez prononcé.
 La deuxième étape renvoie à ce j’ai appelé « l’héritage impossible » de mai 68. Je parle bien de l’héritage impossible et non de l’événement historique lui-même. C’est ma différence avec Eric Zemmour et d’autres critiques qui ont un aspect « revanchard » : je ne règle pas des comptes avec l’événement historique et les soixante-huitards ne sont pas responsables de tous les maux que nous connaissons aujourd’hui. En France, l’événement mai 68 a été un événement à multiples facettes où ont coexisté la « Commune étudiante », une grève générale qui rappelait les grandes heures du mouvement ouvrier et une prise de parole multiforme qui a été largement vécue comme une véritable libération dans le climat de l’époque. L’événement historique Mai 68 n’appartient à personne, c’est un événement important de l’Histoire de France, et plus globalement des sociétés développées de l’après-guerre qui sont entrées dans une nouvelle phase de leur histoire et ont vu surgir un nouvel acteur : la jeunesse étudiante. Ce que le regretté Paul Yonnet a appelé le « peuple adolescent ». En ce se sens, à l’époque, Edgar Morin est l’un de ceux qui a le mieux perçu la caractère inédit de l’événement en caractérisant la « Commune étudiante » comme un « 1789 socio-juvénile ».
La deuxième étape renvoie à ce j’ai appelé « l’héritage impossible » de mai 68. Je parle bien de l’héritage impossible et non de l’événement historique lui-même. C’est ma différence avec Eric Zemmour et d’autres critiques qui ont un aspect « revanchard » : je ne règle pas des comptes avec l’événement historique et les soixante-huitards ne sont pas responsables de tous les maux que nous connaissons aujourd’hui. En France, l’événement mai 68 a été un événement à multiples facettes où ont coexisté la « Commune étudiante », une grève générale qui rappelait les grandes heures du mouvement ouvrier et une prise de parole multiforme qui a été largement vécue comme une véritable libération dans le climat de l’époque. L’événement historique Mai 68 n’appartient à personne, c’est un événement important de l’Histoire de France, et plus globalement des sociétés développées de l’après-guerre qui sont entrées dans une nouvelle phase de leur histoire et ont vu surgir un nouvel acteur : la jeunesse étudiante. Ce que le regretté Paul Yonnet a appelé le « peuple adolescent ». En ce se sens, à l’époque, Edgar Morin est l’un de ceux qui a le mieux perçu la caractère inédit de l’événement en caractérisant la « Commune étudiante » comme un « 1789 socio-juvénile ».
Et en quoi, donc, les suites de Mai 68 ont-elles selon vous transformé notre société, et mené au nouvel individualisme qui vous préoccupe tant ?
J-P LG : Cet « héritage impossible » est présent dans l’événement lui-même, plus précisément au sein de la « Commune étudiante », et il va se développer dans les années de l’après mai. Cet héritage comporte des éléments qui, au terme de tout un parcours de transgression et de désillusion, vont déboucher sur l’avènement d’un individualisme de déliaison et de désaffiliation. Je résumerai schématiquement ce legs en quatre points : l’autonomie érigée en absolu, le rejet de toute forme de pouvoir (forcément synonyme de domination et d’aliénation), la mémoire pénitentielle, et cette idée que l’homme est naturellement bon, que tout le mal vient du pouvoir, des institutions, de la morale… qui pervertissent cette bonté naturelle.
Des années post-soixante-huit à aujourd’hui, les pages sombres de l’histoire française, européenne et occidentale ont été exhumées et mises en exergue dans une logique de règlement de compte qui a conduit à une rupture dans la transmission. La responsabilité précise des « soixante-huitards », à qui l’on a fait porter bien d’autres chapeaux, est liée à cette rupture dans la transmission. Elle est importante et a notamment bouleversé notre rapport à l’enfant, à son éducation, à l’école… En 68, les slogans dénonçaient une société qui méprisait sa jeunesse - « Sois jeune et tais toi ! ». Depuis, c’est « sois jeune et parle ! », car on considère que l’enfant a en lui-même un potentiel de créativité méconnu, et l’on n’est pas loin de penser que tout ce qu’il peut dire est nécessairement salutaire et brillant…
Et s’il ne parle pas, c’est qu’il n’est pas « normal »… Alors, si c’est nécessaire, on pourra consulter les nombreux spécialistes de l’enfance qui ont les moyens psychologiques et pédagogiques de le faire parler… (il rit). C’est l’image inversée de l’enfant de l’ancien monde d’avant 68 qui a débouché sur une nouveau modèle éducatif dont les effets problématiques ont été longtemps masqués ou sous-estimés. À cette « révolution culturelle » va venir s’ajouter le développement du chômage de masse, la conjugaison des deux a produit des effets de déstructuration anthropologique
Selon vous, l’individualiste moderne qui peuple nos sociétés occidentales est un « faux gentil ». Pourtant, à première vue, il a l’air assez sympathique : pacifique, zen, ouverts aux autres cultures… Que lui reprochez-vous ?
J-P LG : J’essaie d’abord de comprendre comment fonctionne un individualisme de type nouveau. Pour le dire de façon schématique : il est très autocentré et sentimental, se vit comme le centre du tout, en ayant tendance à penser que le monde est la prolongation de lui-même. Contrairement aux apparences, il n’est pas si « ouvert » à l’autre qu’il y paraît, considérant celui-ci avant tout selon sa mesure et son bon plaisir, en ayant quelques difficultés à comprendre que le monde est plus compliqué que le schéma binaire des gentils et des méchants. Cet individualisme est gentil avec les gens qui lui ressemblent mais supporte difficilement les contraintes, les échecs, les contradictions et les conflits.
Cette structure de la personnalité est liée à une éducation historiquement inédite où les adultes ont placé les nouvelles générations dans des situations paradoxales. D’un côté, l’enfant a été extrêmement valorisé : depuis des décennies, il est « placé au centre »… Le bambin est considéré comme un génie méconnu à qui l’on offre enfin la possibilité d’épanouir toutes ses potentialités créatrices qui s’affirment comme on ne l’avait jamais vu auparavant ! Tous les enfants – c’est désormais comme une évidence –, sont des poètes qui s’ignorent ; on expose leur moindre gribouillis en les considérant sinon comme une œuvre d’art, du moins comme la preuve tangible de leur créativité… (il rit) D’ailleurs, globalement, les parents ne comprennent pas – de nombreux professeurs au bout du rouleau peuvent en témoigner – que l’aptitude brillante de leur bambin surinvesti par leurs attentes ne soit pas reconnue comme ils estiment qu’elle devrait l’être. En même temps: ces enfants sont abandonnés…
Abandonnés ? Mais vous disiez à l’instant qu’ils étaient surinvestis et mis au centre de tout?
J-P LG : C’est là tout le paradoxe : abandonnés, oui, par des parents qui bien souvent rechignent aux devoirs qu’implique le fait d’avoir un enfant et de l’éduquer, de l’aider et de l’accompagner dans le cheminement qui l’amènera vers l’âge adulte avec l’autorité et les contraintes qui en découlent. Du reste, ils n’ont pas trop le temps de s’en occuper. J’ai connu une féministe à la bonne époque qui disait à son enfant : « Tu ne m’empêcheras pas de vivre ma vie. » Quelle phrase terrible… D’un côté « l’enfant au centre », celui qui est l’objet de toutes les attentions et d’un amour quasi fusionnel, celui qui correspond à l’image fantasmée que s’en font les adultes, celui qu’on montre et qu’on affiche volontiers comme un petit roi, et de l’autre l’enfant contraignant (et agité) qui agace et vient contrarier le désir de vivre sa vie comme on l’entend en toute autonomie. Qu’on ne s’étonne pas alors de rencontrer de plus en plus en plus d’individus imbus d’eux-mêmes et prétentieux, en même temps que très anxieux et fragiles : c’est le résultat d’un profond bouleversement de ce que j’appelle dans mon livre le « nouveau terreau éducatif », lié notamment à la conjugaison de l’« enfant du désir » et de la « culture psy ».
Dans votre livre, vous reprenez et développez la notion que feu votre ami, le sociologue Paul Yonnet, appelait « l’enfant du désir d’enfant » – le fait que l’enfant n’est désormais plus une donnée de la nature, mais le fruit d’un désir (1). Le problème avec ces analyses qui décortiquent les conséquences de ces bouleversements sociologiques, tout comme ceux entrainés par le travail des femmes (qu’Eric Zemmour a quasi décrété catastrophe humanitaire), c’est qu’on ne voit pas toujours quelles conclusions en tirer… Prônez-vous de remettre les femmes aux fourneaux ?, d’interdire la contraception ?
J-P LG : Pas du tout ! Je pense que l’une des grandes luttes du xxe siècle a été celle de la libération des femmes. Je suis très critique vis-à-vis de l’idéologie féministe qui a versé dans le fantasme de la toute puissance dans l’après 68 et continue sous d’autres formes aujourd’hui, mais cela n’implique pas de nier le caractère émancipateur du combat des femmes qui a traversé le siècle et participe de l’individualisme démocratique au bon sens du terme : l’individu s’affirme comme un sujet autonome et responsable et ne se réduit pas au rôle social qu’on entend lui faire jouer. Comme je l’ai dit précédemment, cet individualisme a basculé à un moment donné vers de nouveaux horizons problématiques. Je ne veux pas pour autant revenir à la situation antérieure et je ne crois pas que cela soit possible. Je ne suis pas dans la nostalgie pavlovienne du « c’était mieux avant ». Si vous me permettez cette nuance paradoxale, je suis conservateur au sein même de la modernité et à partir des acquis de la modernité (2), ce qui permet d’examiner le passé en toute liberté en essayant d’en dégager un certain nombre de leçons.
Dans l’ancien type d’éducation, il y avait des violences, l’enfant était vu comme un petit animal à dresser, la famille s’ordonnait autour de la volonté du père, le statut du divorce était dur et l’on ne maîtrisait pas la contraception… Mais il ne suffit pas de dire cela pour être quitte en se donnant bonne conscience alors que les drames familiaux remplissent quotidiennement la rubrique des « faits divers ». Dans le domaine de l’éducation comme dans beaucoup d’autres, nous sommes dans un rapport dépréciatif au passé qui le considère comme ringard sinon barbare. On est dans le simplisme et la caricature. La réalité est beaucoup plus ambivalente : dans l’ancien monde, il y avait certes des aspects problématiques, cela pouvait être dur, injuste, mais les anciens n’étaient pas des « abrutis » ou des « beaufs » comme le gauchisme culturel l’a laissé entendre. Dans mon livre, j’ai voulu précisément mettre en lumière les conceptions différentes de la condition humaine qu’impliquent les anciennes et les nouvelles méthodes d’éducation. Cette mise en perspective de l’ancien et du nouveau monde permet de tirer des leçons. Il ne s’agit pas de croire que l’on pourrait appliquer pareillement les mêmes méthodes qu’auparavant, mais le passé peut être source d’inspiration et de rééquilibrage contre les impasses du nouvel individualisme et de ses méthodes d’éducation.
Quelles sont ces leçons ?
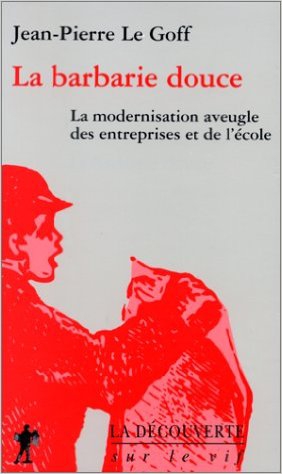 J-P LG : L’éducation était antérieurement liée à une conception pour qui les contraintes, la limite, le tragique étaient considérés comme inhérents à la condition humaine, tout autant que les plaisirs de la vie, la sociabilité et la solidarité. Devenir adulte c’était accepter cette situation au terme de tout un parcours qui distinguait clairement et respectait les différentes étapes de la vie marquées par des rituels qui inséraient progressivement l’enfant dans la collectivité. C’est précisément cette conception qui s’est trouvée mise à mal au profit nom d’une conception nouvelle de l’enfance et de l’adolescence qui a érigé ces étapes spécifiques de la vie en des sortes de modèles culturels de référence. Valoriser les enfants et les adolescents en les considérant d’emblée comme des adultes et des citoyens responsables, c’est non seulement ne pas respecter la singularité de ces étapes de la vie, mais c’est engendrer à terme des « adultes mal finis » et des citoyens irresponsables. Aujourd’hui, il y a un écrasement des différentes étapes au profit d’un enfant qui doit être autonome et quasiment citoyen dès son plus jeune âge. Et qui doit parler comme un adulte à propos de tout et de n’importe quoi. On en voit des traces à la télévision tous les jours, par exemple quand un enfant vante une émission de télévision en appelant les adultes à la regarder ou pire encore dans une publicité insupportable pour Renault où un enfant-singe-savant en costume co-présente les bienfaits d’une voiture électrique avec son homologue adulte… Cette instrumentalisation et cet étalage de l’enfant-singe sont obscènes et dégradants. Les adultes en sont responsables et les enfants victimes. Paul Yonnet a été le premier à mettre en lumière non seulement l’émergence de « l’enfant du désir » mais celui du « peuple adolescent ». Dans la société, la période de l’adolescence avec son intensité et ses comportements transgressifs a été mise en exergue comme le centre de la vie. Cette période transitoire de la vie semble durer de plus en plus longtemps, le chômage des jeunes n’arrange pas les choses et les « adultes mal finis » ont du mal à la quitter.
J-P LG : L’éducation était antérieurement liée à une conception pour qui les contraintes, la limite, le tragique étaient considérés comme inhérents à la condition humaine, tout autant que les plaisirs de la vie, la sociabilité et la solidarité. Devenir adulte c’était accepter cette situation au terme de tout un parcours qui distinguait clairement et respectait les différentes étapes de la vie marquées par des rituels qui inséraient progressivement l’enfant dans la collectivité. C’est précisément cette conception qui s’est trouvée mise à mal au profit nom d’une conception nouvelle de l’enfance et de l’adolescence qui a érigé ces étapes spécifiques de la vie en des sortes de modèles culturels de référence. Valoriser les enfants et les adolescents en les considérant d’emblée comme des adultes et des citoyens responsables, c’est non seulement ne pas respecter la singularité de ces étapes de la vie, mais c’est engendrer à terme des « adultes mal finis » et des citoyens irresponsables. Aujourd’hui, il y a un écrasement des différentes étapes au profit d’un enfant qui doit être autonome et quasiment citoyen dès son plus jeune âge. Et qui doit parler comme un adulte à propos de tout et de n’importe quoi. On en voit des traces à la télévision tous les jours, par exemple quand un enfant vante une émission de télévision en appelant les adultes à la regarder ou pire encore dans une publicité insupportable pour Renault où un enfant-singe-savant en costume co-présente les bienfaits d’une voiture électrique avec son homologue adulte… Cette instrumentalisation et cet étalage de l’enfant-singe sont obscènes et dégradants. Les adultes en sont responsables et les enfants victimes. Paul Yonnet a été le premier à mettre en lumière non seulement l’émergence de « l’enfant du désir » mais celui du « peuple adolescent ». Dans la société, la période de l’adolescence avec son intensité et ses comportements transgressifs a été mise en exergue comme le centre de la vie. Cette période transitoire de la vie semble durer de plus en plus longtemps, le chômage des jeunes n’arrange pas les choses et les « adultes mal finis » ont du mal à la quitter.
Tout ce qui va au delà peut apparaître comme une forme de déchéance, une insertion difficile dans une réalité contraignante et insupportable au regard de ses rêves et des ses désirs de jeunesse. La nostalgie n’est plus ce qu’elle était et les « revivals », pas seulement musicaux, connaissent un succès sans précédent. Et voilà comment vous avez des gens à 70 printemps, qui gratouillent la guitare et qui jouent les Hell’s Angels avec leur couette et leurs boucles d’oreille sur des motos genre Harley Davidson… Je tiens à préciser que j’adore le jazz, le rock, la pop, la chanson française…, sans pour autant me limiter à ces genres musicaux, croire que tout se vaut et que n’existe pas une hiérarchie dans le domaine des œuvres culturelles, la musique classique demeurant pour moi une référence. Ma génération a saturé l’image de la toute puissance de la jeunesse et certains ex-soixante-huitards et quelques-uns de leurs descendants constituent des sortes « d’arrêts sur images » assez pathétiques. Mais l’âge et l’expérience aidant, on peut parvenir à une forme de réflexion et de sagesse qui allie la réflexion critique et la responsabilité. Je ne crois pas que tous les possibles de la vie soient ouverts jusqu’à 80 ans et plus... Le problème est que nombre de médias entretiennent l’illusion de l’éternelle jeunesse et jouent ce jeu à fond. Ils sont dans le jeunisme et dans la fête de la transgression socialement assistée à longueur de temps : le conformisme de l’anticonformisme où règnent les perpétuels adolescents et les nouveaux « m’as-tu-vu ». Nous arrivons au point limite de cette tendance qui s’épuise et finit par lasser les acteurs et les spectateurs de la transgression banalisée, de l’euphorie et de la dérision obligatoires.
Cet écrasement des différents stades ne se fait-il pas au détriment de l’adulte et de sa réflexion d’adulte ? On multiplie les micros-trottoirs de cour de récré sur l’actualité, Le Monde publie même une pleine page d’un dessinateur pour enfants afin d’expliquer la crise des réfugiés. L’arrière pensée étant : « la vérité sort de la bouche des enfants. » Est-ce que l’homme moderne ne se compromet pas dans une sorte de manichéisme enfantin ?
J-P LG : Oui, mais c’est largement un trompe l’œil. En vérité, c’est bien lui-même que l’adulte projette dans l’enfant. Sous prétexte de mettre en valeur le bambin, on nous refourgue l’image de l’enfant tel que nous voudrions qu’il soit. Les enfants sont devenus les miroirs dans lequel les adultes aiment percevoir non seulement une innocence première qu’ils ont perdue, mais une sorte d’adulte autonome en miniature, créateur et citoyen avant l’heure, l’image idéalisée d’eux-mêmes correspondant au modèle social du nouvel air du temps. Ce qui tend à nier le statut d’être infantile et dépendant et a l’avantage de croire que l’on n’aurait pas trop à s’en occuper. Du reste, on confie les enfants une bonne partie du temps à des spécialistes qui entretiennent et reproduisent cette même image de l’enfant autonome et citoyen. C’est en ce sens que, oui, il y a abandon par refus de reconnaître la fragilité de l’enfant et les devoirs que cela implique. Ce fantasme de l’enfant autonome, qui parle comme un adulte, qui a un point de vue sur tout et que l’on va solliciter pour qu’il corresponde à cette image, est une forme d’abandon. On peut résumer ce rapport paradoxal qui allie valorisation et rejet dans le phénomène de « l’enfant ours » courant dans certains milieux : dans les dîners, on va chercher le gamin pour le montrer à ses amis – « regardez comme il est beau et génial » – c’est tout juste si on ne le fait pas jouer du violon –, et puis au bout de quelques minutes : « Écoute maintenant c’est terminé, tu ne nous embêtes plus… » Le paradoxe sous-jacent reste le même : nous aimons intensément notre enfant que nous trouvons formidable et nous tenons à le faire savoir, mais il ne faudrait quand même pas qu’il nous empêche de vivre pleinement notre vie en toute autonomie. Cette situation paradoxale dans laquelle on place l’enfant est inséparable de la difficulté des adultes à devenir adultes, c’est-à-dire à quitter ce stade de la vie qu’est l’adolescence qui valorise l’intensité des sentiments dans le présent, entend passer outre les devoirs et les contraintes, pour qui la vie demeure éternellement ouverte sur tous les possibles. L’amour se doit d’être intense et fusionnel, autrement ce n’est pas vraiment de l’amour, d’où la grande difficulté à l’insérer dans la durée. Alors, à la première désillusion et engueulade, qui ne manquent pas de survenir au fil du temps, on se sépare ou on divorce !
On n’a qu’à revenir au mariage de raison, tant que vous y êtes…
J-P LG : (il rit). Bien sûr que non. L’alliance basée avant tout sur l’amour vaut mieux que les mariages arrangés de l’ancien monde, encore que, dans certains mariages arrangés, l’amour n’était pas toujours absent. Mais les sentiments sont devenus des critères essentiels de l’union, en dehors même de leur inscription dans un ordre généalogique et juridique qui les insère dans un temps long. Soumise à l’hégémonie des sentiments et à leur versatilité, l’union qui se veut authentique s’est en même temps fragilisée, passant facilement de l’amour fusionnel à la haine et au ressentiment, faute d’un décentrement et d’une référence à un ordre institutionnel pouvant permettre un recul salutaire face aux aléas et aux déconvenues d’un moment. Là aussi, le déni fonctionne à plein, tout particulièrement quand les séparations impliquent des enfants : on se rassure tant bien que mal en disant que les séparations et les divorces sont devenus banals et que cela pourrait se passer sans trop de dégâts, quitte à envoyer le ou les enfants chez un psy. Tous ces efforts pour effacer la responsabilité et la culpabilité des parents n’empêchent pas les enfants d’être les premières victimes de la désunion. On touche une différence essentielle entre l’ancien monde et le nouveau : comment l’on construit une famille dans la durée et comment l’institution que constitue le mariage permet de vous décentrer d’une relation duale de type fusionnel et simplement sentimentale, de vous inscrire dans une généalogie, dans un temps long qui tissent le fil des générations.
Comme quelques autres, vous déplorez une « pensée dominante », notamment dans les grands médias. Mais, enfin : entre Alain Finkielkraut, Michel Onfray, Régis Debray, Marcel Gauchet ou encore vous–même, on ne peut pas dire que le « gauchisme culturel » pour reprendre votre notion soit si bien représenté en une des magazines, ni dans les ventes en librairies !
J-P LG : On assiste, c’est vrai, à la fin d’un cycle historique, mais, si j’ose dire celui-ci « n’en finit pas de finir »… Ceux qui sont nés dans la marmite du gauchisme culturel, c’est à dire ceux qui étaient adolescents après mai 68 ont développé une posture d’anticonformiste et d’imprécateur, rejouant la énième version de l’antifascisme, donnant constamment des leçons au peuple qui a voté Front national, avec les résultats que l’on sait. Ce que j’ai appelé le gauchisme culturel (3) a servi de substitut à la crise de la doctrine de la gauche dans les années 1980, à l’heure du mitterrandisme triomphant.
Son hégémonie est aujourd’hui battue en brèche (4) et ses représentants voient d’ailleurs que le vent tourne en leur défaveur, tout en continuant de se prétendre les représentants d’une certaine idée du Bien, d’une gauche pure, morale et authentique, contre toutes les « trahisons ». Ces gens-là vivent dans un monde de plus en plus coupé de la société et de ses évolutions qu’ils ne comprennent pas, les réduisant bêtement à la montée inexorable de la « réaction », du fascisme, de la xénophobie, du racisme et maintenant de « l’islamophobie » au moment même où la terreur islamique exerce ses ravages… Ils se sont créés un monde à part, angélique, où ils vivent dans l’entre-soi célébrant de grandes valeurs générales et généreuses : ouverture, multiculturalisme invertébré, gentillesse, pacifisme… Ce sont les gardiens des « villages Potemkine » de la post-modernité. Ils se tiennent chaud, y compris économiquement et socialement, dans un milieu à l’écart de l’épreuve du réel et ils ne cessent de célébrer leur monde rêvé sous la forme de multiples fêtes.
Tout se passe comme dans La ville qui n’existait pas, bande dessinée d’Enki Bilal et de Pierre Christin (5), une « cité à l’abri des autres hommes et de leurs cris, des autres villes et de leur crasse », ville littéralement mise sous une cloche transparente, ville aux couleurs chatoyantes, avec ses fêtes et ses défilés de carnaval, avec ses manèges et ses multiples attractions. En dehors de cette ville sous cloche, « parfaite et hors du temps », c’est la désolation, le chômage dans un paysage industriel en ruine… Cette bande dessinée qui date de la fin des années 1970 et a un côté science-fiction n’est plus si éloignée de la réalité ! Paris et les grandes métropoles mondialisées ressemblent à cette « ville qui n’existait pas ». Prenez par exemple Lille, qui voudrait devenir une capitale de l’art contemporain et dont les manifestations s’exposent dans nombre d’anciennes usines. Il n’est pas besoin d’aller bien loin en dehors de cette bulle pour voir la misère et la déstructuration liée au chômage de masse. C’est une fracture à la fois sociale et culturelle, accentuée par certains grands médias qui entretiennent à leur façon un monde fictif « où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil ».
Quant aux succès de librairie, il ne faudrait quand même pas oublier les multiples best-sellers liés à l’écologie fondamentaliste – qui ne se confond pas avec les problèmes réels que posent l’écologie –, les succès des livres sur le bien-être, la réconciliation avec soi-même, avec les autres et avec la nature, les méditations et les exercices en tout genre qui développent, comme je le montre dans mon livre, un angélisme et un pacifisme qui tentent de mettre les individus à l’abri des désordres du monde et nous désarment face aux ennemis qui veulent nous détruire. Mais je vous l’accorde : on arrive peut-être à la fin de ce courant qui dure depuis des années. Les attentats terroristes, la vague de migrants qui arrivent en Europe, l’impuissance de l’Union européenne, les effets d’une mondialisation économique libérale, le chômage de masse… constituent autant d’épreuves auxquelles il est difficile d’échapper. Sauf à mener une sorte de « politique de l’autruche » qui me paraît encore être pratiquée par une partie de la classe médiatique, politique et intellectuelle française et européenne. Mais la coupure avec la réalité est telle qu’elle ne peut plus être dissimulée comme elle l’a été auparavant. A chaque fois, on « remet le couvercle », mais cela devient de plus en plus difficile et ça déborde…
C’est ce que vous appelez « le point limite » ? Il y a quoi derrière ?
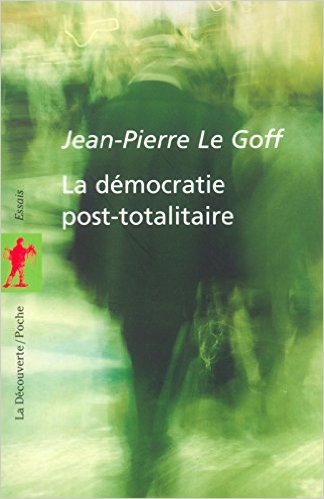 J-P LG : Ce n’est pas parce que cette période historique est en train de finir que ce qui va suivre est nécessairement réjouissant. Le monde fictif et angélique qui s’est construit pendant des années – auquel du reste, à sa manière, l’Union européenne a participé en pratiquant la fuite en avant – craque de toutes parts, il se décompose et cela renforce le désarroi et le chaos. La confusion, les fondamentalismes, le communautarisme, l’extrême droite gagnent du terrain… Le tout peut déboucher sur des formes de conflits ethniques et des formes larvées de guerre civile y compris au sein de l’Union européenne. On en aura vraiment fini avec cette situation que si une dynamique nouvelle émerge au sein des pays démocratiques, ce qui implique un travail de reconstruction, auquel les intellectuels ont leur part. Il importe tout particulièrement de mener un travail de reculturation au sein d’un pays et d’une Europe qui ne semblent plus savoir d’où ils viennent, qui il sont et où il vont. Tout n’est pas perdu : on voit bien, aujourd’hui, qu’existe une demande encore confuse, mais réelle de retour du collectif, d’institutions et d’un Etat cohérent qui puissent affronter les nouveaux désordres du monde. Ce sont des signes positifs.
J-P LG : Ce n’est pas parce que cette période historique est en train de finir que ce qui va suivre est nécessairement réjouissant. Le monde fictif et angélique qui s’est construit pendant des années – auquel du reste, à sa manière, l’Union européenne a participé en pratiquant la fuite en avant – craque de toutes parts, il se décompose et cela renforce le désarroi et le chaos. La confusion, les fondamentalismes, le communautarisme, l’extrême droite gagnent du terrain… Le tout peut déboucher sur des formes de conflits ethniques et des formes larvées de guerre civile y compris au sein de l’Union européenne. On en aura vraiment fini avec cette situation que si une dynamique nouvelle émerge au sein des pays démocratiques, ce qui implique un travail de reconstruction, auquel les intellectuels ont leur part. Il importe tout particulièrement de mener un travail de reculturation au sein d’un pays et d’une Europe qui ne semblent plus savoir d’où ils viennent, qui il sont et où il vont. Tout n’est pas perdu : on voit bien, aujourd’hui, qu’existe une demande encore confuse, mais réelle de retour du collectif, d’institutions et d’un Etat cohérent qui puissent affronter les nouveaux désordres du monde. Ce sont des signes positifs.
L’écrivain et journaliste Kamel Daoud a récemment annoncé qu’il entendait se mettre en retrait du journalisme (6). Ses mises en garde contre les dangers de l’islamisme lui ont valu, il y a un an, une fatwa émise depuis son pays, l’Algérie. Mais c’est apparemment les invectives du camp des « bien-pensants », et notamment la tribune d’un collectif d’anthropologues et de sociologues parue dans Le Monde, l’accusant d’islamophobie, qui aura eu raison de son énergie. Etes vous d’accord avec Jacques Julliard quand il écrit que « l’intimidation, l’interdit et la peur dominent aujourd’hui le débat » ?
J-P LG : Sur la question de l’islamisme, oui ! Avec un phénomène de prise en étau. Car vous avez d’un côté, l’islamisme radical qui exerce ses propres menaces, y compris sur la sécurité des personnes, et de l’autre côté, un phénomène de pression sourde, au sein même de la société. Certains pensent tout bas : « J’aurais des choses à dire mais je préfère les garder pour moi sinon cela risque de m’attirer des ennuis. » Quand on commence à raisonner de la sorte, on cède à une pression qui met en cause la libre réflexion et la liberté d’opinion. Ces dernières, oui, doivent faire face aux coups de boutoirs de la nouvelle police de la pensée et de la parole qui fait pression sur tout le monde en dégainant son accusation d’islamophobie à tout va et en n’hésitant pas à porter plainte à la moindre occasion.
Elisabeth Badinder dans les colonnes de Marianne, ou Chantal Delsol, dans celles du Figaro, évoquent les années 70, et les procès d’intention en fascisme à tout bout de champ…
J-P LG : Il peut y avoir de ça, mais la situation actuelle comporte une différence essentielle : aujourd’hui, quand vous accusez un tel ou un tel d’« islamophobie », vous désignez des cibles à des gens qui ne sont pas simplement dans le débat et la polémique avec les outrances et les schémas des années 1970. Vous les désignez à l’ennemi. C’est grave. Ces sociologues et anthropologues patentés ont tout de même dénoncé un intellectuel algérien qui connaît bien l’islamisme et fait preuve de courage en mettant sa vie en jeu. Il faut appeler un chat un chat. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de débat et de confrontation possibles, qu’il faille restreindre la liberté d’expression et les controverses, mais il faut faire attention. Le pluralisme, la critique et la polémiques sont inhérents au débat démocratique, mais encore s’agit-il d’ajouter que celui-ci n’a de sens que s’il existe un ethos commun impliquant un sens de la responsabilité, faute de quoi la référence à la liberté d’expression peut servir à justifier les dénonciations en tout genre.
Les réseaux sociaux bruissent désormais d’odieuses insultes du type « collabeur » à chaque coin de la toile… C’est quand même un climat pourri, qui empêche la libre réflexion et le débat de fond, pourtant absolument indispensables sur ces questions. Je crains que les difficultés et les pressions pour empêcher d’aborder librement les questions relatives à l’islam se développent au fil des ans sous prétexte de ne pas heurter la sensibilité de nos compatriotes de religion musulmane. Ce serait un grave coup porté à liberté de pensée et à l’Europe qui est précisément le « continent de la vie interrogée ». Dans ce domaine, les intellectuels ont un rôle important à jouer en faisant valoir une liberté de pensée qui n’est pas négociable.
Jean-Pierre Le Goff, propos recueillis par Anne Rosencher (Marianne, 13 mars 2016)
Notes
(1) Cf. « Comment être à la fois conservateur, moderne et social ? », Le Débat, n° 188, janvier-février 2016.
(2) Malaise dans la démocratie, Ed. Stock
(3) « Du gauchisme culturel et de ses avatars », Le Débat, n° 176, avril-mai 2013.
(4) « L’entretien du camp du Bien battue en brèche », Revue des deux mondes, février-mars 2016.
(5) Enki Bilal, Pierre Christin, « La ville qui n’existait pas », in Légendes d’aujourd’hui 1975-1977, Casterman, 2007.
(6) Kamel Daoud, Lettre à un ami étranger
14:53 Publié dans Entretiens, Philosophie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : jean-pierre le goff, entretien, philosophie, philosophie politique, sociologie, individualisme, individualisme moderne, démocratie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 mai 2013
L’Individualismo Assoluto della modernità è qualcosa di anti-umano
di Francesco Lamendola
Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]

Si dice che l’uomo moderno è individualista per eccellenza, e che tutta la società moderna si basa sull’individualismo; ed è sostanzialmente vero. Bisogna però precisare che non si tratta di “un“ individualismo qualsiasi, di un individualismo più o meno “normale”, cioè storicamente dato, ma di un individualismo radicale, quasi di una nuova religione: di un “individualismo assoluto”.
Mai nella storia s’era visto alcunché di simile. Individui portati alla solitudine, all’introspezione, al distacco dai propri simili, probabilmente ve ne sono sempre stati (anche se la cultura moderna favorisce il proliferare di questo tipo umano); ma si trattava pur sempre di un individualismo psicologico, capace di coesistere con la società nel suo insieme e di non recarle danno, semmai di stimolarla in senso positivo, perché fra tali individui vi sono, il più delle volte, quelli maggiormente creativi.
L’individualismo moderno, invece, è un individualismo ideologico, teorizzato da filosofi come Locke e Rousseau e inserito nella costituzione delle democrazie, a partire da quella degli Stati Uniti d’America: un individualismo virulento, intollerante, tanto astratto quanto velleitario, che pretende di dettar legge alla società, anzi, che concepisce la società in funzione di esso, così che quella diviene semplicemente lo sfondo sul quale l’individuo possa agire, mediante la quale egli possa affermarsi, mentre il compito dello Stato e delle leggi si riduce semplicemente quello di limitare, controllare, imbrigliare la società a favore dei “sacri” diritti individuali.
Il modo di produzione capitalistico ha aggiunto a tale individualismo un ulteriore elemento di aggressività brutale e di spietatezza: non ha alcuna importanza se, fuori della porta di casa mia, un povero disgraziato sta morendo di fame o di freddo: l’importante è che la mia casa, la mia fabbrica, i miei beni, siano adeguatamente tutelati contro di lui e contro le pretese dello Stato stesso (che, essendo una creazione sociale, è pur sempre un male, anche se il minor male possibile); e, se non lo sono, ne deriva automaticamente il mio diritto a difenderli da me stesso, armi alla mano, magari sparando e colpendo a morte un poveraccio o un bambino affamato, introdottisi nel mio giardino per rubarvi quattro mele.
L’individualismo assoluto è, dunque, in buona parte il frutto del capitalismo assoluto, nel quale il lavoro diventa una merce come qualsiasi altra e in cui chi possiede tale merce può farne l’uso che crede; o meglio, in cui il lavoro diviene una merce sottoposta non tanto all’arbitrio del singolo capitalista “cattivo”, ma a tutto un sistema di sfruttamento e di alienazione, sostanzialmente impersonale, dominato dalle banche e dalla finanza e alimentato continuamente dal cosiddetto progresso tecnologico (non per nulla, agli esordi della Rivoluzione industriale, il luddismo tentò di contrastare una tecnica messa interamente al servizio del profitto e tale da ridurre il lavoratore in condizioni di assoluta indigenza e disperazione).
Uno degli specchi nei quali tale situazione si riflette con maggiore evidenza è la letteratura, e più precisamente la narrativa di carattere popolare (e diciamo “popolare” non necessariamente in senso spregiativo: così come “popolare”, ad esempio, è «Pinocchio», o come lo fu e volle esserlo «I Promessi Sposi»; altro discorso andrebbe fatto per i vari «Il nome della rosa» o «Il codice Da Vinci», anche se Umberto Eco rifiuta con sdegno, ma secondo noi a torto, l’accostamento al romanzaccio di Dan Brown).
Sono preziose le osservazioni formulate dal critico letterario inglese e storico della letteratura Ian Watt (1917-1999) in un saggio divenuto ormai un classico, anche se, all’inizio, accolto assai poco favorevolmente dalla cultura accademica: «Le origini del romanzo borghese. Studi su Defoe, Richardson e Fielding» (titolo originale: «The Rise o f the Novel», 1957; traduzione dall’inglese di Luigi Del Grosso Destrieri, Milano, Fabbri, 1976, 1980, pp. 56-57):
«L’interesse del romanzo per la vita quotidiana per le persone ordinarie sembra dipendere da due importanti condizioni generali: la società deve valutare ogni singolo individuo abbastanza da considerarlo un soggetto degno di letteratura seria e deve esistere una varietà sufficiente di idee e di azioni tra le persone comuni perché un racconto dettagliato che le riguardi possa interessare persone altrettanto ordinarie, cioè i lettori di romanzi. È probabile che nessuna di queste due condizioni per l’esistenza del romanzo si sia verificata se non abbastanza recentemente perché ambedue dipendono da sorgere di una società caratterizzata da quel vasto complesso di fattori interdipendenti che chiamiamo “individualismo”
Perfino la parola è recente, essendo apparsa verso la metà del diciannovesimo secolo. In tutte le epoche e tutte le società, senza dubbio, alcune persone sono state “individualiste” nel senso di egocentriche, uniche o indipendenti in modo notevole dalle idee o costumi correnti; ma il concetto di individualismo implica assai di più. Implica una intera società retta principalmente dall’dea dell’intrinseca indipendenza di ogni individuo dagli altri individui e da quel complesso di modelli di pensiero e di azione che si denota col termine “tradizione”, una forza che è sempre sociale e non individuale. L’esistenza di una tale società, a sua volta, presuppone uno speciale tipo di organizzazione economica e politica e un’appropriata ideologia. Più specificamente, un’organizzazione economica e politica che permetta ai suoi membri un ampio ventaglio di scelte per le loro azioni e una ideologia basata principalmente, non sul rispetto per la tradizione, ma sull’autonomia dell’individuo, indifferentemente dalla sua condizione sociale e dalle sue capacità personali. Vi è un notevole accordo sul fatto che la società moderna è, per questi aspetti, estremamente individualista e che, delle numerose cause storiche della sua nascita, due sono soprattutto importanti: il sorgere del moderno capitalismo industriale e la diffusione del protestantesimo, specialmente nelle sue forme calvinista o puritana.
Il capitalismo produsse un grande incremento della specializzazione economica e questo, combinato a una struttura sociale meno rigida e omogenea e a un sistema politico meno assolutistico e più democratico, aumentò enormemente la libertà di scelta dell’individuo. Per coloro che erano pienamente esposti al nuovo ordine economico, l’entità su cui si basavano i vari arrangiamenti sociali non era più la famiglia né la chiesa né la corporazione né la città o qualunque altra entità collettiva, ma l’individuo che, egli solo, era primariamente responsabile dei suoi ruoli economici, speciali, politici e religiosi.
È difficile dire quando questo nuovo orientamento cominciò a influire sull’intera società: probabilmente non prima del diciannovesimo secolo. Ma il movimento era certamente cominciato assai prima. Nel sedicesimo secolo la Riforma e il sorgere degli stati nazionali avevano sfidato la sostanziale omogeneità sociale della cristianità medievale e, nelle famose parole di Maitland, “per la prima volta lo Stato Assoluto fronteggiava l’Individuo Assoluto”. Al di fuori della sfera politica e religiosa, tuttavia, i mutamenti furono lenti ed è improbabile che una struttura sociale e economica a base individualista non apparisse prima dello sviluppo del capitalismo industriale per influenzare una parte considerevole, anche se non ancora la maggioranza, della popolazione.»
Ora, è chiaro - o almeno dovrebbe essere chiaro, se vi fossero ancora delle teste pensanti e non una genia di “intellettuali” sistematicamente asserviti al sistema, nel quale trovano la loro mangiatoia e la relativa gratificazione narcisista – che nessuna società potrebbe resistere a lungo, se costruita su tali premesse e se sottoposta in maniera organica e sistematica a una tale logica intrinsecamente distruttiva: la logica dell’individualismo assoluto.
La società nasce per trovare un punto di equilibrio fra i bisogni dell’individuo e quelli della comunità, mentre la società moderna si è andata sempre più configurando come una dittatura del primo sulla seconda. Al tempo stesso, la “logica” democraticista ha diffuso la filosofia dell’individualismo assoluto presso strati sempre più ampi della popolazione, fino a includere, teoricamente, tutti, compresi coloro i quali non appartengono a quella determinata società (e a ciò ha contribuito anche il fenomeno della globalizzazione), con il risultato che l’odierno individualismo assoluto è anche un individualismo di massa, cosa chiaramente contraddittoria in se stessa e foriera di continue, inevitabili tensioni e spinte centrifughe.
La schizofrenia dell’uomo moderno, divaricato fra opposte spinte e tendenze («quel doppio uomo che è in me», dice messer Francesco Petrarca, il primo campione e vessillifero di tale nuovo tipo umano), è, al tempo stesso, causa ed effetto di questa inestricabile contraddizione, di questa radicale impossibilità: la nascita di una società nella quale tutti, ma proprio tutti, si sentono unici e originali, anche se appiattiti sulle mode più effimere e proni al conformismo più banale, anzi, appunto per tale assoggettamento alle mode e per tale abietto conformismo.
È bene sforzarsi di essere molto chiari su questo punto.
L’individualismo psicologico non è affatto un male in sé, almeno in teoria; il male nasce quando si afferma un virulento individualismo ideologico, che pretende di rifare il mondo sulla misura di qualunque imbecille che si crede un genio, di qualunque egoista che si crede una bella persona, di qualunque prepotente che si sente legittimato a calpestare il prossimo: tutti costoro, anzi, son convinti che la scopo della società sia quello di incoraggiare, proteggere e alimentare la stupidità, l’egoismo e la prepotenza del singolo individuo, specialmente se ricco e potente.
La tecnica, questo particolare tipo di tecnica moderna, scaturente dall’individualismo assoluto – automobile, televisione, computer, telefonino cellulare -, non fa che rafforzare tale spirale solipsistica e distruttiva: ciascun individuo non vede che se stesso, i propri timori e le proprie brame; e, intanto, non si accorge di essere decaduto dallo “status” di persona, ossia di soggetto, a quello di oggetto: esattamente il destino che egli contribuisce a creare per i suoi simili (oltre che per gli altri viventi, piante e animali, e per la Terra medesima). Tutto viene ridotto a cosa, tutto viene mercificato, tutto è in vendita e chiunque è pronto a vendersi e a prostituirsi – non solo in senso sessuale, si capisce -, perché la sola, unica, ossessiva parola d’ordine è sempre quella di Luigi Filippo d’Orléans: «Arricchitevi!».
I sentimenti, le passioni, l’affettività e la stessa sessualità soggiacciono interamente a questa logica. Lo si vede bene, ad esempio, in un film come «Nove settimane e mezzo», di Adrian Lyne (un film peraltro mediocre, sotto ogni punto di vista: ed è interessante che una certa critica “progressista” e di sinistra lo abbia accolto, nel non lontanissimo 1986, con un certo favore, scorgendovi chi sa mai quale critica implicita al capitalismo): nemmeno una profonda attrazione fra uomo e donna può resistere alle spinte distruttive dell’individualismo assoluto, perché quest’ultimo tende a ridurre la persona a oggetto, a cosa, cioè a corpo: ed è un gioco che, per quanto possa risultare intrigante all’inizio, almeno per un certo tipo di uomini e donne, alla lunga finisce per stancare e per generare un senso di amara e sconfortata sazietà, una vera sindrome di angoscia.
L’individualismo assoluto, dunque, è profondamente anti-umano: lo si vede anche nel paesaggio, stravolto dalla aberrante logica ultra-economicistica (che Marx, si badi, non ha affatto contestato alla radice): brutte case a schiera, tanto pretenziose quanto banali nel loro conformismo; palazzi e villette disordinati, dominati dal cattivo gusto, gli uni in stridente contrasto con gli altri; campagne devastate e desolate da superstrade e autostrade, il cui scopo è consentire al super-individuo di massa un rapido spostamento nel tempo più breve possibile, costi quello che costi: traforando montagne, abbattendo foreste, decretando la scomparsa di innumerevoli specie vegetali e animali.
L’individualismo assoluto, inoltre, mina alla base - perché la colpisce al cuore -, la società fondamentale, sulla quale si basano tutte le altre società: la famiglia. Esso crea un nuovo tipo umano, in costante competizione e rivalità con il proprio compagno o la propria compagna, con i propri genitori e con i propri figli: una vera e propria guerra di tutti contro tutti. Ma non è questo il volto “normale” della famiglia, come hanno amato dipingerlo scrittori e registi degli anni ruggenti della pseudo-contestazione (che era, in realtà, profondamente funzionale al sistema che essa pretendeva di criticare). È solo il volto di quella micro-società, patologica e intossicata, che è diventata la famiglia moderna, asservita alle logica distruttive dell’Individualismo Assoluto…
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : modernité, anti modernité, postmodernité, individualisme, moeurs contemporaines, philosophie, tradition, trraditionalisme, francesco lamendola |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 01 février 2012
Recuperare l’unità della coscienza contro la deriva del soggettivismo e delle “scienze umane"
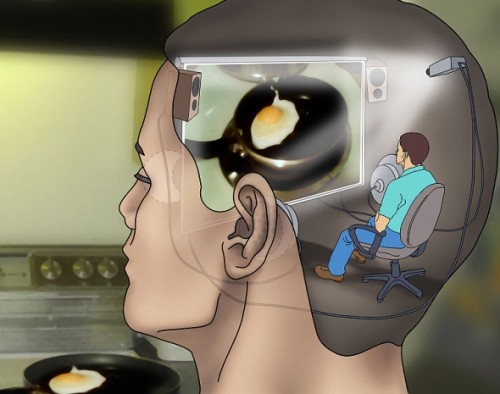
di Francesco Lamendola
Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
La coscienza dell’uomo moderno si trova presa in trappola tra due forze apparentemente opposte: da un lato quella del soggettivismo, dell’individualismo e del nominalismo, che nega la possibilità di conoscere alcunché, e dunque - a maggior ragione - la coscienza, se non come semplice nome; e quella delle sedicenti “scienze umane”, e specialmente dello strutturalismo, le quali, in nome di una visione oggettivistica dei fatti interiori, ridotti a semplici prodotti di norme e divieti imposti dall’esterno, vorrebbe azzerare la coscienza individuale in quanto tale e farne un semplice prodotto di risulta.
Diciamo che si tratta di “forze” perché, penetrando nella cultura del cittadino medio e venendo continuamente enfatizzate dalla grande maggioranza degli intellettuali, specialmente filosofi e psicologi, esse sono entrate a far parte del nostro modo di pensare e di sentire e non si delineano più semplicemente come l’orizzonte culturale entro il quale pensiamo, agiamo e viviamo, ma come parte del nostro immaginario e del nostro stesso sentire, cioè come parte del nostro essere.
Presa in una simile tenaglia, la coscienza dell’uomo moderno si è notevolmente modificata rispetto a quella dell’uomo pre-moderno; e, se la prima di queste due forze ha avuto l’effetto di relativizzare al massimo i suoi legami con il mondo, la seconda ha prodotto quello di opprimerla sotto il peso di un destino ineluttabile, o all’opposto (ma sono le due facce di una stessa medaglia) di consegnarla, per reazione, al più disordinato relativismo e al più egoistico indifferentismo.
Il soggettivismo moderno incomincia con Kant e si afferma con l’idealismo di Fichte ed Hegel: inizia con la negazione della cosa in sé e della metafisica e culmina con la delirante dottrina secondo cui non è la realtà a creare il pensiero, ma il pensiero a creare la realtà. A partire da quel momento, la strada era aperta per ogni fumisteria solipsistica: le cose non sono quelle che sono perché possiedono una propria natura, ma perché attraverso di esse si manifesta l’Idea: Idea che, a dispetto della lettera maiuscola, non è affatto un dato metafisico, ma una sorta di manifestazione superomistica (ante-litteram) del pensiero medesimo.
E così via di questo passo: deducendo, l’una dall’altra, tutta una serie di conseguenze sempre più improbabili, l’idealismo se ne va dritto per la sua strada, costruendo un castello di affermazioni gratuite, che si arrampicano l’una sopra l’altra, per niente preoccupato che il primo soffio di vento possa far crollare un edificio così pericolosamente sbilanciato e del tutto privo di solide fondamenta.
Le scienze umane - le quali, già nella definizione, tradiscono la matrice positivista -, da parte loro, hanno largamente avvalorato l’idea che il comportamento dell’uomo non sia che il frutto di un condizionamento da parte della società o che sia il risultato di istinti sui quali egli ha uno scarso controllo, oppure l’una e l’altra cosa insieme: in ogni caso, quel che emerge è una realtà umana impoverita, compressa, alienata da se stessa, condannata o ad un conformismo avvilente o ad una rivolta velleitaria, in nome di una autenticità che, di fatto, non è mai esistita.
Nessuna meraviglia che, in una simile prospettiva, l’io dell’uomo moderno appaia frammentato, disgregato, dissolto: che cosa resta dell’uomo, una volta che gli siano state strappate via le varie maschere, se non il nulla?
E che cosa può giustificare da parte sua, una determinata scelta etica, se in nessun caso il soggetto sceglie liberamente, ma agisce sempre sotto la duplice, inesorabile tirannia delle istituzioni sociali e dei propri stessi, inconfessabili istinti?
Ci sembra meritevole di riflessione quanto scrive a questo proposito Giannino Piana nell’articolo «La coscienza nell’attuale contesto culturale» (in: «Credere», Edizioni Messaggero, Padova, n. 128, vol. 2 del 2002, pp. 7-10):
«La cultura moderna è contrassegnata, fin dall’inizio e in tutte le sue fasi, dalla riduzione del soggetto a individuo, alla mancanza di una visione “personalista” del soggetto, la sola in gradi di fare immediatamente spazio (interpretandola non come dato accidentale ma come fattore costitutivo) alla dimensione della relazione e sociale. Vi è chi - non a torto - tende a far risalire tale riduzione all’influsso del Nominalismo, cioè alla negazione che esso fa dell’esistenza di ogni dato oggettivo (a causa della impossibilità di pervenire all’elaborazione di concetti che abbiano una consistenza reale, che non siano meri nomi o semplici “flatus vocis”), perciò a una lettura radicalmente “singolare” della realtà e alla riconduzione dell’ordine esistente a una realtà onnipotente, cin significative ricadute tanto su piano etico che politico.
La definitiva soppressione del concetto di “natura” (e conseguentemente di diritto naturale”) coincide con la nascita del “diritto soggettivo” come unico referente della vita sociale:l’antropologia individualista non consente di fondare la società a partire dal’essenza del soggetto, ma ne impone l’accettazione unicamente come condizione per lo sviluppo delle istanze individuali; la mediazione dei diritti soggettivi, cioè la imitazione della loro area di estensione diviene pertanto la via che rende possibile a tutti l’accesso a una loro (sia pire parziale) fruizione. La visione pessimistica dell’uomo propria della Riforma accentua tale tendenza, identificando il diritto soggettivo con il luogo di concentrazione degli istinti individuali e dei desideri egocentrici. Le teorie contrattualiste - a partire da Hobbes - fanno proprio questo assunto, impegnandosi, mediante il “patto sociale”, nella costruzione di un ordine, che consenta il superamento del “bellum omnium contra omnes”, che renda in altri termini possibile l’articolarsi di una forma di convivenza ordinata e pacifica
Il presupposto individualistico trova poi ulteriore conferma (e grande consolidamento) con l’avvento dell’industrializzazione e con l‘affermarsi del sistema capitalista. L’egoismo intellettuale sembra costituire la molla da cui l’attività economica prende avvio, e la stessa scienza economica, che si sviluppa in tale contesto fa dei princìpi della proprietà privata e della massimizzazione della produttività e del profitto le leggi “naturali” che devono governare la vita economica. L’interesse generale non rientra direttamente negli obiettivi dell’economia, ma viene piuttosto concepito o come l’esito automatico del ibero mercato si pensi al teorema della “mano invisibile” che ridistribuisce quanto viene prodotto (A. Smith) - o con una variabile con cui fare i conti per ragioni puramente economiche, considerando cioè i riflessi negativi prodotti dall’eccesso di sperequazione in termini di disagio e di conflittualità sociale.
Questo insieme di fattori si riflette in una lettura radicalmente soggettivistica della coscienza: : essa, lungi dall’essere vista come fonte originaria di una identità - quella del soggetto - che prende senso e si costruisce in un tessuto di relazioni, risulta espressione di una individualità chiusa e autosufficiente; la necessità di fare i conti con istanze derivanti dalla presenza dell’altro (e degli altri) ha infatti carattere del tutto esteriore ed è motivata da ragioni meramente utilitariste. La coscienza non è soltanto l’ultimo criterio della verità, è il criterio unico (ed esclusivo) del suo esercizio. L’affermazione “decido secondo coscienza” rispecchia questa convinzione: il riferimento a un ordine oggettivo è ritenuto superfluo (e persino deviante), l’agire ha nell’individuo la sua sorgente e si esaurisce in esso; tutto il resto è legato esclusivamente a ragioni di convenzione sociale, ragioni che non intaccano la soggettività delle scelte.
Questa spinta soggettivista si scontra peraltro - sta qui ilo carattere paradossale della situazione attuale - con l’opposta tendenza alla radicale oggettivazione della coscienza, provocata soprattutto dall’interpretazione (o dalle interpretazioni) che di essa ci forniscono le scienze umane. La psicologia, quella del profondo in particolare, pone l’accento sull’importanza che riveste il processo di formazione della personalità : la coscienza morale altro non è che l’introiezione del super-io sociale, l’assimilazione cioè di comandi e di divieti, che non hanno origine nell’interiorità del soggetto, ma sono il prodotto del condizionamento esercitato dal mondo esterno di cui il soggetto si appropria in nome del “principio di realtà”. A loro volta, le scienze sociali e culturali – basti qui ricordare l’antropologia d’ispirazione funzionalista - sottolineano la pesantezza degli influssi esercitati dalle strutture e dalle istituzioni della vita associata e, più in generale, dal costume dominante, cioè dagli stili di vita e dai modelli di comportamento, sulla condotta dei singoli; mentre gli stessi sviluppi elle scienze biologiche - si pensi alla fisiologia dei vari apparati e allo studio delle interazioni che tra essi si istituiscono - svelano la dipendenza dell’agire dell’uomo da dinamismi istintuali che producono forme di reazione immediata, difficilmente controllabili a livello razionale. La coscienza risulta così essere più il riflesso dell’insieme delle pressioni esercitate da un insieme di fattori - endogeni o esogeni - guidati, in ogni caso, da logiche deterministiche che una realtà dotata di consistenza originaria e autonoma, da cui prende forma il giudizio e la decisione morale. È come dire - ed è questa la posizione più radiale (e tuttavia, in tale ottica, coerente) espressa dallo strutturalismo - - che essa si riduce a eventi del tutto sovrastrutturale, a epifenomeno, la cui genesi e i cui caratteri distintivi vanno ricercati altrove; nel’influenza di un complesso intreccio di elementi, il peso di ciascuno dei quali è inoltre difficilmente valutabile. Al di là della convergenza attorno a questa visione, che svuota la coscienza della sua identità soggettiva, e pertanto la reifica, diverse sono le modalità descrittive che si danno di essa a seconda che si privilegi l’una o l’latra tecnica di approccio; la tendenza elle scienze umane, guidate nella ricerca e nella elaborazione dei dati da inevitabili precomprensioni metascientifiche, è infatti quella di trasformarsi in ideologie totalizzanti, dando vita a un “conflitto delle interpretazioni” che ha come sbocco la riduzione della coscienza alla realtà dell’inconscio op al riflesso condizionato dei modelli sociali e culturali egemoni.
L’oggettivazione della coscienza comporta per ciò stesso la negazione della moralità: sottraendo all’uomo quel principio interiore che dà senso autenticamente umano all’agire e riducendolo alla risultante di condizionamenti indotti dalla pressione di fattori diversi (e in ogni caso decisivi), si perviene allo svuotamento totale della soggettività umana, perciò all’ammissione dell’impossibilità di attribuire contenuto etico alle scelte…»
Giannino Piana, dunque, dopo aver fatto una analisi a nostro avviso largamente condivisibile della situazione attuale, considera tuttavia “paradossale” la confluenza di soggettivismo e scienze umane nell’espropriazione del senso di unità e di interiorità della coscienza che caratterizza la cultura moderna.
Ma è proprio vero che si tratta di un dato paradossale, ossia di un dato che scaturisce in maniera imprevista dall’azione reciproca delle forze in gioco? Vediamo.
Il nominalismo, che parte dalla negazione di una realtà conoscibile in se stessa, si sposa, come egli ben mette in evidenza, con l’utilitarismo sul piano etico e con il liberalismo sul piano politico-sociale. Ora, tanto l’utilitarismo quanto il liberalismo sono ideologie dell’egoismo individuale: per esse l’individuo è tutto, la società non è altro che lo sfondo in cui egli si muove e che deve assicurargli il massimo della sicurezza e del soddisfacimento dei suoi “diritti”.
In particolare, il liberalismo è parente stretto di una ideologia politica che, a torto, si considera come radicalmente antitetica ad esso, l’anarchismo: in realtà, esse hanno in comune l’interesse esclusivo per i diritti del singolo, la diffidenza verso l’altro, il fatto di ritenere lo Stato come un male inevitabile, ma da ridurre al minimo (liberalismo) o da eliminare del tutto (anarchismo). Adam Smith e Max Stirner sono molto più simili di quanto non si creda e hanno più cose in comune di quante ve ne siano a dividerli.
Entrambe le ideologie negano un’etica che si basi sulla relazionalità dei soggetti e che rappresenti l’autentico compimento della coscienza individuale, ciò che fa dell’uomo una “persona” e non un atomo isolato o, come voleva Leibniz (ma anche Freud), una monade senza porte e senza finestre; ed entrambe tentano poi, goffamente, di reintrodurre in qualche modo, dalla finestra, ciò che avevano cacciato dalla porta: il liberalismo, tirando in ballo la stravagante teoria per cui il massimo dell’egoismo individuale produrrebbe anche, chissà come, il massimo del bene comune; l’anarchismo, sposandosi - ma solo a parole - con il suo esatto contrario, il comunismo, e dando vita al comunismo anarchico di Kropotkin e Malatesta.
In ogni caso, il nominalismo porta al soggettivismo e quest’ultimo porta all’accentuazione ipertrofica delle ragioni dell’ego, nello stesso tempo in cui tende a svalutare la presenza dell’altro o, addirittura, a vederla come un impedimento e un ostacolo: c’è un filo rosso che lega, con assoluta coerenza, l’affermazione di Freud, secondo cui il comandamento di amare il prossimo come se stessi è assurdo, perché irrealizzabile, e quella di Sartre, che vede negli altri la manifestazione del nostro particolare inferno.
Le scienze umane, poi, per il modo stesso in cui sono sorte e si sono affermate e per il contesto culturale che le ha prodotte, dominato dall’ideologia del Positivismo, hanno esasperato la componente esterna nella formazione della coscienza, fino a suggerire che, senza tale azione proveniente dalla società, gli uomini sarebbero più o meno privi di una coscienza originaria e, con essa, di un senso profondo ed autentico del bene e del male, riducendoli a oggetti passivi ed inermi davanti a delle forze molto più grandi di loro.
Preso fra un inconscio oscuro e minaccioso, che lo domina con i suoi impulsi tanto più potenti, quanto più ci si sforza di reprimerli, ed una pressione sociale continua, sistematica, soffocante, l’uomo finisce per ridursi alla condizione di un grottesco burattino, agitato da ogni vento e sbattuto di qua e di là, senza una volontà propria, senza una capacità di distinguere, e tanto meno di scegliere, fra il bene e il male: per cui egli agisce come capita, «non si sa come» (parafrasando Pirandello), in maniera bizzarra, capricciosa, imprevedibile.
Ed è logico che così avvenga: se la coscienza non esiste come dato originario, o se essa è per noi inattingibile, e - dunque - si riduce a una mera ipotesi indimostrabile, allora non bisogna aspettarsi alcuna coerenza, alcuna progettualità, alcuna logica nelle azioni umane: esse avvengono a capriccio, incomprensibilmente, sul filo dell’istinto o della nevrosi cui il conflitto permanente e insolubile tra Es e Super-Io ci tiene costantemente impegnati e lacerati.
Oppure si prenda il caso delle terapie psicologiche moderne (per distinguerle da quelle che sono sempre esistite, sia presso i popoli tribali, ad esempio con i riti d’iniziazione, sia presso il mondo classico, ad esempio con la catarsi provocata nel pubblico dalla tragedia greca): come è possibile che possano essere realmente d’aiuto all’uomo, se esse partono dall’assunto pregiudiziale che non vi sia alcuna anima da guarire, alcuna coscienza da ricostituire, ma soltanto delle funzioni psichiche da ripristinare, in base ad una valutazione arbitraria ed egoistica di ciò che è utile, e non di ciò che è vero, buono e giusto?
Ebbene, non ci sembra che la convergenza di soggettivismo e oggettivazione esasperata si possa definire un fatto paradossale, perché in essa vi è una logica piuttosto chiara e lineare: se il nominalismo sostiene che non possiamo conoscere nulla di reale e il suo naturale erede, il soggettivismo, afferma che dobbiamo agire in base al nostro interesse e non in base alla scelta tra il bene e il male, allora il soggettivismo estremo viene a completarsi naturalmente nelle dottrine dell’oggettivazione, secondo le quali possiamo misurare i fattori che agiscono su di noi, sia dall’interno che dall’esterno, ma non rispondere ad essi con una decisione della coscienza, poiché quest’ultima non è che una vuota parola che diamo, sostanzializzandola, alla rete di influssi che operano su noi sia dall’esterno, sia dall’interno.
Il punto estremo del nominalismo, la filosofia del linguaggio che riduce le cose a frasi logicamente consequenziali, si tocca con il punto estremo dell’oggettivismo, ossia quello strutturalismo che fa sparire il soggetto come sorgente di coscienza e volontà e lo riduce a passiva appendice di forze molto più grandi, che agiscono su di lui a senso unico.
Che sia andata smarrita l’unità della coscienza è un male, perché, con buona pace di certo agnosticismo e di certo relativismo etico, tale smarrimento ha accentuato il senso di solitudine, di impotenza e di frustrazione dell’uomo moderno e ha trasformato la sua vita sociale in un deserto popolato di incubi, di nemici da abbattere o di schiavi da sottomettere.
Quando capiremo che la rifondazione della coscienza, il recupero della sua unità e della sua originaria autonomia, sono i compiti più urgenti che ci dobbiamo dare per il prossimo futuro?
Quando capiremo che ogni altra preoccupazione, che ogni altra indagine, al confronto, sono qualcosa di simile alle dispute sul sesso degli angeli, mentre Costantinopoli stava per cadere?
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, individualisme, solipsisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 22 avril 2010
Liberté française, liberté allemande
Liberté française,liberté allemande
à propos de « L'idéologie allemande » de Louis Dumont
par Guillaume HIEMET
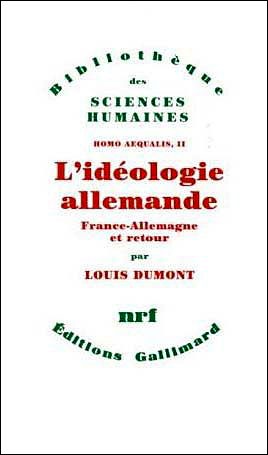 En 1967, Louis Dumont publiait un ouvrage, devenu un classique aujourd'hui, consacré à l'étude du système des castes en Inde. Cette vaste enquête, fort novatrice à l'époque, était le point de départ d'une comparaison méthodique entre les cultures traditionnelles et cette spécificité dans l'histoire des cultures que représente l'idéologie moderne occidentale. Pour aider à mieux comprendre le cheminement particulier qui a abouti au monde moderne, Dumont était enclin à souligner l'importance de la conception que les sociétés ont de la place de l'individu à l'intérieur d'elles-mêmes. Pour cela, il créait une distinction majeure entre les sociétés de type holiste et les sociétés de type individualiste. Par holiste, il entendait les représentations qui privilégient la totalité, le corps social avant de mettre en avant le rôle des individus, et, par le second terme, les idées qui posent l'individu comme premier par rapport au tout social. La comparaison entre le jeu des castes, la hiérarchie qu'il suppose et l'univers de l'individu, les notions de liberté, d'égalité présentait un éclairage nouveau de la situation moderne. Il poursuivait son enquête avec la publication, en 1977, d'Homo aequalis, une étude des fondements de la pensée économique, puis avec les Essais sur l'individualisme (1983) qui retraçaient la genèse de l'idéologie moderne à partir de la césure de l'ère chrétienne.
En 1967, Louis Dumont publiait un ouvrage, devenu un classique aujourd'hui, consacré à l'étude du système des castes en Inde. Cette vaste enquête, fort novatrice à l'époque, était le point de départ d'une comparaison méthodique entre les cultures traditionnelles et cette spécificité dans l'histoire des cultures que représente l'idéologie moderne occidentale. Pour aider à mieux comprendre le cheminement particulier qui a abouti au monde moderne, Dumont était enclin à souligner l'importance de la conception que les sociétés ont de la place de l'individu à l'intérieur d'elles-mêmes. Pour cela, il créait une distinction majeure entre les sociétés de type holiste et les sociétés de type individualiste. Par holiste, il entendait les représentations qui privilégient la totalité, le corps social avant de mettre en avant le rôle des individus, et, par le second terme, les idées qui posent l'individu comme premier par rapport au tout social. La comparaison entre le jeu des castes, la hiérarchie qu'il suppose et l'univers de l'individu, les notions de liberté, d'égalité présentait un éclairage nouveau de la situation moderne. Il poursuivait son enquête avec la publication, en 1977, d'Homo aequalis, une étude des fondements de la pensée économique, puis avec les Essais sur l'individualisme (1983) qui retraçaient la genèse de l'idéologie moderne à partir de la césure de l'ère chrétienne.
Deux conceptions de l'individu
Dans son dernier ouvrage, L'idéologie allemande,la méthode comparative ne s'attache plus tellement aux différences entre sociétés traditionnelles et monde moderne, mais davantage maintenant, aux deux formes différentes qu'a pu revêtir l'individualisme en France et en Allemagne. Le propos n'est pas nouveau chez Dumont, c'est déjà celui des Essais sur l'individualisme. Les cultures, contrairement à toute attente, ne sont pas transparentes, la notion d'individu ne se décline pas de la même manière des deux côtés du Rhin, le terme n'a pas la même histoire et il renvoie à des idées qui sont loin d'être identiques dans les deux pays. D'où le germe d'un malentendu, encore renforcé, lorsque celui-ci se conjugue à la difficulté, comme chez les Français, de concevoir les cultures comme ne répondant pas aux mêmes présupposés que les leurs.
L'universalisme français a du mal à discerner le fait que les autres cultures ne se laissent pas juger à l'aune de la sienne, suivant la tranquille certitude selon laquelle, pour reprendre l'expression d'Ernest Lavisse, la France est « la plus humaine des patries ». La distinction holisme-individualisme et la relation hiérarchique n'est pas la même selon les cultures et tend aisément à emprunter des vêtements très divers. Cela est, sans nul doute, la conséquence de notre héritage historique et du contexte dans lequel sont apparues les idées d'individu, car, comme le souligne Dumont, l'individualisme n'a jamais été capable de fonctionner dans une société sans que le holisme contribue d'une façon ou d'une autre à la bonne marche de celle-ci. Il n'est d'exemple plus probant que celui des Lumières où les nouvelles idées ont pu se développer prodigieusement dans un terreau politique traditionnel ne souffrant jamais ainsi, d'être mises à l'épreuve des faits.
Le rôle-clef de la Bildung
Pour Dumont, la spécificité de l'idéologie allemande se laisse ramener à trois idées majeures : la permanence du holisme, le rôle à long terme du luthérianisme dans la vision de l'individu et l'idée de souveraineté universelle, héritage du Saint Empire Romain de la Nation germanique (dernière réflexion qui aurait mérité d'être approfondie). Nantis de ces notions, Dumont est successivement conduit à se pencher sur les figures décisives d'Ernst Troeltsch et de Thomas Mann. Tous deux mis, en quelque sorte, en demeure par la violence du conflit franco-allemand d'éclairer la particularité allemande, avaient cherché à rendre intelligible ce que signifiaient liberté et individu outre Rhin. L'historien des religions tout comme l'auteur des Considérations d'un apolitique (1918) voyaient dans l'idée de Bildung,qui est formation, éducation personnelle de l'individu, le nœud géorgien donnant la clé du sentiment allemand.
Pour être bref, nous pourrions dire que la Bildung est l'espace de liberté à l'intérieur duquel se développe la pensée d'un individu, espace qui existe en dehors et qui laisse intact l'ensemble des liens qui rattachent cet individu à la communauté dans laquelle il vit. À la différence de la liberté anglaise ou française, la liberté allemande ne réside pas en première instance dans l'hémicycle des revendications politiques, elle est davantage liberté de s'épanouir, de se former, et ne considère que dans un second temps les conditions politiques. Ce que résume parfaitement Troeltsch dans un article publié en 1916, où la liberté allemande est définie comme : « Unité organisée du peuple sur la base du dévouement â la fois rigoureux et critique de l'individu au tout, complété et légitimé par l'indépendance et l'individualité de la libre culture (Bildung)spirituelle ».
Les sphères où évolue l'idée d'individu française et allemande ne sont pas superposables. L'individu des Droits de l'homme français ne rencontre pas la formulation luthérienne puis piétiste de l'individualité au sens où Thomas Mann avait pu dire, que la Réforme avait immunisé l'Allemagne de la Révolution. Si le propos de Dumont va à l'essentiel, le lecteur informé reste cependant sur sa faim. Les études trop courtes consacrées à Troeltsch ou à Mann permettent difficilement de sortir des grandes lignes alors que les études préexistantes consacrées notamment au second sont foison. On a l'impression en outre – est-ce snobisme de chercheur ? – que Dumont maîtrise mieux la bibliographie américaine que les études publiées en allemand ou en français sur le même sujet !
Crise française de la pensée allemande, crise allemande de la pensée française
La partie centrale consacrée à la genèse de la notion de Bildung en suivant respectivement Karl Philipp Moritz, Wilhelm von Humboldt (17671835) et « les années d'apprentissage de Wilhelm Meister » de Gœthe est incontestablement la partie la plus riche et la plus intéressante du livre. Œuvres littéraires, correspondances, réflexions politiques, cette fin de dix-huitième et début de dix-neuvième siècle sont perçus sous le signe d'une crise française de la pensée allemande, de même que les années qui suivirent 1871 en France, les années de la « Réforme intellectuelle et morale » peuvent être considérées comme une crise allemande de la pensée française. Dumont est clair : « Je me suis proposé ici de présenter l'histoire de la pensée et de la littérature allemande de 1770 à 1830 comme une réponse au défi des Lumières et de la Révolution » (1).
Dumont laisse entrevoir que l'idée de Bildung se forme peu à peu, est contrainte de se préciser en opposition à l'idée française d'individu. Mais avant d'aller plus en avant, il est nécessaire d'avoir à l'esprit les origines religieuses, protestantes, de cette idée de formation personnelle. La Bildung est, dès la fin du Moyen-Âge chez les mystiques, une éducation de soi qui se comprend comme ouverture à la grâce divine, le modèle (Vorbild)de cette attention constante à soi étant la figure de Jésus-Christ. Ce fondement religieux reste déterminant, rajeuni et ancré qu'il est par le piétisme, et ce, malgré l'élargissement et l'approfondissement que connaît l'idée de Bildung en cette fin de dix-huitième siècle.
Intégration et revendication d'autonomie
Dans un premier temps, l'analogie de la Bildung et des Lumières ne manque pas de se faire, partic ulièrement dans les manifestations les plus exacerbées des héros de roman : exaltation de l'homme en son individualité unique, égocentrisme, raison et liberté vagabonde. À partir de là, les rapprochements deviennent plus délicats. En effet, l'éducation de la Bildung consiste en grande part à faire sienne les valeurs intangibles de la communauté, de les intégrer au mieux, suivant les traits de sa complexion. Un peu de la façon dont Gœthe pourra dire : « Ce dont tu as hérité, acquiers-le afin de le posséder ». Le nouveau Bildungsroman, roman de formation, décrit les itinéraires de ces jeunes gens, où la revendication d'autonomie de la pensée se conjugue avec la nécessité du voyage, qui est reprise en charge, reconnaissance par soi-même, assimilation de ce qui a déjà été créé, vécu. Ainsi, comme le montre bien Dumont, la Bildung, loin de créer un individu désolidarisé, en retrait du monde, n'incite au retour sur soi que pour mieux s'enrichir des ressources du monde qui l'entoure. L’idéal de développement du sujet de la Bildung en vient à transformer l'homme abstrait des Lumières en lui taisant intégrer la dimension holiste, en l'intégrant dans un tout plus vaste.
C'est sur cette base que s'établit le dialogue avec la culture grecque et son souci pédagogique. L'homme qui naît au monde est un être mal dégrossi qui se doit de se développer, d'épanouir sa propre personne. Le perfectionnement de soi est le premier but auquel l'homme se doit de répondre. Cette réflexion de longue haleine centrée sur la formation et l'éducation de soi permettra ainsi à Wilhelm von Humboldt de dire : « C'est la contribution incontestable des Allemands d'avoir les premiers vraiment saisi ce qu'est la Bildung grecque ». Le parcours personnel d'un homme, l'approfondissement de sa pensée croissent à mesure que le monde proche a été reconnu et fait sien. À l'inverse, un monde mis en coupe réglée, géométrisé, cher à Descartes et à ses héritiers est un monde hors de toute présence humaine et dont l’exemplaire d'humanité, si ce mot a encore un sens ici, ressemblerait fort au téléspectateur modeme, martien héberlué.
Le zèle révolutionnaire, produit d'un individualisme à la française
Le personnage de Wilhelm von Humboldt, l'évolution de ses idées permettent assez bien de saisir la particularité de l'idéologie allemande, l'adaptation aux Lumières qui s'est opérée, la prudence puis le rejet de plus en plus ferme à l'égard de la Révolution française. La Révolution qui heurte les Allemands de plein fouet, qui entraîne l'Europe dans la guerre, qui suscite violences et spoliations lui ôte rapidement les rares partisans qu'elle pouvait trouver hors de France. Pour Humboldt, ces tares ont leur source dans cette volonté de transformation politique abrupte qui caractérise la Révolution, cette volonté de mettre en œuvre le contrat social rousseauiste en oubliant, un instant, que l'auteur de l'Émile ne pose celui-ci que comme hypothèse de réflexion.
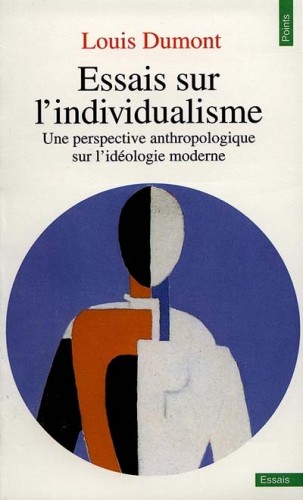 Humboldt, dans ses écrits, met en forme la réponse allemande aux idées révolutionnaires : l'individu de la Bildung forme un cercle indépendant de l'État et le laisse se réformer tout seul. Le pendant de cette conception est développé dans une importante étude théorique, l'Essai sur les limites de l'État. Si la première préoccupation de l'homme politique concerne la libre formation des sujets, les fonctions de l'État doivent être réduites au minimum et la première des tâches de celui-ci est d'assurer la sécurité des sujets.
Humboldt, dans ses écrits, met en forme la réponse allemande aux idées révolutionnaires : l'individu de la Bildung forme un cercle indépendant de l'État et le laisse se réformer tout seul. Le pendant de cette conception est développé dans une importante étude théorique, l'Essai sur les limites de l'État. Si la première préoccupation de l'homme politique concerne la libre formation des sujets, les fonctions de l'État doivent être réduites au minimum et la première des tâches de celui-ci est d'assurer la sécurité des sujets.
Cette subordination de la politique à la formation singulière de l'individu n'a pu se faire que dans la mesure où la Bildung était perçue comme une ouverture à la totalité. Les conséquences de ces points de vue se laissent assez rapidement saisir. Le conservatisme de l'État allemand retient les pleurs et les soupirs des historiens, qui regardent d'un même coup avec perplexité la conjugaison de méfiance envers l'État et d'obéissance qui caractérisent ses sujets. Ainsi, l'individualisme qui surgit dans la notion de Bildung est loin de se retrouver dans l'individu des Droits de l'homme.
Les lacunes de l'université française
Si l'individualisme français de l'identité renvoie à une égalité première de tous les hommes, pour le lecteur allemand, la même notion renvoie à la singularité, à la spécificité de tout être, et cette différence implique une inégalité de fait. C'est finalement lors de la création de l'université (1809-1810) de Berlin que Wilhelm von Humboldt aura la possibilité de mettre en œuvre ses vues réformatrices. Après la défaite devant les années napoléoniennes, la restauration de l'État passait en premier lieu par la relève spirituelle, préoccupation des meilleurs esprits de l'époque. L'université de Berlin, symbole du renouveau prussien, deviendra bientôt le foyer européen des sciences historiques et philologiques, modèle d'innovation dans les sciences humaines.
L'idée de Bildung renforce encore la tradition d'indépendance des universités allemandes. En comparaison, le régime des universités françaises, sous les régimes les plus différents du dixneuvième siècle, Empire, Restauration, Républiques, reste une université sous tutelle. Autrement dit, l'université allemande n'a de comptes à rendre qu'à la culture allemande ; en France, elle est un moyen de diffuser l'idéologie du régime. L'insuffisance de l'université française, ses tares, ont été remarquablement décrites par Georges Gusdorf dans son ouvrage sur l'herméneutique (Les origines de l'herméneutique), il est plaisant de constater que sa dépendance envers le pouvoir politique n'a aujourd'hui que peu changé, signe de la permanence des idées politiques.
L'idée de Bildung, de formation personnelle, a conservé un très fort pouvoir d'attraction dans les pays de langue allemande jusqu'à nos jours. Il nous semble que la littérature allemande a toujours été particulièrement sensible de préciser d'une part, la place de la personne dans la collectivité, de l'autre, son cheminement propre. Ainsi dans la confrontation franco-allemande qui est celle de la première guerre mondiale, l'individu apparaît en Allemagne sous trois couleurs dissemblables : « das Individuum », l'individu français détaché de toute appartenance à son peuple, « der Einzelne », l'individu dénombrable, et enfin « die Persönlichkeit », la personne en tant qu'elle a été formée par la Bildung, consciente de son appartenance. Les réponses pressenties par le Bildungsroman ne sont jamais univoques. Ainsi de l'itinéraire de Joseph Knecht, héros du Jeu de perles de verre de Hermann Hesse qui, au terme de son parcours initiatique, parvenu à la tête de son ordre éprouve une nostalgie inextinguible vers le monde et la nécessité d'y retourner. Initiation, enseignement forment un cercle où se déploie la liberté de l'homme ; la compréhension de la culture dessine, tout à la fois, son individualité et son attachement à la communauté.
Guillaume HIEMET.
• Louis Dumont, L'idéologie allemande : France-Allemagne et retour, Gallimard, 1991, 316 p., 145 FF, ISBN 2-07072426-3.
Esthétique du nihilisme
Du romantisme au modernisme
Bruno HILLEBRAND, Ästhetik des Nihilismus : Von der Romantik zum Modernismus, J.B. Metzlersche Verlagsbuchhandlung, Stuttgart, 1991, VI + 237 S., DM 48; ISBN 3-476-00781-2.
Un professeur allemand. Bruno Hillebrand (°1935), spécialiste de Gottfried Benn, s'interroge, avec pertinence et acuité, sur le rapport entre esthétique et nihilisme. Depuis que le romantisme a découvert le nihilisme vers la fin du XVIIIème siècle, cet « isme », qui est un mystérieux et inquiétant convive, comme l'a dit Nietzsche, frappe à toutes les portes : celle de la littérature comme celle de la philosophie ; plus tard, en notre siècle il est venu tambouriner à la porte du monde des arts. Dans le champ de la littérature, c'est Tieck qui l'a découvert ; Jean Paul a introduit, en toute connaissance de cause, le concept de nihilisme dans sa Vorschule der Ästhetik ; dès 1804, les Nachtwachen de Bonaventura constituent l'un des points culminants de l'expérience nihiliste. À l'évidence, Kleist souffrait du syndrome nihiliste, de l'absence de sens. Plus que tout autre poète, Büchner a thématisé dans sa poésie le sentiment de l'inutilité, de la vacuité, de l'absurdité du cosmos, de la religion et de l'existence. La pensée nietzschéenne, elle, englobe, arraisonne, place au centre de ses préoccupations, la nouvelle philosophie du nihilisme. Elle lui donne une profondeur inégalée et la transmet à d'autres poètes, écrivains et philosophes d'Allemagne et de France, Heidegger, Benn, Sartre, Camus et bien d'autres encore. Dans les arts plastiques et les styles de notre siècle, on ne cesse de percevoir les symptômes issus de l'expérience nihiliste : les réductions, les provocations, les positions anti-idéelles, les volontés anti-harmoniques ; bref, l'anti-art en général, avec son refus de toute conciliation tant au niveau du contenu qu'au niveau de l'objet.
Sans une saisie suffisante de ce que signifie le nihilisme, on ne peut comprendre l'évolution des arts au XXème siècle. Globalement, le modernisme dans les arts se place sous l'enseigne de « ce convive le plus mystérieux et le plus inquiétant ». En effet, s'il n'y a pas de sens, si tout est inutile ou vain, les futuristes peuvent briser les œuvres du passé, pour tenter (désespérément ?) de construire du neuf. Les gestes outrés, matamoresques de DADA, sont signes de désespoir ou acceptation joyeuse, narquoise, du chaos fondamental du monde. Et puisqu'il n'y a pas de valeurs éternelles, puisqu'aucune métaphysique ne peut être sérieusement revendiquée ou propagée, DADA estime que l'existence sur terre est insaisissable. Pour DADA, ce n'est pas le principe espérance qui est la constante fondamentale du modernisme, mais le principe hasard, ce qui appelle une question, qui est capitale : l'homme est-il un hasard ?
00:05 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, allemagne, france, sociologie, idées, idéologie, individualisme, liberté, 18ème siècle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 07 mars 2009
Année 2008 : l'effondrement du modèle individualiste

Année 2008 : l’effondrement du modèle individualiste [1]
Par Olivier Carer
La faillite de Lehman Brother le 15 septembre 2008 et l’écroulement du frauduleux château de cartes Madoff auront signifié pour l’ordre marchand ce que l’effondrement des Tours jumelles du World Trade center représenta pour l’Empire états-uniens.
Le krak mou qui aspira en quelques mois l’adiposité des fortunes les plus installées, de même que la déconfiture des usuriers ou la ruine de leurs malheureux clients ont scellé la fin du mythe de l’argent facile fondé sur une pyramide spéculative, sur des montages financiers incompréhensibles ou même souvent sur des manipulations mirobolantes. L’immoralité des spéculateurs névrotiques, la perversité de systèmes de rémunérations des traders ou des banquiers, la complaisance d’agences de notation consanguines ont accompagné la généralisation d’agissements collectifs illégaux pour lequel le médiatique Kerviel servit un temps de bouc émissaire utile.
Mais cette analyse technique de la crise de l’automne 2008, somme toute assez classique, ne laisse apparaître que l’écume de la vague. Car sous les soubresauts boursiers, un mouvement tellurique de grande ampleur ébranle tout un système de valeurs. C’est une véritable déflagration à laquelle nous assistons. Elle vient saper les fondements d’un ordre marchand que le vaticinateur Jacques Attali décrivait avec une provocante délectation dans sa « Brève histoire de l’avenir ».
La bataille de l’homme invisible avec lui même
Avec un à-propos salvateur, une intelligence invisible est venue menotter « la main invisible du marché » et faire sortir de ses rails la globalisation marchande et la financiarisation de l’économie qui se voulaient inéluctables. Ce déraillement de la locomotive mondialiste a surtout renvoyé à la figure d’une élite mondiale anthropocentrée qui a cru pouvoir revendiquer le meurtre de Dieu, les règles de l’ordre naturel.
La revanche du réel
L’économie qui relève moins d’une science prédictive que d’une méthode d’analyse de phénomènes passés, feint depuis peu d’opportunes indignations !
Comment réclamer 12% de rendement garanti lorsque la richesse effectivement produite ne dépasse pas 3%? Comment les banques ont-elles pu s’écarter des règles prudentielles en acceptant d’investir dans un système de titrisations risquées enrobé dans une opacité entretenue ? Pourquoi aucun organisme de contrôle privé ou étatique n’est intervenu comme régulateur d’un petit monde financier devenu fou ? Comment professer qu’un prêt puisse être accordé au delà des capacités propres de remboursement de l’emprunteur? Comment les états ont-ils pu croire que l’overdose de crédits allait pouvoir masquer indéfiniment l’érosion du pouvoir d’achat des ménages ? Comment imaginer un seul instant que la planète pouvait supporter la généralisation du modèle de consommation américaine pour les milliards d’humains à venir?
Le retour sur terre est effroyable. L’univers « champagne» où les financiers naviguaient dans un océan de liquidités et de bulles, s’est brutalement asséché. Les bulles boursières, du crédit, de l’immobilier, et récemment celle des matières premières ont explosé faisant de nombreuses victimes. On ne peut dépenser que la richesse que l’on a réellement créée. On ne peut engager nos économies que sur des risques que l’esprit humain est capable de mesurer. On ne peut rembourser qu’avec des revenus effectifs et non supposés car personne n’est riche de crédits garrotteurs. Enfin, la terre ne peut satisfaire la promesse mondialiste de l’accès à un salut de l’homme ici-bas par la consommation planétarisée. Dans un monde purement matérialiste où le seul moteur collectif est la consommation, lorsque le mirage des écrans plats et des gadgets informatiques qui servait de but ultime de la vie s’évapore, il ne reste rien que le désarroi. En 1951, l’économiste François Perroux proclamait déjà avec justesse: « les biens les plus précieux et les plus nobles dans la vie des hommes, l’honneur, la joie, l’affection, le respect d’autrui, ne doivent venir sur aucun marché ».
La revanche du grégaire
La conception d’un monde « nomade », du règne de la jouissance éphémère et immédiate qu’avec Bernard Attali, les mondialistes appelaient de ses vœux sombre dans le grand tourbillon bancaire et financier. Nous vivons le discrédit d’un paradigme cosmopolite qui annonçait l’avènement de l’homme nouveau « libéré » de ses attaches territoriales, historiques ou identitaires et devait voir la naissance d’un être de consommation, ne vivant que pour lui, n’agissant que pour satisfaire son égocentrisme, ne connaissant de loyauté qu’envers ses propres intérêts.
En cette fin d’année, cette utopie dangereuse rejoint le communisme au cimetière des idéologies cannibales.
Ce cataclysme bienfaisant qui balaye « le nouvel ordre mondial » devenu subitement ancien, déverrouille les portes d’un monde qui situe l’homme dans sa communauté et dans la chaine des générations. L’hétéronomie a désormais vocation à effacer progressivement la tyrannie de l’autonomie qui reconnaissait à l’homme un droit absolu de s’affranchir de tout mode de pensée héritée, de toute référence à une norme collective. Dans une économie qui ne doit être une fin en soi, ce mouvement rappelle à nous les valeurs des peuples sédentaires, celles des hommes qui construisent les murets de la montagne sur plusieurs générations pour eux-mêmes mais aussi pour leurs descendants. Refusant l’éphémère, le superficiel et l’individualisme prédateur, ils œuvrent dans la durée, dans le souci du futur et le respect de la nature.
Ce mouvement plein d’espoir pour l’avenir, vient donner à Barrès et à Péguy une nouvelle modernité.
Article printed from AMI France: http://fr.altermedia.info
URL to article: http://fr.altermedia.info/general/annee-2008-leffondrement-du-modele-individualiste_18822.html
URLs in this post:
[1] Image: http://fr.altermedia.info/images/olivier_carer51.jpg
00:30 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : finance, usure, crise, individualisme, politique internationale, politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 12 janvier 2009
Maatschappij allarmerend individualistisch
Maatschappij allarmerend individualistisch
Bijna 1 op 10 van de Vlamingen, of 8 procent, zegt dat hij of zij geen vrienden heeft. Dat staat in het januarinummer van het gratis tijdschrift "çava? " van de Christelijke Mutualiteit (CM) Midden-Vlaanderen.
(belga) - CM Midden-Vlaanderen ondervroeg zo'n 1.500 Vlamingen over vriendschappen. Hoewel 8 procent zei dat ze geen vrienden heeft, telde de Vlaming toch gemiddeld zeven vrienden. Gemiddeld waren er daarvan 2,5 beste vrienden.
Vier op tien leerde zijn vrienden kennen op het werk, ruim een derde via het verenigingsleven en meer dan een vierde via het uitgaansleven. Bijna de helft gaf aan dat ze hun vrienden leerden kennen via gemeenschappelijke vrienden.
Opvallend is dat een derde van de ondervraagden zei online vrienden te hebben. Dat was eerder het geval bij mannen dan bij vrouwen, met respectievelijk 40 procent en 27 procent. Vrouwen sluiten vriendschappen vooral via fora, mannen via gamen of bloggen. Wel zei ruim een vierde dat ze die vrienden nooit in werkelijkheid zien. Ook zou een op acht zich anders voordoen op het net dan in werkelijkheid. Drie kwart van de ondervraagden maakte een onderscheid tussen online vrienden en andere: ruim de helft vond die eerste oppervlakkiger.
Tenslotte zou meer dan een derde een afspraak met vrienden laten doorgaan, ook als de baas zou vragen om over te werken. Als de partner een vriend als liefdesrivaal zou beschouwen zou bijna 9 op 10 van de Vlamingen een en ander proberen uit te praten. Van de ondervraagden zou 3 procent de vriendschap laten vallen, 2 procent zou de relatie beëindigen. Zes procent zou de vriend stiekem blijven ontmoeten.
Het huidige beleid dat steeds meer de nadruk legt op het individu en egoisme ten koste van de gemeenschap, het middenveld en het gezin.
Het beleid dat steeds opnieuw tracht tradities te breken, onze cultuur te vernietigen, en multicultuur in te voeren zodat mensen van elkaar vervreemden, heeft zijn vruchten afgeworpen.
Het middenveld gaat kapot, gezinnen vallen uit elkaar, tradities gaan verloren en de Vlaming vereenzaamd.
00:16 Publié dans Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : sociologie, individualisme, détresse, isolement, psychologie, société |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




