Ex: http://www.counter-currents.com
1. Introduction
Those on the New Right are bound together partly by shared intellectual interests. Ranking very high indeed on any list of those interests would be the works of Martin Heidegger and those of the Traditionalist [1] [2] school, especially René Guénon and Julius Evola. My own work has been heavily influenced by both Heidegger and Traditionalism. Indeed, my first published essay (“Knowing the Gods [3]”) was strongly Heideggerian, and appeared in the flagship issue of Tyr [4], a journal that describes itself as “radical traditionalist,” and that I co-founded. This is just one example; many of my essays have been influenced by both schools of thought.
In my work, I have made the assumption that Heidegger’s philosophy and Traditionalism are compatible. This assumption is shared by many others on the Right, to the point that it is sometimes tacitly believed that Heidegger was some kind of Traditionalist, or that Heidegger and the Traditionalists had common values and, perhaps, a common project. These assumptions have never really been challenged, and it is high time to do so. The present essay puts into question the Heidegger-Traditionalism relationship.
Doing so will allow us to accomplish three things, at least:
(a) Arrive at a better understanding of Heidegger. This is vital, for my own study of Heidegger (in which I have been engaged, off and on, for over thirty years) has convinced me that he is not only the essential philosopher for the New Right, he is the only great philosopher of the last hundred years — and quite possibly the greatest philosopher who ever lived. I don’t make such claims lightly, and feel that I have only recently come to truly appreciate how much we need Heidegger. Yet reading Heidegger is extremely difficult. The present essay will help to clarify his thought by putting it into dialogue with the Traditionalists, whose writings are much more accessible, and much more familiar to my readers.

(b) Arrive at a better understanding of Traditionalism. We will find that in important ways Heidegger’s thought is not compatible with Traditionalism. The reason for this is that from a Heideggerian perspective Traditionalism is fundamentally flawed: it is thoroughly (and naïvely) invested in the Western metaphysical tradition which, according to Heidegger, sets the stage for modernity. In other words, because Traditionalism uncritically accepts the validity of Western metaphysical categories, it buys into some of the foundational assumptions of modernity. In the end, Traditionalism has to be judged a thoroughly modern movement, an outgrowth of the very epoch reviled by the Traditionalists themselves. All this, again, becomes clear only if we view Traditionalism, and Western intellectual history, from a Heideggerian perspective. I will argue that that perspective is correct. Thus, part of the purpose of this essay is to convince those on the Right that they need to take a more critical approach to Traditionalism.
(c) Arrive at a new philosophical approach. Although I will argue that Heidegger and Traditionalism are not compatible, the case can nonetheless be made that Heidegger is a traditionalist of sorts, and that, for Heidegger, something like a “primordial tradition” does indeed exist (though it is markedly different from the conceptions of Guénon and Evola). In short, through an engagement with Heidegger’s thought, and how it would respond to Traditionalism, we can arrive at a more adequate traditionalist perspective — one that shares a great many of the values and beliefs of Guénon and Evola, while placing these on a surer philosophical footing. In turn, I will also show that there are limits to Heidegger’s own approach, and that it is flawed in certain ways. Here we achieve a perfect symmetry, for these flaws are perceptible from a traditionalist perspective, broadly speaking. What I will have to say on this latter topic will also be of great interest to anyone influenced by Ásatrú, or the Germanic pagan revivalist movement.
In the end, we will not arrive simply at a fusion of Heidegger and Traditionalism, since both are transformed through the dialogue into which I put them. We will arrive instead at a new philosophical perspective, a new beginning and a new “program” for Western philosophy, one that has rejected Western metaphysics and that seeks to prepare the way for something yet to come, something beyond the modern and the “post-modern.” This new beginning is possible because the groundwork was laid by Heidegger, Guénon, and Evola (to name only three).
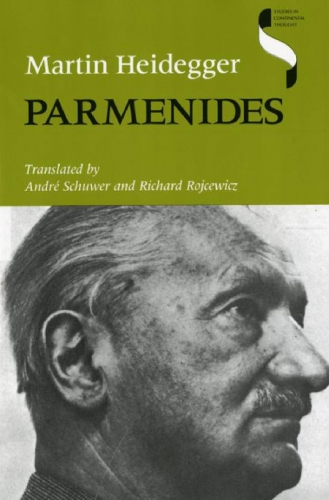
The project described above is quite ambitious, and it cannot be carried out in a single essay. Thus, the present text is the first in a series of several projected essays. (The outline of the series is presented as an Appendix, at the end of this essay.) Here, I will limit myself to a basic survey of Heidegger in relation to Traditionalism, his knowledge of Traditionalist writings, and the criticisms he would likely have leveled against this school of thought.
2. Anti-Modernism in Heidegger and the Traditionalists
The primary reason Heidegger gets associated with Guénon and Evola is that all three were trenchant critics of modernity. Heidegger and the Traditionalists hold that modernity is a period of decline, that it is a falling away from an “originary” [2] [5] position that was qualitatively different, and immeasurably superior. Further, the terms in which these authors critique modernity are often remarkably similar.
Consider these lines from Heidegger’s Introduction to Metaphysics, worth quoting at length because they sound like they could have come straight out of Guénon’s The Reign of Quantity and Signs of the Times:
When the farthest corner of the globe has been conquered technologically and can be exploited economically; when any incident you like, at any time you like, becomes accessible as fast as you like; when you can simultaneously “experience” an assassination attempt against a king in France and a symphony concert in Tokyo; when time is nothing but speed, instantaneity, and simultaneity, and time as history has vanished from all Dasein of all peoples; when a boxer counts as the great man of a people; when the tallies of millions at mass meetings are a triumph; then, yes then, there still looms like a specter over all this uproar the question: what for? — where to? — and what then? The spiritual decline of the earth has progressed so far that peoples are in danger of losing their last spiritual strength, the strength that makes it possible even to see the decline [which is meant in relation to the fate of “Being”] and to appraise it as such. This simple observation has nothing to do with cultural pessimism — nor with any optimism either, of course; for the darkening of the world, the flight of the gods, the destruction of the earth, the reduction of human beings to a mass, the hatred and mistrust of everything creative and free has already reached such proportions throughout the whole earth that such childish categories as pessimism and optimism have long become laughable. [3] [6]
In a later passage, Heidegger emphatically reiterates much of this: “We said: on the earth, all over it, a darkening of the world is happening. The essential happenings in this darkening are: the flight of the gods, the destruction of the earth, the reduction of human beings to a mass, the preeminence of the mediocre.” [4] [7] Consider also this passage:
All things sank to the same level, to a surface resembling a blind mirror that no longer mirrors, that casts nothing back. The prevailing dimension became that of extension and number. To be able — this no longer means to spend and to lavish, thanks to lofty overabundance and the mastery of energies; instead, it means only practicing a routine in which anyone can be trained, always combined with a certain amount of sweat and display. In America and Russia, then, this all intensified until it turned into the measureless so-on and so-forth of the ever-identical and the indifferent, until finally this quantitative temper became a quality of its own. By now in those countries the predominance of a cross-section of the indifference is no longer something inconsequential and merely barren but is the onslaught of that which aggressively destroys all rank and all that is world-spiritual, and portrays these as a lie. This is the onslaught of what we call the demonic [in the sense of the destructively evil]. [5] [8]
Finally, let us consider a passage from a later text, What Is Called Thinking? (1953):
The African Sahara is only one kind of wasteland. The devastation of the earth can easily go hand in hand with a guaranteed supreme living standard for man, and just as easily with the organized establishment of a uniform state of happiness for all men. Devastation can be the same as both, and can haunt us everywhere in the most unearthly way — by keeping itself hidden. Devastation does not just mean a slow sinking into the sands. Devastation is the high-velocity expulsion of Mnemosyne. The words, “the wasteland grows,” come from another realm than the current appraisals of our age. Nietzsche said, “the wasteland grows” nearly three quarters of a century ago. And he added, “Woe to him who hides wastelands within.” [6] [9]
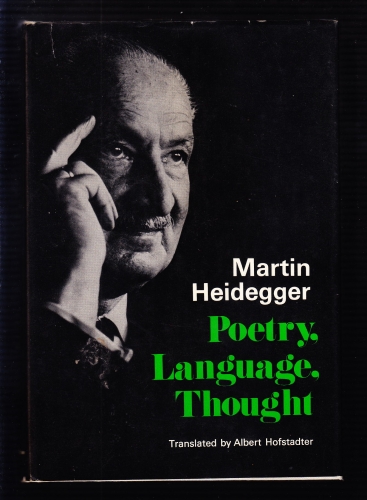
These passages give a fairly good summation of the essentials of Heidegger’s critique of modernity, which is worked out in much greater detail in his entire oeuvre. (Arguably, Heidegger’s confrontation with modernity is the central feature of his entire philosophy.) We may note here, especially, four major points. [7] [10] I will set these out below, along with quotations from Guénon’s Reign of Quantity, for comparison:
(a) The predominance of the “quantitative” in modernity; the triumph of the quantitative over the qualitative:
Guénon: “The descending movement of manifestation, and consequently that of the cycle of which it is an expression, takes place away from the positive or essential pole of existence toward its negative or substantial pole, and the result is that all things must progressively take on a decreasingly qualitative and an increasingly quantitative aspect; and that is why the last period of the cycle must show a very special tendency toward the establishment of a ‘reign of quantity.’” [8] [11]
(b) The cancellation of distance in the modern period; the increasing “speed” of modernity:
Guénon: “[Events] are being unfolded nowadays with a speed unexampled in the earlier ages, and this speed goes on increasing and will continue to increase up to the end of the cycle; there is thus something like a progressive ‘contraction’ of duration, the limit of which corresponds to the ‘stopping-point’ previously alluded to; it will be necessary to return to a special consideration of these matters later on, and to explain them more fully.” [9] [12]
And:
“The increase in the speed of events, as the end of the cycle draws near, can be compared to the acceleration that takes place in the fall of heavy bodies: the course of the development of the present humanity closely resembles the movement of a mobile body running down a slope and going faster as it approaches the bottom . . .” [10] [13]
(c) Modernity’s leveling effect; the destruction of an order of rank:
Guénon: “It is no less obvious that differences of aptitude cannot in spite of everything be entirely suppressed, so that a uniform education will not give exactly the same results for all; but it is all too true that, although it cannot confer on anyone qualities that he does not possess, it is on the contrary very well fitted to suppress in everyone all possibilities above the common level; thus the ‘leveling’ always works downward: indeed, it could not work in any other way, being itself only an expression of the tendency toward the lowest, that is, toward pure quantity . . .” [11] [14]
(d) Modernity’s reduction of everything to uniformity:
Guénon: “A mere glance at things as they are is enough to make it clear that the aim is everywhere to reduce everything to uniformity, whether it be human beings themselves or the things among which they live, and it is obvious that such a result can only be obtained by suppressing as far as possible every qualitative distinction . . .” [12] [15]

In later works, Heidegger explicitly ties modernity’s will towards uniformity to the “mechanization” of human beings. The spirit of technology becomes so totalizing that finally human beings themselves are “requisitioned” (to use a Heideggerian expression) and integrated as subsidiary mechanisms within the vast machine of modernity. In this connection, consider this passage from Guénon, worth quoting at length:
Servant of the machine, the man must become a machine himself, and thenceforth his work has nothing really human in it, for it no longer implies the putting to work of any of the qualities that really constitute human nature. The end of all this is what is called in present-day jargon ‘mass-production,’ the purpose of which is only to produce the greatest possible quantity of objects, and of objects as exactly alike as possible, intended for the use of men who are supposed to be no less alike; that is indeed the triumph of quantity, as was pointed out earlier, and it is by the same token the triumph of uniformity. These men who are reduced to mere numerical ‘units’ are expected to live in what can scarcely be called houses, for that would be to misuse the word, but in ‘hives’ of which the compartments will all be planned on the same model, and furnished with objects made by ‘mass-production,’ in such a way as to cause to disappear from the environment in which the people live every qualitative difference. [13] [16]
One last quotation from Guénon: “Man ‘mechanized’ everything and ended at last by mechanizing himself, falling little by little into the condition of numerical units, parodying unity, yet lost in the uniformity and indistinction of the ‘masses,’ that is, in pure multiplicity and nothing else. Surely that is the most complete triumph of quantity over quality that can be imagined.” [14] [17]
It would be pointless to amass further such quotations from Guénon since his work is replete with them — and since many of my readers are much more familiar with Guénon’s work than with Heidegger’s. It would be equally pointless to quote the many virtually identical observations from Evola (who is probably much more familiar to my readers even than Guénon). A substantial amount of Evola’s work is occupied with elaborating and extending Guénon’s critique of modernity, to which Evola devoted entire volumes (e.g., Revolt Against the Modern World, Ride the Tiger, Men Among the Ruins, etc.). However, their positions diverge when Evola advocates that the superior man respond to modernity by “riding the tiger” (i.e., utilizing certain negative elements of the modern world, which might destroy lesser men, for the positive purpose of self-realization).
3. The Evola Quotation in Heidegger’s Nachlass
The foregoing has hopefully demonstrated to the reader that Heidegger and Guénon held strikingly similar views on modernity. Although Heidegger knew individuals who respected Guénon (e.g., Carl Schmitt and Ernst Jünger), no evidence has emerged that Heidegger actually read Guénon’s work. Very recently, however, evidence has emerged that Heidegger read Evola. However, far from supporting the idea that Heidegger was influenced by Evola or sympathetic to him, an examination of this evidence will demonstrate exactly where Heidegger parts company with Traditionalism. [15] [20]

Amongst Heidegger’s Nachlass (the papers left behind after his death) a handwritten note has been found in which the philosopher quotes a passage from Friedrich Bauer’s 1935 German translation of Revolt Against the Modern World (Erhebung wider die moderne Welt). Here is the passage as Heidegger copied it out:
Wenn eine Rasse die Berührung mit dem, was allein Beständigkeit hat und geben kann — mit der Welt des Seyns — verloren hat, dann sinken die von ihr gebildeten kollektiven Organismen, welches immer ihre Größe und Macht sei, schicksalhaft in die Welt der Zufälligkeit herab.
And here is a translation:
When a race has lost contact with what alone has and can give it permanence [or “stability,” Beständigkeit] — with the world of Beyng [Seyns] then the collective organisms formed by it, whatever be their greatness and power, are destined to sink down into the world of contingency.
For comparison, here is the entire passage from Bauer’s text:
Wenn eine Rasse die Berührung mit dem, was allein Beständigkeit hat und geben kann — mit der Welt des “Seins” — verloren hat, dann sinken die von ihr gebildeten kollektiven Organismen, welches immer ihre Größe und Macht sei, schicksalhaft in die Welt der Zufälligkeit herab: werden Beute des Irrationalen, des Veränderlichen, des “Geschichtichen,” dessen, was von unten und von außen her bedingt ist. [16] [21]
We immediately notice two things when Heidegger’s handwritten version is compared to the original. First, Heidegger has rendered Sein as Seyn. [17] [22] Second, Heidegger replaces a colon with a period and omits the last part of the sentence entirely. The part after the colon can be translated as follows: “[to] become prey to the irrational, the changeable, the ‘historical,’ of what is conditioned from below and from the outside.” Why did Heidegger make these changes? Fully answering this question will allow us to see that Heidegger actually rejects Evola’s Traditionalism in the most fundamental terms possible.
First of all, it is likely that this undated note comes from sometime in the 1930s. During this time, Heidegger began utilizing Seyn, an archaic German spelling of Sein (Being). [18] [23] But why? What did this signify? It was not simply eccentricity on Heidegger’s part. By Seyn, Heidegger meant something distinct from Sein, which refers to the Being that beings have (“Being as such”). Seyn instead refers to what Heidegger calls elsewhere “the clearing” (die Lichtung). This metaphorical expression refers to a clearing in a forest, which allows light to enter in and illuminate what stands within the clearing. Thomas Sheehan describes Heidegger’s clearing as “the always already opened-up ‘space’ that makes the being of things (phenomenologically: the intelligibility of things) possible and necessary.” [19] [24] The clearing is what “gives” Being.

Heidegger writes in “The End of Philosophy and the Task of Thinking” (1964):
The forest clearing is experienced in contrast to dense forest, called Dickung in our older language. The substantive “opening” [Lichtung] goes back to the verb “open” [lichten]. The adjective licht “open” is the same word as “light.” To open something means: to make something light, free and open, e.g., to make the forest free of trees at one place. The openness thus originating is the clearing. . . . Light can stream into the clearing, into its openness, and let brightness play with darkness in it. But light never first creates openness. Rather, light presupposes openness. However, the clearing, the opening, is not only free for brightness and darkness, but also for resonance and echo, for sounding and the diminishing of sound. The clearing is the open region for everything that becomes present and absent. . . . What the word [opening] designates in the connection we are now thinking, free openness, is a “primal phenomenon” [Urphänomenon], to use a word of Goethe’s. [20] [25]
Consider a simple example. I approach an unfamiliar object sitting on my doorstep. I cannot place it; try as I might it remains a mystery. But as I approach closer still, all is revealed: I see now that it is an Amazon box. In this moment, what has occurred is that the Being of the object — what it is, what its meaning is — becomes present to me. [21] [26] In order for this to be possible at all, I must bear within me a certain special sort of “openness,” within which the Being of something makes itself known or makes itself present. [22] [27]
Contrary to how empiricists tend to conceive things, I don’t actually experience myself as hanging a label onto the object or slotting it within a mental category. This is an analysis after the fact of experience, not what I actually experience. If we are truer to the phenomenon than the empiricists (i.e., if we are good phenomenologists) we have to report that the experience is actually one in which the Being of the thing seems to “come forth,” or to display itself as we explore the object. But, again, this is only possible because of the “openness” referred to earlier. In this openness, Being displays itself; it is “lit up” within the space of the metaphorical “clearing.”

Thus, for Heidegger it is possible to speak of something deeper or more ultimate than Being itself (hence, an Urphänomenon): that which allows our encounter with the Being of beings in the first place; the open clearing. When Heidegger famously refers to “the forgottenness of Being” (Vergessenheit des Seins) he is actually referring to the forgottenness of the clearing. [23] [28] The clearing is forgotten in the sense that we have forgotten that in virtue of which Being is given to us. As I will discuss later, Heidegger holds that the Western metaphysical tradition, beginning with the Pre-Socratics, systematically forgets the clearing, and he traces all of our modern ills to this forgetting. He writes: “In fact, the history of Western thought begins, not by thinking what is most thought-provoking, but by letting it remain forgotten.” [24] [29]
Now, by contrast, when Evola speaks of “the world of being” (Welt des Seins; mondo di essere) in this passage and elsewhere, he is referring to a Platonic realm of timeless essences that are the true beings, in contrast to the changeful, impermanent terrestrial beings we encounter with the five senses. Traditionalism is heavily dependent on this Platonic metaphysics. Consider, for example, Evola’s words from the very beginning of Revolt:
In order to understand both the spirit of Tradition and its antithesis, modern civilization, it is necessary to begin with the fundamental doctrine of the two natures. According to this doctrine there is a physical order of things and a metaphysical one; there is a mortal nature and an immortal one; there is the superior realm of “being” and the inferior realm of “becoming.” Generally speaking, there is a visible and tangible dimension and, prior to and beyond it, an invisible and intangible dimension that is the support, the source, and the true life of the former. [25] [30]
Not only does Heidegger reject this Platonic metaphysics, he sees it as the first major stage in the decline of the West. Its inception is essentially identical with the “forgottenness” of the clearing spoken of a moment ago. All the aspects of modernity Heidegger was quoted earlier as deploring are ultimately traceable, he believes, to Platonic metaphysics. Thus, Heidegger completely rejects the idea that a “race” declines when it has “lost contact” with being, in the Platonic sense of “being” meant by Evola. Quite the reverse: a race — our race — has declined precisely through its turn toward Platonic metaphysics, and its turn away from the clearing. Thus, when Heidegger swaps Sein for Seyn, he is entirely changing the meaning of what Evola is saying. He is rewriting the passage so that it agrees with his own position: the decline of the West stems from its forgottenness of Seyn (the clearing) and its embrace of the Platonic Sein of the Western metaphysical tradition.

Heidegger omits the last part of Evola’s sentence for similar reasons. Let us look again at those words. Evola tells us that when a race has lost contact with “the world of being” it will “become prey to the irrational, the changeable, the ‘historical,’ of what is conditioned from below and from the outside.” Heidegger omits these words because he rejects Evola’s dichotomy between “being” and “the historical.” Heidegger argues, in fact, that Beyng/the clearing is inherently historical (geschichtlich), and changeable (veränderlich). The Being of things actually changes as culture changes. This is the same thing, fundamentally, as saying that the meaning of things changes over time.
But could the Being/meaning of the Amazon box on my doorstep ever change? Of course. Imagine a future world without Amazon, or one in which Amazon has been declared a monopoly and broken up into a number of different, competing entities. No more Amazon boxes on doorsteps. When you do see them, you see them in museums and you no longer see them simply as utilitarian objects. You no longer think, on glimpsing one, “Oh, my copy of Being and Time has arrived,” or some such. Instead, the Amazon box takes on a new meaning: as a symbol of a dark time we are, happily, well beyond; a time in which we allowed companies like Amazon not only to corner the market and put all smaller competitors out of business, but to shape the information we have access to through censorship and the banning of books [31].
Thus, if the Being or meaning that things have for us changes over the course of history, as culture and circumstances change, then, contra Evola, Being is inescapably “changeable” and “historical.” Evola also says that a race which loses contact with his idea of being falls prey to “the irrational” (das Irrational, in the German translation). Would Heidegger endorse this as well? Is his idea of Being “irrational”? Well, Heidegger does argue that historical-cultural shifts in Being/meaning are not fully intelligible to human beings. The reason for this is that it is always within Beyng/the clearing that things are meaningful or intelligible to us. It therefore follows that Beyng/the clearing itself is not ultimately intelligible. In a highly qualified sense, we could thus describe it as “irrational.” That Evola implicitly endorses the equation of being with “the rational” in this passage is extremely ironic. As we will see in a later installment, Heidegger argues that this equation is a key feature of the modern inflection of the Western metaphysical tradition, and that all the modern maladies Evola decries are ultimately attributable to it.
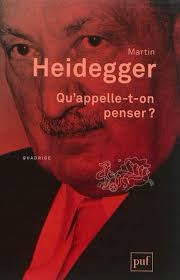 Heidegger would have regarded Guénon and Evola as philosophically naïve—for several reasons. First, they uncritically appropriate the Western metaphysical tradition in the name of combating modernity. Yet, as I have already mentioned, Heidegger argues that that tradition is implicated in the decline of the West. Second, the Traditionalists naïvely assert that this metaphysical tradition is “perennial” or timeless. They take Platonism as preserving elements of a primordial tradition that antedates Plato by millennia. They hold that the time of Plato belongs to the Kali Yuga (the fourth age, the decadent “Iron Age”), but they take Plato (and other ancient philosophers) to be preserving an older, indeed timeless wisdom. However, this is pure speculation, for which there is no solid scholarly evidence. [26] [32]
Heidegger would have regarded Guénon and Evola as philosophically naïve—for several reasons. First, they uncritically appropriate the Western metaphysical tradition in the name of combating modernity. Yet, as I have already mentioned, Heidegger argues that that tradition is implicated in the decline of the West. Second, the Traditionalists naïvely assert that this metaphysical tradition is “perennial” or timeless. They take Platonism as preserving elements of a primordial tradition that antedates Plato by millennia. They hold that the time of Plato belongs to the Kali Yuga (the fourth age, the decadent “Iron Age”), but they take Plato (and other ancient philosophers) to be preserving an older, indeed timeless wisdom. However, this is pure speculation, for which there is no solid scholarly evidence. [26] [32]
A further Heideggerian objection to Traditionalism may be considered at this point, and it is an extremely serious one. Both Heidegger and the Traditionalists decry rootless modern individualism. However, Heidegger’s critique goes much further. Recall that for the philosopher Being is inherently historical and changeable. What things are for us, or what they mean, is determined in part by our historical situation. Human Dasein is always embedded in a set of concrete historical, cultural circumstances. Heidegger writes: “Only insofar as the human being exists in a definite history are beings given, is truth given. There is no truth given in itself; rather, truth is decision and fate for human beings; it is something human.” [27] [33] This does not, however, mean that truth, as human, is something “subjective”:
We are not humanizing the essence of truth: to the contrary, we are determining the essence of human beings on the basis of truth. Man is transposed into the various gradations of truth. Truth is not above or in man, but man is in truth. Man is in truth inasmuch as truth is this happening of the unconcealment of things on the basis of creative projection. Each individual does not consciously carry out this creative projection; instead, he is already born into a community; he already grows up within a quite definite truth, which he confronts to a greater or lesser degree. Man is the one whose history displays the happening of truth. [28] [34]

As a result of this stance, Heidegger rejects both the Enlightenment ideal of a “view from nowhere,” as well as rootless, modern cosmopolitanism.
Consider, however, the following lines from The Reign of Quantity. Guénon writes disapprovingly of “those among the moderns who consider themselves to be outside all religion” — i.e., freethinking individualists. He asserts that such men are “at the extreme opposite point from those who, having penetrated to the principial unity of all the traditions, are no longer tied to any particular form.” This latter position, of course, is that of Guénonian Traditionalism itself. In a footnote, he then approvingly quotes Ibn ‘Arabî: “My heart has become capable of all forms: it is a pasture for gazelles and a monastery for Christian monks, and a temple for idols, and the Kaabah of the pilgrim, and the table of the Thorah and the book of the Quran. I am the religion of Love, whatever road his camels may take; my religion and my faith are the true religion.” [29] [35]
Though Guénon contrasts the position of the modern freethinker to the Traditionalist, Heidegger would doubtless argue that there is a fundamental identity between them. The freethinker imagines that he has freed himself from any cultural-religious context and become a kind of intellectual or spiritual cosmopolitan. Yet the Traditionalist thinks the exact same thing. The only difference is that the freethinker believes he has cast off religion or “spirituality” itself, whereas the Traditionalist imagines that he adheres to a decontextualized, ahistorical, and universal spiritual construct called “Tradition.” This standpoint too is fundamentally modern.

One might object, however, that Guénon’s decision to convert to Islam and “go native” in Cairo, where he spent the last twenty years of his life, indicates that he was aware that tradition could not be a free-floating abstraction, and that to be a true Traditionalist one had to choose a living tradition and immerse oneself in it. This is true, as a statement of Guénon’s views. But the very idea that one can choose a tradition buys into the modern conception of the autonomous self who may, from a standpoint of detachment from any cultural or historical context, survey the different traditions and select one. It is no use here to point out that all Muslims must, in a sense, “choose” Islam, as it is not an ethnic religion but a creedal one, whose faith all adherents must profess, and to which anyone may convert. This is a valid point, but a superficial one. Islam emerged from a cultural and historical context quite alien to the West, and which no Westerner may ever truly enter.
4. Conclusion
Let us now consider a couple of objections to this Heideggerian critique of Traditionalism.
First, defenders of Traditionalism might respond that Guénon and Evola are primarily grounded in the Indian tradition, and not in Western metaphysics at all. There are essentially two pieces of evidence for this claim. The first is Guénon and Evola’s endorsement of the Hindu cyclical account of time, of the yugas, which is indeed quite ancient. Both seem to accept this teaching in very literal terms, right down to the traditional Hindu calculations of the time span of each yuga (which strike most modern readers as arbitrary inventions). Second is the primacy granted by both thinkers to Vedanta. Both Guénon and Evola regard the teachings of the Upanishads as an expression of a very ancient ur-metaphysics, which constitutes a “perennial philosophy.”

The dependence of the Traditionalists on the Indian tradition is very real. The trouble, however, is that they interpret the Indian materials in terms of the categories and terminology of Western metaphysics. Indeed, this is especially true of Guénon, who shows no signs of recognizing that there is anything problematic about understanding the Upanishads in terms derived from Platonic and Aristotelian philosophy. For example, right at the beginning of The Reign of Quantity, Guénon discusses the duality of Purusha and Prakriti using the categories of “essence and substance” — then, a page later, he appeals to “form and matter,” then to “act and potency.” [30] [38] This is all Aristotelian terminology. Moreover, there is no attempt on Guénon’s part to recover the “originary” sense of these terms in Aristotle. Instead, he unhesitatingly adopts the medieval scholastic understanding of these distinctions.
It may be that Guénon thought it was valid to discuss Vedanta in Platonic-Aristotelian terms because he regarded the Platonic tradition as itself an expression of the perennial philosophy. Thus, he simply decided a priori that Vedanta and Platonism are two streams flowing from the same source: primordial Tradition. But, again, this is pure speculation. The bottom line is that Guénon and Evola do accord special primacy to the Indian tradition over Western metaphysics — but they see the former almost entirely through the lens of the latter. Thus, despite their interest in Indian thought, they are still thoroughly beholden to Western metaphysics.
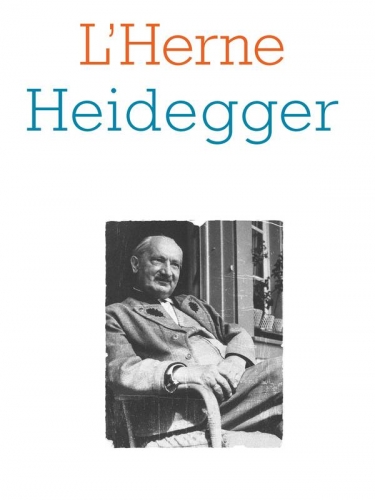
It remains to consider a further, much more significant, objection to these Heideggerian critiques of Traditionalism. The primary objection I have raised against Guénon and Evola is that they are thoroughly committed to Western metaphysics. This is a problem because Heidegger argues that the Western tradition is not only a falling away from a more primordial encounter with Being, it actually makes possible the modern decadence that Traditionalists rightly reject. But why we should follow Heidegger in any of this? Why should we accept Heidegger’s negative evaluation of Western metaphysics? Why should we accept the thesis that Platonic metaphysics made modernity possible? The next essay in this series will be devoted to addressing just these questions. It will be the first of several essays offering a compressed summary and commentary on Heidegger’s history and critique of metaphysics, demonstrating that the claims he makes are both plausible and profound. Heidegger is right in thinking that Western metaphysics lies at the root of modernity. We will begin with Heidegger’s critique of Plato.
What did Heidegger have to say about tradition? In “The Age of the World Picture” (1938) He warns us against “merely negating the age” and writes that “The flight into tradition, out of a combination of humility and presumption, achieves, in itself, nothing, is merely a closing the eyes and blindness towards the historical moment.” [31] [39] But Heidegger also argues that the turn toward metaphysics is a turn away from a more authentic way of encountering Being. It is in this latter conception that we find what may be the equivalent of “primordial tradition” in Heidegger’s thought. One of the conclusions that will be defended in this series of essays is that while Heidegger is clearly not a Guénonian or Evolian Traditionalist, he is actually more traditionalist than the Traditionalists.
Appendix. Outline of the Series:
Part One (the present essay): Why Heidegger and Traditionalism are not compatible; major errors in Traditionalism from a Heideggerian perspective.
Part Two: Heidegger’s history of metaphysics, focusing on his critique of Platonism. This account will deepen our understanding of why Heidegger would regard Traditionalism as a fundamentally modern movement, as well as deepen our understanding of modernity.
Part Three: The continuation of our account of Heidegger’s history of metaphysics, from Plato to Nietzsche. Among other things, Part Three will discuss Evola’s problematic indebtedness to German Idealism, especially J. G. Fichte, whose philosophy (I will argue) is like a vial of fast-acting, concentrated modern poison.
Part Four: From Nietzsche to the present age of post-War modernity, which Heidegger characterizes as das Gestell (“enframing”). Part Four will deal in detail with this fundamental Heideggerian concept, which is central to his critique of technology.
Part Five: How Heidegger proposes that we respond to technological modernity. His project of a “recovery” of a pre-metaphysical standpoint; his “preparation” for the next “dispensation of Beyng.” His phenomenology of authentic human “dwelling” (“the fourfold”), and Gelassenheit.
Part Six: A call for a new philosophical approach, building upon Heidegger and the Traditionalists, while moving beyond them. Three primary components: (1) The recovery of “poetic wisdom” (to borrow a term from G. B. Vico): Heidegger’s project of the recovery of the pre-metaphysical standpoint now applied to myth and folklore, and expanded to include non-Greek sources (e.g., the pre-Christian traditions of Northern Europe); (2) Expanding Heidegger’s project of the “destruction” of the Western tradition to include the Gnostic and Hermetic traditions, Western esotericism, and Western mysticism; (3) Finally, social and cultural criticism from a standpoint informed by the critique of metaphysics, critique of modernity, and recovery of “poetic wisdom.”
Notes
[1] [40] I will capitalize the “t” in Traditionalism to indicate the school of Guénon, Evola, et al., as opposed to “traditionalism” in the looser, broader sense of the term. This device is necessary, as I will be using the term in both senses. I should also note that it is primarily the Traditionalism of Guénon and Evola that I am concerned with here. I am comparatively less interested in the “softer” Traditionalism of figures like Coomaraswamy, Schuon, Huston Smith, etc. Most of the objections raised against Guénon and Evola herein would apply to these authors as well.
[2] [41] “Originary” (ursprünglich) is a term frequently used by Heidegger.
[3] [42] Martin Heidegger, Introduction to Metaphysics, trans. Gregory Fried and Richard Polt (New Haven, CT: Yale University Press, 2000), 40-41. This was originally a lecture course given by Heidegger in 1935. It was published for the first time in German in 1953. The material in square brackets was added by Heidegger when the lecture course was published in 1953.
[4] [43] Fried and Polt, 47.
[5] [44] Fried and Polt, 48-49. Bracketed phrase added by Heidegger for the 1953 edition.
[6] [45] Martin Heidegger, What is Called Thinking?, trans. J. Glenn Gray (New York: Harper Perennial, 1968), 30.
[7] [46] One point is omitted from the discussion below, one which my readers might expect me to discuss: “the flight of the gods.” What Heidegger means by this, however, is complicated, and far from obvious. I will discuss this issue in a later essay.
[8] [47] René Guénon, The Reign of Quantity and the Signs of the Times, trans. Lord Northbourne (Hillsdale, NY: Sophia Perennis, 2001), 43.
[9] [48] Reign, 42
[10] [49] Reign, 43. For similar remarks see Julius Evola, Meditations on the Peaks, trans. Guido Stucco (Rochester, Vermont: Inner Traditions, 1998), 45-46.
[11] [50] Reign, 51-52.
[12] [51] Reign, 48.
[13] [52] Reign, pp. 60-61. Compare this to some remarks by Alexandre Kojève: “Hence it would have to be admitted that after the end of history men would construct their edifices and works of art as birds build their nests and spiders spin their webs, would perform their musical concerts after the fashion of frogs and cicadas, would play like young animals and would indulge in love like adult beasts.” See Introduction to the Reading of Hegel, ed. Raymond Queneau and Allan Bloom, trans. James H. Nichols, Jr. (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1969), 159 (footnote).
[14] [53] Reign p. 194.
[15] [54] The discovery of the note in 2015 received some attention in the German press. Writing in the Frankfurter Allgemeine Zeitung [55], Thomas Vasek claims that “textual comparisons suggest that Heidegger had not only read Evola, as this note indicates, but was also influenced by his ideas from the mid-thirties on, from his critique of science and technology, his anti-humanism and rejection of Christianity, to his ‘spiritual’ racism.” This is a completely baseless, and, indeed, ludicrous assertion, as I will shortly demonstrate. See Greg Johnson’s analysis of the Heidegger note, and Vasek’s article, here [56].
[16] [57] Julius Evola, Erhebung wider die moderne Welt, trans. Friedrich Bauer (Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt, 1935), 65. The translator actually leaves out portions of Evola’s text, but since Heidegger only read the translation and not the original, these omissions do not concern us here. For the full passage in English translation, see Julius Evola, Revolt Against the Modern World, trans. Guido Stucco (Rochester, VT: Inner Traditions, 1995), 56-57.
[17] [58] The “s” at the end of Seins/Seyns in the passage simply indicates the genitive case. The nominative is Sein/Seyn.
[18] [59] Anglophone translators of Heidegger have adopted the convention of rendering Seyn as “Beying.”
[19] [60] Thomas Sheehan, Making Sense of Heidegger: A Paradigm Shift (Lanham, MD: Rowman and Littlefield, 2015), 20.
[20] [61] Martin Heidegger, Basic Writings, ed. David Farrell Krell (New York: Harper and Row, 1977), 384-385. This essay was translated by Joan Stambaugh; italics added.
[21] [62] Sheehan argues at length that, for Heidegger, Being and meaning are identical.
[22] [63] This way of expressing things should be understood as figurative, and preliminary. Actually, Heidegger wants to entirely avoid a “subjective” treatment of the clearing as some sort of “faculty” or Kantian a priori structure that I “bear within me.” The reason, at root, is that this treatment of the clearing is phenomenologically untrue. I do not, in fact, experience the clearing as something “in me” that is “mine.” Still less do I experience it as something over which I have any kind of influence or control. There is thus no real basis for “subjectivizing” the clearing; for locating it “within the subject.” Indeed, Heidegger critiques the subject/object distinction prevailing in philosophy since Descartes, which locates certain “properties” as “within” a subject, as if this subject is a kind of cabinet in which we dwell, removed from an “external world.” See Heidegger, Being and Time, trans. Joan Stambaugh, rev. Dennis J. Schmidt (Albany, NY: State University of New York Press, 2010), 60-61.
[23] [64] Generally speaking, this is correct. Unfortunately, Heidegger is inconsistent with his use of Sein/Seyn, sometimes referring to Being, sometimes to the clearing that gives Being.
[24] [65] What is Called Thinking?, 152.
[25] [66] Revolt, 3.
[26] [67] The Traditionalists are in much the same position as the Renaissance “Hermeticists” who falsely believed that the Corpus Hermeticum contained an Egyptian wisdom that far antedated Plato and the Greeks, and from whom those philosophers had taken their basic doctrines. In reality, the Corpus Hermeticum was no older than the first century BC, and it derived its doctrines, in large measure, from Plato and his school.
[27] [68] Martin Heidegger, Being and Truth, trans. Gregory Fried and Richard Polt (Bloomington: Indiana University Press, 210), 134. Italics in original.
[28] [69] Being and Truth, 136. Italics in original.
[29] [70] Reign, 62-63.
[30] [71] Reign, 11-12.
[31] [72] Martin Heidegger, Off the Beaten Track, trans. Julian Young and Kenneth Haynes (Cambridge: Cambridge University Press, 2002), 72.





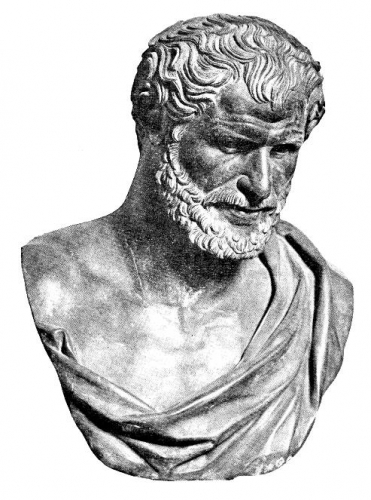 Dans le contexte islamique, puisque la révélation y est à la fois prophétie et loi, le sens réel du terme conflit utilisé par Héraclite apparaît avec toute sa force perturbatrice dans le concept théologique de djihad. Cela, rappelons-le, signifie littéralement "effort" et indique l'engagement de l'homme à s'améliorer, à devenir un "vrai" être humain, paraphrasant l'interprétation qu'en donne l'imam Khomeiny [2].
Dans le contexte islamique, puisque la révélation y est à la fois prophétie et loi, le sens réel du terme conflit utilisé par Héraclite apparaît avec toute sa force perturbatrice dans le concept théologique de djihad. Cela, rappelons-le, signifie littéralement "effort" et indique l'engagement de l'homme à s'améliorer, à devenir un "vrai" être humain, paraphrasant l'interprétation qu'en donne l'imam Khomeiny [2].
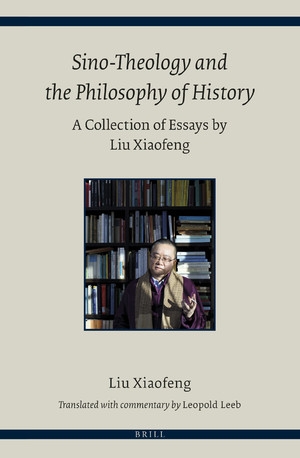 Dans ce contexte, selon l'historien et homme politique Liang Qichao, qui a vécu au tournant des XIXe et XXe siècles à l'époque du déclin inexorable et de la partition impérialiste de l'espace chinois, la solution ne pouvait être que la création d'une forme de nationalisme chinois. Cependant, ce que Qichao considérait comme du nationalisme était une forme de conscience politique et culturelle nationale, mais pas du nationalisme au sens européen du terme. En fait, ce concept est resté complètement étranger à la forme impériale traditionnelle qui, même aujourd'hui, dans son expression modernisée et influencée par le marxisme-léninisme, ressemble davantage au modèle achéménide qu'à l'idée européenne de l'État-nation et de ses impulsions impérialistes. Et, en tant que telle, elle s'est imposée dès son origine comme un dépassement en nuance de cette idée.
Dans ce contexte, selon l'historien et homme politique Liang Qichao, qui a vécu au tournant des XIXe et XXe siècles à l'époque du déclin inexorable et de la partition impérialiste de l'espace chinois, la solution ne pouvait être que la création d'une forme de nationalisme chinois. Cependant, ce que Qichao considérait comme du nationalisme était une forme de conscience politique et culturelle nationale, mais pas du nationalisme au sens européen du terme. En fait, ce concept est resté complètement étranger à la forme impériale traditionnelle qui, même aujourd'hui, dans son expression modernisée et influencée par le marxisme-léninisme, ressemble davantage au modèle achéménide qu'à l'idée européenne de l'État-nation et de ses impulsions impérialistes. Et, en tant que telle, elle s'est imposée dès son origine comme un dépassement en nuance de cette idée.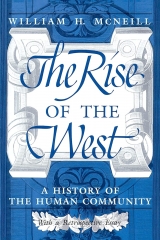 Ainsi, l'histoire mondiale n'a été que la superstructure historiographique du libéralisme occidental à l'époque de la guerre froide et de l'instant unipolaire.
Ainsi, l'histoire mondiale n'a été que la superstructure historiographique du libéralisme occidental à l'époque de la guerre froide et de l'instant unipolaire.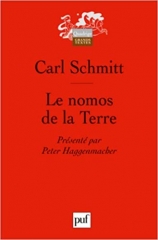 Les États-Unis sont nés dans un "espace libre" où prévalait la loi du plus fort, celle de l'état de nature et sur le fond idéologico-religieux du thème biblique de l'Exode et de la conviction messianique de la construction du "Nouvel Israël" et de la "Jérusalem sur terre" : des principes qui sont à la base de l'idée puritaine de supériorité morale et de prédestination et qui représentent les fondements existentiels de l'américanisme. Les États-Unis sont nés en totale opposition au modèle européen. Leur entrée sur le Vieux Continent marque le passage de la guerre "légale" à la guerre "idéologique" : l'ennemi doit non seulement être vaincu, mais diabolisé, criminalisé et donc anéanti. Ce que les États-Unis ont fait, c'est ramener en Europe la loi du plus fort, en la considérant, comme les Européens l'avaient fait avec l'hémisphère occidental à l'époque moderne, comme un "espace libre" à soumettre à la simple conquête.
Les États-Unis sont nés dans un "espace libre" où prévalait la loi du plus fort, celle de l'état de nature et sur le fond idéologico-religieux du thème biblique de l'Exode et de la conviction messianique de la construction du "Nouvel Israël" et de la "Jérusalem sur terre" : des principes qui sont à la base de l'idée puritaine de supériorité morale et de prédestination et qui représentent les fondements existentiels de l'américanisme. Les États-Unis sont nés en totale opposition au modèle européen. Leur entrée sur le Vieux Continent marque le passage de la guerre "légale" à la guerre "idéologique" : l'ennemi doit non seulement être vaincu, mais diabolisé, criminalisé et donc anéanti. Ce que les États-Unis ont fait, c'est ramener en Europe la loi du plus fort, en la considérant, comme les Européens l'avaient fait avec l'hémisphère occidental à l'époque moderne, comme un "espace libre" à soumettre à la simple conquête.

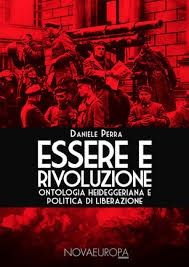 NOTES
NOTES
 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg
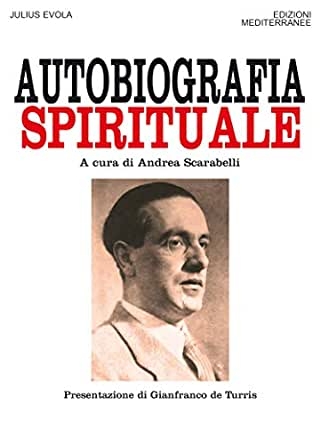 Tout cela est très révélateur de l'influence de la culture allemande sur l'œuvre d'Evola. Mais il faut ajouter d'autres données : en rappelant ici ce qui a été mentionné dans la biographie d’Evola, au premier chapitre, je me souviens de l’évocation des longs séjours d'Evola en Autriche et en Allemagne, des nombreuses conférences qui s'y sont tenues, de ses relations avec les représentants de la tradition aristocratique et conservatrice d'Europe centrale et de la révolution conservatrice, etc. En outre, dans les pays germanophones, Evola jouissait, au moins jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une notoriété différente de celle qu'il avait en Italie, car il y fut reçu comme l'exposant d'un courant particulier de la pensée italienne, et cela depuis 1933, année de la publication de Heidnischer Imperialismus. Voici l'opinion d'Adriano Romualdi sur le sujet : "L'action d'Evola en Allemagne n'était pas politique, même si elle a contribué à dissiper de nombreux malentendus et à préparer une entente entre le fascisme et le national-socialisme. Elle a investi le sens de ces traditions qui, en Italie et en Allemagne, ont été évoquées par les régimes, comme le symbole romain et le mythe nordique, le sens du classicisme et du romantisme, ou des oppositions artificielles, comme celle entre la romanité et le germanisme".
Tout cela est très révélateur de l'influence de la culture allemande sur l'œuvre d'Evola. Mais il faut ajouter d'autres données : en rappelant ici ce qui a été mentionné dans la biographie d’Evola, au premier chapitre, je me souviens de l’évocation des longs séjours d'Evola en Autriche et en Allemagne, des nombreuses conférences qui s'y sont tenues, de ses relations avec les représentants de la tradition aristocratique et conservatrice d'Europe centrale et de la révolution conservatrice, etc. En outre, dans les pays germanophones, Evola jouissait, au moins jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'une notoriété différente de celle qu'il avait en Italie, car il y fut reçu comme l'exposant d'un courant particulier de la pensée italienne, et cela depuis 1933, année de la publication de Heidnischer Imperialismus. Voici l'opinion d'Adriano Romualdi sur le sujet : "L'action d'Evola en Allemagne n'était pas politique, même si elle a contribué à dissiper de nombreux malentendus et à préparer une entente entre le fascisme et le national-socialisme. Elle a investi le sens de ces traditions qui, en Italie et en Allemagne, ont été évoquées par les régimes, comme le symbole romain et le mythe nordique, le sens du classicisme et du romantisme, ou des oppositions artificielles, comme celle entre la romanité et le germanisme".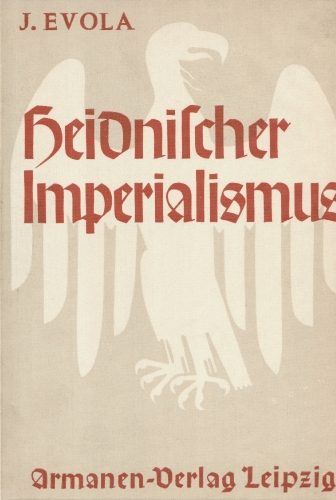

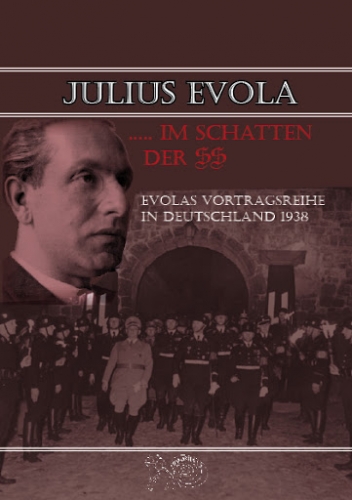 Mais les différences, du point de vue de l’environnement, sont beaucoup plus marquées. Dans son essai sur le Troisième Reich, qui décrit les courants culturels complexes et souvent irréductibles qui ont coopéré à sa genèse, Evola écrit : "Après la Première Guerre mondiale, la situation en Allemagne était nettement différente de celle de l'Italie. [...] Mussolini a dû créer presque tout à partir de rien, en ce sens qu'au moment de combattre la subversion rouge et de remettre l'État sur pied, il ne pouvait pas se référer à une tradition au sens le plus élevé du terme. Tout bien considéré, ce qui était menacé n'était que l'extension de l'Italie démocratique du XIXe siècle, avec un héritage du Risorgimento influencé par les idéologies de la Révolution française, avec une monarchie qui régnait mais ne gouvernait pas et n’avait pas d’articulations sociales solides. En Allemagne, les choses étaient différentes. Même après l'effondrement militaire et la révolution de 1918, et malgré le marasme social, il y avait encore des vestiges profondément enracinés dans ce monde hiérarchique, parfois encore féodal, centré sur les valeurs de l'État et de son autorité, faisant partie de la tradition précédente, en particulier du prussianisme. […]. En fait, en Europe centrale, les idées de la Révolution française n'ont jamais pris autant d'ampleur que dans les autres pays européens" .
Mais les différences, du point de vue de l’environnement, sont beaucoup plus marquées. Dans son essai sur le Troisième Reich, qui décrit les courants culturels complexes et souvent irréductibles qui ont coopéré à sa genèse, Evola écrit : "Après la Première Guerre mondiale, la situation en Allemagne était nettement différente de celle de l'Italie. [...] Mussolini a dû créer presque tout à partir de rien, en ce sens qu'au moment de combattre la subversion rouge et de remettre l'État sur pied, il ne pouvait pas se référer à une tradition au sens le plus élevé du terme. Tout bien considéré, ce qui était menacé n'était que l'extension de l'Italie démocratique du XIXe siècle, avec un héritage du Risorgimento influencé par les idéologies de la Révolution française, avec une monarchie qui régnait mais ne gouvernait pas et n’avait pas d’articulations sociales solides. En Allemagne, les choses étaient différentes. Même après l'effondrement militaire et la révolution de 1918, et malgré le marasme social, il y avait encore des vestiges profondément enracinés dans ce monde hiérarchique, parfois encore féodal, centré sur les valeurs de l'État et de son autorité, faisant partie de la tradition précédente, en particulier du prussianisme. […]. En fait, en Europe centrale, les idées de la Révolution française n'ont jamais pris autant d'ampleur que dans les autres pays européens" .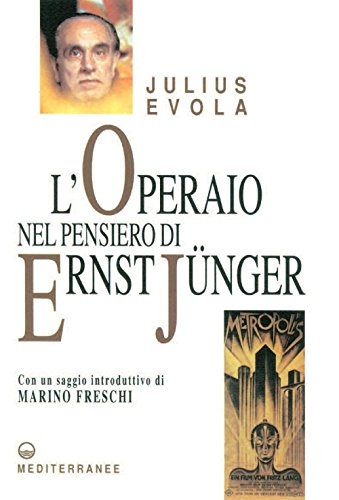 La même Allemagne de Frédéric II puis de Guillaume II, tout en conservant les structures et l'ordre d'un État traditionnel (Obrigkeitsstaat), dans lequel la même bureaucratie et le même appareil d'État apparaissaient presque comme les organes d'un ordre, contenait les germes de la dissolution, due aux idées des Lumières qui avaient commencé à filtrer - de façon plus subtile qu'ailleurs - dans les différentes instances. Si le jugement d'Evola sur le code de Frédéric, préservant l'ordre divisé en Stände est positif, c'est parce que, pour l'époque où il a été créé, ce code a mieux préservé que tout autre les structures féodales et hiérarchiques précédentes. Celles-ci, à travers la tradition prussienne, s'enracinent dans l'Ordre des Chevaliers Teutoniques et leur reconquête des terres baltes : un ordre ascético-chevaleresque formé par la discipline et une organisation hiérarchique stricte. Ainsi, dès son plus jeune âge, Evola pressent l'absurdité de la "guerre civile européenne" qu'il va devoir néanmoins mener, en tant que très jeune officier, à la frontière austro-italienne, celle du Karst : l'Italie prend parti contre ce qui reste de la meilleure tradition européenne. "En 1914, les Empires centraux représentaient encore un vestige de l'Europe féodale et aristocratique dans le monde occidental, malgré des aspects indéniables d'hégémonie militariste et quelques alliances suspectes avec le capitalisme présent surtout dans l'Allemagne wilhelminienne. La coalition contre eux était ouvertement une coalition du Troisième pouvoir contre les forces résiduelles du Deuxième pouvoir [...]. Comme peu d'autres dans l'histoire, la guerre de 1914-1918 présente toutes les caractéristiques d'un conflit non pas entre États et nations, mais entre les idéologies de différentes castes. Les résultats directs et attendus ont été la destruction de l'Allemagne monarchique et de l'Autriche catholique, les résultats indirects l'effondrement de l'empire du tsar, la révolution communiste et la création, en Europe, d'une situation politico-sociale si chaotique et contradictoire qu'elle contenait toutes les prémisses d'un nouvel embrasement. Et ce fut la Seconde Guerre mondiale" .
La même Allemagne de Frédéric II puis de Guillaume II, tout en conservant les structures et l'ordre d'un État traditionnel (Obrigkeitsstaat), dans lequel la même bureaucratie et le même appareil d'État apparaissaient presque comme les organes d'un ordre, contenait les germes de la dissolution, due aux idées des Lumières qui avaient commencé à filtrer - de façon plus subtile qu'ailleurs - dans les différentes instances. Si le jugement d'Evola sur le code de Frédéric, préservant l'ordre divisé en Stände est positif, c'est parce que, pour l'époque où il a été créé, ce code a mieux préservé que tout autre les structures féodales et hiérarchiques précédentes. Celles-ci, à travers la tradition prussienne, s'enracinent dans l'Ordre des Chevaliers Teutoniques et leur reconquête des terres baltes : un ordre ascético-chevaleresque formé par la discipline et une organisation hiérarchique stricte. Ainsi, dès son plus jeune âge, Evola pressent l'absurdité de la "guerre civile européenne" qu'il va devoir néanmoins mener, en tant que très jeune officier, à la frontière austro-italienne, celle du Karst : l'Italie prend parti contre ce qui reste de la meilleure tradition européenne. "En 1914, les Empires centraux représentaient encore un vestige de l'Europe féodale et aristocratique dans le monde occidental, malgré des aspects indéniables d'hégémonie militariste et quelques alliances suspectes avec le capitalisme présent surtout dans l'Allemagne wilhelminienne. La coalition contre eux était ouvertement une coalition du Troisième pouvoir contre les forces résiduelles du Deuxième pouvoir [...]. Comme peu d'autres dans l'histoire, la guerre de 1914-1918 présente toutes les caractéristiques d'un conflit non pas entre États et nations, mais entre les idéologies de différentes castes. Les résultats directs et attendus ont été la destruction de l'Allemagne monarchique et de l'Autriche catholique, les résultats indirects l'effondrement de l'empire du tsar, la révolution communiste et la création, en Europe, d'une situation politico-sociale si chaotique et contradictoire qu'elle contenait toutes les prémisses d'un nouvel embrasement. Et ce fut la Seconde Guerre mondiale" . Dans cet humus historique des années de l'entre-deux-guerres, dans lequel les liens sentimentaux et éthiques de beaucoup avec la tradition impériale précédente étaient encore forts - la monarchie des Habsbourg d'Autriche avait au moins formellement conservé, jusqu'au Congrès de Vienne, la propriété du Saint Empire romain - Evola a également eu l'occasion de percevoir directement l'attachement populaire généralisé à la monarchie, et de l'expliquer en ces termes : "Sans exhumer des formes anachroniques, au lieu d'une propagande qui "humanise" le souverain pour captiver les masses, presque sur le modèle de la propagande américaine pour les élections présidentielles, il faut voir dans quelle mesure les traits d'une figure caractérisée par une certaine supériorité et dignité innées peuvent avoir une action profonde, dans un cadre approprié. Une sorte d'ascétisme et de liturgie du pouvoir pourrait jouer un rôle ici. Précisément ces traits, s'ils renforceront le prestige de celui qui incarne un symbole, devraient pouvoir exercer sur l'homme grossier une force d'attraction, voire une fierté à l'égard du sujet. En outre, même à une époque assez récente, nous avons eu l'exemple de l'empereur François-Joseph qui, tout en plaçant entre lui et ses sujets le vieux cérémonial sévère, sans pour autant imiter du tout les rois "démocratiques" des petits États du Nord, jouissait d'une popularité particulière, non vulgaire". Dans la même veine, en 1935, écrivant sur la possibilité d'une restauration impériale en Autriche, Evola rapporte ce que les représentants de la pensée conservatrice et monarchique dans ce pays préconisaient : "Le postulat, quant à lui, est celui auquel tout esprit non encombré de préjugés peut également adhérer, à savoir que le régime monarchique, en général, est celui qui peut le mieux garantir un ordre, un équilibre et une pacification intérieure, sans avoir à recourir au remède extrême de la dictature et de l'État centralisé, à condition qu'il subsiste chez les individus la sensibilité spirituelle requise par tout loyalisme. Cette condition, selon ces personnalités, serait présente dans la majeure partie de la population autrichienne, ne serait-ce que pour la force d'une tradition et d'un mode de vie pluriséculaire".
Dans cet humus historique des années de l'entre-deux-guerres, dans lequel les liens sentimentaux et éthiques de beaucoup avec la tradition impériale précédente étaient encore forts - la monarchie des Habsbourg d'Autriche avait au moins formellement conservé, jusqu'au Congrès de Vienne, la propriété du Saint Empire romain - Evola a également eu l'occasion de percevoir directement l'attachement populaire généralisé à la monarchie, et de l'expliquer en ces termes : "Sans exhumer des formes anachroniques, au lieu d'une propagande qui "humanise" le souverain pour captiver les masses, presque sur le modèle de la propagande américaine pour les élections présidentielles, il faut voir dans quelle mesure les traits d'une figure caractérisée par une certaine supériorité et dignité innées peuvent avoir une action profonde, dans un cadre approprié. Une sorte d'ascétisme et de liturgie du pouvoir pourrait jouer un rôle ici. Précisément ces traits, s'ils renforceront le prestige de celui qui incarne un symbole, devraient pouvoir exercer sur l'homme grossier une force d'attraction, voire une fierté à l'égard du sujet. En outre, même à une époque assez récente, nous avons eu l'exemple de l'empereur François-Joseph qui, tout en plaçant entre lui et ses sujets le vieux cérémonial sévère, sans pour autant imiter du tout les rois "démocratiques" des petits États du Nord, jouissait d'une popularité particulière, non vulgaire". Dans la même veine, en 1935, écrivant sur la possibilité d'une restauration impériale en Autriche, Evola rapporte ce que les représentants de la pensée conservatrice et monarchique dans ce pays préconisaient : "Le postulat, quant à lui, est celui auquel tout esprit non encombré de préjugés peut également adhérer, à savoir que le régime monarchique, en général, est celui qui peut le mieux garantir un ordre, un équilibre et une pacification intérieure, sans avoir à recourir au remède extrême de la dictature et de l'État centralisé, à condition qu'il subsiste chez les individus la sensibilité spirituelle requise par tout loyalisme. Cette condition, selon ces personnalités, serait présente dans la majeure partie de la population autrichienne, ne serait-ce que pour la force d'une tradition et d'un mode de vie pluriséculaire".
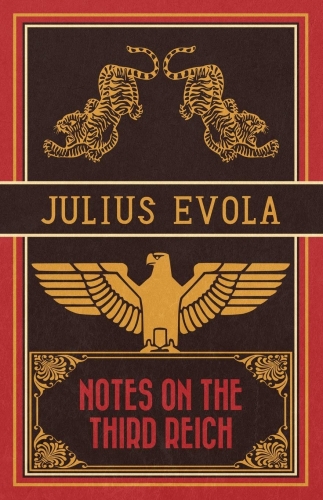
 Même après la Seconde Guerre mondiale, Evola a gardé un œil sur les pays germanophones. Sa vision était celle d'une admiration pour la nouvelle résurrection économique opérée par les Allemands après être sortie du champs de ruines qu’elle était dans la seconde période de l'après-guerre ("cette nation a pu se relever complètement d'une destruction sans nom. Même sous l'occupation, elle a surpassé les nations victorieuses elles-mêmes sur le plan industriel et économique et a repris sa place de grande puissance productrice"). et pour le courage avec lequel la République fédérale avait banni le danger communiste de sa politique ("Les Allemands font toujours les choses avec cohérence. Donc aussi dans le jeu de la conformité démocratique. Ils ont mis en place une démocratie modèle comme un système "neutre" - nous dirions presque administratif, plutôt que politique - à la fois équilibré et énergique. Contrairement à l'Italie, l'Allemagne, précisément du point de vue d'une démocratie cohérente, a proscrit le communisme. La Cour constitutionnelle allemande a statué ce qui correspond à l'évidence même des choses, à savoir qu'un parti qui, comme le parti communiste, ne suit les règles démocratiques que dans une fonction purement tactique et de couverture, ayant pour objectif final déclaré la suppression de tout courant politique opposé et l’avènement de la dictature absolue du prolétariat, ne peut être toléré par un État démocratique qui ne veut pas creuser sa propre tombe") . Mais, malgré cela, la guerre avait alors produit un vide, un vide spirituel qui n'était plus comblé : "Contre tout cela, il est surprenant, en République fédérale, l'absence de toute idée, de tout "mythe", de toute vision supérieure du monde, de toute continuité avec l'Allemagne précédente". Toujours dans le domaine de la culture, Evola constate un glissement général, une sorte d'"échec" général aux positions courageuses et avant-gardistes des intellectuels allemands dans les années - selon Evola, très prospères et rentables sous le profil culturel - du Reich national-socialiste. Dans son jugement négatif, Evola prend comme exemple de cet effondrement Gottfried Benn et Ernst Jünger (tombant avec cela dans des erreurs de vue assez grossières).
Même après la Seconde Guerre mondiale, Evola a gardé un œil sur les pays germanophones. Sa vision était celle d'une admiration pour la nouvelle résurrection économique opérée par les Allemands après être sortie du champs de ruines qu’elle était dans la seconde période de l'après-guerre ("cette nation a pu se relever complètement d'une destruction sans nom. Même sous l'occupation, elle a surpassé les nations victorieuses elles-mêmes sur le plan industriel et économique et a repris sa place de grande puissance productrice"). et pour le courage avec lequel la République fédérale avait banni le danger communiste de sa politique ("Les Allemands font toujours les choses avec cohérence. Donc aussi dans le jeu de la conformité démocratique. Ils ont mis en place une démocratie modèle comme un système "neutre" - nous dirions presque administratif, plutôt que politique - à la fois équilibré et énergique. Contrairement à l'Italie, l'Allemagne, précisément du point de vue d'une démocratie cohérente, a proscrit le communisme. La Cour constitutionnelle allemande a statué ce qui correspond à l'évidence même des choses, à savoir qu'un parti qui, comme le parti communiste, ne suit les règles démocratiques que dans une fonction purement tactique et de couverture, ayant pour objectif final déclaré la suppression de tout courant politique opposé et l’avènement de la dictature absolue du prolétariat, ne peut être toléré par un État démocratique qui ne veut pas creuser sa propre tombe") . Mais, malgré cela, la guerre avait alors produit un vide, un vide spirituel qui n'était plus comblé : "Contre tout cela, il est surprenant, en République fédérale, l'absence de toute idée, de tout "mythe", de toute vision supérieure du monde, de toute continuité avec l'Allemagne précédente". Toujours dans le domaine de la culture, Evola constate un glissement général, une sorte d'"échec" général aux positions courageuses et avant-gardistes des intellectuels allemands dans les années - selon Evola, très prospères et rentables sous le profil culturel - du Reich national-socialiste. Dans son jugement négatif, Evola prend comme exemple de cet effondrement Gottfried Benn et Ernst Jünger (tombant avec cela dans des erreurs de vue assez grossières).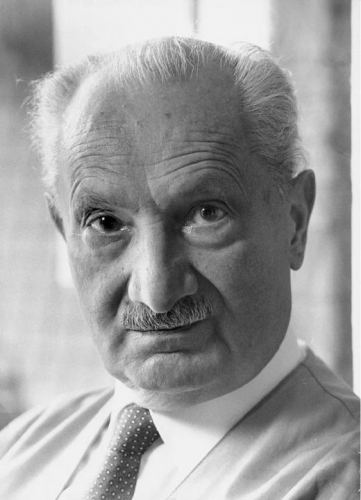


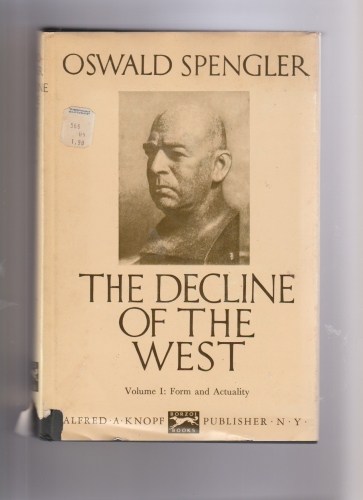

 Il y a 80 ans, le 9 décembre 1940, Adriano Romualdi naissait à Forlì. Cet anniversaire est important pour se souvenir de cet intellectuel, demeuré jeune parce que décédé prématurément, le 12 août 1973, à la suite d'un accident de voiture. Son souvenir est resté gravé dans la mémoire de la jeune génération des années cinquante, confrontée à l'engagement politique et culturel des années soixante-dix. Adriano Romualdi était, pour cette génération, une sorte de grand frère, capable d'offrir à la vision néo-fasciste des raisons d'être plus profondes, puis d’emprunter de manière autonome les chemins d'un nouveau dynamisme culturel. Dans cette perspective, sa personnalité reste encore un exemple.
Il y a 80 ans, le 9 décembre 1940, Adriano Romualdi naissait à Forlì. Cet anniversaire est important pour se souvenir de cet intellectuel, demeuré jeune parce que décédé prématurément, le 12 août 1973, à la suite d'un accident de voiture. Son souvenir est resté gravé dans la mémoire de la jeune génération des années cinquante, confrontée à l'engagement politique et culturel des années soixante-dix. Adriano Romualdi était, pour cette génération, une sorte de grand frère, capable d'offrir à la vision néo-fasciste des raisons d'être plus profondes, puis d’emprunter de manière autonome les chemins d'un nouveau dynamisme culturel. Dans cette perspective, sa personnalité reste encore un exemple.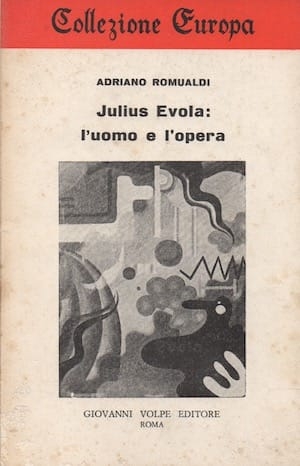 Son idée d'un droit politique "non égalitaire" repose sur ces solides fondements spirituels, que je viens d’exposer ici. C'est en septembre 1972 qu'Adriano Romualdi, à l'occasion de la conférence annuelle de la revue L'Italiano, dirigée par son père Pino, figure historique du MSI, met en évidence la distinction entre la droite (politique et culturelle) et le qualunquisme, sous ses différentes formes (qualunquisme politique, patriotique, culturel).
Son idée d'un droit politique "non égalitaire" repose sur ces solides fondements spirituels, que je viens d’exposer ici. C'est en septembre 1972 qu'Adriano Romualdi, à l'occasion de la conférence annuelle de la revue L'Italiano, dirigée par son père Pino, figure historique du MSI, met en évidence la distinction entre la droite (politique et culturelle) et le qualunquisme, sous ses différentes formes (qualunquisme politique, patriotique, culturel).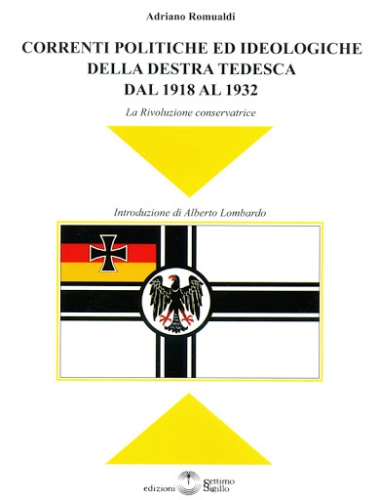 En dehors des contingences d'une situation politique et culturelle de cette époque d’avant 1973, qui sont nettement perceptibles dans certains passages de son œuvre écrite, inévitablement affectée par le temps qui a passé. Les bouleversements de notre époque ont changé la donne (il suffit de penser à la fin de l'URSS, à la crise de l'empire américain, à l'émergence de la mondialisation, à la montée des nouvelles économies asiatiques). Les propositions de Romualdi conservent leur valeur, dans la mesure où elles se nourrissent d'une vision profonde de la culture et donc de la politique, rejetant tout minimalisme et toute respectabilité rassurante.
En dehors des contingences d'une situation politique et culturelle de cette époque d’avant 1973, qui sont nettement perceptibles dans certains passages de son œuvre écrite, inévitablement affectée par le temps qui a passé. Les bouleversements de notre époque ont changé la donne (il suffit de penser à la fin de l'URSS, à la crise de l'empire américain, à l'émergence de la mondialisation, à la montée des nouvelles économies asiatiques). Les propositions de Romualdi conservent leur valeur, dans la mesure où elles se nourrissent d'une vision profonde de la culture et donc de la politique, rejetant tout minimalisme et toute respectabilité rassurante.
 Selon lui, la philosophie, pendant plus de 2000 ans d'histoire, a prêté attention à tout ce qui a les caractéristiques de l'"être" dans ce monde, y compris le monde lui-même, mais a oublié ce que cela signifie. C'est la "question de vie" de Heidegger, qui traverse toutes ses œuvres comme un fil rouge. Une des sources qui a influencé son interprétation de ce thème a été les travaux de Franz Brentano (photo) sur l'utilisation des différents concepts de l'être dans Aristote. Heidegger commence son œuvre principale, L’Etre et le Temps, par un dialogue tiré du Sophiste de Platon, qui montre que la philosophie occidentale a ignoré le concept d'être parce qu'elle considérait que sa signification allait de soi. Heidegger, pour sa part, exige que toute la philosophie occidentale retrace dès le début toutes les étapes de la formation de ce concept, appelant à un processus de "destruction" de l'histoire de la philosophie. Heidegger définit la structure de l'existence humaine dans son ensemble comme "Sorge" (= le Souci), qui est l'unité de trois moments : "être dans le monde", "courir en avant" et "être avec le monde de l'être". La "Sorge" est la base de "l'analyse existentielle" de Heidegger, comme il l'a appelée dans L'être et le temps. Heidegger pense que pour décrire une expérience, il faut d'abord trouver quelque chose pour laquelle une telle description a un sens. Ainsi, Heidegger déduit sa description de l'expérience à travers le Dasein, pour lequel l'être devient une question. Dans L’Etre et le Temps, Heidegger a critiqué la nature métaphysique abstraite des façons traditionnelles de décrire l'existence humaine, comme l’"animal rationnel", la personnalité, l'être humain, l'âme, l'esprit ou le sujet. Le Dasein ne devient pas la base d'une nouvelle "anthropologie philosophique", mais Heidegger le comprend comme une condition pour la possibilité de quelque chose comme "anthropologie philosophique". Selon Heidegger, le Dasein est "Sorge". Dans la partie sur l'analyse existentielle, Heidegger écrit que le Dasein, qui se trouve jeté au monde entre les choses et les Autres, trouve en lui la possibilité et l'inévitabilité de sa propre mort.
Selon lui, la philosophie, pendant plus de 2000 ans d'histoire, a prêté attention à tout ce qui a les caractéristiques de l'"être" dans ce monde, y compris le monde lui-même, mais a oublié ce que cela signifie. C'est la "question de vie" de Heidegger, qui traverse toutes ses œuvres comme un fil rouge. Une des sources qui a influencé son interprétation de ce thème a été les travaux de Franz Brentano (photo) sur l'utilisation des différents concepts de l'être dans Aristote. Heidegger commence son œuvre principale, L’Etre et le Temps, par un dialogue tiré du Sophiste de Platon, qui montre que la philosophie occidentale a ignoré le concept d'être parce qu'elle considérait que sa signification allait de soi. Heidegger, pour sa part, exige que toute la philosophie occidentale retrace dès le début toutes les étapes de la formation de ce concept, appelant à un processus de "destruction" de l'histoire de la philosophie. Heidegger définit la structure de l'existence humaine dans son ensemble comme "Sorge" (= le Souci), qui est l'unité de trois moments : "être dans le monde", "courir en avant" et "être avec le monde de l'être". La "Sorge" est la base de "l'analyse existentielle" de Heidegger, comme il l'a appelée dans L'être et le temps. Heidegger pense que pour décrire une expérience, il faut d'abord trouver quelque chose pour laquelle une telle description a un sens. Ainsi, Heidegger déduit sa description de l'expérience à travers le Dasein, pour lequel l'être devient une question. Dans L’Etre et le Temps, Heidegger a critiqué la nature métaphysique abstraite des façons traditionnelles de décrire l'existence humaine, comme l’"animal rationnel", la personnalité, l'être humain, l'âme, l'esprit ou le sujet. Le Dasein ne devient pas la base d'une nouvelle "anthropologie philosophique", mais Heidegger le comprend comme une condition pour la possibilité de quelque chose comme "anthropologie philosophique". Selon Heidegger, le Dasein est "Sorge". Dans la partie sur l'analyse existentielle, Heidegger écrit que le Dasein, qui se trouve jeté au monde entre les choses et les Autres, trouve en lui la possibilité et l'inévitabilité de sa propre mort.

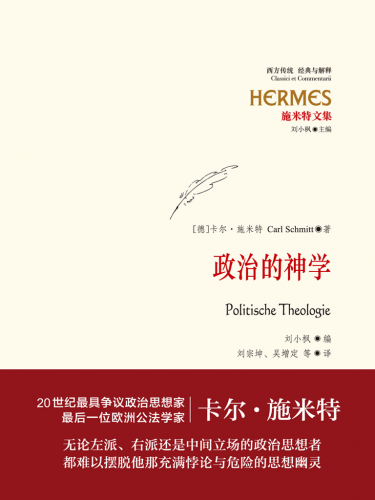
 Le professeur Xiao Bin a souligné dans son livre "De l'État, du monde et de la nature humaine à la politique : la construction du concept politique de Schmitt", que l'homme lui-même est un être dangereux. "Il prétend que la politique est un danger pour les gens." La question suivante qui se pose lorsque l'on participe à la politique est d'expliquer ce qu'est la politique, en particulier la nature de la politique. La survie de l'unité nationale exige comme condition préalable une distinction entre ennemis et amis. Une politique fondée sur la séparation des ennemis et des amis est non seulement le destin inévitable de l'unité de la nation et de l'État, mais aussi la base de son existence. Schmitt a une compréhension unique de la nature de la politique : la norme de la politique est de séparer les amis et les ennemis. En fait, ce que nous appelons la politique implique la relation entre un ami et un autre, et la différence est l'intensité de cette différence. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que les origines théologiques les plus secrètes et les plus mystérieuses et le nationalisme allemand ont un niveau de critères différent pour séparer les amis des ennemis.
Le professeur Xiao Bin a souligné dans son livre "De l'État, du monde et de la nature humaine à la politique : la construction du concept politique de Schmitt", que l'homme lui-même est un être dangereux. "Il prétend que la politique est un danger pour les gens." La question suivante qui se pose lorsque l'on participe à la politique est d'expliquer ce qu'est la politique, en particulier la nature de la politique. La survie de l'unité nationale exige comme condition préalable une distinction entre ennemis et amis. Une politique fondée sur la séparation des ennemis et des amis est non seulement le destin inévitable de l'unité de la nation et de l'État, mais aussi la base de son existence. Schmitt a une compréhension unique de la nature de la politique : la norme de la politique est de séparer les amis et les ennemis. En fait, ce que nous appelons la politique implique la relation entre un ami et un autre, et la différence est l'intensité de cette différence. Cependant, nous ne pouvons pas ignorer le fait que les origines théologiques les plus secrètes et les plus mystérieuses et le nationalisme allemand ont un niveau de critères différent pour séparer les amis des ennemis. Du point de vue ci-dessus, la politique émerge des conflits humains et les phénomènes politiques de la société humaine sont inévitablement associés aux conflits et à la coopération. Même si vous comprenez la politique en termes de bonté et de moralité, comme Aristote, elle ne peut pas cacher l'existence du mal. Sous le bien suprême se trouve la crise du mal. L'homme est l'existence de l'incertitude, l'homme est un animal politique naturel, et où qu'il soit, il y aura des conflits. Dans les conflits, il y aura inévitablement deux camps opposés et la politique ne peut pas se débarrasser du conflit... Les deux aspects du conflit et de la confrontation nous donnent une base logique pour la division en amis et ennemis.
Du point de vue ci-dessus, la politique émerge des conflits humains et les phénomènes politiques de la société humaine sont inévitablement associés aux conflits et à la coopération. Même si vous comprenez la politique en termes de bonté et de moralité, comme Aristote, elle ne peut pas cacher l'existence du mal. Sous le bien suprême se trouve la crise du mal. L'homme est l'existence de l'incertitude, l'homme est un animal politique naturel, et où qu'il soit, il y aura des conflits. Dans les conflits, il y aura inévitablement deux camps opposés et la politique ne peut pas se débarrasser du conflit... Les deux aspects du conflit et de la confrontation nous donnent une base logique pour la division en amis et ennemis.
 Il y a des zones d'ombre dans l'histoire que l’on ne raconte généralement pas; peut-être à cause de la difficulté de les étiqueter, de les insérer dans des schémas préconçus qui facilitent, pour les utilisateurs d'un tel code (les masses), la compréhension de la réalité comme mythe : la réalité de la lutte métaphysique du XXe siècle, la lutte du Bien (l’antifascisme sous ses diverses formes, même si les communistes, et surtout les staliniens, étaient partiellement dénigrés dans ce contexte) contre le Mal (le sulfurisme nazi, satanisé à souhait avec queue velue et ratomorphe, fourche brandie).
Il y a des zones d'ombre dans l'histoire que l’on ne raconte généralement pas; peut-être à cause de la difficulté de les étiqueter, de les insérer dans des schémas préconçus qui facilitent, pour les utilisateurs d'un tel code (les masses), la compréhension de la réalité comme mythe : la réalité de la lutte métaphysique du XXe siècle, la lutte du Bien (l’antifascisme sous ses diverses formes, même si les communistes, et surtout les staliniens, étaient partiellement dénigrés dans ce contexte) contre le Mal (le sulfurisme nazi, satanisé à souhait avec queue velue et ratomorphe, fourche brandie).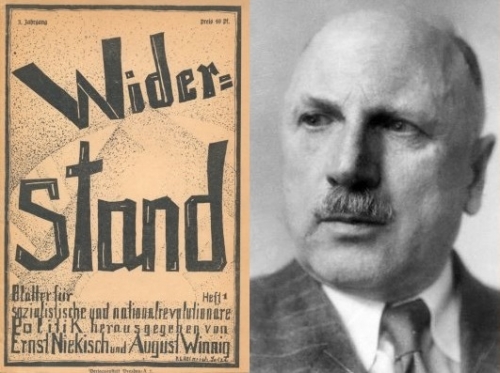

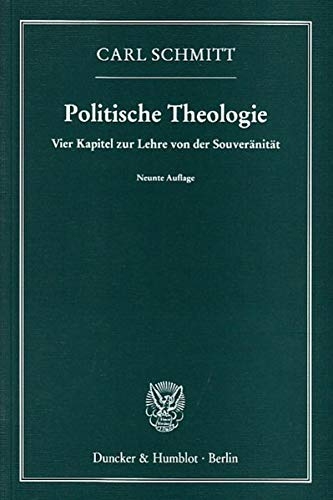 Ainsi, Schmitt en est venu à théoriser un État refondu incarnant la décision souveraine, à neutraliser les affrontements destructeurs issus des chocs entre intérêts privés, et enfin, à se positionner comme un tiers supérieur capable de faire prévaloir le dernier mot d'une autorité radicale, exprimée dans l'état d'exception, sur le conflit social. On comprend qu'avec de telles idées, Schmitt était sur une trajectoire de collision avec le conservatisme prussien politiquement hégémonique dans l'Allemagne wilhelminienne, et aussi dans uneplus large mesure dans l'Allemagne de Weimar. Le pouvoir d'État, pour l'école prussienne, plus que l'autorité transcendante, c'était l'autoritarisme immanent, et plus que la synthèse hégélienne des contraires, c'était l'affirmation monolithique d'un principe unique et ossifié. C'est pourquoi Schmitt a considéré le suicide du grand poète prussien Heinrich von Kleist - un adepte de l'idée métaphysique du Reich -, qui a eu lieu théâtralement sur les rives du lac Wannsee, comme le symbole de l'échec historique du prussianisme et comme un effet tragique de ses contradictions. Schmitt a alors développé la conviction qu'une relance de l'Europe était possible mais sur d'autres bases. Sur la base, précisément, d'une théologie politique. Très critique à l'égard de la pensée politique du Romantisme - accusé d'extravagances irréalisables - Schmitt en est néanmoins une parcelle, et ce, au moment même où il pense que la restauration de l'Esprit est possible sur des bases irrationnelles mais objectives. Greffer le point de vue prométhéen d'un nouveau mythe communautaire dans la pratique politique était plus qu'un rêve. Reconnaître le sens cosmologique de la pensée présocialiste d'un Proudhon, ou le sens poético-visionnaire d'un Theodor Däubler comme antécédents du pouvoir politique, peut sembler une rechute de Schmitt dans ces divagations très impolitiques dont il avait accusé le romantisme.
Ainsi, Schmitt en est venu à théoriser un État refondu incarnant la décision souveraine, à neutraliser les affrontements destructeurs issus des chocs entre intérêts privés, et enfin, à se positionner comme un tiers supérieur capable de faire prévaloir le dernier mot d'une autorité radicale, exprimée dans l'état d'exception, sur le conflit social. On comprend qu'avec de telles idées, Schmitt était sur une trajectoire de collision avec le conservatisme prussien politiquement hégémonique dans l'Allemagne wilhelminienne, et aussi dans uneplus large mesure dans l'Allemagne de Weimar. Le pouvoir d'État, pour l'école prussienne, plus que l'autorité transcendante, c'était l'autoritarisme immanent, et plus que la synthèse hégélienne des contraires, c'était l'affirmation monolithique d'un principe unique et ossifié. C'est pourquoi Schmitt a considéré le suicide du grand poète prussien Heinrich von Kleist - un adepte de l'idée métaphysique du Reich -, qui a eu lieu théâtralement sur les rives du lac Wannsee, comme le symbole de l'échec historique du prussianisme et comme un effet tragique de ses contradictions. Schmitt a alors développé la conviction qu'une relance de l'Europe était possible mais sur d'autres bases. Sur la base, précisément, d'une théologie politique. Très critique à l'égard de la pensée politique du Romantisme - accusé d'extravagances irréalisables - Schmitt en est néanmoins une parcelle, et ce, au moment même où il pense que la restauration de l'Esprit est possible sur des bases irrationnelles mais objectives. Greffer le point de vue prométhéen d'un nouveau mythe communautaire dans la pratique politique était plus qu'un rêve. Reconnaître le sens cosmologique de la pensée présocialiste d'un Proudhon, ou le sens poético-visionnaire d'un Theodor Däubler comme antécédents du pouvoir politique, peut sembler une rechute de Schmitt dans ces divagations très impolitiques dont il avait accusé le romantisme.
 La quadrature du cercle entre le pouvoir hiérarchique et la participation du peuple, entre la figure salvatrice du Guide et l'égalité des droits, a été réalisée par Schmitt à travers l'élaboration d'une sorte de démocratie germanique. Critiquant le concept ecclésiastique de pasteur et de fidèle (ndt : de distinction entre le pasteur « sachant » et actif et les fidèles passifs), Schmitt a écrit dans Staat, Bewegung und Volk en 1934 que "cette vision ecclésiastique est que le pasteur reste absolument transcendant par rapport au troupeau. Ce n'est pas notre concept de la Führung". Le nouveau concept de Führung, de commandement, d'autorité, Schmitt l’a en effet placé dans "l'égalité absolue de la lignée entre le leader et les suiveurs (la suite, die Folge)... Seule l'égalité de la lignée peut empêcher le pouvoir du leader de devenir tyrannique et arbitraire". De ce point de vue de la hiérarchie égalitaire, l'accès populaire aux différents rangs sociaux était garanti par le Führerprinzip, la plate-forme de masse de l'autorité charismatique. L'histoire a donc mis entre les mains de Schmitt un cas concret de théologie politique...
La quadrature du cercle entre le pouvoir hiérarchique et la participation du peuple, entre la figure salvatrice du Guide et l'égalité des droits, a été réalisée par Schmitt à travers l'élaboration d'une sorte de démocratie germanique. Critiquant le concept ecclésiastique de pasteur et de fidèle (ndt : de distinction entre le pasteur « sachant » et actif et les fidèles passifs), Schmitt a écrit dans Staat, Bewegung und Volk en 1934 que "cette vision ecclésiastique est que le pasteur reste absolument transcendant par rapport au troupeau. Ce n'est pas notre concept de la Führung". Le nouveau concept de Führung, de commandement, d'autorité, Schmitt l’a en effet placé dans "l'égalité absolue de la lignée entre le leader et les suiveurs (la suite, die Folge)... Seule l'égalité de la lignée peut empêcher le pouvoir du leader de devenir tyrannique et arbitraire". De ce point de vue de la hiérarchie égalitaire, l'accès populaire aux différents rangs sociaux était garanti par le Führerprinzip, la plate-forme de masse de l'autorité charismatique. L'histoire a donc mis entre les mains de Schmitt un cas concret de théologie politique...

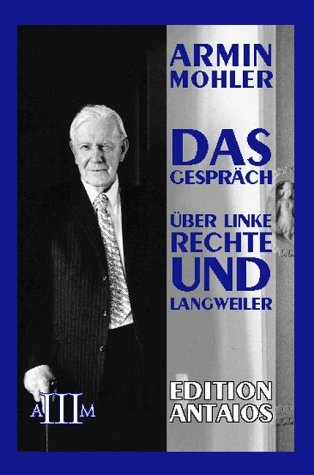
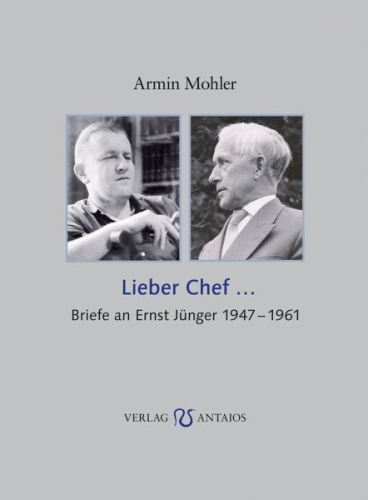

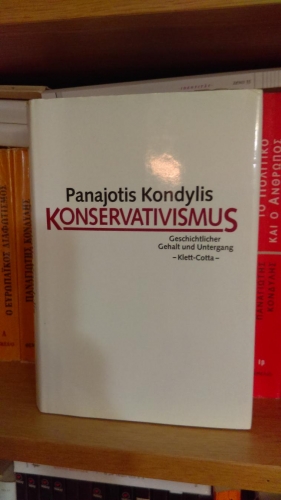
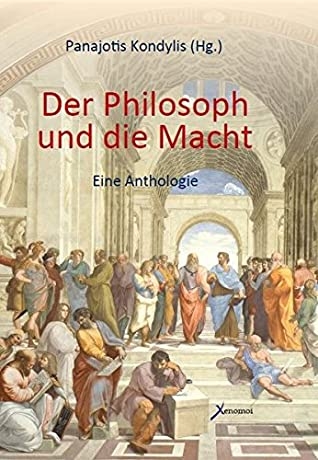 “[C]ommonplaces of conservative self-understanding and self-presentation have crept […] into the scientific discussion,” such as “the coquettish enmity of conservatives towards theory.” The prioritization of the “concrete” over the “abstract” is itself, or relies upon, an abstraction (p. 15).
“[C]ommonplaces of conservative self-understanding and self-presentation have crept […] into the scientific discussion,” such as “the coquettish enmity of conservatives towards theory.” The prioritization of the “concrete” over the “abstract” is itself, or relies upon, an abstraction (p. 15).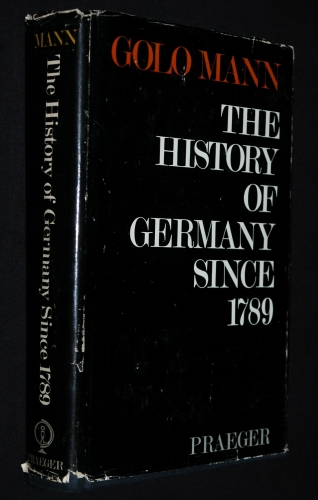


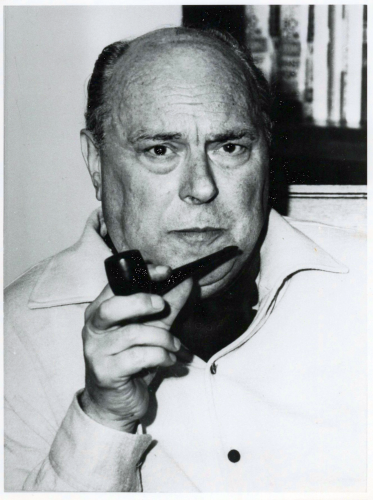
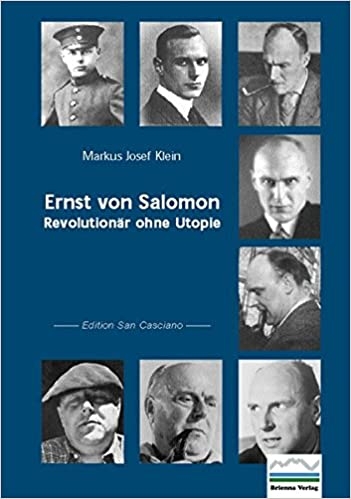
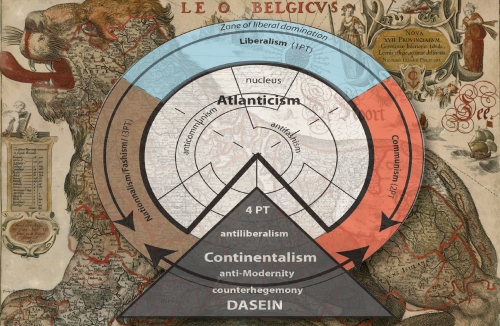
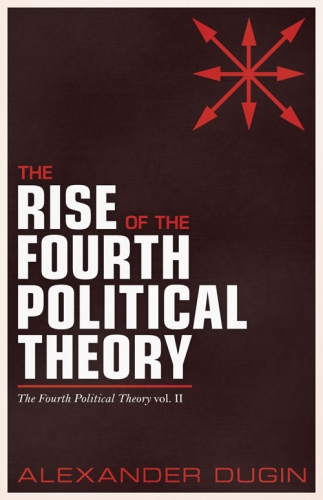 Mais qu’est-ce que « sauver » veut dire ? Sauver est apporter le salut, cela nous le savons, tout le monde le sait sans néanmoins comprendre profondément la portée d’un tel geste. Apporter le salut, s’il faut donc définir correctement cette expression, signifie faire l’effort de redonner son intégrité à une personne, la considérer en son entièreté. Il ne s’agit donc point originellement d’une action visant à la soustraire d’un danger extérieur à elle-même, donc de se permettre soi-même de la dominer de ses sentiments prétendument supérieurs. Cela est autre chose que le salut. C’est d’ailleurs l’attitude prétentieuse qui prédomine dans notre monde lorsque de l’homme l’on désire en faire autre chose que ce qu’il est ! Mais nous y reviendrons.
Mais qu’est-ce que « sauver » veut dire ? Sauver est apporter le salut, cela nous le savons, tout le monde le sait sans néanmoins comprendre profondément la portée d’un tel geste. Apporter le salut, s’il faut donc définir correctement cette expression, signifie faire l’effort de redonner son intégrité à une personne, la considérer en son entièreté. Il ne s’agit donc point originellement d’une action visant à la soustraire d’un danger extérieur à elle-même, donc de se permettre soi-même de la dominer de ses sentiments prétendument supérieurs. Cela est autre chose que le salut. C’est d’ailleurs l’attitude prétentieuse qui prédomine dans notre monde lorsque de l’homme l’on désire en faire autre chose que ce qu’il est ! Mais nous y reviendrons.

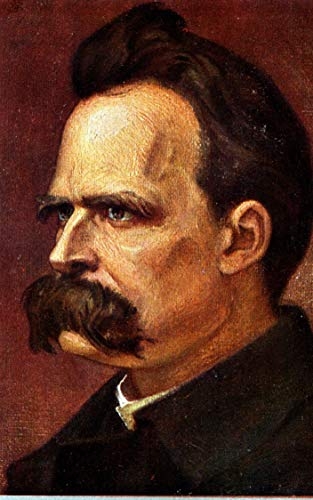
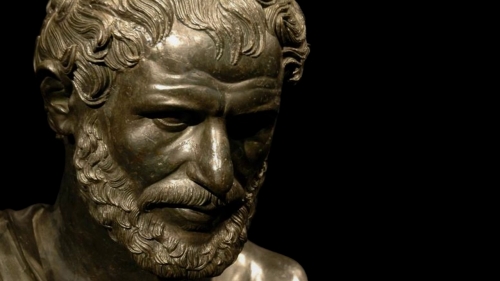




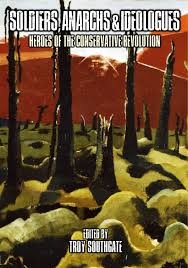

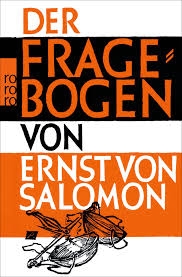 De ce fait le roman présente un intérêt historique évident, qui tient pour une large part à l’acuité de son auteur et à ses ambiguïtés – surtout pour nous autres, lecteurs contemporains, à qui la Seconde Guerre mondiale apparaît volontiers comme un affrontement manichéen qui rend impossible une compréhension exacte de ses ressorts historiques.
De ce fait le roman présente un intérêt historique évident, qui tient pour une large part à l’acuité de son auteur et à ses ambiguïtés – surtout pour nous autres, lecteurs contemporains, à qui la Seconde Guerre mondiale apparaît volontiers comme un affrontement manichéen qui rend impossible une compréhension exacte de ses ressorts historiques.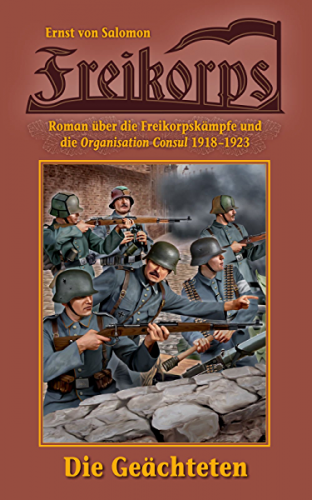 La condamnation pour complicité dans l'affaire Rathenau est toutefois décisive : la prison sera rétrospectivement une chance à plus d'un titre. Pour notre bonheur, d’abord, parce que cet épisode fournit le prétexte à certaines des pages les plus drôles du roman, von Salomon traitant de la vie carcérale avec un humour féroce, se réjouissant par exemple de pouvoir écrire en toute sérénité sans avoir à se soucier ni du gîte ni du couvert ; pour le sien, ensuite, parce que ce séjour en prison empêche sa réintégration au grade de sous-officier dans la Wehrmacht, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate (von Salomon appartient au corps royal des cadets, une expérience décrite dans le roman Les Cadets). Il peut ainsi se maintenir simultanément à l'écart de la politique, du front (il travaille pendant ces années dans l'industrie cinématographique) et par voie de conséquence, de la potence, une fois la guerre perdue.
La condamnation pour complicité dans l'affaire Rathenau est toutefois décisive : la prison sera rétrospectivement une chance à plus d'un titre. Pour notre bonheur, d’abord, parce que cet épisode fournit le prétexte à certaines des pages les plus drôles du roman, von Salomon traitant de la vie carcérale avec un humour féroce, se réjouissant par exemple de pouvoir écrire en toute sérénité sans avoir à se soucier ni du gîte ni du couvert ; pour le sien, ensuite, parce que ce séjour en prison empêche sa réintégration au grade de sous-officier dans la Wehrmacht, lorsque la Seconde Guerre mondiale éclate (von Salomon appartient au corps royal des cadets, une expérience décrite dans le roman Les Cadets). Il peut ainsi se maintenir simultanément à l'écart de la politique, du front (il travaille pendant ces années dans l'industrie cinématographique) et par voie de conséquence, de la potence, une fois la guerre perdue.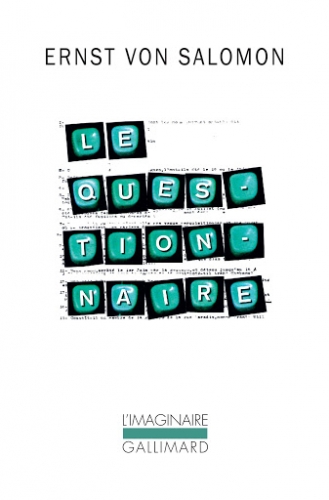 On sent bien que la politique dans son sens le plus noble, celle qui s’attache aux États et aux peuples, est un tropisme de Von Salomon, et la politique occupe évidemment le devant de la scène dans la période; pourtant Le Questionnaire ne s'y résume pas, loin de là. Outre le récit des différents épisodes de la vie de l’auteur, on y trouve de nombreuses réflexions sur l'art, l'écriture et la littérature, sur l'Histoire, la société, la culture. Von Salomon est aussi un bon vivant, qui aime manger, boire, séduire, conduire des voitures avec une «gueule chromée», plutôt cigale que fourmi, et qui nous offre à l’occasion des saillies authentiquement rabelaisiennes.
On sent bien que la politique dans son sens le plus noble, celle qui s’attache aux États et aux peuples, est un tropisme de Von Salomon, et la politique occupe évidemment le devant de la scène dans la période; pourtant Le Questionnaire ne s'y résume pas, loin de là. Outre le récit des différents épisodes de la vie de l’auteur, on y trouve de nombreuses réflexions sur l'art, l'écriture et la littérature, sur l'Histoire, la société, la culture. Von Salomon est aussi un bon vivant, qui aime manger, boire, séduire, conduire des voitures avec une «gueule chromée», plutôt cigale que fourmi, et qui nous offre à l’occasion des saillies authentiquement rabelaisiennes.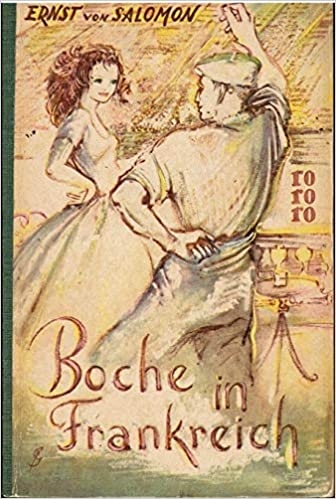 Von Salomon consacre près de quatre-vingt pages (642-722) à un séjour en terres basques, du côté de Saint-Jean-de-Luz (le questionnaire s'intéresse à ses séjours à l'étranger) où il fait la connaissance de Mayie, avec laquelle il entretient une relation avant de regagner l'Allemagne. Ce roman dans le roman, évocation nostalgique d'un paradis perdu, s'intercale de façon presque surréaliste entre les derniers moments du régime nazi et l'entrée des Américains dans une Allemagne défaite, et s'imprime dans ce long récit comme un songe – et c'est sans doute comme un songe que ce souvenir est resté à von Salomon, qui écrit : «Mais quand je pense à Mayie, je pense à la France et quand je pense à la France, je pense à Mayie. Ô douce Mayie, Ô Sainte France ! Vous m'avez donné le rêve de ma vie, les grandes vacances de ma vie» (pp. 719-720). Le sentiment qui s’en dégage s’approche de celui que suscite le dernier moment de L’Éducation sentimentale. Ceux qui l’auront lu se souviendront sans doute du vertigineux saut dans le temps que ménage Flaubert à la fin du roman. Proust, à ce propos, écrit en 1920 (À propos du style de Flaubert, in La Nouvelle revue française) : «Sans l’ombre d’une transition, soudain la mesure du temps devenant au lieu de quarts d’heure, des années, des décades». Eh bien cet «abîme» qui s’ouvre et nous laisse justement contempler, amer, la folie d’une vie qui s’est écoulée avec fulgurance et qui contenait, avec le recul, beaucoup plus de vide que de matière – c’est le sentiment qui surnage ici.
Von Salomon consacre près de quatre-vingt pages (642-722) à un séjour en terres basques, du côté de Saint-Jean-de-Luz (le questionnaire s'intéresse à ses séjours à l'étranger) où il fait la connaissance de Mayie, avec laquelle il entretient une relation avant de regagner l'Allemagne. Ce roman dans le roman, évocation nostalgique d'un paradis perdu, s'intercale de façon presque surréaliste entre les derniers moments du régime nazi et l'entrée des Américains dans une Allemagne défaite, et s'imprime dans ce long récit comme un songe – et c'est sans doute comme un songe que ce souvenir est resté à von Salomon, qui écrit : «Mais quand je pense à Mayie, je pense à la France et quand je pense à la France, je pense à Mayie. Ô douce Mayie, Ô Sainte France ! Vous m'avez donné le rêve de ma vie, les grandes vacances de ma vie» (pp. 719-720). Le sentiment qui s’en dégage s’approche de celui que suscite le dernier moment de L’Éducation sentimentale. Ceux qui l’auront lu se souviendront sans doute du vertigineux saut dans le temps que ménage Flaubert à la fin du roman. Proust, à ce propos, écrit en 1920 (À propos du style de Flaubert, in La Nouvelle revue française) : «Sans l’ombre d’une transition, soudain la mesure du temps devenant au lieu de quarts d’heure, des années, des décades». Eh bien cet «abîme» qui s’ouvre et nous laisse justement contempler, amer, la folie d’une vie qui s’est écoulée avec fulgurance et qui contenait, avec le recul, beaucoup plus de vide que de matière – c’est le sentiment qui surnage ici.
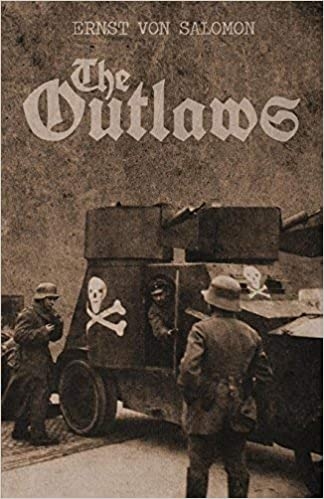 On constate qu’avec une très grande intelligence littéraire, Von Salomon a donc ménagé la présence de ces trois pôles dans le récit (le Gouvernement militaire allié, le lecteur et lui-même), de sorte qu’ils apparaissent d’intensité à peu près égale et que l’un n’écrase pas les deux autres. Pour ce faire, il fallait accentuer démesurément la présence du Gouvernement militaire allié (aidé par son existence historique mais qui demeure, des trois pôles, le plus fragile) – raison pour laquelle il structure si profondément l’ensemble du roman – et il fallait forcer le lecteur à entrer dans le bocal, donc le faire déchoir de sa position confortable mais lointaine d’observateur, de destinataire naturel à qui tout est acquis. Raison pour laquelle son horizon d’attente est trompé : alors que le genre autobiographique invite le lecteur à se croire légitimement destinataire («Je veux montrer à mes semblables...», dit Rousseau dans l’incipit des Confessions), Von Salomon lui coupe l’herbe sous le pied et semble lui substituer le Gouvernement militaire allié. Il fallait enfin circonscrire la place démiurgique de l’auteur, une illusion que von Salomon parvient à donner dès lors qu’il semble se conformer aux injonctions du questionnaire, comme s’il n’était pas maître du récit.
On constate qu’avec une très grande intelligence littéraire, Von Salomon a donc ménagé la présence de ces trois pôles dans le récit (le Gouvernement militaire allié, le lecteur et lui-même), de sorte qu’ils apparaissent d’intensité à peu près égale et que l’un n’écrase pas les deux autres. Pour ce faire, il fallait accentuer démesurément la présence du Gouvernement militaire allié (aidé par son existence historique mais qui demeure, des trois pôles, le plus fragile) – raison pour laquelle il structure si profondément l’ensemble du roman – et il fallait forcer le lecteur à entrer dans le bocal, donc le faire déchoir de sa position confortable mais lointaine d’observateur, de destinataire naturel à qui tout est acquis. Raison pour laquelle son horizon d’attente est trompé : alors que le genre autobiographique invite le lecteur à se croire légitimement destinataire («Je veux montrer à mes semblables...», dit Rousseau dans l’incipit des Confessions), Von Salomon lui coupe l’herbe sous le pied et semble lui substituer le Gouvernement militaire allié. Il fallait enfin circonscrire la place démiurgique de l’auteur, une illusion que von Salomon parvient à donner dès lors qu’il semble se conformer aux injonctions du questionnaire, comme s’il n’était pas maître du récit.
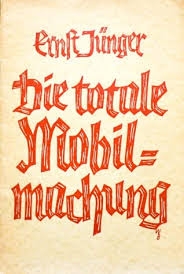
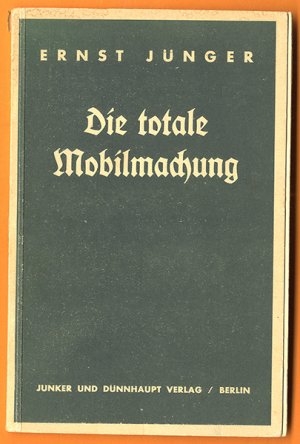
 Quatrième extrait
Quatrième extrait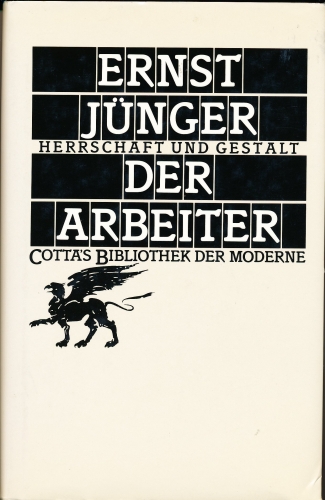 Sixième extrait
Sixième extrait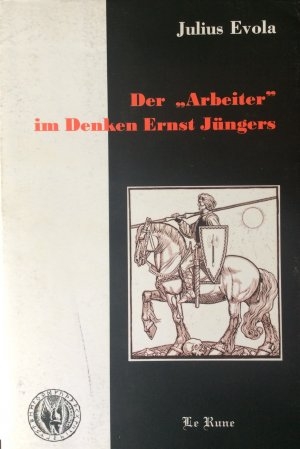 Les masques tomberaient-ils, malgré la propagande, en dépit de la mobilisation ? Certains d’entre nous, trop peu bien entendu, ont pris goût à une vie décélérée et exempte des tourbillons et de l’agitation du quotidien, réalisent que cette liberté retrouvée les renvoie, par contraste, à leur ordinaire condition de servilité, se disent qu’au fond ils se satisferaient bien d’un prolongement de cette parenthèse enchantée. Ils ont même retrouvé une certaine forme de mesure et de sérénité dont le fol emballement de la vie moderne les avait privés (et ils en furent les complices volontaires, nous le savons bien !) : mais que valent ces gouttes d’eau dans l’océan de dispositifs digitaux, que peuvent ces minuscules prises de conscience contre le Grand Déferlement ?
Les masques tomberaient-ils, malgré la propagande, en dépit de la mobilisation ? Certains d’entre nous, trop peu bien entendu, ont pris goût à une vie décélérée et exempte des tourbillons et de l’agitation du quotidien, réalisent que cette liberté retrouvée les renvoie, par contraste, à leur ordinaire condition de servilité, se disent qu’au fond ils se satisferaient bien d’un prolongement de cette parenthèse enchantée. Ils ont même retrouvé une certaine forme de mesure et de sérénité dont le fol emballement de la vie moderne les avait privés (et ils en furent les complices volontaires, nous le savons bien !) : mais que valent ces gouttes d’eau dans l’océan de dispositifs digitaux, que peuvent ces minuscules prises de conscience contre le Grand Déferlement ? 


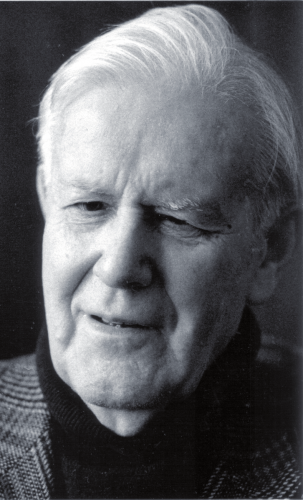
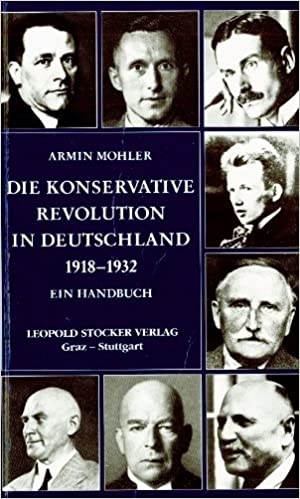 À partir de 1953, Armin Mohler s’installe en France. Il travaille pour les journaux allemands et suisses alémaniques Die Zeit, Die Welt et Die Tat. Il lit Maurice Barrès, Léon Bloy et Georges Sorel qu’il estime dans un livre de 2000 non traduit comme le « Grand-père » de la Révolution conservatrice. Ses amis se nomment Michel Mourre, le provocateur lettriste pré-situationniste, et le futur académicien José Cabanis. Revenu en Allemagne, Armin Mohler s’investit en politique. Ce directeur – gérant de la prestigieuse fondation Carl Friedrich von Siemens écrit pour les revues jeune-conservatrice
À partir de 1953, Armin Mohler s’installe en France. Il travaille pour les journaux allemands et suisses alémaniques Die Zeit, Die Welt et Die Tat. Il lit Maurice Barrès, Léon Bloy et Georges Sorel qu’il estime dans un livre de 2000 non traduit comme le « Grand-père » de la Révolution conservatrice. Ses amis se nomment Michel Mourre, le provocateur lettriste pré-situationniste, et le futur académicien José Cabanis. Revenu en Allemagne, Armin Mohler s’investit en politique. Ce directeur – gérant de la prestigieuse fondation Carl Friedrich von Siemens écrit pour les revues jeune-conservatrice 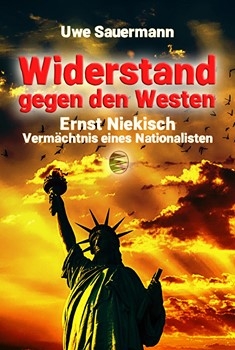



 In which case, with John Hargrave (photo), of the Kibbo Kift, and then the Green Shirt Movement for Social Credit, and with Rotha Lintorn-Orman, in her move from pioneering Girl Guide to British Fascist, 2* shades into 4*. Rolf Gardiner is an emblematic figure here. Born in Berlin, and a writer in German, he was a conduit for Bündische ideas.
In which case, with John Hargrave (photo), of the Kibbo Kift, and then the Green Shirt Movement for Social Credit, and with Rotha Lintorn-Orman, in her move from pioneering Girl Guide to British Fascist, 2* shades into 4*. Rolf Gardiner is an emblematic figure here. Born in Berlin, and a writer in German, he was a conduit for Bündische ideas. The influence of Nietzsche is almost as important in England as in Germany. Levy’s “Nietzsche Movement in England” is a C.R.-adjacent current. Ludovici began in Levy’s movement to become important within the English Mistery, as well as the illiberal wing of the eugenic movement. An overlooked aspect of Hulme qua philosopher is his similarity to Nietzsche (in “Cinders,” especially). A feature shared by many of the sects thrown together in the pages of The New Age—Social Credit, Toryism, Marxism, guild socialism, Fabianism, Gurdjieffism, etc., etc.—is an interest in Nietzsche.
The influence of Nietzsche is almost as important in England as in Germany. Levy’s “Nietzsche Movement in England” is a C.R.-adjacent current. Ludovici began in Levy’s movement to become important within the English Mistery, as well as the illiberal wing of the eugenic movement. An overlooked aspect of Hulme qua philosopher is his similarity to Nietzsche (in “Cinders,” especially). A feature shared by many of the sects thrown together in the pages of The New Age—Social Credit, Toryism, Marxism, guild socialism, Fabianism, Gurdjieffism, etc., etc.—is an interest in Nietzsche.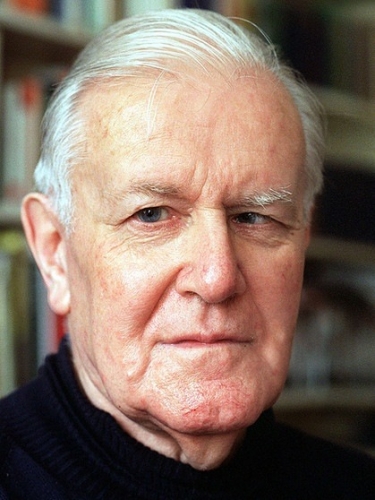
 Ce n’était pas une crise, ce n’était pas un problème concret, ce n’était pas davantage une analyse de la situation qui avait généré ces phénomènes politiques. Ils ne devaient leur émergence et leur succès qu’au seul effet de la pensée du défunt Armin Mohler. Or celui, ajoutait le rédacteur de Die Zeit, n’avait rien d’un penseur original. Car Mohler n’avait fait que recycler le « nationalisme folciste » du temps de la République de Weimar. Bien sûr, les protagonistes actuels de la « nouvelle droite » n’atteignaient plus le niveau des Moeller van den Bruck, Oswald Spengler, Carl Schmitt ou Ernst Jünger. Mais, voilà, elles avaient mûri les graines que Mohler, avec son livre Die konservative Revolution in Deutschland, avait semées.
Ce n’était pas une crise, ce n’était pas un problème concret, ce n’était pas davantage une analyse de la situation qui avait généré ces phénomènes politiques. Ils ne devaient leur émergence et leur succès qu’au seul effet de la pensée du défunt Armin Mohler. Or celui, ajoutait le rédacteur de Die Zeit, n’avait rien d’un penseur original. Car Mohler n’avait fait que recycler le « nationalisme folciste » du temps de la République de Weimar. Bien sûr, les protagonistes actuels de la « nouvelle droite » n’atteignaient plus le niveau des Moeller van den Bruck, Oswald Spengler, Carl Schmitt ou Ernst Jünger. Mais, voilà, elles avaient mûri les graines que Mohler, avec son livre Die konservative Revolution in Deutschland, avait semées.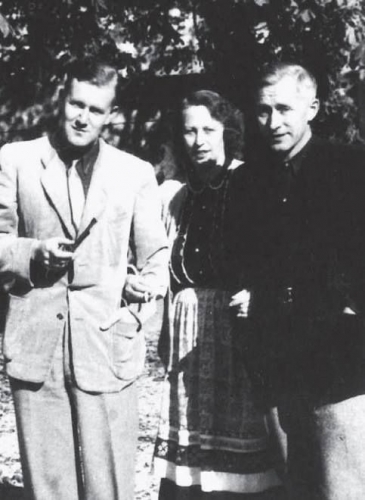 On devra toutefois constater que Mohler n’a laissé qu’un petit nombre d’écrits réellement personnels : on citera, outre son œuvre principale consacrée à la révolution conservatrice, Was die Deutschen fürchten et Die Vergangenheitbewältigung ; mais il ne faut pas oublier, qu’à côté de ces livres-là, il y a eu toute une série d’essais qui ont sans nul doute laissé, chez leurs lecteurs, des impressions bien plus fortes comme, par exemple, Der faschistischen Stil ou Liberalenbeschimpfung.
On devra toutefois constater que Mohler n’a laissé qu’un petit nombre d’écrits réellement personnels : on citera, outre son œuvre principale consacrée à la révolution conservatrice, Was die Deutschen fürchten et Die Vergangenheitbewältigung ; mais il ne faut pas oublier, qu’à côté de ces livres-là, il y a eu toute une série d’essais qui ont sans nul doute laissé, chez leurs lecteurs, des impressions bien plus fortes comme, par exemple, Der faschistischen Stil ou Liberalenbeschimpfung. 
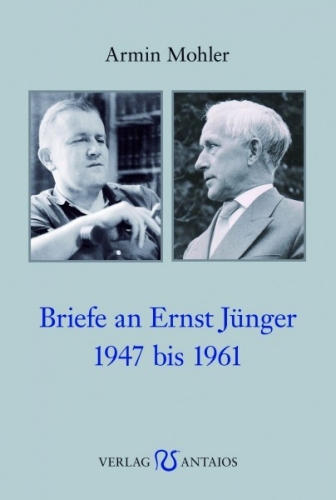 Si l’on cherche à expliquer ce qu’il reste de la pensée de Mohler, alors il faut laisser tomber ce qu’il a souvent lui-même (et aussi ses adversaires) mis au centre de ses préoccupations. Son « nominalisme » n’avait guère de consistence tout comme sa critique du christianisme, sa vision « technocratique » n’a nullement été une solution pour la mouvance conservatrice, son orientation « gaullienne » n’a quasi convaincu personne. En revanche, ce qui est incontournable dans sa manière de saisir le monde, c’est son analyse de « la période axiale du conservatisme ».
Si l’on cherche à expliquer ce qu’il reste de la pensée de Mohler, alors il faut laisser tomber ce qu’il a souvent lui-même (et aussi ses adversaires) mis au centre de ses préoccupations. Son « nominalisme » n’avait guère de consistence tout comme sa critique du christianisme, sa vision « technocratique » n’a nullement été une solution pour la mouvance conservatrice, son orientation « gaullienne » n’a quasi convaincu personne. En revanche, ce qui est incontournable dans sa manière de saisir le monde, c’est son analyse de « la période axiale du conservatisme ». 
