
Parution du numéro 474 du Bulletin célinien
 Sommaire:
Sommaire:
Un Céline méconnu
Pour saluer Bernard Pivot
Écrire contre Céline
Montaigne dans Voyage au bout de la nuit.
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
La 25ème heure et le citoyen technique
Nicolas Bonnal
La vingt-cinquième heure ? C’est selon Virgil Gheorghiu « le moment où toute tentative de sauvetage devient inutile. Même la venue d’un messie ne résoudrait rien ».
JO, surveillance, confinements-vaccins, reset-écologie….
Nous y sommes car nous avons devant nous une conspiration avec des moyens techniques et financiers formidables, une conspiration formée exclusivement de victimes et de bourreaux volontaires. On a vu les bras croisés le cauchemar s’asseoir depuis la mondialisation des années 90 et la lutte contre le terrorisme (2001), puis progresser en 2020-21 à une vitesse prodigieuse, cauchemar que rien n’interrompt en ces temps de pleine apostasie catholique. La dégoûtante involution du Vatican s’est faite dans la totale indifférence du troupeau de nos bourgeois-diplômés-cathos, et on comprend ce qui pouvait motiver Drumont, Léon Bloy ou Bernanos contre une telle engeance de bien-pensants. Un pour cent ou un pour mille de résistants ? Le reste s’est assis masqué et a applaudi.
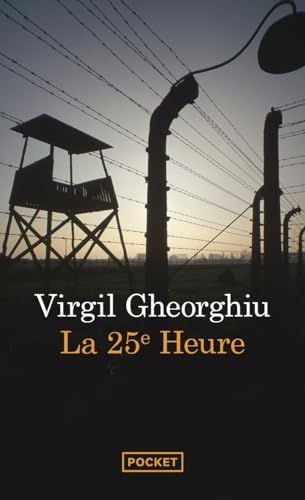 La situation est pire que sous le nazisme ou le communisme, car à cette époque elle était localisée. Il y a des Thomas Mann, il y a des Soljenitsyne pour témoigner, pour tonner contre, comme dit Flaubert. Là, la situation techno-nazie de Schwab-Gates-Leyen sera globale. La crise du virus a déclenché une solution totalitaire planétaire et des expédients ubiquitaires - signe de l’Antéchrist, dit Mgr Gaume. Certes c’est surtout l’Occident la cible, et cette vieille race blanche toujours plus gâteuse, que je mettais en garde il y a dix ans (Lettre ouverte) ou trente (La Nuit du lemming). Mais c’est le propre des Cassandre de n’être jamais crues ou des Laocoon d’être étouffés par les serpents. Lisez dans Virgile l’entrée du cheval dans la cité de Troie pour comprendre. Après la mort de Laocoon, le peuple troyen enjoué abat les murs et laisse entrer la machine pleine de guerriers. Allez, un peu de latin :
La situation est pire que sous le nazisme ou le communisme, car à cette époque elle était localisée. Il y a des Thomas Mann, il y a des Soljenitsyne pour témoigner, pour tonner contre, comme dit Flaubert. Là, la situation techno-nazie de Schwab-Gates-Leyen sera globale. La crise du virus a déclenché une solution totalitaire planétaire et des expédients ubiquitaires - signe de l’Antéchrist, dit Mgr Gaume. Certes c’est surtout l’Occident la cible, et cette vieille race blanche toujours plus gâteuse, que je mettais en garde il y a dix ans (Lettre ouverte) ou trente (La Nuit du lemming). Mais c’est le propre des Cassandre de n’être jamais crues ou des Laocoon d’être étouffés par les serpents. Lisez dans Virgile l’entrée du cheval dans la cité de Troie pour comprendre. Après la mort de Laocoon, le peuple troyen enjoué abat les murs et laisse entrer la machine pleine de guerriers. Allez, un peu de latin :
Diuidimus muros et moenia pandimus urbis.
Nous sommes donc à la veille d’une gigantesque extermination et d’un total arraisonnement. Et tout cela se passe facilement et posément, devant les yeux des victimes consentantes ou indifférentes que nous sommes. Nous payons ici l’addition de la technique et de notre soumission. De Chateaubriand à Heidegger elle a été rappelée par tous les penseurs (voyez ici mes chroniques). C’est cette dépendance monotone qui nous rend incapables de nous défendre contre les jobards de l’économie et de l’administration qui aujourd’hui veulent faire de leur troupeau humain le bifteck de Soleil vert ou les esclaves en laisse électronique. Et le troupeau est volontaire, enthousiaste comme disait Céline avant juin 40.
Chateaubriand dans ses Mémoires :
« Au milieu de cela, remarquez une contradiction phénoménale : l’état matériel s’améliore, le progrès intellectuel s’accroît, et les nations au lieu de profiter s’amoindrissent : d’où vient cette contradiction ?
C’est que nous avons perdu dans l’ordre moral. En tout temps il y a eu des crimes ; mais ils n’étaient point commis de sang-froid, comme ils le sont de nos jours, en raison de la perte du sentiment religieux. À cette heure ils ne révoltent plus, ils paraissent une conséquence de la marche du temps ; si on les jugeait autrefois d’une manière différente, c’est qu’on n’était pas encore, ainsi qu’on l’ose affirmer, assez avancé dans la connaissance de l’homme ; on les analyse actuellement ; on les éprouve au creuset, afin de voir ce qu’on peut en tirer d’utile, comme la chimie trouve des ingrédients dans les voiries ».
Voilà pourquoi les parlements et les administrations ne seront arrêtés par rien. Et le troupeau renâclera peut-être trois minutes mais il se soumettra comme les autres fois sauf qu’ici ce sera global et simultané. Quant aux minorités rebelles (1% tout au plus) le moins que l’on puisse dire c’est qu’elles ne sont pas très agissantes…
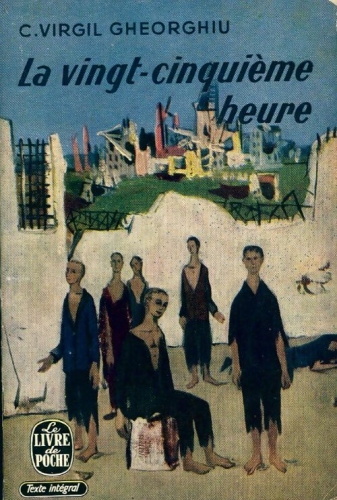
Dans La vingt-cinquième heure, Virgil Gheorghiu dénonce avec son personnage Trajan notre déchéance liée au progrès, au confort, à la technique, à la bureaucratie, ce qu’on voudra. Et cela donne :
« Nous apprenons les lois et la manière de parler de nos esclaves pour mieux les diriger. Et ainsi, peu à peu, sans même nous rendre compte, nous renonçons à nos qualités humaines, à nos lois propres. Nous nous déshumanisons, nous adoptons le style de vie de nos esclaves techniques… »
Cela explique pourquoi l’homme moderne, fils des droits constitués et pas gagnés, se laisse liquider partout si commodément.
« L’homme moderne sait que lui-même et ses semblables sont des éléments qu’on peut remplacer ».
Celui qui ne veut pas de leur ordre nouveau sera liquidé ou marginalisé (pas de restau, de magasin, de transport, d’eau, d’électricité). Gheorghiu, futur prêtre orthodoxe, le dit :
« Ceux qui ne respectent pas les lois de la machine, promue au rang des lois sociales, sont punis. L’être humain qui vit en minorité devient, le temps aidant, une minorité prolétaire ».
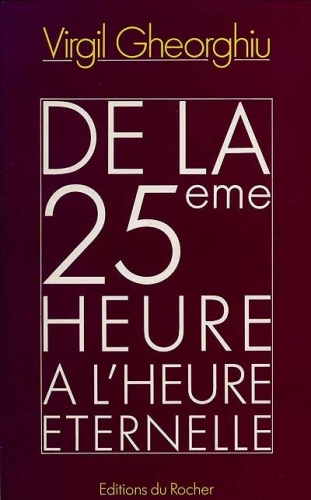
L’humain déshumanisé, Gheorghiu l’appelle le citoyen technique :
« Les esclaves techniques gagneront la guerre. Ils s’émanciperont et viendront les citoyens techniques de notre société. Et nous, les êtres humains, nous deviendrons les prolétaires d’une société organisée selon les besoins et la culture de la majorité des citoyens, c’est-à-dire des citoyens techniques ».
Et comme Chateaubriand Gheorghiu rappelle :
« Dans la société contemporaine, le sacrifice humain n’est même plus digne d’être mentionné. Il est banal. Et la vie humaine n’a de valeur qu’en tant que source d’énergie ».
Et de conclure moins lugubre que réaliste :
« Nous périrons donc enchaînés par les esclaves techniques. Mon roman sera le livre de cet épilogue… Il s’appellera La vingt-cinquième heure. Le moment où toute tentative de sauvetage devient inutile. Même la venue d’un messie ne résoudrait rien. Ce n’est pas la dernière heure : c’est une heure après la dernière heure. Le temps précis de la société occidentale. C’est l’heure actuelle, l’heure exacte ».
Je dis moins lugubre que réaliste car il est temps de voir et de dire que tout cela est au final scientifique et juste, comme disait l’orthodoxe Vladimir Volkoff. Volkoff disait que le bolchévique c’est celui qui en veut plus, idéaliste, progressiste, banquier central, militaire, agent secret ou même journaliste. Le troupeau c’est celui qui n’y croit pas ou ricane et de toute manière se soumet. C’est celui qui en veut moins. C’est le troupeau des citoyens-troyens euphoriques.
Sources :
https://www.amazon.fr/vingt-cinqui%C3%A8me-heure-Virgil-G...
https://www.amazon.fr/DANS-GUEULE-BETE-LAPOCALYPSE-MONDIA...
https://nicolasbonnal.wordpress.com/2024/01/13/monseigneu...
17:33 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : virgil gheorghiu, nicolas bonnal, littérature, littérature roumaine, lettres, lettres roumaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Bernanos et la "masse disponible" des temps totalitaires
Nicolas Bonnal
« Leur soumission au progrès n'a d'égale que leur soumission à l’Etat… »
Bernanos avait rêvé au début, juste après la Libération, et ça donne la France contre les robots, livre qui doit être oublié – même par les ignares et les distraits - car il est dépassé un an ou deux après. Le grand esprit déchante vite (« votre place est parmi nous ! » lui chantait de Gaulle qui part vite aussi) et cela donne ensuite les prodigieuses conférences de « La Liberté, pour quoi faire ? », où le grand esprit pragmatique et non visionnaire remet tout le monde à sa place : la démocratie vaut les dictatures et le christianisme est crevé, surtout celui qui veut se moderniser. On relira mon texte fondamental (je pèse mes mots, car on est en enfer, on y est vraiment) sur Bruckberger qui va plus loin que Bernanos quand il découvre que l’Inquisition est la source et le prototype des méthodes totalitaires modernes.

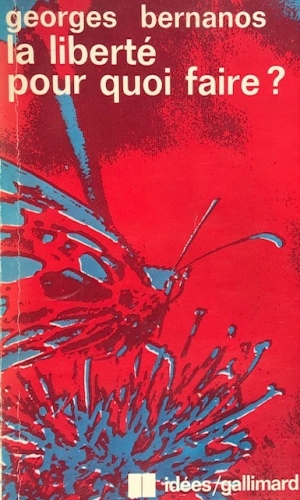
Robert Steuckers m’a appris que j’étais publiquement insulté par certains pour citer Bernanos. C’est un immense plaisir et un intense hommage. Je vais citer au maximum sans commenter, en remerciant encore ma Tetyana qui m’a tout scanné ; on commence par « cette masse affreusement disponible » qui vote pour l’Europe, pour Macron-antifasciste-républicain-humaniste, pour la guerre, pour le vaccin, pour l’Europe, pour l’Otan, pour le mondialisme, pour le Grand Reset, pour le totalitarisme informatique, pour tout.
Or cette masse bascule de Pétain à de Gaulle comme cela, par mouvement mécanique, par mouvement de balancier :
« Il y a des millions et des millions d'hommes dans le monde qui n'ont pas attendu notre permission pour soupçonner que la France de 1940- formée d'une majorité de gaullistes et d'une poignée de pétainistes - ne forme réellement qu'UNE SEULE MASSE AFFREUSEMENT DISPONIBLE, dont l'événement de Munich avait déjà permis de mesurer le volume et le poids, qui s'est retrouvée presque tout entière à l'Armistice pour rouler dans le pétainisme par le seul effet de la pesanteur, jusqu'à ce que l'invasion de l'Afrique du Nord, rompant l'équilibre, l'ait fait choir sur l’autre pente… La masse française, cette masse électorale suicidaire, cherche aujourd'hui à tâtons un autre fait irréparable… Au terme de notre évolution, il ne subsistera de l’Etat qu’une police, une police pour le contrôle, la surveillance, l’exploitation et l’extermination du citoyen (la liberté pour quoi faire ?). »


Et d’ajouter :
« Il y a des millions et des millions d'hommes dans le monde qui n'ignorent plus que la Résistance ayant été l’œuvre d'une poignée de citoyens résolus, qui électoralement ne pouvaient pas compter pour grand-chose, il était fatal que la réorganisation de la Démocratie parlementaire réduisît la Résistance à rien. »

On connait mon admiration pour Stefan Zweig, citoyen du monde et apatride comme moi (les patries ayant toutes été exterminées par l’américanisme il ne reste qu’à se trouver un hôtel – et un bon), qui écrit sur cette masse affreusement disponible dans son inoubliable Monde d’hier : « la masse roule toujours immédiatement du côté où se trouve le centre de gravité de la puissance du moment ». Monde d’hier, Livre de Poche, p. 469 pour les curieux. On ajoute pour les gourmets : « Ceux qui criaient aujourd’hui « Heil Schuschnigg ! » hurleraient demain « Heil Hitler ! ». C’est la page suivante…
Heil Biden ! Heil Davos ! Heil Ursula ! Heil climat !...
On connaît le nombre exorbitant (mais toujours insuffisant) d’homosexuels dans nos élites françaises, européennes et mondialistes. Zweig ajoute cette note page 365 :
« Déjà les sociétés secrètes fort mêlées d’homosexuels étaient plus puissantes que ne le soupçonnaient les chefs de la république… ».
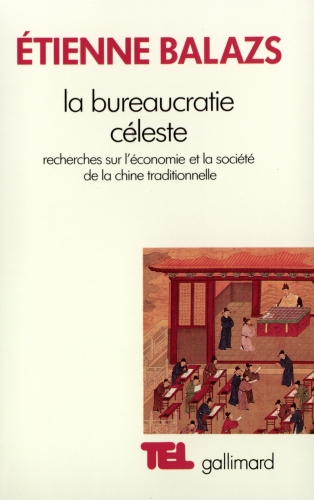
On relira mes textes sur Zweig et sur les eunuques de Balasz qui dans la Chine ancienne drivaient déjà une économie et une société totalitaires (on ne pouvait ni marcher ni se vêtir comme on voulait, comme au temps du Covid et du changement climatique…). Voir La bureaucratie céleste, Tel, Gallimard, pp. 36-37, 73-75., où Balasz décrit des guerres d’extermination eunuques de proportions… bibliques. La brave Chine des Brics est le modèle de Fink et de Davos.
Bernanos n’aime pas qu’on le dise pessimiste (le terme est insultant, c’est vrai) ; mais voici ce qu’il écrit sur l’optimiste :
« L'optimisme est un ersatz de l'espérance, dont la propagande officielle se réserve le monopole. Il approuve tout, il subit tout, il croit tout, c'est par excellence la vertu du contribuable. Lorsque le fisc l’a dépouillé même de sa chemise, le contribuable optimiste s'abonne à une revue nudiste et déclare qu’il se promène ainsi par hygiène, qu'il ne s'est jamais mieux porté. »
Sur le pessimisme :
« Le mot de pessimisme n'a pas plus de sens à mes yeux que le mot d'optimisme, qu'on lui oppose généralement. »
Le problème, le vrai problème c’est la dévaluation du matériel humain ; et là Bernanos surprend avec des arguments… en or massif (Zweig en parle aussi au début de ses mémoires) :
« Les événements n'ont pas plus de volume qu'avant, ce sont les hommes qui sont dévalués. La dévaluation de l’homme est un phénomène comparable à celui de la monnaie. N'attendez pourtant pas que les dévalués conviennent de leur dévaluation! Si le billet de mille francs pouvait parler, il dirait que le bifteck est devenu aussi précieux que l'or, il n'oserait jamais avouer que c'est lui qui ne vaut plus que cent sous. Ainsi les hommes dévalués préfèrent se venger sur l'histoire de leur dévaluation. Ils sont de plus en plus enclins à nier l’histoire, à ne voir en elle que l'ensemble des fatalités historiques... »

La fin de l’étalon-or a signifié pendant la guerre la tuerie interminable : le citoyen ne valait plus rien et l’Etat pouvait imprimer et exterminer tout ce qu’il voulait.
La fin des hommes c’est la Révolution Française, et la conscription par la Convention :
« En décrétant la conscription obligatoire, la Convention nationale a trahi la civilisation et fondé le monde totalitaire. Dès qu'il suffit d'un décret pour que tous les citoyens appartiennent à l'Etat, pourquoi ne lui appartiendraient-ils pas toujours, de la naissance à la mort ? ».

Le problème c’est qu’il en est tout content le citoyen : comme dit Tocqueville : il faut enlever et la peine de vivre et le trouble de penser ! C’était déjà fait longtemps avant la télé, notez. L’imprimerie, toujours…
Le combat contre l’homme et la liberté est le même partout, derrière les slogans (« tu es à la solde de Wall Street et du mikado ! ») :
« Tout homme qui pense a compris que l’Amérique et la Russie s'opposent plus économiquement qu'idéologiquement, une nation de trusts est toujours menacée de devenir brusquement totalitaire. La Russie s’emploie de plus en plus à créer un type d'ouvrier à grand rendement aussi semblable que possible à l'ouvrier… »
Les extrêmes (d’ailleurs jamais si éloignés que cela, on l’a vu au moment de notre « pandémie ») ont vite fait de se rejoindre :
« Car ce monde n'est pas nouveau. Capitaliste ou marxiste, libéral ou totalitaire, il n'a cessé d'évoluer vers la centralisation et la dictature. Le régime des trusts ne saurait nullement s'opposer au collectivisme d'Etat, puisqu'il n'est qu'une phase de l'évolution que je dénonce. »
On se demande si Bernanos aurait fini libertarien (Chesterton était considéré comme un chrétien-libertarien, mais vous imaginez un parti ?) : no state, no war, no taxes, comme disent nos amis de lewrockwell.com. Trop simple ou trop évident ?
La course au gigantisme :
« Les trusts ont concentré peu à peu la richesse et la puissance autrefois réparties entre un très grand nombre d'entreprises, pour que l'Etat moderne, le moment venu, distendant sa gueule énorme, puisse tout engloutir d'un seul coup, devenant ainsi le Trust des Trusts, le Trust-Roi, le Trust-Dieu... Non, ce monde n'est pas nouveau. »
Répétons qu’on est en enfer :
« Qui peut croire ce monde digne d'amour? A quoi bon aimer ce qui s'est voué soi-même à la haine ? Dieu n'y réussit même pas, il se résigne à laisser subsister l'enfer. Le Fils de Dieu est mort et on pourrait dire que l'enfer survit au Fils de Dieu. Oh! vous pouvez parfaite trouver scandaleux de m'entendre comparer le monde moderne à l'enfer. Mais c'est là une impression que n'ont pu manquer d'avoir les habitants de Nagasaki, à moins que le temps hélas ! ne leur ait fait défaut pour cela. »

Car le lendemain de la guerre, rebelote avec déjà le plan Monnet :
« La France a des raisons de ne pas s'enthousiasmer pour le plan Monnet! On lui demande de construire des machines, encore plus de machines, de se sauver par la machinerie. Elle ne croit plus à la multiplication indéfinie des machines… »
Pierre Gille (d’ailleurs écarté depuis) remarque dans son excellente préface :
« Bernanos attendait de la Libération de la France une insurrection des forces de l’esprit… Et que voit-il, ce même monde recommencé comme si rien ne s’était passé… ».
C’est qu’il a ses adeptes ce monde religieusement adoré de l’américanisme. Céline parle dans des pages immortelles des Français parfaitement enthousiastes, Bernanos des amateurs de radiations (elles les rendent radieux !) :
« Supposez que demain - puisque nous sommes dans les suppositions, restons-y - les radiations émises sur tous les points du globe par les usines de désintégration modifient assez profondément leur équilibre vital et les sécrétions de leurs glandes pour en faire des monstres, ils s'arrangeront très bien de leur condition de monstres, ils se résigneront à naître bossus, tordus, ou couverts d'un poil épais comme les cochons de Bikini, en se disant une fois de plus qu'on ne s'oppose pas au progrès. Le mot de progrès sera le dernier qui s'échappera de leurs lèvres à la minute où la planète volera en éclats dans l'espace. »
Et dans ce monde, comme au moment du refus du vaccin nocif et inutile l’homme libre sera le monstre à abattre:
« La menace qui pèse sur le monde est celle d'une organisation totalitaire et concentrationnaire universelle qui ferait, tôt ou tard, sous un nom ou sous un autre, qu'importe ! de l'homme libre une espèce de monstre réputé dangereux pour la collectivité tout entière, et dont l’existence dans la société future serait aussi insolite que la présence actuelle d'un mammouth sur les bords du lac Léman. Ne croyez pas qu'en parlant ainsi je fasse seulement allusion au communisme. Le communisme disparaîtrait demain, comme a disparu l'hitlérisme, que le monde moderne n'en poursuivrait pas moins son évolution vers ce régime de dirigisme universel auquel semblent aspirer les démocraties elles-mêmes. »
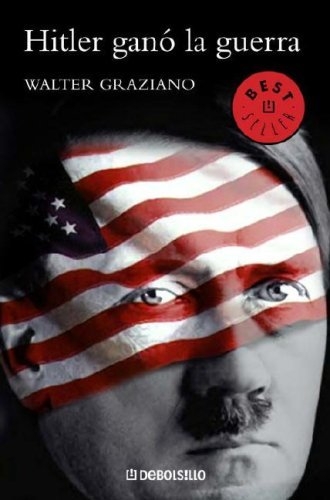
En 45, Hitler a gagné la guerre (voyez l’amusant livre homonyme de Graziano). Schwab et Ursula y mettront bon ordre :
« Il est clair qu'il reste partout des foyers d'infection totalitaire dans le monde. Le totalitarisme a été battu grâce à ses propres méthodes, par des méthodes totalitaires… Les dictatures ont été les symptômes d'un mal universel, dont souffre toute l'humanité. La civilisation des machines a considérablement amoindri dans l’homme le sens de la liberté. Les disciplines imposées par la technique ont peu à peu sinon ruiné, du moins considérablement affaibli les réflexes de défense de l’individu contre la collectivité. »
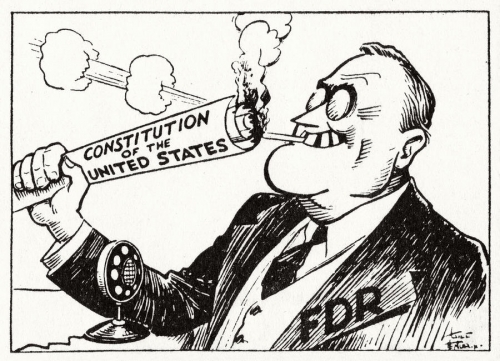
On sait que tout passe par le contrôle de l’Etat, surtout aux USA, pays du simulacre libéral, et ce depuis Wilson et Roosevelt et leurs guerres totalitaires contre l’Allemagne:
« La plupart des démocraties, à commencer par la nôtre, exercent une véritable dictature économique. Elles sont de véritables dictatures économiques. La dictature économique survit presque partout aux nécessités de la guerre, par lesquelles on prétendait la justifier. Il serait difficile de nier que le cadre de l'activité économique… »
Ensuite Bernanos se rapproche du banc des accusés (ben oui…) :
« On voudrait nous faire croire que l'Etat nazi fut une sorte de monstre imprévu, imprévisible, un phénomène absolument fortuit, une espèce de chose tombée de la lune. Mais cet État hitlérien ne différait pas spécifiquement de certains Etats modernes prétendus démocratiques, en voie d'évolution vers la forme totalitaire et concentrationnaire. Démocratique ou non, l'Etat moderne a économiquement tous les droits. »
Je le disais libertarien ? Voyez là :
« Lorsqu'un État prétend disposer, en certains cas, de 83 % du revenu du citoyen, contre la promesse, d'ailleurs toujours révocable, de lui garantir ce qui lui reste, on a bien le droit de se demander où s'arrêteront ses prétentions. Qui dispose des biens finit toujours par disposer un jour des personnes. »
Confiscation de l’épargne, du corps (soumis à la tyrannie vaccinale, voyez Kennedy), des maisons, de la liberté de se déplacer, demandez le programme !
A la fin on comprend que l’Etat et les partis (presque tous libéraux ou socialos) qui le contrôlent ne rêvent que d’une chose: la grande et belle extermination du citoyen-électeur distrait.

« Et cette bureaucratie, chez les plus atteints, se décomposait elle-même jusqu'à la forme la plus dégradée de la bureaucratie, qui est la bureaucratie policière. Au terme de cette évolution, il ne subsiste de l'État qu'une police, une police pour le contrôle, surveillance, l'exploitation et l'extermination du citoyen. »
Dans ce désastre il ne faut rien attendre des chrétiens (pour ceux qui auraient encore des doutes) ; ici aussi le matériel humain a été dégradé, édulcoré ou autre:
« Des chrétiens sans cervelles, de pauvres prêtres sans conscience, épouvantés à l'idée qu'on va les traiter de réactionnaires, vous invitent à christianiser un monde qui s'organise délibérément, ouvertement, avec toutes ses ressources, pour se passer du Christ, pour instaurer une justice sans Christ, une justice sans amour, -la même au nom de laquelle l’Amour fut fouetté de verges et mis en croix. »
Pour terminer une magnifique remarque : on dégénère en s’endurcissant.
« Le drame de l'Europe, le voilà. Ce n'est pas l'esprit européen qui s'affaiblit ou s'obscurcit depuis cinquante ans et plus, c'est l'homme européen qui se dégrade, c'est l’humanité européenne qui dégénère. Elle dégénère en s'endurcissant. Elle risque de s'endurcir au point d'être capable de résister à n'importe quelle expérience des techniques d'asservissement, c'est-à-dire non pas seulement de les subir, mais de s'y conformer sans dommage. »
Allez, cessons de déprimer : on a eu l’euro-foot, on a les JO et un gouvernement technocrate ; on a évité le fascisme et on va pouvoir construire une Europe plus juste, plus verte et encore plus remplacée. Ensuite on déclarera la guerre à Trump et (encore plus) à la Russie.
Sources:
https://www.amazon.fr/libert%C3%A9-pour-quoi-faire/dp/207...
https://strategika.fr/2020/09/08/observations-sur-le-deve...
https://strategika.fr/2021/06/12/a-la-lumiere-du-covid-st...
https://www.amazon.fr/grands-auteurs-traditionnels-Contre...
https://www.amazon.fr/Bureaucratie-c%C3%A9leste-Recherche...
https://www.dedefensa.org/article/bruckberger-et-labdicat...
https://www.dedefensa.org/article/stefan-zweig-contre-lam...
18:45 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, georges bernanos, totalitarisme, lettres, littérature, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 474 du Bulletin célinien
 Sommaire:
Sommaire:
Un Céline méconnu
Pour saluer Bernard Pivot
Écrire contre Céline
Montaigne dans Voyage au bout de la nuit.
Le monde littéraire est féroce. Le perspicace Jérôme Dupuis a rappelé que pendant des années Philippe Sollers (1936-2023) s’est targué d’avoir été l’un des grands artisans de la réhabilitation de l’auteur de Voyage au bout de la nuit ¹. Voire… Il y a quinze ans est sorti un recueil de tous les textes qu’il a consacrés à Céline depuis le début de sa carrière. Après un bref texte paru en 1963 dans le légendaire Cahier de l’Herne, il faut attendre… 1991 pour lire un nouveau texte de lui sur le sujet. Or, précise malignement Dupuis, la grande période de traversée du désert, ce furent les années 60, 70 et 80, où Sollers jugeait plus urgent de célébrer Lacan, Mao ou Casanova. Semblant devancer cette critique, Sollers concède, dans ce recueil, que « [sa] lecture de Céline aura été permanente, avec des hauts et des bas, en fonction de ce vers quoi [l’]entraînaient [sa] curiosité et [ses] passions du moment. »² Si Sollers n’a effectivement rien écrit sur le sujet durant ces années, il ne manqua pas de défendre l’écrivain à chaque fois qu’il fut sollicité. Ce fut notamment le cas en 1965 lorsque Le Nouvel Observateur lança une enquête sur Céline.

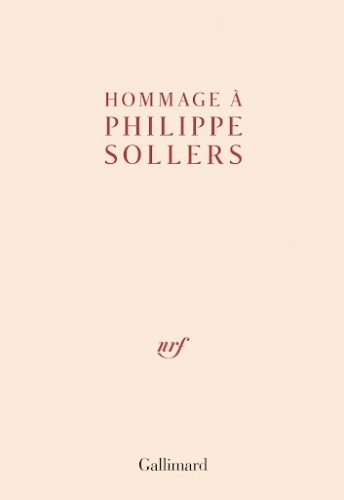
Sollers s’y exprimait aux côtés d’Aragon, Vailland, Nadeau, Barthes, Butor et d’autres : « Les livres qui m’intéressent sont les derniers qu’il ait écrits. Les plus importants sur le plan de la technique (…). Les points de suspension, cette confluence permanente entre la parole et l’écriture, tout cela est très moderne. » Ou en 1976 dans l’émission “Une légende, une vie” diffusée sur la deuxième chaîne de la télévision française. Je me souviens aussi de sa défense de l’écrivain, plus tardive, face à un hâbleur qui avait commis un consternant factum contre Céline. Souvenir moins plaisant : dans sa revue Tel quel, au mitan des années soixante, il lâcha les chiens sur Dominique de Roux, pourtant auteur d’un livre inspiré sur le natif de Courbevoie³.
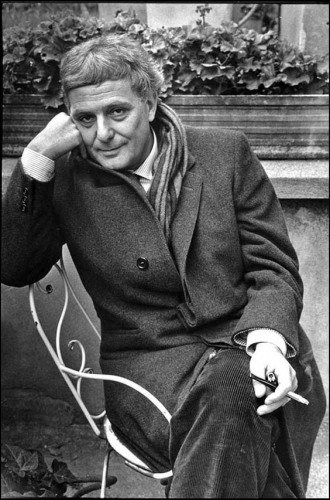
Dix ans plus tard, Marc Hanrez, ami de l’un et de l’autre, fut sur le point de les réconcilier. La mort prématurée du fondateur de L’Herne empêcha cette rencontre. C’était l’époque où Sollers avait pris ses distances avec ce qu’il appelait ses « engagements extrémistes ». Comme on sait, ils trouvèrent leur acmé avec ce maoïsme aussi échevelé que fol. Sans doute serait-il malvenu à un admirateur de Céline de tancer ce genre de dérive. Lorsqu’on lui rappelait ses textes délirants sur Mao, il s’en sortait par une pirouette en disant qu’il s’agissait de « poèmes » (!).
Quant au racisme célinien, il le qualifiait de « biologisme » en totale contradiction avec le génie de l’écrivain. Et d’ajouter que, pour le maoïste qu’il était, « il y avait beaucoup de Chine dans Rigodon ». Si pendant trois décennies Sollers ne l’a guère défendu, c’est sans doute parce qu’il ne voulait pas être associé à cette droite qui défendait Céline mordicus alors même que lui s’activait à l’extrême gauche. Le temps où Libération lui consacrera un supplément d’une douzaine de pages n’était pas encore venu4. Aujourd’hui l’écrivain est indéboulonnable et il est incontestable que Sollers fut l’un de ses exégètes les plus sagaces.
• Ouvrage collectif, Hommage à Philippe Sollers, Gallimard, 2023 (12 €).
Signalons la création d’un groupe sur facebook, « La Closerie de Sollers », fondé par Yannick Gomez.
20:41 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philoppe sollers, louis-ferdinand céline, revue, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
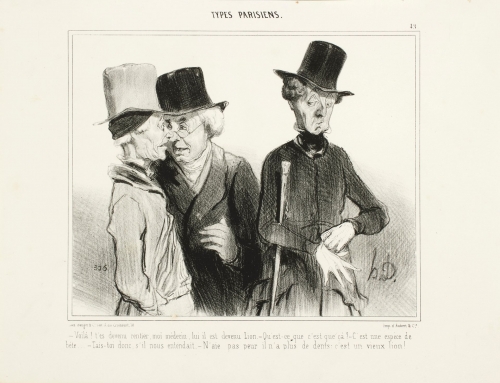
Bons à rien et prêts à tout: voici les modérés (qui ne sont pas les conservateurs)
Gennaro Malgieri
Source: https://electomagazine.it/buoni-a-nulla-e-disposti-a-tutto-ecco-i-moderati-che-non-sono-i-conservatori/
Nous sommes assiégés par les "modérés". Réels ou supposés. Mais indéfinissables dans l'absolu. Chacun se définit à sa manière et décline cette catégorie intangible comme il l'entend. C'est aussi une façon d'être "modéré": ne pas avoir de caractère établi et reconnu. Et au final, il n'est pas irréaliste de penser que les "modérés" sont les femelles de la politique: ils souhaitent être soumis à une violence agréable. "L'idée d'être sauvées par un adversaire est toujours dans leur cœur".
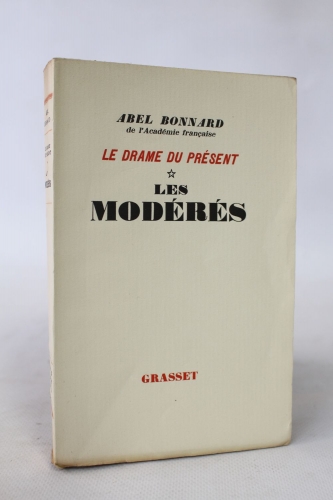
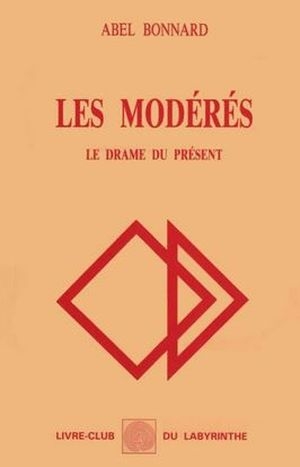
Ainsi s'exprimait Abel Bonnard (1883-1960), universitaire, poète, romancier, essayiste et homme politique français qui publia en 1936 Les modérés, livre publié en Italie en 1967 par l'éditeur Volpe et ensuite oublié. Pourtant, à sa sortie, il suscita curiosité et discussion: pour la première fois, il diagnostiquait un "symptôme" (pour ne pas dire un "mal") du siècle qui allait se répandre surtout dans l'après-guerre dans toute l'Europe et en particulier dans les pays les plus fragiles, comme l'Italie, où elle allait connaître les fastes du pouvoir incarné par des partis politiques qui, comme l'écrit Stenio Solinas dans la brillante préface de la nouvelle édition italienne des Modérés (Oaks editrice, pp.178, 14,00 €), se sont référés à la catégorie des "modérés" pour représenter "cette bourgeoisie moyenne qui espère la révolution parce qu'elle n'ose plus croire à la conservation".

Abel Bonnard.
Telle est la donnée culturellement et anthropologiquement décisive qui caractérise le modérantisme: son aversion pour le conservatisme, auquel il a aussi été assimilé à tort par les habituels benêts qui manipulent les idées comme s'il s'agissait d'eau et de farine, sans même imaginer que pour faire fructifier des éléments essentiels et primaires, il faut les faire lever.
Et les conservateurs ont été et sont le levain des sociétés ordonnées: quand on croit pouvoir s'en passer, voici que le modérantisme se substitue à eux et devient l'avocat d'une sauvagerie politique qui n'a rien à voir avec la tendance naturelle à soutenir l'organicité communautaire et, par conséquent, une agrégation civile et cohésive. Solinas note d'ailleurs que le "conservatisme impossible" en Italie provient précisément de l'incompréhension du fait que les modérés ne s'identifient pas aux conservateurs. Pour en venir à aujourd'hui, Solinas observe que "les modérés de Berlusconi se définissent comme des réformateurs et accusent la gauche de conservatisme, et les modérés de l'Ulivo puis du PDD se définissent comme tels contre l'extrémisme de leurs adversaires... Et, en somme, les conservateurs sont toujours les autres".
Mais alors, qui sont les modérés? Abel Bonnard les voit constitués en parti, un parti imaginaire ou idéal si l'on veut, "semblable à une ampoule d'eau pure, dans laquelle le profane ne voit qu'un objet insignifiant, mais où le devin intentionné voit mille scènes du passé et de l'avenir".

Lors des campagnes électorales, se souvient Bonnard, parmi les maisons fouettées des petites villes, les affiches des candidats modérés étaient celles qui entraient le moins en conflit avec l'environnement, la douceur du contexte : "Tous les mots ronflants y apparaissaient, mais comme des cadavres jetés sur une pierre tombale ; aucun ne conservait sa propre vertu. On y parlait d'ordre, sans jamais indiquer de principes ni de conditions ; de progrès, avec une volonté évidente de ne pas bouger ; de liberté, mais pour éviter toute discipline ; le seul mot de patrie impliquait des obligations acceptées avec sincérité et parfois même avec courage". Et au Parlement ? "Les modérés, se souvient Bonnard, apparaissaient comme un ramassis d'indécis, et leurs têtes tournaient au vent des discours, comme des girouettes au sommet des cheminées, obéissant à tous les zéphyrs. Ils semblaient toujours avides d'un malentendu qui leur permettrait de rattraper leurs adversaires. A la moindre phrase d'un ministre, qui ne les traitait pas trop dédaigneusement, ils l'applaudissaient avec enthousiasme. Si, par contre, l'un d'entre eux parlait en leur nom avec une certaine vigueur, ils se détournaient rapidement de lui, l'abandonnaient par leur silence, avant de l'abandonner à l'ennemi avec les "lignes de couloir".

L'attitude des modérés n'a pas beaucoup changé depuis 1936. Il faut avoir siégé au parlement au cours des dernières décennies pour confirmer l'expérience de Bonnard. Le portrait semble sortir de la plume d'un chroniqueur contemporain. Sans parler de l'esquisse morale dont l'écrivain français n'imaginait même pas qu'elle aurait pu traverser les époques et s'adapter au nouveau siècle où le modérantisme, loin de ne représenter rien de politiquement pertinent, est en réalité l'absence de sentiment politique auquel certains se raccrochent pour justifier leur présence dans la vie.
Bons à rien mais prêts à tout, les modérés que l'on voit pulluler dans les palais du pouvoir ont toujours l'air d'être sur le point de dire quelque chose de fondamental, d'incontournable, d'inévitablement intelligent. Ils sont devenus, sans le vouloir probablement, la colonne vertébrale du système politique qui, dans ses différentes composantes, est désormais modéré par habitude.
Regardez-les bien, ce sont des extrémistes prêts à tout et qui n'ont rien à voir avec la modération: "elle, dit Bonnard, est aux antipodes de ce qu'ils sont... la vraie modération est l'attribut du pouvoir : il faut y reconnaître la plus haute vertu de la politique". Elle marque le moment solennel où la force devient capable de scrupules et se tempère selon la conception de l'ensemble dans lequel elle intervient". On peut dire que ces mots sont sortis de la bouche d'Edmund Burke dans l'un de ses célèbres discours au Parlement de Dublin. Ce sont celles d'un universitaire modéré qui ne pensait pas offrir, il y a quatre-vingts ans, avec son traité politico-moral, des conseils pour reconnaître un type humain qui, hélas, sévit dans la vie publique, inondant malheureusement jusqu'à nos vies privées.

Pour tempérer ce malheur, il ne serait peut-être pas inutile de relire - puisque tout le monde est essentiellement "modéré" - l'essai en or de Simone Weil, Contro i partiti (Piano B edizioni, pp.125, €12.00), qui vient d'être réédité, dans lequel la grande essayiste française qui eut une vie brève (1909-1943) et à la pensée longue et intense, analyse impitoyablement l'inadéquation des partis et leur tendance intrinsèque au conformisme pour conclure que "le parti ne pense pas", mais crée des consensus et des passions collectives. Rédigé quelques mois avant sa mort, Weil aurait ajouté, si elle avait eu le temps de voir comment ils se réorganisaient après la guerre, que les partis sont aussi des vecteurs de corruption ; pas toujours et pas tous, bien sûr. Leur tendance à s'immiscer dans l'administration publique, cependant, n'oublions pas qu'elle a été prévue et dénoncée par Marco Minghetti dans la seconde moitié du XIXe siècle, alors que le processus du Risorgimento était en train de s'achever politiquement.
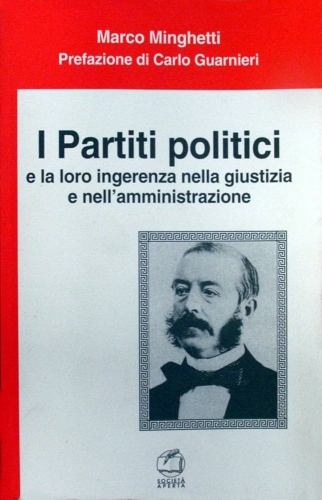
Weil affirme que le problème politique le plus urgent auquel sont confrontés les partis est double: comment offrir au peuple la possibilité d'exprimer une opinion sur les grandes questions collectives d'une part, et d'autre part, comment éviter que ce même peuple, une fois interrogé, ne soit imprégné et donc conditionné par une quelconque passion collective. Une réflexion très actuelle. Il suffit de lire les considérations sur le besoin de démocratie directe soulevé en France par l'écrivain Michel Houllebecq. L'élimination de la médiation des partis pourrait-elle favoriser le besoin exprimé par Simone Weil (et plus tôt encore en Italie par Giuseppe Rensi, pour ne citer qu'un intellectuel qui a posé très tôt le problème de la démocratie, en notant toutes les apories liées à la production du consensus) ? La réponse n'est pas simple. Mais que les partis traversent (comme le supposait l'écrivain français) une phase de crise profonde est incontestable.

Certes, un parti est une machine à fabriquer de la passion collective ; c'est une organisation construite de manière à exercer une pression sur la pensée de chacun ; son but exclusif est sa propre croissance, "sans aucune limite". Et alors ?
Weil n'indique pas d'issue. Mais elle offre une plate-forme sur laquelle articuler une nouvelle pensée politique qui dépasse la médiation des partis. Méfions-nous de ceux qui rejettent tout avec l'anathème du "populisme". Cette lecture autorise également les pages de Weil. Elle conclut, non sans raison, que presque partout "l'opération de prise de parti, de prise de position pour ou contre, a remplacé l'obligation de penser. Cette lèpre a pris racine dans les milieux politiques et s'est étendue à la quasi-totalité du pays".
Comment en finir avec cette lèpre ? Qui sait, peut-être en battant en brèche le tabou du "modérantisme" qui, comme une subtile tentation totalitaire, voudrait que tous les partis s'alignent sur la pensée unique. A bien y regarder, Abel Bonnard et Simone Weil n'étaient pas si éloignés que leurs histoires le laissent entendre.
14:16 Publié dans Littérature, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, abel bonnard, simone weil, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, modérés, modérantisme, théorie politique, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

La magie noire des dystopies
Ayhan Sönmez
Une prophétie auto-réalisatrice est une prophétie qui se réalise en tant que cause et effet direct de l'apprentissage de la prophétie en premier lieu. Un joueur à qui un diseur de bonne aventure a dit qu'il allait gagner un match se sent soudain beaucoup plus détendu par rapport à l'issue du match et joue donc mieux et gagne. L'effet placebo d'un médicament, c'est-à-dire l'effet du médicament résultant de la croyance psychologique du patient en son efficacité, est un autre exemple de prophétie autoréalisatrice. Ces prophéties ne sont pas des preuves de magie, mais plutôt de l'influence puissante de l'esprit sur les événements extérieurs ; croire en quelque chose est un pas vers sa réalisation.
De même que les événements d'une vie sont liés à la psyché, les événements d'une société, d'une civilisation dans son ensemble, sont liés à une psyché collective ou, comme l'a écrit Carl Jung, à l'inconscient collectif. Il ne s'agit pas d'un phénomène philosophique compliqué ; tout cela montre que nous sommes tous influencés les uns par les autres, et les influences collectives qui en résultent sont appelées forces sociales, qui orientent les tendances de la mode, de l'art, de la philosophie et des modèles de gouvernement. Ce qu'un membre de la société considère comme une "idée normale" à un moment donné est en fait sa connexion avec l'inconscient collectif, avec les forces sociales invisibles qui lui disent que c'est normal. Il ne sait pas consciemment comment il est arrivé à cette idée, mais il en est inévitablement convaincu, à moins qu'il ne se distancie de la société d'une manière suffisamment significative pour s'extraire de l'inconscient collectif. Mais on pourrait aussi dire que cet isolement est une condition préalable pour tous les philosophes sérieux.
L'inconscient collectif est un système vivant qui relie les gens dans son réseau. La forme de transmission la plus importante dans ce système est, et a toujours été, l'histoire. Les histoires racontées au coin du feu, écrites dans des romans, des chansons, des poèmes, entendues à la radio et, plus récemment, vues dans des séries Netflix, sont les méthodes par lesquelles les idées importantes sont transmises d'une personne à l'autre et, partant, "normalisées". Lorsque vous voyez un couple gay élever un bébé asiatique en vue de son adoption dans Modern Family, vous commencez à penser qu'il est normal que deux hommes se marient et fondent une famille. Ainsi, au lieu d'être inclus dans ce système de pensée, vous devez choisir d'en rester à l'écart. Oui, oui, il est nécessaire de rappeler les mécanismes de base de la propagande et d'en expliquer les fondements. Commençons par Black Mirror, par exemple.
L'utopie n'existe pas et, tout au long de l'histoire, de nombreuses personnes ont tenté d'imaginer un monde parfait. C'est un excellent exercice pour un esprit imaginatif et profond, car il vous oblige à cesser de vous plaindre et à commencer à imaginer, aussi minutieusement que possible, à quoi ressemblerait un monde meilleur. Cet exercice est puissant car l'esprit trouve involontairement des solutions à de nombreux problèmes fondamentaux auxquels la société est confrontée. La dystopie est une version de l'utopie. Le but de l'écriture d'une dystopie est de décrire un monde terrible. Il s'agit fondamentalement d'une entreprise nihiliste, car elle commence par poser la question suivante : "À quoi ressemblerait le monde si tout allait mal ?".

En termes de dystopie, le Meilleur des mondes d'Aldous Huxley est célèbre. Il s'agit de l'histoire d'un monde futur caractérisé par une dégénérescence sexuelle totale et l'effondrement de la structure familiale. Chaque individu naît d'un utérus artificiel et est assigné à une classe en fonction du niveau d'alcool auquel il a été exposé in utero. La devise est "tout le monde appartient à tout le monde". Le sexe est l'assouvissement de la luxure, rien d'autre. L'amour, l'engagement, l'art, l'émotion n'existent pas. Chaque individu de la société doit prendre du "Soma", une drogue qui empêche les émotions de devenir un problème. Un autre livre, 1984 de George Owell... Une société dans laquelle l'histoire est constamment modifiée pour s'adapter aux tendances politiques modernes. Quiconque se souvient de la vérité et ne se conforme pas à la nouvelle réalité est sévèrement puni par l'État. Si cela vous semble étrangement proche du monde moderne, vous n'avez pas tort. Les éléments de ces histoires sont si semblables au monde moderne que c'est comme s'ils avaient eu l'idée de ces choses directement à partir de ces romans. C'est comme si les méchants utilisaient ces romans comme des manuels d'instruction.

Aldous Huxley et George Orwell étaient-ils des génies brillants dont la clairvoyance les a conduits à écrire de grandes œuvres littéraires ? C'est possible. Mais le génie n'est pas une garantie de sagesse ou de moralité. Toute personne ordinaire lisant ces histoires conclura que les mondes qu'elles dépeignent ne sont pas des mondes dans lesquels on voudrait vivre. Mais en décrivant et en articulant ces horreurs avec tant de détails, les auteurs, aussi bien intentionnés soient-ils, ont déjà ouvert la boîte de Pandore. Il est fort probable qu'ils aient contribué à créer ces mondes en écrivant ces histoires.
L'énergie humaine est une ressource extrêmement précieuse. Les agences de publicité l'ont déjà compris et convertissent chaque jour l'attention humaine, la colère, etc. en argent réel et en profit. L'énergie humaine est ce qui donne à un artiste sur scène l'immense frisson que de nombreux acteurs ressentent à la fin d'une représentation. L'énergie humaine est une force puissante, et lorsqu'elle est dirigée, même par la peur, pour se concentrer intensément sur des choses très spécifiques, elle peut les faire naître. Il ne s'agit pas nécessairement d'une discussion purement surnaturelle. Penser à quelque chose de spécifique signifie que vous en parlez avec des gens ; les idées affluent dans vos exemples, vos références, vos allusions et finalement dans vos idées originales sur la façon d'organiser le monde. Il ne s'agit pas de décisions conscientes. On dit que ces idées font partie de l'inconscient et qu'elles opèrent à ce niveau, tant au niveau individuel que culturel. La popularité des livres de Huxley et d'Orwell a eu l'effet inverse de celui d'empêcher l'avenir qu'ils annonçaient ; en fait, ils l'ont fait naître.
La prière est également puissante parce qu'elle concentre l'énergie et l'attention de l'homme sur quelque chose de vrai, d'important et de bon. Par un mécanisme similaire à celui décrit ci-dessus, la prière régulière fait également passer des idées importantes dans l'inconscient et les y solidifie, alimentant ainsi le reste de nos pensées, actions et motivations inconscientes tout au long de la journée. La répétition et la poésie constituent un élément important de la prière, car c'est ainsi que les idées pénètrent le plus efficacement dans l'inconscient. C'est pourquoi il est très dangereux que la dystopie prenne la forme d'œuvres d'art et de littérature : Il s'agit d'utiliser la méthode puissante de la modélisation de l'inconscient, mais de le faire dans un but néfaste.

On peut en dire autant des programmes télévisés actuels tels que Black Mirror, qui montrent des choses horribles comme la façon dont nous pouvons torturer les gens en les plaçant dans des simulations qui leur donnent l'impression d'être en isolement dans leur cerveau pendant des décennies en une minute. On y voit des gens dont le cerveau est équipé de puces informatiques qui enregistrent tous les événements de la vie humaine et qui sont ensuite obligés de montrer toutes les "séquences" de leur vie avant d'être autorisés à faire des choses comme contracter un prêt ou monter à bord d'un avion. Même le célèbre film Matrix est une histoire dystopique de personnes qui vivent dans des capsules et passent toute leur vie dans une simulation de la réalité, tandis que leurs corps réels sont pétrifiés dans un purgatoire vivant. Étant donné que les humains sont utilisés comme des batteries vivantes pour les extraterrestres, même les auteurs de Matrix ont compris, à un certain niveau, le pouvoir de l'énergie humaine.

Beaucoup de gens aiment Matrix, Black Mirror, Huxley et Orwell. Ils pensent que ces dystopies nous "mettent en garde" contre les dangers de l'abandon de la morale, de la nature, de la religion et de l'humanité. Mais que s'est-il passé depuis que ces œuvres ont été introduites dans la société ? Elles n'ont pas seulement agi comme des prophéties, elles ont en fait réalisé leurs explications, puisqu'elles nous enseignent comment créer ces réalités cauchemardesques. Elles nous ont fourni le vocabulaire et le matériel linguistique nécessaires pour décrire ces cauchemars, ce qui constitue la première étape de leur construction. Dieu a utilisé la parole pour faire naître le monde. À l'instar de Dieu, les auteurs de dystopies utilisent leurs mots pour faire naître des dystopies.
De même que le toucher d'une plaie peut provoquer un plaisir masochiste pervers, ou qu'un dépressif en proie à une douleur intense peut ressentir l'extase de se couper la jambe avec un couteau, les dystopies sont une forme d'automutilation d'un inconscient collectif de plus en plus nihiliste. Quand on n'a plus d'espoir pour l'avenir, s'appuyer sur la peur et la douleur en imaginant les pires tortures imaginables pour l'humanité peut être une délicieuse extase, peut-être comme une façon de se détruire, de se punir. Il est toujours plus facile de se punir que de chercher à améliorer la situation de quelque manière que ce soit. L'apitoiement sur soi est toujours plus approprié que l'amélioration de soi.

Rejetez les dystopies. Comme vous l'avez toujours su, vous savez au fond de vous-même qu'il s'agit de magie noire et que vous donnez vie à vos pires cauchemars parce que vous ne voulez pas faire le travail d'un héros. Vous ne voulez pas risquer l'échec, vous essayez d'espérer et vous vous battez pour cet espoir. Mais au lieu de cela, encourageons les parties les plus nobles de nous-mêmes. Rêvons d'utopies. Osons être des héros et réaliser un avenir meilleur. Au lieu de nous allonger dans une capsule et de nous lier à la dystopie, prenons l'épée et battons-nous, en nous libérant de la condamnation de l'échec.
Source : https://adimlardergisi.com/2024/05/17/distopyalarin-kara-buyusu/
14:56 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : dystopie, littérature, lettres, georges orwell, aldous huxley, black mirror, matrix |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Maupassant et la politique moderne
Nicolas Bonnal
C’est dans Les Dimanches d’un Bourgeois, bref roman au ton Audiard. Déjà, nous dit le maître, il faut être fou pour aller voter (cf. Mirbeau à la même époque ou Bloy) :
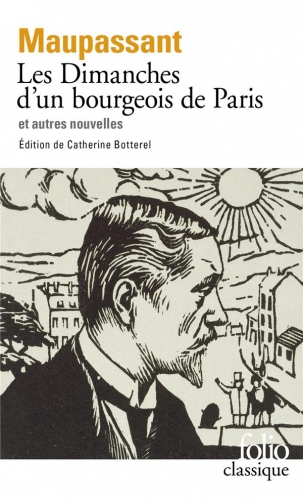 « En effet, livrer des millions d’hommes, des intelligences d’élite, des savants, des génies même, au caprice, au bon vouloir d’un être qui, dans un moment de gaieté, de folie, d’ivresse ou d’amour, n’hésitera pas à tout sacrifier pour sa fantaisie exaltée, dépensera l’opulence du pays péniblement amassée par tous, fera hacher des milliers d’hommes sur les champs de bataille, etc., etc., me paraît être, à moi, simple raisonneur, une monstrueuse aberration. Mais en admettant que le pays doive se gouverner lui-même, exclure sous un prétexte toujours discutable une partie des citoyens de l’administration des affaires est une injustice si flagrante, qu’il me semble inutile de la discuter davantage. »
« En effet, livrer des millions d’hommes, des intelligences d’élite, des savants, des génies même, au caprice, au bon vouloir d’un être qui, dans un moment de gaieté, de folie, d’ivresse ou d’amour, n’hésitera pas à tout sacrifier pour sa fantaisie exaltée, dépensera l’opulence du pays péniblement amassée par tous, fera hacher des milliers d’hommes sur les champs de bataille, etc., etc., me paraît être, à moi, simple raisonneur, une monstrueuse aberration. Mais en admettant que le pays doive se gouverner lui-même, exclure sous un prétexte toujours discutable une partie des citoyens de l’administration des affaires est une injustice si flagrante, qu’il me semble inutile de la discuter davantage. »
Un des personnages (ce sont tous des fonctionnaires) de Maupassant se déclare anarchiste :
« Autrefois, quand on ne pouvait exercer aucune profession, on se faisait photographe ; aujourd’hui on se fait député. Un pouvoir ainsi composé sera toujours lamentablement incapable ; mais incapable de faire du mal autant qu’incapable de faire du bien. Un tyran, au contraire, s’il est bête, peut faire beaucoup de mal et, s’il se rencontre intelligent (ce qui est infiniment rare), beaucoup de bien.
Entre ces formes de gouvernement, je ne me prononce pas ; et je me déclare anarchiste, c’est-à-dire partisan du pouvoir le plus effacé, le plus insensible, le plus libéral au grand sens du mot, et révolutionnaire en même temps, c’est-à-dire l’ennemi éternel de ce même pouvoir, qui ne peut-être, de toute façon, qu’absolument défectueux. »
Puis Maupassant se moque de nos gauchistes immortels (son bourgeois assiste à une réunion politique) :
« Le bureau était au complet. La citoyenne Zoé Lamour, une jolie brune replète, portant des fleurs rouges dans ses cheveux noirs, partageait la présidence avec une petite blonde maigre, la citoyenne nihiliste russe Eva Schourine.
Juste au-dessous d’elles, l’illustre citoyenne Césarine Brau, surnommée le « Tombeur des hommes », belle fille aussi, était assise à côté du citoyen Sapience Cornut, de retour d’exil. Celui-là, un vieux solide à tous crins, d’aspect féroce, regardait la salle comme un chat regarde une volière d’oiseaux, et ses poings fermés reposaient sur ses genoux. »
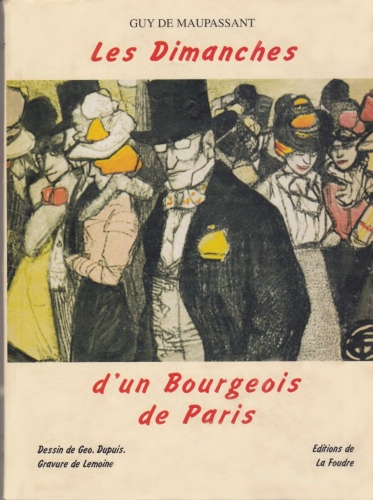
Ce monde progressiste crée des vieilles filles :
« À droite, une délégation d’antiques citoyennes sevrées d’époux, séchées dans le célibat, et exaspérées dans l’attente, faisait vis-à-vis à un groupe de citoyens réformateurs de l’humanité, qui n’avaient jamais coupé ni leur barbe ni leurs cheveux, pour indiquer sans doute l’infini de leurs aspirations. »
Les grands discours sur la servitude féminine commencent :
« La citoyenne Zoé Lamour ouvrit la séance par un petit discours. Elle rappela la servitude de la femme depuis les origines du monde ; son rôle obscur, toujours héroïque, son dévouement constant à toutes les grandes idées. Elle la compara au peuple d’autrefois, au peuple des rois et de l’aristocratie, l’appelant : « l’éternelle martyre » pour qui tout homme est un maître ; et, dans un grand mouvement lyrique, elle s’écria : « Le peuple a eu son 89, ayons le nôtre ; l’homme opprimé a fait sa Révolution ; le captif a brisé sa chaîne ; l’esclave indigné s’est révolté. Femmes, imitons nos despotes. Révoltons-nous ; brisons l’antique chaîne du mariage et de la servitude ; marchons à la conquête de nos droits ; faisons aussi notre révolution. […] »

Chose marrante, dans ce bataclan du verbe et des idées, tout le monde se croit déjà capable de réparer la France, même ceux qui ne sont pas capables de réparer leur montre :
« Pardon, Monsieur, je suis un libéral, moi. Voici seulement ce que je veux dire : Vous avez une montre, n’est-ce pas ? Eh bien, cassez un ressort, et allez la porter à ce citoyen Cornut en le priant de la raccommoder. Il vous répondra, en jurant, qu’il n’est pas horloger. Mais, si quelque chose se trouve détraqué dans cette machine infiniment compliquée qui s’appelle la France, il se croit le plus capable des hommes pour la réparer séance tenante. Et quarante mille braillards de son espèce en pensent autant et le proclament sans cesse. Je dis, Monsieur, que nous manquons jusqu’ici de classes dirigeantes nouvelles, c’est-à-dire d’hommes nés de pères ayant manié le pouvoir, élevés dans cette idée, instruits spécialement pour cela comme on instruit spécialement les jeunes gens qui se destinent à Polytechnique. »
Les classes dirigeantes nouvelles, énarques ou autres, on a donné depuis, merci !
Cerise sur le gâteau, le problème est dans la populace, pas dans les élites qu’elle élit – pis encore, dans la populace déformée par l’école et l’université:
« Des « chut ! » nombreux l’interrompirent encore une fois. Un jeune homme à l’air mélancolique occupait la tribune. Il commença :
Le vieux monsieur répondit :
– Non, Monsieur ; ils sont des millions comme ça. C’est un effet de l’instruction.
Patissot ne comprenait pas.
– De l’instruction ?
– Oui ; maintenant qu’ils savent lire et écrire, la bêtise latente se dégage. »
Il ne les avait pas entendus à la télé ou à la radio ! Dans les réseaux sociaux!
19:36 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guy de maupassant, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

De Zemmour à Malraux (le crépuscule culturel)
Nicolas Bonnal
On va reparler de la liquidation de la France sous De Gaulle. Et c’est Zemmour qui nous a montré la voie dans sa très bonne Mélancolie française que l’on pourrait ainsi définir : une fois qu’on a dépassé le stade de l’inépuisable mythologie française (Vercingétorix-Clovis-Jeanne-Richelieu-Louis-Napoléon-Général-etc.), que reste-t-il de concret ? Dans le même genre curatif il faut redécouvrir le livre d’entretiens de René Girard sur Clausewitz, qui dénonce le désastre napoléonien sur le long terme (Marx n’avait pas suffi…).
On commence par un rappel des extraordinaires Entretiens de Michel Debré: « une impulsion a été donnée pour permettre à Malraux de créer des maisons de la culture, moyennant quoi toutes les maisons de la culture, ou à peu près, sont des foyers d’agitation révolutionnaire (Entretiens, p. 145) ».
Merci de rappeler les origines réelles de mai 68 : elles sont essentiellement culturelles et non conspiratives. Souvent la culture mène au chaos en France (1789-1830-1848…).

Dans sa Mélancolie française, Éric Zemmour évoque courageusement le caractère méphitique de la politique culturelle de Malraux. Et cela donne, sur fond d’étatisme culturel-financier et de messianisme cheap (France, lumière du monde, terre de la liberté, etc.):
« En 1959, le général de Gaulle offrit à son « génial ami », André Malraux, un ministère de la Culture à sa mesure, sur les décombres du modeste secrétariat aux Beaux-Arts de la IVe République. Dans l’esprit de Malraux, la France devait renouer avec son rôle de phare révolutionnaire mondial, conquis en 1789 et perdu en 1917 ; devant en abandonner les aspects politiques et sociaux à l’Union soviétique et aux pays pauvres du tiers-monde, elle consacrerait toute son énergie et tout son talent à propager la révolution mondiale par l’art. »
France nouvelle URSS : un peu ironique, Éric ? Voyez donc :
« Nouveau Monsieur Jourdain, Malraux faisait du « soft power » sans le savoir. »
Et de rappeler le rôle prestigieux de ce pays (l’ancienne France donc) jusqu’alors sans « ministère de la culture » :
« La France ne manquait pas d’atouts. Dans la première moitié du XXe siècle encore, Paris demeurait la capitale mondiale de la peinture moderne ; le cinéma français fut le seul (avec l’allemand) à résister au rouleau compresseur d’Hollywood, et les grands écrivains américains venaient en France humer l’air vivifiant de la première puissance littéraire. « Il n’y a qu’une seule littérature au monde, la française », plastronnait alors Céline. Dans les années 1960 encore, la chanson française – Aznavour, Brel, Brassens, Ferré, Barbara, Bécaud, etc. – s’avérait la seule à tenir la dragée haute à la déferlante anglo-saxonne partout irrésistible par l’alliage rare de talents exceptionnels et de puissance commerciale et financière. »



J’en ai parlé de tout cela, notamment dans mon livre sur la comédie musicale américaine, genre qui vouait un culte à la ville-lumière : voyez deux chefs-d’œuvre comme Un américain à Paris ou Drôle de frimousse, sans oublier Jeune, riche et jolie, avec Danièle Darrieux. Tout cela disparait en…1958. Voyez aussi la Belle de Moscou de Mamoulian, qui se passe au Ritz. Paris meurt dans les sixties (voyez ici mon texte sur Mattelart).
Car les ennuis commencent sous De Gaulle :
« De Gaulle ne pouvait qu’être séduit ; il laissa la bride sur le cou à son glorieux ministre. Pourtant, le Général, par prudence de politique sans doute, sens du compromis avec les scories de l’époque, « car aucune politique ne se fait en dehors des réalités », amitié peut-être aussi, ne creusa jamais le malentendu qui s’instaura dès l’origine entre les deux hommes. »
Mais Zemmour souligne les différences :
« De Gaulle était, dans ses goûts artistiques, un « ancien » ; il écrivait comme Chateaubriand, goûtait la prose classique d’un Mauriac bien davantage que celle torrentielle de son ministre de la Culture ; il préférait Poussin à Picasso, Bach à Stockhausen. La France était pour lui l’héritière de l’Italie de la Renaissance, et de la conception grecque de la beauté. »
Malraux c’est autre chose :
« Malraux, lui, était un « moderne » ; hormis quelques génies exceptionnels (Vermeer, Goya, Rembrandt), il rejetait en vrac l’héritage classique de la Renaissance, et lui préférait ce qu’il appelait « le grand style de l’humanité », qu’il retrouvait en Afrique, en Asie, au Japon, en Amérique précolombienne. Il jetait pardessus bord la conception gréco-latine de la beauté et de la représentation, « l’irréel », disait-il avec condescendance, et remerciait le ciel, et Picasso et Braque, de nous avoir enfin ramenés au « style sévère » des grottes de Lascaux ou de l’île de Pâques. La révolution de l’art que porterait la France serait donc moderniste ou ne serait pas. »

Malraux (que plus personne ne lit) saccage le jardin à la française et va jeter les froncés dans les bras musclés de la sous-culture US :
« Loin de créer un “contre-modèle” solide et convaincant au marché capitaliste de l’entertainment, comme les gaullistes et les marxistes français l’espérèrent de Malraux ministre et de ses successeurs socialistes, la politique culturelle inaugurée par l’auteur des Voix du silence parvenu au pouvoir, en d’autres termes la démocratisation du grand art du modernisme, s’est révélée, au cours de son demi-siècle d’exercice, un accélérateur de cela même qu’elle se proposait d’écarter des frontières françaises : l’afflux d’une culture de masse mondialisée et nivelée par le bas et le torrent des images publicitaires et commerciales déracinant tout ce qui pouvait subsister en France, dans l’après-guerre 1940-1945, de vraie culture commune enracinée comme une seconde nature par des siècles de civilisation. […] »
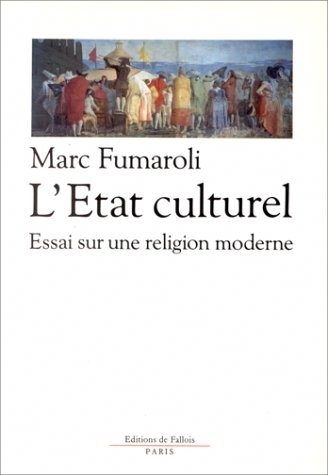
On se rapproche de la phrase : « il n’y a pas de culture française » de Macron. Et Zemmour mélancolique cite alors Marc Fumaroli, auteur de l’Etat culturel :
« Pour Fumaroli, l’Amérique ne pouvait pas perdre ce duel autour de l’« art moderne », qu’elle incarnait presque d’évidence, par sa puissance industrielle, ses gratte-ciel, son vitalisme économique et scientifique. La France de Malraux, au lieu de rester sur ses terres d’excellence de l’art classique, des mots et de la raison (héritées de Rome), vint jouer sur le terrain de l’adversaire, des images et des noces ambiguës de la modernité avec l’irrationnel primitif, même rebaptisé « premier ». L’échec était assuré. »
Entre cette culture déracinée, les villes nouvelles, la société de consommation (voir Baudrillard-Debord…), les autoroutes, le métro-boulot-dodo et la télé pour tous (voyez la vidéo de Coco Chanel…), on se demande ce qui pouvait rester de français à la fin de la décennie gaullienne : les barricades et les Shadocks ?
Lectures complémentaires:
https://www.amazon.fr/M%C3%A9lancolie-fran%C3%A7aise-Eric...
https://www.dedefensa.org/article/mattelart-les-jo-et-la-...
https://www.dedefensa.org/article/la-destruction-de-la-fr...
https://www.dedefensa.org/article/debre-et-le-general-fac...
https://www.amazon.fr/com%C3%A9die-musicale-am%C3%A9ricai...
13:37 Publié dans art, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : art, littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, andré malraux, politique culturelle, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Cœur de chien de Mikhaïl Boulgakov
Alexei Levkin
Source: https://counter-currents.com/2024/06/mikhail-bulgakovs-heart-of-a-dog/
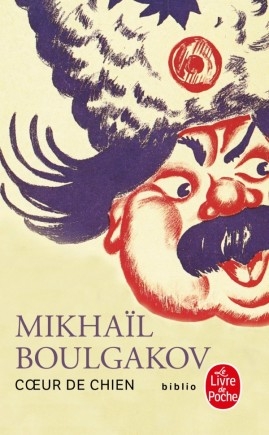 Cœur de chien est une œuvre immortelle du célèbre écrivain russe Mikhaïl Boulgakov. Inscrit au programme scolaire obligatoire de la Fédération de Russie, ce petit livre peut sembler, à première vue, n'être qu'une comédie amusante de style théâtral, basée sur le désir des généticiens de la première moitié du 20ème siècle d'élever de « nouvelles espèces biologiques ». Mais au fond, ce livre extrêmement laconique est une satire cruelle de la réalité soviétique et traite du ressentiment de l'homme inférieur, animal, qui n'est pas seulement le sujet, mais aussi l'incarnation même de l'idée gauchiste.
Cœur de chien est une œuvre immortelle du célèbre écrivain russe Mikhaïl Boulgakov. Inscrit au programme scolaire obligatoire de la Fédération de Russie, ce petit livre peut sembler, à première vue, n'être qu'une comédie amusante de style théâtral, basée sur le désir des généticiens de la première moitié du 20ème siècle d'élever de « nouvelles espèces biologiques ». Mais au fond, ce livre extrêmement laconique est une satire cruelle de la réalité soviétique et traite du ressentiment de l'homme inférieur, animal, qui n'est pas seulement le sujet, mais aussi l'incarnation même de l'idée gauchiste.
L'histoire est celle d'une confrontation entre deux types de personnes: les Russes dignes de ce nom de la « vieille Russie » ; sinon les aristocrates, du moins les représentants de la haute société, qui sont séparés par un fossé colossal du soi-disant « prolétariat » - la foule qui festoie sur le cadavre de la Russie dans l'appartement d'un certain « bourgeois » F. P. Chabline (qui a déjà été abattu) dans la maison Kalabukhovsky sur la Prechistenka. Le porte-parole et principal idéologue de l'œuvre est une caricature qui porte le nom de Chvonder. Entre eux, semble-t-il, surgit une chose absolument merveilleuse, due au génie scientifique du professeur Preobrajensky: un chien transformé en homme.
L'animal, une fois sous forme humaine, se définit comme étant du côté de Chvonder et de ses camarades quelques semaines seulement après sa réincarnation miraculeuse, mémorisant même (et commentant même la correspondance d'Engels avec Kautsky) Marx, Engels et Lénine. Ainsi, devant le peuple de la Vieille Russie, qui tient la dernière ligne de défense contre ces experts qui tentent de tout « enlever et diviser », apparaît un personnage tout à fait exact: une créature absolument déconnectée du sens commun, mais qui, en fin de compte, est parfaitement adaptée à la nouvelle réalité soviétique. On lui trouve une place pour débarrasser la ville des chats et, apothéose de tout, à la fin du film, cette créature reçoit même une salve d'applaudissements lors d'une réunion internationale des membres du parti.

Dans chaque scène, dans chaque son, l'un des nombreux fils se révèle, menant au dénouement de quelque chose de plus que l'intrigue du livre: la solution au phénomène du bolchevisme et, en général, à ce que l'on peut interpréter comme le « mob rule » dans sa forme la plus pure. Le génie littéraire de Boulgakov remplit les dialogues de codes culturels et en fait des unités sémantiques à part entière : un « orateur du peuple » annonce à la foule rassemblée chez Preobrajensky que la découverte du professeur est la propriété du communisme ; une créature chassant les chats et avalant de la poudre dentifrice donne des conseils à « l'échelle cosmique » sur la manière de tout diviser ; une femme en costume d'homme exprime son aversion pour le prolétariat (il s'agit en fait d'un « crime de pensée » orwellien) et déclare que le professeur doit être arrêté.
La métaphore des puces est également révélatrice ici : de la même manière qu'elles collent à Charikov, ce dernier commence à devenir un parasite sur le corps du professeur Preobrajensky, qui est également privé de la possibilité de se débarrasser simplement du parasite en le jetant à la rue. En même temps, la « socialisation » réussie de Charikov dans la société soviétique va de pair avec son humanisation complète, ce qui pourrait finalement conduire les héros de l'histoire à une fin décevante.
Peut-être Boulgakov voulait-il montrer comment Charikov, ayant achevé le processus d'évolution, s'établirait finalement dans ce monde : une sorte de triomphe d'un chien coiffé d'une casquette et armé d'un revolver chargé. Mais un tel rebondissement priverait définitivement Cœur de chien de ce sous-texte, en raison de la fin heureuse. Un simple spectateur n'y voit qu'une comédie et perçoit Charikov comme une créature tout à fait fantastique.
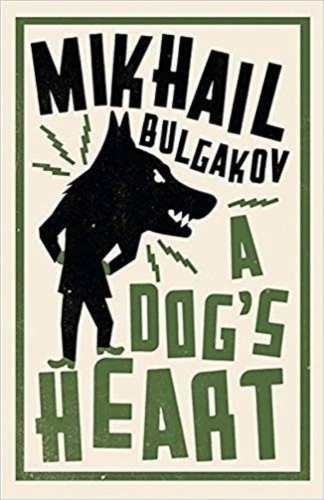
D'autre part, lorsque les chirurgiens ramènent Charikov à son état animal, cela ne reflète-t-il pas le fait que Boulgakov lui-même nourrissait l'espoir qu'un jour les sujets du bolchevisme retomberaient dans l'égout d'où ils étaient sortis ? C'est d'ailleurs ce qu'affirme le professeur Preobrajensky, qui radicalise son rejet du bolchevisme au cours du film en déclarant : « Je jure que je finirai par abattre ce Chvonder ! ».
Il convient de noter que le chien symbolise le service. Il établit une analogie entre trois types de personnes et trois animaux: les moutons, les loups et les chiens. Ces derniers se révèlent avoir une mission de garde pour protéger les premiers des seconds. La même symbolique, avec l'identification du chien comme gardien, sera plus tard transférée aux ordres chevaleresques et à leur héraldique. Le chien est donc ici un zélateur de l'idéologie et sa symbolique est très claire: un zélateur du socialisme est un bâtard, et à en juger par ses pensées, il est également très mauvais (comparez-le par exemple au noble chien du « Croc blanc » de Jack London). Bien que dans le film le réalisateur ait dû utiliser un chien dressé - très joli d'ailleurs - pendant le tournage, on peut supposer que dans le projet de l'auteur, sa race était aussi ignoble que celle de cet ivrogne qui a été envoyé avec lui sur la table d'opération.
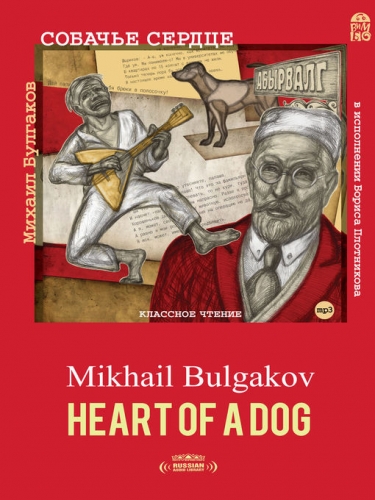
Le livre a fait l'objet de deux adaptations cinématographiques, l'une italienne et l'autre soviétique. Si la première n'a rien d'exceptionnel - hormis le rôle du professeur Preobrajensky, interprété par le magnifique acteur suédois Max von Sydow -, l'autre, qui suit fidèlement le livre, s'est révélée être une excellente adaptation. Le seul épisode qui manque au livre de Boulgakov - lorsque, à la fin de la première partie, Charikov interprète dans l'amphithéâtre de l'université « Eh, Apple », qui est déjà devenu la carte de visite de ses semblables - ne gâche en rien l'authenticité du scénario. Cœur de chien est donc certainement le meilleur film soviétique, étant donné qu'il n'est pas du tout soviétique dans l'esprit et qu'il est entièrement basé sur le scénario d'un écrivain aristocrate russe. De ce fait, il ne s'agit pas d'un film indépendant, ce qui, dans ce cas, n'est qu'un avantage.
En revanche, le réalisateur de la version italienne a modifié le message principal de Boulgakov et a essayé de flirter avec l'humanité de Charikov (en changeant même son nom en Bobikov). Ici, le troisième personnage principal n'est pas le docteur Bromenthal, mais la servante Zinaida, interprétée par une actrice au physique expressif et magnifique, qui éprouve de la sympathie pour Charikov, et peut-être même de l'amour.
On assiste donc ici à une certaine analogie avec La Belle et la Bête, ce qui, dans le contexte de Heart of a Dog (Coeur de chien), semble tout simplement ridicule. Tout le reste est également ridicule : de belles prises de vue de la campagne italienne au lieu de la sombre Russie, une foule d'acteurs aux visages typiquement italiens, un travail de caméra trop rapide et des dialogues qui tentent de transformer un film d'art et d'essai en un film d'action. Et bien que Max von Sydow dans le rôle de Preobrajensky crée un contraste nécessaire entre lui et Charikov, il s'avère qu'il a un contraste général avec tous les autres visages à l'écran. Avec un peu d'ironie noire, cela suggère que des images telles que celle du professeur, joué par von Sydow, sont tout simplement étrangères au monde soviétique.
20:48 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mikhaïl boulgakov, littérature, littérature russe, lettres, lettres russes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
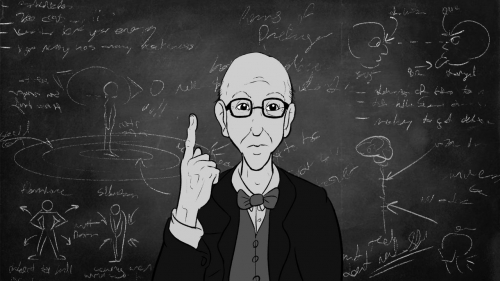
Cordwainer Smith et l'Instrumentalité
par Joakim Andersen
Source: https://motpol.nu/oskorei/2024/05/26/cordwainer-smith-och-instrumentaliteten/
Paul Myron Anthony Linebarger (1913-1966) a été l'un des leaders de la guerre psychologique, notamment en formant des agents de la CIA et en conseillant Kennedy. En tant que professeur, il a écrit plusieurs ouvrages sur la politique en Extrême-Orient (il était également le filleul de Sun Yat-sen). Parallèlement à ses carrières académique et militaire, il avait un vice secret : il écrivait de la science-fiction sous le nom de Cordwainer Smith. Comme Philip K. Dick, Isaac Asimov et Frank Herbert, il a créé son propre mythe et diffusé sa propre vision de l'avenir. Smith n'a pas atteint la même renommée que les autres, mais c'était un écrivain habile avec une vision unique (sans surprise, Zappa faisait partie de ses lecteurs).

L'histoire
L'histoire racontée par Smith s'étend sur des dizaines de milliers d'années dans le futur, mais l'accent est mis sur le mythique et l'existentiel, bien qu'il introduise également des inventions technologiques fascinantes. Peu de temps après notre époque, une civilisation périt dans une guerre dévastatrice (« les années s'écoulèrent ; la Terre continua à vivre, même si une humanité tarabustée et hantée se faufilait à travers les ruines glorieuses d'un immense passé »). Plusieurs races différentes sont apparues, dont les vrais humains, les « Morons » primitifs, les chasseurs d'hommes automatiques et les humains animaux. Pendant un certain temps, le monde a été gouverné par les Jwindz, « des Chinois, des philosophes... leur pouvoir ne s'exerce pas sur le corps de l'homme mais sur l'âme... ils sont éloignés, retirés, sans sang... ils ont recruté des personnes de toutes les races, mais l'homme n'a pas bien réagi. Seule une poignée d'entre eux aspire à la perfection esthétique que les Jwindz se sont fixée comme objectif. Les Jwindz ont donc eu recours à leur connaissance des drogues et des opiacés pour faire de l'homme véritable un peuple tranquille et indifférent - pour qu'il soit facile de le gouverner, de tout contrôler ». Nous retrouvons ici deux thèmes récurrents chez Smith : les dirigeants cachés et la perte de vitalité (comparez avec les « derniers hommes » de Nietzsche). Mais il en va de même pour les contre-forces qui surgissent, contre lesquelles les Jwindz transforment leur propre force de police, appelée l'Instrumentalité.

L'Instrumentalité a guidé l'histoire de l'humanité pendant des millénaires, comme une aristocratie décentralisée. Smith l'a décrite comme « un corps d'hommes qui se perpétue lui-même, doté d'énormes pouvoirs et d'un code strict. Chacun était un plénum de la basse, de la moyenne et de la haute justice, et pouvait faire tout ce qu'il jugeait nécessaire ou approprié pour maintenir l'Instrumentalité et la paix entre les mondes. Mais s'il commettait une erreur ou une faute - ah, là, c'était soudain différent. N'importe quel Seigneur pouvait mettre à mort un autre Seigneur en cas d'urgence ». Paradoxalement, ils ont un peu trop bien réussi dans leur objectif d'accroître la sécurité des gens et leur liberté de travail, ce qui a conduit à « une fade utopie de facilité et d'abondance » avec son cortège de futilités. Et de nouvelles solutions, notamment la réintroduction de phénomènes comme le risque, les nations, les maladies et les conflits. Ce projet, baptisé « La redécouverte de l'homme », visait à « restaurer le droit de l'homme à la liberté soit au risque, à l'incertitude et même à la mort ».
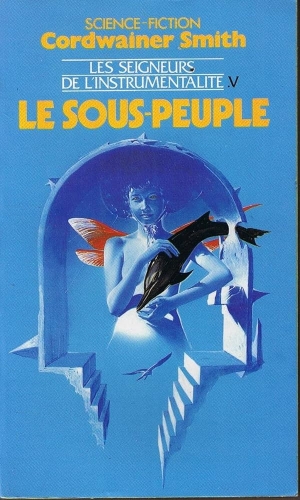
Mais avant cela, les histoires de Smith suivaient l'exploration de l'espace et les relations entre les hommes et les animaux. Un thème récurrent est la nature inhumaine de l'espace, où les étendues désolées et les longues périodes de temps poussent les gens à la mort et à la folie. À une époque, les voyages étaient supervisés par des scanners et des habermans de type cyborg, « les habermans étaient des criminels ou des hérétiques, et les scanners des gentlemen-bénévoles ». A une autre époque, les voyages se déroulaient sur d'immenses voiliers. Les scanners perdaient une grande partie de leur humanité, les capitaines la majeure partie de leur vie, tandis que les passagers dormaient congelés pendant des décennies. Une idée originale de Smith était celle des « dragons » qui se cachaient dans l'obscurité de l'espace et pouvaient, en une fraction de seconde, assommer tous les êtres vivants d'un coup de poing psychique. Contre ces êtres, « des bêtes plus intelligentes que les bêtes, des démons plus tangibles que les démons, des tourbillons affamés d'énergie et de haine composés par des moyens inconnus à partir de la matière ténue existant entre les étoiles », les humains ont utilisé des télépathes comme défenseurs. Des êtres étranges ont également rencontré l'humanité sur des mondes étrangers, comme les Apaciens, semblables à des canards, et les Arachosiens, mangeurs d'hommes.

Thèmes mythiques
Contrairement à Asimov, Smith se concentre sur les dimensions mythiques et psychologiques de l'histoire. Le jeu entre la vitalité et l'insignifiance ou la décadence est un sujet récurrent. L'originalité réside dans l'utilisation de l'allemand comme représentant de la vitalité. Une aristocrate prussienne congelée, Carlotta vom Acht, remet l'humanité sur les rails 16.000 ans après la Seconde Guerre mondiale et ses descendants restent des membres éminents de l'Instrumentalité. Une autre solution est représentée par les habitants de la planète Norstrilia, « Old North Australia ». Ils élèvent des moutons assez énormes qui sont la seule source de stroon, un médicament qui prolonge la vie, et sont donc extrêmement riches. Mais pour protéger leur culture et leur mode de vie, ils ont des coutumes tout aussi extrêmes, ce qui signifie qu'ils vivent comme des colons sur leur planète. « L'ancienne Australie du Nord est restée simple, pionnière, féroce et ouverte. Chaque Australien du Nord est également un guerrier tueur et un télépathe.
Le choix des Norstriliens de ne pas utiliser les animaux, les « underpeople » ou « homunculi », comme on les appelle également, comme main-d'œuvre nous amène à un autre fil conducteur de l'histoire de Smith, la relation entre les humains et les animaux. Le travail et la privation de droits des seconds sont la condition sine qua non de la vie facile des premiers. Ce sont des animaux dotés d'une intelligence humaine et de traits plus ou moins humains. Leurs noms sont liés à leurs origines animales ; C'Mell, par exemple, est un chat. Les animaux n'ont aucun droit dans l'avenir de Smith ; s'ils deviennent vieux ou malades, par exemple, ils sont euthanasiés. Au fil des ans, Smith est devenu chrétien, et les tentatives des animaux pour obtenir des droits et la liberté s'inscrivent dans un thème chrétien primitif plutôt que révolutionnaire. Dans The Dead Lady of Clown Town en particulier, ce thème est à la fois puissant et émouvant, les animaux prenant la place des premiers martyrs chrétiens (« the underpeople started to chant love, love, love in a weird plainsong full of sharps and halftones »). Le christianisme, « l'ancienne religion forte », continuera à réapparaître à l'avenir, malgré l'opposition vigoureuse de l'Instrumentalité à l'exportation de la religion entre les mondes.
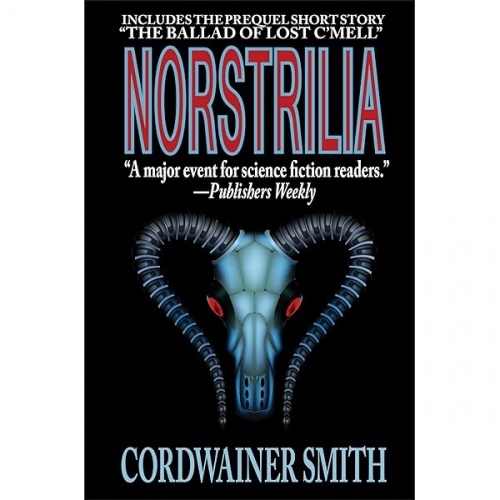
En général, l'élément mythique est très présent dans l'œuvre de Smith, l'expert en guerre psychologique étant conscient que « l'homme ne vit pas que de pain ». De nombreuses histoires contiennent des chansons et des légendes, d'autres sont structurées comme des mythes chinois. De temps à autre, on voit apparaître un prince de l'Instrumentalité nommé Lord Sto Odin, une planète du châtiment appelée Shayol et une nouvelle version d'Ekhnaton. Les événements menant à l'émancipation des hommes-bêtes sont les plus intéressants d'un point de vue narratif, les événements s'influençant les uns les autres sur plusieurs générations. Mais Smith était également capable d'écrire des histoires courtes et concises, peignant des décors fascinants tels que les profondeurs souterraines où le peuple animal vivait parmi les ruines d'anciennes civilisations situées sous des maisons hautes de plusieurs kilomètres. Un thème plus personnel était l'ailurophilie de longue date de Smith ; les chats jouaient un rôle récurrent et important dans son mythe. Dans l'ensemble, il s'agit d'une connaissance enrichissante, notamment pour ceux qui apprécient Philip K. Dick.
A propos de l'auteur : Joakim Andersen
Joakim Andersen alimente le blog Oskorei depuis 2005. Il a une formation universitaire en sciences sociales et une formation idéologique marxiste. Au fil des ans, l'influence de Marx a été complétée par celles de Julius Evola, d'Alain de Besiont et de Georges Dumézil, entre autres, car le marxisme manque à la fois d'une théorie durable de la politique et d'une anthropologie. Aujourd'hui, Joakim Andersen ne s'identifie à aucune étiquette, mais considère que la fixation, entre autres, sur le conflit supposé entre la « droite » et la « gauche » occulte les véritables enjeux de notre époque. Son blog continue également de s'intéresser à l'histoire des idées et aime présenter des courants étrangers au public suédois.
20:01 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres américaines, littérature américaine, science-fiction, cordwainer smith |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 473 du Bulletin célinien
 Sommaire:
Sommaire:
Entretien avec Rémi Ferland
Bibliographie : la réception critique
Céline raciste, Ramuz racialiste ?
Robert Poulet, éditeur du Pont de Londres


17:46 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : louis-ferdinand céline, lucien rebatet, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Hamsun l'hyperboréen
par Gennaro Malgieri
Source: https://www.barbadillo.it/114125-hamsun/
Knut Hamsun est bien connu en Italie, et ce depuis quelques années. Ses romans ont toujours eu une fortune inversement proportionnelle aux mésaventures de l'auteur. L'universitaire finlandais Tarmo Kunnas, dont l'éditeur Settimo Sigillo a publié il y a quelques années L'avventura di Knut Hamsun. La grande maison d'édition Adelphi a envoyé en librairie certains de ses romans les plus significatifs. Kunnas en parle longuement dans la biographie la plus complète du prix Nobel de littérature de 1920. Les matériaux ne manquent donc pas pour se faire une idée de l'ensemble de son œuvre, mais surtout de sa pensée et de ses opinions politiques controversées pour lesquelles il a été ostracisé et démoli dans l'immédiat après-guerre. Le livre de Kunnas met d'ailleurs fin à une « diabolisation » scandaleuse, ramenant Hamsun dans le courant principal de la littérature européenne du 20ème siècle, où il occupe une place de choix.
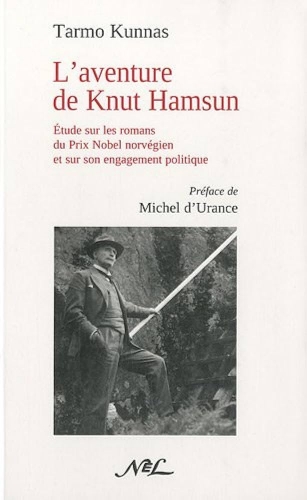
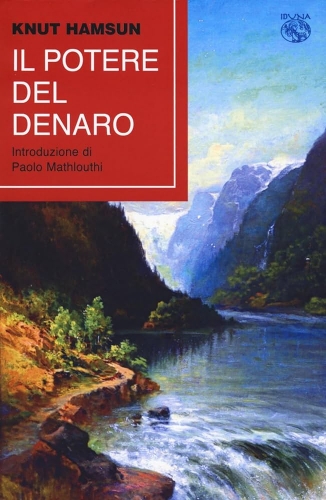
Son dernier livre à paraître en Italie est un curieux et sage roman philosophico-économique : Il potere del denaro, publié par Iduna avec une introduction de Paolo Mathlouthi. Le protagoniste est Benoni Hartvigsen, un pauvre pêcheur et facteur qui, un jour, devient soudainement riche et fait l'expérience directe du contraste dramatique entre l'argent et le travail, entre la nature et la ville, entre la sérénité d'une vie pauvre mais insérée dans une communauté harmonieuse et l'angoisse d'une existence riche vécue au milieu d'un égoïsme individualiste, en un mot entre la culture et la civilisation. Un roman « conservateur », pourrait-on dire. Et il le ramène à ses origines, à des romans comme La Faim, par exemple, qui a connu une grande notoriété au début du siècle dernier. Au point que beaucoup ont loué ses qualités littéraires et apprécié son éthique.
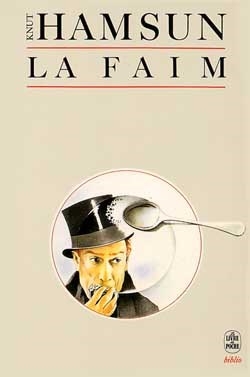 Lorsqu'il reçoit le prix Nobel en 1920, par exemple, Thomas Mann déclare que jamais il n'a été décerné à quelqu'un de plus méritant ; Kafka, Brecht, Miller sont séduits par son style ; Isaac Bashevis Singer estime que « toute la littérature moderne dérive de Hamsun » ; Eugenio Montale le considère comme « le plus digne successeur d'Ibsen et de Björnson dans le ciel de la littérature européenne moderne ».
Lorsqu'il reçoit le prix Nobel en 1920, par exemple, Thomas Mann déclare que jamais il n'a été décerné à quelqu'un de plus méritant ; Kafka, Brecht, Miller sont séduits par son style ; Isaac Bashevis Singer estime que « toute la littérature moderne dérive de Hamsun » ; Eugenio Montale le considère comme « le plus digne successeur d'Ibsen et de Björnson dans le ciel de la littérature européenne moderne ».
Après la Seconde Guerre mondiale, il est « jeté » dans la « géhenne où aboutissent les méchants », une géhenne dont il ne sortira jamais par décret de ceux-là mêmes qui ont instauré la « mort civile » pour Ezra Pound, des vainqueurs qui, insouciants de son génie et peu enclins à séparer l'art de la politique, ont construit autour de Hamsun une sorte de cordon sanitaire dont l'écrivain a témoigné dans son examen de conscience Io traditore (Le Traître). Il est vrai qu'il a soutenu Quisling, mais il n'a pas adhéré au national-socialisme. C'est plutôt, comme l'écrit Kunnas, son anti-américanisme et son hostilité à l'Angleterre, « puissance mercantile » qu'il détestait, qui l'ont privé de « respectabilité ». Pour cette raison, il fut d'abord interné dans une maison de travail, puis dans un asile. L'accusation, infondée mais vicieuse, porte sur l'« intelligence avec l'ennemi » et le « collaborationnisme ». Un intellectuel « délinquant », en somme. De la même « famille » que Pound, Brasillach, Drieu La Rochelle, Céline... Mais le temps est gentilhomme et la poussière n'est pas retombée sur Hamsun. En témoigne la réédition constante de ses oeuvres.
Son œuvre, en effet, reste intacte du point de vue littéraire, l'un des derniers romans civilisés. Et elle connaît une surprenante revalorisation (outre sa négligence délibérée dans les différents festivals de littérature nordique) pour les personnages originaux qu'elle présente. Son hostilité au matérialisme, au mercantilisme, à l'absolutisme de l'argent, au conditionnement de l'industrialisme, à la « pensée unique », en somme, en fait un précurseur de la défense de la nature et de l'identité culturelle de son pays, ainsi que de toutes les différences, comme le souligne Kunnas. Cette même nature que l'on célèbre en rendant hommage à une jeune fille et à un mouvement d'opinion écologiste intangible, en négligeant des écrivains comme Hamsun, dont l'écologisme anté-littéral a imprégné sa production littéraire. Ne serait-ce que parce qu'une place dans une revue comme celle de Milan aurait dû être occupée par lui, témoignant du fait que la question du rapport homme-nature est vécue culturellement depuis plus d'un siècle, suscitant des mouvements politiques et littéraires parmi lesquels Hamsun mérite un rôle respectable.
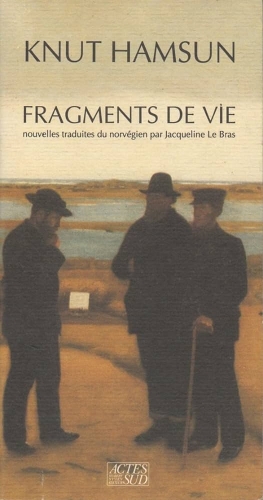 Plus encore. Pour son biographe Kunnas, Hamsun « représente l'un des analystes les plus perspicaces des formes extrêmes du marché et de l'industrialisation, ainsi que de la vie politique ». En outre, il ne se contente pas d'exalter la « grandeur de l'homme européen », mais il en souligne aussi les limites. Il révèle également « le côté archaïque de chaque homme et de l'humanité tout entière », montrant que le destin de l'individu est loin d'être facile à définir et à déterminer dans le contexte de la civilisation moderne.
Plus encore. Pour son biographe Kunnas, Hamsun « représente l'un des analystes les plus perspicaces des formes extrêmes du marché et de l'industrialisation, ainsi que de la vie politique ». En outre, il ne se contente pas d'exalter la « grandeur de l'homme européen », mais il en souligne aussi les limites. Il révèle également « le côté archaïque de chaque homme et de l'humanité tout entière », montrant que le destin de l'individu est loin d'être facile à définir et à déterminer dans le contexte de la civilisation moderne.
Tout cela a été ignoré par l'État norvégien à la fin de la guerre, qui a persécuté Hamsun au-delà de toute raison plausible, étant donné que l'écrivain n'avait été coupable d'aucun crime et qu'il était âgé de près de quatre-vingt-dix ans. Aujourd'hui, nous le considérons comme un écrivain « posthume ». Et Kunnas nous rappelle son « aventure ». Qui revient avec la réédition par l'éditeur Fazi de ce qui fut son dernier livre, Per i sentieri dove cresce l'erba, dans lequel il a bien fait de préciser, dans cette sorte de journal, comment étaient les choses ; un livre de fragments, de souvenirs, de suggestions, défensifs et jamais offensifs, qui devrait être lu aujourd'hui comme il le fut par peu de gens dix ans après la mort de l'écrivain, en 1962, lorsqu'il parut en Italie, aux éditions Borghese, sous le titre Io, traditore, sans susciter d'intérêt particulier.
Les temps ont changé, semble-t-il. Per i sentieri dove cresce l'erba (nouveau titre, nouvelle traduction) ne peut qu'être accueilli comme l'examen de conscience d'un écrivain qui ne cherche pas à se justifier, mais revendique seulement le droit d'être jugé pour ses idées qui, de toute façon, ne préfigurant pas des crimes, ne sauraient être mises à la barre. C'est donc un livre qui nous interroge sur la liberté de pensée et sur l'ampleur de l'intolérance exercée notamment à l'encontre des intellectuels.
Lorsque la Cour suprême a prononcé la sentence, Hamsun a fini d'écrire. Après quatre ans de silence, il s'éteint. Il avait quatre-vingt-treize ans et s'est endormi dans la contemplation de « sa » nature scandinave qui avait servi de toile de fond à presque tous ses romans. Un véritable « hyperboréen », fils d'une ethnie nordique extrême, chère à Apollon.
Gennaro Malgieri
20:22 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, livre, knut hamsun, lettres, lettres norvégiennes, littérature norvégienne, norvège |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 472 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
L’affaire Pierrat (Erreurs et contrevérités)
Le Céline de Meudon
Actualité célinienne
Acte de parole, acte d’écriture
À quand une grande émission littéraire consacrée à Céline ? Ce qui a été diffusé le mois passé sur France Inter rappelle furieusement ce qui l’avait été en juillet 2019 sur France Culture. Dans les deux cas, on a affaire à une dizaine d’heures d’émission (en plusieurs épisodes) où les historiens ont la part belle. Logique pour l’émission de Philippe Collin (2024) qui entend précisément apporter un regard historique ; ça l’était moins pour Christine Lecerf (2019), traductrice et critique littéraire.
C’est ce qu’avait déploré à l’époque Henri Godard qui lui avait accordé trois heures d’entretien (!) et dont seules quelques phrases furent retenues pour l’émission : « En dehors de la biographie, l’éclairage fut mis tout entier sur l’antisémitisme, au détriment de l’œuvre littéraire. Sur cette autre face de Céline, presque rien : de temps en temps quelques adjectifs et quelques exclamations ponctuelles (« grand écrivain », « quel écrivain ! » etc.) mais pas l’ébauche d’un commentaire qui tenterait de faire comprendre à des auditeurs qui ne connaissent pas l’œuvre sa nouveauté et sa puissance. » Même constat aujourd’hui par Émile Brami : « Je pensais que le journaliste voulait faire quelque chose d’intéressant ; il a tout gommé. »
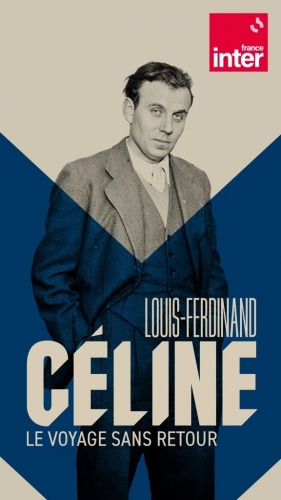
Par ailleurs, dans l’une et l’autre émission, on retrouve quasi les mêmes intervenants, dont l’historienne Anne Simonin. Celle-ci a raison de rappeler que la loi d’amnistie du 16 août 1947 (article 10-4) bénéficiant aux anciens combattants de la guerre 14-18 ne pouvait s’appliquer à Céline, ladite loi en excluant ceux qui avaient été condamnés pour faits de collaboration (article 25). Là où elle fait fausse route, c’est lorsqu’elle prête à Jean Seltensperger, rédacteur d’un réquisitoire clément, un machiavélisme ne correspondant pas du tout au personnage¹.
L’idée fut, selon elle, d’inciter Céline à rentrer en France et à se présenter devant ses juges : « Une fois qu’ils auraient eu la main sur Céline, l’indignité nationale pouvait être couplée avec un autre article du code pénal (83-4) sanctionnant les actes de nature à nuire à la défense nationale. Et là, Céline faisait de la prison. » Cette fable, qu’elle avait déjà énoncée il y a six ans¹, ne cadre pas du tout avec la personnalité de ce magistrat, admirateur de Céline, qui avait d’ailleurs conservé par-devers lui la correspondance que l’écrivain lui avait adressée alors qu’il eût dû la déposer dans le dossier². Ironie de l’histoire : en imaginant cette stratégie judiciaire pour appâter l’inculpé, l’historienne se met au diapason célinien.
Suspicieux invétéré, n’imaginait-il pas en exil que « le moyen pour la justice de [l’] attirer à Paris, est de [lui] promettre la Chambre Civique… Une fois à Paris, on verra ce que l’on fera du lapin ! » ? Il y aurait encore bien d’autre singularités à relever dans cette émission. Elle s’ouvre par les “Actualités” de la R.T.F. à la mort de Céline, dont cette affirmation de Claudine Chonez (1906-1995), longtemps proche du PCF, à propos de Bagatelles pour un massacre : « Il s’agissait tout simplement du massacre des juifs. » [sic] Le contresens n’est évidemment pas rectifié par le journaliste. Mais pouvait-il en être autrement, lui qui définit ainsi Céline : « une âme pathétique au service des passions tristes, un homme plus que gênant, un esprit venimeux » ?
• Émission « Face à l’histoire » de Philippe Collin : “Louis-Ferdinand Céline, le voyage sans retour”, France Inter, 26 mars 2024. Podcast disponible sur le site internet de cette radio.
20:17 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, revue |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 471 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Céline et Brassens, l’impossible filiation?
Entretien avec Gaël Richard
Céline dans Les Lettres françaises [1951-1953]
Une lettre et une carte postale de Colette Destouches à Henri Mahé.
La nouvelle a fait l’effet d’une bombe dans le petit univers médiatique : pendant trente-cinq ans, Philippe Grumbach (1924-2003), directeur de L’Express, a renseigné les services secrets de l’URSS. Nous devons cette révélation à Vassili Mitrokhine, lieutenant-colonel du KGB, qui fut l’archiviste en chef du service secret soviétique durant une décennie¹.
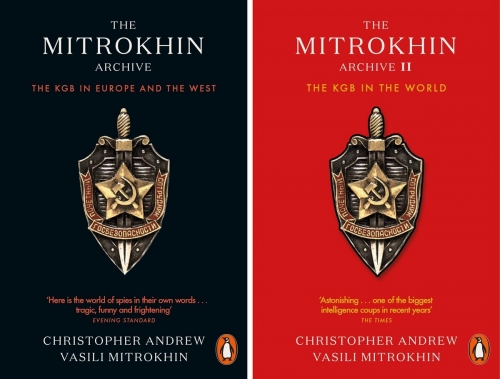
Quel rapport avec Céline ? C’est que ce Grumbach accompagnait Madeleine Chapsal à Meudon lorsqu’elle fit, pour cet hebdomadaire, le fameux entretien à l’occasion de la parution de D’un château l’autre. Roger Nimier, qui était à la manœuvre, suggéra l’idée à cette journaliste dont il était proche. Cela ne se fit pas sans mal comme elle s’en souvient : « Hurlement général ! C’était tout de même un journal de gauche, avec pas mal – allons y gaiement ! – de Juifs. Alors l’idée de donner beaucoup de place à Céline les avait beaucoup remués. Surtout Philippe Grumbach, qui était rédacteur en chef, et avait essayé de faire barrage. » Il tint pourtant à l’accompagner, voulant voir « la tête de l’ennemi des Juifs »².

Cet entretien parut au printemps 1957 alors que Grumbach travaillait depuis dix ans pour les services secrets soviétiques. Une conférence de rédaction animée avalisa finalement la publication mais il fut décidé que le chapeau journalistique de cet entretien marquerait les distances de l’hebdomadaire avec l’écrivain sulfureux. L’entretien, titré « Voyage au bout de la haine », fut suivi d’une introduction relevant que les réponses de Céline « éclairent crûment les mécanismes mentaux de ceux qui, à son image, ont choisi de mépriser l’homme. » Quelques mois auparavant, l’Armée rouge avait réprimé dans le sang l’insurrection de Budapest, ce qui ne dissuada pas Grumbach de maintenir un contact fréquent (et rémunéré³) avec ses interlocuteurs soviétiques. Après cette invasion, le communiste militant qu’était Roger Vailland prit, lui, ses distances avec le PCF. Tout en collaborant à La Tribune des Nations, hebdomadaire dirigé par André Ulmann, agent d’influence soviétique. Il y défendait les positions diplomatiques de l’URSS dans cette revue qui avait un certain écho car envoyée aux ministères et aux principaux décideurs, ainsi qu’à de nombreuses ambassades. Durant une vingtaine d’années, il reçut plus de trois millions de francs et, en prime, une décoration soviétique. C’est dans cette publication que Vailland signa, un mois avant le procès devant la Cour de justice, son article fielleux, « Nous n’épargnerions plus L.-F. Céline ». Lorsque Grumbach fut harponné par le KGB, il était proche du PCF alors totalement inféodé à Moscou. Incompatibilité majeure avec Céline qui notait dès 1936 que « les Soviets donnent dans le vice, dans les artifices saladiers (…) : ils essayent de farcir l’étron, de le faire passer au caramel. ». Et de conclure : « C’est ça l’infection du système. »

16:10 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, philippe grumbach, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises, archives mitrokhine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le mensonge de Robinson
par Roberto Pecchioli
Source : EreticaMente & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-menzogna-di-robinson
En ces temps de culture de l'effacement, où même la musique de Beethoven et les épopées d'Homère sont mises à l'index selon le jugement sans appel du présent, où Shakespeare est accusé de sexisme, d'antisémitisme et de mépris pour les handicapés, il est curieux que l'une des œuvres les plus significatives de la littérature anglaise, Robinson Crusoé (1660-1731) de Daniel De Foe, soit rarement remise en question. Publié en 1719, il a immédiatement connu un succès extraordinaire qui perdure encore aujourd'hui, bien qu'il soit surtout considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature enfantine. L'intrigue est bien connue: le marin Robinson s'échappe du naufrage de son navire et débarque sur une île déserte où il vit seul pendant douze ans. Il se débrouille comme il peut, trouve la foi en Dieu et rencontre alors un indigène, un "bon sauvage", qu'il sauve d'une tribu cannibale. Il l'appelle Vendredi, du nom du jour de la semaine où il le rencontre, l'éduque, lui apprend l'anglais et en fait un sujet. Au bout de vingt-huit ans, Robinson parvient à retourner à la civilisation avec Vendredi, pour vivre d'autres aventures avec lui. Son île, quant à elle, devient une colonie espagnole pacifique, dont il est nommé gouverneur.
Peu d'intrigues sont plus politiquement incorrectes que celle de Robinson. Pourquoi, alors, n'est-il pas attaqué par les "woke" avec la véhémence qui n'épargne pas Dante et Michel-Ange - sa chapelle Sixtine ne représente, par culpabilité, que des Blancs - jusqu'à Aristote, répudié pour avoir justifié - dans la Grèce du IVe siècle avant J.-C. - l'esclavage ? Même les woke en colère ont une laisse et une chaîne, celle du sommet du mondialisme, des maîtres qui les ont placés dans le fauteuil, à la tête des journaux, des chaînes de télévision, des maisons d'édition et des centrales du divertissement. La raison en est simple: Robinson est un symbole, la représentation parfaite de leur idéologie, l'un des mythes fondateurs de l'individualisme libéral.

De Foe (tableau, ci-dessus) représente en Robinson le caractère des Lumières britanniques, la montée de la bourgeoisie mercantile, triomphante dans le sang de la Glorieuse Révolution proto-libérale de la fin du XVIIe siècle, la croyance en la raison, la religiosité moraliste puritaine, toujours présente - bien que bouleversée dans ses valeurs - dans la culture d'annulation anglo-saxonne d'aujourd'hui. Robinson exalte la mentalité individualiste qui sous-tend la société capitaliste naissante. Celle-ci s'efforce de plier la nature à ses besoins, de dominer la nature sauvage, en ne faisant confiance qu'à ses forces, éclairées par la raison et soutenues par la technologie. James Joyce a vu dans ce livre le manifeste de l'utilitarisme anglais qui, au début du XIXe siècle, avait trouvé en Jeremy Bentham son plus grand théoricien. Le personnage de Vendredi a été repris par Jean Jacques Rousseau dans l'archétype pédagogique du "bon sauvage" de l'Emile.
C'est pourquoi Robinson échappe à la censure: à sa manière, il est politiquement correct, ou du moins acceptable. Le politiquement correct est une forme de mensonge et doit être contré non pas par son antonyme, l'incorrection, mais par la vérité. Dans l'Europe de l'époque de De Foe, personne n'était un naufragé dans la mer de l'histoire. La société traditionnelle était un ensemble de racines, de dépendances mutuelles et de loyautés dont dépendait la survie de la communauté: un ensemble organique, une immense famille, une figure quasi biologique dans laquelle l'esprit de la terre et les générations précédentes confirmaient les coutumes et les croyances collectives sans qu'il soit nécessaire d'établir des constitutions écrites.
L'idée de l'individu est un produit de l'ingéniosité littéraire et non de la nature humaine. Pour le lecteur des XVIIIe et XIXe siècles, l'exemple de Robinson Crusoé, l'homme qui se prend en charge et parvient à optimiser des ressources rares grâce à son initiative et à ses connaissances techniques sur une île déserte, est devenu la parabole favorite du libéralisme européen et américain, dont Daniel De Foe a été - sans le savoir - le premier prophète. D'autres fables heureuses ont ensuite accompagné le développement du mythe : les vices privés qui deviennent des vertus économiques (Mandeville) ; la main invisible du marché (Adam Smith - portrait, ci-dessous) qui règle et résout tout dans l'intérêt ; la loi qui fait d'une chimère, la poursuite du bonheur inscrite dans la constitution américaine, un objectif de haute force symbolique.

L'homme rationnel, indépendant, libre, libéré des contraintes, abstrait, naufragé sans histoire et sans racines, est l'ancêtre, le totem de l'homo oeconomicus contemporain: apatride, monade destinée à la production et à la consommation parfaitement interchangeable avec n'importe quelle autre. L'étonnant paradoxe de l'individualisme: des millions d'atomes identiques convaincus d'être uniques. La faiblesse de l'aventure robinsonnienne est qu'elle exige d'abord le naufrage, la solitude, l'absence de lien social. Au bout du compte, l'Anglais aride et morne finit par rencontrer un Vendredi. Le naufragé éclairé et "civilisé" colonise le sauvage, l'innocent Caliban de la Tempête de Shakespeare qui tombe entre ses mains, lui donne un nom - manifestation absolue de pouvoir, acte qui ne peut être accompli qu'avec un nourrisson ou un animal domestique -, le réduit à ses catégories morales et le soumet à un processus paternaliste d'acculturation qui le dénature.
Ces mêmes actions montrent que Robinson n'est pas un individu qui surgit du néant, mais une personne qui a des racines culturelles, identitaires, spirituelles: sans l'héritage millénaire du christianisme, il aurait probablement mangé ou tué Vendredi. Sans son éducation, l'apprentissage de la division du travail et de la technologie, il n'aurait pas exploité son serviteur avec autant de profit. Après tout, les Anglais pratiquaient le trafic d'esclaves depuis le XVIe siècle, avec la bénédiction de la couronne, qui délivrait aux entrepreneurs du vol et de l'inhumanité tels que Francis Drake et Walter Raleigh une autorisation spécifique, la "lettre de passage", et les érigeait en baronnets pour leurs tristes succès.
Robinson Crusoé a connu un immense succès dans l'Europe des Lumières et il n'est guère d'essayiste de l'époque qui ne le cite. Bernardin de Saint Pierre - écrivain et scientifique - Chateaubriand, mais aussi Rousseau, ont trouvé leur inspiration dans ce classique qui a enchanté d'innombrables enfances, dont la nôtre. Mais il aura fallu que Robinson se retrouve sur une île déserte, devienne une épave, un atome humain à la dérive pour devenir l'un des héros de l'individualisme libéral. Et devenir une sorte de Jean-Baptiste - le précurseur annonçant la naissance de ceux qui viendront après lui - de la modernité naissante, de l'homme nouveau engagé à fonder son paradis sur les ruines du monde traditionnel. Paradoxalement, ceux qui deviendront les chantres de l'individualisme sont des gens solidement organisés en corporations, actionnaires de banques et fondateurs des premières compagnies d'assurance, des personnages respectables membres de "guildes" et de corps de métiers, la bourgeoisie de Rembrandt et de Frans Hals, premiers acteurs de l'épopée séculaire du marchand, leur protecteur.
L'argent a toujours eu besoin de lois, de gendarmes, de prisons, d'Etats, de juges. Robinson était l'image que les puissances montantes des XVIIIe et XIXe siècles se faisaient d'elles-mêmes, une idéalisation de l'individu proactif qui permettait à quelques-uns d'exploiter sans pitié une masse de millions de Vendredi à la peau blanche et chrétienne, l'ancêtre de Kurtz dans Au cœur des ténèbres. Les universitaires anglo-saxons ne se soucient pas de cette gigantesque exploitation indifférente à la race et ne réclament pas de réparations historiques pour les héritiers des pauvres Européens blancs. C'est la mystique inversée - intouchable - du libéralisme, dont la neutralité/l'indifférence morale justifie toutes les infamies commises au nom de l'intérêt personnel.
L'histoire déclenchée par le type humain dont Robinson est le héros éponyme est dramatique : lois sévères contre les pauvres, enclosures des champs communaux (enclosures qui ont poussé des millions de paysans privés de subsistance vers les usines), enfers industriels de Manchester et de Birmingham, landlords vantant les vertus morales du travail des enfants dans les mines et les filatures. L'Angleterre, dominée par l'oligarchie qui en est encore aujourd'hui l'architrave, a été la première à penser à limiter la croissance de la pauvreté non pas par une juste répartition des revenus, mais en imposant des limites à la reproduction biologique des misérables. L'élevage contrôlé du bétail humain prolétaire esquissé par le révérend Malthus est aujourd'hui concrétisé par le mondialisme anti-humain, qui considère l'avortement et l'euthanasie comme philanthropiques. "Son intérêt supérieur", peut-on lire dans la sentence qui a condamné à mort l'enfant malade Alfie, faute de soins.
Depuis Robinson, les riches donnent des leçons de morale: les guerres de l'opium en Orient ont été déclenchées pour défendre le libre-échange. Peut-on s'étonner de l'indifférence actuelle face à la propagation des drogues ? Robinson l'utilitariste, l'inépuisable homo faber, est le protagoniste de l'agonie de la beauté (à quoi sert-elle ?): la laideur à grande échelle, la fonctionnalité comme icône du profit, l'expression ultime de la rationalité libérale.

Karl Friedrich Schinkel, le grand architecte néoclassique prussien, a visité les villes industrielles d'Angleterre, sombres, enfumées, dépourvues de services, grouillant d'une humanité appauvrie et échevelée sous les "noirs moulins sataniques" haïs par le poète William Blake. Il repart en pleurant : c'était un homme de l'ancien régime. La révolution industrielle anglaise, qui a commencé à l'époque de De Foe, a été la première révolution libérale, plus que la révolution américaine de 1776. Celle de la France fut un chaos causé par le vide d'une noblesse débauchée qui avait renoncé à son rôle de leader.
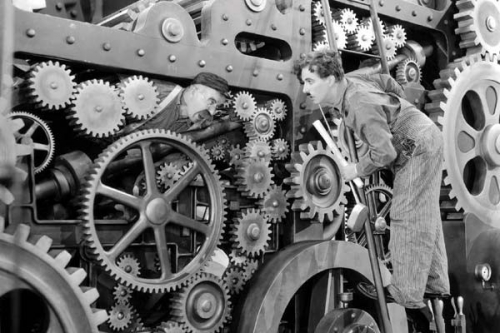
Le libéralisme est le bras politique du système qui a ensuite trouvé dans la social-démocratie une soupape de sécurité servile. Le capitalisme a besoin d'ordre, de discipline, d'horaires, de division du travail ; Charlie Chaplin, dans Les Temps modernes, a représenté la chaîne de montage avec la précision plastique du génie. L'exploitation intensive de ces enfers (réserves de plus-value !) emploie des voyous pires que ceux des mines des Indes. L'enfant et la femme deviennent des instruments du processus de production. L'expansion des marchés passe par la destruction des sociétés traditionnelles : toute transformation du système de production impose d'innombrables sacrifices. En Espagne, les confiscations du 19ème siècle ont conduit à la transformation des paysans en ouvriers affamés, à la destruction du patrimoine artistique, à la déforestation et à un état de guerre civile permanent. Les libéraux ont apporté la liberté à ceux qui en avaient les moyens. Le suffrage censitaire était l'ancêtre grossier de la partitocratie actuelle, où le peuple plébiscite des candidats payés par les oligarques.
La démocratie est formelle car le pouvoir réside dans les conseils d'administration. Les marchés, hypostases terrestres de la divinité, décident mieux que nous. L'individualisme du naufragé Robinson est une revendication idéologique, une publicité. Un solvant, un acide nihiliste qui corrode toute forme de communauté, détruit tout lien, coupe toute racine. Vendredi perd son nom, son dieu, sa langue et sa mémoire. C'est la seule façon pour lui de servir Robinson. La dérive matérialiste du naufragé Crusoé, devenu gouverneur colonial, s'accomplit. À son mensonge, il faut opposer une vérité perdue : le matérialisme est l'effondrement de toute morale. C'est la leçon de Giovanni Gentile dans Genèse et structure de la société. "L'homme accomplit une action universelle qui est la raison commune aux hommes et aux dieux, aux vivants, aux morts eux-mêmes et même aux enfants à naître. " Il n'est pas un atome solitaire, ni Robinson ni Vendredi : il vit et devient une personne dans la mesure où il crée et transmet de la civilisation, et non des produits. "Au fond de l'ego, il y a toujours un Nous, qui est la communauté à laquelle il appartient et qui est la base de son existence spirituelle, et il parle avec sa bouche, sent avec son cœur, pense avec son cerveau". Robinson est le père glacial du "je" contemporain, Vendredi le serviteur nécessaire, éloigné de son destin originel, de son peuple, de son nom. Le mensonge de Robinson est un suprémacisme exigeant, brillant de paillettes, vendu à prix d'or.
19:42 Publié dans Littérature, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, daniel de foe, robinson crusoe, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise, libéralisme, individualisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

"Masculinité et nationalisme": Shakespeare doit maintenant être gommé des mémoires
Source: https://zuerst.de/2024/04/02/maennlichkeit-und-nationalismus-jetzt-soll-shakespeare-demontiert-werden/
Londres. La mode "woke" et la haine du blanc s'attaquent de préférence aux grandes figures de l'histoire (intellectuelle) européenne. C'est maintenant au tour du poète national anglais Shakespeare (1564 - 1614). Une étude de l'université de Roehampton, réalisée pour le compte du Arts and Humanities Resarch Council du gouvernement britannique, accuse désormais le grand dramaturge d'être responsable, par son héritage littéraire, d'une culture théâtrale "sexiste" et "raciste".
Selon le Telegraph britannique, le directeur de l'étude, Andy Kesson, déplore que "la masculinité et le nationalisme aient été les principales motivations de l'ascension de Shakespeare au rang de référence en matière de grandeur littéraire" et avertit : "Nous devons considérer la place de Shakespeare dans le théâtre contemporain avec beaucoup, beaucoup plus de méfiance".
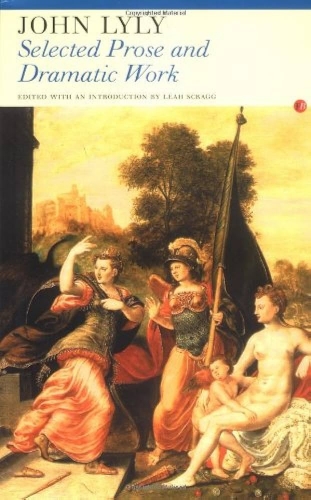 En revanche, l'étude fait l'éloge d'un contemporain de Shakespeare, John Lyly (1553/54 - 1606), aujourd'hui largement inconnu. La pièce "Galatea" de ce dernier offrirait un regard bien plus varié sur la société et serait donc bien plus susceptible d'être mise en avant en tant que bien culturel national. En revanche, la raison du succès de Shakespeare est une culture de la virilité et du nationalisme, estime l'auteur de l'étude, Kesson.
En revanche, l'étude fait l'éloge d'un contemporain de Shakespeare, John Lyly (1553/54 - 1606), aujourd'hui largement inconnu. La pièce "Galatea" de ce dernier offrirait un regard bien plus varié sur la société et serait donc bien plus susceptible d'être mise en avant en tant que bien culturel national. En revanche, la raison du succès de Shakespeare est une culture de la virilité et du nationalisme, estime l'auteur de l'étude, Kesson.
L'opinion publique britannique n'apprécie pas le démantèlement du poète national. Ainsi, le député conservateur Jane Stevenson, membre de la commission culturelle du gouvernement britannique, souligne : "Les œuvres de Shakespeare ont été traduites dans une centaine de langues et continuent manifestement d'influencer les gens dans le monde entier. L'amour, la haine, l'ambition, la perte, la jalousie - toutes ces émotions sont universelles et nous pouvons tous encore nous identifier à elles".
Le satiriste et journaliste nord-irlandais Andrew Doyle est du même avis : "Il y a une très bonne raison pour laquelle Shakespeare est si souvent joué et John Lyly si rarement. Shakespeare était de loin le dramaturge supérieur. Les idéologues réduisent une fois de plus le grand art à de simples mécanismes de promotion d'une idéologie" (mü).
Demandez ici un exemplaire de lecture gratuit du magazine d'information allemand ZUERST ! ou abonnez-vous ici dès aujourd'hui à la voix des intérêts allemands !
Suivez également ZUERST ! sur Telegram : https://t.me/s/deutschesnachrichtenmagazin
21:28 Publié dans Actualité, Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : shakespeare, lettres, lettres anglaises, littérature, littérature anglaise, wokisme, cancel culture |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

"La beauté éternelle et intemporelle est préfigurée par l'éphémère". Jünger et les insectes
par Michele (Blocco Studentesco)
Source: https://www.bloccostudentesco.org/2024/03/21/bs-eterna-bellezza-senza-tempo-junger/
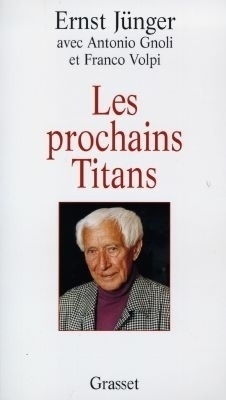 "Observer la vie de la nature, dans le petit comme dans le grand, est un spectacle incomparable, une occupation qui me procure de la sérénité". C'est ainsi qu'Ernst Jünger a expliqué sa passion pour l'entomologie aux journalistes italiens Antonio Gnoli et Franco Volpi lors d'une série de conversations datant de 1995, qui ont ensuite été rassemblées et publiées sous le titre Les prochains Titans. Un intérêt qui est bien plus qu'une curiosité, mais que l'auteur allemand considère comme égal à celui pour la littérature : "D'habitude, tout le monde me considère comme un écrivain et considère mes intérêts entomologiques comme une extravagance. Pour moi, ce sont deux passions tout aussi épanouissantes l'une que l'autre, et je ne les sépare pas".
"Observer la vie de la nature, dans le petit comme dans le grand, est un spectacle incomparable, une occupation qui me procure de la sérénité". C'est ainsi qu'Ernst Jünger a expliqué sa passion pour l'entomologie aux journalistes italiens Antonio Gnoli et Franco Volpi lors d'une série de conversations datant de 1995, qui ont ensuite été rassemblées et publiées sous le titre Les prochains Titans. Un intérêt qui est bien plus qu'une curiosité, mais que l'auteur allemand considère comme égal à celui pour la littérature : "D'habitude, tout le monde me considère comme un écrivain et considère mes intérêts entomologiques comme une extravagance. Pour moi, ce sont deux passions tout aussi épanouissantes l'une que l'autre, et je ne les sépare pas".
L'entomologie est une branche de la zoologie qui étudie les insectes. Jünger a été attiré par cette discipline dès son plus jeune âge, lorsque son père lui a donné, ainsi qu'à ses frères, le matériel nécessaire pour les capturer et les classer. Cette passion l'accompagnera tout au long de sa vie, des journées oisives à la campagne après avoir fait l'école buissonnière, aux brefs moments de répit pendant la guerre juste à côté des tranchées, en passant par les longs voyages autour du monde, en Asie comme en Méditerranée. L'intérêt de Jünger n'était pas seulement celui d'un amateur ou le résultat d'une improvisation, mais pouvait s'appuyer sur des bases scientifiques solides et lui valut plusieurs satisfactions, dont celle d'avoir donné son propre nom à deux nouvelles espèces qu'il avait découvertes : le Carabus saphyrinus juengeri et le Cicindela juengeri juengerorum.
Parmi les nombreuses variétés d'insectes, Jünger s'est surtout consacré aux coléoptères et en particulier aux cicindèles. Une prédilection qu'il justifie ainsi dans Chasses subtiles (1967), en la comparant à celle, plus courante, pour les papillons : "Les coléoptères ne s'offrent pas à l'œil avec autant de grâce. Ils sont plus matériels, plus durs et, en tant que joyaux de la terre, plus proches des fruits que des fleurs, plus proches des coquillages et des cristaux que des oiseaux. Ils ne déploient pas leur beauté d'un coup d'aile. Il est donc facile de comprendre pourquoi ceux qui les aiment sont plus constants que les "amateurs de papillons".
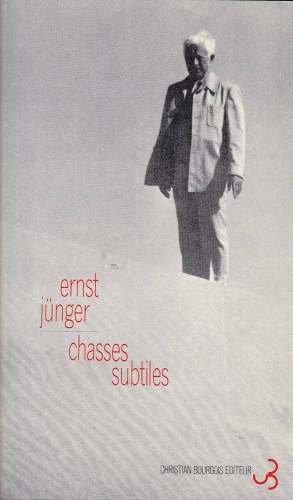

C'est précisément dans Chasses subtiles que l'auteur allemand s'engage davantage dans ces thèmes, en évoquant ses souvenirs et ses expériences personnelles et en les entremêlant de réflexions plus profondes. L'observation de la nature est pour Jünger bien plus qu'un passe-temps. C'est un viatique pour accéder aux couches les plus profondes de la réalité, là où se trouve le domaine de la forme, là où l'éternel se cache derrière le visible, là où, pendant de brefs instants, l'être resplendit : "Ces passions ne dépendent pas du rang des créatures, mais du choix de leur adorateur et de l'endroit où il se trouve. C'est précisément de là qu'il peut apercevoir, dans la mer des phénomènes, l'éclat d'une vague sur laquelle se brise la lumière, et c'est par cette petite fenêtre qu'il peut jeter un regard sur la magnificence de l'univers".
20:25 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ernst jünger, littérature, littérature allemande, lettres, lettres allemandes, entomologie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

L'Enfer et le paradis sont déjà ici-bas
par Luc-Olivier d'Algange
On s’aventure souvent à chercher et à définir le dessein d’une œuvre, alors que sa vocation est de demeurer cachée, impondérable, imprévisible, jusqu’à éclore dans la mémoire et le cœur du lecteur. Cette recherche aventurée, cependant, parfois se justifie par l’apparent disparate d’un livre, placé sous le signe de l’imprévisible et de l’inespéré, et dont la cohérence est destinée à se révéler au cours de la lecture - comme un paysage se précise peu à peu aux détours de la promenade.
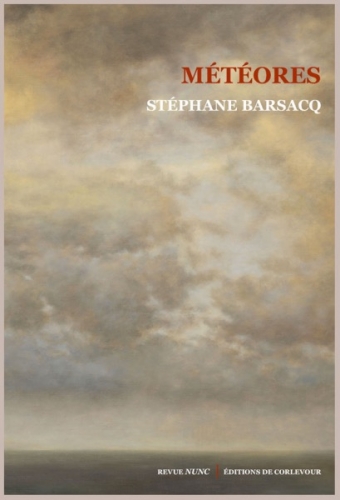
C’est là une des joies que suscitent ces Météores que Stéphane Barsacq (photo) vient de publier aux éditions de Corlevour: quoiqu’ils nous disent, nous savons que ces météores viennent de loin, par surprise - signes du ciel qui est en nous et en dehors de nous, dans l’histoire de la vérité humaine et dans l’éternité des idées, sans oublier la perpétuité du cosmos: «Il est une heure du soir, écrit Stéphane Barsacq, entre six et sept heures où le soleil allonge les oiseaux dans le ciel, cependant que le crépuscule amplifie leur voix, la gonflant d’un vent virtuose de versatilité (…). On progresse soudain dans le ciel par paliers. On va de nuage en nuage, par ascension, à l’infini. Et ceux qui rasent les flots ne sont jamais si noirs que pour laisser le bleu indiquer une hiérarchie commencée à l’horizon».
Comment mieux nous dire que l’art poétique se tient, non dans les savantes constructions des linguistes, mais dans le secret de l’heure du soir, dans le crépuscule qui est le pays de tous les pressentiments? La gradation précise. Loin de nous détourner de l’exactitude, elle la rend possible, dans ce combat subtil de l’esprit contre l’indéfini, le vague ou le confus.
Mais ce ne sera point pour retrouver les prisons rassurantes des catégories, mais pour laisser venir à soi l’infini sans parure. Qu’est-ce qu’un poète alors? Les Météores nous le disent par l’exemple: un homme qui s’engage à combattre l’indéfini par les armes de l’infini.
Dans ce recueil de formes brèves, où il est beaucoup question de musique, Stéphane Barsacq cherche la juste mesure, qui, précisons-le, n’est nullement le sens commun, mais un mystère pythagoricien. Or, la juste mesure se prouve mieux qu’elle ne s’explicite.
La forme brève témoigne de la plus haute exigence, coupant court aux arguties, aux ratiocinations, ou à cette veulerie de l’homme de lettres qui, pour s’assurer d’un succès, tient à tout prix à ce que le lecteur ne soit jamais sollicité au-delà de ce qui fait sa rumeur ordinaire, son ressassement familier. Les lecteurs qui portent les œuvres à travers le temps, au demeurant, ne s’y trompent guère qui portèrent jusqu’à nous, de préférence à des ouvrages plus complaisants ou plus étayés, les fragments d’Héraclite, les pensées de Pascal, les aphorismes de Nietzsche, les «feuilles tombées» de Rozanov, les aperçus à la venvole de la «tête en liberté» du Prince de Ligne ou les Carnets de Joseph Joubert.
Combattre cet indéfini qui ruine les civilisations et attriste les cœurs, le combattre infiniment, le combattre avec, pour allié, l’infini même, ce privilège revient à ceux dont la pensée est « ad usum delphini », royale donc, mais aussi semblables à la vivacité scintillante des dauphins entre la surface et la profondeur de la mer. Ainsi s’accorde la pensée musicale de Stéphane Barsacq, entre l’exigence du style et l’appel du sens, entre le souvenir personnel et l’aperçu général, entre le proche et le lointain que rien ne sépare, en vérité, - mais nous l’apprendrons au fur à mesure, - que l’interstice s’ouvrant sur le Paraclet.

La piété, mieux que la croyance, l’expérience intuitive, plus que la dévotion, ce qu’enfin les Muses nous enseignent depuis qu’elles apparurent, recueille ce qui nous sera une faveur de l’intelligence, du goût et de la bonté - cette victoire surnaturelle sur les «lois de la nature» auxquelles les hommes, qui n’y comprennent rien, veulent adapter leurs cupidités et leur absence de compassion et d’amour: «Ceux qui en ont fait l’expérience savent le caractère indubitable de ces moments où l’on sent brûler en soi le feu de l’amour divin. Alors douleur et joie se confondent. Le royaume de la différence est effacé. Et par là se révèle l’unique réalité.»
Mais pour atteindre le seuil «où l’Ange nous attend», il faut parcourir le monde, être attentif, se laisser environner par la beauté des êtres et des choses, et les ressaisir en se ressaisissant par-delà les confusions et les abandons: «Quoique l’on ait vécu, l’important est de le ressaisir. Qu’importe qui on a été ; qu’importe ce que l’on a fait ; qui on a vu et où on a vécu ; le passé est le passé ; le tout est de s’accorder à la juste mesure de ce à quoi on tend ; d’être en harmonie, en résonance, en présence continue avec ce qui a sens et dit le tout de la vie au moment où l’on vit.»
Une sagesse discrète, venue comme disait Nietzsche, «sur des pattes de colombe», une sagesse qui est, tout au contraire de la résignation, une résistance, - dont l’art littéraire est un des moyens, et non le moindre en des temps où certains voudraient censurer Ovide ou Homère, où le fondamentalisme «anti-logocratique», dépêche ses sbires pour défigurer la langue par le jargon bien-pensant ou l’écriture «inclusive», - se précise ainsi de fragments en fragments, de réminiscences en méditations, dans la considération d’une sorte de «supra-sensible concret» qui ne laisse guère place aux manies moralisatrices où à l’abstraction: «Il n’y va d’aucun jugement de valeur. Pour ma part, je me situe ailleurs: à la fois dans le combat contre la dissolution de ce temps, et dans un effort pour tendre les énergies et sauver ce qui peut l’être, pour le placer sous la lumière éternelle, celle de demain.»

Celle-ci, cependant, requiert que nous quittions la «zone de confort»: «Les peuples de la chrétienté se sont arrangés pour s’installer avec tout un confort chrétien au milieu de tout ce qu’il faut quitter pour être chrétien». La profonde vérité du Christ se révèle non à ceux qui furent des tièdes ou des prudents, mais, par exemple à Oscar Wilde, lorsque, dans sa prison, il écrit sa lettre à Lord Douglas.
Stéphane Barsacq saisit là où elle se trouve, la vérité profonde, celle du « De profundis », en citant précisément ce passage: «Savez-vous, Dear, que c’est la pitié qui m’a empêché de me tuer? Oh pendant les six premiers mois j’ai été terriblement malheureux ; si malheureux que je voulais me tuer ; mais ce qui m’a retenu de le faire, cela a été de regarder les autres, de voir qu’ils étaient aussi malheureux que moi, et d’avoir pitié.»

Rimbaldien, Stéphane Barsacq nous divulgue un secret: celui qui nous dit en nous-mêmes, comme une mise-en-demeure: «là tu te dégages et voles selon». Le purgatoire, l’enfer et le paradis sont déjà, à titre de reflet ou de miroir, ici-bas. Le purgatoire, c’est le nihilisme confortable, le ricanement qui se veut intelligence, mais qui n’est que soumission et ruse pour justifier son incurie. L’enfer, nous le voyons tous les jours, c’est le ressentiment, poussé jusqu’à la haine de soi. Le paradis, enfin, est épars, comme les mots que le poète ressaisit, et se recueille en nous aux moments heureux. «J’ai cinq ou mille ans. C’est le paradis qui revient au cœur: au cœur de cette présence. On comprend que celui-ci a été conçu par des hommes qui n’espéraient nulle consolation ultérieure ; des hommes qui l’avaient arpenté autrefois, et qui savaient que nous allions à lui, même à l’envers.»
Luc-Olivier d'Algange
Météores de Stéphane Barsacq, éditions de Corvelour.
20:08 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, stéphane barsacq, luc-olivier d'algange |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Wyndham Lewis: Vorticisme, avant-gardisme et politique
Par Sara (Blocco Studentesco)
Source: https://www.bloccostudentesco.org/2024/03/25/bs-wyndham-lewis-vorticismo-avanguardia-politica/
Percy Wyndham Lewis: peintre, écrivain, révolutionnaire. Né en 1882 à Amherst et mort en 1957 à Londres, Lewis ne s'est jamais contenté d'être un simple observateur de son temps. En effet, il a bousculé les conventions artistiques avec ses peintures guerrières et son style féroce et déshumanisant.
Wyndham Lewis, dans la ferveur artistique du début du 20ème siècle, ne se contente pas de suivre les courants existants. Entre 1913 et 1915, animé par un désir de nouveauté et de critique, il forge le vorticisme. S'associant à Ezra Pound, il transforme son attirance pour le cubisme et son insatisfaction pour le futurisme en une synthèse explosive, créant un mouvement qui vise à capturer l'essence dynamique de la modernité sans en perdre la structure. BLAST, la revue vorticiste, est devenue la trompette de ce nouvel ordre artistique, attaquant avec véhémence les conventions et promouvant une vision radicalement nouvelle du monde.




L'une de ses premières œuvres les plus importantes s'intitule The Wild Body (1927; Le corps sauvage), un recueil de nouvelles qui se présente comme une déflagration contre le conventionnalisme, tant sur le fond que sur la forme. Dans The Wild Body, Lewis dépeint un panorama grotesque de personnages inadaptés, incarnations vivantes de l'impatience de l'auteur à l'égard de l'ordre social établi. Cet univers fictif est habité par des personnages qui, dans leur primitivité et leur nature prédatrice, représentent une célébration de l'élément sauvage de l'existence. C'est une rébellion contre la stérilisation de la vie moderne, un cri pour un retour à une énergie plus brute et vitale, considérée par Lewis comme fondamentale pour la régénération de l'esprit humain.
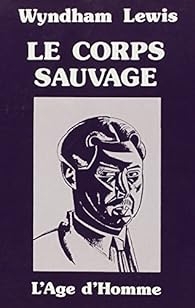
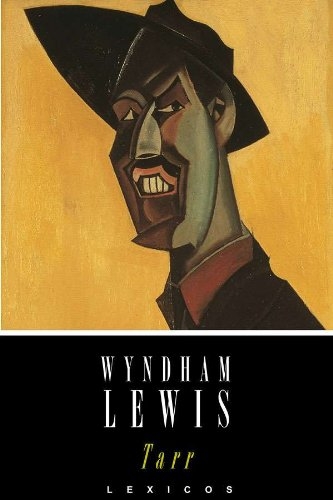
Tarr (1918) est considéré comme le chef-d'œuvre de Lewis. Situé dans le Paris d'avant-guerre, le roman explore la dynamique complexe entre les membres de la communauté artistique de Montmartre, en mettant l'accent sur les relations interpersonnelles et le contraste entre l'authenticité artistique et la prétention. L'histoire se concentre sur deux personnages en particulier, l'Anglais Frederick Tarr et l'Allemand Otto Kreisler, auxquels correspondent deux figures féminines Bertha et Anastasya. À l'intelligence lucide et authentiquement artistique de Tarr répond la finesse et l'intelligence sans préjugés d'Anastasya, tandis qu'à la fadeur du pseudo-artiste Otto répond la superficialité de la bourgeoise Bertha. L'histoire est menée avec sarcasme et ironie, stimulée par le rejet méprisant de Lewis du monde de l'art typiquement socialiste et freudien de son époque. Le personnage de Frederick Tarr, avec ses qualités "mécaniques" de froideur et de lucidité, transforme l'autodestruction moderniste en une force destructrice projetée vers l'extérieur, incarnant la tension nietzschéenne de l'impulsion vitale. En fait, Lewis, comme Tarr, rejette l'immersion dans l'introspection psychologique en faveur d'une exploration de l'extériorité, en utilisant une prose dure et "rugueuse" qui vise à déshumaniser et à objectiver les personnages afin de capturer leur essence à travers la tangibilité des objets plutôt qu'à travers une analyse interne.
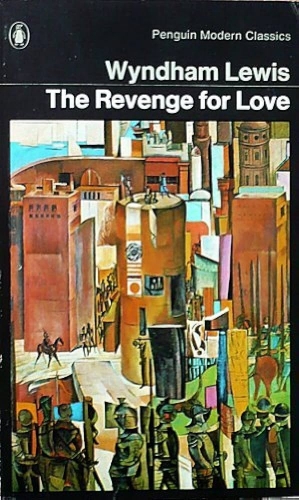
Le ton de Revenge for Love (1937) est tout aussi méprisant : Lewis y dépeint avec mépris l'idéalisme abstrait des intellectuels anglais de gauche, qui s'ennuient et s'entichent du communisme, dans les années précédant le déclenchement de la guerre civile espagnole, au cours de laquelle se déroule le début du roman.
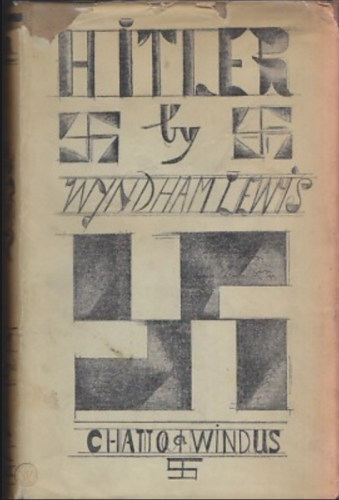
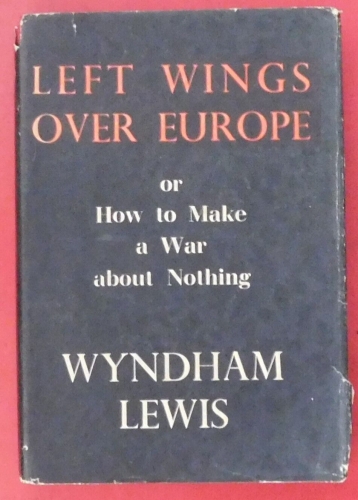
Parmi ses écrits les plus "controversés", on peut certainement citer Hitler (1931), qui témoigne de son adhésion, surtout dans les années 1930, à l'idéologie fasciste, consolidée plus tard par sa contribution au British Union Quarterly de Mosley. En 1936, il écrit également Left Wings over Europe : or, How to Make a War About Nothing dans lequel il s'oppose à la guerre en cours, arguant que la population britannique ne soutient pas la déclaration de guerre contre l'Allemagne.

À une époque qui récompensait le conformisme et la faiblesse, son art et ses mots étaient des grenades lancées dans les bons salons de l'intellectualité, scandalisant les bien-pensants avec ses idées toujours contre-culturelles. Son héritage ne réside pas tant dans le contenu qu'il a créé que dans le défi qu'il a lancé : oser, toujours. Maître du contrecoup culturel, sa figure reste un rappel vivant que l'art véritable ne cherche pas l'approbation, mais génère la discussion.
20:21 Publié dans art, Littérature | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : art, avant-gardes, vorticisme, lettres, lettres anglaises, littérature anglaise, littérature, wyndham lewis |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
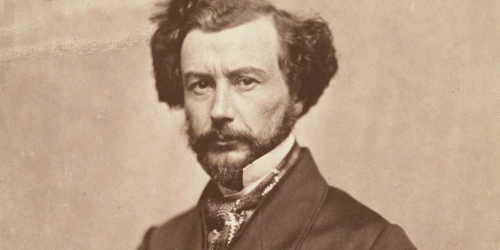
Maxime du Camp et l’éternel ridicule français en 1870
Nicolas Bonnal
On a du mal à percevoir l’absence de mouvement sous le mouvement.
1870, la fête impériale, l’art de bien rigoler…
On laisse écrire Maxime du Camp.
Sur Bismarck :
« Bismarck fut habile, il agit envers nous comme en 1866 il avait agi à l'égard de l'Autriche. Quand il eut machiné son plan et préparé ses pièges, il se fit déclarer la guerre et prit l'attitude d'un pauvre homme réduit à la défensive; il mit les torts d'apparence de notre côté. Comme un pêcheur consommé, il conduisit le poisson dans la nasse sans que celui-ci s'en aperçût. »
Après une belle phrase sur notre esprit de décision :
« Il avait pris pour une démonstration de notre force ce qui n'était qu'une preuve de l'inconséquence de notre caractère. »
Maxime du Camp passe par l’Allemagne et il découvre que cette nation est scientifique, organisée et disciplinée, mais pas seulement : elle est inspirée spirituellement et elle chante bien :
« J'entendis de loin une mélopée lente et grandiose, qui montait dans les airs comme la voix d'un chœur invisible. Des enfants couraient dans la direction du bruit; le chant se rapprochait, s'accentuait, vibrait avec un accent religieux et profond dont je me sentis remué. Je reconnus le Choral de Luther, que psalmodiait un régiment en venant prendre garnison dans la citadelle que ce pauvre général Mack nous a jadis si facilement abandonnée. Je fus très ému, je l'avoue, et je me demandai quel caractère allait revêtir cette guerre pour laquelle les hommes marchaient en chantant des psaumes. »
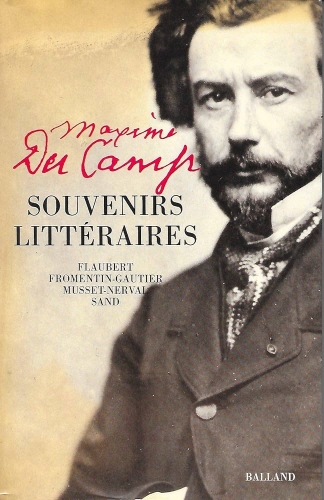
Après on va faire la comparaison avec Paris et sa salade impériale :
« Après avoir rapidement traversé la Suisse, j'arrivai à Paris, que l'empereur avait quitté deux jours auparavant.
Là le spectacle était autre : le soir, sur les boulevards, on buvait de l'absinthe en agaçant les filles; des hommes en blouse, vautrés dans des voitures découvertes, braillaient la Marseillaise. Qui donc avait vieilli, le chant national ou moi? Je ne sais. Il me déplut et je lui trouvai un air provocant qui ne s'adressait pas à l'ennemi. »
C’est Tartarin contre Siegfried. Et si Tartarin était l’essence de la France moderne (voyez mon texte sur Tartarin dans les Alpes) ? J’ai cité plusieurs fois cette ligne de Céline :
« Et les Français sont bien contents, parfaitement d’accord, enthousiastes. »
Voilà celle de Maxime du Camp en 1870 :
« Se souvient-on aujourd'hui de la frénésie dont la population fut atteinte? On se croyait tellement certain de la victoire, que les adversaires systématiques de l'empire, — les irréconciliables, — demandaient la paix. »


Après la reddition de Sedan, la république arrive avec ses bienfaits ! Première divine surprise :
« Le 4 septembre, j'étais au Journal des Débats; cette fois c'était bien fini; la révolution tendait la main à l'invasion et complétait son œuvre. La plupart de ceux qui se trouvaient dans le bureau de rédaction étaient accablés.
Quelqu'un entra et dit : « C'est égal, nous voilà débarrassés des Bonaparte! ». Oui, débarrassés des Bonaparte, mais débarrassés aussi de l'Alsace, de la Lorraine, débarrassés de cinq milliards, de beaucoup de monuments de Paris que l'on a brûlés et de quelques honnêtes gens que l'on a massacrés. »
Une belle phrase sur la France :
« La France était comme ces hommes frappés de la foudre qui gardent l'apparence de la vie et tombent en poussière dès qu'on les touche ».
Après on cherche comme toujours des excuses (euro, Bruxelles, etc.) :
« La nation crie, pleure, se désespère, déclare qu'elle est innocente et que l'empire seul est coupable. La nation a tort; elle a eu ses destinées entre les mains, qu'en a-t-elle fait? Nous mourrons par hypertrophie d'ignorance et de présomption. »
Du Camp se met à rêver :
« La France a cherché les réformes politiques : néant; elle a cherché les réformes sociales : néant; mais les réformes morales qui seules peuvent la sauver, elle n'y pense même pas. Si j'étais le maître, je traiterais tout de suite, quitte à subir des conditions léonines, car l'issue de la guerre ne peut actuellement être douteuse, et plus nous prolongerons la lutte, plus les conditions seront dures; puis je ferais des lois draconiennes pour organiser le service militaire et l'enseignement, l'enseignement surtout, non seulement scientifique, mais moral. C'est la morale qui forge les caractères et ce sont les caractères qui font les nations. »

Maxime du Camp comprend enfin :
On ne fera pas cela, sois en certain; on va expliquer au peuple français qu'il est le premier peuple du monde, qu'il a été trahi, qu'il a été livré, en un mot qu'il est indemne, et le peuple français continuera à croupir dans l'ignorance, à avoir le moins d'enfants possible, à boire de l'absinthe et à courir les donzelles. Nous mourrons, parce que nous sommes agités sans but et que la danse de Saint-Guy n'est pas le mouvement; nous n'avons pas d'hommes, parce que nous n'avons pas d'idées; nous n'avons pas de principes, parce que nous n'avons pas de mœurs. »
Dans mon livre sur Céline, j’ai évoqué le latin conifié par les mots. Idem ici :
« Nous sommes saturés de rhétorique; nous avons des façades de croyance, d'opinion, de dévouement; derrière il n'y a rien. Tout est faux, tout est théâtral, nous sommes des Latins; chez nous, comme pour le baron, tout est « pour paraître ». C'est la fin du monde. Il y a une phrase des Mémoires d’outre-tombe qui m'obsède et sonne en moi comme un glas funèbre :
« Il ne serait pas étonnant qu'un peuple âgé de quatorze siècles, qui a terminé cette longue carrière par une explosion de miracles, fût arrivé à son terme. »
Du Camp a une bonne idée qui eût pu éviter des déboires, et il prévoit même l’espace vital et sa conquête à venir :
« Au lieu de ces territoires, offrir nos colonies, en vertu de ce principe qu'il vaut mieux se faire couper les cheveux que de se laisser couper la tête. Malgré sa richesse, l'Allemagne étouffe, parce qu'elle n'a pas la vraie mer, qui est l'Océan; elle est insuffisante à consommer ses produits, qu'elle n'écoule que difficilement; elle est trop restreinte pour sa population, qui est forcée d'émigrer en Amérique. On peut donc la tenter sérieusement en lui proposant nos colonies des Antilles et nos stations dans l'Indochine. »
Évidemment il y a un risque avec… l’Angleterre !
« Si elle consent à cet échange (et je crois qu'on peut l'y amener), elle voudra devenir une puissance maritime de premier ordre et elle aura alors à s'entendre avec l'Angleterre. »
Du Camp dans ces lignes géniales prévoit donc la guerre Allemagne-Angleterre (voyez Preparata et quelques autres) et aussi la haine franco-allemande qui va dévaster l’Europe :
« Toute gentillesse, comme eût dit Montaigne, est perdue pour longtemps, un monde va commencer; on élèvera les enfants dans la haine des Prussiens ! »
La France commence à creuser sa tombe. Et quand elle touche le fond, elle creuse encore ! Du Camp :
« Rien de ce que Flaubert avait rêvé ne se réalisa, le quelque chose qui lui avait promis la victoire s'était trompé; de défaite en défaite on descendit jusqu'à l'endroit où la terre manque sous les pieds. »
La guerre de 1870 a tué la France, c’est mon sentiment. Après nous sommes en république, et la troisième république, ce n’est plus la nation ni la patrie. Elle tue net Mérimée et achève Théophile Gautier :
« La guerre, la révolution du 4 septembre, la Commune ont porté à Théophile Gautier un coup dont il a toujours souffert; il a traîné, ou plutôt il s'est traîné jusqu'à la tombe, languissant, enveloppé d'ombre, parlant peu et n'ayant plus guère que des regrets. »
Sources
Maxime du Camp, Souvenirs littéraires, II, p.348-sq (archive.org)
18:56 Publié dans Histoire, Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : maxime du camp, 1870-71, france, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, nicolas bonnal, histoire |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Nicolas Bonnal
On l’a vu avec Trump : les pacifistes sont toujours considérés comme des nazis. Celui qui veut l’humanité cuite au nucléaire (péril chinois, russe, arabo-iranien, nord-coréen, etc.) est le héros humanitaire et démocrate et nobélisable. C’est le Malhuret qui menace tout le monde « pétainiste-poutiniste » ou « wokiste-poutiniste » (et la croisade LGBTQ de Biden et Ursula-Macron alors ? Elle est wokiste la Russie ?) comme il menaçait hier les non-vaccinés.
Mais on ne la refera pas leur république. Elle aime s’envoyer en l’air sur les champs de bataille – et ce depuis le début.
C’est comme ça, on ne discutera pas. On nous fait le coup de Churchill à chaque fois, l’homme qui rasa gratis l’Allemagne, affama l’Inde et livra l’Europe à la Russie soviétique.
On rappelle ce que l’on peut dire sur cette histoire de Céline et du pacifisme.

Dans le Voyage au bout de la nuit le mot n’apparaît pas.
Dans les pamphlets le mot apparaît et désigne Léon Blum et sa bande, mais ce sont eux bien sûr dit Céline qui veulent la guerre. A la fin de Bagatelles il se dit quand même plus pacifiste que Blum. Le partisan de la paix (Macron, Biden, Malhuret, Valls, BHL) veulent atomiser la Russie ou la repousser (on ne leur a pas encore dit que ce serait difficile ?) jusqu’au Kamtchatka mais c’est parce qu’ils sont pacifistes. En ordonnant à Sarkozy de détruire la Libye, BHL précisait qu’il le faisait parce qu’il détestait la guerre.
Toute ressemblance avec la novlangue, etc.
Après la guerre, Céline se désignera comme pacifiste. Mais les pacifistes sont alors les nazis, comme Charles Lindbergh et les partisans d’America First en Amérique (Hitchcock les accuse de nazis, les pacifistes ricains : voyez mon livre). John T. Flynn reprochera à Lindbergh sa bourde du 11 septembre (tiens, tiens, c’est le jour du honni discours de Des Moines !) lorsque Lindbergh accuse le gouvernement américain, les Anglais mais aussi les Juifs de pousser à la guerre. C’était la fin pour les pacifistes américains, et ils seraient nazifiés ad vitam. Depuis lors toutes les interventions militaires sont jugées favorablement et célébrées en Amérique. C’est le Truman (Harry) chaud qui commence !
Raser et bombarder le monde au nom de la lutte contre la barbarie.
Sinon on est nazi.
Evidemment on pourrait dire que l’on se paie de mots et qu’on n’ira pas loin. Céline encore :
« Si c’était par la force des mots on serait sûrement Rois du Monde. Personne pourrait nous surpasser question de gueule et d’assurance. Champions du monde en forfanterie, ahuris de publicité, de fatuité stupéfiante, Hercules aux jactances. Pour le solide: la Maginot ! le Répondant : le Génie de la Race ! Cocorico ! Cocorico ! Le vin flamboye ! On est pas saouls mais on est sûrs ! En file par quatre ! Et que ça recommence ! »
Céline se trahit le 6 août 1946 (premier anniversaire d’Hiroshima) dans une lettre :
« Si j’ai attaqué les juifs c’est que je les voyais provocateurs de guerre et que je croyais le national-socialisme pacifiste ! ».
C’est vrai que le national-socialisme en a déçu beaucoup après. S’il avait fini l’Angleterre au lieu de s’en prendre à la Russie… Le grand scénariste Dalton Trumbo était opposé à l’intervention contre l’Allemagne jusqu’au 22 juin 41. Il était communiste, et il croyait au pacte germano-soviétique.
Il dit aussi dans une autre lettre notre écrivain :
« Je n’ai jamais été nazi. Je suis un pacifiste et c’est tout. J’ai été antisémite par pacifisme. »
Cela suffit à diaboliser le pacifisme.
D’où les guerres à mort à venir contre la Chine ou la Russie etc.
Trump devra faire guerre ou il sera tué et remplacé : par amour de la paix.

L’économiste-philosophe-historien-pacifiste juif libertarien Murray Rothbard (foto) souligne cette infamie avec le sourire. Mais c’est hélas somme ça. C’est parce qu’on adore la paix partout qu’on veut la guerre, la guerre universelle. Il faut faire un monde sûr pour la démocratie dit le couillon Wilson qui brise l’Europe et crée en 1918 le soviétisme et les conditions du nazisme. Mais rien ne les arrêtera. On le cite encore et toujours notre Ferdinand furioso :
« Une telle connerie dépasse l’homme. Une hébétude si fantastique démasque un instinct de mort, une pesanteur au charnier, une perversion mutilante que rien ne saurait expliquer sinon que les temps sont venus, que le Diable nous appréhende, que le Destin s’accomplit. »
Pacifisme donc : le mot n’est pas présent dans le Voyage. C’est quand il parle à Lola que notre pacifiste sans le savoir parle le mieux de son refus de la guerre. Il y a le refus de la guerre perso, charnelle, et le refus de la guerre totalitaire, globale (la Deuxième Guerre, la première est encore humaine, elle a encore des relents charnels franco-allemands, c’est celle d’Adenauer et de De Gaulle). Ici Céline parle de la première et il en est bouleversant parce qu’il dit honnêtement qu’il veut sauver sa peau et ne pas mourir pour rien, même s’il va en perdre l’amour de sa belle américaine (il aurait dû se taire peut-être ? Mais il n’a jamais su se taire ce fanfaron avec la Lola) :
« ce qu’il y a dedans… Je ne la déplore pas moi… Je ne me résigne pas moi… Je ne pleurniche pas dessus moi… Je la refuse tout net, avec tous les hommes qu’elle contient, je ne veux rien avoir à faire avec eux, avec elle. Seraient-ils neuf cent quatre-vingt-quinze millions et moi tout seul, c’est eux qui ont tort, Lola, et c’est moi qui ai raison, parce que je suis le seul à savoir ce que je veux : je ne veux plus mourir. »

Ce « Je ne veux plus mourir » est sublime. Mais il fallait dire peut-être à la belliciste yankee : je ne veux pas mourir comme ça ou pour ça (pour la république ou même Jeanne d’Arc car la Lola le bombarde avec Jeanne d’Arc et on utilise alors la figure de Jeanne pour vendre des bons du trésor-guerre en Amérique). Le jeu de la vérité en valait-il la chandelle ? Il n’est pas traité de nazi mais de lâche. Il insiste quand même avec un bon jeu de mots :
— Alors vivent les fous et les lâches ! Ou plutôt survivent les fous et les lâches ! Vous souvenez-vous d’un seul nom par exemple, Lola, d’un de ces soldats tués pendant la guerre de Cent Ans ?… Avez-vous jamais cherché à en connaître un seul de ces noms ?… Non, n’est-ce pas ?… Vous n’avez jamais cherché ? Ils vous sont aussi anonymes, indifférents et plus inconnus que le dernier atome de ce presse-papier devant nous, que votre crotte du matin…
La postérité c’est pour les asticots dira-t-il.
Puis dans un bel élan infinitif notre auteur assène (son prof prisonnier Princhard en fait, l’idole du début du Voyage) :
« Engraisser les sillons du laboureur anonyme c’est le véritable avenir du véritable soldat ! Ah ! camarade ! Ce monde n’est je vous l’assure qu’une immense entreprise à se foutre du monde ! Vous êtes jeune. Que ces minutes sagaces vous comptent pour des années ! »
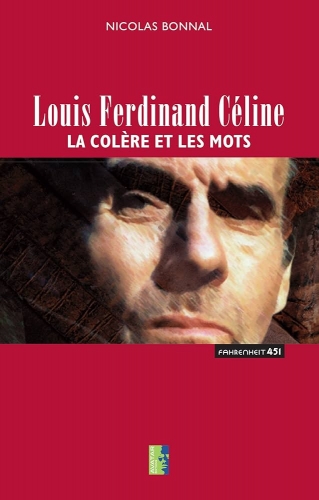
Mais finalement on lui laisse quand même le dernier mot parce que c’est Céline et parce qu’il a raison. La guerre démocratique, humanitaire ou pacifiste… la guerre pacifiste est un scandale éternel à l’horizon. Charles Beard l’a dit en Amérique que ce sera « la guerre perpétuelle pour une paix perpétuelle » :
« Les hommes qui ne veulent ni découdre, ni assassiner personne, les Pacifiques puants, qu’on s’en empare et qu’on les écartèle ! Et les trucide aussi de treize façons et bien fadées ! Qu’on leur arrache pour leur apprendre à vivre les tripes du corps d’abord, les yeux des orbites, et les années de leur sale vie baveuse ! »
Princhard conclut avec infinitifs, accumulation et gradation :
« Qu’on les fasse par légions et légions encore, crever, tourner en mirlitons, saigner, fumer dans les acides, et tout ça pour que la Patrie en devienne plus aimée, plus joyeuse et plus douce ! »
Ils vont faire la guerre à cette Russie (qui est trop molle depuis le début, je suis d’accord avec Craig Roberts, et aura donc enhardi tous les pacifistes démocrates et démocratiques et autres) et on aura les charniers remplis et puis niés, et on aura la Bombe, et on aura la chasse aux collabo-pacifistes.
On sait comment finit Jean Jaurès.
15:51 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, nicolas bonnal, pacifisme, bellicisme, littérature, littérature française, lettres, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
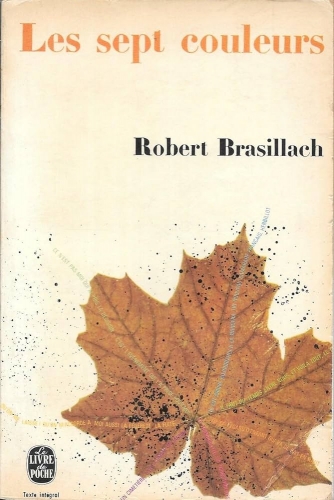
"Les Sept Couleurs" de Robert Brasillach
Entre roman et conte de fée
Par Frédéric Andreu
L'enfant rêveur évolue dans un monde double, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Les personnes qu'ils croisent sur le chemin de l'école ressemblent parfois aux princes et princesses des légendes. Plusieurs temps se mêlent dans ses rêves. Dans mon cas, il m'arrivait de croire que ma mère et mon père n'étaient pas mes "vrais" parents. Jusqu'à six ou sept ans, je croyais vivre dans une sorte de décor de théâtre, où s'agitaient des acteurs plus ou moins conscients de l'être. Ce jeu de rôle entre réalité et fiction est sans doute l'un des phares éclairant le lecteur des "Sept Couleurs", chef d'oeuvre de Robert Brasillach.
Ce roman étonne déjà par le titre. En ouvrant le livre au hasard, on se demande quel arc-en-ciel va s'ouvrir ? Très vite, l'ouvrage étonne par cette délicatesse de style que l'on reconnait à Brasillach. En ouvrant ce roman rare, vous découvrirez, par les yeux de Patrice et Catherine - les personnages principaux du récit - les merveilles que peut offrir le Paris de 1926. Le Bois de Boulogne, le Musée Grévin, la Tour Eiffel... mais aussi, cette petite église Saint-Germain de Charonne. L'église y apparaît telle "une épave merveilleuse d'un ancien village". Suivie du village éponyme, du cimetière, des tombes qui le composent décrites avec tellement de bonheur d'expression. À l'intérieur du cadre spatial (quartier de Charonne, Est de Paris) et temporel (nous sommes en 1926), vous serez aussi et surtout les témoins amusés d'un incroyable impromptu féerique. Patrice, le jeune homme, et Catherine, la jeune fille, vont bras-dessus bras-dessous, accompagnés de bien curieux personnages... Au cours du récit, nous apprenons que ce quartier, les trésors qu'il renferme, fut découvert par hasard un jour où - précise le narrateur - "Patrice s'était trompé d'autobus".
Patrice connaissait donc Charonne, mais ce lieu atypique au coeur de Paris, il voulait le faire découvrir à sa belle. Pour quelle raison ? Afin de visiter, ensemble, un cimetière beau comme un jardin, avec des tombes fleuries et d'autres pas. Mais peut être pas seulement pour cela.

Patrice savait-il que son double enfantin le rencontrerait dans un cimetière ? Certainement pas. Cher lecteur, avant de vous révéler le pourquoi du comment sur cette rencontre pour le moins insolite, quelques mots descriptifs sur ce cimetière s'imposent : tout d'abord, son nom : Saint-Germain de Charonne. Le cimetière fait corps avec une église, partie liée avec un ancien village. Tous ces lieux ont gardé un peu de leur atmosphère d'antan. Il ne s'agit aucunement d'un lieu fictif ; d'aucun peut visiter ce quartier Charonne, monter les marches de cette église en descendant à la station de métro éponyme.
Mais alors que les jeunes amis passe devant la tombe de Bègue (secrétaire de Robespierre), un étrange petit personnage fait son apparition. Amusant et espiègle. Le récit narratif bascule dans un autre temps. Je dirais que le métier à tisser narratif pivote soudainement du fil blanc du réalisme au fil rouge de la légende. Résultat, le "textus" change d'affectation. Le réalisme de la phrase A bascule soudainement à la fiction de la phrase B. En l'espace d'un blanc entre deux phrases, le monde bascule. Phrase A : le narrateur décrit une tombe du cimetière ; phrase B : un petit garçon apparaît, de six ou sept ans. Que fait-il au milieu du cimetière ? Il a un rendez-vous avec une jeune fille. Comment s'appelle-t-il? Patrice. Et la fillette qu'il attend, comment s'appelle-t-elle? Elle s'appelle Catherine, tout comme les protagonistes du roman ! Ce "double enfantin" de Patrice et Catherine, quel rôle joue-t-il dans la trame narrative ?

Il joue le rôle de guide dans le Charonne à la fois réel et féérique du chapitre I. Quelques pages d'une rare beauté, caractéristique de la magie de l'auteur font dessiller nos yeux : les protagonistes ne se transforment ni en fées ou loups-garous, rien de spectaculaire, mais rencontrent leur double légendaire. Voulez vous savoir pourquoi cette partie est selon moi, un moment clé, non seulement du roman "les Sept Couleurs" mais de toute l'œuvre de Robert Brasillach ? C'est parce qu'on y perçoit, mieux qu'ailleurs dans l'oeuvre protéiforme de R.B., les modalités de sa pensée symbolique. Le réel rentre en contact avec le surréel de la légende. A titre de comparaison, nous pourrions dire que le spectre des couleurs visibles laissent apparaître l'infrarouge et l'ultraviolet, invisibles à l'œil nu. D'ailleurs, le roman ne se nomme t-il pas "les Sept Couleurs ?
Mais comment s'articule, dans le texte, ce "double regard" ? Encore une fois : point de "grenouille transformée en prince", point de fée clochette à la sauce Walt Disney, l'art de Brasillach consiste à faire co-exister le réalisme et le féerique, les couleurs visibles et invisibles du récit.
Deux "temps" coexistent dans un même récit. L'apport de Brasillach dans la littérature c'est, résumé en huit mots, cela : "la double postulation du réel et du merveilleux". Avant lui, le conte de fée, conservatoire du monde de l'enfance, se chargeait de nous dévoiler le merveilleux de l'existence ; le roman se chargeait de nous dire la société et ses travers. Brasillach innove en inventant un nouveau genre narratif situé "quelque part" entre le conte de fée et le roman. Il est donc, ni plus ni moins, le créateur d'un nouveau genre narratif.
Intrigué par le dialogue entre les personnages et leur "double enfantin", témoin de leur complicité, témoin aussi du déjeuner qu'ils partagent dans l'espace du cimetière, es-tu surpris, lecteur, par le dénouement final de la scène ? Les deux couples se séparent, certes, mais non sans invite à se revoir. "Quand vous reviendrez, vous n'aurez qu'a revenir ici" s'écrit le petit Patrice. Le curieux personnage les invite chez lui : "Regardez bien le numéro. Vous nous demanderez. S'il n'y a personne vous tirerez la bobine de la ficelle et vous entrerez" s'écrit le petit Patrice au seuil du départ.
La bobine de ficelle, ne rime-t-elle pas avec une sorte d'initiation secrète ? On rentre dans la maison du petit Patrice comme dans une cabane au fond des bois. Le petit homme explique comment entrer secrètement dans la maison, en passant la main par un trou situé dans l'huis... où un fil permet d'ouvrir la porte... simple jeu d'enfant, fil de bobine et aussi, fil métaphorique d'une trame narrative nouvelle. Non celle du roman, mais celle du conte merveilleux !
Vient ensuite l'heure des "au revoir". En terminant la partie intitulée "Les Doublures du Destin", par un "Au revoir Petit Chaperon Rouge !" le narrateur confirme ce que l'on pressentait tout au long du texte. Quelque chose d'extraordinaire se produit ; un personnage de conte de fée - le petit Chaperon Rouge – a fait irruption dans le roman de Brasillach, et nous ne le savions pas.
On remonte alors le cours du temps, et on se rend compte que tout un réseau d'indices et de pistes anticipait la rencontre. Par exemple, au début du chapitre II, Catherine compte ses frères et sœurs "sur ses doigts", comme le font les enfants. Combien a-t-elle de frères et de sœurs ? Sept, nombre clé du conte de fée. Un grand nombre de détails tend à avertir le lecteur : ce roman, est certes un roman réaliste, il raconte la visite de deux jeunes gens dans Paris, mais il contient aussi des éléments du registre merveilleux. À sa manière, Robert Brasillach nous fait éprouver l'existence de la pluralité des mondes. On pressent que l'extraordinaire n'est rien d'autre que l'ordinaire dévoilé. Pour se faire, son roman nous prévient : la trame de nos vies n'est pas composée de 50 % de réalisme et de 50 % de merveilleux, mais plutôt de 100 % de l'un et de 100 % de l'autre. Toute rencontre peut être merveilleuse si elle croise le destin de quelqu'un pour qui voir l'autre ne va pas de soi. Au cours de la partie intitulée "Les Doublures du destin", la description réaliste de la tombe de Bègue précède l'apparition du petit enfant. Le narrateur choisit l'ordinaire d'un contexte ( la description d'une tombe dans un cimetière est de cet ordre), pour mieux surligner l'extra-ordinaire irruption du petit Patrice.

Ce roman fourmille d'autres exemples où l'ordinaire et l'extraordinaire co-existent et s'annoncent l'un l'autre. Une thèse entière suffirait à peine à en faire le tour ? Il y a aussi un autre moyen subtil de pallier à cette difficulté de recensement. Cet autre moyen, le voici : lisez simultanément la première et la dernière phrase de quelques chapitres, et voyez ce que cela donne. La première phrase des Doublures du destin est "Catherine ne connaissait pas Saint-Germain de Charonne ; la phrase finale est "Au revoir, petit Chaperon Rouge!". C'est justement à Catherine, héroïne du roman - et premier mot du chapitre - que le Petit Garçon s'adresse. Pourquoi ? Parce que n'étant jamais venu auparavant dans le quartier Charonne, elle pose sur lui un regard neuf.
Robert Brasillach n'a pas besoin de se perdre et de nous perdre dans le labyrinthe des concepts philosophiques. Nul besoin de composer une énième théorie de littérature comparée réservée à quelques spécialistes ; il laisse tout simplement parler ses personnages. Ce sont eux - et non lui - qui nous intiment l'extraordinaire de nos rencontres. Si nous gardons nos âmes légendaires, une rencontre peut bouleverser notre vie, blasonnant notre existence non pas de belles paroles, mais de paroles belles.
19:42 Publié dans Littérature, Livre, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : robert brasillach, littérature, lettres, littérature française, lettres françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 470 du Bulletin célinien
Sommaire :

Le modèle de Mme Bérenge : Barbe Domis (1856-1935)
Entretien avec Stéphane Zagdanski
Bagatelles pour un massacre loué par un militant sioniste (1944)
Divorce à Rennes
De Céline à Beethoven
Ramuz et Céline
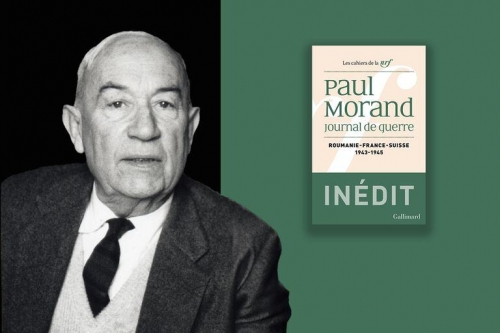
• Paul MORAND, Journal de guerre, I (Londres – Paris – Vichy, 1939-1943) & Journal de guerre, II (Roumanie – France – Suisse, 1943-1945), Gallimard, coll. “Les cahiers de la nrf”), 2 vol. de 1028 et 1042 p. Édition établie, présentée et annotée par Bénédicte Vergez-Chaignon (27 & 35 €)
13:26 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, littérature françaiise, lettres, lettres françaises, louis-ferdinand céline, paul morand |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Relire Drieu La Rochelle, Le jeune européen
par Gennaro Malgieri
Source: https://www.destra.it/home/gioielli-ritrovati-rileggere-drieu-la-rochelle-il-giovane-europeo/
Si, à vingt-huit ans, un jeune intellectuel français éprouve le besoin d'écrire son autobiographie et entreprend, avec le flair d'un écrivain mûr qui a traversé la guerre en compagnie de la littérature, de se raconter dans son intimité, pourquoi ne se représenterait-il pas comme "le jeune Européen", à peine plus âgé, trente-quatre ans, capable de défier le vieux monde décrépit et inutile dans lequel il erre avec l'arme de l'écriture persévérante qui lui ouvre les portes de la consolation ? La réponse se trouve dans le "triptyque" qui m'est tombé dessus par hasard, alors que je cherchais Socialisme fasciste ("Volpe editore" pour l'édition italienne) sur les rayons encombrés de ma bibliothèque. Feuilletons ces pages brillantes et limpides du Jeune Européen sur les traces d'une vocation à suivre.

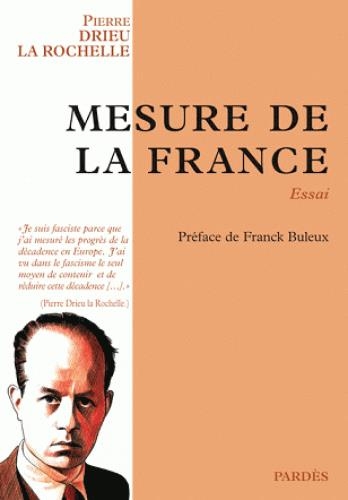
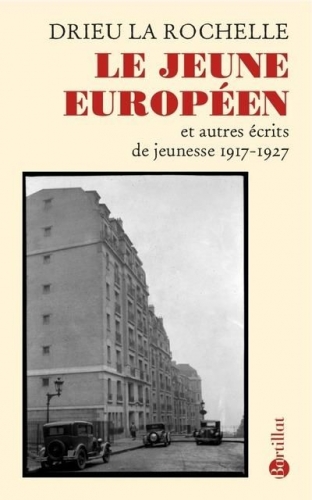
Drieu La Rochelle, avec Etat civil (Bietti), offre sa carte de visite en racontant la jeunesse d'un leader inquiet ; avec Le Jeune Européen (Aspis), il propose une méditation sur l'histoire, dans les années 1920, en obtenant une image décadente qu'il projette comme une représentation de son époque et de l'époque à venir.
Ce deuxième essai biographique est la suite idéale du premier, qui sera suivi par l'analyse politique contenue dans les pages de Mesure de la France (Idrovolante edizioni) : un triptyque qui ressemble à un retable de la Renaissance au centre duquel se trouve lui, le jeune écrivain, tel qu'il deviendra : la représentation du 20ème siècle d'un homme qui a traversé la décadence, l'ayant préconçue, s'accompagnant inconsciemment "de deux frères aînés, Nietzsche et Spengler".
D'eux, plus ou moins consciemment, il tire la vision de la fragilité du vieux monde, tandis que le nouveau peine à se manifester et que le vide est comblé par les stéréotypes d'une modernité paillarde qui, de Moscou à New York, étend un voile de crasse morale qui ne peut que dégoûter un homme comme Drieu, "l'antithèse du nihiliste", comme l'écrit Marco Settimini dans son essai introductif, cultivé et raffiné. Car c'est un intellectuel qui "a le goût de la vie, de la beauté, de la chair, des formes". En somme, s'il fallait le définir, je dirais qu'à son âge, à ces moments-là, c'est un "jeune Européen" d'ascendance "dorienne", étranger à l'apitoiement et soucieux de ne rien faire d'autre que de coucher sa pensée sur le papier, d'être un écrivain comme peut l'être un guerrier, mais pas un commerçant, un homme d'affaires, un fellah européen qui se contente des bordels bourgeois, qu'ils soient culturels, esthétiques ou, pis encore, éthiques. "C'est un aristocrate de l'esprit, observe Settimini, qui, destiné à vivre au 20ème siècle, souffre de façon choquante du "dépérissement de la vie" qu'il constate dans tous les domaines humains. À cinquante-deux ans, il aurait décidé d'en finir. Le désespoir l'aurait conduit à se tirer une balle dans la tête - comme le protagoniste/alter ego de Feu follet - après s'être "préparé" avec du gaz et du gardenal en lisant deux versets de la Bhagavadgita. Aristocratique jusqu'au bout. Au temps de la populace inintelligente, ce n'était pas sa faute - comme il l'écrira dans Récit secret - s'il n'avait pas compris que le monde décomposé roulait avec la fureur d'une symphonie de Rachmaninov.
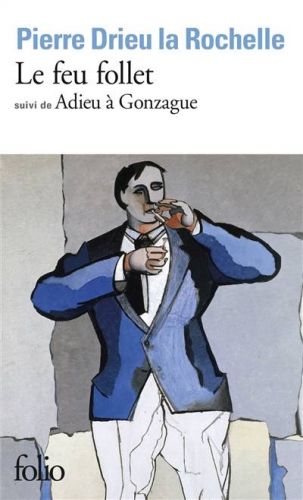
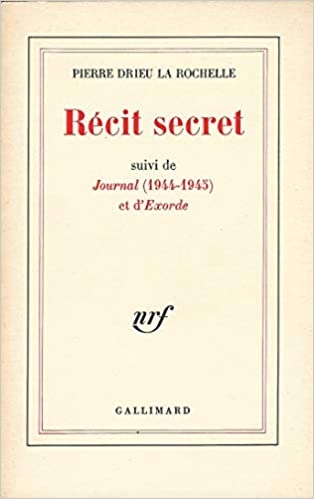
Le "jeune Européen" a consciemment roulé avec l'histoire au cours de son adolescence lumineuse et charnelle d'abord, de sa maturité ensuite. Réalisant qu'il ne pourrait échapper à la mort qu'en concevant une grande œuvre, son œuvre littéraire qui lui inspirait parfois de la terreur lorsque la page blanche restait telle quelle. Car l'écriture, comme pour Nietzsche, et un peu comme pour Spengler, est un instrument de liberté, voire la seule preuve que la liberté existe, en dehors de la mort volontaire.

Drieu n'abdique pas, même s'il assiste et participe à la fin d'un monde, pour vivre en "homme couvert des femmes", brillante métaphore pour dire qu'il n'aurait renoncé à rien, surtout pas à l'amour, vécu dans ses fibres les plus intimes, ou charnelles mais totalement, spirituellement épanouissantes. Comme celui qui le liait, avec des fortunes diverses, à Victoria Ocampo (photo), écrivain argentin hors pair, tendrement et désespérément aimée, ou à n'importe quelle dame de la haute société parisienne, paradigme d'une sensualité brillante, dépourvue de fougue et de poésie. Amour pétri de littérature, c'est-à-dire creusé dans les profondeurs de l'âme ou simplement de la chair, pur occasionnalisme, vitalisme pour vaincre l'ennui.

Toutes les femmes, les siennes ou celles qui se croyaient les siennes, ne l'ont pas abandonné le jour où elles l'ont accompagné dans son dernier voyage. Certains ont dit qu'on n'avait jamais vu autant de femmes à l'enterrement d'un homme, y compris des épouses et des amantes, en compagnie des chamanesses au sexe aventureux qu'il avait déifiées dans ses romans, au premier rang desquels Gilles. Mais l'amour et le sexe n'ont jamais compensé la nostalgie d'un monde inexistant, le 13ème siècle par exemple, du jeune et du moins jeune Européen. Seule l'écriture pouvait pallier le manque d'ordre qu'il aurait représenté dans Mesure de la France.
"Je n'avais aucune idée que l'on pouvait écrire sur autre chose que sur soi-même. Je ne voyais pas plus loin que le bout de mon nez, qui m'enchantait. Je restais inerte comme si toutes mes facultés avaient été absorbées par le spectacle du monde ; je ne regardais ni les choses ni les gens. C'est ce qu'il y avait de plus palpitant, de plus précieux, de plus éphémère en moi que je voulais surprendre, mais à cause de cette attention même, plus rien ne bougeait en moi", avoue Drieu avec une candeur impudique. Cela ressemblerait à la confession d'un masque, à la Mishima, aussi désagréable ou risquée que puisse paraître la comparaison. C'est plutôt la description d'une agitation qui l'a épuisé : "Alors plus je m'interrogeais, plus la vie m'échappait : ma plume grattait un sol aride et stérile. Je m'enfermais dans un cercle au point d'être mortel. Je cherchais ma vie à écrire, mais parce que je la cherchais, je ne la vivais plus. Et autour de moi, immobile, sous mon regard distrait, le monde entier devenait peu à peu immobile".
Qui est donc le "jeune Européen" ? Quelle que soit la manière dont on le lit et l'interprète, c'est le masque de Drieu, âgé de trente-quatre ans, qui, devant une feuille blanche, pose le problème de la résistance à l'époque où la vie lui apparaît comme un rêve collectif. "L'individualité exaspérée, épuisée, finira par mourir, et d'elle naîtra un communisme liquide, inévitable".
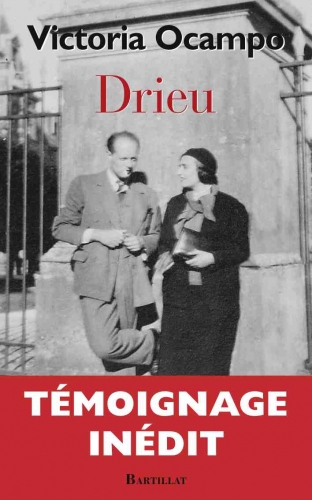
Ne serait-ce pas la "pensée unique" de l'égal du temps, le signe de l'extrême décadence qu'en 1927 le jeune homme contemple avec le désenchantement de celui qui a soif d'univers formels à recomposer au milieu des décombres que la guerre a laissés dans tous les coins de l'Europe défaite ? Probablement. On l'appelle inconsciemment "communisme liquide" pour l'"ennoblir", mais ce n'est que le goût du laisser-faire qui connote "la pourriture de l'élite d'aujourd'hui".
Le Jeune Européen, au-delà de l'exaspération esthétisante à se contempler presque comme une sorte de remède à la vulgarité qui l'entoure, est l'un des livres les plus modernes de Drieu La Rochelle. En quelques coups de plume sur un homme qui lui ressemble beaucoup, l'écrivain français révèle sa nature, celle d'un challenger audacieux, d'un aventurier téméraire, d'un visionnaire conscient : "L'âme d'un héros s'était nichée un moment dans mon corps. Mon intelligence s'épanouissait. J'apprenais et je me souvenais de tout. Et j'étais bon, maître de ma langue, de mes mains, de mes yeux", avait-il écrit dans Etat civil. Six ans plus tard, il n'a pas changé d'avis. Rêver, mais aussi intervenir avec son arme la plus redoutable dans les destinées françaises et européennes : la plume - arme impropre - qu'il trempe quotidiennement dans l'encre rouge et noire de ce socialisme d'avenir qui est le dernier horizon qu'il esquisse à l'intention des nietzschéens déçus et des soréliens rêveurs, les premiers visant à ramasser les fragments de la volonté de puissance, les seconds s'attachant à recoller les morceaux disjoints d'une mosaïque faite de classes et de nations.
19:24 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : littérature, lettres, lettres françaises, littérature française, pierre drieu la rochelle |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Léon Bloy contre-attaque
Par Eugenia Arpesella
@eugeniarpe
Source: https://revistapaco.com/leon-bloy-contraataca/
Pour sa prose extemporanée, pour son catholicisme extrême, pour être antimoderne et réactionnaire, pour être un saint, un prophète et un égaré, Léon Bloy (1846-1917) a été jeté, avec son œuvre, dans l'oubli littéraire. Il est possible qu'il s'agisse d'un oubli un peu forcé, produit d'une opération de censure largement consensuelle. En tant que critique littéraire, Bloy a descendu presque tous les écrivains et intellectuels français de son époque. Aujourd'hui, pourtant, Bloy pourrait être le saint patron des annulés. Mais le drap du fantôme du politiquement incorrect serait trop court pour lui, et s'il voyait de ses yeux le pétrin dans lequel nous nous sommes fourrés, il s'en servirait volontiers pour se pendre.
Il y a dix ans, à la stupéfaction des cardinaux, le Pape François l'a sorti des catacombes dans sa première homélie en tant que pape, dans la chapelle Sixtine : "Quand on ne confesse pas Jésus-Christ, je me souviens de la phrase de Léon Bloy : "Celui qui ne prie pas le Seigneur, prie le diable"". En Argentine, entre-temps, il est difficile de trouver ses livres, les Journaux sont épuisés et ses romans et essais peuvent, avec un peu de chance, être consultés sur le web, et pas nécessairement parce qu'ils ont si mal ou si peu vieilli. La bonne nouvelle est que la maison d'édition de Bucarest vient de publier Sobre la tumba de Huysmans, traduit pour la première fois en espagnol par Nicolás Caresano, qui est également chargé des notes et du prologue de l'édition. Il s'agit de l'un des derniers livres publiés par Bloy de son vivant, qui rassemble les comptes rendus critiques qu'il a rédigés sur les romans de Joris Karl Huysmans, un auteur contemporain avec lequel il entretenait une amitié compliquée.

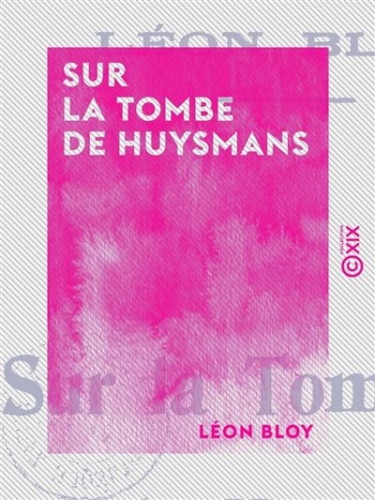
Après la mort de Huysmans, en 1913, Bloy, dans un geste lapidaire, publie ce livre. "Les pages qui suivent marquent deux époques", explique Bloy. "Les premières ont été écrites avant la conversion de Huysmans, lorsque, plein d'espoir et sans prévoir les atroces tribulations qu'il me réservait, je le choyais avec délicatesse. Les autres expriment l'amer désenchantement qui a suivi. A la fin de cette préface à la première édition, Bloy se justifie : "On me reprochera peut-être de manquer de respect à un défunt. La mort, disait Jules Vallés, n'est pas une excuse. Les notes du traducteur donnent des indications intéressantes sur le tempérament de Bloy et sur son sens des relations publiques. Par exemple, Caresano précise que Jules Vallés avait publié les premiers articles socialistes et anticléricaux de Bloy dans son journal La Rue. Mais lorsque Bloy se convertit au catholicisme, il lui rendit la pareille en le qualifiant de "délinquant capable de jeter Homère dans les toilettes".
L'amitié entre Bloy et Huysmans semble avoir été intéressée, surtout de la part de Bloy, qui voyait en Huysmans un converti plutôt qu'une promesse littéraire. La publication du roman A rebours (que Michel Houellebecq évoque longuement dans Soumission) enthousiasme Bloy au point qu'il en fait l'éloge, à l'étonnement de beaucoup : "Je ne vois pas de roman qui déclare plus résolument cette alternative : ou bien nous nous muons en bêtes, ou bien nous contemplons la face de Dieu".
Disciple d'Émile Zola, que Bloy avait baptisé "le crétin des Pyrénées", Huysmans était comme la brebis égarée qu'il fallait récupérer et ramener au bercail. Plus tard, la dérive littéraire et spirituelle de Huysmans vers le satanisme a fait que l'amitié entre les deux, comme l'a expliqué Bloy plus haut, a littéralement sombré dans l'enfer. On ne peut comprendre son radicalisme vis-à-vis de Huysmans, et celui de toute son œuvre, sans considérer l'histoire de sa fervente conversion. Dans sa prime jeunesse, Léon Bloy avait été un athée et un anticlérical forcené jusqu'à ce qu'il rencontre Barbey D'Aurevilly, écrivain monarchiste et conservateur réputé, qui devint son mentor spirituel et littéraire et l'accompagna sur le chemin de l'initiation au catholicisme. Initiation qui, comme on le sait chez les croyants, est un chemin total, absolu. Mais la foi de Bloy est celle du Calvaire, celle du Vendredi saint, celle de la nuit noire. "Je ne ressens jamais la joie de la résurrection. Je vois toujours Jésus à l'agonie", écrit-il dans son Journal. L'amour du Christ est l'amour de la Vérité, et cette Vérité, dira Bloy, se trouve dans la souffrance. La souffrance du Christ crucifié entre deux voleurs, la pauvreté qu'il a lui-même endurée tout au long de sa vie. Bref, sa conversion n'a pas été une conversion de splendeur, de joie, de paix, de réconciliation.
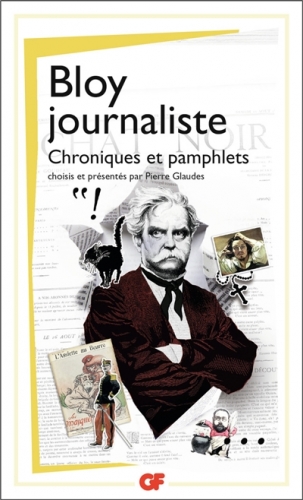 Écrivain catholique, ou plutôt journaliste catholique, pamphlétaire et auteur de libelles, il s'est lancé dans l'écriture comme un prophète désespéré et malveillant : toute son œuvre est un grand défi aux valeurs de la modernité, cette déchirure de l'histoire dont les fruits ont été autant de poisons pour l'esprit. Le suffrage universel, la science, le progrès, la république, le matérialisme, l'immanentisme comme précurseur de l'individualisme récalcitrant, l'art, la littérature, le catholicisme mou et sentimental, sans parler de Luther et de la Réforme protestante ! Il s'est donc battu en duel contre tout ce qui, pour lui, éloignait irrémédiablement les hommes du mystère, de la transcendance, c'est-à-dire de Dieu. L'essayiste Roberto Calasso résume bien cette croisade morale et de principe : Bloy s'est attaché à fustiger les bourgeois hypocrites, les intellectuels éclairés et, surtout, les âmes tièdes et en paix avec elles-mêmes. "Qu'est-ce qu'avoir bonne conscience ? C'est être convaincu qu'on est une parfaite canaille", écrit-il dans son Journal. Terriblement pauvre, il se comportait lui-même comme un misérable et le savait mieux que quiconque : "Je mendie comme un voleur à la porte d'une ferme qu'il a l'intention d'incendier". Certains critiques suggèrent qu'il y a toujours quelque chose de sacré dans la colère de Bloy, rappelant le Christ contre les pharisiens et contre les marchands du temple.
Écrivain catholique, ou plutôt journaliste catholique, pamphlétaire et auteur de libelles, il s'est lancé dans l'écriture comme un prophète désespéré et malveillant : toute son œuvre est un grand défi aux valeurs de la modernité, cette déchirure de l'histoire dont les fruits ont été autant de poisons pour l'esprit. Le suffrage universel, la science, le progrès, la république, le matérialisme, l'immanentisme comme précurseur de l'individualisme récalcitrant, l'art, la littérature, le catholicisme mou et sentimental, sans parler de Luther et de la Réforme protestante ! Il s'est donc battu en duel contre tout ce qui, pour lui, éloignait irrémédiablement les hommes du mystère, de la transcendance, c'est-à-dire de Dieu. L'essayiste Roberto Calasso résume bien cette croisade morale et de principe : Bloy s'est attaché à fustiger les bourgeois hypocrites, les intellectuels éclairés et, surtout, les âmes tièdes et en paix avec elles-mêmes. "Qu'est-ce qu'avoir bonne conscience ? C'est être convaincu qu'on est une parfaite canaille", écrit-il dans son Journal. Terriblement pauvre, il se comportait lui-même comme un misérable et le savait mieux que quiconque : "Je mendie comme un voleur à la porte d'une ferme qu'il a l'intention d'incendier". Certains critiques suggèrent qu'il y a toujours quelque chose de sacré dans la colère de Bloy, rappelant le Christ contre les pharisiens et contre les marchands du temple.
En revanche, Franz Kafka l'admirait, tout comme Jorge Luis Borges. Le "Miroir des énigmes", publié dans Autres inquisitions, rend justice au Bloy non racheté. Mais l'un des meilleurs portraits de l'écrivain français est peut-être celui du père Leonardo Castellani, jésuite et écrivain argentin : "Il est facile de rire de Léon Bloy. Autrefois, je me moquais de lui, ce saint plus impatient que le mauvais larron ! La somme d'injures, d'imprécations et d'épithètes qui lui sont tombées dessus de son vivant est énorme et, à Dieu ne plaise, justifiée. Ah, le malheureux ! Mais la misère est une chose sérieuse. On ne peut pas rire de la misère. Jésus-Christ, dans sa passion, était littéralement misérable. Tout ce qui est suspendu à un arbre est maudit, dit la Loi. C'est ainsi que le monde d'aujourd'hui s'est moqué de Bloy et de Jésus-Christ.
Dans le prologue de Sur la tombe de Huysmans, Caresano pose la question que nous nous posons tous si nous sommes arrivés jusqu'ici : qu'est-ce que ce vieux sage et carcaman a à nous offrir aujourd'hui ? Quels abîmes de notre présent ce prophète du 19ème siècle peut-il éclairer ? Son héritage", dit Caresano, "nous enseigne encore qu'il n'est pas possible d'affirmer sans nier en même temps, d'admirer sans mépriser implicitement et que, parfois, la seule façon d'atteindre le centre profond d'une époque est de se déplacer vers les marges". L'une des qualités intemporelles de Bloy est peut-être son affront à l'exercice de la critique et à ses implications dans le monde de la culture, c'est-à-dire le coût que peu sont prêts à payer aux dépens d'un relativisme dépourvu de sainteté. Le "politiquement correct" ne cache-t-il pas des intérêts ? Affirmer simultanément l'un et l'autre et en tirer la conclusion qui intéresse le plus le pouvoir en place, n'est-ce pas une affaire détournée ? "Celui qui ne prie pas le Seigneur...". En l'invoquant lors de la messe inaugurale de son pontificat, le pape François a renouvelé un affront au pharisaïsme de notre époque, plus courroucée et stridente que celle de Bloy, mais tout aussi déserte.
20:24 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : 19ème siècle, léon bloy, france, catholicisme, lettres, lettres françaises, littérature, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
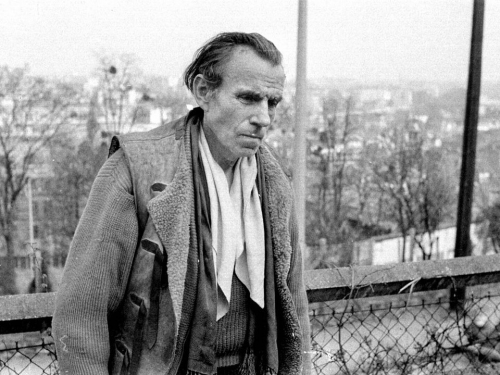
Parution des numéros 467, 468 & 469 du Bulletin célinien
N°469:
 Sommaire :
Sommaire :
Des lettres retrouvées
Les sœurs Canavaggia et Céline
L’Église vue par Charles Bernard [1933]

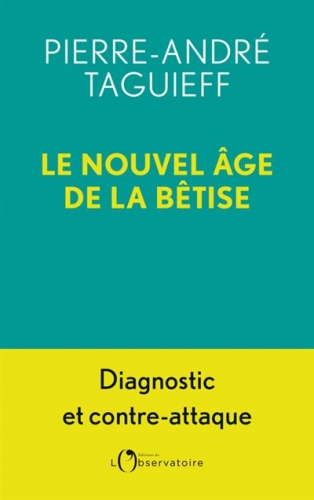
• Pierre-André TAGUIEFF, Le Nouvel Âge de la bêtise, Éditions de l’Observatoire, 2023 (23 €).
N°468:
 Sommaire :
Sommaire :
Une heure chez Me Gibault
Céline dans Le Populaire
Bibliographie. Les Dictionnaires.
Henri Thyssens nous a quittés le 28 octobre¹ à l’âge de 75 ans. Je le connaissais depuis 1979 ; il m’avait contacté à la parution du premier numéro de feu La Revue célinienne. Il découvrit Voyage au bout de la nuit à l’âge de dix-neuf ans alors qu’il effectuait son service militaire. « Ce Voyage me transporta dans un monde nouveau, celui de la lecture, à tel point que j’en fis un métier : libraire ². » Avant de créer sa propre librairie, “La Sirène”, il apprit le métier chez Halbart, puis chez Eugène Wahle, à Liège dont il était originaire. Parallèlement, il fit du courtage à Paris. Spécialisé dans les ouvrages de généalogie et de régionalisme, il publiait des catalogues qui attestaient d’un professionnalisme sans faille. Ceux qu’il réalisa sur la gastronomie ou sur Simenon sont conservés par les amateurs. Alors qu’il avait été un élève peu appliqué, Céline joua pour lui le rôle d’initiateur et lui donna l’amour des lettres. À l’instar de nombreux céliniens pointus, le livre de Céline qu’il préférait, sensible à la modernité du style, était Mort à crédit. Ce qui ne l’empêchait pas d’apprécier des auteurs au style classique, tels Stendhal, Paul Léautaud ou Jules Renard qu’il relisait fréquemment. En 1976, cet autodidacte s’était fait connaître en éditant la correspondance à Évelyne Pollet qu’il avait rencontrée à plusieurs reprises. Cinq ans plus tard, il se rendit au Danemark sur les traces de Céline³. Il en ramena le flacon de cyanure que celui-ci avait emporté en Allemagne. Il l’avait fait analyser (c’était bien du cyanure de potassium mais désormais sans danger), ce qui lui permit de le proposer dans l’un de ses catalogues ! Il fut le créateur de la série Tout Céline, répertoire des livres, manuscrits et lettres passés en vente, qui connut cinq numéros et dans lesquels il publia différentes études, notes biographiques et recensions bibliographiques.

Mais la grande affaire de sa vie fut ses recherches sur l’itinéraire de Robert Denoël. Elles aboutirent à la création d’un site internet en accès libre d’une rigueur et d’une érudition en tous points remarquables. « Un éditeur assassiné, c’est rare, c’est incongru, on ne meurt pas pour les Lettres. Celui-là était différent, c’était un vrai bagarreur, et Liégeois de surcroît. Je me lançai donc à sa poursuite. Elle dura trente ans, mais je ne parvins jamais à mettre un nom sur son assassin, ou plutôt j’en trouvai plusieurs, ce qui compliquait encore l’affaire. »

On trouve d’ailleurs sur son site toutes les pièces connues sur cet assassinat ainsi que sur l’instruction judiciaire qui suivit. Il y a là matière à un livre majeur sur cette vie brisée mais Henri ne s’était jamais résolu à cette conversion, étant dans l’impossibilité, disait-il, de faire la synthèse de ce qui équivaut à un volume de centaines de pages. Il faudrait aussi évoquer l’homme qu’il fut : son ironie, sa fidélité en amitié, son indépendance d’esprit. Épris de liberté, il aura mené l’existence qu’il souhaitait. Ce qui importe maintenant c’est de préserver son travail. Michel Fincœur (attaché scientifique à la Bibliothèque Royale) et moi l’avions convaincu de léguer sa documentation aux “Archives & Musée de la Littérature”, à Bruxelles, ce qu’il fit il y a cinq ans. Il y existe désormais un “Fonds Robert Denoël / Henri Thyssens” qui a vocation à pérenniser le site internet qu’il créa en 2005 et qui constitue l’œuvre de sa vie.
N°467:
 Sommaire :
Sommaire :
Retour sur Drena Beach et Winna Winfried –
Le Spiegel et Céline
Un monument à Claude Duneton
En juillet 2021, la découverte des inédits a éclipsé celle d’un manuscrit de Mort à crédit, l’un des plus anciens retrouvés et donc antérieur à celui déjà connu. L’année passée, dans la nouvelle édition du roman (La Pléiade), Henri Godard annonçait que la publication du facsimilé de ce manuscrit de plus de 1.600 feuillets permettrait dans une certaine mesure de faire la lumière sur les différentes étapes de rédaction. Cela s’avère fondé et c’est ce qui en fait un document passionnant pour les amateurs et les chercheurs. Comme l’écrit Pascal Fouché, qui en a excellemment réalisé l’édition et la présentation, s’il est incomplet et qu’il ne livre pas toutes les clés de la méthode de travail de Céline, il nous permet tout au moins de mieux l’appréhender. Grâce aux versions successives de nombreuses séquences, on a accès aux différentes étapes. On assiste ainsi “en direct” au travail de création et on comprend mieux la manière de travailler de l’écrivain qui n’a de cesse d’accroître successivement plusieurs passages. Il est aussi intéressant de comparer avec ce qui sera modifié dans la version définitive. Un exemple parmi d’autres : on se souvient que dans celle-ci, il évoque sa mère en disant : « Elle a tout fait pour que je vive, c’est naître qu’il aurait pas fallu » ; cette phrase figure bien dans ce manuscrit, mais ici c’est de son père qu’il s’agit (« Il a tout fait… »). Les noms des personnages y sont loin d’être définitifs : ainsi, la concierge Mme Bérenge, qui fait l’ouverture du livre, s’appelle d’abord Mme Dovis. Quant à la datation, il faut situer la rédaction effective en 1934-1935, après qu’il a abandonné la partie qui serait devenue Guerre et le projet de Londres¹. Il se consacre alors uniquement au premier volet de ce roman qui, initialement, devait en comporter trois : « Enfance, Guerre, Londres. »
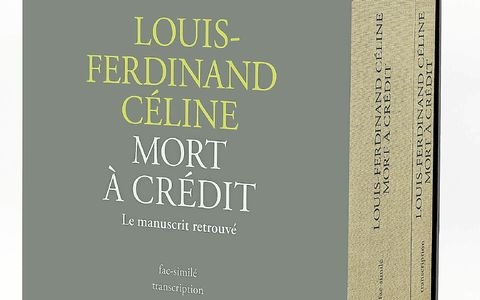
C’est que cette première partie prit tellement d’importance qu’elle constituera le roman tout entier totalisant pas moins de 700 pages imprimées. Nombreux sont les céliniens qui le considèrent comme son chef-d’œuvre, en tout cas supérieur à Voyage au bout de la nuit et surtout conforme à son projet esthétique. Mais cela n’a pas toujours été le cas et pas seulement pour la critique ; lorsque Henri Thyssens (†) lui consacra l’un de ses catalogues au début des années 80, il le titra fort justement « Mort à crédit, le mal-aimé »². Le prochain colloque de la Société d’Études céliniennes sera consacré aux manuscrits découverts il y a deux ans. Il reste à former le vœu que, sur la base de ce facsimilé, il se trouvera un céliniste pour dégager les leçons qu’apporte cette édition. Ajoutons que cette initiative éditoriale constitue une belle réussite bibliophilique, ce qui ne gâte rien.
• Louis-Ferdinand CÉLINE, Mort à crédit. Le manuscrit retrouvé (fac-similé & transcription), Gallimard, 2023, 2 volumes, l’un pour le fac-similé intégral ; l’autre pour la transcription (établie, annotée et présentée par Pascal Fouché), 1712 p., relié sous coffret, couverture toilée et marquée à chaud au format 25 x 11 x 39 cm, tirage limité à 999 exemplaires numérotés, 5,51 kg. (450 €).
15:28 Publié dans Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : revue, littérature, lettres, louisferdibnabnd céline, pierre-andré taguieff, henri thyssens, lettres françaises, littérature française |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook