mardi, 24 février 2026
Coup de gueule numérique: l'interdiction des réseaux sociaux enferme la jeunesse dans une chambre d’écho de gauche

Merz soutient les projets d’interdiction
Coup de gueule numérique: l'interdiction des réseaux sociaux enferme la jeunesse dans une chambre d’écho de gauche
Source: https://derstatus.at/politik/digitaler-maulkorb-social-me...
Le couvre-feu numérique pour les jeunes arrive-t-il ? Alors qu’on parle officiellement de protection, la suspicion grandit car il ne s’agit nullement d'une prévention de la dépendance, mais d'un contrôle, d'un monopole de l’interprétation et d'une influence politique généralisée sur toute une génération. Et d’une surveillance potentielle de tous les citoyens comme “effet secondaire utile”.
Le gouvernement discute d’une interdiction graduelle
En Allemagne aussi, une interdiction progressive des médias sociaux pour les enfants et les jeunes est à l’étude. Le prétexte: prétendument “protéger les jeunes contre la dépendance, le stress psychique, la haine et la désinformation”. La SPD a présenté à la mi-février 2026 un document pour impulsion au projet. Le parti socialiste exige une interdiction totale pour les enfants de moins de 14 ans, avec un blocage technique d’accès par les plateformes, sous peine de sanctions allant jusqu’au blocage du réseau. Pour les 14-16 ans, une “version jeunesse” obligatoire doit être instaurée: sans recommandations algorithmiques, sans défilement infini ni systèmes de récompense, avec une vérification obligatoire de l'âge.
La CDU a discuté, lors de son congrès, la proposition du Land du Schleswig-Holstein. Celle-ci prévoit un âge minimum légal de 16 ans pour les plateformes ouvertes telles qu’Instagram, TikTok ou Facebook, avec vérification obligatoire de l'âge. Il existe un large soutien pour cette proposition, mais certains prônent une régulation plutôt qu’une interdiction totale. Le chancelier Friedrich Merz a exprimé dans le podcast “Machtwechsel” “beaucoup de sympathie” pour les deux propositions. Il a souligné que beaucoup de jeunes adolescents de 14 ans sont en ligne jusqu’à cinq heures par jour. Cela nuirait, selon lui, à la socialisation, à la concentration et au développement de la personnalité. Lui aussi avance la “protection des enfants” pour se justifier par un motif louable.
Imposer une chambre d’écho: tel est le calcul politique
Le danger réside dans le fait que de nombreux citoyens pourraient percevoir cette initiative comme une “bonne” mesure visant la protection de l’enfance. En Autriche, où une mesure similaire est envisagée, le système produit facilement des sondages suggérant qu'une majorité de citoyens soutient le projet. Mais, du point de vue populiste et patriotique, il ne faut en aucun cas approuver tout cela sans émettre de critique. Même à des fins électorales. Car, depuis la campagne pour les élections européennes, l’idée qu’il pourrait y avoir une stratégie politique derrière ce "beau projet" ne constitue plus une théorie du complot.

Lors de cette campagne électorale, l’AfD a particulièrement gagné des suffrages auprès des jeunes électeurs, et même l’opposition soulignait, entre autres choses, l’efficacité de leur offensive sur TikTok & Co. La capacité de l'AfD, malgré l'environnement parfois très à gauche dans lequel baignent les jeunes en subissant une propagande constante qui prône des idées “woke”, à atteindre les jeunes avec des contenus patriotiques et critiques du système s'avère particulièrement menaçante pour les élites au pouvoir. Sans internet, beaucoup de jeunes seraient enfermés dans une chambre d’écho de gauche, qui, dans le pire des cas, serait composée d'une famille aux idées de gauche, de camarades de classe campés à gauche et de professeurs militants de gauche.
Si on prive désormais les jeunes de la possibilité de s’informer en dehors des médias mainstream, on étouffe dans l’œuf leur contestation potentielle des narratifs dominants. Toute opposition à l'hégémonie en place de la part des jeunes serait rapidement reléguée au rang d'une simple rébellion juvénile fortuite. Que les médias sociaux puissent être une arme à double tranchant n’est rien de nouveau. Le danger qu'il y a à être exposé pendant de longues heures de loisirs improductifs et psychiquement destructeurs ne peut être nié. Mais ces médias sociaux restent aussi, pour l’instant, les seuls moyens pertinents pour transmettre aux jeunes des idées d’opposition sans qu'ils aient à subir le filtre méprisant du mainstream.
Briser la bulle d’échos de gauche
De plus, chacun doit être conscient qu’une vérification de l’âge donnerait aux gouvernants encore plus de pouvoir sur ce qui est écrit en ligne, puisqu’il faudrait déposer ses pièces d’identité. Et cela signifie, dans le pire des cas, que même les personnes de 80 ans devraient prouver qu’elles ont en réalité plus de 14 ans. Rappelons que des raids policiers ont déjà eu lieu à cause de memes inoffensifs en ligne, dans un réseau partiellement anonyme, ce qui constitue un nouveau levier pour faire fuir les personnes politiquement indésirables sur Internet.
Le fait que les revendications pour une telle interdiction s’intensifient presque simultanément dans tout l’Occident, surtout lorsque les élites perdent leur contrôle politique, doit faire retentir tous les signaux d'alarme. Cela ressemble à une synchronisation concertée pour nuire à l’opposition contre les élites souvent mondialistes et pour reprendre le pouvoir d’interprétation. Justement celles que l’on a commencé à perdre lors des récentes manifestations de “gilets jaunes” – ou des protestations contre la crise migratoire, le coronaturlutuvirus et la guerre en Ukraine.
+++ Suivez-nous sur Telegram : t.me/DerStatus & sur Twitter/X : @derStatus_at +++
13:31 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, allemagne, affaires européennes, réseaux sociaux, censure |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 21 février 2026
Lors d'une réunion informelle de l'UE à Larnaca, l'Irlande demande davantage d'efforts pour la remigration…

Lors d'une réunion informelle de l'UE à Larnaca, l'Irlande demande davantage d'efforts pour la remigration…
Peter Logghe
Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94
Vous n’en avez rien lu ni entendu dans nos médias mainstream flamands, l’intérêt était apparemment « modéré », comme il se doit. Mais lors d’un sommet informel de l’UE à Larnaca (Chypre), où tous les ministres de la Justice et de l’Intérieur des États membres de l’UE se sont réunis le 23 janvier pour discuter notamment de migration et de la lutte contre la migration illégale, le ministre irlandais Niall Collins a plaidé de manière argumentée pour une politique de retour plus forte et plus ferme, en d’autres termes, la remigration.

Niall Collins est ministre du parti de centre-droit Fianna Fáil, et en tant que membre du gouvernement irlandais, il est responsable du Droit international, des réformes juridiques et de la Justice en ce qui concerne la jeunesse. En Chypre, il a suscité l’émoi en plaidant «pour une politique durable de retour et de réintégration», toujours dans le plein respect des droits de l’homme. «Nous devons accélérer considérablement le rythme du retour», a déclaré Collins. Il ne s’agit pas seulement des étrangers ayant commis de graves crimes, mais aussi de ceux qui mettent en danger la sécurité du pays d’accueil.
L’Irlande dépense jusqu’à 10.000 euros par famille qui retourne
Cela ne se limite pas à de simples souhaits politiques: depuis l’automne 2025, Niall Collins a augmenté les primes pour le retour volontaire en Irlande. La petite île verte «encourage les demandeurs d’asile à retirer leur demande d’asile pendant le traitement de leur dossier, à quitter l’île et à retourner dans leur pays d’origine. En échange, une aide financière de 2500 euros par personne est proposée, jusqu’à 10.000 euros maximum pour une famille entière», rapporte InfoMigrants.
 InfoMigrants est une filiale de France Médias Monde et de la chaîne publique allemande Deutsche Welle
InfoMigrants est une filiale de France Médias Monde et de la chaîne publique allemande Deutsche Welle
Pour les migrants qui sont en procédure d’appel (c’est-à-dire qui ont fait appel contre le rejet de leur demande d’asile par les autorités irlandaises) et qui retournent volontairement, les aides financières sont limitées à 1500 euros par personne et à 6000 euros maximum par famille. «Ce soutien est essentiel pour faciliter financièrement l’intégration dans le pays d’origine», explique le ministre Niall Collins. «Ainsi, nous pourrons certainement augmenter le nombre de remigrants».
Pourquoi nos médias mainstream restent-ils si silencieux à ce sujet? Ce n’est pas parce que de plus en plus d’États membres abandonnent progressivement l’«axiome des frontières ouvertes»? Ce n’est tout de même pas parce que le ministre irlandais plaide pour une politique de remigration...?
20:39 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, niall collins, fianna fail, irlande, europe, affaires européennes, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Débat nucléaire en Europe: Qui serait vraiment prêt à mourir pour qui?

Débat nucléaire en Europe: Qui serait vraiment prêt à mourir pour qui?
Elena Fritz
Bron: https://t.me/global_affairs_byelena#
En Europe, un débat a commencé ( https://www.faz.net/aktuell/politik/sicherheitskonferenz/... ), qui aurait été impensable il y a seulement quelques années. Des politiciens de premier plan parlent désormais ouvertement d’un «parapluie nucléaire» européen. Le président polonais Karol Nawrocki le réclame, le chancelier fédéral Friedrich Merz en discute avec Emmanuel Macron, et lors de la Conférence sur la sécurité à Munich, ce sujet n’était plus un tabou. Le fait même que cette question soit posée montre surtout une chose: la confiance dans les garanties de sécurité actuelles s’émousse. Le point de départ est moins idéologique que stratégique. Dans de nombreuses capitales européennes, l’incertitude grandit quant à savoir si, en cas d’urgence, les États-Unis seraient vraiment prêts à risquer leur propre survie pour l’Europe. Cette inquiétude ne date pas de la politique intérieure américaine actuelle. Déjà pendant la Guerre froide, la même question se posait. Lorsque l’Union soviétique a développé des missiles intercontinentaux dans les années 1950, il est devenu évident pour les États-Unis qu’une attaque contre l’Europe menacerait inévitablement la population américaine. Washington a alors réagi avec une nouvelle stratégie: pas de représailles automatiques et massives, mais une réponse flexible. En d’autres termes: une marge de manœuvre plutôt qu’un auto-engagement.
Aujourd’hui, cette logique revient. Le monde est devenu multipolaire, les risques sont plus complexes, et la politique américaine se concentre davantage sur l’Indo-Pacifique. Pour des États comme la Pologne ou les pays baltes, cela signifie une réalité désagréable: en cas d’urgence, l’Europe pourrait se retrouver seule stratégiquement. Le fait que Varsovie tourne désormais son regard vers Paris est rationnel.
Mais c’est ici que commence le vrai problème. La France est une puissance nucléaire, mais son arsenal est limité et surtout conçu pour sa propre dissuasion nationale. Une extension à toute l’Europe ferait de la France la principale cible d’une contre-attaque. Il en découle une question cruciale, rarement posée dans le débat politique jusqu’à présent:
La France serait-elle prête à risquer son propre existence pour la Pologne, l’Allemagne ou la Finlande ?
Cette question est inconfortable, car elle touche au cœur de toute dissuasion. La dissuasion ne fonctionne que si l’adversaire croit qu’un État est prêt à vraiment commencer une politique d'escalade en cas de crise. Mais cette crédibilité ne peut pas être remplacée par des traités ou des déclarations politiques. Elle repose sur la culture politique, la réflexion stratégique et les intérêts nationaux.
On peut pousser cette logique plus loin. Si la France devait prendre cette décision, elle serait existentielle. Une contre-attaque nucléaire ne viserait pas seulement l’infrastructure militaire, mais aussi les fondements de l’État français. Aucun système politique ne décide à la légère de sa propre destruction. C’est précisément pour cette raison que la fiabilité d’une telle garantie reste incertaine.
Cela met en lumière une deuxième question, encore plus difficile:
D’autres États européens seraient-ils prêts à ce que la France prenne ce risque pour eux?
Car une garantie de protection nucléaire implique toujours une dépendance politique. Celui qui est protégé doit céder du pouvoir. Celui qui protège exige une influence. Un parapluie de protection européen ne concernerait donc pas seulement la sécurité militaire, mais aussi la réorganisation des rapports de force en Europe. La France deviendrait le centre politique de la sécurité. Les décisions concernant toute politique d’escalade, le risque et la guerre seraient finalement prises à Paris.
Pour l’Allemagne, cette situation serait particulièrement sensible. D’un côté, la pression croît pour rendre la politique de sécurité plus efficace. De l’autre, l’Allemagne deviendrait, dans un tel système, un acteur central à la fois financier et politique, sans en avoir le contrôle ultime. La dépendance aux États-Unis serait en partie remplacée par une dépendance à la France.
19:50 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, armement nucléaire, europe, affaires européennes, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 19 février 2026
Le nouvel atlantisme de Marco Rubio

Le nouvel atlantisme de Marco Rubio
Alexander Douguine
Le discours du secrétaire d'État américain Marco Rubio lors de la Conférence de sécurité de Munich le 14 février 2026 différait nettement de celui du vice-président J. D. Vance, qui en avait prononcé un tout autre un an auparavant lors de la même conférence.
Le discours de Vance était, en substance, un triomphe de l'esprit MAGA, cette idéologie sous la bannière de laquelle Donald Trump était arrivé au pouvoir et avait remporté à nouveau l’élection présidentielle. Le vice-président américain avait expliqué devant des Européens (majoritairement globalistes) la nouvelle orientation prise par Washington, visant à renforcer les États-Unis en tant que pôle souverain dans un monde multipolaire, ainsi que la fin de l’ère du mondialisme. Vance ne dissimulait pas son mépris envers les Européens et critiquait sévèrement leur idéologie libérale de gauche. L’absence de discours hystériques russophobes et de malédictions dans son allocution a été perçue par l’élite euro-globale comme une «position pro-russe». On a eu l’impression que l’atlantisme s’était effondré et que l’Occident collectif se divisait en deux systèmes autonomes: le nationalisme américain (America First) et un fragment du mondialisme déchu, incarné par l’UE.
Cette fois-ci, c’est le secrétaire d’État Marco Rubio qui s’est exprimé à Munich — et son discours reflétait les transformations que la politique de l’administration américaine avait traversées depuis. Il est important de noter que Rubio est lui-même un néoconservateur, orienté vers le renforcement de la solidarité atlantique, la poursuite, voire l’amplification, de la politique hégémonique en Amérique latine (c’est précisément Rubio qui a promu l’invasion du Venezuela, le renversement de Maduro ainsi que les interventions et changements de régime à Cuba), et vers l'escalade vis-à-vis de la Russie. Mais en même temps, Rubio cherche à s’inscrire dans la rhétorique conservatrice de Trump, critiquant (même si c'est de manière beaucoup plus douce que le mouvement MAGA et Vance) le programme du libéralisme de gauche.
Tout d’abord, Rubio a rassuré les dirigeants européens quant au maintien de la solidarité atlantique. Selon lui: «À une époque où les titres annoncent la fin de l’ère transatlantique, sachez et faites savoir à tous que cela n’est ni notre objectif ni notre désir, car pour nous, les Américains, notre maison peut être dans l’hémisphère occidental, mais nous serons toujours l’enfant de l’Europe». Et il a poursuivi: «L’Europe et l’Amérique appartiennent l’une à l’autre».
L’ère transatlantique, donc, se poursuit. En ce sens, Rubio, dans l’esprit des néoconservateurs classiques, a souligné l’aspect stratégique de l’Europe. Il a déclaré: «Nous voulons que l’Europe soit forte. <...> Notre destin a toujours été, et le sera toujours, lié au vôtre. Car le destin de l’Europe ne sera jamais indifférent pour nous». Le secrétaire d’État a également assuré que rien ne menace l’OTAN. «Nous ne voulons pas nous séparer de l’Europe, mais nous voulons raviver l’alliance».
Rubio a critiqué le système des valeurs libérales/gauchistes, mais il a surtout expliqué que l’illusion de la victoire mondiale garantie par les libéraux, leur assurance après la chute de l’URSS, était erronée. Rubio a déclaré: «L’euphorie de cette victoire nous a conduits à une erreur dangereuse, celle de croire que chaque nation deviendrait une démocratie libérale, que les liens formés uniquement par le commerce et les affaires remplaceraient l’identité nationale, que l’ordre mondial basé sur des règles remplacerait les intérêts nationaux et que nous vivrions dans un monde sans frontières où chacun serait citoyen du monde. <...> L’idée de vivre dans un monde sans frontières était une idée stupide».
Bien que Rubio n’ait pas mentionné directement la Russie dans son discours, lors de ses déplacements il s’est plaint des «horreurs de la guerre», a déclaré que «nous ne savons pas si les Russes sont sérieux quant à la fin de la guerre» et que «nous continuerons à vérifier cela», tout en assurant que les États-Unis continueront à faire pression sur la Russie par des sanctions économiques et par la livraison d’armes à l’Europe, qui finiront par se retrouver en Ukraine. Sur cette question, Rubio s’est plutôt rangé du côté du Vieux Continent: «… nous et l’Europe continuons à prendre des mesures pour faire pression sur la Russie afin qu’elle se mette à la table des négociations».

Cependant, Rubio a manqué la rencontre entre les dirigeants européens et Zelensky sur l’Ukraine, organisée en marge du forum, et est allé rencontrer Orban — ce qui a été critiqué par les euro-globaux, qui ont considéré ce comportement comme un «défi».
Son discours lors de la conférence s’est terminé de manière optimiste, laissant entendre que le «nouveau shérif» incarné par Donald Trump n’est pas aussi terrible qu’on le pense, et que dans la réalité, son programme international ne diffère pas beaucoup de celui des mondialistes, si ce n’est qu'il a pris une forme particulière et extravagante. La figure du néoconservateur et mondialiste Rubio devait confirmer cette thèse. Il a conclu en disant: «L’Amérique ouvre la voie à un nouveau siècle de prospérité, et nous voulons le réaliser avec vous, nos chers alliés et amis de longue date».
En faisant abstraction des émotions, on peut constater que la visite du secrétaire d’État Marco Rubio en Europe, lors de la conférence de Munich, marque un déplacement important dans la politique de l’administration américaine par rapport à l’année précédente. La nouvelle stratégie de sécurité nationale a affirmé que les États-Unis se concentreraient désormais sur «l’hémisphère occidental», ce qui a été interprété comme un retour à la doctrine Monroe («L’Amérique aux Américains») et une rupture avec l’ancien continent. Rubio a cependant clarifié que ce n’était pas le cas et que toutes les structures atlantistes restent en place.
On peut donc, avec une certaine confiance, affirmer que la politique des États-Unis s’est éloignée depuis un an des projets révolutionnaires du mouvement MAGA et s’oriente vers une version plus radicale du néoconservatisme et du réalisme atlantiste.
Sur la base des principes avec lesquels Trump a commencé son second mandat présidentiel, la Russie et les États-Unis avaient la possibilité de négocier de nouveaux fondements pour l’ordre mondial. Surtout parce que nous, Vance, Trump lui-même et Rubio, sommes d’accord pour dire que l’ancien ordre mondial libéral basé sur des «règles» n’existe plus. Nous n’aurions pas particulièrement d’objection à ce que les États-Unis renforcent leur présence dans l’hémisphère occidental, et Vladimir Poutine aurait pu, à Anchorage, discuter avec le président américain de sa vision globale du monde. La question ukrainienne aurait été difficile à résoudre, mais Washington aurait pu sortir de cette guerre et se concentrer sur ses propres problèmes. La détérioration des relations entre les États-Unis et l’UE nous a plutôt été favorable, et le retour aux valeurs traditionnelles correspondait même à notre propre idéologie patriotique-conservatrice. Avec MAGA, nous avions toutes les chances de trouver un terrain d’entente.
Mais à un moment donné, Trump lui-même a commencé à s’éloigner des principes du mouvement MAGA dans sa politique et à se rapprocher des néoconservateurs. Parallèlement, le rôle de Marco Rubio dans le système politique s’est renforcé. Les négociations sur l’Ukraine, déjà problématiques et ambivalentes, ont progressivement abouti à une quasi impasse.
Le plus important, c’est que cela ne concernait pas seulement les relations russo-américaines. La stratégie néoconservatrice (essentiellement un effort pour sauver l’hégémonie de l’Occident et un monde unipolaire) s’est également étendue à d’autres domaines: pression sur les BRICS, attaques contre l’Iran, enlèvement de Maduro, renforcement des sanctions contre la Russie. Et voilà que Rubio, lors de la conférence de Munich, expose le programme du nouvel atlantisme, moins libéral et plus réaliste, mais toujours atlantiste. Il ne s’agit donc pas d’un nouveau projet de mondialisation des grandes puissances.
Les voies de la civilisation russe et celles de l’Occident s’éloignent de plus en plus (alors que ce processus a commencé il y a plusieurs siècles). Et nous devons nous y préparer.
16:52 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, états-unis, marco rubio, conférence de munich, atlantisme, néo-atlantisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 15 février 2026
Les vigilants aux abonnés absents

Les vigilants aux abonnés absents
par Georges Feltin-Tracol
Ancienne militante de l’UMP qui soutint à la primaire de la droite et du centre de 2016 Alain Juppé avant de rallier quelques mois plus tard Emmanuel Macron, Aurore Bergé exerce à compter du 11 janvier 2024 (avec une brève interruption sous Michel Barnier) le rôle de ministresse déléguée chargée à l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la sacro-sainte lutte contre les discriminations. À cette fonction subalterne, elle a appartenu et appartient encore aux gouvernements de Gabriel Attal, de François Bayrou et de Sébastien Lecornu.

En juillet 2025, elle a fomenté une coalition autour d’une dizaine d’associations déjà grassement subventionnées afin de combattre une soi-disant haine en ligne: comprendre les canaux de diffusion de la ré-information et de la liberté d’expression.
Afin d’améliorer le travail de cette nouvelle censure numérique, elle a osé débloquer plusieurs millions d’euros en ces temps de restriction budgétaire. Mais au diable l’avarice quand un tel combat ontologique frôle un sommet eschatologique! On doit cependant s’étonner que toutes les ligues de petite vertu, toujours prêtes à dénoncer et à déposer plainte pour des broutilles, demeurent silencieuses face à la résurgence incroyable des « heures-les-plus-sombres-de-leur-histoire » dans le tourisme de masse.

En effet, depuis le 14 janvier dernier, plusieurs hauts-lieux touristiques et musées français (le Louvre, les châteaux de Versailles et de Chambord, l’ensemble de la Conciergerie et de la Sainte-Chapelle sur l’Île de la Cité et l’Opéra Garnier) pratiquent une tarification différenciée. Les touristes non-citoyens ou non-résidents d’un État-membre de l’Union dite européenne ainsi que ceux de l’Islande, de la Norvège et du Liechtenstein (et quel sort pour les Andorrans, les Monégasques et les Saint-Marinais?) doivent payer un prix d’entrée augmenté de 45%, soit 32 euros. À Versailles, ce sont trois euros supplémentaires pour les étrangers. Quant à Chambord, les «privilégiés» paient 21 euros et les extra-Européens 31 euros ! La préférence nationale existerait donc bien !
La direction de ces établissements à la renommée internationale justifie cette distinction tarifaire au nom d’inévitables travaux de rénovation qui s’élèvent, par exemple, à plus d’un milliard d’euros pour le seul Louvre. Tablant sur une fréquentation touristique en hausse, le gouvernement envisage neuf millions de visiteurs par an, soit la possibilité d’engranger chaque année entre 20 et 30 millions d’euros rien que pour le Louvre. En janvier 2025, le Louvre, cette autre gare parisienne où l’on circule comme dans un moulin, avait augmenté l’entrée de 17 à 22 euros…

En raison des variations de prix, les agents des musées doivent désormais vérifier l’identité des visiteurs. Le temps d’attente devant la tristement célèbre pyramide de l’architecte Ming Pei risque de s’étirer encore plus. Or, avec le risque de manquer d’effectifs de contrôle, on peut envisager une procédure de fluidification des admissions en recourant au QR-code à l’instar des temps maudits de l’imposture covidienne.
On s’en doute: les syndicats fulminent contre «cette double tarification qui foule aux pieds notre Histoire républicaine et l’universalisme fondateur du musée du Louvre». Ils ont raison parce qu’ils y voient avec justesse une éclatante démonstration de discrimination. L’hostilité à toutes les formes de discrimination reste pourtant le mantra officiel de cette république croulante. Le régime républicain vermoulu les condamne toutes, mais il en promeut d’autres. Attention Marianne ! La schizophrénie te guette !!!
Parmi les nombreux (et exagérés) motifs de discrimination pénalement répréhensibles se trouve l’origine, en l’occurence pour les musées, la nationalité. Faire payer plus cher les touristes étrangers sous le prétexte qu’ils sont précisément des étrangers représente un singulier paradoxe. Pour paraphraser la magnifique saynète des Inconnus, il y aurait de bonnes discriminations et de mauvaises discriminations. Qui aurait la capacité d’effectuer cette distinction? L’État? Les associations para-étatiques? Le quidam? Le hasard?
Les bonnes discriminations ne s’arrêtent pas aux seuls musées. Dans les métropoles mondialisées, il devient courant que des boîtes de nuit et des bars réservent la fin d’après-midi ou le début de soirée à des fêtes exclusivement ouvertes aux femmes, souvent mères de famille harassées par leur progéniture. À part les vigiles, les responsables légaux de l’établissement et, peut-être, le serveur au bar, toute présence masculine y est proscrite. Pis, des féministes tiennent des réunions non mixtes excluant les hommes blancs cisgenres hétérosexuels de tout âge. Entend-on les ligues de petite vertu s’indigner de ces actes discriminatoires assumés ? Non, elles préfèrent viser l’Institut Iliade qui tiendrait des réunions avec uniquement des Albo-Européens ou bien Le Canon français qui organise dans tout l’Hexagone des réunions festives accompagnés de chants traditionnels, de charcuterie et de vins de terroir.

L’extrêêêêêêêêêêêêêêêêêêêême droite tapie dans l’ombre serait à la manœuvre. On frise ici le complotisme à l’état pur, mais comme il est propagé par les plumitifs de gauche, cela ne choque personne.
La fin du mois de janvier vient d’être secouée par une polémique futile. La SNCF propose, contre un billet plus élevé, à ses clients qui prennent les TGV en semaine des compartiments sans enfants, la classe Optimum Plus.

La compagnie ferroviaire française ne fait que suivre une tendance sociétale bien vivace. Outre les mariages, bien des restaurants, des hôtels et des centres de loisirs refusent la venue de jeunes enfants de moins de 12 ans. Certaines associations condamnent cette mode, reflet manifeste du naufrage historique du système scolaire hexagonal. Les gamins dérangent parce que leur éducation à l’école repose sur la bienveillance, ce terme politiquement correct pour désigner le laxisme.
Hormis Jean-Yves Le Gallou dans un article mis en ligne sur Polémia le 2 janvier dernier, personne n’a enfin réagi aux propos pitoyables tenus en décembre 2025 par Mathias Wargon, le patron des urgences à l’hôpital Delafontaine en Seine – Saint-Denis. L’urgentiste médiatique suggérait de refuser les malades de la grippe de plus de 65 ans non vaccinés. Singulière application du serment d’Hippocrate ! Dans « Matthias Wargon veut interdire les urgences médicales aux non-vaccinés », le président – fondateur de Polémia cingle avec un rare bonheur les contradictions de l’époux d’Emmanuelle Wargon, ancienne ministresse des gouvernements d’Édouard Philippe et de Jean Castex, fille par ailleurs de l’immigrationniste Lionel Stoléru. « Wargon veut-il aussi fermer les urgences aux victimes de coma alcoolique et les hôpitaux aux alcooliques, écrit Jean-Yves Le Gallou ? Wargon veut-il interdire des soins aux drogués et aux victimes d’overdose. Allons plus loin, Wargon veut-il fermer l’hôpital public aux accidentés de sports à risque – équitation, parachutisme, alpinisme par exemple – activités dangereuses qu’ils auraient pu sagement éviter de pratiquer ? Pourquoi aussi ne pas limiter l’accès aux soins cardiovasculaires pour les obèses souvent jugés responsables de leur état en raison de leur alimentation et de leur sédentarité ? Dans le même ordre d’idées, faut-il conditionner l’accès aux soins respiratoires aux non-fumeurs ? On peut d’ailleurs poursuivre l’idéologie wargoniste à l’infini et reprocher à certains malades du SIDA ou de MST d’être la cause de leur malheur par certaines de leurs pratiques sexuelles dangereuses. » Aucune officine spécialisée dans la délation n’a attaqué le médecin devant la justice. En aurait-il été autrement s’il avait porté une chemise noire ?
L’hostilité officielle aux discriminations est une vaste et coûteuse fumisterie. Selon son étymologie latine, discriminer signifie « mettre à part, séparer, distinguer ». Mettre à part, distinguer, séparer sont des actions de tous les jours. Tout un chacun discrimine en permanence. S’il choisit telle compagne et non une autre, il pratique une discrimination. S’il préfère acquérir une maison résidentielle péri-urbaine et non un appartement miteux dans un immeuble de banlieue saturé par l’immigration, il réalise une autre discrimination.

Avant de conclure, n’oublions pas enfin que la discrimination est parfois recommandée et même encouragée. Les ménages doivent trier les ordures et les distinguer selon leur caractère domestique, alimentaire ou recyclables (papier, carton, bouteilles en plastique). Notons au passage que le « tri sélectif » constitue un pénible pléonasme puisque trier, c’est distinguer et donc sélectionner… Loin de l’opinion officielle, les discriminations façonnent le quotidien. Dans une logique évolutionnaire darwinienne, c’est grâce à ce jeu complexe que s’opère la sélection des espèces. La réalité le prouve avec aisance: discriminer, c’est vivre!
GF-T
«Chronique flibustière», n° 181, mis en ligne le 11 février 2026 sur Synthèse nationale.
17:58 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, france, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Lyon, Quentin, un seuil est franchi

Lyon, Quentin, un seuil est franchi: l’antifascisme imaginaire tue
par Sergio Filacchioni
Source: https://www.ilprimatonazionale.it/approfondimenti/lione-q...
Rome, 14 février – Une conférence de la députée de gauche Rima Hassan, qui s’est tenue le 12 février à l’Institut d’Études Politiques de Lyon, s’est transformée en un grave incident, où le sang a coulé. En effet, aux abords du lieu où se déroulait l’événement, une agression a eu lieu, qui a fait une victime Quentin, 23 ans, qui serait intervenu — selon les versions — pour défendre des activistes du collectif identitaire Nemesis présentes sur place lors d’un flash mob de protestation.
À Lyon, le sang recommence à couler
Selon les dénonciations des militants eux-mêmes, un groupe d’environ trente antifascistes, affiliés au groupe de la Jeune Garde, aurait encerclé et frappé plusieurs personnes. Quentin aurait été atteint de coups de poing et de pieds, même une fois à terre, subissant de graves traumatismes crâniens. Transporté en urgence à l’hôpital Édouard-Herriot, il a été admis dans un état critique. Dans les heures qui ont suivi, son état s’est aggravé jusqu’à son décès, selon les mêmes sources proches du collectif. Les autorités françaises ont ouvert une enquête pour meurtre volontaire et analysent les vidéos de surveillance ainsi que les témoignages pour reconstituer la dynamique exacte des faits et identifier d’éventuels responsables. Parmi les noms cités par les activistes de Nemesis, figure celui de Jacques-Élie Favret. Sa présence dans le groupe responsable du meurtre brutal indique comment la gauche structure le conflit politique: Favret est collaborateur du député de La France Insoumise, Raphaël Arnault.
Seul contre un grand nombre
Avec l’assassinat de Quentin, la France et l’Europe sont confrontées à un fait qui ne s’était pas produit depuis des années: un jeune militant a été tué lors d’une attaque organisée et politiquement protégée par l’extrême gauche. Un événement qui ne peut pas nous laisser indifférents en Italie: de Sergio Ramelli à Paolo Di Nella, les agressions antifascistes ont marqué une période sanglante de notre histoire nationale récente. Et, non, le discours sur les “extrêmes opposés” ne tient pas. Quentin, Sergio et Paolo ont été attaqués par de nombreux adversaires alors qu'ils étaient seuls: certains revenaient chez eux, d’autres collaient des affiches, d’autres encore se sont avancés. Des militants politiques qui n’ont pas brandi d’arme ou de bâton, mais qui avaient le courage de vouloir changer le destin de leur pays. Quentin était un patriote, un catholique dévot, un garçon sportif et amoureux de la lecture. Selon les témoins, il n’aurait pas hésité à se porter volontaire pour protéger les jeunes activistes du collectif féministe/identitaire lors d'un moment de tension maximale. C’est cet élément, plus encore que la dynamique violente, qui frappe ceux qui le connaissaient: l’idée d’une responsabilité assumée personnellement, sans calcul.
L’antifascisme à l’épreuve des faits
Pendant des années, une certaine mouvance politique a revendiqué “l’antifascisme militant” comme une catégorie légitime, distincte de la violence. Pourtant, lorsqu’un antifascisme se structure comme présence organisée dans la rue, prête à l’affrontement physique, la frontière entre politique modérée et politique violente disparaît. Si la France a connu ces dernières années dissolutions, polémiques et procédures surtout contre des groupes identitaires et nationalistes, il est évident que la tolérance pour certaines formes de militantisme de gauche a nourri leur aura d’impunité. En fin de compte, lorsque des partis structurés présentent des candidats issus de l'activisme radical, les protègent ou légitiment de telles figures, le message est clair: cet engagement fait partie intégrante du champ politique institutionnel. Le cas d’Ilaria Salis en Italie — devenue symbole avant même la fin de sa procédure judiciaire — illustre cette dynamique où le charognard est transformé en modèles pour la représentation politique par des partis qu’on voudrait en théorie modérés, qu'ils soient “verts” ou de centre-gauche.
À Lyon, le climat change pour tous
Pendant des années, on a répété que “tuer un fasciste n’est pas un crime”, que l’adversaire politique n’est pas un concurrent mais une menace ontologique, le saut de la délégitimation morale à l’agression physique n’est pas une aberration imprévisible: c’est une dérive logique. Et le problème ne concerne pas seulement la France. En Italie, en 2025, à Padoue, un militant de CasaPound a fini à l’hôpital après une attaque antifasciste organisée pour frapper durement. Nous nous souviendrons de Quentin, mais pas comme d’une victime. Nous nous souviendrons du courage et de la détermination avec lesquels cet “un” est meilleur que ce “beaucoup”. Nous nous souviendrons de ce jour comme le point où une nouvelle ère de radicalisation tragique trouve sa pleine éclosion. Parce qu’à partir de maintenant, personne ne pourra plus faire semblant que ce n’est qu’un simple conflit politique. Une nouvelle frontière a été franchie. Et quand une frontière est dépassée, le climat change pour tous.
Sergio Filacchioni.
Sergio Filacchioni est journaliste, graphiste et photographe, actif avec le site en ligne Il Primato Nazionale. Rome. Il est né en 1998.
* * *
16:41 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lyon, quentin, france, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 14 février 2026
Les trois Europe à une époque de danger maximal

Les trois Europe à une époque de danger maximal
Carlos X. Blanco
Article de Carlos X. Blanco publié dans Voces del Periodista (Mexique), année XXX, n° 519, février 2026.
Il appartient aux hommes et aux femmes de cette génération de revivre une fois de plus des temps dangereux. En réalité, l'exception est le contraire : la chance de connaître, au cours d'une seule vie, de longues années de paix relative, entrecoupées seulement de conflits locaux qui ne menacent pas l'existence même de la civilisation, voire de l'espèce.
Cette paix « froide » et relative, ces 80 années de guerres localisées et contenues, sont désormais révolues. Nous devons nous préparer à la « convergence des catastrophes », pour reprendre un terme cher au défunt penseur français Guillaume Faye.
La vie de cette génération et de la prochaine, en particulier dans cette sphère que l'on appelle, par intérêt ou par paresse, « l'Occident », sera de plus en plus risquée, incertaine et soumise à des réalités difficiles. L'« Occident », en tant que tel, est un concept voué à disparaître ; l'idée est en train de mourir parce que la réalité qu'elle reflète est en train de mourir. Il n'existe qu'un seul empire américain... et les autres. La faiblesse même du concept, d'une part, ainsi que la transformation brutale de la réalité géopolitique au cours des derniers mois, d'autre part, conduisent inévitablement à sa fin.
L'« Occident » était un concept qui, s'il n'a pas été inventé, a certainement été diffusé à des fins de propagande par l'Anglosphère. Le mot lui-même cache ce qui, jusqu'au XIXe siècle, était une réalité fondamentale : la civilisation européenne. Depuis leurs îles, les Britanniques se sont historiquement consacrés à maintenir le continent dans un état de guerre civile permanente, désuni et, surtout, séparé de la Russie, séparé de cette immense nation, la seule qui aurait pu donner une consistance (territoriale, démographique, énergétique) à un continent déjà doté d'une tradition culturelle commune, comme l'Europe.
Depuis 1492, lorsque les Européens se sont projetés vers les Amériques dans cette tâche complexe de détruire et de construire un monde nouveau, et depuis la fin du XVIIIe siècle, lorsqu'une nouvelle « nation » anglo-saxonne, les États-Unis, a commencé à acquérir les caractéristiques d'une puissance, cet Occident est devenu synonyme d'américanisation du monde, et l'« Europe » a été éclipsée.

L'américanisation du monde a connu plusieurs phases au cours du XIXe siècle. La première, évidemment, a consisté à régler ses comptes avec la Couronne britannique. Non seulement l'indépendance de l'Union vis-à-vis des Anglais, mais aussi la sécurité contre les représailles ou les tentatives de reconquête de la part des Anglais, étaient les priorités immédiates. Le mode de production capitaliste, dans son évolution incessante au cours du XIXe siècle, allait transformer la confrontation anglo-américaine en son contraire, une complémentarité, comme nous le voyons aujourd'hui. Le Royaume-Uni continue d'être le pont d'envoi des États-Unis en Europe. Les îles britanniques sont comme d'énormes porte-avions ancrés dans l'océan Atlantique, toujours prêts à intervenir, avec un type d'ingérence spécifiquement destiné à créer la désunion et le dysfonctionnement entre les Européens. L'Amérique du Nord a pris la place de l'Empire britannique dans sa domination impérialiste sur le monde, et aussi sur l'Europe, à l'ère du capitalisme. Parler de l'impérialisme comme de la « phase suprême » du capitalisme (Lénine) et parler de l'Empire de l'Anglosphère, c'est la même chose. En ce sens, ce stade suprême a consisté en deux phases : la phase britannique et la phase américaine. Cette deuxième phase, la phase américaine, dont nous assistons au déclin, est en fait complétée par une entité (le Royaume-Uni) en fort déclin depuis 1945, mais dont les vestiges et le butin sont encore utiles aux États-Unis.
Au cours des dernières semaines, nous avons assisté à une sorte de révélation. C'est comme si les dieux avaient décidé de révéler leurs desseins les plus secrets à l'humanité, nous montrant la signification cachée du monde, un mystère insondable depuis le début du XIXe siècle. Deux longs siècles sont en train d'être déchiffrés. Parlons des deux grandes révélations:

La « doctrine Monroe ». L'existence même d'une nation artificielle, support matériel d'un empire capitaliste prédateur, repose sur l'anéantissement existentiel de l'Amérique ibérique. Les « États-Unis d'Amérique » avaient un noyau puritain et anglo-saxon, mais ils se sont progressivement étendus avec l'immigration européenne. L'extermination systématique et complète des Amérindiens au cours du XIXe siècle préfigurait Gaza. Le génocide actuellement en cours à Gaza est, à son tour, un présage de ce qui arrivera à d'autres peuples et nations. De plus, la nation américaine ne serait qu'une petite bande de territoire américain peuplée de colons blancs d'origine européenne et de villes calquées sur l'Angleterre, sans l'usurpation massive et le vol de terres au Mexique.
Depuis ses origines au XVIe siècle, une époque où l'Angleterre n'était guère plus qu'une nation appauvrie et un repaire de pirates, l'Anglosphère a trouvé sa raison d'être et sa source d'énergie dans l'anéantissement existentiel de l'Hispanidad : le monstre anglo-saxon s'est développé proportionnellement à la part de l'Hispanidad qu'il a engloutie et pillée. Les nations hispaniques, ou plus généralement les nations ibériques, doivent être traitées comme des colonies et des champs d'extraction, tant en Amérique qu'en Europe, afin de soutenir l'existence même de l'Anglosphère. Tant que les géopoliticiens et les philosophes de l'histoire ne reconnaîtront pas pleinement et méticuleusement, comme une loi inexorable, l'équation qui dit : « plus l'Anglosphère est grande, plus l'Ibéro-sphère est petite », il n'y a aucune chance d'arrêter le monstre de ce même hémisphère, appelé « hémisphère occidental ». La chute du dollar lui-même, ou les attaques défensives de la Russie, de la Chine et d'autres puissances non occidentales, accéléreront la ruine de l'Empire occidental, avec des millions de morts et une grande dévastation dans de nombreux pays.
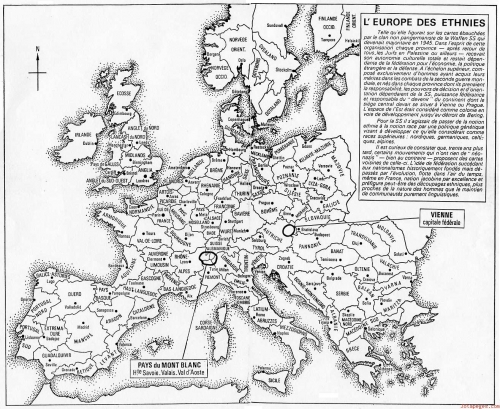
Colonialisme et racisme. Il est urgent que l'Europe elle-même se « dés-occidentalise ». Il existe peut-être, pour arrondir, une centaine de nations en Europe. Les différences ethniques entre elles ne sont pas grandes, mais la grande mosaïque qui constitue l'Europe est bien connue. Cette énorme diversité possède cependant un mortier ou un ciment qui lui a donné sa substance pendant des siècles : la tradition hellénique (transmise à Rome et au christianisme), base d'une pensée rationnelle qui s'est épanouie sous la forme de la philosophie, de la science et de l'éthique de la personne. La christianisation de l'Europe tout au long du Moyen Âge est l'autre substance unificatrice qui a fait du chrétien européen l'habitant d'une immense république, la même de Lisbonne aux confins les plus reculés de la Russie, identique des régions septentrionales lointaines aux rives de la mer Méditerranée. Cependant, c'est à l'époque moderne, l'époque des empires d'outre-mer et du capitalisme, que la signification de l'« européité » a été complètement déformée. Ce n'est qu'alors que le mythe de la suprématie blanche s'est emparé du cœur des conquérants qui, se considérant comme des « civilisateurs » et des « évangélisateurs », sont devenus – en réalité – des génocidaires.
Entre le XVIe et le XXe siècle, l'Europe connue par les autochtones d'autres continents n'était pas tant l'Europe d'Homère, de Platon, d'Aristote, de Thomas d'Aquin, de Kant, d'Einstein... ni tant l'Europe de Cervantes, de Shakespeare, de Goethe, ni tant celle de Bach et de Beethoven... c'était l'Europe des esclavagistes, des génocidaires, des pillards. De plus, le mythe suprémaciste et raciste a été intériorisé dans le système complexe des « cent nations » d'Europe. Le continent, désormais rabaissé par les actions néfastes de ses propres élites, laquais des pouvoirs financiers mondiaux et abjects sbires de Trump, traverse également une crise d'identité et une remise en question de son existence homogène.

L'Europe n'est plus « hellénique », car la religion du capitalisme anglo-saxon (prédation, loi de la jungle en économie, individualisme rampant, idolâtrie du marché, consumérisme féroce...) a remplacé les idéaux d'une vie modérée et rationnelle, de modération face à l'orgueil (hybris) et de culture de la beauté dans le corps et l'âme. Et elle n'est même pas chrétienne : l'Europe a perdu son unité, non seulement à cause d'une « sécularisation » que les progressistes de tous bords exaltent comme bénéfique, mais aussi à cause de l'immigration massive de musulmans, d'une part, et de l'adoption de principes sionistes (que certains confondent avec des principes « chrétiens ») tels que la vision de la « préférence divine » pour un peuple particulier, le suprémacisme ségrégationniste, la bellicosité prétendument justifiée par Dieu, l'acceptation de l'oxymore appelé « judéo-christianisme », etc. Le « modèle Gaza » sera imposé dans d'autres parties du monde tant que l'Empire occidental, c'est-à-dire la superstructure créée par le secteur le plus prédateur et le plus meurtrier du capitalisme anglo-saxon, fonctionnera. Tant que l'Europe ne parviendra pas à retrouver son unité spirituelle (fondement de l'unité géopolitique) basée sur la richesse de ses « cent nations » et, surtout, sur ses doubles racines helléniques et chrétiennes, elle restera une partie du monde vouée à devenir un champ de bataille (elle l'est déjà) et un camp de concentration (elle l'est déjà, au niveau numérique et médiatique).
La raison d'être de l'Europe dans les années à venir devra consister à éviter ces deux horribles possibilités et, à tout prix, à rompre les liens avec les États-Unis. Ce sera difficile : renverser des gouvernements, boycotter des institutions, réajuster les niveaux de consommation et s'habituer à la modestie... Mais si elle n'y parvient pas (et cela doit être fait par les peuples européens eux-mêmes, à partir de la base), elle connaîtra le même sort que les empires « blancs » suprémacistes, esclavagistes et colonisateurs ont infligé à une grande partie de l'humanité qui a assisté à leur arrivée. Les Noirs, les indigènes, les Asiatiques le savent et ne peuvent l'oublier.
À l'heure actuelle, pour le dire simplement, il existe trois grandes Europe : l'Europe orientale, complètement manipulée par l'Empire dans sa russophobie ; l'Europe occidentale et septentrionale, dominée par les Français et les Allemands, victime des mêmes vices suprémacistes, désireuse de continuer à sous-développer l'Europe méridionale, mais vassale indigne des États-Unis ; et enfin, l'Europe méridionale (Portugal, Espagne, Italie et Grèce). Cette Europe méridionale, la plus maltraitée par une Union conçue pour servir l'OTAN et l'Anglosphère (tout se révèle maintenant), est la seule à avoir le potentiel de conclure des alliances avec les principaux pays d'Amérique latine et d'explorer des voies en dehors de celles de l'Anglosphère. Pourtant, nous nous trouvons dans les griffes de cette Anglosphère.
16:59 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 10 février 2026
À partir de 2027, plus de GNL russe vers l’Europe

À partir de 2027, plus de GNL russe vers l’Europe
Les membres du G7/UE se sont enfermés dans une position délicate: comment nuire à la Russie en cessant d’importer du GNL russe tout en garantissant l’approvisionnement nécessaire en GNL?
par Joachim Van Wing
Source: https://joachimvanwing.substack.com/p/vanaf-2027-geen-rus...
Exclure le GNL russe s’annonce comme un défi de taille, car les deux objectifs semblent presque incompatibles. Comment échanger le GNL russe contre tout le gaz naturel disponible du Qatar, d’Australie et des États-Unis?
Nous en sommes déjà à la 20ème série de sanctions que le G7/UE27 impose à la Russie. Elles s’appuient sur des sanctions précédentes qui ont été techniquement bien préparées, mais qui, comme prévu, n’ont jamais atteint l’effet escompté.
« La Russie ne viendra à la table des négociations qu’avec des intentions sincères si elle est mise sous pression. C’est la seule langue que la Russie comprend. »
– Ursula von der Leyen, Bruxelles, 6 février 2026
Sanctions précédentes contre la Russie
Jusqu’à présent, la 6ème série de sanctions, fin 2022, a été la plus sévère.
(I) 6 octobre 2022 : interdiction des services de transport, de financement et d’assurance pour l’exportation russe de pétrole par bateau.
(II) 5 décembre 2022 : mise en œuvre d’un plafonnement des prix pour le pétrole brut russe.
(III) 5 février 2023 : mise en œuvre d’un plafonnement des prix pour les produits pétroliers russes, comme le diesel raffiné et l’essence.
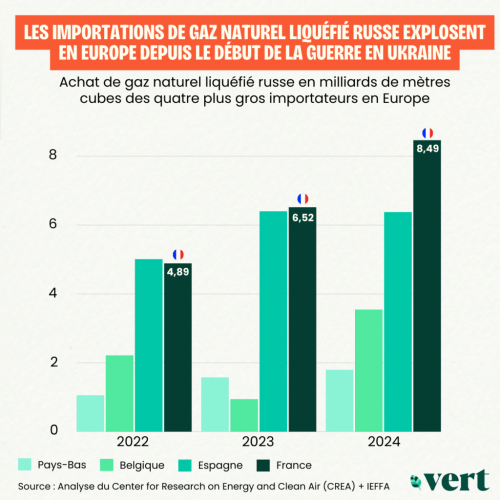
Cette 6ème série de sanctions s’est révélée moins efficace que prévu, car les clients et fournisseurs ont contourné ces mesures par trois astuces simples:
(1) Des centaines de compagnies maritimes ont proposé de transporter le pétrole russe en dehors du système d’assurance occidental. Ces compagnies sont désignées comme la « flotte fantôme ».
(2) Des pays du sud global et des BRICS n’ont en rien respecté le plafond fixé, utilisant les sanctions comme levier pour obtenir de fortes réductions de prix à Moscou.
(3) Le pétrole brut russe et les produits finis sont déchargés ou mélangés en ports ou en mer, rendant la « provenance » non documentée ou non traçable. Le pétrole russe continue ainsi d’alimenter nos voitures, camions, grues, tracteurs, ainsi que les clusters pétrochimiques de Dunkerque, Barcelone, Bilbao, Rotterdam ou Anvers.
20ème cycle de sanctions économiques
Attention… les traders et compagnies maritimes respectant scrupuleusement le « plafond de prix » transportent aujourd’hui en toute légalité le pétrole russe vers l’Europe de l’Ouest. La surproduction mondiale de pétrole fait chuter les prix en dessous du plafond fixé à 65 dollars le baril, ce qui a réduit l’effet du « price cap » sur le pétrole russe. En réaction, l’UE ajoute 43 navires à la liste des sanctions, portant la « flotte noire » à 640 tankers. Par ailleurs, le plafond de prix du diesel et du pétrole brut est encore abaissé à 15 % en dessous des prix du marché de l’Oural. Enfin, l’UE27, avec le soutien du G7, impose une interdiction de maintenance et de services techniques pour les tankers et brise-glaces russes, ciblant directement les infrastructures clés pour l’exportation gazière de la Russie et ses activités dans l’Arctique.
Malgré cette 6ème série de sanctions, la Russie a encore exporté en janvier 16% de son pétrole brut et 35% de ses produits raffinés vers l’Europe. Les chiffres pour le GNL sont également importants.
Importation/exportation de GNL russe
Les sanctions concrètes contre le pétrole russe se sont révélées plus difficiles à mettre en œuvre que prévu. C’est pourquoi l’Union européenne et le G7 concentrent désormais leurs efforts sur le gaz naturel liquéfié russe (GNL), livré quotidiennement en grandes quantités dans nos terminaux de GNL en Europe de l’Ouest.
En 2025, l’UE27 a importé pour 7,2 milliards d’euros de GNL russe et a reçu l’an dernier plus de 200 livraisons de GNL en provenance de Russie. Selon un rapport de Kpler, en janvier cette année, 92,6% de la production totale de GNL à Yamal a été achetée par des clients européens. Cela représente une augmentation de 8% par rapport à janvier de l’année dernière. Sur les 25 navires transportant du gaz de Yamal en janvier 2026, 23 ont livré leur cargaison dans des ports européens, Zeebrugge étant la destination la plus importante.

Exportations de GNL russe vers l’UE en janvier 2026. Source : Kpler
Conclusion
Cela montre à quel point l’Europe, malgré les sanctions et la pression politique, dépend du gaz russe. Et c’est compréhensible: la Russie reste le producteur mondial pivot de gaz naturel. En d’autres termes… les volumes que la Norvège, le Qatar, les États-Unis et l’Australie peuvent exporter ne suffisent pas à remplacer la totalité des exportations russes.
A la Place Schuman à Bruxelles, cette réalité est pleinement reconnue. Mais cela n’empêche pas le Conseil de l’Union européenne de commencer, dès le 1er janvier 2027, à limiter totalement l’importation de GNL russe.
21:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, sanctions, gaz, gaz russe, gnl, gnl russe, hydrocarbures |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 09 février 2026
L'Europe est prête à se suicider pour une poignée de misérables idées

L'Europe est prête à se suicider pour une poignée de misérables idées
Lorenzo Maria Pacini
Source: http://newsnet.fr/304235
Il y eut une période où l’Union européenne était décrite comme un rempart compétitif face aux États-Unis, comme la création d’un sujet supranational doté d’une masse critique suffisante pour peser sur la scène mondiale.
Tout cela s’est avéré une illusion.
Pourquoi ?
Lorsque le Traité de Maastricht a été élaboré, l’Occident était encore plongé dans le mythe de la victoire néolibérale sur l’Union soviétique. En conséquence, le modèle néolibéral a façonné les principaux mécanismes juridiques, le rôle de l’industrie publique et les relations avec la finance.
Ce modèle suppose que la liberté de marché constitue une sorte d’équivalent supérieur de la démocratie (quasi une perfection par rapport au mécanisme électoral traditionnel) et confère une fonction de moteur au grand capital, reléguant la politique à un rôle subordonné, limité à faciliter les processus économiques.
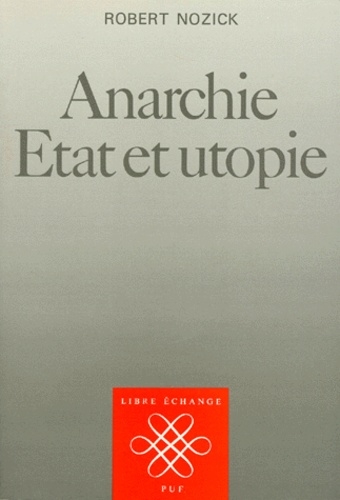 Des théories extrêmement abstraites, comme celle de Nozick sur la naissance de l’État à partir du libre échange entre individus motivés par l’intérêt personnel, ont fourni la structure d’un modèle inédit. On imaginait qu’une entité politique (une union, une fédération) pourrait émerger spontanément d’une intense intégration de marchés.
Des théories extrêmement abstraites, comme celle de Nozick sur la naissance de l’État à partir du libre échange entre individus motivés par l’intérêt personnel, ont fourni la structure d’un modèle inédit. On imaginait qu’une entité politique (une union, une fédération) pourrait émerger spontanément d’une intense intégration de marchés.
L’expérience européenne représente ainsi la première (et, à la lumière des résultats, peut-être la dernière) tentative historique de construire une union politique à partir d’un marché commun, fondée sur la compétition mutuelle entre États obligés d’atteindre une compétitivité maximale.
Ce qui s’est produit, cependant, correspond à ce qui arrive habituellement sur des marchés hautement compétitifs dépourvus de correctifs politiques adéquats (sans tarifs douaniers, sans instruments d’ajustement monétaire, etc.): il y a eu des gagnants et des perdants. Certains pays ont accumulé des avantages, d’autres ont vu leurs ressources s’amincir (notamment l’Italie).
L’idée traditionnelle de gouvernements démocratiquement responsables envers les citoyens a été progressivement remplacée par le concept de «gouvernance», entendu comme un système de règles techniques pour la gestion économique, jusqu’à configurer une politique guidée par un «pilote automatique».
Les systèmes financiers sont impersonnels et supra-nationaux, mais pas pour autant dépourvus de centres de pouvoir. Le principal centre de la finance occidentale se situe le long de l’axe New York-Londres, tandis que l’axe politique reste, historiquement, le gouvernement des États-Unis.

L’Europe née avec Maastricht, choisissant d’opérer selon des règles néolibérales, est inévitablement entrée dans l’orbite des grands centres financiers, étroitement liés à la politique américaine. Aux États-Unis, la recherche de la suprématie nationale et celle du profit financier coïncident presque parfaitement.
Ainsi, au moment même où le développement de l’après-guerre aurait pu permettre une plus grande autonomie, l’Europe est revenue sous l’hégémonie américaine.
Depuis les années 1990, cette hégémonie s’est manifestée non seulement sur le plan financier et militaire, mais surtout culturellement, érodant progressivement la capacité de résistance de l’Europe. Au cours des trente dernières années, on a assisté à une profonde américanisation idéologique: non seulement dans le domaine du divertissement, mais aussi dans les modèles institutionnels, la gestion de l’éducation, de l’université et des services publics.
L’hégémonie culturelle a facilité l’expansion de l’influence politico-militaire américaine, qui, au lieu de diminuer après la Seconde Guerre mondiale, s’est redéfinie dans une nouvelle dimension mondiale.

L’UE a systématiquement soutenu les principales initiatives géopolitiques américaines: Afghanistan, Irak, Yougoslavie, Libye. Le cadre narratif — celui de l’ordre international fondé sur des règles et des droits humains — a permis de faire accepter ces politiques par l’opinion publique européenne.
En même temps, alors que l’Europe se félicitait de sa supériorité morale, les États-Unis ont contribué à interrompre des chaînes d’approvisionnement essentielles pour notre continent. Plusieurs producteurs d’énergie du Moyen-Orient non alignés ont été déstabilisés; d’autres, comme l’Iran, ont été frappés par des sanctions limitant leurs relations commerciales avec l’Europe.
La guerre en Ukraine a finalement coupé le principal canal énergétique européen en provenance de Russie.
Privée de ces sources, l’Europe s’est liée au GNL américain, avec une hausse significative des coûts énergétiques et une perte de compétitivité industrielle. Dans ce contexte, le pouvoir de négociation européen face aux États-Unis s’est considérablement réduit.

Une telle situation, aussi détériorée, est difficile à inverser. L’Union européenne néolibérale et ses institutions ont produit l’un des moments de faiblesse relative les plus importants de l’histoire moderne de l’Europe.
Il ne reste plus qu’à laisser « les morts enterrer leurs morts », car, soyez-en certains, il n’y aura, dans l'avenir, ni ceux qui chercheront à sauver le statu quo, ni ceux qui voudront de nouvelles alliances pour « changer le système de l’intérieur » — mais tous ignorent que des idées déjà mortes ne peuvent qu’engendrer la mort.
Lorenzo Maria Pacini est professeur associé en philosophie politique et en géopolitique, à l'UniDolomiti de Belluno. Consultant en analyse stratégique, renseignement et relations internationales.
strategic-culture.su
20:45 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 08 février 2026
Quand la droite européenne en aura-t-elle fini avec Trump?

Quand la droite européenne en aura-t-elle fini avec Trump?
Peter W. Logghe
Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94
Dire qu’une grande partie de ce que l’on appelle la « droite européenne » voit dans l’élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis une percée du populisme de droite, et que ces élections ont aussi laissé entrevoir le meilleur espoir pour les partis de droite en Europe, c’est ouvrir une porte grande ouverte. Trump a été soutenu dans ses provocations par la droite européenne, car, comme j’ai lu quelque part sur une page Facebook: «Trump est l’anti-illusion. Il ne parle pas le langage de l’auto-illusion européenne d’après-guerre, mais celui de la réalité. Brutale. Parfois maladroite. Souvent exagérée. Mais ancrée dans une seule vérité simple: le monde ne suit pas des lignes directrices morales, mais des rapports de force».
Une partie de cette sympathie de droite était liée aux réactions pavloviennes de figures comme Björn Soenens et d’autres face à chaque intervention du président américain. Une autre partie avait aussi à voir avec le fait que Donald Trump ose au moins dire ce qu’il pense: «Si vous voulez la paix, préparez-vous à la guerre!». De même, la politique de Trump en matière d’immigration illégale, une politique dure qui porte peu à peu ses fruits, a pu recueillir beaucoup de compréhension de la part de la droite européenne. N’est-ce pas Trump qui réalisait ce qu’il avait promis aux électeurs ?
L’intervention de Trump fait-elle fondre le soutien électoral de la droite européenne?
Les premiers mois de bonheur semblent derrière nous: la menace de taxes à l’importation, le mépris du président américain pour ses partenaires de l’OTAN, et pour couronner le tout, la crise du Groenland ont probablement fait réaliser à certainrs figures de la droite européenne que Trump considère l’Europe comme insignifiante, voire gênante, et qu’il ne sert que les intérêts américains. Qu’il ne croit qu’au droit du plus fort — de l’Amérique donc. Et que ceux qui lui mettent des bâtons dans les roues sont traités avec brutalité, mépris.
À quel moment la sympathie idéologique se transforme-t-elle en soumission politique ou, au contraire, en rébellion politique? La politique migratoire de Trump pourrait bien devenir ce moment de basculement. Comme j’ai aussi lu quelque part sur Facebook : «Arrêter la migration illégale? Aucun problème. Poursuivre les clandestins et les expulser du pays? Aucun problème. Mais tuer des gens de cette façon, c’est une ligne qu’on ne peut pas franchir». La méthode de Trump — brutale, violente, qui semble même désorganisée — cause des soucis à (une partie de) la droite en Europe. Pour la droite européenne, une politique migratoire stricte ne peut être efficace que si elle s’inscrit dans un cadre ordonné, juridiquement fondé et politiquement soutenu. Le soutien à une politique migratoire stricte en Europe de l’Ouest s’élargit, mais jusqu’à quand, avec les actions de Trump en arrière-plan ?
Copier les méthodes américaines ne serait pas seulement une erreur, cela risquerait aussi d’être sanctionné politiquement. Et là réside probablement le plus grand danger pour la droite en Europe: la politique migratoire de Trump freine-t-elle la percée électorale des partis de droite radicale en Europe de l’Ouest, et empêche-t-elle indirectement ces partis d’accéder au pouvoir? Et comment prendre ses distances d’un président et de ses méthodes sans perdre sa crédibilité?
16:04 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, droites européennes, affaires européennes, actualité, donald trump |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Guerre en Ukraine: pourquoi la fixation sur les territoires mène à une erreur analytique

Guerre en Ukraine: pourquoi la fixation sur les territoires mène à une erreur analytique
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
Un texte remarquable nous vient de Washington — et il est l’un des textes qui, dans le discours mainstream allemand, reste largement sous le radar. Il émane de l’analyste américaine Jennifer Kavanagh de Defense Priorities (https://www.defensepriorities.org/opinion/conceding-donet...) et remet en question une hypothèse qui est également considérée comme acquise ici: que la question « Donbass oui ou non ? » n’est pas une perspective de solution, mais une simplification analytique. La guerre n’a pas été lancée à cause des territoires — et elle ne peut pas être terminée en résolvant la question des territoires.
Pendant des mois, l’administration Trump, selon Kavanagh, a défendu une équation simple: concessions territoriales de Kiev contre garanties de sécurité occidentales. Cette approche a été notamment portée par Steve Witkoff, qui a déclaré que la question des territoires était le dernier obstacle sur la voie de la paix. C’est cependant ici que réside l’erreur de raisonnement. Réduire le conflit à des cartes géographiques, c’est passer à côté de sa nature en tant qu’affrontement militaire-stratégique autour d’espaces de sécurité, autour d'un contrôle pour éviter toute escalade et toute logique d’alliance.

Le point central de l’analyse est donc sobre — et d’un point de vue sécuritaire, impératif:
Un cessez-le-feu stable n’est possible que si les causes structurelles de la guerre sont traitées. Ces causes ne résident pas dans le simple contrôle de certaines régions, mais dans des questions relevant d'une architecture de sécurité de dimension européenne: rapports de force militaires, zones de stationnement, de portées balistiques, appartenance à une alliance et profondeur stratégique.
Kavanagh argumente logiquement : même une concession territoriale de Kiev ne marquerait pas la fin, mais seulement le début de négociations substantielles. Il s’agirait alors: 1) de la taille des forces ukrainiennes et de l’orientation qu'elles prendraient, 2) d’un statut de non-alignement formellement établi, 3) d'un contrôle des armements et 4) de questions d’ordre politique intérieur. Le territoire ne serait alors plus un objectif, mais au mieux un facteur tactique dans un cadre de sécurité plus global.
On peut contredire l’auteure sur certains détails — par exemple sur la confusion entre Donetsk et le Donbass. Mais cela est secondaire. Ce qui est plus important, c’est autre chose: pour la première fois, la partie américaine reconnaît sérieusement que cette guerre ne peut pas être analysée isolément, mais qu’elle est l’expression d’une question fondamentale de sécurité qui n’a pas été résolue en Europe depuis des années.
De ce point de vue, il devient évident qu'une stratégie de négociation qui mettrait l’accent sur les seules questions territoriales resterait superficielle. Ce qu’il faudrait, c’est un retour aux instruments classiques de la politique de sécurité et de contrôle des armements: règles de neutralité, limitations des forces armées, transparence sur l’infrastructure militaire, accords sur la non-stationnement de certains systèmes d’armes.
Le point devient politiquement sensible lorsque les think tanks américains parlent encore d’un rôle «médiateur» de Washington. Du point de vue européen — et encore plus du point de vue allemand — cette vision est problématique. Les États-Unis ne sont pas un observateur extérieur, mais un acteur central avec ses propres intérêts stratégiques. Ces intérêts ne sont pas automatiquement alignés avec les besoins de sécurité de l’Europe.
Pour l’Allemagne en particulier, ce point est crucial. Car les conséquences de cette guerre — économiques, énergétiques, sécuritaires — touchent directement l’Europe. Un ordre de paix européen reposant uniquement sur des garanties de sécurité transatlantiques reste structurellement instable.
Il ne suffit donc pas d’émettre des déclarations politiques en faveur de la fin de l’expansion de l’OTAN vers l’Est. La stabilité ne se construit pas par la rhétorique, mais par des règles vérifiables et contractuellement fixées.
#géopolitique@affaires_mondiales_par_elena
14:58 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ukraine, europe, affaires européennes, actualité |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 06 février 2026
Le gros bâton : les États-Unis se retournent contre leurs alliés – l’Europe commence à reconnaître le coût de sa dépendance, mais ne peut s’en libérer

Le gros bâton: les États-Unis se retournent contre leurs alliés – l’Europe commence à reconnaître le coût de sa dépendance, mais ne peut s’en libérer
par Shen Sheng
Source: https://www.cese-m.eu/cesem/2026/02/il-grosso-bastone-usa...
Les propos du Premier ministre belge Bart De Wever marquent un changement de ton en Europe : la « protection » américaine devient un levier de pression contre les mêmes alliés. La prise de conscience des coûts de la dépendance s’accroît, mais l’autonomie reste encore loin.
SOURCE DE L’ARTICLE : https://giuliochinappi.com/2026/02/04/il-grosso-bastone-u...
Le nombre de dirigeants occidentaux qui lancent des avertissements sévères contre la pratique, adoptée par le passé, d’une dépendance excessive aux États-Unis, augmente. Le Premier ministre belge Bart De Wever a mis en garde, lors d’un forum de haut niveau sur « L’avenir de l’Europe » organisé par un média belge de première importance, que l’Europe s’est longtemps appuyée sur le « gros bâton » des États-Unis pour sa protection, pour découvrir que ce même bâton est maintenant brandi contre ses propres alliés. En plus de ses observations selon lesquelles l’Europe pourrait passer de « vassal heureux » à « esclave misérable » si elle ne trace pas de lignes rouges, ses paroles sont devenues virales sur les réseaux sociaux dès lundi.
Fin janvier, De Wever a prononcé une série de déclarations cinglantes lors du forum annuel de début d’année « L’avenir de l’Europe », co-organisé par les principaux quotidiens économico-financiers belges De Tijd et L’Echo. En abordant des thèmes tels que l’autonomie stratégique européenne, la transformation des relations transatlantiques, une intégration plus profonde du marché intérieur de l’UE et la fin de l’excès de dépendance vis-à-vis des États-Unis, il a lancé des avertissements nets sur les risques d’une subordination prolongée.
Certains observateurs ont souligné que les paroles de De Wever résonnent comme un sentiment similaire exprimé lors du discours très suivi du Premier ministre canadien Mark Carney à Davos. Tous deux montrent une réflexion plus lucide des alliés traditionnels de l’Occident sur la dépendance passée aux États-Unis et la vague d’angoisse actuelle.

Un moment crucial
Dans la vidéo, De Wever a déclaré que l’Europe a longtemps compté sur le « gros bâton » de Washington pour sa sécurité, mais qu’elle découvre maintenant que ce même levier est de plus en plus utilisé contre ses propres alliés. « C’est un moment crucial », a-t-il dit, ajoutant que la situation actuelle a mis en lumière les vulnérabilités de l’Europe et l’a forcée à faire face à des vérités inconfortables concernant sa dépendance vis-à-vis des États-Unis.
Il a également soutenu que la vision de l’Europe par le président américain Donald Trump est fondamentalement hostile à l’UE en tant que force politique et économique unifiée. Lorsqu’il affirme « aimer l’Europe », selon De Wever, il entend « 27 pays séparés qui vivent en vassaux ou tendent vers l’esclavage », notant que l’économie collective de l’UE est la seule capable de rivaliser avec celle des États-Unis. « Et cela ne lui plaît pas », a-t-il ajouté.
Certains médias décrivent la fermeté récente de certains dirigeants occidentaux envers les États-Unis comme une transition d’un accommodement prudent à une attitude plus assertive, dans le contexte des menaces tarifaires de Trump et des demandes concernant le Groenland. The Guardian l’a qualifié de « moment de vérité pour l’Europe », tandis que la BBC a écrit que « l’Europe abandonne la stratégie douce-douce avec Trump».
Un expert chinois a indiqué lundi au Global Times que ce n’est pas un tournant soudain, mais le résultat d’un processus de longue durée. L’Europe, longtemps traitée comme un « instrument » de l’hégémonie mondiale américaine, a désormais reconnu les coûts de sa dépendance vis-à-vis de Washington.
 « Pendant des décennies, l’Europe a fonctionné sur la base d’une hypothèse centrale : les États-Unis garantissent la sécurité, tandis que l’Europe se concentre sur la croissance économique et le bien-être. Mais la réalité offre maintenant un réveil brutal », a déclaré lundi à la Global Times Jiang Feng (photo), chercheur senior à l’Université des études internationales de Shanghai.
« Pendant des décennies, l’Europe a fonctionné sur la base d’une hypothèse centrale : les États-Unis garantissent la sécurité, tandis que l’Europe se concentre sur la croissance économique et le bien-être. Mais la réalité offre maintenant un réveil brutal », a déclaré lundi à la Global Times Jiang Feng (photo), chercheur senior à l’Université des études internationales de Shanghai.
Jiang a dit que l’observation de De Wever selon laquelle le « gros bâton » américain est maintenant dirigé contre ses alliés équivaut, en substance, à admettre ce qui suit: l’Europe ne s’est jamais vraiment appuyée sur de véritables garanties de sécurité institutionnalisées, mais sur la « bonne humeur » de l’Amérique.
La vidéo du forum a également suscité une vague de réactions parmi les utilisateurs européens, dont beaucoup ont exprimé leur soutien aux propos du Premier ministre. Un utilisateur, @dirkschneider1608, a écrit : « Il est temps que le bla-bla constant dans les conseils européens se transforme en actions concrètes. Le moment, c’est maintenant, pas dans cent ans, pas dans une décennie. Sinon, nous finirons dans l’assiette à manger de Trump».
En commentant ses interactions récentes avec Trump et l’avenir des liens transatlantiques, De Wever s’est dit « le plus pro-américain qu’on puisse trouver », mais a souligné que les alliances doivent reposer sur le respect mutuel. « Pour danser le tango, il faut être deux, dans un mariage, il faut s’aimer mutuellement », a-t-il dit, comparant la relation transatlantique à un partenariat qui exige de la réciprocité et non des concessions unilatérales.
Vues différentes, même situation
Les références explicites aux « lignes rouges » et à l'« esclavage » ne sont pas évoquées pour la première fois par le Premier ministre belge, lequel utilise désormais un langage assez dur. Lors du même forum de Davos où le Premier ministre canadien Mark Carney a prononcé un discours très commenté, De Wever a déclaré : « Nous étions dans une position très défavorable à cette époque. Nous dépendions des États-Unis, alors nous avons choisi d’être indulgents. Mais maintenant, tant de lignes rouges sont franchies qu’il ne vous reste qu’un choix: exiger le respect de soi… ». Il a souligné que « être un vassal heureux, c’est une chose, être un esclave misérable, c’en est une autre ».
De manière similaire au Premier ministre belge, le chancelier allemand Friedrich Merz a également souligné la nécessité pour l’Europe de l’unité et de l’autosuffisance. Lors d’un discours au parlement allemand jeudi, Merz a loué «l’unité et la détermination» de l’Europe à réagir face aux menaces tarifaires de Trump durant la crise du Groenland, et a exhorté le continent à agir avec plus de confiance sur la scène mondiale, comme le préconise DW. « Nous étions tous d’accord pour ne pas nous laisser intimider par les menaces de taxes », a-t-il dit. « Si quelqu’un pense pouvoir faire de la politique en menaçant d'imposer des tarifs contre l’Europe, ce quelqu'un sait maintenant que nous pouvons et nous voulons nous défendre. »
« Ces dirigeants européens ont compris le coût de la dépendance, mais ils n’ont pas encore acquis la capacité de s’en libérer », a déclaré Jiang, ajoutant qu’il s’agit d’une situation où « la conscience s’est réveillée, mais les muscles ne sont pas encore développés ». L’expert a analysé que, en raison de divisions internes, de carences militaires et de pressions extérieures provenant des États-Unis, l’autonomie stratégique de l’Europe ne peut pas être atteinte du jour au lendemain et que l’Europe pourrait rester longtemps suspendue entre dépendance et autonomie.
Malgré cette situation, il existe aussi d’autres voix. Selon Reuters, lundi, le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré lors d’une conférence organisée par l’International Institute for Strategic Studies à Singapour, que l’Allemagne « n’est pas neutre » entre les États-Unis et la Chine, et qu’elle restera toujours plus proche de Washington malgré les tensions récentes.
Zhao Junjie, chercheur senior à l’Institut d’études européennes de l’Académie chinoise des sciences sociales, a déclaré au Global Times que les propos du ministre allemand ne reflétaient pas la réalité changeante que traverse l’Europe. Il a ajouté que les manœuvres politiques internes en Allemagne influencent aussi les déclarations de Wadephul.
Selon Zhao, il existe en Europe trois principales orientations concernant la relation avec les États-Unis. Actuellement, la déception et la distanciation prédominent, exprimées par de nombreux dirigeants européens, car la base de valeurs et la confiance entre l’Europe et les États-Unis ont été structurellement endommagées, et les liens transatlantiques ne reviendront jamais à la « belle époque ».
La deuxième orientation est celle de la contradiction et de l’alternance : tout en reconnaissant des frictions croissantes avec Washington, on affirme que l’alliance n’est pas encore rompue et qu’il reste de l’espoir pour des réparations.
La troisième, relativement rare, consiste à continuer d’affirmer le rôle de leader des États-Unis dans l’OTAN et en Occident, en insistant sur la préservation du cadre actuel d’alliances malgré la fracture transatlantique.
« Quelle que soit la vision qui l’emportera, en Europe, un consensus se forme : les relations transatlantiques ne reviendront pas comme avant, et une période de profonde réorganisation et de désengagement stratégique s’amorce », a déclaré Zhao.
« Un changement de marée dans l’histoire est un processus long, tortueux, plein de contradictions. Il est normal, pas exceptionnel, que différents pays et différentes personnes aient des opinions divergentes. Dans un paysage mondial en mutation, la coexistence de positions divergentes est la norme, tandis que la Chine a maintenu de manière cohérente ouverture, confiance et calme stratégique », a ajouté Zhao.
20:54 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : europe, états-unis, actualité, affaires européennes, politique internatuionale, bart de wever |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 04 février 2026
Cinq élections qui pourraient bouleverser la donne politique en Occident
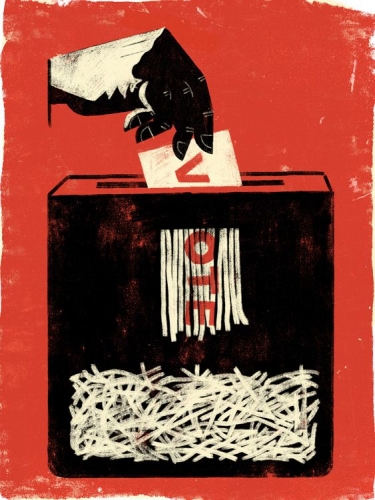
Cinq élections qui pourraient bouleverser la donne politique en Occident
Peter W. Logghe
Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94
L'année 2026 sera une année électorale et donc potentiellement une année clé pour les démocraties européennes. Qu'il s'agisse de sécurité, d'énergie, de changements géopolitiques, de souveraineté ou de migration, ces élections auront un impact sur l'UE. En avril 2026, les Hongrois éliront un nouveau parlement. Depuis 2010, Orban a réussi, avec sa coalition de centre-droit Fidesz-KDNP, à remporter quatre élections consécutives. Budapest est devenue une plaque tournante du conservatisme européen.
Orban a notamment mené une politique migratoire restrictive, ce qui lui a valu des sanctions juridiques, des pressions financières et politiques de la part de l'UE. Et pour la première fois, toute l'opposition hongroise se rallie derrière une seule figure, Peter Magyar et son parti Tisza, pour défier Orban. Tisza appartient au groupe PPE et se montre très pro-UE. Une défaite d'Orban sera perçue comme un succès stratégique des institutions et de la politique de l'UE.

Les États-Unis d'Amérique, la Suède, la Slovénie et l'Allemagne
Les élections de novembre 2026 aux États-Unis, les élections dites de mi-mandat, sont également importantes. Il s'agit d'un test crucial pour Donald Trump, car il ne dispose que d'une faible majorité à la Chambre des représentants. Il peut jouer plusieurs atouts : la croissance économique, la lutte contre l'immigration clandestine, la guerre contre la drogue, les interventions à l'étranger. Cela suffira-t-il à lui permettre de conserver sa majorité ou va-t-il la perdre ? Et surtout, quelles en seront les conséquences pour l'Europe ?

Les Suédois éliront un nouveau parlement en septembre 2026, après quatre ans de gouvernement au cours desquels les Démocrates suédois ont pu influencer la politique migratoire et sécuritaire en accordant leur soutien au gouvernement de centre-droit. Seront-ils récompensés pour cela ? Les récents sondages indiquent que les sociaux-démocrates ont la faveur des électeurs. Y aura-t-il un nouvel accord avec les conservateurs en Suède ? En Slovénie, le populiste de droite Janez Jansa (photo) espère revenir au pouvoir avec son parti SDS après les élections de mars. Cela signifierait un renforcement du bloc de droite en Europe de l'Est.
Enfin, plusieurs élections régionales auront lieu en Allemagne, où les « etablierte Parteien » (les partis établis) observent avec inquiétude la montée en puissance du parti populaire Alternative für Deutschland. Dans certains Länder est-allemands, l'AfD dépasse largement les 35% des intentions de vote, si l'on en croit les sondages. Non, nous ne nous ennuierons certainement pas sur le plan politique en 2026.
19:02 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : affaires européennes, politique, actualité, europe, hongrie, slovénie, suède, allemagne, états-unis, midterms 2026 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 03 février 2026
Odessa, clef de voûte du conflit russo-ukrainien
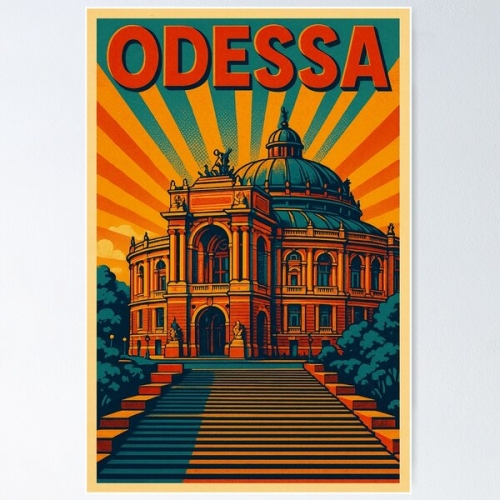
Odessa, clef de voûte du conflit russo-ukrainien
Andrea Marcigliano
Source: https://electomagazine.it/odessa/
On en parle très peu... voire pratiquement pas du tout, dans ces journaux uniformisés que sont désormais nos grands médias.
Pourtant, ce serait une nouvelle à la une. Une nouvelle fondamentale.
Odessa est prise dans les anneaux d'un python. Et elle étouffe peu à peu.
Et Odessa représente la clé de voûte du conflit russo-ukrainien. L'objectif final visé par le Kremlin.
C'est le principal débouché maritime de l'Ukraine. Une ville portuaire, traditionnellement cosmopolite, mais fondamentalement russe dans ses fondements. Elle a été donnée à Kiev pour lui permettre d'avoir un débouché important sur la mer Noire. À une époque pas si lointaine, celle des Soviets. Mais elle a toujours été un monde à part. Fondamentalement étrangère à l'Ukraine, terre agricole, sans aucune projection ni vocation maritime.

Le dessein stratégique du Kremlin est évident. La conquête d'Odessa signifie réduire ce qui reste de l'Ukraine à un petit État purement continental et enclavé. Sans débouchés sur la mer. Et donc sans projection internationale.
De plus, Odessa représente la possibilité de créer une continuité entre le territoire russe et la Transnistrie. Cette province moldave russophone et rebelle s'est proclamée indépendante, refusant la politique pro-européenne de Chisinau.
Une indépendance de fait, protégée par les troupes russes.
La stratégie russe pour conquérir Odessa progresse lentement. Avec un calme délibéré, sans accélérations, sans offensives violentes.
Poutine veut la ville portuaire, mais pas un bain de sang. Ce qui serait pire qu'inutile. Carrément contre-productif.
D'autant plus que la majorité des habitants, russes et autres, attendent avec impatience l'arrivée des Russes. Considérés comme des libérateurs de l'oppression de Kiev.
La conquête russe signifierait, par ailleurs, un retour d'Odessa au rang de grand port sur la mer Noire.
Un rôle qui, pour l'instant, est paralysé par l'embargo russe, qui ne laisse pratiquement passer aucun navire marchand à destination du port.
Une stratégie d'étouffement bien précise. Et fonctionnelle.
Il faut d'ailleurs rappeler que des navires de l'OTAN arrivaient à Odessa, sous faux pavillon et sous de faux prétextes, pour apporter des armes et des drones aux Ukrainiens. Un ravitaillement de guerre qui a désormais été stoppé.
Poutine rencontre Trump. Il se déclare prêt à négocier avec Kiev. Il serre des mains et sourit.
Cependant, il n'a pour l'instant aucune intention d'accepter un cessez-le-feu.
Du moins, pas avant d'avoir pris Odessa.
Alors, probablement, il y aura un tournant dans cette terrible guerre.
Et le conflit, alors, et alors seulement, touchera à sa fin.
21:12 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : odessa, ukraine, actualité, europe, mer noire, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
L’Europe après l’érosion de l’OTAN – un projet d’ordre stratégique

L’Europe après l’érosion de l’OTAN – un projet d’ordre stratégique
Elena Fritz
Source: https://t.me/global_affairs_byelena
Le débat sur la politique de sécurité en Europe a atteint un stade nouveau. Avec la contribution « If NATO Dies, Long Live NEATO » issus du Center for European Policy Analysis (CEPA), une esquisse cohérente d’un ordre de sécurité post-guerre (https://cepa.org/article/if-nato-dies-long-live-neato/) pour l’ordre euro-atlantique est proposée pour la première fois. Non comme une réforme des structures existantes, mais comme une rupture consciente avec celles-ci.
- 1. Situation de départ : la perte progressive de fonctionnalité de l’OTAN
Le constat de l’auteur du texte est sobre: l’OTAN existe formellement, mais n’accomplit plus que partiellement sa fonction stratégique initiale. Les intérêts des États-Unis et des États européens se sont structuralement éloignés. Washington privilégie la compétition mondiale des systèmes, l’Europe reste ancrée régionalement. L’OTAN compense cette divergence jusqu’à présent uniquement par le leadership américain – un état qui devient de plus en plus fragile politiquement et socialement.
- 2. L’approche NEATO : Sélection fonctionnelle plutôt qu’intégration
L’auteur du CEPA en tire une conclusion claire, mais radicale: l’Europe ne doit pas être davantage intégrée, mais divisée fonctionnellement. L'hypothétique NEATO n’est expressis verbis ni une armée européenne ni une UE militaire. Dans ce modèle, l’Union européenne est considérée comme inadaptée à la politique de sécurité – trop lente, trop consensuelle, trop bloquante politiquement.
À la place, une zone militaire nord- et nord-est-européenne est proposée, composée d’États à haute préparation militaire, qui perçoivent une menace susceptible de conduire à une confrontation. D’autres pays européens restent en dehors. Le concept n’envisage pas la division de l’Europe comme un risque, mais comme une condition de la capacité d’action.
- 3. Le vide stratégique du modèle NEATO
Aussi claire que soit cette approche, sa principale faiblesse demeure: les contradictions internes de l’Europe ne sont pas résolues, mais institutionnalisées. La disparition de l’hégémonie américaine en tant qu’élément équilibrant révélerait sans frein les lignes de conflit existantes – entre l’Est et l’Ouest, le Nord et le Sud, entre grandes et moyennes puissances. Le modèle mise sur l’efficacité opérationnelle, pas sur la stabilité politique.
- 4. Une autre approche de l’ordre
Dans ce contexte, une autre conception stratégique, plus prudente, apparaît nécessaire. Elle évite délibérément la formation de nouveaux blocs et mise plutôt sur une limitation de la logique d’escalade.
Les éléments clés d’une telle approche seraient :
– Rattacher clairement la responsabilité militaire à l’État-nation.
Pas de forces supranationales, pas d’engagements automatiques en dehors de situations défensives clairement définies. La puissance militaire reste politiquement attribuable.
– Coopération sans contrainte institutionnelle de blocage.
La coopération sécuritaire se fait bilatéralement ou en petits formats ciblés – régionalement, à durée limitée, toujours révisable. La capacité d’action naît par la précision, non pas par la taille.
– Refus d’une logique de tri européen basée sur la capacité militaire.
Une division de l’Europe en noyaux de sécurité et en marges accroît à long terme l’instabilité. La stabilité ne naît pas de la sélection, mais de l’équilibre d’intérêts divergents.
– Flexibilité stratégique plutôt que fixation permanente.
Dans un ordre mondial fluide, la capacité d’adaptation est plus précieuse que l’immobilisme institutionnel. La politique de sécurité doit garder ses options ouvertes, ne pas fermer d’avance.
- 5. Conséquences pour l’Allemagne
De ce point de vue, l’Allemagne n’a pas pour mission de prendre la tête de nouveaux blocs militaires, mais une responsabilité différente: limiter toute escalade par un choix de structure. La valeur ajoutée sécuritaire de l’Allemagne ne réside pas dans une position maximaliste, mais dans l’évitement de liaisons frontales et automatiques qui limitent irréversiblement l’espace d’action politique.
Conclusion
La proposition NEATO marque une étape importante: elle montre à quel point certains segments du débat transatlantique ont déjà évolué d’une logique d’intégration vers une logique de sélection. C’est précisément pour cela qu’il est nécessaire de proposer une contre-approche, qui ne se fonde pas sur une nouvelle architecture confluictuelle, mais sur une modération institutionnelle.
Ce ne sont plus les alliances qui décident de la sécurité, mais la capacité à attribuer la responsabilité clairement, à peser les intérêts de manière objective et à limiter structurellement toute éventuelle escalade.
#géopolitique@global_affairs_byelena
20:47 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Défense | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, défense, europe, affaires européennes, otan |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les indicateurs économiques allemands annoncent des temps difficiles
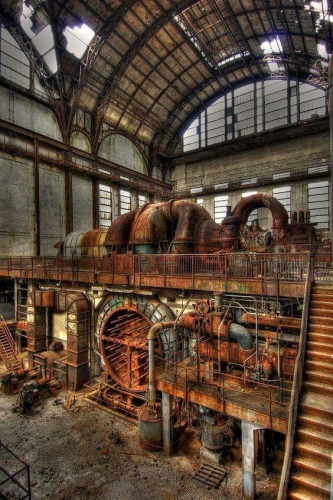
Les indicateurs économiques allemands annoncent des temps difficiles
Peter W. Logghe
Source: https://www.facebook.com/peter.logghe.94
Les chiffres du bureau de conseil aux entreprises Falkensteg montrent que le nombre de faillites de moyennes et grandes entreprises (entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 10 millions d'euros) aura augmenté de 25% en 2025 par rapport à 2024. Depuis la crise du coronavirus, le nombre de faillites de moyennes entreprises a triplé. Le chercheur Jonas Eckhardt parle d'une évolution dramatique, car selon lui, il ne s'agit plus d'une faiblesse conjoncturelle, mais de problèmes structurels profonds.
 Pour 2026, le cabinet de conseil Falkensteg prévoit également une augmentation supplémentaire du nombre de faillites de moyennes et grandes entreprises. Selon Jonas Eckhardt (photo), nous pouvons nous attendre à une augmentation de 10 à 20%. Les principales causes ont déjà été mentionnées: des consommateurs incertains qui reportent leurs achats (construction automobile et mécanique), des coûts énergétiques élevés (en raison de la transition énergétique verte) et une bureaucratie, une réglementation sans équivalent en Europe, même en Flandre.
Pour 2026, le cabinet de conseil Falkensteg prévoit également une augmentation supplémentaire du nombre de faillites de moyennes et grandes entreprises. Selon Jonas Eckhardt (photo), nous pouvons nous attendre à une augmentation de 10 à 20%. Les principales causes ont déjà été mentionnées: des consommateurs incertains qui reportent leurs achats (construction automobile et mécanique), des coûts énergétiques élevés (en raison de la transition énergétique verte) et une bureaucratie, une réglementation sans équivalent en Europe, même en Flandre.
Les chiffres des exportations baissent, ceux des importations augmentent
Ces chiffres indiquent également une «fatigue économique» en Allemagne. En novembre 2025, les exportations allemandes ont baissé de 2,5% par rapport à octobre, soit la plus forte baisse mensuelle depuis mai 2024. Dans le même temps, les importations de marchandises étrangères en Allemagne ont augmenté de 0,8%. Il s'agit de chiffres officiels, publiés par l'Office fédéral allemand de la statistique.
Les exportations allemandes ont atteint 128,1 milliards d'euros, tandis que les importations étrangères en Allemagne se sont élevées à 115,1 milliards d'euros. L'excédent commercial s'élève ainsi à 13,1 milliards d'euros, alors qu'il était encore de 17,2 milliards d'euros en octobre. La plus forte augmentation des importations a été enregistrée pour les marchandises en provenance de Chine, ce qui n'est bien sûr pas tout à fait surprenant. C'est une augmentation de 8% par rapport au mois d'octobre.
Une dernière donnée économique concernant notre principal partenaire commercial, l'Allemagne: depuis le début de l'année 2026, les réserves de gaz dans les réservoirs allemands ont atteint leur niveau le plus bas en 15 ans. Selon le Verband der europäischen Gasinfrastrukturbetreiber (GIE ou Union des gestionnaires d'infrastructures gazières européennes), les réserves de gaz en Allemagne représentaient 53% de la capacité maximale de stockage au 5 janvier. Normalement, le niveau à la fin janvier est de 70%. L'Agence allemande pour le réseau gazier a donc appelé les Allemands à économiser leur consommation de gaz. Heureusement, l'Allemagne peut compter sur les importations de gaz via la France et la Belgique. La moyenne européenne des réserves de gaz s'élève à 59% de la capacité disponible. Avec 53%, l'Allemagne se situe clairement en dessous de cette moyenne. En Pologne, où il fait également très froid en ce moment, les réservoirs de gaz sont actuellement remplis à plus de 80%.
L'Allemagne est dans une situation difficile. Cela ne sera pas sans conséquences pour les autres États membres de l'UE.
20:19 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, europe, allemagne, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 02 février 2026
L'UDC suisse réclame les milliards consacrés à l'asile pour l'armée

L'UDC suisse réclame les milliards consacrés à l'asile pour l'armée
Source: https://opposition24.com/politik/svp-fordert-asylmilliard...
L'Union démocratique du centre (UDC) tire un bilan de la politique d'asile actuelle et exige un changement radical de cap en faveur de la défense nationale. Dans une déclaration récente, l'UDC affirme que le système d'asile coûte des milliards à l'État, sape la sécurité intérieure et fait l'objet d'abus systématiques. Au lieu de générer sans cesse de nouvelles recettes par des augmentations d'impôts, la Confédération doit enfin fixer des priorités et libérer les fonds disponibles pour l'armée, explique le parti dans un communiqué.
Selon le parti, la situation sécuritaire en Suisse s'est sensiblement détériorée. Les crimes violents, les agressions au couteau et les vols à main armée ne sont plus des exceptions, mais font désormais partie du quotidien. La migration liée à l'asile est particulièrement problématique: l'afflux incontrôlé, les contrôles d'identité insuffisants et les rapatriements rarement appliqués ont donné naissance à un système qui favorise la criminalité et sape l'État de droit. Depuis 2000, plus de 655.000 demandes d'asile ont été déposées, l'identité de nombreux demandeurs étant incertaine et les sanctions minimales, même en cas d'infractions graves.
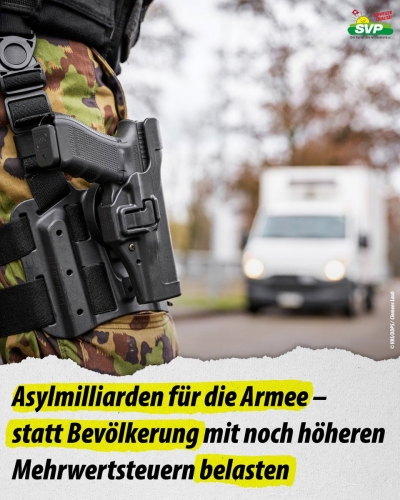
Sur le plan financier, le système d'asile est depuis longtemps hors de contrôle. Rien qu'au niveau fédéral, environ quatre milliards de francs sont dépensés chaque année, auxquels s'ajoutent des coûts immenses pour les cantons et les communes, ainsi que pour les poursuites pénales et l'exécution des peines.
Dans ce contexte, l'UDC qualifie la proposition du Conseil fédéral d'augmenter la taxe sur la valeur ajoutée de 0,8 point de pourcentage d'attaque directe contre la population. Cette augmentation d'impôt représenterait une charge supplémentaire d'environ 2,7 milliards de francs par an pour les ménages.
Le parti affirme clairement qu'une armée plus forte est nécessaire, mais pas au détriment des citoyens. Au lieu de cela, l'UDC demande que les «milliards de l'asile» soient systématiquement réaffectés et utilisés pour renforcer la capacité de défense du pays. Elle exige en outre des réductions dans l'aide au développement et une réduction significative du personnel fédéral pléthorique. Selon elle, la Confédération n'a pas un problème de recettes, mais un problème de dépenses, et celui-ci est d'origine interne.
20:06 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : immigration, actualité, europe, suisse, armée suisse, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 01 février 2026
Interdiction de l’AfD: les vieux partis allemands ne tiennent plus qu’en nouant des intrigues

Interdiction de l’AfD: les vieux partis allemands ne tiennent plus qu’en nouant des intrigues
Source: https://derstatus.at/politik/afd-verbot-altparteien-werde...
Que faire lorsque l’adversaire politique devient trop puissant? Apparemment, on préfère recourir au bâton judiciaire et à des astuces politiques douteuses, plutôt que d’affronter le jugement des citoyens. La frontière entre démocratie et maintien du pouvoir devient préoccupante dans un Allemagne du «Mur de feu» (du "cordon sanitaire").
Interdiction de l’AfD comme condition préalable
Quand un système établi est-il dépassé? La réponse peut être très courte: dès que les vieux acteurs en place mettent la pression pour forcer un dernier reste de cohésion. Les jours d’une ère idéologique semblent comptés, dont les composantes n’ont plus grand-chose en commun quant au fond et au programme, mais qui cherchent le moindre dénominateur commun de peur de perdre le pouvoir. Les Verts exigent, avant les élections régionales en Rhénanie-Palatinat, qu’une procédure d’interdiction contre l’AfD soit engagée.
Sans cet artifice, il ne pourrait y avoir de contrat de coalition, pourrait-on dire. Friedrich Merz a déjà dû accepter des milliards de dettes pour acheter le soutien de la SPD à sa candidature à la chancellerie. Et maintenant, il semblerait aussi qu’à Mayence, une tractation du même acabit se prépare. Si tu me promets que nous irions ensemble devant la Cour constitutionnelle, je te tends la main pour un mariage de convenance, telle serait probablement une solution de compromis. En quoi tout cela a-t-il encore du sens ou relève-t-il du bon ordre des choses? En rien, absolument rien, il faut le constater.
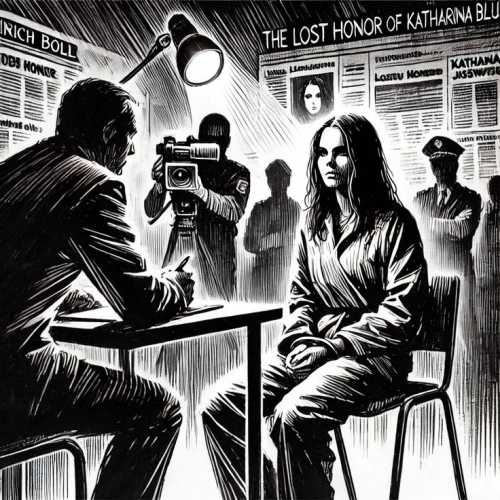
Éliminer la concurrence par un procès fallacieux
Les pressions et les menaces façonnent désormais tellement la vie politique berlinoise que de simples citoyens seraient depuis longtemps traduits en justice pour des délits, s’ils s’aventuraient à appliquer les méthodes que les partis utilisent sans scrupules ni honte pour préserver leur vacuité. La crainte que l’Alternative für Deutschland puisse atteindre une majorité absolue et empêcher ceux qui se sont si confortablement installés dans les sièges et les postes de prendre pour contrôler le pouvoir, ne conduit pas seulement à des déviances bizarres, mais à des actes carrément criminels.
Les menaces et les ultimatums ne peuvent en aucun cas constituer une base de confiance. Quiconque tombe dans le piège y participe, et devient complice du mécontentement, de la désillusion et de la colère du peuple souverain. Le boycott et le blocage de l’opposition, agonie de critiques, prennent des tournures si extrêmes qu’on ne peut plus parler de démocratie. La polarisation a contribué à bien plus que l’exclusion, que l’isolement et que la privation d’égalité des chances dans les joutes électorales. La privation des droits se poursuit à un rythme sans précédent: ce ne sont pas les Bleus (= AfD), accusés de tous les maux, qui veulent détruire le pays et les institutions, mais bel et bien les partis colorés.
Un quart des électeurs, de manière totalitaire, risque d'être privé de tribune
Vaincre un concurrent à tout prix et le faire taire, se chercher des alliés contre-nature pour suivre la seule voie de la répression: ce type de comportement est assumé de manière dévoyée et délinquante. Les mécanismes sont aussi subtils que dans l'ancienne RDA, on ne fait même plus l’effort de dissimuler le caractère totalitaire de ses agissements. Les partis de l'establishment utilise une règle fondamentale du droit constitutionnel, qui n'autorise l’élimination d’un adversaire politique qu'à titre absolument exceptionnel dans la vie politique. En agissant de la sorte, les vieux partis de l'establishment montrent des traits grotesques, exprimant un primitivisme sordide.
Comme si l’on n’était pas capable de voir ce que Klingbeil, Banaszak, Reichinnek ou Brantner complotent sous le prétexte de «défense» de la démocratie allemande. Ils veulent ôter à un quart des citoyens toute identité idéologique, croyant, dans leur méchante naïveté, qu’après une décision du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, les brebis perdues reviendraient aux troupeaux d’origine. La durabilité n’a jamais été leur fort quand il s’est agi d’automobiles électriques nuisibles à l’environnement, de pompes à chaleur et d’éoliennes, qu’ils considèrent comme des exploits en matières écologiques. Il est tout simplement naïf de penser que la politique peut se faire par interdits.
Une interdiction renforcerait l’opposition
Un tel simplisme ne fonctionne ni avec l’alcool ni en ce qui concerne l’AfD. La croyance naïve selon laquelle il suffit de tourner la tête pour oublier est probablement une mauvaise croyance. Mais la RDA a déjà montré que la résistance populaire ne peut pas être arrêtée par des expédients simplistes. Si l’on veut vraiment éliminer le risque d'une rébellion, d'une révolte des mécontents, il faut faire intervenir le seul bon sens.
Jusqu’à présent, la rue est encore calme, à l’exception des grand-mères que l'on a mobilisées pour battre le tambour ou souffler dans des trompettes de Jéricho pour faire reculer et couler la droite alternative. Mais la situation pourrait rapidement changer si l'on place sous tutelle ceux qui refusent de changer de cap, c’est-à-dire si l'on donne à un parti alternatif et challengeur le droit légitime de diriger, si cela est confirmé par le vote des citoyens.
La crainte d'une manipulation des élections n’est pas à écarter; déjà dans des sondages organisés par les médias publics, on constate des décalages étranges, difficilement explicables par la raison. Il faut rester vigilant face à la fraude. Car les «bons» (auto-proclamés) n’hésitent plus devant aucune audace pour garantir leur carrière, leurs postes et leur argent.
+++ Suivez-nous sur Telegram : t.me/DerStatus & sur Twitter/X : @derStatus_at +++
19:22 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : afd, allemagne, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Trump a dévoilé la faiblesse de l’Union européenne

Trump a dévoilé la faiblesse de l’Union européenne
Le Canada et le Groenland? Il ne sera même pas nécessaire de les occuper: la souveraineté se termine si l’on ne sait pas la défendre
par Sarmaticus
Source: https://www.barbadillo.it/127756-trump-ha-smascherato-la-...
Le président Trump s’est entretenu le mercredi 4 septembre 2019 avec le Premier ministre bahaméen Hubert Minnis, exprimant ses condoléances pour la perte de vies humaines et les dégâts catastrophiques dans certaines parties des Bahamas. Le président a également confirmé l’engagement des États-Unis à fournir une assistance humanitaire rapide aux populations et communautés affectées des Bahamas.
Donald Trump ne se limite pas à ridiculiser l’UE. Il le fait publiquement. Un théâtre si précis qu’il frise la cruauté, si ce n’est qu’il est mérité. Deux images suffisent :
- Les “meilleurs” de l’UE, réunis dans la salle ovale, regardent une carte, pendant que Trump fait la prédication, en tant que propriétaire remontant le bretelles de quelques locataires défaillants.
- Trump plante le drapeau américain sur le Canada et le Groenland, non comme une conquête, mais comme une moquerie : une image si brutale qu’elle fait exploser chaque leçon que l’UE a donnée sur la souveraineté au cours de la dernière décennie.
Un continent qui a “externalisé”
Dans le miroir que tend Trump, l’UE se voit enfin: un continent qui a externalisé l’énergie, la défense et la prise de décision, mais qui murmure “droit international”, quand son hypocrisie est dévoilée. L’UE prêchait des valeurs, alors qu’elle vivait du gaz russe, économique et fiable. L’UE adressait force reproches à Moscou, tandis que l’OTAN s’insinuait à l’est, brisant promesse après promesse faite à la Russie. L’UE riait des garanties de sécurité en estimant qu'elles relevaient de la paranoïa, même après l’explosion des gazoducs et le scintillement des lumières déclinantes. Et maintenant ? Maintenant, l’UE découvre que l’impérialisme est moche, mais seulement quand l’échiquier est inversé.
Souverains ? Cela dépend...
Soudain, la souveraineté (dans un certain sens) compte. Soudain, les frontières sont sacrées. Soudain, l’ordre basé sur des règles doit être (doucement) défendu – mais seulement lorsque Washington fait pression, au lieu de Moscou. Voilà ce que l’UE refuse de dire: annexer l’UE n’est pas l’intention de Moscou, c’est la réalité de Davos, avec Washington, qui est complice de la classe politique du “véritable européisme”.
La Russie a demandé une architecture de sécurité juste et indivisible, de Lisbonne à Vladivostok. L’Europe n’a pas fait d’offre alternative. Elle a reporté, cachée derrière les communiqués russophobes de l’OTAN. Puis elle a applaudi les sanctions qu’elle savait qu'elles allaient se retourner contre elle, car il était plus facile de faire du théâtre moral que de faire de la stratégie.
Les familles face à la misère et l’arrogance des élites
Maintenant, les usines sont presque à l’arrêt. Les familles européennes paient le prix le plus élevé de cette arrogance. Le choc des importations de gaz de l'Allemagne a été brutal: selon les données officielles, le prix moyen à la frontière a augmenté de 224 % en un an, après l’interruption de l’approvisionnement via le gazoduc russe, et les coûts énergétiques industriels de l’UE ont atteint 2 à 4 fois ceux des concurrents mondiaux, paralysant la compétitivité dans le secteur manufacturier lourd.
Nous paierons le double
L’Europe s’est mise en rang pour acheter du GNL américain à des prix exorbitants, en faisant semblant de ne pas savoir qui en bénéficiait, en avalant la facture sans broncher et en la qualifiant de “solidarité”. Puis est venue l’humiliation. Trump a publié un message du chef de l’OTAN, Rutte, un message de gratitude, d’éloges et de soumission. Le chef de l’OTAN est réduit à un courtisan numérique, remerciant l’empereur pour sa discipline.
L’Europe aurait pu choisir l’équilibre, la diplomatie plutôt que le dogme russophobe. Elle aurait pu choisir l’autonomie stratégique plutôt que l’esclavage atlantiste, déguisé en vertu. Trump n’a pas créé la faiblesse de l’UE: il l’a dévoilée. Il ne l’a pas sapée dans sa souveraineté. Il a rappelé à l’UE qu’elle ne l’a plus. L’UE voulait être sainte, elle est maintenant simplement faible. Trump n’a pas brisé le continent, il refuse simplement de le faire passer pour pertinent.
18:45 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, donald trump |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 30 janvier 2026
«Nous avons conquis l'Inde!». Curieux monde imaginaire des néo-actionnistes

«Nous avons conquis l'Inde!». Curieux monde imaginaire des néo-actionnistes
Enrico Toselli
Source: https://electomagazine.it/abbiamo-conquistato-lindia-il-c...
Le maître américain n'est plus fiable, entre menaces de droits de douane, guerres et occupations diverses. Il est donc temps de regarder ailleurs. Bon sang, il aurait fallu commencer depuis longtemps, mais on ne peut pas en demander trop aux euro-toxicos de l'UE. Mieux vaut tard que jamais. Mais où chercher? Le Canada s'est tourné vers la Chine, évitant les accords de libre-échange, mais l'idée d'augmenter les échanges commerciaux a suffi à mettre en colère le pirate de Washington: le Canada m'appartient et c'est moi qui le gère.
Bruxelles s'est d'abord tournée vers le Mercosur, avec un accord théoriquement avantageux pour les deux parties, si ce n'est qu'il représente la fin de l'agriculture européenne. Et l'agriculture est le premier élément, fondamental, de la souveraineté. Même si Kallas aura du mal à le comprendre et risque, si elle s'y essaie, d'attraper une méningite carabinée.
Alors, en attendant de surmonter les obstacles posés par la France et le Parlement européen – quelle nuisance, la démocratie... –, l'Europe s'accorde avec l'Inde. Et Linkiesta (qui d'autre ?) se réjouit car c'est un accord qui pénalise la Russie, qui place définitivement New Delhi parmi les grandes démocraties, qui favorisera Israël et, via Suez, donnera plus de travail aux ports italiens.

Il ne manquait plus qu'un commentaire de Cetto La Qualunque et tout aurait été parfait. Parce que Modi et Poutine ne lisent peut-être pas Linkiesta et viennent de conclure un accord visant à renforcer trois corridors pour le transport de marchandises non seulement entre les deux pays, mais aussi pour accroître les échanges commerciaux dans leurs zones de compétence. La route préférée est celle du nord au sud, qui passe également par l'Iran et réduit considérablement les temps de trajet via Suez. Mais, à terme, l'Inde envisage également de s'appuyer sur la flotte russe pour rejoindre l'Europe via la route arctique. Ce n'est pas vraiment une bonne affaire pour les ports italiens.
Et Modi, qui ne lit pas Linkiesta, s'est également permis d'ignorer les menaces de Trump contre l'Inde pour l'achat de gaz et de pétrole à la Russie. Ce n'est pas un hasard si les euro-toxicos se sont bien gardés de demander à Modi de renoncer à l'énergie fournie à bas prix par Moscou. Cette énergie que l'Europe achète à des prix exorbitants aux États-Unis.
19:56 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, inde, politique inbternationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Allemagne: combat pour la constitution

Allemagne: combat pour la constitution
Werner Olles
Depuis au moins l’époque de l’essai très lucide de Günter Maschke, Die Verschwörung der FLAK-Helfer (= « La conspiration des auxiliaires de la Flak », 1985), nous savons que l’histoire de la République fédérale d’Allemagne est une histoire qui emprunte la pente savonneuse, et que le noyau sacré de sa constitution, sous la forme d’un « patriotisme constitutionnel », a remplacé la nation. Depuis longtemps, la célèbre phrase de Friedrich Ebert de 1919 n’est plus d’actualité: «Et si nous sommes confrontés à la question: ou l'Allemagne ou la Constitution, alors nous ne laisserons pas l’Allemagne sombrer à cause de la Constitution!».
Cette phrase éclaire la situation dans laquelle « notre démocratie » se trouve aujourd’hui, bien qu'elle l'explique seulement de manière rudimentaire, mais elle porte encore en elle la substance même de l’État, de la souveraineté et de la nation, ainsi que la conscience de la corruption que contient cette conception propre à la RFA et à ses quislings de gouvernants, propre à son establishment corrompu dans tous les domaines, ceux de la politique, des médias et de l’économie, ainsi que propre à leur «société civile» actuelle, qui n’est rien d’autre qu’un peuple mutilé.
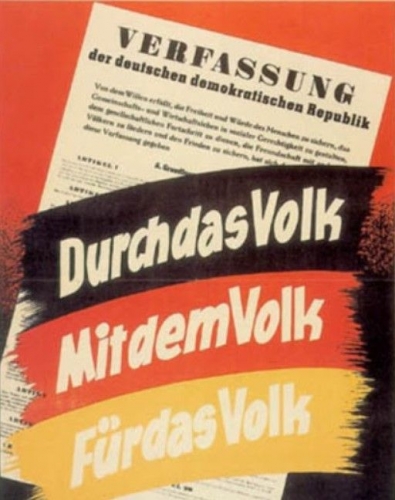
Mais si la Constitution est réellement la prison dont il faut s’échapper pour enfin retrouver la nation, alors, en conséquence, on doit voir la RFA comme un organe de domination étrangère et déplorer son absence totale de légitimité politique structurelle, y compris de la démocratisation de cette belle décadence, et on doit aussi la voir comme une hydre quasi-totalitaire, dépourvue de conscience, taraudée par un moralisme excessif, et, dans le sens le plus strict du terme, affecté d’un infantilisme et d’une intrinsèque infériorité dépourvue de limites, et, enfin, on doit la soumettre à une critique des plus acerbes et des plus dures.
Car, en réalité, les Allemands ne peuvent plus rien faire de ce joujou qu’est la Loi fondamentale, que les vainqueurs alliés leur ont généreusement offert, sauf qu'ils l'ont modifiée à de nombreuses reprises au détriment de leur propre peuple.
La RFA oscille entre idiocratie et démonocratie: elle est prisonnière d’un lien apparemment indissoluble entre simulation démocratique et hypocrisie. La libérer de cette mentalité propre à des « cerveaux de cochon » signifie, pour la droite, de quitter la zone monotone de la supériorité morale, de briser sa propre hybris et sa propre arrogance, et de sortir de ses ghettos, ceux du statu quo bétonné, de la médiocrité, de l’obscurantisme dogmatique, de l’autosatisfaction et de la lâcheté, afin de parachever l’agonie d’une structure qui n’a plus rien à voir ni avec l’Allemagne en tant qu’État ni avec la nation des Allemands.
La seule raison d’État allemande qui tienne ne peut être que la restitution du Reich allemand, avec toutes ses bonnes traditions. Grâce à une nouvelle loi sur les partis, il faudra garantir que les positions qualifiables de félonnes pour la patrie, telles qu’elles sont actuellement exprimées par les partis du cartel au pouvoir et surtout par les partis d'une gauche rabique, nouvelle loi qui serait édictée dans la démocratie illibérale qu'il faudra bien vite fonder, une démocratie illibérale qui combinera éléments césariens et démocratie directe, pour que les partis foireux ne puissent plus jamais revenir au pouvoir.
Les peurs àla carthaginoise et les réserves des instances conservatrices sont hors de propos. Au contraire, la droite doit se laisser guider par la « Déclaration de foi » (1812) de Carl von Clausewitz: "Je crois et je déclare que tout peuple ne doit rien respecter davantage que la dignité et la liberté de son existence… et je considère comme des plus nuisibles la fausse sagesse avec laquelle les petits esprits cherchent à fuir le danger, car elle pouvait inspirer la peur et l’effroi !".
16:33 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, europe, affaires européennes, droit, constitution, loi fondamentale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 27 janvier 2026
Mourir pour des idées: une synthèse du suicide européen

Mourir pour des idées: une synthèse du suicide européen
par Andrea Zhok
Source: https://telegra.ph/Morire-per-delle-idee-una-sintesi-del-...
Il fut un temps où l'Europe Unie était présentée comme:
- un bastion compétitif face aux États-Unis;
- la création d’un organisme supranational doté d’une masse critique capable de s’imposer sur la scène internationale.
Tout cela s’est avéré une farce.
Pourquoi ?
A) Le modèle idéologique:
Lorsque le traité de Maastricht a été élaboré, l’Occident était dominé par la légende de la victoire néolibérale sur l’ours soviétique, et donc le système néolibéral a défini tous les mécanismes juridiques principaux, le rôle de l’industrie publique, les relations avec la finance, selon ce modèle idéologique.
Ce modèle suppose que la liberté d’échange est une substitution idéale à la démocratie (en réalité une amélioration par rapport au mécanisme brut des élections démocratiques) et privilégie le rôle dynamique du grand capital, pour lequel la politique doit jouer un rôle subsidiaire, de facilitateur.
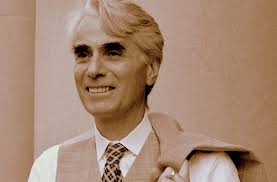
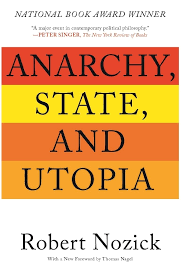
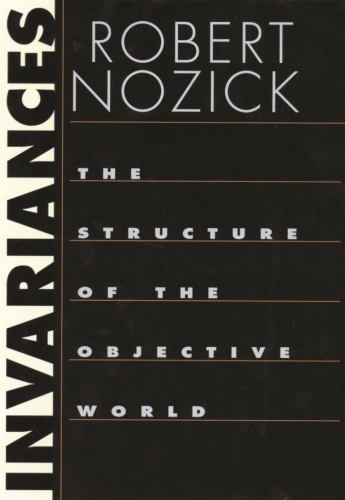
B) La souveraineté de l’économie financière:
Des théories outrageusement abstraites comme le modèle de Nozick sur la naissance de l’État à partir du libre-échange intéressé ont constitué l’épine dorsale d’un modèle inédit, où l’on imaginait qu’une entité politique (une union politique, un État fédéral, etc.) pourrait émerger comme résultat d’une interaction intense du marché. Le modèle européen est ainsi devenu la première expérience historique (et, vu les résultats, la dernière) où l’on pensait qu’un marché commun (c’est-à-dire un dispositif de compétition mutuelle entre États dans un cadre qui obligeait à la plus grande compétitivité) serait le prélude à une union politique.
Ce qui s’est produit en réalité, comme toujours dans des conditions de marché très concurrentielles sans filtres politiques (sans barrières douanières, sans ajustements monétaires, etc.), c’est qu’il y a eu des gagnants et des perdants, des pays qui ont obtenu des avantages et d’autres dont les ressources ont été vampirisées (l’Italie en fait partie).
L’idée obsolète de gouvernements démocratiques responsables devant les électeurs a été remplacée par celle d’une “gouvernance” comme système de règles pour la gestion économique, menant à l’idée d’une politique gérée par un “pilote automatique”.

C) La politique du “winner takes all”
Les systèmes financiers sont impersonnels, apolitiques et supranationaux, mais cela ne signifie pas qu’ils n’aient pas de centres de gravité. Le centre de gravité principal du système financier occidental est l’axe New York – Londres, où son bras politique principal a toujours été le gouvernement américain (quel que soit par ailleurs le gouvernement américain).
L’Europe de Maastricht, qui s’est lancée sur la scène internationale selon des règles néolibérales, est fatalement tombée dans l’orbite gravitationnelle des principaux gestionnaires de fonds financiers, incarnés par la politique américaine. Aux États-Unis, la politique de suprématie nationale et de profit financier sont indissociables: c’est la même chose avec de faibles variantes stylistiques. L’Europe de Maastricht est donc revenue intégralement sous l’aile hégémonique des États-Unis, précisément à l’époque où le développement économique d’après-guerre aurait pu permettre une autonomisation.
L’hégémonie des États-Unis depuis les années 90 a été financière, militaire, mais surtout culturelle, détruisant peu à peu toutes les capacités de résistance intérieure en Europe. Sur le plan culturel, les 30 dernières années ont représenté une américanisation idéologique totale de l’Europe, où ont été importés non seulement des produits cinématographiques et des styles musicaux, mais surtout des modèles institutionnels, des modèles de gestion de l’école, de l’université, des services publics, etc.
D) Le suicide géopolitique:
L’hégémonie culturelle a facilité une croissance de l’hégémonie politico-militaire américaine, qui, au lieu de se retirer après les résultats de la Seconde Guerre mondiale, s’est imposée dans une nouvelle dimension géopolitique.
L’Europe (UE) a commencé à soutenir systématiquement toutes les initiatives de restructuration géopolitique américaines, de l’Afghanistan à l’Irak, en passant par la Yougoslavie et la Libye.
Le cadre idéologique – la légende progressiste du système international basé sur les règles et le respect des droits de l’homme – a permis aux politiques américaines d’être acceptées sans résistance par l’opinion publique européenne. La citoyenneté européenne a englouti comme des oies engraissées pendant deux décennies tous les contes américains sur “l’émancipation des peuples opprimés”, “les interventions humanitaires”, “la police internationale”.
Pendant ce temps, alors que nos journaux échangeaient mutuellement des médailles sur notre civilisation et notre enlightenment, (nos "Lumières"), les États-Unis ont rompu toutes les chaînes d’approvisionnement vitales pour l’Europe. Ils ont déstabilisé tous ces producteurs de pétrole du Moyen-Orient qui n’étaient pas déjà vassaux des États-Unis (Arabie Saoudite, EAU, etc.). Ainsi, l’Irak et la Libye ont été transformés de fournisseurs indépendants en amas de ruines où seule la force militaire compte. Avec la naïve fable des droits de l’homme, l’Iran a été placé sous sanctions et isolé également de la possibilité de commercer ses ressources avec l’Europe. Enfin, les provocations répétées à la frontière ukrainienne ont réussi à produire la guerre encore en cours, qui a coupé le principal poumon d’approvisionnement énergétique de l’industrie européenne, la Russie.

Après avoir éliminé le Moyen-Orient et la Russie, les stratèges européens se sont appuyés à fond sur le GNL américain, faisant perdre dramatiquement en compétitivité l’industrie européenne. Et à ce stade, le pouvoir de négociation européen face aux États-Unis est évidemment nul. Si Trump veut le Groenland, nous lui donnerons le Groenland ; s’il veut le “ius primae noctis”, nous lui donnerons aussi (il lui suffit de couper le GNL pour mettre le continent à genoux).
E) Que faire ?
Une situation aussi compromise est vraiment difficile à récupérer. En fait, l’Union Européenne néolibérale et ses institutions ont scellé le plus grave effondrement historique que l’Europe ait subi dans son histoire, pire même que la Seconde Guerre mondiale, du point de vue du pouvoir comparatif.
La solution théorique, en principe simple (beaucoup moins en pratique), est que l’UE doit fermer boutique, afficher “faillite” et devenir une page sombre dans les livres d’histoire (restera alors la question technique de ce qu’on fait de l’euro).
À la place de l’UE, doivent naître immédiatement des alliances stratégiques entre États européens aux intérêts communs.
Tous les canaux diplomatiques et économiques doivent être rouvert immédiatement avec tous les pays que le soft power américain nous a présentés comme des monstres repoussants : Russie, Chine, Iran.
C’est seulement par cette voie que l’encerclement américain de l’Europe (et du reste du monde) pourra être brisé.
C’est seulement ainsi que l’Europe pourra ouvrir un avenir pour les prochaines générations.
Évidemment, dans l’atmosphère culturelle entretenue depuis des décennies, une telle perspective ne peut que rencontrer une résistance farouche. Et si tel est le cas, une fois de plus, l’Europe se sera sacrifiée pour des idées (stupides).
Mais, contrairement à la chanson de Georges Brassens, cette fois-ci, nous mourrons pour des idées, mais pas d’une mort lente.
15:04 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, suicide européen |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Le plus grand problème de l'Europe est peut-être son incapacité à distinguer amis et ennemis

Le plus grand problème de l'Europe est peut-être son incapacité à distinguer amis et ennemis
par Giulio Chinappi
Source: https://telegra.ph/Il-problema-pi%C3%B9-grande-dellEuropa...
Qui aurait jamais imaginé qu’un conflit, inédit depuis des générations entre les États-Unis et l’Europe, finirait par éclater, avec le Groenland comme épicentre de cette tempête géopolitique?
Dimanche, heure locale, le secrétaire au Trésor Scott Bessent a déclaré sans détour: je crois que les Européens finiront par comprendre que le meilleur résultat sera que les États-Unis maintiennent ou reprennent le contrôle du Groenland». Le même jour, les ambassadeurs des 27 pays de l’UE se sont réunis à Bruxelles, évaluant l’imposition de droits de douane pour 93 milliards d’euros (108 milliards de dollars) ou des restrictions d’accès pour les entreprises américaines au marché de l'Union. Un jour plus tôt, les États-Unis avaient annoncé qu’ils appliqueraient une nouvelle taxe de 10% au Danemark et à sept autres pays européens à partir du 1er février, jusqu’à ce qu’un accord pour l’achat complet et total du Groenland soit conclu.
En apparence, la dernière réponse européenne semble indiquer qu’enfin, l’Europe pourrait passer de la défense passive à la riposte active. Cependant, la réalité est beaucoup plus complexe. Les droits de douane de 93 milliards d’euros en représailles n’ont pas encore été appliqués. Certains responsables ont noté que cette mesure, ainsi que le soi-disant instrument d'anti-coercition (Anti-Coercition Instrument, ACI), qui peut limiter l’accès des entreprises américaines au marché intérieur de l’UE, «est en cours d’élaboration pour donner aux dirigeants européens un levier dans les négociations cruciales avec le président des États-Unis lors du Forum économique mondial de Davos cette semaine». Mais, selon les rapports, ils attendront jusqu’au 1er février pour voir si Washington donnera suite à la menace tarifaire, avant de décider d’adopter des contre-mesures.
De plus, peu après l’annonce des droits de douane américains, l’équipe de reconnaissance allemande composée de 15 personnes a brusquement interrompu sa participation à l’Opération Arctic Endurance, un exercice militaire au Groenland dirigé par le Danemark pour 2026, et a quitté l’île arctique. Auparavant, sept pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Suède, la France, la Norvège, les Pays-Bas et la Finlande, avaient déployé au total 37 militaires au Groenland. Au moment de la publication, Berlin n’a fourni aucune explication publique pour ce retrait, bien que les analystes l’attribuent largement à la pression tarifaire.
Les États-Unis ont transformé la plaisanterie sur l’«achat du Groenland» en une pression concrète et sérieuse, probablement parce qu’ils ont jugé à juste titre que l’Europe ne réagirait pas de manière énergique. Pendant des années, l’Europe a mal interprété ses propres opportunités de développement ainsi que les changements qui s'opéraient dans le paysage mondial, devenant excessivement dépendante de liens profonds avec les États-Unis et remettant à plus tard, sine die, la coopération avec des partenaires plus vastes, y compris la Chine et la Russie. En conséquence, l’Europe est devenue de plus en plus vulnérable au harcèlement américain, facilement pressurable et manipulable, avec une capacité de riposte limitée.
Par exemple, après l’éclatement du conflit entre la Russie et l’Ukraine, l’Europe a cessé, de manière tranchée, ses approvisionnements en gaz en provenance de Russie, sans faire montre de beaucoup de sagesse politique ou de capacité à évaluer les conséquences concrètes d'une telle décision, pour ensuite se retrouver à faire face à d’énormes coûts économiques et sociaux. Le même schéma s’applique à la Chine. Autrefois florissante grâce à la coopération économique, les relations entre la Chine et l’Europe ont changé lorsque l’Europe a suivi la ligne américaine, en regardant la Chine à travers un prisme idéologique plutôt que comme un partenaire pragmatique.
Dans ses relations avec les États-Unis, l’Europe choisit souvent le compromis, allant jusqu’à l’acquiescement. Lors de la guerre commerciale, l’Europe a pratiquement capitulé sans se battre, ce qui pourrait avoir ouvert la voie aux États-Unis qui peuvent, dès lors, viser ouvertement l'annexion d'une portion du territoire européen.
«Qui sont nos ennemis? Qui sont nos amis?»: c’est là une question de première importance pour toute révolution nécessaire, une phrase bien connue et familière à la majorité des Chinois. Aujourd’hui, apparemment, l’Europe a besoin de cette sagesse. Dans les relations internationales, il n’y a ni amis ni ennemis permanents: l’Europe doit donc faire face à la situation avec réalisme et lucidité.
L’Europe a longtemps cru que les États-Unis étaient ses amis, mais les États-Unis voient-ils l’Europe de la même façon?
Malgré la présence de bases militaires américaines au Groenland et des preuves qui réfutent les affirmations sur la présence de navires de guerre russes et chinois dans la région, les États-Unis auraient pu obtenir facilement ce qu’ils veulent, qu’il s’agisse de ressources minérales ou de routes maritimes arctiques, en renforçant leurs liens militaires avec le Groenland. Cependant, cette fois, Washington s'exprime clairement sur un point: les Américains ne recherchent plus seulement la coopération mais exigent la souveraineté pleine et entière sur le Groenland. Et ils estiment que l’Europe n'opposera probablement que peu de résistance sérieuse.
L’escalade des actions et de la rhétorique américaines montre au monde que, pour les États-Unis, le Groenland est une priorité incontournable. La vraie question est maintenant de savoir si l’Europe pourra faire comprendre à Washington qu’elle est, elle aussi, déterminée à défendre la souveraineté territoriale de ses États membres souverains.
14:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : états-unis, europe, groenland, affaires européennes, souveraineté, souveraineté européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 janvier 2026
Cinq raisons pour lesquelles la droite allemande doit se détourner du culte MAGA - Ainsi que toutes les droites et les gauches européennes...

Cinq raisons pour lesquelles la droite allemande doit se détourner du culte MAGA
Ainsi que toutes les droites et les gauches européennes...
par Bruno Wolters
Source: https://www.freilich-magazin.com/politik/fuenf-gruende-wa...
Le culte qui s'est créé autour du mouvement « MAGA » révèle, chez une partie de la droite allemande, moins une force qu’une dépendance stratégique, et menace de subordonner les intérêts européens à des jeux de pouvoir étrangers. Bruno Wolters met en garde contre le fait que la souveraineté politique ne peut naître que lorsque l’on maintient une distance vis-à-vis des cycles d’excitation médiatiques lancés par les services américains.
Il y a des moments où la proximité politique ne signifie pas la force mais la dépendance. L’enthousiasme actuel pour le fatras idéologique du mouvement MAGA chez une large partie de la droite européenne – en particulier en Allemagne – l'atteste. Ce qui a commencé comme une sympathie tactique s’est, dans certains cas, transformé en une soumission mentale.
L’une des tentations classiques des mouvements politiques est de considérer les succès étrangers comme des succès à soi. La fixation d’une partie de la droite allemande sur Donald Trump et le milieu MAGA est l’expression exacte de cette tentation: on projette ses propres désirs, conflits non résolus et blocages stratégiques sur un acteur étranger, en oubliant que ses actions ne sont ni destinées ni adaptées à l’Europe.
Ce n’est pas seulement imprudent sur le plan politique mais aussi stratégiquement dangereux – surtout maintenant que le président américain et ses conseillers veulent, après le Venezuela, aussi contrôler le Groenland. Il s’agit ici d'un territoire danois, donc de l'espace souverain d’un partenaire de l’OTAN, qui s’est montré au fil des décennies comme l’un des alliés américains les plus loyaux.
Conséquence: selon certains médias, Trump aurait ordonné à ses militaires d’élaborer des plans offensifs, tandis que les généraux tenteraient de le distraire en abordant d’autres sujets. La cupidité de Trump pour le Groenland ne doit pas nous apaiser – et que se passerait-il s’il déclarait que les bases américaines en Europe, comme Ramstein, deviendraient toutes territoire américain? Avec l’instabilité de Trump, tout doit être envisagé. Cela signifie que la droite allemande et européenne doit suivre une voie différente de celle du mouvement MAGA.
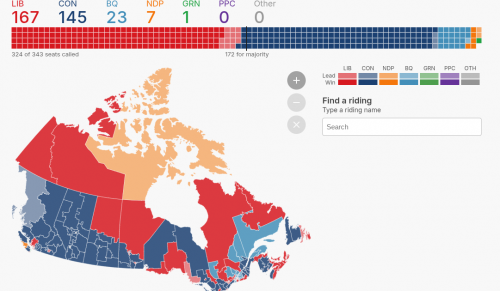
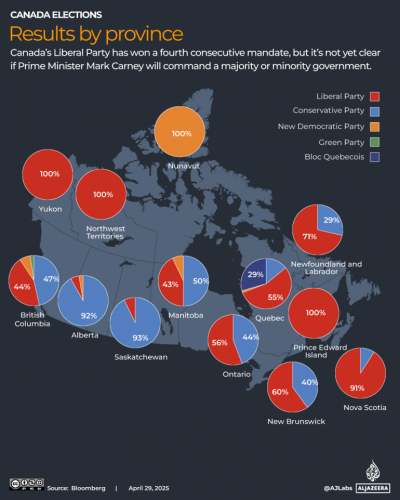
1. Le piège canadien: quand la souveraineté nationale devient soudain réalité
Au Canada, jusqu’à peu près avant les élections de l’été 2025, une victoire claire des conservateurs sur les libéraux au pouvoir était attendue, jusqu’à ce que Trump, avec ses fantasmes d’annexion ("51ème État") et ses taxes punitives, ne bouleverse la rhétorique de la campagne. Début 2025, selon des études, les conservateurs avaient près de 30 points de pourcentage d’avance sur leurs rivaux de gauche et libéraux. Mais ce qui a suivi n’a pas été une révolte de gauche ou une campagne morale, mais une réaction souverainiste des électeurs. Les sondages montraient que la majorité des Canadiens percevaient ces débordements comme une attaque contre leur souveraineté nationale, tandis que, contre toute attente, les supporters conservateurs de Trump au Canada étaient soudain considérés comme des collaborateurs potentiels du futur ennemi américain. Le parti conservateur, proche de Trump, a ainsi perdu son avantage.
C’est ici que cet exemple canadien devrait servir d'avertisseur pour la droite allemande. S’attacher de manière démonstrative à un président américain dont la rhétorique remet en question la souveraineté d’autres pays, voire la sienne propre, envoie un message à son propre peuple et lui dit que le destin de la nation dépend finalement des caprices d’un autre continent. Les sondages sur le gouvernement Trump montrent à quel point sa personne est polarisante: les républicains l’aiment, les démocrates le détestent, et les indépendants sont divisés. Pour la droite et la mouvance conservatrice allemandes, cela signifie: s’accrocher à une figure aussi divisive consiste aussi à importer une telle division en Europe, sans toutefois posséder les moyens de puissance correspondants.
Une dépendance trop étroite à l'endroit du mouvement MAGA comporte le danger d’être perçu non pas comme une force nationale indépendante mais comme une formation qui importe des conflits étrangers. Le message des électeurs canadiens est clair: faire de son pays un appendice des projets d'une puissance étrangère, c’est perdre sa légitimité. Nous, Européens, ne devons pas faire cette erreur à notre tour.
2. La souveraineté mentale comme condition d’efficacité politique
Trump et son mouvement MAGA mènent une politique selon le modèle de l'«escroquerie populiste de droite»: d’abord, la colère populaire contre l’immigration, le terrorisme et la désindustrialisation est attisée. Ensuite, les populistes de droite sont élus, qui font beaucoup de bruit, puis agissent de manière perturbatrice en politique étrangère en étant principalement au service des intérêts de l’élite politique et économique, sans changer fondamentalement la situation intérieure. Finalement, ils sont houspillés hors des allées du pouvoir, la gauche reprend alors celui-ci, aggravant la situation – et le cycle recommence. Ce mécanisme s’applique désormais au mouvement MAGA, presque comme un cas suggéré par un manuel. En Europe, on a aussi pu voir ce modèle dans le gouvernement de Wilders aux Pays-Bas.
Après un peu plus d’un an au pouvoir, l’administration MAGA semble politiquement épuisée: le bilan de la rémigration promise et annoncée est à peu près le même que celui des gouvernements démocratiques précédents, les chiffres des expulsions réelles restent dans la moyenne, tandis que des "expulsions spectaculaires" et symboliques sont médiatisées. L'inflation, la migration massive et les ruptures sociales ne sont pas résolues, voire empirent – et les premières analyses économiques indiquent que la politique douanière a détruit plus d’emplois qu’elle n'en a créés. Beaucoup de promesses et d'annonces n’ont pas été concrétisées jusqu’à présent. Trump s’en démarque même.

Cela signifie que MAGA remplit exactement la fonction systémique esquissée par l'effet «scam»: la colère populaire est canalisée, transformée en une politique de type affectif et en une mise en scène médiatique, mais pas en réformes structurelles véritables. Le système d’immigration reste essentiellement inchangé, les structures de soutien au combat anti-blancs ne sont pas remises en question, et l’administration libérale reste intacte. Pour la droite allemande, c’est une leçon: s’aligner sur un populisme de droite de ce type, c’est adopter un mécanisme qui génère de l’indignation pour la neutraliser politiquement.
Car l’Europe ne deviendra pas une grande puissance ou une puissance spatiale tant qu’elle restera mentalement dans la zone d’avant-garde des États-Unis. Cela concerne non seulement les gouvernements, mais aussi l’opposition. Un mouvement de droite qui tire son énergie politique des batailles culturelles américaines, des cycles électoraux et des rituels d’indignation made in USA, ne pense pas souverainement, mais réactivement: pure agitation sans effets réels.
Les études sur le soutien à Trump illustrent ce problème précis. MAGA n’est pas un projet qui intègre la nation, mais un phénomène de constitution de camps fortement polarisés. Même aux États-Unis, le mouvement MAGA ne subsiste que de manière fragmentaire. Le rejet massif par les indépendants, la division selon des lignes culturelles et sociales, ainsi que la diminution du soutien en dehors de la base dure, ne parlent pas en faveur d’un modèle à exporter.
La souveraineté mentale consiste à analyser la réalité politique de manière objective, plutôt que de s’enivrer d’images où force et dureté sont obscènement mises en exergue. Ceux qui réagissent constamment aux signaux venus d'Amérique perdent de vue leurs propres nécessités stratégiques.

3. Les intérêts des États-Unis ne sont pas les nôtres – et ne l’ont jamais été
L’une des erreurs les plus tenaces de la droite européenne est de supposer qu’un président «de droite» aux États-Unis serait un allié naturel. Cependant, cette supposition ignore des faits fondamentaux d’ordre géopolitique. Les États-Unis agissent comme un empire – indépendamment de celui qui siège à la Maison Blanche. Leurs intérêts sont structuraux et idéologiques.
Les États-Unis poursuivent – indépendamment de leur administration – la stabilisation de leur empire. Un sondage sur une intervention militaire américaine montre qu’au sein même de la population américaine, un équilibre existe entre les réponses «opposition», «soutien» et «indécision», alors que les camps politiques s’opposent. Mais que l’on lise 47% de rejet ou 33% d’approbation: pour Washington, ce qui compte, c’est que la machine de la politique étrangère continue de fonctionner, peu importe si l’Europe en bénéficie.
Mais: le conflit imminent avec la Chine est perçu par Washington comme existentiel. Pour l’Europe, la Chine est principalement un partenaire économique, moins une menace géopolitique ou idéologique. Pour l’Allemagne, la coopération avec la Chine est cruciale pour l’industrie et l’exportation. Une politique ignorant cette réalité nuit à ses propres bases.
Il en va de même pour la question énergétique. La dépendance croissante de l’approvisionnement énergétique européen à des intérêts américains crée de nouvelles dépendances. L’énergie devient un levier de pression politique – même sur les alliés. Ceux qui pensent pouvoir désamorcer cela par proximité idéologique se méprennent sur la logique de la politique de puissance.
L’Europe a d’autres intérêts fondamentaux: la coopération économique avec de nombreux autres pays, une fourniture d’énergie stable et l’évitement de guerres d’intervention coûteuses qui génèrent des flux migratoires. Si la droite allemande se laisse entraîner dans «les combats à mort» qui agitent l’imperium américain – cela va du changement de régime réclamé en Iran à la surveillance des champs pétrolifères vénézuéliens –, elle adopte un agenda qui déstabilise ses propres sociétés.
Ajoutez à cela la question énergétique et monétaire: avec la perte progressive du pouvoir du dollar américain, l’incitation pour Washington d’exercer une pression politique via des ressources énergétiques et des régimes de sanctions s’accroît. Une dépendance durable de l’approvisionnement énergétique allemand aux diktats américains signifierait que toute politique indépendante envers la Russie ou la Chine pourrait être indirectement sanctionnée. Ceux qui brandissent dans de telles conditions des drapeaux MAGA contribuent involontairement à fixer la République fédérale comme avant-poste industriel d’une grande puissance étrangère. Qui exige la souveraineté doit d’abord la penser. Et ceux qui prennent au sérieux l’indépendance européenne ne peuvent plus se laisser lier aux cycles d’excitation propagés par un empire étranger.

4. Dommages à la réputation: la menace MAGA comme hypothèque stratégique
Un problème central de la gouvernance MAGA actuelle réside moins dans ses échecs ouverts dans certains domaines politiques que dans la manière dont le pouvoir est désormais exercé de manière démonstrative: non comme une puissance étatique, mais comme un réseau personnel. Non plus comme un projet politique, mais comme un réseau familial et économique.
Ce que l’on observe actuellement aux États-Unis, ce n’est pas une renaissance nationale, mais un affaiblissement rapide des intérêts politiques qui y sont liés. L’entourage immédiat de Trump agit de plus en plus comme une structure parallèle d’entrepreneurs: projets cryptographiques non ironiques avec un caractère évident de scam, construction de marques personnelles utilisant la proximité politique, accès privilégié pour les grands donateurs et les oligarques technologiques, qui ne jouent plus le rôle d’alliés mais de co-gouvernants.
Ce n’est pas un argument moral mais un argument qui doit évoquer la réputation. Ceux qui se lient de manière démonstrative au mouvement MAGA ne s’attachent pas à «l’Amérique» ou à une transformation de l’État dans un sens idéologiquement conservateur, mais à un milieu de plus en plus étroit d’intérêts familiaux, de capital-risque, de monopoles technologiques et de patronage politique. La frontière entre pouvoir politique et avantage privé n’est plus dissimulée mais ostentatoirement acceptée.
Plutôt que d’être perçue comme une contre-force souveraine, une telle alliance, étiquetée nationaliste, populiste ou conservatrice, risque d’apparaître comme la branche provinciale d’un milieu oligarchique américain. Non comme une force sérieuse avec ses propres réponses mais comme spectatrice enthousiaste de jeux de pouvoir étrangers. Cela nuit non seulement à la crédibilité, mais aussi à toute stratégie à long terme.
Précisément parce que la confiance dans les institutions politiques s’effrite, la crédibilité devient la ressource la plus rare de toute opposition. Toute proximité visible avec un réseau de fraude cryptographique, de deals d’oligarques et de patronage familial affaiblit cette ressource – non seulement auprès des opposants mais aussi auprès des électeurs potentiels qui espèrent restaurer l’ordre, la transparence et la justice sociale. Une droite européenne souveraine doit donc maintenir ses distances: aussi bien vis-à-vis du culte MAGA en tant que figure cultuelle que vis-à-vis des réseaux environnants d’argent, de glamour et de spectacles numériques.
5. Solutions propres – la droite multipolaire plutôt que l’importation MAGA
Pour la droite européenne, un rare créneau temporel s’ouvre actuellement: celui de la possibilité de maintenir une distance dans la dignité. Ceux qui abandonnent maintenant leurs illusions gagnent du temps pour la théorie, l’organisation et la construction stratégique. Ceux qui persistent dans le culte du mouvement MAGA risquent une perte massive de crédibilité. Il est temps de formuler une stratégie européenne indépendante qui associe rémigration, souveraineté et rationalité économique, sans s’attacher aux cycles de la politique intérieure américaine.
De plus, l’usure intérieure du camp MAGA est manifeste: le «tournant» promis n’a pas eu lieu, des scandales majeurs n’ont pas été élucidés, et économiquement, ce sont surtout les grands donateurs, les réseaux néocon et l’entourage familial immédiat de la direction qui ont profité. La collusion apparente avec le grand capital et les intérêts lobbyistes n’est même plus dissimulée mais célébrée comme une expression de «puissance». Le prix en est la déconnexion avec les électeurs qui rêvent d’une véritable renaissance sociale ou nationale.
Le danger est réel que des acteurs américains tentent d’utiliser le populisme de droite européen comme le vecteur d'une vassalisation renouvelée. La dépendance énergétique, les exigences de loyauté géopolitique et la pression économique en seraient les conséquences. La démocratie chrétienne classique est aujourd'hui épuisée – une nouvelle mouvance porteuse doit être trouvée.
Une stratégie européenne indépendante devrait, en revanche, être sobre et orientée par ses propres intérêts. Elle n’éviterait pas des questions difficiles telles: la relation avec la Russie, la coopération économique avec la Chine, le rejet d’une politique extérieure uniquement basée sur le moralisme niais au profit de calculs politiques réalistes. Une démarcation consciente par rapport aux luttes simulées et mimétiques, le tout au profit d’une conquête silencieuse mais résolue des institutions nationales, voilà ce qui serait nécessaire.
Conclusion: contre le fallacieux populisme de droite
Le populisme de droite d’aujourd’hui n’a pas disparu mais s’est adapté. Il utilise un langage, des codes et des affects de droite sans en réaliser les objectifs. Il canalise l’énergie de la protestation, la neutralise, puis la ramène dans le système existant de façon contrôlée. Ceux qui veulent un changement réel doivent apprendre à reconnaître aussi le populisme de droite comme une impasse potentielle. MAGA en est l’exemple le plus visible. Pour la droite allemande, ce serait un signe de maturité de tourner froidement la page de ce culte – non pas par anti-américanisme, mais par simple conscience que les peuples qui ne se représentent pas eux-mêmes sont gérés par d’autres.
La droite allemande doit faire un choix : continuer à agir dans l’ombre de puissances étrangères – ou agir enfin de manière indépendante. La souveraineté n’est pas une pose. C’est une séparation délibérée.
À propos de l’auteur: Qui est Bruno Wolters?
Bruno Wolters est né en 1994 en Allemagne et a étudié la philosophie et l’histoire dans le nord de l’Allemagne. Depuis 2022, Wolters est rédacteur de la revue Freilich. Ses domaines d’intérêt sont l’histoire des idées et la philosophie politique.
22:25 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, allemagne, droite allemande, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pourquoi la politique allemande est-elle si faible sur le plan stratégique?

Pourquoi la politique allemande est-elle si faible sur le plan stratégique?
Markus G. Bußmann, MBA
Source: https://www.linkedin.com/in/markusgbussmann/
C'est simple. Parce que la politique allemande est systématiquement conçue pour sa propre gestion, et non pour une stratégie bien précise. Il ne s'agit pas de l'échec personnel de certains politiciens mais d'un défaut de conception conforme à la norme DIN.
Voici 7 raisons qui expliquent pourquoi nous semblons si dépassés et pourquoi cette situation devrait perdurer:
1. La gestion plutôt que la pensée stratégique
L'Allemagne se considère comme le gardien moral du monde. Or, toute stratégie cohérente exige de penser explicitement en termes de pouvoir, d'intérêts et de conflits. À Berlin, on considère cela comme indécent. On préfère réagir "correctement" mais toujours trop tard. L'État fonctionne comme un service d'urbanisme obstiné avec une perception extérieure déplorable.
2. Les coalitions tuent la vision à long terme
Les cycles de quatre ans et les calculs cogités par toute coalition conduisent à une politique basée sur le principe suivant: ce qui ne suscite pas de controverse aujourd'hui est déjà stratégique.
Les grandes lignes ne survivent pas aux négociations de la coalition en cours. Elles sont édulcorées jusqu'à ce que plus personne ne s'y oppose, mais que plus personne ne les soutienne non plus. Nous avons affaire à un ragoût consensuel au lieu d'un changement de cap.
3. Le consensus comme substitut à la décision
En Allemagne, le consensus est considéré comme une catégorie morale. Mais la stratégie a besoin de dissensions et de priorités. Celui qui veut tout prendre en compte ne donne la priorité à rien. Celui qui ne donne la priorité à rien se voit imposer des priorités par d'autres.
4. Forte domination des juristes et de l'administration
L'élite allemande raisonne en termes de :
- compétences
- procédures
- risques constitutionnels
Et non en termes de :
- scénarios
- changements de pouvoir
- dépendances
Le droit remplace la réalité. D'un point de vue juridique, cela semble correct, conforme, à première vue, mais c'est complètement irréaliste.
5. L'économie est considérée à tort comme un secteur qui fonctionne tout seul
Pendant des décennies, on a cru que la puissance industrielle était une loi naturelle en Allemagne. Donc:
- pas de programme de recherche ambitieux
- pas de stratégie technologique
- pas de culture startup
Lorsque d'autres États ont commencé à subventionner, protéger et orienter stratégiquement, l'Allemagne a déclaré que c'était incorrect, puis qu'il n'y avait pas d'autre alternative.
6. Un frein historique
Après 1945, un profond malaise s'est développé à l'égard de tout ce qui ressemble à l'intérêt national. C'est compréhensible, mais cela a des conséquences :
- les intérêts sont dissimulés sous des considérations morales
- les questions de pouvoir sont externalisées
- le leadership est délégué à des règles
Les règles sont une bonne chose. Mais elles ne dirigent pas les pays.
7. Une politique sans prix à payer pour les erreurs
Les erreurs stratégiques n'ont pratiquement aucune conséquence sur les personnes dans ce pays. In fine, personne n'est responsable. Et personne ne démissionne à cause d'erreurs
- de dépendances
- de prévisions
- d'attentes en matière de risques
Sans responsabilité, pas de stratégie. La politique allemande n'est ni stupide ni incompétente. Elle est simplement optimisée structurellement pour la stabilité, et non pour un véritable changement. Cela fonctionne très bien en période calme.
Dans un monde marqué par la rivalité entre Xi, Poutine et Trump, par les guerres technologiques et la formation de blocs, cela revient à participer à une course automobile en respectant parfaitement le code de la route. Et ensuite, le conducteur vertueux demande avec un grand sérieux pourquoi les autres ont un comportement inconsidéré.
21:34 Publié dans Actualité, Affaires européennes | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, europe, affaires européennes, allemagne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook


