
Parution du numéro 477 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Entretien avec Émile Brami
Céline vu par un oxfordien. Une lecture de Guerre
Un poème de Charles Bukowski sur Céline
Dans la bibliothèque de Céline. Ouverture
Philippe Sollers, un an déjà…
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.




18:20 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, brigitte bardot, france, cinéma, droites, droites françaises |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Ma jeunesse s'en souviendra!
Brigitte Bardot (1934-2025)
Pierre Robin
Source: https://www.facebook.com/pierre.robin.121
C'était là le grand rdv que je redoutais, ces mauvais temps-ci. Peut-être par paresse "littéraire", si je puis dire, car que raconter, qu'écrire d'Elle, après? Oh, on peut déjà rappeler que c'était l'autre grand astre français survivant après son ami Delon, et cet astre il brille bien au-delà du cinéma, bien au-delà d'une vie, d'une époque. Il y a trop de Bardot en vérité: la Femme créée soudain par Dieu au beau milieu de la peu sexy IVème République. Bardot en Notre-Dame du désir moderne (j'ai dû collecter, mâle vieillissant et complétiste, pas loin de mille photos d'elle et s'il y en a une vingtaine où elle n'est pas troublante...), vierge folle qui a démodé tout (et toutes) autour d'elle. Bardot et son féminisme pro-mecs (jetables ou un peu durables), à gêner rétrospectivement toutes les Adèle Haenel et les Judith Godrèche d'Occident wokeux ou, plus tôt, les miss Météo formatées de Canal+. Quoi encore ? Bardot et l'antique civilisation (disparue de son vivant) de Saint-Trop'. Bardot et le binôme Islam-Immigration (la même que Bardot imprécatrice, parfois maladroite toujours courageuse). Bardot et Gainsbourg avec tous les émouvants scopitones que cette aventure à suscités (et aussi ce bel hymne à l'amour, Initials BB). Bardot et les animaux bien sûr, quand elle attendit moins du genre humain...

Indépassable désirable...
Bardot et le cinéma au fait. Je crois qu'elle s'en foutait un peu du Septième Art même si elle lui doit tout. On pouvait toujours ricaner de sa voix nunuche, mais quand elle dansait en 1956 dans Et Dieu... ce mambo signalant des temps nouveaux - oh d'ailleurs le film n'est pas le navet qu'on a dit, avec son casting solide et ses dialogues marrants. Du reste BB a tourné pas mal de films "marrants", qui étaient souvent de bonnes comédies - revoyez seulement Voulez-vous danser avec moi de Michel Boisrond (1959) ou même Les Femmes de Jean Aurel (1969), ou encore L'Ours et la Poupée de Michel Deville (1970).

Ah vous voulez du grand art tragique, comme chez les Grecs antiques et Jean Vilar ? Dans En cas de Malheur d'Autant-Lara (1958), où elle affronte un Gabin installé, elle est une splendide racaille blanche qui montre (sous René Coty !) ses fesses et apporte le chaos dans la bourgeoisie et puis la Mort ; et dans La Vérité de Clouzot (1960) son personnage de bombe sexuelle malheureuse se suicide, juste avant qu'elle-même tente de le faire pour de vrai, éprouvée par le difficile tournage et sans doute pas mal de déceptions de superstar - elle joue à cet égard son propre rôle de super-vedette victime de sa gloire dans le moyen Vie Privée de Louis Malle (1962) .

C'est vrai, Clouzot n'était pas gentil, et Jean-Luc Godard non plus sur le tournage du Mépris (1963), lui peut-être par frustration de timide. Quelle frustration inspirée ! Bardot, cheveux noirs ou cheveux blonds, est à tomber, elle a là sa plus belle moue méprisante (ça tombe bien) pour le personnage d'amant de Piccoli ou le dragueur yankee Jack Palance, et tout ça se passe dans le bleu hellénistique de Capri, sur le blockhaus inspiré de la Villa Malaparte, et aux accords du beau thème triste de Camille signé Georges Delerue. Et puis citons encore les westerns foutraques, 2ème degré, de Viva Maria (1965) de Louis Malle en Pétroleuses de Christian-Jaque (1971) en passant par Shalako d'Edward Dmytryck (1968), avec leurs bagarres et leur révolution pour rire - et l'immense Sean Connery reparti la queue basse ! Et à chaque fois, quoiqu'elle joue, toujours sexy - j'allais écrire "bandante" mais je me suis retenu à temps !

Bon, j'en oublie sûrement, des films et des amants de prestige. Mais on retiendra qu'elle a quitté tout ça, un beau jour de l'an 73, pour ne pas faire un film de trop, de plus. Après, les bébé phoques et la défense de tout le genre animal, la croisade contre l'Islam migratoire et la sainte colère contre les "élites" politiques et médiatiques de sa deuxième moitié de vie, je ne les mettrais certes pas au passif de cette vie. C'est méritoire de persister à être clivante quand on pourrait se contenter d'être une icône rituellement vénérée par tous les cool-nomenklaturistes de l'époque, je trouve. C'est méritoire et puis c'est tout simplement courageux.
Bon Dieu Brigitte Bardot est morte ! Le Troisième millénaire peut officiellement commencer avec juste un quart de siècle de retard, un peu comme le XXème siècle a débuté en 1914. Sa France, la mienne par la même occasion, est officiellement morte elle aussi...
18:00 Publié dans Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : hommage, brigitte bardot, cinéma, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Quand les bandits ont appris à faire la loi
Henryk Gondorff
Source: https://overton-magazin.de/hintergrund/kultur/1923-als-die-raeuber-lernten-wie-man-staat-macht/
La série 1923 est plus qu'un néo-western. Elle montre la transformation de l'Amérique en une société de propagande et de technologie.

Avec sa série 1923, le cinéaste Taylor Sheridan a créé une épopée familiale dans le style du western tardif. Elle s'inscrit dans son univers Yellowstone et vise à montrer comment la famille Dutton a traversé une période où les nouvelles technologies et un nouveau système politique ont transformé le pays. À cette époque aussi, c'était un tournant. Il apparaît clairement que les vieux Dutton perdent leurs certitudes et que les jeunes membres de la famille sont désorientés dans leur vie quotidienne. Car le monde n'a pas seulement été simplifié par de nouveaux appareils électriques, il a également été soumis au régime qui règne encore aujourd'hui aux États-Unis.
L'ancien et le nouveau monde
La première saison de la série est désormais disponible sur Netflix. Elle met en scène la famille Dutton, dont le ranch dans l'État du Montana est en crise. Une sécheresse entraîne une pénurie de fourrage pour le bétail. Les Dutton ne sont pas les seules victimes de la sécheresse, d'autres éleveurs s'inquiètent également pour leur avenir. Des spéculateurs fonciers envisagent désormais de racheter leurs terres. Mais les temps ont changé. Ceux qui convoitent les terres n'envoient plus de cow-boys armés pour les prendre. Ils portent des costumes élégants et travaillent en étroite collaboration avec les banques. En 1923, le Far West est en passe d'être domestiqué. Et il est mis au pas par l'administration, les grandes entreprises et les barons prédateurs et richissimes.

Cette série montre les bouleversements sous de multiples facettes. Des poteaux télégraphiques sillonnent la prairie, les colons savent assez bien ce qui se passe dans la lointaine New York. Dans les rues de la ville de Bozeman, on vante les mérites des machines à laver comme si c'était la clef de l'avenir. Mais c'est dans les nouvelles méthodes utilisées pour mater les citoyens gênants que la transformation vers la nouvelle Amérique est la plus visible: on les rend dépendants financièrement et on les maintient dans un état de soumission. Le capitalisme financier dévore ceux qui dérangent.
Helen Mirren et Harrison Ford incarnent cette vieille Amérique avec une gravité stoïque. Leurs personnages sont tout sauf modernes, ils sont terre-à-terre, têtus et durs avec eux-mêmes. Quand ils désespèrent, c'est dans le silence de la prairie. Les explosions émotionnelles sont pour eux des phénomènes de mode d'une époque dans laquelle ils ont du mal à trouver leur place. La décence et l'honneur cimentent leur vision du monde. Au fil des épisodes, ils se rendent compte qu'ils sont désespérément dépassés. Les deux acteurs surpassent le reste de la distribution.

En même temps, Sheridan parvient à ne pas mettre en scène la disparition de l'ancien monde de manière trop nostalgique. Son histoire ose le réalisme analytique. Rien n'est romancé, sauf le mariage entre les vieux Duttons, qui se caractérise par une relation affectueuse. La violence est toujours présente dans ce néo-western, mais elle s'inscrit dans un cadre progressiste. Un cadre où la violence est toujours exercée dans un but lucratif. Sheridan offre deux autres intrigues à ses spectateurs. L'une se déroule en Afrique et raconte l'histoire du neveu des Dutton, qui doit revenir pour sauver le ranch. Un autre raconte l'histoire d'une jeune Indienne qui souffre dans un internat chrétien. Les deux histoires sont bien racontées, mais elles ne développent pas la force qui anime l'intrigue principale.
L'Amérique des démagogues et des propagandistes
Car seule l'intrigue principale raconte l'histoire des États-Unis du 21ème siècle. Une histoire pleine de technologie et d'une nouvelle vision du monde, pleine de recherche du profit et de radicalisme de marché, pleine de domination des riches et de légalisation des Crésus malhonnêtes. Cette Amérique que présente le créateur de la série se révèle être un pays où le progrès n'est pas venu aux gens de manière noble et sous des aspects honorables, mais avec une brutalité impitoyable et la violence de brigands effrontés. Ils ont soumis le pays, exploité les gens et mis leurs profits en sécurité.

Sheridan ne dit rien de la propagande d'entreprise qui avait pris le pays en otage depuis quelque temps en 1923, mais on la sent à certains endroits. Le président américain de la Première Guerre mondiale, Woodrow Wilson, avait fait appel à des experts en propagande à la Maison Blanche. Edward Bernays était le plus célèbre de cette équipe. Ensemble, ils ont façonné l'Amérique moderne, en faisant un lieu où les élites nationales peuvent gouverner et faire du commerce sans se soucier de l'intérêt général. Le gouvernement américain a recouru au mode de communication que les barons voleurs s'étaient auparavant approprié. Avec un zèle propagandiste, ils se sont fait passer pour des mécènes et des philanthropes. Cela a si bien fonctionné que certains membres de ce cercle sont encore considérés aujourd'hui comme de grands bienfaiteurs.
Ainsi, 1923 n'est pas simplement une épopée historique. C'est un éclairage sur notre présent. Celui-ci est présenté comme la continuation de la violence de l'époque. Les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui sont nés à cette époque, où le pays est devenu une puissance mondiale, même s'il a d'abord traversé une phase d'isolement. Des fortunes ont été amassées de manière criminelle, qui existent encore aujourd'hui et sont encore plus importantes qu'à l'époque. Les petites gens, incarnées par les Dutton, n'ont guère influencé le cours des événements. Elles étaient le jouet de démagogues, de propagandistes, de millionnaires qui seraient aujourd'hui milliardaires. Et elles étaient les victimes d'un État qui n'hésitait pas à faire intervenir l'armée lorsque le grand capital était menacé.

Le pays des escrocs
En y regardant de plus près, on remarque toujours de petits changements dans les grands panoramas de la série : une automobile entre des charrettes tirées par des chevaux, un gramophone dans une cabane. La modernité fait son entrée dans la vie quotidienne et fait miroiter aux gens une ère nouvelle. Bien sûr, on leur dit que leur vie sera bientôt plus facile, que l'électricité va complètement transformer leur vie rurale. Mais on pourrait dire que les appareils modernes étaient les cadeaux nécessaires pour que les citoyens acceptent une époque où ils seraient à nouveau contraints de vivre dans un système féodal. La vie plus facile leur a doré la pilule.
Le vieux Dutton, joué par Harrison Ford, semble le pressentir. Ce n'est pas un philosophe, mais il a néanmoins un sens aigu des plans des puissants. Il sait qu'une époque approche où la promesse de grande liberté que l'Occident représentait autrefois pour les colons sera abandonnée. Les États-Unis se modernisent. Et ils tueront pour parfaire jusqu'au bout ce projet de modernisation outrancière. Chaque fois que cela sera nécessaire.
La première saison de 1923 n'est pas une histoire complète. Une deuxième et dernière saison s'est terminée il y a quelques semaines pour les spectateurs des États-Unis. La série y a été très bien accueillie. La critique du caractère prédateur de l'histoire de leur propre pays a été bien accueillie.
Les petites gens en Amérique savent généralement qu'à un moment donné, une époque a commencé où plus rien ne comptait pour elles. Même si chaque jour est une question de survie. Politiquement, elles sont exclues, économiquement, elles se soumettent. Les escrocs sont confortablement installés dans leurs villas et leurs penthouses depuis plus d'un siècle. 1923 montre clairement une chose: le pays considéré comme la vitrine du monde libre est en réalité une pure escroquerie. Et ce, depuis longtemps...
Henryk Gondorff
Cinéaste de la première et de la dernière heure. Il a beaucoup vu et beaucoup oublié très vite. Si vous voulez savoir ce qui ne va pas dans une société, allez dans ses cinémas. Vous y trouverez le diagnostic.
Plus d'articles de Henryk Gondorff : https://overton-magazin.de/author/henryk-gondorff/
13:09 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : film, cinéma, taylor sheridan, états-unis, modernisation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
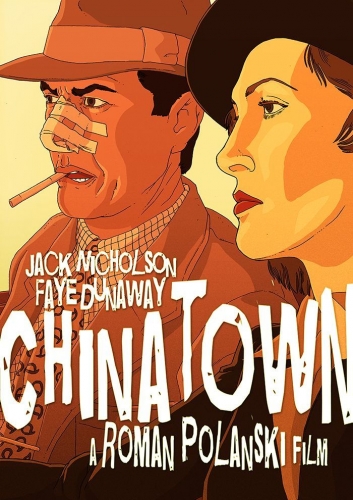
Le Chinatown de Polanski et le dévoilement de l’Amérique
Nicolas Bonnal
« Le désert croît. Malheur à qui recèle des déserts ! » (Zarathoustra).
Mère de toutes les images et de tous les vices de la planète ciné-télé Los Angeles est une ville-simulacre qui n’aurait pas dû naître, pas dû pousser sur un désert. Elle l’a fait quand même, et de quelle manière ; et sa récente punition inexplicable et terrifiante à la fois marque comme pour Hawaï (autre terre du rêve et du cinéma) une énième descente aux enfers et au désert. Mais cette ville qui est une anti-ville peut descendre plus bas et le fera sans doute.
A propos du Chinatown de Polanski, film le plus important sans doute du cinéma (tout y est voile de la Maya, sauf cet enfant mexicain à cheval venu d’un autre monde, celui de la licorne de Ridley Scott et d’un moyen âge chrétien), on rappellera que le film explique comment ce monstre tératologique, la ville du cinéma donc (voir le quatrième partie de ma Damnation des stars publiée chez Filipacchi il y a trente ans déjà) est venue au monde. Car le film tourne autour de ça, des eaux, de la terre et du ciel sec.
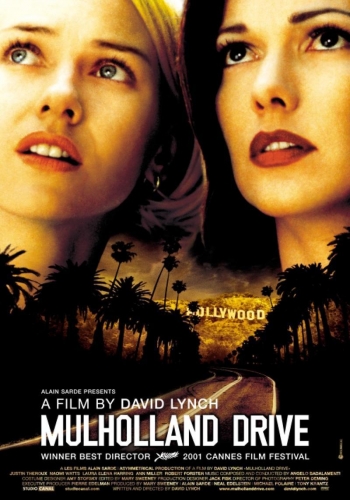

On y découvre un personnage (l’une des victimes, la plus importantes), inspiré par William Mulholland qui a donné son nom à deux chefs-d’œuvre du cinéma postmoderne comme on dit : Mulholland Drive de David Lynch et l’excellent Mulholland Falls du maori Tamahori qui reprend une thématique proche d’Aldrich (celui d’En quatrième vitesse of course) : les inventions démoniaques (la bombe nucléaire) créent des monstres non pas physiques (ce serait trop facile…) mais psychologiques. C’est aussi cela qui aussi a créé ce Deep State indéracinable dont on connait les intentions globales et locales depuis le Covid. Le film de Polanski reprend la thématique de Rosemary : le Diable (celui de Baudelaire) va prendre le monde en charge, et directement encore. De Manhattan (revoyez Ghostbusters et les révélations qui y sont faites par Harold Ramis) à Los Angeles l’Amérique est « couverte ».
Sur Mulholland autant savourer Wikipédia :
« Dans les années 1880-90, Frederick Eaton et William Mulholland comprennent que l'obstacle principal à l'extension de la ville de Los Angeles est son approvisionnement en eau. Ces derniers se rendent compte que la vallée de l'Owens possède un trop-plein d'eau provenant de la Sierra Nevada et qu'un aqueduc pourrait conduire cette eau jusqu'à Los Angeles.

Au 20ème siècle la vallée de l'Owens (photo) devient la scène d'affrontement où corruption et manipulation opposent les résidents locaux et la ville de Los Angeles pour obtenir les droits sur l'eau… »
Le film fait allusion à une guerre caïnite de l’eau :
« Les guerres de l'eau en Californie (anglais : California Water Wars) désignent les différends entre la ville de Los Angeles et les fermiers de la vallée de l'Owens en Californie concernant les droits de l'eau. Les conflits découlent principalement de l'emplacement dans une zone semi-aride de Los Angeles et la disponibilité de l'eau de la Sierra Nevada dans la vallée de l'Owens. »

Enfin voyons pour le grand homme au bilan génial mais contestable :
« William Mulholland (Belfast, Irlande, 11 septembre 1855 – Los Angeles, Californie 22 juillet 1935) (photo) est un ingénieur américain d'origine irlandaise qui travailla en Californie et fut une figure marquante de l'histoire de Los Angeles.
Il a dirigé la construction du premier aqueduc de Los Angeles, qui a permis à la cité de devenir l'une des plus grandes villes du monde. L'exploitation de l'aqueduc a conduit cependant aux conflits connus sous le nom de guerres de l'eau en Californie, et à un désastre écologique dû à l'assèchement du lac Owens et de la vallée du même nom. En mars 1928, sa carrière prend fin lorsque, 12 heures après que lui et son assistant y ont effectué une inspection de sécurité, le barrage de St. Francis s'effondre, causant un grand nombre de morts et des dégâts considérables… ».
Le double de Mulholland refuse de « commettre la même erreur ». C’est là que les moutons interviennent (dans le film…). Bientôt on va lui envoyer les égorgeurs.
J’ai déjà dit que le film noir sert à dénoncer ou simplement dévoiler un monde criminel, un monde si dystopique qu’il débouche en univers de SF. Le monde criminel en Occident est invincible et le sait ; il n’aime pas être dénoncé mais il aime bien être révélé parfois. Ici le scénariste Robert Towne (Robert Bertram Schwartz, auteur aussi de Bonnie & Clyde et de l’exceptionnel Shampoing d’Hal Ashby) se surpasse et se défoule même.
Le méchant du film, qui a violé sa fille, lui a fait une enfant et tue finalement son associé et gendre, est joué par John Huston. Il se nomme Noah Cross et on voit comme un règlement de comptes se profiler là. Après tout on est à l’époque où l’inspecteur Columbo (présumé italien) envoie tous les riches Wasp en prison. Le film évoque sèchement une atmosphère antisémite: notamment dans la maison des retraités qui servent de prête-noms au groupe d’oligarques mêlés à cette opération de confiscation des eaux (Nicholson évoque la prostration des populations en pleine sécheresse, il est donc assuré que JAMAIS NOUS NE NOUS REVEILLERONS).
C’est une des données du film noir: on dénonce un monde taré qu’on ne peut renverser (on a juste remplacé les élites Wasp, voir McDonald ou Todd). Le film réveille et rendort: on reste dans le chaos de ce quartier auquel le flic ne comprend rien, Chinatown donc, surtout quand à la fin la police abat la victime (Faye Dunaway) et laisse le méchant (le père autoritaire d’Adorno, vicieux et intouchable) s’échapper. A la même époque l’exceptionnel directeur de la photo Alonso (premier mexicain ou presque respecté à Hollywood) éclaire – c’est le cas de le dire – l’Adieu ma jolie de Mitchum (il vole la vedette au réalisateur inconnu) et confère une aura magique à ce retour de bâton historique. La crise du pétrole passe par là, les Reset à venir et le Vietnam passent facture. On est définitivement sortis de l’innocence rooseveltienne dont parlait ma prof Denise Artaud à sciences-po. Mais y eut-il jamais un âge innocent pour l’Amérique, ce pays créé par l’esprit et non par la nature, comme dit Dostoïevski dans les Possédés ? Née de la sédition, de la Traite, du refus oligarque de payer des impôts, du dieu maçonnique, de la rage de faire du fric et de nuire à l’Europe, l’Amérique n’a pas d’innocence à nous vendre. Et « son air d’innocence ne reviendra plus » (Debord) : voir l’excellent livre de Zinn. Le projet immobilier de Gaza promu par Trump et ses acolytes nous rappelle très bien ce bref passage de Tintin en Amérique : voici vingt-cinq dollars, vieil hibou ; on prend ton territoire et on construit une ville nouvelle. Quant à la vieille civilisation hispanique et catholique de Mexique ou de Californie, on la retape pour les touristes et les thésards.
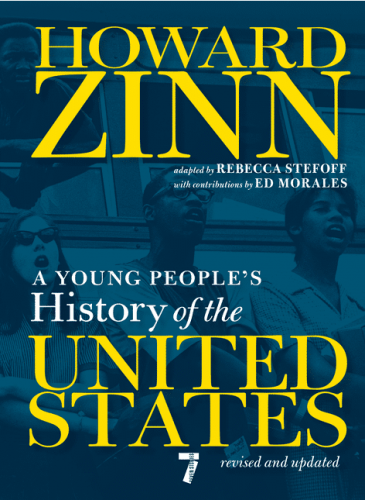
Comme dit Guillaume Faye dans son Système à tuer les peuples (c’est pourquoi l’enfant mexicain est un fantôme, les Mexicains ne reviennent que comme consommateurs obèses et péons du « cheap labor » du Donald) :
« L'humanisme apolitique, en revanche, comme tout ce qui relève de la raison égalitaire, s'avère obscène et castrateur. Los Angeles : monstrueuse verrue du bout de l'Occident, modèle de la future civilisation mondiale et californienne, où le mode de vie remplacera le politique. Rien d'étonnant, dans de telles conditions, que nous assistions à une dépolitisation de la classe politicienne bien plus, contrairement aux plaintes des politiciens qui ne connaîtront décidément jamais leur peuple, qu'à une dépolitisation de la société civile. »

C’est la Kali fournie qui dévore le monde, un peu comme l’araignée géante Ungoliant de Tolkien (voyez mon livre), qui se dévore en même temps – et sans complexes.

Le pire est que le film bien léché offre un panel d’images splendides héritées de l’Espagne coloniale ou du Spanish Revival architectural où Columbo déniche ses coupables Wasp. La beauté recyclée et muée en simulacre de Los Angeles (les annales gelées…) se retrouvera dans L. A. Confidential (film adoré par Jean Parvulesco qui me l’avait recommandé) ; Curtis Hanson explique que ce film lui fut inspiré par ce drame avec Bogart tourné dans un patio espagnol, qui montre un scénariste de cinéma massacrer et torturer son monde. Le cinéma c’est Nicholas Ray…
Venons-en à Nicholson. Dans le film il s’appelle Guittes et on nous dit que le nom fut inspiré par un ami de Jack. Je veux bien mais il se trouve que je vérifie, que Guittes veut dire divorce en hébreu et que ce détective pourchasse les maris pour obtenir de généreuses pensions : on le lui reproche pendant tout le film. Le Klein d’œil si j’ose dire est énorme ; je trouve ceci sur le site passionnant des Chabad (voir lien) :
« Parmi les lois détaillées dans la paracha de Ki Tetsé, il y a une section traitant du divorce. Le Rabbi analyse dans ce discours le concept de divorce tel qu’il s’applique entre les époux, et entre l’homme et D.ieu. Il examine certains paradoxes dans le traité talmudique sur le divorce (Guittine) et dans le nom donné, dans la loi juive, au document qui consomme la séparation. Ces paradoxes ont en commun de suggérer que bien que le divorce soit, extérieurement, une séparation, ce n’est pas là sa véritable nature. La pensée ‘hassidique, avec l’accent qu’elle met sur la découverte de l’essence de D.ieu et de l’homme, se fait devoir de percer le cœur de cette question : dans la mesure où l’essence de l’univers est l’unité de D.ieu, la séparation peut-elle être réelle et définitive ? »
Il y a bien divorce d’avec Dieu, le monde créé par le capital américain (voir Zinn, toujours) s’avérant infernal. Qui nous dit d’ailleurs que ce fantôme d’enfant que l’on voit n’a pas été emporté par les eaux ?
Sur la machine américaine à divorcer (et à déplacer l’argent finalement) je me suis rappelé ce splendide passage de Francis Parker Yockey :
« La vie familiale américaine a été profondément désintégrée par un régime déformant la culture. Dans un foyer américain classique, les parents ont en réalité moins d'autorité que les enfants. L'école, tout comme les églises, n'impose aucune discipline. La fonction de formation de l'esprit des jeunes a été abandonnée par tous au profit du cinéma. »
Todd croit que les Wasp ont été dépossédés vers 1965 ; rude erreur, car comme l’explique Yockey toujours :
« En Amérique, le mariage a été remplacé par le divorce. Ceci est dit sans intention paradoxale. Dans les grandes villes, les statistiques montrent qu'un mariage sur deux se termine par un divorce. À l'échelle nationale, ce chiffre est d'un sur trois. Cette situation ne peut plus être qualifiée de mariage, car son essence réside dans sa permanence. Le commerce du divorce est un vaste marché qui fait prospérer avocats, détectives privés et autres charlatans, et qui nuit aux valeurs spirituelles de la nation, comme en témoigne l'indifférence émotionnelle des enfants américains. »
L’enfant prostré (penser à Shining) est une constante en effet du cinéma américain et ce avant la télé et le popcorn. Yockey enfonce son clou :
« L'érotisme occidental, ancré dans la chevalerie de l'époque gothique, et l'impératif d'honneur qui en découle, hérité de siècles d'histoire occidentale, ont été bannis. L'idéal de Wedekind, le déformateur culturel qui prônait la bohème obligatoire en Europe au tournant du XXe siècle, a été réalisé par le régime déformateur culturel américain. Un puritanisme inversé a émergé. » Avec wokisme et transsexualisme au bout de la route…
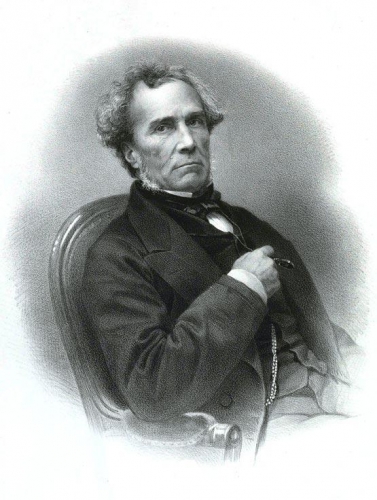
Je rappelle que le premier à avoir évoqué le problème du couple et de la famille américaine (la femme philosophe, l’homme affairiste) est Gustave de Beaumont (portrait, ci-dessus), compagnon de voyage de Tocqueville. Pour Beaumont (cité par Marx), le prêcheur américain exerce un business comme un autre. Il n’y a pas eu d’innocence américaine, et « l’Amérique n’a pas eu d’enfance mystérieuse » (voir notre texte et surtout Marie, ou de l’esclavage).

Chinatown mériterait un chapelet d’articles et sans doute un livre – comme tous les grands films de Roman Polanski. On rappellera ces lignes de Joseph Kessel, juif rebelle qui comme Stefan Zweig (qui aurait pu faire fortune à Hollywood) refuse cette américanisation du monde :
« Mais dans les plus grandes artères, il n’y a pas de passants. Les automobiles roulent, roulent sans arrêt les unes derrière les autres, comme les anneaux d'une chaîne sans fin, entre les trottoirs déserts. C'est la seule ville au monde où l'on voit les camelots vendre les journaux au milieu de la rue, aux carrefours où les signaux lumineux et les bras mécaniques arrêtent, pour quelques secondes, le flux des voitures. »
Ce monde récolte la distance (on se rapproche de Debord…) :
« Mais pour voir un ami, pour acheter un grapefruit- dans ces marchés aux piles rigoureuses qui ressemblent à des halls d'usine -, il faut faire des kilomètres et des kilomètres. »
Il ajoute :
« Vitesse, rendement, précision, correction : voilà les caractéristiques essentielles de l'existence. »
Mais ce monde va s’exporter et s’imposer rapidement. Le phénoménal Daniel Boorstin explique quelque part que la conversation mondaine tourne autour des autoroutes et du réseau routier dans les dîners mondains à L.A., mais le modèle aberrant bien sûr triomphe.
Il ne manquerait que ça.

Dans son Colloque entre Monos et Una Poe, aristocrate virginien élevé en Angleterre, se déchaîne :
« Hélas ! nous étions descendus dans les pires jours de tous nos mauvais jours. Le grand mouvement, – tel était l’argot du temps, – marchait ; perturbation morbide, morale et physique. »
Il relie très justement et scientifiquement le déclin du monde à la science:
« Prématurément amenée par des orgies de science, la décrépitude du monde approchait. C’est ce que ne voyait pas la masse de l’humanité, ou ce que, vivant goulûment, quoique sans bonheur, elle affectait de ne pas voir.
Mais, pour moi, les annales de la Terre m’avaient appris à attendre la ruine la plus complète comme prix de la plus haute civilisation. »
Quelques sources :
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2025/05/16/l...
https://fr.chabad.org/library/article_cdo/aid/3761610/jew...
https://www.dedefensa.org/article/le-feminisme-us-par-del...
https://www.amazon.fr/damnation-stars-Nicolas-Bonnal/dp/2...
https://www.boervolkradio.co.za/boeke/Imperium.pdf
https://files.libcom.org/files/A%20People%27s%20History%2...
14:34 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, film, roman polanski, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le cinéma noir et la prison de fer
Nicolas Bonnal
Encensé d’une manière ridicule depuis des décennies par la cinéphilie (une cinéphilie d’ilotes sans culture théologique ni philosophique), le cinéma noir ne peut toutefois offrir comme la plus fille du monde que ce qu’il est : un documentaire sur la pourriture du monde (allez, du monde capitaliste), sur la déchéance du héros, le nihilisme tragi-comique, la laideur industrielle (relire les pages de Tocqueville à Manchester), la rapacité féminine qui mène l’homme par le bout de son nez, les invincibles méchants et cette loi de la rue maladive et tordue qui évoque les pages inoubliables d’Edgar Poe :
– des efforts insensés furent faits pour établir une Démocratie universelle. Ce mal surgit nécessairement du mal premier : la Science. L’homme ne pouvait pas en même temps devenir savant et se soumettre. Cependant d’innombrables cités s’élevèrent, énormes et fumeuses. Les vertes feuilles se recroquevillèrent devant la chaude haleine des fourneaux. Le beau visage de la Nature fut déformé comme par les ravages de quelque dégoûtante maladie. Et il me semble, ma douce Una, que le sentiment, même assoupi, du forcé et du cherché trop loin aurait dû nous arrêter à ce point. Mais il paraît qu’en pervertissant notre goût, ou plutôt en négligeant de le cultiver dans les écoles, nous avions follement parachevé notre propre destruction.
On ne saurait être plus clair : la folle activité industrielle et commerciale américaine, bientôt dominée par des banquiers invisibles et des mafieux trop invisibles (le jeu, la drogue, le sexe, le tabac, l’alcool, les paris, etc.) ne peut déboucher que sur le désastre deviné et courageusement révélé par Walt Whitman dans ses vistas démocratiques publiées après la Guerre de Sécession. Cette dernière sonne le glas de la civilisation américaine déjà compromise par le commerce et l’immigration européenne. Poe, mais aussi Booth Tarkington (Splendeur des Amberson…) ou Walt Whitman (voir notre texte) l’ont déjà compris.

La dégoutante maladie de Poe se met en place et l’on observe avec tous les forbans de la nuit (film d’autant plus supérieur qu’il est tourné à Londres !) une civilisation maudite et malade. Nous sommes maudits, dit la blonde de King Kong (la vraie, celle de 1976, traînée dans la boue par la critique). Dick parle de prison de fer, à laquelle l’humanité n’a pu échapper malgré (à cause de, plutôt) le judéo-christianisme. L’homme judéo-chrétien et capitaliste étriqué né du protestantisme scientiste et bientôt athée est déchu non de sa nationalité mais de son ontologie. Et Tocqueville comprend longtemps avant le sinistre Grand sommeil (métaphore non de la mort mais de la vie occidentale, de l’American Way of Death) que « les petits et vains plaisirs dont ils emplissent leur âme » mènent au désespoir. Métaphore du crédit et de la dette du consommateur, la femme dite fatale se retourne contre l’homme-banquier-financier-équipementier qu’elle ruine et mène à la mort (pauvre Burt Lancaster, grand dadais mécanique dans Criss Cross et les Killers) ; dans la divine comédie de Dante, premier film noir, spendere veut dire tuer ; dépenser c’est tuer, tout comme consommation veut dire mort. D’ailleurs chez Shakespeare Mercutio se dit spent quand il est transpercé. Dépenser, s’est ne plus être. La monstruosité américaine va déteindre sur nous, n’apparaissant plus monstrueuse qu’à une mince élite, le reste se mutant en troupeau zélé de consommateurs.
L’école de Hudson et ses paysages géniaux trottent alors dans nos têtes, alors que le sujet du western consiste à faire bouger des vaches, du capital donc, d’un coin de paradis piétiné par les sabots à un autre.
Le monde est beau à voir et laid à être, a dit l’oncle Arthur.
Dans son grand opus, le formidable Francis Parker Yockey (les Américains ont les plus grands penseurs nationalistes au vingtième siècle, et ce n’est certes pas un hasard) parle admirablement des métiers parasites qui pullulent en cette Fin des Temps agonique et interminable : le mariage a été remplacé par le divorce et le détective déglingué homoncule sorti d’un cauchemar de Dostoïevski (qui envoie ses idiots et ses démons en Amérique pour se faire initier puis démolir leur Russie, voir notre livre) couche avec sa cliente, celle qui veut se débarrasser d’un riche mari pour trouver mieux à court terme. Lui-même parsème son cursus honorum de cadavres et détruit toujours plus ce qu’il prétend protéger : ce qu’on appelle une Happy End.
Le grand sommeil (le monde de l’idiot intentionnel dont parle Orson Welles au début de sa Femme de Shanghai) n’est pas terminé et mériterait sa conclusion. On arrive au monde de la science-fiction et au héros taré et désabusé de Dick, sur fond de décor noir, pluvieux, et de gabardines façon Blade runner (on cherche à fuir, mais où ? Le monde sera vie américanisé comme le Mexique, voyez The Big Steal, toujours avec Mitchum).

« Et encore une clairvoyance dickienne concernant notre présent où les socialistes et communistes regagnent le pouvoir partout dans le monde sous des formes différentes : Dick revient à sa théorie développée dans les autres romans où le camp capitaliste est égal au camp communiste et les deux amènent le même danger (ainsi le président FFF de ce roman est un communiste caché). Et encore l’image fusionnée de l’Empire et de la prison, du temps romain et du temps californien où le narrateur « sentait l’Empire, sentait une énorme prison de fer où travaillaient des esclaves », et seuls les petites figures en vêtements gris (les premiers chrétiens) résistent aux espions de l’Empire qui n’est pas disparu mais s’est caché à notre vue. »
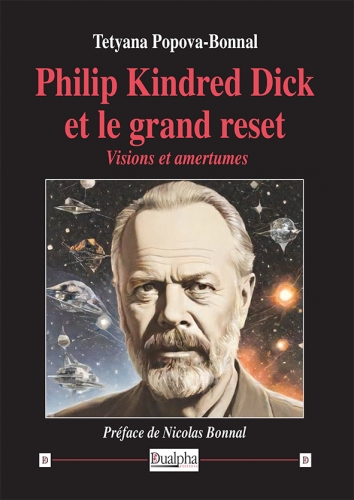
Tetyana ajoute dans son livre sur Dick :
« Infatigable Philip Dick trouve une ironie même dans cette situation de son personnage : « Maintenant il a senti sur sa propre peau qu’être un fou – à part d’être enfermé- te coûte aussi beaucoup d’argent. On t’émettra une facture pour ta folie, et si tu ne peux pas ou ne veux pas la payer – on te poursuivra en justice, et si tu n’accomplis pas la décision du juge on t’enfermera dans la prison pour offense contre le juge ». De cette manière le personnage est enfermé pas seulement dans l’Empire mais aussi dans sa prison de fer personnelle. »
On a du mal à croire au salut par le christianisme depuis longtemps fondu et confus, confondu dans cette masse gélatineuse de pouvoir et d’argent. La Sibylle de Dick annonçait un autre message, un âge d’or qu’on a raté en temps et en lieu.
Le cinéma noir et son roman annonçaient toutes sortes de grandes transformations (ou déformations, comme a dit Stockman justement, car après Eisenhower…)
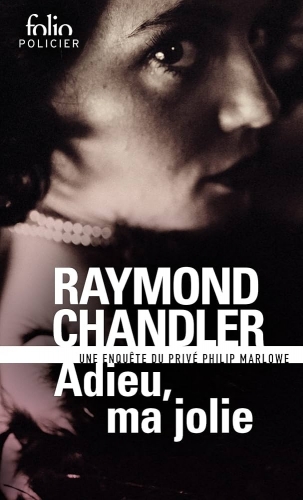
Tiens, la première phrase d’Adieu ma jolie (roman que personne n’a dû lire) :
IT WAS ONE OF THE MIXED BLOCKS over on Central Avenue, the blocks that are not yet all Negro.
On comprend pourquoi personne n’a lu le livre ; à la même époque Céline fait les mêmes observations, avec tout un tas d’Américains surpris de se voir remplacer à la vitesse de l’éclair. L’âge d’or colonial célébré par Madison Grand ou Lothrop Stoddard (cités dans Gatsby, récit à clés) est terminé.
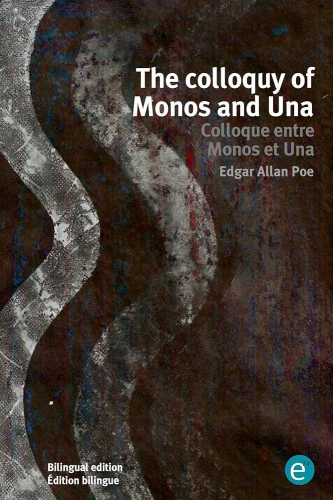
Revenons-en à Edgar Poe. C'est dans son Colloque entre Monos et Una que notre aristocrate virginien élevé en Angleterre se déchaîne :
« Hélas ! nous étions descendus dans les pires jours de tous nos mauvais jours. Le grand mouvement, – tel était l’argot du temps, – marchait ; perturbation morbide, morale et physique. »
Il relie très justement et scientifiquement le déclin du monde à la science:
« Prématurément amenée par des orgies de science, la décrépitude du monde approchait. C’est ce que ne voyait pas la masse de l’humanité, ou ce que, vivant goulûment, quoique sans bonheur, elle affectait de ne pas voir.
Mais, pour moi, les annales de la Terre m’avaient appris à attendre la ruine la plus complète comme prix de la plus haute civilisation. »
Sources:
https://www.amazon.fr/puissance-apocalyptique-Essais-foli...
https://www.amazon.fr/Philip-Kindred-Dick-grand-reset/dp/...
https://www.dedefensa.org/article/walt-whitman-et-la-maud...
https://www.dedefensa.org/article/poe-et-baudelaire-face-...
17:11 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : nicolas bonnal, cinéma, edgar a. poe, cinéma noir |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

King Kong et la profanation du monde
Nicolas Bonnal
On nous disait que le premier King Kong c’était une métaphore de la crise de 29… Et le comte Zaroff ?
Le grand King Kong c’est le deuxième, celui de Guillermin, français (d’origine) créateur de la Tour infernale, et qui pendant quelques années a réalisé des superproduction géniales qui enfoncent tous les opus contemporains de Godard et compagnie ; et ce film est essentiel pour des raisons moins liées au cinéma que prévu (de toute manière c’est fini depuis Griffith ou Orson le cinéma) : on a une époque déchue mais lucide, un peu contestataire (le personnage de Jeff Bridges) ; on a la crise du pétrole et la révolte contre l’industrie (ce que Spengler appelle dans son livre sur la technique "la nausée de la machine") ; on a la prison de fer du grand pétrolier (fantastique décor) où l’on enferme le terrible poète amoureux, et qui rappelle encore et toujours la prison de fer de Dick; on a la lucidité maladroite et sympa des personnages pas trop prétentieux et encore positifs (l’une veut être une star, l’autre plus riche, l’autre sauveur de la nature); on a John Barry, musicien primaire mais malin génie capable de vous transporter trois notes ; on a Kauai l’île magique de l’archipel, et sa plage d’Honopu, et son rocher cathédrale. On a un peu de brouillard et on a un bon tricoteur de singe. La leçon anti-spectaculaire et anticapitaliste du film (le rigolo producteur finit écrasé par son monstre, on est à une époque où l’anticapitalisme de façade, venu de Debord ou Marcuse, ne doute de rien) a vite fait long feu mais l’essentiel reste. On enlève leur singe aux indigènes, on est dans la deuxième chute d’Eliade, dans le désenchantement du monde pas très bien compris par Max Weber.

Ce film avait été moqué par la critique – mais moins par l’excellent critique et épistémologue iranien Youssef Ishagpour, qui essaie de voir au-delà d’Hollywood et ses stars. D’ailleurs c’était un film sans stars : ni la blonde (maladroite et malheureuse Jessica Lange) ni les acteurs ne sont vraiment des stars. La star c’est le singe, le sujet c’est l’amour si l’on veut, et la folie du monde moderne qui détruit le singe au lieu de l’exploiter. On n’a plus de pétrole alors on a des idées, on n’a plus d’usines alors tout devient spectacle et simulacre (le Vietnam d’Apocalypse now…). Vive Debord.
D’une certaine manière le film se termine dès que l’on retire le grand singe de son île. Les sauvages locaux, qui sont comme nos paysans de Farrebique, des êtres enracinés dans leur terre avec une relation magique au cosmos (cf. le marxiste Henri Lefebvre et ses propos sur la petite église de campagne encore ouverte dans les Fifties). Prescott explique très bien dans son anglais mesuré :
No, you're dead wrong. He was the terror, the mystery of their lives, and the magic. A year from now that will be an island full of burnt-out drunks. When we took Kong, we kidnapped their god.
Et comme on parlait de Mircea Eliade, parlons du lien entre cinoche et religion (voir Trotski aussi) :
« Tout un ouvrage serait à écrire sur les mythes de l'homme moderne, sur les mythologies camouflées dans les spectacles qu'il chérit, dans les livres qu'il lit. Le cinéma, cette « usine des rêves », reprend et utilise d'innombrables motifs mythiques : la lutte entre le Héros et le Monstre, les combats et les épreuves initiatiques, les figures et les images exemplaire (la « Jeune Fille », le « Héros », le paysage paradisiaque, I' « Enfer », etc.).»
Eliade ajoute :
« La grande majorité des «sans-religion» ne sont pas à proprement parler libérés des comportements religieux des théologies et des mythologies. »

Le King Kong de Guillermin c’est aussi la nostalgie d’un solide paradis (certes étrange) :
« Mais ce n'est pas uniquement dans les « petites religions » ou dans les mystiques politiques que l’on retrouve des comportements religieux camouflés ou dégénérés : on les reconnaît également dans des mouvements qui se proclament franchement laïques, voire antireligieux. Ainsi, dans le nudisme ou dans les mouvements pour la liberté sexuelle absolue, idéologies où l'on peut déchiffrer les traces de la « nostalgie du Paradis », le désir de réintégrer l’état édénique d'avant la chute, lors que le péché n'existait pas et qu'il n'y avait pas rupture entre les béatitudes de la chair et la conscience. »
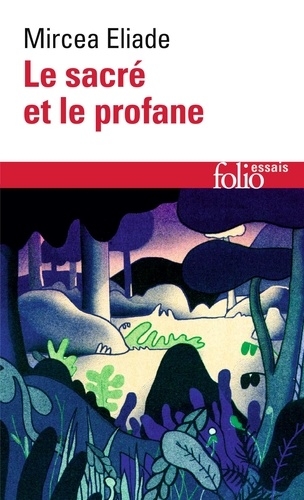
Eliade annonçait qu’on allait tomber encore plus bas (ils font des selfies devant le cadavre de leur pape) :
« La non-religion équivaut à une nouvelle« chute » de l'homme : l’homme areligieux aurait perdu la capacité de vivre consciemment la religion et donc de la comprendre et de l’assumer ; mais, dans le plus profond de son être, il en garde encore le souvenir, de même qu'après la première « chute », et bien que spirituellement aveuglé, son ancêtre, l'homme primordial, Adam, avait conservé assez d'intelligence pour lui permettre de retrouver les traces de Dieu visibles dans le Monde. Après la première « chute », la religiosité était tombée au niveau de la conscience déchirée: après la deuxième, elle est tombée plus bas encore, dans les tréfonds de l’inconscient : elle a été « oubliée ». Ici s'arrêtent les considérations de l'historien des religions. »
Sources :
Le sacré et le profane (Eliade)
https://lesakerfrancophone.fr/monseigneur-gaume-et-le-car...
Grands auteurs traditionnels contre le monde moderne (Bonnal)
19:36 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, king kong, mircea eliade, nicolas bonnal, john guillermin |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Audiard et ses tontons flingueurs contre la France moderne
Nicolas Bonnal
J’ai retitré mon livre sur la destruction de la France au cinéma en insistant sur le conflit entre le Général (penser au fameux épisode du Prisonnier rebaptisé en France) et Audiard, l’Audiard du début des années soixante. Après il baisse un peu les bras quand même. Il faut bien vivre et l’âge d’or ne dure jamais longtemps.

Chez Audiard et son antigaullisme du 18 juin il y a comme chez Kerillis la conviction qu’on est face à une énorme escroquerie qui va marcher, essentiellement (je l’ajoute), grâce à la télé, à la radio (l’appel…) et à la propagande scolaire et politique – on ne change pas une équipe qui gagne depuis mettons 1870 et Gambetta (voyez mon texte sur Gambetta et Zelenski). La cinquième république achève d’enterrer et de liquider le vieux pays encore vivant dans les films de Guitry, Pagnol ou Rouquier (Farrebique, à comparer avec l’apocalyptique Biquefarre tourné une génération après) et Audiard pense avoir saisi le truc, aussi bien dans les Tontons que dans Vive la France.
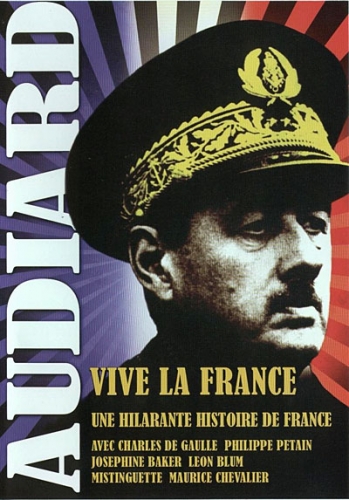
J’ai un faible pour trois opus majeurs dans l’œuvre disons polémique et politique d’Audiard : les Tontons, les Vieux de la vieille et Vive la France. Le cave ne tient pas la route en la matière malgré cette envolée de Gabin qui nous précise à quelle sauce CBDC les banquiers centraux nous mangeront. Leur kolkhoze fleuri anti-carbone aura tôt fait de nous régler notre compte. Dans les Vieux de la vieille, le trio infernal des pépés qui vont vers une EHPAD encore tenu par des bonne sœurs (au début du gaullisme il y avait encore des bonnes sœurs, quand on vous dit que le gaullisme c’est notre hyper-modernité dont d’ailleurs tous se réclament)

Et comme on parlait de Gabin :
« Pauvre con ! Le droit ! Mais dis-toi bien qu'en matière de monnaie les États ont tous les droits et les particuliers aucun !
Si les faux-monnayeurs ne peuvent plus faire confiance aux Etats...
J’aime aussi la rébellion des petits vieux combattants dans le classique du vénérable Grangier (un des plus méprisés de nos cinéastes, et ce n’est pas un hasard) d’autant que j’ai leur âge maintenant. On ne murit plus du reste, on devient un vieil adolescent et la comparaison avec Gabin ou Fresnay ne tourne pas à notre avantage. Mais on a aussi peu envie de se laisser casser les sabots comme on dit :
« JEAN GABIN : Y z'ont, y z'ont, y z'ont qu'y sont chez eux ! Pis qu'y z'ont passé l’âge de s'laisser casser les sabots par des opinions étrangères et conifiantes ! V'là c'qu'y z'ont !... »
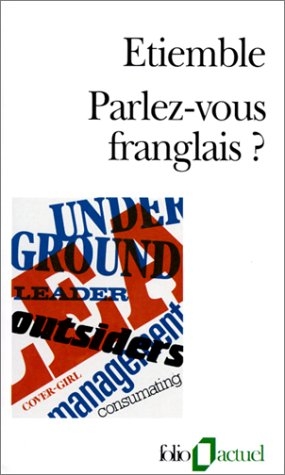 Comme on sait en France les opinions sont devenues très conifiantes et très étrangères. On relire le Parlez-vous franglais d’Etiemble (esprit peu suspect d’anarchisme de droite) publié aux débuts de l’époque gaulliste.
Comme on sait en France les opinions sont devenues très conifiantes et très étrangères. On relire le Parlez-vous franglais d’Etiemble (esprit peu suspect d’anarchisme de droite) publié aux débuts de l’époque gaulliste.
Je rappelle que le meilleur rôle de jeunesse de Gabin c’est celui de Ponce-Pilate dans l’incomparable Golgotha de Duvivier (Le Vigan y est divin, vraiment) tourné dans notre magique Algérie française et interdit de séjour en Amérique par les moghols d’Hollywood (merde, mais pourquoi donc ?).
Mais le grand moment des Vieux c’est bien sûr quand ils règlent leur compte à nos apprentis-footballeurs pas encore trous remplacés par l’Afrika Korps. Un ban pour le doublé de connard alors :
https://www.youtube.com/watch?v=aaCv5XK6i34
Audiard devait passer pour misogyne auprès de nos abrutis alors que ses femmes sont phénoménales, à commencer par François qui eut même une carrière hollywoodienne (elle est géniale en reine-mère dans Saraband for dead lovers, un des films les plus importants du monde dont une scène masquée est copiée plan par plan par Kubrick). Ses femmes sont des rebelles traditionnelles (le genre Vera Miles chez John Ford) et il ne faut pas leur marcher sur les pieds car elles ont des manières. On a la scène géante qui m’a inspiré mon livre quand Dominique Davray (géniale et triste dans Cléo de cinq à sept, qui montre en 1963 un Paris déjà crépuscule, vérolé par la bagnole cheap et le… terrorisme) explique l’arrivée de la bagnole et de la télé. Car on ne peut rien faire contre la technique et l’informatique et l’euro numérique nous boufferont comme devant.
https://www.youtube.com/watch?v=AEv9VLQegvY
On a retrouvé le texte, ce texte surhumain, évolien même, qui se suffit à lui-même :
« Chère Madame, on m’a fait état d’embarras dans votre gestion, momentanés j’espère. Souhaiteriez-vous nous fournir quelques explications?
– Des explications, Monsieur Fernand, y’en a deux : récession et manque de main d’œuvre. C’est pas que la clientèle boude, c’est qu’elle à l’esprit ailleurs. Le furtif par exemple, a complètement disparu.
– Le furtif?
– Le client qui venait en voisin. »Bonjour Mesdemoiselles, au revoir Madame »... Au lieu de descendre après le dîner y reste devant sa télé pour voir si, par hasard, y serait pas un peu l’Homme du XXème siècle ! Et l’affectueux du Dimanche? Disparu aussi! Et pourquoi? Voulez-vous me dire?
– Encore la télé?!
– L’auto, Monsieur Fernand, l’auto !
– Vous parliez aussi de pénurie de main d’œuvre ?
– Alors la Monsieur Fernand, c’est un désastre. Une bonne pensionnaire ça devient plus rare qu’une femme de ménage. Ces dames s’exportent… Le mirage africain nous fait un tort terrible. Si ça continue, elles iront à Tombouctou à la nage ! »
Comme on sait c’est plutôt Tombouctou qui est venu à la nage.
Audiard le remarque en se marrant dans Vive la France : la décolonisation a produit l’invasion de la France. On est passé dit-il de cinq à 300 restaus chinois en dix ans par exemple. Aujourd’hui ils sont cinq mille en région parisienne ; il faut dire qu’il y en a cinq mille partout, cf. Debord encore : « le tourisme, se ramène fondamentalement au loisir d'aller voir ce qui est devenu banal. »
J’aime assez aussi cette envolée de Dame Dominique :
« – J’dis pas que Louis était toujours très social, non, il avait l’esprit de droite. Quand tu parlais augmentation ou vacances, il sortait son flingue avant que t’aies fini, mais il nous a tout de même apporté à tous la sécurité. »
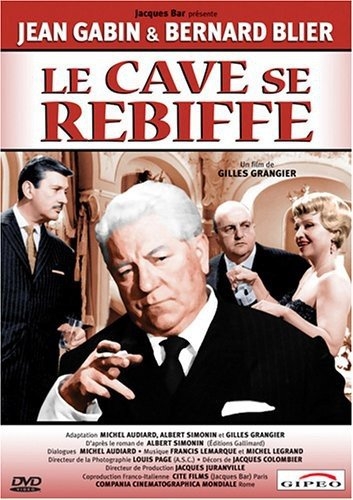
La base chez Audiard c’est la peur de l’Etat modernisé et des impôts et des interdictions de tout poil qui vont avec. Ce libertarien avait tout compris. Gabin s’est réfugié en Amérique du Sud comme on sait dans le Cave (en fait il est au Champ de courses à Cannes !), quand cette Amérique du Sud était encore une terre libre, y compris en matière sexuelle (Keyserling en personne en parle très bien quelque part). Et cela donne cette passe (sic) superbe : - Il est giron ton petit sommelier (NDLR : une superbe métisse) ! – Si tu veux, je peux te le bloquer pour la sieste !
Evidemment les Tontons marquent une défaite double : face à l’Allemand retors qui les trahit comme toujours (c’est Medvedev qui parle du retour du nazisme avec le fritz crétin-démocrate Merz) et face aux jeunes qui sont américanisés, pédantisés par les études (Molière toujours) et qui touchent au grisbi avec des mains pas propres : aujourd’hui comme on sait ces citoyens du monde numérisés ne connaissent plus le liquide.
Un petit bijou verbal du maître-lutteur Ventura :
– Patricia, mon petit, je ne voudrais pas te paraître vieux jeux et encore moins grossier…L’homme de la pampa parfois rude, reste toujours courtois… Mais la vérité m’oblige à te le dire: Ton Antoine commence à me les briser menu!

Ajoutons que la culture célinienne de Don Miguel lui interdisait tout optimisme : il avait fait tout dire à Gabin dans le Président sur l’Europe totalitaire et ploutocratique qui advenait (et ce en pleine rodomontade souverainiste gaulliste) ; et cela donne :
« Tout le monde parle de l’Europe… mais c’est sur la manière de faire cette Europe que l’on ne s’entend plus. C’est sur les principes essentiels que l’on s’oppose…
Pourquoi croyez-vous, Messieurs, que l’on demande à mon gouvernement de retirer le projet de l’Union Douanière qui constitue le premier pas vers une Fédération future ?
Parce qu’il constitue une atteinte à la souveraineté nationale ? Non pas du tout ! Simplement parce qu’un autre projet est prêt… »
Gabin ajoute pour ceux qui n’auraient pas compris :
« Si cette assemblée avait conscience de son rôle, elle repousserait cette Europe des maîtres de forges et des compagnies pétrolières. Cette Europe, qui a l’étrange particularité de vouloir se situer au-delà des mers, c’est-à-dire partout… sauf en Europe ! Car je les connais, moi, ces Européens à têtes d’explorateurs ! »
Soixante ans après ils n’ont toujours pas compris. C’est vrai que les cons ça ose tout finalement. Ça ose ne jamais rien comprendre – c’est tellement fainéant. Voir Goscinny. Je serai bien content quand Macron leur pompera quarante milliards tantôt avant de se faire réélire. Surtout les retraités, pompe-les Manu : c’est les anciens footballeurs qui accablaient les vieux guerriers d’Audiard.
Ah, ce foot, ce cyclisme pour septuagénaire harnaché comme un personnage de George Lucas…
Relisons Léon Bloy sur le sport : « Je crois fermement que le Sport est le moyen le plus sûr de produire une génération d’infirmes et de crétins malfaisants. L’examen de quelques lignes d’un journal de sport suffit pour se former une très ample conviction. Pour ce qui est de mon « sport favori » votre ignorance montre clairement que vous n’avez rien lu de moi ce qui ne peut m’étonner, le sport et la lecture étant tout à fait incompatibles. Ceux qui m’ont lu savent que l’unique sport qui m’a particulièrement séduit depuis mon adolescence est la trique sur le dos de mes contemporains et le coup de pied dans leur derrière. »
 Et comme je disais que les femmes sont des reines chez Audiard je vais citer Ginette Leclerc (photo), ex-femme du boulanger, vous savez celle qui aime le bâton de berger mais qui a (encore) peur du curé :
Et comme je disais que les femmes sont des reines chez Audiard je vais citer Ginette Leclerc (photo), ex-femme du boulanger, vous savez celle qui aime le bâton de berger mais qui a (encore) peur du curé :
« Quand ils rouvriront il sera trop tard. Tu trouveras plus personne capable de tenir convenablement une taule. T’auras du standard mais les manières seront perdues. »
Allez, on va terminer sur une note gaulliste, celle du désespoir gaulliste que nous aimons tant et que nous aimons savourer avec Debré :
« Le Général redit son analyse. Ce qui paraît le frapper le plus c’est le fait que les sociétés elles-mêmes se contestent et qu’elles n’acceptent plus de règles, qu’il s’agisse de l’Eglise, de l’Université, et qu’il subsiste uniquement le monde des affaires, dans la mesure où le monde des affaires permet de gagner de l’argent et d’avoir des revenus. Mais sinon il n’y a plus rien (p. 122). »
Je trouve qu’il a raison même si Guizot l’avait dit avant : enrichissez-vous.
Sources :
https://www.youtube.com/watch?v=aaCv5XK6i34
http://tontons.flankers.free.fr/Audiard.html
https://www.dedefensa.org/article/sur-michel-audiard-et-s...
https://www.dedefensa.org/article/la-destruction-de-la-fr...
https://www.pandoravox.com/politique/les-lecons-du-presid...
https://zonesons.com/repliques-cultes-de-comedie/phrases-...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_Davray
https://anardedroite.wordpress.com/2013/04/03/michel-audi...
https://www.amazon.fr/Audiard-antigaulliste-cin%C3%A9ma-d...
19:27 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, michel audiard, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Douglas Sirk et le génie médiéval du mélo américain
Nicolas Bonnal
Le vent du matin souffle à jamais, le poème de la création est ininterrompu ; mais rares sont les oreilles qui l’entendent.
Thoreau.
Douglas Sirk est l’auteur des plus grands mélos de l’histoire du cinéma. Né en Allemagne de parents danois, il quitte son pays, mais en 1937 seulement. Il tournera des films de toutes sortes, assez oubliés. Curieusement sa carrière, comme celle d’autres cinéastes, ne stupéfie vraiment l’amateur de grand cinéma que durant quelques années. Il s’agit de cinq à six ans, pendant les merveilleuses années Eisenhower qui sont pour moi comme un dernier rayon de soleil cinéphilique ; il s’agit donc de mélos traitant de sujets domestiques et assez féminins, avec entre autres deux acteurs fétiches, Jane Wyman, deuxième femme de Reagan, et Rock Hudson, alors au sommet de sa virile beauté et de sa fragilité cachée. Après, Sirk ne fera plus rien ou presque ; comme Hudson, Ford ou Walsh. Comme Hitchcock ou comme Hawks vieillissant. La fin d’Eisenhower, c’est la fin du cinéma doré américain.
Les histoires de Sirk sont toujours banales. Si ce n’est pas lui qui les dirige, cela donne un navet dans le cadre des remakes de Fassbinder ou plus près de nous, Ozon. Le monde est fait de gens normaux, il est à l’eau de rose, la femme est veuve ou souffre fort, on a des confidentes frustrées, des milliardaires égoïstes et obsédés d’horreur sportive, des filles de riches nymphomanes, des fils de riches alcooliques, tout un tas de trivialités depuis longtemps recyclées dans les soaps et les feuilletons les plus usés et fatigants.

Mais la trivialité n’est qu’apparente. Sirk est un génie chrétien du cinéma, au sens ou le christianisme et surtout l’Évangile, qui, pour sauver nos âmes de haute lutte, transfigure la réalité domestique d’une situation, les noces de Cana, l’Annonciation, la prestation de soins, etc. Sirk aussi impose un cinéma décalé de rédemption. Voyez Hudson passer du rôle d’ennuyeux sportsman à celui de grand médecin dans l’Obsession. Si l’on devait résumer ce cinéma de splendeur de l’âme humaine et de transcendance polychromique, festival goethéen et gothique de la magie des couleurs en cinémascope, on devrait alors parler la phrase imperturbable de Thoreau :
Ce qu’il faut aux hommes, ce n’est pas quelque chose avec quoi faire, mais quelque chose à faire, ou plutôt quelque chose à être.
Cette recherche, ce quelque chose à être, est le fait des auteurs qui ont inspiré Sirk ; l’un, celui qui a écrit la surprenante obsession magnifique, était un pasteur luthérien dans l’Amérique profonde. Le film a d’ailleurs été filmé deux fois, comme l’autre plus grand mélo du cinéma américain, Elle et lui, de l’immense irlandais catholique McCarey.

La beauté de la Création célébrée par Sirk passe par un sensationnel traitement des couleurs (génial Russell Metty, primé aux oscars, mais pour Spartacus), digne d’un vitrail de cathédrale ou des maîtres allemands Dürer et Altdorfer, par une musicalité géniale parfois inspirée de Chopin ou du romantisme allemand, par aussi un montage aérien, et par une direction d’acteurs merveilleuse de sensibilité, de délicatesse et de dureté.

Vous croyez avoir vu un type arriver en voiture. Pourtant, voyez le début d’Écrit sur du vent, avec un Robert Stack bourré arrivant pétaradant au milieu des derricks de pétrole expressionnistes et violets dans un roadster jaune qui humilie tout ce qui se fait maintenant. Là, vous découvrez, là vous voyez enfin ce que peut être, ce que doit être le cinéma ; une flamboyance. Il y a la même différence entre un film actuel et le cinéma de Sirk qu’entre le parking d’un centre commercial et la cathédrale de Reims. C’est pourtant de l’architecture dans les deux cas. Sirk nous révèle la réalité oubliée sous la médiocrité.

Je donnerais donc à voir seulement trois films, la sainte trinité des films mélodramatiques, Obsession magnifique, Écrit sur du vent et bien sûr Tout ce que le ciel permet. Le jardinier Hudson inspiré par Thoreau ramène à la vie une veuve (Jane Wyman, épouse Reagan pour un temps) qui va être tuée par son milieu affairiste et sa… télévision présentée comme l’outil de compagnie pour la femme veuve et surtout divorcée. Sirk avait tout prévu – comme Tex Avery !
Le film procède lentement, même s’il est court ; tous les chefs d’œuvre sont à la fois inépuisables et brefs. Il est un conte parfait. La solitude ; la déclaration d’amour ; l’amour impossible ; la réconciliation. Les arbres symboliques ont ici leur rôle et c’est Rock Hudson qui explique leur symbolisme. L’amour qui vient est d’une pureté totale. Il défie la société mais dans un sens chrétien, pas dans le sens mondain et luciférien d’aujourd’hui. Faire du fric en montrant du sexe est si simple ; mais inspirer l’humain en révélant son âme ?
C’est la splendeur, c’est le joyau du cinéma, à voir trois mille fois dans sa vie au lieu de rester planté et connecté trente mille heures durant devant n’importe quoi. Godard a très bien parlé de Sirk et de son médiévalisme, et il a raison.
Car Douglas Sirk, c’est la révélation médiévale au cinéma. En voyant Sirk, aurait dit Philip K. Dick, vous saurez si vous êtes vivant ou si vous êtes mort… c’est le mélo, disais-je, comme évangile de la réalité moderne.
12:32 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fouglas sirk, cinéma, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Quand Hollywood fait la chasse au comte Zaroff
Nicolas Bonnal
J’ai repris ma version de 2016 pour établir ce texte, dont j’avais écrit une première version bien avant. Je reconnais qu’en matière de russophobie, depuis, l’élève européen a dépassé le maître (l’Amérique, toujours, plus russophile avec les républicains pour des raisons établies par Todd)….
Je crois de plus en plus à une montée de la tension russo-américaine pour l’année prochaine, qui pourrait déboucher sur une catastrophe. C’est comme pour les produits dérivés ; on ne s’arrêtera pas en si bon chemin, et c’est Hollywood qui va nous éclairer à ce propos.

Dans les années 80 et 90, Hollywood envoyait Schwarzenegger égorger des latinos en Amérique centrale ou du sud (Commando, Predator, Collateral Damage) ; ou bien, quand on avait moins d’argent, on envoyait Chuck Norris. Dans les années 90, alors que l’on prépare l’opinion aux attentats du 11 septembre et aux guerres qui s’ensuivent, on ne cesse de montrer au public des films consacrés au terrorisme islamiste. Enfin, dans les années trente, pour remonter le cours du temps, les épisodes de Buck Rogers nous initiaient au péril jaune.
Chaque fois, des guerres ont bien eu lieu. En Asie bien sûr (Japon, Corée, Vietnam et tout le reste). En Amérique centrale, en Colombie (300.000 morts tout de même), au Moyen-Orient où elles ne cessent pas, et ne cesseront peut-être jamais. Et ce que nous voyons aujourd’hui, c’est que la pression antirusse ne cesse de monter du côté de Los Angeles.

Dans les années 80, on avait eu Rambo 2 et 3, la délirante Aube rouge, qui voyait une invasion russo-cubaine des USA. L'invasion latino a bien eu lieu, mais sous forme de réfugiés économiques.

Il y a toujours eu pléthore de films antirusses à Hollywood, et il est bon de noter que ces films antirusses étaient rarement anticommunistes : sous Roosevelt le cinéma fut même pro-stalinien. Je me souviens d’une comédie, Jet Pilot, de von Sternberg, datant d’après d’ailleurs, narrant le mariage d’une belle pilote stalinienne avec John Wayne ! Sous Reagan aussi, Le Quatrième Protocole (1987), Double Détente (1988) ou Gorky Park (1983) ne marquaient pas, c’est le moins qu’on puisse dire, un anticommunisme viscéral. On peut rappeler aussi la Belle de Moscou qui voit Fred Astaire séduire Cyd Charisse avec son soft power. Et je ne cite pas Reds de Warren Beatty oscarisé en 1981 pour son catéchisme bolcheviste (c’est à croire que l’on attendait avec impatience la nationalisation de toutes les banques et de toutes les dettes…).
Les grands cinéastes anticommunistes comme Mervin Le Roy, l’immense McCarey ou même Kazan ont même été diabolisés ou sciemment oubliés depuis, à l’instar de Joe McCarthy.

Les films hollywoodiens étaient plutôt antirusses, et marquaient une haine antirusse civilisationnelle, essentiellement tsariste et orthodoxe. L’Amérique comme l’Angleterre de Palmerston au 19ème siècle poursuivait la lutte de la périphérie océanique contre le pays-continent, que l’on symbolisait par le conflit de l’ours et de la baleine. L’Angleterre réussit à entraîner la France de Louis-Napoléon dans son irréelle guerre de Crimée (la charge de la brigade légère). Disraeli voulait une guerre contre la Russie en 1878, pour protéger l'empire ottoman, et l’obsession anglo-saxonne était d’empêcher la Russie d’avoir accès aux mers chaudes ou bien de se rapprocher des Indes (la thématique de McKinder). C’est une belle espionne russe qui aide Mohammed Khan à capturer les Trois lanciers du Bengale dans le film éponyme (par ailleurs œuvre préférée d’Adolf Hitler, qui s’y connaissait en racisme antirusse). Kim avec Errol Flynn tacle aussi la Russie (elle envahit l'Inde!). Le Kipling sur l'homme qui voulut être roi est aussi antirusse (le "grand jeu"…), mais pas la belle adaptation de John Huston. On pourra aussi citer Capitaine sans peur, de Raoul Walsh où un fougueux Gregory Peck se fait fouetter par un noble russe, dont il a séduit la fiancée... Encore un marin contre un terrien. Le film tourne autour de l'Alaska que le tsar Alexandre II vendit pour une bouchée de pain. Et dire qu'Alexandre aurait pu aider l'Angleterre et la France impériale à soutenir le Sud sécessionniste…

Mais c’est le légendaire comte Zaroff (avatar de King Kong finalement) qui synthétise tous les préjugés antirusses : c’est évidemment un russe blanc, un aristocrate ; il adore chasser ; il est cruel et entouré de moujiks sordides ; et il se lance dans des chasses sadiques après avoir coulé les navires des riches yachtmen qui croisent près de son île mélanésienne. Rappelons qu’Hollywood ne dénoncera presque jamais le bolchévisme : McCarthy a essayé d’expliquer pourquoi, on a vu comment il a fini dans la fosse à purin, plus bas qu’Hitler ou presque.
Trente ans plus tard, Kubrick le russophile (voyez mon livre sur Kubrick aux éditions Dualpha) se moque un peu du racisme antirusse dans son Docteur Folamour : pour le général xénophobe qui pousse le président à une guerre totale, les Russes sont un « tas de moujiks ignorants ». Mais l’ambassadeur soviétique ne s’illustre pas par sa bonne conduite dans la War Room où il ne faut pas se battre... Dans 2001 les savants russes sont du reste des savants trompés par une conspiration américaine !

Comme je l’ai dit déjà, il y eut une baisse de régime antirusse sous le regretté Ronald Reagan : les républicains sont devenus moins hostiles aux Russes depuis Nixon que les démocrates, ce n’est pas difficile... Et puis l’implosion du communisme, mauvais service rendu aux Anglo-Saxons (il a libéré les forces vives de la Chine, de la Russie et même de l’Inde), fait qu’en 1997 Simon Templar alias Le Saint va combattre un « oligarque ultranationaliste » qui risque de nous priver de pétrole et de liberté. A la même époque les oligarques apatrides enrichis sous l'ère Eltsine sont déjà tous à Londres ou à Megève... La même année Air Force One nous décrit l’assaut de l’avion présidentiel américain par un groupe de terroristes nationalistes. Le sulfureux Gary Oldman peut exposer son point de vue de méchant, d’ailleurs parfaitement justifié.

Il faut attendre dix ans pour voir une nuée de films antirusses déferler sur nos écrans : Les Promesses de l’Ombre, de Cronenberg, La Nuit nous appartient, X-Files de Chris Carter. La russophobie revient avec le regain russe, comme le dit Todd dans son Après l'Empire. A chaque fois, on n’y va pas de main morte : les Russes sont des cannibales, des racistes abrutis, des trafiquants de cocaïne, ou des mafieux pathétiques qui contrôlent tout ce qui se fait du mal dans le monde (Equalizer)... Pis encore, ils vont aussi à l’église et ont l’esprit de famille...
C’est eux, et non pas d’autres, qui organisent la nouvelle traite des blanches. On se croirait au temps du terrible Ivan Grozny !
Menacent-ils la sécurité des Etats-Unis, qui aujourd’hui peut être menacée n’importe où ? Oui, pour Charlie’s Wars, écrit par Aaron Sorkin et réalisé l’an dernier par Mike Nichols, qui montre comment les Etats-Unis ont équipé les talibans pour abattre les hélicoptères de l’armée rouge. S’agit-il d’une répétition ?
La russophobie en Amérique est ancienne. On demandera à Tocqueville de la justifier, ce qu'il fait nûment à la fin du tome premier de sa Démocratie :
« Il y a aujourd'hui sur la terre deux grands peuples qui, partis de points différents, semblent s'avancer vers le même but: ce sont les Russes et les Anglo-Américains. Tous deux ont grandi dans l'obscurité; et tandis que les regards des hommes étaient occupés ailleurs, ils se sont placés tout à coup au premier rang des nations, et le monde a appris presque en même temps leur naissance et leur grandeur. »
Sources :
https://www.dedefensa.org/article/emmanuel-todd-et-le-con...
https://www.dedefensa.org/article/kubrick-et-la-question-...
https://www.dedefensa.org/article/kubrick-et-la-demence-d...
https://www.dedefensa.org/article/kubrick-et-polanski-con...
https://www.revuemethode.org/sf111630.html
12:13 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, cinéma, cinéma américain, hollywood |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
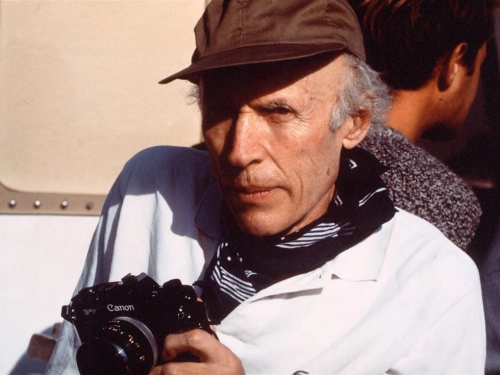
Rencontre d’Éric Rohmer et de Jean Parvulesco
Nicolas Bonnal
Jean Parvulesco a traversé l’âge doré du cinéma français (les années soixante et soixante-dix donc) comme un agent secret et un grand initié discret. Tous ces maîtres plus ou moins célébrés et reconnus réveillèrent une France cinématographique endormie par l’académisme de l’après-guerre (Lourcelles…) et l’Amérique. Et c’est elle qui se mit à inspirer l’Amérique, le tout grâce à un savant et pétillant mélange d’avant-gardisme et d’esprit réactionnaire (voyez notre texte sur la nouvelle vague). La France sous coupe réglée technocratique commençait à disparaître mais il restait quelque chose à anéantir encore. Cet heureux temps n’est plus.

Jean me disait que l’autre lui devait tout, lui et bien d’autres encore. Il est clair en tout cas qu’ils ne surent ou ne voulurent pas l’utiliser, et que celui qui eût mieux pu le révéler était Rivette, et son obsession pour les conspirations et les mondes secrets. Toujours est-il que personne ou presque n’a vu Rivette et qu’en Amérique du sud j’ai pu voir ou revoir dans les Alliances françaises (que ce mot fait vétuste…) tous les Rohmer qui, en tant qu’ancien prof, avait bien su se faire distribuer. Il y avait d’un côté l’élitisme discret, de l’autre, cette popularité de festival, qui s’interrompit le jour où notre courageux géant régla son compte à notre Révolution dans l’Anglaise et le duc. Là les yeux de certains se dessillèrent et on tempêta contre l’intrus qui remettait en cause l’essentiel : la dictature culturelle de la gauche caviar.

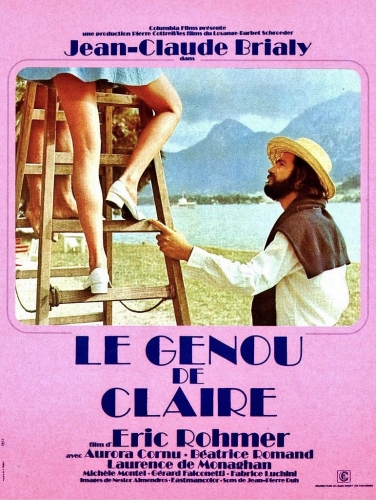

Envoutant et petit-bourgeois (je le dis presque élogieusement), le cinéma d’Éric Rohmer a célébré la terre de France comme personne, arpentant souvent du reste des lieux que je connaissais (que nous connaissions tous) enfant, quand ils n’étaient pas encore trop profanés (car le temps de Farrebique est loin…) : on eut le lac d’Annecy dans le Genou de Claire, le jardin des Buttes-Chaumont dans la Femme de l’aviateur, le coin de Ramatuelle dans la Collectionneuse, la région de Clermont dans ma Nuit chez Maud, plus grise et sinistre, encore industrielle. N’oublions pas Dinard et Saint-Malo dans Pauline ou le Conte d’été, le meilleur de la série.

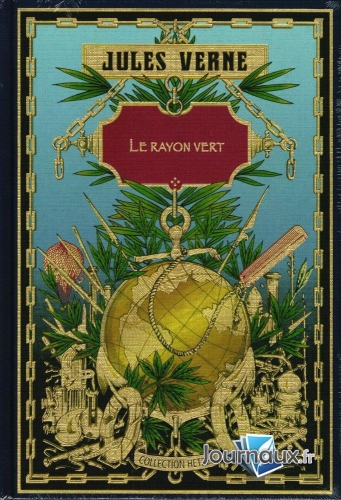
Rohmer a le mieux exprimé son lien avec les paysages et la géographie sacrée, façon Jean Phaure, dans le Rayon vert, tourné au pays basque et à Biarritz. J’avais lu le roman initiatique et voyageur de Jules Verne grâce à Gilbert Lamy et remis mon exemplaire à Jean, qui ne l’avait pas connu jusque-là. Ce film montre admirablement le basculement enchanteur de la dépression, du monde qui ne signifie rien, à celui de la géographie magique et du sixième sens amoureux.
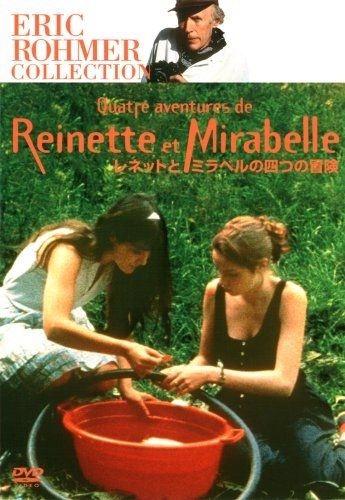
Éric Rohmer essayait de se protéger en protégeant la France avec sa caméra : c’est là que l’on redécouvre Reinette et Mirabelle, l’Arbre, le Maire et la Médiathèque, qui narre la lutte de l’inévitable Lucchini contre la mégalomanie bâtisseuse des années Mitterrand. Dans ce film de résistance politique, on découvre Parvulesco s’entretenant sur le « grand initié » qui se situe « dans ma dialectique à la droite de l’extrême-droite ». C’est vrai que depuis le départ de Mitterrand on a senti une accélération du processus de désintégration ontologique et physique de la France : effets de la construction européenne et du départ de ce bienveillant protecteur qui entretenait aussi une relation magique et tellurique avec sa terre.

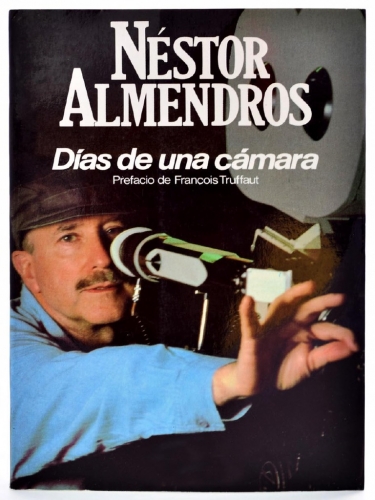
Le cinéma de Rohmer avait une dimension magique et tellurique, presque initiatique. On le comprenait par la beauté des images de Nestor Almendros (photo) qui malheureusement se sépara du maître au cours des années 80. La splendeur des images de Perceval (plus grande entreprise cinématographique de l’époque avec Apocalypse now, avait dit Joël Magny), de Claire et de l’incroyable Marquise d’Ô en témoignent. Dans son beau livre de mémoires Almendros, artiste hispano-cubain promis à un bel oscar pour le meilleur Malik, raconte que même le directeur de la photo de Kubrick, John Alcott en personne, lui avait demandé comment il s’y était pris pour ses fameux (mais moins que ceux de Barry Lyndon) éclairages à la bougie ; et on se prend comme Jünger à regretter Soixante-dix qui s’efface. Epoque libre, libertaire, païenne, aventurière (ô les Odyssées de Schroeder, autre ami de Parvulesco)…, les Seventies nostalgiques souvent et rebelles toujours se révèlent comme notre préhistoire maintenant. En marge du cinéma libre et des grands westerns révisionnistes, C’est THX 1138, Woody et les robots ou Roller Ball qui ont triomphé, et bientôt Soleil vert.

La décennie soixante-dix, c’est aussi l’époque de Tarkovski cet autre maître traditionnel perdu dans l’entropie du système soviétique agonisant (et tolérant, finalement, comme je l’ai montré dans mon livre sur le folklore dans le cinéma soviétique). Le grand cinéma d’auteur européen disparaissait, qui avait génialement suppléé à l’effondrement de la Tradition : revoyez dans ce sens l’abominable début du Ginger et Fred de Fellini qui montre que l’Italie a disparu comme ça, en quelques années, au début des années 80. Fini son cinéma aussi comme on sait.

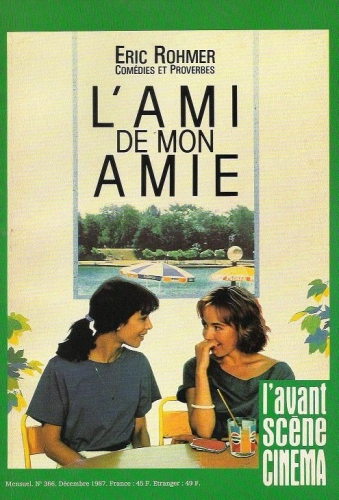
Rohmer n’était pas un pleurnichard et, lui, il a tenu bon en célébrant jusqu’à la fin (j’allais écrire la faim) le vieux Paris, les villes nouvelles pour jeunes enracinés (L’ami de mon amie), les avanies de nos territoires protocolaires. C’est là que son ami Paul Virilio écrivit :
« Je considère qu’après la dissuasion militaire (Est-Ouest), qui a duré une quarantaine d’années, nous sommes entrés, avec la mondialisation, dans l’ère d’une dissuasion civile, c’est-à-dire globale. D’où les interdits si nombreux qui se multiplient aujourd’hui (exemples : un des acteurs de La Cage aux folles déclarant qu’aujourd’hui on ne pourrait plus tourner ce film ; ou mon ami Éric Rohmer à qui son film, L’Astrée, a valu un procès, un président de conseil régional l’attaquant pour avoir déclaré que L’Astrée — le film — n’a pu être tourné sur les lieux du récit engloutis par l’urbanisation, tu te rends compte ?). Donc je suis très sensible au fait que nous sommes des Dissuadés. »
Que le pauvre Rohmer ait été poursuivi pour avoir simplement déclaré que nous avions saccagé ou fait disparaître nos paysages est finalement un hommage rendu à sa grandeur et à son courage.
Pour le reste il faut aussi comprendre qu’il est trop tard pour s’adonner à la pleurnicherie nostalgique. Nous sommes trop avancés dans le néant pour ça, en France ou ailleurs.
Si j’avais un moment de Rohmer à recommander, pour terminer sur une note plus sereine, ce serait l’Heure bleue. C’est l’heure la plus silencieuse de Zarathoustra mise à portée des jeunes filles en fleur, ou le coin où l’espace et le temps se touchent, comme dit Guénon en évoquant Wagner.
Sources:
https://www.dedefensa.org/article/paul-virilio-et-lere-de...
https://www.dedefensa.org/article/parvulesco-et-le-secret...
https://www.dedefensa.org/article/nouvelle-celebration-de...
11:16 Publié dans Cinéma, Film, Jean Parvulesco | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : eric rohmer, jean parvulesco, cinéma, film, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Tombeau hindou: Fritz Lang et le masque populaire
Nicolas Bonnal
Plus grand cinéaste de l’Histoire, Fritz Lang n’aura ni perdu son temps ni son aura. Il vole la vedette aux acteurs (excellent Jack Palance tout de même) et au gentil disciple Godard dans le Mépris, où il devient notre Homère, citant Brecht et Hölderlin au passage. Quelques années auparavant il avait commis son opus magnum, le doublé Tigre du Bengale-Tombeau hindou qui est un film à la fois testamentaire et originel. Le cinéma peut mourir en Europe (télé, abrutissement consumérisme, gauchisme culturel, nihilisme institutionnel, etc.) mais il a montré qu’il est toujours là, proche de ses racines et de son enfance nietzschéenne. Que les dieux se retirent n’a rien de surprenant : Hölderlin nous prévint lui-même dans son poème Pain et Vin.

Je recommande de voir muet le Tombeau hindou tourné dans un Udaipur (que j’ai vu en 1988) solaire et encore épargné par le tourisme du retraité. On a des tombeaux, des palais, des passages, des portes qui s’ouvrent et qui se ferment, des corridors et des labyrinthes. Jamais le maître de la matrice cinématographique qu’est Lang ne s’est autant amusé même si ses jeux (cf. la Femme au portrait…) sont toujours impitoyables.


Le monde est un labyrinthe bourré de lépreux (les vrais possesseurs du souterrain dostoïevskien) et de Minotaures. Le montage, la lumière, le rythme, le mouvement des personnages est prodigieux. On a comme protagonistes l’athlète germanique, petit-fils du Siegfried du Maître, et on a la danseuse cosmique consacrée à la déesse mais éperdue d’amour pour son sauveur (et pas pour son prince). Deux tigres sont en lice. La danseuse hindoue est jouée par la merveilleuse Debra Paget (photo - souvent une indienne de western) et sa servante martyre par une future James Bond girl, l’italienne Luciana Paluzzi, qui tombe victime de la barbarie d’un maître dévoré de passions (les tigres, le sexe, la cruauté) et qui n’a pas encore appris à renoncer : il le fera à la fin se consacrant à son gourou.

La beauté sacerdotale et guerrière de la langue allemande dans ce film phénoménal est d’ailleurs à souligner. La langue de Goethe devient védique. La magie solaire de l’Inde est telle, et le petit peuple encore si épargné qu’on se croirait au temps des pharaons. Rappelons que le James Bond Octopussy fut aussi tourné à Udaipur (photo) vingt ans plus tard, avec dans le rôle du « maharadjah » l’impeccable et froid Louis Jourdan. Mais déjà le monde solaire prenait l’eau.


Il se trouve aussi qu’après la trop longue parenthèse hollywoodienne Fritz Lang avait retrouvé sa terre allemande et sa scénariste préférée Théa von Harbou (photo) cette femme géniale avec qui il a conçu tous les chefs-d’œuvre des années vingt, les Mabuse, Metropolis et autres Espions, film sans doute le plus parfait de Lang comme le pensait le connaisseur Claude Chabrol.
Fritz Lang fut d’une certaine façon le concepteur du Blofeld d’Ian Fleming comme les Français qui créèrent Fantômas. Le monde moderne ne peut qu’avoir été conçu par un génie du mal et ce n’est pas un hasard (voyez mon livre) si les grands écrivains populaires de l’époque ont tous basculé, de Jack London à Chesterton en passant par Gustave Le Rouge, dans la théorie de la conspiration, à l’heure où les « 300 » businessmen de Rathenau mènent comme aujourd’hui, sous la houlette de leurs banquiers (découvrez David Starr Jordan et l’incroyable Empire invisible), le monde des machines à l’abattoir de la guerre et à la fatidique apocalypse numérique.
Le vrai génie de Lang est donc populaire: dans ses deux films on a un costaud, une danseuse magique, un maharadjah trop soumis à l’émotivité de sa caste (autorité spirituelle et pouvoir temporel…), on a la vieille Inde encore vivante, le monde moderne débarquant, on a les tigres, l’amour, l’aventure, le conflit entre modernité et Tradition (et cela se fait et se montre sans rire), on a le crépuscule du kshatriya ; comme le remarque Daniélou dans ses somptueuses Mémoires (voyez mon texte), l’Inde traditionnelle penche du côté fasciste pendant la guerre, car elle est dans le camp anticolonialiste d’abord, et dans celui de la caste des guerriers ensuite.

Mais chez Lang rien de tout cela : le vieil ordre doit disparaitre, et les tigres finiront au cirque ou au zoo. Le monde désenchanté de Max Weber triomphe et, pour reprendre la merveilleuse remarque de Freud, le narcissisme psychique des uns perd face à la protestation véhémente de la réalité… Espérons que notre nouvel ordre mondial finira de même, sauf que l’ordinateur fera moins de cadeaux que l’humain. Mais bon, même Kubrick nous a donné un peu d’espoir dans 2001…
On a dit du bien du cinéma populaire et de ses engagements initiatiques. C’est du reste le premier chapitre de notre livre sur le Paganisme au cinéma. Tout est déjà chez Homère et Virgile, sans compter Ovide. Deux mille ans après James Bond et un certain nombre (pas tous…) de superhéros recyclent et entretiennent le rêve et son cheminement ténébreux. Il faut bien contrebalancer la banalité de la vie ordinaire.
Guénon a dit : « il arrive aussi que celui que nous pouvons appeler indifféremment « vulgaire » ou « populaire » (car ces deux mots sont à peu près synonymes au fond) serve à lui seul de « masque » initiatique ; nous voulons dire par là que les initiés, et spécialement ceux des ordres les plus élevés, se dissimulent volontiers parmi le peuple, faisant en sorte de ne s’en distinguer en rien extérieurement. »

J’ai évoqué dans mon texte sur la prostration et le meurtre du cinéma européen par la classe moyenne, le snobisme culturel, le nihilisme déconstructeur et les festivals. Tolstoï dans son maître-essai sur l’art revient aux textes de sa gesse bibliques, aux prophètes, aux poètes primordiaux, aux contes de fées et folkloriques. Il assassine l’enseignement de l’art et les festivals (comme on sait, sa cible favorite est… Wagner) et il a raison car cela tue la littérature à l’époque comme cela tuera le cinéma : l’art qui se saisit comme essence et comme science s’assassine tout simplement. Relire Schiller et ses lettres sur l’éducation esthétique.
Guénon (qui lui-même devenu un jour à la mode, a été tué par les guénoniens) ajoute, toujours dans Initiation et réalisation spirituelle :
«... c’est du peuple qu’il s’agit toujours en pareil cas, et non point de ce qu’on est convenu d’appeler en Occident la « classe moyenne », ou de ce qui y correspond plus ou moins exactement ailleurs ; et il en est ainsi à tel point que, dans les pays de tradition islamique, on dit que, lorsqu’un Qutb doit se manifester parmi les hommes ordinaires, il revêt souvent l’apparence d’un mendiant ou d’un marchand ambulant. »
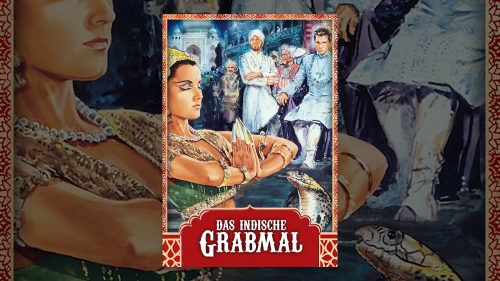
Le peuple est détenteur d’une puissance initiatique (Bernanos pense de même), et c’est pourquoi sans doute la classe moyenne (elle est menacée par les mondialistes ? Tu parles !) tente de le liquider partout et par tous les moyens via ses partis chrétiens-démocrates et sociaux-démocrates et sa sous-culture festivalière) :
« …et c’est là en somme l’origine réelle et la vraie raison d’être de tout « folklore », et notamment des prétendus « contes populaires ». Mais, pourra-t-on se demander, comment se fait-il que ce soit dans ce milieu, que certains désignent volontiers et péjorativement comme le « bas peuple », que l’élite, et même la plus haute partie de l’élite, dont il est en quelque sorte tout le contraire, puisse trouver son meilleur refuge, soit pour elle-même, soit pour les vérités dont elle est la détentrice normale ? Il semble qu’il y ait là quelque chose de paradoxal, sinon même de contradictoire ; mais nous allons voir qu’il n’en est rien en réalité. »
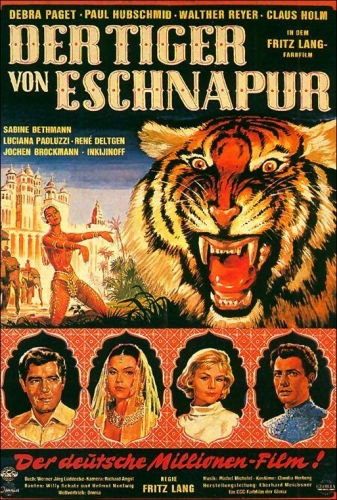
Certes la sous-culture savante (un sot savant est plus sot qu’un sot ignorant a même reconnu notre drôle de contre-initié Molière…) peut polluer toutes les sources populaires et ne se prive pas de la faire. Mais il reste toujours quelque chose.
Revenons au Tombeau hindou : dehors il y a la jungle avec son tigre, ou le désert avec sa soif (dirait Haddock…) ; dedans il y a le labyrinthe avec son maharadjah fou, ses crocodiles cachés, ses inondations (cf. la fin de Metropolis où l’oligarchie tente comme toujours de NOYER LE PEUPLE), et Varoufakis a très bien parlé du minotaure européen. Entre les deux il y a, il y aurait le pueblo (génial mot espagnol qui recouvre les deux notions) et qui tente d’échapper à Babel comme à la barbarie. Le superhéros de Lang (joué par l’acteur suisse Hubschmid (photo, ci-dessous) et des acteurs venus du merveilleux cinéma Heimat allemand comme la blonde solaire Sabine Bethmann - photo ci-dessous) semble seul capable de triompher des deux mondes.


Lang a réalisé un dernier film sur Mabuse qui consacre l’entrée de nos sociétés de surveillance: Les mille yeux du docteur Mabuse. On est revenu à force de technologie (Dédale créateur du labyrinthe et des automates) aux pièges étudiés par le paganisme le plus savant.

Terminons sur le cinéma. La parole est à Céline, Maître du Voyage en Amérique :
« Alors les rêves montent dans la nuit pour aller s’embraser au mirage de la lumière qui bouge. Ce n’est pas tout à fait vivant ce qui se passe sur les écrans, il reste dedans une grande place trouble, pour les pauvres, pour les rêves et pour les morts. »
Sources principales :
INITIATION ET RÉALISATION SPIRITUELLE- Chapitre XXVIII LE MASQUE « POPULAIRE »
https://en.wikipedia.org/wiki/Debra_Paget
https://ekladata.com/BuhIzMo2QTOKHvt8wfMzuCLkSLY/Init.-Re...
http://www.dougashford.info/wordpress/wp-content/uploads/...
https://www.amazon.fr/Une-br%C3%A8ve-histoire-paganismes-...
https://www.amazon.fr/GUENON-BERNANOS-GILETS-JAUNES-Nicol...
https://www.amazon.fr/CINEMAS-JAPONAIS-ALLEMAND-VISION-MY...
https://www.amazon.fr/GOETHE-GRANDS-ESPRITS-ALLEMANDS-MOD...
17:44 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (4) | Tags : cinéma, film, fritz lang, nicolas bonnal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
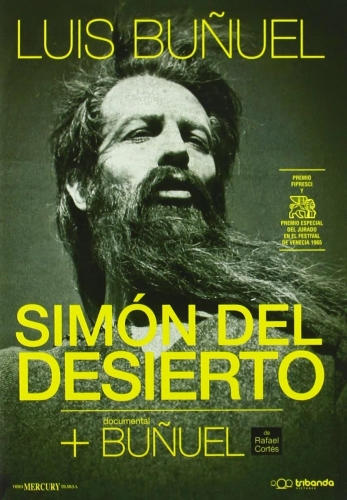
1965: Simon du désert et la fin du catholicisme
Nicolas Bonnal
1965 : on est dans la décennie qui a tout brisé, celle des Beatles et de BB, du gaullisme et de mai 68, de la télé et de la libération sexuelle, de l’Europe et des Trente Glorieuses, du gauchisme outrancier et du krach chrétien et familial. La société devient enfin surréaliste et refuse les « tiroirs du cerveau » du vieux Breton ou de Marcuse, tout en préparant à long terme un totalitarisme néo, plus informaticien et vicieux que l’ancien.
Debord (cité par mon ami Christophe Bourseiller dans sa bio plantureuse) parle « du processus de formation d’une société totalitaire cybernétisée à l’échelle planétaire ». Le fait est que quand on commence à interdire d’interdire on commence par une interdiction, et on va interdire tout ce qui interdisait peu ou prou comme on dit quelque chose : la famille, le sexe, la religion, l’Etat, la nation, tout sauf l’interdiction. On entre dans la société du numéro deux Keir Starmer et du Prisonnier de McGoohan. Ce dernier illustre le propos situ : l’insatisfaction devient une marchandise – et sera traitée comme telle, et la révolte ne peut être que formelle, entre deux enjeux dérisoires (IE les élections). Ergo à chaque évasion on revient avec notre numéro six bien-aimé et têtu au point de départ dans le quartier de Westminster : ici l’ombre !

Les années soixante c’est aussi le progressif triomphe israélien, l’idiotisme voyageur, le déclin terminal du christianisme, notamment romain. Alors que les Palestiniens vont être chassés après avoir été plus ou moins exterminés dans une totale indifférence (ou même bienveillance) occidentale, on se demande à quoi finalement aura pu servir ce christianisme déchu ou manipulé depuis le début. A partir en croisade pour Jérusalem ? Quelle farce.
Après tout, comme le Christ le dit lui-même, le salut vient des Juifs, donc pas des Palestiniens. Tant pis donc pour Gaza. Les cathos, qui en ont vu d’autres, se soumettront un peu plus. Sur les cathos je ne sais rien de plus rafraîchissant que cet extrait du journal de Léon Bloy vers 1910…: « Le curé nous dit que ses paroissiens sont à un tel degré d’abrutissement qu’ils crèvent comme des bestiaux, sans agonie, ayant détruit en eux tout ce qui pourrait être l’occasion d’un litige d’Ame, à leur dernière heure. »

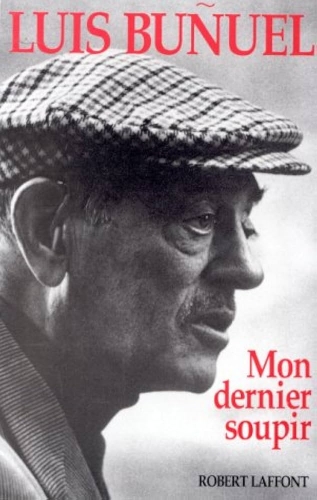
J’en viens brièvement à mon géant Luis Buñuel (voyez mon texte sur ses incroyables Mémoires) qui est selon moi le seul cinéaste chrétien avec l’oublié Bresson. Grâce à Dieu, je suis athée, a-t-il dit génialement un jour, en enchantant mon grand-oncle Georges Sadoul, communiste et critique de cinéma. Buñuel s’est acharné gentiment et savamment (la voie lactée…) sur le christianisme en évoquant l’embourgeoisement éternel de cette religion, sa vocation carcérale, son progressif abandon des pauvres et son déclin humain et sociologique, lié aux temps qui passent et à la civilisation industrielle agonisante muée en société du spectacle. McLuhan écrit quelque part que sans télévision on n’aurait pas eu Vatican 2.
...Et Céline que la vérité de ce monde c’est la mort.
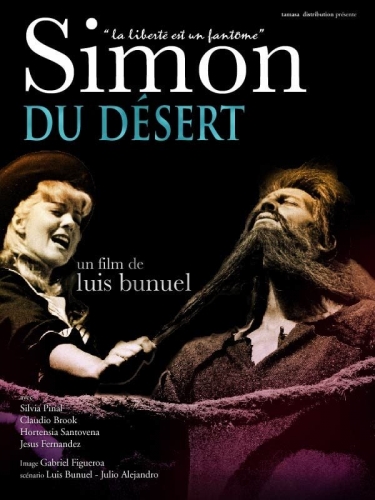
C’est là qu’intervient son Simon du désert. C’est un court-métrage avec l’impeccable Claudio Brook, acteur de la Grande Vadrouille et surtout de l’âge d’or mexicain, qui a accompagné Buñuel dans une nuée de chefs-d’œuvre. En une demi-heure la caméra explore le temps, liquide la furibarde vocation du saint (il se tient sur un pied sur sa colonne), découvre enfin la malignité des pauvres.

C’est un des traits de génie de Buñuel: le pauvre n’est ni bon ni chrétien, voyez Viridiana, en fait un bon pauvre, c’est un rêve de richard, cf. les migrants. Buñuel emmène avec le diable tentateur (géniale Silvia Pinal) notre saint aux enfers c’est-à-dire à New York. Cet enfer est d’abord signalé par un énième et satanique boucan d’aéroport (cf. l’interview de Parvulesco dans A bout de souffle), et c’est un espace dans lequel on s’acclimate et s’ennuie instantanément. C’est ce qui explique le succès de l’américanisation ou de la mondialisation : on s’y habitue instantanément. Richard Bandler, un des fondateurs de la PNL me raconta un jour qu’en Afrique on avait recours au psychiatre une fois qu’on y avait installé l’eau courante. L’eau des fontaines et des riantes conversations ne coulerait plus. Pensez au destin de Farrebique ou du village de Manon des sources, tournée dans une banlieue de Marseille…
La date choisie par Buñuel pour nous régaler de cet opus magique et définitif fait rêver.
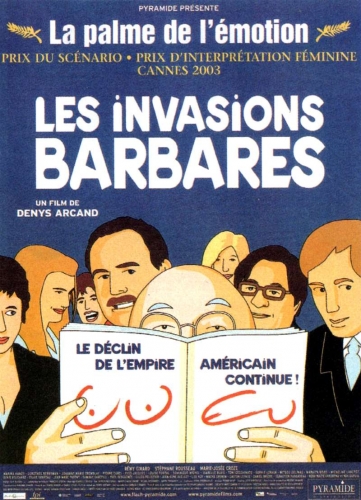
Je me souviens que dans ses provocantes (et bizarrement tolérées, plus que les films suivants) Invasions barbares, notre français du Canada Denys Arcand fait intervenir un prêtre québécois qui explique à une agente de Sotheby (ou de Christie’s) que la religion a disparu (et la pratique religieuse donc) EN QUELQUE MOIS vers 1966-67. Tout cela sent bon son 666 et son Québec libre.

J’étais enfant, je peux en témoigner: tout disparaissait en quelques mois ou en quelques années (depuis il n’y a plus rien à détruire) ; on est passé, pour rester en bons termes avec le cinéma, de la civilisation de la Renaissance à la civilisation du cul (début de Pierrot le fou) et de la France de Jean Gabin à celle de Jean Yanne. Tout cela sous la houlette du gendarme hystérique Louis de Funès (voyez mon livre sur la destruction de la France au cinéma) et de celui qui voulait faire une France great again. On sait comment ça se termine.
Sources:
https://www.dedefensa.org/article/bunuel-et-le-grand-nean...
https://www.amazon.fr/DESTRUCTION-FRANCE-AU-CINEMA/dp/B0C...
17:19 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : déclin, nicolas bonnal, luis bunuel, cinéma, christianisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le cinéma et la prostration européenne
Nicolas Bonnal
La vieille dame transie européenne rêve donc d’écraser, comme en 1941, et l’Amérique et la Russie et se suicide une nouvelle fois (voyez encore le livre de Laurent Guyénot sur la malédiction papale pour comprendre) en se pendant au premier joueur de bite venu, le nommé Zelenski. On ne sent aucune opposition autre que minoritaire poindre dans le vieil incontinent et on se demande si on rêve. Non, on fait on vit dans un continent zombi depuis longtemps, fils de Kafka, de Kubin et de Céline (autre auteur fantastique), et on ne fait qu’attendre la fin de la pièce. La société mortifère décrite par Chateaubriand après 1815 finira bien par crever et on laisse de vraies grandes puissances, l’Amérique ou la Russie, le soin de remodeler le monde, même si le résultat n’est ni brillant ni ragoutant.

Une nouvelle fois le cinéma permet de bien saisir les choses. L’Europe est depuis longtemps, depuis très longtemps même, la terre de la prostration en matière de cinéma. On aime l’ennui, l’existentialisme, le sexe cheap, la bonne déprime, la pleurnicherie humanitaire, bref on se plonge dans le « qu’est-ce qu’on peut faire ? » du Pierrot le fou de Godard quand la gourde Karina arrive au bord de l’amer et commence à casser les pieds à son Jules.
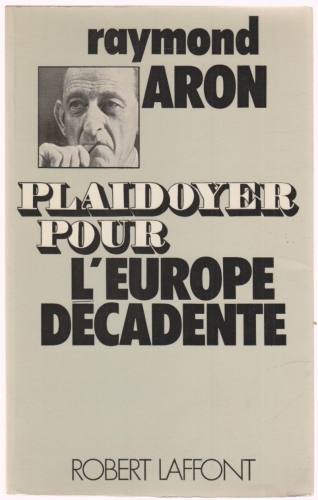
Dans les années soixante Raymond Aron, toujours aussi peu inspiré, avait publié un pensum universitaire de plus (les livres universitaires sont ceux qui vieillissent le plus vite dans l’Histoire, n’en ayant jamais fait partie) intitulé Plaidoyer pour l’Europe décadente. Mais ayant matériellement récupéré de la guerre, l’Europe était déjà moribonde sur le plan humain, culturel, philosophique : on relira avec intérêt Chevaucher le Tigre et l’Arc et la Massue de Julius Evola pour s’en rendre compte.

A cette époque, on a le cinéma d’Antonioni qui en inspira beaucoup d’autres. Prenons Blow up qui montre un Londres décadent, gauchiste, drogué, hagard, vide, politiquement correct, débauché, rocker et ennuyé. Une histoire encore plus ennuyeuse nous retient pendant une heure et demie. C’est l’époque où la cinéphilie qui était un émerveillement durant l’âge d’or hollywoodien (voyez mes livres !) devient une corvée : j’ai donné dans ma jeunesse.

Antonioni a commis un navet avec Wenders qui lui-même avant, sans le vouloir, avait montré notre dépendance aux USA. On a eu l’Ami américain (très bons Blain et Hopper) puis l’Etat des choses qui montre une équipe de cinoche s’emmerder au Portugal, car elle n’a plus le pognon US pour continuer son navet apocalyptique (pour une fois qu’on sort de l’existentialisme !). Le réalisateur (excellent Patrick Bauchau, jadis acteur de Rohmer et copain de… Parvulesco) s’en va donc à Los Angeles, pendant que son équipe baise et fume à l’hôtel, pour se retrouver canardé dans un trailer avec son petit producteur victime de sa générosité. Métaphoriquement ce film était parfait : l’Europe attend toujours le pognon et le projet des USA. Le navet suivant de Wenders était Paris Texas, ce qui montrait le devenir ricain de l’Europe. Mais c’est un devenir volontaire, pas une conséquence de l’impérialisme américain. J’ai rappelé Trotski qui explique le devenir domestique de la social-démocratie européenne ou Dostoïevski qui dans ses Possédés montrent la fascination involontaire que les USA, alors puissance secondaire, exercent déjà sur l’Europe et ses bataillons de progressistes.
Ce n’est pas l’Amérique qui a conquis l’Europe. C’est l’Europe qui se vend en putain éternelle et qui voulait être bonne fille à Biden et aux présidents démocrates type Wilson-Obama-Roosevelt (voir mon texte sur l’Europe et les présidents démocrates). La révolte actuelle qui mènera à une implosion de l'UE ou à une guerre mortifère contre la Russie est celle d’un cadavre.

Mais j’en reviens brièvement au cinéma : on a d’un côté les maîtres du cinéma non subventionné (jusqu’à Joe Biden !), du cinéma d’action, au grand air, pour grand public, familial, aventurier ou policier, mais qui toujours veut dire quelque chose : et puis on a le cinéma qui ne veut rien dire, le cinéma du néant, que personne ne va voir, le cinéphile comme moi préférant encore le nihiliste ricain pour découvrir un monde sans sens : voyez Jim Jarmusch, qui s’est moqué de Trump et de son électorat dans son navet cannois (la France finance tous les films qui perdent du fric, c’est une obsession chez elle), sur les zombis. Voyez la fille Coppola qui dans Lost in translation avait très bien filmé l’effondrement ontologique du Japon, bien confirmé depuis par la diplomatie et par l’économie nippones.
Dans sa découverte de l’archipel, ouvrage qui m’avait fasciné jeune, Elie Faure (pote à Céline tout de même, érudit et médecin, adorateur de la psychologie des peuples – quand il y en avait une) avait excellemment écrit qu’il ne fallait pas parler de ploutocratie (la France en est une) mais de dynamocratie pour évoquer l’Amérique : Trump, Musk, Vance, avec « tous leurs défauts » le montrent nuit et jour à la face du vieux continent perdu qui ne rêve que de s’enfoncer dans la nuit à la suite de Zelenski et de ses légions nationalistes. Certes, il faut du fric en Amérique : eh bien, tu n’as qu’à en gagner, et c’est facile là-bas (Daniélou).

De la même manière que le cinéma américain est un pléonasme (comme disait Orson Welles, traité de fasciste par la critique gauchiste en France), la mondialisation est un phénomène moins américain que français (les idéaux de la révolution) ou britannique (l’Empire, les Huxley, les institutions) ; l’Amérique avait justement rejeté à l’époque du grand et méconnu président Harding la SDN (tableau, ci-dessus). Son instinct toujours isolationniste et non-interventionniste lui disait de ne pas s’en mêler, et il avait fallu la création de la Fed par des banquiers allemands pour la précipiter dans la catastrophe de 1914-1918 qui allait susciter d’autres catastrophes durant tout le vingtième siècle et après.
On verra s’il y a une justice et si l’Europe sera vraiment, justement punie cette fois, pour sa mauvaise politique et son cinéma désastreux. En dépit de rodomontades de certains, la soumission des droites et les dernières désastreuses élections allemandes montrent que l’Europe désire à nouveau être CORRIGEE.
20:43 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, europe, nicolas bonnal, déclin européen |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Jean Parvulesco et le secret de la Nouvelle Vague
Nicolas Bonnal
Rebelote avec Jean Parvulesco et le cinéma qui loin de sa marotte était sa Fin ultime: voyez son texte sur David Lynch, le cinéma comme révélation et comme dévoilement de ce monde... Je rappelle qu’il fut émerveillé par Eyes Wide Shut, dernier film du monde, qui annonçait notre post-monde (élites hostiles folles et génocidaires, masse complice et aveugle): il découvrait Kubrick.
Mais parlons de la Nouvelle Vague. Moi aussi elle me rendit prodigieusement nostalgique, comme s’il s’était agi d’une époque, les Sixties, d’ailleurs assez agréables à vivre, et où l’on touchait du doigt le cinéma via la cinéphilie, ce culte nouveau mais bref. Tout s’effondra dans les années 70, assez brutalement je dois dire: mai 68, France défigurée, pornographie, télé, bagnole, gauchisme, crise du pétrole, destruction de Paris : voir notre texte sur Mattelart car cette destruction se fit sur ordre US.

Fin 1998. Nous sommes à Paris à la Rotonde. Comme toujours Jean est arrivé en avance. Il me dit tout joyeux qu’il allait se faire éreinter dans la revue 1895 (voyez le film de la femme de Coppola, un étrange voyage vers Paris, une traversée de la France en cabriolet 504, et qui passe par une curieuse visite au musée du cinéma à Lyon) par une certaine universitaire nommée Hélène Liogier : du temps de sa jeunesse folle, Parvulesco avait écrit dans une revue de droite espagnole que la nouvelle vague était « fasciste. » Rappelons d’abord que si ce mot est une insulte fourre-tout pour la gauche, il est un vocable fourre-tout pour une certaine droite !
Le texte était évidemment enflammé et hyperbolique, bien dans son style. Il était surtout attrape-tout. Il est évident que ce petit monde qui fut acheté ensuite par les subventions de la culture et de Jack Lang n’allait pas rester longtemps provocateur : il attendait sa retraite sur fond de Kali Yuga français (voyez l’excellent Rebelle de Gérard Blain, acteur de Howard Hawks tout de même, qui exprime le désespoir de cette fin des années Giscard).

Mais l’auteure, qui l’éreinte plus ou moins bien, oublie certains faits. Parvulesco fut toujours ami de Rohmer, qui fut un fan du Graal et de l’ésotérisme, un arpenteur de la France en sommeil, et même un provocateur (le salut « Montjoie ! » bras tendu au début de La collectionneuse). Même Louis Malle cite Drieu La Rochelle dans le Souffle au cœur et il le filme même quinze ans plus tôt avec Maurice Ronet, qui disait aimer « le goût amer de l’échec ». Voyez mon livre sur la Damnation des stars où je fais le lien entre les stars et le sujet brûlant de l’après-guerre: les rock stars britanniques de la grande époque (Jimmy Page, Bowie, Keith Moon…) furent étonnamment provocantes et tentées. Même un apparent gauchiste comme Jean Eustache fait lire dans la Maman et la putain (deux obsessions du fasciste) un livre sur la SS au copain de J. P. Léaud (quelle vie celui-là : douze ans de rêve, cinquante ans d’oubli). Et l’on connaît le penchant de Truffaut qui a été proche de Rebatet, si l’on oublie le fascisme déclaré de Raoul Coutard (photo,ci-dessous), plus grand chef-op’ de l’après-guerre, héros de la guerre d’Indochine qui célébra SAS ou la légion sautant sur Kolwezi...

Je repense à un des derniers films du cinéma, Hatari, avec John Wayne, Gérard Blain, Michèle Girardon, future suicidée et actrice de Rohmer - et bien sûr Hardy Kruger : on est dans un exercice de fascisme cool, post-historique mais encore bien colonial. On s’amuse, on attrape des filles (encore que ce soit plutôt les filles qui attrapent des pigeons) et des animaux, on retombe en enfance et on découvre que Nietzsche s’est trompé : on ne renaît pas comme dans Zarathoustra ou dans 2001 quand on retombe en enfance.

J’allais oublier Paul Gégauff tué au couteau par sa femme, grand provocateur, créateur de la fameuse scène des Cousins : on descend en officier SS dans un escalier le chandelier à la main, en écoutant du Wagner et en épelant du Nietzsche (pauvre Brialy). Gégauff aura avec Chabrol bien montré la transformation en monstre du mâle froncé, à coups de bagnole et de téléradio, au cours des années gaullisto-pompidoliennes : revoyez le Boucher ou que La bête meure en ce sens.

Rappelons aussi que Le petit soldat fut censuré, comme La religieuse de Rivette ou Les Sentiers de la gloire de Kubrick – et que Malraux, liquidateur de la culture française, abolit la cinémathèque française en 68, ce qui déclencha une mémorable révolte. C’était avec le renvoi de Langlois la fin d’une Eglise. Le cinéma allait devenir ce qu’en dit Duhamel : un divertissement d’ilotes.

Parvulesco fut l’upagourou de Godard. Il est interviewé à la fin d’A bout de souffle. Habillé comme Bogart (jouer au gangster ou au privé américain, c’est être un homme libre, au moins dans ce foutu hexagone), il répond à une interview à l’aéroport. La vieille France va disparaître et la femme moderne, la « dégueulasse » va prendre le pouvoir avec la sinistre Jean Seberg qui joua aussi Jeanne d’Arc et Bonjour tristesse.

Parvulesco joué par Melville : saluons encore ce juif, pas très gauchiste non plus, et qui dépeignit admirablement la destruction vitrifiée de la France durant les années gaullistes, voyez ma Destruction de la France au cinéma. Il est temps en tout cas de comprendre que notre anti-héros américain a tout pour fasciner l’intellectuel de droite en Europe. Aldrich dira de son propre Mike Hammer qu’il était un fasciste : certes, mais un fasciste en lutte contre les mafias et le Deep State US dans En quatrième vitesse. Toute la quincaillerie Belmondo-Delon aura pastiché ces géants du film noir américain.

Mais il faut reparler de Godard.
Je vais alors rappeler en quelques mots l’essentiel à savoir sur Godard :
Godard pour moi n’a existé que dans les années soixante, au temps de la splendeur de Bardot, de Belmondo, de Marina Vlady, actrice d’Orson Welles, qui sera lui aussi accusé de fascisme par les gauchistes de la fin des années Malraux. On vivait, pas encore anesthésiés à l’heure de la Conquête du cool décrite par Lipovetsky, et Godard incarne à la fois une révolte formelle – qui a totalement disparu depuis du cinéma – et politique, une révolte proche dans l’esprit de celle des situationnistes.

En quelques films il remet en cause la réalité de la France bourgeoise, consumériste et gaulliste – et ne propose rien. Il s’est euthanasié ailleurs à plus de 90 ans et, dans un de ses textes cités par Liogier, Parvulesco parle de fascisme qui débouche sur du nihilisme. Pensez aussi à Dominique Venner. Quand il va proposer quelque chose (la Chine maoïste, les Black Panthers, etc.), Godard va sombrer.
Dans A bout de souffle l’aéroport aussi est un signe : on quitte la France profonde, le paysage ancestral devient un terminal. Jünger en a très bien parlé dans Soixante-dix s’efface (NRF, p. 534) de cette disparition du monde et de cette surabondance de paysages spectraux. Dès Alphaville ou Weekend, plus grand pamphlet anti-bagnole de l’Histoire, le monde a disparu. On sent la même intensité du néant palpiter dans les Killers de Don Siegel (toujours lui…) ; dernier grand film de Lee Marvin et aussi dernier film d’un certain Ronald Reagan…

Aucune envie de polémiquer. Je rappellerai donc que :
Dans A bout de souffle, Godard montre (et dénonce sans doute sans le vouloir) l’américanisation en profondeur et en surface de la France. La France est déjà un pays englouti par l’américanisation, peut-être plus que d’autres (d’où sans doute ce très inutile antiaméricanisme qui nous marque tous). La belle américaine mène notre voyou franchouillard à la mort (comme aujourd’hui ils nous remmènent à l’abattoir – on y a pris goût).
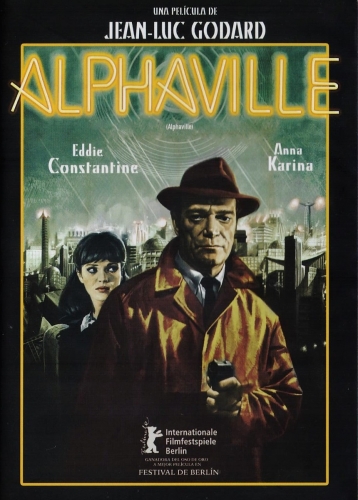
Dans Alphaville, Godard annonce le nazisme numérique de la Commission de Bruxelles. C’est la victoire du professeur von Braun et de la machine. On a tant écrit sur ce sujet – pour rien encore…

Dans Deux ou trois choses que je sais d’elle, Godard filme l’horreur des banlieues et des HLM. Le grand remplacement a déjà eu lieu et il est dans les têtes et les paysages. Relire Virilio et mon texte sur ce très grand auteur, repris par son éditeur Galilée.

Dans Le Petit soldat, Godard fait un film d’extrême-droite, peut-être le seul du cinéma français. C’est sur la guerre d’Algérie. Le film vaut par la surperformance de Michel Subor, acteur d’origine russe-azéri, que l’on retrouvera dans le Rebelle de Blain.

Dans Le Mépris, Godard lamente, avec le thème sublime de Delerue, la fin du cinéma, la Fin des dieux (il cite Hölderlin et nous montre Fritz Lang), et la fin de la Méditerranée. Le touriste va remplacer les héros odysséens. La crise du couple postmoderne nous barbe beaucoup plus. L’homme aux dieux grecs, à Ulysse et à Ithaque est tout bonnement prodigieux. Ne lisez que Virgile, Homère et Ovide (les Métamorphoses).
D’autres films pourraient être cités de cette extraordinaire époque anarchiste de droite, comme Les Carabiniers, qui avaient enchanté Roman Polanski. Rappelons que ce dernier a longtemps travaillé avec Gérard Brach, devenu un ami grâce à la rédaction de mon livre sur Jean-Jacques Annaud, et qui était un ancien de l’armée allemande... Doux et désabusé, Gérard est présent une seconde dans A bout de souffle.
Les aventuriers de l’arche perdue pourraient aussi suivre les errances de Barbet Schroeder (un autre mutant du cinéma de cette époque), dans More (belles allusions à Otto Skorzeny) et de son équipe dans la Vallée en Nouvelle-Guinée : sublime moment quand Bulle Ogier récite dans le désordre les Scènes de la vie des marionnettes de Kleist sur fond de monde fragmenté. Certaines scènes annoncent avec beaucoup moins d’argent mais autant d’inspiration Apocalypse now et les citations de T. S. Eliot du colonel Kurz. Godard s’était fait un devoir de défendre ses citations.
Et ce que le cinéma nous aura appris à Jean et à moi finalement c’est qu’on peut faire des films d’extrême-droite tout en étant parfaitement de gauche ; à l’inverse des conservateurs (cf. John Ford) peuvent faire n’importe quoi avec leurs bonnes intentions de droite. De toute manière la question n’est pas là. Une flamme brillait, celle du génie de la Liberté, qui n’est plus là.

Sources:
https://www.persee.fr/doc/1895_0769-0959_1998_num_26_1_1376
http://euro-synergies.hautetfort.com/archive/2022/09/13/j...
https://www.dedefensa.org/article/kleist-et-le-transhumai...
https://www.dedefensa.org/article/parvulesco-et-david-lyn...
https://www.dedefensa.org/article/la-destruction-de-la-fr...
https://www.dedefensa.org/article/mattelart-les-jo-et-la-...
https://www.dedefensa.org/article/eric-zemmour-et-le-crep...
16:13 Publié dans Cinéma, Jean Parvulesco | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : cinéma, jean parvulesco, nicolas bonnal, jean-luc godard |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Orson Welles et la nostalgie des origines
Nicolas Bonnal
J’ai déjà insisté sur Booth Tarkington, romancier essentiel et oublié, rendu célèbre par le « gauchiste-progressiste » Orson Welles dans la Splendeur des Amberson – Welles le met au-dessus de Mark Twain. « Sous la rude écorce de marin se cache une âme de grand enfant un peu naïf », dit génialement la Castafiore de son capitaine Haddock: ici c’est la même chose, et c’est un peu comme avec Trump qui caricature brutalement le message. On aime rêver de l’Amérique jadis grande, qu’on ne sait comment définir du reste. Certains la voient impuissante avec le temps, d’autres la regrettent innocente (découvrez l’école picturale de Hudson). Le slogan MAGA est écrit tel quel dans Taxi driver: car l’homme politique que veut tuer Robert de Niro fait déjà de la nostalgie et du Trump. On a vu ici que même Fenimore Cooper faisait de la nostalgie et regrettait le bon vieux temps qui passe et les invasions européennes à forte connotation socialiste (revoir Tocqueville).

Mais voilà que le prince Orson Welles vient à ma rescousse: il ne s’en cache pas de cette nostalgie des origines qui nous enchanta avec Mircea Eliade (professeur à Chicago et donc voisin relatif du natif du Wisconsin), nous qui n’avons pas connu le monde d’avant la merde – un peu en Tunisie, le monde d’avant la technologie, les machines et les services comme on dit, revoyez Farrebique pour comprendre. On sait que dans Apocalypse now (Welles rêva d’adapter le récit de Conrad Heart of Darkness avant la paire Coppola-Milius) le colonel Kurtz (sublime Brando pendant quelques secondes) évoque cette descente de la rivière Ohio, et cette plantation de gardénias qui lui rappelle l’âge d’or et le paradis, « sous forme de gardénias ». On sait du reste que Trump dans sa tentation néo-païenne évidente (on en reparlera) a célébré un âge d’or à sa façon dans sa cérémonie d’inauguration. On n’en a pas fini avec Trump: la vraie révolution politique, c’est le retour aux origines. Ses gardes du corps vont avoir du boulot.
Orson Welles déclare donc à Peter Bogdanovitch dans un livre d’entretiens légendaire et surtout indispensable; je préfère le citer en anglais :
Grand Detour was one of those lost worlds, one of those Edens that you get thrown out of. It really was kind of invented by my father. He's the one who kept out the cars and the electric lights. It was one of the "Merrie Englands." Imagine: he smoked his own sausages. You'd wake up in the morning to the sound of the folks in the bake house, and the smells. ... I feel as though I've had a childhood in the last century from those short summers.
PB: It reminds me of Ambersons. You do have a fondness for things of the past, though...
OW: Oh yes. For that Eden people lose It's a theme that interests me. A nostalgia A nostalgia for the garden--it's a recurring theme…
Il y a nostalgie (le mot signifie douleur en grec, il ne fait pas le prendre à la légère) dans Citizen Kane (le berceau Rosebud qui inspire une des meilleurs épisodes de Columbo), et il y a nostalgie dans la Splendeur des Amberson, narration de la petite aristocratie locale et féodale qui va disparaître sous le poids du progrès technique et de l’immigration européenne. Je cite à nouveau cette page extraordinaire qui évoque le Bernanos de la France contre les robots :
« Il y eut un nouveau silence; le Major consterné fixait son petit-fils. Mais Eugène se mit à rire joyeusement.
– Je ne suis pas sûr qu’il ait tort à propos des automobiles, dit-il. En dépit de toute leur vitesse, elles ne seront peut-être qu’un pas en arrière dans la civilisation. J’entends la civilisation spirituelle. Ajouteront-elles à la beauté du monde, à la vie de l’âme? Je ne le crois pas. Mais elles sont là; elles transforment nos vies plus profondément que nous pourrions le supposer. Elles transformeront la guerre, et elles transformeront la paix. Je pense que l’esprit humain lui-même changera, à cause d’elles. Comment? Je n’en sais rien. Mais le changement extérieur n’ira pas sans un changement intérieur; ici, George a peut-être raison: ce changement intérieur nous sera défavorable. Qui sait? Dans vingt ou trente ans je pourrais n’avoir plus le droit de défendre ma voiture sans cheval, et déclarer moi-même: «Son inventeur a fait un beau gâchis ! »
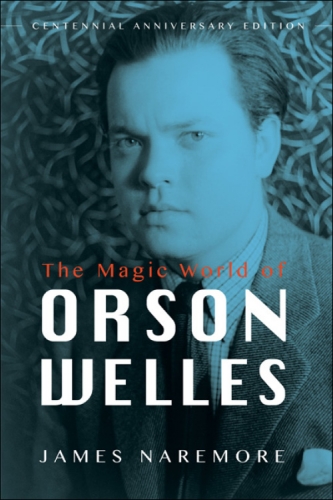
Dans son excellente bio de Welles Naremore rappelle que le jeune maître n’a pas voulu parler du « racisme » du roman qu’on rappelle en une phrase :
« Mais le plus grand changement s’observait parmi les habitants mêmes. Les descendants des pionniers étaient petit à petit submergés par le flot des nouveaux venus et s’identifiaient si bien à lui qu’on ne les y distinguait plus. Comme à Boston, comme à Broadway, la vieille race perdit son caractère propre, et de tous ceux qui nommaient la ville «chez eux»). »
On n’insistera pas.
La nostalgie de Welles s’est étendue à sa vie. Il est venu vivre en Espagne, dans l’Espagne franquiste qui enchante alors Hollywood et où même on laissa réaliser le très marxiste Spartacus (voir mon livre sur Kubrick où je décortique cette acrobatie). Après Franco, il dira tel quel que la démocratie a détruit l’Espagne.
Et en quelques années s’il vous plaît.

Et dire que dans la Dame de Shanghai (ô cette croisière à Acapulco sur le yacht d’Errol Flynn – le Zaca, que je salue toujours à Fontvieille-Monaco !) le héros se flatte d’avoir tué un nationaliste espagnol ! Mais c’est dans la Dame de Shanghai que Welles a le mieux défini l’homme moderne : quand j’ai décidé de faire l’imbécile, il n’y a personne qui puisse m’arrêter.

Welles a très bien célébré l’Espagne, notamment les pueblos de Calatanazor (réservé aux Happy Few celui-là) de Pedraza dans son Falstaff. Le film se clôt par une rupture: le jeune roi moderne et bureaucrate émerge, bon lecteur de Bertrand de Jouvenel - l’Etat c’est moi, fous-moi la paix, vieux fou.
Le vieux rembarré meurt de chagrin: c’est la fin de la libre Angleterre que même Marx va célébrer dans le Capital. On est avant Azincourt…
Après, il faut voir la naissance du monstre: Kane et le capital, la ville tentaculaire de Verhaeren (les Amberson toujours), Harry Lime du troisième homme, qui trafique du vaccin (tiens, tiens…). Mr Arkadin aussi se réfugie en Espagne (ô Ségovie, ô Alcazar) mais devient un monstre technocratique et capitaliste. On a la même ferveur nostalgique dans la Soif du mal : le vieux Quinlan reste bébé avec ses bonbons et jeune ado avec Marlène Dietrich, la courtisane des débuts. Il y a aussi cette innocence perdue, dont avait parlé mon excellente prof d’histoire américaine à sciences-po, Denise Artaud, et qui succomba avec la création de la Fed et la guerre voulue par le président démocrate Woodrow Wilson et ses marionnettistes banquiers.

Il est marrant que cette nostalgie de l’âge d’or existe en Amérique, mais alors pas en en France, en Allemagne, ou en Angleterre, pays où les peuples se ruent vers la fin la plus noire possible. Là-bas, on a toujours une nostalgie, même quand on est de gauche, voyez Redford ou les frères Coen après Welles.

Et comme j’ai parlé de Colombo, qui est devenue mon sucre d’orge avec l’âge, je citerai aussi Requiem pour une star déchue, l’épisode avec Anne Baxter (la jeune actrice des Amberson) et Faux témoin, où comme par hasard on voit la villa de Hearst (le parrain…), magique mansion en mode Spanish Revival, construite en plein âge d’or américain - Paul Johnson parla de la dernière Arcadie. Colombo, qui vient faire le mélange et liquider les derniers princes anglo-protestants pour mettre qui l’on sait au pouvoir (la bande à Fink et à Biden), ne peut s’empêcher de nous montrer les merveilles dont ils furent les auteurs, ces anglo-américains qui fascinaient Tocqueville et dont Orson Welles fut le plus prodigieux avatar cinématographique.
Quelques sources :
https://lesakerfrancophone.fr/booth-tarkington-un-romanci...
https://www.dedefensa.org/article/orson-welles-et-sa-fonc...
https://www.amazon.fr/FIN-LINNOCENCE-ETATS-UNIS-W/dp/2200...
https://www.amazon.fr/Tocqueville-politiquement-incorrect...
16:45 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : nicolas bonnal, orson welles, cinéma, vieille amérique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Comment le cinéma a contribué à la philosophie d'Henri Bergson
Troy Southgate
Source: https://troysouthgate.substack.com/p/how-cinema-contribut...
En parcourant certains écrits du penseur français Henri Bergson (1859–1941), j’ai été amené à réfléchir aux implications politiques et linguistiques de sa pensée pour la société moderne. Bergson a soutenu avec brio que la conscience ne peut être quantifiée de la même manière que l’on mesure les corps dans l’espace. Il en fit la découverte lors d’une visite au cinéma dans les premières années du 20ème siècle, lorsqu’il remarqua que ce que l’on perçoit à l’écran n’est en réalité qu’une série d’instantanés successifs donnant l’illusion du mouvement.
Lorsqu’il déclara que les philosophes pouvaient apprendre énormément du cinéma, le philosophe et mathématicien Bertrand Russell (1872–1970) mit sa théorie à l’épreuve et conclut qu’il avait raison. Cependant, Russell ne réalisa pas que son homologue français considérait la méthode cinématographique comme une fenêtre sur une grande méprise que la plupart des gens avaient intégrée dans leur existence, y compris Russell lui-même.

En spatialisant la conscience et en vivant d’un point à un autre, à l’image des diapositives d’un projecteur qui créent un mirage de continuité, les humains évoluent dans un contexte où le changement n’est plus qu’une succession d’arrêts potentiels où l’action peut intervenir. En d’autres termes, nous ne percevons pas réellement des « choses », mais plutôt des instants singuliers qui contiennent la possibilité d’une interaction. Cela nous conduit à agir comme des corps discontinus. Comme l’explique Barry Allen, biographe de Bergson :
« La vie est une véritable continuité, qui implique une interpénétration temporelle et une succession sans séparation. La cinématographie, en revanche, offre une séparation réelle et une succession sans interpénétration ; le moment suivant ne découle pas du précédent, il est simplement juxtaposé, externe, comme des points dans l’espace. »
En visualisant artificiellement le mouvement, nous cherchons ainsi à le contrôler. Imaginez que vous vous trouviez devant un ruisseau en mouvement et que vous souhaitiez l’assujettir. Pour ce faire, il vous faudrait d’abord contenir l’eau en lui donnant une forme, c’est-à-dire la transformer en une sorte de solide. Mais le fait que l’eau s’écoule naturellement signifie qu’elle échappe à toute mesure ou évaluation. Dans cette logique, l’homme moderne, fidèle à sa faculté rationnelle, utilise la contrainte comme moyen de quantification.
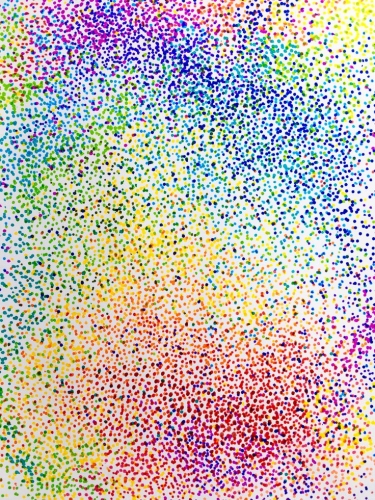
La méthode cinématographique peut également être vue comme une analogie des systèmes de contrôle sous lesquels nous vivons aujourd’hui. Selon Bergson, l’attrait des individus pour les clichés et les comportements ritualisés conduit à cet instinct grégaire dont Nietzsche parlait dans sa propre philosophie. Si la continuité de la conscience se réduit à une succession de points homogénéisés sur une trajectoire partagée par la masse, notre liberté individuelle se trouve considérablement amoindrie. La conscience ne peut être modelée comme de l’eau que l’on verse dans un récipient ou dans un canal, car la simple commodité de la quantification est incompatible avec le principe même de réalité.
Bien que Bergson concède que ces tendances sont « inhérentes à l’esprit humain », ce n’est qu’à travers le langage que des corrélations non visuelles prennent une forme spatiale. Allen souligne qu’en recherchant l’identité et la répétition au détriment de la nouveauté, la raison cherche en réalité à « éliminer la diversité en découvrant l’identité partout ».
19:40 Publié dans Cinéma, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, philosophie, henri bergson |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Vers un cinéma civilisationnel russe
par Alexandre Douguine
Alexandre Douguine affirme que la Russie doit surmonter la dictature de la médiocrité dans sa sphère culturelle pour établir un cinéma civilisationnel distinct et récupérer son identité culturelle unique dans un monde multipolaire.
Si nous, Russes, avons l'intention de construire un monde multipolaire, alors chaque civilisation doit avoir sa propre sorte d'Oscar, un prix pour les meilleures performances, le meilleur scénario, la meilleure musique et les meilleurs costumes.
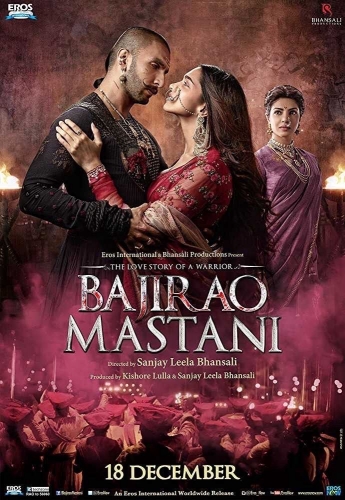
Nombreux sont ceux qui savent que l'Inde possède ce qu'on appelle Bollywood, sa propre industrie cinématographique. Elle a ses propres prix et ses propres héros, qui peuvent être totalement inconnus en Occident ou même dans la Chine voisine. Mais pour leur civilisation (et l'Inde est pratiquement un continent entier), ces films et leurs Oscars sont d'une importance énorme.

Il en va de même pour la Chine. Il y a des films et des acteurs chinois qui sont totalement inconnus dans d'autres pays, mais qui sont immensément populaires en Chine. Cela s'explique par le fait que la Chine et l'Inde sont des civilisations indépendantes, avec leurs propres traditions cinématographiques. Aujourd'hui, le développement d'un cinéma propre est devenu un facteur de civilisation.
Nous, les Russes, devons également créer notre propre prix eurasien. Mais pour ce faire, nous devons développer notre propre cinéma, distinct et original. Et pour cela, des individus brillants et talentueux sur le plan culturel doivent prendre la tête des processus culturels de la Russie. Des Russes, bien sûr, au sens culturel du terme.

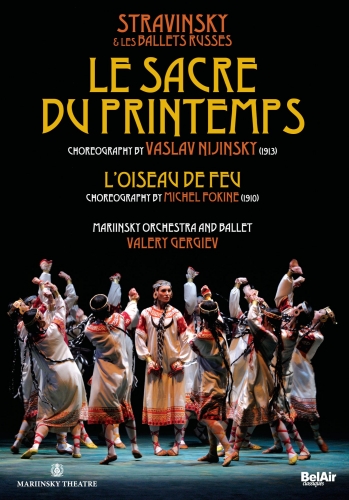
Valery Abisalovich Gergiev (photo) est un merveilleux exemple de talent extraordinaire, reconnu et apprécié pour ce qu'il est (1). D'origine ossète, il connaît et ressent la culture, l'art et l'esprit russes mieux que beaucoup d'autres en Russie - peut-être mieux que quiconque.
On dit du maestro Valery Gergiev qu'il est un génie doté d'une baguette magique.
Pour organiser un Oscar russe digne de ce nom, nous avons besoin de talents du même calibre dans notre industrie cinématographique. Oui, nous avons des acteurs talentueux, et même quelques réalisateurs remarquables, mais il nous manque une industrie cinématographique russe complète et distincte.
Par exemple, de nombreux pays dans le monde ont des philosophes locaux mais n'ont pas de tradition philosophique unique. De même, certains pays produisent des films et ont donc des acteurs et des réalisateurs, mais n'ont pas de tradition cinématographique distincte.
Cela est dû au fait que le code culturel n'est pas conceptualisé ou compris. Et parce qu'il n'y a pas une concentration suffisante d'individus passionnés et de génies qui pourraient former un cercle créatif, comme cela s'est produit au 19ème siècle lorsque la musique classique russe a émergé autour de la « Mighty Handful » (2) ou lorsque la culture de l'âge d'argent russe (3) a vu le jour.
Aujourd'hui, en revanche, tout est fragmenté. Même lorsque Valery Gergiev monte une nouvelle production, celle-ci ne fait l'objet que de critiques formelles. Le sens profond de ce que le maestro essaie de transmettre n'est presque jamais discuté - ni dans les médias fédéraux, ni dans les canaux Telegram, où les gens se disputent sans fin sur des sujets triviaux, souvent vulgaires.
Ainsi, pour que nous devenions un pays doté d'un cinéma civilisationnel à part entière, nous devons d'abord apprendre à rechercher et à soutenir les vrais génies. Nous devons les rassembler dans une sorte de club, un cercle de génies, aussi petit soit-il, où ils auront toutes les chances de s'épanouir. Un lieu où les vrais philosophes interprètent les œuvres des vrais artistes et où les vrais acteurs suivent les conseils des vrais maîtres.
Actuellement, cependant, notre sphère créative est encombrée de couches de déchets accumulés au cours des périodes libérales soviétique et post-soviétique. En conséquence, notre intelligentsia créative est largement médiocre, à de rares exceptions près, comme Gergiev, Bashmet et quelques autres.
Nous ne devrions pas aspirer à avoir notre propre Oscar comme référence - nous devons créer notre propre art civilisationnel.
Ce n'est qu'en nous concentrant sur cet objectif que nous pourrons développer une forme d'art propre à la civilisation, y compris le cinéma. Pour l'instant, je le répète, nous avons des génies individuels, mais nous manquons d'art. Ainsi, au lieu de célébrer la nomination aux Oscars de tel ou tel acteur talentueux, en particulier ceux qui travaillent en Occident, nous devrions nous concentrer sur ce point.

À propos, outre Bollywood, il y a maintenant Nollywood, l'industrie cinématographique nigériane. Nous la regardons avec horreur et nous nous demandons ce que c'est, mais beaucoup de gens l'apprécient. En fait, dans certains pays africains, même les conflits militaires ont été interrompus pour la sortie d'une nouvelle série de films nigérians sur des événements et des dynamiques tribales qui nous semblent totalement incompréhensibles. Le cinéma philippin est un autre exemple - unique et original.
Il est essentiel pour nous d'entretenir la diversité de notre monde multipolaire. Nous ne devrions pas viser les Oscars, mais plutôt créer des concours de films civilisationnels distincts afin de priver l'Occident collectif de son monopole sur le cinéma mondial. Et si nous reconnaissons enfin les fondements uniques et profonds de l'esthétique russe, nous évaluerons nos acteurs, nos musiciens, nos artistes et nos poètes en fonction de leur alignement ou non sur notre code culturel.
L'écume pseudo-culturelle qui domine actuellement notre scène culturelle ne correspond manifestement à aucun code culturel. Elle n'est que la périphérie de l'Occident, et c'est la raison pour laquelle nous cherchons à tout prix à être reconnus en Occident, en tant qu'imitateurs serviles de nos maîtres. À de rares exceptions près, il ne s'agit pas d'art, mais d'une forme de mimétisme obséquieux.
C'est pourquoi je pense que la participation aux Oscars - dominés par l'agenda libéral occidental - n'aurait de sens que si Trump sécurise son emprise sur le pouvoir et que les valeurs traditionnelles dominent les festivals occidentaux. Si nous développons notre propre cinéma, nous pourrons alors rivaliser sur la base de valeurs traditionnelles partagées.
Vivrons-nous assez longtemps pour voir le jour où les valeurs traditionnelles domineront les festivals de cinéma occidentaux ?
Mais pour l'instant, nous n'avons pas de cinéma qui reflète nos valeurs traditionnelles. Cela est dû au fait que certaines personnes, qui ont pris le contrôle de la sphère culturelle, agissent comme des caillots dans un vaisseau sanguin, bloquant le flux d'un véritable développement culturel en Russie. Elles tentent de censurer et de diriger la production créative, mais elles sont tellement mesquines, insignifiantes et incompétentes que le résultat est une image pathétique et peu attrayante - surtout lorsque la médiocrité tente de censurer le talent.
Dans l'Empire russe, en revanche, les censeurs étaient des philosophes, des penseurs et des publicistes remarquables, comme Konstantin Leontiev. La censure est une question très délicate. Il faut savoir reconnaître le génie, même lorsqu'il ne s'inscrit pas dans des cadres rigides. En même temps, il faut aussi identifier et supprimer les tendances néfastes, qui ne sont pas toujours évidentes au premier abord.
La censure est un grand art. En bref, ce dont nous avons le plus besoin aujourd'hui, c'est de mettre un terme à la dictature de la médiocrité qui s'est installée en Russie au cours des dernières décennies.
Notes:
(1) Valery Gergiev, né à Moscou en 1953 de parents ossètes, est un chef d'orchestre et directeur d'opéra réputé. En décembre 2023, il a été nommé directeur artistique du théâtre Bolchoï, devenant ainsi la première personne à diriger simultanément les théâtres Mariinsky et Bolchoï. Le lien de Gergiev avec la culture russe est profond. Il a contribué à promouvoir la musique et les artistes russes sur la scène internationale, à défendre de jeunes talents comme la soprano Anna Netrebko et à faire revivre des opéras russes moins connus comme La ville invisible de Kitège de Rimski-Korsakov et Les fiançailles dans un monastère de Prokofiev.
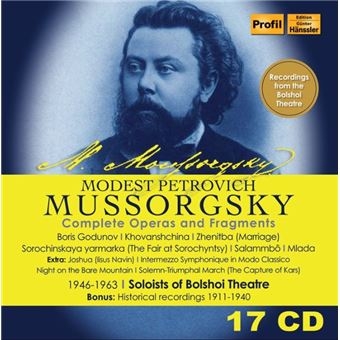
(2) La « Puissante poignée », également connue sous le nom des « Cinq », était un groupe de compositeurs russes du XIXe siècle - Mily Balakirev, César Cui, Modest Moussorgski, Nikolaï Rimski-Korsakov et Alexandre Borodine - qui se sont unis dans les années 1860 pour développer un style national distinct de musique classique, libre des influences de l'Europe de l'Ouest.
(3) L'âge d'argent russe désigne une période culturelle dynamique qui s'étend de la fin du XIXe siècle au début du XXe siècle, soit approximativement de 1890 à 1917. Cette époque a connu un essor exceptionnel de la poésie, de la littérature et des arts russes, marqué par l'émergence de divers mouvements artistiques, dont le symbolisme, l'acméisme et le futurisme. Parmi les figures marquantes de cette époque figurent des poètes tels qu'Alexandre Blok, Anna Akhmatova, Boris Pasternak et Marina Tsvetaeva. L'âge d'argent est souvent considéré comme une renaissance de la vie culturelle russe, comparable à l'âge d'or du début du XIXe siècle. Cependant, cette explosion créative a été freinée par la révolution russe de 1917 et les changements politiques qui ont suivi, qui ont conduit à un renforcement de la censure et de la répression, mettant fin à cette période remarquable de l'histoire culturelle russe.
17:03 Publié dans art, Cinéma | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : alexandre douguine, cinéma, russie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parvulesco et David Lynch sur le cauchemar US
Nicolas Bonnal
Source: https://www.dedefensa.org/article/parvulesco-et-david-lynch-sur-le-cauchemar-us
David Lynch est mort et il ne tournait plus depuis dix-sept ans. Les larmes de crocodile des uns (dont Spielberg) ne doivent pas nous faire oublier l’avarice des autres : qui a cessé en effet de le financer, et sur quel ordre ? Ce n’est certes pas parce que ses films ne rapportaient rien, malgré leur dimension de film-culte qui ne concernait qu’une chapelle peu éclairée. On a sciemment laissé crever son cinéma. D’un autre côté j’ai assez fréquenté Kubrick pour savoir qu’un long silence au cinéma est parfois préférable à une myriade d’opus ratés. Perte d’inspiration, disent les idiots ? D’autres savent qu’il vaut mieux se taire et mirer l’écran blanc. Certains maîtres dépérirent sous le nombre de leurs films sans inspiration : Godard, Resnais, Ridley Scot… Roule, torrent de l’inutilité, comme dit Montherlant.
Imdb.com a dit un jour que les trois plus grands cinéastes étaient Hitchcock, Kubrick – j’ai écrit sur les deux – et David Lynch, sur qui j’ai hésité d’écrire : je me demande en effet s’il y a tant à dire sur lui. Et comme en plus il y a selon moi du politiquement incorrect…
Soyons brefs et synthétiques :
Lynch est le témoin de la montée de l’horreur dans les années Kennedy-Johnson. Le bon vieux temps va être remplacé, que MAGA pleure encore (l’américain est plus nostalgique que l’apathique froncé qui a laissé son pays se dézinguer sans réagir, même culturellement). Le pays se désintègre sur tous les plans sous la poussée étatique et migratoire (voyez entre autres Paul Johnson ou l’excellent Jonah Goldberg sur le fascisme libéral). Ses personnages les plus célèbres, l’homme-éléphant et la tête à effacer, montrent une horreur suinter, celle de la Révolution industrielle, puis de l’écroulement de la société américaine dans les années soixante, dont tous les gens de droite ont parlé, et même John Wayne dans sa fameuse interview dans Playboy. C’est la fin de la race blanche (disons-le nûment), de sa famille, de ses traditions, l’ouverture exotique des frontières entre autres voulue par les frères Kennedy (voyez l’extraordinaire Alien nation de Peter Brimelow), la montée de l’insécurité et de l’orange mécanique (Vivian Kubrick soulagée de quitter New York pour gagner la campagne anglaise, dixit Vincent Lo Brutto) : société multiraciale, drogue, violence ultra, racaille toute-puissante, horreur des paysages urbains, tout ce que décrit Kunstler dans sa Long Emergency. Aux cowboys vont succéder des obèses ahuris de drogues autorisées et de télé, cowboys enfermés dans des territoires protocolaires autoroutiers interminables. C’est la fin de la petite ville blonde de Jane Powell (Small Town Girl, une de mes comédies musicales préférées, voyez mon livre).

Tout cela pour se demander si le message clairement racial de Lynch (lui-même officiellement partisan de Bernie Sanders, et comme il a raison sur certains plans !) a été compris par l’Ennemi, qui l’aurait puni pour cela ? Cet homme tranquille théoriquement de gauche délivrait un message de blondeur, de nostalgie, parois optimiste (cf. le petit couple survivaliste de Nicholas Cage et la sublime Laura Dern), mais surtout nihiliste et pessimiste : rien ne va rester de l’ordre ancien. Et comme nous perdons en même la tête et la mémoire… Blue Velvet avec son oreille et non son temps retrouvé décrit cette atmosphère de petite ville US sortie des films de Negulesco ou de Douglas Sirk, petite ville fragile si détestée par l’élite, qui va être liquidée par le Deep State et ses représentants, ces élites folles que dénonce alors Christopher Lasch (mais aussi le frère de Paul Auster). Les élites préfèrent l’exotisme à plumes, comme l’a rappelé Gilles Chatelet dans Vivre et penser comme des porcs (livre presque dédié à Attali et Sorman…).
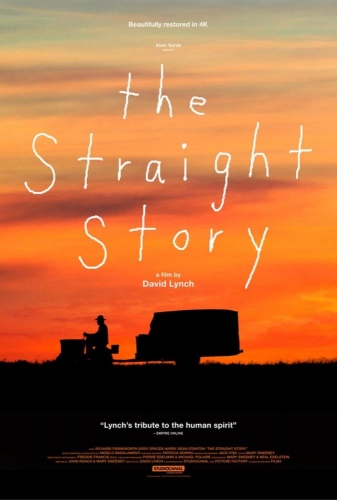
La critique cannoise célébrait l’atmosphère de sexe hard, de libération sexuelle, de drogue ou de dérive sociale qui marquait les films de Lynch. Elle fut surprise (je me souviens de la réaction d’Elizabeth Quin) par The Straight Story qui narre l’aventure routière d’un vieil homme, père d’une fille handicapée et soucieux d’aller retrouver son frère sur sa tondeuse à gazon (éloge de la lenteur !) à quelques centaines de kilomètres de là. Cadre enchanteur, mais c’était le Canada d’avant Trudeau. Ici Lynch jetait un peu son masque et l’insuccès auprès d’un public toujours plus hébété précipita sa chute. Mulholland Drive qui se voulait un film sur une série télé façon Twin Peaks (belle peinture de la déchéance US avec un casting de jeunes d’une beauté sensationnelle et les plus beaux paysages du monde dans l’Etat de Washington), s’avéra en fait et en définitive un «pilote» raté qui n’intéressa pas les télés – comme les derniers Columbo qui décrivaient très bien et presque involontairement (donc excellemment) la déchéance intégrale de la société américaine sous les années Bush et Clinton, nos mondialistes consacrés. Le dernier film tourné en Bulgarie m'était apparu comme insipide : je maintiens que le plus dur chez Lynch c’est cette angoisse de la pellicule blanche qui frappe d’autres petits maîtres comme Jarmusch ou Payne (en France qu’avons-nous avec notre cohorte de cinéastes subventionnés par l’Etat-PS ?) et cette fatigue de décrire ou de refléter une réalité qui ne cesse de disparaître, conformément aux prédictions de Debord dans les années soixante.

Je termine par une citation de Jean Parvulesco dans Retour en Colchide (merci au fidèle lecteur Paul), livre où il parle étrangement de mon rapport avec un Grand Monarque, que j’ai connu et qui n’a pas reçu l’accueil qu’il méritait. Avec Parvulesco nous parlions souvent à La Rotonde du jeune Godard (génie éblouissant c’est certain) qu’il avait inspiré, de Kubrick, de Hollywood (comme son texte sur ce grand incendie rituel et sacrificiel nous manquera !), et bien sûr de Rohmer et de Schroeder. Jean réagit très fortement à Eyes Wide Shut de Kubrick. Mais grâce à mon lecteur Paul je trouve ces lignes sur le triomphe du satanisme dans la société américaine et occidentale, lignes inspirées par Mulholland Drive :
« …Car ce film de David Lynch est en réalité le récit - la mise en scène de sa propre désintégration en marche et partant d’une certaine désintégration totale de ce monde, ramenant à la superbe séquence finale du basculement général dans la démence collective totale coïncidant d’une manière sous-entendue avec une prise en possession définitive par les Enfers.
En dernière analyse, Mulholland Drive signifie et annonce l’engagement peut-être irréversible de l’actuelle soi-disant civilisation américaine vers une conclusion infernale, vers la pétition de plus en plus paroxystique de sa prise en main par les pouvoirs occultes des soubassements nocturnes de ce monde. Par leur glissement fatal sous la Régence des Ténèbres. »
Il n’y a rien à ajouter. Le triomphe de Satan me semble évident en France comme en Amérique maintenant – et très bien accepté. Je pense encore que si j’écris un bref livre sur Lynch j’y inclurai un texte sur le cinéma néo-noir. Le cinéma noir ou néo-noir est ce qui permet de rentrer dans la graisse de la société bourgeoise et moderniste, de lui en extraire le lard. Le plus grand film en la matière, qui annonce Lynch, l’incontournable reste Point Blank de John Boorman, qui narre la destruction de la société américaine par le capitalisme modernisé (voyez mon texte sur Robert Reich et les manipulateurs de symboles), entité qui adore dévorer ses enfants inconscients.
18:10 Publié dans Cinéma, Jean Parvulesco | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, david lynch, nicolas bonnal, jean parvulesco |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le mystère de Twin Peaks
Derrière le surréalisme des films de David Lynch
Alexander Douguine
J'ai récemment participé à un programme consacré à David Lynch dans le cadre du « projet Decameron », dans lequel plusieurs personnalités dialoguaient en ligne, racontant différentes histoires et discutant de différents films. L'émission s'intitulait « Guide to Kulchur ». J'ai été invité à parler de David Lynch. L'animateur et moi avons eu une conversation très intéressante. Je vais vous en raconter les principaux détails.
Bien que Lynch soit considéré comme un postmoderniste, un réalisateur populaire parmi les hipsters et les libéraux, l'organisateur du projet Guide to Kulchur, un conservateur de droite (Fróði Midjord) a déclaré qu'il aimait Lynch (se mettant ainsi probablement en opposition avec la plupart de ses propres partisans). J'ai répondu que j'étais un conservateur russe, mais que j'aimais aussi Lynch.
Mon collègue a remarqué que dans Twin Peaks, toute l'action se déroule dans une petite ville américaine sans bourse ni migration, où vivent des Américains ordinaires et classiques, et où tout ce qui leur arrive a le charme de la tradition aux yeux des Américains modernes. Twin Peaks est une sorte d'utopie conservatrice. Les gens marchent lentement, tout le monde se connaît, ils sont familiers avec les particularités de chacun ; même si les relations sont parfois exotiques et surréalistes, il s'agit de relations humaines. Elles ne font pas partie de la machine urbaine. C'est une utopie rurale américaine.

Je n'avais pas envisagé Twin Peaks sous cet angle, mais j'ai été heureux de le soutenir. Peut-être que pour les Américains avec leur culture spécifique, Twin Peaks est l'Amérique profonde, une vision de l'Amérique défendue par ceux qui ne sont pas d'accord avec la mondialisation, le libéralisme de gauche, la société civile, Soros, Obama, Clinton.... En quelque sorte, l'électorat de Trump, ou les gens ordinaires.
Il est intéressant de constater que lorsque Lynch montre les habitants de Twin Peaks comme des personnes extrêmement étranges vivant au bord de la folie, impliquées dans les perversions les plus profondes et se tenant au seuil de l'au-delà (qui envahit de temps en temps leur vie) - il s'agit toujours d'un monde idéal, pastoral et positif comparé au cauchemar que représentent les grandes villes américaines - paysages urbains, Art nouveau américain, l'opposé du backwoods.
Si la schizophrénie surréaliste d'une petite ville américaine est une antithèse positive (aux yeux de certains conservateurs) de l'Amérique urbaine, de Wall Street et des grandes entreprises, cela en dit long sur la société américaine. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de voir Twin Peaks comme Macondo dans « Cent ans de solitude » de Marquez... Comme un monde idéal, une utopie. Et pour les Américains, peut-être une perspective possible...
Ensuite, nous avons parlé de la vraie Amérique, celle des petites villes comme Twin Peaks. J'ai noté comment Lynch reconstruit subtilement la structure à trois niveaux de l'image traditionnelle du monde. Avec de l'ironie, des rebondissements ironiques... Mais en fait, ce qui est étrange dans Twin Peaks, c'est que l'action se déroule sur trois niveaux à la fois.

Aussi étrange que cela puisse paraître, il s'agit d'une caractéristique traditionnelle du théâtre classique, où, outre les actions dans le monde du milieu, deux dimensions supplémentaires sont impliquées. Dans Twin Peaks, il s'agit de la Black Lodge et de la White Lodge. Elles sont en contact avec le monde de Twin Peaks - nous n'entendons pratiquement pas parler de la Loge Blanche, mais beaucoup de la Loge Noire. L'invasion de la vie mesurée de Twin Peaks par la Black Lodge crée des tourbillons, des distorsions de la vie spatiale et existentielle qui sont l'essence même du récit de Lynch.
En fait, Lynch reconstruit une ontologie tridimensionnelle, qui relève de la tradition classique du christianisme, des mythologies indo-européennes, des traditions non chrétiennes, grecques, etc.
Nous vivons dans l'une des dimensions, qui est conditionnellement au centre, et au-dessus et au-dessous de nous, il y a d'autres mondes. La Black Lodge de Lynch correspond à la mythologie classique, étant composée de nains ou de géants. Tous deux sont des types post-anthropologiques limites, entre lesquels nous trouvons l'humain. Les géants et les nains représentent des figures limitrophes nécessaires qui rappellent à l'homme la relativité de ses positions. De même, la présence de la Black Lodge et de la White Lodge souligne les limites de la compétence humaine. Là où commence la sphère d'influence de la Black Lodge, là explose la frontière de la compétence humaine. En particulier, Twin Peaks traite de l'invasion de Bob venu du monde inférieur, qui s'empare de Leland, le meurtrier, puis de Dale Cooper lui-même. C'est alors que la vision tridimensionnelle de la structure du monde change complètement d'accent: le surréalisme de Lynch cesse alors d'être dénué de sens comme il peut sembler l'être à première vue.
Lynch lui-même nous a dit que sa façon de faire un film n'est pas un scénario tout fait, mais plutôt un scénario qui est tourné et créé pendant qu'il est filmé. Ils savent seulement où ils vont - ils dessinent leur récit au fur et à mesure qu'ils se développent. Et parce qu'ils sont sensibles à l'influence des dimensions parallèles (en particulier la dimension inférieure), ils sont capables de reproduire brillamment l'atmosphère de suspense, les attentes.
Non seulement les spectateurs sont surpris par les rebondissements de l'intrigue, mais Lynch lui-même ne les connaît pas à l'avance. Il présente l'opportunité, et le film se tourne de lui-même. Cette attention aux dimensions supplémentaires (dont Lynch lui-même parle souvent) est le secret de la crédibilité de son film. Et Lynch lui-même est humble - il dit qu'il n'y a pas de réponse exacte. Qui a tué Laura Palmer ? En général, il ne voulait pas que le public discute de l'identité du meurtrier, mais la banale conscience américaine exigeait une fin heureuse, et les financiers étaient obligés d'accuser le père de Laura Palmer d'un crime irrationnel. Et ce, même si, dans la troisième saison, Lynch a ramené Laura Palmer à la vie, comme pour dire : « Vous pensiez avoir tout compris ? Vous n'avez rien compris. On ne comprend rien à Twin Peaks. Pour comprendre Twin Peaks, il faut vivre dans Twin Peaks, il faut entrer dans ce monde, il faut passer derrière les oscillations des invasions étranges qui, par une logique incompréhensible, sans l'algorithme habituel, se retrouvent dans la vie de la population, des citoyens de Twin Peaks, dont l'un parle avec son propre pied, l'autre - avec une bûche...
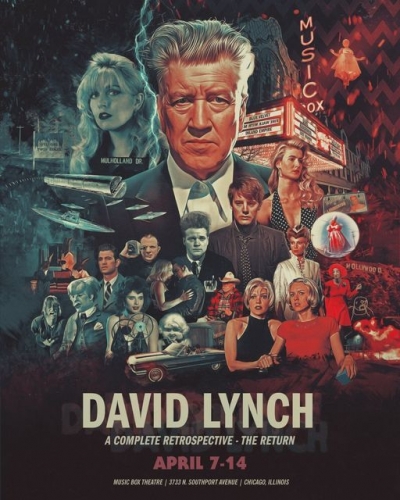
Mais progressivement, dans la conversation avec son pied, nous trouvons une référence à la philosophie du parlement des organes dans le post-moderne, la conversation d'une femme avec la bûche - ontologie orientée objet, quand la bûche est un certain sujet, ou même un objet radical qui supprime la complexité et l'intensité de la présence humaine dans le monde. Les visites périodiques de Lynch à la Black Lodge (on parle moins de la White Lodge - elle existe aussi, mais son influence est insensible, surtout dans le monde moderne) deviennent de plus en plus lumineuses et, dans un sens, on peut considérer la création de Lynch comme une chronique de l'invasion infernale, lorsque des entités intracorporelles pénètrent dans notre monde et commencent à l'influencer activement. Mais même si elle rencontre une certaine résistance, même la vie américaine traditionnelle est incapable de construire une véritable forteresse face à la Black Lodge, qui devient de plus en plus sûre d'elle, s'emparant de différents vecteurs, et nous entrons progressivement dans le domaine des miracles noirs.
La troisième saison, à mon avis, est beaucoup plus sombre que les précédentes - quelque chose a changé dans l'ontologie des Américains eux-mêmes, ou peut-être de chacun d'entre nous. La résurrection de Laura Palmer et son dernier cri (lorsqu'elle est morte et qu'il s'avère qu'elle ne l'était pas) sont comme le miracle noir de l'Antéchrist - c'est comme le miracle de la résurrection, mais il n'a pas de suite. Le noir ne signifie pas le fait d'être noir, mais un manque total de signification. Pour Laura Palmer, cette résurrection noire sans l'aide des forces de la lumière est une parodie fondamentale des temps récents.
En ce sens, Lynch dépeint l'invasion globale de ce qui se trouve sous la ligne de fond de la réalité humaine. En ce sens, son œuvre peut être considérée comme une preuve précieuse. Elle peut être interprétée comme postmoderne, mais le manque de sens de Lynch n'est pas une exploitation. C'est un point important, une hypothèse que j'ai émise au cours de cette conversation. Lynch est à égale distance de ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe dans le monde moderne ; il peut les aimer, les inspirer ou les effrayer, les attirer, mais il n'est pas l'un d'entre eux.
Ce qui le distingue des maîtres de la falsification et du codage à Hollywood, c'est qu'il n'exploite pas l'idiotie des masses (il ne libère pas les masses de l'idiotie, mais il ne les exploite pas non plus). Il est exactement à mi-chemin entre les révolutionnaires (les films d'art et d'essai, qui deviendront un cinéma culte, révélant toute la vie et la profondeur de la chute) et les masses (bien qu'il n'exploite pas les goûts de la foule). En cela, je pense qu'il est plus proche de Tarantino, car il est sur le fil. Il ne fait pas un pas ni vers les masses, ni pour les sortir de ce rêve.
Cette ambiguïté, cette dualité du propos cinématographique de Lynch crée l'ironie. En grec, « ironie » signifie dire une chose et en signifier une autre. C'est le sens d'une rhétorique basée sur la courbure d'un énoncé direct et logique.
Le langage et l'art de Lynch déforment la réalité de manière à ce que quelqu'un puisse voir une chose dans un énoncé tout en sous-entendant l'autre. Mais ce n'est pas tout à fait ainsi que cela fonctionne dans le cas de Lynch. J'aimerais beaucoup que les gens essaient d'interpréter ce que dit Lynch. Il dit « A » - nous comprenons qu'il veut dire quelque chose d'ironique, une autre lettre, une lettre que personne ne connaît. Mais ce qui est intéressant, c'est que Lynch ne la connaît pas non plus. C'est la dualité et l'ironie métaphysique profonde de ses films.
17:15 Publié dans Cinéma | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : david lynch, cinéma, alexandre douguine |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

David Lynch s’en est allé: un chaman du cinéma et un expérimentateur surréaliste
Le réalisateur de Dune et Twin Peaks est mort à 78 ans d’un emphysème
par Giovanni Balducci
Source: https://www.barbadillo.it/118442-se-ne-va-david-lynch-sciamano-del-cinema-e-sperimentatore-surrealista/
David Lynch s’en est allé : réalisateur, acteur, expérimentateur dans le domaine de la peinture, musicien, écrivain, un artiste aux multiples facettes. Jeune homme, il voyagea en Europe pour rencontrer les derniers représentants des avant-gardes du 20ème siècle. Après des années passées comme peintre et réalisateur de courts-métrages, il fit ses débuts dans le cinéma américain en 1977 avec son premier long-métrage, Eraserhead. Ce film, avec sa vague électrique sombre – qui deviendra la marque de toute son œuvre – éblouit la scène cinématographique mondiale.
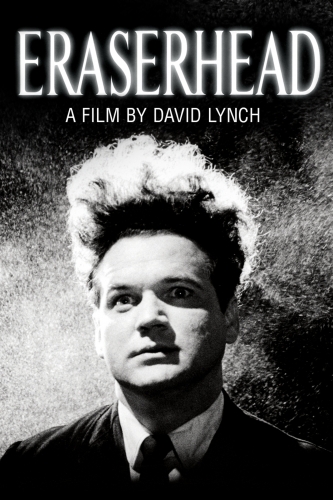
Humour noir et frisson métaphysique, les recoins secrets de la psyché (et son empire sans limites, comme dans Inland Empire), l’obsession et la folie (mais aussi la terreur d’être père, dans Eraserhead), la perversion et l’aspiration au ciel (admirablement exprimées dans l’épopée de Twin Peaks à travers l’ange/démon Laura Palmer), l’Amérique profonde avec ses collines verdoyantes et ses sombres mystères (qui servaient déjà de décor à Poe et Lovecraft), mais aussi l’univers tourbillonnant d’Hollywood (comme dans Mulholland Drive), les femmes fatales (comment oublier l’iconique Audrey Horne (photo), avec ses yeux félins et ses mouvements de déesse égyptienne) et le cabaret (on pense à l’envoûtante Isabella Rossellini – longtemps sa compagne – dans Blue Velvet), les danseuses, les nains… et les géants, les campus universitaires avec leurs reines de beauté et leurs brutes en cabriolet : toute l’épopée américaine, en somme, entre Gatsby le Magnifique et le capitaine Achab, se retrouve chez Lynch.

Le suspense du polar aux résonances ésotériques (pensons à l’agent du FBI aux pouvoirs ESP Dale Cooper, interprété par son acteur fétiche Kyle MacLachlan, ou à l’agent Gordon, qu’il incarnait lui-même dans Twin Peaks), les figures de puissants corrompus, liés à Bob, incarnation du Mal ontologique, et à la non moins terrifiante Jody ; la Loge noire et la Loge blanche, anges et démons, bons et méchants. Comme dans Dune, où l’on cherchait l’“Épice”, les entités errant autour de Twin Peaks préfèrent la “Garmonbozia” : une ambroisie extraite de la douleur humaine, tandis que ces mêmes humains se font la guerre pour de l’argent.

Tout cela, et bien plus encore, a été représenté par ce puissant “rêveur” qui vivait “à l’intérieur de son rêve”, pour reprendre l’expression de notre “Monica nationale” (Bellucci, ndlr).
À 78 ans, Lynch avait déjà révélé en 2024 la maladie dont il souffrait: un grave emphysème diagnostiqué après une vie passée à fumer des cigarettes (une habitude qu’il aimait autant que boire son “café noir”). Cette maladie l’empêchait probablement de reprendre une caméra hors de chez lui. Sa famille a annoncé son décès dans un post sur les réseaux sociaux, écrivant : « Il y a un grand vide dans le monde maintenant qu’il n’est plus avec nous. Mais, comme il le dirait lui-même : “Garde les yeux sur le donut, pas sur le trou.” »
Palme d’Or au Festival de Cannes, quatre fois nommé aux Oscars, Lynch a reçu un Oscar d’honneur pour l’ensemble de sa carrière en 2020, l’année de la pandémie, où il divertit son public avec des prévisions météorologiques improbables.
Explorer au-delà du théâtre des conventions humaines et de la banalité du quotidien les forces, matrices, signes et esprits d’un univers où tout est esprit, scrutant les profondeurs de la conscience humaine : tel était le cinéma de Lynch. Telle était la force qui animait Lynch. Un chaman et un métaphysicien hors norme. Le dernier des surréalistes.
Giovanni Balducci
18:56 Publié dans Cinéma, Hommages | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, hommage, david lynch, 7ème art |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Le Grand Bleu, le film le plus profond
par André Waroch
Luc Besson n’a pas toujours été cette odieuse caricature de notre époque, faisant assaut de bien-pensance à chacune de ses interviews. Il a commis, alors même qu’il était déjà au faîte de sa gloire, ce film prodigieux qu’est Le Grand Bleu. Prodigieux à plus d’un titre : d’abord parce que son succès est né d’un gigantesque malentendu, peut-être orchestré par un service com’ magnifiquement inspiré, qui aurait réussi à faire croire aux spectateurs qu’ils allaient voir une ode à la nature et à la mer avec des gentils dauphins qui nagent dedans.
Il se peut que personne, en réalité, n’ait compris ce film, et même que Luc Besson lui-même n’ait pas compris le film qu’il avait réalisé.
Le Grand Bleu n’est pas une ode à la nature, encore moins à la mer. La mer, dans le film, est ignoble, horrible. C’est un monstre, d’un bleu métallique quand on la voit depuis la terre, et d’un noir total dès qu’on y plonge un peu profond. Un monstre qui commence par emporter le père de Jacques Mayol sous les yeux de son fils encore enfant, lors d’une scène terrifiante, puis, à la fin du film, son meilleur et son seul ami. Et qui finit, selon toute vraisemblance, par l’emporter lui aussi. Les dauphins qui l’appellent dans ses hallucinations ne sont que l’autre visage de la mort et du suicide.
Jacques Mayol est un homme brisé, un homme dont l’âge socio-affectif a été arrêté vers dix ans, un homme dont le père est mort alors même que sa mère, dont on ne saura rien d’autre, était déjà définitivement partie dans son pays d’origine, les Etats-Unis. De l’autre côté de l’Atlantique…
A ce stade, on pourrait s’attendre à ce que la suite du film ne soit qu’une pleurnicherie pré-féministe, en mettant, à la place d’une femme aux cheveux gras et au regard vide jouée par Elodie Bouchez, un homme-victime pareillement penché sur son nombril, son passé et ses souffrances.

Il n’en est rien. Absolument rien. Et, il faut rendre justice à Luc Besson, il déteste les pleurnicheries qui pleurnichent dans le vide pendant deux heures et demie. Il lui faut une histoire, un enjeu, de l’action. C’est son côté mec.
Celui qui va sauver l’histoire, celui qui, en réalité, enclenche tout l’histoire, c’est Enzo Molinari.
Enzo, qui a légué son prénom à une génération entière de beaufs français, est la caricature absolue du macho italien : c’est un colosse, sûr de lui, parlant très fort, aimant bien manger, bien boire et aimant les femmes. Mais tout cela, finalement, n'est que secondaire. Et cela pourrait même être ridicule et pathétique s’il n’y avait, au centre de cette identité masculine, ce qui constitue, plus que toute autre chose, la masculinité: l’esprit de compétition poussé jusqu’à son paroxysme, celui qui pousse les hommes à se mesurer entre eux pour savoir qui est le meilleur. Les plus masculins, les plus virils, les plus testostéronés d’entre eux, y sacrifient leur vie, qu’il s’agisse de leur vie privée, souvent catastrophique puisqu’ils la considèrent comme quelque chose de secondaire, ou de leur vie au sens littéral.
Jacques Mayol, à première vue, est le contraire absolu d’Enzo : il fuit le monde, il fuit les humains, il se réfugie dans l’illusion morbide qu’il pourrait un jour ne jamais remonter de ses escapades aquatiques. Il est timide, il parle doucement, n’ose pas conclure avec Rosanna Arquette qui n’attend que ça, puisqu’il n’a selon toute vraisemblance jamais eu aucune relation sexuelle. Normalement, un type comme ça est écrasé, humilié, balayé sans un regard et sans remords par les types comme Enzo.
C’est pourtant Enzo, qui n’a jamais oublié son ami d’enfance, qui vient lui-même le chercher, lors d’une scène centrale qui n’a pas été comprise comme telle, dans ce film que finalement, répétons-le avec insistance, aucune critique, aucun journaliste, aucun spectateur n’a compris.
Il ne vient pas le chercher pour lui demander ce qu’il devient, se remémorer les vieux souvenirs. Il vient le chercher pour lui proposer de participer au championnat du monde de plongée en apnée. Et, quand, Mayol lui demande pourquoi il fait ça, Enzo a cette réponse lumineuse, claire comme de l’eau de roche :
« parce que tu meurs d’envie de me battre ».
Voilà ce qui rattache Jacques Mayol au monde des hommes, au monde du masculin : l’esprit de compétition poussé jusqu’à ses dernières extrémités. Voilà pourquoi Enzo le respecte alors qu’il devrait le mépriser et l’écraser.

Osons l’anachronisme : Le Grand Bleu est un film masculiniste, c’est-à-dire uniquement préoccupé par l’exploration de la psyché masculine. Les femmes, évidemment, sont présentes, puisqu’il n’y a pas de masculin sans féminin, de même qu’il n’y a pas de ying sans yang.
Il y a les vraies femmes : la mère d’Enzo, qu’on aperçoit à peine, et Rosanna Arquette, qui s’est entiché de Mayol. Elle est américaine, comme sa mère, énième fausse coïncidence de ce film aux profondeurs psychanalytiques. Et - beaucoup l’ont constaté mais aucun n’a osé l’écrire – son visage ressemble littéralement à celui d’un dauphin. Le dauphin au sens strict du terme, annoncé par la com’ de l’époque comme un personnage fondamental du film, n’apparait qu’épisodiquement, et toujours comme un symbole. Mais un symbole de quoi ?
Le dauphin, comme Rosanna Arquette, comme la mer (homophone de mère dans la langue natale Luc Besson), est la personnification de l’élément féminin. On ne le voit jamais lors des compétitions. Il apparait toujours quand cesse la lutte, quand disparaît le monde des hommes.
Il y a dans l’âme de Jacques Mayol deux pôles qui se battent pour la victoire. D’un côté, le pôle masculin, c’est-à-dire la lutte pour le titre de champion du monde, le nombre de mètres qui restent pour battre le record, la concentration, les chiffres, les muscles saillants sous l’écume. De l’autre, l’élément féminin, et c’est là que les choses se compliquent. Car deux éléments féminins se font face : d’un côté, le féminin positif incarné par Rosanna Arquette, sincèrement amoureuse, se projetant sincèrement dans un avenir amoureux avec un homme qu’elle espère arracher à ses démons intérieurs, et qui lui annonce qu’elle est enceinte de lui.
De l’autre côté, le féminin négatif, c’est-à-dire la mer, qui répétons-le, n’est en aucun cas présentée sous un jour favorable. Elle est une étendue bleue et noire, glacée, menaçante, impitoyable, et ne réserve en définitive que la mort aux hommes qui y plongent. Les dauphins ne sont que des faux amis, des sirènes dont la fonction est d’arracher Jacques au monde humain et de l’attirer dans les profondeurs glacées, c’est-à-dire vers la mort, ce dont on a confirmation définitive lors de la dernière scène, proprement terrifiante malgré la musique poétique d’Eric Serra.
Ainsi la mer aura tué le père de Jacques, puis Enzo, puis Jacques lui-même.
Alors pourquoi certains présentent-ils encore Le Grand Bleu comme « une ode à la mer » ?
20:25 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, luc besson |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
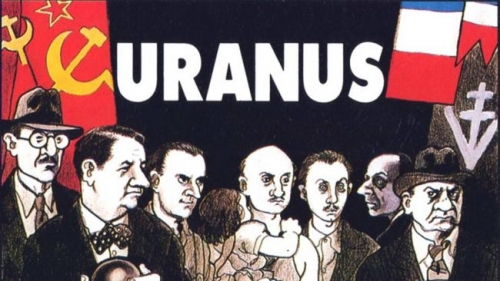
Uranus, ou Pétain sauvé des eaux
par André Waroch
Nous avions parlé récemment des films qui n'ont pas été compris - ou pas complètement compris - à leur époque, principalement en raison d'un manque de recul, ou d'une campagne de promotion trompeuse qui substitue l'idée du film au film lui-même.
Uranus appartient à une autre race de films : ceux que les journalistes et les critiques ont fait semblant de ne pas comprendre parce qu'ils contredisaient trop abruptement le politiquement correct, et qu'ils étaient produits et réalisés par des gens trop puissants et trop prestigieux pour qu'on puisse se permettre d'en appeler au scandale et au boycott. C'est le cas de Eyes wide shut de Stanley Kubrick. De Gran Torino de Clint Eastwood. Et d'Uranus de Claude Berri.
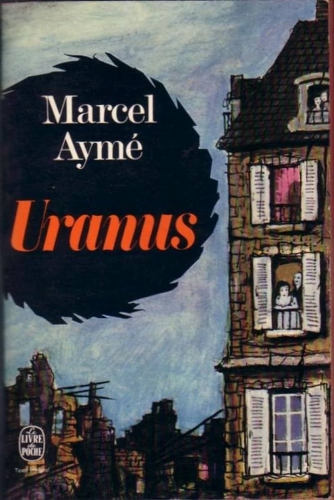
Si on analyse à l'os, si l'on oublie la propagande de ceux qui ont voulu nous faire passer des vessies pour des lanternes, Uranus, adaptation très fidèle d’un roman de Marcel Aymé, n'est rien de moins qu'une réhabilitation du pétainisme, de la collaboration, et une condamnation ferme de l'épuration et, par-dessus tout, du parti communiste. Ce parti communiste qui profite de la situation d'exception qui prévaut dans l'immédiat après-guerre, alors que l'ancien régime est tombé et que le nouveau est en train de se mettre en place, pour éliminer la concurrence, en lançant des accusations de collaboration souvent fictives, quitte à envoyer des innocents en prison ou au peloton.
Qui pouvait se permettre de sortir un film pareil, à part Claude Berri, le dernier nabab du cinéma français, producteur et réalisateur, dont les trois derniers films mis en scène à ce moment (Tchao Pantin Jean de Florette et Manon des sources) sont trois triomphes, Claude Berri, juif victime des persécutions de l'occupant allemand ?

Pour taper encore plus fort, il lance les plus grands acteurs du cinéma français à l'assaut de la citadelle du mensonge. Il s’agit tout simplement du casting le plus impressionnant de ces cinquante dernières années : Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Philippe Noiret, Fabrice Luchini, Michel Galabru, Michel Blanc et Daniel Prévost, qui dit mieux ?
Ayant ainsi terrorisé d’avance les journalistes et les critiques, Berri peut laisser tranquillement et implacablement se dérouler l’histoire, qui apparaît comme un engrenage fatal ne pouvant aboutir qu’à son horrible et inéluctable dénouement.
Depardieu campe Léopold, un tenancier de bistrot, alcoolique jusqu'à l'extrême, véritable colosse, fort en gueule, sympathique et sans filtre : c'est lui qui va jouer, en quelque sorte, le rôle de bouffon du roi, qui non seulement sait tout -comme tout le monde- mais aussi dit tout, ce qui finira par lui coûter la vie.

Luchini, à rebours des films médiocres de ces dernières années qui ne reposent trop souvent que sur sa propension au cabotinage, incarne Jourdan, un idéologue communiste, fanatique, rentré, glacé, ne rêvant que de censure, de terreur, d'emprisonnement des opposants politiques et de la future dictature du prolétariat. Il s’oppose en cela à Gaigneux (Michel Blanc), autre figure locale du PC, resté humain malgré tout.
Quant à Marielle, moins éclatant que d’habitude dans le rôle d’Archambaud, homme sobre et mesuré, il est le Français moyen de la bourgeoisie moyenne, pétainiste « comme tout le monde » pendant la guerre, voyant et entendant, avec un écoeurement qu’il n’arrive pas à dissimuler, les vestes se retourner et les armes automatiques changer de main. Comble du sacrilège anti-politiquement correct, il accepte de cacher chez lui de façon héroïque (c’est ainsi que le film le présente) Maxime Loin, ancien milicien, recherché par les autorités avec la certitude de finir devant un peloton d’exécution.
Brochard (Daniel Prévost, toujours formidable dans les rôles d’ordure) le troisième communiste, est un personnage plus ambivalent : véritable barbare qui crève les yeux des miliciens, mesquin et méchant au point de faire mettre Léopold en prison après l’avoir accusé gratuitement, pour se venger d’une humiliation, de cacher Maxime Loin, il accepte de tenir le bistrot pendant la détention de Léopold, à la demande celui-ci.
Ainsi, Claude Berri et Marcel Aymé (le roman et le film sont quasiment identiques) sauvent partiellement Gaigneux et Brochard, qui chacun à leur manière gardent intacte leur part d’humanité. Ils ne sauvent pas Jourdan, Jourdan qui refuse la vie, qui refuse la complexité de la vie humaine, qui veut l’écraser sous le dogme et l’idéologie.
Par contre, ils sauvent un autre idéologue fanatique, mais de l’autre bord, Maxime Loin, présenté comme un pauvre hère, victime de ses mauvais choix, qui aurait pu gagner, et qui n’a pas forcément tort, détestant d’ailleurs Pétain qui selon lui aurait fait perdre l’Allemagne.
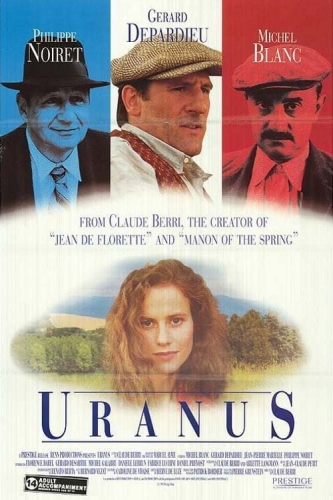
Deux personnages apparaissent comme un peu au-dessus, ou à côté, de la mêlée: Watrin (Philippe Noiret, pour une fois supportable) étrange personnage, qui ne voit tous ces évènements que comme des espiègleries de la race humaine, qui s’affirme détaché de tout mais qui aide tout de même Archambaud à cacher Maxime Loin. Et Monglat (Michel Galabru) le notable suprême, le commerçant, guidé seulement par l’appât du gain et par une véritable perversité, le vrai chef de la ville, qui n’a aucune conviction particulière, mais qui a fait fortune en faisant affaire sans vergogne avec les autorités allemandes, malgré tout cela intouchable, plus puissant encore que les communistes, et qui fait assassiner Léopold par la gendarmerie après que celui-ci, dans une crise d’éthylisme, en réveillant toute la ville en pleine nuit avec un haut-parleur, ait révélé la vérité à son sujet.
Il était déjà stupéfiant que Marcel Aymé ose sortir un tel roman juste après la guerre. Il l’est, encore plus que Claude Berri, malgré son histoire personnelle, adapte son roman, sans l’édulcorer en rien, en 1990, en recrutant une telle équipe pour interpréter la galerie des personnages forgés par Aymé.
Nous vivons sur un mensonge, ou plutôt sur un catalogue de mensonges, sur une mythologie de mensonges, et cette mythologie a commencé à s’écrire pendant cette période de l’immédiat après-guerre, sous la plume des gaullistes et des communistes, paraphant ainsi un nouveau pacte de non-agression, sinon d’alliance plus ou moins occulte.
19:21 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : cinéma, film, marcel aymé, claude berri, uranus |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Smile 2, dites cheese et mourez
André Waroch
Le film d’horreur a trop longtemps été confisqué par des producteurs avides qui ne pensent qu’à créer des produits formatés pour les bandes d’ados qui fréquentent les salles obscures ; frayeurs attendues, procédés répétitifs, et schémas narratifs convenus dont s’était moqué Wes Craven dans Scream, mise en abime des films d’épouvante hollywoodiens.
L’intelligence diabolique de Smile II (dont le schéma narratif de base depuis le premier épisode est la malédiction qui se transmet par contagion, déjà vu notamment dans le très bon It follows) est de choisir un personnage principal dont on jurerait qu’il est effectivement confectionné par le service marketing pour attirer des bandes d’adolescents ; ce personnage principal est une star de la chanson, un mélange entre Lady Gaga, Miley Cyrus, Beyonce, Pink (rajoutez les noms que vous voulez). On la voit répéter ses chorégraphies en petite tenue en vue de sa prochaine tournée, aux côtés de sa mère qui la coache, de ses assistants gays et de ses danseurs.

Mais, de même que la réussite d’Alien et la crédibilité d’un sujet à première vue abracadabrantesque était avant tout due au réalisme total avec lequel Ridley Scott filmait l’équipage du Nostromo avant tout contact avec la créature, de la même façon, Parker Finn installe la crédibilité de son film, avant l’apparition de tout élément surnaturel, en dépeignant le quotidien d’une popstar idole des jeunes exactement à l’inverse de la façon dont le service marketing le dépeindrait : Skye Riley (Naomi Scott, extraordinaire de vérité) mène une existence solitaire, sinistre, consacrée à un métier qu’elle n’a même pas l’air de vraiment aimer. Elle n’est pas encore remise, ni moralement ni physiquement, d’un accident de voiture qui s’est produit un an auparavant et qui a stoppé net sa carrière, alors qu’elle et son petit ami étaient camés jusqu’aux yeux. Le petit ami y est resté, Riley s’en est sortie avec de très graves blessures, de larges cicatrices qu’elle cache avec des vêtements ajustés, et des douleurs subites au dos qui la foudroient et la laissent exsangue. Pourtant, elle parait déterminée à opérer un come-back.
Cherchant des médicaments de nature à faire taire les douleurs dorsales qui troublent ses entrainements et pourraient gâcher son spectacle, elle va voir en cachette son ancien dealer. C’est lui qui va se suicider devant ses yeux, lors d'une scène absolument traumatisante, selon le même procédé déjà vu dans Smile I : le témoin du suicide se voit rongé par la même force qui a envouté le suicidé ; à partir de là, il ne lui reste que quelques jours à vivre, des jours peuplés de cauchemars, d’hallucinations de plus en plus horribles, avec toujours ce même terrible sourire arboré par des personnes réelles, ou par des personnes disparues, ou par des personnes réelles mais qui ne sont en réalité pas là du tout. Car, au fur et à mesure que le mal progresse, la victime ne sait plus ce qui relève de l’illusion et ce qui relève de la réalité.
Contrairement à It follows, où les non-envoutés finissent par constater l’existence des zombies invisibles qui poursuivent chaque nouveau condamné, et mis à part le mode de transmission et la chaîne de transmission, rien ne prouve jamais aux autres qu’il s’agit de quoique ce soit d’autre qu’une maladie mentale, voire d’une maladie tout court ; Maupassant, lui aussi, avait contracté une maladie qui lui provoquait des hallucinations, des phases délirantes, une perte de contact progressive avec la réalité, et qui finit par l’emporter, même s’il fallut quinze ans pour cela: la syphilis. Il se servit d’ailleurs de ces phases hallucinatoires pour mettre au point sa célèbre nouvelle Le horla, sa seule (ou quasi) incursion dans le domaine du fantastique (contrairement aux âneries inlassablement répétées à ce sujet). Maupassant tenta lui aussi de se suicider, avant d’être enfermé à l’asile et d’y mourir dix-huit mois plus tard.

Il n’y a pas de fantaisie dans Smile II, pas de second degré, pas d’extravagance, pas de dérision. Le gore n’est utilisé que pour rendre la mort et sa violence aussi authentiques que possible. Ce réalisme total rend certaines scènes presque insoutenables. Il ne dessert pas l'horreur, il décuple son impact. Ce film, comme l'étrange virus dont il raconte la progression dans un cerveau humain, est un poison qui s’infiltre dans les fibres et les tripes du spectateur, un film hanté, un film qui rampe lentement, dans l’obscurité, jusqu’à son dénouement inéluctable.
Smile II, comme le I, mais avec plus d’âpreté, de virtuosité dans la mise en scène, avec une musique additionnelle plus travaillée et envoutante, et une actrice principale étourdissante, est un film sans issue, sans espoir, sans chaleur, mais dont le talent et l’inspiration habitent chaque plan.
Si Smile II mérite le titre de film d’horreur, c’est au sens de l’horreur de l’irruption de la mort, de sa monstrueuse fatalité, de sa logique impitoyable, dans la vie des vivants, de leurs espoirs, de leurs rêves. La mort qui applique son propre programme, sa propre logique, sans trier entre les bons et les mauvais, entre les stars et les anonymes, entre les vieillards et les belles jeunes femmes, entre ceux qui mériteraient de continuer à vivre et les autres. Et l'on ne peut s'empêcher de nouveau de penser à Maupassant : "La vie si courte, si longue, devient parfois insupportable. Elle se déroule, toujours pareille, avec la mort au bout. On ne peut ni l’arrêter, ni la changer, ni la comprendre. Et souvent une révolte indignée vous saisit devant l’impuissance de notre effort. Quoi que nous fassions, nous mourrons ! Quoi que nous croyions, quoi que nous pensions, quoi que nous tentions, nous mourrons. Et il semble qu’on va mourir demain sans rien connaître encore, bien que dégoûté de tout ce qu’on connaît. »
19:08 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : smile 2, cinéma, film |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Delivrance ou la mort du grand Pan
André Waroch
Le gauchisme n’a pas que du mauvais. Ainsi le mouvement soixante-huitard américain nous débarrassa-t-il du carcan puritain qui obligeait jusque là Hollywood à mettre en scène des héros au cœur pur défenseurs de la veuve et de l’orphelin. Les années soixante-dix vont réinventer le cinéma dans tous les domaines, avant qu’un nouveau puritanisme, le politiquement correct, ne prenne le pouvoir dans les années quatre-vingt. Entre les deux bien-pensances, dix ou quinze ans de films d’une audace incroyable, financés par des producteurs fous.
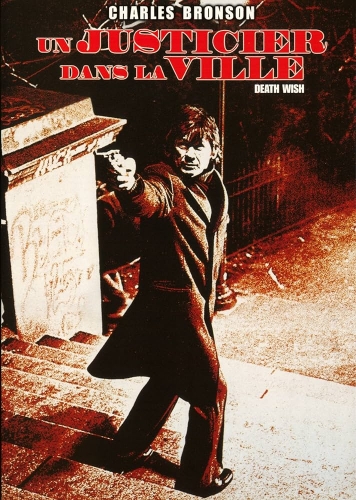
Mais cette révolution n’a pas libéré que les « progressistes ». Ainsi verra-t-on surgir bon nombre de films réactionnaires, répressifs, héroïques, qui n’ont absolument rien à faire avec la morale de gauche, mais qui n’avaient pas non plus le droit d’exister sous l’ère John Wayne. Les films de Clint Eastwood ou ceux de Charles Bronson en sont un bon exemple, en particulier Un justicier dans la ville, où un bourgeois excédé se promène dans New-York, Magnum 357 dans la poche, et se met à flinguer à vue la racaille, dont une bonne moitié de Noirs.

Où situer Délivrance ? Déjà, resituer le film dans l’œuvre de John Boorman, Nietszchéen par excellence, conservateur par essence, comme il le prouva ultérieurement avec La forêt d’émeraude, film-plaidoyer dénonçant la destruction de l’habitat naturel des indiens d’Amazonie (l’éradication de la nature, due à une conception desséchée du monde qui met l’humain et la rationalité au centre de tout, est de gauche par essence) ou la mise en scène des mythes arthuriens dans son fameux Excalibur.

Délivrance met en scène quatre citadins voulant descendre le cours d’une rivière sauvage, alors que l’ensevelissement de ladite rivière et de l’ensemble de la vallée qui l’entoure par un lac artificiel est déjà programmée. Ces hommes vont rencontrer une population de rednecks oubliée, immensément arriérée, en sursis comme le pays qu’elle habite.
L’incontestable leader du groupe, c'est Lewis, Nietszchéen en acte, qui méprise la mollesse de son époque. Sûr de lui, bras musculeux en avant, il cherche l’authenticité et la vérité en voulant redevenir un homme des bois. Inversant le sens du « retour à la terre » prôné par les hippies pacifistes, il prône le recours aux forêts, en appelle à la violence rédemptrice, à la chasse et à la guerre à l’arme blanche, au combat régénérateur pour la survie dans une nature sauvage et indomptée.
Il y a Bobby, sorte d’antithèse de Ed, gras, méprisant, jugeant et mesurant tout ce qu’il voit à l’aune de la seule chose qu’il connaisse, la vie moderne. La nature n’est pour lui qu’un objet de consommation parmi d’autres, à part peut-être quand elle existe par elle-même, qu’elle n’est pas prévue pour le confort des humains, quand par exemple il s’agit d’une forêt primaire comme celle au milieu de laquelle ils vont naviguer. Dans ce cas très précis, la nature lui apparaît comme une anomalie à éradiquer, comme les Amérindiens encore païens sont apparus à ces authentiques fanatiques religieux qu'étaient les conquistadors. Bobby épouse totalement leur héritier, le fanatisme moderniste évangélisateur. Mais aucun mysticisme chez lui. Il vit, travaille et mange sans se poser aucune question, parfaitement à l’aise dans le monde urbain qu’il habite, et trouvant parfaitement normal que le monde se bétonnise peu à peu totalement.
Drew est une sorte de scout, macroniste avant la lettre, jouant de la guitare, portant sur tout ce qu'il voit un regard candide. Un peu comme Bobby, mais dans un autre style, il croit à la démocratie, à la civilisation.
Quant à Ed, il est finalement le plus subtil, le moins caricatural des quatre, trimbalant sa pipe en promenant sur toute chose un regard songeur et contemplatif. Les trois autres, en réalité, représentent les trois tendances de son esprit indécis. Ed est tiraillé entre l’appel de la forêt et le confort de sa petite vie. Il n’est pas fixé. Il se cherche.

L’opposition la plus frontale, sur le plan philosophique et humain, a lieu entre Lewis et Bobby. Comme à l'occasion de ce mini-dialogue entre les deux personnages après une descente de rapides particulièrement musclée :
- On l’a vaincu, Lewis ! On a vaincu cette rivière !
- Non, répond Lewis, elle est invincible.
Dans l’euphorie de ce qu’il considère comme une victoire sur une nature encore vierge et non domestiquée, Bobby cherche à créer une camaraderie de vainqueurs entre lui et son co-pilote de canoé. Lewis, en une réponse définitive, lui signifie là où vont ses allégeances, établissant ainsi entre eux deux une séparation et une hostilité difficilement surmontables.
Puis, lors d’une scène qui appartient à l’histoire du cinéma, Ed et Bobby, ayant fait halte sur les berges en pleine forêt vierge, se font agresser par deux autochtones menaçants et armés, surgis d’on ne sait où. L’un deux finit par violer le gros Bobby sous les yeux de son ami, avant de se faire tuer d’une flèche par Lewis arrivé à la rescousse, pendant que l’autre parvient à s’enfuir.
Ces deux autochtones, bien que revêtant le même aspect pouilleux, brutal et dégénéré que les autres habitants de la vallée rencontrés par le groupe avant de commencer la descente de la rivière, n’apparaissent pas une seule fois avant cette scène et disparaissent totalement par la suite. Personne ne saura jamais qui ils sont, d’où ils viennent, ni s’ils avaient prémédité leur crime.
Rien de moins anecdotique, en réalité, que cette histoire racontée par Boorman. Tout y est message, tout y est symbole, tout y est de l’ordre du subliminal. Et rien de moins gratuit que ce viol ignoble commis par deux êtres surgis du néant.
Boorman, rompant avec toute la tradition chrétienne et occidentale, met en scène, de la manière la plus délibérément radicale, la vengeance de la nature, de la nature qui s’apprête à être souillée une fois de plus. Elle envoie pour cela deux fantasmagoriques hommes des bois, représentants d’une population ancienne, présentée comme primitive et consanguine, mais qui aura pourtant réussi à vivre pendant plusieurs siècles au coeur d’une gigantesque étendue sauvage sans jamais avoir l’idée d’y construire des hôtels, des banques et des supermarchés. Et cette vengeance s’exerce sur le plus parfait représentant de la bonne conscience éradicatrice occidentale.
Après ce viol, les quatre hommes ont une âpre discussion, et, sous l'impulsion de Lewis, décident de ne pas prévenir la police et d'enterrer le corps, sachant que la vallée est sur le point d'être inondé et que personne ne le retrouvera jamais.

S'ensuit une scène qui, si on s'en tient à la simple rationalité du récit, n'a absolument aucun sens : les quatre hommes, de manière totalement absurde, sans aucun motif, déplacent le corps à plusieurs dizaines de mètres de là, ahanant et trébuchant, alors qu'ils auraient très bien pu l'enterrer sur place.
Boorman veut tourner cette scène parce que, consciemment ou inconsciemment, il veut filmer cet incroyable tableau qui montre Ed, Lewis, Bobby et Drew transporter leur victime suppliciée, les bras en croix.
C'est en réalité, à un véritable rituel auquel on assiste. Et, comme chacun le sait, ou comme le savent ceux qui ont déjà assisté à des cérémonies funèbres, quatre est le nombre règlementaire des proches chargés de porter le cercueil du mot.
Mais qui est celui qu'on on enterre ? Qui est-il réellement ?

Voilà, à mon sens, l'ultime vérité de ce film : cet homme n'est pas un homme. Il est la personnification de la nature sauvage et indomptée. Cet homme, c'est Pan, le dieu de la nature chez les grecs, d'une laideur inouïe, obsédé sexuel, qui rôdait par les campagnes et les bois, Pan qui poursuivait ses victimes pour les violer. Pan, le seul dieu de la mythologie grecque qui soit mort, sous la plume de Plutarque.
C'est donc en 1972, sous l'oeil de la caméra de John Boorman, que que le grand Pan fut assassiné une seconde fois par des citadins en week-end, dans une des dernières forêts primaires des Etats-Unis, qu'il y fut enterré, que sa tombe fut ensuite recouverte par d'infinies trombes d'eau, et que la nature sauvage disparut définitivement. Ad maiorem Dei gloriam.
14:56 Publié dans Cinéma, Film | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : john boorman, film, cinéma |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook

Parution du numéro 477 du Bulletin célinien
 Sommaire :
Sommaire :
Entretien avec Émile Brami
Céline vu par un oxfordien. Une lecture de Guerre
Un poème de Charles Bukowski sur Céline
Dans la bibliothèque de Céline. Ouverture
Philippe Sollers, un an déjà…



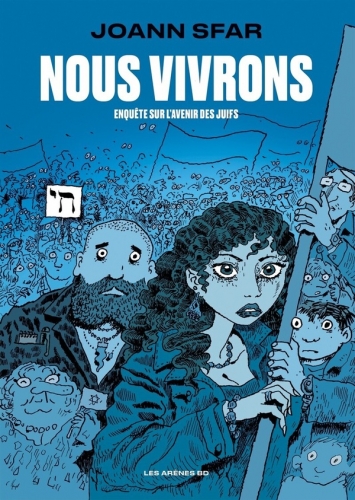

14:18 Publié dans Cinéma, Film, Littérature, Revue | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : louis-ferdinand céline, joann sfar, lettres, lettres françaises, littérature française, littérature, cinéma, film |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook