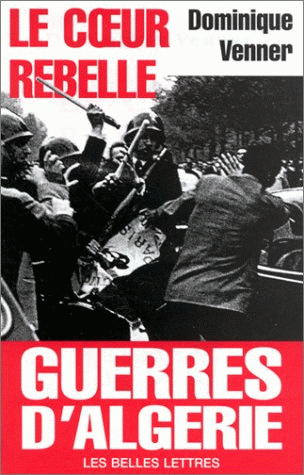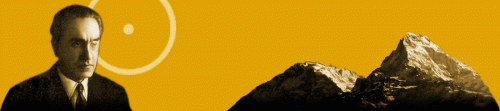Robert STEUCKERS: Pour préciser les positions de "Synergies Européennes" (2)
Propos recueillis par Pieter Van Damme
Pourquoi Synergies accorde-t-elle tant d'attention à la Russie, outre le fait que ce pays fasse partie de l'ensemble eurasien?
L'attention que nous portons à la Russie procède d'une analyse géopolitique de l'histoire européenne. La première intuition qui a mobilisé nos efforts depuis près d'un quart de siècle, c'est que l'Europe, dans laquelle nous étions nés, celle de la division sanctionnée par les conférences de Téhéran, Yalta et Postdam, était invivable, condamnait nos peuples à sortir de l'histoire, à vivre une stagnation historique, économique et politique, ce qui, à terme, signifie la mort. Bloquer l'Europe à hauteur de la frontière entre l'Autriche et la Hongrie, couper l'Elbe à hauteur de Wittenberge et priver Hambourg de son hinterland brandebourgeois, saxon et bohémien, sont autant de stratégies d'étranglement. Le Rideau de Fer coupait l'Europe industrielle de territoires complémentaires et de cette Russie, qui, à la fin du XIXième siècle, devenait le fournisseur de matières premières de l'Europe, la prolongation vers le Pacifique de son territoire, le glacis indispensable verrouillant le territoire de l'Europe contre les assauts des peuples de la steppe qu'elle avait subis jusqu'au XVIième siècle. La propagande anglaise décrivait le Tsar comme un monstre en 1905 lors de la guerre russo-japonaise, favorisait les menées séditieuses en Russie, afin de freiner cette synergie euro-russe d'avant le communisme. Le communisme, financé par des banquiers new-yorkais, tout comme la flotte japonaise en 1905, a servi à créer le chaos en Russie et à empêcher des relations économiques optimales entre l'Europe et l'espace russo-sibérien. Exactement comme la révolution française, appuyé par Londres (cf. Olivier Blanc, Les hommes de Londres, Albin Michel), a ruiné la France, a annihilé tous ses efforts pour se constituer une flotte atlantique et se tourner vers le large plutôt que vers nos propres territoires, a fait des masses de conscrits français (et nord-africains) une chaire à canon pour la City, pendant la guerre de Crimée, en 1914-1918 et en 1940-45. Une France tournée vers le large, comme le voulait d'ailleurs Louis XVI, aurait engrangé d'immenses bénéfices, aurait assuré une présence solide dans le Nouveau Monde et en Afrique dès le XVIIIième siècle, n'aurait probablement pas perdu ses comptoirs indiens. Une France tournée vers la ligne bleue des Vosges a provoqué sa propre implosion démographique, s'est suicidée biologiquement. Le ver était dans le fruit: après la perte du Canada en 1763, une maîtresse hissée au rang de marquise a dit: "Bah! Que nous importent ces quelques arpents de neige" et "après nous, le déluge". Grande clairvoyance politique! Qu'on peut comparer à celle d'un métapolitologue du 11ième arrondissement, qui prend de haut les quelques réflexions de Guillaume Faye sur l'“Eurosibérie”! En même temps, cette monarchie française sur le déclin s'accrochait à notre Lorraine impériale, l'arrachait à sa famille impériale naturelle, scandale auquel le gouverneur des Pays-Bas autrichiens, Charles de Lorraine n'a pas eu le temps de remédier; Grand Maître de l'Ordre Teutonique, il voulait financer sa reconquête en payant de sa propre cassette une armée bien entraînée et bien équipée de 70.000 hommes, triés sur le volet. Sa mort a mis un terme à ce projet. Cela a empêché les armées européennes de disposer du glacis lorrain pour venir mettre un terme, quelques années plus tard, à la comédie révolutionnaire qui ensanglantait Paris et allait commettre le génocide vendéen. Pour le grand bénéfice des services de Pitt!
Dans l'état actuel de nos recherches, nous constatons d'abord que le projet de reforger une alliance euro-russe indéfectible n'est pas une anomalie, une lubie ou une idée originale. C'est tout le contraire! C'est le souci impérial récurrent depuis Charlemagne et Othon I! Quarante ans de Guerre Froide, de division Est-Ouest et d'abrutissement médiatique téléguidé depuis les Etats-Unis ont fait oublier à deux ou trois générations d'Européens les ressorts de leur histoire.
Le limes romain sur le Danube
Ensuite, nos lectures nous ont amenés à constater que l'Europe, dès l'époque carolingienne, s'est voulue l'héritière de l'Empire romain et a aspiré à restituer celui-ci tout le long de l'ancien limes danubien. Rome avait contrôlé le Danube de sa source à son embouchure dans la Mer Noire, en déployant une flotte fluviale importante, rigoureusement organisée, en construisant des ouvrages d'art, dont des ponts de dimensions colossales pour l'époque (avec piliers de 45 m de hauteur dans le lit du fleuve), en améliorant la technique des ponts de bateaux pour les traversées offensives de ses légions, en concentrant dans la trouée de Pannonie plusieurs légions fort aguerries et disposant d'un matériel de pointe, de même que dans la province de Scythie, correspondant à la Dobroudja au sud du delta du Danube. L'objectif était de contenir les invasions venues des steppes surtout au niveau des deux points de passage sans relief important que sont justement la plaine hongroise (la "puszta") et cette Dobroudja, à la charnière de la Roumanie et de la Bulgarie actuelles. Un empire ne pouvait éclore en Europe, dans l'antiquité et au haut moyen âge, si ces points de passage n'étaient pas verrouillés pour les peuples non européens de la steppe. Ensuite, dans le cadre de la Sainte-Alliance du Prince Eugène (cf. infra), il fallait les dégager de l'emprise turque ottomane, irruption étrangère à l'européité, venue du Sud-Est. Après les études de l'Américain Edward Luttwak sur la stratégie militaire de l'Empire romain, on constate que celui-ci n'était pas seulement un empire circum-méditerranéen, centré autour de la Mare Nostrum, mais aussi un empire danubien, voire rhéno-danubien, avec un fleuve traversant toute l'Europe, où sillonnait non seulement une flotte militaire, mais aussi une flotte civile et marchande, permettant les échanges avec les tribus germaniques, daces ou slaves du Nord de l'Europe. L'arrivée des Huns dans la trouée de Pannonie bouleverse cet ordre du monde antique. L'étrangeté des Huns ne permet pas de les transformer en Foederati comme les peuples germaniques ou daces.
Les Carolingiens voudront restaurer la libre circulation sur le Danube en avançant leurs pions en direction de la Pannonie occupée par les Avars, puis par les Magyars. Charlemagne commence à faire creuser le canal Rhin-Danube que l'on nommera la Fossa Carolina. On pense qu'elle a été utilisée, pendant un très bref laps de temps, pour acheminer troupes et matériels vers le Noricum et la Pannonie. Charlemagne, en dépit de ses liens privilégiés avec la Papauté romaine, souhaitait ardemment la reconnaissance du Basileus byzantin et envisageait même de lui donner la main d'une de ses filles. Aix-la-Chapelle, capitale de l'Empire germanique, est construite comme un calque de Byzance, titulaire légitime de la dignité impériale. Le projet de mariage échoue, sans raison apparente autre que l'attachement personnel de Charlemagne à ses filles, qu'il désirait garder près de lui, en en faisant les maîtresses des grands abbés carolingiens, sans la moindre pudibonderie. Cet attachement paternel n'a donc pas permis de sceller une alliance dynastique entre l'Empire germanique d'Occident et l'Empire romain d'Orient. L'ère carolingienne s'est finalement soldée par un échec, à cause d'une constellation de puissances qui lui a été néfaste: les rois francs, puis les Carolingiens (et avant eux, les Pippinides), se feront les alliés, parfois inconditionnels, du Pape romain, ennemis du christianisme irlando-écossais, qui missionne l'Allemagne du Sud danubienne, et de Byzance, héritière légale de l'impérialité romaine. La papauté va vouloir utiliser les énergies germaniques et franques contre Byzance, sans autre but que d'asseoir sa seule suprématie. Alors qu'il aurait fallu continuer l'œuvre de pénétration pacifique des Irlando-Ecossais vers l'Est danubien, à partir de Bregenz et de Salzbourg, favoriser la transition pacifique du paganisme au christianisme irlandais au lieu d'accorder un blanc seing à des zélotes à la solde de Rome comme Boniface, parce que la variante irlando-écossaise du christianisme ne s'opposait pas à l'orthodoxie byzantine et qu'un modus vivendi aurait pu s'établir ainsi de l'Irlande au Caucase. Cette synthèse aurait permis une organisation optimale du continent européen, qui aurait rendu impossible le retour des peuples mongols et les invasions turques des 10ième et 11ième siècles. Ensuite, la reconquista de l'Espagne aurait été avancée de six siècles!
[Pour en savoir plus: Robert STEUCKERS, «Mystères pontiques et panthéisme celtique à la source de la spiritualité européenne», in: Nouvelles de Synergies européennes, n°39, 1999].
Après Lechfeld en 955, l'organisation de la trouée pannonienne
Ces réflexions sur l'échec des Carolingiens, exemplifié par la bigoterie stérile et criminelle de son descendant Louis le Pieux, démontre qu'il n'y a pas de bloc civilisationnel européen cohérent sans une maîtrise et une organisation du territoire de l'embouchure du Rhin à la Mer Noire. D'ailleurs, fait absolument significatif, Othon I reçoit la dignité impériale après la bataille de Lechfeld en 955, qui permet de reprendre pied en Pannonie, après l'élimination des partisans du khan magyar Horka Bulcsu, et l'avènement des Arpads, qui promettent de verrouiller la trouée pannonienne comme l'avaient fait les légions romaines au temps de la gloire de l'Urbs. Grâce à l'armée germanique de l'Empereur Othon I et la fidélité des Hongrois à la promesse des Arpads, le Danube redevient soit germano-romain soit byzantin (à l'Est des "cataractes" de la Porte de Fer). Si la Pannonie n'est plus une voie de passage pour les nomades d'Asie qui peuvent disloquer toute organisation politique continentale en Europe, ipso facto, l'impérialité est géographiquement restaurée.
Othon I, époux d'Adelaïde, héritière du royaume lombard d'Italie, entend réorganiser l'Empire en assurant sa mainmise sur la péninsule italique et en négociant avec les Byzantins, en dépit des réticences papales. En 967, douze ans après Lechfeld, cinq ans après son couronnement, Othon reçoit une ambassade du Basileus byzantin Nicéphore Phocas et propose une alliance conjointe contre les Sarrasins. Elle se réalisera tacitement avec le successeur de Nicéphore Phocas, plus souple et plus clairvoyant, Ioannes Tzimisces, qui autorise la Princesse byzantine Théophane à épouser le fils d'Othon I, le futur Othon II en 972. Othon II ne sera pas à la hauteur, essuyant une défaite terrible en Calabre en 983 face aux Sarrasins. Othon III, fils de Théophane, qui devient régente en attendant sa majorité, ne parviendra pas à consolider son double héritage, germanique et byzantin.
Le règne ultérieur d'un Konrad II sera exemplaire à ce titre. Cet empereur salien vit en bonne intelligence avec Byzance, dont les territoires à l'Est de l'Anatolie commencent à être dangereusement harcelés par les raids seldjoukides et les rezzou arabes. L'héritage othonien en Pannonie et en Italie ainsi que la paix avec Byzance permettent une véritable renaissance en Europe, confortée par un essor économique remarquable. Grâce à la victoire d'Othon I et à l'inclusion de la Pannonie des Arpad dans la dynamique impériale européenne, l'économie de notre continent entre dans une phase d'essor, la croissance démographique se poursuit (de l'an 1000 à 1150 la population augmente de 40%), le défrichage des forêts bat son plein, l'Europe s'affirme progressivement sur les rives septentrionales de la Méditerranée et les cités italiennes amorcent leur formidable processus d'épanouissement, les villes rhénanes deviennent des métropoles importantes (Cologne, Mayence, Worms avec sa superbe cathédrale romane).
Cet essor et le règne paisible mais fort de Konrad II démontrent que l'Europe ne peut connaître la prospérité économique et l'épanouissement culturel que si l'espace entre la Moravie et l'Adriatique est sécurisé. Dans tous les cas contraires, c'est le déclin et le marasme. Leçon historique cardinale qu'ont retenue les fossoyeurs de l'Europe: à Versailles en 1919, ils veulent morceler le cours du Danube en autant d'Etats antagonistes que possible; en 1945, ils veulent établir une césure sur le Danube à hauteur de l'antique frontière entre le Noricum et la Pannonie; entre 1989 et 2000, ils veulent installer une zone de troubles permanents dans le Sud-Est européen afin d'éviter la soudure Est-Ouest et inventent l'idée d'un fossé civilisationnel insurmontable entre un Occident protestant-catholique et un Orient orthodoxe-byzantin (cf. les thèses de Samuel Huntington).
Au Moyen Age, c'est la Rome papale qui va torpiller cet essor en contestant le pouvoir temporel des Empereurs germaniques et en affaiblissant de la sorte l'édifice européen tout entier, privé d'un bras séculier puissant et bien articulé. Le souhait des empereurs était de coopérer dans l'harmonie et la réciprocité avec Byzance, pour restaurer l'unité stratégique de l'Empire romain avant la césure Occident/Orient. Mais Rome est l'ennemie de Byzance, avant même d'être l'ennemie des Musulmans. A l'alliance tacite, mais très mal articulée, entre l'Empereur germanique et le Basileus byzantin, la Papauté opposera l'alliance entre le Saint-Siège, le royaume normand de Sicile et les rois de France, alliance qui appuie aussi tous les mouvements séditieux et les intérêts sectoriels et bassement matériels en Europe, pourvu qu'ils sabotent les projets impériaux.
Le rêve italien des Empereurs germaniques
Le rêve italien des Empereurs, d'Othon III à Frédéric II de Hohenstaufen, vise à unir sous une même autorité suprême les deux grandes voies de communication aquatiques en Europe: le Danube au centre des terres et la Méditerranée, à la charnière des trois continents. A rebours des interprétations nationales-socialistes ou folcistes ("völkisch") de Kurt Breysig et d'Adolf Hitler lui-même, qui n'ont eu de cesse de critiquer l'orientation italienne des Empereurs germaniques du Haut Moyen Age, force est de constater que l'espace entre Budapest (l'antique Aquincum des Romains) et Trieste sur l'Adriatique, avec, pour prolongement, la péninsule italienne et la Sicile, permettent, si ces territoires sont unis par une même volonté politique, de maîtriser le continent et de faire face à toutes les invasions extérieures: celles des nomades de la steppe et du désert arabique. Les Papes contesteront aux Empereurs le droit de gérer pour le bien commun du continent les affaires italiennes et siciliennes, qu'ils considéraient comme des apanages personnels, soustraits à toute logique continentale, politique et stratégique: en agissant de la sorte, et avec le concours des Normands de Sicile, ils ont affaibli leur ennemie, Byzance, mais, en même temps, l'Europe toute entière, qui n'a pas pu reprendre pied en Afrique du Nord, ni libérer la péninsule ibérique plus tôt, ni défendre l'Anatolie contre les Seldjoukides, ni aider la Russie qui faisait face aux invasions mongoles. La situation exigeait la fédération de toutes les forces dans un projet commun.
Par les menées séditieuses des Papes, des rois de France, des émeutiers lombards, des féodaux sans scrupules, notre continent n'a pas pu être "membré" de la Baltique à l'Adriatique, du Danemark à la Sicile (comme l'avait également voulu un autre esprit clairvoyant du XIIIième siècle, le Roi de Bohème Ottokar II Premysl). L'Europe était dès lors incapable de parfaire de grands desseins en Méditerranée (d'où la lenteur de la reconquista, laissée aux seuls peuples hispaniques, et l'échec des croisades). Elle était fragilisée sur son flanc oriental et a failli, après les désastres de Liegnitz et de Mohi en 1241, être complètement conquise par les Mongols. Cette fragilité, qui aurait pu lui être fatale, est le résultat de l'affaiblissement de l'institution impériale à cause des manigances papales.
De la nécessaire alliance des deux impérialités européennes
En 1389, les Serbes s'effondrent devant les Turcs lors de la fameuse bataille du Champ des Merles, prélude dramatique à la chute définitive de Constantinople en 1453. L'Europe est alors acculée, le dos à l'Atlantique et à l'Arctique. La seule réaction sur le continent vient de Russie, pays qui hérite ainsi ipso facto de l'impérialité byzantine à partir du moment où celle-ci cesse d'exister. Moscou devient donc la "Troisième Rome"; elle hérite de Byzance la titulature de l'impérialité orientale. Il y avait deux empires en Europe, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient; il y en a toujours deux malgré la chute de Constantinople: le Saint-Empire romain germanique et l'Empire russe. Ce dernier passe directement à l'offensive, grignote les terres conquises par les Mongols, détruit les royaumes tatars de la Volga, pousse vers la Caspienne. Par conséquent, tradition et géopolitique obligent: l'alliance voulue par les empereurs germaniques depuis Charlemagne entre Aix-la-Chapelle et Byzance, doit être poursuivie mais, dorénavant, par une alliance impériale germano-russe. L'Empereur d'Occident (germanique) et l'Empereur d'Orient (russe) doivent agir de concert pour repousser les ennemis de l'Europe (espace stratégique à deux têtes comme le symbolise l'aigle bicéphale) et dégager nos terres de l'encerclement ottoman et musulman, avec l'appui des rois locaux: rois d'Espagne, de Hongrie, etc. Telle est la raison historique, métaphysique et géopolitique de toute alliance germano-russe.
Cette alliance fonctionnera, en dépit de la trahison française. La France était hostile à Byzance pour le compte des Papes anti-impériaux de Rome. Elle participera à la destruction des glacis de l'Empire à l'Ouest et s'alliera aux Turcs contre le reste de l'Europe. D'où les contradictions insolubles des "nationalistes" français: simultanément, ils se réclament de Charles Martel (un Austrasien de nos pays d'entre Meuse et Rhin, appelé au secours d'une Neustrie et d'une Aquitaine mal organisées, décadentes et en proie à toutes sortes de dissensions, qui n'avaient pas su faire face à l'invasion arabe) mais ces mêmes nationalistes français avalisent les crimes de trahison des rois, cardinaux et ministres félons: François I, Henri II, Richelieu, Louis XIV, Turenne, voire des séides de la Révolution, comme si, justement, Charles Martel l'Austrasien n'avait jamais existé!
L'Alliance austro-russe fonctionne avec la Sainte-Alliance mise sur pied par Eugène de Savoie à la fin du XVIIième siècle, qui repousse les Ottomans sur toutes les frontières, de la Bosnie au Caucase. L'intention géopolitique est de consolider la trouée pannonienne, de maître en service une flotte fluviale danubienne, d'organiser une défense en profondeur de la frontière par des unités de paysans-soldats croates, serbes, roumains, appuyés par des colons allemands et lorrains, de libérer les Balkans et, en Russie, de reprendre la Crimée et de contrôler les côtes septentrionales de la Mer Noire, afin d'élargir l'espace européen à son territoire pontique au complet. Au XVIIIième siècle, Leibniz réitère cette nécessité d'inclure la Russie dans une grande alliance européenne contre la poussée ottomane. Plus tard, la Sainte-Alliance de 1815 et la Pentarchie du début du XIXième siècle prolongeront cette même logique. L'alliance des trois empereurs de Bismarck et la politique de concertation avec Saint-Pétersbourg, qu'il n'a cessé de pratiquer, sont des applications modernes du vœu de Charlemagne (non réalisé) et d'Othon I, véritable fondateur de l'Europe. Dès que ces alliances n'ont plus fonctionné, l'Europe est entrée dans une nouvelle phase de déclin, au profit, notamment, des Etats-Unis. Le Traité de Versailles de 1919 vise la neutralisation de l'Allemagne et son pendant, le Traité du Trianon, sanctionne le morcellement de la Hongrie, privée de son extension dans les Tatras (la Slovaquie) et de son union avec la Croatie créée par le roi Tomislav, union instaurée plus tard par la Pacta Conventa en 1102, sous la direction du roi hongrois Koloman Könyves ("Celui qui aimait les livres jusqu'à la folie"). Versailles détruit ce que les Romains avaient uni, restaure ce que les troubles des siècles sombres avaient imposé au continent, détruit l'œuvre de la Couronne de Saint-Etienne qui avait harmonieusement restauré l'ordre romain tout en respectant la spécificité croate et dalmate. Versailles a surtout été un crime contre l'Europe parce que cette nécessaire harmonie hungaro-croate en cette zone géographique clef a été détruite et a précipité à nouveau l'Europe dans une période de troubles inutiles, à laquelle un nouvel empereur devra nécessairement, un jour, mettre un terme. Wilson, Clemenceau et Poincaré, la France et les Etats-Unis, portent la responsabilité de ce crime devant l'histoire, de même que les tenants écervelés de cette éthique de la conviction (et, partant, de l'irresponsabilité) portée par le laïcisme de mouture franco-révolutionnaire. Derrière l'hostilité de façade à la religion catholique qu'elle professe, cette idéologie pernicieuse a agi exactement comme les papes simoniaques du Moyen Age: elle a détruit les principes d'organisation optimaux de notre Europe, ses adeptes étant aveuglés par des principes fumeux et des intérêts sordides, sans profondeur historique et temporelle. Principes et intérêts totalement inaptes à fournir les assises d'une organisation politique, pour ne même pas parler d'un empire.
Face à ce désastre, Arthur Moeller van den Bruck, figure de proue de la révolution conservatrice, lance l'idée d'une nouvelle alliance avec la Russie en dépit de l'installation au pouvoir du bolchevisme léniniste, car le principe de l'alliance des deux Empires doit demeurer envers et contre la désacralisation, l'horizontalisation et la profanation de la politique. Le Comte von Brockdorff-Rantzau appliquera cette diplomatie, ce qui conduira à l'anti-Versailles germano-soviétique: les accords de Rapallo signés entre Rathenau et Tchitcherine en 1922. De là, nous revenons à la problématique du "national-bolchevisme" que j'ai évoquée par ailleurs dans cet entretien.
Dans les années 80, quand l'évolution des stratégies militaires, des armements et surtout des missiles balistiques inter-continentaux, amène au constat qu'aucune guerre nucléaire n'est possible en Europe sans la destruction totale des pays engagés, il apparaît nécessaire de sortir de l'impasse et de négocier pour ré-impliquer la Russie dans le concert européen. Après la perestroïka, amorcée en 1985 par Gorbatchev, le dégel s'annonce, l'espoir reprend: il sera vite déçu. La succession des conflits inter-yougoslaves va à nouveau bloquer l'Europe entre la trouée pannonienne et l'Adriatique, tandis que les officines de propagande médiatique, CNN en tête, inventent mille et une raisons pour approfondir le fossé entre Européens et Russes.
Blocage des dynamiques européennes entre Bratislava et Trieste
Ces explications d'ordre historique doivent nous amener à comprendre que les soi-disant défenseurs d'un Occident sans la Russie (ou contre la Russie) sont en réalité les fossoyeurs papistes ou maçonniques de l'Europe et que leurs agissements condamnent notre continent à la stagnation, au déclin et à la mort, comme il avait stagné, décliné et dépéri entre les invasions hunniques et la restauratio imperii d'Othon I, à la suite de la bataille de Lechfeld en 955. Dès la ré-organisation de la plaine hongroise et son inclusion dans l'orbe européenne, l'essor économique et démographique de l'Europe ne s'est pas fait attendre. C'est une renaissance analogue que l'on a voulu éviter après le dégel qui a suivi la perestroïka de Gorbatchev, car cette règle géopolitique garantissant la prospérité est toujours valable (par exemple, l'économie autrichienne avait triplé son chiffre d'affaire en l'espace de quelques années après le démantèlement du Rideau de fer le long de la frontière austro-hongroise en 1989). Nos adversaires connaissent bien les ressorts de l'histoire européenne. Mieux que notre propre personnel politique pusillanime et décadent. Ils savent que c'est toujours là, entre Bratislava et Trieste, qu'il faut nous frapper, nous bloquer, nous étrangler. Pour éviter une nouvelle union des deux Empires et une nouvelle période de paix et de prospérité, qui ferait rayonner l'Europe de mille feux et condamnerait ses concurrents à des rôles de seconde zone, tout simplement parce qu'ils ne possèdent pas le vaste éventail de nos potentialités, fruits de nos différences et de nos spécificités.
Quelles sont les positions concrètes de Synergies Européennes sur des institutions comme le Parlement, la représentation populaire, etc.
La vision de "Synergies Européennes" est démocratique mais hostile à toutes les formes de partitocratie, car celle-ci, qui se prétend “démocratique”, est en fait un parfait déni de démocratie. Sur le plan théorique, "Synergies Européennes" se réclame d'un libéral russe du début du siècle, militant du Parti des Cadets: Moshe Ostrogovski. L'analyse que ce libéral russe d'avant la révolution bolchevique nous a laissée repose sur un constat évident: toute démocratie devrait être un système calqué sur la mouvance des choses dans la Cité. Les mécanismes électoraux visent logiquement à faire représenter les effervescences à l'œuvre dans la société, au jour le jour, sans pour autant bouleverser l'ordre immuable du politique. Par conséquent, les instruments de la représentation, c'est-à-dire les partis politiques, doivent, eux aussi, être transitoires, représenter les effervescences passagères et ne jamais viser à la pérennité. Les dysfonctionnements de la démocratie parlementaire découlent du fait que les partis deviennent des permanences rigides au sein des sociétés, cooptant en leur sein des individus de plus en plus médiocres. Pour pallier à cet inconvénient, Ostrogovski suggère une démocratie reposant sur des partis "ad hoc", réclamant ponctuellement des réformes urgentes ou des amendements précis, puis proclamant leur propre dissolution pour libérer leur personnel, qui peut alors forger de nouveaux mouvements pétitionnaires, ce qui permet de redistribuer les cartes et de répartir les militants dans de nouvelles formations, qui seront tout aussi provisoires. Les parlements accueilleraient ainsi des citoyens qui ne s'encroûteraient jamais dans le professionnalisme politicien. Les périodes de législature seraient plus courtes ou, comme au début de l'histoire de Belgique ou dans le Royaume-Uni des Pays-Bas de 1815 à 1830, le tiers de l'assemblée serait renouvelé à chaque tiers du temps de la législation, permettant une circulation plus accélérée du personnel politique et une élimination par la sanction des urnes de tous ceux qui s'avèrent incompétents; cette circulation n'existe plus aujourd'hui, ce qui, au-delà du problème du vote censitaire, nous donne aujourd'hui une démocratie moins parfaite qu'à l'époque. Le problème est d'éviter des carrières politiciennes chez des individus qui finiraient par ne plus rien connaître de la vie civile réelle.
Weber & Minghetti: pour le maintien de la séparation des trois pouvoirs
Max Weber aussi avait fait des observations pertinentes: il constatait que les partis socialistes et démocrates-chrétiens (le "Zentrum" allemand) installaient des personnages sans compétence à des postes clef, qui prenaient des décisions en dépit du bon sens, étaient animés par des éthiques de la conviction et non plus de la responsabilité et exigeaient la répartition des postes politiques ou des postes de fonctionnaires au pro rata des voix sans qu'il ne leur soit réclamé des compétences réelles pour l'exercice de leur fonction. Le ministre libéral italien du XIXième siècle, Minghetti, a perçu très tôt que ce système mettrait vite un terme à la séparation des trois pouvoirs, les partis et leurs militants, armés de leur éthique de la conviction, source de toutes les démagogies, voulant contrôler et manipuler la justice et faire sauter tous les cloisonnements entre législatif et exécutif. L'équilibre démocratique entre les trois pouvoirs, posés au départ comme étanches pour garantir la liberté des citoyens, ainsi que l'envisageait Montesquieu, ne peut plus ni fonctionner ni exister, dans un tel contexte d'hystérie et de démagogie. Nous en sommes là aujourd'hui.
“Synergies Européennes“ ne critique donc pas l'institution parlementaire en soi, mais marque nettement son hostilité à tout dysfonctionnement, à toute intervention privée (les partis sont des associations privées, dans les faits et comme le rappelle Ostrogovski) dans le recrutement du personnel politique, de fonctionnaires, etc., à tout népotisme (cooptation de membres de la famille d'un politicien ou d'un fonctionnaire à un poste politique ou administratif). Seuls les examens réussis devant un jury complètement neutre doivent permettre l'accession à une charge. Tout autre mode de recrutement devrait constituer un délit très grave.
Nous pensons également que les parlements ne devraient pas être uniquement des chambres de représentation où ne siègeraient que des élus issus de partis politiques (donc d'associations privées exigeant une discipline n'autorisant aucun droit de tendance ou aucune initiative personnelle du député). Tous les citoyens ne sont pas membres de partis et, de fait, la majorité d'entre eux ne possède pas de carte ou d'affiliation. Par conséquent, les partis ne représentent généralement que 8 à 10% de la population et 100% du parlement! Le poids exagéré des partis doit être corrigé par une représentation issue des associations professionnelles et des syndicats, comme l'envisageait De Gaulle et son équipe quand ils parlaient de “sénat des professions et des régions”. Pour le Professeur Bernard Willms (1931-1991), le modèle constitutionnel qu'il appelait de ses vœux repose sur une assemblée tricamérale (Parlement, Sénat, Chambre économique). Le Parlement se recruterait pour moitié parmi les candidats désignés par des partis et élus personnellement (pas de vote de liste); l'autre moitié étant constituée de représentants des conseils corporatifs et professionnels. Le Sénat serait essentiellement un organe de représentation régionale (comme le Bundesrat allemand ou autrichien). La Chambre économique, également organisée sur base des régions, représenterait les corps sociaux, parmi lesquels les syndicats.
Le problème est de consolider une démocratie appuyée sur les "corps concrets" de la société et non pas seulement sur des associations privées de nature idéologique et arbitraire comme les partis. Cette idée rejoint la définition donnée par Carl Schmitt des “corps concrets”. Par ailleurs, toute entité politique repose sur un patrimoine culturel, dont il doit être tenu compte, selon l'analyse faite par un disciple de Carl Schmitt, Ernst Rudolf Huber. Pour Huber, l'Etat cohérent est toujours un Kulturstaat et l'appareil étatique a le devoir de maintenir cette culture, expression d'une Sittlichkeit, dépassant les simples limites de l'éthique pour englober un vaste de champs de productions artistiques, culturelles, structurelles, agricoles, industrielles, etc., dont il faut maintenir la fécondité. Une représentation plus diversifiée, et étendue au-delà des 8 à 10% d'affiliés aux partis, permet justement de mieux garantir cette fécondité, répartie dans l'ensemble du corps social de la nation. La défense des "corps concrets", postule la trilogie “communauté, solidarité, subsidiarité”, réponse conservatrice, dès le 17ième siècle, au projet de Bodin, visant à détruire les “corps intermédiaires” de la société, donc les “corps concrets”, pour ne laisser que le citoyen-individu isolé face au Léviathan étatique. Les idées de Bodin ont été réalisées par la révolution française et son fantasme de géométrisation de la société, qui a justement commencé par l'éradication des associations professionnelles par la Loi Le Chapelier de 1791. Aujourd'hui, le recours actualisé à la trilogie “communauté, solidarité, subsidiarité” postule de donner un maximum de représentativité aux associations professionnelles, aux masses non encartées, et de diminuer l'arbitraire des partis et des fonctionnaires. De même, le Professeur Erwin Scheuch (Cologne) propose aujourd'hui une série de mesures concrètes pour dégager la démocratie parlementaire de tous les dysfonctionnements et corruptions qui l'étouffent.
[Pour en savoir plus: 1) Ange SAMPIERU, «Démocratie et représentation», in: Orientations, n°10, 1988; 2) Robert STEUCKERS, «Fondements de la démocratie organique», in: Orientations, n°10, 1988; 3) Robert STEUCKERS, Bernard Willms (1931-1991): Hobbes, la nation allemande, l'idéalisme, la critique politique des “Lumières”, Synergies, Forest, 1996; 4) Robert STEUCKERS, «Du déclin des µours politiques», in: Nouvelles de Synergies européennes, n°25, 1997 (sur les thèses du Prof. Erwin Scheuch); 5) Robert STEUCKERS, «Propositions pour un renouveau politique», in: Nouvelles de Synergies européennes, n°33, 1998 (en fin d'article, sur les thèses d'Ernst Rudolf Huber); 6) Robert STEUCKERS, «Des effets pervers de la partitocratie», in: Nouvelles de Synergies européennes, n°41, 1999].
Bibliographie:
◊ Jean-Pierre CUVILLIER, L'Allemagne médiévale, deux tomes, Payot, tome 1, 1979, tome 2, 1984.
◊ Karin FEUERSTEIN-PRASSER, Europas Urahnen. Vom Untergang des Weströmischen Reiches bis zu Karl dem Grossen, F. Pustet, Regensburg, 1993.
◊ Karl Richard GANZER, Het Rijk als Europeesche Ordeningsmacht, Die Poorten, Antwerpen, 1942.
◊ Wilhelm von GIESEBRECHT, Deutsches Kaisertum im Mittelalter, Verlag Reimar Hobbing, Berlin, s.d.
◊ Eberhard HORST, Friedrich II. Der Staufer. Kaiser - Feldherr - Dichter, W. Heyne, München, 1975-77.
◊ Ricarda HUCH, Römischer Reich Deutscher Nation, Siebenstern, München/Hamburg, 1964.
◊ Edward LUTTWAK, La grande stratégie de l'Empire romain, Economica, 1987.
◊ Michael W. WEITHMANN, Die Donau. Ein europäischer Fluss und seine 3000-jährige Geschichte, F. Pustet/Styria, Regensburg, 2000.
◊ Philippe WOLFF, The Awakening of Europe, Penguin, Harmondsworth, 1968.






 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg