samedi, 31 mai 2025
Prisons intelligentes. La caverne de cristal à l'ère numérique
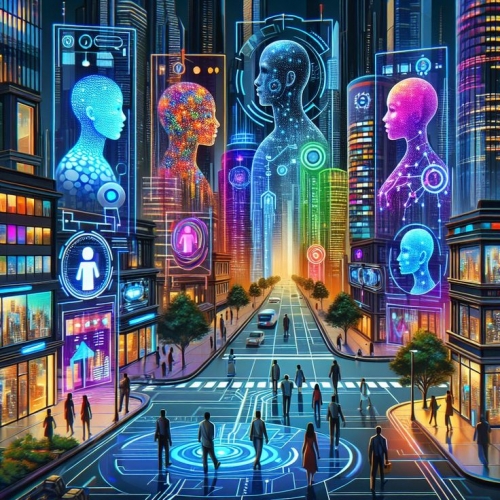
Prisons intelligentes. La caverne de cristal à l'ère numérique
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/prisiones-smart-la-caverna-de-cri...
Bien que modulée selon des figures différenciées et de manière faussement polyphonique, la rengaine ininterrompue que la société du spectacle répète à travers ses réseaux unifiés – « la société existante est la seule possible, comme elle l'a toujours été et comme elle le sera toujours » – finit par priver de fondement, au niveau de l'imaginaire collectif, la critique théorique et, avec elle, la possibilité d'un renversement pratique. Elle nous persuade de l'inexistence de quoi que ce soit en dehors de la caverne et, en fin de compte, de l'inévitabilité de la caverne elle-même qui nous transforme en internés à l'échelle mondiale. Dans chacune de ses représentations, le spectacle cherche une transformation : d'une part, celle de l'espace de la caverne en une cage de fer avec des barreaux inoxydables et une sortie interdite pour éviter d'éventuelles fuites ; et d'autre part, celle des prisonniers, potentiellement en quête de leur propre libération, en simples spectateurs passifs et, de plus, en dévots inconscients de leurs propres chaînes. C'est la condition qui prévaut à l'époque triste de Facebook, Twitter et toutes les autres ego-sphères postmodernes, variations numériques et rigoureusement solitaires de la caverne de Platon.

Ce modèle semble pouvoir être ramené à la « caverne parfaite » des solitudes numériques de la civilisation technomorphe et du nouveau « capitalisme de surveillance » (surveillance capitalism) avec l'esclavage intelligent (Smart) auquel il condamne quotidiennement ses heureux serviteurs. Les systèmes totalitaires du « siècle court » opprimaient la liberté, là où le néolibéralisme de la surveillance l'exploite et la soumet à un régime de profit, apparaissant ainsi comme le premier régime cool. Les deux figures hégéliennes opposées du Serviteur et du Seigneur, du Maître et de l'Esclave, se rejoignent en une seule figure, celle de l'homo neoliberalis qui, en tant qu'« entrepreneur de soi », s'exploite sans relâche pour être le plus performant possible. Chacun, en tant que maître, exige de lui-même, en tant qu'esclave, une productivité maximale, portant l'exploitation capitaliste à son niveau hyperbolique.
L'homo digitalis prend de plus en plus l'apparence d'un sujet de « l'empire cybernétique » en pleine technicisation, peuplé de vagues océaniques faites de solitudes connectées via Internet, vouées au langage post-humain des « émoticônes » de la société des likes. Le socialisme, forme politique centrée sur la dyade liberté et égalité, tombe au rang de simple activité individuelle sur les réseaux sociaux. Plus précisément, le socialisme réel est défenestré par le « socialisme numérique » des réseaux sociaux et des plateformes cybernétiques, nouvelles prisons intelligentes qui piègent le sujet dans les mécanismes de la solitude connectée et de la valorisation ininterrompue de la valeur.
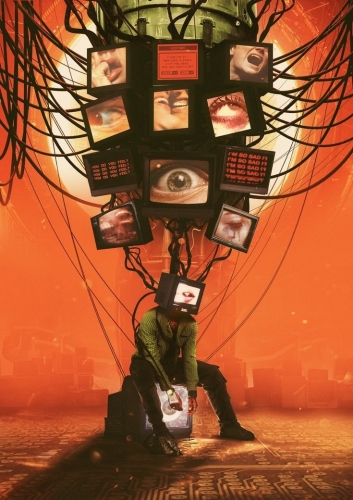
L'espace numérisé, lisse et apparemment libre, ressemble de plus en plus à un immense camp de concentration intelligent, une communauté non communautaire dans laquelle les sujets sont contrôlés et suivis, exploités et trompés, illusionnés par des expériences ludiques et divertissantes alors qu'en réalité, ils travaillent sans relâche – et sans échange d'équivalents – pour l'ordre néolibéral. Dans la bulle numérique, où la connexion remplace le contact et où la solitude des réseaux sociaux remplace la sociabilité, on est seul et surveillé, car presque chaque geste, en plus de générer des profits pour le capital, est surveillé et suivi de manière panoptique. La ludification, rendue possible par les émoticônes persuasives et la spirale des likes, cache le fait que l'utilisateur inconscient des plateformes sociales, se trompant en pensant qu'il communique et s'amuse, travaille pour le capital sans contrepartie et donc dans la forme maximale d'exploitation.
La numérisation et l'infosphère contribuent non seulement au déclin du monde objectuel (produisant ainsi le paradoxe d'une société hyper-matérialiste dans un ordre des choses de plus en plus dématérialisé), mais elles promettent également une croissance exponentielle de la liberté qui se transforme rapidement en un régime de surveillance totale, en une prison intelligente dont les barreaux invisibles sont faits du même matériau que les applications de suivi et de collecte de données disséminées dans nos appareils techniques. Prenons le cas emblématique du smartphone, « le camp de travail mobile dans lequel nous nous emprisonnons de notre plein gré », comme l'a défini Byung-Chul Han : il déréalise le monde et, en même temps, sous la forme d'un hublot sur le réel, il se présente comme un informateur qui surveille implacablement son propriétaire, contrôlé et heureux de l'être grâce à la cession volontaire de données et d'informations sur presque tous les domaines de sa vie.
Dans l'histoire sub specie speleologica de l'humanité, la dernière caverne – en attendant d'autres qui viendront peut-être – est en verre.

Les nouvelles prisons numériques et intelligentes de la civilisation technomorphe sont transparentes et vitrées, à l'image du flagship store d'Apple à New York, évoqué par Byung-Chul Han: un cube de verre, véritable temple de la transparence, qui rend les êtres humains – rectius, les consommateurs – entièrement transparents et visibles, supprimant toute zone d'ombre et tout angle soustrait à la vue. Tout doit être vu et exposé, et les sujets ne doivent rien désirer d'autre que leur exposition spectaculaire ininterrompue sous forme de marchandise.
L'esclave idéal de la caverne vitrée – réduit à un profil sans aucune identité – communique et partage sans cesse des données et des informations, occupant chaque espace de sa présence et travaillant à tout moment pour le capitalisme informationnel. Le nouveau « capitalisme de surveillance », royaume de l'infocratie et du « dataïsme », exploite non seulement les corps et les énergies, mais aussi, dans une mesure non négligeable, les informations et les données: grâce à la transparence totale de la nouvelle caverne de verre, l'accès aux informations permet de les utiliser à des fins de surveillance psycho-politique et de contrôle biopolitique, mais aussi pour prédire les comportements et générer des profits.
Comme le personnage de Platon, le prisonnier ignorant de la caverne Smart de cristal se considère libre et créatif dans son geste, systématiquement stimulé, de performance constante et d'ostentation ininterrompue de lui-même dans les vitrines de cette communauté virtuelle qui, habitée uniquement par des consommateurs, n'est rien d'autre que la version commercialisée de la communauté. Plus les sujets numériques génèrent de données et plus ils communiquent activement leurs goûts et leurs activités, leurs passions et leurs occupations, plus la surveillance devient efficace, de sorte que le smartphone lui-même apparaît comme une prison intelligente, voire comme un appareil de surveillance et de soumission qui ne réprime pas la liberté, mais l'exploite implacablement dans le double but du contrôle et du profit.
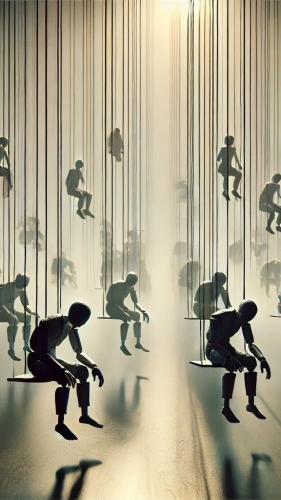
Byung-Chul Han a écrit que l'histoire de la domination peut également être décrite comme la domination de divers écrans. Chez Platon et dans la caverne qu'il a imaginée, nous trouvons le prototype de tous les écrans: l'écran archaïque du mur qui met en scène les ombres échangées et confondues avec la réalité. Dans 1984 d'Orwell, nous rencontrons un écran plus évolué, appelé le "télécran", sur lequel sont diffusées sans cesse des émissions de propagande et grâce auquel tout ce que les sujets disent et pensent chez eux est scrupuleusement enregistré. Aujourd'hui, la dernière figure de la domination par l'écran semble se mettre en place avec l'écran tactile des téléphones portables: le smartphone devient le nouveau média de la soumission, la caverne individualisée et vitrée dans laquelle les êtres humains ne sont plus des spectateurs passifs, mais deviennent tous des émetteurs actifs, qui produisent et consomment de l'information en continu. Ils ne sont pas obligés de rester silencieux et de ne pas communiquer, mais au contraire son invités à parler sans arrêt et à transmettre sans relâche, tout en « vendant » pour le compte du capital leurs propres histoires et leurs propres vies, leurs propres données et leurs propres attitudes comportementales (le storytelling se transforme en storyselling). En résumé, la communication n'est pas interdite, comme dans les anciennes cavernes, mais elle est encouragée et stimulée, à condition qu'elle soit fonctionnelle au capital et à sa valorisation, à sa conservation et à son progrès.
Dans les anciennes cavernes – de Platon au panoptique de Bentham et de Foucault –, les pensionnaires étaient surveillés et punis ; dans la nouvelle caverne vitrée aux murs tactiles de l'ère numérique, ils sont motivés et performants, encouragés à s'exhiber et à communiquer. Il suffit de penser au paradigme postmoderne de la maison intelligente (smart house), hautement technicisée, avec des dispositifs sophistiqués – jalousement installés par le propriétaire lui-même – qui transforment l'appartement en une prison numérique, où chaque action et chaque discours sont minutieusement contrôlés et transcrits. Le contrôle, la surveillance et le suivi sont ainsi perçus et vécus comme un confort et comme des expressions de la coolness du monde technicisé, et non, au contraire, comme des outils et, en même temps, des expressions de la captivité confortable, agréable et douce de l'homo globalis. La caverne parfaite est vitrée non seulement pour que son prisonnier soit observé à tout moment et jusque dans les moindres recoins de sa conscience, mais aussi pour que ses murs ne soient pas visibles et que, par conséquent, on ne puisse en aucun cas être conscient de son existence.

Sur cette base, il faudrait repenser le récit, si cher aux chantres de l'ordre discursif néolibéral, qui présente toujours l'Allemagne de l'Est et l'Union soviétique comme des empires gris ayant contrôlé la « vie des autres », comme le dit le titre d'un film à succès sur le sujet; dans le but, cela va sans dire, d'opposer à ces empires du contrôle total leur propre idéal resplendissant de liberté sous forme de marchandise. Il est bien sûr vrai que dans le Berlin d'avant le Mur ou dans le Moscou soviétique, les citoyens étaient espionnés et surveillés en permanence (nous ne savons pas, en vérité, dans quelle mesure et de quelle manière ils étaient espionnés en Allemagne de l'Ouest ou aux États-Unis par la CIA, pour la simple raison que tous deux ont survécu à la chute du Mur et à l'extinction ignominieuse de l'URSS). Mais il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, l'habitant de la caverne de verre sans frontières est espionné, suivi et surveillé de manière incomparablement supérieure, grâce aux progrès technoscientifiques qui, comme cela devrait être clair, tendent à coïncider avec les progrès de la soumission de l'homme à l'appareil techno-capitaliste. La Stasi de la RDA apparaît, à tous égards, archaïque et marquée d'amateurisme par rapport à Alexa, l'« assistante virtuelle » et « enceinte intelligente » des nouvelles maisons connectées. Prisonnier de la énième manifestation de la fausse conscience nécessaire, l'homo neoliberalis condamne comme une surveillance oppressive, en Allemagne de l'Est et dans le Moscou du socialisme réel, cette même domination qu'il subit quotidiennement sous des formes incroyablement plus radicales et plus invasives, la vivant au contraire, avec une joie insensée, comme un « confort » et un « progrès ».
On retrouve, mutatis mutandis, un modèle remis en question par la modernité et désormais actualisé sous forme numérique. La nouvelle figure de la caverne parfaite correspond à celle où les prisonniers sont totalement contrôlés et – c'est là la nouveauté décisive à l'ère des masses techno-narcotisées – sont heureux de l'être, collaborant activement à leur propre incarcération. C'est le paradigme développé à l'origine par Jeremy Bentham dans la prison idéale qu'il a conçue en 1791, le Panopticon comme caverne de haute surveillance, qui isole et contrôle totalement. La surveillance parfaite, propre à la forteresse idéale dont il est impossible de s'échapper, est confiée à un seul gardien : caché dans la tour centrale, entourée d'une construction circulaire où sont disposées les cellules des prisonniers, éclairées de l'extérieur et séparées par d'épais murs, le gardien mystérieux, que personne ne peut voir, observe tout et tout le monde (c'est ce à quoi fait allusion la synthèse entre πᾶν et ὀπτικός) sans permettre aux détenus de savoir si, à un moment donné, ils sont réellement observés. Les détenus sont potentiellement contrôlés à chaque instant, car ils ne peuvent jamais voir le contrôleur: le regard est en effet à sens unique, puisque l'observateur n'est pas observé et que les observés ne sont pas des observateurs.
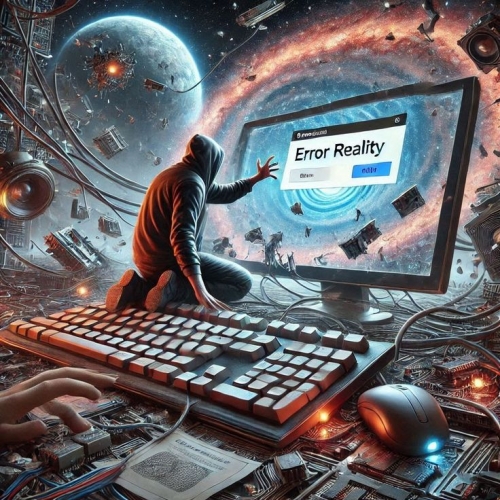
Cette relation asymétrique, dans laquelle se cristallise le lien de domination et de servitude dans la « caverne » de Bentham, admirablement analysée en 1975 par Foucault dans Surveiller et punir, oblige les prisonniers à se comporter comme s'ils étaient surveillés en permanence, sans nécessairement l'être concrètement: la tour pourrait en effet être dépourvue de gardien, mais les prisonniers, ne pouvant le savoir, devraient continuer à se comporter comme s'il était à son poste de contrôle. En fait, ils devraient adopter des comportements disciplinés et presque automatiques, comme s'ils étaient réellement surveillés de manière totale. Ce paradigme, repris par Bentham, avait déjà été esquissé par le sophiste Critias – l'un des Trente Tyrans – lorsqu'il en était arrivé à soutenir que l'invention même des dieux « qui voient tout » était fonctionnelle au comportement moral des individus, lesquels sont dès lors potentiellement toujours observés d'en haut.
À l'ère du nouvel ordre technomorphe, le contrôle est total sans que, en général, le caractère problématique de sa présence soit même remarqué, ce qui est ainsi recherché et souhaité par les nouvelles subjectivités techno-narcotisées. Une fois de plus, selon le théorème d'Adorno, la toute-puissance de la répression et son invisibilité s'inversent l'une dans l'autre. Dans le panoptique de verre de l'ère numérique, les internés ne savent pas qu'ils sont internés et sont incités à communiquer sans retenue sur tout ce qui les concerne: dans aucune des cavernes précédentes de l'aventure historique, il n'était arrivé que ce soient les sujets eux-mêmes qui s'enregistrent avec enthousiasme et fournissent au pouvoir toutes sortes d'informations sur eux-mêmes et sur leur propre vie.
13:49 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : ère digitale, numérisation, prison numéroque, panopticon, diego fusaro, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 26 mai 2025
Théologie politique: la politique comme religion des modernes
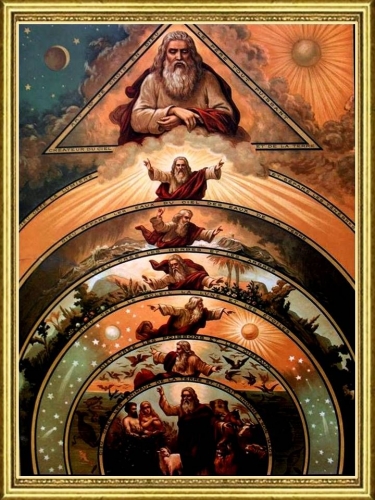
Théologie politique: la politique comme religion des modernes
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/teologia-politica-la-politica-com...
À la lumière de l'herméneutique mobilisée par Schmitt, c'est dans le Léviathan de Hobbes (1651) que le dispositif de la politische Theologie (théologie politique) apparaît opératoire dans sa splendeur originelle. Mais ce n'est qu'à partir du système catégoriel de Rousseau que le modèle de la théologie politique commence à s'articuler selon une dichotomie qui prélude à celle entre la droite et la gauche apparue avec la Révolution française.
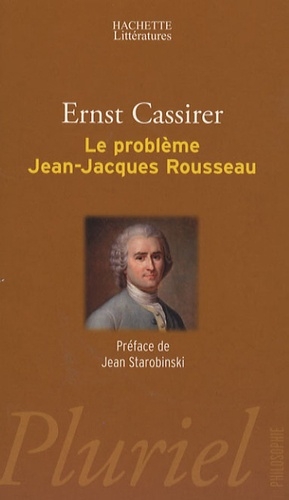 C'est ce qu'Ernst Cassirer a analysé dans son étude Das Problem Jean Jacques Rousseau (1932). Selon le spécialiste des « formes symboliques », le cœur théorique de la pensée politique de Rousseau réside dans le fait qu'il a déplacé la « théodicée » - un énoncé, comme on le sait, composé de « θεός » et de « δίκη », « Dieu » et « justice » - de la sphère théologique verticale à la sphère politique horizontale. À partir de Rousseau, la genèse du mal n'est plus imputable au « péché originel » ou à une volonté divine impénétrable, mais à la société elle-même. Pour Rousseau, en effet, ce n'est pas l'homme qui est naturellement mauvais, comme le prétend le « sophiste Hobbes ». La doctrine du péché originel, « propagée par le rhéteur Augustin », n'est pas non plus admise.
C'est ce qu'Ernst Cassirer a analysé dans son étude Das Problem Jean Jacques Rousseau (1932). Selon le spécialiste des « formes symboliques », le cœur théorique de la pensée politique de Rousseau réside dans le fait qu'il a déplacé la « théodicée » - un énoncé, comme on le sait, composé de « θεός » et de « δίκη », « Dieu » et « justice » - de la sphère théologique verticale à la sphère politique horizontale. À partir de Rousseau, la genèse du mal n'est plus imputable au « péché originel » ou à une volonté divine impénétrable, mais à la société elle-même. Pour Rousseau, en effet, ce n'est pas l'homme qui est naturellement mauvais, comme le prétend le « sophiste Hobbes ». La doctrine du péché originel, « propagée par le rhéteur Augustin », n'est pas non plus admise.
La société qui a produit le mal - l'aliénation et l'exploitation, l'inégalité et la propriété privée, comme l'affirme déjà Rousseau dans le Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes (1755) - est également appelée à se racheter par la politique. Puisque, comme l'affirme le Contrat social (1762), l'homme est né libre et partout il est dans les fers, c'est une exigence fondamentale de la politique que de travailler à rendre à l'homme sa liberté en brisant les chaînes qui ont été créées par l'évolution historique.
Pour Rousseau, précisément parce que le mal n'est pas co-essentiel à la nature humaine et ne coïncide pas avec une condamnation sanctionnée ab aeterno par Dieu, c'est la tâche ambitieuse de la politique de rectifier l'injustice et de libérer la société du mal, en instaurant l'égalité entre les hommes et la démocratie directe comme forme de gouvernement.
Il est vrai, cependant, que Rousseau se place dans le cadre « contractualiste » des modernes et, bien qu'il aspire à une communauté de solidarité et de rédemption, il part de l'hypothèse anthropologique trompeuse de l'individu comme préexistant à l'État (compris à son tour - dirait Hegel - comme le fruit d'un « contrat » conçu selon les modules du « contrat privé »). Le Discours sur l'origine de l'inégalité de 1755 distingue l'inégalité naturelle - celle qui, par exemple, différencie les hommes par l'intelligence et la puissance physique - de l'inégalité conventionnelle, qui « dépend d'une sorte de convention, et est établie ou du moins permise par le consensus des hommes ». Il faut agir pour éliminer la seconde et neutraliser les effets de la première.
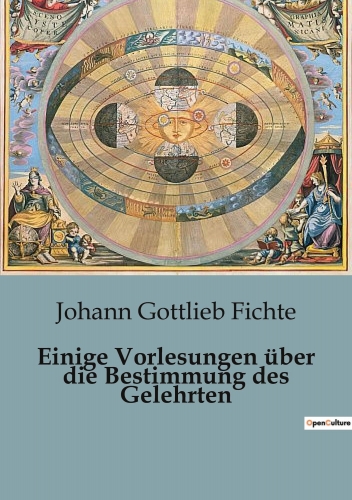
Fichte, dans ses cinq conférences d'Iéna sur le destin des sages en 1794, n'apportera pas de modifications majeures à ce programme. Il se contentera d'insister davantage sur la dimension de l'avenir comme espace ouvert à sa réalisation par l'action passionnée d'un Sujet conscient (je) capable, sous la conduite intelligente du « sage » (der Gelehrte), de redéfinir l'Objet (non-moi) en fonction de la raison.
Nous avons ainsi la genèse de la « théologie » moderne de la politique divisée entre gauche et droite, bien que le lexique de Rousseau ne mentionne pas encore expressément le clivage (la division) qui n'émergera qu'avec le choc de 1789. La gauche est le parti qui aspire à corriger un mal - l'inégalité entre les hommes et les pathologies qui lui sont associées - qui est social, c'est-à-dire produit par la société et rachetable par sa propre praxis. La droite, quant à elle, réagit en réaffirmant la nature de l'ordre existant, dont elle s'érige en gardienne: l'inégalité, qui pour la gauche est une erreur sociale à laquelle il faut remédier, apparaît à la droite comme la condition naturelle, toujours donnée, voulue par Dieu ou, en tout cas, nécessairement produite par les relations entre ces entités belligérantes et réciproquement hostiles que sont les hommes, tels des loups.
Cette reconstruction permet, entre autres, de comprendre pourquoi la gauche est « originaire » et la droite « dérivée ». La seconde est « réactionnaire », car elle répond à la mobilisation théorico-pratique de ceux qui aspirent à modifier les grammaires de l'existant pour le libérer du mal. Le profil philosophique de Nietzsche peut donc, pleno iure, être compris comme l'inversion de celui de Rousseau.
En effet, il part du principe que les hommes sont inégaux par nature et que seule la société, avec sa « morale du troupeau » et sa religion de la résignation, produit la corruption de l'égalité (du christianisme au socialisme).
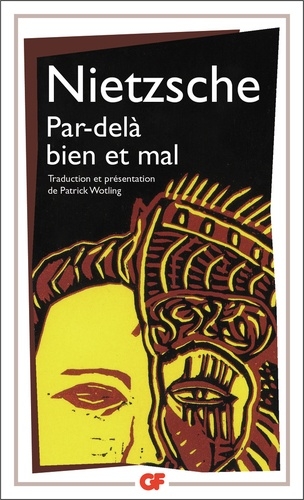 La corruption, qui pour Rousseau engendre l'inégalité, produit en revanche pour Nietzsche l'égalité, c'est-à-dire ce « drôle d'expédient mental » - comme dans Par-delà le bien et le mal - qui permet de masquer « l'hostilité de la plèbe à l'égard de tout ce qui est privilégié et souverain ». La droite, avec Nietzsche, reconnaît l'inégalité et propose des politiques qui la favorisent, tandis que la gauche, avec Rousseau, prend l'égalité comme présupposé et élabore des politiques qui la favorisent.
La corruption, qui pour Rousseau engendre l'inégalité, produit en revanche pour Nietzsche l'égalité, c'est-à-dire ce « drôle d'expédient mental » - comme dans Par-delà le bien et le mal - qui permet de masquer « l'hostilité de la plèbe à l'égard de tout ce qui est privilégié et souverain ». La droite, avec Nietzsche, reconnaît l'inégalité et propose des politiques qui la favorisent, tandis que la gauche, avec Rousseau, prend l'égalité comme présupposé et élabore des politiques qui la favorisent.
Cette approche permet de différencier la droite et la gauche en fonction de la manière dont elles se sont articulées et opposées dans l'aventure multiforme de la modernité. La droite tend à défendre un ordre naturel - s'il n'est pas directement voulu par Dieu - contre ses éventuelles convulsions pratiques ; un ordre qui, en tant que tel, présuppose des hiérarchies et des inégalités. Cela ne signifie pas pour autant que la droite, si attentive à la nature, n'ait pas sa propre culture, ni même qu'elle puisse être identifiée au rejet total de la culture au nom du réalisme et du pragmatisme: cela signifie simplement que la culture de la droite - non moins riche et articulée que celle du camp opposé - trouve sa propre référence constante dans l'immédiateté de la nature et d'un ordre naturellement donné.
La gauche, pour sa part, insiste sur la culture et sur l'historicité plutôt que sur la nature, sur le νόμος -nómos- plutôt que sur la φύσις -physis- : pour la gauche, l'ordre existant n'est pas naturel, mais le produit de rapports de force concrets qui, marqués comme ils le sont par des hiérarchies et des inégalités, exigent d'être rectifiés au nom de configurations de société plus élevées et plus rationnelles, qu'il appartient à la praxis sociale de traduire de la puissance à l'acte. L'immédiateté de la nature donnée, chère à la droite, crée une antithèse radicale à la réflexivité de la culture, typique de la gauche.
Il s'agit donc d'une contraposition entre la culture comme regnum hominis, d'où découle l'impératif - typique de la gauche - de l'action visant à façonner le monde selon les préceptes de la raison, et la nature comme puissance extérieure, qui - pour la droite - ne se laisse pas anthropomorphiser et qui, au contraire, doit être protégée contre les prétentions révolutionnaires à la violer en la subvertissant et en la réorganisant en fonction de la volonté de l'homme.
La genèse théologico-politique de la dichotomie droite-gauche, qui projette sur le plan immanent-horizontal les espoirs et la foi, le dogmatisme et souvent l'intransigeance propres à la sphère transcendante-verticale de la religion, explique à sa manière, entre autres, le caractère « sacré » avec lequel le couple dichotomique continue à être défendu liturgiquement et fidéistiquement même à l'époque de son « crépuscule » : précisément, presque comme s'il s'agissait d'une foi, souvent même en contraste avec les canons du λόγος -lógos- (credo quia absurdum - je le crois parce que c'est absurde-).
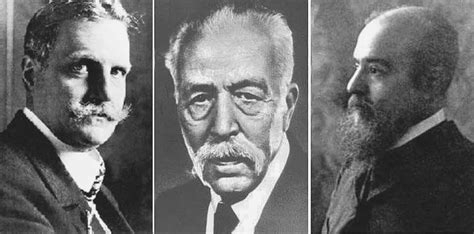
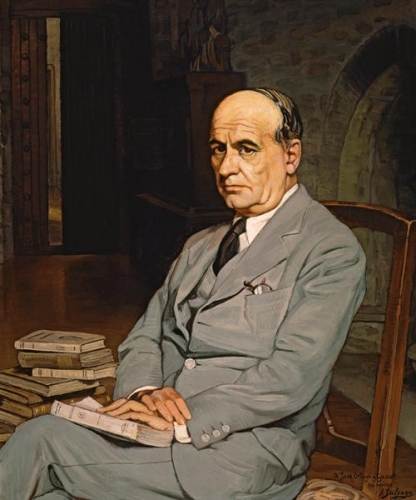
Le clivage a en effet guidé la pensée et l'action des modernes: et ils sont dans l'erreur ceux qui, partant peut-être d'une évaluation correcte de la hodierna morte de la dichotomie, soutiennent qu'elle n'a jamais existé ou qu'elle n'a jamais joué un rôle vraiment décisif. Par exemple, les partisans de la théorie des élites (Mosca, Pareto, Michels) ont diversement considéré que, toujours et de toute façon, il était inévitable que des groupes dirigeants sélectionnés se forment au sommet de la société, même dans les sociétés qui prétendaient ex hypothesi être plus égalitaires et de gauche : pour eux, donc, la dichotomie entre droite et gauche serait en tant que telle un ens imaginationis. Ortega y Gasset a exprimé cette thèse, bien que dans une perspective différente, en affirmant qu'« être de gauche est, comme être de droite, l'une des infinies façons dont l'homme peut choisir d'être un imbécile: toutes deux, en effet, sont des formes d'hémiplégie morale ».

Il est vrai que, historiquement, c'est surtout la droite qui a nié la validité de la dichotomie, la présentant comme une construction intellectualiste subreptice qui désintègre la nature organique et unitaire de la société. Cette thèse, embryonnaire dans la pensée de De Maistre, est pleinement formulée, par exemple, par Jean Madiran dans La droite et la gauche (1977). Madiran (photo, ci-dessus) va plus loin. Il affirme que la distinction s'est toujours faite à l'initiative et au profit de la gauche, qui l'a utilisée pour renverser le pouvoir et pour boucler et exclure la droite en l'identifiant au mal.
Par ailleurs, Donoso Cortés avait déjà affirmé que le parlementarisme et la dichotomie gauche-droite se réfèrent à la « chattering class », la classe bourgeoise qui débat.
Ici aussi, il y a un aspect paradoxal. Si la dichotomie est à l'origine symboliquement favorable à la droite (le « bon » côté opposé au « mauvais » côté), c'est la gauche qui l'institue - et y fonde sa propre identité - et c'est la droite qui, dans un premier temps, la rejette. C'est pourquoi, comme le soulignait déjà Alain au siècle dernier, c'est surtout la droite qui tente de nier la dichotomie alors qu'elle était encore opérante: et celui qui, dans la Modernité, prétend n'être ni de droite ni de gauche, tend à le faire parce qu'il se place déjà dans les rangs de la droite. Mais il est vrai aussi que, si l'on inverse les rôles, ceux qui attribuent à la droite l'indistinction ou l'inexistence du clivage sont presque toujours à gauche.
Il est vrai que la droite surtout, après 1945, a essayé de nier la dichotomie pour des raisons purement techniques et tactiques, c'est-à-dire pour cacher sa propre faiblesse et son échec, en cherchant à se « camoufler » sous des catégories de sortie différentes et moins désavantageuses.
 Cependant, comme nous le verrons, un discours diamétralement opposé s'appliquera à ceux qui nient la validité de la dyade après 1989, reconnaissant son épuisement évident et non plus son inexistence tout court. La liste de ces auteurs comprend des personnalités de la Nouvelle Droite, comme Alain de Bneoist, et des philosophes de la gauche marxiste, comme Costanzo Preve (photo, ci-contre).
Cependant, comme nous le verrons, un discours diamétralement opposé s'appliquera à ceux qui nient la validité de la dyade après 1989, reconnaissant son épuisement évident et non plus son inexistence tout court. La liste de ces auteurs comprend des personnalités de la Nouvelle Droite, comme Alain de Bneoist, et des philosophes de la gauche marxiste, comme Costanzo Preve (photo, ci-contre).
D'autre part, en ce qui concerne la dichotomie, il ne faut pas négliger le caractère structurellement asymétrique qu'elle présente : le dupla n'est pas seulement utilisé pour décrire aseptiquement, mais aussi pour distinguer, discriminer et évaluer. Dans le passé, on s'en souvient, la gauche était identifiée à la « partie maudite », la droite à la « partie divine ». C'est surtout dans la seconde moitié du 20ème siècle, du moins en Europe, que le rapport s'est inversé : seule la gauche tend à être présentée avec des connotations positives dans le discours public, tandis que la droite - souvent identifiée sans réserve par ses adversaires aux expériences tragiques du nazisme et du fascisme - se voit imputer des dévalorisations substantielles.
Alors que la gauche se voit souvent attribuer sans réfléchir les valeurs d'égalité, de progrès et de solidarité, la transformant idéologiquement en une sorte de paradis sémantique, la droite se voit attribuer, depuis la seconde moitié du 20ème siècle, les prérogatives les plus abjectes de dictature, de violence, d'inégalité et de discrimination.
En dehors de ces considérations, le caractère religieux et seulement imparfaitement sécularisé de la dichotomie apparaît clairement, et ce sous la forme d'une foi tenace qui, de manière apparemment contradictoire, semble survivre même à la fin des grands récits avec laquelle, selon Lyotard, la condition postmoderne coïnciderait. Weber avait raison lorsqu'il affirmait que le « désenchantement du monde » (Entzauberung der Welt) ouvert par le « développement particulier » (Sonderentwicklung) de la rationalisation capitaliste occidentale finit par coexister avec une sorte de réenchantement immanent qui lui est propre : celui en vertu duquel les hommes ont cessé de croire en Dieu et en la dichotomie entre l'au-delà et l'au-delà, au moment même où la foi dans le marché capitaliste et dans le binôme droite-gauche a atteint un degré d'intensité impressionnant.
C'est pourquoi, à l'époque de la « mort de Dieu » et de la splendeur de la religion du capital, la dichotomie semble dotée d'une charge religieuse maximale ; une charge qui s'exprime, entre autres, dans le « tabou de l'impureté » adressé à quiconque appartient au parti adverse (ou, ce qui n'est pas rare, à quiconque est même soupçonné d'avoir des relations avec lui) et dans la substitution désormais consommée de l'espace de « l'action communicative » (socratique avant même d'être habermassienne), incardiné sur le λόγος, -logos-, par le terrain émotionnel, fidéiste et fanatique de l'appartenance « confessionnelle » et de la lutte obéissante contre les « hérétiques » du camp adverse. En bref, la politique devient à toutes fins utiles la religion des modernes. Aujourd'hui, cependant, les post-modernes vivent la mort de Dieu également en politique ; et sous toutes les latitudes, c'est la perte de la foi politique ou, si l'on préfère, le nihilisme politique qui prédomine.
14:45 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, philosophie, clivage gauche-droite, gauche, droite, théologie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 16 mai 2025
Turbo-capitalisme financier: comment tout nous est volé

Turbo-capitalisme financier: comment tout nous est volé
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/turbocapitalismo-financiero-como-...
Le turbo-capitalisme financier pourrait être décrit comme une industrie extractive, bien que sui generis. Il s'agit en effet d'un puissant appareil d'abstraction, de centralisation et de captation des biens communs et de la valeur sociale, selon la figure de « l'accumulation par dépossession » évoquée par David Harvey dans Une brève histoire du néolibéralisme, en référence au paradigme néolibéral et à la transition entre le capitalisme producteur manufacturier bourgeois et le capitalisme prédateur financier post-bourgeois.
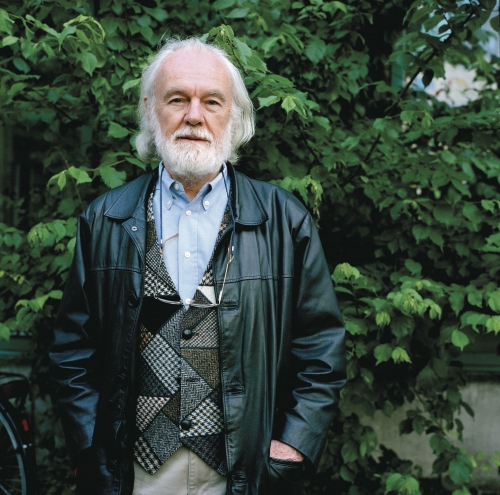
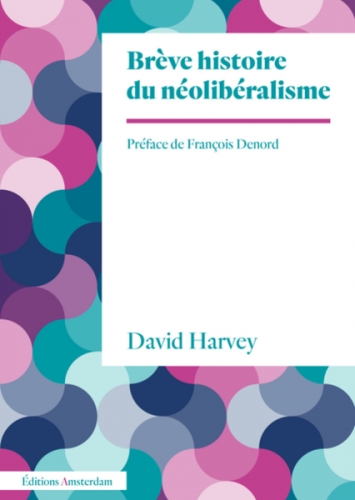
Cette accumulation se fait souvent avec la médiation du gouvernement dans sa version libérale, par des manœuvres telles que le remplacement des organismes de retraite par des assureurs privés, ou encore par le dé-financement du secteur public. Le crédit est ainsi présenté comme le principal système par lequel le turbo-capital financiarisé peut extraire la richesse de la population. Il utilise de multiples stratagèmes pour mettre en œuvre son projet d'extraction des richesses et d'expropriation de l'argent au profit de la classe dirigeante déjà hyper-possédante. Tous s'articulent autour de pratiques prédatrices astucieuses qui s'appuient formellement sur la loi, en la rédigeant ex novo ou en la pliant simplement à leurs interprétations, de manière à garantir de manière stable - pour parler comme Thrasymaque (La République, 339a) - « l'intérêt du plus fort ». Ainsi s'expliquent les taux d'intérêt usuraires des cartes de crédit, les saisies d'entreprises privées de liquidités en cas de difficultés, la promotion de l'actionnariat, la fraude aux entreprises, la manipulation des marchés et l'utilisation de systèmes pyramidaux comme la fameuse « pyramide de Ponzi ».
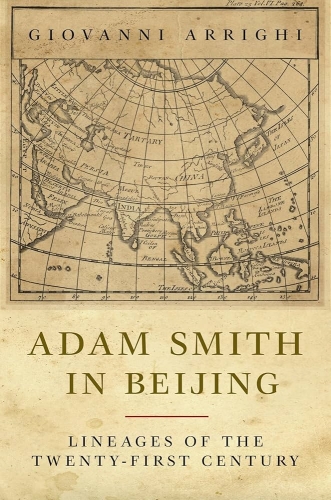
Pour reprendre le titre du chef-d'œuvre de Weber, on pourrait à juste titre parler d'accumulation par expropriation et du nouvel esprit de l'ordre capitaliste. Cette dépossession ne se limite d'ailleurs pas aux leviers de l'extraction financière, mais se détermine - explique Harvey - également dans de nombreuses autres figures connexes (« privatisation », « gentrification », « réclusion de masse ») ; au premier rang de celles-ci - surtout après 1989 et l'effondrement du Weltdualismus (dualisme mondial) - figure le retour de l'impérialisme atlantiste sous ses formes les plus brutales. Harvey lui-même le reconnaît dans Perpetual War (2003) et, à côté de lui, Giovanni Arrighi dans The Long Twentieth Century (1994) et dans Adam Smith in Peking (2007) : hors des frontières de l'Occident, le capital utilise à nouveau la violence de l'expropriation directe, appelée pieusement « privatisation », sous des formes qui ne sont pas si différentes de celles étudiées par Marx, à propos de l'« accumulation originelle », dans le chapitre 24 du premier livre du Capital. Marx lui-même, en revanche, nous enseigne que « l'hypocrisie profonde et la barbarie intrinsèque de la civilisation bourgeoise apparaissent devant nous sans voile lorsque de la métropole, où elles revêtent des formes respectables, nous tournons les yeux vers les colonies, où elles sont nues ».
A titre d'exemple, il suffit de rappeler le travail de la civilisation du dollar dans l'Irak occupé par les troupes de l'impérialisme en 2003. Le politicien Paul Bremer a publié quatre ordonnances prévoyant la privatisation totale des entreprises d'État, la propriété privée totale des activités économiques irakiennes par des sociétés étrangères, le rapatriement total des bénéfices réalisés par les sociétés étrangères, l'ouverture des banques irakiennes au contrôle étranger, l'égalité de traitement entre les sociétés étrangères et les sociétés nationales et la suppression de la quasi-totalité des obstacles au commerce. Le premier laboratoire de ces stratégies soutenues par Washington avait été le Chili de Pinochet.
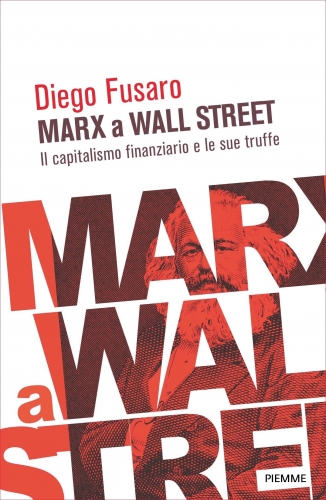
En résumé, l'oligarchie ploutocratique néolibérale se présente comme une aristocratie extractive, puisqu'elle s'enrichit en extrayant la richesse du corps social sans contribuer d'aucune manière à sa production. Elle apparaît ainsi, à toutes fins utiles, comme la Parasitenklasse (classe parasitaire) évoquée par Marx. L'accumulation par dépossession - ou, si l'on préfère, « l'accumulation dominée par la finance » (finanzdominierte Akkumulation) - propre à la phase absolue, repose sur l'hypothèse que la forme la plus rapide et la plus immédiate d'enrichissement consiste à soustraire de la richesse ou, plus précisément, à l'extraire par la contrainte: cela s'obtient, concrètement, en spoliant les épargnants et les investisseurs, en vidant les banques (après avoir empêché l'utilisation des liquidités et, donc, la fuite de l'épargne), en pillant les « actifs » (les « assets », comme les appelle le néo-langage) des entreprises et des Etats par le recours à des emprunts meurtriers.
In specie, le système de crédit tisse une toile d'obligations pour le débiteur de telle sorte que, finalement, la personne endettée n'a pas d'autre choix que de céder ses droits de propriété au prêteur. Cette stratégie, en revanche, était déjà connue de Marx, qui la mentionne fréquemment dans le troisième livre du Capital. Par exemple, lorsque des hedge funds - fonds spéculatifs - prennent le contrôle d'entreprises pharmaceutiques, ils achètent d'immenses quantités de maisons saisies et les mettent ensuite à la disposition des consommateurs qui en ont besoin à des prix exorbitants, organisant scientifiquement l'accumulation par l'expropriation. Il arrive souvent, en effet, que les crises laissent dans leur sillage une masse d'actifs dévalués, qui peuvent ensuite être obtenus à des prix avantageux par ceux qui ont les liquidités pour les acheter : c'est ce qui s'est passé en 1997-1998 en Asie de l'Est et du Sud-Est, lorsque des entreprises parfaitement saines ont fait faillite par manque de liquidités et ont été rachetées par des banques étrangères, pour être ensuite revendues avec des profits impressionnants.

Si la bourgeoisie entrepreneuriale générait la richesse par le travail et son exploitation, les élites mondialistes sans frontières s'enrichissent par la dépossession aux dépens des travailleurs et des classes moyennes non libéralisées. Elles extraient la richesse du corps social productif et ne contribuent pas à la production de cette richesse : en d'autres termes, elles ne participent pas au travail qui la produit, ce qui les rapproche - mutatis mutandis - de l'ancienne aristocratie de l'Ancien Régime. Les maîtres de la finance techno-féodale, qui gèrent la création monétaire privée à des fins privées (cachées et exemptes de toute responsabilité), dirigent la domination parasitaire et extractive du produit et du travail d'autrui. En vue de cet objectif conforme à leur domination de classe, les globocrates - habitués à vivre « sur l'argent des autres », pour reprendre la formule de Luciano Gallino - opèrent le détournement prédéterminé du crédit de l'économie productive vers la finance spéculative, processus qui est suivi par la désindustrialisation, le désinvestissement, la baisse des salaires et les licenciements.
Les classes moyennes et populaires, quant à elles, sont contraintes de travailler et de payer des impôts très élevés pour enrichir une classe financière mondiale qui a le monopole de la création des symboles monétaires et qui, en échange de ses prêts, retient, sous la formule de l'intérêt usuraire, une grande partie du produit du travail. La finance elle-même, dans sa dynamique essentielle, opère en favorisant le passage de la fabrication bourgeoise à l'hégémonie des multinationales post-bourgeoises et de leurs monopoles. Cela conduit à cette inversion mortelle entre la finance et l'industrie déjà décrite, dans ses caractéristiques les plus particulières, par Lénine et, bien que d'une manière différente, par Rudolf Hilferding dans son Finanzkapital (1923).

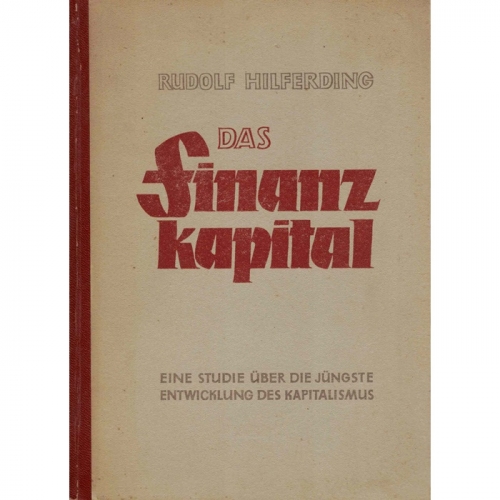
Tous deux, bien que dans des perspectives différentes, avaient pleinement décrypté le quid proprium du capital financier et son remplacement de la primauté des industriels par celle des banquiers. L'industriel bourgeois est impliqué et proche des processus productifs, et dirige la coopération (dans le chapitre XXIII du Capital, Marx utilise l'exemple du chef d'orchestre) ; le banquier, en revanche, est éloigné de la production et n'est pas lié à ses éventuelles tragédies (en fait, il a souvent tout intérêt à ce qu'elles se produisent).
Comme toutes les activités de rente, la finance fonctionne aussi selon la figure de l'actio in distans: elle s'abstrait de la production et gouverne à distance, sans se montrer, en agissant de manière parasitaire par rapport à la production réelle et à la société dans son ensemble. La finance, en outre, ne s'intéresse pas à la construction de la stabilité et, en fait, vit de l'instabilité et de la précarité, selon les fondements de la nouvelle forme d'accumulation flexible que nous avons analysée dans notre livre Histoire et conscience du précariat (Ed. esp. 2021).
Contrairement à ce que le regard idéologiquement contaminé détecte habituellement, le capital financier n'opère pas dans une terra nullius indéterminée, ni ne génère de la richesse à partir de rien : en réalité, il extrait de la valeur du bien commun de la société et, en général, de la « classe qui vit du travail », c'est-à-dire du serf précarisé. Le capital financier liquide se présente ainsi comme un puissant appareil d'expropriation faussement anonyme. Il opère en transférant des biens publics tels que les chemins de fer et l'eau, les lignes téléphoniques et le patrimoine culturel dans des mains privées, libérées de toute localisation nationale. On peut également en déduire l'analogie avec les processus d'« accumulation originelle » décrits par Marx dans Le Capital.
Ce n'est qu'à cette lumière que l'on peut expliquer la soi-disant crise américaine de 2007, ainsi que - pour rester en Europe - la perte d'environ quarante pour cent du pouvoir d'achat du peuple italien avec le passage de la lire à la monnaie unique de l'euro (on peut dire à peu près la même chose du peuple espagnol). Le capitaliste bancaire-monétaire apparaît comme un faiseur d'argent et, en même temps, comme un donneur d'argent : il crée de l'argent ex nihilo et le prête dans le but évident d'endetter les « bénéficiaires ». Elle prélève non seulement les fruits du travail, mais aussi l'épargne de l'ensemble de la classe dominée.

Par essence, la finance produit de la « richesse » en créant de l'argent à coût nul. Mais en réalité, elle crée du papier et non de la richesse : avec la conséquence évidente que la richesse qu'elle obtient doit être soustraite, par des impôts et des artifices usurocratiques, à ceux qui la produisent réellement, c'est-à-dire au précariat en tant que classe qui vit du travail. Dans son aspiration à dominer la planète entière au nom du profit et de la croissance infinie, la classe mondiale des seigneurs de la finance a imposé des modifications de la fiscalité à son profit exclusif. En Occident, la progressivité de l'impôt diminue progressivement, depuis 1989, au fur et à mesure que l'on s'élève dans la hiérarchie des comptes bancaires. La classe moyenne bourgeoise en voie d'illicitisation se voit prélever en moyenne 45% de ses modestes revenus. Bref, dans une synthèse plausible, alors que le travail est de plus en plus taxé, la spéculation financière et les grandes affaires de l'aristocratie financière restent non taxées et non contrôlées, le plus souvent sous la forme d'une véritable légalisation de l'évasion fiscale.
De leur côté, les multinationales, leurs actionnaires et leurs PDG paient des impôts fixés à des chiffres dérisoires, allant régulièrement de 1 à 5% (et qu'ils évitent, quand ils le peuvent, en utilisant les « paradis fiscaux »). Tout employé du colosse Amazon est taxé dix fois plus que la même multinationale multimilliardaire pour laquelle il travaille. Sous cet aspect, la lutte contre l'évasion fiscale, toujours invoquée comme une figure de la justice universelle, est ponctuellement menée par l'Etat libéral contre les classes moyennes et populaires au profit de la classe financière mondiale. Loin d'être une garantie de justice universelle, la « lutte contre l'évasion fiscale », telle qu'elle est gérée par l'ordre néolibéral, apparaît comme l'un des nombreux instruments du massacre des classes opéré par les cagoulards de la finance et par l'Etat libéral à leur service.
En témoigne le fait que la possibilité d'évasion fiscale des classes moyennes et populaires, quand elle n'est pas rendue impossible par une fiscalité qui pille les salaires avant même qu'ils ne soient perçus (c'est le cas de l'emploi public, en voie de démantèlement au nom de la raison libérale), est poursuivie comme une règle de droit, là où l'évasion des géants du commerce cosmopolite, des usuriers de la finance spéculative et des multinationales massives, est admise comme une règle de droit. Cela confirme, pour la énième fois, que le droit, dans l'ordre des rapports capitalistes, ne garantit pas la justice universelle, mais les intérêts de la classe dominante, dont il « juridifie » et « légalise » la domination.
15:42 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, turbocapitalisme, capitalisme financier, diego fusaro |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 13 mai 2025
Economie verte et écologisme néolibéral

Economie verte et écologisme néolibéral
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/business-ecologico-el-ambientalis...
Il existe un paradoxe apparent lié à la question de l'apocalypse environnementale qu'il convient d'aborder : le logo dominant dans le cadre du technocapitalisme du nouveau millénaire non seulement ne reste pas silencieux face au dilemme de la catastrophe imminente, mais l'élève au rang d'objet d'une prolifération discursive hypertrophique. L'urgence environnementale et climatique est, à juste titre, l'un des sujets les plus soulignés et les plus discutés dans l'ordre actuel du discours.
Cela semble, à première vue, une contradiction dans les termes, si l'on considère que poser ce dilemme revient à énoncer la contradiction même du capital, qui est son fondement. Ne serait-il pas plus cohérent avec l'ordre technocapitaliste d'occulter - ou du moins de marginaliser - cette question problématique, d'une manière similaire à ce qui se passe avec la question socio-économique du classisme et de l'exploitation du travail, rigoureusement exclue du discours public et de l'action politique ?
Affirmer que, contrairement au problème de l'exploitation du travail (qui reste largement invisible et qui, de toute façon, peut être facilement éludé par le discours dominant), la question environnementale est claire et évidente aux yeux de tous, oculos omnium, et que, par conséquent, il serait impossible de l'éviter comme si elle n'existait pas, revient à faire une affirmation vraie mais, en même temps, insuffisante: une affirmation qui, en outre, n'expliquerait pas les raisons pour lesquelles le discours dominant non seulement aborde ouvertement la question, en la reconnaissant dans sa pleine réalité, mais tend même à l'amplifier et à la transformer en une urgence et en une véritable urgence planétaire.

La thèse que nous entendons soutenir à cet égard est qu'il existe une différence notable entre la question environnementale et la question socio-économique (que Marx appellerait, sans périphrase et à juste titre, « lutte des classes »). Cette dernière ne peut en aucun cas être « normalisée » et métabolisée par l'ordre technocapitaliste qui, en fait, opère de telle sorte qu'elle n'est même, tendanciellement, jamais mentionnée (ni, ça va sans dire par les forces du camp gauche de la politique, depuis longtemps redéfini comme gauche néolibérale ou, mieux encore, « sinistrash » - gauche poubelle). Margaret Thacher, quant à elle, avait déjà ostracisé le concept même de classe sociale, le qualifiant de vestige inutile et pernicieux du communisme (selon ses propres termes : « la classe est un concept communiste. Il sépare les gens en groupes comme s'il s'agissait de parcelles et les monte ensuite les uns contre les autres").
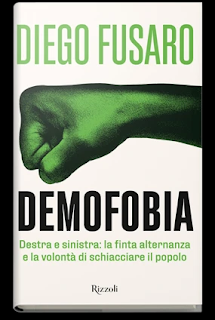 Comme nous l'avons montré plus en détail dans notre étude Démophobie (2023), les droits sociaux sont remplacés dans l'ordre discursif et dans l'action politique par des « droits arc-en-ciel », c'est-à-dire par ces caprices de consommateurs qui, en plus de permettre de détourner le regard du conflit de classe, sont intrinsèquement fonctionnels à la logique néolibérale d'expansion de la marchandisation du monde de la vie. Et les forces politiques sont toutes réorganisées à l'extrême centre de la grosse Koalition néolibérale, apparaissant de plus en plus comme des articulations du parti unique du turbo-capital qui élève le fanatisme économique et le classisme, l'impérialisme et l'aliénation à un destin inéluctable et à un horizon exclusif (il n'y a pas d'alternative).
Comme nous l'avons montré plus en détail dans notre étude Démophobie (2023), les droits sociaux sont remplacés dans l'ordre discursif et dans l'action politique par des « droits arc-en-ciel », c'est-à-dire par ces caprices de consommateurs qui, en plus de permettre de détourner le regard du conflit de classe, sont intrinsèquement fonctionnels à la logique néolibérale d'expansion de la marchandisation du monde de la vie. Et les forces politiques sont toutes réorganisées à l'extrême centre de la grosse Koalition néolibérale, apparaissant de plus en plus comme des articulations du parti unique du turbo-capital qui élève le fanatisme économique et le classisme, l'impérialisme et l'aliénation à un destin inéluctable et à un horizon exclusif (il n'y a pas d'alternative).
Contrairement à la question socio-économique, la question environnementale peut être métabolisée et - littéralement - rentabilisée par l'ordre technocapitaliste pour de multiples raisons. Précisons toutefois que l'ordre discursif néolibéral affronte et, en fait, amplifie la question environnementale et climatique dans l'acte même par lequel il la déclare abordable et résoluble mais toujours et seulement dans le cadre du technocapitalisme, neutralisant a priori la pensabilité de toute arrière-pensée ennoblissante éloignée de la prose de la réification du marché et de la Technique. Et c'est en fonction de cette clé herméneutique que s'explique l'intensification discursive néolibérale de l'urgence climatique et environnementale, toujours caractérisée par l'occultation de la matrice capitaliste des désastres.
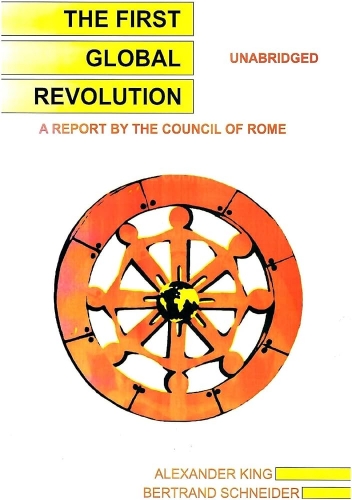
Bien canalisée dans les rails de la mondialisation néolibérale, la question environnementale peut jouer, pour l'ordre dominant, le rôle d'une fonction efficace de défocalisation du regard sur la question socio-économique, le classisme, l'exploitation et l'impérialisme. Pour comprendre cet usage apotropaïque dans toutes ses implications, on peut par exemple se référer au rapport de 1991 intitulé La première révolution mondiale, publié par le « Club de Rome », une association fondée en 1968 par l'homme d'affaires Aurelio Peccei, le scientifique écossais Alexander King et le turbo-capitaliste milliardaire David Rockefeller : une entité que l'on peut à juste titre classer parmi les nombreux think tanks (du Cato Institute à la Heritage Foundation, de l'Adam Smith Institute à l'Institute of Economic Affairs) au service de l'ordre dominant, auquel ils apportent une caution idéologique.
Ainsi, on peut lire dans le rapport de 1991 : « Dans la recherche d'un nouvel ennemi qui pourrait nous unir, nous avons trouvé l'idée que la pollution, la menace du réchauffement climatique, la pénurie d'eau potable, la faim et d'autres choses du même genre serviraient notre objectif ». En somme, la question verte doit être habilement identifiée comme une contradiction fondamentale et un « ennemi commun » capable de nous unir ("un nouvel ennemi pour nous unir") dans une bataille qui, d'une part, détourne le regard du conflit entre le Serviteur et le Seigneur et, d'autre part, conduit le premier à adhérer à nouveau à l'agenda du second, notamment aux nouvelles voies du capitalisme écologique telles qu'elles seront sculptées dans les années à venir.
Le rapport du Club de Rome peut être accompagné d'un autre document datant de deux ans plus tôt qui, malgré les différences de nuances et d'intensité des approches, propose un schéma de pensée convergent. Il s'agit d'un discours prononcé par Margaret Thatcher le 8 novembre 1989 devant l'Assemblée générale des Nations Unies. Il est animé, entre les lignes, par la volonté d'identifier un nouvel « ennemi commun » pour remplacer le « socialisme réel », déjà en déclin (il est significatif que le discours de la Dame de fer ait eu lieu à la veille de la chute du mur de Berlin). Et que, par conséquent, il peut être assumé comme le nouveau défi global au capitalisme, en impliquant tout le monde dans son projet. Selon Thatcher, « de tous les défis auxquels la communauté mondiale a été confrontée au cours de ces quatre années, l'un d'entre eux est devenu plus évident que tous les autres, à la fois en termes d'urgence et d'importance : je veux parler de la menace qui pèse sur notre environnement mondial ».
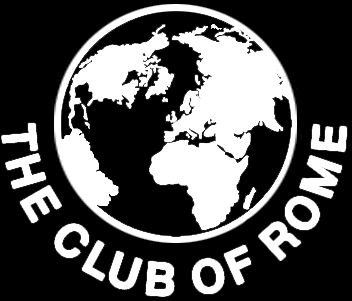
Le sermon de la Dame de fer est parfois encore plus symptomatique du nouvel esprit du temps que le rapport du « Club de Rome », en particulier dans son insistance sur la nécessité de traiter la question environnementale sans renoncer à l'impératif de croissance, préservant ainsi le capitalisme sous une forme éco-durable tout en se consacrant à la croissance économique. Pour reprendre les termes de Thatcher, « nous devons faire ce qu'il faut sur le plan économique. Cela signifie que nous devons d'abord avoir une croissance économique continue afin de générer la richesse nécessaire pour payer la protection de l'environnement ». L'astuce - une constante dans l'ordre du discours néolibéral - consiste à dénoncer le problème environnemental, en accompagnant immédiatement la dénonciation de la reconnaissance que la croissance, le développement et les auri sacra fames - la faim d'or maudite - du capital ne sont pas la cause, mais la solution possible : « nous devons résister à la tendance simpliste de blâmer l'industrie multinationale moderne pour les dommages causés à l'environnement. Loin d'être les méchants, ce sont eux sur qui nous comptons pour enquêter et trouver des solutions ».
Ainsi, suivant le discours de Thatcher, qui résume le nouvel esprit du capitalisme vert in statu nascendi - en phase d'émergence - la critique du capitalisme comme cause de la destruction de l'environnement (en un mot, l'environnementalisme socialiste) serait une « tendance simpliste », du fait que les industries multinationales, « loin d'être les méchants », sont les agents qui peuvent mener les recherches et trouver les solutions au dilemme. Cependant, le non sequitur dans lequel la réflexion de Thatcher, et avec elle, la raison d'être néolibérale elle-même, s'enlisent est que, même à supposer que les entreprises multinationales puissent trouver la solution, cela ne peut servir d'alibi à leur responsabilité dans la genèse de la tragédie, comme semble l'indiquer le passage cité plus haut. Et, de toute façon, comme nous essaierons de le montrer, les « solutions » recherchées et trouvées par l'industrie multinationale moderne évoluent toujours sur la base de l'acceptation (et de la reproduction perpétuelle) de la contradiction qui génère le problème.
Par conséquent, l'ordre hégémonique admet et même encourage le discours sur la catastrophe, tant qu'il est invariablement articulé dans les périmètres du cosmos technocapitaliste, supposé comme un a priori historique non modifiable ou, en tout cas, comme le meilleur système possible à la fois parmi ceux qui ont déjà existé et parmi ceux qui pourraient éventuellement exister en tant qu'alternative.
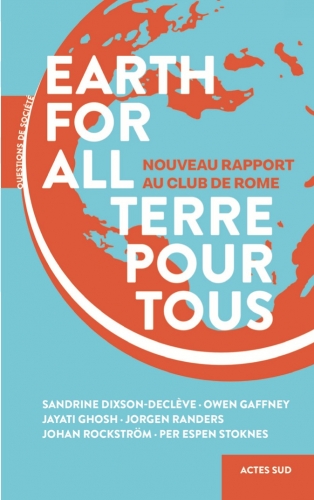
L'évocation constante de la catastrophe climatique et l'exigence d'y remédier sont donc permises et d'ailleurs constamment induites, à condition que les recettes et les solutions soient administrées par la logique du profit et le maintien de la forme valeur comme fondement du système de production.
Enfin, si l'environnementalisme néolibéral est ouvertement promu et pratiqué par les modèles politiques de l'Occident - ou, plus précisément, de l'Ouest -, l'environnementalisme socialiste est découragé et diabolisé, soit sur la base de ce que Fisher a défini comme le « réalisme capitaliste » (selon lequel il n'y aurait pas d'alternatives à ce qui existe), soit sur la base de la stigmatisation de la passion utopique et anti-adaptative, idéologiquement assumée comme prémisse à la violence et au retour des atrocités du 20ème siècle.
En d'autres termes, le turbo-capitalisme pose et débat la question de l'apocalypse verte en se présentant comme la solution et non comme l'origine du problème: ainsi, tout en cultivant les causes de la catastrophe, il se propose de travailler sur les effets, dans une perspective qui, de surcroît, est fonctionnelle à la préservation de la logique du capitalisme lui-même. Il va sans dire qu'affronter le dilemme environnemental en restant sur le terrain du technocapitalisme signifie, dans la meilleure des hypothèses, ne pas le résoudre et, dans la pire (comme nous pensons que c'est effectivement le cas), renforcer encore les bases de la catastrophe.
En particulier, nous tenterons de montrer comment, sous la forme de l'environnementalisme néolibéral, le discours turbo-capitaliste sur l'apocalypse verte tente, d'une part, de moduler les stratégies de résolution de la catastrophe qui, présupposant l'ordre technocapitaliste et son maintien, sont toutes vouées à l'échec et, d'autre part, de neutraliser préventivement la viabilité de l'option de l'environnementalisme socialiste. Sans exagérer, si le logo hégémonique s'approprie le discours environnemental, c'est en raison de sa volonté de le sortir du camp socialiste pour le ramener - et donc le « normaliser » - sur le terrain néolibéral, plutôt qu'en raison de sa volonté réelle de remédier au cataclysme qui s'annonce. D'autre part, pour les porte-drapeaux du fanatisme techno-économique - pour paraphraser Jameson - il est plus facile et moins douloureux d'imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme.

L'hypertrophie discursive de la question environnementale à l'ère néolibérale s'explique par trois raisons principales, qui seront examinées ci-dessous : (a) la transformation de l'urgence environnementale elle-même en une source d'extraction de la plus-value, qui se produit surtout en vertu du système manipulateur de l'économie verte et de ses « sources renouvelables » d'affaires ; (b) le brouillage du regard par rapport au conflit socio-économique (qui, comme on l'a rappelé, ne peut être incorporé et normalisé dans l'ordre technocapitaliste, contrairement à la question environnementale) ; (c) la fabrique de la crise et le gouvernement de l'économie de marché, qui sont les principaux responsables de l'hypertrophie discursive de la question environnementale à l'ère néolibérale ; c) la fabrique de la crise et l'utilisation gouvernementale de l'urgence, sous la forme d'un « Léviathan vert » qui utilise la crise elle-même comme ars regendi - l'art de gouverner - pour consolider, optimiser et étendre la domination technocapitaliste sur la vie.
Sur la base de ces hypothèses, l'économie verte peut être comprise à juste titre comme la solution que la raison néolibérale propose pour la question environnementale, dans une tentative non pas tant de sauver la planète (et avec elle, la vie) du capitalisme, mais de sauver le capitalisme lui-même des impacts environnementaux et climatiques. En d'autres termes, l'économie verte aspire à garantir que le capital puisse, de quelque manière que ce soit, surmonter sa contradiction intrinsèque qui se traduit par l'épuisement des ressources et la neutralisation du « remplacement organique » de la mémoire marxienne : pour rendre cela possible, le punctum quaestionis - l'état de la question - conduit à la redéfinition du capitalisme lui-même, selon une nouvelle configuration verte, qui lui permet de poursuivre la valorisation de la valeur, en évitant la récession et en reportant dans le temps l'éclatement de la contradiction.
Les élites turbo-financières apatrides s'approprient les revendications écologistes croissantes, nées dans les années 1970 et devenues de plus en plus solides, et les détournent vers les circuits de l'économie verte, en cohérence avec laquelle la limite environnementale doit être perçue non pas comme un obstacle au développement, mais comme une opportunité de profit sans précédent, comme un moteur de croissance renouvelé et comme le fondement d'un nouveau cycle d'accumulation.
L'erreur qui est à la base de l'« économie verte » et, plus généralement, de l'environnementalisme néolibéral dans toutes ses extra-inspections, peut être facilement identifiée dans la conviction générale que la contradiction ne réside pas dans le capitalisme en tant que tel, mais dans son fonctionnement, encore insuffisamment calibré pour trouver un équilibre avec la nature.
En somme, le capitalisme est perçu comme la thérapie d'un mal qui, tout au plus, peut être compris comme la conséquence d'une application encore perfectible du capitalisme lui-même. Il va sans dire que ce qui échappe à la raison d'être néolibérale, c'est que, comme Marx et Heidegger l'ont montré - bien que sur des bases différentes - c'est le fondement même du technocapitalisme qui consomme les entités dans leur totalité et conduit à l'épuisement de la nature.

En bref, le capitalisme n'est pas malade, comme les hérauts de l'économie verte et de l'environnementalisme néolibéral semblent vouloir le suggérer : il est la maladie. Il ne s'agit donc pas de guérir le capitalisme, mais de guérir l'humanité et la planète du capitalisme. Cela signifie que ni la justice sociale ni même un véritable environnementalisme ne peuvent exister sans l'anticapitalisme. Prétendre guérir le capitalisme signifie seulement perpétuer, sous de nouvelles formes, le système d'oppression de l'homme et de la nature par l'homme.
La dévastation de l'environnement et le changement climatique générés à son image par le technocapital (heideggérien dans son « oubli de l'Être » et sa volonté de puissance de croissance démesurée) deviennent, grâce à l'économie verte, un phénomène par lequel la ruse de la raison capitaliste (comme nous pourrions aussi l'appeler, en empruntant la formule hégélienne), se trompe elle-même en croyant pouvoir résoudre la contradiction, désormais indéniable parce qu'attestée par les données scientifiques et l'expérience quotidienne.
En d'autres termes, puisque la contradiction est réelle et évidente, et que ses effets désastreux tendent à se manifester dès le temps présent, l'ordre libéral s'emploie à la résoudre par des méthodes qui ne remettent pas en cause l'ordre capitaliste lui-même et qui, de surcroît, permettent de le maintenir et même de le renforcer.
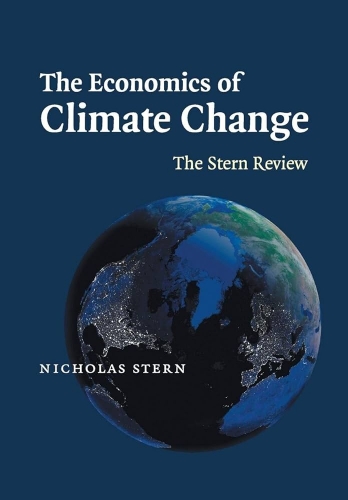
Selon la ligne théorico-pratique ouverte par le « Rapport Stern » (2006), l'économie verte conçoit de nouvelles sources de profit qui, sans affecter réellement le processus de production, ont simplement - ou semblent avoir - moins d'impact sur l'environnement et le climat. En substance, ils recommandent que nous fassions simplement ce que nous faisons déjà, mais d'une manière verte. Ainsi, non seulement le capitalisme se trompe lui-même (et nous trompe) en prétendant avoir trouvé la solution à la catastrophe environnementale dont il a été l'un des principaux responsables, mais il se revitalise et revitalise sa propre logique en modifiant les hypothèses du mode de production et en conquérant de nouveaux marchés, en inventant de nouvelles stratégies et en encourageant la consommation de nouvelles marchandises « éco-durables ».
17:34 Publié dans Actualité, Ecologie, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, écologie, économie verte, club de rome, diego fusaro, philosophie, philosophie politique, capitalisme, actualité, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 22 avril 2025
L'évaporation du christianisme
L'évaporation du christianisme
par Diego Fusaro
Source : Diego Fusaro & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/la-evaporazione-del-cristianesimo
Bergoglio nous a quittés hier à l'âge de 88 ans. Cette perte douloureuse nous offre tout de même l'occasion de faire quelques considérations générales sur sa figure et sur la manière dont il a géré l'Église de Rome ces dernières années. La première précision nécessaire concerne le fait que Bergoglio, techniquement, n'a jamais été Pape : comme nous l'avons montré largement dans notre livre "La fin du christianisme", Benoît XVI n'a jamais renoncé au munus petrinum, mais a seulement renoncé au ministerium : expliqué en termes très simples, Ratzinger a renoncé à exercer le rôle de Pape sans jamais renoncer à ce rôle. Avec la conséquence évidente qu'il est resté jusqu'à la fin Pape : pour cette raison, l'élection de Bergoglio en 2013 a été un acte nul plutôt qu'invalide. Comme chacun le sait, il ne peut y avoir qu'un seul Pape, et l'on ne fait pas de nouveau Pape tant que celui en fonction n'est pas mort ou n'a pas renoncé au munus, pas au ministerium. Ainsi, en fin de compte, le siège papal est vacant depuis le 31 décembre 2022.
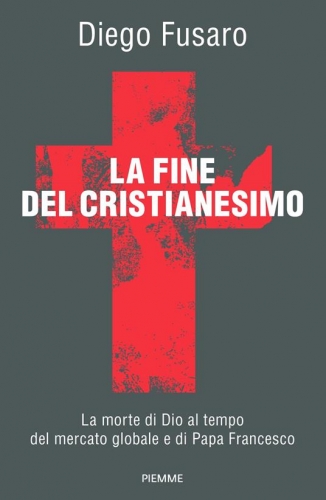
En ce qui concerne la manière dont Bergoglio a administré l'Église, nous nous contenterons ici également de résumer ce que nous avons écrit dans notre livre mentionné précédemment, nous pouvons dire qu'il a favorisé de toutes les manières les processus en cours d'évaporation du christianisme, promouvant une néo-église intelligente et liquide, post-chrétienne et ouverte à l'immanence, tout en se fermant intégralement à la transcendance. La religion de Bergoglio a été une religion du néant, sous la forme d'un nihilisme post-chrétien qui a de fait contribué à vider complètement le christianisme, le réduisant à une simple couverture idéologique de la globalisation libérale-progressiste.
Si Ratzinger avait héroïquement résisté à l'évaporation du christianisme, mettant au centre la tradition, la philosophie et la théologie, et pour cela étant continuellement combattu par l'ordre dominant, Bergoglio a agi de manière diamétralement opposée et c'est pour cette raison qu'il a été dès le départ le favori de l'ordre hégémonique : au lieu de résister à l'évaporation du christianisme, il l'a favorisée de toutes les manières. Dans les années soixante-dix, Pasolini notait que le christianisme était à un carrefour fondamental, le cristallisant ainsi : soit le christianisme repartira des origines et de l'opposition à un monde qui ne le veut plus, soit il se suicidera et se dissolvera dans la civilisation de la consommation. Avec Ratzinger, nous avons assisté à la tentative de donner vie à la première hypothèse de Pasolini. Avec Bergoglio, au contraire, nous avons constaté le triomphe de la seconde.
20:10 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : religion, pape françois, catholicisme, vatican, diego fusaro, christianisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 19 juillet 2024
Diego Fusaro: le vrai marxiste

Diego Fusaro: le vrai marxiste
Carlos X. Blanco
Source: http://decadenciadeeuropa.blogspot.com/2024/06/diego-fusaro-el-verdadero-marxista.html
Diego Fusaro est né dans la ville de Turin en 1983. Le jeune Italien va acquérir une solide formation philosophique. À l'université de Turin et à l'université San Raffaele (Milan), il fait ses armes intellectuelles, notamment en philosophie de l'histoire et en histoire de la philosophie. En tant qu'Italien, Fusaro était un grand connaisseur de ses grands compatriotes qui l'ont précédé dans le travail philosophique (Gentile, Croce, Gramsci), bien que le maître le plus direct de tous, et celui avec lequel il a eu un contact personnel, ait été Costanzo Preve (1943-2013).
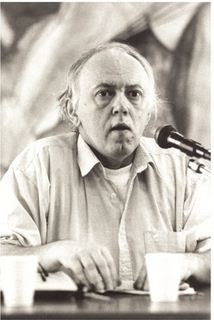
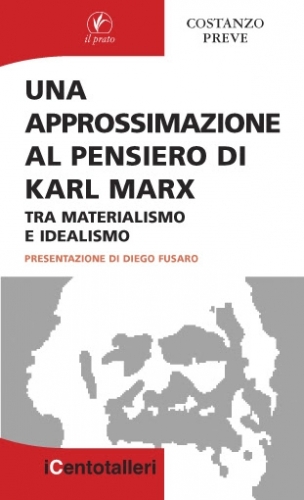
L'influence du marxiste Preve sur Fusaro est énorme et le jeune Diego est sans aucun doute l'un de ses plus fidèles disciples. Ces dernières années, la maison d'édition Letras Inquietas a entrepris un intense travail de traduction et de diffusion de l'œuvre de Preve et de tous les autres auteurs qui, avec leur touche personnelle, sont proches de lui ou sont ses continuateurs (Denis Collin, Salvatore Bravo et Diego Fusaro lui-même). Il est difficile de définir cette empreinte, mais pour utiliser une expression très prévoyante, je la qualifierais d'« hérésie marxiste ». En effet, autrefois, était hérétique celui qui rompait avec l'Église officielle, qui s'opposait à ses dirigeants ou à ses interprètes suprêmes, ou qui proposait des interprétations absolument nouvelles et scandaleuses du dogme sanctionné. Le révélateur était « un hérétique au sein d'une hérésie », comme il l'a dit. Si le marxisme, ou plutôt l'œuvre de Marx, est une hérésie pour le dogme libéral-capitaliste, Preve et les Previens, y compris Fusaro, sont une hérésie pour la Sainte Église du « matérialisme » et du « progressisme ».
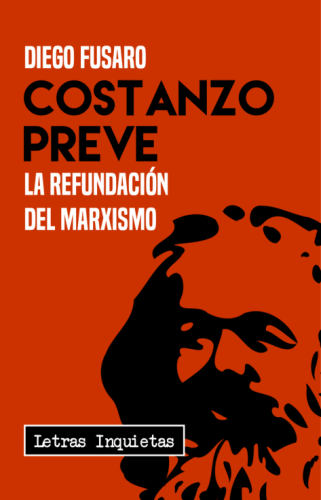
En Italie, comme en Espagne et dans d'autres pays occidentaux, la gauche a fini par s'organiser comme une Église ou une Confrérie de la « pensée politiquement correcte ». La même virulence qu'ils mettent à attaquer ceux qui « devraient être les leurs », au moyen de procédures inquisitoriales (c'est aujourd'hui l'« antifascisme »), brille par son absence chez les confrères et les petites sœurs rouges lorsqu'il s'agit de s'attaquer au système libéral ; ils mettent de côté leur anticapitalisme pour courir après de prétendus « nouveaux droits » à étendre, tandis que les « anciens droits » (les droits fondamentaux) sont systématiquement violés au milieu de leur silence complice et de leur dissimulation. L'église de la gauche bien-pensante a condamné Preve et Fusaro au moment même où ils critiquaient le pire du système libéral, et au moment même où la (mauvaise) compagnie de ces deux penseurs était considérée comme interdite. Par exemple, la fréquentation occasionnelle d'Alain de Bneoist, co-créateur historique et fondamental de la soi-disant Nouvelle Droite, ou la fréquentation interdite du géopoliticien russe A. Dugin.
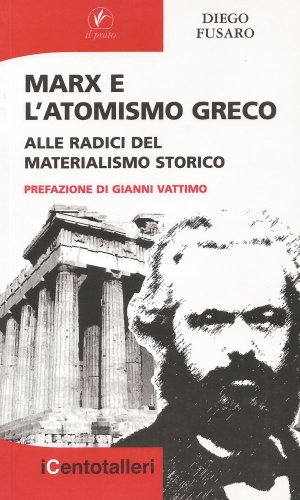
L'attitude des nonnes et des inquisiteurs de la gauche bien-pensante est très frappante. Elle rappelle le « totalitarisme » franquiste de l'après-guerre: avant d'être fiché et surveillé par « la Secreta », le dissident pouvait être observé par de vieilles femmes derrière leurs rideaux, qui surveillaient nuit et jour les fréquentations d'un jeune qui rentrait tard et avait cent regards sur lui dans le quartier. Ceux qui traînaient avec les rouges étaient des rouges. Et puis, ici et maintenant, c'est la même chose : celui qui fréquente des « fascistes » est un fasciste. Il est dommage que la gauche bien-pensante soit incapable de voir que des auteurs comme de Benosit ont beaucoup plus à offrir dans leur critique du libéralisme et du capitalisme que la plupart des paroissiens du dogme gauchiste, quoi qu'ils entendent par « fasciste ». Quiconque a étudié les principaux leaders de la Nouvelle Droite sait parfaitement que les critiques de cette école de pensée du capitalisme financier occidental, de l'OTANisme, de l'UE comme instrument au service de l'OTAN, du colonialisme américain, de l'ingénierie sociale « woke », etc. coïncident davantage avec l'approche révolutionnaire de Marx, d'un vrai Marx, qu'avec l'œuvre néolibérale systémique de ceux qui se disent ses disciples et soutiennent l'aliénation capitaliste.
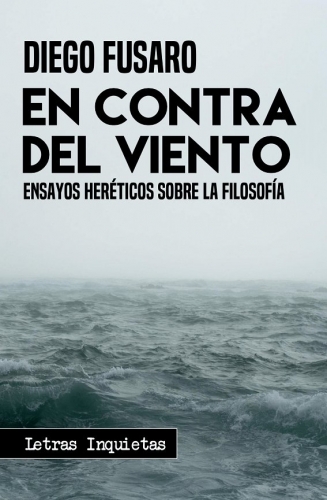
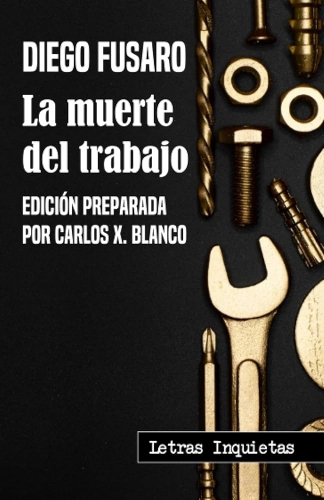
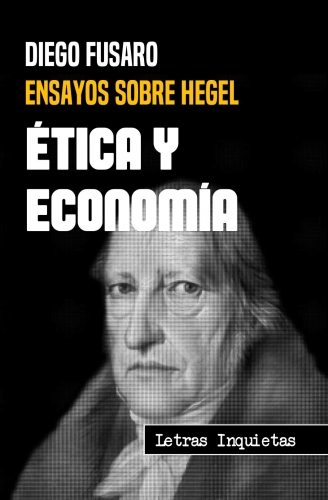
Les derniers textes de Fusaro publiés dans Letras Inquietas, « Marx : penseur de l'individualité communautaire libre », et « Preve : la refondation du marxisme » (2024), servent à enregistrer ces dettes contractées avec l'« hérétique » Preve. Il y a d'autres textes dans la même maison d'édition qui peuvent familiariser le lecteur avec ce marxiste très spécial qu'est Fusaro, un marxiste très lu par les membres de la Nouvelle Droite, une école qui converge avec la Nouvelle Gauche hérétique, celle qui combat honnêtement et avec acidité le système de l'hégémon yankee et son impérialisme chaotique. Fusaro est un auteur « Contre le vent » (titre publié en 2022), qui ose combattre l'hégémonie de la pensée néo-libérale, dont les « sociétés ouvertes » grincent au contact de Platon et de Hegel, c'est-à-dire au contact de la philosophie elle-même. Dans « Éthique et économie » (2023), l'Italien nous présente ses études les plus profondes sur Hegel. Dans « La mort du travail » et « 100% Fusaro » (2021), il compile quelques-unes des critiques les plus acerbes de l'évolution déclinante de notre société, programmée pour faire de nous des parasites et des êtres sans intérêt,
Un auteur essentiel. Un auteur incontournable. Un géant de la pensée.
A consulter:
le blog de « Letras Inquietas ».
19:17 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, diego fusaro, marxisme, théorie politique, livres, sciences politiques, politologie, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 23 juin 2024
La gauche fuchsia. Ou de la métamorphose kafkaïenne

La gauche fuchsia. Ou de la métamorphose kafkaïenne
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/la-izquierda-fucsia-o-de-la-metamorfosis-kafkiana/
Les lys qui pourrissent sentent bien plus mauvais que les mauvaises herbes [1] . Ces vers, tirés des Sonnets de William Shakespeare, pourraient à juste titre être considérés comme la description la plus réaliste du sort qui a impitoyablement englouti la gauche dans le quadrant occidental du monde après la chute du mur de Berlin.
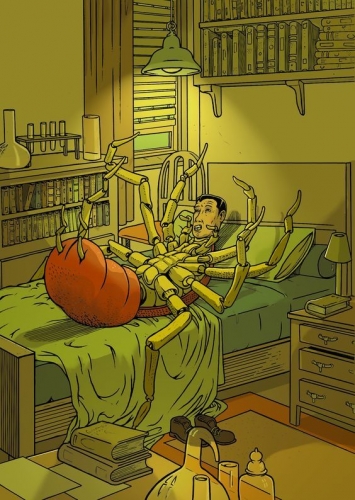
Pour évoquer une autre figure littéraire, les néo-gauchistes ont subi une Verwandlung, une "métamorphose" semblable à celle décrite par Kafka. Une métamorphose qui les a fait plonger dans l'abîme où ils se trouvent depuis 1989 et, plus encore, depuis l'arrivée du nouveau millénaire. La situation peut sembler parfois tragicomique, si l'on considère qu'aujourd'hui les slogans du Capital et les desiderata des classes dominantes (moins d'État et plus de marché, moins de liens et plus de fluidité, moins d'appartenance communautaire et plus de libéralisation individualiste) trouvent dans les programmes et le lexique de la néo-gauche arc-en-ciel une réponse ponctuelle, une défense énergique et une célébration ininterrompue. Sans hyperbole, l'ordre des dominants, dans le cadre de la mondialisation capitaliste, présente, dans la néo-gauche décaféinée, une apologie et une sanctification non moins radicales que celles qu'elle trouve dans la droite, siège traditionnel de la reproduction culturelle et politique du nexus hégémonique du pouvoir.
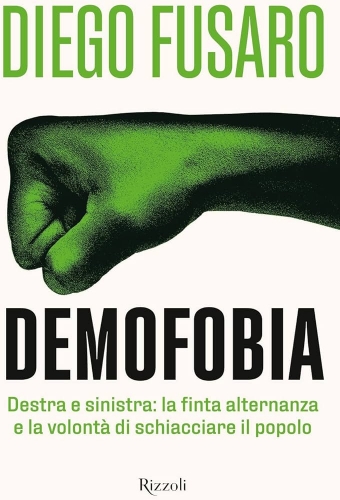
La régression et la barbarie, qui n'ont pas cessé d'accompagner le Capital, ne sont plus contestées par la gauche en faisant appel au désir de plus grandes libertés et d'avenirs anoblissants ; au contraire, elles sont obstinément défendues et présentées par la gauche elle-même comme la quintessence du mouvement de ce progrès de claritate in claritatem qui - pour le dire avec Marx - n'a pas cessé de ressembler à "cette horrible idole païenne qui ne voulait boire le nectar que dans le crâne des sacrifiés" [2]. Non plus "socialisme ou barbarie", mais "capitalisme ou barbarie", tel semble être le nouveau et magnétique mot d'ordre d'une gauche qui, en se reniant elle-même et en reniant sa propre histoire, est devenue la plus fidèle gardienne du pouvoir néolibéral.
Nous appelons la Nouvelle Gauche post-moderne et néo-libérale, ennemie de Marx, de Gramsci et des classes laborieuses et, en même temps, amie du Capital, de la ploutocratie néo-libérale et du Nouvel Ordre turbo-capitaliste mondial, la New Left comme on dit en "anglais des marchés", cet anglais-là qui lui est si cher. Nous utilisons cette terminologie pour distinguer soigneusement la néo-gauche fuchsia de la vétéro-gauche rouge qui, à différents degrés et avec différentes intensités (du réformisme au maximalisme révolutionnaire, du socialisme au communisme), a tenté de différentes manières, au 19ème siècle et plus tard au cours du "siècle court", de "prendre d'assaut les cieux", de modifier l'équilibre des pouvoirs, de réaliser le "rêve d'une seule chose" et de mettre en pratique la "simplicité insaisissable".
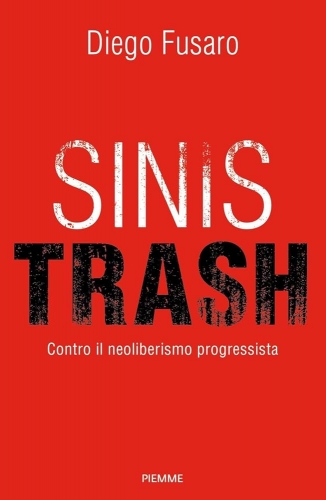
Plus la vieille gauche traditionnelle, socialiste et communiste semble noble, avec ses succès et ses réalisations, mais aussi avec ses échecs et ses défaites, plus elle suscite l'effet désagréable des "lys flétris" dont parlait Shakespeare, la Nouvelle gauche fuchsia réduite au statut de gardien de la cage de fer du Capital (avec le polythéisme des valeurs de consommation qui y est incorporé) ; une garde sui generis cependant, qui, pour préserver sa propre identité - en réalité perdue depuis longtemps - et l'ancien consensus de force du côté des droits et des faibles, et donc pour pouvoir conduire les masses à l'acceptation silencieuse du pouvoir du néo-capitalisme, doit en permanence se ressusciter à nouveau. Elle doit sans cesse ressusciter des ennemis définitivement éteints (l'éternel fascisme) ou inventer de nouvelles luttes annexes (les micro-luttes identitaires pour le genre et l'économie verte), qui lui permettent d'apparaître comme partie prenante de l'offensive contre les maux d'un existant auquel il a prêté allégeance sans l'avouer.
C'est là que réside l'élément vraiment trash de la gauche néolibérale. En particulier, l'élément le plus abject de la Nouvelle Gauche post-moderne arc-en-ciel consiste à se considérer, avec une fausse conscience nécessaire, comme le front avancé du développement et du progrès universels, sans réaliser que le développement et le progrès qu'elle promeut coïncident avec ceux du Capital et de ses classes ; un développement et un progrès qui, par conséquent, s'accompagnent de la déresponsabilisation, de l'appauvrissement et de la régression des classes nationales-populaires, c'est-à-dire celles que la gauche néolibérale "anti-populiste" considère aujourd'hui ouvertement comme ses principaux ennemis. Et que la vieille gauche rouge a assumé comme son propre sujet de référence social et politique, dans l'empressement de provoquer l'émancipation de la prose de l'aliénation capitaliste. Il n'y a pas de doute : pour la Nouvelle Gauche libérale-progressiste, l'ennemi principal n'est pas la mondialisation capitaliste, mais tout ce qui ne s'est pas encore incliné devant elle et lui résiste encore.
L'antifascisme en l'absence de fascisme et les micro-luttes identitaires pour les droits arc-en-ciel ou, en tout cas, pour des questions sidéralement éloignées de la contradiction capitaliste, permettent à la Nouvelle Gauche de bénéficier d'un triple avantage: (a) disposer d'un alibi pour justifier son adhésion désormais intégrale au programme de la civilisation néolibérale postmoderne ; (b) maintenir sa propre identité et son propre consensus, à travers la fiction de la lutte contre des ennemis morts et enterrés (le fascisme) ou contre des instances qui, de toute façon, ne remettent pas en cause la reproduction globale de la société techno-capitaliste ; (c) conduire les masses de militants - qu'il conviendrait souvent d'appeler "militants" - tout droit vers l'adhésion à l'anarchie efficace du néo-cannibalisme libéral, présenté précisément comme progressiste et "de gauche".
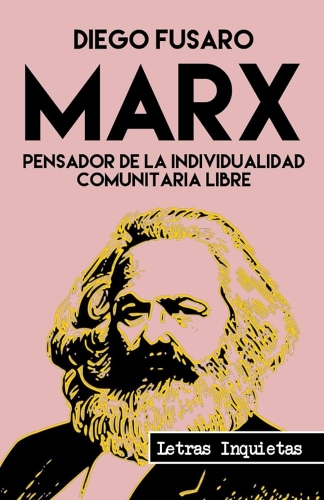
Le consensus inertiel dont bénéficie encore la néo-gauche fuchsia, grâce à un passé glorieux du côté du travail et de l'émancipation, sert ainsi à exploiter et donc à légitimer ce que la vieille gauche rouge avait combattu. A l'appui de la thèse de ce processus de métamorphose, qui a commencé avec les soixante-huitards et s'est manifesté sous sa forme la plus radicale après l'annus horribilis de 1989, il suffit de rappeler que, depuis les années 90 du "petit siècle", chaque succès de la gauche en Occident tend à coïncider avec une défaite retentissante des classes laborieuses.
Au nom du Progrès, la gauche s'est faite, avec encore plus de zèle que la droite, le promoteur de la libéralisation et de la privatisation consuméristes, de la précarisation du travail et de l'exportation impérialiste des droits de l'homme ; en d'autres termes, elle a réalisé, avec une méthode scientifique et une rigueur admirable, le tableau de bord du bloc oligarchique néolibéral. Et elle l'a fait en soutenant toujours - et en ennoblissant comme un Progrès - l'extension de l'impitoyable logique marchande à toutes les sphères du monde de la vie, à tous les coins de la planète, à tous les recoins de la conscience, en délégitimant symétriquement (comme "régression", "fascisme", "totalitarisme", "populisme" et "souverainisme") tout ce qui pourrait encore contribuer, selon les mots de Walter Benjamin, à tirer le frein d'urgence, à arrêter la "fuite éperdue" vers le néant de la barbarie et du nihilisme.
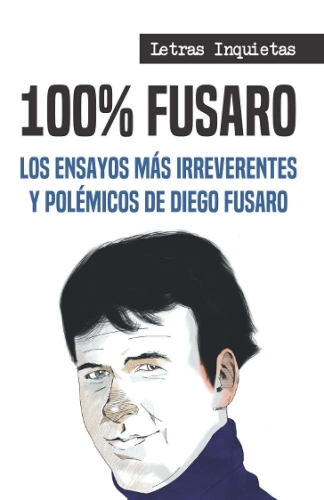
Dans le lexique politique postmoderne de la Nouvelle Gauche arc-en-ciel, il n'y a aucune trace des droits des travailleurs, des peuples et des opprimés: au contraire, le "populisme" est l'étiquette péjorative, de plus en plus en vogue, qui - en maîtres de la néo-langue brevetée par Orwell [3] - délégitime a priori toute revendication nationale-populaire des classes laborieuses et du peuple souffrant, tout écart par rapport au "Progrès", c'est-à-dire au programme de développement de la civilisation néolibérale. Il ne fait aucun doute que le discours du capitaliste, comme l'appelait Lacan, et la "nouvelle raison du monde" néolibérale [4] ont également saturé l'imaginaire d'une gauche désormais philo-atlantiste et orientée vers le marché, qui est passée cyniquement et sans complexe de la lutte contre le Capital à la lutte pour le Capital.
Cette intégration dans le capitalisme mondial est rarement admise ouvertement pour ce qu'elle est réellement: un alignement conscient sur le monde en opposition auquel les politiques de la gauche socialiste et communiste ont été légitimées pendant la majeure partie du 20ème siècle. De manière diamétralement opposée, la nouvelle gauche est presque toujours justifiée par le recours à la formule hypocrite, libératrice et déresponsabilisante de "il n'y a pas d'alternative" ou à sa variante - sur laquelle se fonde la nouvelle théologie économique - selon laquelle "c'est ce que le marché exige". Il n'est pas rare que cette formule soit louée par la gauche comme une adhésion au rythme du progrès, en oubliant de souligner que le progrès en cours coïncide avec celui du capital et de sa marche triomphale vers l'affirmation de soi.
Cette obscène adhésion apologétique à la prose réifiante de l'inégalité capitaliste parmi les hommes et à son augmentation vertigineuse est prétextée dans le quadrant gauche par le recours au théorème de l'identification du statu quo intrinsèquement antidémocratique avec la "démocratie" parfaitement complète qui doit être protégée des dangereuses tentatives de "subversion fasciste", qui à leur tour sont faites pour coïncider idéologiquement avec toute prétention à mettre en marche l'exode de la cage de fer néolibérale.
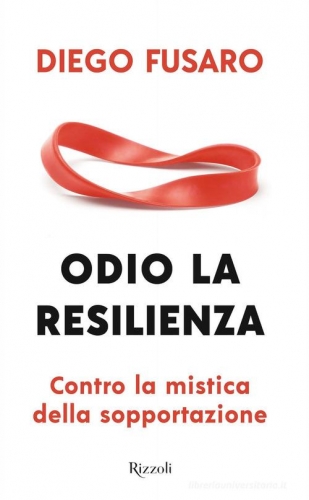
La rhétorique antitotalitaire, comme l'ont montré Losurdo [5] et Preve [6], joue un rôle décisif dans la consolidation du consensus vers la civilisation néolibérale : elle permet de glorifier le mode de production capitaliste comme le royaume de la liberté, en liquidant comme " totalitaire " le communisme historique des 19ème et 20ème siècles et, en perspective, tout mouvement qui pourrait proposer des voies alternatives d'émancipation par rapport au capitalisme lui-même. D'une part, le seul totalitarisme réellement existant aujourd'hui - celui de la société totalement administrée du techno-capital - est vénéré comme la société ouverte de la liberté parfaitement mise en œuvre ; et, d'autre part, l'idée de socialisme est condamnée sans appel, induisant l'adaptation, euphorique ou résignée, à la " cage de fer " néolibérale.


Achille Occhetto et Giorgio Napolitano.
L'adoption du paradigme antitotalitaire a contribué de manière décisive à la métamorphose de la Nouvelle Gauche en une force libérale-atlantiste complétant le rapport de force hégémonique. Il ne faut pas oublier que dès mai 1989, c'est-à-dire quelques mois avant la chute du mur, Achille Occhetto et Giorgio Napolitano - figures de proue du Parti communiste italien - se trouvaient à Washington (c'était d'ailleurs la première fois dans l'histoire qu'un secrétaire du PCI se voyait accorder un "visa"). Occhetto avait mis le PCI sur la voie d'une métamorphose kafkaïenne ("svolta della Bolognina") en Nouvelle Gauche, c'est-à-dire en un parti radical de masse. Napolitano, quant à lui, occupera deux fois de suite la fonction de président de la République (de 2006 à 2015), sans s'opposer ni à l'intervention impérialiste en Libye (2011) ni à l'avènement du " gouvernement technique " ultralibéral de Mario Monti (2011).
Dans ce même sillage métamorphique, sous le signe de la rhétorique antitotalitaire, il faut lire la déclaration du secrétaire du Parti de la refondation communiste, Paolo Ferrero, dans le journal Liberazione du 9 novembre 2009, à propos du "jugement politique sur la chute du mur de Berlin": "ce fut un événement positif et nécessaire, à célébrer". Les propos de Ferrero auraient pu être ceux de n'importe quel homme politique d'obédience libérale-atlantiste.
La métamorphose kafkaïenne de la Nouvelle Gauche apparaît d'autant plus clairement si l'on considère que, pour sa part, le communisme a été la promesse la plus séduisante d'un bonheur autre que celui disponible, mais aussi la critique la plus glaçante de la civilisation de la marchandise: il a été, au moins en théorie, la plus grande tentative jamais faite dans l'histoire des opprimés pour briser les chaînes, sans rien à perdre et avec seulement un monde à gagner.
C'est aussi pour cette raison que la gauche post-marxiste et néolibérale figure parmi les réalités les moins nobles qui soient: elle a déterminé opérationnellement ou, en tout cas, favorisé docilement le silence du "rêve d'une chose", sa triste conversion en "rêve des choses" et la réconciliation avec le monde de l'exploitation et de l'inégalité, de la réification et de l'aliénation.
Pour reprendre la formule bien connue de Benedetto Croce à propos du christianisme [7], il fut un temps où il était impossible de ne pas se déclarer "de gauche", tout comme aujourd'hui, pour les mêmes raisons, il est impossible de se dire "de gauche". Essayer de réformer ou de refonder la gauche est une opération intrinsèquement impossible et inutilement énergisante, puisque - comme nous essaierons de le montrer - son paradigme est contaminé dès le début par cette contradiction, qui explose complètement en deux phases: la première avec les soixante-huitards, et la seconde avec 1989. A partir de Marx, de Gramsci et de l'anticapitalisme, le chemin à la recherche de la communauté émancipée pourrait être repris, sous la bannière des relations démocratiques entre individus également libres.
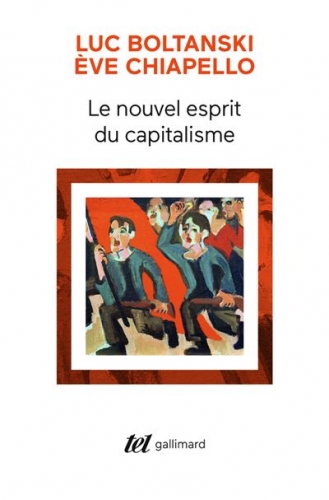
Mais pour ce faire, il faudra en même temps dire adieu au paradigme de la gauche, animé - comme nous l'ont appris les études de Boltanski et Chiapello, celles de Michéa et Preve - par une adhésion irréfléchie au mythe du Progrès et à la croyance erronée que l'approbation du monde bourgeois et de sa culture produit par elle-même l'émancipation. Il faudra "déconnecter" le paradigme de Marx de la gauche et de ses apories internes, repartir de Marx lui-même et s'aventurer vers un communautarisme anticapitaliste nouveau - et à imaginer - au-delà des colonnes d'Hercule de la droite et de la gauche.
Nous considérons donc qu'il est inutile et, de surcroît, contre-productif de s'obstiner à "hurler avec les loups", pour reprendre l'heureuse formule que Hegel utilisait à Francfort pour expliquer qu'il n'était pas possible de réformer quoi que ce soit chez les Francfortistes [8]. Nous vivons à l'époque de la "gauche impossible". Si, comme Preve aimait à le dire, "le message est irrecevable quand le destinataire est irréformable", il faut aller plus loin, sans se soucier du chœur vertueux des loups hurlants. Ces derniers, plongés dans l'agoraphobie intellectuelle, s'opposeront à toute innovation théorique et à toute éventuelle production théorico-pratique de nouveaux paradigmes ayant la capacité - pour reprendre les hendíadis explosifs mis en cause par Marx - de critiquer théoriquement et de changer pratiquement l'ordre des choses.
La néo-gauche glamour, en effet, semble définitivement figée dans son propre paradigme. Et, à la merci de son agoraphobie intellectuelle permanente, elle ne veut pas s'exposer à un dialogue sur les questions et les problèmes qui la concernent et qui concernent sa propre vision : son indisponibilité pour la discussion rationnelle et problématisante fait que celui qui ose la critiquer est, pour cette raison même, ostracisé comme un ennemi à expulser et comme un infiltré fasciste qui - nouvel hérétique - tente de pénétrer dans la citadelle "pure" pour la corrompre.

Même ici, la Nouvelle Gauche joue une fonction apologétique non négligeable vis-à-vis de la globocratie néolibérale : plus précisément, une fonction apotropaïque.
En effet, dans le sillage de son passé, la gauche continue à se présenter perfidement comme le camp de l'émancipation, à l'heure où elle ne défend que les raisons du bloc oligarchique néolibéral : et par ce biais, en se prétendant monopolistiquement du côté de la défense des dominés (qu'en réalité elle contribue quotidiennement à déresponsabiliser), elle contribue à délégitimer toute tentative de critique et de dépassement du capitalisme, en la qualifiant immédiatement de "pas de gauche" et donc de réactionnaire par définition.
En bref, le paradoxe réside dans le fait que si la droite incarne pleinement le paradigme de ceux qui, de diverses manières, s'accommodent du statu quo, la nouvelle gauche prétend représenter exclusivement toute instance critique possible, dans l'acte même par lequel - pas moins que la droite - elle est organique à l'ordre des marchés. Ce faisant, elle garantit sa fonction de gardien de la meilleure façon possible.
Notes:
[1] William Shakespeare. Sonnets. Éd. Cliff, 2013
[2] Karl Marx. "Future Results of British Rule in India", 1853 http://www.marxist.org/espanol/m-e/1850s/1853-india.htm
[3] George Orwell. 1984. Signet Classic, 1961
[4] Pierre Dardot et Christian Laval. La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale. Ed. Gedisa, 2015
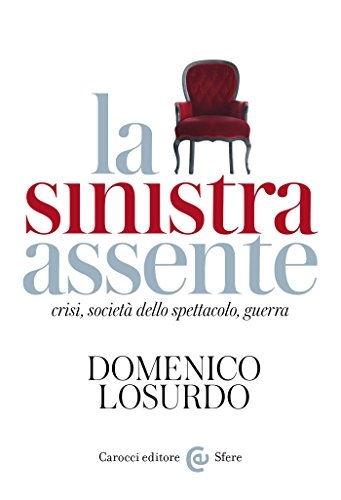
[5] Domenico Losurdo. La gauche absente. Crise, société du spectacle, guerre. Ediciones de Intervención Cultural, 2015
[6] Costanzo Preve. Destra e Sinistra. La natura inservibile di due categorie tradizionali. Petite Plaisance, 2021.
[7] Benedetto Croce. Perché non possiamo non dirci <cristiani>. Ed. Laterza, 1959
[8] Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Enciclopedia delle scienze filosofiche in compendio. Ed. Laterza, 1963
14:48 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, fauche, gauche fuchsia, nouvelle gauche, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 24 mars 2024
Gastronomiquement correct. McDonald's et la mondialisation à table

Gastronomiquement correct. McDonald's et la mondialisation à table
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/gastronomicamente-correcto-mcdonalds-y-la-mundializacion-a-la-mesa/
L'identité gastronomique se déclare au pluriel car il y a de nombreuses traditions à table et chacune d'entre elles existe dans un nexus constant de mélange et d'hybridation avec les autres. Chaque identité existe, en soi, comme le résultat jamais définitif d'un processus par lequel elle s'entrelace ou - pour rester dans le domaine des métaphores culinaires - se mélange avec les autres.
Il est vrai que dans le passé, si l'on s'aventure dans l'"archéologie du goût", cette riche pluralité culturelle liée aux traditions alimentaires a eu tendance, dans certains cas, à dégénérer en des formes de nationalisme culinaire, en vertu desquelles chaque peuple se considérait comme détenteur d'une sorte de primauté oeno-gastronomique. À cet égard, certains ont inventé la catégorie de "gastro-nationalisme", bien qu'en réalité, même si la cuisine est fondamentale pour tracer les frontières politiques et culturelles des identités nationales, les traditions culinaires n'ont jamais existé à l'origine sous une forme nationale, étant plutôt des héritages régionaux, comme l'a montré Mintz. Quoi qu'il en soit, les politiques gastro-nationales se sont également manifestées en raison de la tendance des États à utiliser la reconnaissance de leur propre patrimoine alimentaire comme un instrument de leur propre politique, de leur propre reconnaissance sur la scène internationale et dans la sphère de ce qui est généralement défini comme la "gastro-diplomatie", faisant ainsi allusion à la pratique qui tire parti de la nature relationnelle de la nourriture et cherche à consolider et à renforcer les liens au niveau politique.


Dans l'apothéose d'une sorte de "boria delle nazioni", comme aurait pu l'appeler la Scienza nuova de Giambattista Vico, les Anglais se croyaient supérieurs grâce à leur roast-beef, les Français grâce à leur grande cuisine - le camembert, en particulier, est devenu un "mythe national" gaulois - ou les Italiens grâce à leur variété, unique au monde. Très souvent, cette pluralité a favorisé un désir fructueux d'expérimenter et de connaître ce qui est différent, et donc un dialogue interculturel médiatisé par le patrimoine alimentaire de chaque peuple.
À cet égard, l'étude de Mennell sur la différence gastronomique entre les Anglais et les Français, emblème de la diversité des deux peuples, reste essentielle. Montanari, pour sa part, s'est risqué à soutenir la thèse suggestive selon laquelle l'identité italienne est née à table bien avant l'unification politique du pays. Par ailleurs, Ortensio Lando, dans son Commentario delle più notabili e mostruose e cose d'Italia ed altri luoghi (1548), décrit les spécialités gastronomiques et œnologiques des différentes villes et régions italiennes avec un luxe de détails et de particularités. Et le plus célèbre cuisinier italien du 15ème siècle, le maestro Martino, avait inscrit dans son livre de recettes le chou romanesco et le gâteau bolognais, les œufs florentins et tant d'autres spécialités locales qui, en fait, forgeaient l'identité italienne à table.
Conformément à son idéologie, la désimbrication capitaliste mondiale trouve dans la suppression des identités œno-gastronomiques et dans l'éloignement de leurs racines historiques un moment fondamental qui lui est propre. Même la table est submergée par les processus de redéfinition post-identitaire et homologue qui sont essentiels au rythme de la globalisation turbo-capitaliste.
C'est pourquoi nous assistons très souvent au remplacement des aliments dans lesquels se trouve l'esprit du peuple et de la civilisation dont nous sommes les enfants - la viande rouge, le fromage, le vin, les aliments locaux et villageois - par des substituts créés ad hoc et, plus précisément, par des aliments produits par des multinationales sans visage et sans racines, ces mêmes multinationales qui financent assidûment les opérateurs et les agences qui décideront "scientifiquement" ce qui est sain et ce qui ne l'est pas, en prolongeant le lien hégémonique entre le marché capitaliste et le système techno-scientifique.

Ainsi, dans le cadre du nouvel ordre gastronomique "indigeste", les goûts tendent à devenir de plus en plus horizontaux à l'échelle planétaire, dans l'anéantissement de la pluralité et de la richesse oeno-gastronomique dans laquelle s'enracinent les identités des peuples: si la tendance actuelle n'est pas contrée, on assistera à la création d'un mode d'alimentation unique et standardisé, privé de variété et de diversité, ou, si l'on préfère, d'un sentire idem global, qui se présentera comme la variante gastronomique d'un consensus de masse. Les aliments historiquement ancrés dans le patrimoine identitaire et les racines traditionnelles des peuples - il y a en effet un genius gustus et un genius loci - seront remplacés par des aliments sans identité et sans culture, intégralement désymbolisés, identiques dans tous les coins de la planète, comme c'est déjà en partie le cas. Cela nous permet d'affirmer que le gastronomiquement correct est la variante alimentaire du politiquement correct, tout comme le "plat unique" devient l'équivalent de la pensée unique. L'ordre économique dominant produit, à son image et à sa ressemblance, les ordres symboliques et gastronomiques correspondants.
Leur dénominateur commun est la destruction de la pluralité des cultures, sacrifiées sur l'autel du monothéisme du marché et du modèle du consommateur individualisé et standardisé, soumis à cette "grande charrette" qui succède au Big Brother orwellien. Les pédagogues du mondialisme et les architectes du néo-capitalisme, avec un paternalisme alimentaire sans précédent fondé sur l'ordre du discours médico-scientifique, cherchent à rééduquer les peuples et les individus au nouveau programme gastronomiquement correct, c'est-à-dire au nouveau menu mondialisé composé d'aliments homologués et homogénéisés, L'alimentation composée d'aliments standardisés, souvent incompatibles avec l'identité des peuples, est présentée par les administrateurs du consensus comme optimale pour l'environnement et la santé, contrairement aux plats traditionnels, qui sont ostracisés comme "nocifs" à tous égards.

Cela confirme, également sur le plan alimentaire, la thèse du Manifeste "marxo-engelsien": le Capital "a imprimé un cachet cosmopolite à la production et à la consommation de toutes les nations", en les poussant vers cette homologation qui est la négation du pluralisme internationaliste. La dé-souverainisation des aliments, menée au nom du mondialisme gastronomiquement correct et des intérêts multinationaux, est pilotée par les cyniques et apatrides seigneurs du profit, grâce aussi à l'utilisation d'outils biologiques spécifiques, tels que les pesticides et les engrais de synthèse, ainsi qu'aux pratiques du génie génétique. C'est ainsi que s'explique, à titre d'exemple, l'utilisation des "organismes génétiquement modifiés" (OGM), qui contaminent génétiquement les espèces naturelles, sabotent l'agriculture conventionnelle et privent les peuples de leur souveraineté alimentaire. Ce faisant, ils les obligent à dépendre des multinationales qui leur fournissent des semences et des substances brevetées, protégeant dans l'abstrait, au niveau de la propagande idéologique, la santé de tous et, dans le concret, les profits de quelques-uns.
D'après ce qui a été expliqué ci-dessus, historiquement, l'alimentation a toujours été un véhicule culturel fondamental et, en particulier, interculturel, se révélant comme la manière la plus simple et la plus immédiate de décoder le langage d'une autre culture, afin d'entrer en contact avec elle et ses coutumes. L'élimination des spécificités alimentaires locales est, pour cette même raison, cohérente avec la désintégration continue de toute relation authentiquement interculturelle, remplacée par le monoculturalisme de la consommation: la multiplicité historique des goûts enracinés dans la tradition est remplacée par l'unité des goûts an-historiques et a-prospectifs du menu mondialisé. Après la limitation de "ce qui peut être dit et pensé" par l'imposition du nouvel ordre symbolique politiquement correct, la nouvelle réglementation de "ce qui peut être mangé et bu" est maintenant imposée, de plus en plus furieusement, selon l'ordre hégémonique global-élitiste du bloc oligarchique néolibéral.
Si, dans le passé, la cuisine déterminait aussi les identités culturelles, aujourd'hui, surtout depuis 1989, elle tend à les supplanter. Les aliments traditionnels enracinés dans l'histoire des peuples sont de plus en plus souvent remplacés - parce qu'ils ne sont plus considérés comme "convenables" - par ces aliments de marque délocalisés et "global fusion" qui, dépourvus d'identité et d'histoire, donnent naissance à un régime alimentaire artificiel et nomade, déraciné et culturellement vide, qui homogénéise les palais et les têtes ; un régime qui, cependant - nous assurent les stratèges du consensus - respecte l'environnement et la santé.

Grâce au pouvoir immédiat et inégalé de l'image, une scène de Salò (1975) de Pier Paolo Pasolini - un film conçu ad hoc pour être horrible et obscène, tout aussi horrible et obscène que la civilisation de consommation qu'il photographie - peut valoir plus que n'importe quelle description conceptuelle articulée. La scène se déroule dans l'un des "cercles infernaux" les plus macabres dont le film est composé et qui, à son tour, se veut une allégorie de la civilisation de consommation et de ses erreurs: les détenus de la Villa de los suplicios sont condamnés à manger des excréments.
L'acte coprophagique devient ainsi le symbole même de la société marchande, qui condamne quotidiennement ses ergostuli dociles et inconscients à manger la merde liée à la forme marchandise, un objet simple et apparemment banal, qui cristallise pourtant en lui toutes les contradictions de la société capitaliste, à commencer par celle liée à l'antithèse entre valeur d'usage et valeur d'échange. Entraînant Pasolini "au-delà de Pasolini", cette scène macabre et scandaleuse semble trouver une nouvelle confirmation dans les nouvelles tendances gastronomiquement correctes de la société de marché globale qui, sans autre violence que le glamour de la manipulation, contraint ses propres serviteurs au geste coprophagique.

À l'ère du capitalisme mondial, l'alimentation est généralement gérée par des multinationales et des sociétés offshore, qui manipulent le goût et contrôlent l'abandon de tout ce qui est pluriel et qui n'est pas spécifiquement modelé par le nouveau style de vie déraciné et flexible. Dans ce contexte, McDonald's (paradigme indépassable du "non-lieu", interrogé par Marc Augé - et on pourrait aussi ajouter, du "non-alimentaire") représente la figure par excellence de la globalisation gastronomique et de l'impérialisme culinaire de l'assiette unique triomphant après 1989 : une seule façon de manger et de penser la nourriture, de la distribuer et de la présenter, de la produire et d'organiser le travail, naturalisant un geste et ses conditions d'opportunité dans quelque chose d'aussi évident et manifeste que l'air que nous respirons.
Mais McDonald's lui-même incarne le sens profond de la mondialisation d'un autre point de vue, identifié par Ritzer et exprimé dans sa considération selon laquelle "il est devenu plus important que les États-Unis d'Amérique eux-mêmes". McDonald's, en effet, représente le pouvoir écrasant du capital supranational, aujourd'hui au-dessus - par la puissance et la force spécifique, par la reconnaissance et par la capacité d'attraction - des pouvoirs nationaux traditionnels qui, précisément pour cette raison, ne sont pas capables de le gouverner et, souvent, sont fortement conditionnés par lui.
Que le célèbre fast-food mondialiste représente la figure par excellence de la mondialisation capitaliste semble d'ailleurs conforté par le fait que les deux arcs jaunes qui forment le "M" stylisé de son logo sont aujourd'hui, selon toute vraisemblance, plus célèbres et plus connus que la croix chrétienne, le croissant islamique et le drapeau américain lui-même. Le merchandising universel se confirme, même sur le plan iconographique, comme la grande religion de notre temps en termes de diffusion, de nombre de prosélytes et de capacité à conquérir les âmes avant les corps. C'est pourquoi les arches jaunes de McDonald's, tout comme la bouteille profilée de Coca-Cola, représentent le symbole de la mondialisation en tant que "mauvais universalisme" et, en même temps, la cible privilégiée de l'anti-impérialisme gastronomique.

Comme le souligne Marco D'Eramo, mordre dans un hamburger McDonald's peut, à première vue, sembler un geste évident et naturel. Avec ses saveurs standardisées, sa moutarde et son ketchup, ses cornichons et ses oignons, les mêmes de Seattle à Singapour, de Gênes à Madrid, servis de la même manière et par des serveurs vêtus d'uniformes identiques, le hamburger semble toujours et partout le même, presque comme si, partout dans le monde et à tout moment, il était prêt à se matérialiser à la demande du client; presque comme s'il était la manière naturelle de manger et, pour cette raison même, générait partout une identification et un sentiment de familiarité.
Comme la table dont parlait Marx dans les premières sections du Capital, le hamburger de McDonald's apparaît désormais comme un objet évident et trivial, mais qui, s'il est analysé du point de vue de la "valeur d'échange" et de la socialité, de la division du travail et de la standardisation de la manière de manger, révèle tout le volume de significations et de contradictions qui innerve le mode de production capitaliste à l'ère de la mondialisation néolibérale.
En ce sens, le slogan publicitaire choisi par McDonald's en Italie il y a quelques années mérite d'être pris en considération, même s'il est télégraphique : "Ça n'arrive que chez McDonald's". La formule promet une expérience unique et non reproductible, qui est toujours proposée, toujours de la même manière, dans tous les McDonald's du monde. De plus, elle augure d'une expérience hors du commun qui, en réalité, coïncide en tous points avec l'expérience standardisée de plus en plus répandue de la consommation alimentaire à l'heure de la mondialisation gastro-anomique.
Il serait tout à fait juste d'identifier le hamburger de McDonald's comme l'effigie même de la mondialisation, quel que soit le point de vue à partir duquel on l'observe : qu'il s'agisse de l'homologation des savoirs et des saveurs, ou de la rationalisation capitaliste du mode de gestion de la production et de l'organisation sociale du travail, McDonald's incarne parfaitement le nouvel esprit du capitalisme, sa disposition combinée à l'uniformisation et à l'aliénation, à la réification et à l'exploitation qui, au lieu de reculer au nom de rêves de libertés meilleures, s'étend à l'espace du monde, devenant l'image d'un bonheur réifié et low-cost.

La preuve en est que, quelques mois après la chute du mur de Berlin, le premier fast-food McDonald's a ouvert ses portes en Allemagne de l'Est, à Plauen (photo), où avait eu lieu la première manifestation de masse contre le gouvernement communiste. Un tel événement, sur le plan symbolique avant même d'être matériel, a marqué d'un impact fort la transition soudaine du socialisme réel au mondialisme capitaliste, du communisme au consumérisme.
Deux exemples typiques de la mondialisation flexible sont imbriqués dans le régime alimentaire de McDonald. D'une part, nous avons la présence d'une nourriture standardisée, sans racines culturelles et accessible à tous. Et d'autre part, l'organisation flexible : a) d'une nourriture extrêmement rapide, consommée aux heures les plus diverses de la journée ; b) de lieux conçus comme des non-lieux, comme de simples points de passage inhabitables ; et c) de travailleurs, soumis à des contrats à très haut taux de flexibilité et à faible qualification.
19:37 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : mcdonald, diego fusaro, gastronomie, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 24 février 2024
L'État managérial néolibéral et les organisations non gouvernementales (ONG)

L'État managérial néolibéral et les organisations non gouvernementales (ONG)
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/el-estado-gerencial-neoliberal-y-...
La "managérialisation" de l'Etat, imposée avec grande arrogance après 1989, correspond en fait à sa neutralisation ou, plus précisément, à sa subsomption sous la dynamique économique qui a conduit à la réalisation de la prophétie de Foucault: "il faut gouverner pour le marché, au lieu de gouverner à cause du marché".
Le renversement du rapport de force traditionnel a finalement conduit au passage du marché sous la souveraineté de l'État à l'État sous la souveraineté du marché: en plein cosmopolitisme libéral, l'État n'est plus que l'exécutant de la souveraineté du marché.
Célébrée par la nouvelle gauche post-gramscienne et son programme (qui coïncide de plus en plus clairement avec celui de l'élite libérale), l'abolition de la primauté de l'État a contribué à libérer non pas les classes dominées, mais la "bête sauvage" qu'est le marché.
A l'ère de l'Etat à souveraineté limitée ou dissoute, la prérogative de superiorem non recognoscens est acquise de manière stable et directe par l'élite mondialiste qui prend le figure du seigneur néo-féodal, qui l'exerce à travers des organismes reflétant ses intérêts - de la BCE au FMI. L'économie planétaire a conquis le statut d'une puissance qui ne reconnaît rien comme supérieur.
Les entités privées et supranationales susmentionnées annihilent toute possibilité d'aborder avec des ressources publiques les questions sociales dramatiques et urgentes liées au travail, au chômage, à la misère croissante et à l'érosion des droits sociaux.

En l'absence du pouvoir édificateur de l'État, les élites ploutocratiques libérales-libertaires prêchent ouvertement et pratiquent discrètement, dans leur propre intérêt, la modération salariale, le contrôle des comptes publics et, bien sûr, la sanction d'un éventuel non-respect. En même temps, elles peuvent récupérer tout ce qu'elles ont perdu dans les conflits de classe, c'est-à-dire tout ce que le mouvement ouvrier a réussi à obtenir au cours du 20ème siècle - le siècle des conquêtes ouvrières et sociales, et pas seulement des "tragédies politiques" et des totalitarismes génocidaires: de l'entrée du droit sur le lieu de travail à la formation des syndicats, de l'éducation gratuite pour tous aux fondements de l'État-providence.
En outre, le fanatisme économique de classe peut facilement utiliser les idéologies du passé, liées à des projets politiques ayant ignominieusement échoué, comme une ressource symbolique négative pour se légitimer. Il peut désormais se présenter comme préférable à toute expérience politique antérieure, ou liquider a priori tout projet de régénération du monde et toute passion utopique-transformatrice, immédiatement assimilés aux tragédies du 20ème siècle.
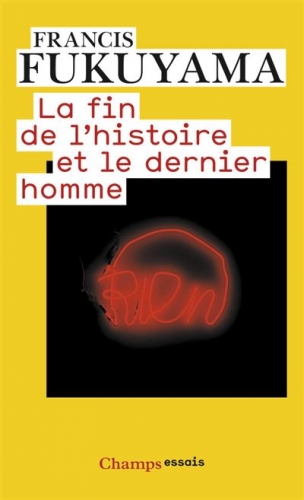
La proclamation de la Fin de l'Histoire est proposée, depuis 1992, comme le condensé idéologique du monde d'aujourd'hui entièrement subsumé par le capital. Emblématique de la philosophie destinaliste du progrès capitaliste de l'histoire, elle a réussi à installer dans la mentalité générale la nécessité de s'adapter aux nouveaux rapports de force. Et cela, d'ailleurs, avec la conscience - cynique ou euphorique, selon les cas - d'être parvenu au terme de l'aventure historique occidentale, achevée avec la liberté universelle du marché planétaire et l'humanité réduite à l'état d'atomes consommateurs solitaires, à la volonté de puissance abstraitement illimitée et concrètement coextensive par rapport à la valeur d'échange disponible.
Fonctionnelle pour l'alignement général sur l'impératif du ne varietur, la démystification postmoderne des grands méta-récits a procédé de pair avec l'imposition d'un seul grand récit autorisé et idéologiquement naturalisé dans une seule perspective admise comme vraie: le storytelling usé et la vulgate libérale abusive de la Fin de l'Histoire destinaliste dans le cadre post-bourgeois, post-prolétarien et ultra-capitaliste, inauguré avec la chute du Mur et avec la cosmopolitisation réelle du nexus de la force capitaliste.

Il suffit de rappeler ici, à l'aide d'un exemple concret tiré de notre présent, le rôle de ce qu'on appelle les "organisations non gouvernementales". Celles-ci, avec les entreprises multinationales et déterritorialisées, ont contesté la prédominance des Etats. Derrière la philanthropie avec laquelle ces organisations prétendent agir (droits de l'homme, démocratie, sauver des vies, etc.), se cachent les intérêts privés du capital transnational.
Les Organisations Non Gouvernementales, en réalité, revendiquent d'en bas et depuis la "société civile" les "conquêtes de la civilisation", les "droits" et les "valeurs" établis d'en haut par les Seigneurs du mondialisme niveleur qui "per sé fuoro" (Inferno, III, v. 39), les nouveaux conquérants financiers et les gardiens de la grande entreprise du marché supranational sous l'hégémonie de la spéculation capitaliste privée.
Ces conquêtes, ces droits et ces valeurs sont donc toujours et uniquement ceux de la classe mondiale compétitive, idéologiquement présentés comme "universels": démolition des frontières, renversement des États voyous (c'est-à-dire de tous les gouvernements non alignés sur le Nouvel ordre mondial unipolaire et américano-centré), encouragement des flux migratoires au profit du cosmopolitisme d'entreprise, dé-souverainisation, déconstruction des piliers de l'éthique bourgeoise et prolétarienne (famille, syndicats, protection du travail, etc.).
Dans cette perspective, sous le vernis humanitaire des ONG, on découvre le cheval de Troie du capitalisme mondial, le tableau de bord de l'élite cosmopolite, avec sa règle fondamentale impitoyable (business is business) et son assaut contre la souveraineté des Etats.
Si elles ne sont pas analysées selon le schéma imposé par l'hégémonie de l'aristocratie financière, les organisations non gouvernementales se révèlent être un moyen puissant de contourner et de saper la souveraineté des États, et de mettre en œuvre point par point le plan mondialiste de la classe dirigeante, en vue de la libéralisation définitive de la réglementation politique des États-nations souverains en tant que derniers bastions des démocraties.

L'affrontement entre les ONG et les lois des Etats nationaux ne cache pas, comme le répètent les maîtres du discours, la lutte entre la philanthropie, celle de "l'amour de l'humanité", et l'autoritarisme inhumain; au contraire, on y trouve la guerre entre la dimension privée du profit des groupes transnationaux et la dimension publique des Etats souverains qu'ils assiègent.
Plus précisément, pour ceux qui s'aventurent au-delà du théâtre vitreux des idéologies et affirment la volonté de savoir de la mémoire foucaldienne, à l'horizon de la mondialisation comme nouvelle étape du conflit cosmopolitisé entre Seigneur et Serviteur (le Maître et l'Esclave, Hegel), les organisations non gouvernementales apparaissent comme les instruments idéaux pour l'imposition d'un agenda politique mûri en dehors de tout processus démocratique et protégeant exclusivement les intérêts concrets de la classe hégémonique.
Cette dernière, d'ailleurs, grâce au travail diligent des anesthésistes du spectacle, calomnie de "souverainiste" - énième catégorie frauduleuse inventée par la néo-langue des marchés - quiconque ne dit pas définitivement adieu au concept de souveraineté nationale. Bastion de la défense des démocraties développées au sein des espaces étatiques encore réfractaires au Nouvel Ordre Mondial (qui est post-démocratique au même titre qu'il est post-national), l'objectif est que la notion même de souveraineté nationale soit idéologiquement dégradée en un instrument d'agression et d'oppression, d'intolérance et de xénophobie.
20:29 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, néolibéralisme, ong, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 18 février 2024
Marx : penseur de la libre communauté et de l'individualité selon Diego Fusaro
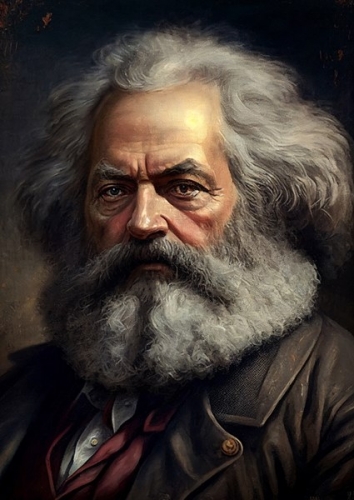
Marx: penseur de la libre communauté et de l'individualité selon Diego Fusaro
Recension de: Marx: Pensador de la individualidad comunitaria libre de Diego Fusaro (Letras Inquietas, La Rioja, España, 2024)
Carlos X. Blanco
Débarrasser Marx du "marxisme" semble être une tâche ardue. Une grande partie des interprétations qui ont suivi la mort du philosophe et révolutionnaire se sont écartées de la voie principale qu'il avait ouverte. Certes, Karl Heinrich Marx lui-même est en partie responsable de cette déviation, lui qui, enfant d'une époque, n'a pu éviter toute une imprégnation environnementale. Marx s'est retrouvé avec toute une série de "-ismes" qui ont gâché la nouveauté radicale et entamé l'acuité de sa pensée. Le philosophe de Trèves n'était pas, en ce sens (et de son propre aveu), un marxiste. Il le savait, et pourtant il "laissait faire". Il a laissé son ami Friedrich Engels compléter son héritage, et a mis en ordre ad libitum les parties inachevées et fragmentairement élaborées. Pire encore, le troisième de la dynastie des dirigeants politico-intellectuels d'un mouvement déjà appelé "marxisme", à savoir Karl Kautsky, a approfondi les préjugés et les imprégnations de l'environnement.
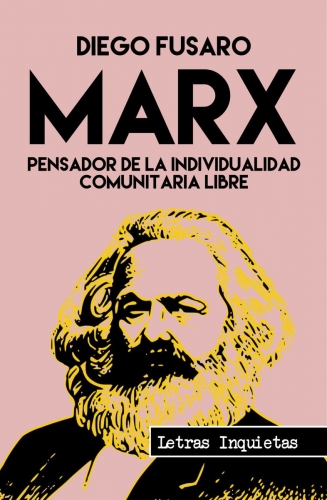
L'un de ces biais et l'une de ces contaminations propre à l'époque était le positivisme évolutionniste. La philosophie de Marx a été considérée comme une "théorie" de l'évolution des modes de production, que la social-démocratie allemande et le stalinisme soviétique ont compris de manière linéaire, déterministe, rigide et quasi-naturaliste. Le rôle volontariste du sujet révolutionnaire, le prolétariat, a été réduit au minimum, comme un simple spectateur qui n'a qu'à suivre la tendance inexorable du capitalisme vers son propre effondrement.
Un autre biais du "marxisme", et pas tellement de Marx lui-même, concerne le soi-disant matérialisme. Fusaro, comme son maître Costanzo Preve, insiste dans ses livres sur le fait que Marx a été victime d'une sorte de malentendu. Comme la psychanalyse nous l'a déjà montré, c'est parfois l'auto-compréhension qui est la pire. On ne peut pas juger un auteur sur la base des jugements qu'il porte sur sa propre œuvre et ses propres théories.
Ce qui est curieux, c'est que cette circonstance, que Marx lui-même n'ignorait pas - des décennies avant l'apparition de la psychanalyse -, il ne l'a pas su ou n'a pas pu se l'appliquer à lui-même. Marx se décrivait comme un matérialiste, comprenant le terme plutôt comme un synonyme de "scientifique". À bien des égards, l'auteur se déclarait matérialiste d'une manière purement métaphorique: de même que la science newtonienne n'était pas une spéculation gratuite sur la nature, mais une connaissance réelle en son temps (science stricte à l'apogée du 18ème siècle et paradigme de la physique jusqu'à la fin du 19ème siècle), le matérialisme historique, par analogie, se voulait une science stricte dans le domaine difficilement contrôlable et prévisible de l'histoire de l'humanité.

Face à l'utilisation purement métaphorique du terme "matérialisme", qui a causé tant de destructions intellectuelles entre les mains d'Engels, de Lénine et de Gustavo Bueno, Fusaro défend dans ce livre la proposition de Preve: considérer Marx comme le dernier grand représentant de la tradition idéaliste allemande. Le cycle des grands métaphysiciens partis de l'idéalisme transcendantal kantien (Fichte, Schelling et Hegel) s'achève avec Marx, qui ne se contente pas de retourner Hegel, de le mettre "à l'envers", en conservant une prétendue méthode dialectique et en remplaçant la vision idéaliste par une vision matérialiste, dans laquelle l'économie détermine "en dernière instance" la superstructure (les idées et les valeurs d'une formation sociale). Ce n'est pas ainsi que les choses se passent. La vision dialectique du monde commence avec Fichte, qui comprend l'ego comme une activité. L'idéalisme de Fichte, dont Hegel et Marx se sont principalement inspirés, n'est pas un "mentalisme". Ce "moi" n'est pas un reflet contemplatif ou spéculatif du monde: ce "moi" est un transformateur du monde. L'infrastructure (économie et technologie, principalement) n'est rien chez Marx si elle n'est pas comprise comme un ensemble de systèmes d'action qui travaillent et retravaillent un monde largement humanisé, pour le meilleur et pour le pire.
Mais le texte qui fait l'objet de la présente étude se concentre principalement sur le problème de la Communauté. Marx est, après Hegel, le grand penseur de la Communauté. Il n'y a pas d'homme libre s'il n'y a pas de véritable Communauté. Contrairement à ce que nous montre la version libérale, à savoir une idée de l'homme atome qui ne peut être lié à l'autre que par le contrat, Marx sait (à la manière aristotélicienne et hégélienne) que sans Communauté il n'y a pas d'homme vraiment libre. Ce n'est pas du totalitarisme, c'est du communautarisme.
Il n'y a pas de meilleure façon d'étudier Marx que d'aller main dans la main avec Fusaro.
Source: https://www.letrasinquietas.com/marx-pensador-de-la-indiv...
17:19 Publié dans Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : karl marx, diego fusaro, livre, marxisme, théorie politique, philosophie, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 14 janvier 2024
Fin de la droite et de la gauche, triomphe du turbocapitalisme

Fin de la droite et de la gauche, triomphe du turbocapitalisme
Diego Fusaro
Source: https://geoestrategia.es/noticia/42063/opinion/fin-de-la-derecha-y-la-izquierda-triunfo-del-turbocapitalismo.html
En suivant les "aventures de la dialectique", comme les appelait Merleau-Ponty, le passage au turbocapitalisme (ou capitalisme absolu-totalitaire) peut être interprété comme la transition historique d'une forme de capitalisme caractérisée par la présence de deux classes (bourgeoise et prolétarienne) à une forme inédite de capitalisme "post-classe", qui ne se distingue plus par l'existence de classes au sens strict (en tant que subjectivité in se et per se) et qui, en même temps, se caractérise par une inégalité maximale. Ce processus évolutif a également déterminé la raison profonde de l'obsolescence de la dichotomie gauche-droite, "deux mots désormais inutiles".
Par capitalisme "post-classe", c'est-à-dire littéralement "sans classe", il ne faut pas entendre un mode de production dépourvu de différences individuelles et collectives en matière de connaissance, de pouvoir, de revenu et de consommation. En effet, ces différences augmentent de manière exponentielle dans le contexte de la cosmopolitisation néolibérale (dont le mot d'ordre est précisément le slogan "Inégalités"). Mais pas en formant, en soi et pour soi, des "classes" en tant que subjectivités conscientes et porteuses de différences culturelles et idéelles. Car en tant que "classes", en soi et par soi, ni le Serviteur national-populaire ni le Seigneur mondial-élitiste ne peuvent être pris en considération. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, au moment où - à Berlin, en 1989 - le capital commence à devenir plus classiste que jamais et à donner lieu à des inégalités plus radicales qu'auparavant, les classes comprises comme des groupes dotés d'une "en-soi-ité" et d'une "pour-soi-ité" seront éclipsées. Plus concrètement, les prolétaires ne cessent pas d'exister et augmentent même en nombre, du fait de la concentration de plus en plus asymétrique du capital. Mais ils ne possèdent plus la "conscience de classe" antagoniste et, à proprement parler, le prolétariat lui-même devient un "précariat", condamné à la flexibilité et au nomadisme, à la mobilité et à la rupture de tout lien solide, en fonction des nouveaux besoins systémiques du turbo-capitalisme. La classe bourgeoise, quant à elle, perd sa conscience malheureuse et, avec elle, sa condition matérielle d'existence. Elle se prolétarise et, depuis 1989, plonge progressivement dans l'abîme de la précarité.

Tant que le système capitaliste, dans sa phase dialectique, était caractérisé par la division en deux classes et deux espaces politiques opposés, il était, dès le départ, intrinsèquement, fragile. En effet, il était traversé par des contradictions et des conflits, qui se manifestaient dans la conscience bourgeoise malheureuse, dans les luttes prolétariennes pour la reconnaissance du travail, dans les utopies futuristes de réorganisation du monde et enfin dans le programme "rédempteur" de la gauche (qu'elle soit socialiste-réformiste ou communiste-révolutionnaire). D'un point de vue hégélien, le capital se trouve dans son propre être-autre-que-soi, dans son propre éloignement de soi qu'il doit dialectiquement "surmonter" afin de pouvoir coïncider pleinement avec lui-même sous la forme d'un dépassement de sa propre négation.
Le Capital, comme la Substance dont parle Hegel, coïncide avec le mouvement de dépossession de soi et avec le processus de devenir autre-que-soi-avec-soi. Il s'agit donc de l'égalité auto-constitutive après la division. Pour le dire encore avec Hegel, il s'agit de devenir égal à soi-même à partir de son propre être-autre. Son essence n'est pas la Selbständigkeit abstraite, l'égalité immobile avec elle-même, mais le "devenir égal à soi-même" : l'identité "avec soi-même" n'est pas donnée, mais est atteinte comme résultat du processus. C'est pourquoi, à l'instar de l'Esprit théorisé par Hegel, le Capital peut aussi être compris comme das Aufheben des/seines Andersseyns, "le dépassement de son propre être-autre". En se développant au rythme de son propre Begriff, c'est-à-dire - selon la Science de la Logique - comme une réalité ontologique en développement dialectique, le capitalisme produit un dépassement à la fois des classes antagonistes, de la dichotomie gauche-droite et, en perspective, de tout autre élément dialectique capable de menacer sa reproduction.

En particulier, ce processus, sur la pente qui va de 1968 à 1989 et de là à aujourd'hui, se développe - comme l'a montré Preve - en subsumant sous le capital toute la sphère des antagonismes et des contestations, tant de la part de la droite (traditionalisme culturel in primis et protestations de la petite bourgeoisie contre la prolétarisation), que - surtout - de la part de la gauche, qu'elle soit démocratique, socialiste ou communiste (réformisme keynésien, pratiques redistributives, welfarisme, praxis révolutionnaire, utopie de la réorganisation égalitaire de la société). La droite et la gauche sont dialectiquement "dépassées" (aufgehoben), au sens hégélien du terme. Elles se transforment en parties abstraitement opposées et concrètement interchangeables de la reproduction capitaliste. Ils apparaissent comme des pôles qui, alternant dans la gestion du statu quo, nient l'alternative. Et ils trompent les masses sur l'existence d'une pluralité qui, en réalité, a déjà été résolue pour toujours dans le triomphe prédéterminé du parti unique articulé du turbo-capitalisme.
C'est pourquoi le dépassement du binôme gauche-droite ne doit être compris ni comme le simple résultat d'une "trahison" des leaders de la gauche, ni comme une subtile tentative contemporaine de la droite radicale d'infiltrer le "monde des gentils". Au contraire, il s'agit d'un processus en acte co-essentiel à la logique dialectique du développement du capital. Et en synthèse, l'incapacité à interpréter correctement le contexte réel constitue l'erreur des tentatives herméneutiques encore généreuses et naïves du vieux marxisme survivant, encore guidées par la prétention illusoire de superposer au turbo-capitalisme les contours du cadre dialectique précédent maintenant dissous, tombant ainsi dans le théâtre de l'absurde; un théâtre de l'absurde sur la scène duquel on continuerait à représenter le conflit entre la bourgeoisie et le prolétariat, et par conséquent, on pourrait "refonder" la gauche par un retour au passé injustement oublié (alors que la vérité crue est que le conflit réellement existant, aujourd'hui, est celui entre "le haut" et "le bas", entre le "haut" de l'oligarchie financière et le "bas" des classes moyennes et des travailleurs, de plus en plus réduits à la misère).

La gauche ne peut se refonder principalement pour deux raisons: a) le cadre historique a muté (ce qui nécessite donc de nouveaux paradigmes philosophico-politiques qui comprennent et contestent opérationnellement la mondialisation capitaliste et le néolibéralisme progressiste); b) elle héberge depuis son origine dans une partie d'elle-même - comme l'a montré Michéa - un double vulnus fondamental : 1) la conception du progrès comme rupture nécessaire avec les traditions et les liens antérieurs, c'est-à-dire l'élément décisif qui le conduira infailliblement à adhérer au rythme du progrès néolibéral; et 2) l'individualisme hérité des Lumières, qui conduit nécessairement à la monadologie concurrentielle néolibérale. La défense de la valeur individuelle contre la société d'Ancien Régime s'inverse dans l'individualisme capitaliste et son anthropologie monadologique, de même que le renversement en bloc des traditions génère l'intégration de l'individu non plus dans la communauté égalitaire, mais dans le marché mondial des biens de consommation.
Le fondement du capitalisme absolu-totalitaire, dans le contexte socio-économique, n'est plus la division entre la bourgeoisie de droite et le prolétariat de gauche. Et ce n'est même pas, politiquement, l'antithèse entre la droite et la gauche. Le nouveau fondement du capitalisme mondial est la généralisation non-classiste et omni-homologisante de la forme marchandise dans toutes les sphères du symbolique et du réel. C'est précisément parce qu'il est absolu et totalitaire que le capitalisme surmonte et résout - au sens capitaliste du terme - les divisions qui menacent sa reproduction de diverses manières. C'est pourquoi le turbo-capitalisme n'est ni bourgeois ni prolétarien. Il n'est pas non plus de droite ou de gauche. En fait, il a dépassé et résolu ces antithèses, valables et opérantes dans sa phase dialectique précédente.
Avec l'avènement du turbo-capitalisme, le prolétariat et la bourgeoisie sont "dépassés" et "dissous" - non pas "in se" et "per se" (en soi et pour soi), dirait-on avec Hegel - dans une nouvelle plèbe post-moderne de consommateurs individualisés et résilients, qui consomment des marchandises avec une euphorie stupide et supportent avec une résignation désenchantée le monde subsumé sous le capital, c'est-à-dire un monde de plus en plus inhabitable écologiquement et déshumanisé anthropologiquement. D'où la société de Narcisse, le dieu postmoderne des selfies, des "autoportraits" de gens tristes qui s'immortalisent en souriant.
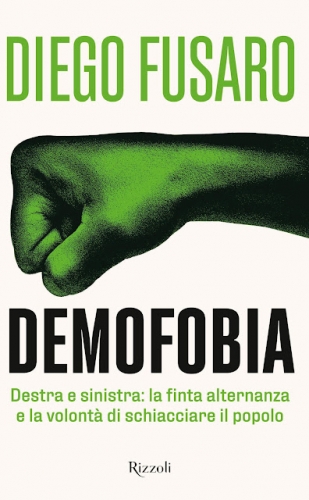
De même, droite et gauche sont "dépassées" et "dissoutes" dans une homogénéité bipolaire, articulée selon la désormais perfide alternance sans alternative d'une droite néolibérale peinte en bleu et d'une gauche néolibérale peinte en fuchsia. Ils ne se battent pas pour une idée différente et peut-être opposée de la réalité, fondée sur des ordres de valeurs différents et sur leurs Weltanschauungen irréconciliables. Au contraire, ils rivalisent pour réaliser la même idée de la réalité, celle décidée souverainement par le marché et le bloc oligarchique néolibéral, par rapport à laquelle ils jouent désormais le rôle de simples majordomes, bien que dans une livrée de couleur différente. Au sommet, sur la passerelle de contrôle, il y a une nouvelle classe post-bourgeoise et post-prolétarienne, qui n'est ni de droite ni de gauche, ni bourgeoise ni prolétarienne. C'est la classe du patriciat financier cosmopolite qui, plus précisément, est de droite en économie (compétitivité sans frontières et marchandisation intégrale du monde), de centre en politique (alternance sans alternative du centre-droit et du centre-gauche également néolibéraux), et de gauche en culture (ouverture, dérégulation anthropologique et progressisme comme philosophie du plus jamais ça).
En bref, la transition vers la nouvelle figure du capitalisme absolu-totalitaire se développe le long d'une trajectoire qui nous suit de 1968 au nouveau millénaire, en franchissant la date fondatrice de 1989. En effet, de 1968 à nos jours, le capitalisme a dialectiquement "surmonté" (aufgehoben) la contradiction qu'il avait lui-même provoquée dans la phase antithétique-dialectique, représentée par le double nœud d'opposition entre bourgeoisie et prolétariat, et entre droite et gauche. Ainsi, le capitalisme actuel absolu-totalitaire se caractérise: d'une part, par l'éclipse du lien symbiotique entre les deux instances de la "conscience malheureuse" bourgeoise et des "luttes pour la reconnaissance du travail servile" prolétariennes ; et d'autre part, par l'élimination de la polarité entre la droite et la gauche, désormais convertie en deux ailes de l'aigle néolibéral. Le turbo-capital a "dépassé" ces antithèses, propres au moment de l'"immense puissance du négatif" (c'est-à-dire de l'être-autre-de-soi), et les a "subsumées" sous lui-même, en reconquérant sa propre identité avec lui-même à un niveau plus élevé que dans la phase thétique, comme le fruit du passage par son propre auto-étranglement.
15:21 Publié dans Actualité, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, droite, gauche, philosophie, néolibéralisme, turbocapitalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 24 octobre 2023
Diego Fusaro: La mondialisation néolibérale, une nouvelle foi religieuse

La mondialisation néolibérale, une nouvelle foi religieuse
Diego Fusaro
Source: https://geoestrategia.es/noticia/41653/opinion/globalizacion-neoliberal-una-nueva-fe-religiosa.html
Selon la syntaxe de Gramsci, il y a "idéologie" quand "une classe donnée réussit à présenter et à faire accepter les conditions de son existence et de son développement de classe comme un principe universel, comme une conception du monde, comme une religion".
Le point culminant esquissé par Gramsci est tout à fait pertinent si l'on se réfère à l'idéologie de la mondialisation comme nature donnée, irréversible et physiologique (globalismus sive natura). Dans le cadre du Nouvel Ordre Mondial post-1989 et de ce qui a été défini comme "le grand échiquier", elle se présente comme un "principe universel", parce qu'elle est indistinctement acceptée dans toutes les parties du monde (c'est ce qu'on pourrait appeler la globalisation du concept de globalisation) et, en même temps, elle est aussi assumée par les dominés, qui devraient s'y opposer avec la plus grande fermeté. Elle se présente comme une vérité incontestable et universellement valable, qui ne demande qu'à être ratifiée et acceptée sous la forme d'une adaequatio cognitive et politique.
La mondialisation apparaît ainsi comme une "vision du monde", c'est-à-dire comme un système articulé et englobant, parce qu'elle a été structurée sous la forme d'une perspective unitaire et systématique, centrée sur la dénationalisation du cosmopolitisme et sur l'élimination de toutes les limitations matérielles et immatérielles à la libre circulation des marchandises et des personnes marchandisées, aux flux de capitaux financiers liquides et à l'extension infinie des intérêts concurrentiels des classes dominantes.
Enfin, elle prend la forme d'une "religion", parce qu'elle est de plus en plus vécue comme une foi indiscutable, largement située au-delà des principes de la discussion rationnelle socratique : celui qui n'accepte pas sans réfléchir et avec des références fidéistes le nouvel ordre mondialisé sera immédiatement ostracisé, réduit au silence et stigmatisé par la police du langage et les gendarmes de la pensée comme un hérétique ou un infidèle, menaçant dangereusement la stabilité de la catéchèse mondialiste et de ses principaux articles de foi (libre circulation, ouverture intégrale de toute réalité matérielle et immatérielle, compétitivité sans frontières, etc. ). La mondialisation coïncide donc avec le nouveau monothéisme idolâtre du marché mondial, typique d'une époque qui ne croit plus en Dieu, mais pas au capital.
D'une manière générale, la mondialisation n'est rien d'autre que la théorie qui décrit, reflète et, à son tour, prescrit et glorifie le Nouvel Ordre Mondial de classe post-westphalien, qui a émergé et s'est stabilisé après 1989 et qui - pour reprendre la formule de Lasch - a été idéologiquement élevé au rang de vrai et unique paradis. Tel est le monde entièrement soumis au capital et à l'impérialisme américano-centré des marchés de capitaux privés libéralisés, avec l'exportation collatérale de la démocratie de marché libre et du désir libre, et de l'anthropologie de l'homo cosmopoliticus.
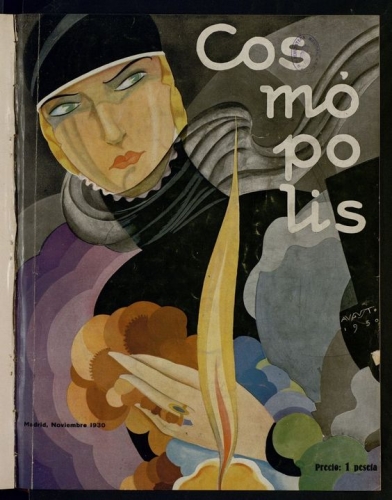
Le pouvoir symbolique du concept de mondialisation est si envahissant qu'il rend littéralement impossible l'accès au discours public à quiconque ose le remettre en question. En ce sens, il s'apparente davantage à une religion au credo obligatoire qu'à une théorie soumise à la libre discussion et à l'herméneutique de la raison dialogique.
À travers des catégories devenues des pierres angulaires du néo-langage capitaliste, toute tentative de limiter l'envahissement du marché et de contester la domination absolue de l'économie mondialisée et américano-centrée est diabolisée comme "totalitarisme", "fascisme", "stalinisme" ou même "rouge-brunisme", la synthèse diabolique de ce qui précède. Le fondamentalisme libéral et le totalitarisme mondialiste du marché libre démontrent également leur incapacité à admettre, même ex hypothesi, la possibilité théorique d'autres modes d'existence et de production.
Toute idée d'un contrôle possible de l'économie et d'une éventuelle réglementation du marché et de la société ouverte (avec un despotisme financier intégré) conduirait infailliblement, selon le titre d'une étude bien connue de Hayek, vers la "route du servage". Hayek l'affirme sans euphémisme : "le socialisme, c'est l'esclavage".
De toute évidence, le théorème de von Hayek et de ses acolytes ne tient pas compte du fait que le totalitarisme n'est pas seulement le résultat d'une planification politique, mais peut aussi être la conséquence de l'action concurrentielle privée des règles politiques. Dans l'Europe d'aujourd'hui, d'ailleurs, le danger n'est pas à chercher du côté du nationalisme et du retour des totalitarismes traditionnels, mais plutôt du côté du libéralisme de marché hayékien et de la violence invisible de la matraque subtile de l'économie dépolitisée.
Il est donc impératif de décoloniser l'imaginaire des conceptions hégémoniques actuelles de la mondialisation et d'essayer de redéfinir son contenu d'une manière alternative. Cela nécessite une nouvelle compréhension marxienne des relations sociales comme étant mobiles et conflictuelles, là où le regard chargé d'idéologie n'enregistre que des choses inertes et aseptisées, rigides et immuables.
En d'autres termes, il est nécessaire de déconstruire l'image hégémonique de la mondialisation, en montrant son caractère de classe et non de neutralité.
Lorsqu'elle est analysée du point de vue des classes dirigeantes mondialistes, la mondialisation peut en effet sembler enthousiaste et très digne d'être louée et valorisée.
Par exemple, Amartya Sen la célèbre avec insistance pour sa plus grande efficacité dans la division internationale du travail, pour la baisse des coûts de production, pour l'augmentation exponentielle de la productivité et - dans une mesure nettement plus discutable - pour la réduction de la pauvreté et l'amélioration générale des conditions de vie et de travail.
Il suffit de rappeler, à l'aube du nouveau millénaire, que l'Europe compte 20 millions de chômeurs, 50 millions de pauvres et 5 millions de sans-abri, alors qu'au cours des vingt dernières années, dans cette même Europe, les revenus totaux ont augmenté de 50 à 70 %.

Cela confirme, d'une manière difficilement réfutable, le caractère de classe de la mondialisation et du progrès qu'elle génère. Du point de vue des dominés (et donc vue "d'en bas"), elle s'identifie à l'enfer très concret du nouveau rapport de force technocapitaliste, qui s'est consolidé à l'échelle planétaire après 1989 avec l'intensification de l'exploitation et de la marchandisation, du classisme et de l'impérialisme.
C'est à cette duplicité herméneutique, qui préside à la duplicité de classe dans le contexte très fracturé de l'après-1989, que renvoie l'interminable débat qui a intéressé et continue d'intéresser les deux foyers de cette contraposition frontale : d'une part, les apologistes de la mondialisation ; d'autre part, ceux qui sont engagés dans l'élaboration des cahiers de doléances du mondialisme.
Les premiers (que l'on peut globalement qualifier de "mondialistes", malgré la pluralité kaléidoscopique de leurs positions) vantent les vertus de la marchandisation du monde. Au contraire, les seconds (qui ne coïncident que partiellement avec ceux que le débat public a baptisés "souverainistes") soulignent les contradictions et le caractère éminemment régressif du cadre antérieur centré sur les souverainetés nationales.
En bref, et sans entrer dans les méandres d'un débat pratiquement ingérable par la quantité des contenus et la diversité des approches, les panégyristes du mondialisme insistent sur la façon dont la mondialisation étend au monde entier la révolution industrielle, les progrès et les conquêtes de l'Occident ; ou, en d'autres termes, sur la façon dont elle "universalise" les réalisations d'une humanité en quelque sorte comprise comme "supérieure" et donc habilitée à organiser la "file unique" du développement linéaire de tous les peuples de la planète.
Même les auteurs les plus sobrement sceptiques quant à la valeur axiologique de la mondialisation, comme Stiglitz, semblent souffrir d'une attirance magnétique et finalement injustifiée pour le travail de transformation du monde en marché. Pour Stiglitz et son optimisme réformateur, ce processus, qui en même temps "planétarise" l'inégalité et la misère capitaliste, ne mérite pas d'être abandonné en raison des évolutions et des changements qu'il pourrait susciter.
20:51 Publié dans Actualité, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, actualité, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques, néolibéralisme, mondialisation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 19 août 2023
Terre de racines contre mer de finances

Terre de racines contre mer de finances
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/tierra-de-los-arraigos-contra-mar-de-las-finanzas/
La société actuelle se présente comme "liquide", voire "aéroforme", selon le diagnostic de Berman sur la dissolution moderne des formes stables dans l'air. Cela dépend éminemment du fait qu'il n'y a pas de réalité en elle qui ne soit pas soumise à la qualité qui distingue les liquides, à savoir leur adaptabilité au contenant qui les abrite et, par conséquent, l'assomption des formes qui leur sont conférées à tout moment.
C'est ainsi que Hegel caractérise l'eau dans l'Encyclopédie (§ 284): "elle n'a pas de singularité d'être en soi, et n'a donc pas en elle-même de solidité (Starrheit) et de détermination (Bestimmung)". C'est pourquoi, n'ayant pas de figure propre, elle "ne reçoit la limitation de la figure que de l'extérieur" et "la recherche extérieurement". Son "état particulier" est la Bestimmungslosigkeit, le "manque de détermination", ce qui le rend intrinsèquement adaptatif dans un sens universel et indifférencié.
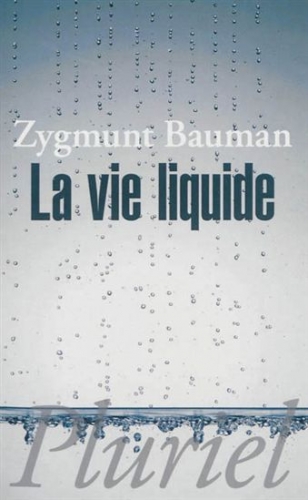
Bauman a raison d'affirmer que "notre époque excelle à démanteler les structures et à liquéfier les modèles, tous les types de structures et tous les types de modèles, par hasard et sans avertissement". Mais ce qu'il n'explicite pas comme il se doit dans son analyse, c'est que cette forme n'est ni extemporanée, ni accidentelle.
Au contraire, elle correspond aux lignes dictées par les politiques néolibérales et par l'évolution du marché mondial flexible, auquel tout est appelé à s'adapter. Car si l'on élimine cet aspect, on ne considère que les effets en négligeant les causes et, par là même, on détourne le regard de la relation de pouvoir basée sur la classe comme base réelle de la liquéfaction des liens et des identités. La relation solide qui relie la superstructure de la précarisation postmoderne à la structure du capital mondialisé, flexible et centré sur les flux est perdue de vue.
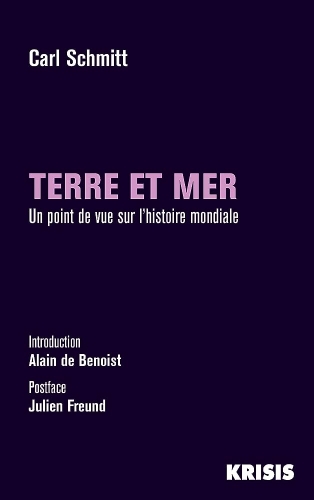
En d'autres termes, on oublie qu'aujourd'hui la flexibilité absolue des formes coexiste dialectiquement avec la rigidité absolue du "contenant", c'est-à-dire avec le capitalisme mondialisé dans l'anonymat des marchés financiers liquides, qui cherche à rendre la précarité éternelle et à s'imposer comme un destin inéluctable aux peuples de la planète. Il s'érige en nouveau contenant global, qui donne forme à toutes les réalités matérielles et symboliques qu'il contient et qui ont été transférées à l'état liquide.
Comme le souligne notre étude Essere senza tempo (Bompiani, 2010), la mobilisation totale des entités, caractéristique du mode de production capitaliste flexible, se déploie dans le cadre de l'immobilisme historique d'un temps qui aspire à faire de la précarité un avenir irréversible: plus ça change, plus c'est la même chose.
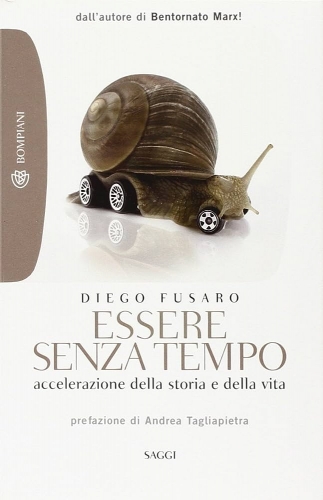
Sa configuration est celle de la cage d'acier wébérienne aux barreaux indestructibles. Mais à l'intérieur, tout est possible, les possibilités étant coextensives par rapport à la valeur d'échange individuelle. De plus, toutes les valeurs, identités et normes ont été nihilistiquement "transvalorisées".
La métaphore de la liquidité est en effet très efficace pour souligner l'essence de l'accumulation flexible et de la société de mouvement fluide des personnes (abstraitement libres de se déplacer et concrètement forcées de se déplacer) et du capital financier en l'absence de barrières et de frontières, "dissoutes" et supprimées en même temps que toute instance "solide" et stable de la structure dialectique et fordiste, prolétarienne et bourgeoise précédente. Telle est l'essence de ce que la relation de pouvoir hégémonique diffuse dans toutes les directions comme le "nouvel impératif catégorique: fluidifions tout !
Parmi les propriétés de l'eau, il y a aussi cette omniprésence et cette capacité à pénétrer et à envahir tous les espaces, à briser toutes les barrières et à éroder même les roches les plus solides. Elles correspondent parfaitement aux caractéristiques de la flexibilité universelle du cosmomarketing liquido-financier qui, en référence à l'ère post-fordiste, a été défini comme la fin du capitalisme organisé.
La flexibilité, ayant saturé tous les espaces réels et imaginaires, est en effet aujourd'hui partout. L'eau, conçue par Thalès comme le principe de l'être, devient aujourd'hui l'ἀρχή de la réalité capitaliste, qui rend tout liquide et envahit tous les espaces, dépassant les digues et les obstacles.
On peut éclairer cette dynamique en se référant au duo philosophique Terre et Mer, canonisé par Schmitt et codifié auparavant par Hegel, qui affirme dans les leçons sur la Wetlgeschichte que :
"Le type le plus universel de détermination de la nature, qui a une signification dans l'histoire, est celui constitué par la relation entre la Mer et la Terre".
Selon cette analogie heuristiquement féconde, les dynamiques du marché transnational et de la précarité mondiale sont, par définition, maritimes.
La lutte entre la globalisation capitaliste et l'enracinement national des peuples est, par là même, un affrontement entre l'élément maritime et l'élément terrestre, dans le cadre du conflit de classe entre le Seigneur thalassien et le Serviteur tellurique. À l'élément terrestre des racines et des lieux, des enracinements et des stabilités, s'oppose l'élément maritime des flux et des surfaces homogènes, des déplacements et des déracinements.
Le Seigneur thalassien aspire à rendre liquide tout élément solide lié à la stabilité de l'éthique, de sorte que l'être entier est redéfini selon la logique liquide de la globalisation marchande; l'ouverture du capital cosmopolite coïncide figurativement avec la mer ouverte et illimitée, avec son expansion homogène, sur laquelle il est possible de naviguer de manière omnidirectionnelle, mais aussi avec la particularité de l'élément liquide lui-même, qui tend à saturer chaque espace.
Le Serviteur "glébalisé", en revanche, doit aspirer à résister à cette dynamique, en imposant la primauté de la dimension tellurique de l'enracinement et des frontières comme murs contre la déterritorialisation, la mobilisation des êtres et l'omnihomogénéisation mondialiste : à la différence de la mer, dont l'essence réside dans ce flux en vertu duquel - dirait Héraclite - "des eaux toujours différentes coulent" (ἕτερα καὶ ἕτερα ὕδατα ἐπιρρρεῖ), la terre est la pluralité d'espaces stables et localisés. Elle est traversée par des limites et des différences, par des frontières et des murs.
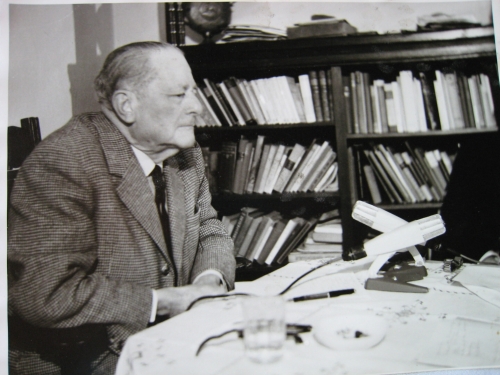
Le Nomos de la terre représente l'espace concret de la pluralité des peuples et leur possibilité de se donner une loi et une histoire, de vivre en permanence, selon cette figure des racines qui accompagne l'image du terroir. Les flux migratoires intercontinentaux s'opposent à la stabilité enracinée des peuples, tout comme les flux de capitaux liquides et financiers marquent une antithèse au travail de la communauté solidaire dans ses espaces circonscrits et dans sa distribution équitable des biens.
Le conflit qui, comme on l'a souligné, traverse le champ de bataille de l'après-1989, et qui voit, selon les termes de Lafay, "d'une part, le processus de mondialisation, impulsé par les entreprises et favorisé par la baisse des coûts de transport et de communication; d'autre part, la permanence des nations, attachées à leur territoire, qui cherchent à s'organiser dans des cadres régionaux définis par des liens de proximité géographique ou historique", se trouve ainsi recadré.
Le Nouvel Ordre Mondial se développe dans un espace aussi lisse que l'étendue de l'océan, sans frontières ni points fixes, sans hauts ni bas. Le triomphe des flux sur les racines solides, de la navigation permanente sur la vie stable, de l'ouverture illimitée sur les territoires délimités par des frontières, dessine une réalité dans laquelle tout ce qui est léger flotte à la surface et tout ce qui a du poids s'enfonce dans l'abîme. Comme le dit Castells :
"L'espace des flux est une pratique structurante des élites et des intérêts dominants. [Dans l'espace des flux, il n'y a pas de place pour la résistance à la domination. J'oppose l'espace des flux aux espaces des lieux qui sont eux-mêmes fragmentés, ségrégués et résistants à la domination, et donc à l'espace des flux".
Ainsi comprise, la lutte des classes se présente, dans le contexte du Nouvel Ordre Mondial, comme une gigantomachie qui voit s'opposer les flux globaux de l'ouverture cosmopolite (marchandises, valeurs, informations, etc.) aux lieux "solides" des communautés nationales, qui s'opposent à cette fluidification et recherchent la stabilité et l'enracinement pour se protéger des éléments d'un mondialisme malheureux.
Dans cette inimitié entre l'élément thalassique des flux de capitaux (de désirs, de marchandises, de personnes marchandisées, de valeurs boursières, etc.) et la dimension tellurique des "lieux de l'autoproduction des mondes de vie", la seule chance de succès du pôle dominé réside dans la reconquête de l'Etat et du politique comme puissance capable de limiter la voracité insatiable de l'autovalorisation de la valeur.
13:12 Publié dans Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : terre et mer, diego fusaro, philosophie, carl schmitt, hegel, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 09 août 2023
L'insaisissable catégorie libérale du totalitarisme

L'insaisissable catégorie libérale du totalitarisme
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/la-escurridiza-categoria-liberal-del-totalitarismo/
Parmi les catégories philosophico-politiques qui rencontrent le plus de succès dans l'ordre du discours néolibéral, tant à droite qu'à gauche, figure celle de "totalitarisme", en particulier dans le sens conceptualisé jadis par Hannah Arendt dans son ouvrage Les origines du totalitarisme (1951). À travers cette catégorie, c'est toute l'histoire du "petit siècle" qui est réinterprétée de manière tératomorphique comme une succession de gouvernements despotiques et génocidaires, rouges et bruns, ennemis de la société ouverte prônée par Popper. L'horreur du siècle court serait cependant déterminée par le happy end capitaliste de la Fin de l'Histoire (brevetée par Fukuyama) et le triomphe de la liberté universelle (traduite en termes réels par celui du libre marché planétaire). Toute l'histoire humaine se déroulerait ainsi dans l'ordre néolibéral, assumé de manière tout sauf idéologiquement neutre, comme la fin (end) et comme la fin (finalité) de l'histoire en tant que telle - selon le double sens du terme grec τέλος.
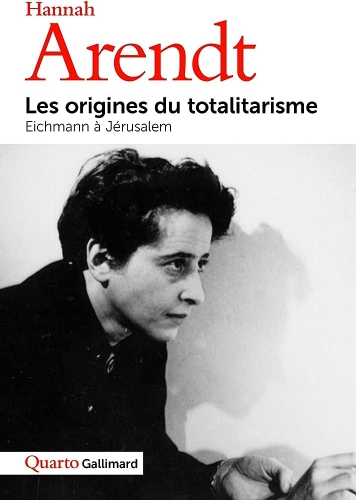
Le haut degré idéologique de ce récit apparaît quel que soit le point de vue dans lequel on l'observe. Tout d'abord, le vingtième siècle, qui fut - comme le rappelle Badiou - le "siècle des passions politiques", se résout entièrement dans le règne sinistre de la terreur et du génocide, des goulags et des barbelés des camps d'extermination; des horreurs bien présentes, ça va sans dire, mais qui ne peuvent certainement pas conduire à ignorer tout ce qui a été différent et mieux produit pendant le "siècle court". Grâce à l'identification, loin d'être neutre, entre 20ème siècle et Totalitarisme, il ne reste en effet aucune trace de la passion utopique pour le dépassement de la prose du capitalisme, ni des conquêtes sociales des classes laborieuses, ni même des acquis en termes de droits et de pratiques démocratiques obtenus grâce au cadre des États-nations souverains. Selon le théorème "publicitaire" des nouveaux philosophes - eux-mêmes célébrés en leur temps comme un produit commercial de l'industrie culturelle - le Goulag devient la vérité de toute aspiration authentiquement socialiste. Et, synergiquement, les barbelés d'Auschwitz deviennent la vérité de toute défense de l'État national, de la souveraineté et de la tradition.
En plus d'hypothéquer la dimension utopique ouverte à la projection de futurs meilleurs, la rhétorique antitotalitaire remplit une fonction apologétique à l'égard du présent lui-même. En effet, elle suggère que, bien que rempli de contradictions et d'injustices, l'ordre néolibéral est toujours préférable aux horreurs totalitaires rouges et brunes qui ont envahi le "siècle court". Ainsi, le présent réifié n'est plus combattu en raison des contradictions qui le sous-tendent (exploitation et misère, inégalités et hémorragie constante des droits); il est au contraire défendu contre le retour possible du fascisme et du communisme.
La victoire du rapport de force capitaliste (Berlin, 1989) peut ainsi être idéologiquement élevée au rang de fait définitif de la Weltgeschichte. Cette dernière, après l'"immense puissance du négatif", mènerait son propre processus autotélique de mise en œuvre de la libre circulation des marchandises et des personnes commercialisées. Celui qui, sans réfléchir, ne reconnaît pas l'identification entre la liberté et le libre marché, entre la démocratie et le capitalisme, en essayant peut-être même de faire revivre le rêve éveillé d'une meilleure liberté et d'un exode hors de la cage d'acier du techno-capital sans frontières, sera donc ostracisé et vilipendé comme "totalitaire", "antidémocratique" et "illibéral" ; ou, dirait Popper, comme "ennemi de la société ouverte" qui, soit dit en passant, est l'une des sociétés les plus fermées de l'histoire, si l'on considère le degré d'exclusion socio-économique, en termes de droits fondamentaux et de nécessités de base, auquel un nombre croissant d'êtres humains sont condamnés.

La rhétorique antitotalitaire fonctionne à plein régime grâce à son activation symétrique par la droite bleue et la gauche fuchsia. La première accuse la gauche - dans tous ses gradations et dans toutes ses couleurs - d'être de connivence avec la "folie totalitaire rouge" du maoïsme et du stalinisme. Elle veille donc à ce qu'elle reste attachée au dogme néolibéral, sans ouverture possible à un plus grand contrôle politique du marché et à d'éventuelles extensions des droits sociaux, pratiques qui sont elles-mêmes immédiatement pointées du doigt comme un retour au totalitarisme rouge. De manière analogue, la gauche fuchsia accuse la droite bleue d'être en permanence tentée par la "folie totalitaire noire ou brune", mussolinienne ou hitlérienne. Elle veille ainsi à ce que la néo-droite libérale reste toujours aussi attachée au credo néo-libéral, en délégitimant immédiatement comme "fascisme" toute tentative de re-souverainisation de l'Etat national, de résistance à la globalisation marchande et de protection des identités culturelles et traditionnelles des peuples. Cela révèle, une fois de plus, comment la droite et la gauche ont introjecté le noyau du fondamentalisme néolibéral, selon lequel - dans la syntaxe de Hayek - toute tentative politique de contrer la libre concurrence et le marché déréglementé conduit inexorablement au "chemin vers la servitude".
En vertu de cette logique néolibérale, qui réciproquement est logique de surveillance (et qui reconfirme donc la fonction déployée aujourd'hui par le clivage droite-gauche comme simple simulacre idéologique au profit de la classe dominante), la droite bleue et la gauche fuchsia se garantissent mutuellement leur propre pérennité stable dans le périmètre de la matrice libérale politiquement correcte de la Pensée Unique. Celle-ci focalise l'ennemi suprême sur l'État souverain keynésien et régulateur de l'économie, l'identifiant automatiquement au totalitarisme rouge et brun ou, plus rarement, à l'ens imaginationis du "totalitarisme rouge-brun". Et comme résultat de tout ce processus, le capitalisme lui-même réapparaît, de plus en plus ennobli et légitimé idéologiquement: en effet, aujourd'hui il est présenté - tant par la droite que par la gauche - comme le royaume de la liberté, comme le meilleur des mondes possibles, ou en tout cas comme le seul possible dans le temps de désenchantement qui reste après les atrocités des totalitarismes rouge et brun.
17:57 Publié dans Actualité, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, philosophie, néolibéralisme, droite, gauche, diego fusaro, théorie politique, philosophie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 03 août 2023
Lifestyle-Left: la gauche selon les modes de vie commercialisés
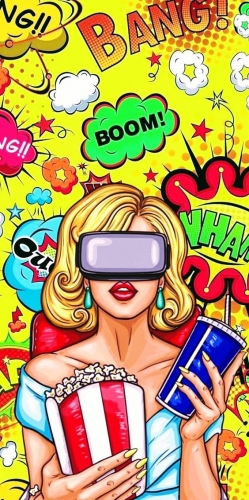
Lifestyle-Left: la gauche selon les modes de vie commercialisés
Diego Fusaro
Bron: https://posmodernia.com/lifestyle-linke-la-izquierda-de-l...
Des phénomènes comme la gay pride sont présentés par l'ordre dominant du discours comme des moments essentiels d'émancipation face à un patriarcat résiduel et homophobe. En réalité, ils ne sont que des manifestations d'adaptation sociale à l'American way of life propre au capitalisme postmoderne, complété par la substitution de la lutte des classes par un conflit de genre et d' "engouements sexuels", par définition interclassiste et donc fonctionnel au maintien de l'ordre dominant. Ce dernier réussit, à chaque fois, à évacuer complètement la priorité politique des classes dominées de la sphère des apparences, c'est-à-dire qu'il supprime, ou du moins atténue, la contradiction asymétrique entre le capital et le travail. Cette contradiction est idéologiquement évacuée au profit d'un conflit de genre totalement abstrait, dans lequel l'homosexuel riche et l'homosexuel pauvre convergent du même côté dans la lutte fictive pour la conquête des droits individuels des consommateurs.

La domestication de tout élan révolutionnaire anti-systémique est obtenue par la distraction, où l'on réoriente les énergies positives vers des conflits issus de la "diversité" et par l'adhésion aux modules de la coolitude post-moderne. Cela se traduit par l'ostentation de l'extravagance et de l'excentricité qui, tout en confirmant la rupture avec l'ancien ordre de valeurs bourgeois et prolétarien, sont pleinement compatibles avec la logique du turbo-capitalisme postmoderne et néo-hédoniste, qui promeut toute transgression fonctionnelle à la conquête de nouveaux espaces pour le marché et tout anticonformisme conforme au nouveau schéma de dérégulation économique et consumériste. La vie entre les barreaux de la cage technocapitaliste n'a cessé de se dégrader entre extravagance et aliénation. Et la gauche, en tant que parti du mouvement et de la transgression, se reconfirme comme partie prenante de la sanctification théorico-pratique de la marche triomphale du capital et des classes dominantes.
Il ne faut pas non plus oublier que l'ère post-héroïque a depuis longtemps remplacé le héros par la victime : être une victime - c'est-à-dire un sujet qui n'a rien fait, mais à qui on a fait quelque chose - confère prestige et immunité contre la critique. Qu'il s'agisse d'un groupe, d'un individu ou de l'environnement lui-même, la victime est le sujet passif par excellence ; elle coïncide avec celui qui a souffert et mérite donc le respect, dans le triomphe de cette résilience qui, ce n'est pas un hasard, est la "vertu" que les magnats cosmopolites apprécient le plus dans les masses subalternes. De plus, la victime a un droit par définition, dans la mesure où on lui a pris quelque chose : de la faiblesse d'avoir souffert, on passe, sans interruption, à la revendication et au désir de compensation.
Enfant de la "culture du narcissisme", de l'égocratie galopante et de la nouvelle culture de la victime vindicative, le jus omnium in omnia apparaît comme le fondement ultime de la civilisation de la libéralisation individualiste tous azimuts de la consommation et des mœurs. Les fantasques batailles arc-en-ciel qui, dans le quadrant gauche, ont remplacé les luttes "rouges" contre le capital et l'impérialisme, se résolvent en fin de compte en revendications pour le capital et l'impérialisme: pour le capital, puisqu'il s'agit, de facto, de batailles libérales-progressistes contre toute limite traditionnelle encore résistante à la libéralisation individualiste de la consommation et des coutumes; pour l'impérialisme, puisqu'elles passent sans réserve au soutien direct de la "mission civilisatrice" - avec le bombardement intégré de la civilisation du dollar et son interventionnisme moralisateur commis au nom de la suppression des droits civils - dans les régions du monde qui ne sont pas encore soumises au mode de production et d'existence capitaliste.
Conformément au nouveau régime de pouvoir postmoderne, caractéristique de la civilisation nihiliste de l'arc-en-ciel, ce sera le désir individuel - et lui seul - qui assumera le statut de loi en l'absence de loi. Une fois de plus, la rébellion anarchique de la gauche arc-en-ciel post-marxiste ne s'oppose pas au pouvoir néolibéral, mais le soutient et le sanctifie idéologiquement. En même temps, comme cela est devenu évident depuis le tournant post-bourgeois et ultra-capitaliste de 1968, elle n'est plus autoritaire et focalisée sur l'hypertrophie de la loi, mais est elle-même devenue anarcho-capitaliste et laxiste, permissive et hédoniste.

D'une part, à travers les batailles de caprices arc-en-ciel, la néo-gauche glamour abandonne définitivement le terrain de la lutte anticapitaliste contre l'exploitation et le classisme, qu'elle accepte désormais comme physiologique, sinon comme fécondante et "créative": elle ne s'occupe que de problèmes hors sujet faisant ainsi l'impasse sur la question du travail, de l'économie et du social, dont s'occupe souverainement la droite de l'argent.
En revanche, avec les caprices de la consommation arc-en-ciel, la gauche du costume, outre qu'elle favorise la distraction des masses de la question sociale et de la lutte contre le capital, promeut la dissolution de la société en un atomisme de "machines désirantes" - pour reprendre la définition de Deleuze - : les machines désirantes exigent que chacun de leurs caprices de consommation individuels soit légalement reconnu comme une loi. La gauche devient ainsi une Lifestyle-Left, qui met l'accent non pas sur le travail et les droits sociaux, mais sur la libéralisation des modes de vie individuels. Au lieu du peuple et de la classe ouvrière, dans l'ordre discursif de la néo-gauche patronale, il n'y a plus que des individus conçus comme des machines à désirer. Ils doivent être "orthopédiqués", libérés de tout lien résiduel avec les communautés et les traditions et, dulcis in fundo, écrasés sous le modèle du consommateur, qui a autant de droits que ses caprices peuvent être transformés en marchandises en fonction de l'argent dont il dispose.
En ce sens, le cas de l'"utérus de substitution", que le néo-langage politiquement correct a pieusement rebaptisé "maternité de substitution", reste emblématique. Dans la plupart de ses actions, la gauche néolibérale n'est plus capable de reconnaître dans une telle pratique l'aboutissement de l'aliénation, de l'exploitation et de l'objectivation, résultant du fait que le ventre de la femme est dégradé en "stock à vendre", que l'enfant à naître est souillé en tant que marchandise à la demande, et que les femmes des classes inférieures sont dégradées et condamnées à recourir à ces pratiques en raison de leur propre condition économique. Ayant intériorisé le regard omniprésent du capital et l'anthropologie du libre désir, la gauche trash défend vigoureusement l'abomination de l'utérus de substitution comme une expression de la "liberté de choix" et comme un "droit civil", comme une "opportunité" et comme un "désir" qui doit être légalement protégé. Une fois de plus, dans le triomphe du néolibéralisme progressiste, la conquête mercantile de l'ensemble du monde de la vie ne trouve plus dans la gauche un rempart d'opposition, mais une de ses justifications théoriques ; et ce, une fois de plus, sur la base de la forma mentis selon laquelle tous les tabous et toutes les limites doivent être brisés parce que c'est précisément la raison ultime du progrès.

Comme le montre notre livre intitulé Difendere chi siamo (Ed. Rizzoli, 2020), le système globocratico-financier vise à déconstruire toute identité collective (Nation et Classe, Peuple et Etat, Communauté et Patrie) et, en général, toute identité ut sique. En effet, il reconnaît dans le concept même d'identité un rempart inopportun de résistance à la généralisation de la culture du néant caractéristique de la marchandise et de son nihilisme relativiste post-moderne. Plus concrètement, la dynamique dialectique du développement du capital procède en détruisant les identités collectives résistantes et, en même temps, en protégeant et en " inventant " des identités organiques à la société de consommation, d'autant plus si elles parviennent à diviser horizontalement le front des offensés. Les seules identités autorisées et célébrées à l'heure de la désidentification omnihomologisante coïncident avec celles des minorités capitalistes globales : c'est-à-dire avec celles des acteurs sociaux dont l'idéologie représente l'enveloppe de légitimation morale du nouvel ordre social, centré sur le capitalisme financier sans frontières pour atomes-consommateurs libéraux-libertaires.
Quel plus grand succès du pouvoir néo-capitaliste que celui obtenu en provoquant la lutte des exploités homosexuels et des exploités hétérosexuels au lieu de la coopération par le bas contre l'exploiteur, qu'il soit homosexuel ou hétérosexuel ? Les micro-conflits sectoriels promus par le nouvel ordre symbolique des gauches postmodernes sont par définition horizontaux et interclassistes, donc fonctionnels à la reproduction du pouvoir néolibéral : ils évacuent complètement les priorités politiques, sociales et économiques des classes dominées de la sphère d'apparition. Et elles les remplacent, de manière distrayante et compensatoire, par des luttes abstraites et horizontales ; des luttes grâce auxquelles l'homosexuel riche et l'homosexuel pauvre, la femme exploiteuse et la femme exploitée, le ploutocrate noir et l'homme noir démuni, convergent fictivement du même côté de la lutte.
La lutte de classe de la base contre le sommet est ainsi fragmentée et rendue invisible par la production artificielle de luttes internes - de luttes " diversitaires " - sur le front des offensés, désormais divisés selon des différenciations promues ad hoc par l'ordre du discours hégémonique. Et la gauche, qui - pour le dire avec Bobbio - était à l'origine du côté de l'égalité, prend de plus en plus le parti des différences et de la défense de la diversité; et ce non seulement parce qu'en adhérant au néolibéralisme elle défend la vision compétitive et asymétrique de la société, mais aussi dans la mesure où elle assume comme son propre front de lutte et d'organisation politico-culturelle la bataille "diversitaire" pour les différences et les minorités.
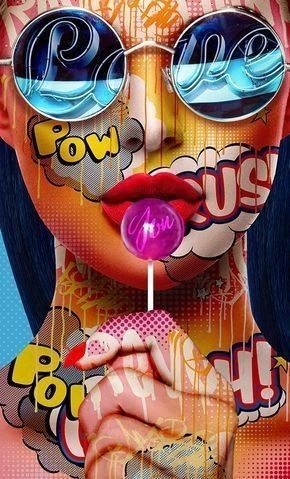
De plus, ces combats revendicatifs et différentialistes - des mouvements féministes aux gay pride - ne visent pas à renverser les structures dominantes, mais à y être pleinement reconnus en tant que minorités. Les exclus se montrent inclus de la même manière qu'ils dénoncent leur exclusion: en effet, ils ne contestent pas un système fondé sur l'exclusion (et qui, à ce titre, mérite d'être aboli), mais se reprochent égoïstement de ne pas avoir été inclus dans ce système. Lequel est littéralement all inclusive, puisqu'il aspire à inclure tout et tous dans son périmètre aliéné en n'affirmant qu'une seule distinction : la distinction économique. C'est là que réside le faux interclassisme homogénéisant de la civilisation marchande, qui brise toutes les différences pour que la différenciation économique, fondement du classisme, puisse régner partout, sans limite.
Le phénomène de protestation Black Lives Matter, que la gauche trash a élevé à sa propre conception, peut également être interprété de la même manière. L'objectif déclaré de cette révolte protestataire, qui a éclaté en 2020, n'était pas la reconnaissance sacro-sainte de l'égale dignité et de l'égalité de tous les hommes, qu'ils soient noirs ou blancs. Il s'agissait au contraire de créer - ou de renforcer - un conflit "sectoriel" développé horizontalement entre les Noirs et les Blancs, en laissant entendre, sans trop de déguisement, que les hommes blancs étaient, en tant que tels et sans exception, à blâmer.
14:19 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lifestyle-left, gauche postmoderne, gauche trash, diego fusaro, gauche fuchsia, définition, philosophie, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 01 août 2023
La dictature de la ploutocratie financière

La dictature de la ploutocratie financière
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/la-dictadura-de-la-plutocracia-financiera/
Grâce aux processus de supranationalisation et à l'ordre du discours dominant, les peuples eux-mêmes sont de plus en plus convaincus que les décisions fondamentales ne dépendent pas de leur volonté souveraine, mais des marchés et des bourses, des "liens extérieurs" et des sources supérieures s'inscrivant dans un sens transnational. C'est cette réalité que les peuples, c'est-à-dire ceux d'en bas, "doivent" simplement seconder électoralement, en votant toujours et seulement comme l'exige la rationalité supérieure du marché et de ses agents.
"Les marchés apprendront aux Italiens à voter comme il faut", affirmait solennellement, en 2018, le commissaire européen à la programmation financière et au budget, Günther Oettinger, condensant en une phrase le sens de la "démocratie compatible avec le marché". Et, en termes convergents, l'eurotechnocrate Jean-Claude Juncker avait catégoriquement affirmé qu'"il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens" ("Le Figaro", 29.1.2015). Des thèses comme celles qui viennent d'être évoquées, concernant une séparation prétendument nécessaire entre la représentation populaire et la sphère de la décision politique, auraient été considérées jusqu'à récemment comme des attaques réactionnaires, autoritaires et inadmissibles contre la démocratie. Avec la "bifurcation" de 1989, en revanche, elles sont devenues hégémoniques dans l'ordre du logos dominant : à tel point que quiconque ose les contester de quelque manière que ce soit est répudié comme "populiste" et "souverainiste".

La droite et la gauche néolibérales appliquent chacune aujourd'hui les mêmes recettes économiques et sociales. Et ces dernières ne sont plus le fruit d'une négociation politique démocratique, puisque la souveraineté économique et monétaire des États-nations souverains a disparu. Les recettes sont donc imposées de manière autocratique par des institutions financières supranationales, qui ne sont pas légitimées démocratiquement (BCE, FMI, etc.). Et comme la droite bleue et la gauche fuchsia ne remettent pas en question les processus de dé-démocratisation et de supranationalisation de la prise de décision (qu'elles facilitent d'ailleurs le plus souvent), toutes deux finissent par légitimer la souveraineté de l'économie post-nationale et, avec elle, celle de la classe apatride de la ploutocratie néolibérale, qui se cache toujours derrière l'anonymat apparent d'entités "raisonnablement suprasensibles" telles que les marchés, les bourses ou la communauté internationale.
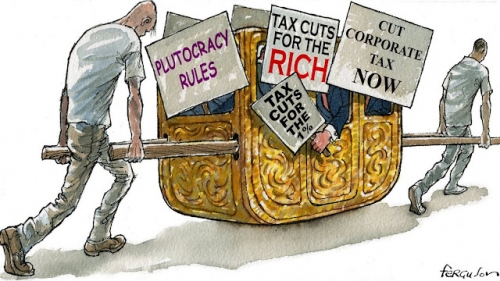
Déjà en 1990, Norberto Bobbio affirmait que "par gauche, nous entendons aujourd'hui la force qui est du côté de ceux qui sont en bas, et par droite la force qui est du côté de ceux qui sont en haut". Même alors, Bobbio décrivait en détail la nature du clivage dans le cadre du capitalisme dialectique moderne, dans lequel la gauche représentait les intérêts des dominés (ceux d'en bas) et la droite les intérêts des dominants (ceux d'en haut). Cependant, Bobbio n'a pas déchiffré l'obsolescence de ce schéma herméneutique dans le cadre du nouveau capitalisme absolu-totalitaire: dans son scénario, comme cela devrait être clair maintenant, la gauche, pas moins que la droite, représente la partie, les intérêts et la perspective de ceux qui sont au sommet.
Par conséquent, au-delà de la perfide dichotomie droite-gauche, il est impératif de re-souverainiser l'économie afin de rétablir la primauté de la décision souveraine et, enfin, d'établir la souveraineté populaire, c'est-à-dire la démocratie en tant que κράτος du δῆμος. Car la souveraineté populaire coïncide avec une communauté maîtresse de son destin, donc capable de décider de manière autonome des questions clés de sa propre existence. La dichotomie entre le socialisme et la barbarie n'a pas cessé d'être valable : avec la novitas fondamentale, cependant, que tant la droite que la gauche se sont ouvertement rangées du côté de la barbarie. Par conséquent, un nouveau socialisme démocratique d'après la gauche doit être façonné.

Les intellectuels organiques au service du capital - le nouveau clergé post-moderne - et les politiques inféodés au pouvoir néo-libéral - droite bleue et gauche fuchsia - maintiennent les classes dominées, le Serviteur national-populaire, à l'intérieur de la caverne mondialisée du capital. Elles convainquent les dominés que c'est le seul système viable. Et ils les incitent à choisir entre des alternatives fictives, qui sont également basées sur l'hypothèse de la caverne néolibérale comme un destin inéluctable, sinon comme le meilleur des mondes possibles. Contre le nouvel ordre mental et la mappa mundi forgée par le clergé intellectuel à l'appui du pôle dominant, nous devons avoir le courage d'admettre que l'antithèse entre la droite et la gauche n'existe aujourd'hui que virtuellement, en tant que prothèse idéologique pour manipuler le consensus et le domestiquer dans un sens capitaliste, selon le dispositif typique de la "tolérance répressive" par lequel le citoyen du monde se voit offrir un choix "libre" d'adhérer aux besoins systémiques. En fait, le choix est inexistant dans la mesure où les deux options au sein desquelles il est appelé à s'exercer partagent, au fond, une identité commune: la droite et la gauche expriment de manière différente le même contenu dans l'ordre du turbo-capitalisme. Et c'est ainsi qu'elles provoquent l'exercice d'un choix manipulé, dans lequel les deux parties en présence, parfaitement interchangeables, alimentent l'idée de l'alternative possible, qui en réalité n'existe pas. Ainsi, l'alternance réelle entre la droite et la gauche garantit non pas l'alternative, mais son impossibilité.
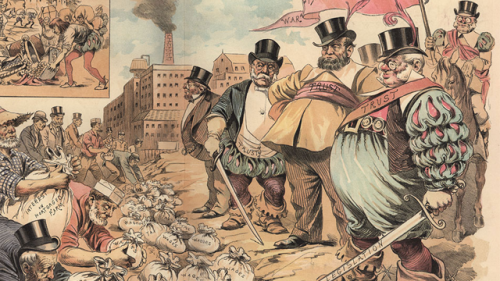
C'est pourquoi, pour réaliser la "réorientation gestaltiste" qui nous permet de comprendre le présent et de nous orienter dans ses espaces par la pensée et l'action, il est nécessaire de dire adieu sans hésitation et sans remords à la dichotomie déjà usée et inutile entre la droite et la gauche. C'est pourquoi l'abandon de la dichotomie ne doit pas s'échouer dans les bas-fonds du désenchantement et de l'apaisement de toute passion politique pour le rajeunissement du monde: la passion durable de l'anticapitalisme et de la recherche opérationnelle d'arrière-pensées ennoblissantes doit au contraire se déterminer dans la tentative théorico-pratique de théoriser et d'opérer de nouveaux schémas et de nouvelles cartes, de nouvelles synthèses et de nouveaux fronts avec lesquels revivre le "rêve d'une chose" et le pathos anti-adaptatif alimenté par les désirs d'une liberté plus grande et meilleure. Pour paraphraser l'Adorno de Minima Moralia, la liberté ne s'exerce pas en choisissant entre une droite et une gauche parfaitement interchangeables et également alliées au statu quo. Elle s'exerce en rejetant, sans médiation possible, le choix manipulé et en proposant de véritables alternatives qui pensent et agissent autrement, au-delà de l'horizon aliéné du capital. Il faut refuser l'alternance, pour redonner vie à l'alternative.
19:19 Publié dans Actualité, Définitions, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, définition, ploutocratie, néolibéralisme, philosophie, diego fusaro, philosophie politique, théorie politique, gauchedroite, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 29 juillet 2023
Hegel, toutes voiles déployées

Hegel, toutes voiles déployées
Carlos X. Blanco
Préface de Ética y economía : Ensayos sobre Hegel de Diego Fusaro. Editorial Letras Inquietas (Cenicero, La Rioja, 2023). Édité par Carlos X. Blanco.
Hegel est aujourd'hui un objet de condamnation. Si l'on écoute les apôtres de la "société ouverte", il y aurait un démon philosophique à exorciser. À côté de Platon, et parmi les plus grands, il y a Hegel, le grand philosophe germanique de Stuttgart (1770-1831) : lui aussi est le monstre que les libéraux Karl Popper et George Soros auraient voulu transpercer, en le déversant sur le dépotoir d'un Marché-Monde totalitaire, aujourd'hui triomphant.
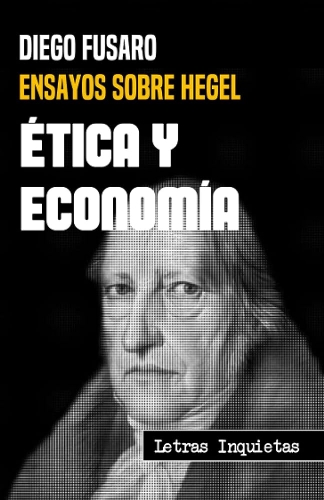 Totalitaire est le qualificatif donné à Hegel par ceux qui représentent aujourd'hui, en réalité, la quintessence du totalitarisme : les prédicateurs du mondialisme, c'est-à-dire du néolibéralisme, de la religion du marché, du monde sans frontières... Les dénigreurs de Hegel sont, en grand nombre, les véritables totalitaires d'aujourd'hui. Chacune de ces dénominations "globalitaires" - comme dirait Fusaro - rend parfaitement compte du totalitarisme réellement existant et actuel. Le terme "totalitaire" en vient à représenter l'idée d'un pouvoir global, sans fissures ni failles, qui étouffe ab initio toute plainte ou dissidence, qui annule la pluralité et élimine les espaces, les coins et les recoins de la libre vie privée.
Totalitaire est le qualificatif donné à Hegel par ceux qui représentent aujourd'hui, en réalité, la quintessence du totalitarisme : les prédicateurs du mondialisme, c'est-à-dire du néolibéralisme, de la religion du marché, du monde sans frontières... Les dénigreurs de Hegel sont, en grand nombre, les véritables totalitaires d'aujourd'hui. Chacune de ces dénominations "globalitaires" - comme dirait Fusaro - rend parfaitement compte du totalitarisme réellement existant et actuel. Le terme "totalitaire" en vient à représenter l'idée d'un pouvoir global, sans fissures ni failles, qui étouffe ab initio toute plainte ou dissidence, qui annule la pluralité et élimine les espaces, les coins et les recoins de la libre vie privée.
Les anathèmes poppériens et sorosiens sont lancés contre un État qu'ils comprennent comme un Léviathan totalitaire, une entité toute-puissante qui annule l'individu et le soumet. Mais le marché mondial, seigneur de la spéculation financière prédatrice, est, lui, bel et bien le nouveau Léviathan. Et il se trouve que l'éloge actuel de l'individu détaché de l'État cache l'étroite imbrication, la chaîne de fer de nature économique, qui lie son "libertarianisme" anti-hégélien dans une relation métallique et palpable avec le Marché mondial. C'est ce Marché mondial qu'ils ont projeté pour un 21ème siècle où "l'argent" n'aurait plus l'odeur des patries, et où les frontières - pour le Capital - n'existeraient pas. Il ne resterait aux peuples que le simulacre libertaire d'un dépassement de l'abolition des États. Les peuples deviendraient des serfs, sans législation protectrice, croyant bêtement que le capitalisme deviendrait - par sa propre dynamique - libertaire. Un capitalisme libertaire : quelle farce !
Mais ainsi, enterrant Hegel, le Seigneur deviendrait Seigneur Absolu, vendant de la fumée et de la camelote idéologique: car la fin des États signifierait l'avènement de la "gouvernance mondiale". Les entités mondialistes auto-légitimées - en commençant par l'ONU elle-même, et en terminant par le Forum de Davos, le FMI, la BM, etc. - agiraient comme de véritables Gouvernements planétaires qui, au plus tôt, mettraient tous les peuples de la Terre dans le même piège.
Il fallait en finir avec Platon et Hegel : c'est ce qu'ont décrété les néolibéraux Popper et Soros, idéologues de la "société ouverte". Bref, il était nécessaire, impératif, vital pour les seigneurs de l'argent de se débarrasser de la philosophie. Pourquoi ? Pour la simple raison que Platon et Hegel sont porteurs d'idées incompatibles avec le totalitarisme mercantile et néolibéral. Ils portent en eux le germe d'un possible sauvetage de l'Humanité bien comprise, c'est-à-dire comme un système de communautés organiques composées d'êtres rationnels et enracinés. Les deux géants du savoir philosophique, Platon et Hegel, nous enseignent (ainsi que leurs "fils" intellectuels respectifs, géants eux-mêmes, à savoir Aristote et Marx) ce qui est fondamental pour l'avènement de l'homme libre, c'est-à-dire la Communauté.
Qu'enseigne Hegel et que condamne le néolibéralisme ?
Premièrement. Hegel, ainsi que les autres géants et champions de la philosophie illibérale (toute vraie philosophie est illibérale) enseignent que l'homme est un animal communautaire (zoon politikon). Il n'est pas un atome isolé et discret. Ne perdons pas de temps à déguiser notre thèse, elle-même hégélienne : le courant dominant de la philosophie politique anglo-saxonne est un mensonge et une monstruosité. Le "loup-garou pour l'homme" (Hobbes) est un avant-goût de la jungle et de l'ère capitaliste sanglante: s'attaquer à son prochain, boire son sang, le violer, le voler et le réduire en esclavage... pour que la "richesse" puisse ensuite exister. Il n'est pas vrai que les vertus naissent des vices (Mandeville) ou des crimes les plus atroces. La tolérance lockienne a toujours été sélective, et son prétendu rejet de l'absolutisme impliquait la construction d'un absolutisme économique bourgeois plus subtil et plus écrasant. C'est alors que Hegel arrive et remet en question toutes ces balivernes libérales, y compris la "main invisible" d'Adam Smith. Fin connaisseur de l'économie politique anglaise, l'homme de Stuttgart nie la majeure. L'homme, comme le voyaient déjà les Grecs, est l'animal communautaire par excellence. L'humanité, c'est la vie rationnelle et l'épanouissement de l'esprit et de la vie éthique dans la communauté organique. Et le lien qui unit les individus, les rendant ontologiquement possibles, est un lien qui, dans la tradition chrétienne, peut être appelé amour. Il s'agit d'un lien éthique. La nature de l'homme est d'être communautaire. L'ontologie de l'être social a été découverte par cet "Aristote contemporain" qu'est Hegel. Dans le couple monogame et hétérosexuel lui-même, l'association organique - et non seulement ou surtout contractuelle - de deux personnes qui s'aiment, ce qui est spécifiquement humain transparaît déjà de manière aveuglante: le lien éthique-amoureux, le lien qui conduit naturellement à la procréation, un lien suprabiologique (parce que l'enfant implique l'éducation, l'affection et la culture) à partir duquel, dialectiquement, se déploient les institutions proprement humaines: la famille et la polis. Cet amour familial est l'antichambre éthique et logique de la cité.
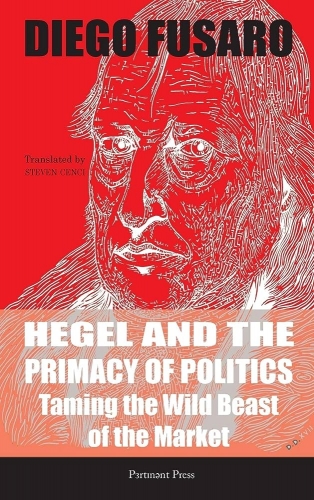
La terrible "Open Society" que nous prépare le mensonge libéral et anglo-saxon n'est pas une société: c'est un agrégat d'atomes discrets et égoïstes (sans amour) qui réduisent leurs "engagements" envers l'autre, envers leurs semblables (en remplaçant les enfants par des animaux domestiques, les conjoints par des amants occasionnels, les identités réelles par des "assignations culturelles" et des "autodéterminations de genre"), et ainsi de suite. Mais l'engagement fondamental reste intact dans ce monde terriblement "ouvert" : celui du nouveau serviteur ab-solu (qui signifie "lâche", détaché) d'un Autre: le Seigneur, qui n'est plus un homme riche fumant le cigare et portant le chapeau, l'ancien patron manchestérien, mais bien plus, quelque chose de plus terrible et de plus englobant. Loin de la figure de l'homme d'affaires, prosopon du Capital, ou du masque humain incarnant un rapport social (c'est-à-dire, à proprement parler, le Capital), le Seigneur est un tyran global, planétaire, un maître anonyme qui opère selon la vieille devise: divide et impera. Le Serviteur d'aujourd'hui, en revanche, est divisé en atomes discrets, ne sait plus fonder de familles ou de poleis, et est aujourd'hui, en ce 21ème siècle occidental, plus faible que jamais.
Deuxièmement. Les néolibéraux et les mondialistes, furieusement anti-hégéliens, enseignent que l'État est ultimement mauvais. Ils ne reconnaissent jamais que l'État, avec ses cadres législatifs potentiellement protecteurs des peuples, peut devenir un rempart contre ce sauvage "Monde sans frontières". Ils n'admettent jamais qu'un État populaire défende la production indigène et la classe ouvrière indigène. Son cadre législatif et sa discipline interne, en se dotant de moyens coercitifs pour la défense du peuple, peuvent empêcher la société de plonger dans une biocénose incontrôlable, où les capitalistes prédateurs gouvernent la planète, les corps et les esprits des hommes, en ruinant les conquêtes sociales (santé, culture, éducation, qualité de l'emploi, réseaux d'assistance et de solidarité...). Ils accusent Platon et Hegel d'"étatisme", et ce concept, pour leur part, ils l'associent ténébreusement aux totalitarismes du 20ème siècle : Hitler et Staline. Les philosophes de la lignée dialectique, de Platon à Hegel et Marx, seraient les pères intellectuels de la statolâtrie, c'est-à-dire du culte d'un État divinisé qui écrase l'individu. Foutaise, pure foutaise.
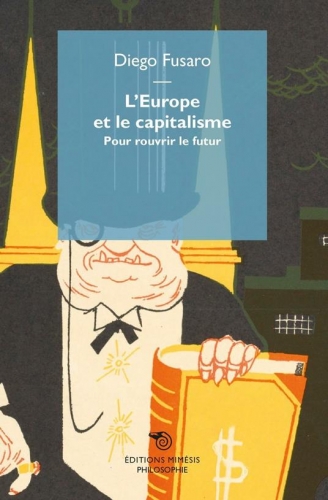
Hegel, bien étudié, parle de lui-même. Son langage n'est pas toujours simple, mais une fois acquis, le Tout est compris, et dans le Tout la vérité devient manifeste. Hegel, en partant de la dialectique découverte par Platon et en prenant au sérieux la définition aristotélicienne de l'homme comme zoon politikon, dissipe la fumée atomistique de Popper et de Soros.L'émergence même d'un monde multipolaire, où le Sud se défait du colonialisme occidental, où les pays émergents redécouvrent le rôle des États comme véhicules du peuple et pour le peuple, sera la preuve que Hegel avait raison. La raison qui, en termes hégéliens, n'est rien d'autre que la cohérence. Elle n'est que le déploiement de l'Esprit qui devient supérieur sur la base de luttes émancipatrices, de conquêtes, de résistances, d'avancées objectives au milieu de mille revers conjoncturels. Le Hegel de Fusaro, c'est le Marx d'avant Marx, le communautarisme d'aujourd'hui dans le langage métaphysique du 19ème siècle, mais aussi l'éclat de la philosophie au milieu de la nuit néolibérale, brutalement "libertaire" et atomiste.
Un maître du 21ème siècle pour comprendre un maître du 19ème. Je suis fier de placer ces quelques lignes devant la prose du Prof. Fusaro, lisse, virile et démolissante. Je ne m'attarderai pas plus longtemps sur la présentation de cet outil essentiel de libération qu'est le livre de Diego Fusaro sur G. W. F. Hegel. Sa parution en langue espagnole fait peut-être partie de la dialectique du monde lui-même. Si les vents soufflent dans une direction favorable, ils rencontreront des voiles déjà déployées.
Pour toute commande:
https://www.letrasinquietas.com/etica-y-economia-ensayos-...
21:20 Publié dans Livre, Livre, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, hegel, g. w. f. hegel, livre, philosophie, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 22 juillet 2023
Diego Fusaro: Romulus et Renus, ou l'importance sacrée de la frontière

Romulus et Remus, ou l'importance sacrée de la frontière
par Diego Fusaro
Source : Diego Fusaro & https://www.ariannaeditrice.it/articoli/romolo-e-remo-ovvero-l-importanza-sacra-del-confine
Bien qu'avec quelques nuances, Tite-Live et Plutarque racontent l'histoire du fratricide entre Romulus et Remus. Le premier, lors de la fondation de Rome, est chargé de labourer le sillon autour de la nouvelle ville, selon le rite étrusque. Jugé digne de poser ce rite sacré, Romulus prépare la charrue dotée d'un soc de bronze et l'attache au joug, en y joignant un taureau à l'extérieur et une vache à l'intérieur, tous deux entièrement blancs. Tenant le timon de la charrue en biais, de manière à ce que la terre excavée soit orientée vers l'intérieur, il trace habilement le premier sillon dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'Urbs est construite sur la base de la frontière sacrée qui entoure son espace et la distingue de l'autre partie d'elle-même.
Remus, sorti vaincu de la querelle augurale, tenta de faire échouer les opérations en se moquant de son frère: "Enfin", raconte Plutarque, "il franchit le fossé, mais tomba, renversé à cet endroit même, selon les uns par Romulus lui-même, selon les autres par un compagnon de Romulus nommé Caelere". Tite-Live rapporte aussi directement les paroles prononcées par Romulus au plus fort de sa colère, après avoir commis le fratricide : "Désormais, quiconque osera franchir ainsi mes murs mourra".
Le mythe pose, à sa manière, une possible solution ante litteram au dilemme d'Antigone formulé par Hegel. Pour Romulus, il n'y a pas de doute : la loi de l'Urbs prévaut sur le lien éthique familial, surtout lorsque ce dernier viole la juste mesure au lieu de la respecter. Mais surtout, le récit mythologique parle de la sacralité de la frontière en tant que limite qui définit une identité - en l'occurrence l'identité politique et culturelle de Rome - en la délimitant et en la différenciant de ce qu'elle n'est pas.
Sans frontière, il ne peut y avoir d'identité, qui est le fondement même de l'existence de la différence, laquelle présuppose toujours la pluralité d'identités qui ne coïncident pas et qui, par conséquent, sont distinctes les unes des autres. À son tour, sans identité, il ne peut y avoir non plus de relation, qui est, par essence, une relation entre identités avec des limites précises. Ces dernières marquent la fin de l'une et le début de l'autre, ainsi que la possibilité d'un lien relationnel, différent de celui qui découle de l'abus de l'une au détriment de l'autre, qui se produit lorsque l'invasion s'infiltre.

La civilisation des marchés sans frontières donne lieu à une invasion permanente qui n'a certainement pas pour but de favoriser les relations entre les différents, même pas sous la forme d'un dialogue. Celui-ci, comme le suggère sans équivoque le mot grec (διάλογος), implique toujours une distance et donc un seuil clair séparant les dialoguants, qui ne sont rien d'autre que des identités différentes placées dans une relation d'amitié médiatisée par le langage. Au contraire, l'invasion du marché, qui est l'impérialisme du neutre indifférencié, aspire à produire la suppression des différences et des identités, de sorte que tout tombe dans l'abîme de l'identique et de l'homologation globale. À proprement parler, la mondialisation elle-même pourrait bien être conçue comme la neutralisation des différences et des identités, et comme le passage de la planète entière vers le neutre global, sans frontières matérielles ou immatérielles, nationales ou identitaires. C'est la revanche post-mortem de Remus et de sa volonté d'invasion, de neutralisation des frontières qui différencient une identité d'une autre.
En ce sens, ce que nous avons expliqué ailleurs à propos du lien entre État-nation et internationalisme s'applique au lien entre identité et différence. La relation amicale de l'internationalisme présuppose l'existence d'États-nations souverains, libérés de leurs impulsions nationalistes dans un sens régressif : la suppression des États-nations souverains ne conduit pas à l'internationalisme, mais à l'espace ouvert réifié du mondialisme de marché, qui est l'unification du monde sous la bannière de l'économie de marché, libérée des limites de la politique souverainiste.
De même, c'est un pur non sequitur de penser que l'on peut favoriser le dialogue entre les différents en dissolvant les identités. Dans cette hypothèse, il n'y a que la monotonie de l'indistinct qui se donne comme l'homologation consumériste des identités et, conjointement, comme le triomphe planétaire de la Pensée Unique comme seule pensée permise. Le différent qui n'accepte pas de se désidentifier et de s'homogénéiser avec l'autre de lui-même est déclaré, sic et simpliciter, illégitime et dangereux. Et en tant que tel, il est traité, neutralisé et rééduqué jusqu'à l'indifférenciation. Par conséquent, même dans ce cas, ce dialogue entre les différents ne prévaut pas, qui présuppose toujours que les différents sont différents et ont leur propre identité spécifique. En revanche, c'est la même chose qui triomphe à l'échelle mondiale : la même langue, la même pensée, la même façon d'être et de produire, de vivre et d'être en relation avec les autres.

Au niveau des identités, comme dans le cas des États-nations, l'identification de deux pôles abstraitement opposés et concrètement complémentaires s'applique également. Le nationalisme régressif et le mondialisme de marché se réalisent l'un dans l'autre : le nationalisme régressif, qui porte en lui le désir d'attaquer l'autre en son propre nom, se réalise dans le mondialisme. Ce dernier est la phase finale du nationalisme, puisqu'il coïncide avec l'assujettissement de la planète entière à la seule nation triomphante, dont la monnaie est le dollar et la langue l'anglais de Wall Street. Le nationalisme s'accomplit dans le mondialisme, qui le présuppose.
Le lien que l'on peut établir entre l'identitarisme régressif et le cosmopolitisme anti-identitaire n'est pas différent. Le premier aspire à nier l'identité de l'autre, et donc la différence, par l'imposition universelle de la sienne. Le second coïncide avec l'universalisation maléfique d'une identité qui, en réalité, n'est pas telle parce qu'elle n'admet pas la différence et donc, comme Remus, ne respecte pas la frontière qui, en se séparant de l'autre, définit ce qui lui est propre. L'identitarisme régressif s'accomplit dans le cosmopolitisme anti-identitaire, qui le présuppose, et qui a en commun avec le premier la négation du droit à la différence, supprimée au nom même de l'impérialisme de la particularité.
Et c'est là, on le sait, un autre nom de l'idéologie, qui est la "volonté abstraite de l'universel" et le triomphe concret du particulier. Mais l'universel, dans son sens authentique, n'est jamais la partie qui s'impose comme universelle, c'est au contraire ce qui existe comme universel concret, qui n'annule pas les particularités mais se réalise en elles et par elles. Cela nous permet d'affirmer, une fois de plus, que l'identité ne peut exister qu'en présence de la différence et que, par conséquent, elle se donne par définition, déclinée au pluriel, comme un nœud entre différentes identités.
La tâche de la culture, qui est sans aucun doute aussi et non secondairement celle d'éduquer à l'identité, ne peut être considérée comme accomplie avec succès que lorsqu'elle produit le respect de la différence et du lien qui en découle entre la différence et l'identité. Rien n'est plus éloigné, en somme, ni du petit identitarisme tribal, qui nie l'autre au nom de lui-même, ni du "vide final" du cosmopolitisme anti-identitaire, qui vend le fantasme de favoriser le dialogue entre ceux qui sont différents en niant leur identité et, par conséquent, la prémisse même de tout dialogue. La culture consiste, au sens propre, à éduquer à l'identité et donc à la conscience de soi - étant entendu que cela n'est possible que si l'on éduque en même temps à la reconnaissance de la différence.

Celle-ci ne doit être interprétée ni comme une survivance importune de l'étranger, qu'il faut rendre identique et donc neutraliser, ni comme une réalité étrange, avec laquelle toute confrontation est a priori impossible. La différence exige au contraire d'être pensée à la manière spinozienne, comme l'un des différents attributs de la substance unique, différenciée en elle-même - attribut qui ne doit donc pas être nié au nom de l'identité indifférenciée, mais valorisé dans son être en tant que manifestation différente de la substance elle-même. D'où la nécessité d'une éducation à la polyphonie et à la différence, qui ne peut être reconnue et appréciée que si l'on possède sa propre identité.
À l'opposé des perspectives de l'identitarisme régressif et du cosmopolitisme anti-identitaire, l'humanité existe en tant que collectivité unique ; si vous voulez, également en tant qu'Unité articulée et en tant que Totalité différenciée, en tant que pluralité d'identités et de différences, dans laquelle l'unité du genre humain s'exprime sous de multiples formes. Aimer vraiment l'humanité signifie donc aimer les différences et les identités qui la composent, et surtout aimer sa propre identité culturelle, son propre peuple, sa propre langue, son propre territoire. C'est respecter la frontière comme symbole d'identité et de juste mesure, et donc comme barrière contre l'invasion, contre la désidentification et contre l'illimité.
20:39 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : identité, romulus, rome, remus, antiquité romaine, rome antique, humanités gréco-latines, diego fusaro, philosophie, philosophie politique, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 18 juin 2023
Diego Fusaro: Pourquoi l'Union européenne est-elle une tragédie pour les peuples et les travailleurs?

Pourquoi l'Union européenne est-elle une tragédie pour les peuples et les travailleurs?
Diego Fusaro
Source: http://adaraga.com/por-que-la-union-europea-es-una-tragedia-para-los-pueblos-y-para-los-trabajadores/
Selon le traité de Maastricht de 1992 (article 104) et le traité de Lisbonne de 2007 (article 123), les États européens ont été privés de la possibilité d'emprunter auprès de leur banque centrale. En outre, l'État a renoncé au droit de battre monnaie. Les États ont transféré ce pouvoir souverain au secteur privé, dont ils sont devenus les débiteurs.
Grâce aux actions par lesquelles la crise de la dette privée des banques a été déguisée en crise de la dette publique des États, la souveraineté monétaire a été neutralisée et, avec elle, la relation entre l'État et l'économie a été complètement inversée. C'est cette dernière qui est souveraine, où l'État, quand il existe encore, devient le pur défenseur du capital et de sa logique, avec pour conséquence la reconfiguration de la politique comme simple continuation de l'économie par d'autres moyens.
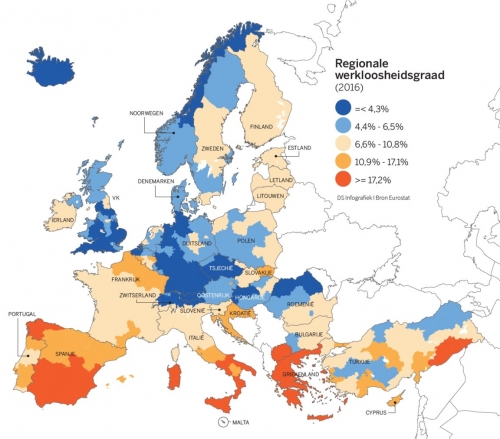
Le chômage par région en Europe.
Depuis le tableau économique avec lequel les physiocrates tentaient de diriger les politiques économiques du roi de France, la modernité est habitée par l'aspiration à substituer la politique à l'économie. C'est, on le sait, l'essence même du capital tel qu'il a été décrit par Marx et la galaxie de ses disciples hétérodoxes.
Depuis l'ère du laissez-faire, la figure du gouvernement frugal s'est imposée, destinée à s'inverser dans la dérégulation et la nouvelle gestion publique de l'État minimal avec une économie dépolitisée post-1989, avec la tyrannie de la dette, la dictature du marché et le chantage à la "confiance des investisseurs" et des gestionnaires du capital financier international.
Telle est l'essence de la nouvelle "démocratie sans peuple", c'est-à-dire du système globocratique qui, dans l'abstrait, se présente comme démocratique et, dans le concret, se détermine comme un plébiscite post-démocratique de marchés dépolitisés.
Dans ce panthéon des fonctions expressives du libéralisme, la figure de l'"État minimal" est centrale (avec le mot d'ordre privilégié par les bardes du cosmomercatisme, "moins d'État et plus de marché") : son but est de contrôler les règles du marché et la concurrence, ainsi que l'établissement d'une politique monétaire articulée sur la stabilité de la monnaie et le contrôle des prix.

À cet égard, il convient de rappeler que le 2 février 2012, le MES (le Mécanisme européen de stabilité) est entré en vigueur, introduisant la règle de la "conditionnalité".
Selon cette dernière, l'aide financière n'est accordée qu'aux États de l'UE qui, en contrepartie, s'engagent à mettre en œuvre un programme de réformes et - donc dans le texte, avec un lexique nettement orwellien - d'"ajustement macroéconomique" conforme aux tendances néolibérales.
Ces tendances, ça va sans dire, coïncident toujours avec la privatisation des services publics, avec la réduction des salaires, avec la réduction des dépenses publiques, avec l'abolition de toutes les restrictions à la circulation des marchandises.
En d'autres termes, mutato nomine, le programme politique habituel de l'aristocratie financière sans frontières. Le chantage à l'aide financière conditionnelle est ainsi déployé, par lequel le "marché des réformes" voulu d'en haut est activé au profit de ceux d'en haut.
Avec le MES, les Etats "assistés" sont privés de leur autonomie politique : ils sont contraints, sous peine de pauvreté, d'accepter des réformes dictées de l'extérieur, toujours au profit de l'oligarchie financière et au détriment des immenses masses précarisées post-bourgeoises et post-prolétariennes.
La Banque centrale européenne peut, en effet, retenir discrétionnairement les liquidités des systèmes bancaires des Etats membres qui refusent de suivre ses préceptes en matière de politiques budgétaires, de secteurs publics et de structure des systèmes de formation des salaires.

A cela s'ajoute le "Traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance", signé à Bruxelles le 2 mars 2012. Les parlements nationaux sont privés de compétences en matière budgétaire. Ils perdent définitivement l'un des piliers des systèmes démocratiques nationaux.
De plus, sur la base du MES, le poids décisionnel des Etats membres de l'UE est proportionnel aux paiements et à la puissance économique : avec pour conséquence évidente que l'Allemagne peut à nouveau faire valoir ses intérêts face à l'ensemble de l'Europe et sans avoir recours à l'esthétique traditionnelle de la violence guerrière. Le nationalisme guerrier n'est pas vaincu : il est simplement sous une forme modifiée, sous le signe de la primauté de l'économique sur le politique.
Les immenses violences liées aux processus de mondialisation de l'Europe mis en œuvre par l'Union européenne sont, plus communément, désignées comme des "règles" par le néo-langage du cosmomarché. L'Europe est désormais sous la tutelle d'une autorité dépourvue de toute légitimité démocratique.
Le pouvoir est remis aux marchés financiers spéculatifs, libres d'imposer sans limites leurs besoins et leurs orientations. L'économie de marché est désormais la seule réalité concrètement souveraine, le politique devenant quant à lui une simple variable dépendante de l'économie financiarisée.
C'est dire combien le processus d'intégration européenne (qu'il serait plus juste de définir comme un projet d'intégration libérale et de révolution passive des élites financières) a parfaitement atteint son but, à savoir l'affaiblissement des classes populaires au profit des seigneurs du capital sans frontières (alias "les maîtres de la finance mondiale") et, plus généralement, dans la contraction des espaces démocratiques.
 En effet, dans son essence même, l'Union européenne apparaît comme un système entièrement post-démocratique à tous les niveaux : un système qui a déconstruit la possibilité pour les masses nationales-populaires de peser sur les décisions politiques et qui remplace le gouvernement démocratique par la gouvernance, c'est-à-dire un gouvernement sans les peuples et orienté vers le seul fonctionnement des marchés libérés des contraintes keynésiennes des Etats-nations.
En effet, dans son essence même, l'Union européenne apparaît comme un système entièrement post-démocratique à tous les niveaux : un système qui a déconstruit la possibilité pour les masses nationales-populaires de peser sur les décisions politiques et qui remplace le gouvernement démocratique par la gouvernance, c'est-à-dire un gouvernement sans les peuples et orienté vers le seul fonctionnement des marchés libérés des contraintes keynésiennes des Etats-nations.
Les pratiques ordinaires sur lesquelles repose l'Eurosystème le confirment indiscutablement. Elles vont de la création d'États au contournement des parlements, pour aboutir au règne de technocrates non responsables et sans mandat démocratique.
L'union monétaire devient ainsi le pivot de la "nouvelle gouvernance européenne" libérale et post-démocratique, centrée sur des pratiques qui condamnent à terme les classes dominées à "mourir pour l'euro".
19:01 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, union européenne, europe, affaires européennes, économie, euro, néolibéralisme, diego fusaro |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 17 juin 2023
Gauche verte, économie verte et environnementalisme néolibéral

Gauche verte, économie verte et environnementalisme néolibéral
Diego Fusaro
Source: http://adaraga.com/izquierda-verde-economia-verde-y-ambientalismo-neoliberal/
Tout comme les caprices arc-en-ciel des consommateurs, les impulsions écologiques de l'environnementalisme capitaliste sont elles aussi complètement subsumées par le capital. L'"avenir vert" est toujours conçu comme un produit commercial du pouvoir commercial, et ce afin que (comme le souligne Harvey) l'ordre néolibéral puisse "gérer la contradiction entre le capital et la nature en fonction de ses intérêts de classe les plus importants". L'économie verte et l'environnementalisme néolibéral sur lequel elle repose théoriquement révèlent clairement comment le capital parvient à transformer même ses propres contradictions en facteur de profit. Et à transformer tout en marchandise, même la protestation contre la marchandisation.
Dans l'apothéose de la critique conservatrice, la protestation contre l'aliénation se donne elle-même sous des formes aliénées, c'est-à-dire des formes qui finissent par renforcer les barreaux de la cage qu'elles voudraient aussi briser. En vertu d'une alchimie énigmatique, au moment de la réification planétaire, la dynamite se transforme toujours en ciment, ce qui fait de tous les "matériaux explosifs" et de tous les "esprits de la dynamite" possibles simplement "une brique de plus dans le mur", comme le dit le titre d'une chanson bien connue.
Le technocapital, en outre, fonctionne infailliblement selon la stratégie paradigmatique de la standardisation, de l'absorption et de la normalisation : l'expression la plus brillante en est le sort réservé à l'image révolutionnaire de Che Guevara, réduite à une icône pop inoffensive, vendue à bas prix sur des T-shirts dans le monde entier. La désactivation de la critique est produite par sa marchandisation intégrale et sa conversion normalisante en simple spectacle, garantissant ainsi le double objectif de sa neutralisation face à toute issue émancipatrice possible et de sa reconversion en marchandise circulante.
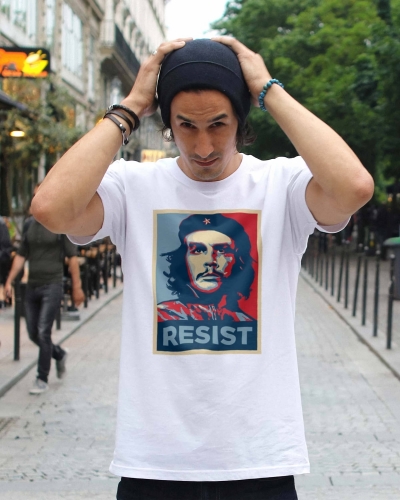
La dévastation environnementale générée à son image par le techno-capital, par son "oubli de l'être" et par sa volonté de puissance pour une croissance incommensurable, devient en effet, grâce à l'économie verte, un phénomène par lequel la ruse de la raison capitaliste, d'une part, invente de nouvelles sources de profit ("voitures électriques", "bioproduits", etc.). Et, d'autre part, avec une fonction apotropaïque, il se sécurise par rapport à un véritable environnementalisme, c'est-à-dire un environnementalisme qui rejoint la lutte plus générale contre la contradiction capitaliste en tant que telle. En bref, les stratèges de l'ordre dominant parviennent à faire passer le message que les problèmes environnementaux, générés par le capital, peuvent être résolus non pas en changeant de modèle de développement, mais en réorganisant le modèle existant en vert. Même sur un plan strictement logique, il s'agit d'un véritable non sequitur: comme si l'on pouvait changer les effets en continuant à cultiver les causes.
L'existence d'un problème environnemental est évidente, comme l'atteste l'avalanche d'études scientifiques consacrées au sujet: nulla quaestio, donc, sur l'insoutenabilité des positions, même généralisées, de ceux qui soutiennent l'inexistence du problème. La question, en revanche, concerne les moyens concrets de l'aborder et, espérons-le, de le résoudre. De ce point de vue, si le technocapital se fonde essentiellement sur l'utilisabilité illimitée de l'entité en vue du renforcement incommensurable de la volonté de puissance, il s'ensuit que, de toute façon, il s'agit d'une forme de production destinée à provoquer sa propre fin: soit parce que, avec sa dévastation de la terre, elle provoquera finalement la fin de toutes choses (et donc aussi d'elle-même), soit parce que, pour éviter cet épilogue, elle devra s'arrêter et donc aussi, dans ce cas, déterminer sa propre disparition. Face à ces deux possibilités, le technocapital tente d'en poursuivre une troisième, verte, basée sur la technologie et la géo-ingénierie.

En réalité, cette possibilité est intimement contradictoire et ne fait en vérité que proposer à nouveau - peut-être de manière différée - la première perspective, celle de la fin de toute chose provoquée par ce système, appelé capitalisme, qui, tel un cancer, anéantit le corps qui l'abrite. Et pourtant, aujourd'hui, elle semble être la vision dominante des choses, également pour les raisons déjà partiellement expliquées, rendant minoritaire la seule position rationnelle : celle qui propose, comme seule issue, le changement radical d'un modèle socio-économique, c'est-à-dire le dépassement du capitalisme. Le fait que la nouvelle gauche épouse les raisons de l'économie verte, désertant une fois de plus la voie de l'anticapitalisme, est une preuve supplémentaire de notre thèse de sa réabsorption dans les spirales du turbo-capitalisme. Le quid proprium de la gauche néolibérale, c'est le détournement de la question des droits sociaux vers celle des droits civiques et de la protection de l'environnement.
La progression de la gauche verte, de l'Allemagne à la Californie, constitue un autre exemple probant de l'essence gauchiste du néolibéralisme progressiste et de la métamorphose de la gauche elle-même. D'une part, la sensibilité verte, avec son besoin de protéger l'environnement, détourne le regard de la contradiction socio-économique et de la nécessité de protéger les travailleurs et les classes les plus faibles: pour les "militants" de la gauche verte, l'indignation face aux "bouteilles en plastique" ou aux "voitures polluantes" coexiste avec l'acceptation indifférente de l'exploitation du travail ou avec les armées de vagabonds et de sans-abri qui vivent aux marges des métropoles opulentes.
15:53 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gauche verte, économie verte, néolibéralisme, actualité, diego fusaro |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Précarité : la misère du travail et la flexibilité existentielle
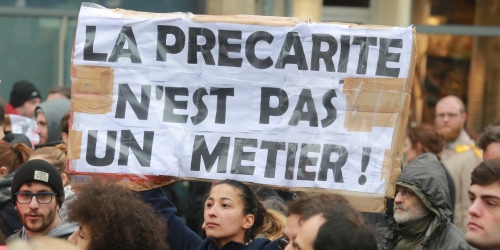
Précarité : la misère du travail et la flexibilité existentielle
Diego Fusaro
Source: http://adaraga.com/precariedad-la-miseria-del-trabajo-y-la-flexibilidad-existencial/
Le nouvel "empire de l'éphémère", c'est-à-dire le scénario de type Babel de l'après-1989, se caractérise à tous égards par une attaque frontale contre les salaires (directs, indirects, différés et sociaux) et les droits acquis.
Cette attaque, à travers les pratiques de privatisation et de libéralisation de la compétitivité, va déconstruire le service national de santé, la sécurité sociale, la médecine, l'éducation, les pensions: en bref, elle s'attaque à tout l'État-providence qui avait été une conquête des luttes du mouvement ouvrier, plaçant le nouveau "quatrième pouvoir" flexible et migrant des travailleurs intermittents dans la position de devoir accepter des emplois mal payés et à temps partiel, sans avoir droit à la protection d'une convention collective. Ce cadre comprend également des licenciements économiques, par lesquels les travailleurs plus âgés, toujours protégés par le système de protection sociale et dont les coûts sont nécessairement plus élevés, sont "incités" à partir en faveur de travailleurs plus jeunes, embauchés sur la base de "licenciements garantis" et de "contrats de collaboration temporaire", avec pour conséquence le non-renouvellement en cas de "sureffectif".
La rupture des relations de travail a pour effet une large segmentation de l'emploi ; un effet dont seuls le capital et sa classe de référence bénéficient. Des différences sont introduites dans les conditions de travail, dans les possibilités de promotion, de stabilisation et de développement professionnel, dans les degrés de protection, la reconnaissance des droits, mais aussi dans la possibilité de contester et de réagir à la politique de classe. C'est le résultat d'un processus lent et obstiné d'érosion des droits et de colonisation convergente des consciences en pleine cohérence avec le massacre de classe géré unilatéralement par la classe dominante.
Si en 2000, des millions de personnes étaient descendues dans les rues de Rome pour protester contre l'abrogation de l'article 18, déjà programmée à cette époque, et que cela avait déterminé son maintien, en 2012 la suppression a été menée à bien, qui plus est avec la connivence des dominés, convaincus, grâce à l'action omniprésente de la fabrique du consensus et de l'industrie de l'imaginaire, de la nécessité de "réformes", de "restructurations" et de "modernisations" au profit exclusif du capital.
Le Statut des travailleurs étant épuisé, c'est désormais l'entreprise et le seigneur post-bourgeois qui décident souverainement de la fin du contrat de travail. Derrière le nom vénérable de "réforme" se cache une nouvelle attaque de classe brutale contre les droits du travail et du serf. Seule la loi du marché régit désormais les relations. Au nom de la concurrence inconditionnelle et de la compétitivité libéralisante, le gagnant est celui qui sait s'adapter, c'est-à-dire celui qui sait abandonner le plus de droits et le plus de temps de vie. Et celui qui ne s'adapte pas est licencié, destiné à rejoindre l'immense réserve industrielle des chômeurs qui se pressent aux portes des villes en quête de projets.
Par essence, la concurrence est, bien sûr, un concept qui est loin d'être neutre. En effet, son admission implique, par le fait même, l'acceptation de la loi du libre marché comme paradigme universel dans lequel les gagnants sont toujours et uniquement le libre marché lui-même et le maître que constitue la classe dirigeante qui lui est organique. Avec les travailleurs, les employeurs qui respectent encore les règles et qui, avec une conscience malheureuse, protègent les valeurs les plus élémentaires du respect de la dignité humaine, sont promptement vaincus. Accepter la règle de la lutte concurrentielle signifie, pour cette même raison, accepter la licence de l'élite à dominer sans opposition, en exploitant sans réserve le travail flexible, précaire, de plus en plus libéré des protections sociales conquises et garanties par l'État.
Il suffit de citer un seul exemple. Une chaîne hôtelière stipule des contrats de huit jours avec des travailleurs aux horaires réguliers. Soudain, de nouveaux travailleurs prennent la relève, avec des contrats prévoyant des horaires de douze heures et un plus grand nombre de chambres à aménager (trente par équipe). Ces nouveaux travailleurs remplacent bientôt les anciens, selon la logique d'une compétitivité qui se confirme une fois de plus comme une licence permettant aux plus forts d'exploiter librement les plus faibles.
En réalité, la mondialisation du marché ne coïncide pas seulement avec la déréglementation, qui est également présente dans divers secteurs et sous divers profils. À côté de cela, il y a aussi un projet grandiose de "re-réglementation" visant à produire une pléthore de dispositions et de lois qui, sur le plan juridique, fixent les règles fonctionnelles à la précarité du travail tout en protégeant les intérêts du maître. La dérégulation de l'ancien système interne de l'Etat-providence et la re-régulation au sens libéral au profit de l'oligarchie financière sont donc liées.
Grâce au rythme de la mondialisation, le capital est en mesure de récupérer rapidement ce qui lui a été volé par le conflit et l'indocilité raisonnée du serf, mais aussi par l'expérience des communismes du 20ème siècle, non sans contradictions : des salaires et des droits sociaux élevés, des restrictions étatiques et législatives au licenciement, des protections syndicales fortes et le droit de grève. Les conquêtes du travail, les droits sociaux, la reconnaissance du serviteur, les prescriptions mêmes de la Constitution italienne, sont pour le capital une "citadelle" (Luciano Gallino) qui retient la compétitivité et qui, en tant que telle, doit être conquise au nom de la concurrence planétaire : elles sont, dans la syntaxe des Grundrisse de Marx, cette limite que la norme de l'accumulation incommensurable et de la croissance infinie doit nécessairement déborder pour s'imposer absolument.

Diego Fusaro
Diego Fusaro (Turin, 1983) est professeur d'histoire de la philosophie à l'IASSP de Milan (Institut des hautes études stratégiques et politiques), dont il est également le directeur scientifique. Il a obtenu son doctorat en philosophie de l'histoire à l'université Vita-Salute San Raffaele de Milan. Fusaro est un disciple du penseur marxiste italien Costanzo Preve et du célèbre Gianni Vattimo. Il est spécialiste de la philosophie de l'histoire, notamment de la pensée de Fichte, Hegel et Marx. Il s'intéresse à l'idéalisme allemand, à ses précurseurs (Spinoza) et à ses successeurs (Marx), avec un accent particulier sur la pensée italienne (Gramsci ou Gentile, entre autres). Il est éditorialiste pour La Stampa et Il Fatto Quotidiano. Il se définit comme un "disciple indépendant de Hegel et de Marx".
15:37 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, travail, précarité, flexibilité, diego fusaro |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 10 mai 2023
La fatwa contre Fusaro
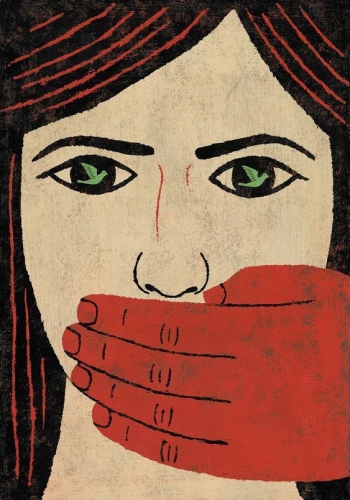
La fatwa contre Fusaro
Par Carlos X. Blanco
Source: https://ntvespana.com/06/05/2023/la-fatwa-contra-fusaro-por-carlos-x-blanco/
A Barcelone, plusieurs muftis ou oulémas de la gauche "radicale" ont pris leur décision. Fusaro doit être "canceld", éliminé de l'horizon ("fatwa"). Et avec cette élimination, par voie de conséquence, tous ceux qui éditent, traduisent, commentent, étudient, diffusent et disent "bonjour" au penseur italien.
La gauche espagnole a réussi, après la mort de Franco, à associer deux concepts dans l'esprit des masses, comme s'ils étaient nécessairement soudés: "censure" et "franquisme". Il est évident pour tout lecteur versé dans les sciences politiques que la censure est inextricablement liée au pouvoir, même au pouvoir démo-libéral. Penser l'Etat et le réalisme politique sans une théorie et une pratique de la censure, c'est vivre dans un monde irréel, dans une utopie infantile. Il y a toujours censure s'il y a pouvoir, s'il y a État, quel que soit son signe. Ce qui est décisif, c'est qui l'exerce, sur quels sujets, de quelle manière et par quels moyens, dans quelle mesure et sur quelles questions. Récemment, le philosophe russe Alexandre Douguine a publié une réflexion intéressante sur la censure et sa portée ontologique.
La portée ontologique de la censure n'est pas un sujet qui plaît aux libéraux, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais le traditionaliste russe touche les plaies, et sait très bien où ses plaies s'ouvrent et où les contradictions s'enveniment : chaque jour, le libéralisme global et omniprésent nous les montre.

Le fait est évident. Il n'y a pas que Franco, il n'y a pas que le "fascisme" : la deuxième République espagnole a aussi été un censeur. Tout régime, qu'il s'agisse d'un régime démolisseur ou d'un régime autoproclamé "socialiste", "communiste", "démocratique-populaire", était un régime de censure. La censure fait partie des pouvoirs que se réserve un Etat, et le "droit à une information libre et véridique" doit toujours côtoyer les pouvoirs - légaux et autres - que se réserve un pouvoir pour se perpétuer et se défendre ou défendre des valeurs suprêmes. Certains de ces pouvoirs peuvent être parfaitement constitutionnels (ordre public, prévention de la trahison, unité nationale, protection des secrets d'État). Être censeur dans l'intérêt politique suprême et avoir besoin d'une "censure juste" est un prius, une donnée essentielle du réalisme politique. Peu importe que l'on soit de gauche ou de droite. Les choses doivent toujours être vues "en lutte" et sans utopie.
Les partis, les journaux, les entités - publiques ou privées - qui "gèrent une coterie", c'est-à-dire un groupe de personnes dans lequel - tel est l'homme - il n'y a pas et il ne peut pas y avoir d'uniformité, censurent également. Il y a aussi l'autocensure, et d'autres pratiques qui se glissent entre la circonspection, la conspiration du silence, le "ninguneo", etc. En parlant de cette autre censure, une censure non étatique, je dois parler de la récente "affaire Fusaro".
Elle s'est produite cette semaine. Une maison d'édition de gauche "de toujours", El Viejo Topo, marxiste à part entière, a été interdite (ou censurée) lors d'une foire du livre à Barcelone. Il semble que cette foire s'appelle "Literal" et qu'elle soit fréquentée par au moins une centaine d'éditeurs "spécialisés dans la pensée radicale". Elle prétend être une foire non seulement de livres, mais aussi d'"idées". El Viejo Topo, selon son directeur Miguel Riera dans un communiqué de presse, s'est vu opposer un veto soudain par un appel téléphonique. La raison ? L'éditeur a publié des livres du philosophe italien Diego Fusaro.
Je me sens obligé d'écrire ces lignes. J'ai une opinion sur le veto de la "Fira Literal", non pas parce que je sais quelque chose à leur sujet, mais à cause des victimes de la censure ou du veto, dont je me sens très proche. J'ai collaboré avec Fusaro à de nombreuses reprises. La dernière fois, j'ai édité et préfacé le livre de ses éditeurs SND "Karl Marx et l'esclavage".
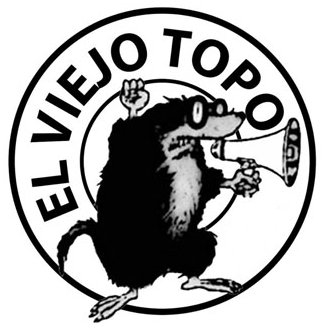
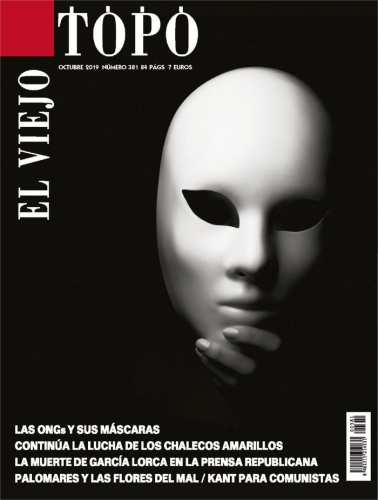
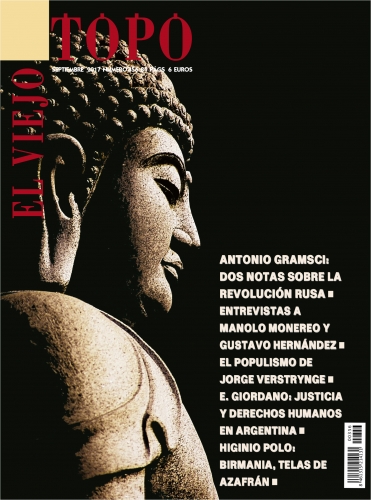
J'ai également collaboré avec El Viejo Topo, dans la revue duquel certains de mes articles ont été publiés. Je dois surtout exprimer ma solidarité avec cette maison d'édition, que j'apprécie, ainsi qu'avec Diego Fusaro, avec qui je suis uni par l'affection et l'admiration.
Il ne s'agit pas d'une censure de l'Etat, dans l'intérêt de la survie du Pouvoir, de l'Ordre Public, de l'intégrité nationale, etc. C'est la censure de quelques misérables tâcherons, incapables de reconnaître où se trouve le vrai radicalisme.
Le vrai radicalisme ne réside pas en quelques farceurs qui organisent une foire du livre, mais dans un philosophe à l'œuvre très vaste (malgré son jeune âge) qui connaît Marx comme très peu de gens dans le monde le connaissent aujourd'hui. C'est pourquoi j'ai travaillé à l'édition de son dernier livre, en collaboration avec SND, une maison d'édition qui sait reconnaître la "racine" (et le radical vient de la racine) des maux du monde moderne, et qui a un grand flair pour repérer un grand penseur et publier l'une de ses œuvres. Fusaro est un grand penseur, et sa très large projection rappelle à tous ces faux "radicaux" ce qu'ils sont vraiment. Une gauche au service du Grand Capital, au service du Nouvel Ordre Mondial. Les gardiens du système, voilà ce qu'ils sont. Un système néolibéral qui repose sur deux piliers, les néolibéraux de l'argent et de la droite, et les gauchistes néolibéraux de l'"empowerment", du séparatisme et de la culture de l'annulation.
Ils essaient d'annuler Fusaro et ce qu'ils obtiennent, à proprement parler, c'est l'auto-annulation. Ils s'enferment dans la négation de leurs propres discours, qui promettaient d'être si émancipateurs: étant si antifascistes, ils distillent eux-mêmes, chaque jour davantage, un totalitarisme nu et honteux. Ils sont les censeurs à la solde du Système, ses garçons de course. Ils font un sale boulot pour pas cher: laver la face d'une pseudo-démocratie et d'une ploutocratie. Bientôt, une forte pluie balaiera cette poussière de nullités. Dans les poubelles de l'histoire, la poussière que sont ces "radicaux" se déposera à jamais. Mais Fusaro, et les courageux éditeurs qui diffusent ses livres, brilleront toujours au milieu de cette poussière d'insignifiance et de cette crasse pseudo-idéologique.
15:47 Publié dans Actualité | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, censure, espagne, el viejo topo, diego fusaro |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 08 mai 2023
Le néolibéralisme. Ou gouverner pour les marchés
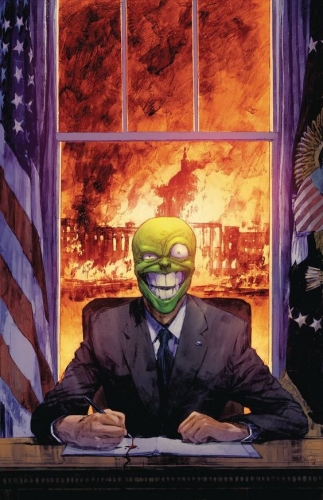
Le néolibéralisme. Ou gouverner pour les marchés
Diego Fusaro
Source: http://www.elespiadigital.com/index.php/tribuna-libre/40588-neoliberalismo-o-del-gobernar-para-los-mercados
Le fondement du turbo-capitalisme s'inscrit dans la vision néolibérale que Foucault a condensée dans la formule d'un gouvernement non pas "des marchés", mais "pour les marchés". Dans le langage de von Hayek, le gouvernement et l'État n'ont proprement qu'une seule tâche, qui n'est pas de "produire certains services ou biens pour la consommation des citoyens, mais plutôt de contrôler que le mécanisme de régulation de la production de biens et de services est maintenu en fonctionnement".
Droite et gauche, inféodées au capital, partagent désormais la même vision économique néolibérale, sous la bannière du fondamentalisme du libre marché, qui consiste à réduire simultanément l'État et le gouvernement au statut de simples serviteurs du marché. L'adhésion au dogme du libre cannibalisme, comme on pourrait définir le marché libre, est la revendication de la droite économique qui s'est tellement répandue qu'elle s'est transformée en Weltbild, la "vision du monde" omniprésente. Elle coïncide essentiellement avec la "liberté de s'envoyer mutuellement à la ruine" - selon la définition de Fichte dans L'État commercial fermé - et avec la suppression de toute limitation extérieure au pouvoir du plus fort (ius sive potentia). Si le keynésianisme pouvait être compris lato sensu comme la tentative de mettre le capitalisme au service des finalités sociales établies par la politique, on peut affirmer à juste titre qu'au contraire, le néolibéralisme marque la transition historique d'époque d'une politique économique à base keynésienne à une politique à matrice hayékienne : la justice sociale et la justice de marché ne coexisteront plus, car la seule qui survivra est la justice de marché, convertie - en accomplissement du théorème de Thrasymaque exprimé dans la République (338c) - en "droit du plus fort", τὸ τοῦ κρείττονος συμφέρον. Selon la vision canonique de Hayek, le concept de justice sociale est, du point de vue néolibéral, un simple ens imaginationis "vide et dénué de sens".
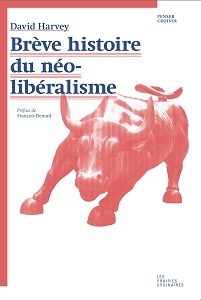 Comme le souligne Harvey dans sa Brève histoire du néolibéralisme (2005), cette perspective trouve son origine dans le quadrant droit et notamment chez des théoriciens tels que von Hayek et von Mises, avant de trouver ses bastions opérationnels chez Reagan et Thatcher. L'idée générale, explique Harvey, est celle d'une dérégulation du marché, jugé capable de s'autoréguler ; une dérégulation par laquelle l'économie devient superiorem non recognoscens et l'État désouverainisé devient un simple "policier" qui surveille les marchés et les défend si nécessaire. L'ordo néolibéral a réinventé l'État avec une fonction anti-keynésienne, en tant que "garde armé" de l'ordre désordonné de la compétitivité et en tant que garant ultime des intérêts du bloc oligarchique néolibéral non frontalier et de son hégémonie.
Comme le souligne Harvey dans sa Brève histoire du néolibéralisme (2005), cette perspective trouve son origine dans le quadrant droit et notamment chez des théoriciens tels que von Hayek et von Mises, avant de trouver ses bastions opérationnels chez Reagan et Thatcher. L'idée générale, explique Harvey, est celle d'une dérégulation du marché, jugé capable de s'autoréguler ; une dérégulation par laquelle l'économie devient superiorem non recognoscens et l'État désouverainisé devient un simple "policier" qui surveille les marchés et les défend si nécessaire. L'ordo néolibéral a réinventé l'État avec une fonction anti-keynésienne, en tant que "garde armé" de l'ordre désordonné de la compétitivité et en tant que garant ultime des intérêts du bloc oligarchique néolibéral non frontalier et de son hégémonie.
L'État néolibéral intervient dans l'économie, mais - et c'est là la nouveauté - il est structuré de telle sorte qu'il peut être géré de manière unidirectionnelle par l'élite cosmopolite pour son propre bénéfice, grâce au changement de la relation entre la politique et l'économie ; cela va du sauvetage public des banques et des entreprises privées (avec la redéfinition de l'État comme une énorme compagnie d'assurance, émettant des polices au profit des loups cyniques de Wall Street) à la répression policière des mouvements de protestation menés par les esclaves du peuple et de la nation contre l'ordre mondialiste (du G8 à Gênes en 2001, aux places françaises occupées par les gilets jaunes en 2019).
La déresponsabilisation du politique par le marché est complétée par l'érosion progressive des bases de la légitimité de l'État démocratique et de ses fondements sociaux, issus du compromis keynésien entre le politique et l'économique : le politique doit désormais être soumis à un rôle subalterne, incapable d'interférer dans l'économie, agissant exclusivement comme son serviteur et son "garde du corps". C'est ce que nous proposons d'appeler la dépolitisation néolibérale de l'économie. A la base, le compromis keynésien était l'artifice délicat construit pour redistribuer les richesses du haut vers le bas et assurer ainsi un équilibre acceptable entre démocratie et capitalisme. Depuis la fin du socialisme réel et avec la subsomption absolue de la gauche sous le capital, la décomposition progressive de l'Etat-providence s'est poursuivie dans ses principales déterminations (des retraites aux indemnités, de la grossesse à la maladie), toutes évidemment incompatibles avec les "défis" de la compétitivité sans frontières, id est avec l'exigence de produire le plus possible au prix le plus bas possible.
Liée à la réorganisation verticale de l'équilibre des pouvoirs rendue possible par le triomphe du paradigme technocapitaliste en 1989, la dé-démocratisation se fonde, comme nous l'avons vu plus haut, sur la dé-souverainisation et, conjointement, sur la supranationalisation, c'est-à-dire sur le déplacement du centre du pouvoir de la dimension des États souverains démocratiques vers des entités transnationales post-démocratiques. Comme le souligne Costanzo Preve, "la décision politique 'publique' est vidée et rendue marginale par son transfert 'privé' vers les grands centres des oligarchies financières", avec pour conséquence le passage des parlements nationaux à des conseils d'administration privés. De cette manière, qui est légitimée comme une libération de la belligérance des États nationaux et qui, en réalité, vise à neutraliser la souveraineté démocratique (qui implique la citoyenneté et la représentation) et à renforcer de manière convergente l'oligarchie financière cosmopolite "pour les peuples superflus", la disjonction entre les mécanismes de représentation populaire et les décisions macroéconomiques est réalisée. L'économie se dépolitise en s'affranchissant de plus en plus du contrôle démocratique, de même que la politique - ou ce que l'on continue d'appeler ainsi - s'"économicise", dans la mesure où elle devient un simple suiveur des intérêts économiques des groupes dominants ("comité d'entreprise des classes dominantes", pour reprendre la formule de Marx). L'état c'est moi est aujourd'hui la formule prononcée non plus par le roi, mais par la classe oligarchique néolibérale dans son ensemble.
Cet horizon de sens inclut aussi, entre autres, les allégements fiscaux mis en œuvre par la gouvernance libérale au profit des seigneurs du capital, au motif non avéré qu'ils conduiraient à des hausses généralisées de l'emploi et des revenus. Les "requins financiers" apatrides - comme les appelait Federico Caffè - et les géants du capital sans frontières sont en fait des évadés fiscaux au sens de la loi - les géants du commerce électronique, par exemple, paient un impôt d'environ 3 % - tandis que les classes moyennes et populaires subissent une hyperpression fiscale qui, en fait, représente une expropriation permanente.

A l'examen des rapports de force du turbo-capitalisme, il est clair que "marché" non seulement ne rime pas avec "démocratie", mais procède par vidange de son contenu et érosion de ses espaces. C'est là l'essence même de la "seconde restauration" post-1989, comme l'appelait Badiou dans Le Siècle : le capital victorieux s'empare de tout. Et il passe à l'offensive, dé-souverainisant les États-nations comme derniers bastions de résistance à la domination de l'économie mondiale, attaquant les classes moyennes et ouvrières et déconstruisant les espaces des démocraties nées au 20ème siècle, lesquelles étaient pourtant encore perfectibles. De plus en plus, surtout depuis les années 1990, la gouvernance néolibérale a avili la démocratie électorale au nom de l'expertise : et cette "expertise" à laquelle ils se réfèrent n'est jamais celle des travailleurs et des masses nationales-populaires, mais coïncide au contraire avec l'expertise exclusive des "techniciens", comme on appelle pieusement les banquiers et les top managers, en utilisant un terme anodin et faussement super partes.
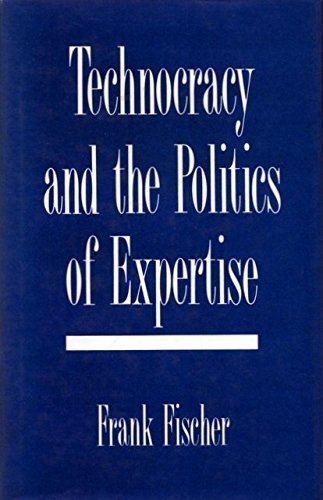
C'est Frank Fischer qui a ouvert la voie dans Technocracy and the Politics of Expertise (1990). Selon l'ordre du discours libéral, le pouvoir de décision ne sera pas dévolu au peuple souverain (ce qui est, après tout, une autre façon de dire "démocratie"), mais au "comité" - ou task force - d'"experts", c'est-à-dire de banquiers et de top managers. En d'autres termes, au-delà du théâtre des apparences, c'est l'économie, le marché et la classe dirigeante qui décident vraiment, et d'une manière qui n'a rien de démocratique. C'est également pour cette raison que le néolibéralisme peut être compris comme le détournement de l'expérience commune par le biais de l'expertise.
Comme on l'a déjà rappelé, même en ce qui concerne l'aversion pour le peuple en tant que sujet souverain (cristallisée dans la catégorie du "populisme"), la nouvelle gauche et le bloc oligarchique néolibéral font système. Et une telle involution serait synthétisée dans la formule suivante : puisque le peuple n'a pas la capacité de décider et de choisir, il faut l'annuler, pour que, sans le peuple - et c'est là le paradoxe - la démocratie puisse mieux fonctionner. C'est le résultat des conclusions tirées dans La crise de la démocratie : sur la gouvernabilité des démocraties - l'étude de 1975 préparée conjointement par Michel Crozier, Samuel Huntington et Joji Watanuki, commandée par la "Commission Trilatérale" - que les groupes dominants ont cherché de nouveaux outils conceptuels pour gouverner le peuple en régénérant la "juste distance" entre le haut et le bas, menacée à ce stade par la participation démocratique croissante et la capacité critique pas encore totalement anesthésiée des classes subalternes.
La réduction du pouvoir syndical, la réduction contrôlée de la participation populaire à la vie politique et la propagation d'une apathie généralisée ont été quelques-unes des stratégies privilégiées pour le réajustement vertical de l'équilibre des pouvoirs. La dévalorisation même du peuple en tant qu'élément essentiel de la vie démocratique a été, dans une mesure toujours plus grande après 1989, le point culminant de cette réorganisation post-démocratique caractéristique du néo-libéralisme.
16:40 Publié dans Actualité, Définitions | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : néolibéralisme, actualité, libéralisme, diego fusaro |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 11 avril 2023
Diego Fusaro: Pourquoi le capital aspire-t-il à détruire l'école?

Pourquoi le capital aspire-t-il à détruire l'école?
Diego Fusaro
Source: http://adaraga.com/por-que-el-capital-aspira-a-destruir-la-escuela/
La pédagogie néolibérale dégrade l'école en tant qu'entreprise destinée à produire des compétences adéquates pour le fonctionnement du système. Elle célèbre donc le stockage des compétences et la primauté de l'action: elle dissout toute figure de la connaissance non liée au pragmatisme de l'efficacité.
C'est ainsi que triomphe sur tout l'horizon ce que l'on pourrait définir comme une "culture barbare", pour reprendre l'image de Veblen dans la Théorie de la classe oisive : une culture qui non seulement ne favorise pas l'émancipation de la société, mais qui la pousse dans la direction opposée, en réprimant tout désir possible d'échapper à la cage d'acier du monde réduit à la marchandise. Les anciens régimes brûlaient les livres : l'actuel, sous forme de marchandise, rend structurellement impossible la figure du lecteur.
Dans le triomphe de l'esprit de quantité sur l'esprit de finesse, le capital ne peut accepter l'existence d'esprits pensants autonomes, de sujets éduqués, dotés d'une identité culturelle et d'une profondeur critique, conscients de leurs racines et de la fausseté du présent. En d'autres termes, il ne peut accepter le profil bourgeois antérieur de l'homme éduqué, enraciné dans sa culture historique et ouvert à l'avenir dans la planification.
Elle aspire au contraire à voir partout les mêmes, c'est-à-dire des atomes consommateurs sans identité et sans culture, de pures têtes calculatrices et irréfléchies, capables de ne parler que l'anglais des marchés et de la finance et incapables de remettre en cause l'appareil technico-économique dans sa totalité expressive.
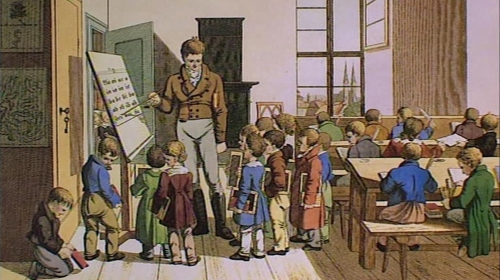
C'est dans ce même cadre cognitif qu'il faut insérer le phénomène des soi-disant "universités numériques", qui offrent à leurs étudiants des cours à distance et des diplômes obtenus sans jamais avoir mis les pieds dans les espaces concrets de l'université comme lieu de discussion et de comparaison, de dialogue et d'exercice de la critique.
La nouvelle figure numérique, de ce point de vue, favorise les processus d'individualisation de masse, en neutralisant l'élément de confrontation humaine et de concentration des étudiants dans les mêmes lieux et, dans l'ensemble, en réduisant de plus en plus la connaissance à des modules pré-packagés administrés à distance, sans aucune relation humaine avec l'enseignant.
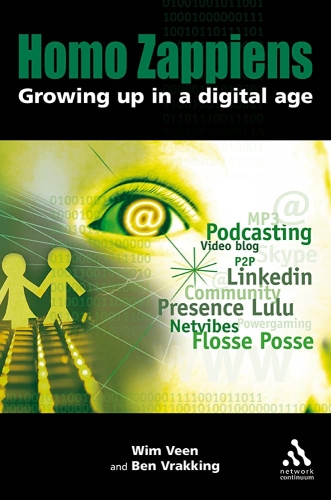
C'est ce qu'ont théorisé, entre autres, Veen et Vrakking dans leur étude Homo zappiens : leur proposition théorique se concentre sur l'idée de rompre avec les formes pédagogiques traditionnelles et, selon eux, obsolètes, et d'adapter les lieux d'enseignement aux besoins de la génération du net. Internet et son modèle doivent donc remplacer les leçons frontales classiques avec lesquelles l'Occident a transmis le savoir doré de l'époque grecque au Moyen-Âge, de la Renaissance au 20ème siècle.
Au cours des vingt dernières années, l'école en Europe a été soumise à une dynamique radicale de corporatisation, qui l'a rapidement reconfigurée dans ses fondements mêmes.
D'un institut de formation d'êtres humains au sens plein, conscients de leur monde historique et de leur histoire, elle s'est transformée en une entreprise fournissant des aptitudes et des compétences inextricablement liées au dogme utilitaire du "servir à quelque chose".
Le phénomène de la "dette étudiante" qui caractérise les campus universitaires libéraux américains et la privatisation totale de la culture sont significatifs à cet égard. Les universités publiques et privées ne cessent d'augmenter les frais de scolarité, obligeant de fait les étudiants à s'endetter pour y accéder : ainsi, non seulement les universités sont transformées en avant-postes de la valorisation de la valeur et en usines à profit, animées par le désir d'avoir plus, désir célébré par le Second traité de gouvernement de Locke, mais les étudiants eux-mêmes se retrouvent prisonniers des mécanismes de captation de la dette. Ils deviennent, dès leur plus jeune âge, les esclaves d'une dette qu'ils tenteront (le plus souvent sans succès) de rembourser tout au long de leur existence.

Dans le passage de l'Académie platonicienne et du Lycée aristotélicien aux écoles de commerce, on pourrait en effet diagnostiquer la parabole de l'Occident, à la merci du pathologique "pan-économisme utilitariste" théorisé par Latouche.
De l'éducation comprise au sens classique comme le développement complet et multiforme de la personnalité humaine, nous sommes passés sans effort à la formation comme accumulation intensive de compétences techniques et pratiques, fonctionnelles pour l'insertion dans le marché du travail instable, flexible et précaire.
Il en résulte une perversion du concept classique de l'école en tant que lieu où le temps est soustrait à l'emprise du profit et consacré à l'apprentissage en vue de la formation de soi.
À cet égard, il est utile de rappeler que les langues européennes appellent "école" (Schule, school, escuela) l'institution de formation primaire des jeunes, en référence directe au σχολή des Grecs, c'est-à-dire au temps libre, que les Romains définiront comme otium, et l'otium est, par essence, le contraire du negotium, qui est le temps occupé par l'entreprise au nom du profit. Le paradoxe de l'école à l'ère du capitalisme post-bourgeois est qu'elle se convertit de plus en plus ouvertement au principe du negotium, devenant une institution de préparation aux pratiques de travail et niant ainsi sa propre essence d'otium.
Même dans le cas de l'enseignement scolaire et universitaire, la règle générale du système chrématistique flexible et précaire s'applique : la corporatisation du monde de la vie se déroule en même temps que la dés-éthicisation du monde de la vie. La marchandisation intégrale repose sur la destruction des contraintes éthiques antérieures de la phase bourgeoise et sur l'apogée de l'individualisme consumériste.
L'introduction de la rationalité libérale dans la structure la plus profonde de la personnalité détermine l'occupation intégrale du matériel et de l'immatériel par la forme marchandise et son modèle calculateur et économiste corrélatif : ce paradigme imprègne intégralement le moi, mais aussi l'ego, la sphère magmatique et insaisissable des instincts et des pulsions ; il n'épargne pas non plus le surmoi, envahissant même le champ des questions morales et religieuses. C'est là que se situe ce que l'on a appelé la "néolibéralisation des sujets".
La pulvérisation de l'éthique et de ses racines va de pair avec la réoccupation de ses espaces par le système des besoins et la forme marchande. Cela se voit non seulement dans la redéfinition corporative des écoles publiques dans le cadre de l'ordre néolibéral, mais aussi dans la privatisation d'autres instituts éthiques fondamentaux tels que les systèmes pénitentiaire et hospitalier.
En ce qui concerne le premier, la monarchie du dollar est, dans ce cas également, à l'avant-garde du processus de post-modernisation : la privatisation du système pénitentiaire dans ce pays expose les prisonniers à un contrôle vexatoire, souvent clairement éloigné de la réglementation juridique et politique.

Les coups brutaux et la malnutrition visible sont la règle et, dans l'ensemble, la mise en œuvre nécessaire du principe "business is business" : selon ce principe, le prisonnier cesse d'être considéré comme une personne à rééduquer et à réhabiliter, en vue de sa réinsertion dans la société civile, et commence à être considéré comme une ressource dont on peut extraire la plus-value.
Cela se traduit par la recherche spasmodique de nouvelles "ressources" à interner (pour qu'il n'y ait plus de places vides) et, par conséquent, par de nouvelles politiques répressives, y compris en ce qui concerne les soi-disant "délits mineurs".
En ce qui concerne le secteur de la santé, le régime libéral promeut, à son image, une "marchandisation" de plus en plus accentuée de la santé et de la vie. Cela permet d'affirmer que les soins de santé sont profondément malades : le soin, dans son acception spécifiquement scientifique (l'éradication de la maladie) et humaniste ("Sorge" comme modalité existentielle fondamentale, comme le suggère l'Être et le Temps), est remplacé par la figure corporative du profit comme finalité ultime de l'action.
La redéfinition libérale du paradigme médical produit des effets désastreux et hautement contradictoires, qui dépendent en fin de compte de la reconfiguration (toujours dans le sillage du modèle américain) de la santé, qui passe d'un droit du citoyen à un bien de consommation. Parmi les effets les plus regrettables, on peut citer la réduction drastique du personnel médical et infirmier, avec pour corollaire un ralentissement des délais d'intervention et un risque accru de mortalité pour les patients, devenus entre-temps des "consommateurs". Il ne faut pas non plus oublier que les crédits alloués à des maladies telles que le cancer et la réduction considérable des soins aux personnes handicapées et aux malades mentaux sont de plus en plus réduits.
Dans le second contexte, il est soutenu par l'émergence de la nouvelle figure de l'"entreprise de santé", qui remplace les anciens "hôpitaux" publics : plus généralement, le droit aux soins universellement reconnu pour chaque citoyen devient une marchandise disponible en fonction de la valeur d'échange, avec pour conséquence une croissance exponentielle à la fois dans le secteur de la santé de luxe de la chirurgie esthétique pour quelques-uns, et dans l'impossibilité, pour beaucoup, d'accéder à des traitements de base.
Diego Fusaro
Diego Fusaro (Turin, 1983) est professeur d'histoire de la philosophie à l'IASSP de Milan (Institute for Advanced Strategic and Political Studies) où il est également directeur scientifique. Il a obtenu son doctorat en philosophie de l'histoire à l'université Vita-Salute San Raffaele de Milan. Fusaro est un disciple du penseur marxiste italien Costanzo Preve et du célèbre Gianni Vattimo. Il est spécialiste de la philosophie de l'histoire, notamment de la pensée de Fichte, Hegel et Marx. Il s'intéresse à l'idéalisme allemand, à ses précurseurs (Spinoza) et à ses successeurs (Marx), avec un accent particulier sur la pensée italienne (Gramsci ou Gentile, entre autres). Il est éditorialiste pour La Stampa et Il Fatto Quotidiano. Il se définit comme un "disciple indépendant de Hegel et de Marx".
16:41 Publié dans Actualité, Ecole/Education, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, école, éducation, philosophie, économisme, philosophie politique, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 03 mars 2023
Diego Fusaro: Sur l'incompatibilité entre le sacré et la finance

Sur l'incompatibilité entre le sacré et la finance
Diego Fusaro
Source: https://posmodernia.com/sobre-la-incompatibilidad-entre-lo-sagrado-y-las-finanzas/
 La destruction de l'élément qu'Otto définit comme le tremendum, c'est-à-dire cette perception de la majesté souveraine du divin qui engendre chez l'homme un sentiment de finitude créatrice, est indispensable au déploiement du subjectivisme absolu co-essentiel à la volonté de puissance et à sa présupposition de l'homme comme entité omnipotente et sans limites. C'est pourquoi - explique Otto (photo) - le sacré est l'authentique mirum, puisqu'il montre le "totalement autre" (Ganz-Anderes), nous renvoyant à une dimension différente et supérieure à celle des choses purement humaines ; le sacré - écrit Otto - coïncide avec le "sentiment d'être une créature, le sentiment de la créature qui fait naufrage dans son propre néant, qui disparaît en présence de ce qui la dépasse"(1). La promesse séduisante, mais aussi perfide, du serpent - eritis sicut dii - nous permet de comprendre pleinement comment la puissance la plus désacralisante, c'est-à-dire le capital, essaie de devenir de plus en plus comme Dieu, comme omnipotent, illimité, impénétrable, au-dessus de tout et de tous. Dans cette acception, la θέωσις, le "devenir divin" apparaît donc comme une figure de l'illimité et de l'orgueil, bien différente de la deitas théorisée par Eckhart.
La destruction de l'élément qu'Otto définit comme le tremendum, c'est-à-dire cette perception de la majesté souveraine du divin qui engendre chez l'homme un sentiment de finitude créatrice, est indispensable au déploiement du subjectivisme absolu co-essentiel à la volonté de puissance et à sa présupposition de l'homme comme entité omnipotente et sans limites. C'est pourquoi - explique Otto (photo) - le sacré est l'authentique mirum, puisqu'il montre le "totalement autre" (Ganz-Anderes), nous renvoyant à une dimension différente et supérieure à celle des choses purement humaines ; le sacré - écrit Otto - coïncide avec le "sentiment d'être une créature, le sentiment de la créature qui fait naufrage dans son propre néant, qui disparaît en présence de ce qui la dépasse"(1). La promesse séduisante, mais aussi perfide, du serpent - eritis sicut dii - nous permet de comprendre pleinement comment la puissance la plus désacralisante, c'est-à-dire le capital, essaie de devenir de plus en plus comme Dieu, comme omnipotent, illimité, impénétrable, au-dessus de tout et de tous. Dans cette acception, la θέωσις, le "devenir divin" apparaît donc comme une figure de l'illimité et de l'orgueil, bien différente de la deitas théorisée par Eckhart.
À la merci du prométhéisme techno-scientifique et d'un ordre des choses dans lequel "des gains soudains / l'orgueil et la démesure ont engendré" (Enfer, XVI, 72-74), l'homme cesse de se reconnaître comme imago Dei et prétend être lui-même Deus - homo homini Deus, dans la syntaxe du Feuerbach de l'Essence du christianisme - dans l'accomplissement de l'antique tentation du serpent. C'est là que réside l'audace arrogante de l'homme qui veut s'élever "au-dessus de tout être appelé Dieu ou objet de culte, jusqu'à s'asseoir dans le sanctuaire de Dieu, en se proclamant Dieu" (2 Thessaloniciens 2:4). Prédominant sur tout l'horizon, préfigurant des désastres toujours nouveaux de la raison instrumentale, c'est la volonté prométhéenne d'autogestion humaine du monde sans plus aucun lien avec la transcendance et, à ce stade, guidée uniquement par la logique nihiliste de la volonté de puissance de la technocratie planétaire. À l'image biblique de l'Arche de Noé, qui sauve les vivants au nom de Dieu, s'oppose le Titanic, image de la technologie débridée et de l'impérialisme prométhéen, qui coule le monde entier sous la promesse trompeuse de sa libération. Dans les espaces réifiés de la civilisation technoforme, il n'y a plus les limites de la φύσις des Grecs ou du Dieu chrétien : à l'âge de l'ἄπειρον, de l'"illimité" élevé au seul horizon de sens, il ne survit que la limite factuelle, id est, la limite que l'insaisissable puissance techno-scientifique trouve chaque fois devant elle et qu'elle dépasse ponctuellement pour pouvoir déployer pleinement toutes ses prémisses et ses promesses. Le Gestell technoscientifique, le "système dominant" de la Technik au sens précisé par Heidegger, ne promeut pas un horizon de sens, ni n'ouvre des scénarios de salut et de vérité : il croît simplement sans limite. Et il le fait en dépassant toutes les limites et en s'autonomisant sans fin. La crainte de Zeus, dans le Prométhée enchaîné d'Eschyle, apparaît donc pleinement justifiée lorsqu'il craint que l'homme, grâce au pouvoir de la τέχνη, puisse devenir autosuffisant et obtenir de manière autonome ce qu'il ne pouvait auparavant espérer obtenir que par la prière et la soumission au pouvoir divin.

Comme l'a montré Emanuele Severino (photo) (2), si la technique est la condition de la mise en œuvre de toute fin, il s'ensuit que ne pas entraver le progrès et le développement de la technique devient la véritable fin ultime, en l'absence de laquelle aucune autre ne peut être mise en œuvre. Suivant la syntaxe de Severino, il ne reste donc plus dans le champ, avec le crépuscule de la vérité, que la technique, c'est-à-dire l'espace ouvert des forces du devenir, dont l'affrontement se décide finalement par sa puissance et certainement pas par sa vérité. En plus de cela, le système technocapitaliste réduit le monde aux limites de la raison calculatrice, de sorte que ce qui ne peut être calculé, mesuré, possédé et manipulé est, eo ipso, considéré comme inexistant. La logique du plus ultra, qui est le fondement du technocapital, est déterminée dans la sphère éthique et religieuse selon la figure susmentionnée de la violation de tout ce qui est inviolable, ce qui suppose de parvenir à la neutralisation de Dieu comme symbole du vόμος. L'instance libertaire des Lumières est inversée dans son contraire, comme l'a déjà montré la Dialektik der Aufklärung d'Adorno et Horkheimer. L'anéantissement de tout tabou, de toute loi et de toute limite, donne naissance au nouveau tabou de la vie qui se suffit à elle-même (3).
La liberté illimitée, ou plutôt - plus proprement - le caprice anomique et le "mal infini" de la croissance autoréférentielle et dérégulée, se précipite dans la servitude de la contrainte à la transgression et à la violation de tout ce qui est inviolable, donc dans l'impératif faussement émancipateur qui prescrit la jouissance sans entrave et sans délai, ne visant que l'intérêt individuel et la rage irréfléchie de la croissance comme une fin en soi. De cette façon, la raison calculatrice - la "vie aride de l'intellect" dont parlait le jeune Hegel (4) - s'érige en juge qui distingue ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, ce qui a du sens de ce qui n'en a pas, ce qui a de la valeur de ce qui n'en a pas. Permettre au technocapitalisme de se développer sans limites d'aucune sorte, qu'elles soient matérielles ou immatérielles : cela ressemble à l'une des définitions les plus invraisemblables que l'on puisse postuler du mythe régressif du progrès, du culte irréfléchi de la réification intégrale de la civilisation, dont les membres sont de plus en plus transformés, souligne Heidegger, en simples "prêtres de la technique" et en simples apôtres de la marche du capital de claritate in claritatem (5).
Provoquer la disjonction du Désir avec la Loi, afin que le premier puisse se développer sans limites et sans inhibitions, selon la figure de cette violation de tout ce qui est inviolable sur laquelle repose l'essence du système chrematistique absolu en tant que métaphysique de l'illimité, est l'une des pierres angulaires faussement émancipatrices de l'ordre désordonné de la civilisation marchande. C'est ce que l'on entrevoyait déjà dans Les Frères Karamazov de Dostoïevski : "Mais alors, je demande, que deviendra l'homme? Sans Dieu et sans vie future? Tout est-il alors permis, tout est-il admissible? La mort de Dieu indique que l'accomplissement du nihilisme est un processus de dévaluation des valeurs et le crépuscule des fondements. Il coïncide avec la "transvaluation de toutes les valeurs", l'Umwertung aller Werte énoncée par Nietzsche.
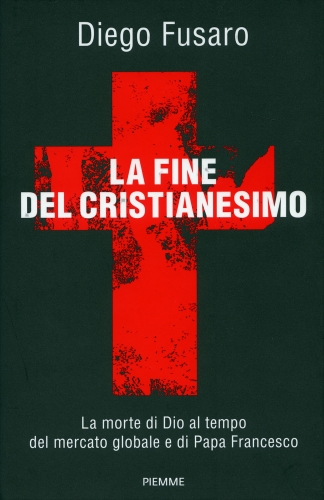
Le nihilisme de la mort de Dieu semble se concrétiser en quatre déterminations décisives, qui tracent les contours de l'époque de la société anomique actuelle du père post mortem Dei évaporé : a) sur le plan ontologique, si Dieu est mort, alors "tout est possible", comme ne cessent de le répéter les stratèges du marketing, et comme le révèle la mécanique de la réduction technique de l'être à des profondeurs exploitables ; b) sur le plan strictement moral, si Dieu est mort, alors tout est permis et aucune figure de la Loi ne survit ; c) cela signifie donc que tout est indifférent et équivalent, sans rang hiérarchique ni ordre de valeurs, dans le triomphe d'un relativisme généralisé où tout devient relatif sous la forme marchandise (la "dictature du relativisme" thématisée par Ratzinger) ; d) sur le plan moral et ontologique, si Dieu est mort et que tout est possible et permis, il s'ensuit que toute limite, tout simulacre de la Loi et toute barrière est, en tant que tel, un mal à renverser et une limite à violer et à dépasser.
La mort de Dieu comme dissolution de tout ordre de valeurs et de vérité (Nietzsche) et comme évaporation de l'idée même de père (Lacan) est donc cohérente avec la dynamique du développement du capital absolu : dans les périmètres globalisés de la société de marché totale et totalitaire, tout est permis, sous réserve qu'il y ait toujours plus, et de la disponibilité de la valeur d'échange correspondante, élevée à la nouvelle divinité monothéiste (7). La désertification de la transcendance et le dépeuplement du ciel sont co-essentiels à la dynamique de l'absolutisation du plan marchand de l'immanence, dont l'expression figurative la plus appropriée semble être identifiée dans le désert, comme l'a suggéré Salvatore Natoli (8). Sur la base de ce qui a été souligné par Heidegger et Hölderlin, l'époque du nihilisme économique correspond à une Weltnacht dans laquelle l'obscurité est tellement dominante qu'elle empêche de voir la situation de misère dans laquelle sont tombés ceux d'entre nous qui se trouvent à l'époque des dieux enfuis :
"Le manque de Dieu signifie qu'il n'y a plus de Dieu qui rassemble autour de lui, visiblement et clairement, les hommes et les choses, ordonnant dans ce rassemblement l'histoire universelle et la permanence des hommes en elle. Mais dans le manque de Dieu se manifeste quelque chose d'encore plus grave. Non seulement les dieux et Dieu ont fui, mais la splendeur de Dieu dans l'histoire universelle s'est éteinte. Le temps de la nuit du monde est le temps de l'indigence, car il devient de plus en plus indigent. Et il est déjà devenu si pauvre qu'il n'est pas capable de remarquer le manque de Dieu comme un manque" (9).
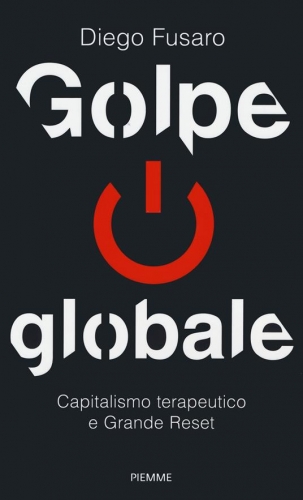
La mort de Dieu annoncée par Nietzsche et évoquée par Heidegger correspond, en effet, à cette complète dé-divinisation nihiliste du monde qui produit la perte de sens et de finalité, d'unité et d'horizon. La dé-divinisation en cours - que, avec le Hegel de la Phénoménologie, nous pourrions aussi comprendre comme un "dépeuplement du ciel"(10) (Entvölkerung des Himmels) - correspond au vidage de tout sens et de toute arrière-pensée par rapport au marché capitaliste, devenu l'horizon exclusif : l'immanentisation monomondaine capitaliste dissout tout point de référence autre que la forme marchandise, devant laquelle tout devient relatif. Les choses et les gens, de plus en plus interchangeables, ne sont plus "rassemblés" dans un cadre qui donne sens. Et ils sont projetés, comme des fragments isolés et sans lien, dans l'espace infini et sombre du marché global, hypostasié dans le seul sens de l'histoire universelle pétrifiée.
Avec la syntaxe de Heidegger, la "splendeur de Dieu" comme valeur des valeurs et comme symbole des symboles s'est éteinte et, avec elle, l'idée même d'un sens du flux de l'histoire universelle et d'un sens qui dépasse la simple valeur d'échange. Tout erre dans le vide cosmique de la fragmentation et de la précarité globale, prêt à être manipulé par la volonté de puissance de la croissance infinie et de la déraison de la raison économique (11). Suivant l'analyse de Pasolini, c'est l'essence du nouveau "Pouvoir qui ne sait plus quoi faire de l'Église, de la Patrie, de la Famille" (12) et qui, de plus, doit les neutraliser en tant qu'obstacles à sa propre réalisation. La mort de Dieu correspond au relativisme nihiliste post-métaphysique propre à l'extension illimitée de la forme marchandise élevée au seul horizon du sens et à la volonté de puissance illimitée de l'entreprise technique. Selon l'enseignement que nous tirons de Weber et de ses considérations sur la Protestantische Ethik, un capitalisme pleinement opérationnel n'a plus besoin du système superstructurel - le "manteau" sur ses épaules, dans la grammaire weberienne - qui lui était initialement indispensable. Poussant le discours au-delà de Weber, il doit précisément s'en défaire, puisque l'absence de ce puissant support de sens est désormais aussi vitale que sa présence l'était auparavant.
Le relativisme consumériste post-métaphysique empêche la reconnaissance de la figure véritative des limites (éthiques, religieuses, philosophiques). Et, par un mouvement synergique, il valorise les goûts infinis de la consommation libéralisée, détachée de toute perspective de valeur. Parallèlement, elle dessine un paysage réifié de monades exerçant leur volonté de puissance consumériste illimitée, libres de faire ce qu'elles veulent, tant qu'elles ne violent pas la volonté de puissance des autres et, ça va sans dire, tant qu'elles ont la valeur d'échange correspondante. Le fanatisme de l'économie ne peut résister à la puissance axiologique, vérificatrice et transformatrice de la philosophie. Il s'appuie au contraire sur le pouvoir de la technoscience, qui sert à produire des marchandises toujours nouvelles et de nouveaux gadgets destinés à accroître la valorisation de la valeur. Le consumérisme compulsif lui-même, qui est devenu le mode de vie ordinaire de l'habitant de la cosmopolis intégralement réifiée, n'est rien d'autre que la réverbération subjective du paradigme technocapitaliste et de sa structure fondamentale (13).
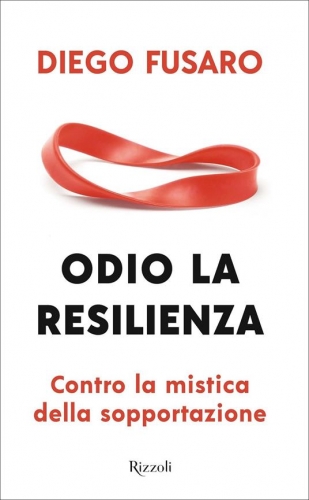
Le nouveau pouvoir technocapitaliste, selon les mots de Pasolini, "ne se satisfait plus d'un "homme qui consomme", mais prétend qu'aucune autre idéologie que celle de la consommation n'est concevable"(14). Elle permet à la permissivité d'"un hédonisme néo-séculaire, aveuglément oublieux de toute valeur humaniste"(15) de prévaloir de manière omniprésente et sans aucune zone franche. Le nouveau pouvoir, par rapport auquel rien d'autre ne sera anarchique, n'accepte pas l'existence d'entités qui ne le sont pas sous forme de marchandise et de valeur d'échange : "Le pouvoir, explique Pasolini, a décidé d'être permissif parce que seule une société permissive peut être une société de consommation" (16). L'homme lui-même, réduit au rang de consommateur, finit par être lui-même consommé par l'appareil technocapitaliste.
Notes:
1.- R. Otto, "Il sacro", Feltrinelli, Milano 1987 (édition espagnole, "Lo santo", Alianza Editorial, Madrid 2016).
2. -Severino, "Il destino della técnica", Rizzoli, Milan 1998.
3.- Cfr, M. Recalcati, "I tabù del mondo". (édition espagnole, "Los tabúes del mundo", Anagrama, Barcelone 2022).
4.- G.W.F. Hegel, "Gesammelte Werke", Meiner, Hamburg 1985 (édition espagnole, dans la "Fenomenología del Espíritu", Pre-Textos, Valencia 2006).
5.- A ce sujet, nous renvoyons à notre étude "Minima Mercatalia. Filosofia e capitalismo", chap. V. Bompiani, Milano 2012.
6.- F.M. Dostoïevski, "Brat'ja Karamazovy, 1880 ; tr. It. "I fratelli Karamazov", Garzanti, Milano 1979, II, p. 623 (édition anglaise, "The Brothers Karamazov", Alianza Editorial, Madrid 2011).
7.- Preve, "Storia dell'etica", Petite Plaisance, Pistoia 2007.
8.- S. Natoli, "La salvezza senza fede", Feltrinelli, Milano 2007.
9.- M. Heidegger, "Wozu díchter in dürftiger Zeit ?", 1946 (édition espagnole, "Caminos del bosque", Alianza Editorial, Madrid 2010).
10.- G.W.F. Hegel, "Phänomenologie des Geites", 1807 ; "Fenomenologia dello Spirito", Bompiani, Milano 2000, p. 973 (édition espagnole, "Fenomenología del Espíritu", Pre-Textos, Valencia 2006).
11.- Latouche, "La Déraison de la raison économique", Albin, Paris 2001.
12.- P.P. Pasolini, "Gli italiani non sono più quelli", 10-6-1974, in id. "Scritti corsari", Garzanti, Milano 1990 (édition espagnole, "Escritos corsarios", Galaxia Gutenberg, Barcelona 2022).
13.- M. Featherstone, "Consumer Culture and Postmodernism", 1991 ; tr. It. "Cultura del consumo e postmodernismo", SEAM, Roma 1994 (édition espagnole, "Cultura de consumo y posmodernismo", Amorrortu, Buenos Aires 2000).
14. - P.P. Pasolini, "Sfida ai dirigente della televisione", 9-12-1973, in Id. "Scritti corsari", op. cit.
15.- Id. "Eros e cultura", dans Id. "Saggi sulla política e sulla società", op. cit.
17:45 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : diego fusaro, philosophie, sacré, finance, technocapitalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook



