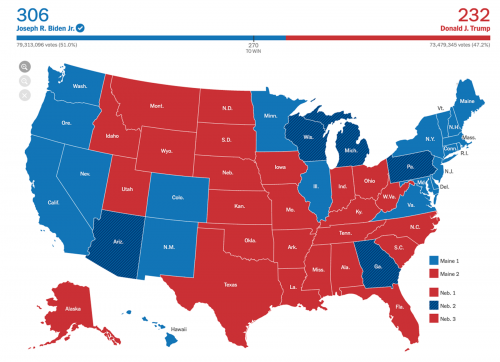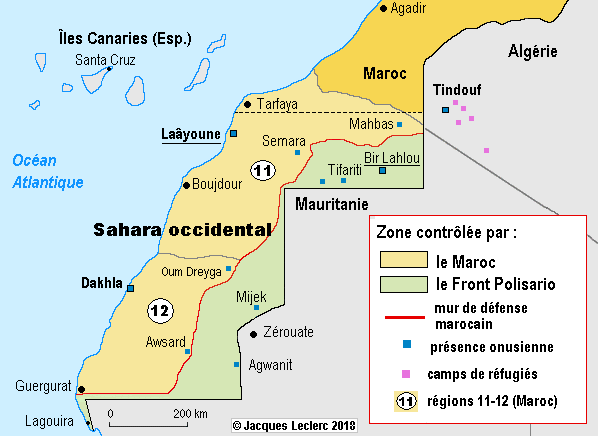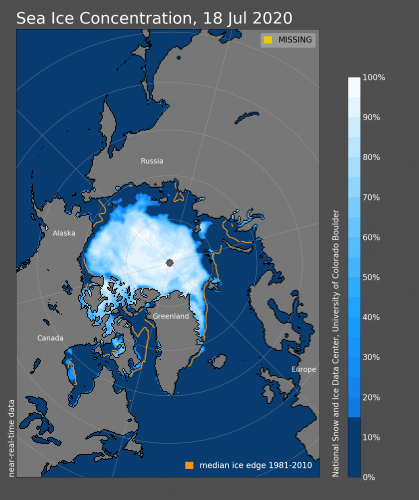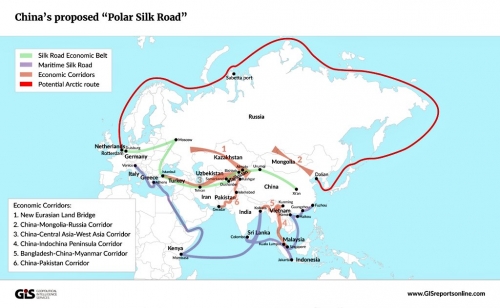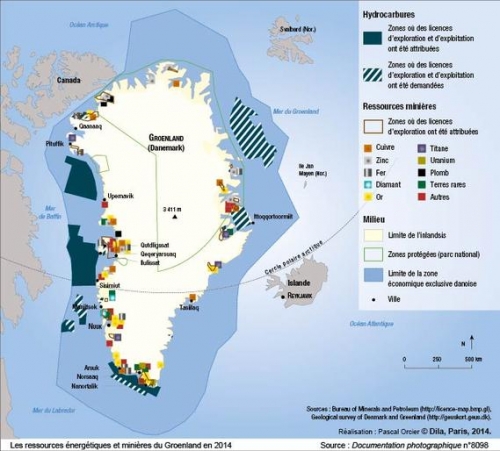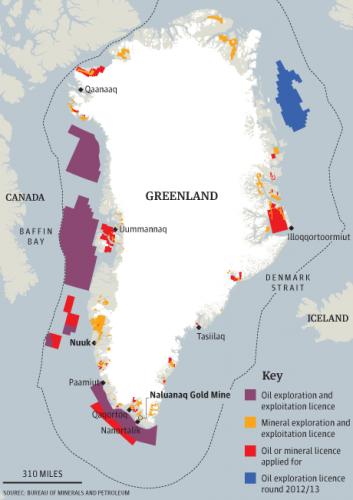Mais quelle est cette secte qui dirige le monde ?
par Piere-Emile Blairon
Portrait d’un robot
Il nous faut d’abord dresser un portrait-robot (on ne peut pas si bien dire !) du sectateur mondialiste-type ; choisissons-le de nationalité française, celle que nous connaissons le mieux, mais il n’est pas plus Français que Guatémaltèque ou Martien.
Il a été formaté en France (ENA et Sciences Po) et aux Etats-Unis (Yale ou Harvard) ; c’est un Young Leader[1], la créature arrogante d’une sorte de club élitiste franco-américain qui se permet de choisir (en finançant leurs études) les futurs dirigeants politiques, financiers, économiques et médiatiques de la société française (existe maintenant en version franco-chinoise - on n’arrête pas le progrès- avec la bénédiction de l’inévitable Attali, le fléau de Dieu, celui qu’on voit sourire béatement derrière chaque Président français depuis Mitterrand lors des cérémonies d’investiture).
Le Young Leader fait aussi partie de l’une ou de plusieurs de ces officines qui rassemblent leurs membres périodiquement dans un grand fracas médiatique sous prétexte que leurs réunions sont « secrètes » : Bilderberg, Trilatérale, Open Society de Soros, Forum de Davos, Fondation Rockfeller, le club Le Siècle d’Olivier Duhamel[2], Skull and Bones, Fondation Gates, etc.
Notre homme-robot est un parfait nomade qui n’a de connaissance des pays qu’il traverse que le confort des hôtels de luxe qui l’hébergent, confort agrémenté de « shoots » et de gâteries sexuelles selon ses « orientations », la plupart du temps exclusivement perverses (c’est qu’on s’ennuie dans la routine !)
On lui a inculqué une aversion totale pour la nature, l’histoire, les traditions, l’enracinement, l’attachement à un sol ou à un peuple ; il n’a aucune connaissance culturelle en dehors de ses spécialités consacrées principalement à l’économie, aux opérations boursières et à l’art de manipuler les foules en jouant de la flûte ; il est probable qu’un élève studieux d’une 3ème des années 1950 aurait pu lui en remontrer en culture générale mais s’il ne s’est jamais aventuré dans les labyrinthes lumineux de la langue d’un Gracq, il vous dira ce qu’il faut en penser parce que ses maîtres n’auront pas oublié de programmer le neurone adéquat. Notre « homme » est un as de la simulation et de la dissimulation.
Enfin, pour compléter ce charmant tableau, il a une haine viscérale pour « le bon peuple » en même temps que ces manants lui inspirent une trouille tout aussi incontrôlée ; c’est juste à ce (dernier) moment qu’il redevient humain.
Il nous faut voir maintenant comment on est arrivé à l’émergence d’un tel monstre.


Les films prophétiques de Stanley Kubrick
Stanley Kubrick est mort le 7 mars 1999 juste après avoir terminé la réalisation de Eyes wide shut, qu’il considérait comme son meilleur film. Il y a donc 22 ans.
La plupart des spectateurs du film, mais aussi des critiques, n’y ont rien compris ; et, mieux, pour se défendre de leur incapacité à l’expliquer, ils ont affirmé que, de toutes façons, il n’y avait rien à comprendre, que ce n’était qu’un « film de cul » décrivant une orgie satanique organisée par l’upperclass new-yorkaise avec un scénario aux dialogues indigents rappelant le film de série B éponyme : Orgie satanique, sorti en 1965. Ce bon Kubrick est bien fatigué, circulez, y a rien à voir.
Mais Stanley Kubrick ne s’est pas contenté d’être parmi les plus grands cinéastes de tous les temps, salué pour sa technique et l’éclectisme de ses choix, il est aussi un visionnaire, de ceux dont on ne reconnaît le génie prédictif que lorsque les événements qu’ils ont décrits arrivent effectivement.
J’ai choisi de parler des œuvres de Stanley Kubrick pour n’avoir pas à remonter aux racines du mal, à savoir au frankisme (fin du XVIIIe siècle), aux Illuminati (début du XVIIIe siècle) ou aux francs-maçons (fin du XVIe siècle) même si ces sociétés plus ou moins secrètes et d’autres beaucoup plus anciennes (la Kabbale, La Confrérie du Serpent) constituent les références (mal comprises) de celle qui gouverne la planète aujourd’hui.
2001 : L’Odyssée de l’espace et le transhumanisme
2001 : L’Odyssée de l’espace, l’autre film prophétique de Kubrick est sorti en 1968 ; il y a trois personnages principaux dans ce film : un monolithe noir[3] qui symbolise la Connaissance apportée aux hommes par des extraterrestres, vraisemblablement originaires de Jupiter, un humain, David Bowman, qui servira d’objet d’observation à ces mêmes extraterrestres[4], un ordinateur, appelé Hal 9000 dans la version originale et Carl 500 dans la version française qui va préfigurer la révolte des robots qui vont s’humaniser jusqu’à défier leurs créateurs et se libérer de leur joug. En quelque sorte, l’histoire de Prométhée défiant les dieux qui recommence.
Le scénario ? Il y a plusieurs millions d’années, une tribu d’australopithèques découvre un monolithe noir déposé devant leur caverne ; en le touchant, ils acquièrent un savoir qui leur permet d’utiliser les os des animaux qu’ils mangent comme armes pour vaincre les tribus ennemies. C’est la scène-culte, exactement archéofuturiste, la plus célèbre de l’histoire du cinéma, qui montre l’un d’eux tuant son adversaire avec un os qu’il va ensuite lancer vers le ciel ; l’os tournoyant se transforme en un vaisseau spatial qui vogue au rythme d’une valse de Strauss ; raccourci stupéfiant entre notre plus vieille histoire et notre plus lointain futur. Une équipe de cosmonautes retrouvera ce même monolithe enfoui dans le sol lunaire[5], émettant des ondes en direction de Jupiter ; il sera encore présent, immense, en orbite autour de Jupiter où va accéder David Bowman au terme d’un voyage à travers l’espace et le temps, et le temps aussi de sa propre vie qui défilera devant les yeux hallucinés du cosmonaute.

Le monolithe noir se dressera une quatrième fois, implacable, tel Thanatos, le juge des morts, devant le lit de Bowman, vieillard agonisant.
La dernière image du film est celle d’un fœtus, probablement Bowman lui-même, image d’espoir, de recommencement, de renaissance, symbolisant le cycle des réincarnations.
Une grande partie du film, entre les fantastiques images de début et de fin, raconte l’emprise progressive du robot sur les humains qui sont censés êtes ses maîtres. L’humanisation du robot ou la robotisation de l’Homme est un lieu commun de la science-fiction depuis Frankenstein. L’œuvre de Marie Shelley, si bien nommée : Frankenstein ou le Prométhée moderne, a été écrite en 1818 ; on connaît l’histoire : Un jeune savant nommé Frankenstein[6] décide de fabriquer un être humain en assemblant des parties diverses de cadavres glanées dans les cimetières. Nous allons voir que « La secte qui dirige le monde » a plus d’affinités avec la créature hagarde de Frankenstein, composée de chairs putrides sanguinolentes, qu’avec une répliquante (femme-robot) de Blade Runner (l’autre film-culte de la SF) mignonne et bien propre sur elle.
C’est cette partie-là du film qui met en vedette le robot qui intéresse précisément La-Secte-qui-dirige-le-monde ; Car la principale obsession (ils en ont d’autres) des membres de la Secte qui sont biologiquement des humains, quoiqu’ils fassent, est l’immortalité du corps ; celle de l’âme ne les intéresse aucunement comme ne les intéresse pas non plus les corps autres que le leur, ils ne sont pas du tout altruistes ; quand ils pensent « élitistes », il convient de traduire : égoïstes ; les Sectateurs sont psychiatriquement malades, dotés d’un ego surdimensionné, d’une vanité incommensurable (qui se traduit universellement par ce qu’on appelle l’hubris), d’un narcissisme hors normes qui en fait des manipulateurs pervers ; on retrouvera ces traits de leur caractère tout au long de leur parcours sociétal, notamment par de sordides faits divers qui les impliquent dans des histoires de délinquance financière ou sexuelle dont ils se sortent toujours. On ne compte plus les membres du gouvernement mis en examen[7].

Les Sectateurs sont progressistes, c’est-à-dire qu’en bons matérialistes athées, ils ne croient qu’au progrès de la technique, or, ce progrès-là se heurte, dans son évolution qu’ils aimeraient infinie et sans obstacle, à une évidence naturelle que nous pensions jusqu’à présent incontournable : la mort.
Les Sectateurs se comportent comme des Titans prométhéens : ils rêvent de gigantisme (de titanisme), ils rêvent d’être Dieu, de le remplacer, de créer (pour eux uniquement) un paradis sur Terre.
Les savants savent désormais comment enrayer l’oxydation des cellules qui est le principal facteur de leur vieillissement[8] ; Les études qui se poursuivent dans ce domaine sont, bien évidemment, financés par les richissimes dirigeants de la Secte, comme ils financent aussi la recherche sur les nanoparticules insérées dans des corps humains qui permettront de changer les organes déficients et donc, à terme, le corps en entier[9]
Mais, mesdames et messieurs qui me lisez, ne rêvez pas ! L’immortalité, ça n’est pas pour vous !
Et c’est là que vous allez comprendre (pour ceux qui ont raté quelques épisodes[10]) ce qui est en train de se passer au moment où j’écris, le 3 février 2021.
« Rien ne garantit qu’une humanité augmentée sera tolérante vis-à-vis des humains traditionnels. […] La possible tyrannie de la minorité transhumaniste doit être envisagée avec lucidité. »
 Ainsi s’exprime le représentant du transhumanisme en France, Laurent Alexandre, dans son livre dont le titre ne prête à aucune ambiguïté : La Mort de la mort[11].
Ainsi s’exprime le représentant du transhumanisme en France, Laurent Alexandre, dans son livre dont le titre ne prête à aucune ambiguïté : La Mort de la mort[11].
Et il va rajouter un peu plus loin :
« Avoir des millions de nanorobots médicaux dans le corps est une perspective intéressante, à condition que la sécurité informatique soit assurée. Imaginez que des bioterroristes parviennent à prendre le contrôle de ces nanorobots ! En les rendant agressifs, ils pourraient tuer d’un clic de souris des millions d’individus […] Une attaque terroriste virale, avec par exemple une version génétiquement modifiée du SRAS, de la variole ou autre, pourrait provoquer des millions de victimes avant qu’un vaccin ne soit disponible[12]. »
Epoustouflantes, ces dernières lignes, non ? Le copain de Bill Gates a écrit son livre en 2011, il y a 10 ans !
Mais les premières lignes sont aussi « prophétiques » ; je le dis et le redis : la Secte ne cache jamais rien de ses monstrueuses intentions. D’abord, la menace : « la possible tyrannie de la minorité transhumaniste » que la Secte met précisément à exécution en ce moment. Puis le projet est exposé : en fait de « terroristes », ce sont les adeptes de la Secte eux-mêmes qui prendront « le contrôle de ces nanorobots » et qui pourront donc éliminer à leur guise tout contrevenant à leurs diktats : « ils pourraient tuer d’un clic de souris des millions d’individus », rajoute Alexandre.
Il n’a jamais été question pour la Secte d’étendre le bénéfice de l’immortalité corporelle à l’ensemble de l’humanité. Et pour cause ! Imaginez la planète qui déborde déjà avec 7 milliards d’individus dont les enfants pourraient ne jamais mourir… Là encore, la Secte nous a avertis (par les inscriptions sur les « Georgia Guidestones[13] ») qu’elle avait fixé le seuil maximal de la population mondiale à 500 millions d’individus. Il faut bien éliminer les autres d’ici là, donc 6 milliards 500 millions d’humains.
La Secte espérait bien arriver à ses fins avec la fabrication par les Chinois (et les Français aussi, semble-t-il) d’un virus qui permettrait une belle hécatombe pour commencer. Raté, l’éléphant n’a accouché que d’une souris et la terrible pandémie que d’une grippe à peine plus sévère que les grippes saisonnières. La Secte va-t-elle se rattraper avec l’inoculation d’un pseudo-vaccin OGM[14] bien mortel ? L’avenir nous le dira. En attendant, le premier volet de l’objectif Covid a été pleinement atteint : la soumission de la population planétaire aux injonctions pourtant hautement stupides de la Secte ; mais, d’un mouton, on ne fait pas un loup et d’un imbécile un génie et, comme disait Céline : « J'ai toujours su et compris que les cons sont la majorité, que c'est donc bien forcé qu'ils gagnent ! »
Eyes wide shut et le satanisme
Revenons au dernier film de Kubrick ; le titre est éloquent : les yeux grand fermés ; c’est exactement l’attitude de repli des populations actuellement ; il n’est de pire sourd que celui qui ne veut pas entendre ; les éléments qui viennent à l’encontre du matraquage médiatique concernant cette pseudo-pandémie comme les statistiques officielles prouvant les unes après les autres qu’il n’y a jamais eu d’augmentation du nombre de morts supérieure à la moyenne depuis 1945 ne servent à rien ; les masses ont décidé de ne rien voir, de garder les yeux fermés. Il est plus confortable d’adopter une attitude moutonnière et de faire comme la majorité plutôt que de penser par soi-même, de se faire une opinion et de découvrir que la vérité va à contre-courant de la doxa officielle.

Là encore, la Secte ne cache pas les statistiques ni leur caractère officiel, donc authentique et vérifiable comme si elle savait que rien désormais ne pourrait convaincre les foules que le Covid n’existe pas et n’a jamais existé ; le lavage de cerveau, qui fait croire qu’on peut mourir du Covid alors qu’on meurt d’une comorbidité (ou de vieillesse, ou des deux), s’est avéré d’une totale efficacité sur la quasi-totalité de la population planétaire et l’on reste toujours effaré de constater cette unanimité même si l’on connaît les méthodes employées pour arriver à ce résultat. L’idée m’était même venue (parce que j’aime bien lire des ouvrages de science-fiction) que ce pouvait être avec l’appui (et sur l’injonction) d’autres puissances extérieures à notre monde, plus efficaces que la Secte, mais tout aussi nocives, sinon plus.
En vérité, et pour revenir sur Terre, notre planète, cette technique de propagande (du titre de l’ouvrage d’Edouard Bernez, Propaganda, dont se sont inspirés tous les petits apprentis-dictateurs), a été bien étudiée par Noam Chomsky, Lucien Cerise ou Philippe Bobola qui nous ont expliqué comment fonctionne la « fabrication du consentement » des masses sur le principe de l’hypnose, ce qu’on appelle « l’ingénierie sociale ».
Mais ce titre – et ce film – concernent un autre domaine, moins policé et moins lisse sur le plan esthétique que celui traité par 2001 : l’Odyssée de l’espace, où l’opinion est tout aussi volontairement aveugle et qui constitue l’autre visage de la Secte, encore plus effrayant, et c’est pour cette raison que ce visage est dissimulé dans les plus importantes scènes du film.
Le personnage principal est un médecin dont le rôle est interprété par Tom Cruise, fréquentant la haute bourgeoisie new-yorkaise, qui, par curiosité, se fait inviter à une soirée très spéciale et très fermée – il n’en sait pas plus - où l’on doit se rendre masqué.
Dans ce grand manoir fortement gardé où arrivent de luxueuses limousines, le jeune médecin va se trouver confronté à un spectacle mêlant à la fois la frénésie de scènes orgiaques et la rigueur glaçante d’une cérémonie accompagnée de lugubres mélopées, offrant tous les aspects d’un rite satanique. Le médecin, qui n’a pas reçu d’invitation en bonne et due forme, est démasqué – dans les deux sens du terme - et doit encourir une lourde sanction dont on devine la sévérité ; il est secouru par une jeune femme qui s’offre à sa place en sacrifice et qui sera effectivement retrouvée morte le lendemain d’une overdose.
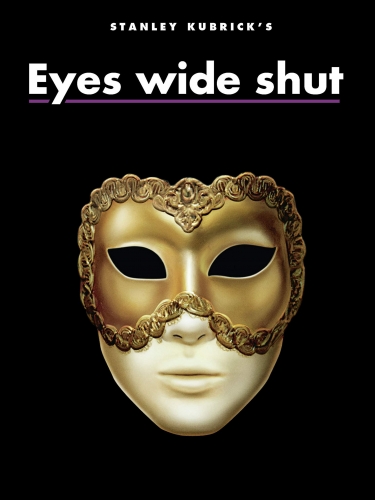
Il raconte sa mésaventure à Ziegler[15], l’organisateur de la soirée qu’il connait bien, puisqu’il est l’un de ses riches patients, mais dont il ignorait le rôle et la présence à la soirée. S’ensuit au cours de cette entrevue un dialogue où Ziegler l’admoneste et lui fait entrevoir le danger auquel il vient d’échapper : « Ecoute, Bill, tu ne sais pas dans quel guêpier tu t’es fourré hier soir. Tu as une idée du monde que tu as côtoyé ? Crois-moi, ces gens ne sont pas n’importe qui ; si je te disais comment ils s’appellent… Je ne vais pas le faire, évidemment, mais si je te le disais, tu n’en dormirais pas de la nuit. »
Drogue, sexe, satanisme, meurtres, magie noire : la Secte. L’affaire Epstein 20 ans avant. Il n’y manque que la pédophilie et les enfants offerts en sacrifice au diable.
Magie kabbalistique et puritanisme biblique : l’alliance de la carpe et du lapin
Mais, pour revenir à la réalité, comment des gens qui ne croient ni à Dieu, ni à diable, participeraient-ils à de telles orgies dont le decorum et les rites semblent inspirés d’une autre époque ? Comment une femme aussi austère que Christine Lagarde qui dirige le FMI peut-elle s’enticher de numérologie[16] ?. On l’entend dans cette vidéo demander à son auditoire de « penser au 7 magique » et prédire en 2014 (guématrie : 7, en additionnant les chiffres) » les 7 années prospères qui vont suivre jusqu’à 2021 », année où « le FMI aura quelque à faire ».
Sans doute, 7 années « prospères » pour les mondialistes et une année 2021 où ils espèrent leur triomphe final, mais une année terrible pour les peuples opprimés par eux.
La secte la plus célèbre et la plus fermée des Etats-Unis a son siège à Yale ; elle a été fondée en 1832 et a accueilli en son sein certains présidents des Etats-Unis, comme la famille Bush ; la secte s’appelle très romantiquement Skull and Bones, crâne et os. Des visiteurs qui se sont introduits par effraction dans le « saint des saints » ont contemplé un décor funèbre : murs tapissés de velours noir ou rouge, pentagramme, une gravure représentant un cercueil et des crânes Tous les ingrédients du parfait petit magicien, genre Harry Potter. On pourrait en sourire si cette caricature de décor de film pour faire peur aux enfants n’était pas prise au sérieux par les individus les plus puissants des Etats-Unis et donc de la planète.

Il est probable que cette mise en scène macabre qui souligne l’attrait des Américains pour le satanisme considéré alors comme une transgression libératrice, trouve ses origines dans celles des Etats-Unis, avant même les pompeux rituels maçonniques, lorsque les premiers puritains chassés d’Angleterre s’installèrent dès 1620 dans le Massachusetts, gens frustes et manichéens n’ayant pour tout repère spirituel que les injonctions bibliques auxquelles ils s’adonnaient dans la plus stricte observance, étouffant les moindres tentatives de liberté de penser et d’indépendance ; c’est dans ce même Massachusetts que, quelques années plus tard, en 1692, éclata l’affaire des « sorcières » de Salem et les procès sordides qui s’ensuivirent qui aboutirent à l’exécution de 14 femmes et 6 hommes.
Nous allons retrouver ce même archaïsme superstitieux dans ce qu’on pensait être l’endroit idéal où s’épanouissait la « modernité », la joie de vivre et la libération des mœurs de cette Amérique coincée : Hollywood.
On se trompait lourdement ; le cinéma américain est tout aussi prude que les premiers pilgrims et il faut s’appeler Kubrick pour oser filmer une paire de fesses ; par contre, l’hémoglobine coule à flots et on s’ingénie à montrer complaisamment et avec force détails tous les massacres, à la tronçonneuse ou avec tout autre ustensile.
Les affaires de sexe ne se traitent pas dans les films, elles se font dans les coulisses et sur les canapés des producteurs ; le répugnant Weinstein sera le premier à tomber sous la charge accusatrice de pas moins de 93 actrices.
Les Américains, dont les pulsions sexuelles étaient refoulées depuis des siècles, s’étaient arrangés autrement depuis longtemps et s’adonnaient secrètement à toutes sortes de perversités, pratiques d’autant plus facilitées qu’ils disposaient d’un solide compte en banque et d’une notoriété suffisante pour décourager les soupçons.
Hollywood et la pédophilie
Mais que peut-on chercher quand on a tout : l’argent, le pouvoir, la gloire ? D’abord, l’immortalité, on l’a vu ; mais après ?
Eh bien, on cherche des dérivatifs à son ennui (surtout s’il doit durer éternellement) , de nouvelles sensations, on cherche à jouer avec ses pairs à qui repoussera toujours plus loin les limites de sa puissance et à transgresser tout ce qui paraît constituer les tabous d’une société qui ne doivent être respectés que par les autres, ceux qu’on paye et qu’on domine.
Et voici qu’on en arrive à la pédophilie, une perversion qui gangrène la totalité de la planète.
Aux USA, le FBI annonce qu’il y a actuellement 1800 enquêtes en cours, qu’une opération datant du mois de janvier de cette année a permis de libérer 33 enfants, que 473 personnes ont été arrêtés l’année dernière pour trafic d’enfants[17].

Hollywood se retrouve encore en première ligne. Un jeune producteur hollywoodien s’est résolu à dénoncer ce dont il a été témoin[18] ; c’était en août 2020.
Et la saga Epstein était déjà passée par là, affaire qui, après celle de Weinstein, libère la parole ; Epstein, cet homme d’affaires milliardaire, agent du Mossad et de la CIA – exactement le même profil que le père de sa compagne Guislaine Maxwell, Robert Maxwell, milliardaire britannique aujourd’hui disparu[19] – filmait les ébats sexuels de ses prestigieux invités avec des jeunes filles mineures ; cela permettait ensuite bien sûr de les faire chanter ; on a répété entre autres les noms des Clinton[20] et du prince Andrew, le fils de la reine Elisabeth ; Epstein sera retrouvé pendu dans sa cellule ; personne ne croit à un suicide, bien sûr ; il est inutile de s’attarder sur cette affaire que tout le monde connaît ; il nous faut juste rappeler que, dans ce grand cercle des puissants, tout le monde se fréquente, investit dans les mêmes entreprises, échange ses partenaires, femmes, filles, fils, maris, se retrouve dans les mêmes clubs sélects, les mêmes plages paradisiaques, les mêmes îles privées, prend les mêmes cocktails dans les mêmes yachts ou les mêmes jets, boit les mêmes coupes de champagne dans les mêmes hôtels particuliers, tous aussi luxueux dans n’importe quelle partie du globe, et participe, in fine, aux mêmes orgies pédo-sataniques sans crainte de se faire prendre en se protégeant les uns les autres.
Guislaine Maxwell est toujours en prison et toujours vivante ; parlera-t-elle ? Rien n’est moins sûr maintenant que ses amis sont au pouvoir en Amérique.
Du marécage new-yorkais au Marais parisien
Epstein avait des liens étroits avec la France, il possédait un bel hôtel particulier à Paris, avenue Foch, Guislaine Maxwell est britannique, mais aussi française (née à Maisons-Laffitte), mais aussi américaine ; l’une de ses sœurs, Christine, spécialisée dans le domaine de l’internet avec sa société Chiliad, s’est installée en France, à Meyreuil, une petite commune limitrophe d’Aix-en-Provence, à la fin des années 1990[21]
Jeffrey Epstein avait un correspondant à Paris, Jean-Luc Brunel-Benchemoul, qui avait créé deux agences de mannequins et qui aurait fourni Epstein en très jeunes filles ; accusé de viol sur mineurs, il a été arrêté par la police française le 17 décembre 2020.
Comme l’Europe et la France ont toujours avalé toutes les turpitudes venant des USA, le courant pédophile a traversé l’Atlantique pour s’installer en France où il semble encore plus actif, et peut-être depuis aussi longtemps qu’aux Etats-Unis.
Tout comme en Amérique aussi, les langues se sont récemment déliées avec le témoignage de nombreuses victimes de pédophiles gravitant dans les hautes sphères du pouvoir politique, médiatique, culturel.
Certains se souviennent de l’affaire du Coral en 1982, un centre éducatif où ont été commis des actes pédophiles ; l’un des protagonistes, qui accusait certaines personnalités du monde politique et littéraire (déjà) est retrouvé mort ; les enquêteurs ont conclu à un suicide (déjà).
En 1996, c’est l’affaire Dutroux en Belgique, en 2003, l’affaire Fourniret, en 2005, l’affaire d’Outreau, en 2007, l’affaire Evrard… mais c’est l’affaire Matzneff, qui va véritablement réveiller l’opinion en 2019 quand elle s’aperçoit que les milieux culturels, politiques et médiatiques étaient depuis toujours très tolérants à l’égard de la pédophilie au point que certains individus invités à l’émission Apostrophes dirigée par Bernard Pivot, comme Daniel Cohn-Bendit ou Gabriel Matzneff, n’hésitaient pas à décrire leurs expériences pédophiles.

Le livre de Vanessa Springora paru en décembre 2019, qui raconte sa relation avec Matzneff alors qu’elle avait 14 ans, jette un pavé dans la mare de la bienpensance ; le livre de Camille Kouchner, fille de Bernard Kouchner et d’Evelyne Pisier, Familia Grande, s’engouffre dans la brèche en dénonçant les agressions sexuelles commises envers son frère Julien par leur beau-père, Olivier Duhamel.
C’est ainsi que l’on reparle de la mort mystérieuse de l’actrice Marie-France Pisier, retrouvée au fond de la piscine de la propriété familiale de Sanary, par la voix de Julien : « Je n'ai jamais cru que ma tante se soit suicidée, mais je ne sais pas comment elle est morte. Ma seule certitude, c'est que toute cette histoire [concernant l'acte de pédophilie] l'a tuée. » Marie-France Pisier s’était élevée, avant sa mort, contre l’apathie de sa soeur à propos des relations connues d’Olivier Duhamel avec son beau-fils ; il se passait de drôles de choses dans cette maison de Sanary où « les jeunes sont offerts aux femmes plus âgées » selon les dires de Camille[22]. Enfin, la dernière qui vient de sortir, le 25 janvier 2020, juste quelques jours après l’affaire Duhamel : l’affaire Richard Berry, un acteur connu, marié à l’époque à Jeane Manson, chanteuse et actrice, accusé par sa fille de l’avoir violée alors qu’elle avait 8 ans ; elle en a 45 aujourd’hui.
Il est fort probable que la liste des plaintes à venir sera longue, en Amérique, en France et ailleurs puisque ces pratiques incestueuses et pédophiles sont habituelles chez les adeptes de la Secte.
Pour conclure, j’aimerais donner un ordre d’idée de ce que pourrait représenter numériquement la Secte sur le plan mondial en prenant arbitrairement comme unité de base l’unité décimale pour simplifier.
Pour une population mondiale de 7 milliards d’individus (où l’on retrouve le chiffre 7) :
En passant rapidement sur le cœur du noyau de la Secte (7, 70, 700, 7000 qui seraient les véritables maîtres du monde) :
Les comploteurs seraient au nombre de 70 000, en y ajoutant les chefs d’Etat, les membres des gouvernements de la planète, les divers membres des clubs secrets déjà cités, les communicants : (journalistes, publicitaires), les grands patrons, les vedettes du showbiz collabos, la jet set, les syndicalistes corrompus… donc en pourcentage sur la totalité de la population planétaire : 0,001 %
Leurs affidés, leurs suiveurs, leurs employés, leur clientèle comme on disait chez les patriciens romains, leurs laquais, grassement payés, auxquels il faut rajouter leurs chiens de garde (leurs milices : police, gendarmerie…) bien dressés, à défaut d’être bien payés : 70 millions, soit 1 % de la population mondiale. Le dissident russe Zinoviev, opérant les mêmes calculs, estimait à quelques 50 millions le nombre de ces employés du Système[23] en 1999.
Les ennemis des comploteurs seraient les complotistes, selon la qualification des comploteurs. Nous reprendrons les mêmes chiffres, pour être à égalité. 70 000 résistants, lanceurs d’alertes, écrivains, journalistes, blogueurs, influenceurs qui ont analysé les intentions malfaisantes de la Secte bien avant le début de leur application, soit 0,001 %.
Les hommes et les femmes de bon sens, qui sont passé au travers du nuage toxique qui se diffuse principalement par hypnose (ingénierie sociale) en allumant la télévision (publicité, infos, images subliminales) ou la radio (publicité, infos, sons subliminaux) ; estimons donc cette population lucide et en bonne santé mentale à 70 millions d’individus, soit : 1 % de la population mondiale.

Et puis, vient le troupeau inconscient qui a suivi les joueurs de flûte sans se poser de questions, qui le conduisent à l’abîme où il se jettera massivement. Les bons toutous muselés et décérébrés respectant les gestes-barrières (pas de barrières le long du précipice, la Secte a oublié d’en disposer) sont au nombre de 6 milliards 859 millions et des poussières, soit 98,998 % et des poussières.
En ramenant tous ces chiffres à la France, en supposant qu’elle contient 70 millions d’habitants, donc 1% de la population mondiale, nous obtenons 700 sectateurs comploteurs, 700 000 affidés, 700 résistants dits « complotistes », 700 000 personnes avec un cerveau en état de marche, et 68 millions 589 000 moutons lobotomisés.
L’objectif souhaité de 500 millions de survivants au maximum recommandé par les Georgia Guidestones sera largement atteint si rien ne change d’ici la fin.
Chapeau ! Rideau !
Pierre-Emile Blairon
Notes:
[1] Parmi tant d’autres exemples, Emmanuel Macron est Young Leader, ainsi que celui qui lui a servi de Premier ministre, Edouard Philippe.
[2] https://www.valeursactuelles.com/societe/onze-ministres-d...?
[3][3] Qui fait des émules en apparaissant mystérieusement un peu partout sur la planète Terre depuis 2019.
https://www.businessinsider.fr/ce-que-lon-sait-des-myster...
[4] https://www.premiere.fr/Cinema/Stanley-Kubrick-revele-le-sens-de-la-fin-de-2001-L-Odyssee-de-l-espace-dans-une-interview.
[5] Pour l’anecdote, 2001 : L’Odyssée de l’espace a été réalisé en 1968 ; le 21 juillet 1969, l’Homme (américain) marchait sur la Lune pour la première fois. Dans une vidéo que vous trouverez ci-après, diffusée par les Inrocks, qui aurait été tournée 3 jours avant sa mort, Stanley Kubrick disait que les Américains n’étaient jamais allés sur la Lune et que les images du prétendu alunissage ont été tournées par lui sur Terre sur commande des autorités américaines en compétition avec les Russes pour la maîtrise de l’espace à l’époque. Selon l’article des Inrocks qui accompagne ces images (et selon tous les medias mainstream), la vidéo en question est un faux (Moon hoax) et c’est un acteur qui tient le rôle de Kubrick ; je n’ai pas trouvé de réponses aux questions que je me pose mais elles existent peut-être : quel est le nom de cet acteur ? D’autre part, en 2021, les techniques de reconnaissance faciale et vocale sont suffisamment sûres pour permettre l’accès à des sites sensibles ; quelle est la société maîtrisant ces techniques qui a déterminé que l’homme qui parle dans cette vidéo ne peut pas être Kubrick ? https://www.lesinrocks.com/2019/03/08/cinema/actualite-ci...
[6] Il est toujours bon de le préciser car on assimile souvent le nom du créateur à sa créature.
[7] https://www.lesechos.fr/politique-societe/politique/ces-affaires-qui-ternissent-le-quinquennat-macron-138374
[8] Voir mon livre La Roue et le sablier, p. 263.
[9] Id. p.259.
[10] Voir mon article Objectif Covid : soumission et robotisation de la population planétaire, Nice Provence infos
[11] Laurent Alexandre, La Mort de la mort, éditions JC Lattès
[12] Voir La Roue et le sablier, p.265
[13] La Roue et le sablier, p 267
[14] Sacré avantage quand même pour ceux qui se feront vacciner : plus la peine de regarder les étiquettes dans les supermarchés pour savoir si le produit que vous achetez comporte des OGM ; les OGM sont déjà inclus : c’est vous !
[15] Interprété par le cinéaste Sidney Pollack, réalisateur de plusieurs chefs-d’œuvre, dont Jeremiah Johnson et Out of Africa.
[16] https://www.youtube.com/watch?v=cU6kwbHArYo
[17] https://exoportail.com/usa-33-enfants-disparus-retrouves-lors-dune-operation-de-lutte-contre-la-traite-detres-humains/?
[18] https://www.youtube.com/watch?v=TBb4HKQsn9w&fbclid=IwAR1iaz4-J3RgBg0fHdNTTlJL3jhwsT-CSnZFTfrkXHz9KKlJW_DpZL897Gw
[19] Mort mystérieuse, car cet excellent marin serait tombé de son yacht… en pissant par-dessus bord. Je n’ai pas compté le nombre de morts mystérieuses évoquées dans cet article.
[20] Le couple Clinton étant lui-même impliqué dans une affaire de pédophilie, le fameux « pizzagate ».
[21] https://www.thedailybeast.com/ghislaine-maxwell-where-in-the-world-is-jeffrey-epsteins-girlfriend
« Her older sister, Christine Malina-Maxwell, has a home in Meyreuil, a semi-rural village about 8 miles from Aix-en-Provence » (Daily Beast)
[22] https://fr.news.yahoo.com/affaire-olivier-duhamel-sc%C3%A8nes-sordides-210414631.html
[23] La Roue et le sablier, p.208.

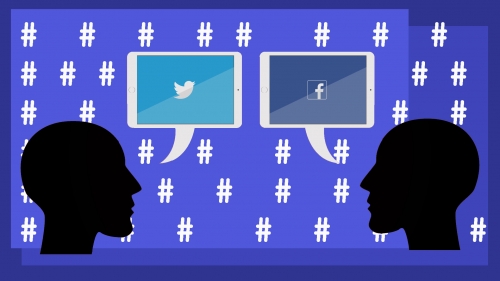





 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg




 Ainsi s’exprime le représentant du transhumanisme en France, Laurent Alexandre, dans son livre dont le titre ne prête à aucune ambiguïté : La Mort de la mort
Ainsi s’exprime le représentant du transhumanisme en France, Laurent Alexandre, dans son livre dont le titre ne prête à aucune ambiguïté : La Mort de la mort
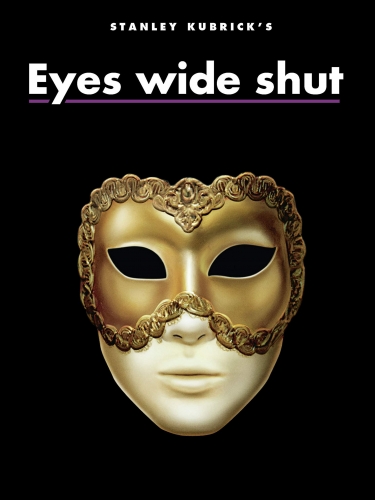













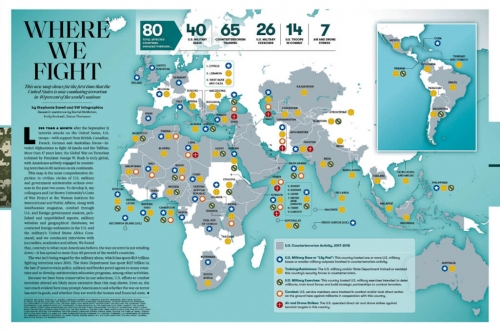
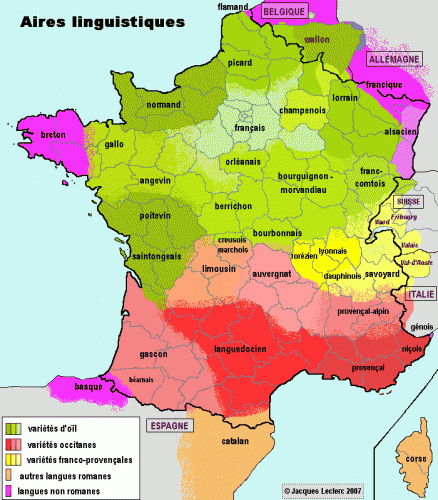













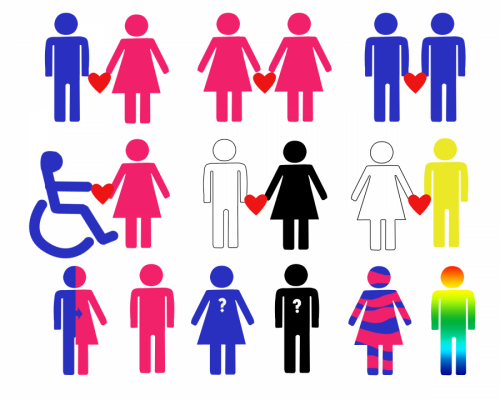

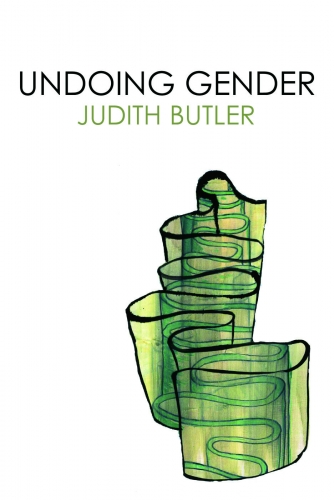





 Un monde entièrement virtuel, qui représente le rêve de ceux qui considèrent l'homme comme quelque chose d'obsolète et de dépassé, quelque chose qui doit être manipulé et perfectionné, un rêve (ou plutôt un cauchemar) également cultivé à des époques non soupçonnées : de fait, déjà à la fin des années 70, la féministe américaine Ti-Grace Atkinson (photo) écrivait : "l'acte sexuel ne devrait plus être le moyen utilisé par la société pour renouveler la population. Et les recherches sur l'utérus artificiel, la fécondation in vitro, le "mind uploading" et autres merveilles du techno-capitalisme, nous permettent de créer un modèle de société dans lequel il n'y a plus de place pour l'homme tel que nous l'avons connu. Un rêve, en dernière analyse, de mort, et qui risque de plonger le monde entier dans un cupio dissolvi incurable (ndt : un désir morbide de dissolution incurable).
Un monde entièrement virtuel, qui représente le rêve de ceux qui considèrent l'homme comme quelque chose d'obsolète et de dépassé, quelque chose qui doit être manipulé et perfectionné, un rêve (ou plutôt un cauchemar) également cultivé à des époques non soupçonnées : de fait, déjà à la fin des années 70, la féministe américaine Ti-Grace Atkinson (photo) écrivait : "l'acte sexuel ne devrait plus être le moyen utilisé par la société pour renouveler la population. Et les recherches sur l'utérus artificiel, la fécondation in vitro, le "mind uploading" et autres merveilles du techno-capitalisme, nous permettent de créer un modèle de société dans lequel il n'y a plus de place pour l'homme tel que nous l'avons connu. Un rêve, en dernière analyse, de mort, et qui risque de plonger le monde entier dans un cupio dissolvi incurable (ndt : un désir morbide de dissolution incurable).

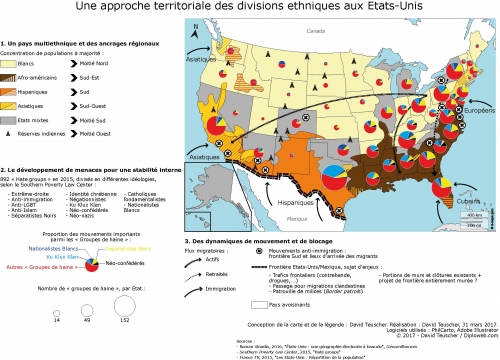
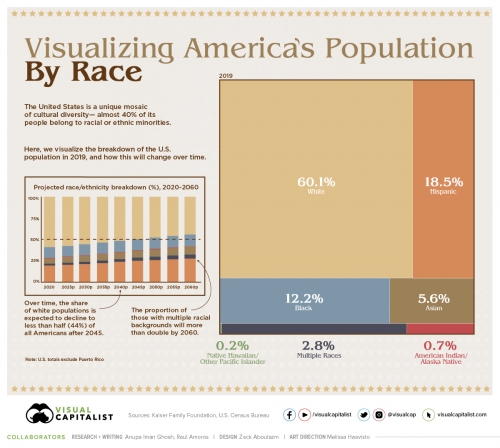




 On peut d’ailleurs leur retourner le compliment. Il suffit d’entendre, pour ceux qui en ont encore le courage, leur lancinante logorrhée, pour se demander si ce ne sont pas eux, les chasseurs de fake news, qui sont les protagonistes essentiels d’une authentique « complosphère »
On peut d’ailleurs leur retourner le compliment. Il suffit d’entendre, pour ceux qui en ont encore le courage, leur lancinante logorrhée, pour se demander si ce ne sont pas eux, les chasseurs de fake news, qui sont les protagonistes essentiels d’une authentique « complosphère »

 Il est une heureuse expression que l’on doit à l’universitaire et homme politique Pierre-Paul Royer-Collard (1763 – 1845) qu’il est utile de rappeler de nos jours. C’est ainsi qu’il oppose « le pays légal au pays réel ». Par après cette opposition a été reprise, diversement, par Auguste Comte ou Charles Maurras. Mais elle a l’heur de nous rappeler que parfois, il existe un divorce flagrant qui oppose la puissance populaire, puissance instituante, au pouvoir officiel et institué. C’est ce qui permet de saisir la lumière intérieure du bon sens populaire. C’est ce qui permet de comprendre qu’au-delà de la décomposition d’une société peut exister une renaissance. C’est cette métamorphose qui est en cours. Et au-delà de la soumission induite par la protection, c’est dans le « pays réel » que se préparent les soulèvements fondateurs d’une autre manière d ‘être ensemble.
Il est une heureuse expression que l’on doit à l’universitaire et homme politique Pierre-Paul Royer-Collard (1763 – 1845) qu’il est utile de rappeler de nos jours. C’est ainsi qu’il oppose « le pays légal au pays réel ». Par après cette opposition a été reprise, diversement, par Auguste Comte ou Charles Maurras. Mais elle a l’heur de nous rappeler que parfois, il existe un divorce flagrant qui oppose la puissance populaire, puissance instituante, au pouvoir officiel et institué. C’est ce qui permet de saisir la lumière intérieure du bon sens populaire. C’est ce qui permet de comprendre qu’au-delà de la décomposition d’une société peut exister une renaissance. C’est cette métamorphose qui est en cours. Et au-delà de la soumission induite par la protection, c’est dans le « pays réel » que se préparent les soulèvements fondateurs d’une autre manière d ‘être ensemble.