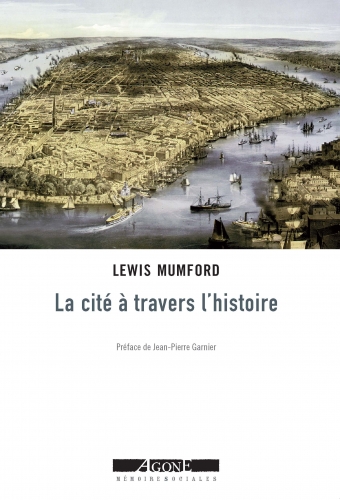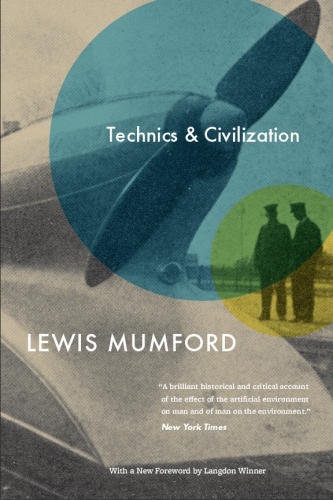Emmanuel Todd
Lineages of Modernity: A History of Humanity from the Stone Age to Homo Americanus
Cambridge, England, and Medford, MA: Polity Press, 2019
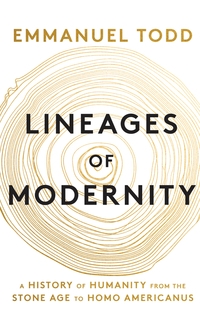 Much of today’s dominant globalist ideology derives from development theory, a body of thought which shares with Marxism the view that economic relations are the basis of social life and sees the races of mankind as fundamentally equivalent beneath the superficial cultural differences which have arisen over history. Human societies everywhere naturally develop from the hunter-gatherer stage to pastoralism, then to settled agriculture, and eventually to modern industrial civilization and “democracy” — the final stage, or at least the highest yet attained. Francis Fukuyama aptly characterized the development theorists’ dream as “getting to Denmark” — a world wherein all nations gradually converge on the model of a prosperous, stable, secure nation of the northern European type. But development occurs at different tempos in different places, with the result that some countries remain “undeveloped” (or, more euphemistically, still “developing”) while others have already reached the highest stage. Those in the vanguard of progress, mainly European-descended peoples, can help the rest develop by means of expertly managed international programs. Not the least important function of development theory, accordingly, is to justify prestige and rewards for a class of globe-trotting program administrators. Yet the world stubbornly refuses to evolve as globalist ideology foresees; plenty of differences remain intractable.
Much of today’s dominant globalist ideology derives from development theory, a body of thought which shares with Marxism the view that economic relations are the basis of social life and sees the races of mankind as fundamentally equivalent beneath the superficial cultural differences which have arisen over history. Human societies everywhere naturally develop from the hunter-gatherer stage to pastoralism, then to settled agriculture, and eventually to modern industrial civilization and “democracy” — the final stage, or at least the highest yet attained. Francis Fukuyama aptly characterized the development theorists’ dream as “getting to Denmark” — a world wherein all nations gradually converge on the model of a prosperous, stable, secure nation of the northern European type. But development occurs at different tempos in different places, with the result that some countries remain “undeveloped” (or, more euphemistically, still “developing”) while others have already reached the highest stage. Those in the vanguard of progress, mainly European-descended peoples, can help the rest develop by means of expertly managed international programs. Not the least important function of development theory, accordingly, is to justify prestige and rewards for a class of globe-trotting program administrators. Yet the world stubbornly refuses to evolve as globalist ideology foresees; plenty of differences remain intractable.
Emmanuel Todd is an anthropologist and demographer who focuses on family systems, an unusual but sometimes enlightening perspective to bring to historical and political questions. In the early 1980s, for example, he pointed out the connection between Leninist communism and a particular kind of peasant family pattern:
. . . a form that combined a father with his married sons, authoritarian as regards the relations between parents and children, egalitarian in the relations between brothers. Authority and equality, indeed, represent the hard core of communist ideology, and the coincidence between family and ideology was not difficult to explain. It resulted from a sequence at once historical and anthropological: urbanization and literacy broke down the communal peasant family; the latter, once it has disintegrated, releases into general social life its values of authority and equality; individuals emancipated from paternal constraint seek a substitute for their family servitude in fidelity to a single party, in integration by the centralized economy.
Todd found this pattern not only in Russia, China, and Vietnam, but also in Serbia (the backbone of Yugoslav communism) and north-central Italy (the region which voted heavily communist in the 1970s). In countries with different family systems — including Poland, the Czech lands, Slovenia and most of Croatia — communism is only likely to prevail for as long as it is imposed by an outside power. I thought I knew a fair amount about communism, but this was new to me.
Deep History
Todd advocates a three-level perspective on the history of nations, with change proceeding at a different pace on each level. At the conscious level we find war, politics, and economic policy. History often proceeds very quickly at this top level. At the subconscious level we find major educational changes such as the spread of basic literacy, which began in Germany with the Protestant Reformation and which Todd expects to reach its completion around the world within the next generation, i.e., over a period of about five hundred years. At the deepest, unconscious level we find religion and family structures, which change even more slowly. The economistic thinking characteristic of globalist ideology mistakes the most superficial level for the most fundamental.
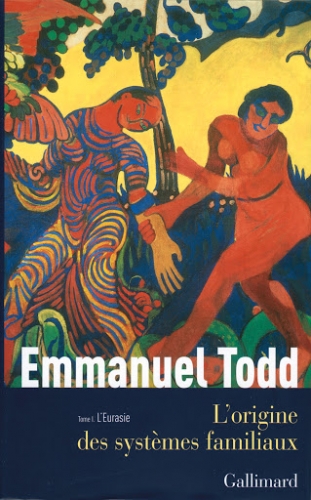 In previous works, Todd has demonstrated that even in fully secularized societies, the religious beliefs of the past continue to influence thinking on an unconscious level. He has, for example, described a “zombie Catholicism” which must be taken into account if one wishes to understand social behavior in the French provinces today. In this work, he finds an analogous “zombie Protestantism” useful for understanding the educational and economic effectiveness of Scandinavia. Furthermore, as he notes,
In previous works, Todd has demonstrated that even in fully secularized societies, the religious beliefs of the past continue to influence thinking on an unconscious level. He has, for example, described a “zombie Catholicism” which must be taken into account if one wishes to understand social behavior in the French provinces today. In this work, he finds an analogous “zombie Protestantism” useful for understanding the educational and economic effectiveness of Scandinavia. Furthermore, as he notes,
It is usually difficult to completely separate family systems from religious systems. Religion generally has something to say about sexuality and marriage, the status of women, the authority of parents, and the equality or inequality of brothers.
Regarding family structure, Todd proposes a model of historical development according to which families tend to become increasingly patrilineal over time,
from the undifferentiated nuclear family (level 0 patrilineality) to the stem family (level 1 patrilineality), then from the stem family to the exogamous communitarian family (level 2 patrilineality), and finally to the endogamous communitarian family (level 3 patrilineality).
It is important to understand that this is not simply a development from worse to better. The higher levels must, indeed, have some advantage over the lower; otherwise, it would be difficult to explain why they developed. But Todd stresses that the more primitive types also have advantages that get sacrificed along the way. The modern economic powerhouses treated as universally normative by development theorists, for example, tend to have what are historically and anthropologically more “primitive” family patterns, while the communitarian family practicing cousin marriage and sequestering its women is the most complex and sophisticated arrangement. Globalists mystified that economically backward Islamic societies do not simply abandon cousin marriage and embrace “modern, progressive” sexual and family norms are in effect expecting several thousand years of historical development to go suddenly into reverse.
The Original Human Family
Early on, Todd offers a description of the original anthropological system of humanity, the “undifferentiated nuclear family,” as an ideal type:
The family is nuclear, albeit without dogmatism — young couples or elderly parents can be temporarily added to it. Women’s status is high. The kinship system is bilateral, giving the mother’s and father’s kin equal places in the child’s world. Marriage is exogamous, but again without dogmatism [i.e., there is no formal prohibition against consanguineous marriage]. Divorce is possible. Polygyny too, and sometimes even, although more rarely, polyandry. Interactions between the families of brothers and sisters are frequent and structure local groups. No relationship is completely stable. Families and individuals can separate and regroup. There are two levels of aggregation above the family:
1. Several nuclear families, most often related, constitute a mobile group.
2. These groups exchange spouses with each other within a territory comprising perhaps a thousand individuals.
Such a primordial human society is fairly tolerant of occasional homosexual or other non-reproductive sexual behavior, but this remains marginal.
Todd’s general descriptor for such flexible arrangements is “undifferentiated.” As he notes, anthropologists have used this term “to describe kinship systems that are neither patrilineal nor matrilineal, but leave individuals free to use paternal and maternal filiations pragmatically.” Todd himself extends the concept “to all elements of the family structure that have not been polarized in the course of history by a stable dichotomous choice.” Todd believes the original undifferentiated family type was universal among Homo sapiens before the rise of cities and writing in ancient Sumer about 5000 years ago.
A family system is undifferentiated in regard to co-residence of generations, e.g., where it occurs temporarily according to convenience without being evaluated either positively (as in the Russian or Chinese peasant family) or negatively (as often in the Anglo-Saxon world). Undifferentiated inheritance is regulated neither in an egalitarian nor an inegalitarian (e.g., with primogeniture) spirit. Polygyny below about the ten percent threshold may be considered undifferentiated; both socially enforced monogamy and polygyny above fifteen percent indicate differentiation. Both the formal prohibition against cousin marriage (as in Christendom) and cousin marriage as a normative ideal (as in the Arab-Persian world) indicate differentiation.
Reading History in Space
If we look at a map of Eurasian family patterns today, we find that the more central regions display greater patrilineal development, while simpler systems (which also involve a higher status for women) survive on the peripheries. To explain this, the author appeals to a once commonplace linguistic and anthropological interpretive principle that fell out of fashion with the rise of structuralism after the Second World War: the conservatism of peripheral areas.
This powerful explanatory hypothesis makes it possible to read history in space: the most archaic forms (linguistic, architectural, culinary or family) survive on the periphery of cultural spaces. . . . If a characteristic A distinguishes several pockets placed on the periphery of a characteristic B that covers a continuous central space, we can suppose that A represents the ancient characteristic, and B a central innovation that has spread to the periphery without completely submerging it. The greater the number of residual pockets, the more certain we can be of our interpretation.
This is what we find with family patterns on the Eurasian landmass. The Arab-Persian world, Northern India, and China are the classic settings of the Communitarian Family. Northwest Russia shows this type as well, albeit without endogamy and only dating back to the seventeenth century.
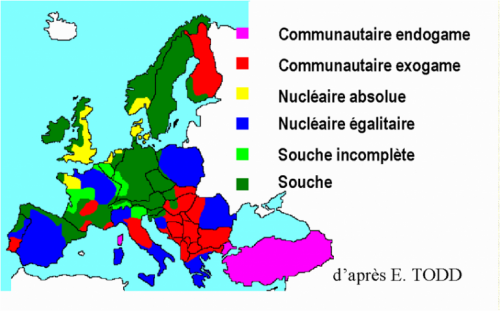
The nuclear family model survives in much of Western Europe. In Northeast Asia, it can still be found among relict native Siberian populations such as the Chukchi, as well as the Ainu of northern Japan. On the fringes of South Asia, it survives in Sri Lanka and among the natives of the Andaman Islands as well as the Christians of Southwest India. And it characterizes much of Southeast Asia, including Indonesia and the Philippine Islands. As Todd remarks: “Geography here provides us with the key to history. We can read the effects of time directly in space; we can see the patrilineal shift transforming the shape of the family, moving in waves toward a periphery that is never reached.”
The Differentiated Nuclear Family: England
It is important to note, however, that the nuclear family, where it has survived, has not remained undifferentiated; it now represents a “stable dichotomous choice.” In Europe, as Todd writes, the primordial patterns were “regulated rather than abolished by the Christian conception of sex and marriage.” In Christian England, e.g., undifferentiated de facto monogamy (with polygyny at the margins) was replaced by socially enforced and indissoluble monogamy: the covenantal marriage. Consanguineous marriage was not tolerated; neither were homosexuality or other nonreproductive forms of sex.
Lateral bonds between adult siblings lost all economic functionality. The three-generation household came to be frowned upon: young couples were required to establish their own households at marriage. This had the disadvantage of making it harder to care for the elderly and infirm. To meet the difficulty, the English Poor Laws of 1598 and 1601 required parishes to levy taxes for their support.
A sample of twenty communities, a picture of which can be formed from the parish register and the poor register combined, means we can study 110,000 pensions payments between 1660 and 1740. Statistical analysis reveals that 5 per cent of the population received a weekly pension, a figure that rose to 8 or 9 per cent in the city and 40-45 per cent for the over-sixties. For the latter, the average level of pension corresponded to the wages of a farm worker.
As the author notes, these facts contradict the “textbook commonplace” that Bismarck’s Germany pioneered social security.
Parents were left free to bequeath their property as they saw fit, a system neither egalitarian nor distinctly inegalitarian. English society also came to be characterized by extreme mobility: “Children moved as servants between large farms while still very young. Even the sons of better-off peasants were sent elsewhere as servants under the practice of ‘sending out.’”
Todd calls this system the absolute nuclear family; it was fully formed (=differentiated) by about the mid-seventeenth century. Apart from England, something broadly similar is found in Denmark, Southeast Norway (the Oslofjord), the Protestant and coastal parts of the Netherlands, as well as Upper Brittany in France.
Chaucer’s England was a land of about three million souls on the edge of a Eurasian continent with a population of about 300 million. Many historians have wondered that so tiny a country on the fringe of civilization went on to shape the modern world more than any other. Todd eventually came to the conclusion that England’s peripheral location and the anthropological backwardness that went with it were the secret of its success:
Its dynamism, and even more so that of [its offspring] America, is the dynamism of the original Homo sapiens. Elsewhere, successive civilizations have had time to imprison themselves in complex constructions that are liable to paralyze human creativity.
Encouraging the autonomy of children, the absolute nuclear family fosters individualism and allows major breaks between generations. These were anthropological preconditions for the industrial revolution, which uprooted much of the English peasantry within just a few decades. So there is a definite association between economic progress and anthropological “backwardness.” Todd devotes a chapter to demonstrating that democracy (or, perhaps better, participatory government) is primordial as well: “the rise of complex family forms corresponds to the rise of authoritarian political forms.”
The Stem Family and Literacy: Germany
Given the advantages of the nuclear family, one may ask why it was ever superseded. The answer is that in the preindustrial world wealth derives mostly from the possession of land, and as population increases, land eventually becomes scarce. If a farmer has many children and divides his land between them, the plots will eventually become too small to support new families. To avoid such a result, primogeniture is instituted:
Male primogeniture makes it possible to transmit real estate without dividing it. The emergence of a densely settled rural world crowned by a political system that controls the whole of the regional space, is the basic condition for it to emerge. As long as there are new lands to be conquered, the emigration of children when they reach adulthood renders the privilege of the eldest useless. When land becomes scarce, this privilege may appear. The stem family then develops as a logical consequence of primogeniture: the choice of a single heir gradually leads to the co-residence of two adult generations.

Primogeniture and the stem family represent the first stage of patrilineality and, as compared to the nuclear family, tend to promote the values of authority and inequality. Younger sons must find their own way in the world.
Historically, this pattern first emerged from the undifferentiated nuclear family in Sumer not long after the invention of writing in 3300 BC. Skipping over antiquity, primogeniture arose in European history toward the end of the Carolingian period, with the founding of France’s Capetian monarchy among its first consequences. The institution subsequently spread through Europe’s aristocracy from the eleventh century. It arrived in England with the Conquest, but there remained the preserve of aristocrats. Yet primogeniture also emerged independently in peasant communities in Germany and Southern France beginning in the thirteenth century, also from a scarcity of land. Todd mentions that the German aristocracy distinguished itself from commoners by their practice of egalitarian inheritance — the reverse of the pattern in England.
The stem family was an essential component of a triple revolution that began in Germany and which, in Todd’s view, represents that nation’s single most important contribution to European and world civilization. The other two components of this revolution were Protestantism and universal literacy.
The author points out a commonality between primogeniture and writing: they both serve the purpose of transmission:
Writing is, in essence, a knowledge-fixing technique that allows human society to escape the uncertainty of oral transmission of memory. Primogeniture, with the stem family that ultimately stems from it, is also a technique of transmission: it transmits the monarchical state, the fief, peasant farming, the artisan’s stall and, at a deeper level, all the techniques that accompany these elements of social structures.
The gradual development of the stem family in Germany can be traced in the historical record between the fourteenth and eighteenth centuries. In about 1454, printing with moveable type was invented by the German Gutenberg, leading to a drastic reduction in the cost of reproducing texts. After 1517, Martin Luther launched the Protestant Reformation which, from the beginning, “sought to establish, for each human being, a personal dialogue with God, without the mediation of the priest.” This meant that responsibility for religious instruction passed to fathers:
Luther’s Little Catechism, the first vehicle of the Protestant educational offensive, displays, right from the start, an unambiguous patriarchal familialism: “The Ten Commandments or the Decalogue, Such as a father of a family must teach them with simplicity to his children and his servants.” It is easy to see how the father’s authority would be reinforced by his new religious role in the family.
Todd even asserts a fundamental connection between the stem family and the specifically theological content of Protestantism:
The mechanism that leads from family organization to religious system is simple; primogeniture comes with a high level of authority in the father; it defines a son who is chosen and other children who are rejected. In such a domestic context, a theological system that affirms that the Everlasting predestines a minority to salvation and the rest of humankind to damnation can appear quite simply as normal. It should be noted that when Protestantism spread from stem-family areas toward regions where the absolute nuclear family dominated, its dogma of predestination eventually collapsed.
As is well-known, the reformation focused on making the Bible available to ordinary people in their national vernaculars. At first, this occurred principally through church services and sermons, but in the course of the seventeenth century, literacy and Bible reading began gaining ground among the masses. By 1700, an estimated 35-45 percent of the population of Protestant Europe could read. This was something new in world history: in the Graeco-Roman world, according to the most careful modern estimates, male literacy rarely exceeded twenty percent anywhere.
The Great European Mental Transformation
One of Todd’s best chapters is devoted to “The Great European Mental Transformation” which resulted from the spread of literacy:
We would be wrong to see learning to read as merely the acquisition of a technique. We are now beginning to measure the enlargement of the brain function induced by an intensive and early use of reading. Reading creates a new person. It changes one’s relationship to the world. It allows a more complex inner life and achieves a transformation of the personality.
According to sociologist David Riesman (The Lonely Crowd, 1950), reading provides the old human personality regulated by custom with a new type of internal guidance system; he may have been getting at something like the anthropological distinction between shame and guilt cultures. More specifically, Riesman writes: “The inner-directed man often develops a character structure which drives him to work longer hours and to live on lower budgets of leisure and laxity than would have been deemed possible before.” Hence, the Protestant work ethic. The spread of literacy also coincided with a significant fall in private violence.
Such self-discipline also carried over into the realm of sex. Historical research into marriage in Protestant countries during the early modern period reveals both a notable increase in age at first marriage and a larger number of permanently unmarried people. In the author’s view, it was Protestantism that finally fulfilled “the old project of sexual abstinence developed more than a thousand years [before] by the Fathers of the Church.” In the Middle Ages, disciplined celibate religiosity had been the preserve of monastic specialists — religious virtuosos, as Max Weber called them — while the surrounding society remained “bawdy and violent.” Protestantism did not so much abolish the priesthood as clericalize the laity. An important result was lowered population pressure which, combined with the industrial revolution, allowed for an unprecedented accumulation of wealth and rise in living standards.

Todd speaks of a Protestant personality profile: “turned in on itself, predisposed by its morality (sexual or otherwise) to feelings of guilt, to leading an honest and upright life, an essentially active life turned towards study and work.” But he also notes that the Protestant surplus of interiority was compensated by a greater community and state hold over the individual: “The concrete life of Protestant communities, from the seventeenth to the nineteenth century at least, also displays an incredible strengthening of the local group and its ability to control the lives of individuals. The Reformation resulted in a reinforced surveillance of manners.” These are the “moral communities” which Kevin MacDonald has written about as substitutes for the kinship group in individualistic societies.
This era was also characterized by such negative phenomena as religious hatreds, the rise of absolutism, and a recrudescence of war: “the price to be paid for the internal pacification of behavior was a collective reorientation of violence.” Stem family Protestant countries in which younger sons had to fend for themselves pioneered standing armies and militarism. Louis XIV is generally considered a warlike king, but at their height in 1710, his forces enrolled only 1.5 percent of Catholic France’s population. Around the same time, the Swedish Empire of Charles XII was employing 7.7 percent of its population in the military. By 1760, 7.1 percent of Prussia, that “army with a country attached,” was in uniform. Hesse, whose soldiers made up the bulk of British forces during the American War of Independence, practiced a mercenary militarism with the goal of increasing state revenue; by 1782 they had matched the Swedish figure of 7.7 percent of the population under arms. In some stem family Protestant countries, younger sons were automatically enlisted upon coming of age.
It remains to speak of the relation of the stem family to the industrial revolution which, as we have seen, was pioneered by a nation with an absolute nuclear family. Firstly, we should mention that literacy is the single most important factor in industrialization, and we have seen that the ideal of universal literacy was one third of a revolution whose other aspects were the stem family and Protestantism.
But the stem family, being essentially a system of transmission, also has a certain conservative tendency. We find such areas resisting industrialism for a time:
A society based on the accumulation of what has been acquired is endowed with the capacity for making any progress that does not entail a radical change in its methods and objectives. For example, it will be more difficult to transform rural people into urban people, artisans into factory workers, or nobles into entrepreneurs. The uprooting and transformation of all these actors can only be brought about under external pressure, and at the cost of great pain.
Of course, the rise of Britain did put pressure on other European nations. The most important stem family nation, Germany, experienced a delayed and highly disruptive transition to industrial capitalism. Once that transformation had occurred, however, the stem family acted as an accelerant: by the beginning of the twentieth century, Germany had actually overtaken Great Britain economically. We might also mention that Japan, a stem family society on the opposite side of Eurasia, went through a similar process during the Meiji period.
Secularization and Ideological Crisis
Another central tendency of the modern era on which light can be shed by the study of family structures and the spread of literacy is secularization. At first, of course, the Protestant Reformation amounted to a religious revival, as did the Catholic Counter-Reformation. Todd, however, interprets puritanism — a kind of radicalized Protestantism — as a “stiffening of the faith” which marks “a step on the path to secularization.”
It was the Paris Basin of Northern France which witnessed “the first religious collapse of a ‘sociological’ magnitude.” Between 1730 and 1740, the recruitment of priests collapsed. Subsequently, both religious observance and the birth rate declined among the masses of Northern France. This process was complete well before the French Revolution.
The family structure of the Paris Basin is an egalitarian variant of the nuclear family wherein parents are expected to divide their property equally between all children. Unlike in the stem family areas,
there was no strong image of the father to prop up the image of God; and there was no inequality between children to justify inequality between the priest and the ordinary person. In such an environment, the shock of rationalism was not cushioned by a deeply rooted belief. In fact, the principle of equality. . . seemed destined to call into question the belief in a superior being of any kind — father, king, or God.
The French Revolution was the result of a long development involving the spread of literacy, secularization, and falling birth rates, as France’s Annales historical school has uncovered.
Although France was the most historically important center of this first wave of secularization, it also affected other areas with a similar family structure:
In Southern Europe, with its egalitarian nuclear families, literacy at this time affected only the urban world, which around the middle of the eighteenth century lay outside the grip of the Church. Because the cities were feeding the countryside with a flow of religious personal, which then dried up, [not only] the Paris Basin [but also] Andalusia and southern Italy entered this new phase . . . [of] secularization.
The apostasy of these egalitarian areas strongly affected the Catholicism which survived into the nineteenth century, largely dependent on stem family regions: the church became a bastion of hierarchy and respect for every sort of authority. As the author notes, this mentality is far removed from that of early Christianity in the Late Roman Empire.
The second round of European secularization occurred in the Protestant lands beginning in the late nineteenth century:
In Calvinist and Lutheran Europe, secularization did not begin until the publication of The Origin of Species. The subsequent collapse was a brutal affair in a world heavily dependent on a literal interpretation of the Bible. Between 1870 and 1930, throughout Northwest and Northern Europe, the recruitment of Protestant pastors collapsed. Secularization was finally hitting the most educated part of the continent. It opened up a phase of maximum ideological instability.
Generalizing from the work of the Annales school, Todd proposes a regular pattern of historical development running from literacy to secularization to a declining birth rate to an ideological crisis and revolution. The ideological crisis which followed the collapse of Protestantism in Germany was not, however, the rise of socialism, heir apparent of France’s revolution:
Socialism took an essentially reformist and reasonable form . . . in Protestant Europe. It was the rise of nationalism that eventually dragged the continent into the conflagration of the First World War. It is obvious that the epicenter of the ideological and mental crisis lay in Germany.
National Socialism was also, in Todd’s view, a consequence of the crisis of German Protestantism. Support for the NSDAP always remained weak in Catholic areas of Germany, despite the party’s Bavarian origins. The author dismisses explanations that focus excessively on the Great Depression as a product of superficial economistic thinking. The deeply authoritarian yet non-egalitarian character of National Socialist ideology Todd explains by Germany’s stem family structure, so different from the egalitarian nuclear family system of Northern France (as well as the egalitarian communal family of Russia).
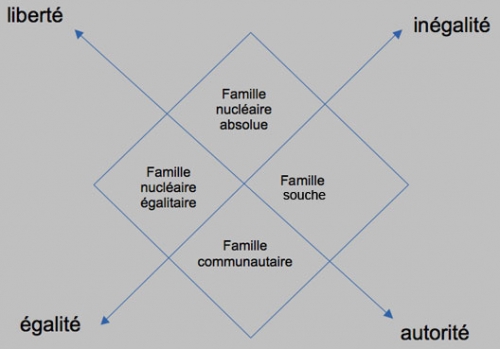
The Memory of Places
The family forms Todd discusses all arose before industrialization, and in a sense clearly belong to the past: there are no more three-generation households in Berlin today than there are in London; fathers do not co-reside with the families of all their grown sons in today’s Moscow any more than in the US. Nuclear households characterize these formerly stem- and communal-family areas no less than the Anglo-Saxon world. Might this represent a “convergence” such as globalists dream of?
Todd does not believe so. He stresses the distinction between
the family system — i.e., a set of values organizing the relationships between men and women, between parents and children, between brothers and sister — and the domestic group as can be seen in the census. It is quite conceivable that a system of values may survive the disintegration of the domestic group in which it was embodied in the peasant era. The nuclearization of households does not necessarily imply that of mentalities.
Mentalities can prove astonishingly stable even amid radical social change. An important example is the persistence of regional cultures. In 2013, Todd and the demographer and historian Hervé Le Bras collaborated on a book documenting
the perpetuation, across 550,000 square kilometers of France, of different systems of customs and manners in most recent times. Despite the acceleration of internal migration, despite the disappearance of complex households and the collapse of Catholicism, regional heterogeneity persists. Homogenization, via television, the TGV express train, and the Internet has not prevented the persistence of diverse cultures, stimulated rather than erased by economic globalization. And all this has happened within a single nation, unified by administration and language.
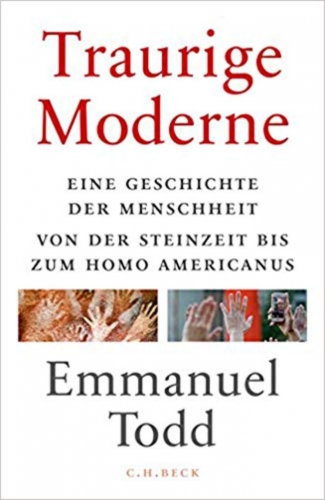 Todd calls this phenomenon the “memory of places.” His explanation for it is that even values weakly held at the individual level and transmitted through the most casual mimetic processes can produce extremely strong, resilient, and sustainable belief systems at the group level. Such an interpretation also helps us to understand the persistence of national temperaments without our having to assume that everyone is the incarnation of an immutable national archetype or Volksgeist.
Todd calls this phenomenon the “memory of places.” His explanation for it is that even values weakly held at the individual level and transmitted through the most casual mimetic processes can produce extremely strong, resilient, and sustainable belief systems at the group level. Such an interpretation also helps us to understand the persistence of national temperaments without our having to assume that everyone is the incarnation of an immutable national archetype or Volksgeist.
The author offers an amusing illustration of how notions weakly held at the individual level can persist in groups: in the 1990s, he found it easy to convince people privately of the absurdity of the project for a single European currency.
But the belief in the inevitability of the euro was invulnerable at the collective level. The weak belief was already carried by a sufficiently broad group, and the individual, convinced for a while, returned to his or her belief at the same time as to his or her milieu after the conversation.
Stem Family Regions Today: The Case of Germany
Todd uses the concept of the memory of places to explain certain aspects of postwar German economic behavior which cannot be accounted for by economic theory itself. German consumers are more likely than those of the English-speaking world to prefer domestic products. German managers are less interested in short-term profit maximization than the long-term viability of their companies. Germany maintains a trade surplus while Anglo-Saxon countries cheerfully heap up debt. And more than other Western nations, the German economy relies on
small and medium-sized companies that dominate a narrow niche of global production, and prefer to develop their product or their range rather than to diversify. These companies are often located in areas that cannot be described as urban, and they continue, where possible, to prefer family transmission. They preserve the memory of primogeniture.
In the generation since reunification,
Germany has rebuilt its eastern area ruined by communism; it has reorganized Eastern Europe, putting to work the active populations brought up under the old popular democracies; in the West, it has conducted a real industrial blitzkrieg against the weaker nations trapped in the euro; it is proposing a partnership with China and posing as the economic rival of the United States.
All of this testifies to a continued German national consciousness and capacity for collective action, traceable to the stem-family mentality. This is all the more remarkable in that it can never be mentioned. Officially and publicly, the country operates on the assumption that the concept of nationhood was first introduced to the world by Adolf Hitler in 1933, so that any explicit national considerations are sufficient to mark one out as a “Nazi.” What we observe in Germany is a “zombie nationalism,” continuing at an unconscious level in spite of the country’s strict anti-national orthodoxy.
But all is not well in Germany. Todd observes that the birth rate in nuclear family regions of the West has remained reasonably close to replacement level at around 1.9 children per woman. In stem family areas it trends considerably lower, and is down to 1.4 in Germany. Todd ascribes this demographic disaster to
a mismatch between stem-family values and the ultra-individualism that has come from the West. In Germany, there is a widespread feeling that caring for a child full time is a moral obligation for the mother. Such a conception is not very compatible with the notion of a career. The level of state childcare provision is therefore low in the Federal Republic. But institutions here are simply reflecting mentalities.
German women have, indeed, increasingly opted for careers since the Second World War, but are more likely to remain entirely childless than their counterparts in France and the Anglosphere.
The eastward expansion of the EU and the recent departure of the United Kingdom have resulted in an EU dominated by its stem family areas — which include Germany, of course, but also the 47 percent share of the stem family population which lies outside the German-speaking world. This has given today’s EU a distinctly more inegalitarian and authoritarian cast than its founders intended:
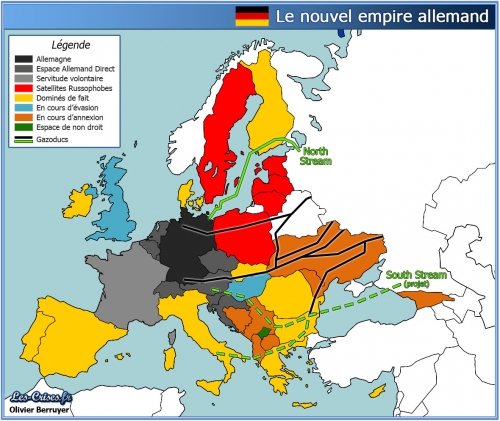
A hierarchy of nations, more or less rich, more or less powerful, more or less dominated, has appeared. Nothing about this system is an accident. The political, economic, and social system that has developed in Europe with its hierarchy of peoples, its economic inequalities, and its absence of representative democracy, is the normal form to which the stem family must give birth.
Communitarian Family Regions: Russia and Belarus
Besides nuclear and stem family forms, three regions in Europe developed exogamous communitarian families in which adult brothers and their families co-reside with the family patriarch. Such a system represents the second level of patrilineal development in Todd’s scheme. One such region is North Central Italy, including Tuscany, Umbria, and Emilia-Romagna where, as we have mentioned, support for the Italian Communist Party used to be quite high. A second communitarian family zone stretches from the Balkans into central Europe, including Bulgaria, Albania, most of the non-Catholic constituents of the former Yugoslavia, as well as Slovakia and parts of Hungary. Todd says relatively little about this area.
The third communitarian family region includes Northwest Russia, Belarus, and the Baltic States. This area developed the communitarian family relatively recently, between the seventeenth century and the abolition of serfdom in 1861. Todd suggests the system may have been “born of a confrontation between the Germanic stem family and Mongolian patrilineal organization.” It is unusual among communitarian regions in maintaining a relatively high status for women (such as is not found in the Balkans, for example). The communitarian family system of Northwest Russia was historically important in providing a sociological basis for Russian communism, as explained near the beginning of this review. In the 1917 elections to the Constituent Assembly, the Bolshevik Party gained only 24 percent of the vote over the whole of the Russian Empire, but achieved over 50 percent support in St. Petersburg, Moscow, and Belarus. In Livonia, a region that included parts of today’s Latvia and Estonia, its share of the vote rose to 71 percent.
Even today, after all the upheavals of the twentieth century, this family background can explain certain aspects of political behavior which mystify outsiders:
The permanence of communitarian values obviously explains the emergence, after the disorder of the 1990s and 2000s, of a stable authoritarian democracy, combining elections and an unanimist vote. Indeed, there is nothing in the electoral process to prevent Vladimir Putin being indefinitely re-elected to head the system. Control of the media is not the fundamental cause of permanence in power; authoritarianism is rooted in the people, and draws on communitarian values that are constantly being reproduced by the memory of places.
The memory of places [also] provides us with the fascinating example of Belarus that today is more attached than Russia to authoritarianism. Pres. Lukashenko is now the only “old-fashioned” dictator on the European continent, but the citizens of Belarus seem perfectly happy with the situation — and their society is functioning quite satisfactorily.
Putin’s Russia has instituted a protectionist regime to allow the reconstruction of the country’s industrial base. This amounts, as the author explains, to a “refusal of the Russian ruling class to see the people sold off as a cheap labor force to globalized capitalism,” and this is something the West’s neo-liberal elites cannot forgive. Poor as it is, Russia “remains a counter-model in a world that has moved towards a fierce ultra-individualism.” It also preserves a strong national consciousness without any of the embarrassment that affects Germany:
The values that have emerged from the communitarian family ensure the persistence of an integrated concept of the nation. The almost familial, concept of the people [narod] that characterizes Russia prevents Moscow from fantasizing about the dissolution of nations. In a world where most nations are small and militarily insignificant, the allure of the Russian approach is obvious, and very exasperating for the American geopoliticians who still think in terms of being all-powerful.
The best proof of the essential healthiness of today’s Russia can be found in demographic statistics. We may note here that Todd first gained notoriety back in the mid-1970s for predicting the impending collapse of Soviet communism on the basis of its rising infant mortality rate, something that had escaped everyone else’s attention. After reaching 22 per 1000 live births in the 1990s, infant mortality began to sink sharply around 2003 and now stands at 7 per 1000 (in Belarus, the figure is 3.6, comparable to Western Europe). Russia has recently experienced a drop of 53 percent in the suicide rate (2001-2014), 71 percent in the homicide rate (2003-2014), and 78 percent in the alcohol poisoning rate (2003-2014).

A revealing large focus of anti-Russian agitation in the West today involves Russia’s so-called homophobia. Todd suggests the West may be shifting away from the nuclear family model in favor of an extreme individualism in which people are conceived of as monads “detached from the conjugal family [and] ideally embodied by the homosexual of either sex” (for whom a redefined “marriage” is now understood as a right rather than, as traditionally for men and women, a duty). Russia, meanwhile, after undergoing a disastrous fall in its birth rate during the late 1980s and 1990s, has rebounded to 1.8 children per woman, well above the European average. In 2008, the Russian Orthodox Church even introduced a new holiday, the “Day of Family, Love, and Faithfulness,” as a celebration of natural procreation. No wonder the West hates them!
Russia fills an important role on the international stage today by offering an alternative to the Anglosphere’s combination of globalism, liberal economics, and maladaptively exaggerated individualism: it stands for a multipolar world of independent sovereign nations.
Mass Immigration and the Clash of Family Systems
Europe, then, is characterized by three fundamental family types: nuclear, stem, and exogamous communitarian. But let us recall that Todd distinguishes a fourth type: the endogamous communitarian family. This variant idealizes cousin marriage and frequently involves polygyny and purdah, or the systematic sequestration of women. Until very recently, such practices were entirely absent from Europe; today, of course, mass immigration has introduced them. Todd, although a man of the Left, is sensible enough to describe this development as “a bridge too far.” “The memory of places requires limited flows of migrants for it to function,” he cautions; “The arrival in just a few months of a block of immigrants is a quite different phenomenon.”
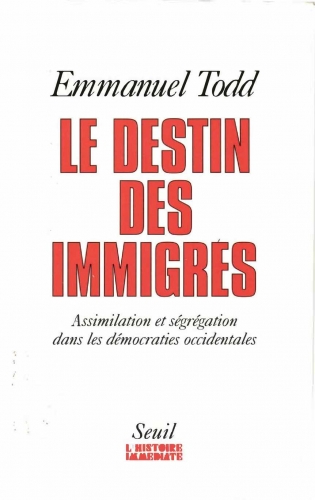 Of Angela Merkel’s lawless decision to open Germany’s borders in the summer of 2015, he observes:
Of Angela Merkel’s lawless decision to open Germany’s borders in the summer of 2015, he observes:
With the family reunifications that will follow, we can predict with absolute certainty the stabilization and growth of a separate population living in parallel with the [pre-existing] Turkish group. We must therefore imagine a Germany increasingly concerned about its internal stability and cohesion. The real risk is that of the internal hardening of a German society in which anxiety leads to a policing of the different ways of life.
To us, the real risk would seem to be something a great deal worse than this, and affecting not only Germany but our entire civilization.
Biology Denial
Thus far, we have had little but praise for Todd’s vision of a deep level of history where “anthropological substrata impose their values without the knowledge of the actors.” Yet we must note one essential limitation: he refuses to descend from the anthropological to the biological level. Early on, he claims that genetic analysis “in most cases . . . does not go much further than the examination of trivial phenotypic differences such as skin color or facial features.” It is tempting to counter that picking up a book such as The Bell Curve might have relieved the author of such a misapprehension. Alas, he reports: “I read this book when it first came out, and it sickened me.” Elsewhere he refers to IQ researchers as “ideologues.”
This blindness is all the odder in that biology represents, even more than anthropology, a deep, unconscious level of history whose study can bring to light otherwise invisible constraints under which the games of international relations and economic policy are played out. It would seem to be the next logical step on the path Todd has taken throughout his professional life.
In practice, the errors into which the author’s refusal to confront biological reality leads him seem mainly to affect his interpretation of very recent history, particularly 1) the higher education revolution since the Second World War, and 2) the third and final wave of secularization affecting areas where Catholicism remained strong until the 1960s.
The Secondary and Higher Education Revolutions: America
The popular spread of literacy which began in Protestant Germany can be seen in retrospect as a first educational revolution. In twentieth-century America, it was followed by what Todd considers a second and third educational revolution involving secondary and higher education respectively.
In 1900, ten percent of young Americans attended high school; six percent graduated. By 1940, 70 percent of Americans were attending high school and fully half of them completing it. Todd believes this rapid expansion of secondary education revolution was in part responsible for the New Deal and declining economic inequality between the 1920 and 1970s. The expansion continued after the war until, by the 1960s, “dropouts” (a term coined at this time) came to be seen as failures. The US was the undisputed leader of the movement to universalize secondary education: in the mid-1950s, when 80 percent of American 15-19 year olds were in education, the corresponding figures for Britain, France and West Germany hovered between 15 and 20 percent. Todd comments:
The second educational revolution was driven by an ideology of a democratic and egalitarian hue. American education was liberal, open, and concerned with the development of the individual as much as the acquisition of knowledge. This educational system showed absolutely no interest in elitist performance. It enabled the assimilation of immigrants [and] thus contributed to the emergence of an America that was not just prosperous but also culturally homogeneous.
In its egalitarian and homogenizing effects, this revolution was similar to the first educational revolution universalizing basic literacy.
The third educational revolution involved higher or tertiary education. Although historically it followed closely upon the expansion of secondary education and was motivated by the same ideals, Todd treats it as a separate phenomenon because of its association with inequality and social stratification.
On the eve of the Second World War, 7.5 percent of America’s men and 5 percent of its women earned Bachelor’s degrees. Following the war and passage of the GI Bill, higher education began expanding rapidly. Within a generation, by 1975, 27 percent of men and 22.5 percent of women were completing college. “Once these levels had been attained,” the author writes, “the model of ever-increasing education for all—applicable almost perfectly to primary and more or less to secondary education — lost its validity.” Higher education plateaued in the 1970s and 80s, and Todd recognizes that this “did not result from any restriction by the host system but from the fact that an intellectual ceiling had been reached.” Rather, “higher education is, by its nature, stratified.”
Misreading Contemporary Inequality: Higher Education and Neo-Liberalism
So far, so good. To a biological realist, it is obvious that the indefinite expansion of education was always a utopian project bound to crash into the wall of natural and inherited capacities, intelligence in particular. Todd’s reference to an “intellectual ceiling” seems to imply a recognition of this. Yet he then turns around and treats so knowledgeable authority on intelligence as Richard Herrnstein as an “ideologue . . . embarked on the theoretical shaping of a new inegalitarian creed” meant to justify social and economic inequality!
It may be that Todd accepts intellectual differences at the individual level but not the group level, or it may be that he simply has no consistent position; his statements remain ambiguous or contradictory. But he clearly affirms that the higher education revolution has produced inequality rather than merely revealing it; one of his chapter subsections is actually entitled “Academia: a machine to manufacture inequality.”
Each institution of higher education assigns each student a place in the social hierarchy. Knowledge is of course transmitted there, and research carried out. However, since studies are now longer than required for the acquisition of knowledge or the identification of aptitude for research, it is clear that the hierarchization of society has become the primary goal.
And he maintains that the rise in economic inequality since the 1980s has been a consequence of this educational system, although all he demonstrates is that, historically, one followed the other; in other words, he may be guilty of the post hoc ergo propter hoc fallacy. I share Todd’s disdain for an economic system that has “forced American workers to compete with Third World workers who were paid twenty or thirty times less,” even as CEO salaries at Fortune 500 companies have risen from 20 times that of the average worker in 1950 to 204 times in 2013. But the natural inequalities increasingly revealed in educational achievement were just as real before this change in policy came about, and will remain with us under any possible educational or economic system.

Todd makes the valid point that the American revolution in higher education, which has since spread throughout the West,
impose[s] on the participants an attitude of submission to authority [and] nourishes a higher class which, because it is selected by merit, thinks of itself [as] intellectually and morally superior. This superiority is a collective illusion: the homogeneity and conformism engendered by the mechanism of selection produces the ultimate paradox of a ‘world above’ subject to intellectual introversion, unsuited to individual thought.
But the illusion is not that differences in natural aptitude for higher education exist; it is that today’s hypertrophy of professional and technical training is equivalent to an increase in education as such. I can only shake my head over the presumption of equivalence between the number of years people now spend in school and their intellectual and (especially) moral development. It should be obvious that neither the individual nor society gains much from any increase in the number of doctorates awarded in “early childhood education” or “resentment studies,” but such bogus programs of study were a nearly inevitable consequence of trying to expand higher education past the point of diminishing returns determined by the fixed factor of inherited natural aptitude.
In such an academic environment, the ideal of liberal education — i.e., the cultivation of the mind for its own sake — cannot survive. And it is a proper liberal education, especially, which can teach intellectual humility to the highly intelligent. Hence the degeneration of higher education into the combination of professional training and political indoctrination we see today. And hence our current elite consisting of admittedly high-IQ persons who mistake their cleverness and academic qualification for breadth of mind, depth of insight, and even moral superiority.
Our political and social elites badly need replacing, and our bloated and corrupt academy badly needs both extensive pruning and qualitative curricular change. But Todd does not succeed in demonstrating that the higher education revolution is responsible for the harmful effects of neo-liberal economic policies.
The Third Ideological Crisis of Secularization: Is Le Pen a Nazi?
In the 1960s, Catholicism began to collapse in the areas — mainly stem family areas — of Europe where it had survived the first two waves of secularization. Much of the mentality and many social practices associated with Catholic Christianity remain strong in such areas, and this is the context in which Todd developed his concept of “zombie Catholicism.” But specifically religious belief and practice is nearly as vestigial there today as in other parts of Europe. And we may recall that Todd has asserted a natural pattern of development leading from literacy, to secularization, to a declining birthrate and ideological crisis. “Zombie Catholic” areas, like other stem family areas, have been especially hard hit by recent demographic collapse. Can we expect an ideological crisis in these areas as well?
This is not a question of merely theoretical interest, for we may recall that the first wave of secularization was associated with the French Revolution and the Napoleonic Wars, while the second wave was associated with two world wars and German National Socialism.
Todd’s treatment of this theme is coy and extremely compressed, being mostly limited to a couple of sentences. But they are revealing:
Since the mid-1960s, the zones of Catholicism have been living through the final stage of European secularization. And again, the metaphysical emptiness this entails is leading, against a backdrop of economic instability, to great anxiety and to the identifying of scapegoats.

Now, the Left’s favored way of explaining opposition to replacement-level immigration is to interpret it as a “scapegoating” of immigrants driven by economic and other anxieties on the part of irrational bigots. Todd’s free use of the cant expression “Islamophobia” suggests sympathy for this view as well. He appears to be suggesting that the identitarian movement which has arisen in Europe in response to the threat of demographic replacement represents the ideological crisis of the third wave of secularization. This would seem to imply that he considers its destructive potential comparable to that of the French Revolution and the World Wars.
By characterizing the ideological crisis of the second (Protestant) wave of secularization as a “rise of nationalism,” Todd also suggests a historical analogy between the rise of Hitler and today’s “nationalist” opposition to multiculturalism and the Great Replacement. But nationalism is a highly ambiguous term that has meant widely differing things in various historical situations. Today’s nationalism is largely a defensive response to an aggressive globalism that threatens the continued survival of any recognizably Western civilization. It would be either stupid or dishonest to equate it with Hitler’s 1939 invasion of Poland. I cannot help but think that Todd’s Jewish identity has influenced him to seek historical analogies where none exist.
Todd thus follows a pattern I have observed in a depressing number of scholars: he is a learned and original interpreter of the past who quickly turns into a cliché-ridden progressive journalist the moment he turns his attention away from his area of specialization toward questions of contemporary politics.
This does not, of course, negate the value of his scholarly work or diminish the truth of his book’s principal message: mankind is not converging; history is continuing, and its deeper levels will always generate differences in mentality and social behavior that may lead to conflict. As he puts it in the conclusion of his study: “We urgently need to accept the divergence of nations resulting from the differentiation of family systems, if we have the peace of the world at heart.”
If you want to support Counter-Currents, please send us a donation by going to our Entropy page [4] and selecting “send paid chat.” Entropy allows you to donate any amount from $3 and up. All comments will be read and discussed in the next episode of Counter-Currents Radio, which airs every Friday.
Don’t forget to sign up [5] for the twice-monthly email Counter-Currents Newsletter for exclusive content, offers, and news.

 Sur ce dernier point, on se souvient par exemple de la stratégie employée par les cigarettiers américains pour étendre leur marché. Durant la première guerre mondiale ils avaient généreusement distribué des cigarettes aux soldats. Résultat, après la fin des hostilités, la plupart des hommes fumait. Mais comment faire fumer les femmes ? Les cigarettiers ont donc sollicité Edward Bernays, publicitaire et neveu de Sigmund Freud. Celui-ci s’est adressé aux suffragettes et féministes, les incitant à défiler clopes au bec, devant les caméras, lors du traditionnel défilé de la parade de Pâque 1929. Les cigarettes étaient appelées « torches de la liberté ». Ainsi, grâce à Bernays, fumer devenait soudainement le symbole de la conquête du pouvoir masculin et de la libération de la femme... au prix de quelques cancers mais pour le plus grand profit de l’industrie cigarettière (contrôlée par des hommes) ! Un cas d’école !
Sur ce dernier point, on se souvient par exemple de la stratégie employée par les cigarettiers américains pour étendre leur marché. Durant la première guerre mondiale ils avaient généreusement distribué des cigarettes aux soldats. Résultat, après la fin des hostilités, la plupart des hommes fumait. Mais comment faire fumer les femmes ? Les cigarettiers ont donc sollicité Edward Bernays, publicitaire et neveu de Sigmund Freud. Celui-ci s’est adressé aux suffragettes et féministes, les incitant à défiler clopes au bec, devant les caméras, lors du traditionnel défilé de la parade de Pâque 1929. Les cigarettes étaient appelées « torches de la liberté ». Ainsi, grâce à Bernays, fumer devenait soudainement le symbole de la conquête du pouvoir masculin et de la libération de la femme... au prix de quelques cancers mais pour le plus grand profit de l’industrie cigarettière (contrôlée par des hommes) ! Un cas d’école !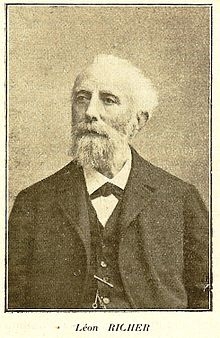 Paradoxalement, c’est bien dans des loges masculines que s’élabore l’idéologie féministe. Si la franc-maçonnerie est alors le laboratoire de pensée de la République (elle le reste assez largement aujourd’hui), la République est alors un instrument au service de la banque, de la finance et de l’industrie (idem). Le sas entre les trois entités est donc loin d’être étanche : les francs-maçons sont surreprésentés dans les instances républicaines (à titre d’exemple, six présidents de la IIIe République sont francs-maçons), et le rôle des francs-maçons élus se cantonne essentiellement à défendre les intérêts bien compris de l’oligarchie. De là ces scandales qui, lorsqu’ils éclatent, éclaboussent à la fois la franc-maçonnerie, la République et l’oligarchie (krach boursier de 1882, scandale des décorations, scandale de Panama…). Tout cela pour dire que la franc-maçonnerie n’aurait jamais pu fonder le féminisme s’il y avait eu le moindre danger que le féminisme soit contraire aux intérêts de l’oligarchie. Bien au contraire : la « libération de la femme » sort la femme de son foyer et la livre pieds et poings liés à un patronat immoral et cupide. De fait, la « libération de la femme » double la main d’œuvre disponible et, comme aujourd’hui avec l’immigration (les mêmes sont à la manœuvre), fait peser à la baisse sur les salaires. Les féministes sont les idiotes utiles du Grand Capital… et de ses agents francs-maçons, qui sont historiquement des hommes (notons que le rôle de la franc-maçonnerie dans l’élaboration du féminisme apparaît très clairement dans d’autres pays que la France. Citons notamment l’Espagne, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis…).
Paradoxalement, c’est bien dans des loges masculines que s’élabore l’idéologie féministe. Si la franc-maçonnerie est alors le laboratoire de pensée de la République (elle le reste assez largement aujourd’hui), la République est alors un instrument au service de la banque, de la finance et de l’industrie (idem). Le sas entre les trois entités est donc loin d’être étanche : les francs-maçons sont surreprésentés dans les instances républicaines (à titre d’exemple, six présidents de la IIIe République sont francs-maçons), et le rôle des francs-maçons élus se cantonne essentiellement à défendre les intérêts bien compris de l’oligarchie. De là ces scandales qui, lorsqu’ils éclatent, éclaboussent à la fois la franc-maçonnerie, la République et l’oligarchie (krach boursier de 1882, scandale des décorations, scandale de Panama…). Tout cela pour dire que la franc-maçonnerie n’aurait jamais pu fonder le féminisme s’il y avait eu le moindre danger que le féminisme soit contraire aux intérêts de l’oligarchie. Bien au contraire : la « libération de la femme » sort la femme de son foyer et la livre pieds et poings liés à un patronat immoral et cupide. De fait, la « libération de la femme » double la main d’œuvre disponible et, comme aujourd’hui avec l’immigration (les mêmes sont à la manœuvre), fait peser à la baisse sur les salaires. Les féministes sont les idiotes utiles du Grand Capital… et de ses agents francs-maçons, qui sont historiquement des hommes (notons que le rôle de la franc-maçonnerie dans l’élaboration du féminisme apparaît très clairement dans d’autres pays que la France. Citons notamment l’Espagne, la Grande-Bretagne ou les Etats-Unis…).




 del.icio.us
del.icio.us
 Digg
Digg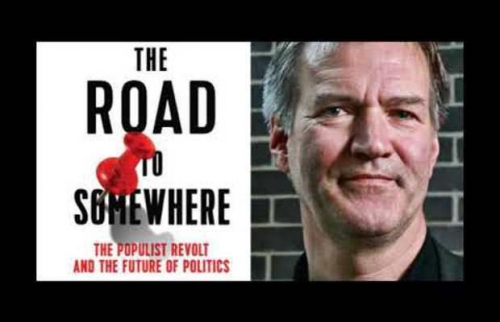


 Dans toute l’Europe francophone apparaît brusquement « rénové », c’est-à-dire en rupture avec l’autorité magistrale, les techniques de dressage (Roland Barthes qualifie l’orthographe de « fasciste »), l’enracinement dans l’histoire nationale et l’apprentissage des langues anciennes (latin, grec). On retrouve dans la mentalité des Partout cette hantise de la « réalisation de soi » au mépris de toute règle contraignante, de toute référence au passé et de tout sentiment d’appartenance à une communauté organique.
Dans toute l’Europe francophone apparaît brusquement « rénové », c’est-à-dire en rupture avec l’autorité magistrale, les techniques de dressage (Roland Barthes qualifie l’orthographe de « fasciste »), l’enracinement dans l’histoire nationale et l’apprentissage des langues anciennes (latin, grec). On retrouve dans la mentalité des Partout cette hantise de la « réalisation de soi » au mépris de toute règle contraignante, de toute référence au passé et de tout sentiment d’appartenance à une communauté organique. À l’époque où j’étudiais à l’Université de Bruxelles, il y avait deux cités universitaires : l’une pour les garçons au cœur du campus, l’autre pour les jeunes filles légèrement en dehors. Ainsi pouvaient déjà se côtoyer, vers 1970, des jeunes provenant de toutes les provinces du Royaume. Le programme Erasmus, d’abord à l’échelon européen, puis au plan mondial, accentue ensuite cet élargissement des horizons et l’impression que « le monde est un village », pour reprendre le titre d’une émission créée par la radio belge francophone en 1998. « La massification de l’enseignement supérieur », l’émergence d’un « secteur universitaire hypertrophié » : voilà des phénomènes qui remontent aux années 1960, vont de pair avec une disqualification du travail manuel et ipso facto avec l’immigration fournissant au patronat une armée de réserve, une classe ouvrière de rechange.
À l’époque où j’étudiais à l’Université de Bruxelles, il y avait deux cités universitaires : l’une pour les garçons au cœur du campus, l’autre pour les jeunes filles légèrement en dehors. Ainsi pouvaient déjà se côtoyer, vers 1970, des jeunes provenant de toutes les provinces du Royaume. Le programme Erasmus, d’abord à l’échelon européen, puis au plan mondial, accentue ensuite cet élargissement des horizons et l’impression que « le monde est un village », pour reprendre le titre d’une émission créée par la radio belge francophone en 1998. « La massification de l’enseignement supérieur », l’émergence d’un « secteur universitaire hypertrophié » : voilà des phénomènes qui remontent aux années 1960, vont de pair avec une disqualification du travail manuel et ipso facto avec l’immigration fournissant au patronat une armée de réserve, une classe ouvrière de rechange.
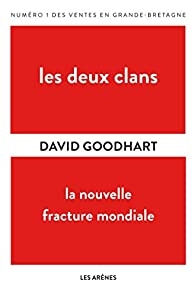 J
J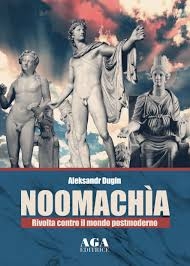 1 :
1 : 
 Après bien d’autres, d’ailleurs cités par l’auteur (y compris Charles Murray
Après bien d’autres, d’ailleurs cités par l’auteur (y compris Charles Murray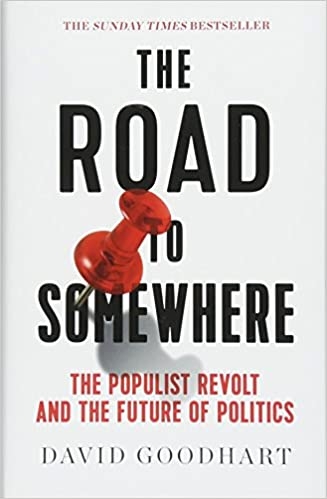 C’est la sélection croissante, au cours de 70 dernières années, sur les performances cognitives dans l’éducation supérieure qui a abouti à la création d’une classe cognitive, renforcée aujourd’hui par l’endogamie cognitive (combinant héritage génétique et ressources pour l’éducation), rendue plus facile avec l’accès croissant des femmes à l’éducation supérieure. Dans Coming Apart , Charles Murray avait montré que Princeton et Yale accueillaient plus d’étudiants provenant du dernier centile que des 6 premiers déciles de revenu.
C’est la sélection croissante, au cours de 70 dernières années, sur les performances cognitives dans l’éducation supérieure qui a abouti à la création d’une classe cognitive, renforcée aujourd’hui par l’endogamie cognitive (combinant héritage génétique et ressources pour l’éducation), rendue plus facile avec l’accès croissant des femmes à l’éducation supérieure. Dans Coming Apart , Charles Murray avait montré que Princeton et Yale accueillaient plus d’étudiants provenant du dernier centile que des 6 premiers déciles de revenu.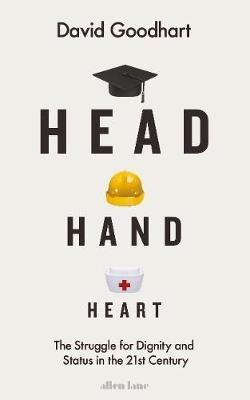 Et en politique
Et en politique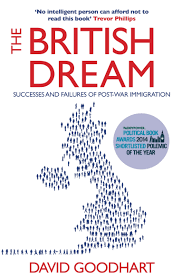 L’économie du soin a un double problème : il est de moins en moins attractif et ceux qui y travaillent s’en vont, souvent désenchantés. Les hommes, particulièrement ceux qui ont un faible statut, ont perdu, sans pouvoir rien mettre à la place, leur rôle principal qui était celui de gagner l’argent de la famille. Un nombre disproportionné de métiers qui ne peuvent être automatisés sont traditionnellement occupés par des femmes, métiers qui n’attirent pas les hommes. Daniel Susskind, dans A World Without Work, publié en 2020, rapporte les résultats d’une enquête au Royaume-Uni selon laquelle « la plupart des hommes qui ont perdu leur emploi industriel préfèrent ne pas travailler que de prendre un “pink collar work” » (traduction personnelle).
L’économie du soin a un double problème : il est de moins en moins attractif et ceux qui y travaillent s’en vont, souvent désenchantés. Les hommes, particulièrement ceux qui ont un faible statut, ont perdu, sans pouvoir rien mettre à la place, leur rôle principal qui était celui de gagner l’argent de la famille. Un nombre disproportionné de métiers qui ne peuvent être automatisés sont traditionnellement occupés par des femmes, métiers qui n’attirent pas les hommes. Daniel Susskind, dans A World Without Work, publié en 2020, rapporte les résultats d’une enquête au Royaume-Uni selon laquelle « la plupart des hommes qui ont perdu leur emploi industriel préfèrent ne pas travailler que de prendre un “pink collar work” » (traduction personnelle).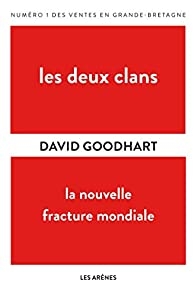 S’il faut préserver les procédures de sélection méritocratiques, il faut aussi veiller à répartir respect et statut plus équitablement en élargissant les sources de réussite et en élevant le statut de ceux qui ne vont pas à l’université. Les dernières recherches sur les capacités cognitives pourraient nous y aider. Une étude menée à l’université Carnegie Mellon aux États-Unis définit trois types de styles cognitifs : la verbalisation (journalistes, avocats…) ; la visualisation spatiale (ceux qui pensent analytiquement : ingénieurs, mathématiciens…) ; la visualisation des objets (artistes…) qui ont tendance à penser un contexte plus large. Mais la diversité doit aussi s’appliquer aux idéologies et valeurs politiques.
S’il faut préserver les procédures de sélection méritocratiques, il faut aussi veiller à répartir respect et statut plus équitablement en élargissant les sources de réussite et en élevant le statut de ceux qui ne vont pas à l’université. Les dernières recherches sur les capacités cognitives pourraient nous y aider. Une étude menée à l’université Carnegie Mellon aux États-Unis définit trois types de styles cognitifs : la verbalisation (journalistes, avocats…) ; la visualisation spatiale (ceux qui pensent analytiquement : ingénieurs, mathématiciens…) ; la visualisation des objets (artistes…) qui ont tendance à penser un contexte plus large. Mais la diversité doit aussi s’appliquer aux idéologies et valeurs politiques.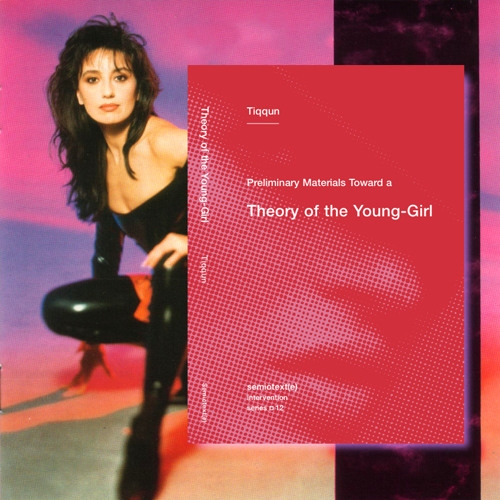
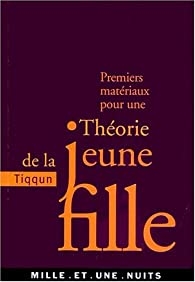 Alors que l’occident est sous contrôle psychiatrique-pathologique, belliciste-humanitaire, féministe-antiraciste, androphobe-russophobe et sociétal-transgenre, relisons ou découvrons un admirable ouvrage collectif (1) sur ce sujet instructif, la Jeune-Fille :
Alors que l’occident est sous contrôle psychiatrique-pathologique, belliciste-humanitaire, féministe-antiraciste, androphobe-russophobe et sociétal-transgenre, relisons ou découvrons un admirable ouvrage collectif (1) sur ce sujet instructif, la Jeune-Fille :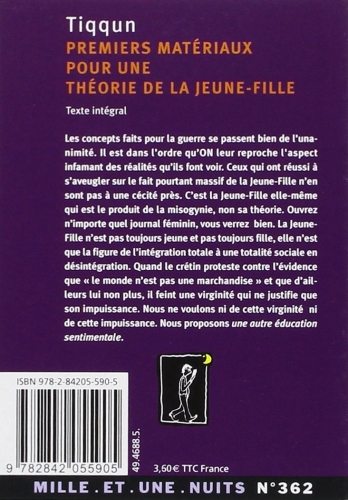

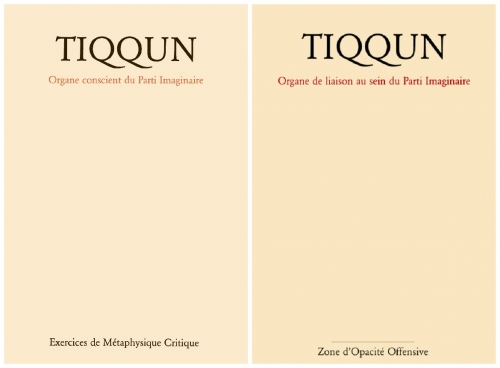
 D’où ce bon vieux virage bio :
D’où ce bon vieux virage bio : Succession d’aphorismes héraclitéens ou presque :
Succession d’aphorismes héraclitéens ou presque :
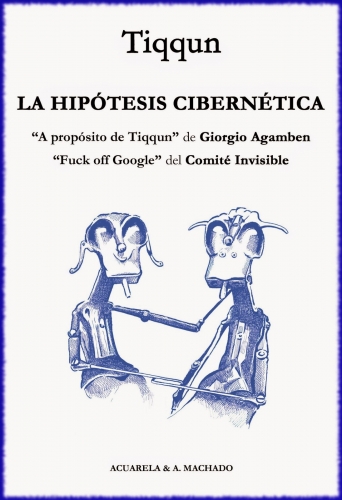

 Ce qui nous consterne en effet n'appartient pas au domaine des décisions, mais des indécisions… des changements de pied… des incertitudes permanentes.
Ce qui nous consterne en effet n'appartient pas au domaine des décisions, mais des indécisions… des changements de pied… des incertitudes permanentes.

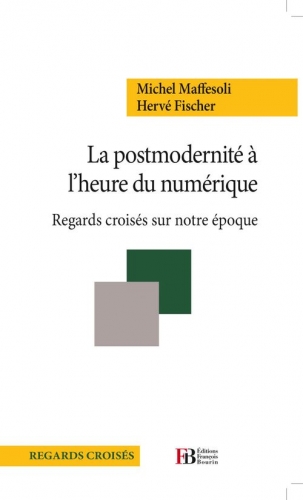

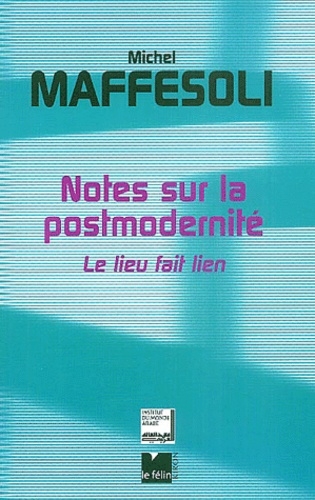

 C’est la politique de Paul Delouvrier, grand commis à l’urbanisme nommé par de Gaulle, qu’il faut incriminer. Les zones à urbaniser étaient choisies en « sautant » par-dessus les banlieues existantes. Donc en lointaine périphérie. On a préféré faire du neuf dans des endroits vierges plutôt que d’améliorer les territoires de vieilles banlieues. Il est vrai que celles-ci étaient communistes pour une bonne part et que le régime gaulliste voulait les contourner. En outre, l’idéologie urbaine « fonctionnaliste » plus ou moins proche de Le Corbusier se prêtait plus à des constructions dans de l’espace vide plutôt qu’à des « retricotages » subtils de la ville dans des territoires déjà urbanisés.
C’est la politique de Paul Delouvrier, grand commis à l’urbanisme nommé par de Gaulle, qu’il faut incriminer. Les zones à urbaniser étaient choisies en « sautant » par-dessus les banlieues existantes. Donc en lointaine périphérie. On a préféré faire du neuf dans des endroits vierges plutôt que d’améliorer les territoires de vieilles banlieues. Il est vrai que celles-ci étaient communistes pour une bonne part et que le régime gaulliste voulait les contourner. En outre, l’idéologie urbaine « fonctionnaliste » plus ou moins proche de Le Corbusier se prêtait plus à des constructions dans de l’espace vide plutôt qu’à des « retricotages » subtils de la ville dans des territoires déjà urbanisés.




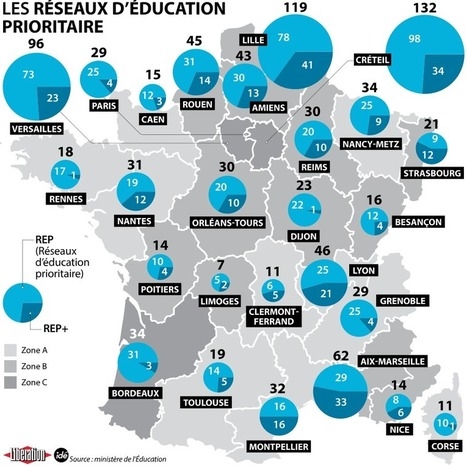
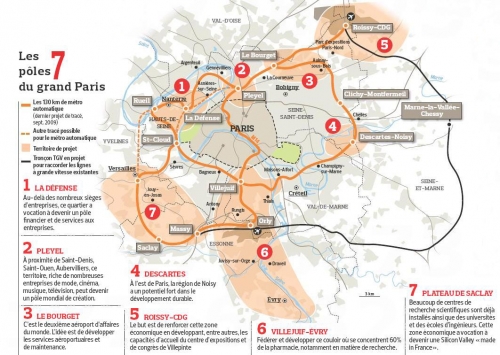

 Il faut aussi refuser la victimisation. Bien des maghrébins qui « s’en sortent », bien des « noirs » – et non pas des « blacks » – Africains ou Antillais qui eux aussi s’en sortent socialement, c’est-à-dire travaillent, montrent que des jeunes, avec de l’énergie, peuvent trouver une formation, un travail, une voie, un avenir, une espérance, une place dans la société. La République française est généreuse, l’éducation gratuite, les soins gratuits, ce n’est pas rien, il faut le dire et le rappeler. En contrepartie, il faut être sévère avec ceux qui pourrissent la vie de ces quartiers, et qui sont tout simplement des canailles qui vivent de trafics de drogue, de vols, d’escroqueries, de harcèlements, etc.
Il faut aussi refuser la victimisation. Bien des maghrébins qui « s’en sortent », bien des « noirs » – et non pas des « blacks » – Africains ou Antillais qui eux aussi s’en sortent socialement, c’est-à-dire travaillent, montrent que des jeunes, avec de l’énergie, peuvent trouver une formation, un travail, une voie, un avenir, une espérance, une place dans la société. La République française est généreuse, l’éducation gratuite, les soins gratuits, ce n’est pas rien, il faut le dire et le rappeler. En contrepartie, il faut être sévère avec ceux qui pourrissent la vie de ces quartiers, et qui sont tout simplement des canailles qui vivent de trafics de drogue, de vols, d’escroqueries, de harcèlements, etc. 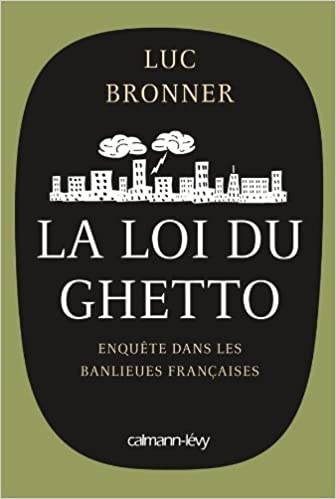 Pour revenir à la question centrale, qui est celle des jeunes des quartiers, ce qui doit être géré est, ajouté au problème de l’identité, un problème « hormonal ». C’est ce qu’a bien vu Luc Bronner dans La loi du Ghetto. Les jeunes garçons ont pris le pouvoir. Le culte de l’enfant-roi de nos sociétés n’a rien arrangé. Quand un parent donne une fessée à son gosse, les services sociaux le réprimandent. Les immigrés ne comprennent pas cela. Ils ont l’impression qu’on leur casse leur travail de parent éducateur. Mais surtout, il y a l’absence fréquente du père ou la dévalorisation de la figure du père. C’est souvent un chômeur. Nombre d’immigrés ont été licenciés de leur travail à 45 ans : cela n’aide pas à donner une image forte. Quant aux familles monoparentales, le garçon seul face à sa mère est roi dans certaines cultures. Il y a une asymétrie de la délinquance entre garçons et filles. Difficile donc de dissocier les questions de la banlieue de ces questions culturelles liées à l’immigration, liées aux cultures des immigrés. Ce qui, bien sûr, ne veut pas dire que, sans problème de l’immigration, il n’y aurait plus de problème de la banlieue. Il resterait le problème de la laideur, et ce n’est pas une petite affaire, car l’homme a besoin de beauté. Il a besoin du ciel étoilé. Il a besoin des nuages. Il a besoin d’une poésie de la vie, et pas seulement de promotions sur les pâtes à tartiner. Il faut à cet égard revoir entièrement la forme et le contenu des centres commerciaux, véritables « rois anonymes » de notre temps, pour reprendre une expression de Georg Simmel à propos de la fonction marchande.
Pour revenir à la question centrale, qui est celle des jeunes des quartiers, ce qui doit être géré est, ajouté au problème de l’identité, un problème « hormonal ». C’est ce qu’a bien vu Luc Bronner dans La loi du Ghetto. Les jeunes garçons ont pris le pouvoir. Le culte de l’enfant-roi de nos sociétés n’a rien arrangé. Quand un parent donne une fessée à son gosse, les services sociaux le réprimandent. Les immigrés ne comprennent pas cela. Ils ont l’impression qu’on leur casse leur travail de parent éducateur. Mais surtout, il y a l’absence fréquente du père ou la dévalorisation de la figure du père. C’est souvent un chômeur. Nombre d’immigrés ont été licenciés de leur travail à 45 ans : cela n’aide pas à donner une image forte. Quant aux familles monoparentales, le garçon seul face à sa mère est roi dans certaines cultures. Il y a une asymétrie de la délinquance entre garçons et filles. Difficile donc de dissocier les questions de la banlieue de ces questions culturelles liées à l’immigration, liées aux cultures des immigrés. Ce qui, bien sûr, ne veut pas dire que, sans problème de l’immigration, il n’y aurait plus de problème de la banlieue. Il resterait le problème de la laideur, et ce n’est pas une petite affaire, car l’homme a besoin de beauté. Il a besoin du ciel étoilé. Il a besoin des nuages. Il a besoin d’une poésie de la vie, et pas seulement de promotions sur les pâtes à tartiner. Il faut à cet égard revoir entièrement la forme et le contenu des centres commerciaux, véritables « rois anonymes » de notre temps, pour reprendre une expression de Georg Simmel à propos de la fonction marchande.  Depuis plus de 30 ans, il y a clairement une ghettoisation des quartiers, une pauvreté endémique, un désoeuvrement, une défrancisation qui touche notamment les mœurs, un développement des trafics de drogue et de toutes les délinquances. Il y a bien sûr un départ de ceux qui peuvent partir notamment les Français « de souche » des classes moyennes, mais aussi les immigrés qui accèdent à la classe moyenne. Quant aux classes supérieures, elles n’ont jamais habité les quartiers sensibles et n’ont donc pas besoin de les fuir. En d’autres termes, la lutte de classes s’accompagne toujours d’une lutte pour s’approprier les lieux, d’une « lutte des places », comme écrit Michel Lussault
Depuis plus de 30 ans, il y a clairement une ghettoisation des quartiers, une pauvreté endémique, un désoeuvrement, une défrancisation qui touche notamment les mœurs, un développement des trafics de drogue et de toutes les délinquances. Il y a bien sûr un départ de ceux qui peuvent partir notamment les Français « de souche » des classes moyennes, mais aussi les immigrés qui accèdent à la classe moyenne. Quant aux classes supérieures, elles n’ont jamais habité les quartiers sensibles et n’ont donc pas besoin de les fuir. En d’autres termes, la lutte de classes s’accompagne toujours d’une lutte pour s’approprier les lieux, d’une « lutte des places », comme écrit Michel Lussault











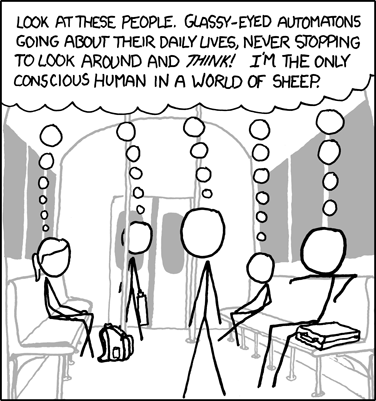



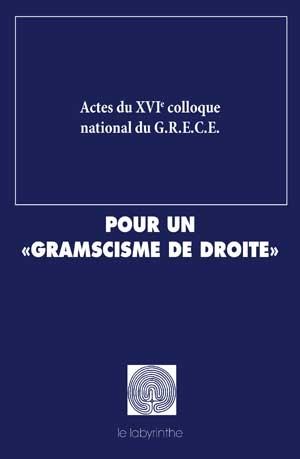 Lo principal que los franceses sacaron del gramscismo fue el rechazo del orden burgués tanto en su infraestructura como en su superestructura. De Benoist y sus colegas enfatizaron que la hegemonía debe entenderse y, lo que es más importante, rechazarse antes de que se logre por completo.
Lo principal que los franceses sacaron del gramscismo fue el rechazo del orden burgués tanto en su infraestructura como en su superestructura. De Benoist y sus colegas enfatizaron que la hegemonía debe entenderse y, lo que es más importante, rechazarse antes de que se logre por completo.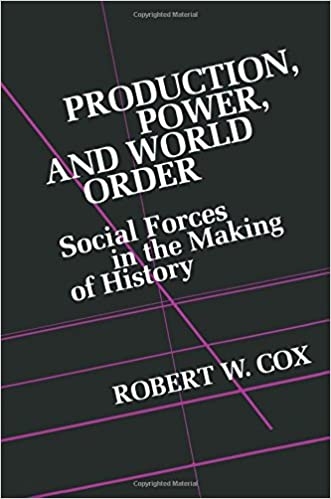 Una de las primeras lecturas fundamentales de Gramsci, siguiendo el desarrollo de su influencia, se considera que es la obra del profesor emérito de la Universidad de York Robert Cox (3). Entre los principales artículos científicos de principios de los años ochenta se pueden destacar "Fuerzas sociales, Estados y órdenes mundiales: más allá de la teoría de las relaciones internacionales" [1], "Gramsci, hegemonía y relaciones internacionales: un esbozo de la metodología" [2].
Una de las primeras lecturas fundamentales de Gramsci, siguiendo el desarrollo de su influencia, se considera que es la obra del profesor emérito de la Universidad de York Robert Cox (3). Entre los principales artículos científicos de principios de los años ochenta se pueden destacar "Fuerzas sociales, Estados y órdenes mundiales: más allá de la teoría de las relaciones internacionales" [1], "Gramsci, hegemonía y relaciones internacionales: un esbozo de la metodología" [2].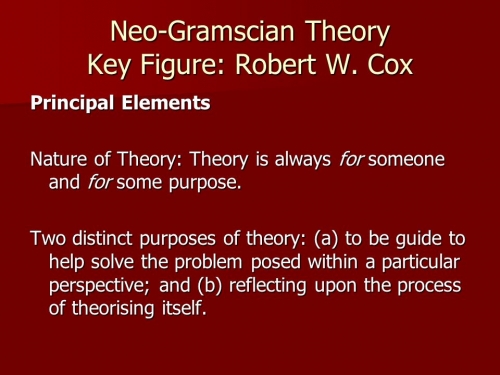
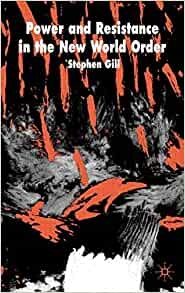 Otro investigador importante del neogramscismo es Stephen Gil, profesor de ciencias políticas en la Universidad de York. En su libro Poder y resistencia en el Nuevo Orden Mundial, [4] Gil mostró cómo la Comisión Trilateral de la élite actuó como un "intelectual orgánico" como lo sugiere Gramsci, forjando la ideología (ahora hegemónica) del neoliberalismo y el llamado Consenso de Washington, y más tarde con sus vínculos con la globalización del poder y la resistencia.
Otro investigador importante del neogramscismo es Stephen Gil, profesor de ciencias políticas en la Universidad de York. En su libro Poder y resistencia en el Nuevo Orden Mundial, [4] Gil mostró cómo la Comisión Trilateral de la élite actuó como un "intelectual orgánico" como lo sugiere Gramsci, forjando la ideología (ahora hegemónica) del neoliberalismo y el llamado Consenso de Washington, y más tarde con sus vínculos con la globalización del poder y la resistencia.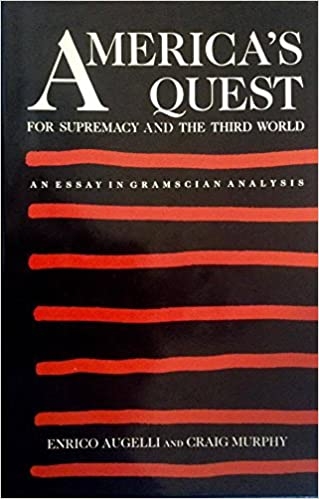 En su trabajo conjunto "In America's Quest for Supremacy and the Third World" (1988), los autores señalan que después de la Segunda Guerra Mundial, las clases dominantes en los Estados Unidos pudieron formar un "bloque histórico" internacional coherente: el "mundo libre". En su núcleo, se encuentra una alianza hegemónica con los países de la Organización de Cooperación Económica (1948), las clases dominantes y la población del Tercer Mundo, las clases dominantes de Europa Occidental y Japón. Todos ellos estuvieron bajo la presión de Estados Unidos en la década de 1980, especialmente a nivel económico. Luego hubo una reconstrucción de la supremacía del mundo estadounidense, que fue "principalmente el resultado del uso efectivo del poder económico".
En su trabajo conjunto "In America's Quest for Supremacy and the Third World" (1988), los autores señalan que después de la Segunda Guerra Mundial, las clases dominantes en los Estados Unidos pudieron formar un "bloque histórico" internacional coherente: el "mundo libre". En su núcleo, se encuentra una alianza hegemónica con los países de la Organización de Cooperación Económica (1948), las clases dominantes y la población del Tercer Mundo, las clases dominantes de Europa Occidental y Japón. Todos ellos estuvieron bajo la presión de Estados Unidos en la década de 1980, especialmente a nivel económico. Luego hubo una reconstrucción de la supremacía del mundo estadounidense, que fue "principalmente el resultado del uso efectivo del poder económico".






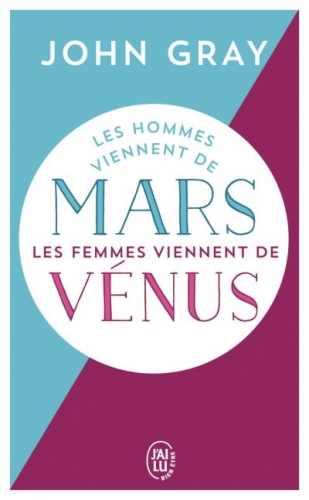 Dans les années 2000, le livre de John Gray « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » eut en France un succès colossal. Les lecteurs des deux sexes le dévoraient pour essayer de comprendre le sexe opposé. On pouvait surement opposer beaucoup d’arguments à la méthode « vulgarisante » de Gray, mais son objectif était clair : aider les hommes et les femmes à mieux se comprendre pour mieux vivre ensemble, et particulièrement en couple.
Dans les années 2000, le livre de John Gray « Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus » eut en France un succès colossal. Les lecteurs des deux sexes le dévoraient pour essayer de comprendre le sexe opposé. On pouvait surement opposer beaucoup d’arguments à la méthode « vulgarisante » de Gray, mais son objectif était clair : aider les hommes et les femmes à mieux se comprendre pour mieux vivre ensemble, et particulièrement en couple. 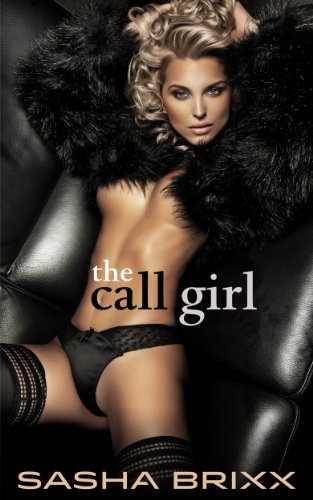 Qu’une call-girl accepte une relation sexuelle pour de l’argent ne dérange pas les féministes. Qu’une carriériste accepte une relation sexuelle avec son supérieur pour obtenir une promotion ne dérange pas les féministes. Ce qui dérange les féministes, ce qui pour elle relève de l’abomination, c’est qu’une femme accepte, parfois, une relation sexuelle par amour pour son mari.
Qu’une call-girl accepte une relation sexuelle pour de l’argent ne dérange pas les féministes. Qu’une carriériste accepte une relation sexuelle avec son supérieur pour obtenir une promotion ne dérange pas les féministes. Ce qui dérange les féministes, ce qui pour elle relève de l’abomination, c’est qu’une femme accepte, parfois, une relation sexuelle par amour pour son mari. 
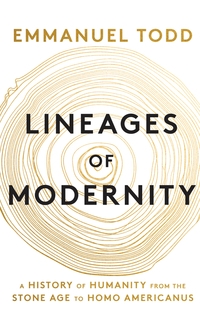 Much of today’s dominant globalist ideology derives from development theory, a body of thought which shares with Marxism the view that economic relations are the basis of social life and sees the races of mankind as fundamentally equivalent beneath the superficial cultural differences which have arisen over history. Human societies everywhere naturally develop from the hunter-gatherer stage to pastoralism, then to settled agriculture, and eventually to modern industrial civilization and “democracy” — the final stage, or at least the highest yet attained. Francis Fukuyama aptly characterized the development theorists’ dream as “getting to Denmark” — a world wherein all nations gradually converge on the model of a prosperous, stable, secure nation of the northern European type. But development occurs at different tempos in different places, with the result that some countries remain “undeveloped” (or, more euphemistically, still “developing”) while others have already reached the highest stage. Those in the vanguard of progress, mainly European-descended peoples, can help the rest develop by means of expertly managed international programs. Not the least important function of development theory, accordingly, is to justify prestige and rewards for a class of globe-trotting program administrators. Yet the world stubbornly refuses to evolve as globalist ideology foresees; plenty of differences remain intractable.
Much of today’s dominant globalist ideology derives from development theory, a body of thought which shares with Marxism the view that economic relations are the basis of social life and sees the races of mankind as fundamentally equivalent beneath the superficial cultural differences which have arisen over history. Human societies everywhere naturally develop from the hunter-gatherer stage to pastoralism, then to settled agriculture, and eventually to modern industrial civilization and “democracy” — the final stage, or at least the highest yet attained. Francis Fukuyama aptly characterized the development theorists’ dream as “getting to Denmark” — a world wherein all nations gradually converge on the model of a prosperous, stable, secure nation of the northern European type. But development occurs at different tempos in different places, with the result that some countries remain “undeveloped” (or, more euphemistically, still “developing”) while others have already reached the highest stage. Those in the vanguard of progress, mainly European-descended peoples, can help the rest develop by means of expertly managed international programs. Not the least important function of development theory, accordingly, is to justify prestige and rewards for a class of globe-trotting program administrators. Yet the world stubbornly refuses to evolve as globalist ideology foresees; plenty of differences remain intractable.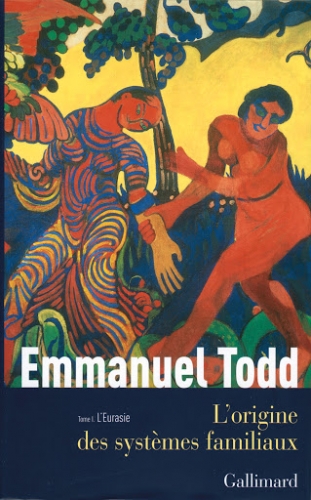 In previous works, Todd has demonstrated that even in fully secularized societies, the religious beliefs of the past continue to influence thinking on an unconscious level. He has, for example, described a “zombie Catholicism” which must be taken into account if one wishes to understand social behavior in the French provinces today. In this work, he finds an analogous “zombie Protestantism” useful for understanding the educational and economic effectiveness of Scandinavia. Furthermore, as he notes,
In previous works, Todd has demonstrated that even in fully secularized societies, the religious beliefs of the past continue to influence thinking on an unconscious level. He has, for example, described a “zombie Catholicism” which must be taken into account if one wishes to understand social behavior in the French provinces today. In this work, he finds an analogous “zombie Protestantism” useful for understanding the educational and economic effectiveness of Scandinavia. Furthermore, as he notes,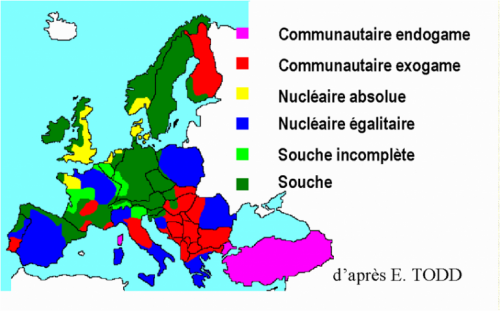


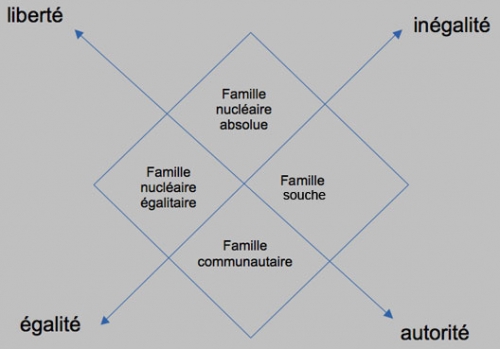
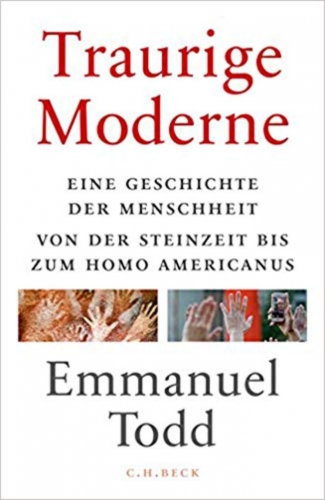 Todd calls this phenomenon the “memory of places.” His explanation for it is that even values weakly held at the individual level and transmitted through the most casual mimetic processes can produce extremely strong, resilient, and sustainable belief systems at the group level. Such an interpretation also helps us to understand the persistence of national temperaments without our having to assume that everyone is the incarnation of an immutable national archetype or Volksgeist.
Todd calls this phenomenon the “memory of places.” His explanation for it is that even values weakly held at the individual level and transmitted through the most casual mimetic processes can produce extremely strong, resilient, and sustainable belief systems at the group level. Such an interpretation also helps us to understand the persistence of national temperaments without our having to assume that everyone is the incarnation of an immutable national archetype or Volksgeist.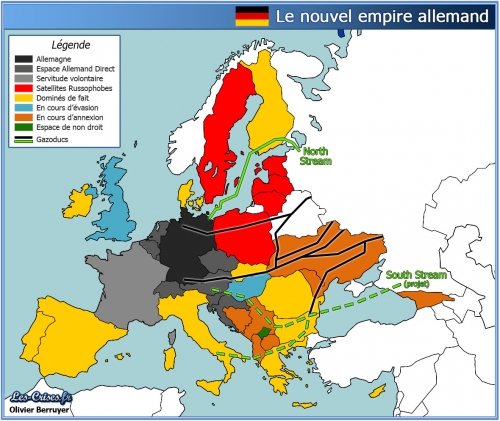

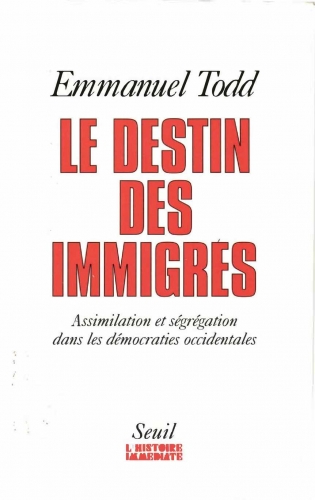 Of Angela Merkel’s lawless decision to open Germany’s borders in the summer of 2015, he observes:
Of Angela Merkel’s lawless decision to open Germany’s borders in the summer of 2015, he observes:







 En 2019, après sept ans d’hystérie féministe anti-hommes, on en comptait 22 900.
En 2019, après sept ans d’hystérie féministe anti-hommes, on en comptait 22 900. C’est en fait à un véritable redémarrage de l’histoire de la France et de l’Occident auquel nous assistons. Car il est fondamental pour les féministes de faire croire que le harcèlement de rue, par exemple, a toujours existé, et que les femmes se faisaient aussi bien insulter il y a cent ans qu’aujourd’hui. Il est fondamental de faire croire qu’il y a « encore » des viols et du harcèlement, et non pas « de plus en plus ». Il est fondamental de faire croire que le sexisme et le machisme bestial sont des survivances du « patriarcat blanc » et non pas l’avenir de la société islamisée.
C’est en fait à un véritable redémarrage de l’histoire de la France et de l’Occident auquel nous assistons. Car il est fondamental pour les féministes de faire croire que le harcèlement de rue, par exemple, a toujours existé, et que les femmes se faisaient aussi bien insulter il y a cent ans qu’aujourd’hui. Il est fondamental de faire croire qu’il y a « encore » des viols et du harcèlement, et non pas « de plus en plus ». Il est fondamental de faire croire que le sexisme et le machisme bestial sont des survivances du « patriarcat blanc » et non pas l’avenir de la société islamisée.  S’il existe une clef pour sortir du piège capitonné dans lequel sont en train de nous enfermer ceux qui veulent notre perte, je ne l’ai pas, ni moi ni aucun homme. Nous ne jouons dans cette affaire qu’un rôle secondaire. Seules les femmes, puisque c’est elles que la propagande a choisies pour cible, ont le pouvoir de nous faire sortir de cette impasse, par une réaction massive de rejet, sans aucune nuance ni ambiguïté. L’enjeu est clair : si le féminisme triomphe, non seulement la société européenne traditionnelle sombrera corps et bien, mais disparaîtra également le rêve apparu au cours des années soixante et soixante-dix, celui d’une société désinhibée où les hommes et les femmes auraient pu ensemble opérer un saut anthropologique à la recherche d’une nouvelle harmonie et d’un nouvel âge d’or, en se débarrassant du carcan des interdits judéo-chrétiens et de la logique productiviste. C’était le rêve de Pierre Clastres. C’était le rêve des hippies, anéanti par la prise de pouvoir de la gauche bourgeoise puritaine à partir des années quatre-vingt.
S’il existe une clef pour sortir du piège capitonné dans lequel sont en train de nous enfermer ceux qui veulent notre perte, je ne l’ai pas, ni moi ni aucun homme. Nous ne jouons dans cette affaire qu’un rôle secondaire. Seules les femmes, puisque c’est elles que la propagande a choisies pour cible, ont le pouvoir de nous faire sortir de cette impasse, par une réaction massive de rejet, sans aucune nuance ni ambiguïté. L’enjeu est clair : si le féminisme triomphe, non seulement la société européenne traditionnelle sombrera corps et bien, mais disparaîtra également le rêve apparu au cours des années soixante et soixante-dix, celui d’une société désinhibée où les hommes et les femmes auraient pu ensemble opérer un saut anthropologique à la recherche d’une nouvelle harmonie et d’un nouvel âge d’or, en se débarrassant du carcan des interdits judéo-chrétiens et de la logique productiviste. C’était le rêve de Pierre Clastres. C’était le rêve des hippies, anéanti par la prise de pouvoir de la gauche bourgeoise puritaine à partir des années quatre-vingt. 
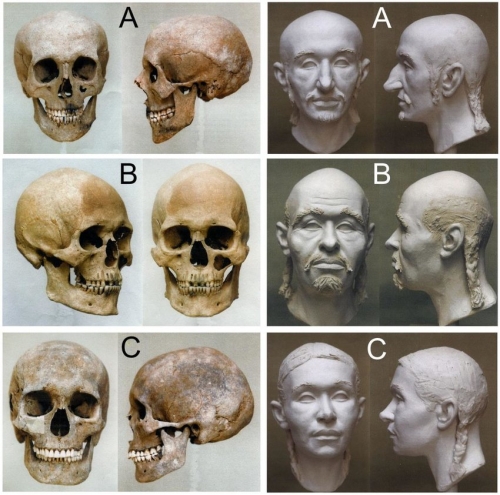

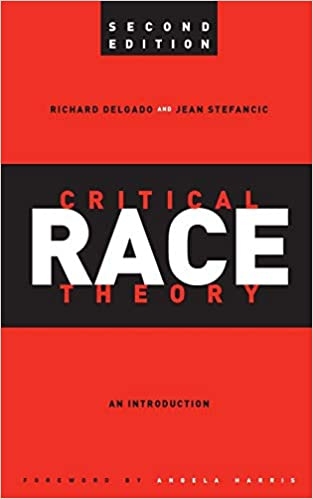 Pour en revenir à Delgado et Stefancic, une position critique sur les sociétés libres et leurs normes est à nouveau au centre de la Théorie critique de la race : « les spécialistes de la [Théorie] critique de la race sont mécontents du libéralisme en tant que structure pour répondre aux problèmes raciaux de l'Amérique. De nombreux libéraux croient au daltonisme et aux principes neutres du droit constitutionnel » (p. 21). Le célèbre « éducateur critique de la
Pour en revenir à Delgado et Stefancic, une position critique sur les sociétés libres et leurs normes est à nouveau au centre de la Théorie critique de la race : « les spécialistes de la [Théorie] critique de la race sont mécontents du libéralisme en tant que structure pour répondre aux problèmes raciaux de l'Amérique. De nombreux libéraux croient au daltonisme et aux principes neutres du droit constitutionnel » (p. 21). Le célèbre « éducateur critique de la 
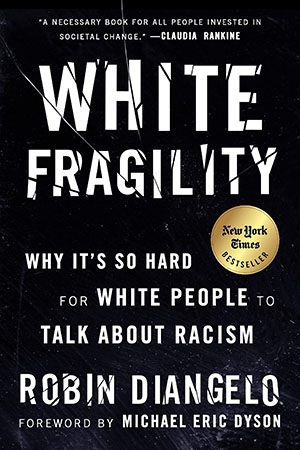 C'est évidemment une opinion abominable, qui va à l'encontre de l'un des tout premiers piliers de la science : l'universalité. L'universalité de la science dit que peu importe qui fait une expérience, le résultat sera toujours le même. C'est parce que la science croit en l'
C'est évidemment une opinion abominable, qui va à l'encontre de l'un des tout premiers piliers de la science : l'universalité. L'universalité de la science dit que peu importe qui fait une expérience, le résultat sera toujours le même. C'est parce que la science croit en l'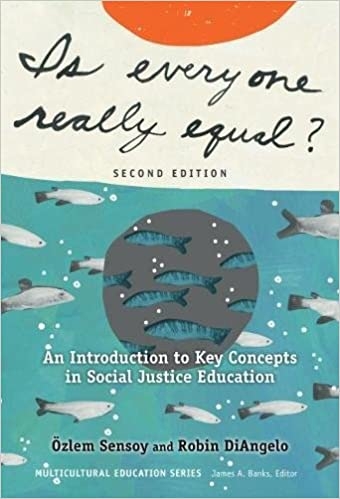 Alors que les récits peuvent être informatifs, pour créer une position selon laquelle la science est un « mode d'acquisition de la connaissance » pour les blancs occidentaux — surtout les hommes — et que le conte est plus adapté aux minorités raciales, la Théorie critique de la race est elle-même raciste — contre les minorités raciales — et paralyse les personnes qu'elle prétend aider. Cela se produit de multiples façons, notamment en sapant leur capacité de réflexion critique, en leur apprenant à voir le monde d'une manière qui les opprime, et en les associant à des stéréotypes négatifs et nuisibles selon lesquels ce sont les Blancs, et non les Noirs, qui utilisent des méthodes rigoureuses.
Alors que les récits peuvent être informatifs, pour créer une position selon laquelle la science est un « mode d'acquisition de la connaissance » pour les blancs occidentaux — surtout les hommes — et que le conte est plus adapté aux minorités raciales, la Théorie critique de la race est elle-même raciste — contre les minorités raciales — et paralyse les personnes qu'elle prétend aider. Cela se produit de multiples façons, notamment en sapant leur capacité de réflexion critique, en leur apprenant à voir le monde d'une manière qui les opprime, et en les associant à des stéréotypes négatifs et nuisibles selon lesquels ce sont les Blancs, et non les Noirs, qui utilisent des méthodes rigoureuses. 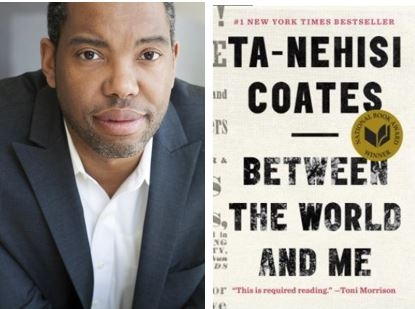
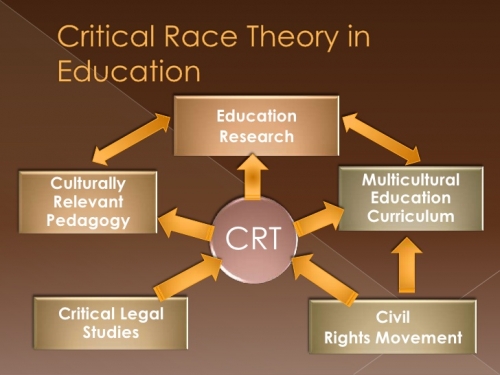
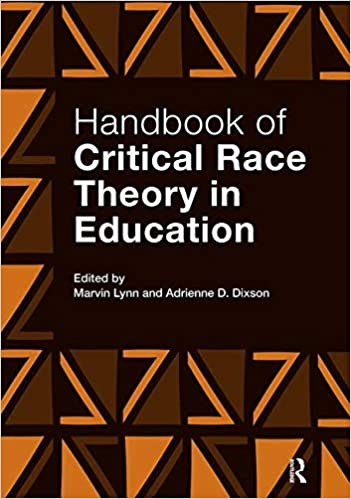 On peut aisément concevoir les types de problèmes créés par la mise en pratique de ces doctrines, et constater avec horreur la manière dont la Théorie critique de la race
On peut aisément concevoir les types de problèmes créés par la mise en pratique de ces doctrines, et constater avec horreur la manière dont la Théorie critique de la race 
 Il y a longtemps qu’Augustin Cochin avait exposé sa théorie de la confiscation des pouvoirs dans nos modernes démocraties, républiques ou autres nations unies. Cochin expliquait pourquoi ce sont toujours « eux » qui décident et pas « nous » ; on est en 1793, quand les sociétés de pensée ont décidé de refaire l’Homme, la Femme, la France, l’Humanité, le reste. Le triste programme de tabula rasa et de refonte est toujours le même depuis cette époque, dirigé par une élite implacable, conspiratrice et motivée :
Il y a longtemps qu’Augustin Cochin avait exposé sa théorie de la confiscation des pouvoirs dans nos modernes démocraties, républiques ou autres nations unies. Cochin expliquait pourquoi ce sont toujours « eux » qui décident et pas « nous » ; on est en 1793, quand les sociétés de pensée ont décidé de refaire l’Homme, la Femme, la France, l’Humanité, le reste. Le triste programme de tabula rasa et de refonte est toujours le même depuis cette époque, dirigé par une élite implacable, conspiratrice et motivée :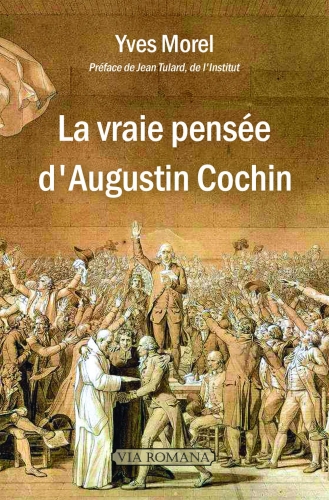 Mais Cochin distingue la méthode. Tout est dans la méthode. Et à propos de la Révolution :
Mais Cochin distingue la méthode. Tout est dans la méthode. Et à propos de la Révolution :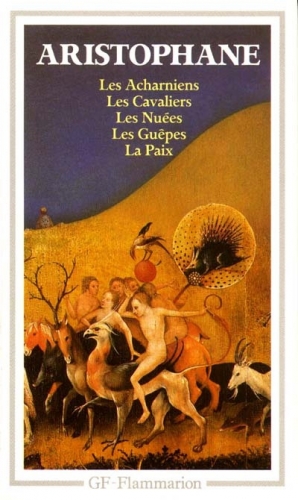 Cochin précise ensuite que nos utopistes, que nos idéalistes sont dangereux parce qu’ils ne sont pas utopistes précisément. Et il se réclame bien sûr des Grecs (Cité/Polis/Politique), d’Aristophane, de sa satire des mœurs démocratiques athéniennes :
Cochin précise ensuite que nos utopistes, que nos idéalistes sont dangereux parce qu’ils ne sont pas utopistes précisément. Et il se réclame bien sûr des Grecs (Cité/Polis/Politique), d’Aristophane, de sa satire des mœurs démocratiques athéniennes :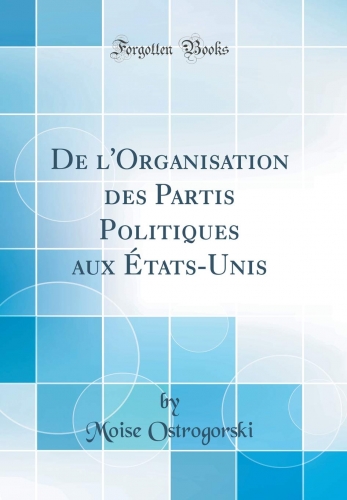 Puis Cochin s’inspire d’Ostrogorski pour écrire les lignes suivantes :
Puis Cochin s’inspire d’Ostrogorski pour écrire les lignes suivantes : Et voilà pourquoi la machine préfère à toutes les autres les activités malsaines, fiévreuses et stériles, impropres, par nature et par elles-mêmes, à la vie normale. Celles-là seulement ne peuvent être qu’impersonnelles. Un viveur qui dissipe ce qu’il vole : voilà ce qui convient en fait de concussion. »
Et voilà pourquoi la machine préfère à toutes les autres les activités malsaines, fiévreuses et stériles, impropres, par nature et par elles-mêmes, à la vie normale. Celles-là seulement ne peuvent être qu’impersonnelles. Un viveur qui dissipe ce qu’il vole : voilà ce qui convient en fait de concussion. »
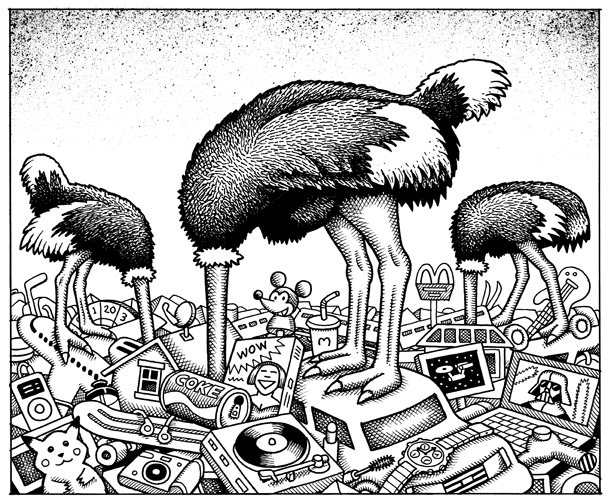
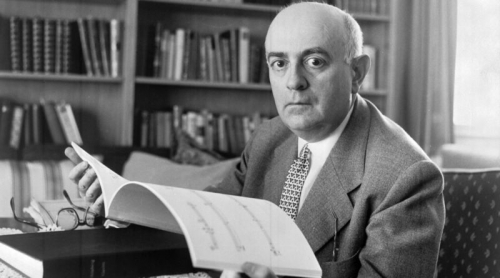
 L’année 1968 sera marquée par un enchaînement de révoltes partout sur le globe : dans le camp occidental, des États-Unis au Japon, en passant par la France ou l’Italie mais aussi dans certains pays du pacte de Varsovie, comme en Pologne ou en Tchécoslovaquie. L’ensemble de l’ordre du monde bipolaire capital-communiste issu de Yalta et du tribunal de Nuremberg allait être ainsi traversé dans un même élan par une série de révoltes marquées par le choc des générations. Pourtant, l’irruption soudaine de cette contestation étudiante internationale n’était pas le fruit du hasard mais bien celui d’un long travail d’incubation intellectuel et politique commencé il y a plusieurs décennies et qui connaîtrait son paroxysme dans les années d’après-guerre. Comme si des forces trop longtemps contenues et désormais sans frein se frayaient maintenant un chemin vers la surface et chercher à tout emporter avec l’éclatante et audacieuse énergie de la jeunesse. Les forces de l’ « Eros » déchaînées, chères aux théoriciens du freudo-marxisme.
L’année 1968 sera marquée par un enchaînement de révoltes partout sur le globe : dans le camp occidental, des États-Unis au Japon, en passant par la France ou l’Italie mais aussi dans certains pays du pacte de Varsovie, comme en Pologne ou en Tchécoslovaquie. L’ensemble de l’ordre du monde bipolaire capital-communiste issu de Yalta et du tribunal de Nuremberg allait être ainsi traversé dans un même élan par une série de révoltes marquées par le choc des générations. Pourtant, l’irruption soudaine de cette contestation étudiante internationale n’était pas le fruit du hasard mais bien celui d’un long travail d’incubation intellectuel et politique commencé il y a plusieurs décennies et qui connaîtrait son paroxysme dans les années d’après-guerre. Comme si des forces trop longtemps contenues et désormais sans frein se frayaient maintenant un chemin vers la surface et chercher à tout emporter avec l’éclatante et audacieuse énergie de la jeunesse. Les forces de l’ « Eros » déchaînées, chères aux théoriciens du freudo-marxisme.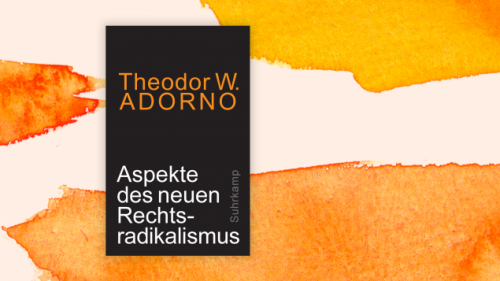
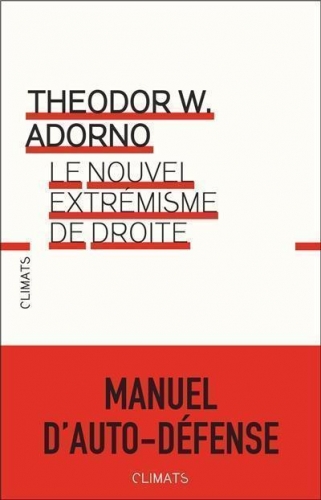 Relire aujourd’hui les Études sur la personnalité autoritaire de Theodor W. Adorno et de l’Institut de Recherche Social se révèle très instructif pour comprendre d’où provient une grande partie du mal-être et de la mauvaise conscience qui mine l’Occident contemporain. On y découvre l’application méthodique et clinique de penseurs politiques engagés qui se sont arrogés le droit de déterminer ce qui est moral ou non, non seulement dans l’Histoire et la culture de l’Occident mais jusque dans l’inconscient supposé des populations occidentales afin de l’en extirper comme par un acte psycho-chirurgical.
Relire aujourd’hui les Études sur la personnalité autoritaire de Theodor W. Adorno et de l’Institut de Recherche Social se révèle très instructif pour comprendre d’où provient une grande partie du mal-être et de la mauvaise conscience qui mine l’Occident contemporain. On y découvre l’application méthodique et clinique de penseurs politiques engagés qui se sont arrogés le droit de déterminer ce qui est moral ou non, non seulement dans l’Histoire et la culture de l’Occident mais jusque dans l’inconscient supposé des populations occidentales afin de l’en extirper comme par un acte psycho-chirurgical.
 Il n’est pas question de dire que la crise sanitaire n’existe pas, nous sommes nombreux à avoir des amis qui s’en sont en allés, ou des proches qui sont atteints ! Mais nos regrets et notre tristesse ne doivent pas nous faire oublier qu’il est une crise de plus grande ampleur : crise civilisationnelle s’il en est !
Il n’est pas question de dire que la crise sanitaire n’existe pas, nous sommes nombreux à avoir des amis qui s’en sont en allés, ou des proches qui sont atteints ! Mais nos regrets et notre tristesse ne doivent pas nous faire oublier qu’il est une crise de plus grande ampleur : crise civilisationnelle s’il en est !

 Auguste Comte, pour caractériser l’état de la société propre aux Temps modernes disait judicieusement reductio ad unum. L’un de l’Universalisme, l’un du Progressisme, l’un du Rationalisme, de l’Économicisme, du Consumérisme etc. C’est bien contre cette unité abstraite que la colère gronde, que la méfiance s’accroit. Et c’est bien parce qu’elle pressent que des soulèvements ne vont pas tarder à se manifester que la Caste au pouvoir, celle des politiques et de leurs perroquets médiatiques, s’emploie à susciter la peur, le refus du risque, la dénégation de la finitude humaine dont la mort est la forme achevée.
Auguste Comte, pour caractériser l’état de la société propre aux Temps modernes disait judicieusement reductio ad unum. L’un de l’Universalisme, l’un du Progressisme, l’un du Rationalisme, de l’Économicisme, du Consumérisme etc. C’est bien contre cette unité abstraite que la colère gronde, que la méfiance s’accroit. Et c’est bien parce qu’elle pressent que des soulèvements ne vont pas tarder à se manifester que la Caste au pouvoir, celle des politiques et de leurs perroquets médiatiques, s’emploie à susciter la peur, le refus du risque, la dénégation de la finitude humaine dont la mort est la forme achevée.


 Pour le Big Brother, le « crime-pensée » par excellence est bien la reconnaissance de la finitude humaine. De ce point de vue, le confinement et la mascarade généralisée sont dans la droite ligne du véritable danger de toute société humaine : l’asepsie de la vie sociale. Protection généralisée, évacuation totale des maladies transmissibles, lutte constante contre les germes pathogènes.
Pour le Big Brother, le « crime-pensée » par excellence est bien la reconnaissance de la finitude humaine. De ce point de vue, le confinement et la mascarade généralisée sont dans la droite ligne du véritable danger de toute société humaine : l’asepsie de la vie sociale. Protection généralisée, évacuation totale des maladies transmissibles, lutte constante contre les germes pathogènes. Le confinement comme négation de l’être-ensemble, la mascarade comme forme paroxystique de la théâtralité, tout cela tente, pour assurer la perdurance du pouvoir économiciste et politique, de faire oublier le sens de la limite et de l’indépassable fragilité de l’humain. En bref, l’acceptation de ce que Miguel de Unanumo nommait le « sentiment tragique de l’existence ».
Le confinement comme négation de l’être-ensemble, la mascarade comme forme paroxystique de la théâtralité, tout cela tente, pour assurer la perdurance du pouvoir économiciste et politique, de faire oublier le sens de la limite et de l’indépassable fragilité de l’humain. En bref, l’acceptation de ce que Miguel de Unanumo nommait le « sentiment tragique de l’existence ».


 Réputé l’un des meilleurs politologues du monde hispanique, l’académicien Negro Pavón a beau montrer que le réalisme politique n’est pas une famille politique homogène mais un point de vue de recherche et d’étude qui vise à éclairer les règles de la politique, qu’il n’est pas la défense du statu quo, qu’il part de l’évidence des faits mais ne se rend pas devant eux, qu’il ne se désintéresse pas des fins dernières mais reconnaît au contraire la nécessité vitale des finalités non politiques (le bonheur et la justice), rien ne peut ébranler la foi de ses adversaires, ennemis autoproclamés de toute pensée « machiavélienne », ou plutôt, selon leurs dires, « machiavélique ». Dans le fond, on le sait, le postmodernisme (mélange de néo-marxisme et de néo-libéralisme), n’est qu’une rébellion contre la réalité. Et le péché capital que redoutent ses thuriféraires est moins la « démagogie populiste », comme on l’entend ad nauseam, que le « sain scepticisme politique ». Une manière de penser qui, précisément, fait dire à Pavón, au grand dam de nos pseudo-progressistes, qu’il y a une condition essentielle pour que la démocratie politique soit possible et sa corruption beaucoup plus difficile: « il faut que l’attitude à l’égard du gouvernement soit toujours méfiante ». Et encore, citant Bertrand de Jouvenel : « le gouvernement des amis est la manière barbare de gouverner ».
Réputé l’un des meilleurs politologues du monde hispanique, l’académicien Negro Pavón a beau montrer que le réalisme politique n’est pas une famille politique homogène mais un point de vue de recherche et d’étude qui vise à éclairer les règles de la politique, qu’il n’est pas la défense du statu quo, qu’il part de l’évidence des faits mais ne se rend pas devant eux, qu’il ne se désintéresse pas des fins dernières mais reconnaît au contraire la nécessité vitale des finalités non politiques (le bonheur et la justice), rien ne peut ébranler la foi de ses adversaires, ennemis autoproclamés de toute pensée « machiavélienne », ou plutôt, selon leurs dires, « machiavélique ». Dans le fond, on le sait, le postmodernisme (mélange de néo-marxisme et de néo-libéralisme), n’est qu’une rébellion contre la réalité. Et le péché capital que redoutent ses thuriféraires est moins la « démagogie populiste », comme on l’entend ad nauseam, que le « sain scepticisme politique ». Une manière de penser qui, précisément, fait dire à Pavón, au grand dam de nos pseudo-progressistes, qu’il y a une condition essentielle pour que la démocratie politique soit possible et sa corruption beaucoup plus difficile: « il faut que l’attitude à l’égard du gouvernement soit toujours méfiante ». Et encore, citant Bertrand de Jouvenel : « le gouvernement des amis est la manière barbare de gouverner ».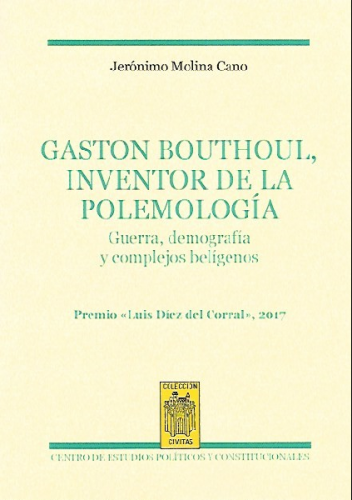 Gaston Bouthoul (Boutboul selon son certificat de naissance), est né dans la petite ville côtière de Monastir en Tunisie, le 8 mai 1896. Élevé au sein d’une famille bourgeoise de la communauté juive d’Afrique du Nord, le jeune Gaston parle le français, le dialecte arabe de la région et l’italien. Une fois ses études secondaires terminées, il quitte Tunis pour Paris, mais il restera toujours très attaché à son pays de naissance. En mai 1916, il s’inscrit à la faculté de droit et de lettres de la Sorbonne, puis, en juillet 1918, à l’Université de Lyon. De retour à Paris, en novembre 1918, dès la fin de la Première guerre mondiale, il acquiert la nationalité française.
Gaston Bouthoul (Boutboul selon son certificat de naissance), est né dans la petite ville côtière de Monastir en Tunisie, le 8 mai 1896. Élevé au sein d’une famille bourgeoise de la communauté juive d’Afrique du Nord, le jeune Gaston parle le français, le dialecte arabe de la région et l’italien. Une fois ses études secondaires terminées, il quitte Tunis pour Paris, mais il restera toujours très attaché à son pays de naissance. En mai 1916, il s’inscrit à la faculté de droit et de lettres de la Sorbonne, puis, en juillet 1918, à l’Université de Lyon. De retour à Paris, en novembre 1918, dès la fin de la Première guerre mondiale, il acquiert la nationalité française. C’est en 1922 que le nom de Gaston Bouthoul est mentionné pour la première fois dans la Revue internationale de sociologie, organe de l’Institut international de sociologie fondé par le sociologue René Worms (1893). À partir de 1926, cette revue réputée est dirigée par un ami de Bouthoul, Gaston Richard, un disciple de Durkheim devenu anti-durkheimien. Collaborateur régulier de la Revue internationale de sociologie mais aussi du Mercure de France, le futur polémologue recense et commente les néo-machiavéliens italiens Roberto Michels, Gaetano Mosca et Vilfredo Pareto. Pacifiste, se situant politiquement au centre-gauche, Bouthoul adhère à la franc-maçonnerie et collabore, semble-t-il, avec Paul Reynaud. Mais ses prises de position partisanes sont accidentelles au regard de son scepticisme politique foncier. Personne n’a plus souligné que lui « l’extrême pauvreté intellectuelle de la vie politique », la persistance dans le temps de quelques idées politiques basiques qui permettent de parler d’une infrastructure psychologique ou mentale dont les effets opèrent constamment sur la pensée et l’action politique. La politique est, selon lui, le degré le plus bas de l’activité intellectuelle. N’importe qui peut aspirer à une brillante carrière s’il est capable de réciter quelques slogans.
C’est en 1922 que le nom de Gaston Bouthoul est mentionné pour la première fois dans la Revue internationale de sociologie, organe de l’Institut international de sociologie fondé par le sociologue René Worms (1893). À partir de 1926, cette revue réputée est dirigée par un ami de Bouthoul, Gaston Richard, un disciple de Durkheim devenu anti-durkheimien. Collaborateur régulier de la Revue internationale de sociologie mais aussi du Mercure de France, le futur polémologue recense et commente les néo-machiavéliens italiens Roberto Michels, Gaetano Mosca et Vilfredo Pareto. Pacifiste, se situant politiquement au centre-gauche, Bouthoul adhère à la franc-maçonnerie et collabore, semble-t-il, avec Paul Reynaud. Mais ses prises de position partisanes sont accidentelles au regard de son scepticisme politique foncier. Personne n’a plus souligné que lui « l’extrême pauvreté intellectuelle de la vie politique », la persistance dans le temps de quelques idées politiques basiques qui permettent de parler d’une infrastructure psychologique ou mentale dont les effets opèrent constamment sur la pensée et l’action politique. La politique est, selon lui, le degré le plus bas de l’activité intellectuelle. N’importe qui peut aspirer à une brillante carrière s’il est capable de réciter quelques slogans.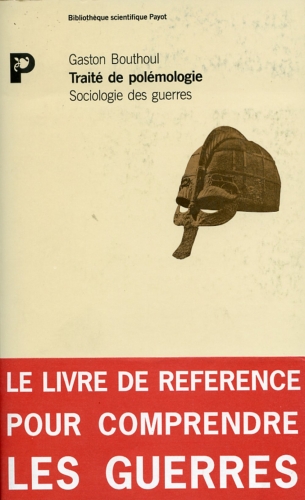 La profonde impression que produit la Deuxième guerre mondiale sur Bouthoul – l’hécatombe européenne et les effets de l’arme atomique -, réoriente sa vie intellectuelle. De retour à Paris en 1945, il fonde l’Institut Français de Polémologie pour l’étude scientifique des causes des guerres (IFP). La polémologie, c’est l’étude de la guerre considérée comme un phénomène d’ordre social et psychologique. Bouthoul cherche à remplacer le pacifisme idéologique par un pacifisme scientifique, c’est-à-dire une conception de la paix fondée sur l’étude multifactorielle du « phénomène guerre ».
La profonde impression que produit la Deuxième guerre mondiale sur Bouthoul – l’hécatombe européenne et les effets de l’arme atomique -, réoriente sa vie intellectuelle. De retour à Paris en 1945, il fonde l’Institut Français de Polémologie pour l’étude scientifique des causes des guerres (IFP). La polémologie, c’est l’étude de la guerre considérée comme un phénomène d’ordre social et psychologique. Bouthoul cherche à remplacer le pacifisme idéologique par un pacifisme scientifique, c’est-à-dire une conception de la paix fondée sur l’étude multifactorielle du « phénomène guerre ».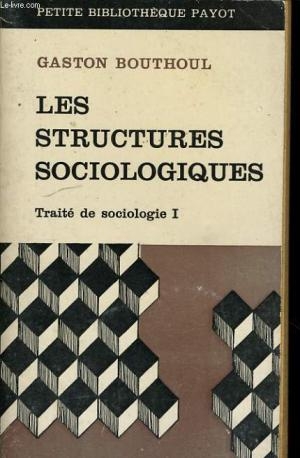 Bouthoul étudie la périodicité des guerres, leurs causes présumées et leurs fonctions sociales. Il remet en question toute forme de déterminisme économiciste qu’il soit d’inspiration libérale ou marxiste. Ce n’est pas l’économie, mais la démographie qui est « le facteur numéro 1 » de la guerre. Ni le dirigisme économique ni le libre-échange influent décisivement sur l’agressivité des nations. Il ne faut pas nier l’influence des facteurs psychologiques, culturels ou économiques, mais les circonstances de nature démographique sont celles qui comptent le plus.
Bouthoul étudie la périodicité des guerres, leurs causes présumées et leurs fonctions sociales. Il remet en question toute forme de déterminisme économiciste qu’il soit d’inspiration libérale ou marxiste. Ce n’est pas l’économie, mais la démographie qui est « le facteur numéro 1 » de la guerre. Ni le dirigisme économique ni le libre-échange influent décisivement sur l’agressivité des nations. Il ne faut pas nier l’influence des facteurs psychologiques, culturels ou économiques, mais les circonstances de nature démographique sont celles qui comptent le plus.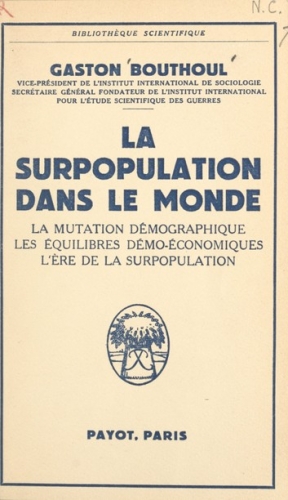 Durant toute sa vie, Bouthoul publie des centaines d’articles et une bonne vingtaine de livres dont les titres sont éloquents. Parmi eux citons : Cent millions de morts (1946), Huit mille traités de paix (1948) [pas moins de 8000 traités de paix « qui devaient durer éternellement » ont été conclus entre l’année 1500 av. J.-C. et 1860], Les guerres, éléments de polémologie (1951), Le phénomène-guerre (1962), Sauver la guerre : lettre aux futurs survivants (1962), La surpopulation dans le monde (1964), L’art de la politique (1969), L’infanticide différé (1970), Essais de polémologie ( 1976) ou encore, en collaboration avec René Carrère et Jean-Louis Annequin, Le Défi de la guerre de 1740 à 1974 (1976) et Guerres et civilisations (1979).
Durant toute sa vie, Bouthoul publie des centaines d’articles et une bonne vingtaine de livres dont les titres sont éloquents. Parmi eux citons : Cent millions de morts (1946), Huit mille traités de paix (1948) [pas moins de 8000 traités de paix « qui devaient durer éternellement » ont été conclus entre l’année 1500 av. J.-C. et 1860], Les guerres, éléments de polémologie (1951), Le phénomène-guerre (1962), Sauver la guerre : lettre aux futurs survivants (1962), La surpopulation dans le monde (1964), L’art de la politique (1969), L’infanticide différé (1970), Essais de polémologie ( 1976) ou encore, en collaboration avec René Carrère et Jean-Louis Annequin, Le Défi de la guerre de 1740 à 1974 (1976) et Guerres et civilisations (1979).