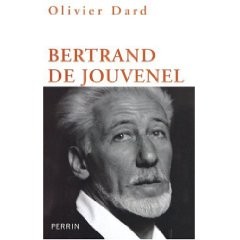dimanche, 02 novembre 2008
Une biographie de Bertrand de Jouvenel
00:12 Publié dans Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : france, politique, sciences politiques, théorie politique, politologie, futuribles |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Misère des intellectuels de "droite"

ARCHIVES DE SYNERGIES EUROPEENNES - 1997
Misère des intellectuels de “droite”
L'option métapolitique de la “nouvelle droite” est, dans l'espace culturel germanique, une importation française. La ND, regroupée autour d'Alain de Benoist, a tenté d'adapter à la droite la théorie du communiste italien Antonio Gramsci, à un moment de l'évolution de cette droite, moment où elle se demandait quels étaient les véritables ressorts de la société. Point de départ de Gramsci: la société n'est mue que partiellement par les groupes politiques visibles, c'est-à-dire les partis. Plus essentielle est la superstructure idéelle de la société, où sont façonnées valeurs, morale et idées. La tâche des “intellectuels organiques” serait alors de mener un combat culturel au sein même de cette superstructure, combat dont le but ultime ne peut être que la révolution. D'après Gramsci, on ne peut donc révolutionner une société que si l'hégémonie culturelle qui la régente est brisée, c'est-à-dire quand les tenants de cette hégémonie ne croient plus en eux-mêmes. C'est alors que les valeurs révolutionnaires prennent le pas sur les valeurs dominantes fragilisées et deviennent graduellement hégémoniques. Le combat culturel mené par les intellectuels devient dans une telle optique la stratégie principale du “révolutionnement” politique de la société.
Dieter Stein, le directeur de l'hebdomadaire néo-conservateur berlinois Junge Freiheit, a analysé très justement cette vision gramscienne de la révolution, qui ne survient que par le biais de la culture; au bout de son analyse, il lance un avertissement: une telle vision de la révolution culturelle pourrait déboucher sur une “political correctness” de droite (cf. JF n°8/97). Si je trouve la critique de Stein pertinente, cela ne veut pas dire que je juge le point de vue de Gramsci incorrect. C'est aujourd'hui précisément que nous constatons que la “superstructure intellectuelle”, c'est-à-dire les médias, a acquis une puissance bien trop considérable, tant et si bien que les hommes politiques ne sont plus que des figurants pour les émissions d'actualité. La puissance qu'ont acquises les émissions de “talkshows” est emblématique et révèle un phénomène inhabituel, soit la “pluralisation totale” de la société mais avec pour corollaire paradoxal la réduction de tout aux idéaux du plus grand nombre, du “brave quidam”, du “Gutmensch” (ndt: ce terme est ironique; il a été forgé par les critiques allemands de la “PC”). C'est cette contradiction qui produit la “political correctness” (PC), qui, lorsqu'elle aura atteint son stade idéal, sera une censure bien installée dans l'intériorité même des citoyens. Cette nouvelle intériorité auto-contrôlée produit un discours mortifère, un discours assassin, qui frapperait abruptement toute personne qui, pour une raison ou une autre, serait déclarée non “politiquement correcte”. Tous ceux qui entendent ignorer les gestes symboliques et rituels de la PC, tous ceux qui ne se sentiraient pas “concernés” par ses gestes et ses agitations, tous ceux qui avanceraient un certain type d'arguments non conventionnels seraient purement et simplement “morts”, du moins au sens figuré.
Pourtant, à droite, beaucoup de militants souhaiteraient, eux aussi, l'avènement d'une telle “censure intérieure”. Mais qui serait tout simplement de signe opposé. Ceux qui ne détiennent aucune puissance politique développent souvent des fantasmes de toute-puissance, mais d'une toute-puissance basée sur d'autres critères que ceux maniés par la toute-puissance en place. Quoi d'étonnant, dès lors, que le concept narcotique d'“hégémomie culturelle” ait été importé de France en Allemagne par des groupuscules qui ont voulu, dans un premier temps, divulguer les aspects intéressants de la nouvelle droite française, mais se sont enlisés, finalement, dans la prédication d'une “stratégie rédemptrice” et, pire, ont fini par aller faire de la formation dans des groupuscules néo-nazis interdits.
La trajectoire du néo-droitisme gramscien est triste, mais cette tristesse provient de plusieurs causes:
1. Il n'existe pas de “nouvelle droite” unitaire.
2. Si, au départ, les intellectuels de droite se voulant gramsciens ont souhaité l'émergence d'un débat, ils se sont rapidement enlisés dans la recherche d'une “Weltanschauung” idéale.
3. La “Révolution conservatrice” n'est pas pour eux une mine de concepts intéressants pour affronter le monde actuel, mais, plus prosaïquement, l'occasion de répéter à satiété un discours invariable, fait d'invocations stériles.
4. Ces intellectuels de droite se sont créé un petit monde, hermétiquement protégé de l'effervescence du réel.
Il n'existe pas “UNE” nouvelle droite. C'est pourtant clair: il suffit de comptabiliser tout ce que l'on vend au public sous cette appelation. Dans ce bric-à-brac, il y a toujours quelque chose de “plus neuf”. Dans les années 60, on disait des nationaux-révolutionnaires allemands qu'ils étaient la “nouvelle droite”. Mais, il n'est pratiquement rien resté de cette école nationale-révolutionnaire. Son espace idéologique était à l'intersection de la gauche et de la droite. Les nationaux-révolutionnaires affirmaient qu'ils n'étaient ni de droite ni de gauche: ils n'ont pas survécu sur la scène politique. Hennig Eichberg, qui, à cette époque, était la tête pensante de cette “nouvelle droite”, se considère aujourd'hui comme un homme de gauche. Beaucoup de nationaux-révolutionnaires de ces années 60 se retrouvent aujourd'hui chez les Republikaner.
Quant à la “nouvelle droite” la plus récente, elle a fini par démontrer qu'elle était au fond “conservatrice”, mais elle s'adresse à de plus larges catégories sociales que ses ancêtres de la nouvelle droite de 1968 qui tentaient d'apporter une réponse aux intellectuels de gauche et à la sottise de la vieille droite. Plus typés étaient les néo-droitistes —quelques personnes et quelques journaux— qui voulaient et veulent faire de leur nouvelle droite un projet de modernisation de l'extrême-droite. Cette catégorie de “néo-droitistes” reste la plus problématique, car, au fond, elle se borne à sortir de la naphtaline la “pensée anti-démocratique” de l'époque de Weimar (telle que l'a définie Kurt Sontheimer). Par cet exercice, elle veut hisser la pensée de l'extrême-droite à l'excellent niveau et à la belle forme, acquis par la “révolution conservatrice” sous Weimar.
A côté de ces “requinqueurs” de vieux corpus, s'est regroupée une autre “nouvelle droite”, composée pour l'essentiel de conservateurs (en Allemagne) ou de nationaux-libéraux et de conservateurs (en Allemagne et en Autriche). Ils ont abordé sans complexe la pensée moderne, ils ont, en ce sens, été conséquents, ont modulé leur action sur ce choix et ont investi les territoires politiques assignés par convention sociale à ces idéologies bourgeoises, bien ancrées et établies. Ces entristes, qui ont pénétré dans les rouages de la CDU, de la CSU ou de l'ÖVP, voire de la FDP ou de la FPÖ, sont de braves citoyens, ils sont tout simplement un petit peu à droite que les autres.
Si l'on mélange ces deux courants sous l'appelation commune de “nouvelle droite”, on débouche évidemment dans un beau désordre, sinon dans une aporie intellectuelle. Les “nouvelles droites” ancrées dans les diverses formes d'extrémismes droitiers confondent la volonté de débattre intellectuellement avec la proclamation impavide d'une Weltanschaunng ancienne, dont elles ont la nostalgie. Pour sortir de cette impasse, on recourt généralement à deux stratagèmes, dont on use et on abuse:
- soit on recommence à se référer directement aux racines théologiques du politique, en tentant de formuler un nouveau projet de “théologie politique”, dans le sens où l'entendait Carl Schmitt,
- soit on s'efforce de séculariser ce besoin d'absolu.
Dans ce cas, on se tourne vers d'autres certitudes, des certitudes immanentes, comme le “peuple” (Volk), des certitudes idéalistes, comme cette “science des citoyens d'Empire” de facture hégélienne, plus exactement mi-hégélienne-de-gauche, mi-hégélienne-de-droite, à l'usage de citoyens qui ne vivent plus dans un Reich et ne souhaitent certainement pas y revivre, les plages de Torremolinos ou des Baléares ayant pour eux plus d'attraits... Les multiples expressions de ces exercices para-théologiques ou “hégélisants” varient considérablement: les plus “sortables” ne sont “que” autoritaires, mais, dans la plupart des cas, le mode totalitaire est bien vite accepté, illustré et défendu...
C'est dans ces recherches et ces tâtonnements qu'il faut replacer l'engouement pour la “révolution conservatrice” de l'entre-deux-guerres. Soyons clairs et honnêtes: cette “révolution conservatrice” est une mine d'or, elle ne cesse de susciter les intérêts des philosophes et des politologues, à juste titre; il est intéressant d'en étudier tous les aspects si l'on veut connaître l'archéologie de certaines pensées aujourd'hui classées à “droite”, si l'on veut se plonger dans des corpus entièrement différents de l'idéologie dominante actuelle, si l'on veut lire de “mauvais livres” au regard des catégories politiques contemporaines. En pratiquant ainsi une forme de transversalité, indubitablement, on se forme l'esprit, on acquiert un sens critique, on aiguise ses intuitions. La “révolution conservatrice” nous apprend que les hommes de droite n'ont pas toujours été bêtes. Mais, en réceptionnant la “révolution conservatrice” de cette sorte, on ne doit pas non plus oublier qu'elle fut un échec. Ni oublier qu'elle fut, en bon nombre de ses aspects, antidémocratique et partiellement extrémiste. Aujourd'hui, notre regard doit se porter sur elle avec le même sens critique que sur les corpus de gauche de la même époque. Malheureusement, pour beaucoup d'hommes de droite actuels, de militants, cette “révolution conservatrice”, dans ses innombrables variantes, n'est que prétexte à répétitions, à dévotions naïves et bigotes, répétitions et dévotions qui remplacent toute intellectualité autonome ou permettent des exercices pénibles comme réitérer une attitude antidémocratique classique en citant des extraits d'auteurs “révolutionnaires-conservateurs”, pour faire intelligent ou pour donner le change.
Le résultat de tout cela est lamentable, car une telle nouvelle droite paraît toujours bien vieille, elle parait truffée de science, elle se gargarise de sa belle Weltanschauung prête-à-porter, mais elle n'est quasi pas branchée sur la réalité. Car la belle Weltanschauung néo-droitiste n'est qu'une construction intellectuelle consolatrice pour tous ceux qui sont laissés-pour-compte dans la société réellement existante. Les plus lucides d'entre eux savent certes que le “peuple” (Volk) de leur idéologie n'est pas le peuple réel qui circule dans les rues d'Allemagne. Mais ce sont les “autres” qui sont coupables de cette inadéquation. Le peuple devrait correspondre à leur image du peuple: nous n'avons plus affaire là à de la nostalgie, à la nostalgie d'une “hégémonie culturelle” de droite, conservatrice, mais la rage de voir partout l'inadéquation génère subtilement une sorte de totalitarisme, camouflé derrière un verbiage conservateur, qui se veut apaisant, moral et “traditionnel”.
Au bout du compte, nos intellectuels de la “nouvelle droite” sont soit des modernisateurs de l'extrémisme, soit des bourgeois à un âge où il n'y a plus de bourgeois classiques, cultivés et conventionnels. Cette alternative, dont les deux termes sont également figés, est le résultat de la ghettoïsation des droites. Elles marinent dans leur jus. Alors que reste-t-il de la “nouvelle droite”?
Il reste sans doute quelques intellectuels de droite, qui se posent en anarchistes pour ne pas sombrer dans le dogmatisme, pour ne pas se laisser aveugler par les illusions. La réalité prosaïque, c'est qu'il n'y a dans le monde ni consolation ni rédemption. Mais, justement, ce n'est pas la tâche des intellectuels de droite de proposer de la consolation et d'annoncer une rédemption: au contraire, ils devraient se donner pour seule mission de déconstruire systématiquement toute idéologie de la consolation et de la rédemption. Travail difficile: en effet, c'est la meilleure façon de se faire mal aimer de tous; les uns détestent le “déconstructiviste” parce qu'il ne partage par leur illusion et n'apporte donc pas de quoi l'alimenter, de quoi entretenir la consolation; les autres le détestent tout autant parce qu'ils sont de gauche ou libéraux, qu'ils appartiennent à des espaces politico-philosophiques dans lesquels, forcément, le déconstructiviste n'aimera pas aller mariner: au contraire, il aimera les détricoter avec une égale délectation. Le véritable intellectuel de la nouvelle droite devrait être celui qui d'emblée se définit comme l'homme sans aucune illusion.
Nos sociétés souffrent d'une absence de créneau critique. Pourtant, aujourd'hui plus qu'auparavant, le terme “critique” est le vocable le plus prisé des hommes de gauche, au point qu'ils identifient les mots “gauche” et “critique”. L'école de Francfort, réservoir idéologique de la gauche, s'est effectivement auto-dénommée “critique”. Mais la gauche ne critique plus, elle accepte le statu quo et gère la crise. Automatiquement, dans un tel contexte, la pratique de la critique incombe alors à la droite. Pire, si un homme de gauche pratique encore la critique, il sera désormais traité de “fasciste” ou de “crypto-fasciste” par ses coreligionnaires (Botho Strauss, même Peter Handke, le cinéaste Fassbinder, le dramaturge Heiner Müller, héritier du théâtre de Brecht).
Pour nous, la démarche “critique”, c'est d'affronter les aléas du réel sans s'embarresser de tabous. L'actuelle “political correctness” instaure de nouveaux tabous et aboie son hostilité à l'égard de tout discours, de tout débat, et justifie ces tabous et ces aboiements au nom d'idées de gauche. Forcément, l'homme de droite sera celui qui s'opposera avec énergie à ces tabous et à ces aboiements: il se dira de droite parce que ces tabous et ces aboiements se disent de gauche. Il rejettera la “political correctness” parce qu'elle refuse tout discours et tout débat. Il restaurera le débat par le simple fait de prendre la parole de force, en avançant des arguments de signes nouveaux ou de signes contraires. Cet acte de prise de parole constitue une pluralisation volontaire du discours et place l'homme de droite —nouveau contestataire radical— au centre même de la vie sociale en danger de rigidification définitive. Il reconnaît alors que la confrontation des idées n'est possible que dans une société marquée du sceau du pluriel. L'intellectuel de droite prend dès lors position pour un ordre social où règne la liberté et où s'épanouit la diversité. Il défend cette liberté précisément parce que ses idées sont bannies et ostracisées dans une société qui devient de moins en moins plurielle et différenciée. Sa tâche consiste à réfléchir et à chercher. Car celui qui connaît les réponses avant de formuler ses questions, tombe dans le piège du totalitarisme.
Que reste-t-il de la “nouvelle droite”? Sans doute un homme de droite qui n'est plus un homme de droite au sens conventionnel du terme. Un homme qui part à l'aventure dans la vie ou dans les épaisses forêts de la pensée, car il sait que rien n'est définitivement sûr, que ce savoir de l'incertitude universelle fait de lui le meilleur critique des conventions figées de la société, mais d'une société dont il connaît les ressorts (organiques), parce qu'il en est issu.
Jürgen HATZENBICHLER.
(Correspondant de “Synergies Européennes” en Carinthie, responsable de la chronique politique de Junge Freiheit/Autriche; article paru dans Junge Freiheit, n°16/97; traduction et adaptation françaises de Robert Steuckers).
00:10 Publié dans Nouvelle Droite | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : droite, conservatisme, critique, philosophie, théorie politique, politique, gauche |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 01 novembre 2008
Atlas militaire et stratégique
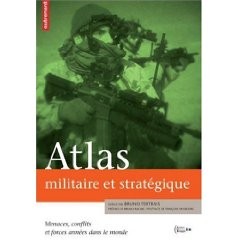
00:15 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, stratégie, armées, militaria, politique, théorie politique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Pour définir les corps concrets de la souveraineté

Pour définir les corps concrets de la souveraineté
Il y a déjà longtemps, depuis des horizons différents, on a reconnu le fait que l'imaginaire moderne s'est constitué en bouleversant de fond en comble et en évidant radicalement le mode traditionnel de comprendre l'homme et sa place dans le monde. Selon ce mode traditionnel, l'homme tire ses qualités d'une appartenance à une communauté et les droits dont il dispose sont l'expression des statuts sociaux et des liens qui y correspondent.
Au contraire, pour l'imaginaire moderne, l'individu est par nature libre et auto-suffisant, avant même d'entretenir des relations sociales avec d'autres individus. Une telle (sur)valorisation de l'individu implique un rejet automatique de tous les fondements métaphysiques et religieux structurant l'ordre social et postule l'élimination implicite de tous les liens de dépendance à l'égard de pouvoirs personnels ou sociaux. C'est pour cette raison que la démocratie moderne, avant de représenter un certain régime politique, exprime surtout la force par laquelle se manifestent 1) l'exigence d'égalité des conditions et 2) la reconnaissance de cette égalité fondamentale pour tous les hommes.
Si tout cela constitue la conscience moderne telle qu'on la pressent encore aujourd'hui, quoique de façon moins vive, en revanche, on se rend parfaitement compte que l'imaginaire moderne a substitué au lien social l'idée d'un rapport juridique entre les hommes. De par cette substitution, l'individu peut entrer en rapport avec les autres seulement par le biais de lois ou d'un contrat juridiquement sanctionné. Ensuite vient l'“invention” de l'Etat, instance posée comme la représentante de la collectivité et conçue comme autorité abstraite et comme pouvoir impersonnel détenant le monopole légal de la violence. Le droit se pose alors comme le principe organisateur par lequel les individus singuliers entrent dans des rapports de réciprocité officiels, mais, simultanément, en dehors de tels rapports (juridiques), les individus n'entretiennent plus que des relations sociales désormais considérées comme dépourvues de significations et non sanctionnables normativement.
La “société des hommes”, en somme, devient une société exclusivement juridique, une société qui s'identifie uniquement à l'institution juridique, laquelle impose des interdits et fixe le rapport qui relie entre elles les volontés individuelles. L'individu moderne peut être entièrement libre, mais seulement à condition qu'il exerce sa liberté sur le modèle de la liberté juridique, c'est-à-dire une liberté d'utiliser dans l'abstrait toutes les normes juridiques. En revanche, il lui est interdit de modifier par la force les conditions matérielles dont il dépend, ce qui a pour effet pratique de l'empêcher d'utiliser réellement ce qui lui est autorisé formellement. Tel est le caractère inédit de la modernité. D'une part, la société n'existe plus officiellement que dans la trame des rapports qui se sont institués par le truchement du droit contractuel. D'autre part, l'égalité juridique ne concrétise plus que la seule parité formelle, mais permet que se reproduisent les disparités économiques et sociales, sous prétexte que celles-ci seraient générées par des rapports privés, dépourvus, en tant que tels, de pertinence juridique.
L'égalité moderne, en fait, ne considère les individus que sur le seul plan abstrait et jamais dans leurs déterminations concrètes et particulières. Cela veut dire que l'égalité face à la loi ne garantit pas l'égalité face au pouvoir de disposer des moyens nécessaires à produire des ressources matérielles. Les règles juridiques qui fondent la citoyenneté politique sont —comme on l'a relevé maintes fois— des règles exclusivement instrumentales qui ne distribuent nullement des ressources mais définissent seulement des modalités d'action mises en théorie à la disposition de chacun, pour réaliser ses propres fins privées. Cette “systématisation” théorique et fonctionnelle 1) occulte les profondes contradictions qui affectent la démocratie moderne (surtout la contradiction entre son aspiration à l'égalité et le maintien effectif d'une structure sociale qui produit et reproduit continuellement des inégalités) et 2) cache ce processus pervers qui est à l'œuvre et où l'égalité formelle fait continuellement émerger des inégalités substantielles. Conséquence: l'“Etat de droit” est fortement mis en crise, de même que les formes du droit qui corrobore l'égalité et que l'équation sujet égal = droits égaux.
de l'égalité formelle à l'égalité substantielle par la participation
Dans un tel cadre, l'égalité substantielle trouve toutes les raisons qui lui permettent de se poser comme la finalité de l'ordre juridique et de réclamer la participation égale de tous dans la production des lois. Le formalisme de l'égalité doit dès lors être dépassé et complété par la pratique de la participation de tous aux décisions, de façon 1) à ce que cette participation prenne concrètement le relais de l'idée d'égalité devant la loi et 2) à introduire dans la pratique la participation égale de tous à la production des normes. On ne s'étonnera pas du fait que le problème de la citoyenneté —et des prérogatives et des contenus qu'elle implique— est aujourd'hui prêt à exploser et à libérer toutes sortes de tensions. Pour éviter cette explosion, on prétend que la citoyenneté-égalité doit se muer en citoyenneté-participation, une participation directe à la formation de la volonté générale. Parce qu'il est nécessaire que tous se voient attribuer des ressources et des biens nécessaires à leur auto-reproduction, on en arrivera obligatoirement au passage d'une citoyenneté politique à une citoyenneté économique et sociale. Mais seule une théorie de la démocratie-participation permettra aux citoyens d'élaborer et de choisir des fins communes, ce qui, en fait, pourra instituer une juste articulation entre droit et politique ainsi qu'entre droit et justice sociale.
Mais est-ce trop demander à ce droit-là, qui n'a jamais réussi qu'à assécher la démocratie, de se dépasser lui-même? Peut-être. Mais nous ne saurions négliger aucune tentative de promouvoir une nouvelle vision de la démocratie, c'est-à-dire une démocratie capable de faire passer la souveraineté du peuple (?) de la dimension abstraite, dans laquelle elle est aujourd'hui confinée, à une “carnalité” citoyenne, qui tienne pleinement compte des spécificités des hommes et de leur concrétude existentielle. Si l'on se souvient brièvement de l'histoire de la souveraineté à l'époque moderne, on constatera qu'elle s'est déployée en deux séquences: elle a d'abord placé le détenteur de la souveraineté dans la personne du Prince, ensuite dans le Peuple. Et a assuré ainsi le passage d'une formulation personnelle et patrimoniale de la souveraineté, typique de l'autorité princière du XVième siècle, à une formulation impersonnelle, inaugurée à la fin du XVIIIième siècle par la révolution française. Mais s'il est vrai qu'en démocratie le peuple n'obéit plus à un roi, il est tout aussi vrai de dire que c'est seulement par un artifice rhétorique qu'en démocratie le peuple obéit à lui-même en obéissant aux lois.
En réalité, l'élément “peuple” introduit dans l'histoire de la souveraineté l'autonomie de la loi dans l'Etat. L'Etat justifie son existence par le “peuple” et, par la loi, il justifie l'autorité qu'il exerce sur ce même peuple. Dans un tel contexte, le “corps” par lequel vit la souveraineté, n'est plus celui du roi, mais n'est pas encore celui des citoyens. Formellement, l'Etat est la traduction juridique du peuple, mais cette entité abstraite qu'est le peuple, à ce niveau-ci, se matérialise dans des groupes restreints, des pouvoirs privés, qui confisquent de fait cette souveraineté au peuple, qui est théoriquement son seul dépositaire.
citoyenneté effective ou barbarie
IL faut dès lors amorcer une nouvelle séquence dans l'histoire de la souveraineté et trouver une nouvelle “figure”, dans laquelle la titularité personnelle et patrimoniale puisse s'incarner, cette fois dans des corps concrets de citoyens. Certes, bon nombre de difficultés surviennent quand on formule un projet de cette sorte. La marge d'aléas est grande, c'est certain, mais si les technocrates voulaient bien investir dans un tel projet une fraction minimale des énergies et du temps qu'ils consacrent à inventer des réformes mortes-nées, ils trouveraient très probablement —et très vite— des solutions acceptables aux multiples problèmes que pose la mise en œuvre d'une démocratie participative et substantielle. Il y a urgence. Nous sommes à la croisée des chemins et nous devons choisir: ou bien nous implantons rapidement une citoyenneté effective ou nous sombrons dans la barbarie.
Giuliano BORGHI.
(texte paru dans Pagine Libere, n°10/1995; trad. franç. : Robert Steuckers).
00:10 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, philosophie, souveraineté, souverainisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
vendredi, 31 octobre 2008
Par sa foi en la machine...
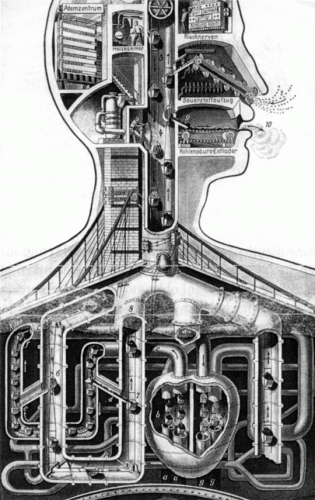
Par sa foi en la machine...
"En faisant de l’homme, par un lavage de cerveau édulcoré, le soldat de quelque religion progressiste, on obtient de surcroît, par simple croyance au progrès, par sa foi en la machine, en la production, en l’abondance, qu’il se soumette spontanément et de bonne grâce aux rites, navettes et circuits, qui lui sont ménagés par la société de production et qui correspondent à ce qu’on a défini comme ses besoins. Ainsi, dans la dénaturation progressiste moderne, l’homme est dépouillé d’une façon bien plus subtile, mais non moins complète que dans l’aliénation purement économique que dénonçait Karl Marx, par laquelle le travailleur était privé du produit de son travail, et par conséquent de son aisance et d’une partie de sa vie : il est subrepticement privé de sa vie qu’on transforme en loisirs et distractions préfabriquées, par là étrangères à lui, et, en outre, il est privé de sa personnalité même qu’on lui soutire et qu’on remplace à son insu par un produit incolore et inoffensif qu’il prend pour lui-même.
Le prétexte de cette dénaturation est le bien-être du plus grand nombre. Cette préoccupation existe en effet, elle est sincère. Mais elle est inséparable d’une disposition qui abhorre secrètement, comme contraire au bien-être du plus grand nombre justement, toute image de l’homme nerveuse, originale, volontaire, qui pourrait propager la maladie contagieuse du refus de la médiocrité. Ainsi notre « civilisation » fait-elle le contraire de toutes les grandes civilisations qui se sont proposés comme idéal un type humain supérieur et chez lesquelles cette culture d’une plante humaine réussie était même la justification essentielle."
Maurice BARDECHE, Sparte et les sudistes, Phytéas, Montrouge, 1994, p. 31-32.
00:26 Publié dans Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : anthropologie, philosophie, france |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Over Arthur Mahraun en zijn Jungdo

Gevonden op: http://www.jorisvanseveren.org
Piet Tommissen, Ukkel
Wie zijn licentiaatsverhandeling aandachtig gelezen heeft, weet dat het Luc Pauwels (°1940) er om te doen is, een “quasi volledig braakliggend terrein”1 - in casu de ideologische evolutie van het denken van Joris van Severen - in kaart te brengen. Te dien einde bestudeert hij een aantal streng geselecteerde grondbegrippen, daarbij verwijzend naar eventuele bronnen. Wat dit laatste punt betreft deelt hij de mening van professor Eric Defoort (°1943) en beschouwt Charles Maurras (1868-1952) dus niet als een, laat staan als dé leermeester van de stichter en leider van het Verdinaso.2 Hij citeert wel andere auteurs die op Van Severen invloed uitgeoefend hebben, o.m. de markies René de la Tour du Pin de la Charce (1834-1924), Georges Sorel (1847-1922)3, Georges Valois (ps. van Alfred-Georges Gressent; (1878-1945), zelfs - voor mij een complete verrassing - de Duits-Joodse anarchist Carl Landauer (1870-1919), e.a.

Tot mijn verbazing maakt Pauwels geen gewag van Artur Mahraun (1890-1950), ofschoon Van Severen hem, of juister zijn Jungdeutsche Orden (afgekort: Jungdo), tweemaal in De West-Vlaming vernoemt. De eerste keer in 1929 bij wijze van voorbeeld, de tweede keer in 1930 i.v.m. het verschil tussen de begrippen volk en natie.4 Tenzij ik me vergis heeft Arthur de Bruyne (1912-1992) in de secundaire literatuur als allereerste Mahraun vernoemd, helaas zonder nadere toelichting.5 De verdienste de kijker op deze man, zijn ideeën en zijn organisatie te hebben gericht, komt toe aan de heren Jan Creve (°1962) en Maurits Cailliau (°1938).
Eerstgenoemde meent dat “een direct aanwijsbare band tussen Mahraun en Van Severen niet bestaat”, doch voegt er onmiddellijk bij: “bepaalde passages uit Hier Dinaso! lijken soms zelfs woordelijk overgenomen uit Der Jungdeutsche.”6 De heer Cailliau stipt in een voetnoot aan dat het opus 10 Jahre Jungdeutscher Orden in de bibliotheek van Van Severens aanwezig was, “wat er op wijst dat hij Mahrauns beweging volgde.”7
Terwijl Creve niet uitsluit dat Van Severen de Jungdo leerde kennen, hetzij via de dichter Wies Moens (1898-1987), hetzij via priester Maurits Geerardijn (1896-1979), hetzij via de contacten die sinds 1926 bestonden tussen Valois en Barrès (niet Maurice [1862-1923] doch diens zoon Philippe [1896-?]) en de Jungdo.8 Zijnerzijds wijst Cailliau er op dat de Jungdo model heeft gestaan bij de oprichting door priester Robrecht de Smet (1875-1937) van de Jong Vlaamsche Gemeenschap (1928-31). omgedoopt in Jong Nederlandsche Gemeenschap (1931-35), maar rept met geen woord over Van Severen.9
Zelf heb ik in het begin van de zestiger jaren der vorige eeuw een artikel over Mahraun en zijn Jungdo gepleegd, na bij Wolfgang Lohmüller. de toenmalige voorzitter van de in december 1953 in het leven geroepen .Artur-Mahraun-Gesellschaft, mijn licht te hebben opgestoken. Waarschijnlijk was het artikel bestemd voor het door Jan Olsen (°1924) opgericht en tot het laatste nummer toe geleid maandblad Het Pennoen (1950-77). Waarom ik het finaal niet verzonden heb, is me helaas ontgaan. Het ligt ten grondslag aan het thans volgende exposé, als aanloop tot een door jongeren te onderzoeken beïnvloeding van Van Severen door Mahraun.
Mijn proeve doet dus in genen dele afbreuk aan mijn respect voor het degelijk werk van de heren Creve en Cailliau. Integendeel zelfs: het wil me voorkomen dat hun en mijn teksten zich aanvullen i.p.v. zich te overlappen. Het is me overigens opgevallen dat we alle drie wel eens andere bronnen raadplegen!10 Alvorens mijn exposé voor te leggen wens ik de heren Cailliau en Dr. Wim van der Elst nog snel te bedanken voor de vlotte ‘levering’ van enkele fotokopies, resp. een stel levensdata.
De in 1890 in Kassel als zoon van een hogere ambtenaar geboren Artur Mahraun werd in zijn jeugdjaren sterk beïnvloed door de geest van de toenmalige Jugendbewegung. Men mag gerust stellen dat zijn latere opvattingen al grotendeels vervat liggen in datgene wat hij als lid van de jeugdbeweging leerde belijden: de afkeer van de grootstad, de natuurverbondenheid, het primaat van de vriendschap, de belangstelling voor groepsverband op vrijwillige grondslag, en dies meer.
In 1908 nam Mahraun dienst in een infanterieregiment, dat nog het Pruisisch princiep “meer zijn dan schijnen” huldigde. In dat midden kreeg hij tevens inzicht in het dieper wezen van hiërarchie en tucht: die ervaring ligt wellicht aan de basis van het achteraf door hem gehuldigd autoriteitsbeginsel. Tijdens Wereldoorlog I - terloops weze aangestipt dat hij o.m. bij de strijd om Luik in de voorste gelederen streed - kwam daar nog het Kriegserlebnis bij: het vormt de derde bron van zijn toekomstig politiek denken en handelen.
Als hoog gedecoreerde luitenant werd Mahraun in 1918 in Kiel door de matrozenopstand verrast en er tot in het diepst van zijn wezen door geschokt. Hij bleef enige tijd bij de Reichswehr en zwaaide in de rang van kapitein af. In januari 1919 was hij evenwel reeds begonnen met de opbouw van een vrijwilligerseenheid, de Offiziers-Kompanie Kassel, die in zijn geboortestad plunderingen voorkwam en daarna meehielp bij de onderdrukking van de spartakistenopstand in Türingen. Deze eenheid werd evenwel bij besluit van de Rijkskanselier in 1920 ontbonden, net zoals de andere vrijwilligerseenheden (Freikorpse). Voor Mahraun de ideale gelegenheid om op 17 maart 1920 de Jungdeutsche Orden te stichten
Deze piepjonge organisatie, in de wandeling Jungdo genoemd, onderstreepte uitdrukkelijk dat ze geen Verein wenste te zijn naast de talrijke bestaande Vereine en het beklemtonen van haar ‘orde’-karakter is haar succes voorzeker ten goede gekomen: begin 1922 telde men 200 afdelingen en ruim 75.000 leden! Onder hen persoonlijkheden die reeds naam gemaakt hadden, zoals de Germanenvorser Kurt Pastenaci (1894-1961) en een paar generaals, of die het tot een zekere beroemdheid zouden brengen, zoals de staatsrechtsleraar Reinhard Höhn (1904-2000)11 en waarschijnlijk ook Albert Leo Schlageter (1894-1923).
Qua organisatie vertoonde de Jungdo gelijkenis met de middeleeuwse Ritterorden. Immers, Mahraun was de Hochmeister die met zijn commandanten (Komturen) de gewesten (Balleien) en - het laagste echelon - de plaatselijke afdelingen (Bruderschafien) en de in universiteiten geboren groepen (Hochschulgesellschaften) bestuurde. Regelmatig kwamen de leden (Brüder) in algemene ledenvergaderingen (Bruderkonvente), de leidende leden (Meister) in kapittels (Kapitel) samen. In afwijking van wat in vrijwel alle gelijkaardige organisaties niet gebeurde, werden de leden van de Jungdo wèl regelmatig en intensief geschoold (lessen gegeven tijdens politieke avondbijeenkomsten) én getraind (weersportoefeningen). Bovendien kregen ze de afkeer voor uitheemse muziek ingeënt en werd de meisjes het bubikopf-kapsel, het dragen van pullovers en trenchcoats ten zeerste afgeraden. Niet te vergeten dat in een krant, een tijdschrift en brochures de leer tot in den treure uiteengezet en/of gepropageerd werd.
Schone liedjes duren zelden lang. Dat ondervond ook de Jungdo. Kort achter mekaar werd de orde verboden en gedeeltelijk ontbonden; de eerste keer i.v.m. de mislukte Kapp-putsch12, de tweede maal na de moord op minister Walther Rathenau (1867-1920) door rechtse extremisten waaronder de auteur Ernst von Salomon (1902-1972). Doch de leiding zette de werfactie gewoon voort en richtte geheime afdelingen op. In die moeilijke periode ging Mahrauns echtgenote zelfs met de eerste bundeling van jonge vrouwen, de Schwesternschaft, van start. Het duurde tot in 1923 alvorens het Geusenhilfswerk begon te functioneren: alleen al in de maand oktober werd in Kassel aan 7.000 behoeftigen een warme maaltijd aangeboden.13
Pijnlijker was het feit dat men zich ook van katholieke zijde voor het Jungdo-verschijnsel ging interesseren. Het begon in 1924 met een venijnig geschrift van de franciscaan Erhard Schlund (1888-1953)14, weldra gevolgd door banbliksems vanuit de bisschoppelijke zetels Paderborn en Breslau. Deze reacties waren het logisch uitvloeisel van het koketteren van de Jungdo met Duits-religieuze, lees: nieuw-heidense, stromingen én met het oogluikend dulden van de invloed van de anthroposofie van Rudolf Steiner (1861-1925). Wanneer men weet dat het in Westfalen vooral priesters en jonge kapelaans waren die de Jungdo-afdelingen leidden. begrijpt men de bezorgdheid vanwege Mahraun. Die decreteerde zonder dralen het nieuw parool: “Geef het volk wat het volk en God wat God toekomt.”
Bijna gelijktijdig ontstond in de schoot van de orde gemor over Mahrauns Franzosenpolitik. Deze politiek beoogde een Duits-Franse toenadering, ja zelfs samenwerking, en dat zag menig Jungdo-lid niet zitten. Zo min trouwens als het feit dat de potasmagnaat Arnold Rechberg (1879-1947), een rabiate antibolsjewist en om die reden het initiatief van Mahraun genegen, die politiek financieel steunde.15 Wat er ook van zij, Mahraun kondigde deze tegen de in Duitsland overheersende revanchementaliteit in Leipzig ten aanhore van 35.000 leden (overwegend Saksische) aan. De kern van zijn betoog vindt men terug in een interview dat de Franse krant Le Matin op 29 augustus 1925 afdrukte: Mahraun benadrukte dat in zijn optiek de op Duitsland terugslaande bepalingen van het verdrag van Versailles dienden geschrapt en de bezette gebieden ontruimd, en dat de Duits-Poolse grens moest worden herzien.
Volgens Klaus Hornung (°1927) stond noch Mahraun noch Rechberg een kruistocht tegen de Sovjet-Unie voor ogen. Deze kenner interpreteert die Frankrijk-politiek als een poging om “een Europese politiek in de zin van een ‘derde kracht’ tussen Oost en West voor te bereiden” en op die manier het bolsjewisme op vreedzame wijze te weren. Hij onderstreept tevens dat de promotoren van die politiek geen heil zagen in de Volkenbond en evenmin in de zelfs in Frankrijk door invloedrijke politici en intellectuelen gesteunde pan-Europese gedachte van graaf Richard Coudenhove-Kalergi (1894-1972).16
Het feit dat het autoriteitsbeginsel het lager kader de mogelijkheid ontnam dergelijke beslissingen van de centrale leiding van de Jungdo te amenderen, gaf aanleiding tot de desertie van waardevolle elementen en tot sektevorming. Tot die laatste protestuiting nam de latere nazi-minister voor sportaangelegenheden Hans von Tschammer und Osten (1887-1943) zijn toevlucht. Mahrauns Frankrijk-politiek viel overigens evenmin in goede aarde bij de pangermanisten van het genre Heinrich Class (1868-1953), noch bij diens discipel Alfred Hugenberg (1865-1950), eigenaar van een krantenconcern waarin door een sterk anti-Frans ressentiment gedreven oudstrijders het goede weer maakten, noch bij de nationaal-socialisten. Uiteraard evenmin in kringen van de Reichswehr die vlijtig meewerkte aan de door het verdrag van Rapallo (16 april 1922) mogelijk geworden geheime Duits-Sovjetische militaire collaboratie.
Had de Jungdo, in weerwil van de crisis waarin hij verkeerde, toch de wind in de zeilen? Men is geneigd het te geloven wanneer men leest dat de liberale politicus Gustav Stresemann (1878-1929) in 1928 van één miljoen leden gewaagde en het Franse Deuxième Bureau er drie jaar later 500.000 telde.17 In ieder geval achtte Mahraun het ogenblik gekomen om een sinds geruime tijd in het vooruitzicht gesteld Jongduits manifest te lanceren. Dat gebeurde op 18 december 1927 met 4.000 Meister als toehoorders. Het gaat hierbij om de uitgerijpte neerslag van een denken over staat, politiek, economie enz, dat jaar in jaar uit geëvolueerd was.18 In dit manifest wordt geopteerd voor de niet parlementaire sociale volksstaat. bestaande uit zogeheten Nachbarschaften, d.i. groepen van telkens zowat 500 in dezelfde regio wonende staatsburgers, alias kiesgerechtigde mannen en vrouwen. De stamgedachte lag aan de Nachbarschaft ten grondslag: als voorbeelden golden de oud-Griekse agora en de germaanse Thingplatz. De Jungdo verwierp de dictatuur en plaatste de volksstaat boven de economie. Onder volk verstond hij geen gemeenschap van door dezelfde bloedsafstamming verbonden mensen, maar een gemeenschap van door bloedsverwantschap verbonden geslachten: geen sprake dus van ras.19 Het volk moest de staat maken; vandaar een pleidooi voor het referendum en voor onbezoldigde topfuncties: de besten moesten de staat zonder eigen belang en in het belang van het volk besturen.
De publicatie van het manifest verwekte heel wat deining. Niemand betwistte dat het aan oprechte vaderlandsliefde en idealisme ontsproten was. Velen hadden het daarentegen moeilijk met het realiteitsgehalte van de stellingen. Dat de socialisten de ondergeschiktheid van de economie in verband brachten met sterke burgerlijke invloeden is geenszins verwonderlijk. Minder evident is de mening van Alfred Weber (1868-1958): volgens deze gekende socioloog ging de staatsopbouw op nachbarschaftliche grondslag de heerschappij van de middelmatigheid en een veralgemeende vervlakking in de hand werken.20 Edgar Jung (1894-1934), de in 1934 door de nazis vermoorde secretaris en ghostwriter van de politicus Franz von Papen (1879-1969), was het met Mahraun over veel eens, doch vond de idee van de Nachbarschaft ongeschikt als basis voor politiek zelfbestuur.21
Hoe dan ook, in 1928 en 1929 leidde de drang om tot praktische verwezenlijkingen te kunnen komen in april 1929 tot de oprichting van een partijenoverkoepelende Volksnationale Reichsvereinigung waaraan ruim 600 persoonlijkheden hun steun verleenden, o.m. de pedagoog Ernst Krieck (1882-1947). Bij gebrek aan belangstelling kwam het slechts tot een alliantie tussen de Jungdo en de Deutsche Demokratische Partei. Aldus ontstond de Deutsche Staatspartei, die geen lang leven beschoren was, want de verkiezingen van 14 september 1930 vielen falikant uit (20 zetels), die van 6 november 1932 waren gewoon desastreus (nog 2 zetels). Het parlementair experiment bracht heel wat Jungdo-leden in de war en veroorzaakte een nieuwe desertiegolf.22
Het waren hoofdzakelijk hogeschoolstudenten die het verval in een nieuwe opgang ombogen. Zij grepen terug op het in 1924 door Mahraun bepleitte autarkisch princiep van de volksdienstplicht. Weldra registreerde men 300 Arbeitseinsatze, stelde financieminister Klepper 200.000 ha bodem ter beschikking en stichtte Mahraun de Jungdeutsche Siedlungs-GmbH. Er werden indrukwekkende successen geboekt23, maar in 1933 was het amen en uit.
Hitler, in Jungdo-middens Pyrrhus II of ook wel Lodewijk XIV genoemd, duidde het bestaan van de organisatie nog enige tijd. De Jungdo kantte zich tegen de Nazi-partij en Mahraun belegde in Bielefeld een Kapitel, naar hij later gezegd heeft met de bedoeling tot een gewapende weerstand tegen het Nazi-regime te komen. Dat liedje ging niet door: de Jungdo werd in juni 1933 verboden en Mahraun twee weken later aangehouden en door de Gestapo gemarteld; bij gebrek aan harde bewijzen werd hij in september 1933 op vrije voeten gesteld. Belangrijk om weten: Jungdo-leden hebben zich in de Duitse weerstand verdienstelijk gemaakt.24
Mahraun bleef in leven door boeken te schrijven (dichtbundels, romans, toneelstukken) die onder eigen naam of onder zijn schuilnaam Dietrich Kärner verschenen zijn. Toch is hij wel eens schaapsherder geweest om de twee eindjes aan mekaar te kunnen knopen. Tijdens W.O. II werd hij niet gemobiliseerd maar de ironie van het lot heeft gewild dat de Engelsen hem in 1945 andermaal interneerden. Na zijn vrijlating richtte hij de Jungdo opnieuw op (1948) en schreef diverse brochures en een boek.25 De doorstane mishandelingen en ontberingen hadden zijn dood op 59-jarige leeftijd voor gevolg; hij werd in maart 1950 in Gütersloh ten grave gedragen. Medestanders onder de leiding van Wolfgang Lohmüller zetten zijn werk voort en tot op dag van heden bestaat een afleggertje van de gewezen Jungdo onder de naam Artur-Mahraun-Gesellschqft e. V.. Maar de naoorlogse situatie valt buiten het bestek van mijn exposé.
Er rest me de hamvraag aan te snijden: heeft Joris van Severen invloed van Mahraun, resp. van de Jungdo ondergaan? Bij gebrek aan documentatie en rekening houdende met de mogelijkheid dat in de niet-gepubliceerde dagboeken indicaties te vinden zijn, verklaar ik me onbevoegd om die vraag te beantwoorden. Toch vallen gelijkenissen niet te loochenen, maar of ze ons berechtigen van invloed te gewagen is minder evident. De kunst bestaat er nu in de gedrukte en de ongedrukte documenten te bestuderen. Wanhopen is alleszins uit den boze.
Noten
1 L. Pauwels, De ideologische evolutie van Joris Van Severen (1894-1940). Een hermeneutische benadering, leper: Studie- en Coördinatiecentrum Joris van Severen, 1999, 272 p., ‘Jaarboek 3’; cf. p. 7.
2 L. Pauwels, op. cit. (vt 1), p. 7.
3 Cf. mijn artikel “Heeft Joris van Severen invloed van Georges Sorel ondergaan?”, deze Nieuwsbrief 9e jg., derde trimester 2005, pp. 11-15.
4 J. van Severen, (a) “Om de zege zo stevig mogelijk te consolideren en uit te baten”, De West-Vlaming (Rumbeke), 22 juni 1929, p. 1; (b) “De vooruitgang van onze zienswijze in de provincie Antwerpen. Volk en natie”, De West-Vlaming (Rumbeke), 26 april 1930, p. 2.
5 A. de Bruyne, Joris van Severen. Droom en daad, Zulte: Oranje Uitgaven, 1961, 341 p.; cf. p. 137. De auteur schrijft ‘Arthur’ i.p.v. ‘Artur’.
6 Balder (= Jan Creve), “Arthur Mahraun”, De Vrjjbuiter (Gent), 7e jg nr. 5-6, juli-aug. 1970, pp. 10-14; cf p. 10. Het moet ‘Artur’ i.p.v. ‘Arthur’ zijn. De krant Der Jungdeutsche begon op 1 juni1924 te verschijnen. Dat De Smet in contact stond met Mahraun signaleert ook Luc Vandeweyer (°1956) in de lemmata ‘Jong Vlaamsche Gemeenschap’ en ‘Jong Nederlandsche Gemeenschap, Nieuwe Encyclopedie van de Vlaamse Beweging (Tielt: Lannoo, 1998), deel II = G-Q, pp. 1578 en 1579.
7 M. Cailliau, “Artur Mahraun en de ‘Jungdeutsche Orden’”, Delta (Ekeren), 26e jg = 1990, nr. 4 pp. 4-6, nr. 6 pp. 6-8, nr. 7 pp. 5-9, nr. 8 pp. 8-10; cf. nr. 8 p. 10 vt 2. Deze auteur presenteert een bruikbare synthese van Mahrauns staatsdenken; hij baseert zich op het mij niet ter beschikking staande boekje van Helmut Kalkbrenner: Die Staatslehre Artur Mahrauns, München: Lohmüller, 1986, 64 p.
8 Balder, art. cit. (vt 6), p. Wat Geerardyn betreft, weze opgemerkt dat hij sympathiseerde met De Smet, zodat hij Van Severen inderdaad over de Jungdo kan geïnformeerd hebben.
9 M. Cailliau, art. cit. (vt 7), nr. 4 p. 4. - Zie voorts het door Romain Vanlandschoot (°1933) geschreven lemma “Smet, Robrecht de”, op. cit. (vt 6). deel 3 = R-Z. pp. 2765 -2767: cf. p. 2766: “… [Josu&eaacute;] de Decker [1879-1953] was weinig opgetogen over deze Duitse contacten, maar De Smet zette door en ontmoette in 1926 te Rotterdam een delegatie van deze Orden [sc. de Jungdo].”
10 Het is vreemd dat noch Creve noch Cailliau de in boekvorm ter beschikking staande dissertatie van de (latere hoogleraar) Klaus Hornung gebezigd hebben: Der Jungdeutsche Orden, Düsseldorf: Droste Verlag, 1958, 160 p., nr. 14 in de reeks ‘Beiträge zur Geschichte des Parlamentarismus und der politischen Parteien’. In zijn brief van 27 juni 1960 werd dit opus door Wolfgang Lohmüller geloofd. Uiteraard dient thans rekening gehouden met recenter bronnenmateriaal; cf. b.v. Cl. Wolfschlag, op. cit. (vt 25).
11 Tot mijn spijt stond een naar ik vernam belangrijk opus van Höhn niet te mijner beschikking: Artur Mahraun, der Wegweiser zur Nation. Sein politischer Weg aus seinen Reden und Aufsatzen, Rendsburg: Schieswig-Holsteinische Verlags-Anstalt, 1929, 143 p.
12 In maart 1920 pleegde de bekende marinebrigade Ehrhardt in Berlijn een staatsgreep, waardoor de hogere ambtenaar Wolfgang Kapp (1858-1922) gedurende vijf dagen (!) als rijkskanselier ambteerde. De putsch mislukte wegens een door de syndicaten gedecreteerde algemene staking.
13 KI. Hornung, op. cit. (vt 10), p. 40.
14 E. Schlund, ofm, Der Jungdeutsche Orden, München: Pfeiffer & Co., 1924, 57 p. De brochure is gebaseerd op opstellen die in de Allgemeine Rundschau verschenen waren. - Deze pater bezorgde me destijds een exemplaar van zijn boek Modernes Gottglauben. Das Suchen der Gegenwart nach Gott und Religion, Regensburg: Habbel, z.j. (= 1939), 307 p; het heeft me toen zeer geholpen.
15 (a) Over deze politiek, cf. o.m. K. Hornung, op. cit. (vt 10), pp. 42-50: “Der nationale Friede am Rhein’: Versailles und die Aussenpolitik”. - (b) Over Rechberg, cf. Eberhard von Vietsch (01912), Arnold Rechberg und das Problem der politischen Westorientierung Deutschlands nach dem ersten Weltkrieg, Koblenz: Staatsarchiv, 1958, nr. 4 in de ‘Schriftenreihe des Bundesarchivs’.
16 KI. Homung, op. cit. (vt 10), pp. 43-45.
17 Georges Castellan (°1920), L’Allemagne de Weimar 1918-1933, Parijs: Colin, 1969, 443 p., in de reeks ‘U - série: Histoire contemporaine’; cf. p. 110.
18 A. Mahraun, Das Jungdeutsche Manifest. Volk gegen Kaste und Geld. Sicherung des Friedens durch Neubau des Staates, Berlin: Jungdeutscher Verlag, 1927, 204 p.
19 Ernst Maste, Die Republik der Nachbarn. Die Nachbarschaft und der Staatsgedanke Artur Mahrauns, Giessen: Walitor-Verlag, 1957, 219 p.
20 Kl. Hornung, op. cit. (vt 10), p. 86.
21 Bernhard Jenschke, Zur Kritik der konservativ-revolutionären Ideologie in der Weimarer Republik? Weltanschauung und Politik bei Edgar Julius Jung, München: Beck, 1971, VIII-200 p., nr. 16 in de reeks ‘Münchner Sudien zur Politik’; cf. pp. 136-137. - Er zijn nog andere interessante auteurs die in hun geschriften te rade gingen bij Mahraun, doch het is hier niet de plaats om op die ‘ontleningen’ nader in te gaan.
22 Alexander Kessler, Der Jungdeutsche Orden auf dem Wege zur Deutschen Staatspartei, München: Lohmüller, 1980, 27 p., nr. 7 in de reeks Beiträge zur Geschichte des Jungdeutschen Ordens. Ook A. Mahraun, Die Deutsche Staatspartei. Eine Selbsthilfeorganisation deutschen Staatsbürgertums. Der Grundungsaufruf und das Manifest der Deutschen Staatspartei. Beantwortung gegnerischer Fragen, Berlijn: Jungdeutscher Verlag, 1930, 48 p.
23 Johann Hille, Mahraun. Der Pionier des Arbeitsdienstes, Leipzig: Kittler, 1933, 90 p.
24 Twee voorbeelden die in 1949 in Gütersloh (Nachbarschaftsverlag) verschenen en te mijner beschikking staan: Der Protest des Individuums, 47 p.; Politische Reformation. Vom Werden einer neuen deutschen Ordnung, 216 p.
25 Voorbeelden geeft Claus Wolfschlag (°1966), Hitlers rechte Gegner. Gedanken zum nationalistischen Widerstand, Engerda: Arun-Verlag. 1995. 214 p.: cf. pp. 65-74 (tekst: “Arthur [sic] Mahraun und der ‘Jungdeutsche Orden’”) en pp. 193-195 (78 vt).
00:15 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, pays-bas, belgique, flandre, mouvements de jeunesse, révolution conservatrice, années 20 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 30 octobre 2008
Otto Dix: un regard sur le siècle

Otto Dix, un regard sur le siècle
Guillaume HIEMET
Le centième anniversaire de la naissance d'Otto Dix a été l'occasion pour le public allemand de découvrir la richesse de la production d'un peintre largement méconnu. Plus de 350 œuvres ont en effet été exposées jusqu'au 3 novembre 1991, dans la galerie de la ville de Stuttgart, puis, à partir du 29 novembre, à la Nationalgalerie de Berlin. Peu connu en France, classé par les critiques d'art parmi les représentants de la Nouvelle Objectivité (Neue Sachlichkeit), catalogué comme il se doit, Otto Dix a toujours bénéficié de l'indulgence de la critique pour un peintre qui avait dénoncé les horreurs de la première guerre mondiale, figure de proue de l'art nouveau dans l'entre-deux guerres, et ce, en dépit de son incapacité à suivre la mode de l'abstraction à tout crin dans l'après-guerre. Quelques tableaux servent de support à des reproductions indéfiniment répétées et à des jugements qui ont pris valeur de dogmes pour la compréhension de l'œuvre. A l'encontre de ces parti-pris, les expositions de 1991 permettent aux spectateurs de se faire une idée infiniment plus large et plus juste des thèmes que développent la production de Dix.
Dix est né le décembre 1891 à Untermhaus, à proximité de Gera, d'un père, ouvrier de fonderie. Un milieu modeste, ouvert cependant aux préoccupations de l'art; sa mère rédigeait des poèmes et c'est auprès de son cousin peintre Fritz Amann que se dessina sa vocation artistique. De 1909 à 1914, il étudie à l'école des Arts Décoratifs de Dresde. Ses premiers autoportraits, à l'exemple de l'Autoportrait avec oeillet de 1913, sont clairement inspirés de la peinture allemande du seizième siècle à laquelle il vouera toujours une sincère admiration. Ces tableaux de jeunesse témoignent déjà d'un pluralisme de styles, caractérisé par la volonté d'intégrer des approches diverses, par la curiosité de l'essai qui restera une constante dans son œuvre.
La guerre: un nouveau départ
En 1914, Dix s'engageait en tant que volontaire dans l'armée. L'expérience devait, comme toute sa génération, profondément le marquer. S'il est une habitude de dépeindre Dix comme un pacifiste, son journal de guerre et sa correspondance montrent un caractère sensiblement différent. La guerre fut perçue par Dix, comme par beaucoup d'autres jeunes gens en Allemagne, comme l'offre d'un nouveau départ, d'une coupure radicale avec ce qui était ressenti comme la pesanteur de l'époque wilhelminienne, sa mesquinerie, son étroitesse, sa provincialité qu'une certaine littérature a si bien décrites. Elle annonçait la fin inévitable d'une époque. Les premiers combats, l'ampleur des destructions devaient, bien sûr, limiter l'enthousiasme des départs, mais le gigantisme des cataclysmes que réservait la guerre, n'en présentait pas moins quelque chose de fascinant. Le pacifiste Dix se rapproche par bien des aspects du Jünger des journaux de guerre. L'épreuve de la guerre pour Ernst Jünger trempe de nouveaux types d'hommes dans le monde d'orages et d'acier qu'offrent les combats dans les tranchées.
Avec nietzsche: “oui” aux phénomènes
Une philosophie nietzschéenne se dégage, “la seule et véritable philosophie” selon Dix, qui, en 1912, avait notamment élaboré un buste en platre en l'honneur du philosophe de la volonté de puissance. Des écrits de Nietzsche, Dix retient l'idée d'une affirmation totale de la vie en vertu de laquelle l'homme aurait la possibilité de se forger des expériences à sa propre mesure. Ainsi, il note: «Il faut pouvoir dire “oui” aux phénomènes humains qui existeront toujours. C'est dans les situations exceptionnelles que l'homme se montre dans toute sa grandeur, mais aussi dans toute sa soumission, son animalité». C'est cette même réflexion qui l'incite à scruter le champ de bataille, qui le pousse à observer de ses propres yeux, si importants pour le peintre, les feux des explosions, les couleurs des abris, des tranchées, le visage de la mort, les corps déchiquetés.
De 1915 à 1918, il tient une chronique des événements: ce sont des croquis dessinés sur des cartes postales, visibles aujourd'hui à Stuttgart, qui ramassent de façon simple et particulièrement intense l'univers du front. Le regard du sous-officier Dix a choisi de tout enregistrer, de ne jamais détourner le regard puis de tout montrer dans sa violence, sa nudité. Les notes du journal de guerre montrent crûment sa volonté de considérer froidement, insatiablement le monde autour de lui. Ainsi, en marche vers les premières lignes: «Tout à fait devant, arrivé devant, on n'avait plus peur du tout. Tout ça, ce sont des phénomènes que je voulais vivre à tout prix. Je voulais voir aussi un type tomber tout à côté de moi, et fini, la balle le touche au milieu. C'est tout ça que je voulais vivre de près. C'est ça que je voulais». Dans cette perception de la réalite, Dix souligne le jeu des forces de destruction, les peintures ne semblent plus obéir à aucune règle de composition si ce n'est les repères que forment les puissances de feu, les balles traçantes, les grenades. Tout dans la technique du dessin sert, contribue vivement à cette impression d'éclatement, les traits lourds brusquement interrompus, hachures des couleurs, parfois plaquées. Le regard est obnubilé par la perception d'ensemble, la brutalité des attaques, vision cauchemardesque qui emporte tout.
La dissolution de toute référence stable
Le réalisme de ces années 1917-1918 qui caractérise ces dessins et gouaches est dominé par cette absence d'unité, l'artiste a jeté sur la toile tel un forcené la violence de l'époque, la dissolution de toute reférence stable. L'abstraction dit assez cette incapacité de se détourner des éclairs de feu et de se rapprocher du détail. Cette peinture permettra pareillement à Dix de conjurer peu à peu les souvenirs de tranchées. Ce rôle de catharsis, cette lente maturation s'est faite dans son esprit pendant les années qui suivent la guerre. L'évolution est sensible. Ce sont en premier, le cycles des gravures intitulé la Guerre qu'il réalise en 1924 puis les grandes compositions des années 1929-1936. Les gravures presentent un nouveau visage de la guerre, Dix s'attarde à représenter le corps des blessés, les détails de leurs souffrances. Ici, le terme d'objectivité est peut-être le plus approprié, il n'est pas sans évoquer toutefois les descriptions anatomiques du poète et médecin Gottfried Benn. Le soin ici de l'extrême précision, de la netteté du rendu prend chez ces guerriers mourants, mutilés ou dans la description de la décomposition des corps une force incroyable.
Les souvenirs de guerre ne se laissaient pas oublier aisément, il avouait lui-même: «pendant de longues années, j'ai rêvé sans cesse que j'étais obligé de ramper pour traverser des maisons détruites, et des couloirs où je pouvais à peine avancer». Dans les grandes toiles qu'il a peintes après 1929, il semble que Dix soit venu à bout des stigmates, entaillés dans sa mémoire, que lui avaient laissées la guerre, ou tout du moins que l'unité ait pu se faire dans son esprit. La manière dont l'art offre une issue aux troubles des passions, ce rôle pacificateur, il l'évoque à plusieurs moments dans des entretiens à la fin de sa vie. Dans ces toiles grands-formats qui exposent maintenant, l'univers de la guerre, se conjuguent une extrême précision et l'entrée dans le mythe que renforce encore la référence aux peintres allemands du Moyen-Age. Dix a choisi pour la plus importante de ces oeuvres, un tryptique, La Guerre, la forme du retable. Le renvoi au retable d'Isenheim de Mathias Grünewald, étrange et impressionnant polyptique qui dans la succession de ses volets propose une ascension vers la clarté, l'aura de la Nativité et de la Résurrection, est explicite. En comparaison, le triptyque de Dix semble une tragique redite du premier volet de Grünewald, La tentation de Saint Antoine. Ici, l'univers apocalyptique de la guerre, la mêlée de corps sanglants, les dévastations de villages minés par les obus, correspondent aux visions délirantes de monstres horribles et déchainés, aux corps repoussants, aux gueules immondes mues par la bestialité de la destruction chez Grünewald.
des tranchées aux marges de la société
L'impossibilité de s'élever vers la clarté, l'éternel recommencement du cycle de destructions est accentué par l'anéantissement du pont qui ferme toute axe de fuite et le dérisoire cadavre du soldat planté sur l'arche de ce pont qui forme une courbe dont l'index tendu pointe en direction du sol. Le cycle du jour est rythmé par la marche d'une colonne dans les brouillards de l'aube, le paroxysme des combats du jour, et le calme, la torpeur du sommeil, les corps allongés dans leur abris que montre la predelle (le socle du tableau). L'effet mythique est encore accentué par la technique qu'utilise Dix pour ces toiles: la superposition de plusieurs couches de glacis transparents, technique empruntée aux primitifs allemands, qui nécessite de nombreuses esquisses et qui confère une perfection, une exactitude extraordinaire aux scènes représentées. Ainsi dans le tableau de 1936, la mort semble être de tout temps, la destinée des terres dévastées de Flandre —“en Flandre, la mort chevauche...”, selon les paroles d'un air de 1917—, et le combat dans son immensité parvient à une dimension cosmique.
Sous la République de Weimar, Dix conserve en grande partie le style éclaté des peintures de guerre. Il demeure successivement à Dresde, Düsseldorf, Berlin puis à nouveau Dresde jusqu'en 1933. Les thèmes que traite Dix se laissent difficilement résumer: le regard froid des tranchées se tourne vers la société, une société caractérisée, disons-le, par ces marges. Dix est fasciné par le mauvais goût, la laideur, les situations macabres, grotesques. L'esprit du temps n'est pas étranger à cet envoûtement pour la sordidité, et souvent ses personnages tiennent la main aux héroïnes de l'opéra d'Alban Berg Lulu: thèmes des bas-fonds de la littérature, aquarelles illustrants les amours vénales des marins, accumulation de crimes sadiques décrits avec la plus grande exactitude. Le cynisme hésite entre le sarcasme et l'ironie la moins voilée. L'atmosphère incite aux voluptés sommaires, comme disait un écrivain français. Une des figures qui apparaît le plus souvent et qui nous semble des plus caractéristiques, est celle du mutilé. La société weimarienne ne connaît pour Dix qu'estropiés, éclopés, que des bouts d'humanité, et tout donne à penser que ce qui est valable pour le physique l'est aussi pour le mental. Ainsi les cervelets découpés et asservis aux passions les plus vulgaires et les plus automatiques.
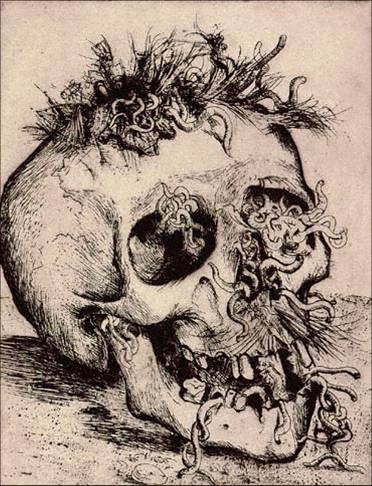
déshumanisation, désarticulation, pessimisme
Une des peintures les plus justement célèbres de Dix, la Rue de Prague en 1920, fournit un parfait résumé des thèmes de l'époque. D'une manière particulièrement féroce, Dix place les corps désarticulés de deux infirmes à proximité des brillantes vitrines de cette rue commerçante de Dresde, dans lesquelles sont exposés les mannequins et autres bustes sans pattes. Le processus de déshumanisation est complet, les infirmes détraqués, derniers restes de l'humain trouvent leur exact répondant dans la vie des marionnettes. La composition du tableau —huile et collage— accentue d'autant plus la désarticulation des corps, la régression des mouvements et pensées humains à des processus mécaniques dont l'aboutissement symbolique est la prothèse. Nihilisme, pessimisme complet, dégoût et aversion affichée pour la société, il y a sans doute un peu de tout cela.
Bien des toiles de cette époque pourraient être interprétées comme une allégorie méchante et sarcastique de la phrase de Leibniz selon laquelle “nous sommes automates dans la plus grande partie de nos actions”. L'absence de plan fixe, de point d'appui suggère cette dégringolade vers l'inhumain. Le rapprochement de certains tableaux de cette époque —Les invalides de guerre, 1920— avec les caricatures de George Grosz est évident, mais celui-ci trouve bientôt ses limites, car très vite il apparaît que si la source de tout mal pour Grosz se situe dans la rivalité entre classes, pour Dix, le mal est beaucoup plus profond. La société tout entière se vend, tel est le thème du grand triptyque de 1927-1928, La grande ville, misère et concupiscence d'une part, apparence de richesse, faste et vénalité de l'autre. Rien ne rachète rien. On a souvent reproché à Dix son attirance pour la laideur, la déchéance physique et la violence avec laquelle il traite ses sujets. La volonté de provocation rentre directement en ligne de compte, mais plus profondément, ces thèmes se présentaient comme un renouvellement de la peinture. Il avouait d'ailleurs: “j'ai eu le sentiment, en voyant les tableaux peints jusque là, qu'un côté de la réalité n'était pas encore représenté, à savoir la laideur”.
Haut-le-cœur, immuables laideurs
Si l'impressionnisme a porté le réalisme jusqu'à son accomplissement ce qui n'était pas sans signifier l'épuisement de ces ressources, les tentatives des années vingt restent exemplaires. Le beau classique s'était mû en un affadissement de la réalité, la perte de la force inhérente à la peinture ne pouvait être contrecarrée d'une part, que par une abstraction de plus en plus poussée à laquelle tend toute la peinture moderne, de l'autre, par la confrontation avec un réel non encore édulcoré. Naturellement, de la façon dont Dix, animé d'une sourde révolte, tire sur les conformismes du temps, on comprend le haut-le-cœur des contemporains devant ces corps qui semblent jouir du seul privilège de leur immuable laideur. Aujourd'hui cependant, le spectateur n'est pas sans sourire à cette atmosphère encanaillée des pièces de Brecht, aux voix légèrement discordantes, le parler-peuple de l'Opéra de Quatre-sous. Il en est de même de la caricature de la société de Weimar, attaque frontale contre les vices et vertus de l'époque à laquelle procède méthodiquement Dix, époque de vieux, de nus grossiers, de mères maquerelles, de promenades dominicales pour employés de commerce.
La toile Les Amants inégaux de 1925, dont il existe également une étude à l'aquarelle, condense particulièrement les obsessions chères à Dix. Un vieillard essaie péniblement d'étreindre une jeune femme aux formes imposantes qui se tient sur ses genoux. Le caractère vain du désir, l'intrusion de la mort dans les jeux de l'amour que symbolisent les longues mains décharnées du vieillard forment une danse étonnante de l'aplomb et de la lassitude, de la force charnelle et de sa disparition.
les révélations des autoportraits
Dix a tout au long de sa vie produit un grand nombre de portraits. L'exposition de Stuttgart en 1991 a montré le fabuleux coloriste qu'il fut. Il affectionne les rouges sang, le fard blanc qui donne aux visages quelque chose du masque, de tendu et de crispé, et les variations de noir et de marron que fournit la fourrure de Martha Dix dans le magnifique portrait de 1923. Selon l'aveu même du peintre, l'accentuation des traits jusqu'à la caricature ne peut que dévoiler l'âme du personnage et la résume d'une façon à peu près infaillible. Il n'est pas interdit de retourner cette remarque à Dix lui même, car il n'est pas sans se projetter dans sa peinture et tout d'abord, dans les nombreux autoportraits que nous disposons de lui. L'esprit qui anime les peintures de l'entre-deux guerres se retrouvent ici aisément: l'Autoportrait avec cigarettes de 1922, une gravure, partage la brutalité des personnages qu'il met en scène. Dix se présente les cheveux gominés, les sourcils froncés, le front décidément obtus, la machoire carrée, bref, une aimable silhouette de brute épaisse dont seul la finesse du nez trahit des instincts plus fins que viennent encore démentir la clope posée entre les lèvres serrées. Qui pourrait nier que ces autoportraits fournissent des équivalences assez exactes de la rudesse et de la brutalite de la peinture de Dix?
Art dégénéré ou retour du primitivisme allemand?
A partir de 1927, Dix fut nomme professeur à 1'Académie des Beaux-Arts de Dresde. En 1933, quelques temps après 1'arrivée au pouvoir du nouveau régime, il est licencié. Dix représentait pour le régime nazi le prototype de l'art au service de la décadence, et des œuvres tels que Tranchées, Invalides de guerre, eurent l'honneur de figurer dans l'exposition itinérante ”d'art dégenéré” organisée par la Propagande du Reich en 1937, plaçant Dix dans une situation délicate. Il est clair que Dix n'a jamais temoigné un grand intérêt pour la chose politique, refusant toute adhésion partisane avec force sarcasmes. Mais, rétrospectivement, ces jugements apparaissent d'autant plus absurdes que la manière de Dix depuis la fin des années vingt avait déjà considérablement évoluée et témoignait d'un très grand intérêt pour la technique des primitifs allemands que le régime vantait d'autre part. Situation ô combien absurde, mais qui devait grever toute la production des années trente.
En 1936, 1'insécurité présente en Saxe l'incite à s'installer avec sa famille sur les bords du lac de Constance dans la bourgade de Hemmenofen. A l'exil intérieur dans lequel il vit, correspond une production toute entière consacrée aux paysages et aux thèmes religieux. Tous ces tableaux montrent une maîtrise peu commune, l'utilisation des couches de glacis superposés, fidèle aux primitifs allemands du seizième, permet une extraordinaire précision et la description du moindre détail. Si Dix a pu dire qu'il avait été condamné au paysage qui, certes, ne correspondait pas au premier mouvement de son âme, on reste néanmoins émerveillé par certaines de ses compositions. Randegg sous la neige avec vol de corbeaux de 1935: la nuit de 1'hiver enclot le village recouvert d'une épaisse couche de neige, les arbres qui se dressent dénudés évoquent les tableaux de Caspar David Friedrich, unité que seule perçoit le regard du peintre. Loin de se contenter d'un plat réalisme, cet ensemble n'a jamais rendu aussi finement la présence du peintre, léger recul et participation tout à la fois à l'univers qui l'entoure.
Devant les gribouilleurs et autres tâcherons copieurs de la manière ancienne aux ordres des nouveaux impératifs, et dans une période où l'humour est si absent des œuvres de Dix, celui-ci semble dire magistral: “Tas de boeufs, vous voulez du primitif, en voilà!”. Art de plus en plus contraint à mesure que passaient les années, mais au moyen duquel Dix exposait une facette majeure de sa personnalité. Dès 1944, il éprouvait le besoin d'en finir avec cette technique minutieuse, exigeante qui bridait son besoin de créativité. La dynamique formelle reprend vivement le dessus dans ses Arbres en Automne de 1945 où les couleurs explosent à nouveau triomphantes. Les peintures de la fin de sa vie renouent avec la grossièreté des traits des œuvres des années vingt.
Peu reconnu par la critique alors que le combat pour l'art abstrait battait son plein, Dix est resté, dans ces années, en marge des nouveaux courants artistiques auxquels il n'éprouvait aucunement le besoin d'adhérer. Les thèmes religieux, ou plutôt une imagerie de la bible qu'il essaie étrangement de concilier avec la philosophie de Nietzsche, tiennent dans cette période un rôle fondamental. Sa peinture semble parvenir à une économie de moyens qui rend très émouvantes certaines de ses toiles —Enfant assis, Enfant de réfugiés, 1952—, la prédisposition de Dix pour les couleurs n'a jamais été aussi présente, l'Autoportrait en prisonnier de guerre de 1947 est organisé autour des taches de couleur, plaquées sur un personnage muet, vieilli, dont les traits se sont encore creusés. Après plusieurs années de vaches maigres, les honneurs des deux Allemagnes se succédèrent —il resta toujours attaché à Dresde où il se déplaçait régulièrement . Atteint d'une première attaque en 1967 qui le laissa amoindri, il devait néanmoins poursuivre son travail jusqu'à sa mort deux ans plus tard. Un des ces derniers autoportraits, l'Artiste en tête de mort, montre le crâne du peintre ricanant ceint de la couronne de laurier, image troublante qui rejette au loin les nullissimes querelles entre art figuratif et art abstrait.
Guillaume HIEMET.
Les citations sont tirées de : Eva KARCHNER, Otto Dix 1891-1969, Sa vie, son œuvre, Benedikt Taschen, 1989.
00:15 Publié dans art | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : allemagne, expressionnisme, années 20, vingtième siècle, pessimisme, anthropologie, première guerre mondiale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Citation de Hubert Lagardelle

L'utopie de la démocratie
"L'utopie de la démocratie a été de dépouiller l'individu de ses qualités sensibles, de le réduire à l'état abstrait de citoyen. De l'homme concret de chair et d'os, qui a un métier, un milieu, une personnalité, elle a fait un être irréel, un personnage allégorique en dehors du temps et de l'espace, et le même à tous les étages de la société.
Ni ouvrier ni paysan, ni industriel ni commerçant, ni du Nord ni du Midi, ni savant ni ignorant : un homme théorique."
Hubert Lagardelle, janvier 1931.
00:12 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : politique, france, années 30, démocratie, philosophie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 29 octobre 2008
1933: la radio devient l'instrument privilégié des propagandes
| 1933 : La radio devient l'instrument privilégié des propagandes |
| par Jean-Jacques Ledos trouvé sur: http://www.gavroche.info
|
00:10 Publié dans Histoire | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : manipulations médiatiques, radio, propagande, fascisme, communisme, national-socialisme, new deal |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
H. von Hofmannsthal et "l'enténèbrement du monde"
Hugo von Hofmannsthal et « l’enténèbrement du monde »
00:05 Publié dans Littérature | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres allemandes, littérature allemande, allemagne, autriche, révolution conservatrice, conservatisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 28 octobre 2008
Bruno Favrit: le recours aux montagnes
Le recours aux montagnes
Auteur entre autres d’un essai remarqué sur Nietzsche et d’un court roman de guerre, Bruno Favrit est à la fois un homme à la culture aussi profonde qu’originale et un alpiniste chevronné. Avec Ceux d’En Haut, son récent recueil de nouvelles, il nous offre un hymne à la haute montagne en tant qu’école de vie, car l’ascension s’y révèle surtout comme une rude initiation à une vision du monde spartiate. Des Cévennes au Caucase, ses héros, solitaires ou groupés en phalanstères (voire en patrouilles), affrontent la montagne pour mieux échapper aux blandices d’une modernité pour laquelle B. Favrit éprouve une tendresse limitée. Sveltes et bronzés (y compris sur le plan mental), ces jeunes gens qui comptent dans leurs rangs quelques troublantes amazones choisissent -ou refusent - cette conversion « hérakléenne » qui fascine cet écrivain pétri de pensée antique. Celui-ci tente en fait de mettre en pratique la sentence de Malraux : « approfondir sa communion ou cultiver sa différence ». Aussi, chez ses personnages, le panthéisme vécu sous la morsure du gel ou du soleil invaincu débouche-t-il sur la solitude des sommets. Quant aux culs de plomb, ceux qui sont morts sans le savoir, malheur à eux ! Livre attachant, d’un courage certain - qui pourrait toutefois être plus serein, au ton moins polémique, mais Favrit se veut disciple d’Héraclite - et à mille lieues de la chiennerie dominante, Ceux d’En Haut illustre la permanence d’une posture à la fois stoïcienne et épicurienne (somptueuse évocation d’un festin solsticial). Bel exemple de refus de l’aliénation techno-marchande, de quête de l’excellence et d’exaltation du « divin imprévu » cher à Stendhal, ce livre tonifiera tous ceux que tente la méditation du haut des cimes.
Christopher Gérard
Bruno Favrit, Ceux d’En Haut, Ed. Auda Isarn, 194 pages, 18€
Rencontre avec Bruno Favrit
Propos recueillis par Christopher Gérard
Qui êtes-vous ? Comment vous définiriez-vous ? Les grandes étapes de votre itinéraire littéraire et spirituel ?
S'il me faut absolument répondre, je dirai : un passionné qui accepte de connaître ce qui veut le réduire pour mieux s'en défaire ensuite. Former une réponse plus complète m'épuiserait assurément. Parce que je n'ai pas cessé, comme dirait Hamsun, de constituer un petit sujet d'étonnement pour moi-même. Ce qui, en un sens, peut être bon signe, si cela signifie qu'à l'échelle d'une vie, rien n'est jamais acquis mais rien n'est jamais achevé.
Pour ce qui est des grandes étapes de mon itinéraire, je ne serai guère plus affirmatif. Il y a une sorte de constante mue par une soif originelle. Un phénomène dont l'explication est au-dessus de mon entendement mais dont je suis conscient qu'il n'a rien d'exceptionnel pour qui est à l'écoute. Je peux tout de même citer le passage par le scoutisme. Je crois que je me suis aussi construit dans ce mouvement qui n'eut alors pour moi absolument rien d'ordinaire. Mais je n'ai lu les romans de Foncine et de Dalens que bien plus tard : je m'appliquais à vivre la réalité avant tout. A quinze ans, il y a eu Nietzsche. Je ne comprenais pas tout, évidemment, mais je percevais que se tenait dans le Crépuscule des idoles et le Zarathoustra une éthique très différente de tout ce qui m'avait été enseigné jusque-là. Cette lecture m'a donné le goût d'aborder les écrits d'autres maîtres d'élévation sans renoncer pour autant à parcourir les forêts et les crêtes. La fréquentation de la Phusis, la Nature sous son acception la plus large, m'a appris l'essentiel, enseignement que la société moderne ne propose plus. Cette immersion m'a également aidé à penser par moi-même en me tenant éloigné des absolutismes tels l'empirisme et les ''valeurs'' spéculatives.
Spirituellement, le qualificatif de panthéiste me convient. Pour ne pas se laisser accaparer par le dogme il faut se construire sa vision du monde en convoquant ses évidences instinctive et héréditaires.
Les grandes lectures ?
Sans doute peut-on se prononcer sur les livres essentiels à ce que l'on éprouve le besoin de les relire. Nietzsche continue à me soutenir. Mais également des penseurs comme Schopenhauer et Cioran. Sans oublier la philosophie antique. C'est la partie métaphysique de cette aventure qui me paraît déterminante. (Je reste assez insensible à l'épistémologie, sans doute parce que mon côté pyrrhonien m'inspire une confiance modérée dans le résultat.) Pour le style : Saint-Simon, Chateaubriand, Rousseau, Mérimée, Barrès, Montherlant. Bien que lisant peu de romans, des auteurs comme Giono, Hamsun ou Lawrence me touchent. J'affectionne aussi l'oeuvre où l'auteur se met à nu ; Henry Miller, Jack Kerouac, Blaise Cendrars, Gabriel Matzneff, furent pour moi de véritables révélations en la matière. Il me semble en effet important de rester plongé dans le réel. Mais un réel qui sait s'accommoder de la métaphysique et des mythes, eux-mêmes à considérer comme une réalité conceptualisée. Je peux citer également Alain Daniélou, Mircea Eliade, Fernando Pessoa, Hermann de Keyserling, Joseph Conrad.
Les grandes rencontres ?
Cette question renvoie pour moi à la précédente : qu'importe que les auteurs que nous relisons aient ''disparus'', leur talent demeure face à la grande majorité de nos contemporains qui excellent en mondanités et courent après les prix. Un livre et la confrontation peut avoir lieu. Mes plus grandes rencontres, je les ai faites aussi dans la fréquentation de sites préservés comme en Irlande, en Laponie, sur les grands causses ou les pentes des Alpes. J'aime la magie des lieux. J'aime voir où ont vécu, où ont écrit ceux qui m'ont marqué. L'Engadine d'Ainsi parlait Zarathoustra, le Valais de Derborence, le Montmartre de Jours tranquilles à Clichy, le quartier latin qui a vu naître Nous n'irons plus au Luxembourg et De l'inconvénient d'être né, la Bourgogne des Etoiles de Compostelle, les Calanques de Bourlinguer, le Vercors d'Un roi sans divertissement, le Montserrat d'Un Voyageur solitaire est un diable.
Après un essai sur Nietzsche et une synthèse sur le vitalisme, vous publiez un recueil de nouvelles dont le personnage principal est la montagne. Vous inscrivez-vous dans la lignée d’un Frison-Roche ou d’autres écrivains de la montagne ? D’où vous est venue cette passion ?
J'ai lu Frison-Roche, mais des écrivains comme Saint-Loup, Ramuz ou Buzzati me paraissent bien plus indispensables. Et un Reinhold Messner, même s'il n'a pas un style inoubliable, est à lire parce qu'il décrit dans ses livres une expérience personnelle réellement nietzschéenne. De là à dire que je m'inscris dans cette lignée d'écrivains, nous dirons que je m'efforce de m'y inscrire, conscient de mes faiblesses. Sur ce point, je me qualifierai plus convenablement de questeur qui s'essaye à l'écriture sans y consacrer tout le temps qu'il faudrait...
Quant à ma passion pour la montagne, elle est née d'une ascension en falaise, dans laquelle m'avaient entraîné deux amis, et d'un séjour estival dans les Alpes suisses où j'ai découvert que ce qui pouvait se faire sur le calcaire à 120 mètres de hauteur se trouvait démultiplié en terme de sensations sur le granit à 3000. J'ai vite ressenti le besoin de ne me détacher jamais longtemps des verticalités et de garder le spectacle de ces virginités ''à portée de main''. Je suis devenu, comme on dit aujourd'hui, un addict. L'escalade et l'alpinisme constituent un moyen idéal de trouver l'air pur, la beauté et de tester sa détermination. Cette nécessité n'a pas été exposée uniquement dans Ceux d'en haut qui a eu un précédent. Les Nouvelles des dieux et des montagnes, parues en 2004, rendaient déjà hommage à l'altitude. J'ai tenté d'y montrer qu'elle est aussi un moyen de fréquenter la divinité.
Les hommes et les femmes que le lecteur croise dans votre livre ont tous en commun de manifester une forme plus ou moins ouverte de rébellion contre le monde moderne.
Pour ce qui est de mon époque, ce n'est pas tant qu'elle me désespère – chacun trouve midi à sa porte – ; je souhaite seulement être le moins possible corrompu par elle. Du moins tenté-je de ne pas céder à ses triviales injonctions. Pas de propriété, pas de stock-options, pas d'idées arrêtées sur les vices ou les vertus (d'autant plus que je crois en la relativité des valeurs). Comme dit Marcel Conche, un des rares philosophes actuels remarquables : « Il faut se retirer de tout ce qui a une signification maintenant, mais n’en aura plus demain. » Cela est vrai pour l'action comme pour la connaissance. Mes personnages me ressemblent parce que je les ai fréquentés ou qu'ils sont un peu de moi-même. Je m'inspire de la réalité pour les mettre en scène. La ''révolte contre le monde moderne'' n'est pas qu'une forme de littérature. Bien qu'ils se fassent, hélas ! rares, il y a encore des corps et des esprits vitalisés en ce bas monde.
Ce qui frappe aussi à la lecture de votre recueil, c’est votre proximité avec la Grèce ancienne, celle d’Héraclite. Comment expliquez-vous ce trait plus qu’original ?
Héraclite ! Il est présent dans la nouvelle ''La Voie hérakléenne'', mais aussi dans Vitalisme et vitalité. Tout ce qui nous reste de lui est constitué de fragments que les doxographes et les philosophes ont sauvé de l'oubli, ''dégraissant'' au passage sa pensée. Cela donne du coup à ses écrits une dimension exceptionnelle. Un présent inestimable pour un âge perclus de discours et de circonlocutions où nul ne ressent plus le besoin de lutter contre l'encombrement et la superfluité. Le vieux sage païen a influencé Platon mais aussi Char et Heidegger, ce qui n'est pas rien. Autant de richesse dans une petite centaine d'aphorismes, il n'y avait que de la Grèce antique qu'un tel héritage pouvait nous venir.
Vos projets ?
Beaucoup trop. J'avance toujours sur plusieurs fronts au gré de mon inspiration... et de mes dispositions à l'éparpillement ! Selon le vieux précepte antique, je pars du principe que naviguer est nécessaire si l'on veut aborder de nouveaux rivages et ne pas s'émousser dans les béatitudes que ces temps encouragent. Alors cinglons au large et tentons de nouvelles expériences. En ce moment, je me consacre plus particulièrement à la composition d'aphorismes. Un travail en chantier depuis des années qui impose des choix; polir, élaguer, supprimer. Encore et toujours la tentation d'une forme d'allégement.
Quelques projets aussi de grandes voies où je puisse me perdre pour me trouver. Tant que les dieux me donnent l'énergie d'aller par ce moyen à leur rencontre, je n'y renonce pas.
Avignon, printemps 2008
00:10 Publié dans Alpinisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : lettres, lettres françaises, littérature, littérature française, montagnes, traditions, traditionalisme |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Etat national et subsidiarité

Etat national et subsidiarité
par Germanico GALLERANI
Il y a longtemps, à la fin de l'année 1947, Carl Schmitt, le célèbre philosophe allemand du politique, avait clairement pris conscience que l'Etat national cheminait désormais vers un déclin inexorable. La forme “Etat” que Schmitt voyait décliner était celle qui avait caractérisé la grande période historique qui va de Hobbes à Hegel, période à laquelle on peut lier le concept d'“Etat”.
Aujourd'hui, si l'on observe les multiples mouvements qui ébranlent les Etats nationaux, on est bien contraint de dire que ces mouvements, dans ce qu'ils ont d'essentiel, s'expriment en dehors du cadre national. L'Etat national, sur le plan intérieur, se lézarde fortement, à cause de l'apparition de nouveaux mouvements sociaux et de la persistance de régionalismes et d'autonomismes qu'il ne réussit plus à intégrer; à tout cela s'ajoutent une prolifération de réseaux associatifs et l'affirmation de nouvelles formes communautaires. C'est précisément ainsi que se reconstruisent les structures intermédiaires de socialité que l'Etat national avait détruites au cours de son processus d'édification. Aujourd'hui, ces structures détruites se reconstituent, reviennent à l'avant-plan et se tournent contre la structure centralisée qu'est l'Etat national. C'est ainsi que s'approfondit sans cesse le fossé qui sépare la société civile de la classe politique et qui a généré le vide de sens dont souffrent les institutions. C'est ainsi également que les demandes les plus intelligentes et les plus conscientes de participation à la vie politique ont été déviées vers d'autres «mondes vitaux», étrangers à l'Etat.
Sur le plan extérieur, l'Etat national est en crise parce qu'il se constitue des bureaucraties intergouvernementales, parce qu'il se forme des institutions supranationales, et parce que l'influence des appareils techno-scientifiques internationaux devient de plus en plus forte, de même que les pressions des groupes transnationaux. En somme, l'Etat national en arrive à une situation telle, qu'il est de fait dépassé, du moins pour une large part de ses prérogatives. A cela s'ajoute que l'expansion mondiale du marché, sous l'influence des multinationales, du jeu des opérations boursières, du mouvement financier continu, de la bataille financière artificielle qui se livre sans cesse, extravertit les économies nationales au détriment des marchés internes et induit ce phénomène d'«occupation industrielle», déjà décrit par Carl Schmitt en son temps, une «occupation industrielle» qui consiste à prendre possession de la totalité des moyens de production, selon l'adage cuius industria, eius regio.
Contestée à la base comme au sommet, la forme «Etat national» n'est plus capable d'assurer une fonction intégratrice ni de garantir la réglementation des rapports entre une “société politique”, critiquée de toutes parts, et une “société civile”, en voie de fragmentation. La forme «Etat national» semble donc avoir épuisé ses potentialités. Mais si la forme «Etat national», centralisatrice, totalisante, omnia facens, est véritablement en train de mourir, le «Principe-Etat», lui, en revanche, est toujours bien vivant; c'est ce Principe cardinal du politique qui permet aux choses de tenir, de rester en place, de se maintenir debout (stare), qui confère stabilité et durée à un ensemble d'éléments qui, autrement, subiraient la dispersion centrifuge.
L'Etat, entendu comme principe politique se situant au-delà des particularités, confère totalité et unité aux multiples segments dont se compose la société nationale; mais cet Etat n'est pas lié à une forme déterminée une fois pour toutes. Ce n'est pas la société qui confère unité à l'Etat, mais c'est le principe de pouvoir et de souveraineté, qu'incarne l'Etat, qui rend une la société nationale. Le Principe-Etat, en somme, se place, dans son essence, sous le signe de l'unité des contraires, où l'unité n'agit pas selon un mode destructeur ou niveleur, en d'autres mots, contre la multiplicité qui constitue la société.
En conséquence, l'Etat est toujours un, même quand sa forme, au lieu de s'inspirer d'un critère d'unitarisme rigide et mécanique, se moule sur une idée d'unité organique, composite, approuvant les autonomies, les décentralisations et la pluralité, en d'autres mots, respectant et reflétant ce qui est la structure naturelle de la société des hommes.
Que des structures intermédiaires de socialité se reforment, prennent corps à l'intérieur même de l'Etat national, que des «mondes vitaux» se meuvent dans des directions différentes par rapport à la collectivité, c'est désormais un fait qui nous interpelle dramatiquement: en effet, ce sont là des questions qui ne sont plus évacuables; est-il encore possible de réintégrer en une unité des phénomènes sociaux qui, tout en étant des éléments de vitalité positive, fonctionnent pour le moment dans le sens d'une désarticulation du cadre formel unitaire de l'Etat et remettent en cause la possibilité même d'un consensus civil. Est-il dès lors possible de disposer d'un principe, simultanément capable de recomposer le tissu des divers autonomismes, en les confinant dans l'espace qui est légitimement leur, et de les articuler dans une unité? Il nous semble qu'un tel principe, —qui serait en mesure de restituer au monde social et politique ordre et intelligibilité, dans l'attente que se profile une nouvelle forme-Etat— pourrait se retrouver dans l'idée de subsidiarité, remise sur le tapis aujourd'hui par la philosophie sociale chrétienne.
Le principe de subsidiarité est utilisé pour désigner les sociétés articulées, où l'ordre résulte d'un rapport organique entre personnes singulières, entre sociétés mineures et sociétés majeures, d'un rapport centré sur un lien d'aide, sur l'idée de subsidium afferre, qui ne doit jamais se transformer en absorption ou en élimination de la personne ou de la société aidées. Cela signifie que la société aidante doit s'auto-limiter dans son action, de façon à ne pas envahir la sphère de compétence d'autrui, comme il n'est pas licite d'enlever aux individus ce que ces individus sont capables d'accomplir par leurs propres moyens; une tel acte de confiscation de compétences et de droits représente une entorse gravissime à l'encontre de tout ordre social juste: on ne transfère pas à une société majeure, de grade plus élevé, ce que des sociétés mineures et de grade inférieur sont en mesure d'accomplir de leurs propres forces. Trouvant son origine dans la détermination des fonctions de l'Etat et des limites de son action face aux individus et aux sociétés mineures, le principe de subsidiarité, dans sa formulation entière, vise à dépasser toutes les formes d'individualisme et indique le chemin à suivre pour atteindre un système harmonieux de rapports entre les individus et les communautés existantes et entre les diverses communautés entre elles. Ce principe, en maintenant des espaces politiques décentralisés et des zones de décision jouissant d'une autonomie relative, vise à conserver unis les multiples segments de la société.
Il nous semble utile de rappeler que le principe de subsidiarité ne se pense pas sur le mode de l'abstraction. Au contraire, il se veut une norme spéciale qui, dans le «concret», régle les compétences des personnes singulières et des diverses sociétés naturelles et politiques, et détermine les devoirs qu'ont ces sociétés vis-à-vis de leurs membres. L'organicité de la polis, qu'implique le principe de subsidiarité, anticipe une forme d'Etat comprenant des fonctions multiples qui conservent leurs caractères spécifiques et une relative autonomie, en se coordonnant, en s'intégrant réciproquement, en convergeant vers une unité supérieure qui ne cesse jamais d'être pré-supposée au niveau de l'idéal. Il y a donc autant d'unité que de multiplicité, il y a gradualité et articulation, mais jamais ce binôme entre un centre et une masse qui lui est soumise, qu'il nivelle. Le principe de subsidiarité, comme critère de la “totalité” sociale, semble être sur la même longueur d'onde que le principe d'unité qui fonde le concept d'Etat.
Mais, avant toute chose, le principe de subsidiarité assure que l'autonomisme relatif est un élément essentiel dans tout système organique, au même titre qu'une décentralisation relative; celle-ci pourra être d'autant plus poussée que le centre unifiant saura exprimer unité, souveraineté et autorité.
Germanico GALLERANI.
(article issu de Pagine Libere di Azione sindacale, n°2/1993, dossier spécial: «Reinventare la democrazia»; adresse: Via Principe Amedeo 42, I-00.185 Roma; abonnement annuel (six numéros): 40.000 Lire; traduction française: Robert Steuckers).
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, italie, carl schmitt, politologie, sciences politiques, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Grandes fortunes et dynasties familiales en France

Grandes fortunes et dynasties familiales en France
Analyse: Michel PINCON & Monique PINCON-CHARLOT, Grandes fortunes. Dynasties familiales et formes de richesse en France, Payot, 1996, 376 pages, 135 FF.
Que de banalités, déjà ressassées, composent cet ouvrage fondé sur l'analyse socio-psychologique des riches, dans la tradition de Bourdieu. Le sociologue P. Bourdieu a développé la notion d'habitus, manière de produire des relations sociales. L'habitus correspond aux acquis personnels d'une vie, dans un milieu social historiquement déterminé. Il s'exprime par des dispositions durables. Il s'agit donc d'un système structuré de règles intériorisées permettant à l'individu d'adapter son comportement aux variations de l'environnement. L'habitus des riches génère tout naturellement des pratiques sociales, des façons de produire des relations sociales.
Les pratiques organisationnelles des riches sont un sous-ensemble de pratiques sociales qui, ayant longtemps perduré à l'identique, subsisteraient pour l'essentiel. Est-ce si évident?
- Il y eut le fief, ou l'enracinement rural, dont certaines familles affirment à juste titre qu'il remonte au moyen-âge. Le château “résiduel” est toutefois plus une charge qu'un bénéfice et oblige nombre de descendants à trouver d'autres recettes pour en assurer l'entretien.
- Il y eut le temps des palaces, des lotissements chics et des beaux quartiers, pour protéger l'environnement de l'intrusion des pauvres. Par exemple: le parc de Maisons-Laffites, la ville nouvelle du Vésinet,... Tous les exemples datent. Que dire des nouvelles castes de riches d'après la marchéisation de l'Occident? Le travail des auteurs s'arrête avant, prudemment.
Les pratiques sociales des riches ne sont pas le simple résultat d'un modèle culturel: la “civilisation des mœurs”. Les expériences acquises au fil du temps modèlent leur perception du monde ainsi que leurs pratiques. L'habitus intériorise une réciprocité articulée de pratiques (1) qui s'acquièrent aussi dans les écoles privées. Elles ont une fonction d'éducation plus que d'enseignement. Les écoles privées, créées dans la seconde moitié du XIXième siècle en Suisse, peuvent coûter jusqu'à 200.000 francs français par an; écoles polyglottes où l'on apprend les bonnes manières, grâce à l'entre-soi pratiqué par ceux qui appartiennent à un certain monde. Mais de quel monde s'agit-il aujourd'hui? La domination de l'Europe par les mafias “Bible and Business”, l'effacement des populations par les nouvelles colonies de peuplement... sur ces transformations aussi définitives, les auteurs sont, là aussi, d'une discrétion remarquable.
Une organisation, dans la perspective de Bourdieu, est un espace social qui produit un système structuré d'habitus spécifique, et qui structure les modalités des pratiques sociales. Les riches entretiennent un ensemble de relations issues des pratiques de chaque acteur, et l'ensemble produit une cohérence autonome. Ainsi, l'analyse des cérémonies, mondanités et rituels impose de comprendre le sens que les acteurs donnent à leurs actions: continuité du clan, délimitation des tribus, ajustement des personnes. Le devoir de transmettre, en particulier, est une représentation possédant une certaines cohérence. Cette cohérence assure la permanence de l'image de la lignée ou de la tribu, en sélectionnant les éléments assimilables, en ne procédant qu'à des réajustements et à des rééquilibres aussi peu perturbateurs que possible de l'ensemble, en évitant les réorganisations en profondeur de la structure existante des significations. Le représentation du “maillon de la lignée” guide les comportements des acteurs et contribue à l'expression symbolique de l'organisation familiale ou tribale dont l'image, véritable archétype, est irréductible à des perspectives individuelles.
D'autres auteurs de psycho-sociologie appliquent le concept de mythe (2) pour caractériser les symboles qui stucturent l'imaginaire individuel au sein d'une organisation quelconque. Le mythe renvoie à la pratique de rites remplissant trois fonctions: réunification, régulation, identité.
- La réunification intègre les pratiques différentes.
- La régulation définit implicitement l'acceptable et l'inacceptable.
- L'identité recouvre ce champ des rapports humains où le sujet s'efforce d'opérer une synthèse entre les forces internes et les forces externes de son action, entre ce qu'il est pour lui et ce qu'il est pour les autres.
Les relations d'affaires et les mondanités ne sont pas simplement un lubrifiant aux rapports fonctionnels dans le cadre d'une gestion de fortune. La gestion des grandes fortunes est de plus en plus collective. Le concept de gestion patrimoniale globale est un relais d'identification permettant de vivre le groupe mythique des riches comme un et cohérent dans ses intérêts.
Le pouvoir symbolique, destiné à convaincre les acteurs, est incertain, compte tenu de l'environnement culturel de chacun et du fait que tout symbole s'apprécie par rapport à autrui. L'incertitude est clairement reconnue par Bourdieu, pour qui les choix dus à l'habitus sont accomplis sans conscience ni contrainte en vertu de dispositions qui... se sont aussi constituées en dehors de la conscience et de la contrainte. La culture des riches happe l'individu et accroît le rôle du pouvoir symbolique en soulignant l'aspect socio-mental de l'organisation en réseaux de relations, en diffusant une idéologie d'emprise inconsciente marquée par l'adhésion.
Le pouvoir symbolique lié à la richesse s'analyse au total comme un effort pour inculquer la croyance en la valeur sociale des organisations, depuis l'école jusqu'aux localités, des mondanités aux héritiers. L'ensemble est supposé implicitement apte à résoudre un certain nombre de problèmes: convaincre les membres qu'ils désirent légitimement ce que ces organisations sont susceptibles de leur apporter. Affirmer que le riche, à un moment donné et avec le comportement qu'il a, est le meilleur possible, légitime l'état de fait en limitant la possibilité d'imaginer d'autres formes.
Mais tous les détenteurs d'un pouvoir ne mobilisent-ils pas, par la culture, des représentations collectives qui favorisent l'acceptation des asymétries de fonctions et de relations prétenduement fondées sur des normes objectives? Ainsi que les valeurs éveillant et entretenant la croyance en la légitimité des maîtres?
Frédéric VALENTIN.
Notes:
(1) P. BOURDIEU, Le sens pratique, Ed. de Minuit, 1980; La distinction: critique sociale du jugement, Ed. de Minuit, 1979.
(2) R. REITTER & B. RAMANANTSOA, Pouvoir et politique. Au-delà de la culture d'entreprise, McGraw Hill, 1985.
00:05 Publié dans Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : finances, banques, capitalisme, richesse |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 27 octobre 2008
Les fruits amers du néo-libéralisme

Andreas MÖLZER:
Les fruits amers du néo-libéralisme
La crise financière internationale a bien saisi l’Europe en ses griffes. Chaque jour, dans l’un ou l’autre pays de l’Union Européenne, on doit rapidement ficeler une politique de sauvetage pour empêcher l’effondrement d’une grosse banque; les indices de la Bourse plongent vertigineusement et, lors des réunions au sommet de l’UE, on cherche fébrilement des solutions de rechange pour échapper à la crise. Toute cette misère n’est pas subitement tombée du ciel. Depuis longtemps déjà, des spécialistes nous ont averti que la bulle pouvait éclater sur les marchés financiers internationaux, bulle que l’incommensurable avidité des spéculateurs américains avait contribué à créer. En se détachant complètement de l’économie réelle, on s’est mis à faire des affaires abracadabrantes et on a remplacé la rationalité économique par un mental de joueur de casino. Les banques européennes n’ont pas voulu demeurer en retrait de cette euphorie et se sont jetées dans le piège américain. Et maintenant que les banques fortement touchées par cette peste risquent d’entraîner toute l’économie dans l’abîme, voilà que l’Etat doit revenir pour empêcher le pire. En d’autres termes: l’Europe récolte désormais les fruits amers du néo-libéralisme.
Prendre le mal à la racine: l’UE n’en a pas eu la volonté. Car pour le faire, il aurait fallu repenser de fond en comble le système financier international existant. Pour empêcher que dans l’avenir, l’avidité pathologique de la haute finance américaine ne ruine le secteur bancaire européen, il faut tenir en laisse les jongleurs de la finance internationale. Il faudrait aussi qu’au niveau du contrôle des marchés financiers, on impose des critères minimaux sévères et, qui plus est, qu’on exige des profiteurs du système financier une contribution de solidarité. De façon à conforter un fonds de sécurité permettant de soutenir les banques en cas de crise.
Quant au Bruxelles eurocratique, il est bien nécessaire qu’il change fondamentalement son attitude et confesse, même indirectement, qu’il a fait fausse route et échoué. Car, rappellons-le, dans les années et décennies passées, le Bruxelles eurocratique ne s’est pas posé comme un rempart contre la globalisation selon le modèle voulu par les Américains, mais, au contraire, comme l’instrument favorisant un libéralisme sans aucun frein. Ce Bruxelles eurocratique n’a pas pour but premier de protéger les citoyens qu’il a sous sa juridiction mais de détricoter les barrières douanières et d’abattre les limitations imposées au commerce et de favoriser le passage et le transfert illimité des marchandises et des capitaux vers tous les continents. C’est à cela que travaillent les lobbyistes de tous poils qui s’agitent dans les corridors du Bruxelles eurocratique: leur objectif, c’est que dans l’UE s’imposent les projets de l’idéologie néo-libérale de Wall Street et d’autres cénacles américains.
Andreas MÖLZER.
(article paru dans “zur Zeit”, Vienne, n°42/2008, trad. franç.: Robert Steuckers).
00:26 Publié dans Politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : néo-libéralisme, crise, libéralisme, finances, usure, usurocratie, union européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Les Etats-Unis, puissance du chaos

ARCHIVES DE "SYNERGIES EUROPEENNES" - 1993
LES ETATS-UNIS, PUISSANCE DU CHAOS
Les analystes ont abondamment commenté le nouvel épisode de la vendetta menée par la Présidence des Etats-Unis à l'encontre de Saddam Hussein. Les troupes irakiennes ont en effet appuyé l'offensive du PDK (Parti Démocratique du Kurdistan) de Massoud Barzani sur Erbil, jusqu'alors aux mains de l'UPK (Union Patriotique du Kurdistan) de Jalal Talabani. Bagdad entendait ainsi, via son allié kurde, assurer la sécurité de l'oléoduc débouchant en Turquie —l'hypothétique mise en oeuvre de la résolution 986 de l'ONU, dite "pétrole contre nourriture", permettrait à l'Irak de redevenir un exportateur d'hydrocarbures— , et réaffirmer sa souveraineté sur la partie irakienne du Kurdistan.
Cet épisode est une des conséquences de la guerre du Golfe (1990-1991). L'opération “Tempête du Désert” conduite par les Etats-Unis ayant pris fin une fois l'Irak ramené à 40% de ses capacités, Bagdad s'était alors retourné contre les minorités chiites du Sud et kurdes du Nord, dont les tendances centrifuges avaient été soigneusement attisées par Washington. Aussi les zones de peuplement kurde et chiite, au nord du 36° parallèle et au sud du 32° parallèle avaient-elles été interdites à l'aviation irakienne, une force américano-franco-britannique assurant l'effectivit de cette mesure (résolution de l'ONU d'avril 1991 et août 1992). C'est pour faire respecter ces résolutions, qui ne concernent pas les actions militaires terrestres, que les Etats-Unis ont unilatéralement riposté à l'offensive sur Erbil, au nord du 36° parallèle: vingt-sept missiles de croisière le 3 septembre, dix-sept autres le lendemain, ont frappé le Sud de l'Irak. Ce qui n'a en rien modifié l'équation militaire au Kurdistan, le PDK mettant à profit son alliance avec le pouvoir central pour refouler l'UPK. Son dernier bastion, la ville de Souleimaniyé, est tombé le 9 septembre et Jalal Talabani s'est réfugié en Iran. Saddam Hussein peut maintenant rafler la mise.
Restent à interpréter ces évènements. A juste titre, les analystes ont stigmatisé l'incohérence et les contradictions de la politique des Etats-Unis dans la région. D'une part, le Département d'Etat affirme que les EtatsUnis ne souhaitent pas le démembrement de l'Irak au profit d'un Etat kurde indépendant. D'autre part, la création d'une enclave kurde autonome par la diplomatie américaine revenait bel et bien à créer un embryon d'Etat doté d'un parlement élu en 1992, d'une administration, de services publics et d'une milice (1). Ce Kurdistan autonome assurait à l'opposition irakienne, regroupée tant bien que mal par les Etats-Unis au sein du Conseil national irakien, une base géographique pour la conquête du pouvoir central. Aujourd'hui, cette illusion a vécu c'est en vain que l'administration Clinton et la CIA auront investi 130 millions de dollars -, et les derniers rebondissements d'une longue lutte entre le PDK et l'UPK ont démontré l'inexistence d'une conscience nationale kurde. Indubitablement, l'opération est un fiasco.
Mais il faut aller plus loin. Contrairement à ce qu'affirme Robert Dole, le candidat républicain à la Maison Blanche, ce fiasco ne saurait s'expliquer par les seuls cafouillages de l'administration Clinton. De même, la prise en considération par Washington des intérêts de l'allié turc —on sait Ankara profondément hostile à l'autonomisme kurde— ne suffit à expliquer 1'attentisme de Clinton. Si les Etats-Unis n'ont pas véritablement voulu s'investir dans la création d'un Etat kurde pleinement souverain, c'est en raison de la nature même de leur puissance.
Le stratégiste François Géré l'a bien vu, les Etats-Unis sont la “Puissance du Flux”: flux de populations migrantes, flux de marchandises et de capitaux, flux d'informations, d'images et de sons (2). Les Américains perçoivent leur territoire non pas comme un espace d'enracinement, mais comme une surface de déplacement, et leur position dans la hiérarchie internationale du pouvoir repose sur la manipulation de flux de toute nature. Dès lors ont-ils pour objectif de faire respecter leur libre-circulation à la surface de la Terre. Gare à l'Etat souverain qui, à l'instar de l'Irak, entendrait définir une zone d'influence et fixer des règles pour tenter de gouverner ces flux. Au moyen d'un navalisme futuriste combinant Sea Power, Air Power et Space Power, ils arasent l'obstacle! Précisons les choses. Ils ne "débarquent" pas pour fonder un nouvel ordre politique régional, mais alternent frappes rapides et retour aux bases ("Hit and run").
Les Etats-Unis refusent donc les responsabilités globales qui sont celles d'un empire —faire prévaloir la Civilisation sur le Chaos— pour se contenter de garantir par un interventionnisme musclé le “bon” fonctionnement des mécanismes du marché. En d'autres termes, les Etats-Unis ne sont plus une puissance hégémonique; faute d'assurer sécurité et prospérité à leurs alliés, leur domination a cessé d'être légitime. Depuis le naufrage du monde communiste, l'Amérique est devenue un système exclusivement prédateur à la recherche d'avantages unilatéraux, et le contrat quasi-féodal qui liait les nations du monde dit libre à leur suzerain, obéissance contre protection, est aujourd'hui caduc, Washington ne daignant plus remplir ses obligations impèriales. Les Kurdes en font aujourd'hui la triste expérience.
Mieux. Loin de nous préserver du chaos, ce système prédateur le généralise. Son libre-échangisme tous azimuts implique le démantèlement des souverainetés à même de territorialiser les flux multiples et désordonnés qui agitent le monde. Faute d'“obstacles” pour cloisonner l'espace mondial, ces flux sont à tout moment susceptibles de se muer en ouragans planétaires, et de disloquer les communautés humaines les plus enracinées. Les sautes d'humeur du méga-marché financier mondial en témoignent.
L'échec du Kurdistan autonome est donc plein d'enseignements. Au delà des erreurs politiques commises par l'Administration Clinton et des calculs à courte vue, il doit être clair que les Etats-Unis ne font jamais que ce qu'ils sont. Par là-même, la Puissance du Flux est aussi la Puissance du Chaos. Et le Nouvel Ordre Mondial américano-centré prophétisé par Georges Bush en 1990 est une fiction. Faute d'“hegemon” couplant sens et puissance, capable d'inscrire un nouveau Telos (une finalité) à l'horizon, le Monde n'est pas unipolaire mais a-polaire.
Louis SOREL.
(1) De manière à assurer la parité entre l'UPK et le PDK, les élections de1992 ont été truquées. De facto, cet accord a débouché sur le partage géographique du Kurdistan irakien, l'UPK contrôlant les villes et le PDK la frontière avec la Turquie.
(2) Cf. Dr. François Géré (Dr), Les lauriers incertains. Stratégie et politique militaire des Etats-Unis 1980/2000, Fondation des études de défense nationale, 1991.
00:10 Publié dans Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : etats-unis, géopolitique, géostratégie, stratégie, globalisation, kurdistan, turquie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
La primera etapa de J. Donoso Cortés
|
 De la poesía a la política. La primera etapa de Juan Donoso Cortés por Gonzalo Larios El objetivo es señalar los antecedentes que conforman su pensamiento político durante los años previos a su conocido compromiso con la corriente del liberalismo doctrinario. Corresponde el período que ahora nos ocupa al fin de sus estudios universitarios, a su incursión en el ambiente literario y a su incorporación definitiva al mundo de la política. Constituye en sí un peiodo, aunque breve, porque considero que merece la pena distinguirlo dentro de su ideario de juventud, que comúnmente se ha englobado en un todo liberal doctrinario que no siempre corresponde, como en este caso, a la realidad de su pensamiento. | |
| El entorno de su decisión de participar en las lides políticas está marcado por un acontecimiento de la mayor trascendencia para el futuro institucional de la España contemporánea. Me refiero a la cuestión sucesoria que se planteó ante el restablecimiento en 1830 de la pragmática sanción que restauró la sucesión al trono por línea directa, aunque fuera femenina. Su posterior derogación, en septiembre de 1832, y su definitivo restablecimiento, a consecuencia del golpe de Estado ocurrido días después de la anterior revocación, terminan por significar el afianzamiento del régimen político liberal en España. Es presumible la participación directa de Donoso Cortés en el mencionado golpe acontecido en La Granja [1] . Este fue organizado por sectores de la nobleza, con el apoyo de parte de la alta burguesía liberal. Entre sus ejecutores destacaron el marqués de Miraflores y los condes de Parcent, Puñonrostro y Cartagena, quienes contaron con la activa participación de los cuñados de Donoso, Juan José y Rufino García Carrasco. Sobre todos ellos hay que sumar el apoyo de María Cristina, esposa del, por entonces, moribundo Fernando VII, y además el de la persuasiva Luisa Carlota, hermana de María Cristina y esposa del infante Francisco de Paula, hermano menor del rey y del infante don Carlos. La primera sellaba de esta manera su alianza con el liberalismo, con el objeto de lograr la sucesión al trono de su hija Isabel. La influencia de la segunda, si bien no del todo aclarada, parece decisiva en el súbito cambio de opinión del monarca y en la destitución del Ministerio, asuntos vitales para el éxito del golpe [2] . La situación política que germina en los sucesos de La Granja, pese a la mejoría temporal de la salud de Fernando VII, quien no fallece sino un año después, supone, en definitiva, el fin del Antiguo Régimen, a través del establecimiento de la Regencia de María Cristina, en espera de la mayoría de edad de su hija Isabel. En lo que corría de siglo, era éste el tercer intento liberal en España por acabar con el Antiguo Régimen. Fue el que finalmente logró su objetivo, no sin tener que resolver por las armas el problema sucesorio que, desde sus orígenes, había planteado el carlismo. Donoso Cortés se incorpora a la política con decisión y compromiso, en torno a estos significativos "sucesos de La Granja"; reconozcamos, pues, cuál fue, entonces, su primer aporte intelectual en aquella hora de transición de la monarquía y del fundamento de su soberanía. Romanticismo Hemos anotado el ambiente poético y literario en el que se desenvuelve Donoso en su juventud. Ha recibido su formación universitaria en centros pre-románticos como Salamanca y Sevilla. Paralelamente, trató de cerca al poeta Quintana. En todo ello, se puede perfilar el tránsito del sentimiento ilustrado al romántico, fase que se completa en la generación del propio Donoso, la que ha nacido en el siglo XIX. No es fácil precisar el concepto de romanticismo o delimitarlo a una esfera literaria o estética, mucho menos a una política. Parece más bien una forma de enfrentar la vida, un estilo de comportamiento, una acusada mentalidad, que en un afán superador del racionalismo dieciochesco, tiende a valorar desmesuradamente el sentimiento, los instintos, el mero impulso. Así, la actitud propia del romántico es la pasión, el arrebato ligero e idealista que lo mueve a despreciar el análisis racional por considerarlo frío, impersonal, carente de vida. La valoración de la libertad y el sentimiento trágico de la vida, son otras dos características comunes al espíritu romántico, que bien pueden ayudar a entender algunas actitudes donosianas. Donoso formó parte y dio sus primeros pasos intelectuales junto a la primera generación del romanticismo español. La historiadora Iris M. Zavala lo incluye, en sus inicios, dentro del romanticismo progresista, que abandona durante la decada de los años treinta, para, en la siguiente, influir como pionero del romanticismo conservador junto a Balmes. Para ella, ambos pensadores alimentaron la defensa del altar y del trono, el retorno a las baladas y leyendas populares y la importancia de la religión ante los "extravíos" románticos [3] . Incluso hace hincapié en el ataque donosiano a la soberanía popular -cuando la calificó de absurda, imposible, y atea-, comparándolo con el significado salvífico que ésta había tenido para Larra y Espronceda. Esta distinción ayuda, en opinión de Zavala, a diferenciar ambas corrientes románticas. Lista, Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano y el duque de Rivas, evolucionaron hacia esta tendencia literaria conservadora, que contó con exponentes de la talla de Nicomedes Pastor Díaz, Gabriel García Tassara y Joaquín Francisco Pacheco, los tres por entonces, amigos de Donoso. Más tarde incluye en esta corriente a Zorrilla, Navarro Villoslada y José María Quadrado. Si bien no todos compartieron los duros juicios de Donoso sobre la soberanía popular, para Zavala los uniría su común espíritu conservador. Literatura y política tienen en aquella época íntima conexión, son los años en que abunda la figura del político-literato, pero debemos cuidarnos de no diferenciarlas como corresponde. Con peculiariedad, el estilo y el pensamiento político de Donoso Cortés, tanto como su carácter personal, responden en medida importante a este espíritu romántico. De entre los pocos versos que se conservan, La venida de Cristina refleja su ánimo romántico ante la llegada de la bella joven y "las felices bodas con el Rey nuestro señor" [4] . Este poema es de felicidad y optimismo ante las perspectivas del nuevo matrimonio Real. Junto a la reina, ve venir la paz, "por la esperanza y el amor llevadas" [5] . No son versos políticos, pero no dejan de reflejar un profundo sentimiento de admiración y respeto por la institución monárquica, incluso un inesperado entusiasmo por lo que podría llegar a suponer para la frustración de la sucesión de don Carlos. Esta inicial simpatía poética llegó a plasmarse, respecto a María Cristina, a lo largo de una vida a su servicio, en una inquebrantable fidelidad. El régimen liberal que encabeza María Cristina cuenta en Donoso con una de sus principales figuras de apoyo, especialmente a través de la prensa. Luego, en 1840, tras la caída de la Reina Gobernadora, ésta le solicitará su colaboración personal durante su exilio en Francia. Es muy probable que Donoso en su primera estancia en Madrid, hacia 1828, recibiera a través de Agustín Durán la influencia del romanticismo schlegeliano, es decir, católico y conservador. De allí pueden provenir sus primeros contactos con las obras de Chateaubriand, M. de Staël y Scott. En su discurso de Cáceres al año siguiente hay palabras de elogio a Durán, cuya posición medievalista debe haber contrarrestado, al menos en parte, los tópicos ilustrados que habría recibido de Quintana. Hacia 1837-38, ya desilusinado del doctrinarismo, se vuelven a hacer notar en sus escritos estas lecturas románticas de matiz conservador y cristiano. Historia y revolución De los primeros escritos, generalmente cartas personales de 1828-29, destaca la alta consideración de sí mismo, y la gran estima intelectual que ya le demuestran sus compañeros de estudios. El joven extremeño demuestra en ellas poseer un considerable conocimiento de las tendencias filosóficas del momento, dejándose ver como un liberal optimista, confiado de la trascendencia positiva de los tiempos que corren [6] . Su Discurso de Apertura en el Colegio de Cáceres (1829), donde apoyado por Quintana comienza a ejercer, no del todo convencido, una cátedra, refleja su fuerte formación ilustrada. Prueba de ello es que la clasificación de la historia que allí utilizó responde al tópico racionalista y liberal apologético en su valoración de la Grecia clásica; recoge asímismo de la Ilustración la despreciativa valoración de la Edad Media como "siglos de barbarie" [7] , y una actitud de sincera admiración hacia el Renacimiento en las figuras de Dante y Petrarca. No obstante, el joven profesor, nada original hasta el momento, llega a afirmar que el surgimiento de la filosofía de las sensaciones, que origina Bacon en la Inglaterra del siglo XVI y que desarrollaron Locke, Condillac y Helvecio, determinó que desde entonces en Europa todo sea "disputa y agitación" [8] . Esta interpretación histórica la completa en el escrito que se le atribuye y que lleva por título Exposición a Fernando VII en favor de Juan José Carrasco, fechada, sin mayor precisión, entre los años 1831 y 1832. Allí Donoso agrega a su análisis que desde aquel instante de disputa y agitación, fue cuando el mundo entró en un caos: "Los filósofos quisieron explicar al hombre y constituir la sociedad, y la sociedad y el hombre se han aniquilado entre sus manos" [9] . Lo explica señalando que fue a partir de entonces cuando se introdujo el germen de la duda en el seno de los pueblos y, con él, el de las revoluciones. Una sociedad, dice Donoso, no puede existir sin una base común de creencia y el principio filosófico, que no es otro que la duda que origina la disputa, ha combatido el principio religioso, que es, dentro de su ideario, ya constitutivo y civilizador de los pueblos europeos [10] . De esta lucha entre ambos principios, en la que el religioso reúne para conservar y el filosófico individualiza para destruir, han nacido, en su opinión, todos los males de Europa. En esta interpretación, la Reforma fue el primer resultado de este enfrentamiento, aunque el triunfo de la filosofía no llegó hasta el siglo XVIII, cuando fue capaz de engendrar la revolución que "conduce a la religión al sepulcro" [11] . La sociedad ha perdido, desde entonces, su base común y no logra encontrar un principio que logre serenarla. El ejemplo lo tiene en Francia, en donde ni la República, ni el Imperio, ni la Restauración, ni siquiera aun las convulsiones recientes de julio de 1830, han encontrado un principio que logre dominar la disolución. Esta la explica afirmando que la derrota del principio religioso en Francia lleva consigo tres principios destructores: la destrucción de la unidad de creencia, la destrucción de costumbres y la destrucción del gobierno. Sin la unidad de creencia la sociedad se disuelve, ya que desaparece el principio de unidad y, en su lugar, se entroniza el espíritu de individualización que se apoderará de las masas; la destrucción de las costumbres es fruto de la corrupción que ha invadido todas las clases sociales; un pueblo corrupto, en consecuencia, no puede darse instituciones ya que aparece incapaz de generar estabilidad sin costumbres, o dicho de otra modo, la falta de una creencia disuelve las costumbres y las pasiones no son capaces de organizar instituciones. El problema está en que este desorden social provoca en la práctica: "la idea anárquica de que todo puede discutirse, de que todos los principios pueden ser falsos si los analiza la razón y de que nada debe respetarse sin haber sufrido el examen de las masas" [12] . En este temprano análisis encontramos ya el enfrentamiento "revolución contra religión", clave en su pensamiento posterior. El afirmar el triunfo de la primera sobre la segunda lleva consigo la denuncia de las consecuencias, inevitablemente anárquicas, que la sociedad ha de seguir: "si en este pueblo se discuten las grandes teorías de los poderes, si se analizan todas las formas de gobierno, todas las maneras de existencia política y social, el pueblo, que nada respeta, porque nada cree, y nada cree, porque no tiene religión, estará siempre en lucha con el Gobierno que le rige; si la imprenta periódica es la arena donde se combaten todos los principios, el pueblo es el juez que debe decidir sin apelación de la victoria; es decir, que un pueblo que sólo se gobierna por pasiones es llamado a decidir como soberano lo que sólo debiera decidir el tribunal de la conciencia y la razón; cuando el mundo moral ha perdido en este grado su nivel, cuando se han quebrantado de esta manera todas las relaciones de las cosas, cuando se ha organizado de esta manera el desorden en el seno de la sociedad, el Gobierno es una ilusión, la obediencia es un engaño y la sociedad es un abismo. Tal es el estado de la Francia: la discusión aniquiló la religión; la discusión ha aniquilado los Gobiernos" [13] . Donoso liga directamente el efecto disolvente de la revolución a la acometida de ésta en contra de la religión; la discusión, en una sociedad descreida, en definitiva, es el germen de la anarquía social. Está aquí presente su crítica a la soberanía popular, en la entrega a discusión de los principios fundamentales de la sociedad a una masa que, sin religión, al perder las costumbres, se regirá por la pasión. En este sentido, la destrucción del principio religioso, en su pensamiento, a diferencia de los filósofos ilustrados, significa una pérdida de análisis racional para hacer frente a los problemas políticos, ya que al final, se someterían únicamente a la resolución "sin apelación" de un pueblo que considera, por descreído, sin costumbres y corrupto. Razón y fe, aparecen ya indisolublemente ligadas en el pensamiento del joven Donoso Cortés. El divorcio de ambas es ya, para él, precisamente la causa de las convulsiones de Francia y el anuncio de catástrofes en toda Europa. Toda esta interpretación de la historia occidental supone un anticipo a tesis fundamentales de su polémico.Ensayo.(1851) La oposición religión católica-filosofía racionalista esta esbozada en estos poco estudiados escritos, como también su teoría de las revoluciones y, especialmente, la consideración negativa de toda discusión desvinculada de un principio que la ordene. Este Donoso, ciertamente, le debe aún mucho al liberalismo, pero su supuesto racionalismo inicial sufre altos y bajos como lo prueba su siguiente afirmación: "la filosofía por sí sola nada puede... de su divorcio con la religión han nacido todos los males que pesan sobre la Europa" [14] . El Donoso maduro, católico, enemigo innato de la revolución; aquél que percibe tras toda gran cuestión política un asunto teológico, se anuncia a ratos, pero con inusitada precisión. Hay quienes han dudado de la sinceridad de estas tempranas afirmaciones donosianas debido al carácter de los escritos en que están incluidas, teniendo en cuenta de que están dirigidos al rey. Sin embargo, la conformidad de ellas con sus posteriores ideas es en muchos casos tan estrecha que, en mi opinión, las liberan, en su mayor parte, de una justificada sospecha de hipocresía. Continuando con su rápida revisión de la historia, surgen algunas contradicciones. Si el siglo XVI había dado origen a las disputas morales con las ya señaladas repercusiones en la sociedad, el siglo XVIII, que por sus "profundos filósofos y celebres artistas" [15] lo tenía todo para ser el siglo de las luces fue, no obstante, el de las revoluciones. En este juicio del siglo que lo precedió, combina el reconocimiento de la magnitud de los pensadores que lo moldearon con los resultados sociales que generarían estas ideas en la práctica. Su viraje al interpretar de forma positiva la historia de lo que va corrido de su siglo vuelve a recordar su formación ilustrada y, fruto de ella, su íntima convicción optimista ante el presente y futuro de su siglo. El XIX deberá ser el siglo de las luces, "en el que se encuentran bastante discutidas todas las opiniones que dividieron a los filósofos y que abrazaron las escuelas" [16] . Es el momento, con todo el saber del pasado y la experiencia del presente, de avanzar con paso seguro y esperanzador en la carrera de la ilustración. Nuestro autor demuestra su juvenil entusiasmo ante el momento histórico que vive. Las disputas, no sabemos por qué razón, las siente superadas, como si se tratara de una lección asumida. No cabe duda, sin embargo que en la discusión, ajena a una creencia común, está considerando un aspecto negativo, disolvente de la sociedad, tesis que desarrolló con profundidad durante sus años de madurez [17] . Su interpretación de la historia es la que por entonces está en boga y que construyó la Ilustración, su juicio negativo del enfrentamiento a partir del siglo XVI de filosofía y religión, rompe el tópico racionalista, anuncia al futuro Donoso, pero no termina de enlazar con el resto de su visión. Nuestro joven intelectual apenas sobrepasa por entonces los veinte años de edad y, como veremos, sus ideas están en continuo desarrollo, no exentas de revisión a través de sus lecturas y en torno a los avatares políticos y sociales de su época. José Alvarez Junco ha creido ver, en estos primeros escritos donosianos, rasgos de un "teocratismo cristiano" al cual "regresará" tras las revoluciones del 48 [18] . Las revoluciones, cuyo estudio ya considera de fundamental importancia, son las que establecen el eslabón de los distintos períodos históricos, constituyen la marcha "constante y progresiva" [19] de los siglos; si bien, en carta a su amigo Gallardo, consideraba que aunque el espíritu humano avance, puede también encontrar retrocesos en su marcha [20] . Este avance progresivo de la historia es una idea muy propia del espíritu decimonónico, del cual Donoso no pretende prescindir, y contrasta con el tono pesimista que se deja ver en su prólogo a El cerco de Zamora (1833), en donde vuelve a perfilarse el último Donoso; en este caso diríamos el de siempre, porque advierte de las consecuencias catastróficas que la supresión de las jerarquías sociales anuncian a la sociedad [21] . Este punto, que ya por entonces llama a meditar, es una de sus constantes: Donoso fue siempre anti-igualitario, porque percibió en las jerarquías una resistencia natural al poder absoluto, a la omnipotencia social como luego lo denominaría. La duda ha sido el sepulcro de la razón y de la fe, pero esta situación anárquica, que a través de la revolución Francia extiende por Europa, encuentra en España un duro escollo. Donoso considera que, en su nación, el principio religioso se respeta, de lo que extrae dos inmediatas consecuencias: el trono tiene aun allí hondas raíces y las costumbres sociales, que sobreviven por la ausencia de principios destructores y la presencia del principio religioso, "hacen imposible en España una revolución" [22] . Así, la religión está reconocida ya en su primer pensamiento como requisito de la institución monárquica y fundamento básico de las costumbres sociales del pueblo español. Donoso no se detiene en señalar el porqué, a diferencia del caso francés, en España no se produjo el divorcio entre filosofía y religión. Siguiendo la lógica de su interpretación, deberíamos señalar que fue porque, en la península, la razón siguió caminando junto a la fe, ya que las consecuencias que él mismo describiera de la filosofía sensualista y la Reforma no lograron penetrar en el ambiente intelectual español sino varios siglos después, viéndose con ello retrasada la aparición de sus efectos. Fue precisamente la monarquía española la que tomó en sus manos la defensa de la religión católica y colaboró activamente en la llamada Contra-Reforma. Sin embargo, Donoso desconocía por completo, al menos durante su juventud, y muy probablemente por su formación liberal ilustrada, el pensamiento escolástico español. No logra por entonces despegarse de la mentalidad de su tiempo para explicar lo que ya comienza a percibir. Monarquía y propietarios Para nuestro pensador los reyes deben depender del "gran movimiento social que se verifica en Europa" y "no de la voluntad particular de un individuo cualquiera" [23] . El primero es el liberalismo, la segunda, el absolutismo. Sin embargo, hemos visto que Donoso, si es liberal por formación, es conservador por instinto y procedencia. Al liberalismo querrá despojarlo de su espíritu revolucionario, o como lo llamará después, de su ánimo disolvente de la sociedad. Aun si en España germinaran las causas de la revolución, ésta no encontraría el apoyo de los propietarios, quienes por su instinto de conservación tienden a proteger sus intereses. Ellos saben que las revoluciones promovidas por las masas estan escritas con la sangre de los propietarios, pueden "todavía consultar los sepulcros de la revolución francesa y no encontrarán sino los cadáveres de los que tuvieron" [24] . Esta relación antagónica revolución-propietarios es característica del liberalismo conservador, que surge una vez producida la revolución y trastocada la propiedad. Antes, como sugieren estos escritos del extremeño, parece señal del más mezquino inmovilismo, aquél que sacrifica toda dinámica política a la mera protección de su peculio. Hay, no obstante, que considerar que Donoso, en la cita anterior, está escribiendo a nombre de su cuñado y nada menos que al rey Fernando VII, y, evidentemente, no es el momento de sugerir cambios, ni de hacer críticas al absolutismo. Lo que pretende decir entonces Donoso, es que no se ha de buscar revolucionarios ni conspiradores en los propietarios, entre los que evidentemente estaría su cuñado. Finalizado el golpe de Estado de 1832, nuestro pensador insistirá en esta tesis, dividiendo a los españoles en los partidos"de la legitimidad y la usurpación" [25] . El primero incluye a todo el sector liberal que se ha hecho con el poder, precisamente un amplio grupo de la aristocracia apoyada por la alta burguesía, que más tarde llamará aristocracias legítimas, y que no son otras que las clases propietarias. Por otra parte, los usurpadores, son el bando carlista, donde deben encontrarse los conspiradores y revolucionarios, curiosamente el sector popular y rural, que políticamente califica de inmovilista, por ignorar la gran transformación que se implementa en Europa y pretender, en cambio, retrotraernos al siglo XII. Donoso proviene de una familia de propietarios terratenientes. Sin embargo, no parece mostrar intereses económicos, ni siquiera en éstos sus comienzos, más allá de los que le permitieran mantener una vida con la dignidad a la que parece acostumbrado. Por otra parte, obtiene el rápido reconocimiento público de sus personales capacidades intelectuales, de lo que sí se muestra orgulloso en esta etapa. Su carrera de funcionario, y el formar parte del selecto ambiente político e intelectual de Madrid, lo mantienen más que satisfecho. Su principal afán será influir a través de sus ideas en la política española e incluso europea. Siempre mantuvo cierto desdén hacia lo material, atributo más propio del ambiente romántico que de su formación liberal. Busca el extremeño en estos años de transición la liquidación del absolutismo, objetivo que mientras viva Fernando VII no corresponde plantear sino señalando que el rey debe depender del "gran movimiento social que se verifica en Europa", evitando los efectos perturbadores de la revolución. Donoso, como hombre de su siglo, acepta la corriente de su tiempo, un liberalismo superador del anquilosado absolutismo, y en este sentido progresista. Su espíritu se percata inmediatamente de la necesidad de controlar los efectos disociadores de la revolución. Si bien señala las causas de éstos en la pérdida del principio religioso, no alcanza aún a recomendar remedios, sino que trata de hacer ver, poco a poco, a la Iglesia y la religión no como un enemigo a destruir por el liberalismo, sino como una institución que ha sido garantía de libertades y de progreso. Así, en su análisis histórico, también pretende superar una visión negativa de la labor de la Iglesia en relación con el progreso de la economía, al ver en las Cruzadas el germen que introduce el entusiasmo y las virtudes, no por sus resultados políticos o por su carácter de empresa común, que obliga a descuidar la familia y la propiedad, incluso a disponer de la vida por un supuesto ideal religioso, sino porque las Cruzadas generaron un desarrollo del comercio que, a su juicio, ha significado un primer paso hacia la ilustración. El beneficio de las Cruzadas, mediante las cuales sorprende la unidad espiritual de Europa, está, para Donoso, en que permitieron el desarrollo comercial con Oriente y entre los mismos europeos [26] . De esta manera, la religión cristiana ha constituido y civilizado a los pueblos, y su mérito no es otro que el de haber dado impulso al desarrollo comercial. Pareciera querer hacer ver a quienes se rigen por intereses ajenos a la religión que la Iglesia no es una institución negativa, sino que por el contrario, como impulsora del comercio, sería fundamento de la felicidad liberal. Sus primeros escritos son liberales pese a su denuncia del divorcio entre fe y razón y las críticas ocasionales al proceso revolucionario contrario a la religión. No llega, sin embargo, a dilucidar las últimas consecuencias de aquella ruptura, sólo lo hará a partir de 1847. Por el contrario, ahora busca asignar a la religión un papel moderno dentro de su época, forzándole un logro económico como el comercial que acabamos de señalar. La defensa de la Pragmática Más allá de adelantarnos algunas consideraciones sobre la monarquía, su Memoria de 1832 buscó la legitimación del golpe del mismo año, incluyendo, para ello, argumentos en pro de la legalidad de la pragmática. Por otra parte supuso afirmar, con decisión, su primera posición política junto a la causa del liberalismo conservador. Sus duros juicios hacia el carlismo buscan identificarlo como el enemigo político sin cuya amenaza no podría justificarse el golpe de 1832. Más aún, Donoso busca legitimar jurídicamente el golpe afirmando la ilegalidad que constituía la medida impuesta en 1713 por el rey Felipe V, la cual supuso el impedimento a la sucesión femenina del trono de España. Partiendo de esta premisa, quiere reconocer como válida toda acción que busque remediar esta "ilegalidad". Una vez ordenada la anterior situación por Fernando VII mediante la pragmática sanción de 1830, juzga como "usurpadores" a quienes han pretendido ignorar ésta última, por oponerse, en definitiva, al restablecimiento de la tradición y la costumbre. Su dialéctica es hábil y oportuna, pero no analizaremos aquí la autoridad o validez de sus juicios históricos o jurídicos. Sí, en cambio, nos interesa la intencionalidad de sus argumentos en favor de la precisión de su inicial ideario. Como hemos señalado, su punto de partida sobre la cuestión es la tesis que considera la revocación de Felipe V como "ilegal y nula... concebida por la venganza y sancionada por la fuerza" [27] . Ilegal porque se acabó con una ley que recogía la costumbre: "las primeras leyes de los pueblos son siempre la expresión exacta de sus necesidades, porque son el resultado inmediato de las costumbres que ellas produjeron. Estas leyes deben ser siempre sagradas, porque han recibido la sanción de la experiencia y de los siglos" [28] . En su opinión, Felipe V, en pos de alejar a la Casa de Austria de la Corona y vengar el agravio de la guerra de sucesión, despojó a las hembras de sus derechos al trono en contra de la costumbre [29] . El asunto es que: "las leyes fundamentales de la Monarquía no pueden trasladarse nunca de una nación a otra, porque una nación no puede existir sino con los elementos que encierra dentro de sí misma. Cuando estas leyes son impuestas y no nacidas espontáneamente en el pueblo que las debe obedecer, ellas son el germen más fecundo de todas las revoluciones" [30] . En consecuencia, la medida de Felipe V lanzaba a España "al abismo de las revoluciones" [31] , precisamente porque la consideró contraria a sus tradiciones y resistida por sus costumbres. En aval de lo anterior, Donoso señala que, en su día, el Consejo de Castilla la acató por presión real: "es muy difícil que los reyes cuando han expresado su voluntad no encuentren medios de ser obedecidos" [32] . Por otra parte, mientras que en el Consejo "doblaron la cerviz y se sometieron al yugo" [33] , las Cortes de 1713, "sólo sirvieron de máscara para cubrir la ilegalidad de la ley que Felipe V había jurado imponer a la nación que gobernaba" [34] . Su aprobación por ellas careció de validez, para el extremeño, ya que constata y denuncia graves anomalías en su representación. En fin, para Donoso, "la disposición de Felipe V no puede tener fuerza de ley porque no fue libremente aprobada por la nación ni por los grandes Cuerpos del Estado" [35] . Por consiguiente, la pragmática sanción no hace sino colocar las cosas en su lugar. La argumentación de Donoso fue bien acogida por Fernando VII, quién ordenó su publicación, no sin provocarle al joven extremeño algunos disgustos por la censura a la que fue sometida su Memoria [36] . Fue éste el primer escrito de carácter político que publicó Donoso y mediante el cual, contando con tan sólo veintitrés años de edad, se da a conocer en torno a la Corte. Poco después, fue incorporado como oficial a la Secretaría de Gracia y Justicia, cargo que recibió, siguiendo a sus biógrafos, como recompensa de su hábil defensa de la pragmática. El joven abogado extremeño ha apoyado a conciencia la sucesión de Isabel, enfrentándose a la del infante don Carlos. Sus argumentos, sean válidos o no, son sí, muy oportunos. Con sagacidad ha defendido la situación que permitirá el establecimiento de un nuevo régimen liberal apelando, más que a la razón o a la inteligencia, a la tradición y la costumbre. Con ello pretende despojar al carlismo de sus títulos y banderas populares. Encasilla como usurpadores a quienes pretenden el trono para don Carlos. Encierra al carlismo en una actitud inmovilista, reflejada en el rechazo a la pragmática de Fernando VII, para calificarlo, finalmente, como revolucionario, por oponerse a lo que establecerían las costumbres y confirmaría la tradición. La prágmatica sanción de 1830, no obstante, responde, de acuerdo con las circunstancias históricas, más a una interesada presión de la nueva familia del Rey que al restablecimiento de una interrumpida tradición. Es publicada precisamente cuando la reina María Cristina estaba encinta y no antes. Sectores ilustrados, si no la promovieron, la acogieron como una ventana que se abría hacia una nueva liberalización del régimen, posibilidad hasta entonces cerrada por la personal aversión hacia los liberales, tanto de Fernando VII como de su hermano don Carlos, hasta poco después el indiscutible sucesor [37] . Donoso demostró muy joven su habilidad dialéctica. Como lo prueba esta Memoria sobre la Monarquía , comenzó a utilizarla para legitimar su objetivo político. Este, en sus inicios, no fue otro que el apoyar las circunstancias más proclives a la instauración de un régimen liberal, que quiso matizado por un peculiar tinte monárquico y conservador. Su énfasis, al comienzo, no responde en exclusiva a la luz de la razón que pretende imponer un sistema abstracto, sino más bien, y a diferencia de la generalidad de los liberales de su época, a una considerable valoración de las costumbres, la religión y la tradición. Donoso pretende legitimar la llegada del liberalismo, utilizando, paradojicamente, una argumentación más propia del tradicionalismo. Por otra parte, no es menos cierto que a Fernando VII, destinatario de la Memoria , no se le convencería apelando a ideas liberales. Liberalismo conservador y monarquía Donoso entra a la política en el mismo sentido en que avanza la corriente ideológica de su tiempo, el liberalismo, que en España tiene aun pendiente el fin del sistema absolutista. Su intención, acabar con el Antiguo Régimen y poder controlar la revolución a través de sus ideas, representa el afán de todo liberal conservador ante el nuevo régimen: acepta sus premisas, advierte sus negativos resultados y se siente capacitado para corregirlos. Valora en más el cambio, la necesidad de superar el absolutismo para marchar con la historia. Es aún optimista ante la revolución, porque se siente capacitado de dominar sus excesos en la medida en que sean sus ideas las que se sustenten desde el poder. Restableciendo un principio, ya distinto al revolucionario, que habría agotado su misión al acabar con el absolutismo, logrará evitar la disolución de la sociedad, estableciendo el orden en la nueva sociedad emancipada y libre. Todo ello debe hacerse desde el poder, requiere, en definitiva, de la monarquía. Análogamente a como en el siglo XVIII los primeros ilustrados se sirvieron del trono para llevar a cabo sus reformas, el liberalismo conservador es conciente de que su cambio deberá producirse desde arriba. En estos primeros años Donoso puede calificarse como liberal conservador: las características recién señaladas lo confirman. El golpe de Estado de 1832 supone la posibilidad de acabar con el Antiguo Régimen y acceder al poder. El adversario entonces es el carlismo y, por lo tanto, dentro de las filas liberales no es el momento de hacer diferencias, pese a que efectivamente existieron. En su Memoria sobre la Monarquía (octubre de 1832), aún con los sucesos de La Granja muy latentes, Donoso divide a los españoles en sólo dos partidos, los ya mencionados de la "legitimidad" y de la "usurpación". Esta clasificación está distorsionada ante la necesidad de evitar discrepancias y lograr así la unidad del liberalismo frente a la amenaza carlista. El mismo Donoso, unos años más tarde, al referirse en su Historia de la Regencia de María Cristina (1843) a la configuración política ante el golpe de La Granja, ya sin presiones contingentes o al menos no con las mismas, divide, como ya hemos visto, el espectro político español en tres: liberales, carlistas y monárquicos. Expresa aquí Donoso no sólo el problema del liberalismo español decimonónico, su creciente división interna a medida que se extingue el fenómeno carlista, sino también la estrecha relación del sector que él integra con la institución monárquica [38] a la que, teóricamente, defiende tanto del liberalismo progresista como del carlismo. Volviendo a su interesada clasificación inicial, su Memoria sobre la Monarquía responde a la necesidad de justificar el golpe de 1832 y el restablecimiento de la pragmática sanción que permite la sucesión femenina; quizás, como ha señalado Carlos Valverde, "para evitar que el vacilante y receloso rey diese otra vez un paso atrás y se retractase de lo hecho y para presentar como magnífica, patriótica y leal la actuación de los liberales" [39] . Esta memoria fue presentada a María Cristina, quien se la dió a conocer al rey, y luego publicada por orden real. De este escrito podemos recoger algunas impresiones con respecto al modelo de monarquía que comienza a sugerir Donoso Cortés. Destaca su insistencia en que el Gobierno requiere unidad en la cima del poder; una unidad que conciba un sistema, que sostenga un principio. Precisamente, en su opinión de lo que carece el partido de la legitimidad, entiéndase todo el liberalismo, es de organización, es decir, de unidad y de sistema. Por ello sugiere al monarca que se rodee de "personas fieles y decididas", unidas entre sí "por los mismos principios" [40] . Está pensando en el grupo que encabezó el golpe, en el sector monárquico del liberalismo, que más tarde se llamará moderado. Son ellos quienes ya han demostrado su decisión, en los mismos sucesos de La Granja, y su unidad debe estar en torno a una idea, a un principio que, precisamente, comienzan a formular. La unidad se requiere para conservar y controlar la espiral revolucionaria: "unamos para conservar; las sociedades no existen si se relajan los vínculos sociales" [41] . La unión que está en la mente de Donoso no es la del liberalismo exaltado o progresista, que tiene como norte la Francia revolucionaria, sino la de los monárquicos. En su lógica, los primeros disuelven, son los segundos los que conservan. La monarquía es entonces la institución política más útil, indispensable, para llevar a cabo esta labor de conservación. Ahora bien, esta monarquía no debe apoyarse en "las últimas clases" de la sociedad, ya que ello la conduciría al "despotismo oriental", que es como ha calificado al carlismo, o al"abismo de una democracia borrascosa" [42] , donde reconoce ya el destino del liberalismo revolucionario. Donoso esta afirmando que una monarquía que pretende sostenerse únicamente en el pueblo conduce, de forma inexorable, al absolutismo o a la anarquía. Es lo que años mas tarde redondeará, como veremos en su momento, en el concepto de omnipotencia social . La monarquía, entonces, debe fortalecer las clases intermedias, y buscar en ellas el necesario apoyo que requiere para su funcionamiento [43] . Como vemos, es el propio Donoso quien se encarga de buscar las ideas en torno a las cuales debe cimentarse el nuevo régimen. Aquí ya esta sugerido el gobierno de las clases intermedias que, poco más tarde, al establecer el principio de la soberanía de la inteligencia, llamará de las aristocracias legítimas . Otra de sus ideas, que en este caso reitera en la Memoria sobre la Monarquía, ya que la viene afirmando desde su Exposición a Fernando VII en favor de Carrasco, es la que establece que la fuerza del monarca deriva de su capacidad de representar todos los intereses de la sociedad [44] . Esta consideración fue una constante en la trayectoria de su pensamiento y fundamento de su posterior crítica a la división del poder. En este momento, sin embargo, este principio se muestra contradictorio con la concepción de una monarquía de clase, como es aquélla a la cual le basta el apoyo específico de las llamadas clases intermedias, a no ser que éstas representen por sí solas, en este momento del ideario donosiano, los intereses de toda la sociedad. Si así fuera, estamos frente a la pretensión de utilizar la monarquía, aceptada por entonces en todos los sectores sociales, para la puesta en práctica del sistema de uno sólo de ellos, el de las clases intermedias. Creado el sistema y dada la unidad en la cima del poder, Donoso nos hace pasar a la siguiente fase política, a saber,"crear la legalidad y el entusiasmo" [45] . Con ello, primeramente y sin querer, parece reconocer que el régimen que emana del golpe de La Granja carecía hasta entonces de estos atributos, porque de otro modo no sería necesario el llamar a crearlos. Para llevar a cabo esta nueva etapa, nuestro autor recurre a las Cortes. Esta institución es la que "representando la voz de la nación" establece las leyes fundamentales de la monarquía. Ella reviste a la ley "de un carácter sagrado, les da aquella perpetuidad solemne, les imprime la sabiduría de los siglos" [46] . No obstante, sabe bien Donoso que, en la práctica, y a consecuencia del sufragio censitario, a los intereses de las clases intermedias no les faltarán defensores en las Cortes. El modelo de la monarquía francesa de julio tuvo que estar presente en los sucesos de La Granja y en el proyecto que de ellos emerge. La necesidad de apoyar a la monarquía, como única institución capaz de detener la disolución revolucionaria, en la clase que emerge preponderante y conformar el poder político en torno a las clases intermedias, que consideraron por principio conservadoras, es la vía que escogen para establecer una monarquía que se haga con los beneficios de la revolución, que impida la posibilidad del retorno al absolutismo, como así mismo, que no permita el exceso revolucionario. Donoso pronto percibe que para todo ello finalmente se requiere de un principio político, una nueva concepción de la soberanía. Si los revolucionarios rinden pleitesía a la soberanía popular y la soberanía de derecho divino se entiende superada, necesitan los liberales conservadores establecer una tercera vía de soberanía. Hasta el momento se limita nuestro autor a criticar las dos primeras vías, más adelante recogerá la soberanía de la inteligencia, precisamente, como veremos, de los teóricos franceses de la monarquía de julio. Si han necesitado de la monarquía para reformar la sociedad desde arriba, no pueden afirmar su poder en la soberanía popular. Donoso al menos parece muy consciente de esto; pertenece a la generación post-revolucionaria y, como hemos visto, sus instintos son desde un comienzo conservadores. El conocido manifiesto a nombre de María Cristina, que es en realidad de Cea Bermúdez como primera cabeza del ministerio desde el golpe de La Granja, está fechado el 4 de octubre de 1833, días después de morir Fernando VII. Su texto está en buena parte circunscrito a la contingencia de una posible guerra civil, y demuestra este ánimo conservador que no pretende alterar nada sustancial en materia de soberanía real: "Yo mantendré religiosamente la forma y las leyes fundamentales de la Monarquía, sin admitir innovaciones peligrosas... la mejor forma de gobierno para el país es aquella a que está acostumbrado". No obstante, la actitud contraria de Cea a una reunión de Cortes propicia su salida en febrero de 1834. La intervención de los embajadores en torno a María Cristina, en especial el francés y el británico, manifiestan la tendencia a convertirse en no desestimables centros de presión en torno a la Regente y permanecerán como tales largamente durante los inicios del régimen liberal. El inmovilismo político de Cea fue aparente, ya que, junto a las declaraciones citadas, decreta una amplia amnistía y demuestra un afán de profundas reformas administrativas. La amnistía aparece como medida reconciliadora de la Corona ante los antiguos liberales, tan fustigados por Fernando VII luego del trienio, en pro de limar asperezas y fortificar la tan conveniente unidad del bando cristino. Donoso, respecto a esta medida, se refiere luego de unos años, señalando que "vino a abrir las puertas de España a las revoluciones" [47] , y ello porque, al regreso de los exiliados, el partido liberal (entiéndase progresista) tuvo por suya la victoria, ante un partido monárquico que se vió perdido con la llegada para la otra facción de los "capitanes ausentes" . Aún más, Donoso achaca al decreto de amnistía el afianzamiento del carlismo y con ello la prolongación de la guerra, al confirmar la tesis de éste acerca del carácter revolucionario de sus adversarios. No eran, a juicio de Donoso, los tiempos, "revueltos y banderizos" [48] , los oportunos para una amnistía general. Si bien estas consideraciones las realizó en 1843, es decir, diez años después de haberse tomado tal medida, su ininterrumpida denuncia del liberalismo progresista nos llevaría a pensar que en su momento, no debió verla tampoco con buenos ojos [49] . No obstante, sí podemos incluir a Donoso, al menos en parte, junto a aquéllos que propiciaron reformas en la administración. Para Cea éstas constituyeron el norte de su actuación; bien supo recoger el espíritu práctico de los ex-afrancesados, como el de su ministro Javier de Burgos, artífice de la división provincial de España. No se manifiesta el extremeño - mayormente aún- sobre estas materias, aunque sí asoma su interés por un sistema "sabio de administración" [50] . Su ideario aparece coincidente con los principales objetivos de las reformas. Por un lado, la consolidación del poder central del Estado, que en definitiva debía fortificar la autoridad real, amenazada por los excesos de la revolución. Por otro, las medidas destinadas a favorecer el movimiento de la riqueza, es decir a propiciar el desarrollo de la burguesía, de las clases intermedias que, como hemos visto, ha propuesto como principal sustento social del nuevo régimen, y en especial del trono. Recapitulando, durante estos años busca Donoso Cortés un principio que organice el nuevo régimen, en el cual colaboró desde su origen. Aunque todavía no lo encuentra, esboza ya la que será su teoría de las aristocracias legítimas e insiste en la necesidad de propiciar un sistema monárquico en torno a una idea nueva, es decir, que supere a las conocidas fórmulas de soberanía. La herencia de su formación ilustrada conforma sólo en parte su pensamiento en estos inicios, ya que demuestra una tendencia, luego interrumpida durante su paréntesis doctrinario, a no limitarse en un racionalismo meramente abstracto, sino a valorar lo que él llama la entraña de los pueblos: sus costumbres, su religión, el respeto a las jerarquías sociales. El ambiente romántico y su marcado espíritu conservador se sobreponen, en muchos casos, a su educación liberal ilustrada y tienen, p>or consiguiente, un peso considerable en la formación de su pensamiento. Gonzalo Larios [1] Ver Suárez Verdeguer, Federico: Introducción a Donoso Cortés, Madrid, p.26; Del mismo autor, véase también:"La primera posición política de Donoso Cortés", p. 79. [2] Con respecto al golpe de Estado de 1832, ver Suárez, Federico: Los sucesos de La Granja . [3] Zavala, Iris M.: "La literatura: romanticismo y costumbrismo", en Historia de España de R. Menéndez Pidal, XXXV-II, Madrid, 1989, p. 147 y ss. [4] La venida de Cristina (1829), en Obras Completas de don Juan Donoso Cortés, recopiladas por Juan Juretschke, Madrid, BAC, 1946, I, 9. [5] Ibid, 10. [6] Dos cartas a Manuel Gallardo (1829), OC, I, pp. 171-178. [7] Discurso de Apertura en el Colegio de Cáceres (1829), OC, I, 184. En Respuesta a una crítica a su ensayo sobre la diplomacia (1834), define la Edad Media en el mismo sentido con que el racionalismo dieciochesco concibió este concepto: "un período de transición entre la unidad que desapareció con Roma y la unidad que renació con las luces". OC, I, 285. [8] Ibid, 199. [9] Exposición al Rey Fernando VII en favor de Juan José Carrasco (1831-32), OC, I, 208. [10] Ibid, 209. [11] Idem. [12] Ibid, 210. [13] Ibid, 209 y 210. [14] Ibid, 209. [15] Discurso de Apertura en el Colegio de Cáceres (1829), OC, I, 201. [16] Ibid, 203. [17] NOTA CON ART´ICULO DE ELIAS DE TEJADA SOBRE DE MAISTRE. [18] Alvarez Junco, José:"Estudio preliminar" a Lecciones de Derecho Político de Juan Donoso Cortés, Madrid, 1984, p. XII. La forma teocrática de gobierno, fue expresamente criticada por Donoso. No me parece el concepto teocratismo cristiano, con el que adjetiviza Alvarez Junco algunos pasajes de la obra donosiana, el preciso para señalar la constatación de la influencia del cristianismo en el devenir político y social de la cultura occidental. [19] Discurso de Apertura en el Colegio de Cáceres (1829), OC, I, 193. [20] Dos cartas a Manuel Gallardo (1829), OC, I, 174. [21] Prólogo a su obra Cerco de Zamora (1833), OC, recopiladas por Juretschke, Madrid, 1946, t. I, p. 81 y 82. [22] Exposición al Rey don Fernando VII en favor de Juan José Carrasco (1831-32), OC, I, 211. [23] Exposición al Rey por don Juan José Carrasco (1831-32), OC, recopiladas por Juretschke, Madrid, 1946, t. I, p. 55. >[24] Exposición al Rey don Fernando VII en favor de Juan José Carrasco (1831-32), OC, I, 211. [25] Memoria sobre la Monarquía (1832), OC, I, 216. [26] Discurso de Apertura en el Colegio de Cáceres (1829), OC, I, 195. La misma idea está expresada también en Exposición a Fernando VII en favor de Juan José Carrasco (1831-32), OC, I, 207 y 208. [27] Memoria sobre la Monarquía (1832), OC, I, 221. [28] Ibid. 219. [29] Históricamente, tiene mayor asidero aquella interpretación de la revocación de Felipe V en orden a despojar a las mujeres de sus derechos a la sucesión, que la relaciona con la conveniencia de evitar la posible unidad de dinastía entre reinos tradicionalmente diferentes, que habría hecho peligrar el inestable equilibrio europeo. Donoso, como fue costumbre en el siglo XIX, utilizó repetidamente la historia como herramienta de sus personales objetivos políticos. De hecho, este argumento que levanta contra la disposición de 1713 podría utilizarse indistintamente también en contra de las constituciones de su tiempo. [30] Ibid. 220. [31] Idem. [32] Idem. [33] Ibid. 221. [34] Idem. [35] Idem. [36] Ver Querella sobre la Memoria (1832), incluye Carta a Fernando VII e Instancia al Ministro de Gracia y Justicia, OC, I, 224 y 225. [37] Ver Suárez, Federico: La crisis política del Antiguo Régimen en España, Madrid, 1958, 171 y ss. [38] He utilizado un escrito de 1843 porque éste trata precisamente, y con mayor exactitud, asuntos relativos al golpe de 1832. [39] Valverde, Carlos: Introducción General a Obras Completas de Donoso Cortés , Madrid, BAC, 1970, t. I, p. 39. [40] Memoria sobre la Monarquía (1832), OC, I, 219. [41] Ibid, 217. [42] Ibid, 218. [43] Idem. [44] Ibid, 216. [45] Ibid, 217. [46] Ibid, 218. [47] Historia de la regencia de María Cristina (1843), OC, I, 993. [48] Ibid, 994. [49] No tenemos testimonios de su hipotético rechazo. [50] Memoria sobre la Monarquía (1832), OC, I, 219. |
00:05 Publié dans Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique, espagne, contre-révolution |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook