samedi, 05 octobre 2013
Qual è il vero significato delle «Favola delle api» di Bernard Mandeville?
di Francesco Lamendola
Fonte: Arianna Editrice [scheda fonte]
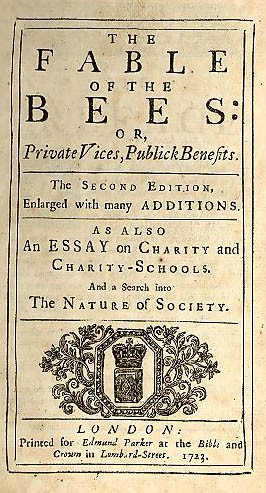 Il successo, la ricchezza, la potenza degli individui e delle nazioni, si possono ottenere con la pratica intransigente della virtù; oppure l’egoismo, l’inganno e la violenza sono gli ingredienti necessari per raggiungerle e conservarle?
Il successo, la ricchezza, la potenza degli individui e delle nazioni, si possono ottenere con la pratica intransigente della virtù; oppure l’egoismo, l’inganno e la violenza sono gli ingredienti necessari per raggiungerle e conservarle?
Bella domanda; domanda impertinente. E impertinente, infatti - anzi, sommamente impertinente, per non dire irritante - è «La favola delle api» di Bernard Mandeville (1670-1733), un medico di origine olandese trasferitosi in Inghilterra, che trasse la sua opera filosofica più famosa da quella che era, in origine, una poesia: «The Grumbling Hive: or, Knaves Turn’d Honest», che, dopo un processo di gestazione e rielaborazione durato quasi cinque lustri, vide infine la luce a Londra, nel 1729, con il titolo definitivo di «The Fable of the Bees: or, Private Vices, Public Benefits».
Per farsi un’idea della spregiudicatezza del tono adottato dall’Autore, basterà riportare qui la conclusione (da: B. Mandeville, «La favola delle api», traduzione dall’inglese di Maria Goretti, Firenze, Casa Editrice Felice Le Monnier, 1969, XXXI, vv. 409-433, pp. 54-55):
«Lasciate, quindi, le lamentele! Soltanto gli sciocchi si sforzano di fare del grande alveare del mondo un alveare onesto. Godere delle gioie della terra, essere rinomati nella guerra, e ancora vivere in pace, sena grandi vizi è soltanto utopia vana, esistente solo nell’immaginazione. È necessario che la frode, il lusso e la vanità sussistano, se noi vogliamo averne in benefici: allo stesso modo la fame è certo un terribile tormento, ma come digerire e prosperare senza di essa? Non dobbiamo il vino alla vigna, magra, brutta, contorta? La stessa, se i polloni sono lasciati stare, soffoca altre piante e diviene solo legna da bruciare; ma se i rami sono pareggiati e tagliati, subito diviene fecondo e ci dà la benedizione del suo nobile frutto: allo stesso modo il vizio risulta beneficio, purché sia rattenuto e nettato del superfluo dalla Giustizia; anzi, qualora un popolo voglia essere grande, il vizio è necessario in uno Stato come la fame è necessaria per obbligarci a mangiare. La sua pura virtù non può rendere mai una nazione celebre e gloriosa; coloro che vorrebbero far rivivere l’età dell’oro debbono accettare con la virtù il cibo dei porci.»
Ce n’è abbastanza per mettere tremendamente a disagio il lettore, tanto più se questi appartiene alla specie degli ipocriti, abituati a predicare bene e razzolare male, ma niente affatto disposti a vedersi smascherati così brutalmente dal primo venuto; e Dio sa se, nella Londra e nell’Inghilterra dei primi decenni del Settecento, in piena espansione commerciale e finanziaria, e già in procinto di varare, con mezzo secolo di anticipo sul resto del continente, la propria rivoluzione industriale, una tale specie umana non era ampiamente diffusa e generosamente rappresentata sia nella società civile, che nelle istituzioni e nel Parlamento.
Mai come in questo caso, infatti, per comprendere il senso di uno scritto filosofico – che pure ci sottopone una questione di portata universale – è necessario contestualizzarlo: perché si rischierebbe di non comprendere i veri termini della questione, o, peggio, di fraintenderli completamente, se non si tenesse presente a quale genere di pubblico aveva l’ardire di rivolgersi il suo autore; vale a dire, quale razza di farisei ipocriti aveva deciso di prendere di mira e di sferzare senza troppi complimenti.
Un Paese in piena espansione, dunque; un Paese che si stava giocando, e che stava vincendo, niente meno che la grande partita per il controllo dei traffici internazionali, forte della marina più agguerrita e numerosa del mondo; un Paese governato con un singolare miscuglio d’intraprendenza, audacia, fortuna e assoluta mancanza di scrupoli, unite a una buona dose d’improntitudine; le cui banche stavano allungando i loro tentacoli sul mondo, le cui navi stavano saccheggiando le materie prime dei cinque continenti, le cui merci ad alto costo stavano invadendo i mercati del globo terracqueo, e le cui dottrine politiche liberali e costituzionali si stavano diffondendo con pari successo, magari al rombo dei cannoni, e preparavano il terreno per potersi poi imporre, con la calma, ma con piglio sicuro, uno dopo l’altro in tutti i Paesi del mondo, presentando sé stesso come modello inarrivabile di benessere, di progresso, di civiltà.
Ma ci piace dare la parola al filosofo Emanuele Riverso, abbastanza recentemente scomparso, per la chiarezza e la lucidità del quadro che sa tratteggiare sia della società inglese, sia del modo in cui fu accolto il capolavoro di Mandeville (da: E. Riverso, «Forme culturali e paradigmi umani. Le tappe del pensiero filosofico e pedagogico nella cultura occidentale», Roma, Edizioni Borla, 1988, vol. 2, pp. 304-305):
«L’opera suscitò un putiferio, perché fu accusata di essere una esaltazione o descrizione cinica del vizio. In realtà essa lacerava quel velo di autocompiacimento»e di auto-approvazione morale che gli scrittori dotti, i pubblicisti politici e gli autori di orientamento religioso distendevano sulla società del tempo, creando la buona coscienza in quanti spregiudicatamente si dedicavano alle speculazioni ed agli affari, sconvolgendo le antiche strutture rurali, urbane, produttive, commerciali e morali e creando masse di diseredati, di frustrati, di angosciati, che si addensavano intorno ai centri urbani e presso i nuovi centri minerari e industriali.
Mandeville volle soltanto spiegare che l’enorme prosperità globale dell’Inghilterra del tempo non poteva essere considerata come un premio o la conseguenza di una benedizione divina (secondo la tesi puritana e calvinista in genere che faceva della prosperità materiale un segno di benedizione e di predestinazione), ma nasceva dal cumulo e dall’interazione di attività e intenzioni individuali che, singolarmente prese, e dal punto di vista cristiano,non potevano essere considerate altro che vizi: i vizi privati (avidità, egoismo, spregiudicatezza, avarizia, lussuria) nel contesto libertario dell’Inghilterra dell’epoca, davano luogo a un dinamismo globale, che nel suo insieme produceva ricchezza e prosperità. Era una tesi realistica, l’esame realistico di una società che, al di sotto delle dichiarazioni ufficiali conformi ai valori cristiani, si andava adattando a valori nuovi di profitto, di ricchezza, di dominio e di prestigio economico. Non era meglio esaminare il fatto sociale per quello che realmente era anziché utilizzare finzioni ed ipotesi normative? Non era meglio tener conto delle reali intenzioni delle persone, quando si doveva procedere a iniziative pubbliche, e mettere da parte le ipocrisie, per ordinare in modo più efficace le azioni di governo?
Scrittori, ecclesiastici, moralisti e letterati reagirono violentemente allo scritto di Mandeville, accusandolo di essere un difensore del vizio. Uno di loro, John Dennis, disse di lui che “il vizio e la lussuria hanno trovato un campione e difensore che mai prima avevano trovato; un altro, William Law, disse che l’intento di Mandeville era quello di “liberare l’uomo dalla SAGACIA dei moralisti dal dominio della virtù e ricollocarlo nei diritti e privilegi della brutalità; di richiamarlo dalle vertiginose altezze della dignità razionale e della rassomiglianza con gli Angeli, per farlo andare nell’erba o a rotolarsi nel fango” (in “Remarks upon a Late Book, entituled, The Fable of the Bees, London 1726, p. 6).
Come si presenta oggi, l’opera di Mandeville, che è una delle più significative della storia del pensiero del settecento, comprende una prefazione, una composizione poetica in trenta strofe intitolata “L’alveare brontolone” o “Gli schiavi divenuti onesti”, in cui descrive la vita inglese del settecento con le assurdità, le angosce, gli sconvolgimenti, gli egoismi, la spietatezza tipici del tempo in cui andavano maturando le condizioni per la prima rivoluzione industriale. Segue una breve Introduzione ed una “Ricerca sulla natura della società”. La sua conclusione era che “né le qualità amichevoli e gli affetti gentili che sono naturali agli uomini, né le virtù reali che egli è capace di acquisire mediante la ragione e l’abnegazione, sono il fondamento della società; ma ciò che chiamiamo Male in questo mondo, tanto morale che naturale, è il grande principio che ci rende creature sociali, la solida base, la vita ed il sostegno di tutti i commerci e le attività senza eccezione: è lì che dobbiamo cercar la vera origine di tutte le arti e le scienze e nel momento in ci il Male cessa, la società so deve impoverite, se non dissolversi” (Mandeville, “The Fable of the Bees”, Pelican 1970, p. 370).»
Ammirevole franchezza, dunque; alla quale non ci sentiamo di aggiungere se non che il trionfo del male nelle attività economiche non è una condizione fatale e necessaria, ma il risultato di un certo modello di economia (e di politica): perché una cosa è, ad esempio, una organizzazione economica, giuridica e sociale che, come quella medievale e pre-moderna, proibisce o scoraggia l’usura e che fonda, con il Banco dei Paschi di Siena, la prima banca non speculativa del mondo; e un’altra cosa, e ben diversa, è una organizzazione economica, giuridica e sociale, come quella del nascente capitalismo inglese, che innalza la più spietata concorrenza al rango di legge ineluttabile e universale, che indica il profitto quale unico criterio di misura della bontà di una determinata iniziativa, che fonda la prima grande banca speculativa del mondo.
Insomma: non è un fatto di natura che lo sviluppo dell’economia si fondi sull’egoismo, sulla brutalità, sul cinismo: non qualunque tipo di economia porta a tali esiti, o non nella stessa misura; si tratta, invece, di una caratteristica specifica di un determinati modello di economia, quello basato sullo strapotere finanziario, sulla massimizzazione dei profitti ad ogni costo, sulla riduzione e la degradazione dell’uomo e del lavoro in una merce come qualunque altra. E non è certo un caso se, mezzo secolo dopo che era apparso lo “scandaloso” apologo di Mandeville, l’economista Adam Smith avrebbe teorizzato che dalla somma degli egoismi individuali discende, misteriosamente, anche la prosperità collettiva; e avrebbe tirato in ballo, con pochissimo rigore logico, una non meglio specificata “mano invisibile” per illustrare tale concetto. Perché nella cultura inglese, e specialmente in quella di matrice calvinista, è sempre stata vivissimo il bisogno di drappeggiare il nudo e crudo perseguimento dell’interesse individuale, squisitamente egoistico, di belle formule miranti a dimostrare che non c’è alcuna contraddizione con l’esigenza del bene comune. Non aveva John Locke posto la proprietà privata fra i diritti NATURALI dell’uomo? Ogni azione egoistica dell’individuo, purché questi sia formalmente timorato di Dio (il Dio dei puritani), trova sempre la sua giustificazione e perfino la sua glorificazione, in nome del progresso e del benessere collettivi. Così, ad esempio, gli “Highlanders” scozzesi, e con loro gli ultimi giacobiti, venivano massacrati fino all’ultimo sangue, perché anche le aree più “arretrate” delle Isole Britanniche si aprissero agli incomparabili vantaggi della modernità, del commercio e dell’industria; così i Pellerossa del Nord America venivano irretiti in trattati menzogneri, ingannati e, infine, braccati come bestie feroci, a maggior gloria dei Padri pellegrini e del manifesto destino civilizzatore dei coloni britannici.
La cultura nordamericana ha ereditato in pieno questa tendenza all’autocompiacimento ipocrita e non ha saputo nemmeno sbarazzarsi dell’ormai logoro paravento religioso: basta ascoltare il discorso di insediamento di un qualsiasi presidente degli Stati Uniti; basta udire le invocazioni a Dio affinché benedica l’America, nel momento in cui essa si appresta a perpetrare delle ingiustificabili guerre di aggressione, con la scusa di voler diffondere la democrazia e la libertà di commercio (cioè la libertà d’imporre un commercio ineguale, a tutto svantaggio degli altri), per udire la stesa nota falsa e stridente, per avvertire immediatamente la stessa sfacciata ipocrisia che si nascondeva dietro i bei discorsi di un William Pitt il Vecchio durante la guerra dei Sette Anni.
Non la sfrontatezza di Mandeville nel celebrare il vizio, dunque, ma la sua aspra sincerità nel mostrare «di lacrime grondi e di che sangue» la formula del successo economico e politico, è la cifra giusta per comprendere la «Favola delle api»; anche se permane – perché negarlo? – una vaga sensazione di ambiguità circa le sue reali intenzioni. Così come ci si è chiesti, infatti, sino a che punto George Berkeley aborrisca da quel libero pensiero che aggredisce con argomenti così pericolosamente simili a quelli dei suoi avversari, ci si può chiedere - e la domanda non è indiscreta - fino a che punto Mandeville abbia voluto davvero indossare i panni severi del moralista. Tuttavia, perché fare il processo alle intenzioni? È più importante che almeno una voce, nell’Inghilterra del XVIII secolo, abbia avuto la franchezza di scoprire gli altarini d’una classe dirigente cinica e falsa...
Tante altre notizie su www.ariannaeditrice.it
00:05 Publié dans Economie, Philosophie, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : fable des abeilles, mandeville, philosophie, économie, théorie politique, politologie, sciences politiques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 24 septembre 2013
Dette abyssale : pourquoi ?

Dette abyssale : pourquoi ? Que risque-t-il de se passer ?
par Guillaume Faye
Ex: http://www.gfaye.com
La dette souveraine française va bientôt atteindre les 2000 milliards d’euros, c’est-à-dire 95,1% du PIB fin 2014, soit 30.000 € par Français. Bombe à retardement. Il y a dix ans, elle atteignait 1.000 milliards et l’on criait déjà à la catastrophe. Mais personne n’a rien fait. Depuis 1974 ( !) aucun budget n’a été en équilibre : tous déficitaires. Les multiples rapports, comme ceux de la Cour des Comptes, ont tous été jetés au panier. Chaque année, il faut rembourser 50 milliards d’euros d’intérêts, deuxième budget de l’État.
Mais pourquoi s’endette-t-on ? Certainement pas pour investir (et donc pouvoir rembourser par les gains escomptés) (1), mais pour les raisons suivantes : A) Payer une fonction publique pléthorique et surnuméraire, qui ne cesse d’enfler. B) Régler les prestations sociales d’un État Providence qui suit (droite et gauche confondues) les préceptes absurdes du collectivisme (2). Parmi ces prestations, on note les allocations chômage les plus généreuses au monde qui, paradoxalement, provoquent l’accroissement du chômage et dissuadent les embauches ; le coût croissant des allocations aux immigrés d’origine et aux étrangers les plus divers, y compris clandestins et fraudeurs (type AME), pris en charge comme nulle part ailleurs au monde ; l’absurdité totale des emplois aidés – pour les mêmes populations – qui ne créent aucune valeur ajoutée. C) L’endettement sert aussi à payer les intérêts de la dette ! Absurdité économique totale, qui ne choque pas la cervelle de nos énarques. On creuse un trou pour en boucher (sans succès d’ailleurs) un autre.(3)
L’Allemagne, elle, a rééquilibré son budget et voit décroître sa dette. Elle mène une politique d’austérité d’expansion, incompréhensible pour les dirigeants français, incapables d’envisager le moindre effort et abonnés au déni de réalité. Et, contrairement à une certaine propagande, pas du tout au prix d’une paupérisation de la société par rapport à la France. Je parlerai du cas de l’Allemagne dans un prochain article. Maintenant, quels risques majeurs font courir à la France cet endettement colossal et croissant (4) ?
A) L’agence France Trésor qui emprunte actuellement à taux bas va automatiquement se voir imposer très bientôt des taux à plus de 5%. Donc on ne pourra plus emprunter autant. B) Il semble évident que, si l’on peut encore rembourser les intérêts, on ne pourra jamais rembourser le ”principal”, même en 100 ans. Point très grave. Un peu comme les emprunts russes d’avant 1914. C) Cette situation aboutira à la ”faillite souveraine”, avec pour conséquence l’effondrement mécanique, brutal et massif, de toutes les prestations sociales de l’État Providence, des salaires des fonctionnaires, des pensions de retraite, etc. D) La France sera donc soumise au bon vouloir de ses créanciers et contrainte de solliciter l’aide d’urgence du FMI, de la BCE et, partant de l’Allemagne, voire de la Fed américaine… Indépendance nationale au niveau zéro, mise sous tutelle. (5) E) Une position débitrice insolvable de la France, seconde économie européenne, provoquera un choc économique international d’ampleur lourde – rien à voir avec la Grèce. F) Paupérisation et déclassement dans tous les domaines : plus question d’entretenir les lignes SNCF ou d’investir dans la recherche et les budgets militaires, etc. G) Enfin, surtout avec des masses d’allogènes entretenues et qu’on ne pourra plus entretenir, cette situation pourra déboucher sur une explosion intérieure qu’on n’a encore jamais imaginée – sauf votre serviteur et quelques autres.
Et encore, on n’a pas mentionné ici la dette de la Sécurité sociale et celles des collectivités locales, en proie à une gestion dispendieuse, irresponsable, incompétente. L’impôt ne pourra plus rien compenser car il a largement atteint son seuil marginal d’inversion de rendement. Mais enfin, le mariage des homos, la punition contre le régime syrien, la suppression des peines de prison pour les criminels, ne sont-ils pas des sujets nettement plus urgents et intéressants ? Un ami russe, membre de l’Académie des Sciences de son pays, me disait récemment, à Moscou : « je ne comprends plus votre chère nation. Vous n’êtes pas dirigés par des despotes, mais par des fous ».
(1) Depuis Colbert jusqu’aux enseignements basiques de toutes les écoles de commerce, on sait qu’un endettement ne peut être que d’investissement et surtout pas de fonctionnement ou de consommation. Qu’il s’agisse d’entreprises, de ménages, de communes, de régions ou d’États. Autrement, on ne pourra jamais le rembourser et ce sera la faillite. Une célèbre Fable de La Fontaine l’avait expliqué aux enfants : La cigale et la fourmi. La fourmi refuse de lui prêter pour consommer pendant l’hiver car elle sait qu’elle ne sera jamais remboursée puisque la cigale chante gratuitement et ne travaille pas. En revanche, si la cigale lui avait demandé un prêt pour organiser une tournée de chant payante, la fourmi aurait accepté. Logique économique basique, hors idéologie.
(2) Le collectivisme peut fonctionner plusieurs décennies dans une économie entièrement socialisée, sans secteur privé, comme on l’a vu en URSS et dans le défunt ”bloc socialiste”. Au prix, évidemment, d’un système de troc autarcique. Pourquoi pas ? Mais l’expérience (plus forte que les idées pures des idéologues) a démontré que ce système est hyperfragile sur la durée car il nécessite un système politique pyramidal et de forte contrainte, et provoque une austérité générale que les populations ne supportent pas objectivement, en dépit de tous les discours et utopies des intellectuels. Mais l’aberration française, c’est d’entretenir un système intérieur collectiviste dans un environnement européen et international mercantile et ouvert. Du socialisme à l’échelle d’un petit pays dans un énorme écosystème libéral. Cette contradiction est fatale : c’est un oxymore économique. Ça ne pourra pas durer. L’énorme Chine elle, peut surmonter ce paradoxe : un régime pseudo-communiste, anti-collectiviste, mais animé par un capitalisme d’État. Mais c’est la Chine…Inclassable.
(3) Aberration supplémentaire: la France s’endette pour prêter aux pays du sud de l’UE endettés afin qu’ils puissent payer les intérêts de leur dette ! On creuse des trous les uns derrière les autres pour pouvoir reboucher le précédent. Le « Plan de soutien financier à la zone euro » à augmenté la dette française de 48 milliards d’euros et culminera en cumulé à 68,7 milliards en 2014. Emprunter pour rembourser ses dettes ou celles de ses amis, ou, pire les intérêts desdites dettes, cela à un nom : la cavalerie.
(4) Contrairement à qu’on entend un peu partout, la dette ne peut que croître en volume principal, même si le déficit passe en dessous du chiffre pseudo-vertueux des 3% négocié avec Bruxelles. La créance brute ne décroît que si le budget du débiteur est définitivement à l’équilibre, voire excédentaire, pendant plusieurs années – et encore cet excédent doit-il est majoré en fonction des taux d’intérêt. Arithmétique de base, qu’on n’enseigne probablement pas à l’ENA.
(5) La solution du Front national – sortir de l’Euro, reprendre le Franc, retrouver une politique monétaire indépendante, pouvoir dévaluer (bon pour l’exportation), pouvoir faire fonctionner la planche à billets librement comme la Fed, s’endetter par des émissions auprès de la Banque de France et non plus des marchés – est irréaliste. Pour deux raisons techniques : d’abord parce que l’économie française n’a pas la taille mondiale de l’économie américaine qui est en situation de ”monétarisation autonome” (self money decision) ; ensuite, et pour cette raison, parce qu’une telle politique, même si elle ferait baisser la charge de la dette, aurait pour conséquence mécanique un effondrement de l’épargne et des avoirs fiduciaires des Français, en termes non pas nominaux mais marchands. ”Vous aviez 100.000 € en banque, le mois dernier, avant le retour au Franc ? En compte courant, assurance vie, épargne populaire, etc ? Désolé, en Francs, il ne vous reste plus que l’équivalent de 50.000.” Politiquement dévastateur. La seule solution (voir mon essai Mon Programme, Éd. du Lore) est de bouleverser le fonctionnement de la BCE, dont l’indépendance est une hérésie, et d’envisager une dévaluation de l’Euro.
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie, Nouvelle Droite, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume faye, nouvelle droite, économie, dette, france, europe, affaires européennes, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 23 septembre 2013
Réflexion sur l’État dans l’économie
Qu’est-ce que le vrai colbertisme?
Réflexion sur l’État dans l’économie
Par Guillaume Faye
Ex: http://www.gfaye.com
 Par manque de formation historique et économique, on présente le « colbertisme » comme de l’interventionnisme étatique à la façon de l’État Providence ou des velléités de notre bruyant ministre du ”Redressement productif ”, M. Montebourg. Première erreur. On s’imagine aussi que le colbertisme est un dirigisme anti-libéral, le choix d’une économie bureaucratique et administrée, sous prétexte de ”volontarisme” anti-marché. Seconde erreur. Le colbertisme n’a rien à voir avec ces clichés, bien au contraire. Dans l’histoire de France récente, les véritables politiques colbertistes ont été menées par De Gaulle et Pompidou, mais certainement pas par les socialistes. Explications.
Par manque de formation historique et économique, on présente le « colbertisme » comme de l’interventionnisme étatique à la façon de l’État Providence ou des velléités de notre bruyant ministre du ”Redressement productif ”, M. Montebourg. Première erreur. On s’imagine aussi que le colbertisme est un dirigisme anti-libéral, le choix d’une économie bureaucratique et administrée, sous prétexte de ”volontarisme” anti-marché. Seconde erreur. Le colbertisme n’a rien à voir avec ces clichés, bien au contraire. Dans l’histoire de France récente, les véritables politiques colbertistes ont été menées par De Gaulle et Pompidou, mais certainement pas par les socialistes. Explications.
Colbert, homme pragmatique, principal ministre de Louis XIV, était révulsé par l’économie corporatiste, héritée de la période médiévale, avec ses corsets réglementaires, coutumiers, paralysants, fiscalistes. Un type d’économie archaïque que défendent, en fait, aujourd’hui les socialistes au pouvoir et les féodalités syndicales. Colbert était un adepte du mercantilisme anglais : il ne faut pas entraver le commerce, même avec les meilleures mais stupides intentions, mais le favoriser, afin d’augmenter la richesse et la prospérité. Mais Colbert ajouta une french touch, comme on dit : l’État ne doit pas seulement veiller à laisser en paix les acteurs économiques, à ne pas les assommer de règlements, les imposer, les contraindre, mais aussi à les aider et à leur construire un environnement favorable et à mener de grands projets d’investissement ciblés, et énormes pour l’époque : la manufacture de Saint-Gobain, celle des Gobelins, celle de Sèvres, le canal du Midi, les grandes routes royales (1), le pavage de Paris, les grands chantiers et commandes artistiques somptueuses, vitrines de la France, etc.
Colbert développa ainsi l’idée d’investissements d’État productifs : les manufactures, les infrastructures et les comptoirs coloniaux. Ces ”grands projets” constituaient à la fois un appel d’offre pour les entrepreneurs privés mais s’inscrivaient dans la doctrine mercantiliste anglo-hollandaise : créer un environnement propice à l’expansion commerciale et à l’exportation – plus d’ailleurs qu’à l’industrie. Loin de lui l’idée de faire de l’État royal un acteur interventionniste, mais plutôt un ”facilitateur”. Pour Colbert, l’État devait être économe, avec des comptes équilibrés, d’où son conflit avec le dispendieux Louvois. L’État colbertiste est libéral et initiateur à la fois. Il limite les impôts. Il favorise le commerce maritime avec les comptoirs.
Le bricolage économique et industriel des socialistes n’a donc rien à voir avec le colbertisme dont l’approximatif M. Montebourg se réclame. Le gouvernement socialiste veut au contraire (mythe marxiste de la ”nationalisation”) que l’État bureaucratique se substitue aux entreprises, les dirige avec prétention et incompétence, tout en les assommant de charges par ailleurs. D’où par exemple le prétentieux et inutile programme étatique en 34 plans techno-industriels (septembre 2013) qualifié avec cuistrerie de « troisième révolution industrielle », par lequel l’État va « faire naître les inventions de demain, les usines de demain, les produits de demain ». Les dirigeants de Google ou de X Space doivent bien rigoler. Ce projet coûtera 3,7 milliards d’euros. Ce sera un coup d’épée dans l’eau. Car les élus et les fonctionnaires sont les plus mal placés pour définir les axes de recherche-développement du secteur industriel marchand. Ce dernier sait faire son job tout seul. À ce propos, Yves de Kerdrel écrit (2) : « à quoi bon mettre l’accent sur la production de textiles intelligents lorsque dans le même temps des industriels de ce secteur se voient refuser l’autorisation d’ouvrir un site de production dans telle friche industrielle sous prétexte qu’on y aurait aperçu une espèce protégée d’escargots. » (3)
De même, la création de la récente banque publique d’investissements est une usine à gaz bureaucratique et coûteuse. L’État ferait mieux non pas de se mêler de créer des emplois, mais de faciliter leur création, non pas de subventionner ça et là des entreprises de pointe mais de cesser de pressurer de taxes, de paralyser par des règlementations l’ensemble des entreprises, d’assouplir le marché du travail, etc. L’État français socialisé est un fossoyeur qui se fait passer pour un infirmier, un destructeur d’industries qui se pose en sauveur de l’industrie. (4)
Tout autre est le véritable colbertisme, ou plutôt le néo-colbertisme de l’ère gaullo-pompidolienne. En ce temps-là (1958-1974), le budget était en équilibre. Ce qui n’empêchait l’État d’aider au financement (lui seul pouvait le faire) de grands projets structurants pour l’avenir, avec une vraie vision, pour la France et pour l’Europe. Nous sommes toujours les héritiers de ces projets, qui n’ont plus de successeurs à la hauteur.
Mentionnons pour mémoire : le programme nucléaire des 58 réacteurs (indépendance énergétique et électricité propre), le Concorde (échec commercial franco-britannique mais énormes retombées technologiques), le programme spatial (Arianespace, leader mondial), le TGV, le réseau autoroutier, Airbus, l’avionique militaire française et tant d’autres initiatives. Bien sûr il y eut des échecs cruels. (5) Le néo-colbertisme se caractérise donc par une action de l’État dans deux domaines essentiels : fournir aux entrepreneurs, forces vives d’une nation, les infrastructures nécessaires à grande échelle ; passer des commandes d’État ou proposer des partenariats dans des domaines stratégiques. Pas ”bricoler” avec des boîtes à outils socialistes, avec de la ”com” (propagande mensongère) à la rescousse.
Maintenant, pour conclure, n’oublions pas que l’État américain fédéral pratique le néo-colbertisme dans certains domaines, avec la NASA ou le pilotage du complexe militaro-industriel. L’Union européenne, elle, adepte d’un fédéralisme mou, bureaucratique, ”libéral” au mauvais sens du terme, n’a aucun projet techno-industriel de grande ampleur, et mobilisateur. Le colbertisme suppose une volonté nationale et l’Union européenne ne se pense toujours pas véritablement comme nation. Très probablement – c’est l’enseignement de l’Histoire – elle ne le fera que si l’alchimie explosive se fait entre une menace et un leader. La menace existe, et le leader européen pas encore.
Notes:
(1) Au début du XVIIe siècle, il fallait trois fois plus de temps pour aller de Paris à Marseille ou à Bordeaux que du temps de l’Empereur Trajan, à la fin du Ier siècle, lorsque les voies romaines étaient entretenues. Après les investissements routiers de Colbert, cette différence n’existe plus. Dans le Paris de Henri IV, le confort urbain était inférieur à celui de Rome ou de Pompéi : pas de rues pavées, pas d’égouts, très peu d’apports hydrauliques non phréatiques.
(2) Le Figaro, 18/09/2013, in « Colbert, reviens ! Ils sont devenus fous », p. 15, article stimulant qui m’a donné l’idée d’écrire celui-ci.
(3) Toujours le principe de précaution, frilosité écolo, que Claude Allègre a dénoncé. Voir l’interdiction, en France, même des recherches sur l’exploitation propre des gaz et huiles de schiste. Les escargots valent mieux que les emplois. Le lobby écologiste (même fanatisme que les islamistes) est dans l’utopie contre le réel. Hélas, il est écouté.
(4) La cause principale de la désindustrialisation de la France est la perte de compétitivité des entreprises industrielles, du fait du fiscalisme pseudo-social étatique, et non pas la recherche de la maximisation des profits par les ”patrons”, contrairement au discours paléo-marxiste.
(5). Par exemple, le “Plan Calcul“ gaulliste des années soixante, maladroit et trop étatiste, qui n’a pas empêché l’informatique mondiale d’être dominée par les Américains. Ou encore notre bon vieux Minitel, lui aussi trop piloté par l’État (sub regnum Mitterrandis), trop cher, balayé par l’Internet US, en dépit de ses innovations et de ses avantages.
00:05 Publié dans Economie, Nouvelle Droite, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : colbert, colbertisme, économie, politologie, théorie politique, sciences politiques, guillaume faye, nouvelle droite |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 17 septembre 2013
EU maakt weg vrij voor geheime bankreddingen met belastinggeld

'De Duitsers kunnen een groot deel van hun auto-export net zo goed op een boot laden en deze bij Hamburg tot zinken brengen. Dat zou net zoveel opleveren als het verkopen van Audi's in ruil voor schuldbekentenissen (IOU's) van de bankroete (euro)landen.'
De kogel is door de kerk. Waar we al lange tijd voor waarschuwen is nu door het Europese parlement mogelijk gemaakt: banken kunnen, in tegenstelling tot alle eerdere beloftes, voortaan met de miljarden van het Europese Stabilisatie Mechanisme (ESM) worden gered. Bovendien blijven deze 'reddingen' geheim voor het publiek. Brussel heeft hiermee een succesvolle, door de media onopgemerkte greep naar het belastinggeld van de Nederlanders en alle andere Europeanen gedaan.
ESM gaat tóch voor banken worden gebruikt
'Onze' politici zwijgen er het liefste over als het graf, maar u herinnert zich vast nog wel dat het volk werd verzekerd dat het ESM beslist niet voor het redden van de banken zou worden gebruikt. Rutte, Dijsselbloem en hun Brusselse bazen beloofden dat de lasten in de toekomst op de aandeelhouders, investeerders en banken zelf zouden worden afgewenteld.
Loze beloften en holle woorden, zo vreesden critici. Ze blijken gelijk te hebben gehad. Met 556 ja-stemmen, 54 nee-stemmen en 28 onthoudingen is het Europese (schijn-)parlement akkoord gegaan met een compromis over het Europese bankentoezicht. De Europarlementariërs krijgen op papier enkel het recht om uit minstens twee kandidaten het hoofd van de toezichthoudende instelling te kiezen, die twee keer per jaar verantwoording aan het EP moet afleggen. Verder krijgt de chef van de financiële commissie van het EP het recht op een 'niet openbare dialoog' met de hoofd-toezichthouder.
Overleg en besluiten blijven geheim
Het publiek mag hier echter niet van op de hoogte worden gebracht. Zowel de parlementariërs als de chef van de financiële commissie krijgen geheimhoudingsplicht opgelegd. Als de ECB-raad niet instemt met een besluit van de bankentoezichthouder, dan krijgen enkel ECB-president Draghi en EP-voorzitter Schulz dit te horen. De ECB-raad hoeft echter niet alle besproken zaken aan het parlement mee te delen.
Ook de protocollen van de zittingen van de commissie van het bankentoezicht worden geheim gehouden. Het EP krijgt slechts een 'gedetailleerde samenvatting' van wat er besproken is. Onofficiële informatie over de betroffen banken, die de ECB en de toezichthouder niet naar buiten willen brengen, krijgt ook het parlement niet te weten.
De reden van de geheimhouding is duidelijk: als bekend wordt welke banken in de problemen verkeren, dan dreigt net als op Cyprus paniek en vervolgens een bankrun te ontstaan.
'Meest verstrekkende stap EU ooit'
Europarlementariër Sven Giegold (Duitse Groenen), die zich tenminste voor minimale controle had ingezet, spreekt van de 'meest verstrekkende stap die de EU sinds de invoering' heeft genomen. Het Europese bankentoezicht wordt echter dermate vaag en ondoorzichtig opgezet, en het parlement krijgt hierbij een zo'n nietszeggende rol, dat van enige democratische legitimering geen enkele sprake is.
Het bankentoezicht betekent niets anders dat Europese banken voortaan uit het met belastinggeld gefinancierde ESM-fonds kunnen worden gered. Nogmaals: het ESM werd uitsluitend opgezet om in problemen geraakt lidstaten te ondersteunen. Het (her)kapitaliseren van de banken werd hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
Bankroete landen staan al in de rij
Vorig jaar juni besloten de minister van Financiën om het ESM ook voor de banken in te zetten, zogenaamd omdat men niet langer belastinggeld voor deze doeleinden wilde gebruiken. Spanje en Italië drongen het meeste aan op het inzetten van het ESM. Duitsland ging 'onder voorwaarden' akkoord.
Die voorwaarden zijn nu vervuld. Het bankentoezicht wordt vanaf de herfst van 2014 actief. Aangezien het Europese parlement al heeft ingestemd, is het onduidelijk of er nu al ESM-gelden naar de banken zullen vloeien, of dat men toch tot de officiële ingangsdatum in 2014 wacht.
Hoe dan ook, Griekenland, Ierland, Portugal, Spanje en Slovenië staan al in de rij om hun banken door het ESM -dus wel degelijk met het belastinggeld van de burgers- te laten 'redden', in de hoop het staatsbankroet te kunnen ontlopen. (1)
Ergste achter de rug?
Media en financiële instellingen, zoals kredietbeoordelaar Moody's, zeggen dan ook dat het ergste voor de banken achter de rug is. ECB-directeur Jörg Asmussen waarschuwde deze week echter dat er nog altijd geen zekerheid is dat we geen tweede 'Lehman Brothers' (het begin van de financiële crisis in 2008) zullen meemaken.
De Europese banken bouwen weliswaar hun portefeuilles met Zuid-Europese staatsschulden af, maar als de schuldencrisis zich verergert, zullen er wel degelijk nieuwe belastingmiljarden 'nodig' zijn om de banken overeind te houden. De crisis is daarom nog lang niet voorbij (2), wat EU-Commissiepresident José Manuel Barroso ook moge beweren.
Overigens kreeg salonmarxist Barroso deze week opnieuw de wind van voren van de Britse Europarlementariër Nigel Farrage, die hem verantwoordelijk stelde voor 'de ramp die de EU voor de armen en werkelozen' is geworden.
'Bezuinigingen zullen dramatisch mislukken'
Volgens de onafhankelijke financiële advies- en onderzoeksfirma GaveKal Research pompt de EU feitelijk waardeloze schuldpapieren in de Unie rond, en weet inmiddels niemand meer wie hier uiteindelijk voor moet opdraaien (wij wel: u, ik en alle andere gewone burgers).
'Het gevolg (van de grote renteverschillen) is dat de private sector massaal hun leningen verminderen, wat gecompenseerd wordt door een enorme toename van de overheidsuitgaven in onder andere Frankrijk, Italië en Spanje. De logica van dit systeem is inherent in strijd met de begrotingsregels van 'Maastricht', want zolang de rente ver boven de (economische) groei ligt, kunnen bezuinigingen alleen maar dramatisch mislukken.'
'Duitsers kunnen hun auto-export net zo goed tot zinken brengen'
'Het systeem veroorzaakt onverbiddelijk de vernietiging van de industriële basis in Italië, Frankrijk, Spanje en andere landen,' vervolgt Charles Gave. Dat de Duitse industrie hier nu van profiteert, is tijdelijke schijn. 'De Duitsers kunnen een groot deel van hun auto's net zo goed op een boot laden en deze bij Hamburg tot zinken brengen. Dat zou net zoveel opleveren als het verkopen van Audi's in ruil voor schuldbekentenissen (IOU's) van de bankroete (euro)landen.'
Deze IOU's duiken bij de ECB op in de vorm van de op deze site al vaak besproken beruchte, door de politieke doodgezwegen Target-2 balansen. 'Dat betekent dat niemand weet wie er uiteindelijk voor het verlies gaat opdraaien. Het spel gaat dus verder... totdat de soevereine landen binnen en buiten de EU stoppen met het accepteren van dit waardeloze papier.'
Crisis niet afgewend, maar versterkt
The Hamiltonian constateert dan ook dat de zogenaamde 'afgewende' crisis in werkelijkheid een versterkte crisis is. Het structurele probleem in Europa, het systeem waarin de Europese politieke, bureaucratische, media-, academische en financiële elite onderling met elkaar verbonden is, wordt niet opgelost. De EU stevent dan ook op een permanente Transferunie af, waarin landen zoals Duitsland en Nederland de andere lidstaten met miljarden overeind moeten houden, wat blijvend ten koste van hun eigen welvaart zal gaan.
Tenslotte deelde The Hamiltonian ook nog een forse sneer uit naar Barroso: 'Zijn opmerkingen afgelopen avond, dat iedere stap terug van 'Europa' dezelfde omstandigheden zal veroorzaken die leidden tot de Eerste Wereldoorlog, zijn niet alleen belachelijk verkeerd -hij zit er 180 graden naast- maar ronduit obsceen.' (3)
Xander
(1) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(2) KOPP
(3) Zero Hedge
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, finances, europe, affaires européennes, eurocatie, union européenne, politique internationale, banques |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 25 août 2013
Inde : économie et société

Gilbert ETIENNE:
Inde : économie et société
Ex: http://aucoeurdunationalisme.blogspot.com
L’année financière (avril de l’année « n » à mars de l’année« n+1 ») 2010-2011 s’est terminée en beauté : le PIB indien a crû de 8,6 %, après un creux suscité par la crise mondiale. Le commerce extérieur se porte bien, les firmes indiennes investissent de plus en plus à l’étranger et la société de consommation s’affirme. Les « Grands » de la planète se succèdent à New Delhi : les présidents Obama et Sarkozy, les premiers ministres David Cameron et Wen Jiabo. Que l’Inde soit bel et bien un pays émergent est évident, mais Amartya Sen et d’autres Indiens rappellent que subsistent de larges pans d’extrême pauvreté dans le pays. L’agriculture, qui occupe encore environ 50 % de la population active, progresse trop faiblement. Les infrastructures (transports, électricité) sont encore très défaillantes, suscitant de lourds surcoûts pour l’économie. Depuis l’automne 2010, plusieurs scandales de corruption ont ébranlé le gouvernement central, créant un climat de suspicion et le ralentissement des prises de décision.
L’économie indienne a le vent en poupe
INTRODUITES à partir de 1980, les réformes se sont très largement amplifiées en 1991 en Inde, grâce à Manmohan Singh, alors Ministre des Finances. Le PIB a enregistré des progressions annuelles de 5 % puis 7 %, voire 8 à 9 %, contre une hausse annuelle moyenne de 3,5 % entre 1950 et 1980. Ouverture, libéralisation, allégements de la bureaucratie, dévaluation de la roupie ont créé un mouvement irréversible. Les gouvernements opposés au Parti du Congrès, qui lui succèderont au pouvoir de 1996 à 2004, ont globalement suivi la même voie. Avec les élections de 2004, le parti du Congrès a repris le pouvoir, mais à la tête d’une coalition disparate de plusieurs partis, ce qui a freiné la poursuite des réformes. Manmohan Singh, devenu Premier ministre, a de nouveau gagné les élections de 2009, mais il doit toujours gouverner avec une coalition de partis alliés.
De nombreux succès sont apparus sur les dernières décennies : modernisation des usines existantes grâce à de nouveaux équipements, floraison de nouvelles entreprises, en particulier dans les technologies de l’information où l’on trouve autant de PME que de sociétés qui démarrent avec quelques milliers de dollars et deviennent des multinationales. Plusieurs unités du secteur public, entre autres SAIL, gros groupe sidérurgique, et BHEL (équipements électriques) se modernisent et s’agrandissent. Le secteur automobile accueille de nombreuses firmes étrangères en joint ventures. Les ventes de voitures explosent, suivant celles de scooters et de motocyclettes, avec pour corollaire un accroissement des embouteillages. Dans l’électroménager, la production, qui s’est affermie entre 1980 et 1991, poursuit sur sa lancée. L’industrie pharmaceutique enregistre des succès en Inde et à l’étranger. Le tourisme médical apparaît, avec d’excellents médecins opérant dans des hôpitaux très bien équipés. Modernisation et innovations débordent des métropoles vers les villes de province.
La construction urbaine bat son plein, après des décennies au cours desquelles le taux de construction de nouveaux immeubles était l’un des plus bas du monde (moins de la moitié de celui de la Thaïlande, trois fois moins qu’en Chine). Dans les districts avancés de Révolution verte (Cf. Infra), apparaissent les premières voitures privées après les motos. La cuisine au gaz remplace la bouse de vache séchée et les femmes font moudre le blé dans un moulin local, au lieu de passer des heures à moudre le grain dans la meule de pierre. Les taux d’épargne et d’investissement indiens se situent désormais autour de 35 % du PIB, contre 22 % pour le premier en 1991.
Les produits indiens deviennent plus compétitifs sur le marché mondial. La catégorie engineering (machines, acier) représente jusqu’à 22 % des exportations, dont 70 % sont assurées par des produits manufacturés. Les produits agricoles totalisent 8,5 % des exportations, les minerais 4,3 %, les produits pétroliers 17,3 % (une partie du pétrole brut importé est raffiné puis exporté). Au sein des importations, le pétrole vient en tête avec 33 %, en forte hausse car la production indienne stagne depuis 2000 autour de 33 millions de tonnes. Viennent ensuite les biens d’équipement, qui représentent 15 % des importations. Fidèle à ses traditions, l’Inde continue à importer de l’or, tandis que de grosses quantités de diamants sont également importées, taillées sur place et exportées. Légumineuses et huiles comestibles représentent 3,7 % des importations.
Les exportations de services sont stimulées par les technologies de l’information et les activités des firmes indiennes pour les entreprises étrangères. Avec les assurances et les transports, les exportations totales de services sont passées de 16 milliards de dollars en 2000/2001 à 96 milliards aujourd’hui, tandis que les importations passaient sur la même période de 15 à 60 milliards. Le commerce extérieur, qui représentait 15 % du PIB en 1990, atteint 35 % vingt ans plus tard. Les principaux pays clients de l’Inde sont l’Asie, avec 57 milliards de dollars, le Moyen-Orient (40 milliards), l’Union européenne (36 %), les États-Unis (19 %). Les exportations indiennes se sont élevées à 179 milliards de dollars sur l’année fiscale 2009/2010. Du côté des importations, le Moyen-Orient est le principal partenaire de l’Inde, avec 81 milliards de dollars (pétrole). Viennent ensuite l’Union européenne (38 milliards), les États- Unis (19 milliards) et l’Asie (90 milliards). Les importations totales s’élèvent ainsi à 288 milliards de dollars. À noter la faiblesse des échanges francoindiens : la France réalise 4 milliards de dollars d’importations et 4 milliards de dollars d’exportations avec l’Inde. À l’inverse, le commerce extérieur de l’Inde se caractérise par un accroissement des exportations chinoises vers l’Inde (31 milliards de dollars) ainsi que par une progression des échanges de l’Inde avec l’Afrique (dont des importations de pétrole) et avec l’Amérique latine.
Très limités dans les années 1970, les investissements privés étrangers (FDI) atteignent 281 milliards de dollars cumulés de 1980 à 2010. Un net ralentissement est apparu en 2010. Est-il simplement conjoncturel ou lié au climat politique actuel (Cf. Infra). Les investissements de portefeuille ont, quant à eux, chuté sous l’effet de la crise financière en 2008 et 2009, avant de remonter à 35 milliards de dollars en 2010-2011. En sens inverse, les entreprises publiques ou privées indiennes investissent à l’étranger, dans l’industrie et les services dans les pays occidentaux, dans les matières premières - notamment le pétrole - en Afrique. De 2000 à 2010, ces investissements ont atteint 133 milliards de dollars.
La société de consommation s’affirme
Comme la Chine, l’Inde subit les ombres de notre révolution industrielle avec toutes sortes d’abus, corruption, coulage, etc. et, dans le même temps, découvre les prémisses de la société de consommation que nous avons connue en Europe occidentale dans les Trente Glorieuses de l’après 1945 (J. Fourastié).
Il existe néanmoins des différences sensibles. Notre niveau de vie en 1945-1950 était très supérieur à celui de l’Inde aujourd’hui. La croissance démographique, même tombée à + 1,5 % l’an, dépasse de loin notre baby boom. Par ailleurs, le taux de croissance économique de l’Inde aujourd’hui est très supérieur au nôtre à l’époque. Mais il faut noter un manque croissant de cadres supérieurs et d’ouvriers qualifiés dans tous les domaines : aux côtés des Instituts de technologie de haut niveau, les universités n’assurent, dans l’ensemble, qu’un enseignement médiocre, ce qui oblige nombre d’entreprises à organiser leurs propres formations de jeunes cadres.
Le développement de la société de consommation se traduit par une amélioration de l’alimentation de la population (lait, fruits, légumes, éventuellement poulet, etc.), ainsi que par des modifications de l’habillement (accroissement du port de jeans pour les garçons et les filles) et une hausse des dépenses en cosmétiques des femmes. Les familles constituant les classes moyennes ou supérieures avec des revenus annuels de 7 000 à 37 000 dollars par an représenteraient environ 13 % de la population totale, soit 160 millions d’âmes. On ne saurait oublier les loisirs : 100 millions de touristes indiens visitent leur propre pays chaque année, sans parler de ceux, nombreux, qui vont à l’étranger. Les repas au restaurant deviennent également à la mode, tout comme la lune de miel pour les jeunes mariés…
27 à 30 % des Indiens ont beau connaître encore l’extrême pauvreté, les aspirations des classes montantes vont constituer un puissant moteur de croissance pour l’Inde pendant encore des décennies, jusqu’à ce que de plus larges couches de la population en profitent.
Le monde rural a besoin de plus d’attention
Le monde rural conserve un très grand rôle dans l’économie indienne, puisqu’il représente encore 69 % de la population totale. L’agriculture emploie environ 50 % du total des actifs et assure 14-15 % du PIB. Des progrès considérables ont été atteints depuis l’indépendance : routes en dur, électricité, croissance agricole d’abord lente, avant que ne soit mise en place la Révolution verte (RV) en 1965.
Le processus de la RV était basé sur des variétés de céréales qui réagissent beaucoup mieux à l’engrais chimique que les semences traditionnelles. Mais qui dit doses relativement élevées d’engrais chimiques dit une exigence en eau plus importante, voire en système d’irrigation. C’est dire que les vastes régions de l’Inde péninsulaire, aux pluies incertaines et aux faibles capacités d’irrigation, se trouvaient - et demeurent encore - en dehors de la Révolution verte. En revanche, dans les plaines irriguées, nombre de paysans, souvent illettrés, ont doublé leurs rendements de blé ou de riz décortiqué en une année pour atteindre 2t/ha dans un premier temps et 3 à 4 t/ha aujourd’hui. En quelques années, l’Inde a ainsi fortement réduit son déficit en céréales, tout en appliquant une politique de stockage d’une partie du grain par l’État en prévision des mauvaises moussons ainsi que pour une distribution de grains à prix modérés.
Autour de 1980, les efforts dans l’agriculture, l’électricité, les routes se sont relâchés, avec une baisse des investissements publics et des dépenses d’entretien. Si l’on observe une plus grande diversité de la production agricole (élevage et lait, fruits et légumes), stimulée par la hausse des revenus, force est de constater que la croissance agricole baisse : la recherche manque de fonds ; les services agricoles sont en plein déclin ; le manque d’électricité affecte les vastes régions dont l’irrigation dépend de puits à pompes électriques ; les canaux d’irrigation sont mal entretenus, tout comme les nouvelles routes ; quant aux investissements dans de nouvelles infrastructures, ils sont très insuffisants.
Au total, les districts concernés par la Révolution verte s’essoufflent et les rendements plafonnent. Qui plus est, les pertes après les récoltes atteignent 30 % pour les fruits et les légumes : lenteur des transports, manque de chambres froides, emballages défectueux, parasites sont autant de nuisances qui plombent la production. Il est non moins urgent de stimuler en particulier les plaines du bas Gange, d’Assam et d’Orissa, encore très peu irriguées malgré un énorme potentiel. Peu développées sous les Britanniques, elles n’ont enregistré que de faibles progressions de leur production depuis 1947, ce qui se traduit par une pauvreté qui reste très aigüe… De gros efforts s’imposent aussi dans les vastes zones de cultures pluviales.
Les infrastructures sont toujours à la peine
Les infrastructures ont joué un rôle décisif de 1950 à 1980, en ville comme à la campagne, pour le développement de l’Inde. Depuis lors, elles sont devenues des freins à la croissance : les plans quinquennaux 1992-2007 n’ont atteint que la moitié de leurs objectifs pour l’électricité ; le plan actuel (2007-2012) ne tient pas non plus l’horaire. Le manque d’investissements et de dépenses pour l’entretien des centrales et des réseaux de transmission et de distribution perdure. Viennent ensuite les vols de courant. Le manque d’électricité aux heures de pointe est passé de 7,5 % en 2001/2002 à 11 % à l’été 2010. Les coupures de courant de plusieurs heures par jour sont fréquentes dans les villes ; elles sont encore plus longues dans les campagnes. 40 à 45 % du courant seraient ainsi perdus sur l’ensemble du territoire. À Bangalore, grand centre du High Tech, les pertes dues au manque d’électricité représentent 12 à 15 % de la production des entreprises informatiques. Des chantiers de grandes centrales ont été ouverts mais les constructions annoncent de nouveaux retards.
Ces défauts sont aussi provoqués par un manque de coordination entre services concernés, des livraisons d’équipement défaillantes, un manque de cadres. Dans ces conditions, les riches installent un petit générateur chez eux, les entreprises en acquièrent de plus gros ou créent parfois leur propre centrale, ce qui grève leurs coûts. La question des matières premières devient délicate : manque de pétrole, de gaz, de charbon pour les centrales électriques et pour d’autres usines. De gros gisements de gaz ont heureusement été découverts au large des deltas de la Godavari et de la Krishna (sud-est de l’Inde) et l’on vient de découvrir des dépôts d’uranium en Andhra qui pourraient être les plus riches du monde : ils sont estimés à 44 000 tonnes.
Autre talon d’Achille de l’Inde, les transports avec, ici aussi, un manque d’investissements et de dépenses d’entretien patents : routes encombrées, souvent étroites, multiplicité des contrôles routiers, au point que les camions ne dépassent guère 25 km/h de moyenne. Le bilan des chemins de fer n’est guère plus brillant, les trains de marchandises roulant eux aussi à 25 km/h. Transports et logistique représentent 20 % des coûts finaux de production en Inde, contre 4 à 5 % en Europe. Les ports sont également sous pression et les coûts d’exportation par container sont de 1 053 dollars, contre 456 à Singapour. Ces insuffisances dans les transports correspondraient à près de 1 % du PIB par an, soit 14 milliards de dollars.
Enfin, mentionnons l’eau dans les villes, dont la fourniture est souvent interrompue et dont seuls 13 à 18 % des eaux usées sont traités. Du point de vue environnemental, les fonds consacrés à la lutte contre la pollution des eaux et de l’air, à l’érosion des sols ou encore aux risques liés au changement climatique sont très insuffisants. Les dommages annuels se situeraient entre 3,5 et 7 % du PIB.
Gouvernance et malaises déstabilisent la vie politique
Une avalanche de scandales se sont succédés depuis l’automne 2010 : pots de vin considérables et détournements touchent le gouvernement et l’administration, des hommes d’affaires, des militaires, etc. La société civile ainsi que de grands industriels donnent de la voix ; les media se déchainent ; même des religieux font la grève de la faim… Il n’est néanmoins pas certain que le coulage et la corruption aient beaucoup augmenté. Lorsqu’il était au pouvoir, en 2001, le Premier ministre Vajpayee du BJP, opposé au Congrès, parlait d’un véritable « cancer ».
La répression des abus a été faible jusqu’à maintenant. Un ministre du gouvernement central est sous les verrous, un autre a été mis à pied, ce qui ne calme pas les critiques, malgré l’intégrité du Premier ministre Manmohan Singh. Un climat de malaise s’est étendu sur New Delhi ; la Chambre du Peuple est secouée de désordres ce qui conduit à de fréquentes suspensions de séance…, le tout étant aggravé par une inflation à 9 % et un ralentissement de la croissance économique depuis le printemps 2011 : + 7,7 % (avril-juin). Les inégalités se creusent. De vastes régions rurales très pauvres, les bidonvilles, une mortalité infantile encore élevée suscitent de légitimes inquiétudes pour l’avenir du pays.
Les inégalités sont également marquées entre les États. Plusieurs d’entre eux, dont l’imposant Uttar Pradesh, sont mal gérés et se développent mal. Au Gujrat, la croissance prend, à l’inverse, des allures à la chinoise. Le Bihar est sorti d’une longue période de pourrissement grâce au gouvernement de Nitish Kumar, depuis les élections de 2005 et 2010. Le Tamil Nadu, malgré beaucoup de corruption, attire toujours plus les grandes firmes de l’automobile. La région de Gurgaon près de Delhi est en plein boom. Le gouvernement central peine plus que jamais à réduire les dépenses et les subventions, à imposer de nouvelles réformes sous le poids des affaires et des dissensions au sein de la coalition. Il faut aussi compter avec le poids de Sonia Gandhi, présidente du parti du Congrès. Depuis 2007, par exemple, est en discussion au Parlement le nouveau Land Acquisition Act pour remplacer celui de 1894 ! Entre temps, conflits, retards se succèdent pour créer des usines, exploiter de nouvelles mines de fer, de bauxite, de manganèse dans l’angle nord-est de la péninsule. Les gouvernements des États concernés perdent des rentrées de fonds, les habitants locaux peuvent être malmenés dans leur opposition, les investisseurs indiens comme Tata ou les firmes étrangères comme POSCO (Corée du Sud) perdent de l’argent alors qu’ils sont prêts à créer de nouvelles aciéries. Une vingtaine de milliards de dollars sont ainsi en attente d’investissement.
En conclusion, malgré le ralentissement actuel, l’économie indienne conserve de solides atouts et presque personne ne conteste le système démocratique du pays en dépit de sérieuses failles. Il serait néanmoins urgent, pour que l’Inde puisse poursuivre son développement, de sortir de la crise de gouvernance qui lèse aujourd’hui l’économie et de réduire l’inflation. Rahul Gandhi, fils de Sonia Gandhi, Présidente du parti du Congrès, actuellement aux États-Unis (pour des soins, semble-t-il), va-t-il quitter ses fonctions au sein du parti pour succéder à Manmohan Singh ? Et si oui, réussira t-il à sortir son pays de la difficile phase d’aujourd’hui ?
00:07 Publié dans Actualité, Economie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : inde, politique internationale, économie, asie, affaires asiatiques, géopolitique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 12 août 2013
Zone euro

Laurent OZON:
Zone euro: En Europe, la gouvernance économique a surtout besoin d'une gouvernance politique
Ex: http://www.newsring.fr/
François Hollande a proposé l'instauration d'un gouvernement économique de la zone euro lors de la deuxième conférence de presse de son quinquennat, le 16 mai 2013. Pour Laurent Ozon, le problème de l'euro provient de notre incapacité à lui assigner une direction politique.
L'actuelle crise de l'euro est le résultat d'une opération d'instabilisation menée par le monde financier et le gouvernement profond US pour maintenir le statut du dollar comme monnaie de change internationale. Cet outil monétaire (le dollar) est ce qui permet aux USA de continuer à financer leur domination par une dette contractée sur le monde entier dans une unité de change qui n'a que la valeur du papier sur laquelle elle est imprimée. De fait, le problème de l'euro est celui de notre incapacité à lui assigner une direction politique et cette difficulté provient en premier lieu de la difficulté d'une organisation politique comme l'UE à définir les contours d'une volonté politique claire, tiraillée entre les volontés contradictoires de ses membres, les empiètements des multinationales, les tentatives répétées de sabotage des USA (via ses satellites) etc.
De fait, toute monnaie non adossée à une volonté politique est un outil problématique. Ceci est valable pour toutes les monnaies, qu'elles soient nationales ou européennes. La question fondamentale est donc bien de savoir où peut se constituer une volonté politique capable d'une direction économico-financière souveraine et conforme à ses intérêts. La seconde question qui découle immédiatement de la première est: quels seront ses moyens réels d'action (en matière monétaire et au delà) face à une hégémonie financiaro-militaire de plus en plus agressive.
La nation par son unité héritée de l'histoire, peut apparemment fournir un environnement de pouvoir mieux maîtrisé et donc un potentiel de volonté politique opérationnel plus simple à obtenir qu'une fédération d'États aux intérêts parfois contradictoires comme l'UE. En clair, la France, par exemple, peut imaginer se donner une monnaie et lier les conditions de sa politique monétaire à ses intérêts souverains. La question qui se posera secondairement sera: quel poids aura la France face à cette hégémonie, compte tenu de son niveau d'autonomie vivrière, énergétique, militaire, médiatico-culturelle, économique et financière ? Un poids faible à n'en pas douter. D'autant plus faible que le niveau d'intégration de la France dans l'économie mondiale ne repose pas seulement sur sa monnaie mais sur un dispositif d'imbrication beaucoup plus vaste et infiniment plus profond que ne le croient ceux qui rêvent d'un destin politique retrouvé, l'œil dans le rétroviseur. C'est un partisan du protectionnisme et de la relocalisation qui l'affirme, dans l'état actuel des choses, il faudra des efforts immenses et du temps à une France isolée des grands systèmes monétaires et des sphères d'influence correspondantes, pour pouvoir résister aux pressions du système financier et militaire de la première puissance mondiale, pour ne pas évoquer les autres.
Confrontée probablement dans les vingts années à venir à une crise civile grave, dépendante de ses importations, sans autonomie industrielle (pièces, technologies, etc.) et sans puissance militaire de premier ordre ni ressources capables d'impacter les rapports de forces géopolitiques mondiaux, la France ne profitera de sa liberté monétaire que bien peu de temps. Celui de s'enfoncer dans la guerre et la ruine, sort qu'elle ne pourra in fine conjurer qu'en passant sous contrôle total d'une puissance dont elle pensait s'affranchir.
De fait, je le pense, la France n'a pas les moyens de faire cavalier-seul. Adossée aux centaines de millions d'européens tournée vers la Russie, elle pourrait se donner dans l'UE, les moyens d'une politique monétaire conforme aux intérêts de son économie. Car ce qui peut être fait en France peut être fait en Europe, certes dans un premier temps plus difficilement, mais à la condition préalable d'une vigoureuse refondation des institutions communautaires qui permettrait à une Europe débarrassée du Royaume-Uni et autres satellites US, de retrouver les moyens de son retour à l'histoire dans un monde multipolaire et de défendre ses choix avec plus de poids que celui d'un pays en pré-guerre civile ne disposant pas des moyens de puissance pour maîtriser, isolé, les conséquences de ses coups de mentons monétaires.
En bref, évoquer la question de la sortie de l'euro sans évoquer celui des rapports de forces internationaux et des implications vitales induites relève au mieux de l'amateurisme politique. De ce point de vue, un gouvernement économique de la zone euro pourrait être une solution, si il n'associait pas les habituels porte-avions américains au sein de l'UE et si la France et l'Allemagne s'engageaient à ajouter une dorsale russe à l'axe Carolingien...
C'est en tous cas le moment, à quelques mois des élections européennes d'ouvrir sérieusement le débat non ?
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zone euro, euro, politique monétaire, politique internationale, europe, affaires européennes, économie, laurent ozon |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 22 juillet 2013
CHARLES ROBIN ou "Le libéralisme comme volonté et comme représentation"

CHARLES ROBIN ou "Le libéralisme comme volonté et comme représentation"
Pierre Le ViganEx: http://metamag.fr
00:05 Publié dans Economie, Livre, Livre, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre le vigan, libéralisme, théorie politique, économie, politologie, sciences politiques, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 07 juillet 2013
P. Jovanovic: les banques ont volé la démocratie
00:05 Publié dans Economie, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : pierre jovanovic, banques, banksters, crise économique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 20 juin 2013
EL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ESTADOS UNIDOS – UNIÓN EUROPEA OTRO PASO HACIA LA GLOBALIZACIÓN

00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie, Géopolitique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, actualité, europe, états-unis, affaires européennes, union européenne, économie, globalisation, mondialisation |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 12 juin 2013
Chute programmée du système financier
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : pierre jovanovic, entretien, économie, crise économique, europe, affaires européennes |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 03 juin 2013
La economía no es el destino
La economía no es el destino
Archivio 1979 - Ex: http://www.nuevaderecha.org/
«Las únicas realidades que cuentan para nuestro futuro son de orden económico», declaraba durante un debate un ministro, que es también, al parecer, el mejor economista de Francia. «Estoy totalmente de acuerdo con usted», le replicaba el adversario político al que se oponía, pero usted es un gestor muy malo y somos más fuertes que usted en economía.
Diálogo revelador.
Como Nietzsche, sepamos descubrir a los falsos sabios bajo la máxima de «especialistas», destrocemos los ídolos, pues la falsa ciencia –la metafísica también– de nuestra época, y la primera de sus ídolos, es la economía.
«Vivimos en sociedades, anota Louis Pauwels, para las cuales la economía es el único destino. Limitamos nuestros intereses a la historia inmediata, y limitamos ésta a los hechos económicos». Nuestra civilización, por supuesto –que no es más una «cultura»– está fundada sobre una concepción del mundo exclusivamente económica. Las ideologías liberales, socialistas o marxistas, se unen en su interpretación «economista» del hombre y de la sociedad. Postulan todas que el ideal humano es la abundancia económica individual; aunque se diferencian por los medios de cómo llegar a ese estado, admiten unánimemente que un pueblo no es más que una «sociedad», reducen su destino a la exclusiva consecución del bienestar económico, explican su historia y elaboran su política sólo a través de la economía.
Es lo que en el GRECE negamos. Rechazamos esta reducción de lo humano a lo económico, esta única dimensión de la Historia. Para nosotros, los pueblos deben primero asegurar su destino: es decir su duración histórica y política y su especificidad. La historia no está determinada, y menos con relaciones y mecanismos económicos. La voluntad humana hace la historia. No la economía.
La economía para nosotros no debería ser ni una contradicción ni una teoría, sino una estrategia, indispensable, pero subordinada a lo político. Administrar los recursos de una comunidad según criterios primero políticos, ese es el sitio de la economía.
Entonces, entre las opciones liberales o socialistas y nosotros, no hay entente posible. Anti-reduccionistas, no creemos que la «felicidad» merezca ser un ideal social exclusivo. Al igual que los etólogos modernos, pensamos que las comunidades humanas sólo sobreviven físicamente si tienen un destino espiritual y cultural.
Podemos incluso demostrar que privilegiando la economía y la búsqueda del bienestar personal, llegamos a sistemas tiranos, a la desculturización de los pueblos, y a corto plazo, a una mala gestión económica. Ya que la economía funciona mejor cuando no ocupa el primer lugar, cuando no usurpa la función política.
Por lo tanto hay que asumir un cambió intelectual en economía, como en otros campos. Otra visión de la economía, según los desafíos contemporáneos, y ya no fundada sobre axiomas de burgueses del siglo XIX, será posiblemente la Economía Orgánica, objeto de nuestras investigaciones actuales.
La revuelta «en el sentido que Julius Evola da a este término» se impone contra esta dictadura de la economía, fruto de una dominación de los ideales burgueses y de una hipertrofia de una función social. Para nosotros europeos del oeste, es una revuelta contra el liberalismo.
«Nuestra época –escribía ya Nietzsche en Aurora– que tanto habla de economía es muy derrochadora; derrocha el espíritu». Fue profeta: hoy, un Presidente de la República se atreve a declarar: «El problema mayor de nuestra época, es el consumo». El mismo, a estos «ciudadanos» reducidos a simples consumidores, afirmar que desea el «nacimiento de una inmensa clase media, unificada por el nivel de vida». También el mismo se ha felicitado de la sumisión de la cultura a la economía mercante: «La difusión masiva –esta palabra que tanto le gusta– del audiovisual lleva a la población a compartir los mismos bienes culturales. Buenos o malos, es otra cuestión (sic) pero en todo caso por primera vez los mismos».
Clara apología, del jefe de fila de los liberales, del rebajamiento de la cultura al tráfico. Así, lo político desciende hasta el nivel de la gestión, fenómeno bien descrito por el politólogo Carl Schmitt. El dominio obsesivo de las preocupaciones económicas no corresponde, sin embargo, al antiguo psiquismo de los pueblos europeos. En efecto, las tres funciones sociales milenarias de los indoeuropeos, funciones de soberanía política y religiosa, de guerra, y en tercer lugar de fecundidad y de producción, supondrían un dominio de los valores de las dos primeras funciones, hechos puestos a la luz por G. Dumézil y E. Benveniste. Pero, no sólo la función de producción se encuentra hoy dominada por una de sus sub-funciones, la economía, sino que ésta, a su vez, está dominada por la sub-función «mercante». Por consiguiente el organismo social está, patológicamente, sumiso a los valores que produce la función mercante.
Según los conceptos del sociólogo F. Tonnies, este mundo al revés pierde su carácter «orgánico» y vivo y se convierte en «sociedad mecánica». Tenemos que reinventar una «comunidad orgánica». Así el liberalismo económico y su colaborador político adquieren su significado histórico: esta ideología ha sido la coartada teórica de una clase económica y social para «librarse» de toda tutela de la función soberana y política, e imponer sus valores –sus intereses materiales– en vez y en lugar del «interés general» de la Comunidad entera.
Solamente la función soberana y sus valores propios pueden asegurar el interés general. La única revolución ha sido la del liberalismo, que ha usurpado la soberanía en interés de la función económica, revindicando primero la «igualdad» con los otros valores, pretexto para marginarlos después.
Según un proceso cercano al marxismo, el liberalismo ha construido un reduccionismo económico. Los hombres sólo son significativos para él como participantes abstractos en el mercado: clientes, consumidores, unidades de mano de obra; las especificidades culturales, étnicas, políticas, constituyen tantos obstáculos, de «anomalías provisionales» hacia la Utopía a realizar: el mercado mundial, sin fronteras, sin razas, sin singularidades; esta utopía es más peligrosa que la del igualitarismo «comunista» ya que es más extremista todavía, y más pragmática. El liberalismo americano y su sueño de fin de la Historia en el mismo way of life comercial planetario, constituye la principal amenaza.
Así señalamos claramente a nuestro enemigo. Tenemos costumbre de designar como «sociedad de mercado» a la realizada según la ideología liberal; podemos señalar que el marxismo y el socialismo nunca han conseguido, ellos, a realizar su proyecto igualitario, la «sociedad comunista», y aparecen así menos revolucionarios que el liberalismo, menos «reales».
Esta «sociedad de mercado» se nos aparece pues como el objeto actual y concreto de crítica y de destrucción. Nuestra sociedad es «de mercado», pero no especialmente mercantil. La república de Venecia, las ciudades hanseáticas vivían de un sistema económico mercantil pero no constituían sociedades «de mercado». Pues el término «mercado» no designa estructuras socioeconómicas sino una mentalidad colectiva, un sistema de valores que caracteriza no sólo la economía pero todas las instituciones.
Los valores del mercado, indispensables a su único nivel, determinan el comportamiento de todas las esferas sociales y de Estado, e incluso la función puramente productiva de la economía.
Se juzga –y al Estado en primer lugar– desde un punto de vista totalmente mercantil. Esto no quiere decir que dominación mercante signifique «dominación por el dinero», no planteamos una condena moral del dinero no del beneficio del empresario. Hay que admitir el comportamiento mercantil o provechoso si acepta subordinarse a otros valores. No hay que ver pues en nuestra posición un «odio de la economía» o un nuevo reduccionismo opuesto a la ganancia y a la función mercantil como tales. No somos moralizadores cristianos. Sociedad de mercando significa pues sociedad donde los valores sólo son mercantiles. Podemos clasificarles en tres figuras «mayores»: la mentalidad determinista, el espíritu de cálculo y la dictadura del bienestar económico individual.
La mentalidad determinista, útil sólo para la única actividad mercantil, tiende a eliminar los riesgos y a minimizar los vaivenes. Pero, adoptada por el conjunto de una sociedad y en particular por los decididotes políticos y económicos, la mentalidad determinista se convierte en coartada intelectual para no actuar ni arriesgar. Sólo el mercante (comerciante) puede por derecho, para maximizar sus ganancias, subordinar sus actos a determinismos: leyes del mercado, coyunturas, curvas de precios, etc… Pero el poder político, no más que la economía nacional no deberían, como un comerciante, someterse o «dejarse llevar» por una racionalidad excesiva que dispensa de todo «juego de riesgo». La sociedad mercante se «administra» a corto plazo, bajo la hegemonía de las «previsiones económicas» pseudos científicas (la industrialización «ineludible» del Tercer Mundo, la mundialización de la competencia internacional, la tasa de crecimiento de las rentas y del PNB, etc.), pero paradójicamente no tiene en cuenta las más elementales de las evoluciones políticas a medio plazo: por ejemplo el oligopolio de los poseedores del petróleo.
Por lo tanto, nada menos «independiente» que las naciones mercantes. Los gestores liberales van en el sentido de lo que creen mecánicamente determinado (por estar racionalmente formulado) haciendo la economía de la imaginación y de la voluntad.
En el siglo de la perspectiva, de la previsión estadística e informática, nos dejamos llevar por el corto plazo y se prevé menos que los soberanos de los siglos pasados. Todo pasa como si las evoluciones sociales demográficas, geopolíticas no existieran y no fuesen a tener efectos mayores. Lo igual en todos los sitos – según la fórmula estúpida de los economistas liberales- solamente son tomadas en cuenta por los que deciden las restricciones o pseudos previsiones económicas a corto plazo. (original francés Toutes choses égales par allieurs –selon la formule stupide des économistes libéraux- seules son prises en compte par les décideurs, les contraintes ou pseudo-prévisions économiques à court terme)
La sociedad mercante es pues ciega. Sometida a las evoluciones y a las voluntades exteriores, porque cree en el determinismo histórico, trata a los pueblos europeos como objetos de la historia.
Segundo rasgo de la mentalidad mercante: el espíritu de cálculo. Adaptado al comerciante, este espíritu no conviene a los comportamientos colectivos. Hegemonía de lo cuantificable sobre lo cualificable, es decir, sobre los valores, dominio de lo mecánico sobre lo orgánico, el espíritu de cálculo aplica a todo la tabla única del valor económico. No pensamos que el «dinero» se haya convertido en la norma general: sino que todo lo que no se puede medir «ya no cuenta».
Se pretende calcularlo todo, incluso lo no-económico: se «programan» los momentos de jubilación, las horas de trabajo, los tiempos de ocio, los salarios, en el mismo nivel –pero mucho antes– los niños que van a tener. Existe incluso un «coste de la vida humana» tomado en cuenta para ciertas inversiones. Pero todo lo que escapa al cálculo de los costes, es decir precisamente lo que más importa, es rechazado, los aspectos incontables económicamente de los hechos socio-culturales (como los costes sociales de la pérdida de raíces resultante de la inmigración) llegan a ser indescifrables e insignificantes para los «tecnomercantes».
Incluso en economía, el exceso de cálculo perjudica: ¿cuántas inversiones útiles a largo plazo, pero que un cálculo de previsión declara no rentables a corto plazo, son abandonadas?
El individuo, seguro, «calcula» su existencia, pero ya no piensa en su herencia, en su descendencia. Los Estados obsesionados por la gestión a corto plazo, sólo toman en consideración los aspectos «calculables» y cifrables de su acción. Estos «hombres de negocios» demagogos sólo actúan ahí donde se pueden «rendir cuentas» y sobre todo en lo inmediato, incluso si es necesario falsificando algunas cifras.
¿Una región muere de anemia cultural? ¿Qué importa si por el turismo de masas, su tasa de crecimiento es positiva? Y, entre adversarios políticos, el argumento político se reduce a batallas de porcentajes.
Esta superficialidad de la «gestión tecnocrática» (ersatz mercante de la función soberana) puede incluso desembocar en el «marketing político», reducción de la política al «negocio» comercial. Hoy, Francia o Alemania, son más o menos asimiladas por sus gobiernos a sociedades anónimas por acciones. La Casa Francia con sus ciudadanos asalariados. Ni que decir que, también, la política exterior e incluso la política de defensa, están determinadas por intereses de salidas comerciales inmediatas. Incluso para la economía no es lo mejor ya que este mercantilismo a corto plazo resulta ser aleatorio y no sustituye una política económica. Cuando los Jefes de Estado en visita se convierten en V.R.P., como verdaderos VRP, se rinden bajo la dependencia de sus clientes. (original francés pone V. R. P. ¿qué es eso)
La sociedad de mercando puede describirse como una «dictadura del bienestar individual» según los términos de Arnold Huelen; dictadura porque el individuo, obligado a entrar en el sistema providencialista del Estado, ve desintegrarse su personalidad en el ambiente consumista. Paradójicamente, el Estado-providencia liberal castiga la iniciativa productiva (cargas sociales excesivas) y desanima indirectamente la iniciativa individual. Asegurados sociales, asalariados, parados remunerados: ya no dominan su destino. Inmenso desprecio de su pueblo por el Estado-providencia, el «monstruo frío» de Nietzsche. Tiranía suave.
¿Cómo extrañarse entonces que se desprecie un soberano transformado en dispensador de entretenimientos? El Politólogo Julián Freund habla justamente del fallecimiento político del Estado.
El liberalismo produce un doble reduccionismo: por una parte el Estado y la sociedad sólo deben responder a las necesidades económicas de los pueblos; y, por otra, estas necesidades son reducidas al «nivel de vida» individual. En el liberalismo mercante se prohíbe, en parte por interés, juzgar si estas necesidades son deseables o no: sólo cuentan los medios técnicos a poner en marcha para conseguirlas.
De ahí el predominio político del nivel de vida y por necesidad igualitaria: sueño burgués – y americano– de pueblos nivelados e igualados por el mismo nivel de vida.
Los pueblos y los hombres siendo todos semejantes para un liberal, la única desigualdad subsistente es la del poder adquisitivo: para obtener la igualdad, es pues suficiente difundir a través del mundo el modo de vida mercante. Así, ahí están reconciliadas milagrosamente (la mano invisible de Adam Smith) el humanismo universalista y los «negocios», la justicia y los intereses, como confesaba puerilmente Jimmy Carter; Bible and Business.
Los particularismos culturales, étnicos, lingüísticos, las «personalidades», son obstáculos para la sociedad mercantil. Lo que explica que la ideología moralizadora de los liberalismos políticos lleva al universalismo, a la mezcla de los pueblos y de las culturas, y a las diversas formas de centralismo.
La sociedad mercantil y el modelo americano amenazan a todas las culturas de la Tierra. En Europa o en Japón la cultura ha sido reducida a un «modo de vida» («way of life») que es justo lo inverso a un estilo de vida.
El hombre es así clasificado, es decir reducido a las cosas económicas que compra, produce o recibe, según el mismo proceso (pero más intensamente aún) que en los sistemas comunistas. Su personalidad se acaba en los bienes económicos que solos estructuran su individualidad. Cambiamos de personaje cuando cambiamos de moda. Ya no estamos caracterizados por nuestros orígenes (reducidas al «folclore») ni por nuestras obras, sino por nuestros consumos, nuestro «standing». En el sistema mercantil, los modelos cívicos dominantes son el consumidor, el asegurado, el asistido; y no el productor, el inversor, el empresario. No hablemos de los tipos no-económicos: el jurista, el médico, el soldado, que se han convertido en tipos sociales secundarios.
La sociedad mercantil difunde un tipo de valores cotidianos perjudiciales respecto al trabajo como tal: vender y consumir el capital parece más importante que construirlo. Y no hay nada más igualitario que la función de consumo. Los productores, los empresarios, se diferencian por sus actos; ponen en juego capacidades desiguales. Pero consumir, es el no-acto al que todo el mundo, sean sus capacidades las que sean, o su origen, puede acceder. Una economía de consumo se mete en una vía inhumana en la medida en que el hombre es etológicamente un ser de acción y de construcción. Así, paradójicamente la alta productividad de las industrias europeas subsiste a pesar de la sociedad liberal mercantil y no a causa de ella. ¿Por cuánto tiempo? Hay que precisar que nuestra crítica de la sociedad mercantil no es un rechazo, muy al contrario, de la industrialización o de la tecnología. La noción de comunidad orgánica, que oponemos a la sociedad mercantil, no tiene nada que ver con la «sociedad de convivencia original francés: conviviale» de los neo-rousseanistas (Illich, etc…)
La técnica es para nosotros una adquisición cultural europea, pero debe ser considerada como una herramienta de poder y de dominio del medio y ya no como una droga al servicio del bienestar. Entonces no compartimos las críticas izquierdistas con resonancia bíblica, sobre la «maldición del dinero» y sobre la «voluntad de poder» de la sociedad contemporánea. La sociedad mercantil no afirma ninguna voluntad, ni en el nivel del destino global, ni siquiera en el de una estrategia económica.
Las consecuencias de esta civilización de la economía son graves para el destino de nuestra especie, y al mismo tiempo, para nuestro futuro político y económico. Honrad Lorenz ve en la «unidad de los factores de selección», todos de naturaleza económica, una amenaza de empobrecimiento humano. «Una contra-selección está en marcha –revela Lorenz en Nouvelle Ecole– que reduce las diversidades de la humanidad y le impone pensar exclusivamente en términos de rentabilidad económica a corto plazo. Las ideologías economistas, que son tecnomórficas, hacen del hombre una máquina manipulable. Los hombres, unidades económicas, son cada vez más iguales, como máquinas precisamente».
Para Lorenz, la subordinación de los valores no económicos es una catástrofe, no sólo cultural sino biológica. El consumir constituye una amenaza psicológica para los pueblos. Lorenz, como médico, habla de patología colectiva. Morimos de arteriosclerosis. La civilización del bienestar económico nos lleva lentamente, según Lorenz, hacia la muerte templada. Escribe: «hipersensibles al no placer, nuestras capacidades de gozar se debilitan».
La neofilia, este gusto siempre insatisfecho de nuevos consumos, tiene, para los antropólogos, efectos biológicos nefastos y desconocidos. Pero, ¿qué es la supervivencia de la especie al lado de la subida del precio de los croissants de mantequilla? En fin, si nadie piensa en estos problemas, nosotros sí.
Muerte templada, pero también declive demográfico. La dictadura de la economía ha hecho de nosotros europeos unos pueblos corto-vivientes según el análisis de Raymond Ruyer. Atacados a nuestras preocupaciones económicas inmediatas, nos hemos convertido en objetos y en victimas de la historia biológica.
Nuestros economistas son sensibles al declive demográfico solamente porque comprometerá la financiación de la jubilación. «Nuestra civilización economista –escribe Raymond Ruyer– es por esencia anti-natalista y suicida porque es, por esencia, anti-vital, anti-instintiva».
Pero el consumo de masas ha convertido a la cultura en «primitiva». Los mercaderes de bienes de consumo poseen un poder cultural, que se ejerce en el sentido de un desarraigo, y de una masificación igualitaria. No son los consumidores quienes eligen su estilo de vida –mito democrático querido por los liberales– sino son firmas mercantes quienes crean comportamientos de masa destruyendo las tradiciones específicas de los pueblos. Mediante el «marketing», mucho más que por la propaganda política, se impone casi científicamente un nuevo comportamiento, jugando sobre el mimetismo de las masas desculturizadas. Una sub-cultura mundial está naciendo, proyección del modelo americano. Se orientaliza o se americaniza a voluntad. Desde el final de la primera guerra mundial, del «new look» a la moda «disco», un proceso coherente de condicionamiento sub-cultural está en marcha. El rasgo común: el mimetismo de los comportamientos lanzados por los mercantes americanos. Así, la economía se ha convertido en uno de los fundamentos cualitativos de la nueva cultura, sobrepasando ampliamente su función de satisfacción de las necesidades materiales.
Incluso en el plano estrictamente económico, que no es, según nuestro punto de vista, capital, el fracaso del sistema mercantil dado hace algunos años es patente. No hablemos ya del paro y de la inflación, sería muy fácil. Jean Fourastié anota: «la indigencia de las ciencias económicas actuales, liberal o marxista» y las acusa de usurpación científica. «Asistimos – dice– sobre todo desde 1973, a la carencia de los economistas y al inmenso naufragio de su ciencia». Añade: «los economistas liberales o socialistas han pensado siempre que sólo lo racional permitía conocer lo real. Sus modelos matemáticos se han construido sobre la ignorancia o el odio de las realidades elementales. Ahora bien, en cualquier ciencia, lo elemental es lo más difícil. Se llega a ser despreciarlo porque no se presta a los ejercicios clásicos sobre los que los economistas universitarios se otorgan sus diplomas. Fourastié concluye: «Nuestro pueblo, nuestros economistas, nuestros dirigentes viven sobre las ideas del siglo XIX. Los impasses de la racionalidad empiezan a ser visibles. El hombre vive al final de las ilusiones de la inteligencia».
Un reciente premio Nobel de economía, Herbert Simon, acaba de demostrar que en sus comportamientos económicos u otros, el hombre, a pesar del ordenador, no podría optimizar sus elecciones y comportarse racionalmente. Así, la «Teoría de los Juegos y del Comportamiento Económico» de Von Neumann y Morgenstern, una de las bases del liberalismo, se revela falsa. La elección razonada y óptima no existe. Herbert Simon ha demostrado que las elecciones económicas eran primer término, al azar, arriesgadas, voluntaristas.
Estas ilusiones de la inteligencia han causado a los liberales graves fracasos; cojamos algunos al azar: El sistema liberal mercante despilfarra la innovación y utiliza mal la acción técnica. Esto es, como lo había visto Wagemann, porque la contabilidad en términos de provecho financiero a corto plazo (y no en términos de «excedente» global) frena cualquier inversión y cualquier innovación no vendible y no rentable a corto plazo.
Otro fracaso, con consecuencias incalculables: la llamada a la inmigración extranjera masiva. Los provechos inmediatos, estrictamente financieros, resultado de una mano de obra explotable y maleable es los que ha contado frente a los «costes sociales» a largo plazo de la inmigración, que nunca han sido considerados por el Estado y por la patronal. La codicia inmediata de los importadores de mano de obra no ha hecho pensar en lo «que no se gana» en términos de «no modernización» provocado por esa elección económica absurda.
El responsable de una gran empresa me decía recientemente con un tono despectivo que su ciudad estaba «rellena de inmigrantes» y que esto le molestaba personalmente. Pero después de algunos minutos de conversación, me confesaba con muy buena conciencia que diez años antes, había «sondeado» en el extranjero para «importar» mano de obra que fuese barata. Tal inconsciencia se asemeja a una nueva esclavitud. Es impresionante constatar que incluso la ideología marxista, a pesar de su desprecio a las diversidades culturales y étnicas, no se ha atrevido, como el liberalismo, a utilizar para su provecho el desenrazamiento masivo de las poblaciones rurales de los países en vías de desarrollo.
Gobiernos irresponsables y una patronal ignorando las realidades económicas, y desprovistos del menor sentido cívico y ético, han garantizado una práctica neo-esclavista cuyas consecuencias políticas, culturales, históricas –e incluso económicas– son incalculables (precisamente) para los países de acogida y sobre todo para los países que proporcionan la mano de obra.
Más preocupados de los «negocios» y del «bienestar», los liberales no se han enfrentado a los desafíos más elementales: crisis de la energía, crisis del patrón dólar, subida de los costes europeos y competencia catastrófica de los países del Este y de Extremo-Oriente.
¿Quién se preocupa de ello? ¿Quién propone una nueva estrategia industrial? ¿Quién piensa en que el final de la prosperidad ya ha empezado? La respuesta a los desafíos gigantes del final del siglo sólo es posible en contra de las prácticas liberales. Solamente una óptica económica fundada en las elecciones de un espacio económico europeo semi-autárquico, de una planificación de una nueva política de sustitución energética a medio plazo, y de una retirada del sistema monetario internacional, se adaptaría a las realidades actuales.
Los dogmas liberales o «libertarios» del libre intercambio, de la división internacional del trabajo, y del equilibrio monetario se revelan no solamente económicamente utópicos (y estamos dispuestos a demostrarlo técnicamente) sino también incompatibles sobre todo con la elección política de un destino autónomo para Europa.
Como para los nuevos filósofos que se contentaban en reactualizar a Rousseau, hay que tomar conciencia de la impostura de la operación publicitaria de los «nuevos economistas».
No se trata ni más ni menos que de una vuelta a las tesis bien conocidas de Adam Smith. Pero los nuevos economistas franceses (Jenny, Rosa, Fourcans, Lepage) no son nada por ellos mismos y sólo vulgarizan las tesis americanas. Miremos del lado de sus maestros.
Partiendo de una crítica pertinente, es verdad, del «Welfare State» (el Estado providencia burocrático aunque neoliberal), la escuela de Chicago, monetarista y conservadora, con Friedmann, Feldstein, Moore, etc., predica un retorno a la ley micro-económica del mercado, rechaza cualquier obligación del Estado hacia grandes empresas, reencontrando así la despreocupación de los liberales del siglo XIX hacia el paro y las cuestiones sociales. Y la escuela de Virginia, con Rothbard, David Friedman, Tullock, etc… quiere ser «anarco-capitalista», partidaria del estallido del Estado y de la reducción total de la vida social y política a la competencia y a la única búsqueda del provecho mercantil.
Se puede criticar estas tesis, conocidas y «recalentadas» desde el punto de vista económico. Pero que sea suficiente decir que, para nosotros europeos, incluso realizable y «próspero», un programa tal significa la muerte definitiva como pueblos históricos. Los «friedmanianos» y los «libertarios» nos proponen la sumisión al sistema del mercado mundial dominado por leyes que favorecen a la sociedad americana pero que son incompatibles con la elección que debemos tomar, de permanecer como naciones políticas y pueblos evolucionando en sus historias específicas.
La economía orgánica no quiere ser una Teoría. Sino una estrategia, que se corresponde únicamente con la elección, en la Europa del siglo XX, de sociedades donde el destino político y la identidad cultural se sitúan antes que la prosperidad de la economía. Subsidiariamente, la función económica es además mejor dominada.
Reflexionamos, en el GRECE, sobre esta nueva visión de la economía, a partir de los trabajos de Tomar Spann y de Ernst Wagemann en Alemania, Johan Akerman en Suecia y François Perroux en Francia. Wagemann compara la economía liberal a un cuerpo sin cerebro, y la economía marxista a un cerebro subido en zancos. La economía orgánica, modelo práctico que no pretendemos exportar, quiere adaptarse a la tradición trifuncional orgánica de los europeos. Según los trabajos de Bertalanffy sobre los sistemas, la función económica se consideraba como un organismo parcial del organismo general de la comunidad. Según los sectores y las coyunturas, la función económica puede estar planificada o actuar según las leyes del mercado. Adaptable y flexible, admite el marcado y el beneficio, pero los subordina a la política nacional. El Estado deja a las empresas, en el marco nacional, actuar según las restricciones del mercado pero puede, si las circunstancias lo exigen, imponer con medios no económicos la política de interés nacional.
Las nociones irreales de «macro y micro economía» dejan paso a la realidad de la «economía nacional», también las nociones de sector público y privado pierden sentido, ya que todo es a la vez «privado» en el nivel de la gestión y «público» en el sentido de la orientación política.
Los bienes colectivos duraderos son preferibles, y no la producción de bienes individuales obsoletos y energéticamente costosos. Los mecanismos y manipulaciones económicos son considerados como poco eficaces para regular la economía con respecto a la búsqueda psicológica del consenso de los productores.
La noción contable de excedente y de coste social sustituye los conceptos criticables de «rentabilidad» y de «provecho». Por su elección de centros económicos autoritariamente descentralizados, y de un espacio europeo de gran escala y semi-autárquico (caso de los EE. UU. de 1900 a 1975) la economía orgánica puede pretender una potencia de inversión y de innovación técnica superior a lo que autoriza el sistema liberal, frenado por las fluctuaciones monetarias y la competencia internacional total (dogma reduccionista del libre intercambio según el cual la competencia exterior sería siempre estimulante).
En última instancia, la economía orgánica prefiere el empresario al financiero, el trabajador al asistido, el político al burócrata, los mercados públicos y las inversiones colectivas, al difícil mercado de los consumidores individuales. Más que las manipulaciones monetarias, la energía del trabajo nacional de un pueblo específico nos parece como lo único capaz de asegurar a largo plazo el dinamismo económico.
La economía orgánica no es en sí misma la finalidad de su propio éxito. Pero quiere ser uno de los medios de asegurar a los pueblos europeos el destino, entre otros posibles (lit: parmi d´autres posibles), de pueblos con larga vida.
Para concluir, habría que citar la conclusión que el economista Sombart ha dado en su tratado El Burgués, pero sólo mencionaremos el pasaje más profético: «En un sistema fundado en la organización burocrática, donde el espíritu de empresa habrá desaparecido, el gigante convertido en ciego estará condenado a arrastrar el carro de la civilización democrática. A lo mejor asistiremos entonces al crepúsculo de los dioses y el Oro será devuelto a las aguas del Rin».
François Perroux ha escrito también que deseaba el fin del culto de Mamón que «brilla hoy con una prodigiosa luz».
Hemos elegido contribuir al fin de este culto (francés: Nous avons choisi de contribuir à la fin de ce culte), asegurar el relevo del último hombre, el de la civilización de la economía, de la que el Zaratustra de Nietzsche decía:
«¿Amor, creación, deseo, estrella?
¿Qué es eso?
Así pregunta el último hombre y guiña el ojo.
La tierra se hará más exigua y sobre ella saltará el último hombre, este que reduce todo.
Hemos inventado la Felicidad, dicen los últimos hombres.
Y guiñan el ojo».
00:05 Publié dans Economie, Nouvelle Droite, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : guillaume faye, nouvelle droite, théorie politique, politologie, économie, sciences politiques, philosophie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 21 mai 2013
Allemagne: récession imminente?
Andrea PERRONE:
Allemagne: récession imminente?
Berlin amorce un déclin lent, à cause d’une croissance en net recul qui met en danger l’avenir de toute la zone-euro!
L’économie de toute la zone-euro poursuit son ressac et l’Allemagne, à son tour, devient sujet de préoccupation, car l’état de l’économie allemande empire. Ce n’est pas un hasard si l’économie allemande n’accuse qu’une très misérable croissance de 0,1% seulement au cours de ces trois derniers mois, tandis que la France, elle, a déjà basculé dans la récession, comme le signalent les données d’Eurostat. Avec un recul de 0,2% au cours des trois premiers mois de l’année 2013, l’économie de la zone-euro est bel et bien, désormais, en récession et cela, depuis un an et demi: c’est là la période de récession la plus longue depuis 1995, année à partir de laquelle Eurostat a commencé à rassembler des données. L’Etat de la zone-euro qui se trouve dans la pire des situations est bien entendu la Grèce, dont l’économie s’est réduite de 5,3%. Elle est suivie du Portugal, qui accuse une récession de –3,9% par rapport à la même période l’an passé.
La France aussi est officiellement en récession après que son économie se soit réduite de 0,2% au cours de ces six derniers mois, avec, en fond, un taux de chômage supérieur à 10%, assorti d’une perte de confiance des entreprises et des consommateurs. Entretemps, l’Allemagne a repris une croissance, après une récession de trois mois à la fin de l’année 2012, mais cette faible reprise s’avère bien trop lente et insuffisante, atteignant seulement le chiffre de 0,1%, surtout à cause d’une augmentation des dépenses de la part des consommateurs. Ce chiffre ne suffit pas, bien entendu, pour faire redémarrer l’économie de la zone-euro en général, qui se débat encore et toujours dans une crise qui perdure.
Les données d’Eurostat montrent que l’économie allemande s’est réduite de 0,3% par rapport à la même période l’an passé. Le bureau allemand des statistiques met ce faible rendement sur le compte d’un “climat hivernal extrême” qui a duré jusqu’en avril. A l’opposé, la Lettonie a enregistré une croissance de 5,6% et la Lituanie de 4,1% par rapport à la même période en 2012. Les deux pays espèrent adhérer à la zone-euro très bientôt: la Lettonie en janvier 2014 et la Lituanie en 2015. L’Estonie voisine, qui a adhéré à la zone-euro en 2011 a enregistré la croissance la plus élevée de la zone par rapport à l’an passé, avec +1,2%. Mais par rapport aux trois mois qui viennent de s’écouler, l’économie estonienne, à son tour, s’est réduite d’un pourcent.
Pour ce qui concerne Chypre, les chiffres montrent que l’économie de l’île a considérablement empiré pendant la période où l’on négociait son plan de sauvetage: son économie a chuté de 4,1% par rapport au trimestre de janvier-mars 2012. La situation économique de l’Italie, de l’Espagne, de la Finlande et des Pays-Bas est préoccupante car tous ces pays ont vu, eux aussi, se rétrécir leur assiette économique par rapport au trimestre précédent et à l’an passé, comme d’ailleurs toute les économies de la zone-euro. La Banque centrale européenne, au début mai 2013, a abaissé le taux de référence à son minimum historique de 0,5%, tentant ainsi de faire redémarrer l’économie de la zone-euro. Mais tout prêt avantageux demeure une chimère, surtout pour les banques des pays de l’Europe méridionale qui continuent à emprunter de l’argent à des taux d’intérêt beaucoup plus élevés que le taux de référence: même le président de la BCE, Mario Draghi, a souligné que les prêts à bon marché ne se sont jamais avéré bons pour l’économie réelle.
Andrea PERRONE.
(article paru dans “Rinascita”, Rome, 17 mai 2013 – http://www.rinascita.eu/ ).
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : zone euro, politique internationale, europe, union européenne, allemagne, affaires européennes, économie, crise européenne |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
PASSET-626x220.jpg René Passet : « Il faut prendre du recul pour voir qu’un autre monde est en train de naître »

René Passet : « Il faut prendre du recul pour voir qu’un autre monde est en train de naître »
Basta ! : Notre manière de penser l’économie dépend de notre perception du monde. Et varie totalement en fonction des époques et du progrès technique. Dans votre dernier ouvrage, vous proposez de relire l’histoire économique à la lumière de ces mutations. Quelles sont les grandes étapes de cette longue histoire ?
René Passet [1] : Ceux qui voient le monde comme une mécanique, une horloge, ne considèrent pas l’économie de la même façon que ceux qui le voient comme un système énergétique qui se dégrade. Les mêmes astronomes, armés des mêmes instruments, ne perçoivent pas les mêmes choses dans le ciel, avant et après Copernic. Quand l’homme n’a que ses sens pour comprendre le monde, l’univers lui apparaît mystérieux.
C’est un univers qui chante, qui le nourrit, qui gronde aussi parfois. Des forces jaillissent de partout. Il pense que des êtres mystérieux et supérieurs le jugent, l’approuvent ou le punissent. Avant même le Néolithique, l’homme s’aperçoit que la plante dont il se nourrit pousse mieux dans les milieux humides. Ou que les déchets organiques favorisent la végétation. Il découvre ainsi les forces productives de la nature et les régularités du monde naturel. Cela va faire reculer les esprits, qui se réfugient sur les sommets des montages, comme l’Olympe.
Les dieux succèdent aux esprits, le monde mythique au monde magique. La civilisation grecque marque le basculement de l’esprit vers la conceptualisation. Un tournant décisif, le début d’une réflexion sur la nature des choses, avec la philosophie, science première. On passe ensuite des dieux au pluriel à un dieu au singulier. L’activité économique est encore une activité pour le salut des âmes, dans la perspective chrétienne. Si vous ne voulez pas finir vos jours dans les lieux infernaux, il faut vivre selon les préceptes économiques des théologiens.
Peu à peu la rationalité l’emporte, et la science se laïcise. Pour Descartes et Newton, le monde fonctionne comme une horloge. C’est dans cette société « mécaniste », que naît l’école libérale classique. Au 18e siècle, Adam Smith, qui était aussi astronome [2], propose une théorie gravitationnelle de l’équilibre : le prix du marché gravite autour du « prix naturel », qui est le coût de production de l’objet, exactement comme les astres gravitent autour du soleil.
Avec la machine à vapeur apparaît une nouvelle représentation du monde…
En 1824, le physicien Sadi Carnot découvre les lois de la thermodynamique : le principe de conservation et le principe de dégradation. Imaginez un morceau de charbon. Il brûle, mais ne disparaît pas : tous ses éléments constitutifs se conservent, répandus dans l’univers. Et s’il a produit du mouvement, jamais plus il n’en produira, car il est désormais déstructuré, « dégradé ».
A ce moment de l’histoire, on passe d’une représentation mécanique du monde à la société énergétique. Alors que chez Adam Smith, chez Newton, c’est l’équilibre – statique – qui compte, les lois de l’énergie sont des lois de probabilité. Quand on répand un gaz dans un volume, il va dans tous les sens, et le hasard fait qu’il se répand partout de manière homogène.
Au niveau de l’individu, il n’y a pas de déterminisme apparent, mais au niveau des grands nombres, les mouvements se compensent : ce sont les lois de probabilité. On change de causalité, et d’univers : le monde est en mouvement, comme le montre aussi Darwin. Au même moment dans l’histoire économique, Marx et les socialistes se mettent à penser non pas en terme d’équilibre mais d’évolution.
Ce passage d’une représentation mécanique du monde à la société énergétique a-t-il un impact sur la vie des idées ?
Le mouvement des idées part alors dans trois directions. Avec Léon Walras, qui invente « l’équilibre général » des marchés, c’est la loi de conservation qui prime. La deuxième loi, celle de la dégradation entropique, amène à la théorie de l’autodestruction du système capitaliste, par Karl Marx. Au fil du temps, le système entropique et le système capitaliste suivent un même cheminement, ils se dégradent, se désorganisent.
La loi de probabilité, on la retrouve chez Keynes [3]. Sa théorie est celle de l’incertitude radicale : les acteurs économiques agissent dans un monde incertain, dont ils ont une connaissance imparfaite. Une vision à l’opposé des analyses classiques sur la rationalité des marchés.
Vient ensuite le temps de l’immatériel et de l’information…
La société énergétique, celle de la grande industrie, fonctionne par l’accumulation de capitaux et le développement du secteur financier et bancaire. La vraie rupture entre les classes sociales apparaît. La société s’organise hiérarchiquement. Au début des années 1970 deux événements vont marquer un tournant important : la première crise du pétrole et la sortie du microprocesseur Intel. L’informatique pour tous, et nous voici dans la société informationnelle (dans le sens de « donner une forme »).
Dans cet univers, la force productive est l’esprit humain. Les modes d’organisation changent complètement. De l’entreprise au monde entier, l’économie est organisée en réseaux. Le monde se vit comme unité, en temps réel. On gomme le temps et l’espace.
Est-ce l’avènement de la financiarisation de l’économie ?
L’ordinateur nous a donné le moyen du contact immédiat et la logique financière nous pousse vers une économie de rendement immédiat. Avec la politique de libération des mouvements de capitaux dans le monde, on assiste à une concentration de capital, et à la naissance d’une puissance financière supérieure à celle des États. Avec des effets désastreux pour l’économie réelle.
Un exemple ? L’entreprise pharmaceutique Sanofi gagne des sommes colossales, licencie pourtant ses chercheurs et n’invente plus rien, depuis que son PDG est issu du secteur de la finance. La finalité ? Produire du dividende et non plus du médicament. On relève la barre de rentabilité, on externalise la recherche et pour le reste, on dégraisse. Les chercheurs sont désespérés, ils ne font plus leur métier.
« L’humanité est en train de résoudre son problème économique », disait Keynes, envisageant un avenir prochain où l’homme pourrait travailler trois heures par jour, grâce à l’augmentation de la productivité. Nous en sommes très loin… Avons-nous raté quelque chose ?
A toute époque, le progrès technique a pour effet d’augmenter la productivité du travail humain. La productivité accroît la quantité de valeur ajoutée. Mais la façon dont celle-ci est partagée dépend du rapport de force dans la société. Dans la vision fordiste, les intérêts des salariés et des entrepreneurs sont convergents.
Henry Ford le dit très bien : « Si vous voulez vendre vos bagnoles, payez vos ouvriers ». Progrès économique et progrès social vont alors de pair. Lorsque c’est le pouvoir de la finance qui domine, le dividende se nourrit de la ponction qu’il effectue sur les autres revenus.
La logique ? Réduire l’État, les salaires, le nombre de salariés, les protections sociales. L’augmentation de la productivité a été compensée par cette logique de la rémunération des actionnaires. Keynes a raison ! Et la semaine de 32 heures est aujourd’hui un des moyens pour rétablir le plein emploi. Keynes évoque aussi les risques psychologiques de cette évolution. Pour la première fois depuis sa création, l’homme devra faire face à son problème véritable : comment employer sa liberté arrachée aux contraintes économiques ?
Vous expliquez comment nous avons successivement fait tomber les barrières, entre espace terrestre et céleste avec Galilée, entre l’homme et l’animal avec Darwin, entre conscience et rationalité avec Freud. Que pensez-vous de cette nouvelle convergence qui s’opère, entre le vivant et la machine, avec les biotechnologies, dont vous décrivez l’importance dans votre ouvrage ?
Je ne crois pas à la fin de l’histoire, mais à la fin de l’homme. Avec les nanotechnologies et le concept « d’homme augmenté », on prévoit d’introduire dans notre sang des robots qui vont nous réparer. Et nous ne saurons bientôt plus quelle est la part humaine et quelle est la part robotique en l’homme. Nous aurons dans le cerveau des puces avec de la mémoire. Est-ce que la puce va appartenir à l’homme, ou bien le modifier ?
Lorsque je m’interrogerai, la réponse arrivera un peu plus vite. Mais est-ce vraiment moi qui répondrai, ou bien est-ce l’encyclopédie Universalis, à ma disposition dans mon cerveau ? Quelles seront les conséquences de tout cela ? L’homme se crée lui-même par les efforts qu’il fournit, en travaillant pour acquérir des connaissances, en transformant le monde, comme disaient Hegel ou Marx. S’il dispose de prothèses pour faire le travail à sa place, je crains que l’homme ne se diminue lui-même. Toute prothèse est atrophiante.
Vous n’êtes pas très optimiste…
Je suis très inquiet pour l’avenir de l’humain. J’ai peur qu’arrive, dans une humanité mécanisée, robotisée, un autre homme dont on ne saura plus très bien ce qu’il est. Le grand cybernéticien Alan Turing (1912-1954) a parié qu’aux environs de l’an 2000 on ne serait plus capable, dans une conversation téléphonique, de faire la différence entre un homme et un robot. C’est une autre limite, une autre frontière. Est-ce le sens de l’évolution ? Cela a-t-il une signification ? Je n’en sais rien.
Pouvons-nous maîtriser ces bifurcations de civilisation ?
Avons-nous maîtrisé les bifurcations précédentes ? Elles sont venues au fil de l’évolution, et nous les avons suivies. Nous ne les comprenons qu’après coup, et nous nous adaptons à une nouvelle normalité qui s’établit. Les gens les ont vécues comme la fin d’un monde, sans comprendre où allait le monde nouveau. Il faut prendre du recul pour voir qu’un autre monde est en train de naître. Nous vivons aujourd’hui une confusion entre crise et mutation. Nous mélangeons deux types de crises.
L’évolution est faite de ruptures et de normalité. La crise dans la normalité, c’est lorsque dans le système établi apparaissent des dysfonctionnements qui nous éloignent de la norme. C’est la crise au sens propre du terme, conjoncturelle. Le problème est alors de revenir à la norme. Si le sous-emploi est conjoncturel, on va essayer de rétablir le plein-emploi dans les normes traditionnelles, avec les moyens traditionnels.
Les crises de mutation, c’est passer d’un système à un autre. Et c’est ce que nous vivons aujourd’hui. Ce n’est pas une crise économique, mais une crise du système néolibéral. C’est la logique même du système qui a provoqué la crise des subprimes en 2008. Notre vrai problème est aujourd’hui de réussir la mutation. Or nous avons chaussé les lunettes de la crise du court terme.
Un exemple : rigueur ou relance ? Tous les gouvernements raisonnent dans une logique de court terme ! Le pouvoir financier impose sa vision du temps court. Cela fausse tout, nous raisonnons à partir d’une économie complètement tronquée.
Quelles en sont les conséquences ?
Dans le temps court, le salaire n’est qu’une charge pour les entreprises, et la protection sociale, une charge pour la société. L’impôt, c’est un prélèvement et rien d’autre. Si vous abordez le problème avec cette vision, cela vous amène forcément à la rigueur : il faut restreindre la dépense publique. Même si la crise ne vient pas de la dépense publique mais du secteur privé, en premier lieu des banques avec la crise des subprimes.
Il faut comprimer les salaires, travailler plus pour gagner moins ! Le résultat ? Un cercle vicieux. Le second effet apparaît dans un temps plus long : le salaire, c’est le support d’un revenu qui alimente la dépense de consommation. L’impôt, c’est le support de la dépense publique. Il ne se perd pas dans les sables du désert ! Toute cette dimension nous manque. Les gouvernements sont piégés dans cette logique de court terme, alors que le vrai problème est celui de la réussite de la mutation.
« L’homme des cavernes pouvait difficilement – à la lumière de son expérience – se faire une conception de l’univers autre que magique », écrivez-vous. Alors que les marchés sont aujourd’hui présentés comme des oracles, ne serions-nous pas capables de faire mieux que l’homme des cavernes ?
Dans une vision à court terme, la tendance est de défendre les structures existantes. Avec de très bonnes intentions, on s’enferme dans des contradictions totales. Les gouvernements mènent une politique de réduction des dépenses énergétiques, et de l’autre côté, n’acceptent pas la diminution du nombre de raffineries, qui découle de cette politique. Le problème n’est pas que les salariés des raffineries restent raffineurs, mais de les employer dans de nouvelles structures, et de voir quelles sont les structures nécessaires à la poursuite de la mutation.
En essayant de régler un problème de long terme avec des instruments de court terme, nous nous enfonçons de plus en plus dans la crise, à force de prendre des décisions à contre-sens. Au contraire, anticiper ces transitions, cette mutation, devrait pourtant inspirer non pas le discours des politiques, mais leur action. On se trompera forcément, mais par tâtonnement nous finirons par trouver la voie pour nous engager dans un cercle vertueux.
Vous définissez la science économique comme un « système de pensée nombriliste, clos sur lui-même, replié sur la contemplation inlassable des mêmes équilibres et des mêmes procédures d’optimisation ». De quelle science économique avons-nous besoin aujourd’hui ?
Lorsque j’ai publié mon livre L’économique et le vivant en 1979, les économistes m’ont dit : « Qu’est-ce que c’est que ce truc ? Ce n’est pas de l’économie. » Depuis, beaucoup ont compris l’importance de la transdisciplinarité. Confrontés aux mêmes réalités, chaque discipline interroge le monde sous un angle différent. La nature de mes questions me définit comme économiste.
C’est le lieu d’où je questionne le monde, mais ce n’est pas une prison ! Si les chercheurs refusent de se hasarder dans les zones d’interférences, certains problèmes ne seront jamais abordés. C’est pourtant dans ces zones que se joue aujourd’hui la survie de l’humanité.
Comment recréer des espaces de réflexion interdisciplinaires ?
Il y a aujourd’hui des courants intéressants, comme celui des Économistes atterrés. On parle en ce moment de la reconstitution d’une structure qui ressemblerait à celle du Plan, avec une ambition de prospective. J’étais très favorable à la planification française, souple. Les objectifs des secteurs stratégiques – sidérurgie, transports, énergie,…– étaient définis au sein des Commissions du Plan, qui réunissaient des grands fonctionnaires, des intellectuels, mais aussi des syndicats ouvriers et patronaux. Une concertation sociale permanente.
C’est ce qui nous manque le plus aujourd’hui. De cette rencontre sortaient des objectifs, ensuite arbitrés par l’État. On n’avait pas besoin de faire des grands discours sur la concertation, on la faisait !
Vous défendez le principe de bioéconomie. En quoi cela consiste-t-il ?
Ce n’est pas une nouvelle branche de l’économie : c’est l’économie qui doit se faire bio. La destruction de la biosphère menace actuellement l’humanité. Et si on détruit la biosphère, cela ne sert à rien de disserter sur le Plan et l’avenir de l’humanité : il n’y aura pas d’avenir, pas d’économie. Le monde est arrivé à ce moment où il atteint et dépasse la capacité de charge de la biosphère. Toutes les conventions sur lesquelles était fondée l’économie sont remises en cause.
La nature était considérée comme inépuisable ? Elle devient un facteur rare que l’on épuise. Et c’est une des conventions fondatrices de l’économie qui disparaît. Quand on cherche la combinaison optimale de facteurs de production, ou de biens de consommation qui vont vous donner le maximum de satisfaction, on procède par substitution de biens. C’est la deuxième convention de base de l’économie : on optimise en substituant.
Cela n’est plus vrai aujourd’hui : quand vous atteignez les limites de la biosphère, certaines ressources ne peuvent plus être augmentés. La substituabilité disparaît. Troisième convention : « Le plus est le mieux » – c’est en consommant davantage que l’on accroît le bien-être. Nous atteignons aussi la limite où ce n’est plus vrai. Le paradoxe d’Easterlin montre que dans les nations les plus riches le bien-être et le revenu ne vont plus de pair. Il arrive un moment où la relation s’inverse carrément.
Comment l’économie peut-elle intégrer la question de la reproduction des ressources et du vivant ?
L’économie est faite pour optimiser – ce n’est pas un vilain mot !. Cela veut dire tirer le maximum de résultats, de choses positives, de satisfaction, à partir des moyens limités dont nous disposons. Mais elle doit intégrer ces stratégies d’optimisation (de production et de consommation) dans les limites des mécanismes de reproduction du système.
Par exemple les rythmes de reproduction des matières premières, des ressources renouvelables : « Voilà, on peut piocher dans les réserves jusque ce niveau, mais pas plus ». Ou des rythmes de prélèvement des ressources non renouvelables compatibles avec des perspectives de relève, de remplacement de ces ressources. L’économie retrouve alors sa vraie vocation : une science d’optimisation sous contrainte. Sans limites, il n’y a pas d’économie, car cela veut dire que l’on peut faire n’importe quoi !
Le système économique actuel peut-il s’adapter à cette contrainte ?
Certains économistes voudraient que l’économie soit une science qui prenne en compte toutes les contraintes, sauf celles de l’environnement ! Dans un système vivant, vous avez une finalité qui domine, c’est la finalité du système tout entier : maintenir et reproduire sa structure dans le temps, alors que les lois physiques, les lois d’entropie voudraient qu’il se désagrège. Cette finalité est supérieure à toutes les autres.
Dans une horloge, vous avez une seule loi, du ressort à la mécanique entière. C’est très différent dans le vivant : on fait un saut dans le vivant, en passant de la molécule à la cellule, c’est une autre logique qui s’applique. Et la logique de l’organe est différente de la somme des logiques des cellules. La pensée n’est pas la somme des atomes du cerveau.
En économie, c’est pareil. C’est le paradoxe de Condorcet : il faut un choix à un moment donné, la logique du tout n’est pas la somme des logiques particulières. On est loin de la « main invisible du marché » d’Adam Smith, qui transforme mécaniquement les intérêts individuels en intérêt général.
Vous parlez de « point critique », ce moment qui nous fait basculer dans un autre univers. Sommes-nous en train d’atteindre un tel point critique ?
Nous vivons une crise de civilisation, mais le dépérissement du système sera long, car trop d’intérêts sont en jeu. Pour l’univers de la finance, ce système n’est pas mauvais : quand tout va bien, il engrange les bénéfices, et quand tout va mal, la charge retombe sur la collectivité.
La faillite d’un paradigme n’implique pas qu’il disparaisse immédiatement. Il faut qu’une théorie concurrente soit prête à prendre la place, comme le dit l’historien Thomas Kuhn. Le point critique, c’est lorsqu’un écart évolutif, au lieu d’être ramené vers la moyenne, bifurque de manière totalement imprévisible vers une nouvelle voie d’évolution.
Tout progrès est ambigu, à la fois chance et péril. C’est nous qui choisissons. Le progrès technique nous donne actuellement la possibilité de gagner plus, de vivre mieux, de travailler moins. Et comme nous avons libéré la cupidité des hommes, avec la libéralisation du secteur financier, ce sont les effets pervers qui l’emportent. Ce qui devrait être un instrument de libération des hommes devient un moyen d’asservissement. L’homme devient la variable d’ajustement de l’augmentation des dividendes.
Tant qu’on n’aura pas tranché le nœud gordien du pouvoir de la finance, rien ne sera possible. Parce que le rapport de force agira toujours dans cette direction, et le côté pervers du progrès technique l’emportera toujours. Sous la pression des événements et des drames qui se multiplieront, serons-nous amenés à le faire à temps ? Sans cela, nous courrons à la catastrophe. Il faut continuer à alerter et à travailler dans ce sens.
Notes
A lire : René Passet, Les Grandes Représentations du monde et de l’économie à travers l’histoire, éditions LLL Les liens qui libèrent, 950 pages, 38 euros.
Notes
[1] René Passet, économiste spécialiste du développement et professeur émérite à la Sorbonne, a été membre du Groupe des Dix, constitué à l’initiative de Jacques Robin et de Robert Buron, au sein duquel il a travaillé avec des biologistes, des physiciens, des sociologues, des anthropologues, des informaticiens. Il a été le premier président du Conseil scientifique de l’association Attac.
[2] Auteur de l’ouvrage Histoire de l’astronomie.
[3] Qui a écrit un traité des probabilités avant de se pencher sur l’économie.
00:05 Publié dans Economie, Entretiens | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : rené passet, économie, entretien |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 16 avril 2013
Othmar Spann: Vom klerikalfaschistischen Ständestaat und seinen Kontinuitäten
| | |
|
Othmar Spann: Vom klerikalfaschistischen Ständestaat und seinen Kontinuitäten von Heide Hammer Ex: http://www.contextxxi.at/
Othmar Spann inthronisierte sich in einem hierarchischen Ständemodell - an der Spitze - und war als Lehrer geistiges Zentrum der von ihm Erwählten. In seinem 1921 erstmals veröffentlichten Werk Der wahre Staat. Vorlesungen über Abbruch und Neubau der Gesellschaft ordnet er "Stände nach ihren geistigen Grundlagen"1 und ficht gegen Demokratie, Liberalismus und vor allem marxistischen Sozialismus. Ordnendes Prinzip sei: "daß jeder niedere Stand geistig vom jeweils höheren geführt wird (im Original gesperrt), nach dem geistigen Lebensgesetz aller Gemeinschaft und Gemeinschaftsverbindung 'Unterordnung des Niedern unter das Höhere'" (Der wahre Staat, S.176). Die Figur des Kreises Auch er hatte zumindest einen Koch dabei - um "Vollstand" also "handelnd" (Ebd., S. 176) zu werden - diese sind durchaus zahlreich, er führt seine Schüler in Privatseminaren (Sonntag Vormittag bei sich zuhause) in die Grundlagen seiner Gesellschaftslehre ein.2 Primus wird - mit überaus langem Atem in seinem Wirken - Walter Heinrich. Er promoviert 1925 bei Spann, wird 1927 sein Assistent, habilitiert sich 1928 und erhält 1933 an der Wiener Hochschule für Welthandel einen Lehrstuhl für Nationalökonomie. Viele Jahre später zeichnet er in der Zeitschrift für Ganzheitsforschung ein Bild wunderbarer Harmonie dieser Lehrer-Schüler-Beziehung, ein Arbeitszusammenhang, der sehr auf politischen Einfluss zielte, hingegen in der Erinnerung jeweils von der konkreten historischen Situation abstrahiert und metaphysische Distanz beansprucht. Der Meister einer elitären Verbindung provoziert den Terminus "Genie", Kritik wird folglich zu einer inadäquaten Form der Auseinandersetzung, lediglich Analogien zu genialen Personen auf anderen Gebieten (Mozart) erleichtern die Übersetzung jener "Größe", die nunmehr in der Erzählung wirkt:3 "Eine ... tiefer schürfende Erklärung für seine [Spanns] Wirksamkeit liegt sicherlich in der geschlossenen Einheit von Leben und Lehre, von Persönlichkeit und geistigem Werk. Hier war das Eroshafte und das Logoshafte, freundschaftliche Nähe und Geisteskraft in seltener Einheit zusammengewachsen und haben vermöge dieser schöpferischen Verbindung einen Gründungsakt eingeleitet, der weiterwirkt. Vom ersten Geistesblitz der Gründung bis zur Entfaltung des Werkes ... der Wurzelgrund der Lehre wurde niemals verlassen. Dieser Wurzelgrund ... ist der Befund, daß Geist nur am anderen Geist werden kann, also gliedhaft; und die Erkenntnis: wo Glied, da Ganzheit. Damit ist eine neue Eroslehre begründet, eine neue Gemeinschaftslehre, eine neue Gesellschaftslehre." J. Hanns Pichler, ein später Apologet und heute Vorstand des Instituts für Volkswirtschaftstheorie und -politik an der WU-Wien, übernimmt u.a. die Aufgabe, in gegebenen Abständen auch an den Schüler zu erinnern, an Geburtstagen, später posthum4 oder die Erinnerung an Spann und Heinrich zu verbinden3. Daneben oder danach protegiert Spann Jakob Baxa, der Rechtswissenschaften studiert hatte; von Spann zum Dank für seine intensive und wertvolle Auseinandersetzung mit der Romantik im Fach Gesellschaftslehre habilitiert (Siegfried, S. 72). Wilhelm Andrae wechselt ebenso unter dem Einfluss Spanns von der klassischen Philologie, mit der er an der Berliner Universität nicht reüssieren konnte, zur Nationalökonomie; er erhält 1927 in Graz einen Lehrstuhl für Politische Ökonomie (Ebd.). Seine Übersetzung von Platons Staat, woran Spann gerne seine Überlegungen knüpft, wird hier als Habilitationsschrift anerkannt. Hans Riehl promoviert 1923 bei Spann, die Habilitation 1928 kann bereits bei seinem Freund Wilhelm Andrae in Graz erfolgen (Ebd., S. 73). Ernst von Salomon5, selbst in jenem Kräftefeld aktiv, das in der Weimarer Republik von Konservativen Revolutionären gebildet wird (u.a. an der Ermordung von Außenminister Walter Rathenau am 24. Juni 1922 beteiligt und verurteilt), hielt sich auf Einladung Spanns in Wien auf und beschreibt in seinem Bestseller, Der Fragebogen6 das alltägliche politische Verhalten der Spann-Schüler (Zit. nach Siegfried, S. 71): "Die 'Spannianer' bildeten auf der Universität eine besondere Gruppe, die größte Gruppe von allen, und, wie ich wohl behaupten darf, auch die geistig lebendigste. In jeder Verschwörerenklave auf den Gängen, in den Hallen und vor den Toren waren Spannianer, mit dem Ziel einer kleinen Extraverschwörung, wie ich vermute, - die beiden Spannsöhne vermochten schon gar nicht anders durch die Universität zu schlendern, wo sie gar nichts zu suchen hatten, ohne ununterbrochen nach allen Seiten vertrauensvoll zu blinzeln. Jeder einzelne von den Spannschülern mußte das Bewußtsein haben, an etwas selber mitzuarbeiten, was mit seiner Wahrheit mächtig genug war, die Welt zu erfüllen, jedes Vakuum auszugleichen, an einem System, so rund, so glatt, so kristallinisch in seinem inneren Aufbau, daß jedermann hoffen durfte, in gar nicht allzulanger Zeit den fertigen Stein der Weisen in der Hand zu haben."7 Die Protagonisten dieser Art Universalismus richten ihre Aktivitäten nach verschiedenen Polen, um in der zeitweiligen Konkurrenz von Nationalsozialismus, Faschismus und Ständestaat ebenso ein Netz zu bilden, wie in den Kontinuitäten der 2. Republik. Ein Blick auf die umfangreiche Publikationsliste J. Hanns Pichlers, des nunmehrigen Vorstands der Gesellschaft für Ganzheitsforschung, dokumentiert eine der Traditionslinien. Sein Bemühen gilt den Klein- und Mittelbetrieben, dem Kleinbürgertum, eine mögliche ideologische Parallele zu Othmar Spann, und - entsprechend seiner Funktion - den Anwendungsgebieten des ganzheitlichen Denkens.8 Dass er im gegebenen politischen Kräftefeld die Publikationsmöglichkeit im Organ der Freiheitlichen Akademie, Freiheit und Verantwortung wahrnimmt, verwundert kaum.9 Gerne bespricht er in der von ihm herausgegebenen Zeitschrift für Ganzheitsforschung Übersetzungen oder Neuauflagen der Schriften Julius Evolas10, jenes faschistischen Philosophen und Mystikers, der Mussolini von seiner Philosophie überzeugen wollte, die SS liebte und heute Inspiration vieler rechter AktivistInnen ist. Evolas 'Cavalcare la tigre' (Den Tiger reiten) sieht Pichler "ungemein aufrüttelnd und zeitgemäß zugleich", der beliebte Plot 'Untergang des Abendlandes' wird diesmal durch die "Auflösung im Bereich des Gemeinschaftslebens" gegeben und Pichler konkretisiert, "von Staat und Parteien, einer weithin endemisch gewordenen Krise des Patriotismus, von Ehe und Familie bis hin zu den Beziehungen der Geschlechter untereinander" (Zeitschrift für Ganzheitsforschung 4 (1999), S. 209). Denn, so die Diagnose Pichlers in einer Rezension des von Caspar von Schrenck-Notzing herausgegebenen Lexikon des Konservativismus (Zeitschrift für Ganzheitsforschung 2 (1998), S. 93), "in einer pluralistisch zerrissenen und 'unkonservativen' Zeit" dürfen dahingehend mutige Leistungen (das vorliegende Lexikon) nicht geschmälert werden - obgleich er die "notorische und offenbar nicht auszumerzende[!] Fehlinterpretation" der inneren Ordnung der Werke Spanns bedauert -, den Wirren der Zeit werden der ganzheitlichen "Geistestradition verpflichtete Autoren" vor- und gegenübergestellt, allen voran immer wieder Spann. Fragen der politischen Funktion, der Adressaten und Verbündeten der universalistischen Staatslehre werden insoweit unterschiedlich beantwortet, als AutorInnen wie Meyer11, Schneller12 oder Resele13 einen Zusammenhang des ideologischen KSpanns und der sozialen Interessen der kleinbürgerlichen Mittelschicht betonen, während Siegfried darauf beharrt, dass sich dahingehend keine eindeutige Beziehung feststellen ließe, die konkreten Bündnispartner (Heimwehr, Stahlhelm) vielmehr Oberklassen repräsentierten (Vgl. Siegfried, S. 14). Spann wirkt im Zeichen eines "dritten Weges", ein Motiv, das im Kontext der Konservativen Revolution14 an unterschiedlichen Positionen deutlich wird und später gerne von VertreterInnen einer vermeintlich "Neuen Rechten" (Nouvelle Droite)15 affirmiert wird. Das Ständestaatskonzept bietet in seinem Kampf gegen den Historischen Materialismus und die politische Organisation der ArbeiterInnenbewegung eine vorgeblich konsensuale Alternative, die als Wirtschaftsordnung "... jeden, Arbeiter wie Unternehmer, aus seiner Vereinzelung herausreißt und ihm jene Eingliederung in eine Ganzheit gewährt, welche Aufgehobenheit und Beruhigung bedeutet statt vernichtenden Wettbewerb, statt der hastigen Unruhe und Erregung der kapitalistischen Wirtschaftsordnung" (Der wahre Staat, S. 234). In Anlehnung an die Gesellschafts- und Staatslehre der politischen Romantik (Adam Müller) war Spann bemüht, soziale Antagonismen, Phänomene des Klassenkampfes in einem geistigen Gesamtzusammenhang aufzulösen (Vgl. Siegfried, S. 32-34) und das Glück der Unterordnung, der freudigen Hingabe an die subalterne Funktion im hierarchischen Gefüge in unglaublichen Variationen und Auflagen zu verbreiten. In den Anfängen seiner akademischen Karriere, Spann habilitiert sich 1907 an der Deutschen Technischen Hochschule in Brünn, positioniert er sich in den nationalistischen Auseinandersetzungen der Germanisierungspolitik in der österreichischen Monarchie (Zit. nach Siegfried, S. 43): Heimwehrkontakte Als nach dem Eingreifen der Polizei 86 Tote die Empörung der ArbeiterInnen - kumuliert im Brand des Justizpalastes - kennzeichnen, erzwingt die Heimwehr den Abbruch der sozialdemokratischen Kampfmaßnahmen und erfreut sich daraufhin der Zuwendung heterogener reaktionärer Kräfte, die Heimwehr wird (besonders bäuerliche) Massenbewegung (Siegfried, S. 81). In dieser zweiten Legislaturperiode der Regierung Seipel dominiert Spanns universalistische Lehre die Wiener Universität, sein Kreis hatte sich kontinuierlich vergrößert, nun kommt es zu intensiven Kontakten zwischen dem Führer der Christlichsozialen Partei, der Heimwehr-Führung und Mitgliedern des Spann-Kreises. Im Sommer 1929 wird Walter Heinrich Generalsekretär der Bundesführung des österreichischen Heimatschutzes, im Oktober übernimmt Hans Riehl die Leitung der Propagandaabteilung der Selbstschutzverbände (Siegfried, S. 84). Die Spannungen innerhalb der Heimwehren, unterschiedlicher Flügel, wie sie z.T. für die ÖVP charakteristisch sind, sollten durch ein Gelöbnis (Korneuburger Eid, 18. Mai 1930) beseitigt werden, dessen Text wesentlich von Walter Heinrich formuliert wurde. Der Versuch der Beschwörung der Einheit misslingt, Aristokraten siegen über kleinbürgerliche Repräsentanten der Heimwehren und beenden die Tätigkeit des Spann-Kreises in der Organisation (Siegfried, S. 100). Versuche in Italien Seit 1929 wenden sich Vertreter der universalistischen Lehre dem Faschismus zu, die italienische Regierung bedachte im übrigen die Heimwehren mit bedeutenden Geld- und Waffenlieferungen, den Mangel eines konkreten politischen Programms will Spann kompensieren (Zit. nach Siegfried, S. 102): Austrofaschismus In Österreich war die Transformation der parlamentarischen Demokratie zu einem klerikalfaschistischen Ständestaat durch die Ausschaltung von Parlament und Verfassungsgerichtshof gelungen. Spann verweist auf seine "organisch universalistische Gesellschafts- und Wirtschaftslehre" und betont deren Unvereinbarkeit mit demokratischen Formen der Repräsentation (Zit. nach Siegfried, S. 139): Spanns Ausführungen gelten der Ablehnung liberaldemokratischer Verfassungen, seine Argumentation richtet sich gegen das zentrale Element der Forderung nach Gleichheit. Diese sei "die Herrschaft der Mittleren, Schlechteren, der den Schwächsten zu sich herauf, den Stärkeren herabzieht. Sofern dabei durchgängig die große Menge die Höheren herabzieht und beherrscht, in der großen Menge jedoch abermals der Abschaum zur Herrschaft drängt, drängt Gleichheit zuletzt gar auf Herrschaft des Lumpenproletariats hin" (Der wahre Staat, S. 44). In der weiteren Illustration der Modi des allgemeinen Wahlrechts muss das "politisch gänzlich unbelehrte ländliche Dienstmädchen" die männliche Qualität der "politisch wenigstens teilweise unterrichteten Staatsbürger", Handwerker oder "gehobene Arbeiter" zwangsläufig mindern, "die Stimme des akademisch Gebildeten, des politischen Führers,..." wird entwertet (ebd.). Nationalsozialismus 1929 beginnt Spann Kontakte zu nationalsozialistischen Organisationen zu pflegen, er unterstützt die von Alfred Rosenberg 1927 gegründete Nationalsozialistische Gesellschaft für deutsche Kultur, deren Aufgabe die Begeisterung akademisch Gebildeter für die Bewegung sein soll (Siegfried, S. 153). Spann gilt in der Analyse der Arbeiterzeitung bereits 1925 als der intellektuelle Führer des Hakenkreuzlertums an der Wiener Universität, er tritt der NSDAP bei und erhält eine geheime, nicht nummerierte Mitgliedskarte (ebd.). Die Schulungsabende des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes finden in den Räumen seines Seminars statt, der Unterricht wird vom Spann-Schüler Franz Seuchter gestaltet (Siegfried, S. 153f.). In einem 1933 veröffentlichten Aufsatz bietet Spann nun dem Nationalsozialismus seine universalistische Gesellschaftslehre als ideologische Grundlage des notwendigen ständischen Aufbaus dar (Zit. nach Siegfried, S. 156f.): Sein Bemühen wird von Repräsentanten der Schwerindustrie, besonders Thyssen, honoriert, der die Idee die Vertretungen der ArbeiterInnen in die Industrieverbände einzugliedern reizvoll findet und für die dahingehende Überzeugungsarbeit die Gründung eines Instituts für Ständewesen (in Düsseldorf) unterstützt. Die wissenschaftliche Leitung des am 23. Juni 1933 feierlich eröffneten Instituts übernimmt Walter Heinrich, weitere Vertreter des Spann-Kreises (Andrae, Riehl, Paul Karrenbrock) werden aktiv (Siegfried, S. 175f). Der wiederholte Ruf nach "ständischer Selbstverwaltung" läuft den Interessen und Machtpositionen der Stahlindustriellen zuwider, Unterstützungen für die Zeitschrift Ständisches Leben werden 1935 eingestellt, eine Kontroverse mit der Führung der Deutschen Arbeitsfront (DAF) führt 1936 zum Ende der Propagandatätigkeit des Spann-Kreises am Institut für Ständewesen (Siegfried, S. 186f. und 195). Spanns Ablehnung der NS-Rassentheorie trug neben seinen politischen Fehleinschätzungen zu den Disharmonien bei. Der Begriff der Nation wird in der universalistischen Gesellschaftslehre kulturell definiert, eine "geistige Gemeinschaft", die antisemitische Diskriminierung ermöglicht, nicht erfordert (Siegfried, S. 201f). Ab 1935 werden die Antagonismen der beiden faschistischen Konzeptionen in zahlreichen Zeitungsbeiträgen offensiv ausgetragen, nach der Annexion Österreichs werden Othmar Spann, Rafael Spann und Walter Heinrich verhaftet. Das daraus gebildete Konstrukt einer vorzeitigen Abkehr konservativer Kräfte vom Nationalsozialismus ohne jegliche Reflexion ihrer Funktion in der Phase der Konstituierung eröffnet rechten Parteien und Einzelpersonen die Verherrlichung bewunderter und geliebter Meister und in diesem Sinne die Relativierung des Nazisystems. Die Lehre von der Ganzheit diente der Zerschlagung demokratisch verfasster Gesellschaften, dass sie zum Dienst und nicht zur Herrschaft gelangte, liegt an den realen Kräfteverhältnissen und auch am dürftigen Angebot, das Zufriedenheit in Unterdrückungsverhältnissen fordert im Tausch gegen "Beruhigung". Die perpetuierte Distribution des Modells liegt gleichsam am Puls der Zeit, ebenso wie ein Dollfußportrait im Parlamentsbüro Khols, Wirtschafts- und Arbeitsminister Bartenstein, die ÖVP Frauenpolitik und Schwester Herbert. 1 Spann, Othmar [1931]: Der wahre Staat. Vorlesungen über Abbruch und Neubau der Gesellschaft. Jena: Fischer, S. 175. → zurück 2 Vgl., Siegfried, Klaus-Jörg [1974]: Universalismus und Faschismus. Das Gesellschaftsbild Othmar Spanns. Wien: Europa Verlag, S. 72. → zurück 3 Zit. nach Pichler, J. H. (Hrsg.)[1988]: Othmar Spann oder die Welt als Ganzes. Wien/Köln/Graz: Böhlau, S. 26ff. Dieses Werk ist Walter Heinrich posthum zugeeignet. → zurück 4 Vgl., Pichler, J. H. [1992]: Betrachtungen zum Vaterunser. Im Gedenken des 90. Geburtstages von Walter Heinrich. Zeitschrift für Ganzheitsforschung, 36. Jg., IV/1992. → zurück 5 http://motlc.wiesenthal.com/text/x29/xm2933.html → zurück 6 Roman in autobiographischer Form, in welchem er die 131 Fragen der Entnazifizierungsbehörden dokumentieren und ad absurdum führen möchte. 1951 publiziert wurde das 800 Seiten Werk zum ersten Bestseller der BRD. → zurück 7 von Salomon, Ernst [1969]: Der Fragebogen. Reinbek bei Hamburg, S. 172. → zurück 8 Vgl. Pichler, J. Hanns [1990]: Woran könnte der Osten sich halten? Ganzheitliche Staatsidee und Wirtschaftsordnung als ein Programm der Mitte. Wiss. Arbeitskreis, Institut für Gewerbeforschung, Wien (Vortrag). ders., [1993]: Ganzheitliches Verfahren in seinem universalistisch überhöhenden Anspruch. In: Klein, H. D./Reikersdorfer, J. (Hrsg.): Philosophia perennis. Erich Heintel zum 80. Geburtstag, Teil 1, Frankfurt/Main, Berlin, Bern, New-York, Wien. → zurück 9 ders., [1999]: Europa und das Europäische. Auf der Suchen nach seiner 'Begrifflichkeit' von der Antike bis zur Neuzeit. In: Berchthold, J./Simhandl, F. (Hrsg.) [1999]: Freiheit und Verantwortung. Europa an der Jahrtausendwende. Jahrbuch für politische Erneuerung. Wien: Freiheitliche Akademie. → zurück 10 Vgl. http://www.trend.partisan.net/trd1298/t351298.html → zurück 11 Vgl. Meyer, Thomas [1997]: Stand und Klasse. Kontinuitätsgeschichte korporativer Staatskonzeptionen im deutschen Konservativismus. Opladen: Westdeutscher Verlag. → zurück 12 Vgl. Schneller, Martin [1970]: Zwischen Romantik und Faschismus. Der Beitrag Othmar Spanns zum Konservativismus in der Weimarer Republik. Stuttgart: Klett. → zurück 13 Resele, Gertraud [2001]: Othmar Spanns Ständestaatskonzeption und politisches Wirken. Wien (Diplomarbeit). → zurück 14 Vgl. Fischer, Kurt R./Wimmer, Franz M. (Hrsg.) [1993]: Der geistige Anschluß. Philosophie und Politik an der Universität Wien 1930-1950. Wien: WUV. Heiß, Gernot/Mattl, Siegfried/Meissl, Sebastian/Sauer, Edith, Stuhlpfarrer, Karl (Hrsg.Innen) [1989]: Willfährige Wissenschaft. Die Universität Wien 1938-1945. Wien: Verlag für Gesellschaftskritik. → zurück 15 Einer der deutschsprachigen Epigonen ist der eifrige Rezensent der Zeitschrift für Ganzheitsforschung Gerd-Klaus Kaltenbrunner, der ebenso im rechtsextremen Criticon (hrsg. von Caspar von Schrenck-Notzing), Sieg oder Aula, Publikation der "Arbeitsgemeinschaft Freiheitlicher Akademikerverbände Österreichs" publiziert. Ein weiterer regelmäßiger Autor der Zeitschrift für Ganzheitsforschung ist der katholische Antisemit Friedrich Romig, früher Europa-Beauftragter Kurt Krenns (Vgl. www.doew.at Neues von ganz rechts - April 2000), der seine antidemokratische Überzeugung gerne hinter ökologischen Bedenken verbirgt (Vgl. Zeitschrift für Ganzheitsforschung 2 (1997), S. 71-86). → zurück |
00:05 Publié dans Droit / Constitutions, Economie, Philosophie, Révolution conservatrice, Théorie politique | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : autriche, mitteleuropa, europe centrale, économie, droit, théorie politique, politologie, sciences politiques, philosophie, révolution conservatrice, othmar spann |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
samedi, 16 mars 2013
Finanzkapitalistische Raumrevolution

Finanzkapitalistische
Raumrevolution
Ein Anfall
Im Haushaltsausschuss des Bundestages verlor Finanzminister Schäuble in den letzten Novembertagen 2012 jeden Anstand. In Brüssel und in Paris hatte er sich darauf eingelassen, dass die Bundesrepublik erneut Milliardenbeträge nach Griechenland pumpen würde, um dort den Staatsbankrott zu vermeiden. Das überschuldete Griechenland, ein Mafiastaat, der jede moderne Verwaltung und Aufsicht vermissen liess, eine Gesellschaft, unterentwickelt, ohne produktive Industrie und Landwirtschaft, strategischer Militärstützpunkt der NATO, heruntergekommerner Tourismusort, unterschied sich vom technologisch und industriell hochgerüsteten Zentraleuropa grundsätzlich. Hinzu kam, dass die vergangenen Militärdiktaturen und eine von der Mafia gesteuerte „Demokratisierung“ vermieden, den Sozial- und Militärstaat mit einer modernen Steuergesetzgebung und rationalen Bürokratie zu verbinden. Die Kontrollen durch das Parlament blieben mangelhaft. Selbst die europäischen Auflagen und Rechtsdirektiven wurden missachtet. Ein aufgeblasener Apparat diente als Selbstbedienungsladen der Staatsangestellten, der Spekulanten und des organisierten Verbrechens. Der Parasitismus der unterschiedlichen sozialen Schichten wurde sogar noch gefördert und die EU Zuschüsse grosszügig verteilt. Gewinne und Profite wurden nicht registriert und versteuert und eine masslose Verschuldung eingeleitet. Sie wurden über landeseigene und internationale Privat- und Kreditbanken, Hedgfonds und über die europäische Umverteilungen finanziert. Alle lebten in Saus und Braus.
In Griechenland wurden zu hohe Renten und Löhne gezahlt und zugleich riesige Gewinne realisiert. Sie wurden nicht erwirtschaftet, sondern über Kredite und Schulden aufgebracht. Nach den Gesichtpunkten der industriellen Durchschnittsproduktivität und nach dem Zustand von Staat und Recht, lag Griechenland irgendwo in Nordafrika. Dieser Kontinent hatte, bezogen auf Technologie, Arbeitsteilung, Produktion, Verkehr, Recht, Verwaltung, Lug und Trug den Balkan, Süditalien, Südspanien und Portugal erreicht. Der Überbau von Staat und Politik als ein Gebilde aus Korruption, Parasitismus, Vetternwirtschaft, Plünderung hatte mit Zentraleuropa nichts gemeinsam. Riesensummen wurden aus diesen Industriestaaten in das europäische „Afrika“ transferiert. Von dort wurden sie als billige Beute von den reichen und einflussreichen Familien in die Schweiz auf Geheimkonten gebracht oder an die nordamerikanischen Spekulanten weitergereicht. Sie hatten den griechischen Staat mit Krediten ausgeholfen. Die griechischen Regierungen verfälschten in der Vergangenheit die Bilanzen und den Stand der Verschuldung, um in das „Paradies“ der Europäische Union zu gelangen. Die deutschen Steuerzahler finanzierten dadurch die griechischen Betrüger und Absahner oder die nordamerikanischen Kredithaie. Ein grosser Rest wurden an die überbezahlten Staatsangestellten und Rentner bezahlt, um sie ruhig zu stellen und dem System eine demokratische Legitimation zu geben. Kein Wunder, dass in einem derartigen Milieu der Spiritualismus gedieh. Die faschistische „Morgenröte“ pendelte sich zu einer starken Partei auf. Die deutschen Steuerzahler leistete sich den Luxus, einen kranken und maroden Staat zu unterstützen, der unbedingt zu Europa gehören sollte. Diese Entscheidung wurde jedoch in USA gefällt.
Geostrategisch bildete Griechenland für diese Militärmacht einen Flugzeugträger, einen Militärstützpunkt und hielt die Meerenge der Dardanellen nach Russland unter Aufsicht. Griechenland stellte die Verbindung zur Türkei her und bildete die Brücke in den Nahen Osten. Es konnte mit dem albanischen Kosovo und Kroatien verbunden werden, die durch die amerikanischen Bombardements Serbien entrissen wurden. Es hielt die Verbindung nach Bulgarien und Rumänien, die unter nordamerikanischen Einfluss gestellt werden sollten. Griechenland schuf die Garantien für ein europäisches Mittelmeer. Es bildete eine Voraussetzung für ein „Grossisrael“, das sich gegen die arabischen Anreinerstaaten behaupten musste. Nordafrika oder die Nahoststaaten sollten militärisch und politisch dem Einfluss des islamischen Fundamentalismus entwunden werden. Sie sollten wie der Irak und Syrien einer Neuordnung unterliegen. Der zukünftige Krieg gegen den Iran benötigte die geostrategische Position Griechenlands und die finanzielle Unterstützung Deutschlands. Dieser deutsche Staat wurde von den USA angewiesen, das südeuropäische „Afrika“ und Israel zu stabilisieren. Es wurde zugleich darauf vorbereitet, in der Zukunft den Bestand der Mafiastaaten Bulgarien und Rumäniens zu gewährleisten. Frankreich entzog sich der Verpflichtung und geriet selbst in eine Finanzkrise. Deutschland sollte den geldpolitischen Hintergrund für ein „nordamerikanisches Europa“ bilden, das sich gegen Russland, gegen China und den Iran in Front brachte. Die Hauptabsatzmärkte der deutschen Wirtschaft lagen in diesen „feindlichen Regionen“ und im Gegensatz zu dem Aufmarsch wäre eine friedliche Koexistenz mit diesen Ländern notwendig. Deutschland als Wirtschaftsmacht und Griechenland als machtpolitischer Dominostein bildeten eine erzwungene Einheit. Den Deutschen wurde ein neues „Versailles“ aufgedrängt, an dem es kaputt gehen konnte. Das konnte Schäubele alles wissen. Er konnte sich den Auflagen und Befehlen der NATO und der USA schwer entwinden. Er fühlte sich inzwischen als Vertrauensmann dieser Mächte. Er hatte Schwierigkeiten, sich diesen Manipulationen zu entziehen. Die Frage stand im Raum, wie lange er diese Rolle aufrechterhalten wollte?
Der Finanzminister war innerlich erregt, denn er konnte nicht begründen, warum er der deutschen Republik derartige Zahlungen zumutete. Ihm fehlte jedes plausible Argument. Also schrie und pöbelte er. Jetzt im Ausschuss, Ende November, kommentiert durch FAZ, FR und FTD, fühlte er sich von der Linksabgeordneten Pau angegriffen und er wehrte sich gegen den SPD – Hinterbänkler aus Hamburg, der nicht einmal wusste, worum es ging, sondern für Würde und Anstand sorgen wollte. Schäubele brüllte über zehn Minuten in den Saal hinein und gab zu erkennen, dass er die Übersicht verloren hatte. Er ahnte wohl, dass die europäische Krise wie in Argentinien 2001 in einem Staatsbankrott enden konnte. Er wusste, dass er deutsche Interessen kaum noch wahrnahm. Er konnte auch die Tatsache nicht verdrängen, dass er die Ziele der NATO, der EU und der USA bediente und dadurch die staatliche Souveränität Deutschlands unterminierte. Seit Ende der achtziger Jahre hatte er sich in der Regierung Kohl als ein Mann der „Kompromisse“ bewährt. Jetzt steuerte er die Finanzpolitik der Regierung von Angela Merkel und würde den Wohlstand der Mittelklassen in Deutschland riskieren und die Armut der millionenfachen Habenichtse in dieser Gesellschaft vergrössern. Die Zahlungen an Griechenland würden die Inflation und die Steuern steigern. Er wusste, dass Europa sich auf einen Krieg zubewegte. Sehr bald musste die Bundesregierung den Einsatz deutscher Soldaten in der Türkei, in Syrien, Ägypten und im Iran rechtfertigen. Schräuble schrie seine masslose Wut heraus, denn sein unbedachtes Spiel wurde offenkundig.
Planspiele
Listen wir die einzelnen Massnahmen auf. An die wirtschaftliche Konsolidierung der südeuropäischen Staaten durch eine gezielte Entwicklungspolitik wurde in Brüssel und Berlin nie gedacht. Statt die Riesensummen für die Spekulanten, die Absahner und die Mafia zu vergeuden, wäre es durchaus sinnvoll gewesen, den Ausbau der Infrastruktur dieser Länder zu finanzieren, um eine industrielle Grundlage zu schaffen. Allerdings hätten die EU – Institutionen die Kontrolle der Investitionen übernehmen müssen, um den korrupten Poltikern der Zugriff zu entziehen. Statt Israel mit Atom- U – booten auszurüsten und Militärausgaben zu übernehmen, hätte Deutschland die israelische Wirtschaft stabilisieren können, um einen Friedensprozess des Ausgleichs gegen die Kriegspropheten in diesem Land einzuleiten. Derartig Visionen durften nicht einmal erwähnt werden. Jede rationale Politik wurde von EU und NATO verworfen. Stattdessen einigten sich der griechische Staat und die Europäische Zentralbank darauf, die finanziellen Griechenlandhilfen, von denen Deutschland den Anteil von etwa 70% aufbrachte, zu einem „Schuldenschnitt“ zu nutzen. Die Schuldenagentur in Athen legte Rückkaufwerte für die ausstehenden Staatsanleihen für „private Investoren“ fest. Sie erreichten einen höheren „Preis“, als von den griechischen und nordamerikanischen Investoren erwartet worden war. Der „Internationale Währungsfonds“ (IWF) sollte ruhig gestellt werden. Zugleich wurde es wichtig, die Verluste der Anleihen zu begrenzen und die Inhaber zu veranlassen, die Papiere zu einem nicht erwarteten Wert zurückzugeben. Der „Umtausch“ bzw. der „Rückkauf“ der Staatsanleihen durch die staatliche Agentur wurde mit Hilfe des europäischen und deutschen Hilfsgeldes attraktiv gestaltet, um die Gläubiger zu veranlassen, die fälligen Staatsschulden abzugeben. Der griechische Staat sollte dadurch einen Anfang gestalten, die riesigen Schulden zu tilgen.
Der internationale Anleihenmarkt reagierte mit einem Kurssprung der griechischen Staatspapiere. Sie stiegen von 4.31 Punkten auf 40.06 Zählern. Sogar der Euro konnte im Kurs gegenüber dem Dollar zulegen und stabilisierte seinen Kurswert, weil die Griechen zu einem nicht erwarteten Teilpreis die „Privatschulden“ bezahlten. Die Regierung in Athen verfolgt den Plan, mit Mitteln des Euro – Rettungsfonds (ESFS) die von Privatinvestoren oder Fondsgesellschaften gehaltenen Anleihen im Umfang von 10 Milliarden Euro zurückzukaufen. Es handelt sich um Papiere, die Griechenland im Frühjahr 2012 im Verfahren einer Umschuldung aufgelegt hatte. Der Rückkauf soll die Schulden, da der Preis zum Ursprungswert halbiert wurde, um rund 20 Milliarden Euro senken. Etwa Eindrittel der von Privatbanken gehaltenen Schulden wären durch diesen Rückkauf beglichen. Den Grossteil der griechischen Schulden, ein paar 100 Milliarden Euro, halten die Europäische Zentralbank, der Internationale Währungsfonds (IWF) und einzelne europäische Staaten. Die genaue Höhe dieser Werte fand bisher keine „öffentliche Zahl“. Gehen die Privatbanken auf dieses angebotene Geschäft des Rückkaufes ein, gibt es einen Wegweiser für die Freigabe der seit Juni „eingefrorenen“ Hilfsgelder. Die Entschuldung Griechenlands könnte langfristig über einen geregelten Rückkauf, über Staatsverträge und über den notwendigen Umbau des Sozial- und Steuerstaates angegangen werden.
Der vorsichtige Anleihenrückkauf verfolgt das Ziel, bis 2020 die Verschuldung auf 124% des Bruttoinlandsprodukts zu senken. Ohne derartige Massnahmen würden die Schulden Griechenlands „explodieren“ und den Staat in den Bankrott treiben. Ein derartiger Staatspleite würde das Land unregierbar machen, denn Teile der Betriebe der Dienstleistung, der Verwaltung, der Kommunen, der Staatswirtschaft würden schliessen müssen und zugleich die anderen „Südstaaten“ der EU in den Strudel der Staatspleiten reissen. Massenstreiks und soziale Unruhen waren zu erwarten. 2014 hätten die Schulden fast 200% des skizzierten Inlandsprodukts erreicht. Der Schuldenrückkauf musste deshalb sicherstellen, dass die Privatinvestoren auf das Geschäft eingehen und sich verpflichten, die angebotene Teilsumme zu akzeptieren. Die Staats- und staatlichen EU – Bankschulden wurden über Staatsverträge geregelt, an die sich die privaten „Spekulanten“ nicht halten mussten. Sie konnten internationale Gerichtshöfe anrufen, ihr Geld einklagen und den Schuldnerstaat in die Pleite jagen. Das passierte 2001 in Argentinien. 2012 wurde der Staatsbankrott des südamerikanischen Staates nicht abgewendet, denn die einzelnen Privatfonds bestanden auf der Zahlung des „gesamten Preises“ der Schulden. Die Konstruktion des Schuldenrückkauf war auch für Griechenland schwierig und der Staat musste eine „wacklige Normalität“ organisieren. Das komplizierte „Kartenhaus“ konnte schnell zusammenstürzen.
Die Entschuldung Griechenlands kannte drei Phasen. Zuerst mussten die Privatkunden, privaten Banken und Spekulanten in die Massnahmen eingebunden werden. Danach regelten Staatsverträge und Abmachungen den Rückkauf der Schulden von den Staatsbanken und Einzelstaaten. Unter Umständen wurde die Summe der Schulden Griechenland erlassen, falls nicht die anderen Schuldnerstaaten wie Spanien, Portugal, Italien, Irland u. a. die gleichen Bedingungen „einklagen“ würden. Der Schuldenrückkauf lief deshalb in der Form einer „Auktion“, um die Stimmungen und Interessen auf dem „Schuldenmarkt“ zu testen. Die Investoren und Gläubiger mussten ihre Preisvorstellungen offenlegen. Danach wurde von der Staatsagentur das Kaufangebot unterbreitet. Griechenland bot seinen Gläubigern je nach Laufzeit der Anleihe zwischen 30,2% und 38,1% des Nennwerts der jeweiligen Staatsanleihe. Den Zuschlag erhalten die Höchstgebote, die zwischen 32% und 40% liegen konnten. Auf dem freien Markt war lediglich mit einer Offerte zwischen 20% und 30% zu rechnen. Für einen begrenzten Zeitraum konnten die Spekulanten mit einem Zuschlag von etwa 10% rechnen. Sie hatten oft die Papiere auf dem niedrigen Stand von ca. 8% des Kurswerts gekauft und verdienten so nebenbei ein paar hundert Millionen Euro, denn Deutschland hatte nun zugesagt, weiterhin für die Schulden Griechenlands aufzukommen. Stimmten sie zu und schalteten nicht die internationalen Gerichtshöfe ein, konnte die zweite und dritte Phase eingeleitet werden. Nicht nur der deutsche Finanzminister zeigte sich nervös. Alles hing an einem „seidenen Faden“.
In Argentinien war 2001 eine derartige Planung gescheitert, die nordamerikanischen Spekulanten und die unterschiedlichen Staatsbanken unter einen „Hut“ zu bringen. Der Staatsbankrott zerstörten den argentinischen Mittelstand, der in Bezug auf Bildung, Dienstleistung, Sicherheit, Gesundheit, Fürsorge, Erziehung usw. vom Staat anhängig war und auf die Strasse gesetzt wurde. Dieser Mittelstand hatte die Elektro-, Mode-, Computer-, Nahrungsmittel-, Bau- und Autoindustrie „gefüttert“ und diese Branchen durch die Arbeitslosigkeit und Pleiten in den Ruin getrieben. Die Immoblienpreise zerfielen. Die Hedgefonds hatten sich am Spiel der „Entschuldung“ nicht beteiligt. Bis heute wird das ausländische Kapital angeklagt, Argentinien in den Abgrund zu treiben. Der Populismus von Cristina Kirchner bekam Auftrieb und aktualisierte den antiimperialistischen Kampf. Vor allem der Hedgefonds Eliot Capital und Aurelius Capital und der Internationale Währungsfonds (IWF) verklagten den argentinischen Staat auf die Zahlung von 1,5 Milliarden Dollar. Sie erhielten 2012 vor dem amerikanischen Gerichtshof Recht. Bereits Ende 2005 beglich Argentinien die Schulden beim IWF, bevor die anderen Gläubiger abgefunden wurden. Der IWF hatte 2001 einen Kredit zurückgehalten und den Staatsbankrott ausgelöst. Argentinien pocht heute auf Souveränität und ist bemüht, den Einfluss des internationalen Finanzkapitals zurückzudrängen, um so etwas wie „Souveränität“ zu erlangen. Die genannten Hedgefonds beteiligten sich nicht am „Schuldenschnitt“. Sie klagten vor dem US – Gericht auf Gleichbehandlung. Die Klage wurde in der ersten Instanz anerkannt. Muss Argentinien zahlen, wäre ein zweiter Staatsbankrott angesagt. Dieses Beispiel beweist, dass der Prozess und die Phasen der Entschuldung eine weitere Komplikation enthalten, ziehen die Spekulanten nicht mit. Sie verfolgen andere Ziele als die Staaten und sind primär an hohen Gewinnen und an der Sicherung der Rohstoffe, Ländereien und Immobilien interessiert. Sie setzen wie in Südeuropa auf Krieg, um die „Landmächte“ Iran, Russland und China zu entmachten. Die „Logik“ ihrer Spekulation ist schwer zu durchschauen. In Nordamerika und in Europa begründeten sie eine Doppelmacht zum Präsidenten oder zu den Staaten der EU, da eine Bankkontrolle fehlte bzw. zu Beginn der neunziger Jahre abgeschafft wurde. Die neuen Rohstoffe, Industrien und Immobilien in Osteuropa, Russland und Afrika sollten gesichert werden.
Die griechische Staatsanwaltschaft demonstrierte der europäischen Öffentlichkeit nach der letzten Zahlung der Hilfsgelder, was die griechischen Spekulanten mit dem leicht verdienten Geld aus der EU anfingen. Die Staatsanwaltschaft untersuchte Vorwürfe gegen knapp 2000 Griechen, die Bankkonten bei der Genfer Filiale der britischen Grossbank HSBC eingerichtet hatten. Ihnen wird Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Finanzbetrug vorgeworfen. Illustre Namen aus Politik, Bankgeschäft und Mafia sind auf der Liste der Betrüger zu finden. Sie belegen Verbindungen, die vorher nicht einmal vermutet wurden. Mit dem Namen von Magret Papandreou tauchten Hinweise auf die Spitzen der politischen Elite auf. Sie lenkten auf raffinierte Weise Zahlungen aus der EU auf ihre Konten, überwiesen die Summen auf Schweizer, britische oder nordamerikanische Banken und kauften mit diesem Geld etwa in Berlin, München oder Frankfurt/ Main Immobilien, Mietshäuser, Grundstücke und landwirtschaftliche Nutzflächen. Die einzelnen Wohnungen wurden mit „Eigenbedarf“ belegt, verkauft und die Mieter vertrieben. Das Geld kam also nach Deutschland zurück und wurde in „sichere Anlagen“ investiert, weil Zentraleuropa für die Spekulanten eine gute Adresse war. Zugleich wurden die deutschen Steuerzahler, die die Zahlungen nach Griechenland aufbrachten und soweit die Wohnhäuser von den neuen griechischen Hausbesitzern „besetzt“ wurden, aus ihren Wohnungen gejagt.
Die griechische Staatsanwaltschaft deckte diese Machenschaften auf, um den Gremien der EU und Deutschlands die europäische Normalität des Rechtsstaates in Griechenland zu signalisieren, falls weiterhin die Unterstützungsgelder flossen. Sie brachten „Bauernopfer“, ohne den Kreislauf oder den Geldtransfer kaschieren zu wollen. Das europäische Geld wurde teilweise in Griechenland abgezweigt und landete auf den Konten in der Schweiz. Von dort wurde das Geld zum Immobilien- und Landkauf in Europa eingesetzt oder wurde genutzt, Ländereien oder Wälder in West- oder Ostafrika zu erwerben. Das „Holz“ wurde geschlagen und die Wälder gerodet. Anschliessend wurden riesige Soya-, Mais- oder Zuckerrohrfarmen errichtet, um aus diesen genmanipulierten Naturrohstoffen Biogas oder Bioöl herzustellen, das in Europa teuer zu Weltmarktpreisen verkauft wurde. Die afrikanischen Bauern wurden vertrieben und schlugen sich nicht selten als Flüchtlinge nach Europa durch. Allein an diesem Beispiel lässt sich die „negative Funktion“ der Finanzspekulation und des Finanzkapitals aufzeigen. Die Zerstörung aller „Produktivkräfte“ enthielt keinerlei Schaffenskraft oder eine Zielsetzung, die Weltgesellschaften zu stabilisieren. Falls die Regierungen der Zerstörungswut und der Raffgier dieses Kapitals keinen Einhalt boten, würde es über den Weltmarkt Not und Elend tragen. Die enge Kooperation der Spekulanten mit den Ganoven der Mafia und der politischen Eliten, die die griechische Staatsanwaltschaft aufgedeckt hatte, entwarf ein erstes „Gesicht“ dieses Kapitals, das keinerlei Moral oder Verantwortungsethik kannte. Erstaunt waren die Berichterstatter der Zeitungen, dass die Parteien des Bundestages, etwa die Grüne Partei und die CDU zu fast 100% der Griechenlandhilfe zustimmten. War die Erwartung einer zukünftigen „Koalition“ so gross, dass diese Parteien die aktuelle „Raumrevolution“ des Finanzkapitals nicht zur Kenntnis nahmen und sich diesen Manipulationen auslieferten? Würde ein Verteidigungsminister Trittin, deutsche Soldaten in die Türkei und in den Iran schicken? Gab es keinen „Karl Liebknecht“ bei den grünen Aufsteigern? Wurde die ganze Biographie dieser Poitiker für einen Staatsjob riskiert?
Fragen des Weltmarktes
Wieso konnte Afrika in Gestalt der Misswirtschaft, der niedrigen Arbeitsproduktivität, der Arbeitslosigkeit, der Überbevölkerung, der Verschuldung nach Südeuropa hineinragen? Warum wurde Russland „asiatisiert“? Wie konnte es passieren, das Afrika, Asien und Lateinamerika sich in den nordamerikanischen Kontinent eingruben? Die Kriterien sollen entschlüsselt werden in der je spezifischen Form des Kapitalismus der einzelnen Gesellschaften und Regionen. Die Übersetzung der technologischen Revolutionen in die Produktivität der Industrie und in den rationalen Aufbau von Staat, Recht und Verwaltung bestimmen ein weiteres Thema. Berücksichtigt werden soll das Ausmass der Konzentration und Zentralisation der Produktion, der Banken und des Handels. Die Machtpolitik der Kapitalfraktionen, vor allem des Finanz- und Medienkapitals und der politischen Klasse, bildet einen anderen Gesichtspunkt. Die Kriegs- und Rüstungswirtschaft, gekoppelt mit den unterschiedlichen Ansätzen von Diktatur, mit der Neudefinition der Klassen und Völker und mit den politischen Bündnissen der einzelnen Eliten, umreissen einen weiteren Masstab der kapitalistischen Durchdringung der einzelnen Kulturen und Erdteile. Wichtig bleibt in diesem Zusammenhang von Machtpolitik und Imperialismus die Disposition der Ideologie und die Umsetzung in Propaganda, Reklame und politische Religion. Der Okkultismus der herrschenden Cliquen gewinnt an Bedeutung, denn sie reagieren auf eine wachsende Rationalität von Organisation und Planung, auf die Unregierbarkeit von „Massen“, die durch Automation und Denkmaschinen aus Arbeit und „Brot“ gedrängt werden. Die herrschenden Machteliten verbergen über rassische, religiöse oder völkische Mythologien die Potentialitäten der sozialen Frage und der „Freiheit“. Sie begründen über Verschwörungen und parapsychologische Phantasmen den Führungsanspruch. Im Angesicht einer technisch begründeten Produktionsordnung radikalisieren die Spekulanten und Ideologen den Irrationalismus und zerren die Neuzeit zurück in das dunkle Mittelalter. Wie lassen sich nun derartige Differenzen und die Formen von Machtpolitik skizzieren?
1. Differente Akkumulationsbedingungen des Kapitals im Weltmaßstab: Entscheidend für die potentielle Einheit und für den hierarchischen Aufbau des Weltmarktes sind und waren die unterschiedlichen Akkumulationsbedingungen des Kapitals. Marx und Engels skizzierten bereits die unterschiedlichen Formen einer ursprünglichen Akkumulation des Kapitals in England, Frankreich, Preussen, Russland und Nordamerika. England wies die klassische Form des Kolonialismus, der Vertreibung, des Handels, des Manufakturkapitals, der „industriellen Revolution“ und der Proletarisierung der eigentumslosen Bauern und Städter auf. Frankreich und USA kannten neben dem Staat die Unterstützung des Finanzkapitals, das jeweils die Kredite für die industrielle Akkumulation zur Verfügung stellte. Die Rüstungswirtschaft und der Aufbau einer modernen Armee und Flotte wurden Motor einer technologischen „Revolution“, die sich an den neusten Waffensystemen orientierte. Die staatlichen Investitionen wurden durch Kredite unterstützt, die das Finanzkapital zur Verfügung stellte. Es favorisierte die Herausbildung der Monopole, der Trust und Syndikate, um die organisatorische und wertmässige Konzentration der Produktion durch eine Zentralisation der „Produktivkräfte“ zu steigern, die eine bessere Arbeitsteilung und eine enge Kooperation der Betriebe und Regionen ermöglichten. Preussen bereits übersetzte über Staat und Armee die technologischen und industriellen Errungenschaften des „Westens“ in Reformen und in eine staatskapitalistische Kriegswirtschaft, die auf der Privatwirtschaft fusste, zugleich jedoch die Erfindungen und Entdeckungen, die Forschung materiell und produktiv in der Rüstung umsetzte. Die Mischformen staatlicher und privater Initiativen wurden bedeutsam. Diese wiederum beeinflusste die zivile Produktion. Über eine weitgefächerte Bildung der Berufs- und Ingenieursschulen und über das System der Forschungsstätten, der Naturwissenschaften und technischen Universitäten wurde ein Mittelstand geschaffen, der als Unternehmer, Forschungsintelligenz, Management, Verwaltungsspezialist, Offizier die Effiziens und die Breite der industriellen Produktion in Gross- und Kleinbetrieben förderte. Über diese technologische und bildungspolitische Kooperation manifestierten sich politische Bündnisse zwischen den Facharbeitern und Ingenieuren, Gewerkschaften und Unternehmern, Parteien und Armee. Die Kriegswirtschaft als staatskapitalistisches Unternehmen bewährte sich nach 1945 als eine enge Zusammenarbeit der gesellschaftlichen Kräfte. So „gewann“ das westliche Deutschland in den fünfziger Jahren durch ein „Wirtschaftswunder“ nachträglich den II. Weltkrieg.
2. Staatskapitalistische Erweiterung der kapitalistischen Industrialisierung: In Russland und USA wurde dieses „preussische Modell“ (Stolypin nach 1905, New Deal nach 1934) übernommen, wirkte jedoch unterschiedlich. Russland wollte den preussischen Reform- und Militärstaat übertragen, scheiterte jedoch an der Schwäche der Staatseliten und des russischen Industriekapitals. Die Arbeiterklasse als legale Gewerkschaft konnte sich nicht formieren. Die bolschewistische Diktatur errichtete nach 1917 einen Kriegskommunismus, der primär über Terror und Zwang die industrielle Akkumulation umsetzte. Zugleich wurden die Klassen und Völker über die Staatsdespotie und die Zwangsarbeit umdefiniert in „werktätige Massen“. Die Rüstung stand im Mittelpunkt, erlangte jedoch nie die Produktivität des westlichen Kapitalismus und konnte nur bedingt auf die zivile Produktion übertragen werden. Trotz einer Bildungsreform fehlten in einer Mangelwirtschaft die produktiven Facharbeiter und Ingenieure. In einem Zwangssystem verpasste die Propaganda und die politische Ideologie die Erziehung selbstbewusster und produktiver Arbeitskräfte. Bis 1989 konnte die Diktatur über Polizei- und Militärgewalt das russische Imperium bewahren, das danach unter den Schlägen des westlichen Kapitalismus sehr schnell zusammenbrach. Die russische Macht, eingeklemmt in den Methoden von Staatskapitalismus, Planwirtschaft, despotischer Präsidialmacht und Privatkapital, hatte Probleme die innere Konsistenz gegen die vielen Völker und nationalen Märkte zu behaupten. Der Präsident Putin nahm deshalb die Ziele der bolschewistischen Expansion erneut auf, um sich gegen das US – Finanzkapital behaupten zu können, das an den Rohstoffen und an den Zerfall Russlands in Einzelrepubliken interessiert ist.
3. Finanzkapitalistische Formen der Konzentration und Zentralisation des Kapitals: In USA sorgte das Finanzkapital für die wirtschaftpolitische Besonderung und „Funktion“ der Monopole und Syndikate, die durch Armee und Flotte unterstützt und durch die Präsidialmacht finanziert und kontrolliert wurden. Schon deshalb erlangte hier das Finanzkapital den Zuschnitt einer Doppelmacht, die Einfluss nahm auf die „Politik“ und die Medien und ausserhalb der Verfassung innen- und aussenpolitische Ziele verfolgte. Es sicherte sich den Zugriff auf die Weltrohstoffen und forderte die Unterstützung von Armee und Flotte. Es konkurierte mit dem europäischen und asiatischen Imperialismus und übernahm sehr bald die Erbschaft des spanischen, portugiesischen, französischen und englischen Imperialismus. Der dreissigjährige Krieg mit Deutschland und Japan nach 1914 liess sich nicht vermeiden. Der Sieg über Japan und Deutschland machten Russland und China zu den Hauptgegnern. Nicht der amerikanische Präsident propagierte den Mythos von „Feindschaft“ und „Okkupation“, sondern das Finanzkapital folgte hier der Logik von Profit, Macht, Markt und Rohstoffsicherung, kaschierte jedoch diese Ansprüche unter den Handels-, Freiheits- und Menschenrechten. Es sorgte dafür, dass über internationale Verträge und Militärstützpunkte die mediale „Inszenierung“ und Gestaltung der Demokratie und die Herrschaft der Machteliten auf die Einflusszonen übertragen wurden. Neben den russischen und chinesischen „Reichen“ und „Kontinenten“ wurde nach 1918 und vor allem nach 1945 und 1989 ein nordamerikanisches „Imperium“ gefestigt und ausgedehnt.
4. Der chinesische Weg der Industrialisierung: China kombinierte die russische Erfahrung von Staatskapitalismus und Planung mit einer Öffnung zum Weltmarkt und zum westlichen Finanzkapital. Es sicherte vielfach das chinesische Reich über staatliche Grossbetriebe, Zwangsarbeit, Kleinwirtschaft, „Kommunen“, das Primat der “Partei“, Militarisierung der Gesellschaft und Polizeiwillkür. Die Gefahr der Verselbständigung einer „Despotie“ sollte durch die materiellen Anreize eines mittelständischen Privatkapitalismus und der „Konkurrenz“ der staatlichen Grossbetriebe auf dem Weltmarkt aufgebrochen werden. Jedoch nicht die kapitalistischen Investoren oder das private Kapital sollte die Oberhand gewinnen und dem westlichen Finanzkapital Einfluss und Herrschaft gewähren. Der chinesische Staatskapitalismus improvisierte als Staatshandel und Staatsbank die westlichen Methoden der Spekulation und der Kreditvergabe und koppelte diese „Kapitalisierung“ mit einer ökonomischen Politik des privaten Handels, des Mittelstands und der Bauernwirtschaft. Zugleich produzierten die Staatsbetriebe vorerst Ramschprodukte für den Weltmarkt, stellten sich jedoch auf eine Qualitätsarbeit im Auto- und Maschinenbau ein. Ob dieser Kriegskommunismus als Friedenswirtschaft Erfolg haben wird, wird sich zeigen. Eine Rüstungswirtschaft, moderne Armee und Flotte belegen die Ziele eines chinesischen Imperialismus, der seinen Einfluss in Asien und Afrika ausbaut. Hatte Russland Mühe, sich als europäische und asiatische Macht zu konsolidieren, stemmte sich die Volksrepublik China gegen die us-amerikanischen Ansprüche von Weltmacht und Einflusszonen.
5. Mischformen der Industrialisierung: Der asiatische Kontinent weist neben dem japanischen und chinesischen Weg zum Kapitalismus Wirtschaftsexperimente auf, die sich an Europa, die USA, Russland oder das britische Empire orientieren. Die wachsende „Überbevölkerung“ kann durch eine mässig wachsende Wirtschaft nicht absorbiert werden. Sie wandert ab, gefördert durch den Weltmarkt oder durch ein EU – Recht oder illegal, nach Europa, Russland oder Nordamerika. Dadurch entstehen in diesen Gesellschaft „kulturelle Zonen“, die die ursprüngliche, nationale Kultur zersetzen oder zu einem neuen, anderen Zusammenhalt kombinieren.
6. Die Teilmärkte unter dem Druck des Weltmarktes: Der Weltmarkt teilt sich auf in die unterschiedliche Teilmärkte, die zwar der industriellen Produktivität „Rechnung“ tragen und sich den Durchschnittpreisen, Gewinnen und Profiten annähern, trotzdem die Politik und den Staat als Regulator benötigen. Dieser Staatseingriff wird durch das nordamerikanische Finanzkapital in Lateinamerika, Europa, Afrika, Australien, Asien, Russland und China aufgebrochen. Die Sicherung der Weltrohstoffe wird als Ursache der Intervention genannt. Es geht jedoch darum, jede Souveränität und Unabhängigkeit auszulöschen, um über einen Weltmarkt die eigene Ordnung zu sichern, die eine Konkurrenz der kulturellen Werte, der politischen Mächte oder gar des Fremdkapitals nicht dulden kann. Die Sicherung der Macht des Finanzkapitals benötigt den Staat und die Legitimation über eine „parlamentarische Demokratie“, die allerdings den Interessen der Lobbygruppen des Kapitals folgen muss. Diese „Legitimation“ durch die „Massen“ benötigt die mediale Inszenierung von Politik und Wohlbefinden und sie ist auf die Einfluss- und Machtlosigkeit der „Bürger“ und „Wähler“ angewiesen. Schon deshalb werden die Partei- und Staatseliten kontrolliert, „bezahlt“ und „verwaltet“. Derartige Herrschaftsmethoden und Feindbilder gegen Russland, China, den Iran, den Islamismus erfordern die politische, wirtschaftliche und kulturelle Einheit des Imperiums.
7. Die Theorie des staasmonopolistischen Kapitalismus und die Fragen der „Raumrevolution“: Nikolai Bucharin und Eugen Varga begründeten eine Theorie des „Staasmonopolistischen Kapitalismus“ (Stamokap), die von einer doppelten Negation der finanzkapitalistischen Intervention auf Wirtschaft und Staat ausging. Die Existenz der „Sowjetunion“ und der kommunistischen Arbeiterbewegung zwang nach diesem theoretischen Kalkül das Finanzkapital, einen Sozialstaat anzuerkennen und zu fördern und zugleich gegen die kommunistische Herausforderung faschistische oder konterrevolutionäre Parteien oder Formationen zu formieren. Mit Hilfe dieser „konterrevolutionären Kräfte“ wurden Kriege vorbereitet, konnte Georgij Dimitroff auf dem VII. Weltkongress der Kommunistischen Internationale berichten. Ein ausserökonomischer Faktor verlangte neben den Verfassungsrechten die Anerkennung sozialer Rechte im Staatsaufbau. Zugleich fand der „Faschismus“ Unterstützung, um die kommunistischen Ansprüche einzugrenzen und zu überwinden. Wir folgen dagegen der Einschätzung von Karl Marx, Rudolf Hilferding, W. I. Lenin, Rosa Luxemburg, Max Horkheimer und Herbert Marcuse. Die Arbeiten der konservativen Denker um Max Weber, Carl Schmitt und Ernst Forsthoff über die Herrschaftsformen und über den Status von Recht und Verfassung geben weitere Einblicke.
8. Zur Theorie der Doppelmacht: Das Finanzkapital formierte neben dem nationalen Staat eine internationale Doppelmacht. Die Staatsinterventionen bzw. die Methoden des Staatskapitalismus wurden genutzt, eigene Interessen umzusetzen. Die „Inszenierung“ der Demokratie als Parteienherrschaft und als Medienmacht sollte sicherstellen, die politischen Eliten in Abhängigkeit zu bringen und die sozialen Klassen und Interessengruppen zur Anerkennung bestehender Herrschaft zu zwingen. Die Umdefinition der Klassen in Publikum, Konsument, Zuschauer usw. sicherte neben der Subsumtion der politischen Eliten unter die kapitalistischen Interessen die Macht des Finanzkapitals, ohne Widerstand oder Widerworte zu riskieren. Die „Paralyse“ und die „Chaotisierung“ der Gesellschaft, ihre Pauperisierung und Verwahrlosung garantierten die finanzkapitalistische Macht als demokratisch inszenierte Diktatur. Diese Macht wirkte expansiv und empfand jeden Widerspruch als politische Herausforderung, so dass neben dem Sicherheitsstaat der Sozialstaat die Ausmasse eines totalen Staates gewann, ohne allerdings eine offensive „Militarisierung“ und „polizeistaatliche Kontrolle“ der Gesellschaft zu eröffnen. Die Sicherung der Weltrohstoffe und die massive Aufrüstung trugen die Potenzen neuer Kriege. Neue Regionen und Kontinente sollten vom Imperium besetzt werden.
9. Finanzkapitalistische Machtprinzipien und die Zerstörung der kontinentalen Ordnung: das Beispiel Russland. Der Zusammenbruch des russischen Kriegskommunismus Ende der achtziger Jahre hatte viele Ursachen. Die Planwirtschaft verlor die Übersicht über die industriellen und materiellen Ressourcen. Die Hierarchie der politischen und wirtschaftlichen Entscheidungsträger potenzierte einen Bürokratismus, der auf die produktiven und technologischen Veränderungen der industriellen Produktion nicht mehr reagieren konnte. Die Mangelwirtschaft schuf Unzufriedenheit im Volk. Die Arbeitsethik wurde zerstört. Schlamperei, Diebstahl, Gleichgültigkeit und Sabotage gehörten zum Arbeitstag der Ingenieue und Arbeitskräfte. Die ideologische Propaganda verlor jede Resonanz. Die Mangel- und Planwirtschaft gab den russischen Werktätigen „überschüssiges Geld“, das sie nicht ausgeben konnten, weil es nichts zu kaufen gab. Die Korruption zerfrass eine geplante „Reproduktion“ der Wirtschaft. Ein „geheimer Kapitalismus“ breitete sich über den Schwarzmarkt und über die organisierte Kriminalität in der Wirtschaft und in den „Staatsorganen“ aus. Den Rüstungswettstreit zwischen USA und UdSSR musste die russische Diktatur verloren geben. Die Rüstungswirtschaft befruchtete nicht die Konsumindustrie. Sie kostete Riesensummen Rubel. Forschung und Spionage waren schlecht mit der Wirtschaft koordiniert. Armee und Geheimpolizei konnten die Gesellschaft nicht länger „militarisieren“ oder kontrollieren. Im wachsenden Chaos konnte sich das finanzkapitalistische Prinzip von Macht und Geschäft ausbreiten, wie Michail Chodorkowski in „Mein Weg, ein politisches Bekenntsnis“ beschreibt. Erste Reformen legalisierten zum Ende der achtziger Jahre den „grauen“ und den „schwarzen“ Markt. Ein eigenständiges „Wirtschaften“ sollte die Kooperation zwischen den Staatsunternehmen und den Universitäten erleichtern. Die Kosten sollten für die staatlichen Grossbetriebe gesenkt werden. „Private Kooperative“ sollten die Möglichkeiten schaffen, mehr Konsumgüter herzustellen. Chodorkowski organisierte in Moskau an der Universität und an der Akademie der Wissenschaften junge Forschungsspezialisten, die neue technische Produkte entwarfen und für den Konsummarkt aufbereiteten. Vor allem die Computertechnik, die Produktion künstlicher Diamanten oder Kunststoffe, Farben wurden für russische Verhältnisse übersetzt, verändert und für die Massenproduktion vorbereitet. „Leistungsverträge“ zwischen den einzelnen Abteilungen der Universität und den Staatsbetrieben wurde geschlossen, um an „Material“ oder Rohstoffe heranzukomen. Ein staatliches Komitee für Preise behinderte weiterhin die Flexibilität der Kooperativen und sorgte für langwierige und bürokratische Verfahren. Das „übeschüssige Geld“ der Betriebe und der Konsumenten verlangte nach einem „freien Handel“, der schliesslich von der staatlichen Preisaufsicht gewährt wurde. Die Planwirtschaft zerbrach. Jetzt liefen sogar die Geheimpolizisten zu den neuen Unternehmern über und lieferten Informationen. Chodorkowski erlangte dadurch von der Staatsbank die Erlaubnis, eine „Geschäftsbank“ zu gründen und mit Devisen und ausländischen Waren, etwa mit amerikanischen Computern, „russifiziert“ im Sprachprogramm und in der „Logistik“, zu handeln. Als erfolgreicher Unternehmer unterstützte er Jelzin bei der Präsidentenwahl Mitte der neunziger Jahre. Es gelang ihm, Erdölquellen und Rohstoffelder zu erwerben und gründete im neuen Jahrtausend den Yukos – Konzern. Er kooperierte eng mit den nordamerikanischen Chevron – Konzern und wollte eine Pipeline nach China und nach Murmansk errichten. Von Chevron übernahm er unterschiedliche Technologien, die das nordamerikanische Patent trugen, die als „Privileg“ die Dieselproduktion aus Erdgas „revolutioniert“ hätten. Chodorkowski finanzierte die russischen Parteien Jabloko, Einheitliches Russland, sogar eine Kommunistische Partei. Zugleich wollte er Fernsehsender aufkaufen, Universitäten und Forschungsakademien einrichten und sich als Präsidentschaftskandidat gegen Putin aufstellen lassen. Er verkörperte ohne Zweifel die amerikanische „Freiheit“ in Russland, trotzden stand die „Struktur“ von Politik und Öffentlichkeit, Technik und Patentrecht, Finanzkapital und Rohstoffverarbeitung, Wissenschaft und Forschung nicht in der „russischen Tradition“. Der Schutz des Volkes, der Rohstoffe und der Wirtschaft liess sich mit dieser „Kapitalisierung“ nicht vereinbaren. Nicht aus dem „russischen Kontinent“ wurden neue Formen der Demokratie, des Rechts und des Marktes aus dem „Kriegskommunismus“ ertrotzt, sondern das Prinzip des westlichen Finanzkapitalismus wurde „aufgeproft“. Das mag der Grund sein, warum der Präsident Putin Michail Chodorkowski verhaften liess.
10. Die vier Säulen der nordamerikanischen Zivilisation: In Strategiepapieren des Center for a New American Security (CNAS) und des German Marshall Fund of the United States (GMFUS) werden die vier Säulen der nordamerikanischen Weltordnung herausgestellt. Sie umfassen Frieden, Wohlstand, Demokratie und Menschenrechte. Sie werden gesichert und ausgebaut über die Welthandelsordnung (WTO), Weltfinanzordnung (IWF), Seefahrtfreiheit (UNCLOS), die Nichtverbreitung von Atomwaffen und die Menschen- und Freiheitsrechte. In Russland und vor allem in China werden diese Säulen des nordamerikanischen Imperiums nicht anerkannt. Die chinesische Volksrepublik unterläuft durch Staatsunternehmen, durch die Staatsbank und durch die Kopie der finanzkapitalistischen Methoden in Handel und Kreditmarkt die Welthandelsordnung. China untergräbt durch eigene Kreditvergaben den internationalen Währungsfonds und wickelt den Welthandel nicht über den Dollar, sondern über den chinesischen Yuan ab und vergibt eigenständig Kredite an afrikanische und lateinamerikanische Staaten. Diese Grossmacht benutzt den Dollar zur „Gegenspekulation“, um die manipulierte Staatsverschuldung und Währungspolitik des nordamerikanischen Finanzkapitals in den Staatsbankrott der USA zu überführen. China verstösst gegen das internationale Seerecht, denn es beansprucht Inseln im südchinesischen Meer. Es will die Rohstoffe und Erdöllager für die chinesische Volkswirtschaft sichern. Der Bau der Atomwaffe wird durch China in Nordkorea und im Iran unterstützt. Es akzeptiert nicht die westlichen Handels-, Menschen- und Freiheitsrechte und unterstützt eine politische Ordnung, die sich grundsätzlich von der nordamerikanischen Demokratie unterscheidet. Dadurch gibt primär China sich als „Feind“ der USA und Westeuropas zu erkennen. Cuba, Venezuela, Iran, Russland wären machtunfähig, würde China nicht für die Souveränität dieser Staaten einstehen.
11. Die USA und die „Swingstaaten“: Um China zu isolieren, orientieren die USA sich auf die „Übergangs- und Swingstaaten“, die eine eigenständige Industrialisierung durchführen und zugleich Teilmärkte des Welthandels bilden. Es handelt sich um Brasilien, Indien Indonesien und die Türkei. Diese Staaten sollen überzeugt werden, die chinesische Wirtschaftsexpansion zu stoppen. Im Rahmen der WTO sollen Schutzzölle gegen chinesische Importe erhoben werden. Mit den einzelnen Unternehmerverbänden sollen Verhandlungen aufgenommen werden, die chinesische Konkurrenz einzudämmen und zu vermeiden, chinesische Kredite anzunehmen. Freihandelszonen mit den USA sollen gegründet werden, um die eigene Wirtschaft zu fördern und den Einfluss des IWF zu gewährleisten. Aus diesem Währungsfonds sollen die Nationalbanken und Staaten Kredite aufnehmen. Eine Kooperation mit Brasilien sollen die USA befähigen, in Afrika eine neue Entwicklungspolitik aufzunehmen, die sich nicht primär um die Rohstofflager kümmert, sondern die wirtschaftlichen Grundlagen der einzelnen Staaten fördert. Die chinesischen Erfolge in Afrika beunruhigen die USA, die Brasilien einsetzen müssen, um auf die afrikanische Kultur und Sozialstruktur eingehen zu können, ohne die korrupten Eliten zu unterstützen. Die Militärmacht der Türkei wird angesprochen, die arabischen Armeen in Saudiarabien zu trainieren und die Verbindungen zur NATO und zur Bundeswehr zu verstärken. Das türkische Militär soll zur politischen Stabilisierung der Region beitragen, falls ein interner Bürgerkrieg die staatliche Struktur Syriens und des Iraks zerstört. Die türkische Armee soll die Intervention der USA oder Israels „übernehmen“ und zugleich den Nahen Osten im Sinne der nordamerikanischen Ordnung befrieden. Der Türkei wird zugestanden, dass kein kurdischer Staat gegründet werden kann. Ausserdem soll die Türkei Teil der EU werden, um diesen Staatenbund und die NATO in den potentiellen Krieg gegen den Iran und gegen Russland einzubinden. Diese Swingstaaten sollen angeregt werden, Parteien und politische Eliten im nordamerikanischen Sinn aufzubauen. Ausserdem sollen Nichtregierungsorganisationen (NGO) den chinesischen Einfluss in Indonesien und in den arabischen Staaten zurückdrängen.
12. Die Weltüberbevölkerung und die sozialen Völkerwanderungen: Die Produktivität der kapitalistischen Industriezweige und das Wachsen der Weltbevölkerung „produzieren“ eine Überbevölkerung, die von den bestehenden Arbeitsmärkten der einzelnen Staaten nicht aufgenommen werden kann. Eine grosse Masse, junge und alte Arbeitskräfte, Flüchtlingen, Vertriebene, Verelendete, Arme, Emigranten werden durch Sozialhilfen und Hilfsgelder ernährt. Sie erlauben primär in Zentraleuropa, in Deutschland und in einzelnen Städten und Staaten der USA den Betroffenen ein „Überleben“, das lediglich den Bruchteil des Wohlstands des Mittelstands erreicht. Fast Eindrittel der europäischen Bevölkerung geriet in den Status der Hilfsbedürftigen. Sie „geniesst“ einen Lebensstandard, der zwar im Masstab des Landes „erbärmlich“ bleibt, trotzdem gegenüber Afrika, Asien und Lateinamerika eine „Verheissung“ vorstellt. Dort darben fast Zweidrittel der Völker ohne Land, ohne Auskommen und Arbeit in den Slumgrosstädten. Eine industrielle Entwicklung scheint unmöglich zu sein, weil die imperialistischen Mächte an Rohstoffen, Urwald und Land interessiert sind und die korrupten Eliten diese Interessen bedienen. Vor allem die Jugend kennt deshalb nur ein Ziel, nach Europa oder Nordamerika zu kommen, um hier zu überleben. Dieser Sozialstaat und dieses Flüchtlingslager in Europa müssen polizeiliche Methoden der Kontrolle einsetzen, um diese Massenbevölkerung der Paupers unter Aufsicht zu halten. Nicht allein der Ausnahmestaat, Rüstung und Militär bedrohen den Rechtsstaat, er wird zugleich durch den Sozialstaat untergraben, der die Hilfsgelder verteilen muss. Neben dem Ausbau des Sicherheits-, Militär- und Polizeistaates übernimmt der Sozialstaat Polizeiaufgaben, denn Einkommen, Bankkonten, Geschäfte, Krankheit, Geburt, Gesundheit der einzelnen Bürger werden durch diesen Staat registriert und verwaltet. Die kleine Schicht der Millionäre und Milliardäre aus dem Sektor der Finanzspekulation wird allerdings von diesen Massnahmen ausgenommen.
13. Jugendarbeitslosigkeit: Nach Berechnungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) hat die aktuelle Krise fatale Auswirkungen auf die Sockel- und Jugendarbeislosigkeit. Die produktive Industrie, Wirtschaft und Verwaltung können in Europa die Masse der Arbeitslosen nicht mehr aufnehmen und beschäftigen. Selbst wenn die Konjunktur irgendwann wieder anspringen würde, wäre diese Massenarbeitslosigkeit nicht überwindbar. In Spanien etwa lag die strukturelle Arbeitslosigkeit Ende 2011 bei 12,6% der arbeitsfähigen Bevölkerung. Diese Arbeitslosen würden zu keinem Zeitpunkt mehr einen Arbeitsvertrag erhalten. Griechenlands „bereinigte“ Erwerbslosenrate wies die Ziffer von 12,8% auf. Vor allem die Südländer der EU gewannen für Investoren keinerlei Attraktivität. Sie errichteten die neuen Autofabriken oder Zuliefererfirmen in China, Indien oder in USA. Die miserable Schul- und Berufsausbildung, die schlechte Arbeitsmoral und die Kosten schreckten die Finanziers ab. Dadurch stieg die „Trendarbeitslosigkeit“ in Südeuropa noch weiter. Vor allem junge Menschen sind von dieser Arbeitslosigkeit betroffen. Ihre Biographie wird kaum eine Beschäftigungskarriere aufweisen, falls sie nicht nach Nordeuropa auswandern. Bei den jungen Menschen unter 25 Jahren ist in Europa fast jeder vierte ohne Arbeitsplatz, Die Arbeitslosigkeit erreicht in dieser Gruppe oder „Generation“ der Erwerbslosen über 25%. Eine wachsende Verwahrlosung der Jugend ist zu erwarten. Soziale Unruhen und Radikalismus finden in dieser hoffnungslosen Jugend ein Echo. Zwar sollen staatliche Massnahmen eine „Bildungspolitik“ ergänzen, die die Jugend bisher an die Universitäten, Schulen und Fachhochschulen versetzt hatte, ohne ihr gesellschaftlich notwendige Berufe oder Fachwissen zu vermitteln. Derartige Bildungsmassnahmen sind kaum finanzierbar, werden jedoch von der EU erweitert und auf die Unterschichtsjugend ausgedehnt, ohne zu wissen, welche Ziele diese „Beschäftigungstherapie“ verfolgt. Sie in die Armeen zu stecken, die Gesellschaften zu militarisieren, würde die Gewaltbereitschaft und die Kriegsgefahr erweitern. Den Zynismus der Politiker kann sich niemand vorstellen, die Jugenderwerbslosigkeit und die Massenarbeitslosigkeit über Kriege regeln zu wollen.
14. Die Neugeburt des nordamerikanischen Kontinents: Eine neue Lage auf dem Weltmarkt entstand, als sich herausstellte, dass in den USA riesige Erdöl- und Erdgaslager gefunden wurden. Die Preise für Energie mussten nicht ausschliesslich über die Sicherung der Weltrohstoffe gewährleistet werden. Das US – Finanzkapital verfügte über Rohstoffreserven, die für eine Reindustrialisierung Nordamerikas eingesetzt werden konnten. Die industrielle Infrastruktur wurde bisher durch den europäischen Maschinenbau, die Auto-, Chemie- und Pharmaindustrie gefährdet. In USA war ausserdem die Bildungskapazität der Facharbeiter, der Ingenieure und des mittleren Managements unterentwickelt. Neben der Spitzenforschung und neben den Spezialisten und Forschern in der Rüstungsindustrie fehlte der Unterbau einer grundlegenden Fach- und Berufsausbildung. Durch die billigen Energiepreise für Kohle, Diesel, Bezin und Elektrizität verlangten die Hilfs- und Massenarbeiter keine hohen Löhne, denn die Sozial-, Renten- und Gesundheitsabgaben waren gering. So kann passieren, dass der deutsche Maschinenbau, die Autoindustrie und die anderen produktiven Industriezweige in Nordamerika neue Betriebe aufbauen und die Gesellschaft bildungs- und berufsmässig „kultivieren“. Der Schaden, den die Finanzoperationen und Spekulationen in Nordamerika angerichtet hatten, wird plötzlich durch die nordeuropäischen Kulturleistungen relativiert und zurückgenommen. Es ist jedoch anzunehmen, dass das US – Kapital aus den alten Fehlern nichts lernen wird. Erneut wird das Prinzip des „Catch is catch can“ alle Aufbauleistungen zerfetzen. Ein „europäischer“ Reform- und Bildungsstaat wird nicht existieren.
15. Über den Okkultismus als Herrschaftsprinzip: Die Marx’sche Religionskritik und die konservative Feindanalyse stimmen in einzelnen Punkten überein. Für Marx stand in der Kritik am Christentum fest, dass der Geldfetisch, das Finanzgebaren, die Spekulation, die Gesinnungsethik des Geldgeschäfts alle Religionen erfassten, die wie die jüdischen, katholischen, protestantischen und islamischen Religionen von einem einzigen „Menschengott“ sprachen, der im Leben der Menschen und zugleich in der Geschäfts- und Arbeitsethik „verkörpert“ wurde. Nicht nur dass die Menschen in diesen Religionen sich als Menschheits- und Sozialprinzip selbst anbeteten, sie übertrugen nach Marx die Geldakkumulation und die Mühen der notwendigen Arbeit auf die Religion als Schuld und Verheissung. Dadurch verloren die religiösen Menschen das Bewusstsein von Freiheit und Gerechtigkeit. Sie leiteten die Freiheits- und Menschenrechte aus den frühen und entstehenden Kapitalismus ab. Ein „Geld- und Warenfetisch“ wurde nach Marx auf den Liberalismus und auf die unterschiedlichen Utopien und „politischen Religionen“ übertragen. Durch diese Übermacht der religiösen Mysterien im menschlichen Denken wurden die die nachfolgenden Ideologien als „politische Religionen“ einem wachsenden Irrationalismus ausgesetzt. Je technisch rationaler die Gesellschaft durch den modernen Kapitalismus gestaltet wurde, desto irrationaler wurde der Glauben bzw. die ideologische Weltsicht. Völkerhass, Rassismus, Astrologie, Weltuntergang, Wunderglauben und Mystik steigerten den irrationalen „Verstand“ in einer durchrationalisierten und technologisch vollkommenen „Gesellschaftsmaschine“. Dieser religiöse Okkultismus war deshalb nach Marx Mittel, die Aufklärungsphilosophie zu verfälschen und die soziale Angst und Entwurzelung zu politisieren. Die Herrschaft der wenigen Geldmagnaten und Mächtigen konnte nur gelingen, wenn die Klassen, Völker und Nationen jeden Gedanken an die eigene Stärke und Tradition verloren und sich in einem Kampf der Religionen und Kulturen verschleissen liessen. Marx sprach diese Religionskritik wiederholt als Form der „Entfremdung“ und der „reellen Subsumtion“ der Arbeitskräfte unter die Kapitalbedingungen von Markt, Geld, Lohn, Profit, Preis und Produktion an. Dem atheistischen Materialisten interessierten nicht die moralischen, ethischen und kulturellen Aufgaben der „Menschengottreligionen“, um so ewas zu garantieren wie „Gottvertrauen“, Moral und Verantwortungsethik. Die Religion gewann bei den Konservativen einen anderen Stellenwert. Die konservativen Kritiker des Liberalismus und der modernen Ideologien setzten eine Feindanalyse an den Anfang der Staats- und Demokratiekritik. Der Feind und Gegner der eigenen Kultur, der die Lebens- und Arbeitsbedingungen bedrohte oder sogar zerstörte, sollte analytisch bestimmt werden, um einen fatalen „Funktionalismus“ bzw. eine Rechtfertigung der kapitalistischen Produktion oder des Bankgeschäfts zu vermeiden. Katholizismus oder Protestantismus bezeichneten den Ausgangspunkt der Feindsicht. Der wachsende Irrationalismus, die Dekadenz, die Zerstörungswut, die „Fäulnis“ des Feindes sollte benannt werden, um sich der eigenen Kraft und Gesellschaftlichkeit zu vergewissern. Die christliche Religion bildete die Voraussetzung der Feindanalyse. Sie gab Grundwerte und Tradition. Diese Vorgehendweise lässt sich in der Philosophie von Martin Heidegger, in der Soziologie von Hans Freyer, in den Arbeiten von Ernst Jünger und in der Staatstheorie von Carl Schmitt aufspüren.
Skizzen einer „Raumrevolution“ in Europa
Die USA übertrugen nach dem II. Weltkrieg ihre Herrschaftsmethoden und die Prinzipien der Macht auf Westeuropa und Japan. Nach 1989 wurden Versuche gestartet, Osteuropa, Russland, die Türkei und sogar den Nahen Osten nach diesen Ordnungsfaktoren zu gestalten. Die USA betätigten sich in diesen Gesellschaften nicht offen als Kolonialmacht, Diktatur und Unterdrücker, obwohl der militärische Sieg und die Besetzung der genannten Länder erst die Garantie bot, die eigenen Interessen umzusetzen. Formal wurden die Freiheits- und Demokratierechte eingeführt und sogar Wirtschaftskonjunkturen angestossen, die dazu beitrugen, das Elend und die Folgen der Kriege und Diktatur zu überwinden. Die Werte und Formen einer instrumentalisierten „Demokratie“ wurden aus USA übersetzt und verbunden mit einem kapitalistischen Lebensstil, Medienkult und Konsumideologie. Die Vereinzelung und Zersplitterung aller sozialen Klassen, Schichten, Bürger und Interessen durch derartige Methoden sicherte den kleinen Gruppen in Wirtschaft und Staat die Macht. In den zwei, drei Grossparteien verwalteten und gestalteten ausgesuchte und überprüfte Eliten, Cliquen und Gruppen eine parlamentarische Demokratie, die den Widerspruch und die Konkurrenz der unterschiedlichen Demokratieformen nicht kannte. Die Wähler wurden zu den „Konsumenten“ und Zuschauern von Ereignissen, Debatten und politischen Szenen, ohne selbst entscheiden zu können. Eine „Einheitspartei“ inszenierte Demokratie als Spektakel.
Westdeutschland gewann ab Mitte der fünfziger Jahre über den Marshall – Plan durch eine „Wohlstandsgesellschaft“ sogar nachträglich gegenüber einzelnen West- und Oststaaten den II. Weltkrieg. Ohne die Unterstützung der USA wäre die Wiedervereinigung der zwei Deutschlands nach 1989 unmöglich gewesen. Umgekehrt half das geeinte Deutschland den USA, in Osteuropa, in Asien und Nordafrika Einflüsse zu gewinnen, um die Rohstoff- und Absatzmärkte zu sichern. Die enge Kooperation der deutschen und nordamerikanischen Wirtschaft war Ausdruck der Präsenz und der direkten Eingriffe der USA. Umgekehrt profitierten die deutschen Märkte von der Dynamik und der Politik Nordamerikas. Allerdings vermieden die deutschen Regierungen, sich in die Interventionskriege dieser Grossmacht hineinziehen zu lassen. Weder in Korea, in Vietnam, im Irak, in Syrien kämpften deutsche Truppen oder Legionäre. Der Krieg in Afghanistan dokumentierte eine ersten „Waffenbrüderschaft“ und es ist zu vermuten, dass ein Angriff auf den Iran eine deutsche, militärische Teilhabe verzeichnen würde. Die Bundesrepublik stabilisierte im Sinne der USA Westeuropa und erleichterte den Zusammenbruch des „Kriegskommunismus“ in Osteuropa. Trotzdem wiesen beide Mächte eine eigene und andere Tradition von Wirtschaft und Politik auf. In der Gegenwart scheint die zerstörerische Kraft des Finanzkapitals dieses „Bündnis“ und die Stabilität der gemeinsamen Ziele zu untergraben.
Der erste Kanzler der Bundesrepublik Deutschland, Konrad Adenauer, setzte auf eine enge Zusammenarbeit mit den USA, um einen neuen, deutschen Teilstaat aus den Resten bzw. Trümmern der NS – Diktatur und der preussischen Tradition zu begründen. Ihm war zugleich wichtig, die westdeutsche Wirtschaft technologisch zu erneuern und über eine Wirtschaftskonjunktur, die „Eingliederung“ der vielen Flüchtlinge, Ausgebombten und „Heimkehrer“ zu gewährleisten. Aus dem Schutt der NSdAP zwei Grossparteien zu errichten und zu zwei politischen, fast „identischen“ Lagern zu fügen, ohne der NS – Ideologie einen Auftrieb zu geben, konnte ohne die USA nicht gelingen. Diese Grossmacht verzichtete auf eine „antifaschistische Neuordnung“, die in Potsdam zwischen der UdSSR und den Westalliierten ausgehandelt wurde und stützte sich auf deutsche Kämpfer und „Partisanen“ aus den Wehrmachtverbänden, der GESTAPO und der SS, um einen russischen Angriff abwehren zu können. Präsident Harry Truman und sein Geheimdienstchef Allan Dulles waren überzeugt, dass die russische Gegenmacht die revolutionären Unruhen in China, Indien, Persien, Griechenland, Westeuropa und Afrika ausnutzen würde, um mit den kampferprobten Panzerverbänden bis zum Atlantik vorzustossen. Die deutschen Kämpfer sollten einen Partisanenkrieg eröffnen und die Rote Armee aufhalten, bis die nordamerikanischen Bomberverbände den Vormarsch zusammemschiessen würden. Eine Geheimarmee, Gladio, von ein paar zehntausend Mann, wurde mit amerikanischen Waffen und Offizieren ausgerüstet. Die USA als Siegermacht schienen mit dem Anspruch der Freiheits- und Menschenrechte die Anschauungen eines „Führerstaates“ und die Utopien der kommunistischen Ideologie endgültig zu widerlegen und durch den materiellen Realismus einer Konsumgesellschaft, des Wohlstands und der wehrhaften Demokratie zu begründen. Endlich „kämpfte“ das westliche Restdeutschland auf der richtigen Seite.
Im Sog dieser geheimen Militarisierung des entstehenden „Kalten Krieges“ entdeckte der ersten Bundeskanzler der deutschen Westrepublik die Chance, aus den unverbrauchten „Resten“ des deutschen Volkes und aus den produktiven Beständen von Wirtschaftsfachleuten, Managern, Militär und Sicherheitsdiensten einen neuen Staat aufzubauen. Die katholische Bourgeoisie des Rheinlandes, Schwabens und Bayerns sollte das soziale Fundament des neuen Staates abgeben. Die katholische und christliche Arbeiterbewegung, alles tapfere Soldaten und Facharbeiter, sollten die bürgerlichen Ansprüche ergänzen und zu einer Bündnis- und Volkspartei vereinen. Der Antipreusse Adenauer nahm die Reform- und Bündnispolitik des preussischen Staates auf, internationalisierte sie jedoch durch den europäischen Katholizismus, der die Grundlagen des europäischen Faschismus und deutschen Nationalsozialismus pragmatisch und ideologisch überwinden sollte. Ihm war zugleich wichtig, den Staat Israel anzuerkennen und eine Politik der Wiedergutmachung an den Juden einzuleiten, um zu vermeiden, dass die zionistischen Kreise in Israel, Europa oder USA Front bezogen gegen den westdeutschen Teilstaat. Der neue Bundesstaat und die Kanzlerdemokratie waren auf die Unterstützung der USA angewiesen, um das Experiment der Neugründung mit den alten, belasteten Beamten und Funktionären zu starten und die politischen Wurzeln einer „Volkspartei“, der CDU/CSU zu stabilisieren, die gerade nicht eine Fluchtburg der Parteigenossen der NSdAP werden sollte. Dieses doppelte Experiment einer Staatsgründung und der Formierung einer Parteiendemokratie gelang, weil der Kanzler Adenauer den Auflagen des Besatzungsstatutes, der „Kanzlerakte“ und der Verträge mit den USA genügte. Er spielte den „Kanzler der Alliierten“, wie Kurt Schumacher höhnte, und erschuf aus den Trümmern der deutschen Kriegswirtschaft und des totalen Staates eine neue Ordnung und Ökonomie. Diese Politik folgte den Direktiven und Vorbehalten der USA und besass trotzdem eine deutsche Tradition. Die Bündnis- und Reformpolitik, die Verbindung von Sozial- und Sicherheitsstaat, die staatliche Konjunkturpolitik, das weitgefächerte Bildungsprogramm, der wachsende Wohlstand, die Einrichtung einer „nivellierten Mittelstandsgesellschaft“, der soziale Aufstieg eines geschundenen Volkes nahmen die Tradionen Preussens und der „deutschen Reiche“ seit 1871 auf.
Die Bundesrepublik überrundete sehr schnell Frankreich und England. Es mussten keine Koloialkriege geführt werden. Ausserdem musste kein „Kolonialreich“ finanziert werden. Es war nicht nötig, die vielen Wirtschaftsflüchtlinge aus Nordafrika und dem „Empire“ aufzunehmen. Die Bundesrepublik verfügte über das Fachwissen und den Aufbauwillen eines Restvolkes, das die Wirtschaftsräume Ostdeutschlands und Osteuropas aufgeben musste. In Westeuropa behinderten die Kolonien ein „Neubeginnen“. Stattdessen siedelte Nordafrika in Südfrankreich und Kalkutta breitete sich in London und Manchester aus. Die Kolonialkriege erreichten die „Mutterländer“ und destabilisierten Wirtschaft und Politik. England und Frankreich verloren nachträglich den II. Weltkrieg und waren auf die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik angewiesen, um selbst ein labiles Gleichgewicht zu halten. General De Gaulle bewunderte deshalb den Kanzler Adenauer und wollte die westdeutsche Politik aufnehmen und erweitern in ein Europa der „Vaterländer“. Nach diesem Muster sollte eine „Europäische Union“ errichtet werden. Die Bundesrepublik wurde zum wirtschaftlichen und kulturellen „Drehpunkt“ des neuen Europas erklärt. Eine derartige „Integration“ lag durchaus im Interesse des nordamerikanischen Finanzkapitals. Vorerst musste deshalb eine neue Ostpolitik eingeleitet werden, um Russland und Osteuropa zu destabilisieren.
Die beiden Deutschlands, die Bundesrepublik und die DDR, wurden in den Plänen der NATO und des Warschauer Paktes als Regionen des Krieges, des Aufmarsches und des Einsatzes von Raketen gesehen. Diese beiden Deutschlands wären in eine Mondwüste bei Ausbruch des modernen und totalen Krieges verwandelt worden. Die westdeutschen Kanzler und die Staatsratsvorsitzenden der DDR wussten, welchem Zwang und welcher Verantwortung sie ausgesetzt wurden. Die USA beobachteten misstrauisch die Angebote Stalins an den Kanzler Adenauer, die deutsche Einheit und einen Friedensplan zu riskieren. Er lehnte ab, denn die USA hielten die Bundeswehr, den Bundesnachrichtendienst und die Regierung unter Kontrolle. Die Nato- und die Wirtschaftsverträge nahmen neben dem Besatzungsrecht und den Stationierungsauflagen der Bundesrepublik die Souveränität. Adnauer verhandelte mit Nikita S. Chrustchew Mitte der fünfziger Jahre über die Rückkehr der deutschen Kriegsgefangenen. Erste Handelsverträge wurden geschlossen. Ludwig Erhardt weigerte sich, die Kriegspolitik der USA in Vietnam und im Nahen Osten in den sechziger Jahren zu unterstützen. Die Studentenrevolte war ihm willkommerner Anlass, vor einem Kriegseinsatz deutscher Soldaten im Ausland zu warnen. Die Regierungen unter den Kanzlerschaften von Georg Kiesinger und Willy Brandt setzten die Adenauerpolitik fort, denn die Sozialdemokratie hatte die „List der Vernunft“ des alten Kanzlers übernommen und sie war wie die CDU daran interessiert nach 1961, nach dem Mauerbau in Berlin, die Kriegsfronten im Osten durch einen Reform- und Gullaschkommunismus aufzuweichen. Die Verwestlichung der Oststaaten und der DDR lag durchaus im Interesse der USA und im Kalkül der finanzkapitalistischen „Doppelmacht“.
Erst 1989, beim Zusammensturz des Kriegskommunismus, traten Widersprüche auf. Kanzler Helmut Kohl wurde von der US – Regierung und vom Finanzkapital auf die Chancen der „deutschen Einheit“ aufmerksam gemacht. Es wurde wichtig, die Generalität und das Offizierkorps der „Volksarmee“ und der „Sovetskaja Armija“ abzufinden und ihnen den Verteidigungswillen zu nehmen. Noch wichtiger wurde es, dem Geheimdienst, KGB, MfS und HVA, neue Aufgaben in der Wirtschaft zu übertragen, ohne eine „revolutionäre Rachejustiz“ einzuleiten. Nicht vergessen werden durfte, die Parteiführung von SED und KPdSU zu schonen und ihre Legalisierung in einer neuen Republik zu gewährleisten. Die Formel der „friedlichen Revolution“ im Osten umschrieb die Manöver, den alten Führungskadern aus Politik, Militär und Sicherheit im Osten Straffreiheit zu gewähren und sie unterzubringen im Sozialstaat und in der Wirtschaft. Voraussetzung dafür war, die entstehende „soziale Revolution“ aufzuhalten und stattdessen die Ordnung der alten Bundesrepublik als Rechtsstaat und als Parteiendemokratie in den Osten zu überführen. Gelang diese „Transformation“ der BRD in die DDR, konnte sie in Osteuropa und in Russland als Programm der „Demokratisierung“ wiederholt werden. Diese Vereinigung der beiden Deutschlands und der beiden Europas kostete mehrere hundert Milliarden DM. Weitgehend die deutsche Wirtschaft brachte diesen Betrag auf und wurde belohnt mit neuen Absatzmärkten, Immobilien und billigen Industrieinvestitionen. Als Verhandlungsführer dieser komplizierten „Übertragung“ wirkte im Auftrag von Helmut Kohl der Staatssekretär Schäubele, heute Finanzminister und Geburtshelfer eines europäischen Einheitsstaates.
Irgendwann nach 1990 entstanden Gegensätze in den politischen Perspektiven des europäischen Kontinents gegenüber der Weltmacht USA. Als finanzkapitalistische und politische Doppelmacht waren die USA an der Zerschlagung Russlands als Grosstaat, Imperium, Kultur, Rohstoffreserve, Industriegigant und asiatische Gegenmacht interessiert. Russland sollte in viele Kleinstaaten zerlegt werden. Die wichtigen Rohstoffregionen sollten durch nordamerikanische Konzerne besetzt werden. Die ehemaligen, russischen Sateliten sollten durch nordamerikanische Stützpunkte und Finanzhilfen unter die Hegemonie der USA gestellt werden. Vor allem Deutschland musste dagegen am russischen Teilmarkt interessiert sein. Wie nach 1871 waren deutsche Investitionen und industrielle Aufbauhilfen gefragt, um den alten morbiden Planstaat, den Sicherheits- und Militärapparat zu überwinden. Die Kombination von Staatskapitalismus, kapitalistischer Grosswirtschaft und Handel, von Mittelstand- und Sozialspolitik und der Einführung einer weitgefächerten Berufsbildung boten Alternativen zum „Kriegskommunismus“, aber auch zur Negativkraft des Finanzkapitalismus, dessen Zerstörungswut in USA und Südeuropa zur Deindustrialisierung, zur Massenarmut, Arbeitslosigkeit und zur Prassucht der Superreichen verleitet hatte. Die „Negation“ der Aufbauarbeit oder das Fehlen einer „neuen Schaffenskraft“, aus den Trümmern neue Initiativen, Technologien und produktive Ansätze zu „zaubern“, wiesen auf eine tiefe Krise der finanzkapitalistischen Spekulation. Der Verlust an Möglichkeiten oder die Realität einer „negativen Aufhebung“ des Kapitalismus auf kapitalistischer Grundlage belegten den Einbruch aller Potenzen. Eroberungskriege wiesen auf einen letzten Ausweg. Selbst die neuen Rohstoff- und Erdölfunde in den USA und die Hineinnahme der europäischen und deutschen Bildungs- und Wirtschaftskraft zum Neuanfang einer Industrieproduktion demonstrierten den grundlegenden Widerspruch, dass der US – Staat die Zerstörungswut des Finanzkapitals nicht länger zügeln konnte. Oder war zu erwarten, das die lateinamerikanischen und afrikanischen Völker in USA das „Steuer“ herumrissen und einen neuen Reform- und Gesundheitsstaat schufen und der finanzkapitalistischen Spekulation Aufsicht und Regulation aufzwangen? Der europäische Kontinent und hier Deutschland und Russland würden aus der kombinierten staats- und privatkapitalistischen Wirtschaft und vor allem aus einer „Revolution von oben“ neue Anfänge hervorbringen.
Diese Alternativen sind öffentlich kaum diskutierbar, weil die Medien, die Parteien und die Politik, die „Negativkräfte“ der fianzkapitalistischen Spekulation in Südeuropa, in Griechenland und USA nicht erörtern und darstellen. Darüber darf nicht gesprochen werden. Die Überwindung oder „Abschaffung“ der Arbeiterbewegung in Deutschland hat alle Konflikte und gegensätzliche Interessen eingeebnet. Die Forschungsinstitute der Parteien und Universitäten sind angewiesen, über den „Negativfaktor“ Finanzkapital keinerlei grundlegende Analysen zu erheben. Die Medien hüllen sich in „Schweigen“ oder in vagen Andeutungen. Es bleibt trotzdem erstaunlich, dass die Hintergründe der aktuellen Krise nicht benannt werden dürfen. Das mag an der Doppel- bzw. Parallelmacht des Finanzkapitals liegen, das über „Logen“, Geheimbünde, Absprachen, Verschwörungen Staat und Wirtschaft durchziehen und die Medien beherrschen. Die devoten Eliten in Parteien und Staat wagen es nicht, aufzubegehren, um ihren Lebensstandard und ihre Position nicht in Frage zu stellen. „Verschwörungen“ bringen letztlich keinerlei Lösung. Sie verstärken ein Chaos durch Entscheidungslosigkeit der Eliten oder durch eine „Paralyse“, die die gesamte Gesellschaft erfasst. Schon deshalb werden Ereignisse auftreten, die wie ein Befreiungsschlag wirken werden.
Mit der nordamerikanischen Doppelmacht des Finanzkapitals ist nicht etwa eine „jüdische Plutokratie“ oder eine „jüdische Weltherrschaft“ gemeint. Diese Form des Kapitalismus lässt sich nicht auf eine Ethnie festschreiben. Die antisemitische Polemik eines Joseph Goebbels diente dem Weltmachtanspruch der NS – Diktatur und entbehrte jeder wissenschaftlichen Grundlage. Dass es auch jüdische Banker und Spekulanten gibt, verleiht diesem Kapital nicht ein irgendwie „jüdisches Wesen“. Der Finanzkapitalismus folgt einer geldspezifischen und finanzpolitischen Logik, die sich aus der „Struktur“ des Geldes, der Spekulation, der Aktie, des Fonds, der Börse, des Handels usw. ergibt. Selbst der Existenzkampf des israelischen Staates hat mit den finanzkapitalistischen Operationen wenig zu tun. Allerdings liegt er in einer Region, deren Bodenschätze für die Spekulation interessant sind. Kurzschlüsse in die skizzierte Richtung zu vollziehen, lässt sich aus den anwachsenden okkultischen Strömungen im modernen Kapitalismus erklären, einen „Schuldigen“ oder das „Böse“ schlechthin zu finden.
00:08 Publié dans Actualité, Economie, Philosophie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : philosophie, bernd rabehl, allemagne, théorie politique, politologie, sciences politiques, capitalisme, globalisation, mondialisation, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
jeudi, 21 février 2013
Nog 'nieuws' voor wie even nadenkt over de toekomst

Nog 'nieuws' voor wie even nadenkt over de toekomst
'Frankrijk nieuwe epicentrum financiële crisis' - Parijs wil alle cashbetalingen boven € 1000 gaan verbieden - Europese banken vrezen nieuw verlies van bijna € 1 biljoen - Centrale banken slaan massaal goud in vanwege komende devaluatie dollar en euro.
Voor het eerst in de geschiedenis heeft een grote multinational, Daimler (moeder van Mercedes-Benz), bij de uitgifte van nieuwe aandelen een clausule opgenomen waarmee het concern zich beschermt tegen een uittreding van Italië uit de eurozone tussen nu en 2015. De voormalige president van de Deutsche Bundesbank en huidige president van de raad van beheer van de megabank UBS, Axel Weber, bevestigde dat Italië 'één van de grootste risicofactoren in de eurozone' is. Ondertussen verschuift het epicentrum van de financiële crisis in Europa zich naar kernland Frankrijk, waar sinds het aantreden van de socialistische president Francois Hollande vrijwel uitsluitend dramatisch slechte cijfers vandaan komen.
Bij een € 150 miljoen grote aandelenemissie heeft Daimler-Benz de clausule opgenomen dat de rente- en aflossingsbetalingen over de in augustus 2015 opeisbare schuldpapieren in de dan 'wettelijke valuta in Italië' moet worden voldaan. Hiermee breekt het concern als eerste met de gangbare praktijk van ondernemingen door automatisch van de euro uit te gaan. Het is dan ook een duidelijk signaal dat Daimler-Benz serieus rekening houdt met een uittreding van Italië uit de Europese muntunie. (1)
Miserabele toestand Italië door Monti
De politiek in Europa onderkent dit gevaar. De Duitse minister van Financiën Wolfgang Schäuble heeft de Italianen openlijk geadviseerd om bij de verkiezingen op 24 en 25 februari op (ex Goldman Sachs) premier Mario Monti te stemmen en niet op Silvio Berlusconi, omdat alleen Monti 'voor een stabiel Europa' zou kunnen zorgen en hij Italië 'sterk heeft gemaakt'. Alle experts zijn het er echter over eens dat Monti nauwelijks iets heeft gerealiseerd van de beloofde hervormingen (2). De Italiaanse economie blijft verder krimpen, in de dienstensector zelfs in recordtempo (3), en het consumentenvertrouwen zakte naar een 17 jarige dieptepunt (4).
Monti heeft Italië juist in een miserabele toestand achtergelaten: een recessie, een hoog begrotingstekort en een bankenschandaal waarbij hij persoonlijk betrokken is. Met zijn openlijke aanprijzen van Monti breekt Schäuble met de Europese traditie zich niet met de verkiezingen in andere lidstaten te bemoeien - opnieuw een teken dat de crisis in Europa ondanks de geruststellingen door de politiek steeds ernstiger wordt.
'Frankrijk nieuwe epicentrum crisis'
Financiële analisten vrezen dat Frankrijk het nieuwe epicentrum van de financiële crisis in de eurozone wordt. De dramatisch slechte cijfers uit Frankrijk spreken in dit opzicht boekdelen. Het gaat Parijs dit jaar niet lukken de Europese begrotingstekortnorm van 3% te halen, volgens premier Ayrault 'omdat de groei in Frankrijk, Europa en de wereld zwakker is dan verwacht.' Volgens het op 1 januari in werking getreden Europese fiscale pact zou Frankrijk eigenlijk een boete moeten krijgen, maar EU commissaris Olli Rehn ziet daar nu al vanaf en wil Frankrijk meer tijd geven (5).
De Franse regering had om de 3% norm te halen de belastingen al met € 32 miljard verhoogd, maar dat blijkt dus nog niet genoeg. Zogezegd om belastingontduiking en fraude tegen te gaan wil Parijs zijn onderdanen alle cashbetalingen boven € 1000 gaan verbieden. Het huidige maximum is € 3000. (10) Ook overweegt president Hollande om te korten op de pensioenen. Mede vanwege zijn belofte aan de Fransen dit nooit te zullen doen won hij vorig jaar de verkiezingen.
Duitsland waarschuwt voor hoge inflatie
Hollande sprak zich onlangs openlijk uit voor het kunstmatig verzwakken van de euro, iets waar de Duitsers geprikkeld op reageerden en waarschuwden dat dit zal leiden tot hoge inflatie en koopkrachtverlies. De president van de Bundesbank, Jens Weidmann, wees erop dat Italië in de jaren '70 door vergelijkbaar beleid een inflatie van 17% veroorzaakte. Volgens Weidmann is de euro op dit moment al 'zwaar overgewaardeerd'. Tevens zei hij te vrezen voor een internationale valuta oorlog 'die aan het einde alleen verliezers zal kennen'. (6)
De Bundesbank president heeft de recente historie aan zijn kant. De Italiaanse centrale bank kocht tussen 1975 en 1981 massaal Italiaanse staatsobligaties op. Het gevolg was dat de staatsschuld explosief steeg van 18 biljoen naar 100 biljoen lire en de jaarlijkse inflatie opliep naar bijna 17%. De ECB heeft de afgelopen jaren regelmatig naar dezelfde noodmaatregel gegrepen. Met name socialistische- en linkse partijen, ook in Nederland, pleiten echter nog steeds voor het permanent inschakelen van de ECB bij het oplossen van de schuldencrisis. (7) Dit zal de Zuid Europese schuldenlanden in staat stellen veel te veel geld te blijven uitgeven en de koopkracht van de Europese burgers ondermijnen.
Recordverliezen
De Franse export lijdt echter onder de dure euro. Het autoconcern Peugeot-Citroën meldde over 2012 een recordverlies van € 5 miljard (8). Ook de Franse banken verkeren in zwaar weer: Société Générale, de op één na grootste bank van Frankrijk, leed in het laatste kwartaal van vorig jaar een verlies van 476 miljoen euro, ruim dubbel zo hoog als verwacht.
Volgens Ernst & Young dreigt door de crisis een record van € 918 miljard aan bedrijfs- en particuliere kredieten niet meer aan de banken te worden terugbetaald. Vooral de banken in Spanje (15,5% slechte kredieten) en Italië (10,2%) zullen hierdoor zwaar worden getroffen. Paradoxaal genoeg steeg de winst van de banken in de eurozone het afgelopen jaar naar € 651 miljard euro (9).
'Schuldencrisis absoluut nog niet opgelost'
Het hoofd van de Duitse financiële toezichthouder Bafin, Raimund Röseler, benadrukte dat de schuldencrisis in Europa 'absoluut nog niet opgelost' is. Volgens Röseler hebben de eurolanden nog steeds veel te hoge schulden en hebben ze geen strategie om deze substantieel te verminderen. 'De ECB heeft meer geld in het systeem gepompt, maar daardoor kunnen de landen niet meteen aan hun betalingsverplichtingen voldoen.'
Bovendien is het onderlinge wantrouwen tussen de banken nog altijd groot. Röselers grootste zorg is echter dat al het nieuwe geld van de ECB 'de druk van de regeringen wegneemt' om hun betalingsproblemen op te lossen. 'Het nog grotere gevaar is dat er nog geen strategie is om al dat extra geld weer uit het systeem te halen.' Europa is hierdoor net als een zieke patiënt verslaafd geworden aan medicijnen. 'We hebben een therapie nodig die deze afhankelijkheid geneest zonder de patiënt om te brengen.' (11)
Centrale banken kopen goud voor devaluatie
De centrale banken van de wereld kochten vorig jaar 534,6 ton goud, een stijging van 17% ten opzichte van het voorjaar en de grootste hoeveelheid sinds 1964. Over heel 2012 werd voor $ 236,4 miljard aan goud ingeslagen, een absoluut record (12). De centrale banken beschermen zichzelf hiermee tegen de verwachte devaluatie van de dollar en de euro, die het onvermijdelijke gevolg zal zijn van het huidige geldbeleid in Europa en Amerika. Volgens financiële experts 'weten Rusland en China dat deze uiteindelijke devaluatie spoedig komt' en zijn deze landen daarom de grootste kopers van goud (13).
Zoals vaker uitgelegd zullen het spaargeld, de pensioenen en de koopkracht van de Westerse burgers door een forse devaluatie worden weggevaagd, wat tot een lagere welvaart en permanente verarming zal leiden. Opnieuw zullen de banken en grote multinationals hiervan het meeste profiteren.
Xander
(1) Format
(2) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(3) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(4) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(5) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(6) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(7) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(8) Die Welt
(9) Focus
(10) Zero Hedge
(11) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(12) Deutsche Wirtschafts Nachrichten
(13) King World News
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, crash financier, europe, affaires européennes, actualité, politique internationale |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mercredi, 13 février 2013
Governo Globale
La storia segreta del Nuovo Ordine Mondiale
Autore: Enrica Perucchietti Gianluca Marletta
Prezzo: € 10,03 (invece di €11,80)

Vuoi scoprire cos'è il Nuovo Ordine Mondiale?
Crisi economiche, rivoluzioni, guerre. Che cosa si cela dietro il rischio di crollo dell’Eurozona, la cosiddetta “Primavera Araba”, l’uccisione di Osama bin Laden, la guerra in Libia, i cablogrammi di Wikileaks, l’attentato di Oslo e Utoja e l’insediamento del governo Monti? Che cosa lega l’omicidio di John Kennedy all’assassinio di Olof Palme? Come fanno eventi in apparenza così diversi e distanti ad avere un’origine comune?
In questo saggio si svela per la prima volta in modo chiaro, completo e documentato, la storia segreta del Nuovo Ordine Mondiale, dalle sue origini a oggi: la genesi, l’ideologia e le tappe storiche, dalle origini della modernità all'attuale sfida militare che vede come terreno di battaglia il Medio Oriente. Chi ha coniato il termine e chi perpetua in segreto il disegno di instaurazione di un governo globale? Quali interessi si nascondono dietro questo progetto? Che ruolo hanno i membri di affiliazioni e gruppi occulti che riuniscono i protagonisti della vita politica, economica e finanziaria globali? Quale disegno si nasconde dietro la diffusione della tossicodipendenza di massa, fenomeni inquietanti e criminali come il satanismo, certi movimenti “culturali”, o di “controcultura”, come la “rivoluzione” psichedelica? In questo gioco di equilibri, quale obiettivo nasconde il progetto di instaurazione di un Governo Globale che lungo il suo cammino assoggetta i Popoli, fa cadere nazioni e governi come pedine di un complesso domino di cui non si riesce a vedere il disegno complessivo?
Anteprima - Governo Globale - Libro
Sull'ondata della profezia Maya in merito all'imminente fine dei tempi, la sensazione che la fine della nostra civiltà possa coincidere con l'instaurazione di un governo globale di stampo totalitario si è trasmessa a gran parte della popolazione mondiale. Le catastrofi naturali, le crisi economiche e il disincanto delle masse nei confronti della politica hanno insinuato il dubbio che qualcosa di tremendamente drammatico stia per accadere. I segni di una trasformazione generale della società e del mondo, così come lo conosciamo, vengono di volta in volta individuati nei più disparati settori.
Continua a leggere: > Anteprima - Governo Globale - Libro
Indice
Introduzione
- Che cos’è il Nuovo Ordine Mondiale?
Parte Prima
- Alle radici di un’idea: dalla Riforma protestante alla “missione” della stirpe anglosassone
- Messianismo e Nuovo Ordine Mondiale
- La questione dei “poteri occulti”
- Dal popolo alla “massa”: tecniche e strategie per un dominio globale
- La creazione del Mondo Nuovo: droga, sesso, de popolazione e “nuova spiritualità”
Parte Seconda
- Come abbattere un regime: da Wikileaks alla “Primavera araba”, il sogno di un Nuovo Medio Oriente
- Signoraggio e crisi economica: da Kennedy a Obama
- Il “trattamento” Milosevic e le guerre dell’Impero: dalla Serbia alla Libia
- 11 settembre 2001: le menzogne dell’Impero e la dottrina della guerra “preventiva”
- Guerra al terrorismo, ovvero gli interessi delle lobby in Iraq e in Afghanistan
- Le nove vite dello Sceicco del terrore: Osama bin Laden
- False flags e scandali di corte: dalla strage norvegese all’Eliseo
- Italia, Stato di banchieri: dalle profezie di Tremonti al tecnogoverno Monti
- L’ombelico del Nuovo Mondo: USA o Cina?
00:05 Publié dans Economie, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : gouvernementmondial, mondialisme, globalisation, globalisme, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 10 février 2013
Quand l’ Islande dit merde aux banquiers !

Quand l’ Islande dit merde aux banquiers !
Ex: http://mediabenews.wordpress.com/
Le jugement de cour est passé presque inaperçu, la semaine dernière. Mais il est de taille. Selon un tribunal de l’Association européenne de libre-échange, l’Islande avait le droit, lorsque ses banques se sont effondrées en 2008, de refuser de rembourser ses épargnants étrangers.
Ce jugement répond à une question cruciale : l’argent public doit-il sauver ou non des banques en faillite ? Après la chute de la première banque privée du pays, Landsbanki, l’Islande avait dû nationaliser en catastrophe son système bancaire. Par la suite, décision avait été prise – les politiciens se voyant un peu forcés par un peuple en colère et des référendums sans équivoque – de dire « merde » aux banquiers… et par la même occasion à leurs victimes étrangères.
***
L’Islande, c’est ce minuscule pays insulaire (325 000 habitants) qui, dès 2008 et avant tous les autres, a connu les affres de la crise économique et financière. Au cours des années 2000, et jusqu’à ce fatidique automne 2008, une gigantesque bulle s’était formée dans ce pays.
Quelques banques de Reykjavik avaient réussi à attirer, de façon plus ou moins honnête, les économies et les investissements de sociétés et d’épargnants étrangers, la plupart britanniques et hollandais, qui étaient venus alléchés par des taux d’intérêt extraordinaires.
Dans les magouilles de ces fastes années, beaucoup d’Islandais avaient trouvé leur compte. Avant leur « divine colère » de 2008-2009, ils avaient longtemps fermé les yeux sur les manoeuvres lucratives des Icesave et autres Landbanski, entreprises financières dirigées par des chefs hautement « créatifs » dans leur recherche de débouchés internationaux.
Fin 2007, l’ONU rapportait qu’avec un produit intérieur brut de 40 000 euros par habitant, les Islandais jouissaient du niveau de vie le plus élevé du monde. Chômage inexistant, dette minime, croissance annuelle de 5 %. Avec un secteur bancaire envahissant qui avait supplanté les activités traditionnelles du pays (pêche).
Fin 2008, la bulle éclatait. Les banques faisaient faillite, laissant des dettes équivalant à plusieurs centaines de milliers de dollars par habitant… et le niveau de vie s’effondrait de près de 20 % en quelques mois.
***
Il y a quelques jours sur Al-Jazeera anglais, en provenance de Davos, on pouvait voir une interview d’Olafur Ragnar Grimsson, président islandais réélu pour un quatrième mandat en juin 2012 (notamment parce qu’il a pris la part « du peuple » dans ce scandale bancaire).
Extrait de cette entrevue du président Grimsson : « Pourquoi considère-t-on que les banques sont les saintes chapelles de l’économie moderne ? La théorie que vous devez payer pour sauver les banques, selon laquelle les banquiers peuvent jouir de leurs propres bénéfices et de leur succès, mais que ce sont les gens ordinaires qui doivent payer pour leurs échecs, au moyen des impôts et de l’austérité… cette théorie, eh bien, les gens ne l’accepteront pas sur le long terme, dans des démocraties éclairées. »
On ne saurait mieux critiquer la doctrine de l’austérité, appliquée scrupuleusement par des pays comme la Lettonie (5,5 % de chômage avant la crise, 14 % aujourd’hui), le Royaume-Uni ou l’Irlande, régulièrement cités en exemple par les tenants de la rigueur fiscale. L’Irlande qui a connu vers la même époque des malheurs similaires, mais qui – à la différence de l’Islande – a remboursé scrupuleusement les créanciers étrangers, augmentant la dette nationale de façon astronomique… L’Irlande dont le taux de chômage, début 2013, reste aux alentours de 15 %.
Et l’Islande en 2013 ? Le pays des Vikings n’a pas seulement dit « merde » aux banquiers véreux. L’État islandais a refusé de suivre les doctes conseils des spécialistes de Londres et de Bruxelles ; il n’a pas fait de la réduction du déficit et des privilèges des banques une priorité absolue ; il a même défié le droit européen. Il a dévalué radicalement sa monnaie (oui, ce petit pays farouchement indépendant dispose toujours de sa devise), et ne s’en trouve que mieux aujourd’hui.
Le niveau de vie des Islandais a certes baissé : les week-ends à Paris sont plus rares, les importations de luxe également. Mais le chômage est retombé sous les 8 %, et après l’épouvantable purge de 2008-2009, la croissance a repris à 3 ou 4 % par an. Le pays, au contraire de tous les voisins qui ont traversé des épreuves semblables, est résolument sur la voie de la récupération totale.
Et s’il y avait une autre façon de faire face à la crise ?
Source
http://www.ledevoir.com
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : islande, banques, crise, crise européenne, crise fiancière, europe, affaires européennes, politique internationale, scandinavie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
mardi, 05 février 2013
2013 L'apocalypse économique
« 2013 L'apocalypse économique : L'hyper classe mondiale à l'assaut de l'économie et de la démocratie » de Jean Michel Groven
par André POSOKHOV
Ex: http://www.polemia.com/

Jean Michel Groven est économiste et assistant parlementaire au Sénat. Son livre 2013, l’apocalypse économique mérite de retenir l’attention car il ouvre en réalité un espace de réflexion sur l’émergence des nouvelles élites mondiales et sur la mondialisation. Il s’exprime très clairement et très courageusement sur des sujets censurés comme la subversion démographique, le libre échange ou le Politiquement correct. Si l’auteur dit à haute voix dans les couloirs du Sénat ce qu’il écrit dans son livre il doit faire sensation. A.P.
_________________________________________________________________
L’émergence d’une nouvelle classe sociale : les supériorisés
L’auteur fait le constat de deux évolutions sociologiques convergentes.
Depuis la fin de la guerre le nombre de personnes qui sont passées par l’enseignement supérieur a explosé. On assiste ainsi à l’émergence d’une nouvelle classe sociale, celle des « supériorisés ». Cette classe n’éprouve pas le besoin d’un destin collectif : nation, socialisme, etc. Ses membres ont une vision idéalisée d’eux-mêmes qui leur font croire qu’ils sont des individus uniques. Le « supériorisé » cherche à ne fréquenter que ses semblables dans les mêmes espaces et a acquis une mentalité d’essence individualiste et hédoniste. Tous les thèmes politiques de ce mode de pensée se trouvaient déjà en filigrane dans les slogans de mai 68. Selon Groven cette mentalité se retrouve toute entière dans la formule : « jouir sans entraves ». Narcissisme (Face Book), destruction de l’institution du mariage, jeunisme caractérisent cette évolution aujourd’hui très avancée. Celle-ci aboutit à la volonté de s’approprier par tous les moyens et immédiatement ce qui fait envie sans qu’une morale ne soit là pour l’empêcher. C’est l’ l’Homo spontaneus qui n’est animé que par ses désirs et ses pulsions qui sont érigés en principes de base du comportement individuel et qui peuvent déboucher sur la violence.
Profondément individualiste, cette mentalité est essentiellement inégalitaire ne serait-ce que par le regard que les « supériorisés » jettent sur le peuple et même sur de moins diplômés qu’eux-mêmes. C’est le grand retour et la légitimation des inégalités en termes de revenus et de patrimoines économiques comme sociaux. L’image des classes populaires est déclassée voire symbolisée par le terme de « beauf ». Cette image négative rejaillit également sur l’image qu’ont les Français d’eux-mêmes telle qu’elle est renvoyée par les élites du type Jacques Attali pour qui il n’est d’horizon pour la France que la dilution dans l’Europe et la dilution de l’Europe dans la mondialisation. L’auteur évoque le PS devenu un parti de cadres supérieurs qui se donnent bonne conscience en discutant du sort des immigrés sans papiers ou du mariage unisexe mais oublient le sort de 70 à 80% de la population qui sont leurs compatriotes.
Ainsi est née une oligarchie qui présente trois caractères :
- -elle prélève une part de plus en plus importante de la valeur ajoutée produite par les travailleurs grâce au libre-échange. C’est à cela que servent la mondialisation et le libre-échange,
- -elle préfère les membres des oligarchies des pays voisins plutôt que son propre peuple dont le sort l’indiffère,
- -elle est parvenue à tenir son pouvoir d’une morale faite par elle et pour elle : le Politiquement correct qui a pour objectif de trouver dans la société des bourreaux et des victimes afin que l’élite puisse s’ériger en « juge arbitre ».
Ce sont ces élites donneuses de leçons qui ne payent jamais les pots cassés de la mondialisation car elles sont planquées derrière leurs capitaux ou leur statut : énarques, universitaires, journalistes.
Basculement millénaire du pouvoir de Dieu vers le pouvoir de l’individu
Le deuxième constat revêt un caractère historique. Pour faire court la démocratie a été une étape dans le lent basculement millénaire du pouvoir de Dieu vers le pouvoir de l’individu. Le Peuple est devenu Dieu. Puis la déité est passée de l’Homme à l’individu : Or cet individu demeure un animal social. Celui-ci se tourne vers sa communauté afin d’assurer ses besoins et sa propre sécurité. Il en résulte un repli sur soi et une atomisation de la société Ainsi peut s’expliquer le fractionnement des nations actuelles en autant de communautés qui se regardent en chiens de faïence, voire en ennemies.
C’est la conjonction de ces deux évolutions sociologiques qui permet la prise du pouvoir économique et politique par l’hyper classe nationale comme mondiale.
La stratégie de l’hyper classe : des coupables et des victimes
Le fractionnement de la population qui est organisée de manière presque consciente par les élites et la mise en place de la tyrannie du Politiquement correct s’effectuent en quatre étapes :
- -la désignation de victimes : immigrés, femmes, homosexuels. La victime absolue est la personne d’origine juive. La désignation de nouvelles victimes est souvent univoque. SOS racisme ne s’intéresse pas à ce que l’on appelle le racisme anti blanc, terme impropre d’ailleurs,
- -la désignation de coupables. Un contestataire du réchauffement climatique est un coupable absolu. La France, désignée comme responsable du génocide des Juifs est mise en accusation d’une manière permanente,
- -l’élite intervient par le biais des lois anti-discrimination et surtout mémorielles qui sont le socle de la tyrannie des associations notamment antiracistes. L’insécurité sous les trois formes de la délinquance, de la précarité économique et de la précarité familiale, constitue également l’épine dorsale du monde nouveau de l’oligarchie. Elle entraine une judiciarisation des relations entre individus et une « cancerisation » des relations humaines par une méfiance généralisée et la guerre de tous contre tous. La nouvelle classe sociale profite de cet état de choses pour imposer sa loi en se posant comme le juge arbitre de tous les conflits qu’elle a elle-même créés,
- -la création d’une « compétition victimaire » en suscitant du ressentiment chez d’autres victimes.
Les passages du livre sur ces thèmes sont particulièrement éloquents et percutants. L’auteur souligne que « ce qui est terrifiant avec cette nouvelle doxa, c’est sa capacité à transposer n’importe quel sujet sous un angle moralisateur avec, à chaque fois, l’éternelle trilogie juge/victime/coupable ». Il souligne que dans certains pays l’idéologie du politiquement correct est devenue folle comme au Royaume uni.
Au bout du compte la nation et les grandes idéologies collectives s’effacent au profit de micro et de macro-tribus. Cette tribalisation et ce communautarisme se retrouvent dans les ghettos géographiques : banlieues mais aussi centres villes et cités pavillonnaires des classes moyennes.
Cette situation délétère est porteuse de chaos social qui ne peut que profiter à un futur régime qui, au nom du rétablissement de la concorde nationale (qu’il aura lui-même brisée..) imposera de plus en plus ses lois afin de contrôler une démocratie vacillante, voire même demandera sa suppression.
L’évolution actuelle.
2013 présente trois types de mondialisation : la mondialisation des cultures, celle de la finance et des biens et services et enfin celle des travailleurs.
Concernant les biens et services l’auteur se livre à une critique économique virulente du libre-échange promu par l’ensemble des milieux qui sont protégés par leur statut de la concurrence extérieure ou qui font partie des secteurs qui en profitent, ce qui ne constitue pas l’originalité de l’ouvrage.et sur laquelle il ne sera pas insisté :
En revanche les conséquences sociales et politiques sont lourdes.
- -les industries américaines puis européennes ont subi de plein fouet la concurrence des dragons asiatiques ce qui a entrainé les délocalisations et la baisse du niveau de vie des classes populaires,
- -l’écart entre les riches et les pauvres est généralement grandissant,
- -Un processus de paupérisation s’est accentué avec l’entrée en scène des pays émergents et touche les classes moyennes,
- -l’endettement des classes moyennes grâce à la bulle immobilière et des classes populaires grâce aux crédits à la consommation,
- -l’effondrement à venir des monnaies : le dollar comme l’euro.
« 2013 l’apocalypse économique » prévoit qu’au terme, proche, de ce processus l’économie occidentale connaitra un effondrement économique, financier et social Ce sera particulièrement le cas des USA qui perdront leur statut de leader mondial.
Ces prédictions sinistres ne sont pas invraisemblables et JM.Groven n’est pas le seul à les formuler. On peut même avancer que les évolutions récentes de l’économie occidentale les rendent vraisemblables. Cependant les présenter comme certaines avec une date précise affaiblit le propos de l’ouvrage. A titre d’exemple JM. Groven prévoyait la chute de l’euro en 2011 et 2012 ce qui n’est pas arrivé.
Pour ce qui concerne la France, l’arrivée de la nouvelle hyper classe mondiale conduit à disloquer le système politique classique basé sur la démocratie et l’Etat nation. Il faut à tout prix éliminer celui-ci en invoquant des motifs nobles et d’intérêt général. L’Union européenne est l’espace au sein duquel la Nation française qui a déjà perdu ses prérogatives étatiques est censée se fondre.
En conclusion l’auteur a exprimé l’espoir que son livre apportera quelques « cartouches intellectuelles à tous ceux qui se rebellent contre ce monde qui s’annonce triste et fatigué à l’image et à la dimension de la nouvelle élite ». Il est loisible de penser que ce but, grâce à de nombreuses pages fortes et courageuses, a été atteint et que la lecture de ce livre peut être recommandée à ceux qui souhaitent découvrir les ressorts de la prise du pouvoir par l’oligarchie mondiale comme nationale.
André Posokhov
29/12/2012
Voir aussi :
L'Idéologie de la superclasse mondiale (1re partie)
« Au bord du gouffre / La faillite annoncée du système de l'argent » d'Alain de Benoist
Quel est l'ennemi ? La superclasse mondiale ou la puissance américaine ?
Dix thèses sur le libéralisme (1/3)
La généalogie de la superclasse mondiale (Première partie)
Essor de la « superclasse globale » (ou hyperclasse) et crise des classes moyennes.
Correspondance Polémia : 1/01/2013
00:05 Publié dans Actualité, Economie, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie, livre |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 04 février 2013
Hitler, disciple d’Abraham Lincoln

Ellen BROWN:
Hitler, disciple d’Abraham Lincoln
“Nous ne sommes pas stupides au point de créer une monnaie liée à l’or, métal dont nous ne disposons pas, mais pour chaque mark que nous avons imprimé, nous avons réclamé l’équivalent de ce mark en travail ou en biens produits. Nous rirons désormais bien fort toutes les fois que nos financiers nationaux affirmeront que la valeur de la devise devra être réglée soit sur l’or soit sur des biens conservés dans les coffres-forts de la banque d’Etat” (dixit Adolf Hitler, citation mentionnée dans “Hitler’s Monetary System, sur http://www.rense.com/ et repris de C. C. Veith, “Citadels of Chaos”, Meador, 1949). Le gouvernement de Guernesey (politicien du Minnesota) ne fut donc pas le seul à avoir résolu ses propres problèmes d’infrastructure en faisant imprimer sa propre monnaie à sa seule initiative. Ce modèle est toutefois plus connu dans l’Allemagne d’après la première guerre mondiale, lorsque Hitler arriva au pouvoir dans un pays complètement ruiné et livré au désespoir.
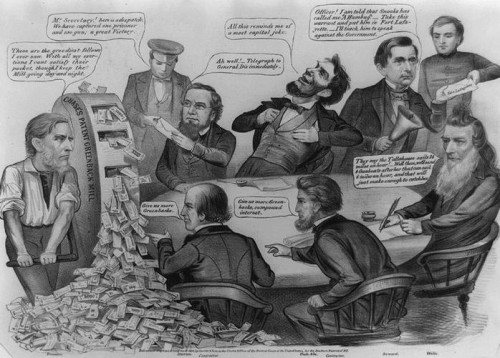
Le Traité de Versailles avait imposé au peuple allemand le paiement d’indemnités si considérables que le pays s’en était trouvé totalement détruit. L’Allemagne devait rembourser tous les frais qu’avait entraînés la guerre dans tous les pays belligérants. Ces indemnités se montaient ainsi au triple de la valeur de toutes les propriétés se trouvant sur le territoire allemand. La spéculation contre le mark allemand avaient provoqué son effondrement, entraînant en même temps l’inflation la plus ruineuse de tous les temps modernes. Au moment le plus fort de cette inflation, une brouette pleine de billets de banques, équivalant à la somme de 100 milliards de marks, ne suffisait pas pour acheter une miche de pain. Les caisses de l’Etat étaient vides; de plus, une grande quantité de maisons et de fabriques avaient été placées sous sequestre par les banques et les spéculateurs. Les gens étaient contraints de vivre dans des baraquements et mourraient de faim. Jamais rien de pareil n’était arrivé précédemment. La destruction complète d’une devise nationale avait littéralement bouffé l’épargne des citoyens et réduit à néant leurs activités et l’économie en général. Pire, à la fin de la troisième décennie du 20ème siècle, la crise internationale empire encore la situation. L’Allemagne ne pouvait plus faire autre chose que tomber dans l’esclavage de la detteet dans les griffes des usuriers internationaux. C’était du moins ce qui semblait à l’époque inéluctable (ndt: comme la Grèce ou l’Espagne aujourd’hui...).
Hitler et les nationaux-socialistes arrivent au pouvoir en 1933 et s’opposent immédiatement au cartel des banques internationales, en commençant par battre une monnaie allemande propre. Le modèle de cette politique ne dérive pas d’une idéologie réactionnaire ou totalitaire, du moins considérée comme telle par les conventions politico-idéologiques contemporaines, mais de la politique lancée jadis aux Etats-Unis par le Président anti-esclavagiste Abraham Lincoln, qui avait financé la guerre civile américaine en faisant imprimer des billets de banque au nom de l’Etat, billets que l’on avait surnommé “Greenbacks”. Hitler amorcera de même son programme de crédit national en élaborant un plan de grands travaux publics. Ces projets, destinés à être financés par les pouvoirs publics, comprenaient la construction d’infrastructures diverses, notamment pour juguler les effets désastreux des inondations dans certaines régions du pays, la remise en Etat ou la modernisation d’édifices publics, voire de demeures privées, la construction de nouveaux bâtiments pour l’Etat ou l’administration, de routes, d’autoroutes, de ponts, le creusement de canaux et de bassins portuaires. Le coût de tous ces travaux et projets fut fixé à un milliard de l’unité de la nouvelle devise nationale. On imprima donc pour un milliard de ces billets d’échange non soumis à l’inflation, appelés “certificats de travail du Trésor”. Cette monnaie imprimée par le gouvernement n’avait pas pour référence l’or mais tout ce qui possédait une valeur concrète. Pour l’essentiel, il s’agissait de reçus émis en échange d’un travail ou d’un gros oeuvre effectués au bénéfice du gouvernement. Hitler: “Pour chaque mark qui sera imprimé, nous avons exigé l’équivalent d’un mark de travail accompli ou de biens produits”. Les travailleurs dépensaient ensuite leurs “certificats” pour acquérir d’autres biens ou services, créant par la même occasion du travail pour d’autres citoyens.
En l’espace de deux années, le problème du chômage avait été résolu et le pays était remis sur pied. Il possédait à nouveau une devise stable et solide, n’avait plus de dettes, ne subissait plus d’inflation, alors qu’au même moment, aux Etats-Unis et dans d’autres pays occidentaux, des centaines de milliers d’ouvriers demeuraient sans travail et vivaient de l’assistance publique. L’Allemagne avait également réussi à relancer son commerce extérieur, malgré le fait que les grandes banques internationales lui refusaient tout crédit et se voyaient contraintes, pour ne pas perdre la face, d’organiser contre elle un boycott économique international. L’Allemagne s’est dégagé de ce boycott en instituant un système de troc: les biens et les services s’échangeaient directement entre pays, tout en contournant les grandes banques internationales. Ce système d’échange direct s’effectuait sans créer de dette ni de déficit commercial. Cette expérience économique allemande a laissé des traces durables, encore perceptibles aujourd’hui, comme le réseau d’autoroutes, le premier au monde à avoir eu pareille ampleur.
Hjalmar Schacht, à l’époque chef de la banque centrale allemande, a confirmé que cette politique était bien la version allemande de l’émission des “Greenbacks” par Lincoln. Un banquier américain avait dit à Schacht: “Dr. Schacht, vous devriez venir en Amérique car nous y avons un paquet d’argent et telle est la vraie façon de gérer un système bancaire”. Schacht avait répliqué: “C’est vous qui devriez venir à Berlin. Nous n’avons pas d’argent. Telle est la vraie façon de gérer un système bancaire” (citation issue de John Weitz, “Hitler’s Banker, Warner Books, 1999).

Certes, aujourd’hui, Hitler est décrit comme un monstre dans les livres d’histoire mais cette politique économique, il faut l’avouer, l’avait rendu populaire dans son pays. Stephen Zarlenga, dans “The Lost Science of Money”, affirme que le dictateur allemand doit cette popularité au fait qu’il avait débarrassé l’Allemagne des “théories économiques anglaises”, soit les théories selon lesquelles l’argent doit s’échanger sur base des réserves d’or possédées par un cartel de banques privées plutôt que sur un argent émis directement par les gouvernements. Ensuite, le chercheur canadien Henry Makow énonce l’hypothèse suivante: c’est pour cette raison qu’il fallait éliminer Hitler car il avait réussi à circonvenir les banquiers internationaux et à créer une monnaie propre. Pour étayer son hypothèse, Makow cite un entretien de 1938 accordé par C. G. Rakowky, l’un des fondateurs du bolchevisme soviétique et ami intime de Trotski, qui a fini victime des purges staliniennes. Selon Rakowsky, “Hitler s’est octroyé à lui-même le privilège de fabriquer de l’argent, non seulement de l’argent tangible mais aussi de l’argent financier; il a fait siens les mécanismes intouchables de la falsification et les a mis au service de l’Etat. Si une telle situation avait réussi à infecter d’autres Etats, on pourrait aisément imaginer quelles en auraient été les implications contre-révolutionnaires” (Henry Makow, “Hitler did not want War”, sur: http://www.savethemales.com/ ).
L’économiste anglais Henry C. K. Liu a lui aussi écrit quelques articles et essais sur la transformation inattendue de l’économie allemande dans les années 30 du 20ème siècle: “Les nazis arrivent au pouvoir en Allemagne en 1933, au moment où l’économie du pays connaît un effondrement total, subissant aussi les conséquences ruineuses des indemnités qu’il a à payer suite à la première guerre mondiale; ses prospectives pour obtenir du crédit et des investissements étrangers égalent zéro. Pourtant, en mettant en oeuvre une politique de souveraineté monétaire indépendante et un vaste programme de travaux publics garantissant le plein emploi, son ‘Troisième Reich’ réussit à soustraire l’Allemagne à la banqueroute, même si elle ne possédait plus de colonies à exploiter; ce programme en fit la puissance économique numéro un de l’Europe, en une période de quatre années seulement, avant même de lancer son programme d’armement”. Dans “Billions for the Bankers, Debts for the People” (1984) Sheldon Hemry commente: “A partir de 1935, l’Allemagne commence par faire imprimer une monnaie non grevée par la dette et les intérêts: c’est cela qui explique son ascension fulgurante, sa sortie rapide d’une ère dominée par la dépression et la création de toutes les conditions qui en ont fait une puissance mondiale, en moins de cinq ans. L’Allemagne a financé le fonctionnement de son propre gouvernement et toutes les opérations militaires de ses armées de 1935 à 1945 sans avoir eu besoin d’or et sans contracter de dettes; il a fallu l’unité du monde entier, capitalistes et communistes confondus, pour détruire cette puissance allemande et l’hégémonie qu’elle exerçait sur l’Europe et pour ramener celle-ci sous la domination des banques”.
L’hyperinflation de Weimar
Dans les textes modernes on parle souvent de la désastreuse inflation qui a frappé la République de Weimar de 1919 à 1933. La dévaluation catastrophique du mark allemand est citée, dans les textes contemporains, comme l’exemple de ce qui peut arriver si on confère aux gouvernants d’un pays le pouvoir, noncontrôlé, de battre monnaie seul. Cependant, dans le monde fort complexe de l’économie, les choses ne se sont pas passées comme ça. La crise financière de Weimar débute par l’impossibilité d’indemniser les puissances alliées comme l’avait imposé le Traité de Versailles.
Schacht, à l’époque responsable de l’Hôtel des Monnaies de la République de Weimar, se lamentait: “Le Traité de Versailles constitue un système ingénieux de dispositions qui toutes ont pour but la destruction économique de l’Allemagne. Le Reich n’a pas réussi à trouver un système pour se maintenir à flot qui soit différent de l’expédient inflationniste, lequel consiste à continuer à imprimer des billets de banque”. C’est du moins ce que Schacht déclarait au début. Mais l’économiste Zarlenga note par ailleurs que Schacht, dans son livre écrit en 1967 (“The Magic of Money”), avait décidé de “dire la vérité et de coucher sur le papier, en langue allemande, quelques révélations importantes, mettant en pièces les racontars et lieux communs colportés par la communauté des financiers internationaux sur la question de l’hyper-inflation allemande”. Schacht révèle notamment que c’est plutôt la Reichsbank, détenue par des cercles privés, et non le gouvernement allemand qui a sans cesse injecté de nouveaux billets dans l’économie. Par le biais du mécanisme financier connu comme “vente à brève échéance”, les spéculateurs prenaient en prêt des choses qu’ils ne possédaient pas, les vendaient et “couvraient” le déficit en les revendant à un prix inférieur. La spéculation sur le marché allemand fut rendue possible par le simple fait que la Reichsbank mettait à disposition des quantités énormes d’argent liquide pour les prêts; ces marks étaient créés au départ de rien, notés comme inscrits sur les registres bancaires puis prêtés à des taux d’intérêt très avantageux.
Lorsque la Reichsbank n’a plus réussi à faire face aux demandes pressantes de marks, on a permis à d’autres banques privées d’en créer au départ de rien et de les prêter à leur tour pour engranger des intérêts. Selon Schacht ce ne fut donc pas le gouvernement de la République de Weimar qui provoqua l’hyper-inflation; au contraire, il l’a tenue sous contrôle. Il imposa à la Reichsbank des règlements sévères et prit des mesures correctrices immédiates pour bloquer les spéculateurs étrangers, éliminant du même coup la possibilité d’un accès facile aux prêts consentis en cet argent imprimé par les banques. Hitler n’a fait que parachever ce travail amorcé par la démocratie weimarienne, en remettant le pays sur pied avec ses “certificats du Trésor”, imprimés par le gouvernement sur le modèle jadis mis en oeuvre par Lincoln aux Etats-Unis, les “certificats du Trésor” étant l’équivalent allemand et hitlérien des “Greenbacks” du Président anti-esclavagiste. Rappelons toutefois que Schacht avait désapprouvé l’émission de cette monnaie par le gouvernement national-socialiste, ce qui entraîna son renvoi: il fut contraint de quitter son poste de nouveau Président de la Reichsbank, justement parce qu’il refusait de soutenir la politique des “certificats du Trésor” (ce qui le sauva sans doute lors du procès de Nuremberg). Cependant, dans ses mémoires, rédigées bien après coup, après l’épisode hitlérien de l’histoire allemande et le procès de Nuremberg, Schacht a reconnu que l’émission par le gouvernement d’une monnaie nécessaire pour le bon fonctionnement des choses publiques, et dont l’Allemagne aux abois avait un besoin urgent, n’avait pas produit l’inflation que prévoyait, dans de tels cas, la théorie économique classique. Dans ses mémoires, Schacht émet la théorie suivante: le gouvernement national-socialiste a évité l’inflation parce que les usines ne tournaient pas et que les gens étaient sans travail. Schacht est ainsi d’accord avec John Maynard Keynes: quand les ressources pour faire croître la production sont disponibles, ajouter des liquidités à l’économie ne provoque pas l’augmentation des prix; cela provoque plutôt la croissance des biens et des services; l’offre et la demande augmentent alors au même rythme, en laissant les prix inchangés (cf. www.webofdebt).
Ellen BROWN.
(article paru sur www.altrainformazione et sur http://www.ariannaeditrice.it/ en date du 27 juin 2011).
00:05 Publié dans Economie, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : hitler, lincoln, allemagne, états-unis, économie, finance, national-socialisme, weimar, inflation, histoire, années 20, années 30 |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 20 janvier 2013
Consommation et Surconsommation
Consommation et Surconsommation
L’accès à la consommation nous est présenté comme la source du bonheur, alors que paradoxalement, être consommateur rend vaine toute tentative d’accéder au bonheur. La publicité est là pour nous rappeler à l’ordre, pour créer l’insatisfaction, le manque et une dépendance par rapport à des produits qui jusque-là n’étaient pas indispensables à l’épanouissement, et qui s’ajoutent à nos besoins.

Il serait plus sage de ne pas tenter d’avoir tout ce que l’on nous propose, mais de savoir apprécier ce que l’on a. Il faudrait d’ailleurs faire en sorte de se libérer de la surabondance (également surabondance de pollution, d’uniformisation, de stress … etc !) plutôt que de convoiter avec obsession ce qui nous fait défaut (le pouvoir d’achat, l’emploi, l’innovation, les parts de marché, la croissance, etc), pour plus de simplicité et moins d’illusionnisme. Posséder le dernier « iphone » est-il indispensable à la vie ?
Comment les hommes faisaient-ils avant toutes ces technologies high-tech qui se régénèrent indéfiniment ? Comment vivaient-ils, étaient-ils épanouis, étaient-ils en manque? En manque de quoi, de bien matériel ? Mais combien de ces choses sont vraiment utiles à notre épanouissement ? Ne servent-elles pas plutôt à cacher notre frustration devant ce monde que nous avons de plus en plus de mal à comprendre et à appréhender ?
L’expansion du développement transforme sur son passage l’autarcie des peuples en misère, et partout sur terre, goûter à « l’économie de marché » devient une addiction qui se substitue à tout mode de vie alternatif (gratuit) et indépendant (libre). Ce système économique arrivera à son apogée quand la mondialisation aura transformé toutes les cultures et toutes les ressources naturelles en marchandises identiques.
Aujourd’hui l’argent ne représente plus rien de concret et se répand plus vite que les réalités du monde qui nous entoure, l’économie s’est emballée comme un taureau fou. En se déconnectant de la réalité, elle est devenue nocive. Cette pseudo science économique régit les décisions politiques de tout bord, mais dans ses savants calculs, elle oublie un facteur essentiel et déterminant : les limites de la planète.
En revanche elle est la source de gains faramineux pour une petite oligarchie constituée de financiers qui ont su endetté des pays en voie de développement comme le Brésil, aujourd’hui contraint à rembourser sa dette en puisant dans les poumons de la planète : la forêt Amazonienne.
En renouvelant obsessionnellement le marché pour amasser des gains, le progrès technologique a rendu la surproduction et la surconsommation responsable de la plus part des problèmes écologiques. Croire en l’émergence d’une nouvelle technologie pour régler ces déséquilibres serait alors un nouveau piège du progrès. Il est impératif de réduire notre impact sur la planète, nous ne sommes pas des consommateurs nés.
Cette surconsommation nous est imposée malgré nous par le modèle de développement capitaliste. Aujourd’hui cette doctrine consumériste est une foi quasi-religieuse et fondamentaliste. Nous sommes pris en otage par le culte et le conditionnement de la consommation. Dans cet empire économique tout n’est pourtant pas régi par le matérialisme, et il existe quantité d’alternatives pour contribuer à son bien-être.
S’il est parfaitement humain d’avoir des désirs autres que nos besoins fondamentaux, passé un certain seuil ces désirs exacerbés deviennent déraisonnables et finissent par être une source de problèmes pour soi et les autres. De plus l’ironie veut qu’une fois l’objet de son désir obtenu, on est toujours insatisfait. Ces deux constats permettent d’établir que le bonheur ne s’achète pas, le bonheur s’apprend en s’ouvrant au monde et en établissant une éthique personnelle, et non en suivant des modèles préétablis.
(Merci à BOB)
00:05 Publié dans Actualité, Economie, Sociologie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : consommation, consumérisme, économie, sociologie, décadence, actualité, moeurs contemporaines |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
lundi, 14 janvier 2013
Gibt es eine Souveränität ohne Energie-Souveränität?

Gibt es eine Souveränität ohne Energie-Souveränität?
Die Energiewende als Weg in eine friedliche Zukunft? Zu Daniele Gansers Buch «Europa im Erdölrausch. Die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit»
von Tobias Salander, Historiker
Wie hängen Menschenwürde, soziale Gerechtigkeit, nationale Unabhängigkeit, Ernährungs-Souveränität, Energiesicherheit, der Wahrheit verpflichtete Geschichtsschreibung und die Frage von Krieg und Frieden zusammen? Gibt es Frieden ohne den demokratischen Rechtsstaat? Den demokratischen Rechtsstaat ohne Ernährungs-Souveränität? Ernährungs-Souveränität ohne Energiesicherheit? Energiesicherheit ohne Frieden? Oder andersherum: soziale Gerechtigkeit ohne nationale Unabhängigkeit? Nationale Unabhängigkeit ohne Energiesicherheit? Energiesicherheit ohne den demokratischen Rechtsstaat? Den demokratischen Rechtsstaat ohne Frieden? Frieden ohne eine der Wahrheit verpflichtete Geschichtsschreibung? Die einzelnen Elemente liessen sich auch in anderen Kausalketten verknüpfen, die Elemente auch erweitern durch die Begriffe Humanitäres Völkerrecht, Menschenrechte, aufrechter Gang, Zivilcourage usw. – kurz und gut durch das Insgesamt der Uno-Charta als wegweisenden Dokuments für eine bessere, humanere Welt und als Kontrapunkt zu Krieg, Hass, Zerstörung, wie sie die Welt im Zweiten Weltkrieg gesehen hatte und daraus den Schluss zog: Nie wieder!
All die oben aufgeworfenen Fragen und Ansätze zu deren Beantwortung finden sich in dem neuen Buch eines Schweizer Historikers, der schon durch frühere Forschungen aufgefallen war – und zwar auf Grund seiner Unerschrockenheit, absoluten Wahrheitsliebe und Unbestechlichkeit, die ihm so manches berufliche Ungemach und scharfe persönliche Anfeindungen eintrugen – ein Vorgang, der einen Forscher, der auf dem Boden des Humanitären Völkerrechts und der direktdemokratischen Tradition der Schweiz steht, ohne zu wanken, nur adeln kann – zeigt es doch, dass die Arbeit ins Schwarze trifft, kriminelle Energien elitärer Oligarchien aufdeckt und deswegen breit diskutiert gehört.
Dr. Daniele Ganser, Historiker und Gründer des SIPER, des Swiss Institute for Peace and Energy Studies, trägt in seinem minutiös recherchierten Werk «Europa im Erdölrausch. Die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit» Daten und Fakten zusammen, die auf folgende Schlussfolgerung hinauslaufen: Angesichts des 2006 erreichten weltweiten Peak Oil, des Fördermaximums von Erdöl, und des seitherigen Rückgangs der Förderrate bleibt der Weltbevölkerung nur ein Ausweg: zu 100% auf erneuerbare Energien zu setzen und die mit der Energiesicherheit der einzelnen Länder verbundenen Konflikte im Dialog zu lösen. Die Alternativen, die niemand wollen kann, wären Krieg, Gewalt oder Terror, also die altbekannten Mittel der Machtpolitik, welche die Würde des Menschen, die Souveränität der Nationalstaaten und das friedliche Zusammenleben der Völker mit Füssen treten.
Vorbei sind die Zeiten, als Forscher, die auf die Begrenztheit fossiler Energieträger verwiesen, nicht ernst genommen wurden. Die Tatsache, dass das konventionelle Erdöl, das heisst jenes Öl, welches einfach zu fördern ist, 2006 weltweit seinen Peak erreicht hat, ist heute Grundlage der Analysen des Internationalen Währungsfonds (IWF), aber auch der Internationalen Energieagentur (IEA) mit Sitz in Paris. Bemerkenswert, dass die IEA, 1974 als Gegenstück zur OPEC und im Dienste der OECD gegründet, seinerzeit lange daran zweifelte und in ihrem jährlich publizierten Standardwerk World Energy Outlook (WEO) die mögliche Förderquote zwar jährlich nach unten korrigieren musste, dann aber mit dem Jahrbuch 2010 den Peak Oil ebenfalls auf 2006 datierte.
Was Ganser mit seinem Buch gelingt und es für die Schule ab Oberstufe qualifiziert, ist sein polyperspektivischer Ansatz: Statt dass er selber Wertungen vornimmt, ausser dort, wo die Sachlage absolut eindeutig ist, lässt er immer die Sicht der Betroffenen und der Akteure zu Wort kommen – Aussagen, die in ihrer Klarheit, ja zum Teil Unverfrorenheit zum eigenen Nach- und Weiterdenken veranlassen. Oder um sein Anliegen mit dem von ihm zitierten Friedrich Nietzsche zu formulieren: «Es gibt nur ein perspektivisches Sehen, nur ein perspektivisches Erkennen. […] Je mehr Affekte wir über eine Sache zu Wort kommen lassen, je mehr Augen, verschiedene Augen wir uns für dieselbe Sache einzusetzen wissen, um so vollständiger wird unser ‹Begriff› dieser Sache, unsere ‹Objektivität› sein.» (Ganser S. 320. Zitat aus: Schönherr-Mann, Hans-Martin: «Friedrich Nietzsche». Paderborn 2008, S. 38)
George W. Bush: «Die USA sind erdölsüchtig»
Was 1859 in Titusville, Pennsylvania, begann und einen unglaublichen Wohlstand für viele Menschen mit sich brachte, vor allem natürlich in der ersten Welt, die Förderung von Erdöl, hat sich seit dem Zweiten Weltkrieg zu einem wahren Erdölrausch mit allen Begleitumständen eines Suchtverhaltens entwickelt. Wurden 1945 weltweit 6 Millionen Fass (à 159 Liter) pro Tag verbraucht, sind wir 2012 bei der schwer vorstellbaren Zahl von 88 Millionen Fass angelangt, einer Menge, die 44 Supertanker täglich über die Weltmeere transportieren!
Die grössten Süchtigen sind die USA mit 20 Millionen Fass täglichen Verbrauchs, dann China mit 9 Millionen Fass. Weniger im Vordergrund der Medien, aber um so zentraler für uns Europäer: Europa liegt immer noch weit vor China mit 15 Millionen Fass pro Tag.
Diese Zahlen und die Tatsache, dass die USA ihren Peak Oil schon 1970 hatten, China 1994, Grossbritannien und Norwegen im Jahre 2000, machen verständlich, dass heute eine scharfe Konkurrenz in Energiefragen zwischen China, den USA und, wenn auch verdeckter, Europa besteht. Wie sagte es im April 2006 George W. Bush in seiner State-of-the-Union-Botschaft? «Die USA sind erdölsüchtig. Und dieses Erdöl muss oft aus instabilen Regionen der Welt importiert werden.» Und der nun wiedergewählte Barak Obama gemäss «Neuer Zürcher Zeitung» vom 5. August 2008: «Unsere Sucht nach Öl zu durchbrechen ist eine der grössten Herausforderungen, der unsere Generation je gegenüberstehen wird.»
Weitere Kriege um Öl – oder friedliche Energiewende?
Kostete ein Fass Öl von 1950 bis 1960 konstant 2 Dollar, waren es 1999 schon 10 Dollar, 2008 dann aber die bis dato unvorstellbare Summe von 148 Dollar! Wenn auch heute der Preis wieder etwas gesunken ist, verharrt er weiterhin auf einem hohen Niveau, was gängigen Preisentwicklungsmodellen widerspricht und erstmalig in der Geschichte der Erdölförderung vorkommt. So musste die IEA 2008 die ernste Warnung publizieren, dass die Produktion vielerorts rückläufig sei, und dies bei steigender globaler Nachfrage: ein ungelöstes Problem!
Auf Grund dieser eindeutigen Faktenlage und in Kenntnis des dunklen Stromes der Menschheitsgeschichte, einer Geschichte, die einerseits zwar so reich an prohumanen Abläufen, Persönlichkeiten und Gemeinschaften ist – es seien nur die Arbeiten über die Genossenschaften von Elinor Ostrom und das Uno-Jahr der Genossenschaften 2012 in Erinnerung gerufen, ganz zu schweigen vom genossenschaftlichen Aufbau des Friedensmodells Schweiz –, andererseits aber auch menschliche Niedertracht aufweist, ein defizitäres Verhältnis des Menschen gegenüber der menschlichen Natur, gipfelnd in der Gier nach Geld, Macht und sexueller Perversion: Eingedenk dieses Hintergrundes stellt Daniele Ganser die These auf und belegt sie auch mit ungezählten Dokumenten, die These, dass die USA und die europäischen Länder heute, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, Kriege führen, um Erdöl zu erbeuten – und mitnichten aus humanitären Gründen.
Oder wie kamen die drittgrössten Erdölreserven wieder in die Hand der westlichen Konzerne? Stichwort Irak-Krieg 2003. Wie kam die grösste Ölreserve Afrikas wieder an die Nachkommen der 7 Schwestern, der grossen westlichen Erdöl-Konzerne wie jene aus dem Hause Rockefeller und Rothschild? Stichwort Libyen-Krieg 2011. Und wird Syrien in einen Krieg um Gas getrieben?
Ganser gibt zu bedenken, dass wir im Westen dies gerne verdrängen würden, dass für Erdöl getötet werde. Seine sauber dokumentierten Belege machen aber künftig eine Verdrängung unmöglich. Und genau das ist das Anliegen des Autors: Einen Bewusstseinswandel herbeizuführen, denn ohne den sei die Energiewende nicht möglich, und schon gar nicht mit den alten barbarischen Methoden des Krieges und der Gewalt. Die vier nicht erneuerbaren Energiequellen: Erdöl, Erdgas, Kohle und Uran, seien durch die 6 erneuerbaren, nämlich Sonne, Wasser, Wind, Biomasse, Biogas, Erdwärme, zu ersetzen. Gemäss WWF Schweiz sei eine hundertprozentige Energiewende bis zum Jahr 2050 machbar.
Unser Zeitalter ist lediglich ein fossiles Intermezzo
Nach einem Blick in die Geologie und die Geschichte der letzten 2000 Jahre, die sich packend liest, da leicht verständlich geschrieben, und sich für Schüler ab der Oberstufe bestens eignet, bilanziert Ganser: Heute leben wir in einem fossilen Energierausch und haben vergessen, dass die Energie einst knapp und sehr teuer war! In den letzten 200 Jahren hat Europa fossile Energieträger verbraucht, die endlich sind – die Schattenseiten aber wurden ausgeblendet!
Unser Zeitalter sei historisch gesehen lediglich ein «fossiles Intermezzo», das allerdings vielen Menschen eine Mobilität gebracht habe, die im Mittelalter nicht einmal Königen möglich war!
Nebst der Beschreibung der Entstehung der grossen integrierten Konzerne wie Standard Oil, Royal Dutch Shell, British Petroleum, Total und Eni, in einer späteren Phase dann auch der staatlichen Konzerne der OPEC-Staaten wie Saudi-Aramco usw. leistet Ganser aber auch eine Arbeit, die schon lange erwartet wurde: Integriert in die Geschichte des «schwarzen Goldes» ist eine Schweizer Geschichte, die eine wohltuende sachliche Darlegung der geostrategischen Lage der Eidgenossenschaft beinhaltet, insbesondere auch während der beiden grossen Kriege des 20. Jahrhunderts.
Erpressungsmittel Kohle und Öl – eine implizite Widerlegung von Bergier
Da wird glasklar dargestellt, dass sowohl in der grössten Katastrophe der bisherigen Menschheitsgeschichte, dem Zweiten Weltkrieg als auch dem Morden des Ersten Weltkrieges, die Schweiz sich im Würgegriff der kriegsführenden Mächte befand und schon früh von den Briten und den Franzosen erpresst wurde, später auch von den USA, aber auch von den Nationalsozialisten. Alle Kriegsparteien wähnten, die kleine, neutrale Schweiz könne zur Sicherheitslücke werden und ihre mühsam importierten Produkte dem Feinde weiterreichen. Dass die wirtschaftliche Souveränität der Schweiz im Ersten Weltkrieg verlorenging, weil die Briten und die Franzosen den Handel nach ihrem Gusto diktierten, liest man als Schweizer Bürger nicht gerne – vor allem auch im Hinblick auf die heutige Situation, umringt von einer krisengeschüttelten EU und als Nachbar eines Deutschlands, welches unverschämte Töne anschlägt und eine Machtpose einnimmt, die an ungute Zeiten erinnert. Die doppelte Würgeschlinge im Zweiten Weltkrieg, die rigorosen kriegswirtschaftlichen Sparmassnahmen, die dunklen und kalten Wohnungen, die Macht von König Kohle, damals noch weniger vom «schwarzen Gold» – all die Ausführungen Gansers lassen eine Rekonstruktion der Ereignisse zu, die ein Bergier-Bericht verunmöglichte, ja in seiner ideologischen Zielrichtung gar bekämpfte. Ohne den Namen Bergier überhaupt nur in den Mund zu nehmen – ein nachahmenswertes Vorgehen, ist doch für das geheimdienstliche Bergier-Machwerk das Papier zu schade, auf dem es gedruckt wurde –, wirkt die sachliche Darstellung Gansers als Antidot, als Gegengift, welches die Köpfe klärt, die Sinne entwirrt und klar herausstreicht: ohne zähe Verhandlungen wären die Schweizer erfroren oder verhungert. Und: Was bereits Autoren wie Charles Higham («Trading with the Ennemy»), Herbert Reginbogin («Hitler, der Westen und die Schweiz»), Alberto Codevilla («Eidgenossenschaft in Bedrängnis») und andere klarstellten (vergleiche auch Zeit-Fragen Nr. 33 vom 20. August 2012): Ohne die Lieferung von Erdöl und seinen Derivaten wie Antiklopfmittel und anderen hätte Mussolini seine Äthiopien-Aggression nach einer Woche abbrechen müssen, wären Hitlers Panzerarmeen mit ihrer Blitzkriegstaktik aus Mangel an Treibstoff schon lange zum Stehen gekommen. Aber man lieferte so lange, wie man Hitler brauchte, um Stalin auszubluten, und als dann Rommel gegen Baku vorstossen sollte, da gingen die Treibstoffreserven plötzlich zur Neige, da die britische Flotte im Mittelmeer die deutschen Tankschiffe versenkte.
Der Zweite Weltkrieg aus der Perspektive des Erdöls – ein anderer Krieg als der, den man in den bisherigen Geschichtsbüchern antrifft.
Öl und der Schuss von Sarajevo, Öl und Pearl Harbor
Hatte nach dem Ersten Weltkrieg der britische Lord Curzon festgehalten: «Die alliierte Sache ist auf einer Woge von Öl zum Sieg geschwommen», so liess Stalin am Ende des Zweiten Weltkrieges in einem Toast gegenüber Churchill die US-Ölindustrie hochleben und sagte: «Dies ist ein Krieg der Motoren und der Oktanzahl.» Auf der anderen Seite hatte Hitler schon früh konstatiert: «Um zu kämpfen, brauchen wir Erdöl für unsere Maschinen.» Und: «Wenn wir das Öl bei Baku nicht kriegen, ist der Krieg verloren.»
Ganser hält fest, dass nicht nur für den Ersten, sondern auch für den Zweiten Weltkrieg die Rolle des Öls stark unterschätzt werde: Mit den USA kämpfen hiess, genügend Erdöl zu haben – und zu gewinnen.
Ganser geht unter Beizug der Quellen und Darstellungen ganz nahe an diverse Ereignisse heran, die in den Schulgeschichtsbüchern tunlichst umschifft werden:
Natürlich fiel in Sarajevo der weltberühmte Schuss – dass aber gerade Serbien das einzige Glied in einer Kette war, bei welchem die Briten die deutschen Bestrebungen, das Öl aus dem Irak via die Berlin–Bagdad-Bahn zu transportieren, noch unterbinden konnten, um ihre Weltmachtstellung, die Beherrschung der Ölrouten mit ihrer Flotte, zu sichern, wird plausibel dargestellt – und lässt weitergehende Schlüsse zu …
Was Pearl Harbor betrifft, lässt Ganser den 1942 bis 1946 in der US-Marine tätigen Robert Stinnett zu Wort kommen: Danach hat Roosevelt Japan mit dem Ölembargo bewusst provoziert, um die USA als Opfer einer Aggression in den Krieg führen zu können. Der Präsident «war gezwungen, zu um- und abwegigen, auch zu unsauberen Mitteln zu greifen, um ein isolationistisch gesonnenes Amerika zur Beteiligung an einem Kampf für die Freiheit zu überreden». Stinnetts Buch sei die fundierteste und umfassendste Untersuchung zu Pearl Harbor.
Einbezug von Öl taucht so manches Ereignis in ein anderes Licht …
Die Fülle des Buches von Ganser kann hier nicht andeutungsweise gewürdigt werden. Es seien hier aber weitere Kostbarkeiten aus seinem Werk in Form von Kapiteltiteln genannt:
«Der Aufstieg von Saudi-Arabien und Saudi Aramco», «Der Sturz der iranischen Regierung durch die USA 1953», «Die Suezkrise und die Angst vor Lieferunterbrüchen», «Der Bau von Pipelines in den USA und Europa», «Der italienische Erdölkonzern ENI und der Tod von Enrico Mattei», «Der Bau der Zentraleuropäischen Pipeline CEL über die Alpen», «Der Bau der Transalpinen Pipeline TAL durch Österreich», «Die Macht der Kartelle», «Die sieben Schwestern und das Kartell von Achnacarry», «Die Milliardengewinne der Erdölkonzerne», «Die Gründung der OPEC 1960», «Die erste Erdölkrise 1973» usw., usw.
Und so geht es weiter zum Club of Rome, zur zweiten Erdölkrise, den Golf-Kriegen, 9/11 und den jüngsten Kriegen bis zum Libyen-Krieg. Ältere Semester erleben bei der Lektüre dieser Kapitel das eine oder andere Déjà-vu, sind vielleicht einmal mehr erschüttert ob der kriminellen Energie der Akteure des Westens, während jüngere Leser, die zur Zeit von 9/11 noch im Kindergartenalter standen, sich ein Bild machen können über die Zeit, die ihre Kindheit und Jugend geprägt hat, ohne dass sie dies bisher, altersbedingt, hatten durchschauen können.
Ölkrise von 1973: US-Inszenierung vor dem Hintergrund des US-Peak-Oil
Aus der Fülle der Einsichten, die man Gansers Buch entnehmen kann, hier kurz einige Stichworte zur Erdölkrise von 1973. Worum ging es dabei noch einmal? Um Ölknappheit? Von wegen. Es war eine Preiskrise, keine Mengenkrise. Und im Hintergrund stand, so die These Gansers, die vorausgegangene Dollarkrise. Und hinter dieser Peak Oil in den USA.
Aber der Reihe nach: Als Folge des teuren Vietnam-Krieges waren mehr Dollars im Umlauf, als Gold im Keller der FED, der privaten US-Notenbank, lagerte. Viele Notenbanken verlangten deshalb Gold für ihre Dollars. Als Frankreich 1969 seine Dollarreserven in Gold einlösen will, sehen sich die USA nicht in der Lage dazu! Denn die Goldreserven der USA deckten nur noch ¼ der US-Auslandschulden. Es war also nicht das Öl knapp, sondern das Gold zur Deckung der Dollars, mit denen man Öl kaufen wollte. In dieser Situation riet Henry Kissinger – seit 1969 nationaler Sicherheitsberater, ab 1973 Aussenminister – mit anderen, Nixon solle die Golddeckung des Dollars aufheben. Und am 15. August 1971 verkündete Nixon die Aufhebung der Golddeckung des Dollars im TV und löste damit das aus, was als «Nixon-Schock» in die Geschichte einging. Europa zeigte sich verstimmt, die Erdölexporteure erhielten nun weniger für ihr Öl, für die USA hingegen hatte dieser Schritt grosse Vorteile: Bis heute kann die FED aus dem Nichts Dollars drucken und gegen Öl eintauschen!
Ben Bernanke, Chairman des FED, brachte es später auf den Punkt: «Die US-Regierung hat eine Technologie, genannt Druckpresse (bzw. heute ihre elektronische Version), die es ihr erlaubt, so viele Dollars zu drucken, wie sie will, und das praktisch gratis.»
Oder mit den Worten von Professor Walter Wittmann, Uni Freiburg, 2008: «Die US-Notenbank FED produziert, wenn nötig, Dollarscheine wie die Firma Hakle Klopapier.»
Kissinger und Bilderberger wollten höheren Ölpreis
Mögen diese Abläufe durchaus nicht unbekannt sein, so geht Ganser einen Schritt weiter in der Aufdeckung der Hintergründe, er zieht quasi einen weiteren Vorhang, der die wahren Fakten verbirgt: Hinter der Auflösung der Golddeckung von 1971 stehe die einbrechende Erdölproduktion in den USA von 1970. Das heisst, die USA mussten nun mehr Öl importieren, und dies ist nun mal viel billiger ohne Golddeckung, da man so die Dollarmenge einfach ausweiten kann.
In der weiteren Darlegung der 1973er Hintergründe folgt Ganser einem Rat von Scheich Ahmad Zaki Yamani, seines Zeichens von 1962 bis 1986 Erdölminister von Saudi-Arabien, vom US-Magazin Time zum Mann des Jahres 1973 gewählt und auch als «Stratege der Ölwaffe» tituliert. Ebendieser Yamani empfiehlt nun das Buch des US-Journalisten William Engdahl, «Mit der Ölwaffe zur Weltmacht», als einzige zutreffende Darstellung der Ölpreisentwicklung von 1973.
Demzufolge habe vom 11. bis 13. Mai 1973, vor der Krise, in Schweden ein Treffen der Bilderberger stattgefunden, der Hintergrundsgruppe, die sich 1954 zum ersten Mal im Hotel Bilderberg in Holland traf.
Am Treffen von 1973 hätten Henry Kissinger, Lord Greenhill von BP, David Rockefeller von der Chase Manhattan Bank, George Ball von Lehman Brothers und Zbigniew Brzezinski über den Zerfall des Dollars und die Erhöhung des Ölpreises gesprochen. Dabei sei die Rede von 400 Prozent gewesen. Effektiv stieg dann als Resultat der Ölkrise der Ölpreis auch um 400 Prozent und entschärfte so die Dollar-Krise!
Reza Pahlavi drängt OPEC auf Geheiss der USA in die Rolle des Sündenbocks
Der Plan der verschworenen Gruppe sah wie folgt aus: Ein globales Ölembargo der OPEC würde die Ölversorgung drastisch verknappen, damit stiegen die Ölpreise dramatisch an, damit auch die Nachfrage nach Dollars, und dies würde dann den Wert des Dollars stützen! So hätten trotz Rezession in den USA die USA profitiert! Die Volkswut würde sich gegen die Scheiche richten, die eigentlichen Drahtzieher blieben unerkannt und könnten sich als Opfer darstellen.
Ganser bedauert, dass diese These von Yamani und Engdahl kaum diskutiert werde, zudem seien auch die Sitzungen der Bilderberger geheim. Deswegen liesse sich die These nicht beweisen.
Aber realiter lief es genau so: Die OPEC beschliesst am 16. Oktober 1973 anlässlich des Jom-Kippur-Krieges, den Ölpreis mehr als zu verdoppeln, und zweitens Förderkürzungen plus einen Totalboykott der USA und der Niederlande sowie Lieferkürzungen für Industrieländer, bis Israel sich aus den 1967 besetzten Gebieten zurückziehe.
Das Wort «Erdölboykott» hatte eine enorme Wirkung: Die Menschen meinten, das Öl werde knapp, die westlichen Medien hetzten gegen die OPEC – aber alles stellte sich als Mythos heraus!
Im Dezember 1973 fand die Konferenz der OPEC in Teheran statt. Diskutiert wurde über den gerechten Ölpreis. Schliesslich kam es zur Versechsfachung des Preises in nur drei Monaten!
Laut US-Erdölforscher Yergin war der Schah Reza Pahlavi am aggressivsten für eine Erhöhung des Ölpreises, mehr als Yamani, der nicht wollte, dass der Westen untergehe, weil dann auch die OPEC unterginge.
Dass gerade der Schah als Statthalter des Westens – von den Briten und den USA unterstützt nach deren Sturz von Mossadegh – sich für höhere Preise stark machte, scheint paradox, denn das schadete den USA. Doch 2001 äusserte sich Yamani dazu: Der Schah habe ihm gesagt, dass Kissinger einen höheren Ölpreis wolle.
Für Yamani ist heute klar: Die USA haben die Erdölkrise von 1973 und das Anheben des Ölpreises von 2 auf 12 Dollar inszeniert. Die OPEC bekam die Rolle als Sündenbock.
Zitate, die den Chefankläger des ICC interessieren müssten …
Es seien hier einige der pointierten Äusserungen von Politikern der US-UK-Kriegsallianz zitiert – die ältere Generation kennt sie irgendwie noch alle, es ist aber das Verdienst Gansers, sie gerade auch für die jüngere Generation zusammengetragen zu haben: In ihrer Dichte, Unverfrorenheit und Chuzpe lassen sie eigentlich keine Frage offen, wer heute vor den ICC gehörte wegen flagranter Verletzung der Nürnberger Prinzipien. Damals, bei der Aburteilung der Nazi-Kriegsverbrecher, hatte ja US-Chefankläger Robert Jackson gesagt, an diesen Prinzipien wollten sich künftig auch die USA messen lassen. Und da das schlimmste aller Verbrechen der Angriffskrieg sei, und Kofi Annan zum Beispiel den Irak-Krieg 2003 als solchen bezeichnete, müssten ganze Heerscharen, angefangen von westlichen Staatsoberhäuptern bis hinunter zum einfachen Soldaten, die Untersuchungshaftzellen in Den Haag bevölkern. Man erinnert sich: Der deutsche Offizier Florian Pfaff, der während des völkerrechtswidrigen Angriffskrieg von 2003 gegen den Irak den Befehl verweigerte, genau unter Berufung auf die Nürnberger Prinzipien und die Uno-Charta, dort insbesondere Artikel 51, bekam in Deutschland recht – wurde aber dennoch militärisch degradiert …
Der Reigen der Zitate sei eröffnet mit Sätzen von Henry Kissinger. Am 22. September 1980, als der Irak mit US-Unterstützung Iran angreift, sagt Henry Kissinger: «Ich hoffe, sie bringen sich beide um, es ist zu schade, dass sie nicht beide verlieren können.» Heute ist bekannt, seit der Iran-Contra-Affäre, dass die USA auch Iran mit Waffen unterstützten – ganz im Sinne des Diktums von Friedensnobelpreisträger Kissinger …
Am 12. Mai 1996 sagte in «60 Minutes» von CBS Madeleine Albright, die damalige Uno-Botschafterin und spätere Aussenministerin der USA, in einem Interview auf die Frage, es seien schon 500 000 Kinder im Irak gestorben, mehr als in Hiroshima, ob das Embargo diesen Preis wert sei: «Ich glaube, das ist eine sehr schwierige Entscheidung, aber der Preis – wir glauben, es ist diesen Preis wert.»
Fazit Ganser: Womit klargeworden ist, dass die USA bereit sind, für Erdöl zu töten, auch Kinder!
John Bolton, Uno-Botschafter unter Bush und Senior Fellow von PNAC auf Fox News 2011: Der Nahe Osten sei «die kritische Erdöl- und Erdgas-produzierende Region der Welt, in der wir so viele Kriege geführt haben, um unsere Wirtschaft vor den negativen Folgen zu schützen, den Erdölzufluss zu verlieren oder ihn nur zu sehr hohen Preisen zu erhalten». al-Kaida wird von Bolton hier plötzlich nicht mehr erwähnt – hatte der Mohr gedient und konnte nun gehen?
Im November 1999 warnt Dick Cheney, CEO von Halliburton, anlässlich einer Rede in London explizit vor Peak Oil. Die Nachfrage werde ansteigen, die Produktion gleichzeitig zurückgehen. Woher solle also das Öl kommen, 2010 zusätzliche 50 Millionen Fass pro Tag?
Prophetisch seine Antwort: «Obschon auch andere Regionen der Welt grosse Möglichkeiten für die Erdölförderung bieten, bleibt der Nahe Osten mit zwei Dritteln der Erdölreserven und tiefen Produktionskosten die Region, wo der Hauptpreis liegt. Erdölfirmen hätten gerne besseren Zugang zu dieser Region.» Brauchte es da nicht nur noch ein «katalytisches Ereignis», um Truppen entsenden zu können? Wie der Oberkommandierende der Nato im Kosovo-Krieg, General Wesley Clark an mehreren Stellen äusserte, waren ja im Pentagon die Kriege gegen den Irak, Libyen, Syrien und andere schon lange vor 9/11 geplant …
Forschungsverbot für 9/11?
Im Januar 2001 gründete Dick Cheney die National Energy Policy Development Group (NEPDG), eine Expertengruppe zu Erdöl- und Energiefragen. Sie tagte geheim bis im Mai 2001 und plante die Energiezukunft der USA. Mit dabei sassen Konzernlobbyisten, die US-Aussen-, Energie- und Finanzminister. Ihren Befund reichten sie Präsident Bush weiter, der im Mai 2001 an die Presse geht und sagt: «Was die Leute laut und deutlich hören müssen, ist, dass uns hier in Amerika die Energie ausgeht. Wir müssen zusätzliche Energiequellen finden.»
Trotz Bemühungen von demokratischen Parlamentariern blieben die Sitzungsunterlagen und die Grosszahl der Teilnehmenden geheim, der Schlussbericht aber wurde am 17. Mai 2001 veröffentlicht: Ihm war zu entnehmen, dass die USA zuwenig Öl haben, und dies gefährde die nationale Sicherheit, die Wirtschaft und den Lebensstandard. So würden die USA immer abhängiger vom Ausland. Da im Nahen Osten zwei Drittel der Reserven lagerten, bleibe die Golfregion sehr wichtig für die US-Interessen.
Wieso ist uns heutigen Bürgern und schon den Zeitgenossen im September 2001 dieser Sachverhalt kaum mehr bewusst? Der Schock von 9/11 verdrängte das Thema des Peak Oil vollständig aus den Schlagzeilen. Wurde vorher noch klar deutlich, dass man Kriege wegen Öl führte, fanden die kommenden Kriege unter dem Label «Krieg dem Terror» und für die «Verbreitung der Demokratie» statt – ein Slogan, den Edward Bernays, Verfasser des Werkes «Propaganda» und einer der ersten Spin-doctors, schon für den Kriegseintritt der USA in den Ersten Weltkrieg kreiert hatte.
Bush und Cheney hatten sofort al-Kaida und Osama bin Ladin verantwortlich gemacht. Bush trat vor der Uno am 10. November 2001 sogenannten «Verschwörungstheorien» entgegen, wonach die USA die Anschläge manipuliert hätten, um Ressourcenkriege führen zu können.
Erstaunlicherweise hielten sich die Europäer brav an die Sprachregelung von Bush, obwohl jeder einigermassen an Geschichte Interessierte doch weiss, dass es in der Geschichte von Lügen, geheimen Absprachen und Verschwörungen nur so wimmelt. Zum Beispiel der Mord an Cäsar, der Angriff von Frankreich, Grossbritannien und Israel gegen Ägypten 1956, die Brutkastenlüge 1990, die Nato-Geheimarmeen, der Reichstagsbrand usw.
Ganser kritisiert, dass Bush mit seinem Statement vor der Uno verlangt habe, dass seine eigene Verschwörungstheorie geglaubt werde; damit habe er ein eigentliches Forschungsverbot zu 9/11 erlassen – ein Sachverhalt, der wissenschaftlich nicht haltbar sei, müsse doch Forschung immer Fragen stellen und Theorien untersuchen dürfen. Forschungsverbote kennt man ja sonst nur aus Diktaturen.
Welche Rolle spielte Dick Cheney?
Europa, so Ganser, dürfe sich der viel offener geführten Diskussion über Geostrategie in den USA anschliessen. Insbesondere müsse dabei die Rolle von Dick Cheney weiter erforscht werden.
So verlangte zum Beispiel das Project for the New American Century (PNAC), ein neokonservativer Think tank, schon im Januar 1998 einen gewaltsamen Regimewechsel im Irak: Die USA sollen die Welt dominieren, auch durch die Kontrolle von Erdöl. Mitunterzeichner waren Cheney, Rumsfeld und Wolfowitz. Der damalige Präsident Clinton hatte allerdings kein Gehör dafür.
Erst unter Präsident Bush hatten Cheney als Vizepräsident und Wolfowitz als stellvertretender Verteidigungsminister Einfluss. In dem Zusammenhang zitiert Ganser aus einer Wolfowitz-Rede in Singapur von 2003: «Der wichtigste Unterschied zwischen Nordkorea und dem Irak liegt darin, dass wir beim Irak aus wirtschaftlicher Sicht einfach keine Wahl hatten. Das Land schwimmt auf einem See aus Erdöl.» (Iraq War Was About Oil. In: «The Guardian» vom 4.6.2003) Wolfowitz offen und ehrlich: Die Kontrolle der Erdölreserven am Golf sei zentral für die USA. Und al-Kaida?
Einen US-Autor, der einen Zusammenhang zwischen 9/11 und Peak Oil sieht, würdigt Ganser besonders: Es ist Michael Ruppert, Ex-Polizist von Los Angeles. Seine These lautet: Zwischen 1998 und 2000 seien sich die US-Eliten des Peak-Oil-Problems bewusst geworden. Ab Januar 2001 hätten Cheney und andere sich entschieden, Terroranschläge zu manipulieren. Im Mai 2001 habe Bush Cheney die Verantwortung für Terrorismus übergeben, an 9/11 habe Cheney die totale Kontrolle gehabt. Sie hätten das kriminelle Vorgehen für richtig gehalten, da es ja «nur um einige tausend Menschenleben» gegangen sei. (Quelle: Michael C. Ruppert. «Crossing the Rubicon: The Decline of the American Empire at the End ot the Age of Oil.» Gabriola Island 2004.)
Hochrangige US-/UK-Zeitzeugen: Es ging ums Öl!
Und nochmals sei General Wesley Clark als Zeuge herbeigezogen: Wolfowitz habe ihm diese Pläne schon 1991 erklärt, was ihn schockiert habe. Wolfowitz habe gesagt: «Was wir aus dem Golf-Krieg gelernt haben, ist, dass wir unser Militär in dieser Region – dem Nahen Osten – einsetzen können, und die Sowjets stoppen uns nicht. Wir haben jetzt etwa fünf oder zehn Jahre, um diese alten Sowjetregime – Syrien, Iran und Irak – wegzuräumen, bevor die nächste grosse Supermacht kommt und uns herausfordert.» (Rede von Wesley Clark vom 3. Oktober 2007 beim Commonwealth Club in San Francisco. Zitiert in: Wes Clark and the neocon dream. In: «Salon News» vom 26.11.2011)
Und ein ähnlich hochrangiger Zeitzeuge, eventuell der hochrangigste, da er Mitglied der Cheney Energy Task Force war, Paul O’Neill, Finanzminister unter Bush, erklärt, es habe nie eine Verbindung des Irak zu den Terroranschlägen gegeben, und: Der Krieg gegen den Irak sei schon lange vor 9/11 geplant gewesen.
Und wie wurde die Thematik vom engsten Verbündeten Grossbritannien her betrachtet? Dort handelte sich der Umweltminister Michael Meacher seine Entlassung ein, weil er Tony Blair wie folgt kritisiert hatte: «Der Krieg gegen den Terrorismus ist ein Schwindel, das Ziel der USA ist die Weltherrschaft. Dazu brauchen sie die Kontrolle über die Ölvorräte.» Fakt sei, dass «den USA und Grossbritannien die sicheren fossilen Reserven ausgehen». Auch Grossbritannien sei «nicht uninteressiert an diesem Wettrennen um die verbleibenden Vorräte an fossilen Energieträgern, was zum Teil erklärt, warum wir Briten in diesen Militäraktionen der USA mitmachen.» («This war on terrorismus is bogus», in: «The Guardian» vom 6.9.2003)
Heutige Quellen, nach dem «Freedom of Information Act» von Greg Muttitt erstritten, geben Meacher recht: Im Oktober und November 2002, ein halbes Jahr vor der Invasion, besprachen Konzernvertreter und die britische Regierung den Zugang zum irakischen Öl.
Oder mit den Worten der US-Autorin Antonia Juhasz: Ziel des Irak-Krieges sei es gewesen, staatliches Öl zu privatisieren und Konzernen zugänglich zu machen. Denn: In 15 Jahren gingen den Konzernen die Reserven aus, deshalb sei der Zugriff auf Reserven der OPEC-Länder für sie überlebenswichtig.
Wenn es Alan Greenspan schon zugibt …
Hier sei zum Abschluss ein Mann zitiert, der durchaus als Kronzeuge gelten darf, hatte er doch den Dollardruck in der Hand: Alan Greenspan, Chairman der Federal Reserve. Ganser zitiert ihn mit folgender, alles entlarvender Aussage: «Ich finde es bedauerlich, dass es politisch unangebracht ist zuzugeben, was alle schon wissen: Im Irak-Krieg ging es vor allem um das Erdöl.» (Alain Greenspan, zitiert in: «Greenspan admits Iraq was about oil». In: «The Guardian» vom 16.9.2007.)
Dass bei solch hochkarätigen Zeugen die Forschung nicht in unzähligen Ländern darauf erpicht ist, mehr Licht ins Dunkel zu bringen, spricht Bände.
BR Couchepin und Kofi Annan: Irak-Krieg verstösst gegen die Uno-Charta
Und wie wurden diese Abläufe in der neutralen Schweiz kommentiert? Ganser bringt hier eine Aussage zum Vorschein, die wohl auch schon wieder vergessen gegangen ist und der Parteizugehörigkeit des Sprechers wegen vielleicht erstaunen mag. Am 20. März 2003 sagte Bundesrat Pascal Couchepin (FDP) vor der Bundesversammlung: Der Krieg gegen den Irak sei vom Sicherheitsrat der Uno nicht bewilligt worden und deswegen ein gefährlicher Präzedenzfall. Die USA und die Koalition hätten sich über die Uno-Charta hinweggesetzt. Es sei ein Gebot der Stunde, dass die Uno-Charta wieder mehr respektiert werde. Die Schweiz zeige sich solidarisch mit der irakischen Zivilbevölkerung, die seit den Sanktionen von 1990 leide.
Aussagen, die von höchster Uno-Ebene bestätigt wurden: So erklärte am 16. September 2004 der damalige Uno-Generalsekretär Kofi Annan den Irak-Krieg gemäss Völkerrecht als illegal.
Ganser gibt zu bedenken, dass mit dem Geld für all diese völkerrechtswidrigen Kriege problemlos und in hohem Masse erneuerbare Energien hätten gefördert werden können. Er bedauert, dass es keine Debatte über Ressourcenkriege gab. Und ganz im Gegenteil hätten diese westlichen Erdölbeutezüge die Terrorgefahr nicht etwa gemindert, sondern im Gegenteil erhöht.
Als Zeugen führt Ganser den algerischen Intellektuellen Rachid Boudjedra an: Der Westen sei in seiner Gier von korrupten arabischen Herrschern flankiert. Nicht der Islam an sich, sondern die Wunden, die durch die westliche Gewalt zugefügt worden seien, führten junge Männer den radikalen Islamisten in die Arme!
Um es mit Michel Chossudovsky von der Universität Ottawa in Kanada aktualisierend zusammenzufassen: Der Libyen-Krieg war wie der Irak-Krieg ein Erdölbeutezug. Es ging darum, die Erdölindustrie des Landes zu privatisieren.
Energiewende oder endlose Ressourcenkriege, Lügen, Leid und Not?
Gansers Fazit: Bedauerlicherweise investiere die Welt heute mehr in die Rüstung als in die Energiewende. So betrügen die weltweiten Militärausgaben im Jahre 2010 1600 Milliarden Dollar. An der Spitze stehen die grossen Erdölkonsumenten: Die USA mit 700 Milliarden, China mit 120 Milliarden Dollar. Ganser dazu: «Wer auf Gewalt setzt und bereit ist, für das Erbeuten von Erdöl und Erdgas zu töten, kann sich strategische Vorteile verschaffen. Doch das Grundproblem, dass in verschiedenen Ländern die Erdölforderung einbricht, lässt sich mit Gewalt niemals lösen. Es gilt daher, Ressourcenkriege zu vermeiden, Konflikte, wo immer möglich, ohne Gewalt zu lösen und die verfügbaren Mittel für die Energiewende einzusetzen. Nur erneuerbare Energien können letztendlich aus der Knappheit führen, weil sie über Generationen zur Verfügung stehen.» (Ganser, S. 322)
Und am Schluss seines Werkes resümiert der Autor: «Nachdem ich während Jahren die Entwicklung der Ölförderung, Rüstungsausgaben und verschiedene Lügen und Täuschungsmanöver im Umfeld von Ressourcenkriegen studiert habe, hoffe ich heute sehr, dass die Energiewende gelingen wird, und ich setze mich mit dem Swiss Institute for Peace and Energy Research (SIPER) für eine Unterstützung dieser Transformation ein. Ich bin mir aber auch bewusst, dass der Weg noch weit und die Gefahr des Scheiterns gross ist. Gelingt die Energiewende? Ich weiss es nicht, aber ich hoffe es. Oder erwarten uns, unsere Kinder und unsere Enkel Ressourcenkriege, Rezessionen, Klimawandel und Wasserknappheiten? Die Zukunft muss es weisen und unsere Wandlungsfähigkeit dokumentieren.» (S. 362)
Ein Ansatz, der voll und ganz die Unterstützung aller friedliebenden und demokratisch gesinnten Bürger verdient, ganz speziell auch in kleinen Ländern, die sonst allzuleicht zu Erpressungsopfern der Gier von Grossmächten werden könnten. •
Quelle: Daniele Ganser. Europa im Erdölrausch. Die Folgen einer gefährlichen Abhängigkeit. Zürich 2012. ISBN 978-3-280-05474-1.
Energiefrage als Gefahr für die Souveränität der Nationalstaaten
ts. In seinen Kapiteln zur Schweizer Energiegeschichte macht Daniele Ganser deutlich, wie stark ein kleines Land, zumal ohne Ressourcen, auf den Goodwill der Global player und grösserer Staaten angewiesen ist. Im Notfall drehen sie dem Kleinen die Energiezufuhr ab. Es sei denn, der einzelne Nationalstaat, insbesondere der Kleinstaat, setze alles daran, ein grösstmögliches Mass an Energieautarkie zu erreichen. Mit fossiler Energie geht dies sicher nicht. Auch hier hilft nur die Energiewende, hin zu erneuerbaren Energien.
Die erste Erdölkrise von 1973 und die Schweiz
Zur Einordnung der Krise von 1973 gab es in der Schweizer Medienlandschaft, aber auch in der Politik kritische Stimmen zu hören: So las man, dass in erster Linie nicht die Scheichs, sondern die westlichen Konzerne und die USA an einer Ölpreiserhöhung interessiert seien. Die Verknappung sei künstlich geschürt worden. Eine Einschätzung, die sich auch auf den US-Gewerkschaftsführer Charles Levinson stützte.
PdA-Nationalrat Jean Vincent äusserte im Parlament, es gebe überhaupt keine Erdölkrise, sondern nur «kriminelle Praktiken der Erdölmonopole». CVP-NR Edgar Oehler verwies auf eine doppelte Erpressung durch arabische Scheichtümer und die Konzerne, während SP-NR Otto Nauer festhielt, dass die Souveränität eines Landes zur Farce werde angesichts des Preisdiktats der Konzerne. Aber auch die Exekutive äusserte sich. Bundesrat Ernst Brugger räumte im Dezember 1973 Fehleinschätzungen ein und sagte: «Dieser internationale Ölmarkt ist wenig transparent, das ist tatsächlich eine Wissenschaft für sich.» Auch die USA würden das nicht durchschauen, meinte er. (vgl. Ganser, S. 188 ff.)
1978 forderte der Schlussbericht der vom Bundesrat eingesetzten Eidgenössischen Kommission für die Gesamtenergiekonzeption (GEK) unter anderem den Ausbau der erneuerbaren Energien – auch wenn das Hauptgewicht damals noch auf den Ausbau der Atomenergie gelegt wurde. (vgl. Ganser, S. 205 ff.)
Kriegswirtschaftliche Instrumente einsetzen
Beim Ausbruch des Krieges zwischen dem Irak und Iran 1980 wies im September 1980 Bundesrat Fritz Honegger darauf hin, dass die Schliessung der Strasse von Hormuz für Europa und die Schweiz äusserst gefährlich wäre, fiele so doch ein Viertel des westlichen Öls weg. Die Schweiz habe sich vorbereitet und könnte kriegswirtschaftliche Instrumente einsetzen, sprich Rationierungen, Fahrverbote usw.
Die Mahnung des Bundesrates im März 1981, die einseitige Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren, blieb ohne Folgen, brach doch der Ölpreis im November 1985 wider Erwarten drastisch ein, von 32 auf 10 Dollar, da Saudi-Arabien plötzlich wieder viel mehr förderte. (vgl. Ganser, S. 225 ff.)
Nötig ist ein Paradigmenwechsel
«Der Umstieg kann nur gelingen, wenn Energiekonzerne mit Energiesparen Geld verdienen; dafür braucht es einen Paradigmenwechsel, der noch nicht eingesetzt hat.» (Daniele Ganser, S. 333)
Kann das unkonventionelle Erdöl die Lücke füllen? Nein, da EROI negativ!
ts. Der CEO von Shell, Jeroen van der Veer, gestand ein, dass im Jahre 2006 das konventionelle Erdöl den Peak erreicht habe. Aber beim unkonventionellen Öl und Gas, die schwerer zu erschliessen sind, da gebe es noch grosse Reserven. Ganser mag hier keine Entwarnung geben, denn eins müsse man wissen: Aufwand, Kosten und Geschwindigkeit der Förderung von konventionellem und unkonventionellem Öl unterschieden sich wie Tag und Nacht.
Konventionelles Öl könne mit Coca-Cola verglichen werden, das nach etwas Schütteln selbständig aus der Dose spritze. Das unkonventionelle Öl hingegen muss aus grosser Meerestiefe, mehr als 500 Meter unter dem Wasserspiegel, gefördert werden; Teersand, der nicht flüssig ist, muss abgebaggert werden; die Förderung braucht mehr Energie als bei konventionellem Öl. Das heisst, dass sich das Verhältnis Energieaufwand zu Energieertrag verschlechtert. Man spreche von «Energy Return on Investment» oder EROI. Liege der EROI bei Easy Oil bei 1:100 (1 Fass Öl aufwenden, um 100 zu gewinnen), so beträgt der EROI bei unkonventionellem Ölschiefer 1:5 oder sogar 1:2!
Mit anderen Worten, so Ganser: Die Nutzung von unkonventionellem Erdöl hilft nur, den Peak auf der Zeitachse etwas nach hinten zu schieben. Und: Es belastet die Umwelt viel stärker!
Für den Laien verkompliziert sich die Sache, da heute in den Statistiken meist konventionelles und unkonventionelles Erdöl vermischt werden. So unterscheiden sich etwa die Zahlen der OPEC und von BP: die OPEC zeigt den Peak von 2006 bei 70 Mio. Fass pro Tag. BP hingegen verzeichnet einen jährlichen Anstieg auf 83 Mio. Fass pro Tag im Jahre 2011. Des Rätsels Lösung? BP führt alle Erdölprodukte auf, auch unkonventionelle, und beim Verbrauch rechnet BP auch Biotreibstoffe dazu. Ganser verlangt von den grossen Zeitungen, dass sie dies genauer ausweisen sollen, auch die «NZZ» und die «FAZ», die das bisher nicht tun.
Immerhin: Heute bestätigt auch ExxonMobil, dass das konventionelle Öl stagniert, während andere Firmen schon einen Rückgang eingestehen. (vgl. Ganser, S. 266ff.)
Lehren in der Schweiz: Eigenes Erdöl weckt Begehrlichkeiten von Grossmächten
ts. Der CIA-Putsch in Iran im Jahre 1953 wurde auch in der Schweiz aufmerksam verfolgt. So gab SP-Ständerat Emil Klöti zu bedenken, dass der Besitz von eigenem Erdöl nicht ungefährlich sei, denn er wecke Begehrlichkeiten der Grossmächte. Deshalb müsse die Schweiz die Suche nach eigenem Erdöl auch in den eigenen Händen behalten. Und der FDP-Nationalrat Paul Kunz doppelte im März 1953 nach: Eigenes Öl könne die Unabhängigkeit und Neutralität in Gefahr bringen – wegen des Erdöldursts der anderen Länder.
Da in der Schweiz die Kantone die Konzessionen für Erdölsuche vergeben, auf Grund des sogenannten Bergregals, mussten ausländische Konzerne wie Shell im Jahre 1951 bei 17 Kantonen gleichzeitig Konzessionsgesuche einreichen. Als der Kanton Fribourg mit der Firma d’Arcy, einer Tochter von BP, handelseinig werden wollte, lud der Bund aus grosser Sorge am 6.11.1952 die Kantone zu Erdölkonferenz nach Bern ein: Dort gab der Bundesrat bekannt, die Erteilung von Konzessionen an ausländische Konzerne sei eine Gefährdung der äusseren Sicherheit, der Unabhängigkeit und der Neutralität, da BP in der Hand der britischen Marine und damit des Staates Grossbritannien war.
Im Juni 1959 wurde die Swisspetrol Holding AG gegründet, eine Dachgesellschaft mit Schweizer Aktienmehrheit, zur Kontrolle der Erdölforschung in der Schweiz. Aber die seismischen Messungen des Untergrundes des Mittellandes durch eine Tochterfirma von Swisspetrol, die Schweizerische Erdöl AG (SEAG), waren wenig ergiebig. Auch anschliessende Tiefenbohrungen blieben erfolglos, was viele Schweizer Bürger freute, da sie davon ausgingen, dass Öl immer bloss Kriege anzog. (vgl. Ganser, S. 90 ff.)
Die Lage der Schweiz im Zweiten Weltkrieg
«Unsere Lage war mit jener in einer Mäusefalle vergleichbar geworden. Es bedurfte unablässiger handelspolitischer und diplomatischer Anstrengungen, um unser Volk vor dem langsamen Hungertode zu bewahren.»
Aus dem Bericht des Bundesrates zur Lage der Schweiz nach dem Fall Frankreichs im Mai 1940, umzingelt von faschistischen Staaten. (Quelle: Eidgenössisches Volkswirtschaftsdepartement [Hrsg.]: «Die Schweizerische Kriegswirtschaft: 1939–1948». Bern. Eidgenössische Zentralstelle für Kriegswirtschaft, 1950, S. XV)
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : politique internationale, hydrocarbures, pétrole, opep, énergie, politique énergétique, souveraineté |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Réflexions autour d’un petit livre bien fait sur la crise
Réflexions autour d’un petit livre bien fait sur la crise
par Jacques GEORGES
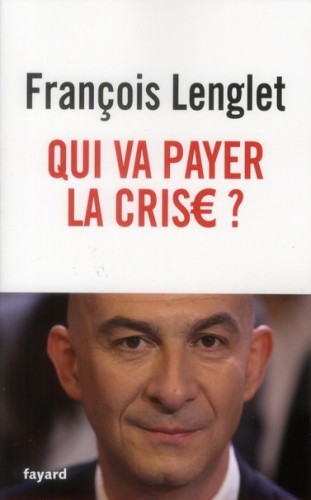 François Lenglet est un journaliste économique compétent, honnête et de bon sens. Arrêtons-nous pour bien peser, car le phénomène ne court pas les rues : entre les spécialistes (ceux qui savent tout sur l’inessentiel et ramènent tout à leurs marottes), les mercenaires (ceux qui vendent leur salade), les demi-savants (ceux qui en savent un peu plus que les autres, sans tout à fait dominer leur sujet), les idéologues (ceux qui ont la réponse avant la question) et les Guignols de l’Info, la place est mince pour ceux qui se contentent de dire simplement, honnêtement, modestement, des choses de bon sens sur des sujets compliqués. Ceci, en ayant des idées. À ce titre, soit dit en passant, François Lenglet, journaliste économiste, est un peu le frère jumeau de Christian Saint-Étienne, économiste communicant.
François Lenglet est un journaliste économique compétent, honnête et de bon sens. Arrêtons-nous pour bien peser, car le phénomène ne court pas les rues : entre les spécialistes (ceux qui savent tout sur l’inessentiel et ramènent tout à leurs marottes), les mercenaires (ceux qui vendent leur salade), les demi-savants (ceux qui en savent un peu plus que les autres, sans tout à fait dominer leur sujet), les idéologues (ceux qui ont la réponse avant la question) et les Guignols de l’Info, la place est mince pour ceux qui se contentent de dire simplement, honnêtement, modestement, des choses de bon sens sur des sujets compliqués. Ceci, en ayant des idées. À ce titre, soit dit en passant, François Lenglet, journaliste économiste, est un peu le frère jumeau de Christian Saint-Étienne, économiste communicant.
François Lenglet vient de commettre un petit livre intitulé Qui va payer la crise ? dans lequel il développe avec des mots simples des idées fortes, qui peuvent plaire ou ne pas plaire, qu’on peut à loisir étiqueter « de droite » ou « de gauche », mais qui en tout cas méritent réflexion. La thèse centrale du livre est assez simple et peut se résumer comme suit :
— la crise de l’euro met aux prises épargnants et contribuables, dissimulant une opposition entre générations et modèles de société,
— le sauvetage de l’euro s’apparente de plus en plus à un désastre annoncé, les pays du Sud s’épuisant comme des hamsters dans leur cage,
— la solution fédéraliste européenne, à base notamment d’euro-bonds, est surtout une échappatoire pour les politiques et une ruse des financiers et donc de leurs commettants épargnants pour différer le règlement de leurs turpitudes; de toute façon, elle ne marche et ne marchera pas à horizon prévisible,
— les souverainistes de gauche ou de droite s’apparentent à des vendeurs de repas gratuits et ne sont au final que des marchands de sable,
— le plus grand risque pour la zone euro, voire pour les pays du Sud eux-mêmes, et la France en tout cas, réside dans la sortie de l’Allemagne et de quelques économies fortes et bien gérées qui en ont les moyens (Finlande…),
— il n’existe aucune solution-miracle, mais seulement une panoplie de remèdes techniques (à fortes implications politiques et sociétales, bien sûr) à organiser et mettre en œuvre de façon pragmatique et aussi juste que possible,
— une ébauche de solution pourrait être la suivante : après avoir organisé au mieux l’inévitable sortie de la Grèce de l’euro, prononcer un moratoire temporaire des dettes donnant aux États et à la société le temps de souffler, en mettant à contribution banques, financiers et épargnants trop épargnés jusqu’à présent.
On peut discuter diagnostic, grille de lecture et esquisses de remèdes, mais on doit reconnaître à cette thèse sa solidité, son honnêteté et sa neutralité idéologique et trans-partisane. Voici quelques réflexions et questions proposées à votre réflexion.
Ce livre vaut d’abord comme dénonciation de l’incompétence technique, des partis-pris idéologiques ou partisans, ou de la simple bêtise des simplificateurs de tous bords : de gauche, bien sûr, puisque c’est souvent leur marque de fabrique, mais de droite dite de conviction aussi : souverainistes et marino-mélenchonnistes gagneraient à s’en inspirer.
Les causes et la genèse de la crise sont décrites à grands traits de façon techniquement solide, mais on aurait aimé en annexe un rappel chronologique détaillé qui aurait ajouté à la solidité de la démonstration.
L’interprétation de la crise comme la résultante d’un conflit de générations entre soixante-huitards, ex-braillards gauchistes devenus rentiers égoïstes forcenés, identifiés de façon paradoxale mais convaincante comme la « génération libérale », et le reste de la société (entrepreneurs et jeunes notamment), est séduisante, et d’ailleurs pas nouvelle (c’est l’une des marottes de l’auteur du présent article depuis 68 ou presque…).
Les remèdes ne sont qu’esquissés (pp. 201 – 202), ce qui est inévitable compte tenu de la complexité du sujet et de la nature de l’ouvrage. Ils tournent tous autour de la notion de moratoire de dettes : prolongation de toutes les échéances de trois ans pour les pays les plus endettés avec suspension des intérêts, rééchelonnement de la dette sur vingt ans, etc. Certaines conséquences sont citées, notamment le rétablissement du contrôle des capitaux et des changes aux frontières de l’Union, mais presque rien n’est dit sur les dépôts bancaires, l’assurance-vie et la veuve de Carpentras. Il est vrai que, sur de tels sujets, on tangente immédiatement l’incitation à la panique bancaire, péché pas du genre de l’auteur, d’ailleurs plus immédiatement nuisible que d’autres incitations pénalement répréhensibles,
In fine, ce livre est un plaidoyer raisonnable pour l’Europe et pour l’euro, expurgé de ses vices de construction les plus rédhibitoires. En tant qu’Européens de destin, dans la lignée des Drieu, des Jünger, voire des Denis de Rougemont, we can live with it.
Jacques Georges
• François Lenglet, Qui va payer la crise ?, Fayard, 2012, 216 p., 11,90 €.
Article printed from Europe Maxima: http://www.europemaxima.com
URL to article: http://www.europemaxima.com/?p=2832
00:05 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie, Livre | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : livre, crise, économie, europe, affaires européennes, crise de l'euro, crise économique |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
Dix preuves que nous vivons dans des économies factices
« Il est temps d’admettre que nous vivons dans une économie factice », écrit le blog américain The Idealist. Les gens réclament des emplois, et les politiciens les leur promettent, mais les politiciens ne peuvent créer d’emplois. Et il ne faut pas compter sur les médias pour nous ouvrir les yeux, tout occupés qu’ils sont à glorifier les ‘people’, parce qu’ils sont riches. Ainsi, la semaine passée, Kim Kardashian a fait la une du Huffington Post parce que son chat est mort, rappelle-t-il.
Il cite 10 autres preuves qui attestent de l’illusion de nos économies :
1/ Les faux emplois. Non seulement les chiffres du chômage sont minimisés artificiellement par les instances gouvernementales, mais 80% des emplois ne produisent aucune valeur. Ils pourraient disparaître demain sans menacer la survie et le bonheur de l’humanité.
2/ Les problèmes créent des emplois, et non des solutions. Nous ne réglerons jamais les problèmes de la drogue, de la violence, des codes des impôts trop complexes, …etc., parce que ces problèmes permettent d’employer des policiers, des percepteurs, des gardiens de prison, des fonctionnaires… En d’autres termes, nous avons besoin de ces problèmes totalement fabriqués pour créer de l’emploi artificiel.
3/ L’argent n’a pas de valeur. L’argent est l’illusion la plus trompeuse. L’argent n’a de la valeur que parce que la loi le décrète. Mais l’argent n’est que du papier avec de l’encre, et sa valeur réelle est nulle. Les seules choses qui aient de la valeur, c’est le travail, les matériaux, la nourriture, l’eau et l’énergie.
4/ Les banques centrales rachètent les dettes des nations. Aux Etats Unis, la Fed prête de l’argent au gouvernement américain qui émet des obligations pour financer ses dépenses. Ces obligations sont ensuite proposées aux investisseurs. Mais en pratique, c’est la Fed qui en rachète près de 90%. C’est ce que l’on appelle la monétisation de la dette. Dans la zone euro, cette monétisation de la dette a aussi lieu lorsque la BCE rachète des obligations souveraines des pays en difficulté, comme Mario Draghi s’est engagé à le faire en juillet de l’année dernière.
Or ceci ne consiste en rien de moins qu’une chaîne de Ponzi. Dans ce système, les taux d’intérêt sont artificiellement maintenus à un bas niveau (s’ils étaient le reflet de la demande réelle des investisseurs pour ces dettes, ils seraient plus élevés).
5/ La détermination de la valeur est faussée. Le mécanisme de fixation des prix est désormais tellement affecté par des variables exogènes qu’il devient difficile de déterminer quelle est la valeur réelle des choses. Les subventions de l’Etat, les taxes, les lois et les règlements, la manipulation des taux d’intérêt, et la spéculation sur les matières premières sont autant de facteurs qui compliquent la valorisation des biens et des services.
6/ L’échec est récompensé. On demande aux citoyens de se serrer la ceinture pour porter secours à des gouvernements, des institutions financières, ou des entreprises. Et lorsque quelqu’un réussit par la force de son travail, il est lourdement imposé pour financer les plans d’aide d’institutions qui se sont mal comporté.
7/ Les organisations privées ont les mêmes droits que les êtres humains, mais pas les mêmes sanctions. Cela devient évident lors de catastrophes industrielles : à quoi aurait été condamné un homme qui aurait provoqué une catastrophe de l’ampleur de celle de la plateforme Deepwater Horizon? Il aurait été jugé comme un tueur psychopathe, et on aurait veillé à ce qu’il ne puisse plus jamais nuire.
8/ Les gens achètent des choses avec de l’argent qu’ils n’ont pas. Malgré l’inflation, le chômage en hausse et l’effondrement des marchés immobiliers, l’achat à crédit ne ralentit pas. Or, rien n’est pire pour une économie que des emprunts adossés à des valeurs dont les retours sur investissement sont négatifs : voitures, cartes de crédit, et prêts étudiants, par exemple.
9/ Les créateurs d’entreprises sont punis. Règlementations abusives, multiplication des considérations écologistes (pas toujours fondées)… Nos économies créent de la dépendance là où il n’y en a pas besoin. La bureaucratie toujours plus lourde entrave les entreprises, quand elles ne les étouffe pas de façon fatale.
10/ L’esclavage moderne. Les banques centrales et les banques commerciales créent de l’argent à partir de rien, et cette création monétaire transforme les gouvernements, les industries et les familles en esclaves. Et même en l’absence d’endettement lié à un crédit, il faut payer des impôts et les effets de l’inflation…
00:05 Publié dans Actualité, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : actualité, économie |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook
dimanche, 06 janvier 2013
Europas verschleierter Bankrott
Es heißt, Europa, und damit wird von vielen meist die EU gemeint, sei, streng genommen, nicht nur geistig und moralisch bankrott. Es müßte deshalb den Konkurs anmelden. Das Wort Versteigerung steht im Raum. An Bietern soll es nicht mangeln.
Eine Überzeichnung vielleicht, aber daß etwas mehr als faul ist, zumindest in dieser Europäischen Union, kann wohl kaum mehr bestritten werden. Aber wäre eigentlich nicht schon Nachwuchsverweigerung – wie in deutschen Landen, auch Österreich, besonders gang und gäbe – ein untrügliches Zeichen für Bankrott?
Und so reagiert die Politik darauf: Sie kratzt das wenig und schummelt sich mit Massen von Einwanderern und fremdem Nachwuchs mehr schlecht als recht durch die Statistik. So wie sich die Regierungen durch Neuverschuldung ihr Überleben in einer verotteten Gesellschaft sichern.
Da flüchten andere, nein, nicht nur in den Konsum oder in märchenhafte Konjunkturprognosen, sondern auch bereits in die Vergangenheit. Sie suchen die „gute alte Zeit“ auf, huldigen einem Historismus dem jegliche vernünftige politische Dimension fehlt.
Dieses Aufsuchen eines neuen Biedermeiers wird aber zur gefährlichen Droge, wenn man sich darin zu sehr suhlt. Wer sich dem „Vollglück in der Beschränkung“ (Jean Paul) zu intensiv hingibt, der könnte am Ende beschränkt in seiner Freiheit daraus hervorgehen. Sozusagen als „politische Nullität (Hegel). Auch sollte dabei eines nicht übersehen werden: man überläßt als Aussteiger das Feld jenen, Politikern z. B., die dieses Europa zu einem Schleuderpreis zu veräußern begonnen haben (Siehe Landnahme durch Konzerne und Einwanderer-Heere). Mit den erkennbaren fatalen Konsequenzen.
Doch die Politik übt sich – angesichts des von ihr angerichteten Desasters - weiter in der Flucht nach vorne, in eine so genannte Verschlimmbesserung. Weist den Weg in eine fragwürdige Zukunft, deren wahrscheinliche bzw. politisch erwünschte Beschaffenheit der Mehrheit verborgen bleiben soll.
Während Einzelne also der Last des überforderten Daseins durch das Eintauchen in eine vergangene Welt zu entrinnen versuchen (sich damit aber ein unsicheres Dereinst einhandeln), nehmen maßgebliche und weniger maßgebliche Politiker, mit genügend Sitzfleisch ausgestattet, die Gegenwart in Beschlag (besonders vor Wahlen oder bei Neujahrsansprachen) um ihre mickrige Macht und Herrlichkeit „mit leerem Schwulst und Schall“ (Vergil) bis an das Ende ihrer Tage sichern zu versuchen.
Von der Gnade der Erinnerung verlassen, unbeeinflußt und unbeeindruckt von einer mehrtausendjährigen Geschichte, ehrfurchtslos vor dem geistigen und kulturellen Erbe und höchstwahrscheinlich ohne Idee von sich selbst, so präsentieren sich die Ausschlachter dieses Europas.
Diese Herrschaften möchten so bald wie möglich am Souverän vorbei einen den transatlantischen und sonstigen raumfremden Interessen entsprechenden und diesen dienlichen zentralistischen Bundesstaat oder ähnlich “Unumkehrbares” errichten. In dem selbst heute oppositionell sich Gebärdende durch klammheimliche Rückversicherung bei Freunden ihr Auskommen zu finden hoffen.
Doch so verheißungsvoll solche Entwürfe und Planungen auch sein mögen, sind sie ja doch nur von der Güte jener von höchsten Stellen besungenen, längst aber hinterfragungswürdigen „europäischen Grundwerte“ wie Demokratie, Menschenrechte usw. Diese sind nachweislich längst das Papier nicht mehr wert, auf dem sie einst gedruckt wurden.
Der Vertrauensschwund gegenüber denen da oben ist infolgedessen an der Wahl-Urne längst amtsbekannt. Was die Verantwortlichen aber erst recht an ihrem Irrweg festhalten läßt. Denn anders als trotzigen Kindern, winkt ihnen auch späterhin hoher Lohn.
Nun wären die laufenden Bittgänge der Regierungen zu internationalen Wucherern, um wenigstens die Zinslasten der Altschulden mit Hilfe neuer Kredite zu bewältigen, schon für sich allein ein abendfüllender Krimi. Auch deshalb, da das tatsächliche Ausmaß der Staatsschulden beinahe überall verschleiert wird .
Aber der Mensch lebt ja bekanntlich nicht vom Brot allein. Deshalb möchte man doch gerne auch einmal einige nicht bloß vom Ökonomischen diktierte Fragen dieses zukünftige neue Europa betreffend beantwortet wissen.
Was ist denn eigentlich dieses vielbeschworene „europäische Volk“, was zeichnet seine Besonderheit aus? Woher will man eine natürlich gewachsene europäische Identität nehmen und welches gemeinsame Geschichtsverständnis soll die Herausbildung einer solchen ermöglichen? Woran erkennt man die neue geistige Gestalt Europas denn?
Aber auch: Wie soll denn die Meinungsfreiheit endlich gewährleistet werden, wenn dieselben, die sie heute einschränken und dem Gesinnungsterror freien Lauf lassen, morgen weiter das Sagen haben werden? Wodurch soll denn die Rechenschaftspflicht, die jetzt schon mit Füßen getreten wird, plötzlich garantiert werden können? Nicht zuletzt, wie will man nach all den Rechtsbrüchen, Skandalen und Drüberfahr-Methoden noch Legitimität und Vertrauen zuerkannt bekommen?
Selbstverständlich wird kein vernünftiger Europäer die Notwendigkeit einer europäischen Einigung und die der viel zitierten Einheit in Vielfalt bestreiten. Aber vielleicht haben die von unterschiedlichen Mentalitäten und Normen, Traditionen und Verhaltensweisen geprägten Völker dieses Kontinents dazu etwas andere Vorstellungen.
Ganz andere wahrscheinlich als selbstherrliche Politiker, Bürokraten und Technokraten oder die eine oder andere „Pressure Group“. Schon die Nationalsozialisten und auch die Kommunisten hatten diese Tatsache außer acht gelassen. Wandeln die EU-Zentralisten nicht auf deren Spuren? Außerdem gilt es abseits von Wachstums- und Gleichheitswahn, von US-Hörigkeit und europäischen Großmachtträumen neben den bekannten ja auch Probleme zu lösen, an denen sieben Jahrzehnte nach WK-II-Ende in einer so genannten Wertegemeinschaft normalerweise kein Endziel versprechender Weg vorbei führen dürfte.
Wer, zum Beispiel, Fragen der Zeitgeschichte weiter nur der Beurteilung von antifaschistisch geeichten Ideologen und politisch korrekten Staatshistorikern überläßt oder nicht geheilte Wunden und weiter bestehendes Unrecht bloß mit blumiger Versöhnungsrhetorik zudeckt, der kann das Unternehmen Neues Europa gleich abbrechen. Dem würde die Geschichte irgendwann ordentlich in die Zügel fallen. Aber wir haben es ja nicht nur mit unerledigten Altlasten zu tun. Man häuft und häuft neue hinzu. Eine der schwerwiegendsten und folgenreichsten zählt ja ebenso zu der bereits erwähnten Tabuzone: Die Überfremdung und deren von der Politik zu verantwortenden Folgen.
Keine Region, keine Großstadt*, die nicht schon dadurch – in einem ausgesprochen negativen Sinne – nachhaltig betroffen wären. Neben schwerwiegenden Sicherheitsproblemen unter anderem auch Raubzüge durch das Sozialsystem und schwere Umweltverwüstungen in Ballungszentren in Milliardenhöhe.
Und um Milliarden geht es auch weiterhin: Zur aktuellen Krise sagt der angesehene Schweizer Finanzexperte Felix W. Zulauf:Die Politik und die EZB brechen alle Regeln und belügen das europäische Volk (das es natürlich noch nicht gibt, Anm.). Früher gab es für die Notenbanken noch disziplinierende Faktoren wie den Goldstandard. Heute werden immer mehr Euro gedruckt – für keine Arbeit. Nur weil die Politik ein Gebäude namens Eurozone zusammenhalten will, bei dem man beim Dach statt bei den Grundmauern zu bauen begonnen hat . Derselbe bezeichnet die EU als ein „Anti-Friedensprojekt“.** Eben zu den erwähnten Grundmauern gehört an erster Stelle aber die Kultur, mit der, wie der längst verstorbene transatlantisch gestimmte Europapolitiker Jean Monnet angeblich einmal gemeint haben soll, er beginnen würde, könnte er das europäische Einigungswerk noch einmal von vorne anfangen.
Kultur - beim Zeus! - wie viele heutige Politiker in ihrem Multikulti-Fimmel haben überhaupt eine Ahnung was das ist, was dazu gehört, wie sich eine solche gründet, zur Hochkultur wird? Offensichtlich zu wenige, sonst stünde nicht eine durch maßlose Gier und Korruption ermöglichte Mißachtung des Souveräns und seiner Kultur auf der Tagesordnung dieser Union.
Als Problemlösung und Ausweg aus ihrem Schlamassel bietet die in Saus und Braus lebende politische Klasse, ob an der Regierung oder nicht, allerdings nichts als Luftschlösser, bewohnt von Lüge und Heuchelei. Wenn, um es mit Albert Camus zu sagen, die Wahrheit bei irgendjemand zu finden ist, dann ganz bestimmt nicht bei Politikern und Parteien, die sie zu besitzen behaupten.
Finden wir in ihren Reihen nicht auch schon einen hochgejubelten deutschen Bundespräsident? In seiner Weihnachtsbotschaft vermeinte dieser wohl Einäugige trotz überbordender Ausländergewalt sagen zu müssen: „Sorge bereitet uns auch die Gewalt in U-Bahnhöfen oder auf Straßen, wo Menschen auch deshalb angegriffen werden, weil sie schwarze Haare und eine dunkle Haut haben.” Wer hätte denn gedacht, daß auch dieser Herr Gauck ein Schelm sein kann.
Keine Frage, auch jedes ausländische Opfer ist eines zu viel, aber daß die überwiegende Mehrheit der Opfer „rassistischer“ Gewalt in der Bundesrepublik Deutschland wie in Österreich oder England weiße „Eingeborene“ und die Gefängnisse in einigen Staaten mit kriminellen Ausländern überfrachtet sind, kann dem allseits hochgelobten deutschen Moralhüter ja nicht entgangen sein.
Übrigens wohl dem Rest der einer abstrakten Menschheitsideologie ergebenen Verantwortungsträger auch nicht, die sich ja schon von politischen Desperados und Scheinasylanten vor sich hertreiben lassen. Ihr Volk und ihre Nation dabei kaltschnäuzig, aber politisch korrekt in Stich lassend. In Berlin wie in Wien oder Brüssel. Unweigerlich kommt einen dabei das eine oder andere in den Sinn. So der Titel des 1962 im Leopold Stocker Verlag in Graz erschienen Buches „Was bleibt“, das eine „Bestandsaufnahme des Wesens, der Wege und Werke des Deutschen“ zum Ziele hatte. Ein Buch das, übrigens, Halbgebildeten und Ignoranten empfohlen werden kann.
Nun wäre aber, nicht ganz nebenbei bemerkt, eine Inventur dessen, was deutsches Wesen noch sei und wohin es noch streben könnte, längst fällig. Eine solche Initiative würde aber, wenn es dazu käme, entweder hämisch angegriffen oder völlig ignoriert werden. Wie an geistiger Immunkrankheit Leidende in solchen Fällen eben reagieren. Doch inzwischen stellt sich ja bereits die ebenso wichtige Frage: Was aber bleibt einmal von Europa, seinem Geist, seinen Menschen und deren jeweils einzigartigen Kultur? Und welche tragende Rolle wird der bodenstämmige Europäer darin überhaupt noch spielen können? Wenn überhaupt.
Die Antworten der politischen Klasse dazu sind völlig unmaßgeblich (und im Voraus bekannt). Wir selbst, als Volk und Europäer, müssen diese Fragen als Eidgenossen des 21. Jahrhunderts beantworten und danach unser Handeln ausrichten. Solange dazu noch Zeit ist.
So wünsche ich auf diesem Wege allen aufrechten Europäern Kraft und Zuversicht für 2013!
*In London, z.B. sind die Weißen bereits eine Minderheit.
**Ich weise noch einmal auf die vorzügliche Schrift „Friedensprojekt oder Europas Untergang“ (Zahlen und Fakten zur EU) des freien Journalisten Klaus Faißner hin. Zu bestellen bei: Klaus Faißner, Postfach 15, A-1133 Wien oder Tel.: 0043/650 7132350 oder k.faissner@gmx.at.
00:09 Publié dans Actualité, Affaires européennes, Economie | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : économie, europe, affaires européennes, politique internationale, euro |  |
|  del.icio.us |
del.icio.us |  |
|  Digg |
Digg | ![]() Facebook
Facebook




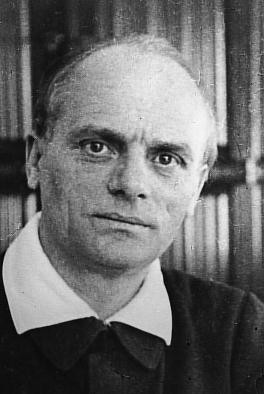 Einer wollte den Führer führen. Nein: Einige wollten den Führer führen und wirkten so im Zeichen des Führers. Ob Heidegger, Rosenberg oder Spann, die Qualität ihrer Beiträge bleibt in diesem Kontext sekundär, wenn auch im Sinne der üblichen Vorwegnahme bei Spann die Betonung auf der philosophischen Stupidität liegen kann. Ihm gelang jedoch die Formierung eines Kreises, der mehr als sechzig Jahre nach seiner eigenen Entfernung von der Universität, der heutigen WU-Wien, das Gewäsch von Ganzheit wiederholt und daneben peinlich bemüht wirkt, keinen runden Geburtstag des Meisters oder seines ersten Schülers, manchmal auch des zweiten oder folgender, zu vergessen und zumeist mit einem Presseartikel, besser mit einem Jubiläumsband zu bedenken.
Einer wollte den Führer führen. Nein: Einige wollten den Führer führen und wirkten so im Zeichen des Führers. Ob Heidegger, Rosenberg oder Spann, die Qualität ihrer Beiträge bleibt in diesem Kontext sekundär, wenn auch im Sinne der üblichen Vorwegnahme bei Spann die Betonung auf der philosophischen Stupidität liegen kann. Ihm gelang jedoch die Formierung eines Kreises, der mehr als sechzig Jahre nach seiner eigenen Entfernung von der Universität, der heutigen WU-Wien, das Gewäsch von Ganzheit wiederholt und daneben peinlich bemüht wirkt, keinen runden Geburtstag des Meisters oder seines ersten Schülers, manchmal auch des zweiten oder folgender, zu vergessen und zumeist mit einem Presseartikel, besser mit einem Jubiläumsband zu bedenken.